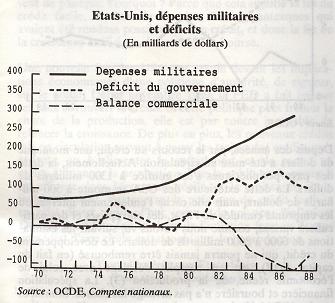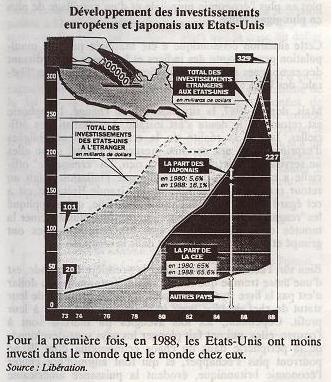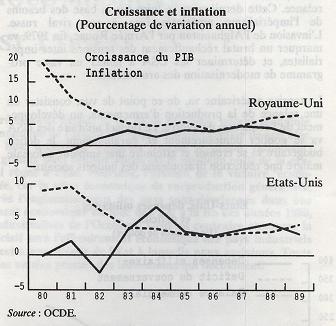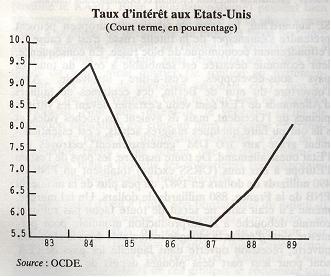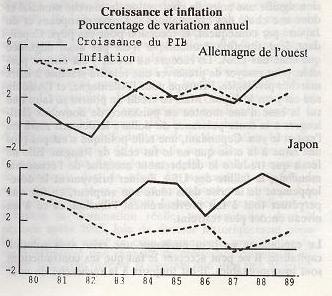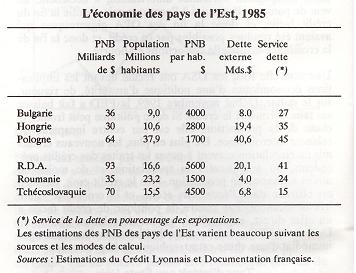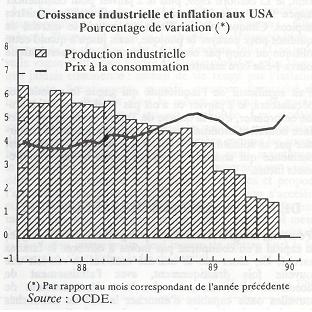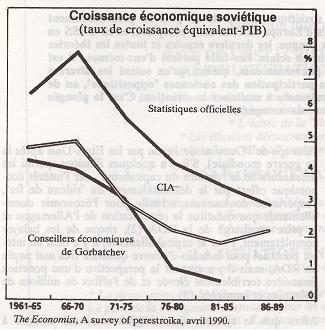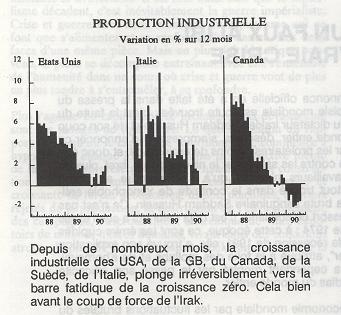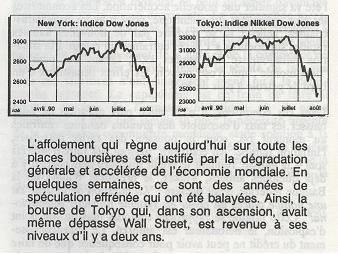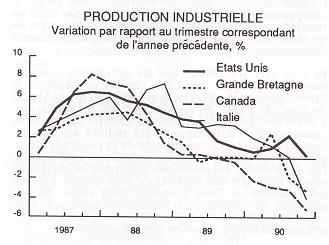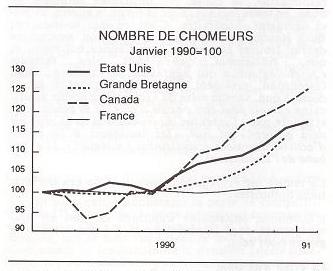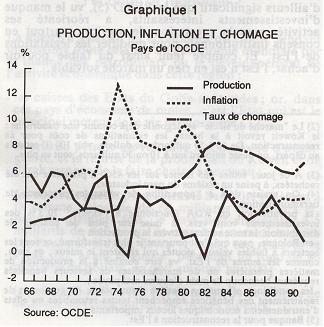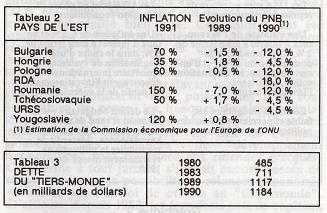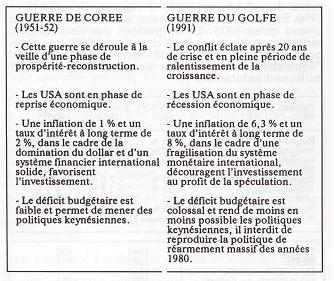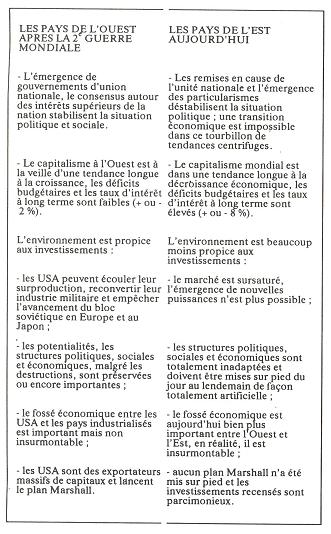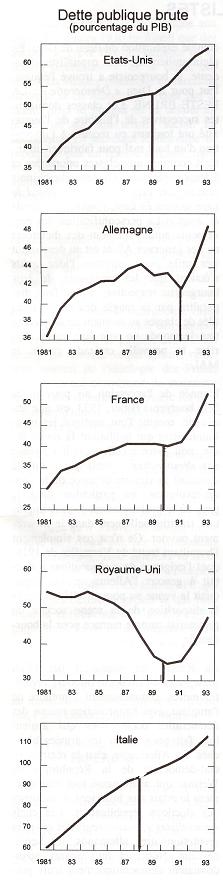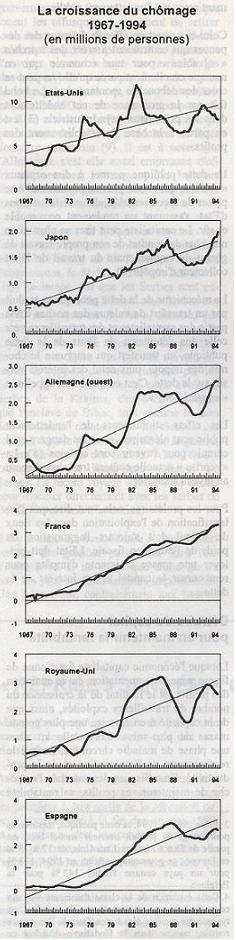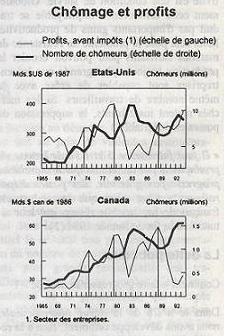Revue Internationale, les années 1990: n°60 - 99
- 4669 reads
La "nouvelle ère de paix et de prospérité" promise par Bush père: la guerre du Golfe, l'effondrement des économies à l'Est, la crise qui continue sur fond de campagnes frénétiques anti-communistes.
Structure du Site:
Sommaires de la Revue Internationale de 1990 à 1999
- 913 reads
N°60 – 1er trimestre 1990
Écroulement du bloc de l’Est : La faillite définitive du stalinisme
- Présentation des thèses
- Crise et faillite du stalinisme sont celles du capitalisme, non du communisme
- Fin du bloc impérialiste russe, fin de Yalta, vers le chaos mondial
- Conséquence pour le prolétariat de la décomposition généralisée du bloc de l’Est
- Perspectives
Thèses sur la crise économique et politique en URSS et dans les pays de l’Est (septembre 1989)
Des difficultés accrues pour le prolétariat
- Le rôle du stalinisme dans la contre-révolution
- L’utilisation par la bourgeoisie de l’effondrement du stalinisme
- Les perspectives pour la lutte de classe
Crise économique mondiale : Après l’Est, l’Ouest
- Face à la récession, la fuite en avant dans l’endettement
- La crise du crédit : les limites d’une politique
- L’effondrement du bloc de l’Est et la déstabilisation de l’économie mondiale
Comprendre la décadence du capitalisme [8e partie]
- La domination réelle du capital ou les réelles confusions du milieu politique prolétarien
- Marx et la transition de la domination formelle à la domination réelle du capital
- Comment les épigones déforment Marx
- 1. Les divagations d’Invariance et des néo-bordiguistes
- 2. La FECCI : centriste comme toujours
- Les frontières changeantes de la domination réelle
N°61 – 2e trimestre 1990
Après l’effondrement du bloc de l’Est, déstabilisation et chaos
- L’URSS s’enfonce dans le chaos
- La crise du capitalisme
- Les antagonismes impérialistes
- Le recul de la conscience dans la classe ouvrière
- Les perspectives pour la lutte de classe
La crise du capitalisme d’État
- L’économie mondiale s’enfonce dans le chaos
- L’éclatement des blocs et la crise du capitalisme d’État
- La plongée des États-Unis dans la récession...
- Annonce un nouvel effondrement de l’économie mondiale
- De nouveaux marchés illusoires
L’expérience russe : Propriété privée et propriété collective
- Introduction du CCI
- L’expérience russe (Internationalisme n°10, Gauche Communiste de France, 1946)
Polémique : Le vent d’Est et la réponse des révolutionnaires
- Le BIPR : un pas en avant, mais combien en arrière
- Bordiguisme, néo-bordiguisme, conseillisme, néo-conseillisme, etc.
- La nouvelle période et la responsabilité des révolutionnaires
Le rapport Fraction/Parti dans la tradition marxiste [2e partie]
- La Gauche Communiste Internationale, 1937-1952
N°62 – 3e trimestre 1990
Pays de l’Est : Crise irréversible, restructuration impossible
- Les pays occidentaux ne renfloueront ni les pays de l’Est, ni l’URSS
- Le délabrement complet de l’économie
- L’échec de la libéralisation
- Les illusions démocratiques et les nationalismes
- Le capitalisme “libéral” occidental à son tour dans la crise
Pays de l’Est : La barbarie nationaliste
- L’explosion nationaliste : la décomposition capitaliste à vif
- Tout nationalisme est impérialiste
- La fausse communauté nationale
La situation en Allemagne (Rapport sur la situation nationale de la section du CCI en Allemagne - mai 1990)
- Le développement de l’économie allemande avant l’union économique et monétaire
- Le plan de la bourgeoisie allemande pour les années 1990 avant l’effondrement de l’Est
- Effondrement de l’Est : les buts de guerre allemands finalement atteints
- La victoire de l’Allemagne victoire à la Pyrrhus
- Les mesures de la bourgeoisie allemande contre le chaos et la décomposition
- L’unification allemande et la possibilité d’une brutale récession
- Le désarroi de la bourgeoisie après la chute du mur
- Lutte de classes : la combativité de la classe reste intacte
- Le retard du prolétariat de RDA
La décomposition, phase ultime de la décadence du capitalisme (Thèses, mai 1990)
Polémique : Face aux bouleversements à l’Est, une avant-garde en retard
- Le retard du milieu politique face à l’importance des événements
- La crise économique à l’origine de l’effondrement du bloc de l’Est : une sous-estimation générale
- Des organisations révolutionnaires incapables d’identifier la lutte de classe
- La faiblesse politique du milieu trouve sa concrétisation dans le poids renforcé du sectarisme
N°63 – 4e trimestre 1990
Golfe persique : Le capitalisme c’est la guerre
- L’invasion du Koweït par L’Irak est un moment de la chute dans Le chaos
- Les USA s’imposent comme seuls capables de jouer le rôle de gendarme au niveau mondial
- L’URSS : une puissance impérialiste de second ordre
- Le nouvel ordre impérialiste : la guerre de tous conte tous
- Le capitalisme précipite L’Humanité dans le gouffre de la barbarie
- La classe ouvrière mondiale est la seule force qui puisse présenter une au perspective
Crise économique : Le pétrole, un faux alibi pour une vraie crise
- Quelle récession ?
- État des lieux avant les événements du Golfe
- Quelles perspectives ?
Résolution sur la situation internationale (juin 1990)
Polémique : Les révolutionnaires face aux émeutes de la faim
- Une expression de la décomposition du capitalisme
- La classe ouvrière face aux émeutes
- “Si le parti existait...”
Mensonges et vérités de l’écologie
- C’est le capitalisme qui pollue la terre
- La pollution idéologique
- Les fausses alternatives des “Verts”
- Le marxisme contre les mystifications des “Verts”
- Seule la révolution prolétarienne peut sauver la planète
N°64 – 1er trimestre 1991
Face à la spirale de la barbarie guerrière, une seule solution : développement de la lutte de classe
- La guerre du Golfe, vers le massacre
- Les résistances des pays développés
- Une seule solution : la lutte de classe
Crise économique : L’économie mondiale au bord du gouffre
- La prospérité des années 80 : le mensonge d’une campagne idéologique de la bourgeoisie
- La fin des illusions : la plongée dans la récession
- L’édifice capitaliste se lézarde : faillites et chômage
- Des dettes qui ne seront jamais remboursées : vers la crise financière
- La fuite en avant dans l’inflation : vers la crise monétaire
Texte d’orientation : Militarisme et décomposition
- Le marxisme est une pensée vivante
- Le militarisme au coeur de la décadence du capitalisme
- Capitalisme d’État et blocs impérialistes
- L’impérialisme dans la phase de décomposition du capitalisme
- La guerre du Golfe : première manifestation de la nouvelle situation mondiale
- La reconstitution de nouveaux blocs n’est pas à l’ordre du jour
- Les États-Unis seul gendarme du monde
- Vers le super-impérialisme ?
- Le prolétariat face à la guerre impérialiste
- L’impact de la guerre sur la conscience dans la classe
Polémique : Le milieu politique prolétarien face à la guerre du Golfe
- Internationalisme et luttes d”indépendance nationale”
- “Défaitisme révolutionnaire” et internationalisme
- Les incompréhensions des enjeux de la guerre
- La sous-estimation de la gravité de la situation actuelle
Milieu politique prolétarien : “Emancipacion Obrera” à la dérive
- Défendre le milieu politique prolétarien, même des attaques de ses amis
- Luttes de résistance et révolution
- Emancipacion Obrera à la dérive
Le rapport Fraction/Parti dans la tradition marxiste [3e partie]
De Marx à Lénine 1818-1917
- 1) De Marx à la Seconde Internationale
Marx, la Ligue des communistes, l’AIT et les leçons de la contre-révolution - La dialectique Fraction/Parti se précise au cours du développement historique du mouvement ouvrier
- Le problème de la Fraction dans la 2e Internationale
Note sur la FECCI : Quand la stupidité atteint des cîmes
N°65 – 2e trimestre 1991
Guerre du Golfe : Massacres et chaos capitalistes. Seule la classe ouvrière internationale peut instaurer un véritable nouvel ordre mondial
La dictature et le totalitarisme du capitalisme
- Après la guerre, ni paix, ni reconstruction : encore la guerre impérialiste
- La guerre contre l’Irak prépare les guerres de demain
Où en est la crise ?
- Crise économique et militarisme
- La guerre permanente dans le capitalisme décadent
- La production d’armements est une destruction de richesses
- La crise pousse le capital à la fuite en avant dans la guerre
- Crise, chaos et guerre
- La récession ouverte frappe de plein fouet
Résolution sur la situation internationale (4 janvier 1991)
Le prolétariat face à la guerre
- Le prolétariat face à la guerre du Golfe : l’enjeu de la situation historique
- La lutte du prolétariat contre la guerre
- Le prolétariat et la guerre au XIXe siècle
- Comment lutter contre la guerre aujourd’hui ?
En hommage à MARC - 1e partie : De la révolution d’octobre 1917 à la deuxième guerre mondiale
- L’engagement dans la lutte révolutionnaire
- Le combat contre la dégénérescence de l’Internationale
- Les grands combats des années 1930
- Face à la guerre impérialiste
Le rapport Fraction/Parti dans la tradition marxiste [3e partie]
- De Marx à Lénine, 1848-1917
- 2) Lénine et les Bolcheviks
- "Sans les Fractions, Lénine lui-même serait resté un rat de bibliothèque"
- De la Fraction bolchevique du POSDR au Parti Communiste Russe
N°66 – 3e trimestre 1991
Éditorial : Le chaos
- Bilan de la guerre du Golfe
- La véritable victoire du capital américain
- L’inévitable enfoncement dans le chaos
- La lutte de classe
Où en est la crise économique ?
- La relance... de la chute de l’économie mondiale
- Les ravages de la récession internationale
- Les mensonges sur l’imminence d’une reprise
L’URSS en miettes
- Le parcours catastrophique du capitalisme russe
- L’effondrement économique s’accélère
- La paralysie de la classe dominante
- Le prolétariat dans la tourmente
- La peur des grandes puissances face à l’éclatement de l’URSS
Les massacres et les crimes des “grandes démocraties”
- Les mensonges et le cynisme de la bourgeoisie pendant et après la guerre du Golfe
- La deuxième guerre mondiale : les crimes et massacres de la “démocratie” et de l’“anti-facisme”
- “Démocratie” et massacres coloniaux
Bilan de 70 années de luttes de "libération nationale" [1e partie]
- La vague révolutionnaire mondiale de 1917-23 affaiblie par le soutien aux mouvements de "libération nationale"
- Une corde au cou de la révolution russe
- La "libération nationale" ne guérit pas des oppressions nationales
- La "libération nationale" précipite les couches non-exploiteuses dans les bras du capital
- La "libération nationale" un facteur de désagrégation de la conscience prolétarienne
En hommage à MARC - 2e partie : De la deuxième guerre mondiale à la période actuelle
- Internationalisme
- Le Courant Communiste International
N°67 – 4e trimestre 1991
Ex-URSS : Ce n’est pas le communisme qui s’effondre, c’est le chaos capitaliste qui s’accélère
- Une révolution populaire ?
- Un combat contre le communisme ?
- Des perspectives de prospérité, liberté et paix ?
- La fin de la lutte de classe ?
Où en est la crise économique ?
- Crime, mensonges et misère
9e congrès du Courant Communiste International
- Présentation : Tâches et responsabilité de l’organisation révolutionnaire
- La nouvelle situation : une rupture historique et le recul de la lutte de classe
- Faire face à l’accélération dramatique de l’histoire
Résolution sur la situation internationale
Rapport sur la situation internationale (extraits)
- La décomposition de la société capitaliste
- L’effondrement du bloc de l’Est
- La nouvelle configuration des conflits impérialistes
- Les rapports de force entre prolétariat et bourgeoisie
Appel au milieu politique prolétarien
N°68 – 1er trimestre 1992
Explosion de L’URSS, massacres en Yougoslavie. Seule la classe ouvrière internationale peut sortir l’humanité de la barbarie
- L’ex-URSS dans le gouffre
- La Yougoslavie : barbarie et antagonismes entre grandes puissances
- La conférence sur le Moyen-Orient : affirmation du leadership des États-Unis
- Aggravation de la crise et attaques contre la classe ouvrière
Crise économique : Crise du crédit, relance impossible, une récession toujours plus profonde
- Le plongeon dans la récession
- Une nouvelle “relance” est impossible
Notes sur l’impérialisme et la décomposition : Vers le plus grand chaos de l’histoire
- Les rivalités entre puissances ne disparaissent pas : elles s’exacerbent
- Le capital américain face au nouvel appétit de ses vassaux
- Vers de nouveaux blocs ?
- Le chaos entrave la constitution de nouveaux blocs
- La dislocation de l’URSS aiguise la contradiction entre le “chacun pour soi” et la confrontation au chaos
Bilan de 70 années de luttes de "libération nationale" [2e partie]
- Au XXe siècle, la "libération nationale", maillon fort de la chaîne impérialiste
- 1919-1945 : derrière la "libération nationale" les manoeuvres impérialistes
- 1945-1989 : la "libération nationale" instrument des blocs impérialistes
- Après 1989 : la "libération nationale" fer de lance du chaos
Le communisme n’est pas un bel idéal mais une nécessité matérielle [1e partie]
- Du communisme primitif au socialisme de l’utopie
- Le communisme avant le prolétariat
- La société de classes, une étape passagère dans l’histoire de l’humanité
- Le communisme en tant que rêve des opprimés
- Les premiers mouvements du prolétariat
N°69 – 2e trimestre 1992
Éditorial - Guerres, barbarie, lutte de classe
Guerre commerciale : L’engrenage infernal de la concurrence capitaliste
La plus grave crise de l’histoire du capitalisme : L’éclatante vérification du marxisme
Bilan de 70 années de luttes de "libération nationale" [3e partie]
- Des nations mort-nées
- Le contexte dans lequel sont nées les "nouvelles nations" : la décadence du capitalisme
- Guerre et impérialisme aggravent le retard et le sous-développement
- Un bilan catastrophique
- Les premières victimes de la décomposition mondiale du capitalisme
- L’explosion des États
- L’effondrement de l’armée
- La paralysie générale de l’appareil économique
- L’humanité n’a pas besoin de nouvelles frontières, mais de l’abolition de toutes les frontières
Le communisme n’est pas un bel idéal mais une nécessité matérielle [2e partie]
- Comment le prolétariat à gagné Marx au communisme
- Le prolétariat, classe communiste
- "Les philosophes n’ont fait qu’interpréter le monde, ce qui importe c’est de le transformer"
N°70 – 3e trimestre 1992
Face au chaos et aux massacres, seule la classe ouvrière peut apporter une réponse
Crise économique mondiale : Une récession pas comme les autres
Résolution sur la situation internationale : Le développement des conditions d’un resurgissement de la lutte de classe
1492 : "Découverte de L’Amérique" La bourgeoisie fête 500 ans de capitalisme
- Une découverte rendue possible par le développement du capitalisme
- Colonisation de l’Amérique : la barbarie capitaliste à l’oeuvre
- En Europe, le capitalisme s’impose avec la même violence
- Un demi-millénaire après Colomb : le capitalisme dans sa crise de décadence
Le communisme n’est pas un bel idéal mais une nécessité matérielle [3e partie]
- L’aliénation du travail constitue la prémisse de son émancipation
- Sur les buts supérieurs du communisme
- Les "Manuscrits économiques et philosophiques" et la continuité de la pensée de Marx
- Le concept d’aliénation : du mythe à la science
- Les quatre facettes de l’aliénation
- L’aliénation du travail est la prémisse de son émancipation
A quoi sert la "Fraction Externe du CCI" ?
- De l’irresponsabilité politique au vide théorique
N°71 – 4e trimestre 1992
La crise monétaire sanctionne l’effondrement du capitalisme
- La classe ouvrière paye la note, en Italie elle commence à répondre (supplément encarté)
Derrière les opérations "humanitaires", les grandes puissances font la guerre
Crise économique mondiale : Catastrophe au coeur du monde industrialisé
La révolution d’octobre 1917 : Oeuvre collective du prolétariat [1e partie]
- La première révolution massive et consciente de I ‘histoire
- La révolution russe fer de lance du mouvement international du prolétariat contre la guerre mondiale
- Un mouvement de masse
- Un mouvement conscient
- Le prolétariat, seule classe révolutionnaire
- Les soviets
Documents de la Gauche communiste
- Présentation
- L’écrasement du prolétariat allemand et l’avènement du fascisme (Extrait d'un article de Bilan, mars 1935)
- Sous le signe du 14 juillet (Extrait d’un article de Bilan N°21, juillet 1935)
Le communisme n’est pas un bel idéal mais une nécessité matérielle [4e partie]
- Le communisme : Véritable commencement de la société humaine
- La production communiste en tant que réalisation de la nature sociale de l’homme
- Dépasser la division du travail
- L’émancipation des sens
- Au-delà du moi atomisé
- Les branches d’un arbre de la terre
N°72 - 1” trimestre 1993
Situation internationale : Un tournant
- Chaos, mensonges et guerre impérialiste
- Somalie un prélude à des interventions plus difficiles
- Clinton : une politique plus musclée
- L’ "Europe de 1993" avortée
- La multiplication des "conflits locaux"
- Guerre et crise
- Vers une reprise des luttes de la classe ouvrière
Crise économique mondiale : Un peu plus d’État
La révolution d’octobre 1917 : Oeuvre collective du prolétariat [2e partie]
- La prise du pouvoir par les soviets
- Le sabotage bourgeois des soviets
- Le rôle du parti bolchevique
- L’insurrection, oeuvre des soviets
Le communisme n’est pas un bel idéal mais une nécessité matérielle [5e partie]
- 1848 : Le communisme comme programme politique
- Le mouvement réel de l’histoire
- L’élaboration du programme : la formation de la Ligue des communistes
- Le Manifeste communiste
Milieu politique prolétarien
- Comprendre le développement du chaos et de conflits impérialistes
- Les zigzags du milieu politique prolétarien
- Le cours historique
- Décadence et nature des guerres
Nationalisme et antifascisme :
- Présentation, Marxisme et nation
- Extraits du livre du révolutionnaire grec A. Stinas Mémoires d’un révolutionnaire
N°73 – 2e trimestre 1993
Le nouveau désordre mondial du capitalisme
- La décomposition du capitalisme pousse aux guerres et aux conflits locaux
- Les antagonismes impérialistes exacerbent les conflits locaux
- En Yougoslavie, les difficultés croissantes de l’impérialisme américain pour imposer son leadership sur les autres puissances
- L’impérialisme mène aux affrontements militaires
- La décomposition et les rivalités impérialistes accrues sont le produit de l’impasse économique du capitalisme
Le réveil de la combativité ouvrière
Le capitalisme allemand à bout de souffle
- Extrait d’un rapport de Weltrevolution sur la situation en Allemagne
L’impossible unité de l’Europe
- L’impossibilité d’une nouvelle nation viable dans la décadence du capitalisme
- L’Europe : instrument de l’impérialisme américain
- Le terrain de la lutte d’influence des grands impérialismes
- Un terrain propice aux campagnes idéologiques contre la classe ouvrière
Qui peut changer le monde ? [1e partie]
- Le prolétariat est bien la classe révolutionnaire
Le communisme n’est pas un bel idéal mais une nécessité matérielle [6e partie]
- Les révolutions de 1848 : la perspective communiste se clarifie
- La révolution bourgeoise et le spectre du prolétariat
- L’intervention de la Ligue des Communistes
- Leçons de la défaite : la nécessité de l’autonomie du prolétariat
- La révolution permanente : de façon permanente non-réalisée.
- Clarification de la perspective communiste : le concept de décadence
N°74 - 3e trimestre 1993
Bas les masques !
- Bosnie : le mensonge d’un capitalisme pacifiste et humanitaire
- Crise économique : le mensonge de la reprise
- La vérité de la lutte de classe face aux mensonges de la bourgeoisie
10e congrès du Courant Communiste International :
- Présentation
- Résolution sur la situation internationale
Qui peut changer le monde ? [2e partie]
- Le prolétariat est toujours la classe révolutionnaire
Vingt-cinq ans après mai 1968
- Que reste-t-il de mai 1968 ?
- Présentation de l’article suivant :
- Comprendre mai (Réédition d’un article de Révolution Internationale n°2 - ancienne série, février 1969)
N°75 – 4e trimestre 1993
Contre le chômage massif, ripostons par des luttes massives
Derrière les accords de paix, toujours la guerre impérialiste
Où en est la crise économique ? Une économie rongée par la décomposition
- Le développement sans précédent de la spéculation, des trafics et de la corruption
- L’obligation de tricher avec ses propres lois
- Tendance croissante au "chacun pour soi"
- Un avenir de destruction, de chômage, de misère
Les luttes ouvrières en Italie 1943
La révolution d’octobre 1917 : Oeuvre collective du prolétariat [3e partie]
- L ‘isolement, c’est la mort de la révolution
- La révolution en Russie a lutté de toutes ses forces pour s’étendre à d’autres pays
- L’encerclement capitaliste de la révolution russe
- La réaction intérieure
- L’asphyxie économique
- La question paysanne
- L’épuisement des Conseils ouvriers
Le communisme n’est pas un bel idéal mais une nécessité matérielle [7e partie]
- L ‘étude du capital et des fondements du communisme
- 1. L’histoire en toile de fond
N°76 – 1er trimestre 1994
La difficile reprise de la lutte de classe
"Reprise économique", accords du GATT : Les mystifications d’une solution capitaliste à la crise
Comment est organisée la bourgeoisie ? Le mensonge de l'État "démocratique" [1e partie]
- Au 19e siècle : une démocratie bourgeoise à l’usage exclusif des bourgeois
- Au 20e siècle : un fonctionnement « démocratique » vidé de tout contenu
- Le totalitarisme "démocratique" contre la classe ouvrière
- L’envers du décor de l’État "démocratique"
Polémique avec le BIPR : Tirer les leçons des expériences négatives
- L’"Appel" du CCI
- Des petits pas
- La nécessité d’une méthode
- Les Conférences internationales de la Gauche communiste
- Le Bureau international pour le Parti révolutionnaire
- Le BIPR en Inde
- Le BIPR dans l’ex-bloc de l’est
- Un nouveau début..., ou encore un peu plus du même acabit ?
- Quel chemin pour l’avenir ?
Le communisme n’est pas un bel idéal mais une nécessité matérielle [7e partie]
- L’étude du capital et des fondements du communisme
- 2. Le renversement du fétichisme de la marchandise
N°77 - 2 trimestre 1994
Les grandes puissances impérialistes sont les fauteurs de guerre dans l’ex-Yougoslavie, tout comme dans le reste du monde
L’explosion du chômage
Comment est organisée la bourgeoisie ? Le mensonge de l‘État "démocratique" [2e partie] : l’exemple des rouages secrets de l’État italien
- La Mafia : au coeur de l’État et de la stratégie impérialiste
- Le réseau "Gladio" : une structure de manipulation pour les intérêts stratégiques du bloc
- La "stratégie de la tension" : la provocation comme méthode de gouvernement
- La Loge P2 : le "Véritable pouvoir occulte de l’État"
- Quelques leçons
La bourgeoisie mexicaine dans l’histoire de l’impérialisme
- Reprise d’un article de « Revolucion Mundial » N°16
- La soi-disant "Révolution mexicaine" ou d’où vient la "fidélité" de la bourgeoisie mexicaine ?
- La main des grandes puissances dans la guerre du Mexique
- La guerre des "cristeros"
- La parenthèse du bloc impérialiste stalinien
- Le Mexique, "toujours fidèle" ?
- Le prolétariat doit-il prendre parti pour une des fractions bourgeoises ?
Polémique avec Programme Communiste
- Le rejet de la notion de décadence conduit à la démobilisation du prolétariat face à la guerre [1e partie]
Le communisme n’est pas un bel idéal mais une nécessité matérielle [8e partie]
- 1871 : la première révolution prolétarienne
- Le communisme : une société sans État
- La Première Internationale, de nouveau la lutte politique.
- La Commune et la conception matérialiste de l’histoire
- Marx contre l’adoration de l’État
- L’armement des ouvriers
- Le démantèlement de la bureaucratie par la démocratie ouvrière
- Du semi-État à la suppression de l’État
- De la Commune au communisme, la question de la transformation sociale
- La classe ouvrière en tant qu’avant-garde des opprimés
- L’État comme "mal nécessaire"
- De la guerre nationale à la guerre de classe
N°78 – 3e trimestre 1994
Édito : Rwanda, Yémen, Bosnie, Corée : Derrière les mensonges de « paix », la barbarie capitaliste
L’étude de l’OCDE sur l’emploi : Le cynisme de la bourgeoisie décadente
Vers une nouvelle tourmente financière
Les commémorations de 1944 : 50 ans de mensonges impérialistes [1e partie]
- La victoire d’Hitler
- La marche à la guerre impérialiste
- L’union nationale pendant la guerre
- La destruction massive du prolétariat
Polémique avec « Programme Communiste »
- Le rejet de la notion de décadence conduit à la démobilisation du prolétariat face à la guerre [8e partie]
Le communisme n’est pas un bel idéal mais une nécessité matérielle [9e partie]
- Le communisme contre le « socialisme d’État »
- Le socialisme d’État est un capitalisme d’État
- « Le socialisme allemand »
- Réforme ou révolution
- La dictature du prolétariat contre l’« État du peuple »
- La critique du ‘substitutionisme’
- Le contenu économique de la transformation communiste
N°79 - 3e trimestre 1994
Édito : Les grandes puissances répandent le chaos
Les commémorations de 1944 : 50 ans de mensonges impérialistes [1e partie]
- 1. L’avant-guerre
- 2. Pendant la guerre
- 3. Vers la « Libération »
- L’action des minorités révolutionnaires
- Quels enseignements pour les révolutionnaires ?
La Gauche Communiste de France en 1944
- Présentation
Tract d’août 1944
Article de « L’Etincelle » août 1944
La conception du BIPR de la décadence du capitalisme
- La guerre impérialiste est-elle une solution à la crise des cycles d’accumulation du capitalisme ?
- La nature de la guerre impérialiste
- La nature de la reconstruction après la 2e guerre mondiale
- Le rapport entre la guerre impérialiste et la crise capitaliste
- La nature des « cycles d’accumulation » dans la décadence du capitalisme
Le communisme n’est pas un bel idéal mais une nécessité matérielle [10e partie]
- Anarchisme ou communisme ?
- Le noyau petit-bourgeois de l’anarchisme
- L’organisation prolétarienne contre les intrigues de la petite- bourgeoisie
- Le matérialisme historique contre l’idéalisme a-historique
- La lutte politique contre 'l’‘indifférentisme’ politique
- La société future : la vision artisanale de l’anarchisme
N°80 – 1er trimestre 1995
Édito : Conflits impérialistes : Tous contre tous
Crise économique : une « reprise » sans emplois
La Première et la Deuxième Internationale devant le problème de la guerre «Bilan » N°21, juillet-août 1935
Enseignements de 1917-23 : La première vague révolutionnaire du prolétariat mondial
- La vague révolutionnaire met un terme à la Première Guerre mondiale
- Le caractère international de la classe ouvrière et de sa révolution
- La guerre ne crée pas les conditions les plus favorables à la révolution
- Le rôle décisif des principales concentrations ouvrières
La deuxième mort de l’« Internationale Situationniste »
Construction de l’organisation révolutionnaire
- Les 20 ans du Courant Communiste International
- La constitution d’un pôle de regroupement international
- La « préhistoire » du CCI
- Les dix premières années : la consolidation du pôle international
- Les principales leçons des dix premières années. L’épreuve du feu.
- Être partie prenante des combats de classe
- Comprendre la nature des événements de 1989
- Le cadre de compréhension de la période présente du capitalisme
N°81 - 2e trimestre 1995
Édito : Guerre et mensonges de la « démocratie »
Tourmente financière : La folie ?
Révolution allemande [1e partie] - Les révolutionnaires en Allemagne pendant la première guerre mondiale
- Les révolutionnaires et leur lutte contre la guerre
- La réaction des révolutionnaires au niveau international
- Le rapport de forces est ébranlé
- La Révolution russe, début de la vague révolutionnaire
- L’intervention des révolutionnaires
- Les luttes de janvier : le SPD, fer de lance de la bourgeoisie contre la classe ouvrière
- La fin de la guerre permise par l’action des révolutionnaires
Chine 1928-1949 : Maillon de la guerre impérialiste [1e partie]
- La IIème Internationale et la révolution en Chine
- La « Révolution » de 1911 et le Kuomintang
- Le Parti communiste de Chine à la croisée des chemins
- La classe ouvrière se soulève
- Le mouvement du 30 mai
- Le coup de force et l’expédition au nord de Chang Kai-chek
- L’insurrection de Shanghai
- La bourgeoisie « révolutionnaire » massacre le prolétariat
Le communisme n’est pas un bel idéal mais une nécessité matérielle [11e partie]
- Marx de la maturité: communisme du passé, communisme de l’avenir
- La propriété privée
- L’État et la famille ne sont pas éternels
- La dialectique de l’histoire : Marx contre Engels ?
- Marxisme et question coloniale
- La question russe et la perspective communiste
N°82 – 3e trimestre 1995
Aggravation de la guerre en ex-Yougoslavie : Plus les puissances parlent de paix, plus elles sèment la guerre
- La mascarade des otages
- La signification de la constitution de la Force de Réaction Rapide
- Vers l’extension et l’intensification de la barbarie guerrière
- La guerre comme facteur de prise de conscience du prolétariat
9e congrès du Courant Communiste International - Le combat pour la défense et la construction de l’organisation
- Les problèmes organisationnels dans l’histoire du mouvement ouvrier et dans l’histoire du CCI
- Les problèmes affrontés par le CCI dans la dernière période
- Le redressement du CCI
- Les perspectives de la situation internationale
Résolution sur la situation internationale
Révolution allemande [2e partie] - Les débuts de la révolution
- Les événements du 9 novembre
- La question de la prise du pouvoir par la classe ouvrière
- La bourgeoisie l’arme au pied
- Les deux armes du capital pour assumer le sabotage politique
- La répression
- L’intervention des révolutionnaires
- Les Conseils ouvriers, fer de lance de la révolution
- Le sabotage de la bourgeoisie
- Le congrès national des Conseils
- Le sang de la révolution, c’est l’activité des masses
- L’oeuvre révolutionnaire ne peut se réaliser qu’internationalement
- La bourgeoisie a tiré les leçons de la Russie
- Le poids du passé
Réponse au BIPR [1e partie]
- La nature de la guerre impérialiste
N°83 – 4e trimestre 1995
Ex-Yougoslavie : Un nouveau cran dans l’escalade guerrière
Hiroshima, Nagasaki, ou les mensonges de la bourgeoisie
Friedrich Engels : Il y a cent ans disparaissait un « grand forgeron du socialisme »
Révolution allemande [3e partie] - L ‘insurrection prématurée
- Les provocations militaires des 6 et 24 décembre 1918
- Le SPD appelle au meurtre des communistes
- Le piège de l’insurrection prématurée à Berlin
- L’insurrection est-elle l’affaire du parti ?
- L’insurrection s’appuie sur l’élan révolutionnaire de la classe
- Le rôle des communistes est central
- Le drame des luttes dispersées
- La république des Conseils de Bavière en avril 1919
Réponse au BIPR [2e partie]
- Les théories sur la crise historique du capitalisme
Parasitisme politique : Le « CBG » fait le travail de la bourgeoisie
- Un problème de tout le milieu politique prolétarien
- L’attaque du parasitisme contre le camp prolétarien
- La nature du parasitisme.
- La trajectoire du « CBG »
- Une haine aveugle et impuissante
- Le parasitisme : fer de lance contre les forces prolétariennes
N°84 – 1er trimestre 1996
Grèves en France : Lutter derrière les syndicats mène à la défaite
- La bourgeoisie utilise et renforce les difficultés de la classe ouvrière
- Un piège tendu aux ouvriers
- Une attaque politique contre la classe ouvrière
- Les véritables leçons à tirer de ces événements
Derrière les accords de paix, la guerre de tous contre tous
Chine 1928-1949 : maillon de la guerre impérialiste [2e partie]
- La liquidation du parti prolétarien
- L’« Armée rouge » et les nouveaux « Seigneurs de la guerre »
- La paysannerie chinoise est-elle une classe spéciale ?
- Les conflits impérialistes
- La «Longue marche »... vers la guerre impérialiste
- L’alliance du PCC et du Kuomintang
- Bilan : une lueur dans la nuit de la contre-révolution
- 1937-1949 : avec l’URSS ou les États-Unis ?
Questions d’organisation [1e partie]
- La Première Internationale et la lutte contre le sectarisme
- La signification historique de la lutte du marxisme contre l’anarchisme organisationnel
- Une lutte à mort entre positions organisationnelles
- Sans organisation révolutionnaire, pas de mouvement ouvrier révolutionnaire
- La lutte à propos des statuts
- La fraternité secrète de Bakounine
- Le “bakouninisme” s’oppose à la rupture du prolétariat avec le sectarisme petit-bourgeois
- Les débats organisationnels sur la question de la conspiration
- Les premiers principes organisationnels prolétariens
- La politique de conspiration
- Bakounine en Italie
- Les sociétés secrètes comme véhicules de révolte
- Un milieu manipulé par la réaction
- Bakounine « découvre » l’internationale
- La « Ligue pour la paix et la liberté »
Le communisme n’est pas un bel idéal mais une nécessité matérielle [12e partie] - 1883-1895, les partis social-démocrates font avancer la cause du communisme
- La définition du socialisme par Engels
- Encore une fois, le socialisme contre le capitalisme d’État
- « Le socialisme révolutionnaire international »
N°85 - 2e trimestre 1996
La progression inexorable du chaos et du militarisme
- Le succès de La contre-offensive des États-Unis
- Là où la première puissance mondiale se heurte au « chacun pour soi »
- L’alliance franco-allemande à l’épreuve
Le retour en force des syndicats contre la classe ouvrière
- L’importance de ce qui s’est passé en France à la fin 1995
- La manoeuvre de la bourgeoisie contre la classe ouvrière
- Les incompréhensions du milieu révolutionnaire
- La nécessité d’un cadre d’analyse historique
Révolution allemande [4e partie] - Fraction ou nouveau parti ?
- Le travail de fraction
- Les différents courants au sein du mouvement ouvrier
- L’intervention vis à vis du centrisme : la clarté politique d’abord, avant l’unité
Questions d’organisation [2e partie]
- La lutte de la Première Internationale contre l’« Alliance » de Bakounine
- La bourgeoisie se sent menacée par l’AIT
- Après la Commune de Paris : la bourgeoisie essaie de briser et de discréditer l’AIT
- La bourgeoisie favorise le travail de sabotage de Bakounine
- La lutte pour le contrôle de la fédération suisse romande
- La Conférence de Londres de 1871
- L’Alliance en Russie : une provocation dans l’intérêt de la réaction
Le communisme n’est pas un bel idéal mais une nécessité matérielle [13e partie] - La transformation des rapports sociaux selon les révolutionnaires de la fin du siècle
- Bebel et la « question de la femme » ou le marxisme contre le féminisme
- Le paysage du futur : le faux radicalisme en vert
- La dialectique universelle
- La civilisation, mais pas telle qu’on la connaît
- La perversion stalinienne
N°86 – 3e trimestre 1996
Le prolétariat ne doit pas sous-estimer son ennemi de classe
- Les analyses des groupes communistes
- Les divagations du Prolétaire
- La question syndicale, talon d’Achille du PCI et du bordiguisme
- La sous-estimation de l’ennemi de classe
- Les manoeuvres syndicales en Allemagne, nouvel exemple de la stratégie de la bourgeoisie
- Le caractère mondial des manoeuvres de la bourgeoisie
12e congrès de Révolution Internationale : La défense de l’organisation
- Une attaque sans précédent de la classe bourgeoise contre le prolétariat
- L’attaque du parasitisme contre le milieu politique prolétarien et contre le CCI
- L’armement organisationnel du CCI
Résolution sur la situation internationale (avril 1996)
Révolution allemande [5e partie] - Du travail de fraction à la fondation du KPD
- L’échec de la tentative de fondation du parti par les Linksradikale
- L’intervention des Spartakistes dans les luttes révolutionnaires
- La fondation du KPD
- La question organisationnelle au congrès
- Les faiblesses sur les questions organisationnelles
- Le marxiste en minorité sur la question organisationnelle
- Le poids du passé
- La construction du parti ne peut réussir qu’internationalement
Polémique avec le PCI (Battaglia Comunista) - Derrière la « mondialisation » de l’économie, l’aggravation de la crise du capitalisme
- La « mondialisation », une attaque idéologique contre la classe ouvrière.
- Les contradictions de Battaglia Comunista face à la « mondialisation ».
- La « mondialisation » et l’État national.
- « Mondialisation » et capitalisme d’État
Le communisme n’est pas un bel idéal mais une nécessité matérielle [14e partie] - La transformation du travail selon les révolutionnaires de la fin du 19e siècle
- Le communisme n’est pas l’« anti-travail »
- L’espoir de repos
- L’espoir de plaisir dans le travail lui-même
- Un point de vue utopique ?
Encart :
- William Morris, militant révolutionnaire (Extrait de World Revolution n°195)
N°87 – 4ième trimestre 1996
Édito - Conflits impérialistes : Triomphe « du chacun pour soi » et crise du leadership américain
- La première puissance mondiale contestée dans son fief.
- Le leadership des USA malmené sur la scène mondiale.
- La disparition des blocs impérialistes et le triomphe du chacun pour soi1
4- Crise économique
- Une économie de casino
- Une situation économique de plus en plus dégradée.
- Un capitalisme drogué qui engendre une économie de casino.
- Le capitalisme dans l’impasse
7- Mouvement ouvrier
- Le marxisme coutre la franc-maçonnerie
- La première internationale contre le sociétés secrètes.
- Le combat contre le mysticisme dans la deuxième internationale.
- La Troisième internationale contre la franc-maçonnerie.
- Le développement vertigineux des sociétés secrètes dans la décadence du capitaliste.
- Un appareil contre-révolutionnaire parallèle.
- Le réseau contre la révolution prolétarienne.
- La défense de l’organisation révolutionnaire.
- Après 68: la renaissance des manipulations occultes contre le prolétariat
13- Questions d’organisation, III
- Le congrès de La Hayes de 1872 la lutte contre le parasitisme politique
- La tâche des révolutionnaires après la Commune de Paris.
- La complicité du parasitisme et de la classe dominante.
- Les délégués contre Bakounine.
- La question des mandats.
- La question des finances, le « le nerf de la guerre ».
- La défense du Conseil Général au coeur de la défense de l’Internationale.
- L’enquête sur l’Alliance.
- Le front parasitaire contre l’Internationale
20- Réponse à la CWO
- Une politique de regroupement sans boussole.
- Lettre de la CWO à World Revolution.
- Réponse à la CWO.
- La fondation incomplète de la CWO.
- La CWO, les Conférences internationales et le BIPR.
- La formation du BIPR.
- La tentative de regroupement de la CWO avec le CBG.
- Les conséquences de l’aventure avec le CBG.
- La CWO et le CCI
N°88 – 1er trimestre 1997
Édito : Lutte de classe : La bourgeoisie multiplie les obstacles.
- La stratégie de la bourgeoisie contre la reprise des luttes.
- Malgré les obstacles, la reprise des luttes se confirme
4- Campagne contre le « négationnisme »
- L’antifascisme justifie la barbarie.
- L’Étincelle N°6, Juin 1945 : ‘Buchenwald, Maidanek’, démagogie macabre
5- Rivalités impérialistes.
- L’« humanitaire » au service de la guerre.
- Moyen-Orient : le « chacun pour soi » et la crise de leadership américain.
- Zaïre : l’offensive américaine contre l’impérialisme français
8- Crise économique.
- Pays de l'EST : des nouveaux marchés mort-nés
- L'écroulement du stalinisme : expression de la faillite du capitalisme.
- Vers des lendemains qui chantent ou vers la tiers-mondialisation ?
- Vers la paupérisation absolue
11- Révolution allemande, VI.
- L'échec de la construction de l'organisation
- 1919 : suite a la répression, le KPD est absent des luttes
- Le 2ème congrès du KPD d'octobre 1919: de la confusion politique à la dispersion organisationnelle
- Toute rupture ne peut avoir lieu que sur des bases claires
- Les positions programmatiques fausses ouvrent la porte à l'opportunisme
- La bourgeoisie favorise l'éclatement du parti
15- Question d'organisation, IV.
- La lutte du marxisme contre l'aventurisme politique
- L'importance historique de l'analyse de la 1re internationale sur Bakounine
- Les déclassés : des ennemis des organisations prolétariennes
- Les déclassés en politique : un terrain fertile pour la provocation
- Les aventuriers une arme terrible contre le mouvement ouvrier
- Le projet de Bakounine est Bakounine lui-même
- Bakounine cherche à gagner les classes dominantes à ses propres ambitions
- La déloyauté envers toutes les classes haïes de la société
- L'essence de l'aventurisme politique
- L'aventurier et le mouvement marxiste
20- Le communisme n'est pas un bel idéal mais une nécessité matérielle, XIV.
- 1895‑1905 : la perspective révolutionnaire obscurcie par les illusions parlementaires
- L'hydre réformiste relève la tête
- Les erreurs d'Engels et la critique de Luxemburg
- Kautsky : l'erreur devient l'orthodoxie
- La conquête de l'économie capitaliste
N° 89 - 2e trimestre 1997
Édito : Tensions impérialistes : La montée de l’impérialisme allemand
- L'Allemagne sape les accords de Dayton et défie les États-unis
- L'offensive allemande dans les Balkans
- Les enjeux stratégiques de ces conflits
- La rivalité germano-américaine en Europe de l'Est
- La montée de l'Allemagne et la crise de la politique européenne de la France
- L'exacerbation des tensions militaires
3- Crise économique
- Les « dragons » asiatiques s’essoufflent
- Le « tiers-monde » dans la décadence du capitalisme
- Pourquoi le développement du Sud-est asiatique après la seconde guerre mondiale
- Les difficultés actuelles dans le Sud-est asiatique
7- Campagnes contre le « négationnisme »
- La co-responsabilité des « Alliés » et des « Nazis » dans l’« Holocauste »
- Le fascisme a été voulu et soutenu par la bourgeoisie
- Le capitalisme décadent exacerbe le racisme
- Le silence complice des Alliés sur l'existence des camps de la mort
- La complicité directe du « camp démocratique » dans l'holocauste
11- RÉVOLUTION ALLEMANDE, VII
- La fondation du K.A.P.D
- Les faiblesses sur la question organisationnelle conduisent à la disparition de l'organisation
- Le drame de l'automutilation
- Les conceptions organisationnelles fausses du KPD accélèrent sa trajectoire vers l'opportunisme
- « La révolution allemande » : histoire de la faiblesse du parti
15- 1917 : LA REVOLUTION RUSSE
LES « THÈSES D'AVRIL », PHARE DE LA RÉVOLUTION PROLÉTARIENNE
- De février à avril : la lutte pour réarmer le « Parti »
- La démonstration de la méthode marxiste
- L'« anarchisme » de Lénine
- Le rôle du parti dans la révolution
20- POLÉMIQUE
- Nous sommes-nous trompés dans les années 1980 ?
- La C.W.O et le cours historique, une accumulation de contradictions
- La perspective du CCI a-t-elle fait faillite ?
- L'aveuglement de la CWO et du BIPR
- Le BIPR et le cours historique
N° 90 - 3e trimestre 1997
1- 12e Congrès du CCI
LE RENFORCEMENT POLITIQUE DU CCI
- La défense de l'organisation
- Le milieu politique prolétarien
- La situation internationale et les perspectives de la lutte de classe
3- RÉSOLUTION SUR LA SITUATION INTERNATIONALE
9- RÉVOLUTION ALLEMANDE, VIII
LE PUTSCH DE KAPP
- L'extrême-droite passe à l'offensive, la démocratie inflige la défaite à la classe ouvrière
- La classe ouvrière supporte le coût de la défaite de l'impérialisme allemand
- La bourgeoisie utilise le Traité de Versailles pour diviser la classe ouvrière
- Le putsch de Kapp : l'extrême-droite passe à l'offensive...
- La riposte armée de la classe ouvrière
- Les limites de la riposte ouvrière
- Le SPD et les syndicats : fer de lance de la défaite de la classe ouvrière
- Depuis la première guerre mondiale tous les partis bourgeois sont réactionnaires et des ennemis de la classe ouvrière
- Les faiblesses des révolutionnaires sont fatales à toute la classe ouvrière
13- 1917: LA RÉVOLUTION RUSSE
LES « JOURNÉES DE JUILLET », LE ROLE INDISPENSABLE DU PARTI
- Une provocation cynique de la bourgeoisie et un piège tendu aux bolcheviks
- La clique des contre-révolutionnaires, « Cent-noirs », antisémites, organisée par les « démocraties » occidentales
- Les provocations politiques de la bourgeoisie assoiffée de sang
- Les bolcheviks évitent le piège
- Les pogroms et les calomnies de la contre-révolution
- Bilan des « journées de juillet »
17- Le communisme n'est pas un bel idéal, il est à l'ordre du jour de l'histoire, I
- 1905: La grève de masse ouvre la voie à la révolution prolétarienne
- Rosa Luxemburg et le débat sur la grève de masse
- Les caractéristiques de la lutte de classe dans la nouvelle période
- Les soviets, organes du pouvoir prolétarien
- Nature et perspectives de la révolution
- Kautsky, Pannekoek et l'État
24- POLÉMIQUE : à l’origine du CCI et du BIPR, I
- La « Fraction italienne » et la « Gauche communiste de France »
- Quelques rectifications et précisions
- Quelques éléments d'histoire de la Gauche italienne
- La « Gauche italienne » durant la seconde guerre mondiale et la formation de la GCF
28- A propos d'une « Prise de position sur l'évolution récente du CCI »
N° 91 – 4e trimestre 1997
Édito : Afrique noire, Algérie, Moyen-Orient : Les grandes puissances, principaux responsables des massacres
- Afrique noire : les intérêts français au plus mal
- Derrière les massacres en Algérie, les mêmes intérêts sordides des « grands »
- Moyen-Orient: les difficultés grandissantes de la politique américaine
4- 1917 : LA REVOLUTION RUSSE
- L'insurrection d’octobre, une victoire des masses ouvrières
- Un faux respect pour la révolution de février, une haine véritable pour celle d'octobre
- « La crise est mûre »
- Le prolétariat prend le chemin de l'insurrection
- La tâche de l'heure : la destruction de l'État bourgeois
- Choisir le bon moment: la clé de la prise du pouvoir
- L'art de l'insurrection
- Le parti et l'insurrection
- Lénine contre Staline
- Le point culminant de l’histoire de l'humanité
12- Le communisme n'est pas un bel idéal, il est à l'ordre du jour de l'histoire, II
- « L'État et la révolution » (Lénine), une vérification éclatante du marxisme
- Le prolétariat au bord du pouvoir
- L'État, instrument de la domination de classe
- L'évolution de la théorie marxiste de l'État
- La réfutation de l'anarchisme
- La base économique du dépérissement de l'État
- Les limites de la vision de Lénine : L'État et l'économie, Parti et pouvoir, Classe et État
19- Le combat des Gauches dans l'Internationale communiste
- La responsabilité des révolutionnaires face à la dégénérescence
- Le long combat des « gauches » de l'IC
- Le début du combat de Trotsky
- La crise de 1925‑26
- Après 1927 e combat continue
- Un combat au niveau international
- Les leçons tirées par la Gauche italienne
23- POLÉMIQUE : à l’origine du CCI et du BIPR, II
- La formation du Partito comunista internazonalista
- Les critères de « réussite » d'une organisation révolutionnaire
- La constitution du PC Int
- Les conséquences de la démarche opportuniste du PC Int
N° 92 - 1er trimestre 1998
1- CRISE ÉCONOMIQUE : De la crise des « pays émergents » asiatiques au nouvel effondrement de l’économie mondiale
- La théorie marxiste contre les mensonges et l'aveuglement des économistes bourgeois
- La banqueroute asiatique, produit de la crise du mode de production capitaliste
- L'endettement généralisé du capitalisme
- La crise du capitalisme est irréversible
4- Perspective Internationaliste décroche un nouvel oscar du bêtisier politique
5- Rapport sur la crise économique au 12e congrès du CCI
LA PREUVE DU TRIOMPHE DU MARXISME
- La fausse reprise
- L'endettement et l'irrationalité capitaliste
- Les limites de la croissance: la crise aux États-Unis, en Grande Bretagne, en Allemagne et au Japon
- Les «Dragons » blessés
- Perspectives
- 1. Une guerre commerciale plus aiguë
- 2. Inflation et dépression
13- Les falsifications de la révolution de 1917
LE MENSONGE COMMUNISME = STALINISME = NAZISME
- La bourgeoisie ressort les vieux mensonges sur la révolution russe
- Une offensive contre la perspective de la lutte du prolétariat
- La perspective révolutionnaire reste à l'ordre du jour
16- Conférences de Moscou
- Les débuts d’un débat prolétarien en Russie confirment la perspective marxiste révolutionnaire
- L'héritage de Trotsky et les tâches de la période actuelle
- Les antagonismes au sein des conférences sur l’héritage de Trotsky
- La Conférence de 1996 sur « La révolution trahie »
- La Conférence de 1997 sur « Trotsky et la révolution russe »
- Perspectives
20- Contribution de Russie
- La classe non identifiée : la bureaucratie soviétique vue par Léon Trotsky
- La bureaucratie : caractéristiques principales
- Le stalinisme et le capitalisme
- Le schéma qui efface la réalité
- La terminologie et la politique
- Le destin de la bureaucratie
25- Congrès du Partito Comunista Internazionalista
- Un pas en avant pour la Gauche communiste
- La dénonciation de la mystification démocratique
- La question syndicale
- Le rôle du parti et la lutte pour sa constitution à notre époque
- Le débat et le regroupement des révolutionnaires
N° 93 – 2e trimestre 1998
Édito : Chômage : La bourgeoisie prend les devants face à la montée de la colère ouvrière
- Le chômage aujourd'hui et ses perspectives
- La classe ouvrière devant la question du chômage
- La signification véritable des « mouvements de chômeurs »
6- Irak : un revers des États-unis qui relance les tensions guerrières
8- MAI 1968 : le prolétariat revient à l’avant de la scène
- Les événements de Mai 68
- Un mouvement « étudiant» ?
- Non, le début de la reprise historique de la lutte de la classe ouvrière
- Un mouvement revendicatif, mais pas seulement
- Une reprise historique longue et tortueuse
- Une reprise difficile
- Mais l'avenir appartient toujours au prolétariat
13- 1848 : Le MANIFESTE COMMUNISTE, une boussole indispensable pour l’avenir de l’humanité
- Le «spectre du communisme » bourgeois
- Le Manifeste: une arme inestimable contre le stalinisme
- Le Manifeste : l'anéantissement du « socialisme en un seul pays » par le marxisme
16- Le communisme n'est pas un bel idéal, il est à l'ordre du jour de l'histoire, III
- 1918: le programme du parti communiste allemand
- La révolution allemande éclipsée de l'histoire
- Le congrès de fondation du KPD : la révolution à l'ordre du jour, pas des réformes
- Ce que voulait Spartacus
22- RÉVOLUTION ALLEMANDE, IX
- L'action de Mars 1921 : le danger de l’impatience petite-bourgeoise
- La bourgeoisie cherche à provoquer les ouvriers
- Forcer la révolution ? - Quel bilan des luttes de mars ?
- Les conceptions organisationnelles fausses un obstacle à la capacité du Parti à faire son autocritique
- La réaction du KAPD
- L'attitude de l'Internationale face à l'Action de mars
- Quelle attitude adopter ?
27- Des débats entre groupes « bordiguistes »
- Une évolution significative du milieu politique prolétarien
N° 94 – 3e trimestre
Édito : Face à la misère et la barbarie une seule réponse : la lutte de internationale du prolétariat
- Quelle alternative à cette barbarie ?
- La responsabilité historique internationale de la classe ouvrière des pays industrialisés
4- EURO : L'aiguisement des rivalités capitalistes
- L'agressivité croissante du capitalisme allemand
- L'Euro : un instrument contre le « chacun pour soi »
- Euro : les plus forts imposent leurs règles aux plus faibles
- Le conflit européen sur l'Euro
6- 13e Congrès de Révolution internationale
- Résolution sur la situation internationale
- Crise économique
- Affrontements impérialistes
- Lutte de classe
10- CHINE, MAILLON DE L'IMPÉRIALISME MONDIAL, III
- Le maoïsme, un rejeton monstrueux du capitalisme décadent
- Contre-révolution et guerre impérialiste : les accoucheuses du maoïsme
- La participation de Mao Zed Ong à la liquidation du parti prolétarien
- La conversion du P.C.Ch. en parti bourgeois et la création de la bande de Mao
- Dans la Longue marche avec la bande stalinienne
- Le contrôle de Yan'an et l'alliance avec le Guomindang
- La défaite de Wang Ming et le flirt avec les États-unis
- Le maoïsme : une arme idéologique du capital
- Une complète falsification du marxisme : Sur la révolution prolétarienne, l'internationalisme, la lutte de classes, l'État, le matérialisme dialectique
16- Le communisme n'est pas un bel idéal, il est à l'ordre du jour de l'histoire, IV
- La plate-forme de l’Internationale communiste
- Introduction du CCI
- PLATE‑FORME DE L'INTERNATIONALE COMMUNISTE
- La conquête du pouvoir politique
- Démocratie et dictature
- L'expropriation de la bourgeoisie et la socialisation des moyens de production
- Le chemin de la victoire
20- Débats entre groupes « bordiguistes »
- Marxisme et mysticisme
- Le marxisme contre le mysticisme
- Les racines de la mystique bordiguiste
22- Construction de l’organisation révolutionnaire
THÈSES SUR LE PARASITISME
N° 95 – 4e trimestre 1998
Édito : Aggravation de la crise, massacres impérialistes en Afrique : Les convulsions croissantes du capitalisme moribond
1- Après l'Asie, la Russie et l'Amérique latine, La catastrophe économique atteint le cœur du capitalisme
- La crise en Russie
- La crise au Japon
- Vers une nouvelle récession mondiale
- Continuité et limites des palliatifs
- La faillite du capitalisme
6- Conflits impérialistes
UN NOUVEAU PAS DANS LE CHAOS0
- La guerre au Congo
- Les attentats contre les ambassades américaines et la réponse des États-Unis
9- BERLIN 1948 : en 1948, le pont aérien de Berlin cache les crimes de l’impérialisme allié
11- RÉVOLUTION ALLEMANDE, X
- Le reflux de la vague révolutionnaire et la dégénérescence de l’Internationale
- La bourgeoisie internationale s'unit pour arrêter la vague révolutionnaire
- L'Internationale communiste du 2e au 3e congrès
- Le reflux de la lutte de classe, un tremplin pour l'opportunisme
- Le slogan u Aux masses », un pas vers la confusion opportuniste
- Le débat sur l'évolution en Russie
- Qui doit exercer le contrôle sur l’État ?
- Le parti ou les conseils ?
15- Le communisme n'est pas un bel idéal, il est à l'ordre du jour de l'histoire, V
1919 : Le programme de la dictature du prolétariat
- L'époque de la révolution prolétarienne
- Politique générale
- Le problème des nationalités - Les affaires militaires - La justice prolétarienne
- L'éducation - la religion - Les affaires économiques - L'agriculture - La distribution
- La monnaie et les banques - Les finances - La question du logement
- La protection du travail et le travail d'assistance sociale - L'hygiène publique
22- GAUCHE COMMUNISTE D'ITALIE
- A propos de la brochure « PARMI LES OMBRES DU BORDIGUISME ET DE SES ÉPIGONES » (Battaglia Comunista)
- Une bonne critique des conceptions du bordiguisme
- Centralisme organique et unanimisme dans les décisions
- Les limites de la critique de Battaglia Comunista
N° 96 - 1er trimestre 1999
Édito : Crise économique : toujours plus profond dans l’abîme
2- Trente ans de crise ouverte du capitalisme
- Effondrement ou écroulement progressif ?
- La «gestion de la crise»
- La politique des années 1970
- Le bilan des années 1970
6- Irak, Kosovo, accords de Wye Plantation
- L'offensive américaine aggrave le chaos et la barbarie impérialistes
- Irak : les États-Unis humilient la France et la Russie au «Conseil de Sécurité »
- Kosovo : les États-Unis font la loi via l'OTAN
- ONU et OTAN : les restes d'un ordre mondial révolu que les grandes puissances se disputent
- Accords de Wye Plantation : un avertissement des États-Unis à leurs rivaux européens
8- 1918-1919 : La révolution prolétarienne met fin à la guerre impérialiste
- Les causes fondamentales de la guerre mondiale
- Le rôle des révolutionnaires durant la guerre
- La révolution prolétarienne et la fin de la guerre
14- Le communisme n'est pas un bel idéal, il est à l'ordre du jour de l'histoire, VI
- 1920: Boukharine et la période de transition
- Une véritable contribution à la théorie marxiste
- Confondre l'embryon et l'être humain achevé
- L'aveuglement sur le danger de l'État
- La trajectoire de Boukharine : reflet du cours de la révolution
19- Question chinoise (1920‑1940)
- La Gauche communiste contre la trahison de l’Internationale communiste dégénérée
- L'écrasement de la révolution en Chine
- La question chinoise et l'Opposition russe
- La Chine et l'Opposition de Gauche internationale
- Les leçons tirées par la Gauche italienne
23- Question d'organisation
- Sommes-nous devenus«LÉNINISTES»
- Le « léninisme » et Lénine
- Le CCI s'est toujours revendiqué du combat de Lénine pour la construction du parti
N° 97 - 2e trimestre 1999
Édito - La guerre en Europe : le capitalisme montre son vrai visage
2- 13e congrès du CCI
- Résolution sur la situation internationale
- Les conflits impérialistes
- La crise économique
- La lutte de classe
11- Crise économique
- Trente ans de crise ouverte du capitalisme, II
- Les années 1980
- La crise de 1980‑82
- La "nouvelle" politique économique
- Le Krach de 1987
- Le bilan des années 1980
15- Le communisme n'est pas un bel idéal, il est à l'ordre du jour de l'histoire, VII
- 1920: Le programme du KAPD
- Introduction
16- Programme du "Parti communiste ouvrier d’Allemagne" (KAPD) (mai 1920)
20- Révolution allemande, XI
- La Gauche russe et le conflit croissant entre l’État russe et les intérêts de la révolution mondiale
- La contribution du KAPD
- Le conflit croissant entre l'État russe et les intérêts de la révolution mondiale
- Les faiblesses du KAPD sur la question organisationnelle
- Comment réagir vis-à-vis du danger de dégénérescence de l'IC ? S'enfuir ou combattre ?
- Les réponses erronées des communistes russes
- Le reflux de la lutte de classe permet le développement du capitalisme d'État
- La croissance hypertrophique de l'appareil d'État en Russie
- Le 4e congrès mondial : la soumission à l'État russe
26- Question d'organisation
- Sommes-nous devenus « LÉNINISTES » (II)
- La position du CCI sur QUE FAIRE?
- La question centrale de Que faire ? Élever la conscience
- La distinction de Que faire ? Entre organisation politique et organisation unitaire
- Qui est membre du parti ?
- Lénine et le CCI : une même conception du militantisme
- LE CCI AUX COTES DE LÉNINE SUR LES STATUTS
- Les statuts ne sont pas des mesures exceptionnelles
- Les statuts comme règle de vie et comme arme de combat
- Le Parti communiste se construira sur les acquis politiques organisationnels apportés par Lénine
N° 98 - 3e trimestre 1999
Editorial - La "PAIX" au Kosovo, un moment de la guerre impérialiste
- Les “grands”et les “petits” impérialistes sèment la terreur et la mort
- Les impérialismes provoquent la ruine des Balkans et la catastrophe écologique.
- Le mensonge de la guerre juste et humanitaire de l'OTAN.
- Les rivalités impérialistes sont les véritables causes de la guerre au Kosovo
- L'occupation et le partage impérialiste du Kosovo : un succès de la Grande-Bretagne
- Un nouveau pas dans les prétentions impérialistes de l'Allemagne
- Le partage du Kosovo aggrave les rivalités entre les grandes puissances
- La guerre du Kosovo va relancer encore plus la multiplication des conflits locaux.
4- Le prolétariat face à la guerre
6- 13e congrès du CCI
- Présentation
7- Rapport sur les conflits impérialistes (extraits)0
13- Pourquoi la présence des Partis de Gauche dans la majorité des gouvernements européens actuels
19- Crise économique
- Trente ans de crise ouverte du capitalisme, III. - Les années 1990
- L'effondrement des pays de l'Est et la récession mondiale de 1991-93
- Une reprise sans emploi
- La prétendue "mondialisation"
- Bilan provisoire des années 1990
24- Révolution allemande, XII. - 1923
- I. La bourgeoisie veut infliger une défaite décisive à la classe ouvrière
- La politique désastreuse du KPD : la défense de la démocratie et du front unique
- Avec le reflux de la vague révolutionnaire, l'intensification des conflits impérialistes
- La provocation de l'occupation de la Ruhr: quelles tâches pour la classe ouvrière ?
- Le KPD et l'espoir d'une "alliance nationaliste"
- Les appels nationalistes visant à séduire la petite bourgeoisie patriote
- La classe ouvrière se défend sur son terrain de classe
- En août 1923, le KPD contre le développement des luttes.
30- A propos de l'appel lancé par le CCI sur la guerre en Serbie
- L'offensive guerrière de la bourgeoisie exige une réponse unie de la part des révolutionnaires
- La guerre en Serbie a démasqué les faux révolutionnaires et mis en évidence l'unité de fond des groupes véritablement internationalistes
- Notre appel au milieu politique prolétarien
- Les réponses à notre appel
- Est-il vrai qu'une réponse unie du milieu politique ait nécessairement un "profil bas" ?
- La signification des conférences de Zimmerwald et Kienthal
- Que reste-t-il ?
N° 99 - 4e trimestre 1999
Édito : Timor, Tchétchénie... Le capitalisme, synonyme de chaos et de barbarie
- Timor et Tchétchénie, deux manifestations de la décomposition du capitalisme
- Le cynisme et l'hypocrisie des puissances démocratiques
4- Crise économique
- Le gouffre qui se cache derrière la “croissance ininterrompue"
6- 1989‑1999 : Le prolétariat mondial face à l’effondrement du bloc de l'Est et la faillite du stalinisme
- Présentation
- Il n'y a pas continuité, mais rupture radicale entre le stalinisme et la révolution d'octobre 1917
- La démocratie n'est que la forme la plus pernicieuse de la dictature du capital
- Face à la barbarie croissante du capital, une seule perspective : la reprise des combats de classe du prolétariat mondial
11- 13e congrès du CCI
- Rapport sur la lutte de classe (extraits)
- 1968‑1989 : le réveil du prolétariat
- 1989‑1999: la lutte de classe face à la décomposition de la société bourgeoise
- L'évolution de la lutte de classe depuis 1989
- Les réponses de la bourgeoisie et les perspectives de la lutte de classe
17- Le communisme n'est pas un bel idéal, il est à l'ordre du jour de l'histoire, VIII
- Comprendre la défaite de la révolution russe (1re partie)
- 1918: la révolution critique ses erreurs
- Rosa Luxemburg et la révolution russe
- Les premiers débats sur le capitalisme d'État
24- Révolution allemande, XIII
- 1923 (II). Une défaite qui signe la fin de la vague révolutionnaire mondiale
- L'I.C. se fourvoie dans l'aventure de l'insurrection
- Des conditions défavorables - Les préparatifs de l'insurrection
- L'insurrection pouvait-elle s'appuyer sur une alliance gouvernementale avec le SPD ?
- Chronique d'une défaite annoncée
- Les leçons de la défaite
- L'incapacité de l'I.C. et du KPD de tirer les véritables leçons
29- Polémique avec le BIPR
- La méthode marxiste et l’appel du CCI sur la guerre en ex-Yougoslavie
- L'idéalisme et le cours historique
- La méthode marxiste et l'intervention révolutionnaire sur la guerre
- Le problème de l'unité dans l'histoire du mouvement révolutionnaire
- La méthode de confrontation des positions dans le mouvement révolutionnaire
Revue Int. 1990 - 60 à 63
- 4758 reads
Revue Internationale no 60 - 1e trimestre 1990
- 3325 reads
Ecroulement du bloc de l'est la faillite définitive du stalinisme
- 5008 reads
Présentation des 'Thèses sur la crise économique et politique en URSS et dans les pays de l'Est"
Les "Thèses"publiées dans ce numéro, ont été adoptées début octobre 1989. Depuis, les événements à l'Est se sont précipités, se télescopant les uns les autres, semaine après semaine, provoquant des situations qui, il y a encore 6 mois, eussent semblé inconcevables. A peine assistions-nous en août 1989 à cette incongruité que Solidarnosc hier encore clandestin - et qui plus est un "syndicat" - accède au gouvernement en Pologne, que d'autres événements, d'une portée historique considérable, secouaient tour à tour tous les pays de l'Est.
La Hongrie, où le parti "communiste" change de nom et proclame sa volonté de devenir social-démocrate, devient elle-même une simple république sans adjectif, renvoyant ainsi aux oubliettes de l'histoire son habit de démocratie populaire" et son appartenance au camp "socialiste". En RDA, l'élément "sage" du bloc de l'Est, son maillon apparemment le plus solide, alors que plus de 100 000 personnes, parmi la force de travail la plus qualifiée, ont déjà quitté, depuis le début de l'année ce pays du "socialisme réel" pour rejoindre la RFA, des manifestations de plus en plus importantes se développent dans toutes les villes, réclamant pêle-mêle des élections libres, la légalisation de l'opposition, la liberté de voyager. Honecker démissionne pour être écarté définitivement quelques semaines plus tard d'un parti contraint de renoncer à son rôle dirigeant exclusif et d'ouvrir le "mur de Berlin", symbole du renforcement en 1961 du partage du monde de la 2e guerre mondiale décidé à Yalta en 1944. En Bulgarie, puis en Tchécoslovaquie, les régimes hérités du stalinisme s'effondrent à leur tour.
Cette accélération de la situation, des convulsions qui se généralisent à tous les pays de l'Est, confirme le cadre tracé par les "thèses" quant à la crise historique du stalinisme et à ses racines. De plus, le rythme auquel les événements se succèdent fait que ce qui n'était encore qu'une perspective, se trouve aujourd'hui déjà totalement réalisé, à savoir l'effondrement définitif du stalinisme et la totale implosion du bloc de l'Est, réduisant dès aujourd'hui celui-ci à une simple fiction, fiction qui va rejoindre rapidement les poubelles de l'Histoire.
Cette situation, qui voit d'ores et déjà l'URSS et les pays de l'Est cesser de constituer un bloc impérialiste, a une importance historique considérable et marque le tournant le plus important depuis la fin de la seconde guerre mondiale et la reprise historique du combat prolétarien à la fin des années 1960, et ce tant sur le plan de l'impérialisme (l'ensemble des constellations impérialistes issues des accords de Yalta va être profondément déstabilisé), que sur le plan de ce qui reste plus que jamais la seule réelle alternative à la décomposition, à la barbarie, au chaos croissant provoqué par la crise historique du système capitaliste à un niveau mondial: la lutte prolétarienne ».
Crise et faillite du stalinisme sont celles du capitalisme, non du communisme
Les "thèses" développent longuement ce qui est à la racine de cette faillite :
- la crise généralisée du mode de production capitaliste à l'échelle mondiale ;
- l’échec de cette forme extrême, caricaturale, du capitalisme d'Etat que représente le stalinisme, produit et facteur de la contre-révolution en Russie.
Ce caractère aberrant du stalinisme n'a fait que renforcer considérablement les difficultés de capitalismes déjà faibles et arriérés face à la crise, et à l'exacerbation de la concurrence qu'elle provoque sur un marché mondial déjà sursaturé. Nous ne reviendrons donc pas ici sur les racines de l'effondrement définitif du stalinisme et du bloc de l'Est, mais nous nous attacherons à en actualiser l'évolution.
Il y a aujourd'hui un déchaînement de mensonges à cette occasion, et en premier lieu, le principal et le plus crapuleux d'entre eux : celui prétendant que cette crise, cette faillite c'est celle du communisme, celle du marxisme ! Démocrates et staliniens se sont toujours retrouvés, au-delà de leurs oppositions, dans une sainte-alliance, dont le premier fondement est de dire aux ouvriers que c'est le socialisme qui, au-delà de ses travers et déformations, règne à l'Est. Pour Marx, Engels, Lénine, Luxemburg, et pour l'ensemble du mouvement marxiste, le communisme a toujours signifié la fin de l'exploitation de l'homme par l'homme, la fin des classes, la fin des frontières, cela n'étant possible qu'à l'échelle mondiale, dans une société où règne l'abondance, "à chacun selon ses besoins, de chacun selon ses capacités", où "le règne du gouvernement des hommes cède la place à celui de l'administration des choses". Prétendre qu'il y aurait quelque chose de "communiste" ou d'engagé sur la voie du "communisme" en URSS et dans les pays de l'Est, alors que régnent en maître exploitation, misère, pénurie généralisée, représente le plus grand mensonge de toute l'histoire de l'humanité, mensonge aussi énorme que prétendre que les rapports entre serfs et seigneurs au Moyen Age avaient quelque chose de socialiste !
A l'Est les staliniens n'ont pu imposer ce mensonge que grâce à la terreur la plus brutale. L'instauration et la défense du "socialisme en un seul pays" se sont faites au prix de la plus sanglante et de la plus terrible contre-révolution, où tout ce qui pouvait subsister d'octobre 1917, et en premier lieu du parti bolchevique, a été férocement et systématiquement décimé, anéanti sous les coups et dans les geôles du stalinisme, avant de livrer à la déportation et à la mort, des dizaines de millions d'êtres humains. Cette féroce dictature, concentré hideux de tout ce que le capitalisme décadent contient de barbarie, n'a eu sans cesse que deux armes pour assurer sa domination: la terreur et le mensonge.
Ce mensonge représente un atout considérable pour toutes les fractions de la bourgeoisie face au cauchemar que représente pour celle-ci "le spectre du communisme", la menace que fait peser sur sa domination la révolution prolétarienne. Or, la révolution d'octobre 1917 en Russie et la vague révolutionnaire mondiale qui l'a suivie jusqu'au début des années 1920, restent jusqu'à présent le seul moment de l'histoire où la domination bourgeoise a été ou renversée par le prolétariat (en Russie en 1917) ou réellement menacée par celui-ci (en Allemagne en 1919). Dès lors, identifier Octobre, identifier la révolution prolétarienne avec son bourreau et son fossoyeur : la contre-révolution stalinienne, représente pour tous nos bons "démocrates" un atout majeur dans la défense de l’ordre bourgeois. Pendant plusieurs décennies, le fait qu'une majorité de la classe ouvrière identifiait positivement, grâce à l'immense prestige d'Octobre 1917, révolution et stalinisme, communisme et régimes de l'Est, a été le facteur idéologique le plus puissant responsable de l'impuissance du prolétariat. Il a été l'instrument de sa soumission jusqu'à accepter de se faire massacrer dans la deuxième boucherie mondiale, justement au nom de la défense du camp "socialiste", allié pour l'occasion au camp de la "démocratie", contre le fascisme, après avoir été l'allié de Hitler au début de la guerre. Le prolétariat n'a jamais été aussi faible, aussi soumis à l'idéologie dominante que lorsque les partis staliniens ont été forts, auréolés qu'ils étaient encore du prestige de l'Octobre rouge. Mais, lorsque cette croyance dans le caractère prétendument socialiste de l'URSS s'est effritée, sous les coups de la reprise historique des combats de la classe ouvrière à l'Est comme à l'Ouest depuis 1968, jusqu'à provoquer un profond rejet du stalinisme dans l'ensemble du prolétariat, il était encore plus vital pour les "démocraties" de maintenir en vie cette monstrueuse fiction du "socialisme" à l'Est. A l'heure où l'aiguillon de la crise à nouveau ouverte du système capitaliste, à l'échelle mondiale, poussait, et pousse de plus en plus les prolétaires à élargir et renforcer leur combat contre la bourgeoisie et son système ; à l'heure où se posait, et se pose de plus en plus à la classe ouvrière la question de donner une perspective à son combat ; il ne fallait surtout pas que la mise à nu de ce plus grand mensonge de l'Histoire : l'identification entre stalinisme et communisme, ne favorise le développement dans le prolétariat de la perspective de la révolution.
C'est pourquoi le maintien de cette fiction représente plus que jamais un enjeu considérable pour la bourgeoisie. Le maintien de ce monstrueux accouplement entre "révolution" et "stalinisme", après avoir servi en "positif", sert aujourd'hui en "négatif", en tant que repoussoir à toute idée de perspective de révolution. Au moment où, pour l'ensemble de l'humanité, est posée de plus en plus crûment l'alternative historique, socialisme ou barbarie sans fin, jusqu'à l'holocauste final, il est vital pour la bourgeoisie de discréditer et de salir le plus possible la perspective du communisme aux yeux des ouvriers.
C'est pourquoi, avec l'effondrement définitif du stalinisme, les "démocrates" redoublent d'effort pour maintenir en vie ce répugnant mensonge : "Octobre 1917 = stalinisme", "marxisme = stalinisme", "URSS = communisme". Avec tout le cynisme dont est capable la classe dominante, on étale partout l'image de ces dizaines de milliers d'ouvriers fuyant le "socialisme" pour rejoindre les pays "d'abondance et de liberté" que sont censées être les "démocraties" capitalistes occidentales. Ce faisant, on essaye de discréditer, aux yeux des prolétaires, toute perspective d'une autre société que celle basée sur le profit et l'exploitation de l'homme par l'homme. Et plus encore on assène la mystification selon laquelle la "démocratie" serait sinon le meilleur, du moins "le moins pire" des systèmes. Enfin, et c'est là un danger bien réel, on tente également d'entraîner les ouvriers à l'Est à lutter pour des intérêts qui ne sont pas les leurs, à épouser la lutte que se livrent les cliques "réformatrices" et staliniennes - Gorbatchev ou Eltsine contre Ligatchev en URSS, "Nouveau Forum" contre SED en RDA, etc. -, et sans compter les différentes "nationalités".
La classe ouvrière, chaque fois qu'elle est tombée dans un tel piège au cours de son histoire, non seulement n'a rien obtenu, mais s'est en fin de compte toujours fait massacrer, comme dans la guerre d'Espagne en 1936-39, au nom du mirage de la "république" bourgeoise. Staliniens et "démocrates", staliniens et "anti-staliniens" ne sont, en réalité, que deux facettes d'un même visage, celui de la dictature bourgeoise. Il faut se rappeler qu'au cours de la seconde boucherie mondiale, les "démocraties" anglaise et nord-américaine n'ont pas hésité à s'allier avec Staline pour mener à bien la guerre contre l'Allemagne. Leur opposition d'alors, qui aboutit au partage du monde en deux zones d'influence antagoniques, ne relève pas d'une opposition idéologique, entre un bloc qui serait "socialiste" et un bloc capitaliste. Elle est bel et bien l'expression de deux blocs, également capitalistes et impérialistes, devenus rivaux.
C'est seulement lorsque l'URSS, profitant de l'écroulement de l'impérialisme allemand, a pu constituer en bloc impérialiste la zone d'influence dont elle a hérité en Europe, que les "démocraties" ont soudainement redécouvert qu'on ne pouvait que s'opposer à un système "communiste" et "totalitaire". Avant la guerre, l'URSS était isolée et une puissance de second ordre, et on pouvait s'allier avec ce même système "communiste et totalitaire". Ce n'est plus le cas lorsque celui-ci, dans les années 50, est une puissance impérialiste de premier plan, et donc un rival impérialiste sérieux!
C'est pourquoi, si le prolétariat ne peut que vomir le stalinisme et les staliniens, il doit tout autant rejeter le camp de la "démocratie" et des "anti-staliniens". Il n'a pas à choisir, sous peine d'abandonner le terrain de classe, de servir alors d'otage et d'être la victime impuissante, dans une lutte qui n'est pas la sienne, entre ces deux bourreaux capitalistes de la révolution prolétarienne que furent le stalinisme et la "démocratie" qui redore son blason aujourd'hui.
C'est la "social-démocratie" qui, ne l'oublions jamais, en écrasant la révolution en Allemagne de 1919 à 1923, condamnant ainsi la révolution russe à un terrible isolement, a ouvert la route au stalinisme et au fascisme.
Fin du bloc impérialiste russe fin de "Yalta" vers le chaos mondial
L'effondrement de ce pur produit de la contre-révolution qu'est le stalinisme, ne peut s'effectuer qu'à travers des convulsions toujours plus profondes, plus généralisées jusqu'à créer une situation de véritable chaos dans ce qui était jusqu'à présent la seconde puissance impérialiste mondiale et le deuxième "bloc".
On assiste, jour après jour, à la généralisation de ces convulsions, à la perte croissante de contrôle de la bourgeoisie sur les événements.
Le syndicat Solidarnosc entre au gouvernement en Pologne, avec comme objectif la "libéralisation de l'économie" et la volonté ouvertement déclarée de se "rapprocher" de l'Ouest, sans que Moscou ne puisse s'y opposer, feignant de l'encourager.
Le parti stalinien au pouvoir en Hongrie change de nom, se proclame social-démocrate, revendique un statut de neutralité pour ce pays, demande son adhésion à l'un des plus importants organismes du bloc de l'Ouest, le Conseil de l'Europe, ce qui équivaut à quitter le Pacte de Varsovie : Gorbatchev envoie un télégramme de félicitations.
En Bulgarie, en RDA, en Tchécoslovaquie, les vieux staliniens sont écartés. La RDA ouvre ses frontières où s'engouffrent des centaines de milliers de personnes.
Partout (sauf en Roumanie au moment de la rédaction de cet article), se produisent quotidiennement des changements dont un seul d'entre eux aurait entraîné l'envoi immédiat des chars russes il y a quelques années. Ce n'est pas là l'expression d'une politique délibérément choisie de la part de Gorbatchev, comme on le présente en général, mais la manifestation de la crise dans l'ensemble du bloc, et en même temps de la faillite historique du stalinisme. La rapidité de ces événements, et le fait que ceux-ci touchent désormais de plein fouet le pilier central sur lequel reposait le bloc de l'Est, la RDA, est le plus sûr symptôme que le deuxième bloc impérialiste mondial a totalement implosé.
Ce changement est désormais irréversible et touche non seulement le bloc, mais son coeur, sa tête, l'URSS elle-même, dont la manifestation la plus claire d'écroulement est le développement du nationalisme sous la forme de revendications d'"autonomie" et d'"indépendance" dans les régions périphériques d'Asie centrale, de la côte de la mer Baltique, et également d'une région aussi importante pour l'économie nationale soviétique que l'Ukraine.
Or, pour un bloc impérialiste, dès qu'un chef de file n'est plus capable de maintenir un tant soit peu la cohésion d'ensemble, et plus encore, dès qu'il n'est plus capable de maintenir l'ordre à l'intérieur même de ses frontières, il ne peut que perdre son statut de puissance mondiale. L'URSS et son bloc ne sont plus au centre des antagonismes interimpérialistes entre deux camps capitalistes, qui est la polarisation ultime que peut atteindre l'impérialisme au niveau mondial dans la période de décadence du capitalisme.
L'implosion du bloc de l'Est, sa disparition en tant qu'enjeu dominant des conflits inter-impérialistes, implique la remise en cause radicale des accords de Yalta, et la généralisation d'une instabilité de l'ensemble des constellations impérialistes constituées sur la base de ces accords, y compris du bloc de l'Ouest dominé depuis 40 ans par les USA. A son tour ce dernier ne peut que connaître, à terme, une remise en cause de ses propres fondements. Si, au cours des années 1980, c'est la cohésion de tous les pays occidentaux contre le bloc russe, qui a constitué un facteur supplémentaire de l'effondrement de ce dernier, le ciment de cette cohésion n'existe plus aujourd'hui. S'il n'est pas possible de prévoir le rythme et les formes que prendra l'évolution de la situation, la perspective est à des tensions entre les grandes puissances au sein du bloc occidental actuel, à la reconstitution à terme de deux nouveaux blocs impérialistes à l'échelle internationale, pour, en l'absence d'une réponse prolétarienne, une nouvelle boucherie mondiale. L'effondrement définitif du stalinisme et son corollaire, l'implosion du bloc impérialiste de l'Est, sont donc porteurs dès à présent d'une déstabilisation de l'ensemble des constellations impérialistes issues de Yalta.
La remise en cause de l'ordre impérialiste hérité de la 2e guerre mondiale, et le fait que la reconstitution de deux nouveaux camps impérialistes majeurs prendra inévitablement un certain temps, ne signifient en aucune façon la disparition des tensions impérialistes. La crise généralisée du mode de production capitaliste ne peut que pousser toujours plus tous les pays, du plus grand au plus petit, et au sein de chaque pays les différentes fractions de la bourgeoisie, à tenter de régler sur le terrain militaire les conflits et la concurrence qui les opposent. Aujourd'hui, la guerre déchire toujours le Liban, l'Afghanistan, le Cambodge, le Salvador, etc. Loin de signifier la paix, l'implosion des blocs issus de Yalta est porteuse, comme la décomposition du système capitaliste qui en est à l'origine, de toujours plus de tensions et de conflits. Les appétits de sous-impérialismes, jusque là déterminés surtout par la division mondiale entre deux camps principaux, que les têtes de bloc ne dominent plus aujourd'hui comme auparavant, vont se développer.
Le stalinisme ne meurt pas pacifiquement en cédant tranquillement sa place à des formes "démocratiques" de la dictature bourgeoise. Il n'y aura pas de transition "en douceur" mais au contraire le chaos. L'agonie de la charogne stalinienne va se faire dans une "libanisation" de l'ensemble du bloc de l'Est. Les affrontements entre cliques bourgeoises rivales nationalistes en URSS même, les tensions entre Hongrie et Roumanie, RDA et Tchécoslovaquie, Roumanie et URSS, RDA et Pologne, etc., les débuts de pogroms auxquels on assiste actuellement en Moldavie, en Arménie, en Azerbaïdjan, indiquent et montrent la perspective de la décomposition généralisée, concentré de toute la barbarie du capitalisme décadent.
Conséquences pour le prolétariat de la décomposition généralisée du bloc de l'est
Derrière les réformes, la "démocratisation", les tentatives de libéraliser l'économie, derrière tous les beaux discours sur "les lendemains qui chantent", la réalité que vivent les ouvriers, c'est d'ores et déjà une dégradation considérable de leurs conditions de vie pourtant déjà très dures. On manque de tout en Pologne et en URSS, on ne trouve presque plus de savon et de sucre à Moscou et Leningrad pourtant traditionnellement mieux approvisionnées. Partout le rationnement se généralise et devient de plus en plus drastique. L'hiver va être terrible car les mesures de libéralisation décidées en Pologne, Hongrie et amorcées en URSS, cela veut dire qu'il y aura toujours pénurie et que le marché noir va devenir de plus en plus inaccessible pour les ouvriers, car le taux d'inflation va bientôt atteindre trois chiffres comme en Pologne, et la vérité des prix va toucher en premier lieu les produits de première nécessité. La libéralisation de l'économie, et son corollaire l'autonomie des entreprises, cela veut dire l'apparition et le développement d'un chômage massif. On mesure l'ampleur de ce chômage, lorsque l'on sait qu'en Pologne, plus d'un tiers des ouvriers devrait être licencié en cas de fermeture des usines non rentables (dixit les experts économiques du gouvernement de Solidarité). En URSS, alors que déjà plusieurs millions d'ouvriers sont de fait au chômage, c'est 11 à 12 millions d'ouvriers qu'il faudrait réduire au chômage d'ici cinq ans. En Hongrie, c'est la majorité des usines que l’on devrait fermer pour cause d'obsolescence et de non-compétitivité ! C'est donc une misère terrible, digne des pays du "tiers-monde", qui attend et tend déjà à toucher le prolétariat de l'Est.
Face à de telles attaques, ce prolétariat va se battre, va tenter de résister, comme le font par exemple les mineurs sibériens qui ont repris leurs grèves de l'été pour réclamer le respect des accords passés avec le gouvernement. Il y a et il y aura des grèves. Mais la question est : dans quel contexte, dans quelles conditions vont se dérouler ces grèves ? La réponse ne doit souffrir d'aucune ambiguïté : une extrême confusion due à la faiblesse et l'inexpérience politique de la classe ouvrière à l'Est, inexpérience rendant particulièrement vulnérable la classe ouvrière à toutes les mystifications démocratiques, syndicales et au poison nationaliste. On le voit en Pologne, en Hongrie, en URSS, où des ouvriers russophones font grève contre des ouvriers baltes et vice versa, ou encore Azéris et Arméniens. Le symbole, sans aucun doute le plus tragique de cette arriération politique du prolétariat de l'Est, c'est ce qui se passe en RDA. Le prolétariat de ce pays hautement industrialisé, situé en plein coeur de l'Europe, ce prolétariat, qui avait été au coeur de la révolution allemande en 1919 (en Saxe et Thuringe), qui avait le premier exprimé son rejet du stalinisme en 1953, manifeste aujourd'hui massivement, mais manifeste en étant totalement dilué dans la population. On crie "Gorby ! Gorby !" en revendiquant pêle-mêle la démocratie, la légalisation des partis d'opposition, sans jamais que ne s'affirment, ne serait-ce qu'embryonnairement, de revendications en tant que classe ouvrière. C'est une image terrible que de voir cette classe ouvrière allemande "s'organiser" à partir des églises luthériennes et se noyer dans le "peuple" en général !
La haine du stalinisme est si forte, si viscérale, que le mot même de prolétariat paraît "maudit", contaminé par la charogne du stalinisme. Ce faisant, en crevant le stalinisme empuantit encore l'atmosphère, et rend un dernier et précieux service à la bourgeoisie, en paraissant condamner aux yeux des prolétaires de l'Est jusqu'à toute revendication de l'identité et des intérêts de la classe ouvrière, en transformant en un terrifiant repoussoir, en cauchemar, toute idée de révolution.
Cet héritage de la contre-révolution stalinienne pèse terriblement. Même si, sans nul doute, la combativité ouvrière à l'Est ne pourra que se manifester face à des attaques de plus en plus insupportables, la conscience de classe, elle, connaîtra d'immenses difficultés pour se frayer un chemin. On ne peut pas exclure la possibilité, pour des fractions importantes de la classe ouvrière, de se faire embrigader et massacrer pour des intérêts qui lui sont totalement opposés, dans des luttes entre cliques nationalistes ou entre cliques "démocratiques" et staliniennes.
Le prolétariat dans son ensemble, internationalement, se trouve face à un surcroît de difficultés, pour le développement de la prise de conscience de la classe, provoquées par cette nouvelle situation (Voir l'article Des difficultés accrues pour le prolétariat dans ce numéro).
Perspectives
Nous entrons dans une période totalement nouvelle qui va profondément modifier aussi bien la configuration des constellations impérialistes (le bloc de l'Ouest va lui aussi être touché, même si c'est à un degré moindre et à un rythme moins frénétique, par les convulsions et l'instabilité, cela est inévitable dans la mesure où son fondement, sa raison d'être principale, l'autre bloc, a cessé d'exister) que les conditions dans lesquelles se déroulaient jusqu'à présent les combats de classe.
Dans un premier temps, cette période nouvelle va être une période difficile pour le prolétariat, car en dehors du poids accru de la mystification démocratique, et ce y compris à l’Ouest, il va être confronté à la nécessité de comprendre les nouvelles conditions dans lesquelles son combat va se dérouler. Cela prendra inévitablement du temps, d'où la profondeur du recul dont parlent les "thèses". Il va devoir en particulier s'affronter de façon frontale à la mystification démocratique et notamment ses deux piliers les plus pernicieux, la social-démocratie et les syndicats.
La classe ouvrière du coeur du capitalisme, en particulier celle d'Europe occidentale, est la seule en mesure de véritablement confronter et combattre cette mystification, et a de ce fait une responsabilité historique considérablement accrue, à la mesure de la fantastique accélération de l'histoire qui se produit depuis quelques mois. Elle seule peut véritablement aider par le développement de ses luttes les ouvriers de l'Est à surmonter le piège mortel des illusions démocratiques dans lesquelles ils ont tous les risques de s'embourber.
Plus que jamais, la crise économique reste le meilleur allié du prolétariat, le stimulateur de cette confrontation indispensable à la "démocratie". La perspective d'une nouvelle récession ouverte, dont les symptômes avant-coureurs sont en train aujourd'hui de rapidement se développer (Voir l'article Crise économique mondiale : après l'Est, l'Ouest, dans ce numéro), en accélérant le rythme de l'effondrement du coeur du capitalisme, le capitalisme occidental, "en balayant les illusions sur la reprise de l'économie mondiale (...) et en dévoilant la faillite historique de l'ensemble du mode de production capitaliste et non seulement de ses avatars staliniens", va aider le prolétariat à comprendre, d'une part que la crise, l'effondrement à l'Est, n'est qu'une expression de la crise du système capitaliste en général, et d'autre part que lui seul détient la solution à la crise historique, à la décomposition généralisée du capitalisme.
Non seulement les attaques redoublées des conditions de vie du prolétariat vont contraindre la classe ouvrière à reprendre et à élargir ses luttes, mais elles vont, plus encore, face à la faillite évidente du capitalisme "libéral" et "démocratique" le contraindre à inscrire ses luttes dans ce qui reste plus que jamais la seule perspective : la révolution communiste mondiale. Plus que jamais, dans ce chaos, l'avenir appartient au prolétariat.
RN. 19/11/89
Géographique:
Questions théoriques:
- Décomposition [3]
Heritage de la Gauche Communiste:
Effondrement du bloc de l'Est : des difficultés accrues pour le prolétariat
- 6490 reads
Le stalinisme a constitué le fer de lance de la plus terrible contre-révolution subie par le prolétariat au cours de son histoire. Une contre-révolution qui a permis en particulier la plus grande boucherie de tous les temps, la deuxième guerre mondiale, et l'enfoncement de toute la société dans une barbarie sans exemple par le passé. Aujourd'hui, avec l'effondrement économique et politique des pays dits "socialistes", avec la disparition de fait du bloc impérialiste dominé par l'URSS, le stalinisme, comme forme d'organisation politico-économique du capital et comme idéologie, est en train d'agoniser. C'est donc un des plus grands ennemis de la classe ouvrière qui disparaît. Mais la disparition de cet ennemi ne facilite pas pour autant la tâche de celle-ci. Au contraire, dans sa mort elle-même, le stalinisme vient rendre un dernier service au capitalisme. C'est ce que se propose de mettre en évidence le présent article.
Dans toute l'histoire humaine le stalinisme constitue le phénomène certainement le plus tragique et haïssable qui n’ait jamais existé. Il en est ainsi non seulement parce qu'il porte la responsabilité directe du massacre de dizaines de millions d'êtres humains, parce qu'il a instauré pendant des décennies une terreur implacable sur près d'un tiers de l'humanité, mais aussi, et surtout, parce qu'il s'est illustré comme le pire ennemi de la révolution communiste, c'est-à-dire de la condition de l'émancipation de l'espèce humaine des chaînes de l'exploitation et de l'oppression, au nom justement de cette même révolution communiste. Parce que, ce faisant, il a été le principal artisan de la destruction de la conscience de classe au sein du prolétariat mondial lors de la plus terrible période de contre-révolution de son histoire.
Le rôle du stalinisme dans la contre-révolution
Depuis qu'elle a établi sa domination politique sur la société, la bourgeoisie a toujours vu dans le prolétariat son pire ennemi. Par exemple, au cours même de la révolution bourgeoise de la fin du 18eme siècle, dont on vient de célébrer en grandes pompes le Bicentenaire, la classe capitaliste a tout de suite compris le caractère subversif des idées d'un Babeuf. C'est pour cela qu'elle l'a envoyé sur l'échafaud, même si, à l'époque, son mouvement ne pouvait constituer une réelle menace pour l'Etat capitaliste ([1] [5]). Toute l'histoire de la domination bourgeoise est marquée par les massacres d'ouvriers perpétrés dans le but de protéger cette domination : massacre des canuts de Lyon en 1831, des tisserands de Silésie en 1844, des ouvriers parisiens de juin 1848, des communards en 1871, des insurgés de 1905 dans tout l'empire russe. Pour ce type de besogne la bourgeoisie a toujours pu trouver dans ses formations politiques classiques les hommes de main dont elle avait besoin. Mais lorsque la révolution prolétarienne a été inscrite à l'ordre du jour de l'histoire, elle ne s'est pas contentée de faire appel à ces seules formations pour préserver son pouvoir. Il est revenu à des partis traîtres, à des organisations que le prolétariat s'était données en d'autres temps, la responsabilité d'épauler les partis bourgeois traditionnels, ou même de prendre leur tête. Le rôle spécifique de ces nouvelles recrues de la bourgeoisie, la fonction pour laquelle ils étaient indispensables et irremplaçables, consistait en leur capacité, du fait même de leur origine et de leur appellation, à exercer un contrôle idéologique sur le prolétariat afin de saper sa prise de conscience et de l'embrigader sur le terrain de la classe ennemie. Ainsi l'honneur insigne de la Social-Démocratie en tant que parti bourgeois, son plus grand fait d'armes, ne réside pas tellement dans son rôle de responsable direct des massacres du prolétariat à partir de janvier 1919 à Berlin (où, comme ministre des armées, le social-démocrate Noske a parfaitement assumé sa responsabilité de "chien sanglant", suivant le terme dont il s'est lui même qualifié), mais bien déjà comme sergent-recruteur de la première guerre mondiale, et, par la suite, comme agent de mystification de la classe ouvrière, de division et de dispersion de ses forces, face à la vague révolutionnaire qui a mis fin et succédé à l'holocauste impérialiste. En effet, seule la trahison de l'aile opportuniste qui dominait la plupart des partis de la 2e Internationale, seul son passage avec armes et bagages dans le camp bourgeois a rendu possible l'embrigadement, au nom de la "défense de la civilisation", du prolétariat européen derrière la "défense nationale" et le déchaînement de ce carnage. De même, la politique de ces partis, qui continuaient à se prétendre "socialistes" et avaient conservé de ce fait une influence importante sur ce même prolétariat, a joué un rôle essentiel dans le maintien en son sein des illusions réformistes et démocratiques qui l'ont désarmé et lui ont interdit de suivre l'exemple donné par les ouvriers de Russie en octobre 17.
Au cours de cette période, les éléments et fractions qui s'étaient dressés contre une telle trahison, qui avaient maintenu debout, contre vents et marées, le drapeau de l'internationalisme et de la révolution prolétarienne, s'étaient regroupés au sein des partis communistes, sections de la 3e Internationale. Mais il revenait à ces mêmes partis de jouer, dans la période suivante, un rôle semblable à celui des partis socialistes. Rongés par l'opportunisme dont l'échec de la révolution mondiale avait ouvert en grand les portes, fidèles exécutants de la direction d'une "internationale" qui après avoir impulsé de façon vigoureuse cette révolution, se transformait toujours plus en simple instrument de la diplomatie de l'Etat russe à la recherche de son intégration dans le monde bourgeois, les partis communistes ont suivi le même chemin que leurs prédécesseurs. A l'image des partis socialistes, ils ont fini par s'intégrer complètement dans l'appareil politique du capital national de leurs pays respectifs. Mais, au passage, ils ont participé à la défaite des derniers soubresauts de la vague révolutionnaire de l'après-guerre, comme en Chine en 1927-28, et surtout ils ont contribué de façon décisive à la transformation de la défaite de la révolution mondiale en une terrible contre-révolution.
En effet, après cette défaite, la contre-révolution, la démoralisation et le déboussolement du prolétariat étaient inévitables. Cependant, la forme qu'a prise la contre-révolution en URSS même - non pas le renversement du pouvoir qui était sorti de la révolution d'octobre 1917, mais une dégénérescence de ce pouvoir et du parti qui le détenait - a conféré à celle-ci une étendue et une profondeur incomparablement plus importantes que si la révolution avait succombé sous les coups des armées blanches. Le parti communiste d'union soviétique (PCUS), qui avait constitué l'avant-garde incontestable du prolétariat mondial, aussi bien dans la révolution de 1917 que dans la fondation de l'Internationale communiste en 1919, s'est converti, suite à son intégration dans l'Etat post-révolutionnaire et sa confusion avec lui, en principal agent de la contre-révolution en URSS, en véritable bourreau de la classe ouvrière ([2] [6]). Mais auréolé du prestige de ses hauts faits d'armes passés, il a continué de faire illusion auprès de la majorité des autres partis communistes et de leurs militants, de même que dans les grandes masses du prolétariat mondial. C'est grâce à ce prestige, dont les partis communistes des autres pays récupèrent une part, que pourront être tolérées par ces militants et ces masses toutes les trahisons que le stalinisme va accomplir dans cette période. En particulier, l'abandon de l'internationalisme prolétarien sous couvert de la "construction du socialisme en un seul pays", l'identification au "socialisme" du capitalisme qui s'est reconstitué en URSS sous ses formes les plus barbares, la soumission des luttes du prolétariat mondial aux impératifs de la défense de la "patrie socialiste" et, en fin de compte, à la défense de la "démocratie" contre le fascisme, tous ces mensonges et toutes ces mystifications n'ont, pour une grande part, pu abuser les masses ouvrières que parce qu'ils étaient véhiculés par les partis qui continuaient à se présenter comme les héritiers "légitimes" de la révolution d'Octobre, alors qu'ils en étaient les assassins. C'est ce mensonge - l'identification entre stalinisme et communisme - probablement le plus grand de l'histoire, et en tout cas le plus répugnant, auquel tous les secteurs de la bourgeoisie mondiale ont prêté leur concours ([3] [7]), qui a permis que la contre-révolution atteigne l'ampleur qu'on lui a connue, paralysant plusieurs générations d'ouvriers, les livrant pieds et poings liés à la deuxième boucherie impérialiste, venant à bout des fractions communistes qui avaient lutté contre la dégénérescence de l'Internationale communiste et de ses partis, ou bien les réduisant à l'état de petits noyaux complètement isolés.
En particulier, au cours des années 1930, c'est aux partis staliniens qu'on doit une part considérable du travail consistant à dévoyer sur un terrain bourgeois la colère et la combativité des ouvriers brutalement frappés par la crise économique mondiale. Cette crise, par l'ampleur et l'acuité qu'elle a revêtues, était le signe indiscutable de la faillite historique du mode de production capitaliste et aurait pu, à ce titre et dans d'autres circonstances, constituer le levier d'une nouvelle vague révolutionnaire. Mais la majorité des ouvriers qui voulaient se tourner vers une telle perspective sont restés prisonniers des nasses du stalinisme qui prétendait représenter la tradition de la révolution mondiale. Au nom de la défense de la "patrie socialiste" et au nom de l’antifascisme, les partis staliniens ont systématiquement vidé de tout contenu de classe les combats prolétariens de cette période et les ont convertis en forces d'appoint de la démocratie bourgeoise, quand ce n'était pas en préparatifs de la guerre impérialiste. Tel fut le cas, en particulier, des épisodes des "fronts populaires" en France et en Espagne, où une énorme combativité ouvrière fut dévoyée et anéantie par l'anti-fascisme qui se prétendait "ouvrier", colporté principalement par les staliniens. Dans ce dernier cas les partis staliniens ont fait la preuve que, en dehors même de l'URSS, où depuis des années déjà ils jouaient le rôle du bourreau, ils valaient bien, et dépassaient même de loin, leurs maîtres social-démocrates dans la tâche de massacreurs du prolétariat (voir en particulier leur rôle dans la répression du soulèvement du prolétariat de Barcelone en mai 1937 ; cf. l'article "Plomb, mitraille, prison..." dans la Revue Internationale n° 7). Au nombre des victimes dont il porte directement la responsabilité à l'échelle mondiale, le stalinisme vaut bien le fascisme, cette autre manifestation de la contre-révolution. Mais son rôle anti-ouvrier aura été bien plus considérable puisqu'il aura assumé ses crimes au nom même de la révolution communiste et du prolétariat, provoquant au sein de celui-ci un recul de sa conscience de classe sans égal dans l'histoire.
En fait, alors qu'à la fin et à la suite de la première guerre impérialiste, au moment où se développait la vague révolutionnaire mondiale, l'impact des partis communistes était directement en rapport avec la combativité et surtout la conscience dans l'ensemble du prolétariat, l'évolution de leur influence, à partir des années 1930, est en proportion inverse de la conscience dans la classe. Au moment de leur fondation, la force des partis communistes constituait, en quelque sorte, un thermomètre de la puissance de la révolution ; après qu'ils aient été vendus à la bourgeoisie par le stalinisme, la force des partis qui continuaient à se dénommer "communistes" ne faisait que mesurer la profondeur de la contre-révolution.
C'est pour cela que le stalinisme n'a jamais été aussi puissant qu'au lendemain de la seconde guerre mondiale. Cette période, en effet, constitue le point culminant de la contre-révolution. Grâce en particulier aux partis staliniens, auxquels la bourgeoisie devait d'avoir pu déchaîner une nouvelle fois le carnage impérialiste et qui s'en sont faits les meilleurs sergents-recruteurs avec les mouvements de "résistance", cette boucherie, contrairement à la première, n'a pas abouti à un surgissement révolutionnaire du prolétariat. L'occupation d'une bonne partie de l'Europe par l'"Armée rouge" ([4] [8]), d'une part, la participation des partis staliniens aux gouvernements de la "Libération", d'autre part, ont permis de faire taire toute velléité de combat du prolétariat sur son terrain de classe, par la terreur ou par la mystification, ce qui l'a plongé dans un désarroi encore plus profond que celui qu'il subissait à la veille de la guerre. Dans celle-ci, la victoire des alliés, à laquelle le stalinisme a apporté toute sa contribution, loin de déblayer le terrain pour la classe ouvrière (comme le prétendaient les trotskystes pour justifier leur participation à la "Résistance"), n'a fait que l'enfoncer encore plus dans la soumission absolue à l'idéologie bourgeoise. Cette victoire, présentée comme celle de la "Démocratie" et de la "Civilisation" sur la barbarie fasciste, a permis à la bourgeoisie de redorer de façon considérable le blason des illusions démocratiques et de la croyance en un capitalisme "humain" et "civilisé". Elle a ainsi prolongé de plusieurs décennies la nuit de la contre-révolution.
Ce n'est d'ailleurs nullement le fait du hasard si la fin de cette contre-révolution, la reprise historique des combats de classe à partir de 1968, coïncide avec un affaiblissement important, dans l'ensemble du prolétariat mondial, de l'emprise du stalinisme, du poids des illusions sur la nature de l'URSS et des mystifications antifascistes. Ce fait est particulièrement parlant dans les deux pays occidentaux où existaient les partis "communistes" les plus puissants et où se déroulent les combats les plus significatifs de cette reprise : la France en 1968 et l'Italie en 1969.
L'utilisation par la bourgeoisie de l'effondrement du stalinisme
Cet affaiblissement de l'emprise idéologique du stalinisme sur la classe ouvrière résulte pour une bonne part de la découverte par les ouvriers de la réalité des régimes qui se prétendaient "socialistes". Dans les pays dominés par ces régimes, c'est évidemment de façon très rapide que la classe ouvrière a pu constater que le stalinisme comptait parmi ses pires ennemis. Dès 1953 en Allemagne de l'Est, 1956 en Pologne et en Hongrie, les révoltes ouvrières, et leur répression sanglante, ont apporté la preuve que, dans ces pays, les ouvriers ne se faisaient pas d'illusions sur le stalinisme. Ces événements (de même aussi que l'intervention armée du pacte de Varsovie en Tchécoslovaquie en 1968) ont contribué également à ouvrir les yeux d'un certain nombre d'ouvriers en Occident sur la nature du stalinisme ([5] [9]), mais bien moins que les luttes de 1970, 76 et dans la place occupée par la guerre impérialiste dans leurs origines respectives. La nature ouvrière de la révolution d'Octobre est illustrée par le fait qu'elle surgit CONTRE la guerre impérialiste. La nature anti ouvrière et capitaliste des "démocraties populaires" est contresignée par le fait qu'elles sont instaurées GRACE à la guerre impérialiste. (5) Ce n'est évidemment pas le seul facteur permettant d'expliquer l'usure de l'impact du stalinisme dans la classe ouvrière, de même que de l'ensemble des mystifications bourgeoises, entre la fin de la guerre et le resurgisse ment historique du prolétariat, à la fin des années 60. D'ailleurs, dans beaucoup de pays (notamment ceux d'Europe du Nord), le stalinisme ne jouait plus, depuis la seconde guerre mondiale, qu'un rôle très secondaire par rapport à celui de la Social-démocratie dans l'encadrement des ouvriers. L'affaiblissement des mystifications antifascistes, faute de l'existence dans la majorité des pays d'un épouvantait "fasciste", de même que l'usure de l'influence des syndicats (qu'ils soient staliniens ou socio-démocrates) déjà mis fortement à contribution au cours des années 60 pour saboter les luttes, permet également d'expliquer l'amoindrissement de l'impact du stalinisme, comme de la Social-démocratie, sur le prolétariat, ce qui a permis à ce dernier, dès les premières attaques de la crise ouverte, de ressurgir sur la scène historique.
Un autre élément qui a contribué à l'usure des mystifications staliniennes est constitué par la mise en évidence, par ces luttes ouvrières, de la faillite de l'économie "socialiste". Cependant, au fur et à mesure que se confirmait cette faillite, et que reculaient d'autant les mystifications staliniennes, la bourgeoisie occidentale en profitait pour développer ses campagnes sur le thème de la "supériorité du capitalisme sur le socialisme". De même, les illusions démocratiques et syndicalistes que les ouvriers de Pologne subissaient de plein fouet ont été pleinement exploitées, notamment à partir de 1980 avec la formation du syndicat "Solidarnosc", pour redorer leur blason auprès des ouvriers d'Occident. C'est en particulier le renforcement de ces illusions, accentué encore par la répression de décembre 1981 et la mise hors-la-loi de "Solidarnosc", qui permet de comprendre le désarroi et le recul de la classe ouvrière du début des années 1980.
Le surgissement, à partir de l'automne 1983, d'une nouvelle vague de luttes massives dans la plupart des pays occidentaux développés, et particulièrement en Europe de l'Ouest, la simultanéité même de ces combats à l'échelle internationale, faisaient la preuve que la classe ouvrière était en train de se dégager de l'emprise des illusions et des mystifications qui l'avaient paralysée dans la période précédente. En particulier, le débordement des syndicats, et même leur rejet, qui s'étaient manifestés notamment lors de la grève dans les chemins de fer en France, fin 1986, et lors de la grève dans l'enseignement en Italie, en 1987, la mise en place par les gauchistes, dans ces mêmes pays et dans certains autres, de structures d'encadrement se présentant comme "non syndicales", les "coordinations", révélaient l'affaiblissement des mystifications syndicalistes. Dans la même période, cet affaiblissement s'accompagnait de celui des mystifications électorales, de plus en plus évidentes à travers la croissance des taux d'abstention lors des diverses élections, notamment dans les circonscriptions ouvrières. Mais aujourd'hui, grâce à l'effondrement des régimes staliniens, et au déchaînement des campagnes médiatiques qu'il permet, la bourgeoisie a réussi à renverser la tendance qui s'était manifestée dans tout le milieu des années 1980.
En effet, si les événements de Pologne de 1980-81, non pas les luttes ouvrières, bien sûr mais le pièce syndicaliste et démocratique qui s'était refermé sur elles (ainsi que la répression à laquelle ce piège avait ouvert le chemin), avaient permis à la bourgeoisie de provoquer une très sensible désorientation au sein du prolétariat des pays les plus avancés, l'effondrement général et historique du stalinisme qui se déroule aujourd'hui ne peut conduire qu'à un désarroi encore plus important.
Il en est ainsi parce que les événements actuels se situent à une toute autre échelle que ceux de Pologne en 1980. Ce n'est pas un seul pays qui en est le théâtre. Ce sont tous les pays d'un bloc impérialiste, à commencer par le plus important d'entre eux, l'URSS, qui sont aujourd'hui concernés. La propagande stalinienne pouvait présenter les difficultés du régime en Pologne comme le résultat des "erreurs" de Gierek. Aujourd'hui, personne, à commencer par les nouveaux dirigeants de ces pays, ne songe à faire porter aux politiques menées ces dernières années par les dirigeants déchus la responsabilité totale des difficultés de leurs régimes. Ce qui est en cause, aux dires mêmes de beaucoup de ces dirigeants, notamment ceux de Hongrie, c'est l'ensemble de la structure de l'économie et des pratiques politiques aberrantes qui ont marqué les régimes staliniens depuis leur origine. Une telle reconnaissance de la faillite de ces derniers par ceux qui se trouvent à leur tête est évidemment pain béni pour les campagnes médiatiques de la bourgeoisie occidentale.
La deuxième raison pour laquelle la bourgeoisie est en mesure d'utiliser à fond, et de façon efficace, l'effondrement du stalinisme et du bloc qu'il dominait, réside dans le fait que cet effondrement ne résulte pas de l'action de la lutte de classe mais d'une faillite complète de l'économie de ces pays. Dans les événements considérables qui se produisent à l'heure actuelle dans les pays de l'Est, le prolétariat, en tant que classe, en tant que porteur d'une politique antagonique au capitalisme, est douloureusement absent. En particulier, les grèves ouvrières qui se sont produites l'été dernier dans les mines en URSS, font plutôt figure d'exception et révèlent, par le poids des mystifications qui ont pesé sur elles, la faiblesse politique du prolétariat dans ce pays. Elles étaient essentiellement une conséquence de l'effondrement du stalinisme, et non un facteur actif dans cet effondrement. D'ailleurs, la plupart des grèves qui se sont déroulées ces derniers temps dans ce pays n'ont pas, contrairement à celles des mineurs, comme objet la défense d'intérêts ouvriers, mais se situent sur un terrain nationaliste (pays baltes, Arménie, Azerbaïdjan, etc.), et donc complètement bourgeois. D'autre part, dans les nombreuses manifestations massives qui secouent à l'heure actuelle les pays d'Europe de l'Est, notamment en RDA, en Tchécoslovaquie et en Bulgarie, et qui ont contraint certains gouvernements, à procéder d'urgence à un ravalement, on ne peut percevoir l'ombre d'une seule revendication ouvrière. Ces manifestations sont complètement dominées par des revendications typiquement et exclusivement démocratiques bourgeoises : "élections libres", "liberté", "démission des PC au pouvoir", etc. En ce sens, si l'impact des campagnes démocratiques qui s'étaient développées lors des événements de Pologne en 1980-81 avait été quelque peu limité par le fait qu'ils prenaient leur source dans des combats de classe, l'absence d'une lutte de classe significative dans les pays de l'Est, aujourd'hui, ne peut que renforcer les effets dévastateurs des campagnes actuelles de la bourgeoisie.
A une échelle plus générale, celle de l'effondrement de tout un bloc impérialiste, dont les répercussions seront énormes, le fait que cet événement historique considérable se soit produit indépendamment de la présence du prolétariat ne peut engendrer au sein de celui-ci qu'un sentiment d'impuissance, même si cet événement n'a pu advenir, comme le montrent les thèses publiées dans ce numéro, qu'à cause de l'incapacité pour la bourgeoisie d'embrigader au niveau mondial, jusqu'à présent, la classe ouvrière dans un troisième holocauste impérialiste. C'est la lutte de classe qui, après avoir renversé le tsarisme, puis la bourgeoisie, en Russie, avait mis fin à la première guerre mondiale en provoquant l'effondrement de l'Allemagne impériale. C'est pour cette raison, en grande partie, qu'a pu se développer à l'échelle mondiale la première vague révolutionnaire. En revanche, le fait que la lutte de classe n'ait été qu'un facteur de deuxième ordre dans l'effondrement des pays de "l'Axe" et dans la fin de la seconde guerre mondiale a joué un rôle important dans la paralysie et le déboussolement du prolétariat au lendemain de celle-ci. Aujourd'hui, il n'est pas indifférent que le bloc de l'Est se soit effondré sous les coups de la crise économique et non sous les coups de la lutte de classe. Si cette deuxième alternative avait prévalu, cela n'aurait pu que renforcer la confiance en soi du prolétariat, et non l'affaiblir comme c'est le cas à l'heure actuelle. En outre, dans la mesure ou l'effondrement du bloc de l'Est fait suite à une période de "guerre froide" avec le bloc de l'Ouest, où ce dernier apparaît comme le "vainqueur", sans coup férir, d'une telle "guerre", cela va engendrer dans les populations d'Occident, et aussi parmi les ouvriers, un sentiment d'euphorie et de confiance envers leurs gouvernements similaire (toutes proportions gardées) à celui qui avait pesé sur le prolétariat des pays "vainqueurs" lors des deux guerres mondiales et qui avait même constitué une des causes de l'échec de la vague révolutionnaire qui avait suivi la première.
Une telle euphorie, catastrophique pour la conscience du prolétariat, sera évidemment beaucoup plus limitée du fait même que le monde ne sort pas aujourd'hui d'un carnage impérialiste. Cependant, les conséquences néfastes de la situation actuelle seront renforcées par l'euphorie qui est celle des populations d'un certain nombre de pays de l'Est, et qui n'est pas sans impact à l'Ouest. Ainsi, lors de l'ouverture du mur de Berlin, symbole par excellence de la terreur que le stalinisme à imposée aux populations des pays qu'il dirigeait, la presse et certains hommes politiques ont comparé l'ambiance qui régnait dans cette ville à celle de la "Libération". Ce n'est nullement un hasard : les sentiments éprouvés par les populations d'Allemagne de l'Est lors du renversement de ce symbole étaient comparables à ceux des populations qui avaient subi pendant des années l'occupation et la terreur de l'Allemagne nazie. Mais comme l'histoire nous l'a montré, ce type de sentiments et d'émotions comptent parmi les pires obstacles pour la prise de conscience par le prolétariat. La satisfaction éprouvée par les habitants des pays de l'Est devant l'effondrement du stalinisme, et surtout le renforcement des illusions démocratiques qu'elle va permettre, se répercutera, et se répercute déjà, fortement sur le prolétariat des pays d'Occident, et tout particulièrement sur celui d'Allemagne dont le poids est particulièrement important au sein du prolétariat mondial dans la perspective de la révolution prolétarienne. En outre le prolétariat de ce pays devra, dans la période qui vient, affronter le poids des mystifications nationalistes que la perspective d'une réunification de l'Allemagne, même si elle n'est pas encore, pratiquement, à l'ordre du jour, ne pourra que renforcer.
Ces mystifications nationalistes sont, d'ores et déjà, particulièrement fortes parmi les ouvriers de la plupart des pays de l'Est. Elles n'existent pas uniquement au sein des différentes républiques qui constituent l'URSS. Elles pèsent aussi lourdement sur les ouvriers des "démocraties populaires", du fait, notamment, de la façon particulièrement brutale dont s'est exercée sur elles la domination impérialiste du "Grand Frère". Les interventions sanglantes des tanks russes en RDA en 1953, en Hongrie en 1956, en Tchécoslovaquie en 1968, de même que le pillage en règle qu'ont subi les économies des pays "satellites" durant des décennies n'ont pu qu'alimenter de telles mystifications. A côté des illusions démocratiques et syndicales, elles ont contribué pour beaucoup, en 1980-81, au déboussolement des ouvriers de Pologne qui a ouvert la porte à l'écrasement de décembre 1981. Avec la dislocation du bloc de l'Est à laquelle on assiste aujourd'hui, elles connaîtront un nouveau souffle rendant encore plus difficile la prise de conscience des ouvriers de ces pays. Ces mystifications nationalistes vont peser également sur les ouvriers d'Occident, non pas nécessairement (à part le cas de l'Allemagne) par un renforcement direct du nationalisme dans leurs rangs, mais par le discrédit et l'altération que va subir dans leur conscience l'idée même d'internationalisme prolétarien. En effet, cette notion a été dénaturée complètement par le stalinisme, et dans sa foulée par l'ensemble des forces bourgeoises, qui l'ont identifié avec la domination impérialiste de l'URSS sur son bloc. C'est ainsi que, en 1968, l'intervention des tanks du pacte de Varsovie en Tchécoslovaquie a été menée au nom de "l’internationalisme prolétarien". L'effondrement et le rejet par les populations des pays de l'Est de "l’internationalisme" à la mode stalinienne, ne pourra que peser négativement sur la conscience des ouvriers de l'Ouest, et cela d'autant plus que la bourgeoisie occidentale ne manquera pas une occasion d'opposer à l'internationalisme prolétarien véritable, sa propre "solidarité internationale", comprise comme soutien aux économies de l'Est en détresse (quand ce ne sera pas d'appels à la charité) ou aux "revendications démocratiques" de leurs populations lorsque celles-ci se heurteront à des répressions brutales (on se souvient des campagnes à propos de la Pologne en 1981, à propos de la Chine encore récemment).
En fait, et nous touchons là le coeur des campagnes que la bourgeoisie déchaîne à l'heure actuelle, leur objectif ultime et fondamental, c'est la perspective même de la révolution communiste mondiale qui est affectée par l'effondrement du stalinisme. L'internationalisme n'est qu'un des éléments de cette perspective. La rengaine que nous assènent à en vomir les médias : "le communisme est mort, il a fait faillite", résume le message fondamental dont les bourgeois de tous les pays veulent bourrer le crâne des ouvriers qu'ils exploitent. Et le mensonge sur lequel s'était déjà faite l'unanimité de toutes les forces bourgeoises par le passé, aux pires moments de la contre-révolution, l'identification entre le communisme et le stalinisme, est repris encore avec la même unanimité à l'heure actuelle. Cette identification avait permis dans les années 1930 à la bourgeoisie d'embrigader la classe ouvrière derrière ce dernier afin de parachever sa défaite. Aujourd'hui, au moment où le stalinisme est complètement déconsidéré aux yeux de tous les ouvriers, ce même mensonge lui sert pour les détourner de la perspective du communisme.
Dans les pays de l'Est, il y a déjà longtemps que la classe ouvrière subit un tel désarroi : lorsque le terme de "dictature" du prolétariat recouvre la terreur policière, que "pouvoir de la classe ouvrière" signifie pouvoir cynique des bureaucrates, que "socialisme" désigne exploitation brutale, misère, pénuries et gabegie, lorsqu'à l'école on doit apprendre par coeur des citations de Marx ou de Lénine, on ne peut que se détourner de telles notions, c'est-à-dire rejeter ce qui constitue le fondement même de la perspective historique du prolétariat, refuser catégoriquement d'étudier les textes de base du mouvement ouvrier, les termes mêmes de "mouvement ouvrier" et de "classe ouvrière" étant perçus comme des obscénités. Dans un tel contexte, l'idée même d'une révolution du prolétariat est complètement discréditée. "A quoi bon vouloir recommencer comme en Octobre 1917, si c'est pour parvenir, en fin de compte, à la barbarie stalinienne". Tel est le sentiment qui domine aujourd'hui chez pratiquement tous les ouvriers des pays de l'Est. Ce que vise à l'heure actuelle la bourgeoisie des pays occidentaux, grâce à l'effondrement et l'agonie du stalinisme, c'est de développer un déboussolement similaire parmi les ouvriers d'Occident. Et la faillite de ce système est tellement évidente et spectaculaire qu'elle y parvient pour une bonne part.
Ainsi, l'ensemble des événements qui secouent les pays de l'Est, et qui se répercutent sur le monde entier, vont peser pendant toute une période de façon négative sur la prise de conscience de la classe ouvrière. Dans un premier temps, l'ouverture du "rideau de fer" qui séparait en deux le prolétariat mondial ne permettra pas aux ouvriers d’Occident de faire bénéficier leurs frères de classe des pays de l'Est de leur expérience acquise dans les luttes face aux pièges et mystifications déployés par la bourgeoisie la plus forte du monde. Au contraire, ce sont les illusions démocratiques particulièrement fortes parmi les ouvriers de l'Est, ce sont leurs croyances à propos de la "supériorité du capitalisme sur le socialisme", qui vont venir se déverser à l'Ouest, affaiblissant dans l'immédiat, et pour un moment, les acquis de l'expérience du prolétariat de cette partie du monde. C'est pour cela que l'agonie de cet instrument par excellence de la contre-révolution que fut le stalinisme est aujourd'hui retournée par la bourgeoisie contre la classe ouvrière.
Les perspectives pour la lutte de classe
L'effondrement des régimes staliniens, résultant, pour l'essentiel, de la faillite totale de leur économie, ne pourra, dans un contexte mondial d'approfondissement de la crise capitaliste, qu'aggraver cette faillite. Cela signifie pour la classe ouvrière de ces pays des attaques et une misère sans précédent, même des famines. Une telle situation provoquera nécessairement des explosions de colère. Mais le contexte politique et idéologique est tel dans les pays de l'Est, que la combativité ouvrière ne pourra, durant toute une période, déboucher sur un réel développement de la conscience (voir l'editorial de ce numéro de la Revue). Le chaos et les convulsions qui s'y développent sur le plan économique et politique, la barbarie et le pourrissement sur pieds de l'ensemble de la société capitaliste qu'ils expriment de façon concentrée et caricaturale, ne pourront pas déboucher sur la compréhension de la nécessité de renverser ce système, tant qu'une telle compréhension ne se sera pas développée parmi les bataillons décisifs du prolétariat dans les grandes concentrations ouvrières d'Occident, et particulièrement en Europe de l'Ouest ([6] [10]).
A l'heure actuelle, comme on l'a vu, ces secteurs eux-mêmes du prolétariat mondial subissent de plein fouet le déchaînement des campagnes bourgeoises et sont affectés par un recul de leur conscience. Cela ne veut pas dire qu'ils seront dans l'incapacité de mener le combat contre les attaques économiques du capitalisme dont la crise mondiale est irréversible. Cela signifie avant tout que, durant un certain temps, ces luttes seront, beaucoup plus qu'au cours de ces dernières années, prisonnières des organes d'encadrement de la classe ouvrière, et en premier lieu des syndicats, comme on peut déjà le constater dans les combats les plus récents. En particulier, les syndicats vont encaisser les bénéfices du renforcement général des illusions démocratiques. Ils vont également trouver un terrain bien plus propice à leurs manoeuvres avec le développement de l'idéologie réformiste résultant du renforcement des illusions sur le thème de la "supériorité du capitalisme" vis-à-vis de toute autre forme de société.
Cependant, le prolétariat d'aujourd'hui n'est pas celui des années 1930. Il ne sort pas d'une défaite comme celle qu'il a subie après la vague révolutionnaire du premier après-guerre. La crise mondiale du capitalisme est insoluble. Elle ne pourra aller qu'en s'aggravant (voir l'article sur la crise économique dans ce même numéro de la Revue) : après l'effondrement du "Tiers monde" à la fin des années 1970, après l'implosion actuelle des économies dites "socialistes", le prochain secteur du capital mondial à se trouver sur la liste est celui des pays les plus développés qui avaient pu, en partie, donner le change jusqu'à présent en reportant le plus gros des convulsions du système vers sa périphérie. La mise en évidence inévitable de la faillite complète, non d'un secteur particulier du capitalisme, mais de l'ensemble de ce mode de production ne pourra que saper les bases mêmes des campagnes de la bourgeoisie occidentale sur la "supériorité du capitalisme". A terme, le développement de sa combativité devra déboucher sur un nouveau développement de sa conscience, développement interrompu et contrecarré aujourd'hui par l'effondrement du stalinisme. Il appartient aux organisations révolutionnaires de contribuer de façon déterminée à ce développement, non pas en essayant aujourd'hui de consoler les ouvriers, mais en mettant clairement en évidence que, malgré la difficulté du chemin, il n'en existe pas d'autre pour le prolétariat que celui qui conduit à la révolution communiste.
F.M. 25/11/89
[1] [11] Il est significatif que la bourgeoisie française, "révolutionnaire" et "démocratique", n'ait pas hésité à bafouer la "Déclaration des droits de l'Homme" qu'elle venait à peine d'adopter (et dont on fait grand cas aujourd'hui) en interdisant toute association ouvrière (loi Le Chapelier du 14 juin 1791). Cette interdiction ne sera abrogée que près d'un siècle plus tard, en 1884.
[2] [12] Ce n'est pas sans résistance, dans la classe ouvrière et au sein même du parti bolchevik, que s'est produite la dégénérescence et la trahison de celui-ci. En particulier, une grande proportion des militants et la presque totalité des dirigeants du parti d'Octobre 1917 ont été exterminés par le stalinisme. Sur cette question voir en particulier les articles "La dégénérescence de la révolution russe" et "La gauche communiste en Russie" dans la Revue Internationale, n° 3 et n° 8 et 9.
[3] [13] Dans la seconde moitié des années 20 et tout au long des années 30, la bourgeoisie "démocratique" d'Occident a été loin de manifester la même répugnance vis-à-vis du stalinisme "barbare" et "totalitaire" qu'elle a affichée à partir de la "guerre froide", et qu'elle continue d'exhiber aujourd'hui dans ses campagnes. Elle a en particulier apporté à Staline un soutien sans faille dans les persécutions qu'il a déchaînées contre l'"Opposition de gauche" et son principal dirigeant, Trotsky. Pour ce dernier, après son expulsion d'URSS en 28, le monde est devenu une "planète sans visa". A son égard, tous les "démocrates" du monde, et en première ligne les socio-démocrates qui étaient au gouvernement en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Norvège, en Suède, en Belgique ou en France, ont fait une nouvelle fois la preuve de leur hypocrisie répugnante en s'asseyant sur leurs "vertueux principes" tels que le "Droit d'asile". Ce beau monde n'a pas trouvé grand chose à redire lors des procès de Moscou où Staline a liquidé la vieille garde du parti bolchevik en l'accusant d'"hitléro-trotskysme". Ces "belles âmes" ont même poussé l'abjection jusqu'à laisser entendre qu'"il n'y avait pas de fumée sans feu".
[4] [14] Une preuve supplémentaire, s'il en fallait, du fait que les régimes qui s'installent dans les pays d'Europe de l'Est au lendemain de la seconde guerre mondiale (de même, évidemment que le régime qui existe alors en URSS) n'ont rien à voir avec le régime instauré en Russie en 1917, réside
[5] [15] en Pologne, qui, parce qu'elles se situaient beaucoup plus directement sur un terrain de classe et qu'elles prenaient place à un moment de reprise mondiale des combats ouvriers, ont pu dévoiler de façon beaucoup plus claire au prolétariat des pays occidentaux, la nature anti-ouvrière des régimes staliniens. C'est d'ailleurs pour cette raison que les partis staliniens d'Occident ont pris quelque distance, lors de ces combats, avec la répression dont ces derniers ont fait l'objet de la part des Etats "socialistes".
[6] [16] Voir notre analyse sur cette question dans l'article "Le prolétariat d'Europe occidentale au centre de la généralisation de la lutte de classe" de la Revue Internationale, n° 31.
Géographique:
Questions théoriques:
- Le cours historique [17]
Heritage de la Gauche Communiste:
Crise économique mondiale : après l'est, l'ouest
- 6497 reads
L’"équilibre" sur lequel les impérialismes planétaires reposaient depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, depuis Yalta, vient de basculer avec l'effondrement économique de l'URSS et l'implosion consécutive de son bloc. Face à la débandade économique de son rival, le bloc occidental apparaît comme le grand vainqueur; l'abondance exubérante des vitrines des magasins des grands pays industrialisés est le meilleur outil de la propagande occidentale face à la pénurie dramatique qui règne à l'Est. Pourtant, l'illusion de la victoire "économique" de l'Occident risque bien d'être de courte durée, car la crise économique de surproduction généralisée, qui dure depuis plus de vingt ans, est mondiale. Après l'engloutissement des pays sous-développés dans une misère insondable à la fin des années 1970, l'effondrement économique du bloc de l'Est à la fin des années 1980, loin de démontrer la vitalité de l'économie des pays industrialisés de l'Occident, vient au contraire annoncer la catastrophe mondiale à venir, dont le prochain pas décisif sera l'effondrement économique des pays industriels les plus développés. Plus qu'une victoire de l'Ouest, c'est à une défaite de l'Est à laquelle nous assistons. Toute l'évolution de l'économie des pays occidentaux depuis des années promet des lendemains qui déchantent.
Que s'est-il passé le vendredi 13 octobre 1989 ? En une seule séance, Wall Street perdait 7 %, et ce malgré toutes les mesures mises en place au lendemain de l'effondrement de l’automne 1987 pour éviter que celui-ci ne se renouvelle, malgré l'intervention massive des investisseurs dits "institutionnels", à qui l’Etat américain avait ouvert immédiatement de nouvelles lignes de crédit pour leur permettre de racheter les actions et soutenir ainsi les cours.
Dans la foulée, après un week-end de concertations intensives des grandes banques centrales des principales économies du bloc occidental, ce sont, le lundi 15 octobre, Francfort qui perd 13 %, Paris 6,9 %, Londres 4,6 %, tandis que Tokyo résiste. Les mesures conjuguées mises en place par les grandes puissances économiques commencent cependant à faire leur effet : ce même, jour Wall Street tient bon et se redresse à +3,4 %. La semaine qui suit va permettre de stabiliser les cours.
L'alerte a été chaude. 200 milliards de dollars se sont envolés en fumée. Une nouvelle purge a été imposée à la spéculation boursière, mais finalement, malgré l'addition salée, les banques centrales peuvent se réjouir de leur "maîtrise technique", elles ont limité les dégâts. Pourtant, l'euphorie ne règne pas, bien au contraire. Ce nouvel accroc à la spéculation boursière vient raviver les inquiétudes. 1987 n'était pas un accident. Les marchés ont été stabilisés, oui, mais jusqu'à quand ?
Les capitalistes ne sont pas des gens particulièrement superstitieux, mais ils vont finir par le devenir. Le mois d'octobre est décidément propice aux effondrements boursiers : en 1929, déjà, et, plus récemment, en 1987. Pourtant, au-delà de l'aspect répétitif, les conditions qui ont présidé à ces effondrements boursiers ne sont pas identiques. Evidemment, la situation de l'économie mondiale est bien différente dans les années 1980 de ce qu'elle était en 1929, nous ne reviendrons pas sur cet aspect qui a déjà été amplement traité dans la Revue internationale ([1] [18]).
Mais si les mêmes causes, la hausse des taux d'escompte des grandes banques centrales, ont produit les mêmes effets - la raréfaction du crédit ravive la peur de la récession et provoque une panique boursière -, le contexte international entre octobre 1987 et octobre 1989 a bien changé. La dégradation de l'économie américaine s'est accélérée et les déséquilibres mondiaux se sont accentués.
Face a la récession, la fuite en avant dans l'endettement
Durant les années 1970, les crédits largement octroyés aux pays sous-développés de la périphérie ont permis de résorber dans une large mesure la surproduction des pays industrialisés. Cependant, cette politique a trouvé sa limite dans la crise du dollar. Les 900 milliards de dollars empruntés par les pays pauvres d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie ne seront jamais remboursés. L'inflation explose, ravage les économies fragiles écrasées par la dette, leur fait perdre toute solvabilité, les fermant définitivement comme débouchés aux marchandises massivement produites par le monde industriel. Le marché mondial se rétrécit brutalement et, à la suite de l'économie américaine, l'économie de la planète plonge dans la récession au début des années 1980.
La récession est le pire des fléaux pour le capitalisme. Elle signifie la chute de la production, la fermeture des usines, le développement du chômage et une montée vertigineuse des dettes impayées. Elle exprime de manière brutale l'impasse dans laquelle se trouve le capitalisme. Une telle situation met en danger la stabilité du dollar, la monnaie reine du marché mondial, symbole de la puissance américaine. Une telle situation est intenable pour le capitalisme américain, car non seulement elle met en cause sa domination économique, mais aussi sa suprématie impérialiste.
En effet, les USA ne sont pas simplement la première puissance économique du globe, ils sont aussi la force impérialiste dominante du bloc dominant, celui de l'Ouest. Maintenir l'activité économique, la croissance, est une priorité pour l'économie américaine, pour sa propre sauvegarde et celle de ses intérêts économiques et impérialistes. Après deux ans de purge imposée par la politique d'austérité au début de la présidence reaganienne, pour sauver son économie, l'Etat américain va pratiquer une politique de relance. Cette dernière va se faire sur la base des besoins de l'impérialisme américain face à son rival russe. L'invasion de l'Afghanistan par l'Armée Rouge, fin 1979, va marquer un brutal réchauffement des tensions inter-impérialistes, et déterminer les USA à lancer un vaste programme de modernisation des armements.
La reprise américaine va, de ce point de vue, consister en une relance de la production d'armements, un développement de l'économie de guerre. Le budget militaire des USA va se gonfler démesurément et, parallèlement, le déficit budgétaire va se creuser et atteindre une ampleur colossale malgré une réduction draconienne des budgets sociaux.
Cependant, la production d'armement a ceci de particulier qu'elle est une pure destruction de capital qui entrave l'ensemble du développement économique ([2] [19]). En effet, les armes ne sont ni un bien de consommation qui fournit l'entretien et la reproduction de la force de travail, ni un bien de production qui permet une accumulation de capital. La catastrophe économique des pays de l'Est traduit bien cette réalité où la priorité absolue donnée à l'économie de guerre durant des décennies a abouti à l'asphyxie de l'ensemble de l'économie.
Dans une moindre mesure, mais de manière tout aussi tangible, cette réalité s'est également imposée aux USA. Les Etats-Unis ont vu depuis les années 1950 s'éroder leur compétitivité dans la concurrence économique mondiale. Ce n'est certainement pas le moindre des paradoxes que de voir aujourd'hui les pays vaincus de la 2e guerre mondiale, le Japon et l'Allemagne, battre des records de compétitivité. Cette situation est due au fait que ces pays, à l'issue de la guerre qu'ils ont perdue, ont reconstruit leur économie détruite sur une base plus moderne, utilisant les technologies alors les plus avancées, alors que l'appareil productif des USA, au lendemain de la guerre, n'a pas été détruit, mais est usé par l'effort d'armement et se retrouve de fait grandement obsolète, en retard. Cette situation de perte de compétitivité relative après 1945 va encore s'accroître dans les années qui suivent, car les vaincus se sont vu interdire par les traités une politique de réarmement, et ont donc pu investir dans la production sans sacrifier celle-ci aux besoins de l'économie de guerre, tandis que les USA ont entretenu un secteur militaire imposant, qui correspondait à leur rôle et à leur besoin comme chef de bloc impérialiste, grevant ainsi constamment leur compétitivité sur le plan économique.
La politique de la présidence Reagan de relance par l'économie de guerre a donc eu pour principale conséquence d'affaiblir encore plus la compétitivité de l'économie américaine. Les déficits budgétaires destinés à financer l'effort militaire se sont en conséquence doublés de déficits commerciaux qui, eux aussi, ont battu des records tout au long des années 1980. Pour financer ces déficits pharamineux, les USA ont du s'endetter et ils ont pulvérisé les records atteints par les pays les plus endettés jusque-là. Aujourd'hui, l'endettement de pays comme le Brésil ou le Mexique (une centaine de milliards de dollars chacun en 1980), qui avait fait frémir les financiers au début des années 1980, pourrait presque paraître ridicule comparé à la fin des années 1980 : plus de 500 milliards de dollars de dette extérieure et une dette interne dont les estimations oscillent entre 6000 et 8000 milliards de dollars, pour les USA. Le budget annuel américain a été écorné de 170 milliards de dollars pour le paiement de la dette. Cette situation ne peut aller qu'en empirant et la dette en grossissant.
Tout à fait significatif de l'affaiblissement de l'économie américaine est le fait que, durant les années 1980, les investissements étrangers aux USA ont largement dépassé les investissements américains dans les autres pays du monde. Des pans entiers de l'économie des Etats-Unis sont aujourd'hui la propriété d'entreprises japonaises et européennes.
Développement des investissements européens et japonais aux Etats-Unis
Pour la première fois, en 1988, les Etats-Unis ont moins investi dans le monde que le monde chez eux. Source : Libération.
Le capitalisme américain à la recherche d'argent frais va utiliser toutes les ressources que lui autorise son statut de première puissance économique mondiale et de chef du bloc impérialiste le plus puissant ; le roi dollar impose sa suprématie :
- la banque fédérale des Etats-Unis (FED), au nom du libéralisme, va guider de manière très étatique l'économie mondiale par sa politique des taux ;
- une politique de soutien du dollar est imposée aux principaux pays industrialisés devenus les bailleurs de fonds des USA.
Cette politique va permettre de freiner momentanément la plongée dans la récession et de maintenir à flot l'économie des pays les plus industrialisés. Elle va se doubler d'une campagne idéologique intensive à la gloire de l'économie capitaliste. En 1987, c'est encore l'euphorie, la "croissance" officielle bat des records tandis que l'inflation est à son plancher. L'effondrement des places boursières est rapidement surmonté, la spéculation repart de plus belle.
La crise du crédit : les limites d'une politique
La pseudo-croissance officielle de la deuxième présidence de Reagan a été une vraie récession larvée de l'économie mondiale ([3] [20]). On a en fait assisté à une croissance de l'économie de guerre, c'est-à-dire à une croissance de la destruction de capital et à une progression artificielle des secteurs improductifs. L'activité économique a été maintenue de manière factice, la production n'est pas réellement payée, les marchandises sont échangées contre des dettes. Dans ces conditions, la production n'est pas directement production de valeur. Le capitalisme ne peut maintenir un semblant d'activité économique qu'au travers d'une immense tricherie avec les lois du marché qui déstabilise de plus en plus l'économie mondiale et d'un gaspillage de plus en plus gigantesque.
Cette situation économique a été masquée par une manipulation grandissante des indices et le tapage assourdissant des campagnes menées sur l'efficacité de la politique "libérale" des USA : lés fameuses reaganomics.
Mais, depuis 1987, la situation a bien changé. L'euphorie est retombée, le doute s'est installé. Les statistiques officielles, face à la réalité de la crise, se voient obligées d'exprimer dans une certaine mesure la réalité, sinon elles ne serviraient strictement plus à rien. La "croissance" officielle a entamé son déclin tandis que l'inflation a fait un retour remarqué. L'exemple de la Grande-Bretagne est à cet égard particulièrement significatif. Elle, qui a appliqué les "reaganomics" avant l'heure, ne parvient plus à freiner la montée de l'inflation alors que les taux bancaires ont grimpé et plongé son économie dans la récession.
Bien sûr, l'économie américaine, la première du monde, est d'une autre trempe que l'économie britannique, et le dollar n'est pas la livre sterling. De plus, les USA profitent de leur statut de chef de bloc pour imposer une discipline à leur profit. Cependant, les lois aveugles du marché sont à l'oeuvre, elles, qui ont fait plonger les pays sous-développés de la périphérie dans un chaos économique dont ils ne pourront plus s'échapper, et qui font aujourd'hui chuter l'économie britannique, érodent la puissance américaine placée au centre des contradictions économiques du capitalisme mondial.
Depuis des années, par le recours au crédit, une montagne de dollars a été mise en circulation. Actuellement, la dette des pays périphériques s'est gonflée à 1300 milliards de dollars. La dette extérieure des USA se monte à 500 milliards de dollars, mais elle cache l'endettement interne, où les emprunts cumulés de l'Etat, des entreprises et des particuliers varient, comme nous l'avons vu, suivant les estimations de 6000 à 8000 milliards de dollars. Le développement du crédit, qui ne pourra jamais être remboursé (en fait du capital fictif), est en complet décalage avec celui de l'économie réelle, de la production ([4] [21]). La spéculation financière et boursière n'a pas arrangé les choses. Stimulées par les "OPA" ([5] [22]), les entreprises ont vu cette décennie leur valeur boursière multipliée par 5, voire par 10, sans que le développement de la production justifie cette explosion des cours.
Dans ces conditions, les lois du marché capitaliste poussent à une ré adéquation de la valeur du dollar à la richesse réellement produite. Les pressions inflationnistes se font de plus en plus fortes. Face à celles-ci, la politique de la FED est, en relevant son taux d'escompte, de rendre le crédit plus cher, donc plus rare. Cependant, par deux fois, cette politique s'est conclue avec une panique boursière, car elle signifie à terme une plongée de l'économie américaine dans la récession, qui ne peut qu'entraîner l'économie mondiale à sa suite. Et, par deux fois, la FED a dû céder, et relâcher les taux, rouvrir les vannes du crédit, pour éviter une plongée accélérée de la croissance qui aurait des conséquences catastrophiques pour sur le plan mondial.
Avant le mini effondrement boursier d'octobre 1989, les managers des cent plus grandes entreprises des USA avaient sonné le tocsin, inquiétés par le ralentissement de l'activité qui s'était concrétisé dans une chute brutale des bénéfices des entreprises américaines (ainsi, les fleurons tels que General Motors, Ford, IBM, ont vu au 3e trimestre 1989 leurs bénéfices chuter de 30 % à 40 %), pour demander à la FED de relâcher ses taux, de maintenir la croissance.
Au regard de l'inquiétude croissante qui ronge les financiers du monde entier à la lecture quotidienne des différents indices économiques, l'événement singulier qui a été, de manière toute phénoménologique, à l'origine de la panique boursière d'octobre 1989 pourrait presque paraître anodin. Pourtant, il est tout à fait significatif des difficultés présentes de l'économie mondiale. Dans la guerre internationale des OPA que se livrent les capitalistes, l'incapacité d'un groupe de spéculateurs de réunir par le recours au crédit sur la place boursière de quoi financer une OPA qu'ils avaient lancée sur United Airlines, une des principales compagnies aériennes américaines, a déclenché un vent de panique. Pourquoi ? Parce que cela signifie la fin du crédit facile, et donc la fin des OPA gigantesques qui avaient été rendues possibles par ce crédit, et donc la fin de la croissance artificielle des actions en bourse.
Une nouvelle fois, les USA ont reculé devant les implications économiques d'une politique d'austérité, de rigueur, sur le dollar. Début novembre 1989, la FED a fait baisser ses taux et rouvert le crédit. Si cette politique peut freiner la chute de la production, elle est par contre incapable de relancer la croissance. De plus en plus, les nouveaux crédits mis en circulation servent à payer les traites des crédits précédents, ou à alimenter la spéculation, et de moins en moins à financer la production. Plus le crédit croît, moins il est efficace dans l'économie réelle, et la croissance chute irrésistiblement. Par contre, la politique de crédit facile a un effet direct, aujourd'hui, qui est de relancer l'inflation. De fait, la FED a fait le choix de l'inflation face au danger immédiat d'une chute catastrophique de la production.
Depuis des années, les économistes et les dirigeants politiques américains parlent de l’"atterrissage en douceur" de leur économie, et de fait la politique des USA est parvenue à limiter les dégâts ; l'avion américain a réussi à effectuer une descente en douceur. Mais où va-t-il atterrir ? Toutes les manoeuvres difficiles qu'on lui impose l'ont usé, ne risque-t-il pas de tomber en panne ? Le carburant du crédit ne va-t-il pas lui faire défaut ?
A partir du moment où l'économie américaine arrête son envol, cela signifie une nouvelle plongée brutale de l'économie mondiale dans la récession, le marché américain qui se ferme aux exportations européennes et japonaises, une incapacité de rembourser la dette et une envolée de l'inflation, c'est-à-dire une crise financière majeure centrée autour du dollar. Ces perspectives sont contenues en filigrane de l'économie mondiale depuis le début des années 1980, et toute la politique des USA a visé à reculer l'échéance, à la reporter dans le temps en manipulant les lois de la valeur sur le marché mondial.
Cette politique de fuite en avant n'a été rendue possible que par le statut particulier des USA, non seulement comme première puissance économique et premier marché du monde, mais aussi comme chef du bloc impérialiste le plus puissant qui impose sa loi aux économies les plus développées de la planète : les pays d'Europe, notamment l'Allemagne de l'Ouest, et le Japon. Le groupe des "sept plus grands pays industrialisés" du bloc occidental - le fameux G7 - a symbolisé la loi américaine exercée au plan économique dans son bloc. La discipline imposée au sein du bloc, notamment à l'Allemagne et au Japon, a été la condition sine qua non de la stabilisation économique durant les années 1980. Malgré la catastrophe du "tiers-monde", la descente de l'économie mondiale, l'enfoncement des pays industrialisés dans le marasme d'une récession larvée, s'est faite en "douceur", pour ce qui est du point de vue des économistes, bien sûr.
Les conditions qui ont permis une telle politique économique de la part des USA ont changé :
- Le délabrement de l'économie américaine contraste fortement avec la bonne santé affichée par ses principaux concurrents que sont le Japon et l'Allemagne. Alors que les USA accumulent les déficits commerciaux, le Japon et l'Allemagne battent des records à l'exportation. A l'inverse de la période de reconstruction de l'après-guerre, ce sont aujourd'hui des capitaux européens et japonais qui rachètent des pans entiers de l'économie américaine. La locomotive s'essouffle et, alors que l'inflation repart, la récession pointe à l'horizon américain. La position de leadership économique des USA est vacillante alors que la crise du dollar menace.
- L'effondrement du bloc russe, en même temps qu'il vient rappeler la réalité incontournable au sein du capitalisme de la loi de la valeur, vient bouleverser les données de l'équilibre mondial des blocs, qui a "organisé" le monde depuis Yalta. La discipline que les USA ont pu imposer à leurs principaux concurrents d'Europe et du Japon, n'a pu se maintenir que grâce au ciment constitué par la menace impérialiste de l'ours russe. Un verrou vient de sauter à l'Est qui implique un bouleversement des relations entre les principales puissances économiques du bloc occidental.
L'effondrement du bloc de l'est et la déstabilisation de l'économie mondiale
Dans ces conditions, la prochaine décennie s'ouvre sous les auspices :
- d'une plongée dramatique dans la crise économique de surproduction généralisée par rapport aux marchés existants qui vont en se rétrécissant ;
- d'une déstabilisation grandissante des équilibres qui dominent le monde depuis la seconde guerre mondiale.
L'effondrement du bloc russe implique la déstabilisation du bloc occidental, et cela a des implications particulièrement importantes sur le plan économique (entre autres). Face à la banqueroute qui menace l'économie américaine et qui signifie, à terme, une fermeture du marché des Etats-Unis aux exportations européennes et japonaises, les tendances centrifuges au sein du bloc vont se faire plus fortes. La menace impérialiste russe n'est plus suffisamment crédible, et, du même coup, le parapluie protecteur américain perd sa justification. Les velléités d'indépendance, qu'une telle situation implique de la part de la RFA et du Japon, vont se concrétiser dans une tendance renforcée au chacun pour soi, chacun essayant de protéger ses propres marchés privilégiés face à la récession ouverte qui, irrésistiblement, s'impose.
Les deux pôles qui garantissaient la suprématie du dollar, la puissance économique et impérialiste américaine, sont en train de s'éroder. La solvabilité du dollar était plus garantie par le rôle impérialiste dominant des USA que comme contrepartie de la puissance économique américaine. La valeur du dollar est en fait largement fictive, liée à la "confiance" qu'inspirent les Etats-Unis, et cette "confiance" va de plus en plus se trouver ébranlée par les bouleversements mondiaux. Dans la perspective du développement de la crise, ce qui est en jeu, c'est le rôle hégémonique du dollar sur la scène internationale, et donc la question de sa solvabilité future. Le système financier international, centré sur la devise américaine, est comme un château de cartes, il menace de s'effondrer au moindre souffle de vent, et ce sont les prémices d'une tempête qui s'accumulent.
Tant que ce le reste de "croissance" aux USA permet à l'Europe et au Japon de continuer à écouler leur production, l'ensemble des pays industrialisés a intérêt au statu quo présent, mais cette situation est provisoire. La perspective de l'effondrement du marché américain dans la récession signifie une nouvelle contraction du marché mondial et donc une chute des exportations des pays européens et du Japon : par conséquent, la récession pour ces pays. Cependant, leur situation économique n'est pas aussi dégradée que celle des USA. Le recours au crédit y est encore possible, pour essayer de préserver une relative stabilité à leurs marchés privilégiés, l'Europe pour l’Allemagne, et l'Asie du sud-est pour le Japon. Mais ce crédit ne pourra se faire que sur la base d'une montée en puissance de nouveaux challengers à la toute puissance du dollar : le deutschmark ou l'ecu et le yen. Cependant, une telle politique n'est pas plus une issue à la crise que ne le fut celle de Reagan. Elle ne ferait que traduire le délabrement accentué de l'économie mondiale, la faillite des USA, freiner brièvement le développement de la crise dans toute son ampleur, en fait que perpétuer tout à fait provisoirement l'illusion, et ce à un niveau encore plus restreint.
Le capitalisme ne peut envisager une crise sans solution capitaliste. Il ne peut accepter le fait que ses contradictions sont insurmontables. Il est toujours à la recherche de nouvelles illusions, de nouveaux mirages, qui puissent le faire rêver. Les bouleversements à l'Est avec la perspective de l'ouverture économique des pays d'Europe orientale vers l'Occident créent l’espoir de nouveaux débouchés pour les marchandises occidentales, donc d'un nouveau ballon d'oxygène permettant de maintenir la "croissance". Cet espoir sera de courte durée. Il y a dix ans, la Chine avait suscité les mêmes espérances, mais les capitalistes occidentaux avaient vite déchanté. Même si la Chine, avec son milliard d'habitants, a des besoins économiques énormes, ceux-ci, dans la logique du capital, ne pourront jamais être un marché solvable. Géante par sa population, la Chine est un nain économique.
Si, aujourd'hui, les pays du glacis est-européen peuvent prétendre s'émanciper de la tutelle russe, c'est à cause de l'effondrement économique du bloc russe. En conséquence, leur économie dévastée est semblable à celle de tous les pays sous-développés, c'est-à-dire insolvable. Avec l'ouverture du mur de Berlin, des centaines de milliers d'Allemands de l'Est sont venus s'extasier devant les vitrines pleines de l'Occident, mais ils avaient les poches vides, et s'ils ont pu faire quelques maigres achats, c'est essentiellement grâce aux 100 DM "généreusement" octroyés par l'Etat ouest-allemand. De toute manière, les pays de l'est de l'Europe à eux tous (URSS exclue) totalisent un PNB de 490 milliards de dollars en 1987, un peu plus de la moitié du PNB de la France, 880 milliards de dollars. Un tel marché, même s'il était sain, ne serait de toute façon pas suffisant comme débouché à la surproduction mondiale pour permettre ainsi d'éviter la plongée inéluctable dans la récession ouverte, récession ouverte dans laquelle les pays de l'Est sont pour leur part déjà plongés depuis de nombreuses années.
La solution du crédit, la manne occidentale à laquelle les dirigeants de l'Est font appel, Walesa en tête, qui s'est fait le représentant des intérêts de l'économie polonaise, ne constitue pas une solution. Vu la ruine d'une économie ravagée par des décennies de gestion stalinienne aberrante, les crédits nécessaires à la "reconstruction" des pays de l'Est ne sont pas à la portée des capitalismes occidentaux. Ils seraient investis en pure perte : l'exemple de la Pologne est là, avec ses 40 milliards de dollars de dette, et la banqueroute persistante de son économie. Ce sont des milliers de milliards de dollars qui seraient en fait indispensables. A une époque où le monde entier ploie sous la dette, où, face à la restriction des marchés, la concurrence fait rage, un nouveau "plan Marshall" n'est plus possible, et les prêts de l'Ouest, plus que de permettre un développement industriel de ces pays, ont pour rôle de stabiliser au jour le jour la situation. Dans ces conditions, les crédits occidentaux resteront tout à fait symboliques.
Au début des années 1980, les pays sous-développés de la périphérie du capitalisme - le "tiers-monde" - ont irrémédiablement sombré économiquement. A la fin des années 1980, c'est au tour du bloc de l'Est - le "deuxième monde" - de s'effondrer. Le "premier monde", celui des grands pays industrialisés occidentaux, apparaît encore, par rapport à la banqueroute générale, comme un îlot de santé et de richesse relatives. Cette situation ne peut que renforcer l'illusion sur le capitalisme "démocratique" et "libéral", et constitue la base sur laquelle s'appuient les campagnes idéologiques intensives du bloc occidental. Cependant, toutes les conditions sont réunies pour qu'éclate au grand jour la faillite économique de l'ensemble du monde capitaliste, et notamment de ses pôles les plus développés. Depuis le milieu des années 1980, à coup de tricherie économique et de statistiques trompeuses, la bourgeoisie des pays industrialisés a entretenu l'illusion de la croissance. Ce mensonge officiel auquel la classe dominante elle-même avait besoin de croire touche à sa fin. Malgré toutes les manipulations dont ils sont l'objet, irrésistiblement, les indices économiques tendent à traduire l'approfondissement de la faillite économique du capitalisme. Les illusions sur la croissance, sur le développement économique, vont tomber brutalement avec les indicateurs officiels eux-mêmes, qui vont être obligés de traduire la réalité de la plongée accentuée dans la récession et du développement accéléré de l'inflation. C'est toute la base de la domination du capital qui se trouve sapée par la crise économique mondiale qui, avec une relative lenteur, mais inéluctablement, se développe.
JJ. 27/11/89.
[1] [23] Voir "Le crédit n'est pas une solution éternelle", Revue internationale n° 56, 1er trimestre 1989.
[2] [24] Voir "Guerre et militarisme dans la décadence", Revue internationale n° 52 et n° 53, 1er et 2e trimestres 1988
[3] [25] Voir présentation et extraits du "Rapport sur la situation internationale du 8 Congrès du CCI", Revue internationale n°59, 4 trimestre 1989.
[4] [26] Voir "L'agonie barbare du capitalisme décadent", Revue internationale n° 57, 2 trimestre 1989.
[5] [27] "Offre Publique d'Achat" : enchère boursière officielle pour racheter une entreprise, le plus souvent par un recours massif au crédit ou à des manipulations comptables acrobatiques.
Récent et en cours:
- Crise économique [28]
Comprendre la décadence du capitalisme (8) : La domination réelle du capital, ou...
- 5703 reads
-
LA DOMINATION RÉELLE[1] [29] DU CAPITAL,
ou les réelles confusions du milieu politique prolétarien
Il y a une nouvelle vogue dans le milieu politique prolétarien, une petite théorie dernier cri, que ses colporteurs présentent comme un secret depuis longtemps perdu du marxisme. Un secret qui permet d'expliquer l'évolution historique de la société capitaliste sans avoir à tomber -et c'est là toute sa beauté !- dans ce lieu commun, cette théorie désuète de la décadence, dont le CCI, en particulier, parle depuis si longtemps.
Selon cette vogue, le CCI et autres courants philistins (comme le KAPD, Bilan, Internationalisme) peuvent bien argumenter que le capitalisme est passé de sa phase ascendante à sa phase de décadence au moment de la première guerre mondiale, mettant la révolution prolétarienne à l'ordre du jour et rendant ainsi obsolètes les vieilles tactiques du mouvement ouvrier (le soutien au parlementarisme, aux luttes de libération nationale, etc.) ; rien n'y fait, ceux qui sont vraiment dans le coup font les dégoûtés et ricanent. Non, non, disent-ils, le véritable secret de l'évolution capitaliste est contenu dans la notion de transition entre sa phase de "domination formelle" à celle de sa "domination réelle", une notion que Marx lui-même a développée, mais à laquelle ses colporteurs contemporains ont donné une signification toute nouvelle.
Jetons un coup d'oeil à l'aile "néo-bordiguiste" du milieu il y a la Revue internationale du Mouvement communiste - au titre impressionnant ! - qui est publiée en commun par Communisme ou Civilisation (France), Union Prolétarienne (France), Comunismo (Mexique) et Kamunist Kranti (Inde). Les trois premiers de ces groupes se réclament tous du cadre de la "domination réelle-formelle". Communisme ou Civilisation (C. ou C.) a écrit trois longs volumes expliquant les tenants et les aboutissants de cette théorie. Et puis, il y a un groupe nouvellement formé, et encore plus grandiosement intitulé Mouvement communiste pour la formation du Parti Communiste Mondial, produit d'un regroupement entre les Cahiers Communistes (France) et À Contre-Courant (Belgique). Le numéro 0 de leur revue contient une déclaration de "points de référence programmatique", qui, à son tour, souligne l'importance de comprendre cette notion.
Et il n'y a pas que les « néo-bordiguistes ». Les crypto-conseillistes qui se sont donnés le nom de "Fraction Externe du CCI" ne veulent pas non plus avoir l'air démodés. Selon un long article de Perspective Internationaliste n° 7 (écrit par le camarade Mc Intosh comme contribution au débat, mais auquel aucun autre membre de la FECCI n'a répondu publiquement), "le passage de la domination formelle à la domination réelle du capital" n'est pas seulement un élément décisif dans le développement du capitalisme d'Etat, mais également "c'est ce passage qui pousse le mode de production capitaliste vers sa crise permanente, qui rend insolubles les contradictions du procès de production capitaliste". Selon la FECCI, le CCI reste totalement aveugle face à cette percée scientifique saisissante parce qu'il a perdu tout intérêt pour l'approfondissement théorique.
Pour être honnête, cette "théorie", comme beaucoup d'autres modes des années 1980, n'est pas entièrement nouvelle. En fait, tout comme la mode punk était en grande partie une resucée du style des années 1950, les propriétés magiques de la "domination formelle-réelle" furent d'abord rendues publiques à la fin des années 1960, par le groupe Invariance autour de Jacques Camatte. Invariance était un groupe qui avait rompu avec le bordiguisme "officiel" du "Parti Communiste International" (PCI-Programma), et commencé à évoluer sur certaines questions (comme la contribution historique de la Gauche Communiste d'Allemagne). Mais l'adoption de la domination formelle réelle comme pierre de touche de son édifice théorique, ne l'a pas empêché d'abandonner rapidement le marxisme et de s'évanouir dans le néant du modernisme. En fait, le mauvais usage de ce concept a certainement participé à le pousser sur cette voie. Pour Invariance, le capitalisme, en achevant sa domination réelle, en particulier dans la période après 1945, loin de devenir historiquement obsolète, décadent, entré en crise permanente, avait non seulement démontré une capacité de croissance quasiment illimitée, mais était devenu si puissant que plus rien ne pourrait lui résister. Pour le moderniste Camatte, la "domination réelle" signifiait le triomphe total, omniprésent du capital, l'intégration du prolétariat, la fin de la perspective de la révolution prolétarienne. Désormais, l'espoir du communisme résidait autant dans les animaux, les végétaux et les minéraux, que dans le prolétariat.
Les nouveaux promoteurs du concept ne s'identifient pas avec la moderniste Invariance qui a rejoint depuis longtemps son nirvana final avec d'autres sectes modernistes qui, elles aussi, avaient repris l'idée de la domination formelle-réelle (Négation, Union Ouvrière, etc.). Mais ce qu'ils partagent avec Invariance, c'est une inflation et un abus éhonté de l'usage de la notion de Marx de domination formelle et réelle du capital.
Pour esquisser une réponse à ces éléments (ce à quoi nous nous limiterons ici), et arriver ainsi à la défense de la théorie de la décadence, comme l'ont fait d'autres articles de cette série, il faut en premier lieu revenir à ce que Marx a dit lui-même de ce concept.
-
Marx et la transition de la domination formelle à la domination réelle du capital
Le fait que la formulation la plus développée de cette notion soit contenue dans un chapitre du Capital qui ne fut pas publié avant les années 1930, et ne fut donc pratiquement connu que dans les années 1960, a, dans une certaine mesure, permis aux théoriciens de dernière heure d'entourer ce concept d'un air de mystère, de donner l'impression d'un secret longtemps enterré et finalement porté à la lumière. La FECCI ajoute du piment à ce mystère quand Mc Intosh déclare que "leurs concepts fondamentaux auraient été intégrés aux derniers volumes du Capital prévus par Marx s'il avait vécu pour les achever" (Perspective Internationaliste n° 7) - ce qui est peut-être vrai, mais minimise le fait que les concepts fondamentaux sont déjà là, dans le seul volume du Capital que Marx a vraiment achevé, le volume I. Les arguments contenus dans le chapitre inédit sont essentiellement une élaboration de ce qui est déjà contenu dans le volume achevé.
Dans le volume I, Marx introduit le concept de "soumission formelle" et "réelle du travail au capital", dans le chapitre "Plus-value absolue et plus-value relative" :
- "Prolonger la joumée de travail au-delà du temps nécessaire à l'ouvrier pour fournir un équivalent de son entretien, et allouer ce surtravail au capital : voilà la production de la plus-value absolue. Elle forme la base générale du système capitaliste et le point de départ de la production de la plus value relative. Là, la journée est déjà divisée en deux parties, travail nécessaire et surtravail. Afin de prolonger le surtravail, le travail nécessaire est raccourci par des méthodes qui font produire l'équivalent du salaire en moins de temps. La production de la plus-value absolue n'affecte que la durée du travail, la production de la plus-value relative en transforme entièrement les procédés techniques et les combinaisons sociales. Elle se développe donc avec le mode de production capitaliste proprement dit." (Le Capital, Livre I, Ed La pléiade, p. 1002.)
- "Cela requiert, par conséquent, un mode de production spécifiquement capitaliste, un mode de production qui, avec ses méthodes, ses moyens et ses conditions, naît et se développe spontanément sur les bases de la subordination formelle du travail au capital. La subordination formelle est alors remplacée par une subordination réelle." (Le Capital Livre I. Marx n'a pas repris ces lignes dans la version française. Nous le traduisons de la version anglaise, Penguin ed., 1976, p. 645.)
En peu de mots : la subordination formelle implique l'extraction de plus-value absolue, la subordination réelle implique l'extraction de plus-value relative.
Historiquement, l'avènement de cette subordination formelle correspond au passage de l'industrie domestique à la manufacture :
- "Une simple subordination formelle du travail au capital suffit pour la production de plus value absolue. Il suffit, par exemple, que des artisans qui travaillaient auparavant pour leur propre compte, ou comme apprentis d'un maître, deviennent des travailleurs salariés sous le contrôle d'un capitaliste." (id.)
Dans le "Chapitre inédit" du Capital, nous trouvons exactement les mêmes concepts, si ce n'est qu'ils s'y trouvent plus longuement expliqués :
- "J'appelle subordination formelle du travail au capital la forme qui repose sur la plus-value absolue, parce qu'elle ne se distingue que formellement des modes de production anciens (...)" ("Matériaux pour 1"Economie"', ed. La pléiade, T. II, p 369).
- "La subordination réelle du travail au capital s'opère dans toutes les formes qui développent la plus-value relative par opposition à la plus-value absolue. Avec elle, une révolution totale (et sans cesse renouvelée) s'accomplit dans le mode de production lui même, dans la productivité du travail et dans les rapports entre les capitalistes et le travailleur." (id., p.379.)
Dans un autre passage, Marx affirme clairement que le passage de la domination formelle du travail à sa domination réelle correspond à la transition de la manufacture (lorsque les capitalistes rassemblaient des artisans et en extrayaient de la plus-value sans modifier fondamentalement leurs méthodes de production) à la grande industrie :
- "(...) la subordination du processus du travail au capital s'opère sur une base antérieure à cette subordination et différente des anciens modes de production. Dés lors, le capital s'empare d'un processus de travail préexistant, par exemple du travail artisanal ou du mode d'agriculture de la petite économie paysanne autonome. Lorsque des transformations se produisent dans le processus du travail traditionnel passé sous le contrôle du capital, il ne peut s'agir que de conséquences graduelles d'une subordination au capital déjà accomplie. En soi et pour soi, le caractère du processus et du mode réel du travail ne change pas parce que le travail se fait plus intensif, ou que sa durée augmente, et qu'il devient plus continu et plus ordonné sous l'oeil intéressé du capitaliste. Tout cela contraste beaucoup avec le mode de production spécifiquement capitaliste (travail sur une grande échelle, etc.) qui révolutionne la nature et le mode réel du travail en même temps que les rapports des divers agents de production. Ce mode de travail, que nous appelons subordination formelle du travail au capital, s'oppose au mode qui s'est développé avant même que surgisse le rapport capitaliste. " (id., p. 366.)
Pour résumer : le changement d"'époque" entraîné par le passage de la domination formelle du capital à sa domination réelle avait déjà eu lieu au moment où Marx écrivait, puisqu'il était la même chose que le passage de la manufacture à l'industrie moderne, réalisé à la fin du 18e et début du 19e siècle. Et, comme l'explique Marx dans le chapitre "Machinisme et grande industrie" du Livre I du Capital, ce passage a constitué un facteur décisif pour l'expansion rapide et sans précédent du mode de production capitaliste dans la période qui a suivi. En d'autres termes : la phase la plus dynamique de l'ascendance de la société bourgeoise reposait sur les bases de la domination réelle du capital.
-
Comment les épigones déforment Marx
1. Les divagations d'Invariance et des néo-bordiguistes
Telle est la définition que donne Marx des concepts de domination formelle et réelle. Mais qu'est-ce qu'en font les épigones ?
Commençons par les néo-bordiguistes. Parmi ceux-ci, CouC est celui qui a consacré le plus de temps et d'énergie à développer la thèse suivant laquelle domination "formelle" et domination "réelle" représentent les deux phases principales dans la vie du capital. Et il faut dire qu'ils ont au moins le mérite d'une certaine consistance avec la pensée de Marx. Tout comme Marx ils situent la transition de la domination formelle à celle réelle à la fin du 18e et début du 19e siècle :
- "La phase de soumission formelle du travail au capital (XVI°-XVIII° siècles) ... et la phase de soumission réelle du travail au capital (XIX°-XX°)" ("Les deux phases historiques de la production capitaliste", I, in CouC, n° 5 p. 3.)
Ou encore
- "Dans le dernier tiers du 18e siècle s'affirme la phase de la soumission réelle, dont le mode d'extorsion de la plus-value repose sur la plus-value relative. " (id., p. 33.)
Le problème se situe au niveau des conclusions que CouC tire de ceci : il s'en sert pour fournir un autre argument contre la notion de décadence et en faveur de 1"'invariance" du marxisme depuis 1848, car pour lui le communisme devient possible dès que débute la phase de domination réelle. Voici comment est présenté son long travail sur les "Deux phases historiques" :
- "Nous espérons ainsi pouvoir déblayer un peu le terrain de toutes les confusions et mystifications dont la périodisation du capital fait l'objet. Enfin, le pseudo-concept d'une 'décadence' du mode de production capitaliste vole en éclats qu'on ouvre au moins le chapitre inédit du Capital de Marx (...) Si l'on estime décadent le mode de production capitaliste parce qu'il a cessé de jouer un rôle progressiste et révolutionnaire, alors nous sommes en pleine décadence depuis 1848, car à cette époque déjà le capital était suffisamment développé pour poser en son sein les bases matérielles du communisme. Qualitativement cette date est celle qui a sonné pour nous, une fois pour toutes, le glas du capital. C'est la compréhension juste de la périodisation du capital qui permet, entre autres d'affirmer ceci : à partir de 1848 le communisme est devenu possible." (id. p. 4.)
A première vue, Mouvement communiste défend la même position :
- "Le marxisme à déclaré le mode de production capitaliste 'en décadence' depuis 1848, en posant, dès cette date, la nécessité et la possibilité de la révolution communiste." (Mouvement communiste, n° 0, p. 21.)
Mais que l'on creuse un peu et l'on découvrira que MC ce n'est en fait que du néo-néo-bordiguisme. Prenons un exemple important: alors que CouC, tout comme son prédécesseur reconnu, la pré-moderniste Invariance, n'a aucune honte à proclamer le caractère "révolutionnaire", "anti-impérialiste" des luttes de libération nationale, qui seraient supposées accélérer le passage de la domination formelle à la domination réelle (cf. CouC n°9, p. 47.), Mouvement communiste ne peut supporter quoi que ce soit qui touche aux luttes de libération nationale. Aussi doit-il forcer la théorie de la domination formelle-réelle pour l'adapter à ses propos :
- "Avec le passage du mode de production capitaliste dans sa phase de subsomption réelle (...) qui est globalement et mondialement effectué au début du 20e siècle - le rapport historique de forces entre les classes antagoniques fondamentales a entraîné la liquidation des tactiques de soutien aux bourgeoises progressistes en lutte contre le féodalisme, de soutien dans l'intérêt de la révolution en pennanence de certaines luttes de constitution d'Etats-nations (...) ainsi que des tactiques spécifiques à la révolution double. Seul reste a l'ordre du jour et mondialement, l'élaboration de la tactique 'directe et/ou indirecte' en parfaite conformité avec la révolution purement prolétarienne et communiste." (MC, n° 0, p. 20-21)
Il en est de même pour les tactiques de parlementarisme et d'organisation en syndicats. On s'aperçoit donc maintenant que pour MC, le véritable changement d"'époque", celui qui requiert un changement global du programme du mouvement ouvrier, ce n'est pas en réalité la transition de la domination formelle à celle réelle, mais le moment où cette transition est achevée à une échelle globale, ce qui, par une remarquable coïncidence, correspond justement à la période que certains philistins définissent comme le début de la phase de décadence du capitalisme.
En réalité cette sournoiserie, cette subtile distorsion de la périodisation en domination formelle et réelle en vue de l'adapter aux vues particulières de tel ou tel groupe, n'est pas le propre du seul MC. On retrouve le même procédé chez ceux qui ont lancé la mode à l'origine, Invariance, pour qui le réel changement se produit tantôt en 1914, tantôt avant, tantôt entre 1914 et 1945 et tantôt seulement après 1945. Et nous trouvons ce même flou chez la FECCI, comme nous le verrons.
Mais pour le moment, penchons-nous sur les vrais invariantistes, CouC, et leur idée que le communisme a été possible depuis 1848. Nous avons déjà traité de cette question longuement, dans un article précédent de cette série (voir Revue internationale, n° 48) à propos des arguments du GCI, qui affirme que le communisme est à l'ordre du jour depuis le début du capitalisme. A ce propos, tout ce qu'on peut dire ici c'est que, bien qu'il se revendique de l'orthodoxie marxiste, CouC n'est pas moins que le GCI en contradiction totale avec le matérialisme historique sur cette question cruciale.
Au coeur de la définition donnée par Marx du matérialisme historique, dans l'Avant propos à la critique de l'économie politique, se trouve la notion selon laquelle une nouvelle société ne devient possible qu'à partir du moment où l'ancienne est devenue une entrave permanente au développement des forces productives. Il est certain que 1848 a constitué un moment décisif historiquement, puisque cette date correspond en même temps à la première apparition du prolétariat comme force sociale autonome (journées de juillet à Paris, Chartisme, etc.), et à la première affirmation scientifique des principes généraux du communisme. Mais, en 1848, les rapports de production capitaliste n'étaient pas du tout une entrave pour les forces productives; au contraire, étant parvenus au niveau de la grande industrie ("domination réelle"), ils connaissaient un processus de conquête de l'ensemble de la planète. En 1848, Marx et Engels ont pu momentanément croire à l'imminence de la révolution communiste. Mais au cours des années 1850 ils ont non seulement révisé leur point de vue, mais aussi considéré que leur tâche la plus importante consistait à comprendre la dynamique historique du capital et à déterminer le point à partir duquel les contradictions internes du système se transformeraient en une barrière permanente pour le capital lui même. Ils ont entièrement reconnu qu'il s'agissait de quelque chose pour l'avenir, car le capitalisme était en train de vivre, sous leurs yeux, sa plus "héroïque" période d'expansion et de croissance. Das Kapital est lui même un produit de cette nécessaire période de réflexion et de clarification.
Le problème avec les bordiguistes, c'est qu'ils ont tendance à confondre les conditions matérielles objectives avec les conditions subjectives de la conscience de l'avant-garde du prolétariat : bref, ils pensent que le parti est tout-puissant. En 1848, la minorité communiste était en mesure d'affirmer la perspective du communisme comme le but final du mouvement ouvrier ; pour les néo-bordiguistes de CouC, cette prévision des marxistes est transformée en possibilité immédiate, comme s'il suffisait que les communistes la veuillent pour qu'elle fût réalité. Le marxisme a un nom pour cette déviation idéologique : idéalisme.
2. La FECCI : centriste comme toujours
Avec la découverte par la FECCI de la domination formelle-réelle, son habituel centrisme vis-à-vis du conseillisme se transforme, sur cette question particulière, en centrisme vis-à-vis du bordiguisme. Alors que CouC et les autres ont explicitement développé leur théorie comme une attaque contre la notion de décadence, la FECCI veut garder le beurre (la notion de décadence, de capitalisme d'Etat) et l'argent du beurre (domination formelle-réelle).
Par la plume du camarade Mc Intosh, ils affirment que la transition de la domination formelle à la domination réelle fournit un "lien causal" dans la chaîne qui conduit en même temps à la décadence du capitalisme et à son mode spécifique d'organisation : le capitalisme d'Etat. Malheureusement, sur la question de savoir comment l'avènement de la domination réelle est "cause" de la décadence du capitalisme, nous n'avons que le petit morceau cité ci-dessus, qui n'est en fait qu'une note dans l'article de Mc Intosh. Nous attendons avec impatience la prochaine livraison. Mais, notons que, pour le moment, Mc Intosh n'a virtuellement rien à dire sur un des maillons de la chaîne causale dont il parlait si aisément lorsqu'il était dans le CCI - à savoir la théorie de Rosa Luxemburg sur l'épuisement des marchés pré-capitalistes comme un déterminant fondamental du commencement de la décadence. On se demande si la FECCI ne va pas laisser tomber la théorie de Rosa ; toujours à la recherche de raisons pour justifier leur existence ils s'éloignent toujours plus des analyses de base du CCI. Mais pour le moment, nous ne pouvons poursuivre ici cette question.
Quoi qu'il en soit, l'essentiel de l'article de Mc Intosh est consacré à démontrer que la transition de la domination formelle à la domination réelle oblige le capitalisme à adopter sa forme étatisée. C'est un très long article, qui contient quelques contributions intéressantes sur le rôle de l'Etat dans la théorie marxiste. Mais l'argumentation mise en avant pour montrer en quoi la transition domination formelle-réelle justifie le capitalisme d'Etat, est en réalité bien mince.
Pour justifier sa thèse, Mc Intosh cite certains passages du "Chapitre inédit" ("Résultats du processus immédiat de production"), où Marx dit que sous la domination réelle du capital "le véritable agent du procès de travail total n'est plus le travailleur individuel, mais une force de travail se combinant toujours plus socialement", et que ce changement exige "l'application au processus de production immédiat de la science" (Cité in PI. n° 7, p. 25.)
A partir de ces brefs passages, Mc Intosh fait un bond jusqu'à la conclusion que seul l'Etat peut organiser, scientifiquement, l'extraction de la plus-value relative du travailleur collectif : d'où le capitalisme d'Etat et l'organisation totalitaire de la vie sociale moderne.
Les défauts de cette argumentation ne sont pas difficiles à trouver. Premièrement, alors que la socialisation du travail est un produit "organique" du développement capitaliste, tout comme la concentration de capital, le capitalisme d'Etat constitue une réponse à l'effondrement de ce développement organique, un produit de l'épuisement des possibilités d'extension "pacifique" de la production capitaliste. Pour trouver les véritables causes du capitalisme d'Etat, il faut expliquer pourquoi la croissance organique du capital dans sa phase ascendante a été violemment interrompue. La théorie de Luxemburg fournit une réponse cohérente et consistante.
Deuxièmement, la périodisation faite par Mc Intosh est confuse, comme nous l'avons argumenté dans la Revue internationale n° 54. L'apparition du travailleur collectif, l'application de la science au processus de production, cela se développait du temps de Marx - dans la phase ascendante du capitalisme, au 19e siècle. Le développement du capitalisme d'Etat se produit au cours du 20e siècle, dans l'époque de décadence : il constitue en réalité une réponse aux conditions économiques, sociales et politiques de la décadence capitaliste. Ce qu'a fait ici Mc Intosh, c'est identifier l'époque d'ascendance avec la phase de domination formelle, et l'époque de décadence avec la phase de domination réelle. Comme nous l'avons déjà dit, CouC a au moins le mérite d'une certaine consistance avec Marx en situant la transition de domination formelle à réelle au sein de la période ascendante ; ils maintiennent une certaine cohérence logique lorsqu'ils utilisent ce fait pour argumenter contre la notion de décadence et affirmer que le communisme a été possible depuis 1848. Mais la FECCI baigne en pleine confusion.
-
Les frontières changeantes de la domination réelle
Dans Perspective internationaliste n° 12, la FECCI prétend répondre à nos critiques précédentes sur leur périodisation du capital :
- "(...) le CCI choisit d'interpréter la catégorie de la domination réelle du capital non comme la généralisation de l'extraction de la plus-value relative à l'ensemble du mode de production capitaliste, non comme la dépendance du capitalisme de l'extraction de la plus-value relative, mais comme la simple apparition de cette catégorie dans le paysage capitaliste, comme sa naissance même, la situant par là au commencement même du capitalisme. (...) En réalité, loin de se situer au 18e siècle, voire en 1848, le passage de la domination formelle à la domination réelle du capital ne s'est achevé qu'après 1914, son triomphe final s'étendant jusqu'aux dernières décennies avec l'extension de la domination réelle du capital à pratiquement l'ensemble du secteur agraire." (Perspective Internationaliste, n° 12.)
Nous avons déjà signalé la tendance chez les colporteurs de cette théorie à changer les frontières de la domination réelle en fonction des besoins de leur version particulière de l'histoire. Invariance, par exemple, s'intéressa de plus en plus à relever les progrès de la domination réelle au cours du 20e siècle, avec l'objectif précis d'étayer sa vision de la toute puissante, omniprésente "communauté du capital". MC et la FECCI sont plutôt trop attachés aux positions de classe qu'ils ont apprises du CCI et veulent ainsi souligner que le changement crucial se produit au début du 20e siècle, lorsque les vieilles tactiques du mouvement ouvrier devaient être abandonnées.
Tout ceci nous éloigne beaucoup de Marx, pour qui les catégories de domination formelle et réelle avaient une signification bien plus précise. Elles ne furent jamais mises en avant comme le secret ultime de l'évolution du capital, comme la clé des crises du système, etc. Ce n'est pas par hasard si Marx développe ces concepts dans le volume I du Capital, où il traite non pas des crises, mais des relations "internes" entre travail et capital, du mode d'exploitation directe au niveau de la production. Le concept était certes important pour expliquer l'énorme expansion du capital à cette époque, mais il n'avait pas d'autre prétention.
Cela peut difficilement satisfaire nos théoriciens de la dernière heure, qui veulent y trouver un concept capable de rivaliser avec la théorie de la décadence (ou, dans le cas de la FECCI, une nouvelle explication de la décadence). Pour eux ce concept doit être enflé jusqu'à englober tous les changements majeurs qui ont pu se produire dans la vie économique, sociale et politique du capital. Mais en faisant cela, le concept perd toute la précision qu'il possède chez Marx et devient outrancièrement flou et vague. Mais cela convient tout aussi bien à nos théoriciens de la domination "formelle-réelle", puisque cela leur permet de mouler la notion suivant leurs propres besoins. Prenons la FECCI, par exemple : ils ont commencé par parler du changement d"'époque" entre domination formelle et domination réelle comme un facteur déterminant dans la crise historique du capital et son évolution vers une forme étatisée. Le CCI avait répondu : si ce changement doit être situé dans une "époque" particulière, c'est au sein de la période ascendante ; aussi en quoi cela serait-il une explication de la décadence du capitalisme ? La FECCI répond par une esquive en argumentant que le "changement d'époque" peut avoir commencé au 18e siècle mais qu'il est toujours en marche aujourd'hui...
Évidemment, ici ils n'ont pas tout à fait tort : il reste, en particulier, dans le "tiers monde", des zones entières de production qui ne sont encore dominées que formellement par le capital. Qui plus est, il demeure des régions entières qui ne sont pas encore parvenues à ce stade. On peut affirmer, sans risque de se tromper, que la domination réelle finale, achevée et universellement triomphante, n'arrivera jamais. Mais si la transition effective est en cours depuis 200 ans, comment diable allons nous mesurer les changements spécifiques que ce processus a entraînés dans la vie du capital ? Parvenu à ce point, tout cela devient si vague qu'on ne peut plus rien distinguer.
Le seul moyen d'éviter ce flou est de reconnaître, avec Marx, que le changement décisif dans le mode d'exploitation capitaliste a eu lieu au cours de la période ascendante et que depuis lors le développement et l'expansion capitalistes ne se sont pas déroulés à travers une répétition mécanique de ce changement dans chaque pays ou région mais sur la base de la domination réelle, de la grande industrie avec son exploitation scientifique du travail social.
Il y a une autre erreur importante dans la vision de ceux qui voient la "véritable" période de domination réelle dans le 20e siècle, et plus spécialement dans la période après 1945. Puisque le passage à la domination réelle fut un facteur décisif dans la phénoménale croissance du 19e siècle, pourquoi n'en serait-il pas de même pour le 20e siècle ? Ou, plutôt, si le véritable changement de la domination formelle se produit au 20e siècle, cela n'implique-t-il pas que le capitalisme du 20e siècle, loin d'être décadent, connaît sa période de plus grande croissance et développement ?
Telle est précisément la conclusion à laquelle était parvenue Invariance ; elle facilita énormément son effondrement dans le modernisme. On retrouve l'écho de cette même idée chez les néo-bordiguistes qui aiment tant ridiculiser la théorie de la décadence en citant les énormes taux de croissance de la période post-1945. Pour la FECCI, qui se cramponne encore à la notion de décadence, il importe d'éviter à tout prix de parvenir à une telle conclusion, mais la logique n'est certainement pas de son côté.
C'est quelque chose de remarquable : plus le capitalisme sombre dans sa décadence, plus il montre sa décomposition avancée, et plus la bourgeoisie se voit obligée de nier la réalité et de promettre un brillant avenir sous le soleil du capitalisme. Telle est l'essence des campagnes actuelles en réponse à l'effondrement du stalinisme : le seul espoir, le seul avenir c'est le capitalisme !
La mode de dénigrer la théorie de la décadence au sein du milieu prolétarien ne peut être comprise que sous cet éclairage : c'est un reflet de la pénétration de l'idéologie bourgeoise au sein du mouvement ouvrier, et cela doit être combattu comme tel. En même temps, la tâche qui consiste à chercher une "alternative" à la théorie de la décadence pour fonder les positions révolutionnaires maintient artificiellement en vie un ensemble de sectes et de groupes parasites qui auraient du mal à justifier autrement leur existence ; les fausses théorisations sur domination formelle et domination réelle tendent à sous-estimer la nature catastrophique de l'actuelle crise, qui est une authentique expression de l'agonie mortelle du système capitaliste ; elles sont un prétexte parfait pour cet académisme stérile qui regarde avec mépris les révolutionnaires qui se sont engagés dans une intervention militante au sein de la lutte de classe. Malheureusement pour nos professeurs et experts en marxisme, l'histoire s'accélère si rapidement aujourd'hui qu'elle va bientôt troubler la sérénité de leurs études avec le bruit vulgaire de ses bottes dans les rues.
CDW. Novembre 1989.
[1] [30] Les termes de "domination" ou "subordination" sont employés pour traduire le terme "subsumption" utilisé par Marx.
Approfondir:
Questions théoriques:
- Décadence [32]
Heritage de la Gauche Communiste:
Revue Internationale no 61 - 2e trimestre 1990
- 3014 reads
Après l'effondrement du bloc de l'est, déstabilisation et chaos
- 8678 reads
Après l'effondrement du bloc de l'est, déstabilisation et chaos ([1] [34])
L'effondrement du bloc de l'Est, auquel nous venons d'assister, constitue, avec la reprise historique du prolétariat à la fin des années 1960, le fait le plus important depuis le dernière guerre mondiale. En effet, ce qui s'est passé dans la seconde moitié de l'année 1989 met fin à la configuration du monde telle qu'elle s'était maintenue durant des décennies. Les Thèses sur la crise économique et politique en URSS et dans les pays de l'Est" (voir Revue Internationale n°60), rédigées en septembre 89, donnent le cadre de compréhension des causes et des enjeux de ces événements. Pour l'essentiel, cette analyse a été amplement confirmée par les faits advenus au cours de ces derniers mois. C'est pour cela qu'il n'est pas nécessaire d'y revenir longuement ici, sinon pour rendre compte des principaux événements qui se sont produits depuis la parution du précédent numéro de notre revue. En revanche, il est essentiel pour les révolutionnaires d'examiner les implications de cette nouvelle situation historique, du fait notamment de l'importance considérable des différences qu'elle comporte avec la période précédente. C'est ce que se propose principalement de faire le présent article.
Pendant plusieurs mois, l'évolution de la situation dans les pays de l'Est a semblé combler les voeux de la bourgeoisie en faveur d'une "démocratisation pacifique". Cependant, dès la fin décembre 89, la perspective d'affrontements meurtriers annoncée dans les "thèses" trouvait une confirmation tragique. Les convulsions brutales et les bains de sang que viennent de connaître la Roumanie et l'Azerbaïdjan soviétique ne sont en effet pas destinés à rester une exception. La "démocratisation" de la Roumanie constituait la fin d'une période dans l'effondrement du stalinisme : celle de la disparition des "Démocraties populaires" ({C}[2]{C} [35]). En même temps, elle inaugurait une nouvelle période : celle des convulsions sanglantes qui vont affecter cette partie du monde, et tout particulièrement le pays d'Europe où le parti stalinien conserve encore son pouvoir (mise à part la minuscule Albanie) : l'URSS elle-même. En effet, les événements des dernières semaines dans ce pays confirment la perte totale de contrôle de la situation par les autorités, même si, pour le moment, Gorbatchev semble être en mesure de maintenir sa position à la tête du Parti. Les chars russes dans Bakou ne constituent nullement une démonstration de force du pouvoir qui dirige l'URSS ; ils sont au contraire un terrible aveu de faiblesse. Gorbatchev avait promis que, désormais, les autorités n'emploieraient plus la force armée contre la population : le bain de sang du Caucase a signé l'échec total de sa politique de "restructuration". Car ce qui se passe dans cette région n'est que le signe annonciateur des convulsions bien plus considérables encore qui vont secouer et finalement terrasser l'URSS.
L’URSS s'enfonce dans le chaos
En quelques mois, ce pays vient de perdre le bloc impérialiste qu'il dominait jusqu'à l'été dernier. Désormais il n'existe plus de "bloc de l'Est", il est parti en lambeaux en même temps que s'effondraient comme des châteaux de cartes les régimes staliniens qui dirigeaient les "Démocraties populaires". Mais une telle déconfiture ne pouvait s'arrêter là : dans la mesure même où la cause première de la décomposition de ce bloc est constituée par la faillite économique et politique totale, sous les coups de l'aggravation inexorable de la crise mondiale du capitalisme, du régime de sa puissance dominante, c'est dans cette dernière qu'une telle faillite devait nécessairement s'exprimer avec le plus de brutalité. L'explosion du nationalisme dans le Caucase, les affrontements armés entre azéris et arméniens, les pogroms de Bakou, toutes ces convulsions qui furent à l'origine de l'intervention massive et sanglante de l'Armée "rouge", constituent un pas de plus dans l'effondrement, dans l'éclatement de ce qui constituait, il y a encore moins d'un an, la deuxième puissance mondiale. La sécession ouverte de l'Azerbaïdjan (où même le Soviet suprême local s'est dressé contre Moscou), mais aussi celle de l'Arménie où la rue est tenue par des forces armées qui n'ont rien à voir avec les autorités officielles, ne font que précéder la sécession de l'ensemble des régions qui entourent la Russie. Par l'emploi de la force armée, les autorités de Moscou ont essayé de mettre un terme à un tel processus dont la sécession "en douceur" de la Lituanie, et les manifestations nationalistes en Ukraine du début janvier, annoncent les prochaines étapes. Mais une telle répression ne peut, au plus, qu'en retarder quelque peu les échéances. A Bakou, déjà, sans parler des autres villes et de la campagne, la situation est loin d'être sous contrôle des autorités centrales. Le silence qu'observent désormais les médias ne signifie nullement que les choses soient "rentrées dans l’ordre". En URSS, comme en Occident, la "glasnost" est sélective. Il s'agit de ne pas encourager d'autres nationalités de suivre l'exemple des arméniens et des azéris. Et même si, pour le moment, les tanks ont réussi à rétablir une chappe de plomb sur les manifestations nationalistes, rien n'est réglé pour le pouvoir de Moscou. Jusqu'à présent, ce n'était qu'une partie de la population qui s'était mobilisée activement contre la tutelle de la Russie, l'arrivée des chars et les massacres ont soudé l'ensemble des azéris contre l’"occupant". Les arméniens ne sont plus les seuls à craindre pour leur vie : les populations russes d'Azerbaïdjan risquent maintenant de payer pour cette opération militaire. De plus, les autorités de Moscou n'ont pas les moyens d'employer partout la même méthode de "maintien de l'ordre". D'une part, les azéris ne représentent qu'un vingtième de la totalité des populations non russes qui peuplent l'URSS. On se demande avec quels moyens, par exemple, le gouvernement de ce pays pourrait mettre au pas les 40 millions d'ukrainiens. D’autre part, les autorités ne peuvent compter sur l'obéissance de l'Armée "rouge" elle-même. Dans celle-ci, les soldats appartenant aux différentes minorités qui aujourd'hui réclament leur indépendance sont de moins en moins disposés à se faire tuer pour garantir la tutelle russe sur ces minorités. En outre, les russes eux-mêmes rechignent de plus en plus à assumer ce genre de travail. C'est ce qu'ont démontré des manifestations comme celle du 19 janvier à Krasnodar, dans le Sud de la Russie, dont les slogans montraient clairement que la population n'est pas prête à accepter un nouvel Afghanistan, manifestations qui ont contraint les autorités à libérer les réservistes mobilisés quelques jours auparavant.
Ainsi, le même phénomène qui a conduit il y a quelques mois à l'explosion de l'ancien bloc russe, se poursuit aujourd'hui avec l'explosion de son chef de file. De même que les régimes staliniens eux-mêmes, le bloc de l'Est ne tenait en place que par la terreur, par la menace, plusieurs fois mise à exécution, d'une brutale répression armée. Dès lors que l'URSS, du fait de son effondrement économique et de la paralysie qui en résultait pour son appareil politique et militaire, n'a plus eu les moyens d'une telle répression, son empire s'est immédiatement disloqué. Mais cette dislocation portait dans son sillage celle de l'URSS elle-même puisque ce pays est, lui aussi, constitué par une mosaïque de nationalités sous la tutelle de la Russie. Le nationalisme de ces minorités, dont l'impitoyable répression stalinienne n'avait fait qu'empêcher les manifestations ouvertes, mais qui s'était encore accru du fait même de cette répression et du silence auquel il était condamné, s'est déchaîné dès qu'il est apparu, avec la "perestroïka" gorbatchévienne, que s'éloignait la menace de la répression. Aujourd'hui, cette répression est à nouveau à l'ordre du jour, mais il est désormais trop tard pour faire tourner à l'envers la roue de l'histoire. De même que la situation économique, la situation politique échappe complètement au contrôle de Gorbatchev et de son parti. La seule chose que sa "perestroïka" ait permise, c'est encore moins de biens sur les étalages des magasins, encore plus de misère et, en outre, la libération des pires sentiments chauvins et xénophobes, les pogroms et les massacres de tous ordres.
Et ce n'est qu'un début, le chaos qui règne dès à présent en URSS ne peut que s'aggraver car le régime qui gouverne encore ce pays, de même que l'état de son économie, n'offrent aucune perspective. La "perestroïka", c'est-à-dire la tentative d'adapter "à petits pas" un appareil économique et politique paralysé face à l'aggravation de la crise mondiale, démontre chaque jour plus sa faillite. Le retour à la situation passée, le rétablissement de la centralisation complète de l'appareil économique et de la terreur de la période stalinienne ou brejnévienne, même s'il est tenté par un sursaut des secteurs "conservateurs" de l'appareil, ne pourra rien résoudre. Ces méthodes ont déjà fait faillite puisque la perestroïka partait justement du constat de cette faillite. Depuis, la situation n'a fait que s'aggraver sur tous ces plans à une échelle considérable. La résistance encore très forte d'un appareil bureaucratique qui voit s'écrouler sous ses pieds les bases mêmes de son pouvoir et de ses privilèges ne pourrait aboutir qu'à de nouveaux bains de sang sans permettre pour autant de surmonter le chaos. Enfin, l'établissement de formes plus classiques de la domination capitaliste - autonomie de gestion des entreprises, introduction de critères de compétitivité liés au marché - même s'il constitue de toutes façons la seule "perspective", ne peut, dans l'immédiat, qu'aggraver encore plus le chaos de l'économie. On peut voir à l'heure actuelle en Pologne les conséquences d'une telle politique : 900 % d'inflation, montée irrépressible du chômage et paralysie croissante des entreprises (au 4e trimestre 89, la production des biens alimentaires traités par l'industrie a chuté de 41 %, celle des vêtements, de 28 %). Et dans un tel contexte de chaos économique, une "démocratisation en douceur", la stabilité politique, n'ont pas de place.
Ainsi, quelle que soit la politique qui sortira des instances dirigeantes du parti communiste de l'URSS, quel que soit le successeur éventuel de Gorbatchev, le résultat ne saurait être très différent, la perspective pour ce pays est celle de convulsions croissantes dont celles des dernières semaines ne nous donnent qu'une petite idée : famines, massacres, règlements de compte armés entre fractions de la "Nomenklatura" et entre populations saoulées par le nationalisme. C'est avec une épouvantable barbarie que le stalinisme avait établi son pouvoir sur le cadavre de la Révolution communiste d'octobre 1917, victime de son isolement international. C'est dans la barbarie, le chaos, le sang et la boue que ce système agonise aujourd'hui.
De plus en plus, la situation de l'URSS et de la plupart des pays d'Europe de l'Est va ressembler à celle des pays du "Tiers-monde". La barbarie complète qui depuis des décennies a transformé ces derniers pays en un véritable enfer, la décomposition totale de toute vie sociale, la loi des gangs armés, tel que le Liban, par exemple, nous en offre aujourd'hui le tableau, seront de moins en moins réservées à des zones éloignées du coeur du capitalisme. Désormais, c'est toute la partie du monde jusqu'à présent dominée par la seconde puissance mondiale qui est menacée de "urbanisation". Et cela, en Europe même, à quelques centaines de kilomètres des concentrations industrielles les plus anciennes et importantes du monde.
C'est pour cette raison que l'effondrement du bloc impérialiste de l'Est, non seulement constitue un bouleversement pour les pays de cette zone et pour les constellations impérialistes telles qu'elles étaient sorties de la seconde guerre mondiale, mais porte avec lui une instabilité générale qui ne manquera pas d'affecter tous les pays du monde, y compris les plus solides. En ce sens, il importe que les révolutionnaires soient capables de prendre la mesure de ces bouleversements et en particulier d'actualiser le cadre d'analyse qui était valable jusqu'à l'été dernier, au moment où s'est tenu notre dernier congrès international (voir Revue Internationale n°59), mais que les événements de la seconde partie de 1989 se sont chargés de rendre en partie caduc. C'est ce que nous nous proposons de faire sur les trois points "classiques" de l'analyse de la situation internationale :
{C}- {C}la crise du capitalisme,
{C}- {C}les conflits impérialistes,
{C}- {C}la lutte de classe.
La crise du capitalisme
C'est le point sur lequel les analyses du dernier congrès du CCI restent le plus d'actualité. En effet, l'évolution de la situation de l'économie mondiale au cours des 6 derniers mois a pleinement confirmé l'analyse du congrès sur l'aggravation de la crise du capitalisme. Les illusions que les "spécialistes" bourgeois avaient essayé d'entretenir sur la "croissance" et sur la "sortie de la crise" - illusions basées sur les chiffres de 1988 et début 1989 concernant les principaux pays avancés - sont, d'ores et déjà, rudement battues en brèche (voir les articles à ce sujet dans ce numéro de la Revue Internationale et dans le précédent).
Pour ce qui concerne les pays de l’ex-bloc de l'Est, la "Glasnost", qui aujourd'hui permet de se faire une idée plus réaliste de leur situation véritable, permet en même temps de mesurer l'étendue du désastre. Les chiffres officiels antérieurs, qui déjà rendaient compte d'un sinistre de première grandeur, étaient encore bien en deçà de la réalité. L'économie des pays de l'Est se présente comme un véritable champ de ruines. L'agriculture (qui pourtant emploie une proportion bien plus élevée de la force de travail que dans les pays occidentaux) se trouve, dans la plupart des pays, absolument incapable de nourrir la population. Le secteur industriel est non seulement totalement anachronique et obsolète, mais, de plus, complètement grippé, incapable de fonctionner, du fait des carences des transports et de l'approvisionnement en pièces détachées, de l'usure des machines, etc., et surtout de la désimplication générale de tous ses acteurs, depuis les manoeuvres jusqu'aux directeurs des usines. Près d'un demi-siècle après la seconde guerre mondiale, l'économie qui devait, aux dires de Kroutchev au début des années 60, rattraper et dépasser celle des pays occidentaux et "faire la preuve de la supériorité du 'socialisme' sur le capitalisme", semble tout droit sortie de la guerre. Et la situation, comme on l'a vu, n'est pas prêt de s'améliorer. Si c'est bien la faillite totale de l'économie stalinienne, enregistrée depuis déjà des années face à l'aggravation de la crise mondiale, qui se trouve à l'origine de l'effondrement du bloc de l'Est, cette faillite n'a pas encore atteint son point le plus extrême, loin de là. Et cela d'autant plus qu'au niveau mondial, la crise économique, non seulement ne peut que s'aggraver encore, mais sera encore amplifiée par les conséquences de la catastrophe qui touche les pays de l'Est.
En effet, il importe de souligner la totale ineptie (propagée par certains secteurs de la bourgeoisie, mais aussi par certains groupes révolutionnaires) suivant laquelle l'ouverture de l'économie des pays de l'Est sur le marché mondial pourrait constituer un "ballon d'oxygène" pour l'ensemble de l'économie capitaliste. La réalité est toute autre.
En premier lieu, pour que les pays de l'Est puissent contribuer à une amélioration de la situation de l'économie mondiale, il faudrait qu'ils constituent un marché réel. Ce ne sont pas les besoins qui font défaut, comme ils ne font pas défaut aux pays sous-développés, d'ailleurs. La question est : avec quoi peuvent-ils acheter tout ce qui leur manque ? Et c'est là qu'on mesure immédiatement l'absurdité d'une telle analyse. Ces pays N'ONT RIEN pour payer leurs achats. Ils ne disposent d'absolument aucune ressource financière : en fait, il y a déjà longtemps qu'ils ont rejoint le lot des pays gravement endettés (ainsi la dette extérieure de l'ensemble des ex-démocraties populaires se montait en 89 à 100 milliards de dollars ([3] [36]), soit un chiffre proche de celui du Brésil pour une population et un PNB également comparables). Pour qu'ils puissent acheter, il faudrait qu'ils puissent vendre. Mais que peuvent-ils vendre sur le marché mondial alors que la cause première de l'effondrement des régimes staliniens (dans le cadre, évidemment de la crise générale du capitalisme) est justement le manque complet de compétitivité sur ce même marché des économies qu'ils dirigeaient ?
A cette objection, certains secteurs de la bourgeoisie répondent qu'il faudrait un nouveau "Plan Marshall" qui permettrait de reconstituer le potentiel économique de ces pays. En réalité, même si l'économie des pays de l'Est comporte des points communs avec celle de l'ensemble de l'Europe au lendemain de la seconde guerre mondiale, un nouveau "Plan Marshall" est totalement impossible aujourd'hui. Ce plan (dont la vocation essentielle, d'ailleurs, n'était pas en soi de reconstruire l'Europe, mais de soustraire celle-ci à la menace d'un contrôle par l'URSS), a pu réussir dans la mesure où le monde entier (à l'exception des Etats-Unis) était à reconstruire. A cette époque ne se posait pas un problème de surproduction généralisée de marchandises ; et c'est justement la fin de la reconstruction de l'Europe occidentale et du Japon qui se trouve à l'origine de la crise ouverte que nous connaissons depuis le milieu des années 60. C'est pour cela qu'aujourd'hui, une injection massive de capitaux vers les pays de l’Est visant à développer leur potentiel économique, et particulièrement industriel, ne peut être à l'ordre du jour. Même en supposant qu'on puisse remettre sur pieds un tel potentiel productif, les marchandises produites ne feraient qu'encombrer encore plus un marché mondial déjà sursaturé. Il en est des pays qui aujourd'hui sortent du stalinisme comme des pays sous-développés: toute la politique de crédits massifs injectés dans ces derniers au cours des années 70 et 80 n'a pu aboutir qu'à la situation catastrophique que l'on connaît bien (une dette de 1400 milliards de dollars et des économies encore plus ravagées qu'auparavant). Les pays de l'Est (dont l'économie s'apparente d'ailleurs à celle des pays sous-développés par bien des côtés) ne peuvent connaître de sort différent. D'ailleurs, les financiers des grandes puissances occidentales ne s'y trompent pas : ils ne se bousculent pas pour apporter des capitaux aux pays qui, comme la Pologne fraîchement "déstalinisée", les réclament à cors et à cris (il faudrait à ce pays au minimum 10 milliards de dollars en trois ans), y compris en leur envoyant l'"ouvrier" prix Nobel Walesa. Et comme ces responsables financiers sont tout sauf des philanthropes, il n'y aura ni crédits ni ventes massives des pays les plus développés en direction des pays qui viennent de "découvrir" les "vertus" du libéralisme et de la "Démocratie". La seule chose à laquelle on puisse s'attendre, c'est l'envoi de crédits ou d'aides d'urgence permettant à ces pays de s'éviter une banqueroute financière ouverte et des famines qui ne feraient encore qu'aggraver les convulsions qui les secouent. Et ce n'est pas cela qui pourra constituer un "ballon d'oxygène" pour l'économie mondiale.
Parmi les pays de l'ex-bloc de l'Est, la RDA constitue évidemment un cas à part. En effet, ce pays n'est pas destiné à se maintenir comme tel. La perspective de son absorption par la RFA est d'ores et déjà admise, à contre-coeur, non seulement par l'ensemble des grandes puissances, mais y compris par son gouvernement actuel. Cependant, l'intégration économique, première étape de cette "réunification", et qui constitue le seul moyen de mettre fin à l'exode massif de la population de RDA vers la RFA, pose dès à présent des problèmes considérables, tant à ce dernier pays qu'à l'ensemble de ses partenaires occidentaux. Le "sauvetage" de l'économie d'Allemagne de l'Est constitue un fardeau énorme du point de vue financier. Si, d'un côté, les investissements qui ne manqueront pas d'être réalisés dans cette partie de l'Allemagne peuvent constituer un "débouché" momentané pour certains secteurs industriels de la RFA et de quelques autres pays d'Europe, de l'autre côté, ces investissements ne pourront qu'accentuer l'aggravation de l'endettement généralisé de l'économie capitaliste tout en contribuant à engorger encore plus le marché mondial. C'est pour cela que l'annonce récente de la création d'une union monétaire entre la RFA et la RDA, décision qui avait des motivations plus politiques qu'économiques (comme en témoignent les réticences du président de la Banque fédérale), n'a pas soulevé l'enthousiasme, loin de là, dans l'ensemble des pays occidentaux. En fait, la RDA constitue, sur le plan économique, un cadeau empoisonné pour la RFA. Dans la corbeille de mariage, l'Allemagne de l'Est n'apporte qu'une industrie délabrée, une économie essoufflée et poussive, une montagne de dettes et des wagons de marks-Est qui valent à peine le papier dont ils sont faits, mais que la RFA devra racheter au prix fort lorsque le Deutsch-Mark deviendra la monnaie commune aux deux parties de l’Allemagne. En RFA, la "planche à billets" a de beaux jours devant elle, l'inflation aussi.
Ainsi, ce que, fondamentalement, l'économie capitaliste peut attendre de l'effondrement du bloc de l'Est, ce n'est certainement pas une atténuation de sa crise mais des difficultés accrues. D'une part, comme on l'a vu, la crise financière (la montagne des dettes non solvables) ne peut que s'aggraver, mais, en outre, l'affaiblissement de la cohésion du bloc occidental et, à terme sa disparition (comme nous le verrons plus loin), portent avec eux la perspective d'un surcroît de difficultés pour l'économie mondiale. Comme nous l'avons mis en évidence depuis longtemps, une des raisons pour lesquelles le capitalisme a pu ralentir jusqu'à présent le rythme de son effondrement, c'est la mise en oeuvre d'une politique de capitalisme d'Etat à l'échelle de tout le bloc occidental (c'est-à-dire de la sphère dominante du monde capitaliste). Une telle politique supposait une discipline très sérieuse de la part des afférents pays qui composent ce bloc. Cette discipline était obtenue principalement grâce à l'autorité qu'exerçaient les Etats-Unis sur leurs alliés du fait de leur puissance économique mais aussi militaire. Le "parapluie militaire" des Etats-Unis face à la "menace soviétique" (de même, évidemment, que la place prépondérante de ce pays, et de sa monnaie, dans le système financier international) appelait, en contrepartie, une soumission aux volontés américaines dans le domaine économique. Aujourd'hui, avec la disparition de toute menace militaire de l'URSS sur les Etats du bloc occidental (notamment ceux d'Europe occidentale et le Japon), les moyens de pression des Etats-Unis sur leurs "alliés" se sont sensiblement réduits, et cela d'autant plus que l'économie américaine, avec ses énormes déficits et le recul continu de sa compétitivité sur le marché mondial, est en très nette perte de vitesse vis-à-vis de ses principaux concurrents. La tendance qui va donc s'affirmer de plus en plus est celle d'une tentative des économies les plus performantes, en premier lieu celles du Japon et de la RFA, de se dégager de la tutelle américaine pour jouer leur propre carte sur l'arène économique internationale, ce qui conduira à une accentuation de la guerre commerciale et à une aggravation de l'instabilité générale de l'économie capitaliste.
En fin de compte, il faut affirmer clairement que l'effondrement du bloc de l'Est et les convulsions économiques et politiques des pays qui le constituaient, n'augurent nullement une quelconque amélioration de la situation économique de la société capitaliste. La faillite économique des régimes staliniens, conséquence de la crise générale de l'économie mondiale, ne fait qu'annoncer et précéder l'effondrement des secteurs les plus développés de cette économie.
Les antagonismes impérialistes
La configuration géopolitique sur laquelle a vécu le monde depuis la seconde guerre mondiale est désormais complètement remise en cause par les événements qui se sont déroulés au cours de la seconde moitié de l’année 1989. Il n'existe plus aujourd'hui deux blocs impérialistes se partageant la mainmise sur la planète.
Le bloc de l'Est, c'est devenu une évidence (y compris pour les secteurs de la bourgeoisie qui, pendant des années avaient jeté des cris d'alarme contre le danger présenté par "l'Empire du Mal" et sa "formidable puissance militaire"), a cessé d'exister. Cette réalité a été confirmée par toute une série d'événements récents tels que :
- le soutien que les principaux dirigeants occidentaux (Bush, Thatcher, Mitterrand, notamment) apportent à Gorbatchev (soutien qui s'accompagne même d'éloges dithyrambiques à son égard) ;
- les résultats des différentes rencontres au sommet récentes (Bush-Gorbatchev, Mitterrand-Gorbatchev, Kohl-Gorbatchev, etc.) qui tous font apparaître la réelle disparition des antagonismes qui ont opposé pendant quatre décennies l'Est et l'Ouest ;
- l'annonce par l'URSS du retrait de l'ensemble de ses troupes basées à l'étranger ;
- la réduction des dépenses militaires des Etats-Unis qui est planifiée dès à présent ;
- la décision conjointe de réduire rapidement à 195 000 les effectifs des armées soviétique et américaine basées en Europe centrale (essentiellement dans les deux Allemagnes), et qui correspond en fait à un retrait de 405 000 hommes pour l'URSS contre 90 000 pour les Etats-Unis ;
{C}- {C}l'attitude des principaux dirigeants occidentaux, lors des événements de Roumanie, demandant à l'URSS d'intervenir militairement pour apporter un soutien aux forces "démocratique" face aux résistances qu'elles rencontraient de la part des derniers "fidèles" de Ceaucescu ;
{C}- {C}le soutien apporté par les mêmes à l'intervention des chars russes à Bakou, en janvier.
Dix ans après le tollé général provoqué dans les rangs des pays occidentaux par l'arrivée des mêmes chars à Kaboul, cette différence d'attitude est on ne peut plus significative du bouleversement complet de la géographie impérialiste de la planète. Ce bouleversement est d'ailleurs confirmé par la tenue, à Ottawa, début février, d'une conférence (co-présidée par le Canada et la Tchécoslovaquie) entre l'OTAN et le Pacte de Varsovie et au cours de laquelle l'URSS a accepté pratiquement toutes les exigences des occidentaux.
Cette disparition du bloc de l'Est signifie-t-elle que, désormais, le monde sera dominé par un seul bloc impérialiste ou que le capitalisme ne connaîtra plus d'affrontements impérialistes ? De telles hypothèses seraient tout à fait étrangères au marxisme.
Ainsi, la thèse du "super-impérialisme", développée par Kautsky avant la première guerre mondiale a été combattue autant par les révolutionnaires (notamment Lénine) que par les faits eux-mêmes. Elle est restée tout autant mensongère lorsqu'elle a été reprise et adaptée par les staliniens et les trotskystes pour affirmer que le bloc dominé par l'URSS n'était pas impérialiste. Aujourd'hui, l'effondrement de ce bloc ne saurait remettre en selle ce genre d'analyses : cet effondrement porte avec lui, à terme, celui du bloc occidental. De plus, ce ne sont pas seulement les grandes puissances à la tête des blocs qui sont impérialistes, contrairement à la thèse défendue par le CWO. Dans la période de décadence du capitalisme, TOUS les Etats sont impérialistes et prennent les dispositions pour assumer cette réalité : économie de guerre, armements, etc. C'est pour cela que l'aggravation des convulsions de l'économie mondiale ne pourra qu'attiser les déchirements entre ces différents Etats, y compris, et de plus en plus, sur le plan militaire. La différence avec la période qui vient de se terminer, c'est que ces déchirements et antagonismes qui auparavant étaient contenus et utilisés par les deux grands blocs impérialistes, vont maintenant passer au premier plan. La disparition du gendarme impérialiste russe, et celle qui va en découler pour le gendarme américain vis-à-vis de ses principaux "partenaires" d'hier, ouvrent la porte au déchaînement de toute une série de rivalités plus locales. Ces rivalités et affrontements ne peuvent pas, à l'heure actuelle, dégénérer en un conflit mondial (même en supposant que le prolétariat ne soit plus en mesure de s'y opposer). En revanche, du fait de la disparition de la discipline imposée par la présence des blocs, ces conflits risquent d'être plus violents et plus nombreux, en particulier, évidemment, dans les zones où le prolétariat est le plus faible.
Jusqu'à présent, dans la période de décadence, une telle situation d'éparpillement des antagonismes impérialistes, d'absence d'un partage du monde (ou de ses zones décisives) entre deux blocs, ne s'est jamais prolongée. La disparition des deux constellations impérialistes qui étaient sorties de la seconde guerre mondiale porte, avec elle, la tendance à la recomposition de deux nouveaux blocs. Cependant, une telle situation n'est pas encore à l'ordre du jour du fait :
- de la permanence d'un certain nombre de structures issues de la configuration passée (par exemple, l'existence formelle des deux grandes alliances militaires, l'OTAN et le Pacte de Varsovie, avec le déploiement des dispositifs militaires qui y correspondent) ;
{C}- {C}de l'absence d'une grande puissance capable de prendre, dans l'immédiat, le rôle - perdu définitivement par l'URSS - de chef de file du bloc qui devrait faire face à celui qui serait dominé par les Etats-Unis.
Pour tenir ce rôle, un pays comme l'Allemagne, notamment après sa réunification, serait évidemment le mieux placé, du fait de sa puissance économique et de sa situation géographique. C'est pour cette raison que, dès à présent, il existe une unité d'intérêts entre les pays occidentaux et l'URSS pour ralentir (ou tout au moins tenter de contrôler) le processus de cette réunification. Cependant, si, d'un côté, il faut constater l'affaiblissement considérable de la cohésion du bloc américain, affaiblissement qui ne fera que s'accentuer, il faut prendre garde également, comme on vient de le faire ressortir, de ne pas annoncer de façon prématurée la reconstitution d'un nouveau bloc dirigé par l'Allemagne. Sur le plan militaire, ce pays est loin d'être prêt à assumer un tel rôle. Du fait de sa situation de "vaincu" de la seconde guerre mondiale, la puissance de son armée est loin d'être à la hauteur de sa puissance économique. En particulier, la RFA n'a pas été autorisée, jusqu'à présent, à se doter de l'arme atomique, l'énorme quantité d'engins nucléaires qui se trouvent sur son sol étant entièrement contrôlée par l’Otan. En outre, et plus important encore à long terme, la tendance à un nouveau partage du monde entre deux blocs militaires est contrecarrée, et pourra peut-être même être définitivement compromise, par le phénomène de plus en plus profond et généralisé de décomposition de la société capitaliste tel que nous l'avons déjà mis en évidence (voir Revue Internationale n° 57).
Ce phénomène, qui s'est développé tout au long des années 1980, résulte de l'incapacité pour les deux classes fondamentales de la société à apporter leur propre réponse historique à la crise sans issue dans laquelle s'enfonce le mode de production capitaliste. Si la classe ouvrière, en refusant de se laisser embrigader derrière les drapeaux bourgeois, contrairement à ce qu'elle fit dans les années 30, a pu jusqu'à présent empêcher le capitalisme de déchaîner une troisième guerre mondiale, elle n'a pas, en revanche, trouvé la force d'affirmer clairement sa propre perspective : la révolution communiste. Dans une telle situation où la société se trouve momentanément "bloquée", privée de toute perspective, alors que la crise capitaliste ne cesse de s'aggraver, l'histoire ne s'arrête pas. Son "cours" se traduit par une putréfaction croissante de toute la vie sociale dont nous avons déjà analysé dans cette Revue les manifestations multiples : depuis le fléau de la drogue jusqu'à la corruption généralisée des hommes politiques, en passant par les menaces sur l'environnement, la multiplication de catastrophes dites "naturelles" ou "accidentelles", le développement de la criminalité, du nihilisme et du désespoir des jeunes (le "no future"). Une des expressions de cette décomposition réside dans l'incapacité croissante de la classe bourgeoise à contrôler, non seulement la situation économique, mais aussi la situation politique. Un tel phénomène est évidemment particulièrement avancé dans les pays de la périphérie du capitalisme, ceux qui, pour être arrivés trop tard dans le développement industriel, ont été les premiers et les plus gravement frappés par la crise de ce système. Aujourd'hui, le chaos économique et politique qui se développe dans les pays de l'Est, la perte complète de contrôle de la situation par les bourgeoisies locales, constitue une nouvelle manifestation de ce phénomène général. Et la bourgeoisie la plus forte, c'est-à-dire celle des pays avancés d'Europe et d'Amérique du Nord, est elle-même consciente de ne pas être à l'abri de ce type de convulsions. C'est pour cela qu'elle apporte tout son soutien à Gorbatchev dans sa tentative de "remettre de l'ordre" dans son empire, même quand c'est fait de façon sanglante comme à Bakou. Elle a trop peur que le chaos qui est en train de se développer à l'Est ne franchisse, tel le nuage radioactif de Tchernobyl, les frontières et ne vienne se répercuter à l'Ouest.
A cet égard, l'évolution de la situation en Allemagne est significative. La rapidité incroyable avec laquelle se sont enchaînés les événements depuis l'automne dernier ne signifie nullement que la bourgeoisie soit saisie d'une frénésie de "démocratisation". En réalité, si la situation en RDA a cessé depuis longtemps de répondre à une quelconque politique délibérée de la bourgeoisie locale, il en est de même, de plus en plus, pour la bourgeoisie de RFA, et aussi pour î'ensemble de la bourgeoisie mondiale. La réunification des deux Allemagnes, dont aucun des "vainqueurs" de 1945 ne voulait il y a quelques semaines (il y a 3 mois, Gorbatchev l'envisageait pour "dans un siècle") de peur que la reconstitution d'une "Grande Allemagne" hégémonique en Europe n'aiguise ses appétits impérialistes, s'impose de plus en plus à tous comme le seul moyen de combattre le chaos en RDA, et par contagion, dans tous les pays voisins. Même la bourgeoisie d'Allemagne de l'Ouest trouve que les choses vont "trop vite". Dans les conditions où elle se présente, cette réunification, qui était pourtant appelée de ses voeux depuis des décennies, ne pourra lui apporter que des difficultés. Mais plus elle retarde son moment, et plus ces difficultés seront considérables. Que la bourgeoisie de RFA, une des plus solides du monde, en soit aujourd'hui réduite à courir après les événements en dit long sur ce qui attend l'ensemble de la classe bourgeoise.
Dans un tel contexte de perte de contrôle de la situation par la bourgeoisie mondiale, il n'est pas dit que les secteurs dominants de celle-ci soient aujourd'hui en mesure de mettre en oeuvre l'organisation et la discipline nécessaires à la reconstitution de blocs militaires. Une bourgeoisie qui ne maîtrise plus la politique de son propre pays est bien mal armée pour s'imposer à d'autres bourgeoisies (comme on vient de le voir avec l'effondrement du bloc de l'Est dont la cause première réside dans l'implosion économique et politique de sa puissance dominante).
C'est pour cela qu'il est fondamental de mettre en évidence que, si la solution du prolétariat -la révolution communiste - est la seule qui puisse s'opposer à la destruction de l'humanité (qui constitue la seule "réponse" que la bourgeoisie puisse apporter à sa crise), cette destruction ne résulterait pas nécessairement d'une troisième guerre mondiale. Elle pourrait également résulter de la poursuite, jusqu'à ses conséquences extrêmes (catastrophes écologiques, épidémies, famines, guerres locales déchaînées, etc.) de cette décomposition.
L'alternative historique "Socialisme où Barbarie", telle qu'elle a été mise en évidence par le marxisme, après s'être concrétisée sous la forme de "Socialisme ou Guerre impérialiste mondiale" au cours de la plus grande partie du 20e siècle, s'était précisée sous la forme terrifiante de "Socialisme ou Destruction de l'humanité" au cours des dernières décennies du fait du développement des armements atomiques. Aujourd'hui, après l'effondrement du bloc de l'Est, cette perspective reste tout à fait valable. Mais il convient de mettre en avant qu'une telle destruction peut provenir de la guerre impérialiste généralisée OU de la décomposition de la société.
Le recul de la conscience dans la classe ouvrière
Les "Thèses sur la crise économique et politique dans les pays de l'Est" (Revue Internationale 60) mettent en évidence que l'effondrement du bloc de l'Est et l'agonie du stalinisme vont se répercuter sur la conscience du prolétariat par un recul de celle-ci. Les causes d'un tel recul sont analysées dans l'article "Des difficultés accrues pour le prolétariat" (Ibid). On peut les résumer ainsi :
{C}-{C}au même titre que le surgissement, en 1980, d'un syndicat "indépendant" en Pologne, mais à une échelle beaucoup plus vaste, compte tenu de l'ampleur considérable des événements actuels, l'effondrement du bloc de l'Est et l'agonie du stalinisme vont permettre une poussée très importante des illusions démocratiques, non seulement au sein du prolétariat des pays de l'Est, mais également dans celui des pays occidentaux ;
{C}-{C}"le fait que cet événement historique considérable se soit produit indépendamment de la présence du prolétariat ne peut engendrer au sein de celui-ci qu'un sentiment d'impuissance" (Ibid) ;
{C}-{C}"dans la mesure ou l'effondrement du bloc de l'Est fait suite à une période de 'guerre froide’ avec le bloc de l'Ouest, où ce dernier apparaît comme le 'vainqueur', sans coup férir, d'une telle 'guerre', cela va engendrer dans les populations d'Occident, et aussi parmi les ouvriers, un sentiment d'euphorie et de confiance envers leurs gouvernements similaire (toutes proportions gardées) à celui qui avait pesé sur le prolétariat des pays 'vainqueurs' lors des deux guerres mondiales";
{C}-{C}la dislocation du bloc de l'Est ne peut qu'exacerber le poids du nationalisme, dans les républiques périphériques de l'URSS et dans les anciennes "Démocraties populaires", mais également dans un certain nombre de pays d'Occident et, en particulier, dans un pays aussi important que l'Allemagne du fait de la réunification des deux parties de ce pays ;
-"ces mystifications nationalistes vont peser également sur les ouvriers d'Occident... par le discrédit et l'altération que va subir dans leur conscience l'idée même d'internationalisme prolétarien..., notion dénaturée complètement par le stalinisme, et dans sa foulée par l'ensemble des forces bourgeoises, qui l'ont identifié avec la domination impérialiste de l'URSS sur son bloc" ;
-"en fait,... c'est la perspective-même de la révolution communiste mondiale qui est affectée par l'effondrement du stalinisme (...) ; l'identification entre le communisme et le stalinisme avait permis, dans les années 1930, à la bourgeoisie d'embrigader la classe ouvrière derrière ce dernier afin de parachever sa défaite (...) ; au moment où le stalinisme est complètement déconsidéré aux yeux de tous les ouvriers, ce même mensonge lui sert pour les détourner de la perspective du communisme."
On peut compléter ces éléments en considérant l'évolution de ce qui reste des partis staliniens des pays occidentaux.
L'effondrement du bloc de l'Est implique, à terme, la disparition des partis staliniens, non seulement dans les pays où ils dirigeaient l'Etat, mais aussi dans ceux où ils avaient pour fonction d'encadrer la classe ouvrière. Soit ces partis se transformeront radicalement - comme est en train de le faire le PC d'Italie - en abandonnant complètement ce qui faisait leur spécificité (y compris leur nom), soit ils seront réduits à l'état de petites sectes (comme c'est déjà le cas aux Etats-Unis et dans la plupart des pays d'Europe du Nord). Ils pourront encore intéresser les ethnologues, ou les archéologues, mais ne joueront plus aucun rôle sérieux comme organes d'encadrement et de sabotage des luttes ouvrières. La place qu'ils tenaient dans ce domaine, jusqu'à présent, dans un certain nombre de pays, sera prise par la social-démocratie ou par des secteurs de gauche de celle-ci. De ce fait, le prolétariat aura de moins en moins l'occasion, dans le développement de sa lutte, de s'affronter au stalinisme, ce qui ne pourra que favoriser encore l'impact du mensonge qui identifie celui-ci au communisme.
Les perspectives pour la lutte de classe
Ainsi, l'effondrement du bloc de l'Est et la mort du stalinisme créent de nouvelles difficultés pour la prise de conscience dans le prolétariat. Est-ce à dire que ces événements vont également déterminer un ralentissement sensible des combats de classe ? Sur ce point, il est nécessaire de rappeler que les "Thèses" parlent d'un "recul de la conscience" et non d'un recul de la combativité du prolétariat. Elles précisent même que "les attaques incessantes et de plus en plus brutales que le capitalisme ne manquera pas d'asséner contre les ouvriers vont les contraindre à mener le combat", car il serait faux de considérer que le recul de la conscience s'accompagnera d'un recul de la combativité. En de nombreuses reprises, déjà, nous avons mis en évidence la non-identité entre conscience et combativité. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir ici en tant que question générale. Dans le cas précis de la situation actuelle, il faut souligner que le présent recul de la conscience ne découle pas d'une défaite directe de la classe ouvrière suite à un combat qu'elle aurait engagé. C'est complètement en dehors d'elle et de ses luttes que se sont produits les événements qui, aujourd'hui, sèment le désarroi dans ses rangs. De ce fait, ce n'est pas la démoralisation qui pèse sur elle à l'heure actuelle. Si sa conscience est affectée, son potentiel de combativité, en revanche, n'est pas fondamentalement atteint. Et ce potentiel, avec les attaques de plus en plus brutales qui vont se déchaîner, peut se révéler à tout moment. Il importe donc de ne pas être surpris face aux explosions prévisibles de cette combativité. Elles ne pourraient pas être interprétées comme une remise en cause de notre analyse sur le recul de la conscience ni "oublier" que la responsabilité des révolutionnaires est d'intervenir en leur sein. .
En deuxième lieu, il serait faux d'établir une continuité dans l'évolution des luttes et de la conscience du prolétariat entre la période qui précède l'effondrement du bloc de l'Est et la période présente. Dans la période passée, le CCI a critiqué la tendance dominante, au sein du milieu politique prolétarien, à sous-estimer l'importance des luttes de la classe et des pas accomplis par celle-ci dans sa prise de conscience. La mise en évidence du recul actuel de cette prise de conscience ne signifie nullement une remise en cause de nos analyses pour la période passée, et notamment celles qui avaient été dégagées par le 8e Congrès du CCI (Revue Internationale n°59).
C'est vrai que l'année 1988 et la première moitié de 1989 ont été marquées par un certain nombre de difficultés dans le développement de la lutte et de la conscience de la classe, et notamment par un certain retour au premier plan des syndicats. Ce fait avait d'ailleurs été relevé dès avant le 8e congrès, notamment dans l’éditorial de la Revue Internationale n°58 qui notait que "cette stratégie (de la bourgeoisie) a réussi pour le moment à désorienter la classe ouvrière et à entraver sa marche vers l'unification de ses combats". Cependant, en s'appuyant sur les données de la situation internationale qui étaient celles de l'époque, notre analyse relevait les limites d'un tel moment de difficultés. En fait, les difficultés que rencontrait la classe ouvrière en 1988 et début 1989 se situaient sur un même plan (même si elles étaient plus sérieuses) que celles qu'elle avait pu rencontrer au cours de l'année 1985 (et relevées lors du 6e congrès du CCI : voir dans la Revue Internationale n° 44 la "Résolution sur la situation internationale" adoptée par ce congrès). Elles n'excluaient nullement la possibilité "de nouveaux surgissements massifs, de plus en plus déterminés et conscients de la lutte prolétarienne" (Revue Internationale n°58), de la même façon que le ralentissement de 1985 avait débouché en 1986 sur des mouvements aussi importants et significatifs que les grèves massives du printemps en Belgique et la grève des chemins de fer en France. En revanche, les difficultés que rencontre le prolétariat aujourd'hui se situent à un tout autre niveau. L'effondrement du bloc de l'Est et du stalinisme est un événement historique considérable dont les répercutions sur tous les aspects de la situation mondiale sont-elles mêmes extrêmement importantes. Ainsi, cet événement ne saurait être placé, du point de vue de son impact sur la classe, sur le même plan que telle ou telle série de manoeuvres de la bourgeoisie comme on les a connues depuis 20 ans, y compris la mise en avant de la carte de la gauche dans l'opposition, à la fin des années 1970.
En fait, c'est une autre période qui s'est ouverte aujourd'hui, distincte de celle que nous avons vécue pendant 20 ans. Depuis 1968, en effet, le mouvement général de la classe, malgré certains moments de ralentissement ou de courts reculs, s'est développé dans le sens de luttes de plus en plus conscientes, se libérant notamment de façon croissante de l'emprise des syndicats. En revanche, les conditions mêmes dans lesquelles s'est effondré le bloc de l'Est, le fait que le stalinisme n'ait pas été abattu par la lutte de classe mais par une implosion interne, économique et politique, déterminent le développement d'un voile idéologique (indépendamment même des campagnes médiatiques qui se déchaînent aujourd'hui), d'un désarroi pour la classe sans commune mesure avec tout ce qu'elle avait dû affronter jusqu'à présent, y compris la défaite de 1981 en Pologne. En fait, il nous faut considérer que, même si l'effondrement du bloc de l'Est s'était produit au moment où les luttes du prolétariat étaient en plein essor (par exemple fin 1983-début 1984, ou en 1986), cela n'aurait changé strictement rien à la profondeur du recul que cet événement aurait provoqué dans la classe (même si ce recul aurait pu éventuellement tarder un peu plus à faire sentir ses effets).
C'est pour cette raison, en particulier, qu'il convient aujourd'hui de mettre à jour l'analyse développée par le CCI sur la "gauche dans l'opposition". Cette carte était nécessaire à la bourgeoisie depuis la fin des années 1970 et tout au long des années 1980 du fait de la dynamique générale de la classe vers des combats de plus en plus déterminés et conscients, de son rejet croissant des mystifications démocratiques, électorales et syndicales. Les difficultés rencontrées dans certain pays (par exemple la France) pour la mettre en place dans les meilleures conditions, ne retirait rien au fait qu'elle constituait l'axe central de la stratégie de la bourgeoisie contre la classe ouvrière, ce qui était illustré par la permanence de gouvernements de droite dans des pays aussi importants que les Etats-Unis, la RFA et la Grande-Bretagne. En revanche, le recul actuel de la classe n'impose plus à la bourgeoisie, pour un certain temps, l'utilisation prioritaire de cette stratégie. Cela ne veut pas dire que dans ces derniers pays on verra nécessairement la gauche retourner au gouvernement : nous avons, à plusieurs reprises (voir, en particulier, la Revue Internationale n° 18), mis en évidence qu'une telle formule n'est indispensable que dans les périodes révolutionnaires ou de guerre impérialiste. Par contre, il ne faudra pas être surpris s'il advient un tel événement, ou bien considérer qu'il s'agit d'un "accident" ou l'expression d'une "faiblesse particulière" de la bourgeoisie de ces pays. La décomposition générale de la société se traduit pour la classe dominante par des difficultés accrues à maîtriser son jeu politique, mais nous n'en sommes pas au point où les bourgeoisies les plus fortes du monde pourraient laisser se dégarnir le terrain social face à une menace du prolétariat.
Ainsi, la situation mondiale, sur le plan de la lutte de classe, se présente avec des caractéristiques très sensiblement différentes de celles qui prévalaient avant l'effondrement du bloc de l'Est. Cependant, la mise en évidence de l'importance du recul présent de la conscience dans la classe ne saurait conduire à une remise en cause du cours historique tel qu'il a été analysé par le CCI depuis plus de 20 ans (même s'il convient de préciser cette notion comme on l'a vu plus haut).
En premier lieu, à l'heure actuelle, un cours vers la guerre mondiale est exclu du fait de l'inexistence de deux blocs impérialistes.
En second lieu, il importe de souligner les limites du recul actuel de la classe. En particulier, même si on peut comparer la nature des mystifications démocratiques qui aujourd'hui se renforcent dans le prolétariat avec celles qui se sont déchaînées au moment de la "Libération", il convient aussi de marquer les différences entre les deux situations. D'une part, ce sont les principaux pays industrialisés, et donc le coeur du prolétariat mondial, qui ont été directement impliqués dans la seconde guerre mondiale. De ce fait, c'est également de façon directe que l'euphorie démocratique a pu peser sur ce prolétariat. En revanche, les secteurs de la classe qui se trouvent aujourd'hui en première ligne de ces mystifications, ceux des pays de l'Est, sont relativement périphériques. C'est principalement à cause du "vent d'Est" qui souffle aujourd'hui, et non parce qu'il serait dans "l'oeil du cyclone", que le prolétariat de l'Ouest doit affronter ces difficultés. D'autre part, les mystifications démocratiques du lendemain de la guerre ont trouvé un relais puissant dans la "prospérité" qui a accompagné la reconstruction. La croyance en la "Démocratie" comme le "meilleur des mondes" a pu s'appuyer pendant deux décennies sur une amélioration réelle des conditions de vie de la classe dans les pays avancés et sur le sentiment que donnait le capitalisme d'avoir réussi à surmonter ses contradictions (sentiment qui a même pénétré certains groupes révolutionnaires). La situation est toute autre à l'heure actuelle où les bavardages bourgeois sur la "supériorité" du capitalisme "démocratique" vont se heurter aux faits têtus d'une crise économique insurmontable et de plus en plus profonde.
Ceci dit, il importe aussi de ne pas se laisser bercer et endormir par des illusions. Même si la guerre mondiale ne saurait, à l'heure actuelle, et peut-être de façon définitive, constituer une menace pour la vie de l'humanité, cette menace peut très bien provenir, comme on l'a vu, de la décomposition de la société. Et cela d'autant plus que si le déchaînement de la guerre mondiale requiert l'adhésion du prolétariat aux idéaux de la bourgeoisie, phénomène qui n'est nullement à l'ordre du jour à l'heure actuelle pour ses bataillons décisifs, la décomposition n'a nul besoin d'une telle adhésion pour détruire l'humanité. En effet, la décomposition de la société ne constitue pas, à proprement parler, une "réponse" de la bourgeoisie à la crise ouverte de l'économie mondiale. En réalité, ce phénomène peut se développer justement parce que la classe dominante n'est pas en mesure, du fait du non embrigadement du prolétariat, d'apporter SA réponse spécifique à cette crise, la guerre mondiale et la mobilisation en vue de celle-ci. La classe ouvrière, en développant ses luttes (comme elle l'a fait depuis la fin des années 1960), en ne se laissant pas embrigader derrière les drapeaux bourgeois, peut empêcher la bourgeoisie de déchaîner la guerre mondiale. En revanche, seul le renversement du capitalisme est en mesure de mettre fin à la décomposition de la société. De même qu'elles ne peuvent en aucune façon s'opposer à l'effondrement économique du capitalisme, les luttes du prolétariat dans ce système ne peuvent constituer un frein à sa décomposition.
En ce sens, si jusqu'à présent nous avions pu considérer que "le temps travaillait pour le prolétariat", que la lenteur du développement des combats de la classe permettait à celle-ci, de même qu'aux organisations révolutionnaires, de se reconstituer une expérience que la contre-révolution avait engloutie, cette analyse est devenue désormais caduque. Il ne "s'agit pas pour les révolutionnaires de s'impatienter et de 1 vouloir "forcer la main de l'histoire", mais ils doivent être conscients de la gravité croissante de la situation s'ils veuillent être à la hauteur de leurs responsabilités.
C'est pour cela que, dans leur intervention, s'ils doivent mettre en évidence que la situation historique reste encore entre les mains du prolétariat, qu'il est tout à fait capable, /par et dans ses combats, de surmonter les obstacles que la bourgeoisie a semés sur son chemin, ils doivent également insister sur l'importance des enjeux de la situation présente, et donc de sa propre responsabilité.
Pour la classe ouvrière, la perspective actuelle est donc celle de la poursuite de ses combats en réponse aux attaques économiques croissantes. Ces luttes vont se dérouler, durant toute une période, dans un contexte politique et idéologique difficile. C'est particulièrement vrai, évidemment, pour le prolétariat des pays où s'instaure aujourd'hui la "Démocratie". Dans ces pays, la classe ouvrière se retrouve dans une situation d'extrême faiblesse, comme le confirment, jour après jour, les événements qui s'y déroulent (incapacité d'exprimer la moindre revendication indépendante de classe dans les différents "mouvements populaires", enrôlement dans des conflits nationalistes - notamment en URSS -, participation même à des grèves typiquement xénophobes contre telle ou telle minorité ethnique, comme récemment en Bulgarie). Ces événements nous donnent un exemple de comment se présente une classe ouvrière prête à se laisser enrôler dans la guerre impérialiste.
Pour le prolétariat des pays occidentaux, la situation est, évidemment, très différente. Ce prolétariat est très loin de subir les mêmes difficultés que celui de l'Est. Le recul de sa conscience se traduira notamment par un retour en force des syndicats dont le travail sera facilité par l'accroissement des mystifications démocratiques et des illusions réformistes : "le patronat peut payer", "partage des bénéfices", "intéressement à la croissance", mystifications facilitant l'identification par les ouvriers de leurs intérêts avec ceux du capital national.
En outre, la poursuite et l'aggravation du phénomène de pourrissement de la société capitaliste exerceront, encore plus qu'au cours des années 1980, ses effets nocifs sur la conscience de la classe. Par l'ambiance générale de désespoir qui pèse sur toute la société, par la décomposition même de l'idéologie bourgeoise dont les émanations putrides viennent empoisonner l'atmosphère que respire le prolétariat, ce phénomène va constituer pour lui, jusqu'à la période prérévolutionnaire, une difficulté supplémentaire sur le chemin de sa prise de conscience.
Pour le prolétariat, il n'y a pas d'autre chemin que de rejeter l'embrigadement interclassiste derrière la lutte contre certains aspects particuliers de la société capitaliste moribonde (l'écologie, par exemple). Le seul terrain sur lequel il peut à l'heure actuelle se mobiliser comme classe indépendante (et c'est une question encore plus cruciale au moment du déferlement de la mystification démocratique qui ne connaît que des "citoyens", ou le "peuple") est celui où ses intérêts spécifiques ne peuvent être confondus avec les autres couches de la société et qui, plus globalement, détermine l'ensemble des autres aspects de la société : le terrain économique. Et c'est justement en ce sens que, comme nous l'avons affirmé depuis longtemps, la crise constitue "le meilleur allié du prolétariat". C'est l'aggravation de la crise qui va obliger celui-ci à se rassembler sur son terrain, à développer ses luttes qui constituent la condition du dépassement des entraves actuelles à sa prise de conscience, qui va lui ouvrir les yeux sur les mensonges à propos de la "supériorité" du capitalisme, qui va le contraindre à perdre ses illusions sur la possibilité pour le capitalisme de se sortir de sa crise et donc sur ceux, les syndicats et les partis de gauche, qui veulent l'attacher à ï'"intérêt national" en lui parlant de "partage des profits" et autres foutaises.
Aujourd'hui, alors que la classe ouvrière se débat contre tous les rideaux de fumée que la bourgeoisie a réussi momentanément à jeter devant ses yeux, restent toujours valables les mots de Marx :
"Il ne s'agit pas de ce que tel ou tel prolétaire ou même le prolétariat entier se représente à un moment comme le but. Il s'agit de ce qu'est le prolétariat et de ce que, conformément à son être, il sera historiquement contraint défaire."
Il appartient aux révolutionnaires de contribuer pleinement à la prise de conscience dans la classe de ce but que lui assigne l'histoire afin qu'elle puisse enfin transformer en réalité la nécessité historique de la révolution qui n'a jamais été aussi pressante.
CCI, 10 février 1990.
{C}
{C}[1]{C} [37] Ce texte est basé sur un rapport adopté par le CCI lors d'une réunion internationale tenue à la fin janvier 1990.
{C}[2]{C} [38] La très faible résistance opposée par la presque totalité des anciens dirigeants des "Démocraties populaires", et qui a permis des "transitions en douceur" dans ces pays, n'exprime nullement le fait que ces dirigeants, de même que l'appareil des partis staliniens, auraient volontairement sacrifié leur pouvoir et leurs privilèges. En fait, ce phénomène illustre, outre la faillite économique totale de ces régimes, leur extrême fragilité politique, fragilité que nous avions signalée depuis longtemps mais qui s'est révélée bien plus considérable encore que tout ce qui avait pu être imaginé.
{C}[3]{C} [39] Parmi ces pays, la Pologne et la Hongrie font figure de "champions" avec respectivement 40,6 et 20,1 milliards de dollars de dettes, soit 63,4 et 64,6% de leur PNB annuel. A côte d'eux, le Brésil, avec un endettement équivalent à "seulement" 39,2% de son PNB, apparaît comme un "bon élève".
Géographique:
Questions théoriques:
- Décadence [32]
- Décomposition [3]
La crise du capitalisme d'Etat : l'économie mondiale s'enfonce dans le chaos
- 4313 reads
"Victoire ! Victoire ! Le capitalisme a vaincu le communisme ! Regardez à l'Est, c'est la ruine, la pauvreté, plus rien ne fonctionne, la population ne veut plus du socialisme ! Regardez à l'Ouest, c'est l'opulence, l'inflation a été terrassée, la croissance économique dure depuis 7 ans, la démocratie libérale et pluraliste est le meilleur des systèmes ! Le marché a gagné ! Les capitales du monde occidental résonnent des cris euphoriques des chantres de l'économie capitaliste. L'effondrement économique du bloc de l'Est est le prétexte au déchaînement d'une campagne idéologique intense à la gloire du capitalisme libéral. Dans tout cela, deux vérités - l'économie du bloc de l'Est est en ruine et la loi du marché s'est imposée. Pour le reste ce ne sont que mensonges que la classe dominante entretien pour mener sa guerre idéologique contre le prolétariat et parce qu'elle-même s'illusionne sur son propre système.
Le plus grand des mensonges réside dans l'affirmation selon laquelle dans les pays du bloc de l'Est, et notamment en URSS, se serait incarné le communisme. De ce fait, le soi-disant "socialisme réel", selon le terme à la mode, serait l'enfer réel où mènerait la théorie marxiste. Ainsi, le prolétariat continue de payer les dividendes de l'échec tragique de la révolution prolétarienne qui avait commencé en Russie en 1917 : l'identification entre la contre-révolution stalinienne et la victoire du communisme est la pire mystification qu'il ait subie dans toute son histoire.
Une classe ouvrière affamée, exploitée de manière forcenée, massacrée au moindre signe de révolte. Une classe dominante arrogante - la nomenklatura -, cramponnée à ses privilèges. Un Etat tentaculaire, bureaucratique et militarisé. Une économie totalement orientée vers la production et l'entretien d'armements. Un impérialisme russe d'une brutalité extrême, imposant le pillage et le rationnement à son bloc. Tous ces traits caractéristiques des pays de l'Est n'ont pourtant rien à voir avec l'abolition des classes, le dépérissement et l'extinction de l'Etat, ni l'internationalisme prolétarien prônés par Marx.
Pourtant, même si la dictature stalinienne des pays de l'Est marque ces traits jusqu'à la caricature, ceux-ci ne sont certainement pas propres au stalinisme. Ils se retrouvent de manière de plus en plus accentuée dans le monde entier. Malgré ses spécificités - liées à son histoire - l'économie des pays de l'Est est capitaliste.
L'éclatement des blocs et la crise du capitalisme d'Etat
La Nomenklatura stalinienne parasitaire et représentant 15 % de la population se retrouve au lendemain de la deuxième guerre mondiale à la tête d'un bloc dont l'économie était soit détruite, soit sous-développée. Elle n'a pu affirmer sa puissance qu'en détournant la loi de la valeur, en trichant avec elle par l'imposition de mesures de capitalisme d'Etat extrêmes du fait de l'absence de l'ancienne bourgeoisie des propriétaires individuels des moyens de production qui a été expropriée par la révolution prolétarienne d'octobre 1917 : étatisation totale des moyens de productions, marché intérieur contrôlé et rationné, développement massif de l'économie de guerre et sacrifice de toute l'économie aux besoins de l'armée, seule garantie en dernière instance de la soumission de son bloc et de sa crédibilité impérialiste internationale. Incapable de recourir à la seule carte qui lui restait : la guerre, son armée entravée par le dysfonctionnement économique et devant faire face à une population dont la terreur policière ne parvenait plus à faire taire le mécontentement grandissant, la nouvelle bourgeoisie russe ne peut plus aujourd'hui que constater le délabrement de son économie et de son impuissance à faire face à la catastrophe.
L'effondrement économique du modèle stalinien ne signifie pas l'effondrement du socialisme mais un nouveau pas du capitalisme dans la crise mondiale qui dure depuis plus de 20 ans. Effectivement, la fameuse loi du marché, dont les vertus sont tant chantées, s'est imposée aujourd'hui, comme elle s'est imposée il y a 10 ans aux pays dits du "tiers-monde", les plongeant définitivement dans une misère et une barbarie - bien capitaliste celle-là, personne n'en doute - qui n'a rien à envier à celle qui règne dans les pays de l'Est.
On ne triche pas impunément avec la loi de la valeur, base du système économique capitaliste. Mais cette vérité, dont aujourd'hui les idéologues occidentaux se gargarisent, répétant à satiété : "Vive le marché ! Vive le marché !", s'impose aussi à l'ensemble de l'économie dite "libérale", en dehors du bloc de l'Est. Alors que la propagande occidentale, face à l'évidence de la faillite économique du bloc de l'Est, entonne le refrain connu : "A l'Ouest tout va bien !", la crise n'en continue pas moins son travail de sape, la fameuse loi du marché est toujours à l'oeuvre. Irrésistiblement, malgré toutes les manipulations dont ils sont l'objet, les taux de croissance continuent partout leur baisse, annonçant une plongée encore plus profonde de l'économie mondiale dans la récession.
Loin d'annoncer des lendemains qui chantent pour le capitalisme, la banqueroute du bloc de l'Est, après celle du "tiers-monde", annonce les banqueroutes futures du capitalisme dans ses pôles les plus développés. La première puissance mondiale : les USA, est en ligne de mire.
La première puissance mondiale, qui se pose comme le champion du libéralisme économique sur le plan idéologique, n'a pas sur le plan pratique concrétisé son discours. Bien au contraire, l'intervention de l'Etat dans l'économie n'a cessé de s'intensifier depuis des décennies.
La tendance au capitalisme d'Etat ne se résume pas à sa caricature stalinienne, aux nationalisations et à l'abolition de la concurrence sur le marché intérieur. Le capitalisme d'Etat à l'américaine, intégrant le capital privé dans une structure étatique et sous son contrôle, le fameux modèle bien improprement appelé "libéral", est bien plus efficace, plus souple, plus adapté, avec un sens plus développé de la responsabilité de la gestion de l'économie nationale, plus mystificateur parce que plus masqué. Surtout, il contrôle une économie et un marché autrement plus puissants : le PNB global des pays de l'OCDE, avec environ 12 000 milliards de dollars, représente six fois le revenu national des pays du COMECON en 1987.
Avocats farouches du libéralisme à tout crin, du moins d'Etat, devant les tribunes médiatiques, Reagan et son équipe, dans les antichambres obscures du pouvoir d'Etat, vont faire mener une politique économique à l'inverse de leurs professions de foi. Mais ces politiques étatiques sont autant de distorsions de la loi de la valeur, de tricheries par rapport à la sacro-sainte loi du marché.
Par la très étatique politique des taux de la très étatique Banque Fédérale, les Etats-Unis vont imposer la loi du dollar - dans lequel sont libellés les trois-quarts des échanges mondiaux - au marché mondial. Pour la défense du roi dollar, la discipline est imposée aux grands pays industrialisés - concurrents économiques mais aussi vassaux du bloc occidental - au sein du groupe G7 qui réuni les pays les plus industrialisés. Des parts de marché sont négociées, réparties, échangées dans les discussions du GATT au mépris de toutes les règles de la concurrence. La fameuse dérégulation des marchés n'a été que l'expression de la volonté très étatique des USA d'imposer les normes de leur marché intérieur au monde entier. Des subventions de plusieurs centaines de milliards de dollars sont directement versées par l'Etat fédéral pour protéger l'agriculture en déroute et renflouer les banques et les caisses d'épargne en faillite, tandis que les commandes d'armement du Pentagone sont une subvention déguisée à toute l'industrie américaine qui en est devenue de plus en plus dépendante.
La relance américaine, après la récession brutale du début de la décennie 1980 (qui a définitivement laissé les pays sous-développés sur le carreau), va se faire par un déficit budgétaire massif qui va servir à financer un effort de guerre sans précédent en période de paix et un déficit commercial record. Une telle politique n'a pu être permise que par un endettement pharamineux.
Ces politiques capitalistes d'Etat ont imposé des distorsions croissantes aux mécanismes du marché, le rendant de plus en plus artificiel, instable, volatil. L'économie américaine flotte sur une montagne de dettes que, pas plus que n'importe quel pays sous-développé, elle ne pourra rembourser. La dette américaine globale (interne et externe) correspond à environ deux années de PNB, la dette externe du Mexique et du Brésil, dont aujourd'hui les banquiers du monde entier font tant cas (la dette interne n'a pas grand sens alors que les monnaies nationales se sont effondrées), correspond à respectivement neuf et six mois d'activité. La super-puissance américaine a des pieds d'argile et sa dette pèse de plus en plus lourd sur ses épaules. Même avec des formes différentes, le soi-disant marché libre du monde occidental - en fait l'essentiel du marché mondial - est tout aussi artificiel que celui du monde de l'Est, car artificiellement maintenu à flot par un recours aux planches à billets et à un endettement croissant, qui ne pourra jamais être remboursé.
Si elles ont permis de renforcer la suprématie impérialiste des USA, les commandes d'armement n'ont pas dopé l'industrie américaine. Bien au contraire. De 1980 à 1987, les parts du marché mondial dans trois secteurs clés de l'industrie : machines-outils, automobiles, informatique-bureautique ont régressé respectivement de : 12,7 à 9 %, 11,5 à 9,4%, 31 à 22%.
La production d'armements ne sert à reproduire ni la force de travail ni de nouvelles machines. C'est de la richesse, du capital détruit, c'est une ponction improductive qui pèse sur la compétitivité de l'économie nationale. Les deux têtes de bloc surgies du partage de Yalta ont toutes deux vu leur économie s'affaiblir, perdre de sa compétitivité par rapport à leurs propres alliés. C'est là le résultat des dépenses consenties au renforcement de leur puissance militaire, garante de leur position de leader impérialiste, condition ultime de leur puissance économique.
Avec l'effondrement économique des pays du COMECON, l’épouvantail de l'impérialisme russe perd sa crédibilité et, du même coup, le bloc de l'Ouest perd son ciment essentiel.
Après des décennies de politique de capitalisme d'Etat menée sous la houlette des blocs impérialistes, le processus actuel de dissolution des alliances, qui avaient partagé la planète, constitue effectivement, d'un certain point de vue, une victoire du marché, une ré adéquation brutale des rivalités impérialistes aux réalités économiques. Et, symboliquement, s'affirme l'impuissance des mesures de capitalisme d'Etat à court-circuiter ad eternam les lois incontournable du marché capitaliste. Cet échec, au-delà même des limites étroites de l’ex-bloc russe, marque l'impuissance de la bourgeoisie mondiale à faire face à la crise de surproduction chronique, à la crise catastrophique du capital. Il montre l'inefficacité grandissante des mesures étatiques employées de manière de plus en plus massives, à l'échelle des blocs, depuis des décennies, et présentées depuis les années 1930 comme la panacée aux contradictions insurmontables du capitalisme, telles qu'elles s'expriment dans son marché.
La plongée des États-Unis dans la récession...
Alors que les idéologues rémunérés du capital s'extasient encore sur la victoire du "capitalisme de marché", et croient voir, à l'Est, le signe d'une nouvelle aurore pour un capitalisme revigoré et triomphant, l'ouragan qui s'approche des rives de l'économie américaine va leur faire rentrer dans la gorge leurs phrases creuses sur le marché.
Le symbole du capitalisme triomphant, la terre sainte des croisés du libéralisme : l'économie américaine, bat de l'aile et entame les dernières manoeuvres improvisées d'un atterrissage qui ne se fera pas en douceur.
Les USA perdent de leur crédibilité sur le marché financier, les prêteurs se font de plus en plus réticents. Le simple paiement des intérêts de la dette fédérale prévu pour 1991, 180 milliards de dollars, équivaut à plus de six mois d'exportations. Les capitalistes européens et japonais, qui ont financé l'essentiel de la dette, commencent à bouder les émissions du Trésor américain dont les cours dégringolent. Ainsi, les emprunts à trente ans du Trésor américain se négocient-ils aujourd'hui 5 % au dessous de leur valeur nominale.
Privée de liquidités, l'économie américaine est en fait à court de carburant, et son industrie artificiellement protégée a perdu sa compétitivité sur le marché mondial. Le dernier trimestre 1989 est marqué par une plongée brutale dans la récession, la croissance officielle chute à 0,5 % en rythme annuel. Les fleurons de l'industrie américaine annoncent des bénéfices en chute libre et des pertes. Dans l'informatique, IBM annonce pour le 4e trimestre 1989 des bénéfices en baisse de 74 %, et pour toute l’année en baisse de 40 %, pour Digital Equipment c'est une baisse de 44 % pour l'année, Control Data annonce pour 1989 des pertes de 680 millions de dollars, 196 millions pour le dernier trimestre. Dans l'automobile il en va de même : Ford, Chrysler, General Motors annoncent des dizaines de milliers de licenciements. La production de pétrole est à son plus bas niveau depuis 26 ans. La sidérurgie est au plus mal. Les entreprises les plus faibles accumulent les pertes et font faillite.
Wall Street est de plus en plus instable et, depuis octobre, a perdu 300 points accumulant les alertes. Les ténors de la bourse américaine suivent leurs collègues industriels et licencient à tour de bras : Merryl Lynch, Drexel-Burnham, Shearson-Lehman, etc. La perspective de réduction du déficit budgétaire angoisse les industriels confrontés à la baisse des commande de l'Etat : 1 milliard de dollars de réduction du budget d'armement équivaut à 30 000 licenciements. Avec le développement du chômage massif se rétrécit toujours plus le marché solvable.
Faute d'acheteurs, le marché immobilier s'effondre après des années de spéculation effrénée. La dévalorisation brutale du parc immobilier dévalorise tout l'avoir du capital américain. De même que les centaines de caisses d'épargne qui font faillite ont vu la valeur de leurs placements fondre comme neige au soleil avec l'effondrement de la spéculation immobilière, les spéculateurs internationaux qui, à coups d'OPA financées à crédit, ont constitué des empires industriels, voient la valeur de leur patrimoine se volatiliser et se retrouvent incapables de faire face aux échéances de leur dette.
La panique commence à gagner les grandes banques. Alors que la question de la dette impayée des pays pauvres ne peut être résolue, elles sont aujourd'hui confrontées à la solvabilité déclinante de l'économie américaine. Le pourcentage des crédits immobiliers à problèmes, par rapport aux fonds propres des banques, a progressé de 8 % à 15 % en un an dans le Nord-Est industriel. Les prêts, qui ont financé les OPA et la spéculation boursière, deviennent inconsistants avec les péripéties de Wall Street. Ainsi la faillite d'un seul spéculateur, Robert Campeau, laisse une ardoise dont l'estimation varie de 2 à 7 milliards de dollars. La banque d'affaire Drexel-Burnham annonce des pertes de 40 millions de dollars et se déclare en faillite. Les industriels confrontés au marasme du marché ont de plus en plus de mal à rembourser leurs emprunts et les 200 milliards de dollars de "junk-bonds" (littéralement "obligations pourries", en fait des obligations à risque mais au fort taux rémunérateur... tant que tout va bien) en circulation voient leur cours s'effondrer.
Les grandes banques, porte-drapeaux du capitalisme américain, accumulent en conséquence les pertes : 1,2 milliards de dollars pour J.P. Morgan, 665 millions de dollars pour la Chase Manhattan, 518 pour Manufacturers Hanover. Et le pire reste à venir : l'accélération de la dégradation s'étant produite au dernier trimestre 89, ses effets vont aller en s'accentuant. Avec cette nouvelle plongée dans la récession, le marché américain est en train de perdre sa solvabilité, non seulement sur le plan national, mais aussi et surtout sur le plan international. Le dollar est gagé sur la puissance de l'économie américaine et la dynamique d'effondrement du marché américain contient la perspective d'effondrement du dollar. Le système financier international est devenu un immense château de cartes qui tremble de plus en plus fortement sous le souffle asthmatique de l'économie US. La fameuse politique des taux se révèle impuissante à entraver la progression de l'inflation et à empêcher renfoncement dans la récession.
...annonce un nouvel effondrement de l'économie mondiale
Avec le ralentissement de l'économie américaine s'annonce un enfoncement encore plus profond de l'économie mondiale dans la récession. Si l'effondrement économique des pays de l'Est n'a eu qu'un très faible impact sur le marché mondial - depuis des décennies ces marchés étaient fermés et les échanges avec le reste du monde très faibles - il ne peut en être de même avec l'économie américaine. Même si depuis la fin de la seconde guerre mondiale, sa part de marché a chuté de 30 % à 16 %, et même si sa compétitivité n'a cessé de se dégrader, l'économie américaine reste la première du monde et son marché de loin le plus important.
Les exportations du Japon et des pays industrialisés d'Europe dépendent du marché américain. L"'empire du Soleil levant" écoule 34 % de ses exportations aux USA. Il est le plus dépendant du marché américain. En 1989 son excédent commercial, en contrecoup des difficultés américaines, a chuté de 17 %. Par conséquent la récession aux USA, l'insolvabilité grandissante de l'économie américaine, signifient une fermeture aux importations en provenance des autres pays et, par conséquent, une chute parallèle de la production mondiale. Dans cette spirale de la catastrophe capitaliste, c'est l'ensemble de l'économie planétaire qui est en train de sombrer dans le chaos. La pagaille invraisemblable qui est en train de submerger le monde, et qui rend difficile et délicat tout pronostic détaillé quant à la forme exacte à travers laquelle l'accélération de la crise va se manifester, montre au moins une chose : l'illusion de relative stabilité, que le capital avait réussi à maintenir sur le plan économique dans ses métropoles les plus développées durant les années 1980, a vécue.
L'ensemble des mécanismes dits de régulation du marche commence à se gripper. Les Etats tentent de huiler les rouages mais les remèdes sont de plus en plus inefficaces.
Les banquiers voient avec effroi leurs bilans s'incliner vers des gouffres sans fond, tandis que les "goldens boys" de Wall-Street, héros du libéralisme reaganien, se retrouvent aujourd'hui en prison ou au chômage. Les grandes places boursières sont inquiètes, elles ont eu des malaises à répétition, le 13 octobre 1989, puis le 2 janvier pour commencer l'année 1990, et le 24 janvier pour confirmer ces sinistres auspices. Chaque fois, les Etats ont inondé le marché de liquidités pour enrayer la panique, mais jusqu'à quand cette politique du coup par coup, de l'improvisation acrobatique pourra-t-elle être maintenue ?
Fait significatif de l'inquiétude qui gagne le monde des spéculateurs, le 2 janvier ce n'est pas Wall-Street qui a craqué en premier, c'est la bourse de Tokyo, devenue première place boursière mondiale et qui s'était fait jusque là remarquer par sa solidité et sa stabilité. Le compte-à-rebours est commencé qui annonce les craquements et les effondrements futurs.
De nouveaux marches illusoires
Pourtant, malgré ces sombres perspectives, les idéologues du capital n'en continuent pas moins à célébrer le fameux marché. Et, alors que le marché mondial se rétrécit une nouvelle fois drastiquement, avec l'affaissement de l'économie américaine, ils cherchent désespérément de nouvelles oasis capables d'étancher la soif de débouchés d'une industrie dont les moyens de production se sont énormément développés, avec les investissements de ces dernières années. Ils ne trouvent que de nouveaux mirages pour perpétuer l'illusion :
- le marché japonais qui, depuis des années, doit s'ouvrir, mais qui reste désespérément fermé car sa propre industrie l'occupe pleinement et ne laisse guère de place aux exportateurs étranger ;
- le marché des pays de l'Est qui vient de s'ouvrir plus largement à l'Occident, mais qui est ruiné par des décennies de pillages et d'aberration bureaucratique staliniennes et qui, pour importer, devra faire massivement appel aux crédits des pays occidentaux ;
- la future "unification" européenne qui en 1992 doit instituer le plus grand marché unique du monde, perspective hypothétique rendue encore plus lointaine par l'instabilité mondiale qui se développe et qui, de toutes façons, est déjà un marché occupé, même s'il est morcelé.
Pour tous ces marchés le problème reste le même : par rapport à leur capacité solvable, ils sont déjà amplement saturés. Une relance dans ces régions ne pourrait se faire qu'à crédit, en faisant marcher la planche à billets. C'est exactement la politique économique menée par les USA depuis des années. On voit où elle mène !
La situation financière mondiale n'incite pas les investisseurs à octroyer de nouveaux crédits qui, pour l'essentiel, ne pourront pas plus être remboursés que les anciens. Il est significatif qu'au-delà des déclarations d'intention d'aide aux pays de l'Est, les crédits occidentaux se soient faits plus que parcimonieux. L'économie mondiale a atteint un seuil. La politique qui consistait, pour forcer les exportations, à prêter en même temps l'argent destiné à les financer, se révèle de moins en moins possible et de plus en plus dangereuse. Les remèdes de cheval de l'économie libérale appliqués aux pays de l'Est, avec l'ouverture de leur marché, signifie d'abord :
- une inflation galopante, 900 % en Pologne ; des prix de denrées de première nécessité qui doublent en Hongrie ;
- la fermeture des usines insuffisamment compétitives, la majorité, et par conséquent, le développement d'un chômage massif, inconnu jusque là dans ces pays.
L'Eldorado mythique du capitalisme occidental qui a fait rêver des générations de prolétaires à l'Est, est devenu le cauchemar quotidien d'une dégradation insupportable des conditions de vie. Pas plus que les pays sous-développés n'ont pu se défaire de la misère ou ils se sont effondrés à la fin des années 1970, les pays de l’ex-bloc de l'Est ne sortiront demain de la catastrophe économique dans laquelle ils s'enfoncent toujours plus. Pas plus que les recettes du capitalisme d'Etat stalinien, les recettes du capitalisme d'Etat libéral ne pourront être efficaces.
Qui pourrait financer une relance destinée à atténuer le contrecoup de l'enlisement de l'économie américaine ? Toujours optimiste, la bourgeoisie mondiale répond : "Mais l'Allemagne et le Japon ! Voyons !". Ces pays ont en effet montré ces dernières années une santé insolente, battant des records à l'exportation, hyper compétitifs sur les marchés déchirés par la concurrence, menant une politique monétaire plus rigoureuse que leur mentor américain.
Cependant, toutes les économies de ces pays ne peuvent suffire à maintenir à flot l'économie mondiale. A eux deux, en 1987, ils ne représentaient que les trois-quarts du PNB américain. L'essentiel de leurs avoirs est immobilisé en bons du Trésor américain, en actions et en réserves libellées en dollars, qui ne peuvent être réalisés sans semer la panique sur les marchés. La "relance" au Japon sur un marché national surprotégé ne peut servir qu'à l'industrie japonaise, mais aura une incidence négligeable sur le marché mondial. Quant à la "relance" allemande, on a un avant-goût de ce qu'elle signifie avec le projet d'unification monétaire, prélude à la réunification des deux Allemagnes. D'abord nul ne peut estimer son coût : les différentes hypothèses varient de quelques dizaines de milliards de deutschemark à plusieurs centaines. L'incertitude règne, mais l'attrait d'une "Grande Allemagne" a poussé la RFA à desserrer le cordon de sa bourse, à mettre en fait à profit une politique de relance pour financer sa réunification. Comme pour le Japon, charité bien ordonnée commence par soi-même.
L'impact d'une telle relance ne peut, en conséquence, qu'être limité sur le plan international. L'abandon de la politique de rigueur monétaire de l'Allemagne, tant citée comme exemple jusqu'alors, sème l'inquiétude dans le monde de la finance effrayé par ce saut vers l'inconnu. Par contrecoup, les marchés européens sont déstabilisés, les taux d'intérêt, face à la peur qu'une telle politique ait pour résultat premier de relancer l'inflation, flambent à Francfort et à Paris, mettant à mal les marchés spéculatifs: bourses, MATIF. Les investisseurs japonais hésitent, le "Serpent monétaire" européen est mis à mal. Le choix allemand de l'Allemagne de l'Ouest mécontente les autres pays de l'Occident, notamment européens qui voient leur échapper l'escarcelle sur laquelle ils comptaient pour sauver leur propre économie.
La RFA n'a pas les moyens de financer à la fois l'absorption de la RDA et une mini relance en Europe de l'Ouest. La Communauté européenne est mal en point et le marché unique de 1992 de plus en plus lointain, improbable, à un moment où les effets conjugués de l'accélération de la crise et de la désagrégation de la discipline des blocs pousse chaque puissance capitaliste dans une concurrence acharnée où domine le "chacun pour soi" et où les tentations protectionnistes se font chaque jour plus fortes.
Loin d'être, comme l'affirmaient les propagandistes médiatisés du capital, une victoire du capitalisme et l'aurore d'un nouveau développement, l'effondrement économique du bloc de l'Est a été le signe annonciateur d'un nouvel enfoncement de l'économie mondiale dans la crise. Liées par leur destin paradoxal, les deux grandes puissances dominantes, qui se sont partagées le monde à Yalta, sombrent aujourd'hui sous les coups de boutoir de la crise capitaliste. De l'est à l'Ouest, du Nord au Sud, la crise économique est mondiale et si l'effondrement du bloc de l'Est a été plus un facteur de déboussolement que de clarification pour le prolétariat mondial, l'enfoncement significatif de l'économie mondiale, à la suite de la récession américaine, dans une crise toujours plus aiguë et dramatique, va donner l'occasion de remettre les pendules à l'heure. Le franchissement du fatidique degré 0 de la croissance aux USA vient inéluctablement affaiblir les axes de la propagande occidentale.
Les prévisions marxistes sur la crise catastrophique du capitalisme trouvent aujourd'hui une concrétisation qui ne va cesser de prendre de l'ampleur. Catastrophe de l'économie planétaire qui plonge des fractions de plus en plus larges de la population mondiale dans une misère insondable. Anarchie croissante des marchés capitalistes qui traduit l'impuissance de toutes les mesures capitalistes d'Etat. Les métropoles développées sont à leur tour en train de sombrer : inflation, récession, chômage qui se redéploie massivement, paralysie du fonctionnement de l'Etat bureaucratique, décomposition des rapports sociaux.
Les lois aveugles du marché, celles des contradictions insurmontables du capitalisme, sont à l'oeuvre.- Elles mènent l'humanité dans la barbarie, la décomposition à l'image de la machine capitaliste devenue folle. Une nouvelle vague d'attaques contre la classe ouvrière, plus sévère que jamais commence : niveau de vie rongé par l'inflation galopante, licenciements massifs, mesures d'austérité de toutes sortes. Partout c'est la même politique de misère pour la classe ouvrière qui est appliquée. Les modèles s'écroulent devant la réalité des faits, ceux qui prétendaient défendre les intérêts de la classe ouvrière comme les autres. Non seulement le modèle stalinien, mais aussi, maintenant, le "socialisme à la suédoise" avec le gouvernement social-démocrate qui annonce le blocage des salaires et propose l'interdiction du droit de grève. La dégradation s'accélère et, plus que jamais, le capitalisme, sous toutes ses formes, montre l'impasse et la destruction dans lesquelles il mène l'espèce humaine. Plus que jamais est posée la nécessité de la révolution communiste, seul moyen de mettre fin à la loi du marché, c'est-à-dire la loi du capital.
JJ. 15 février 1990.
Récent et en cours:
- Crise économique [28]
Heritage de la Gauche Communiste:
- Capitalisme d'Etat [40]
Polémique : le vent d'est et la réponse des révolutionnaires
- 2675 reads
L'effondrement du bloc impérialiste russe est un événement de dimension historique, mettant fin à l'ordre mondial établi par les grandes puissances depuis 1945. Il va sans dire qu'un événement d'une telle échelle est un vrai test pour les organisations politiques de la classe ouvrière, sorte d'épreuve du feu qui montrera si celles-ci possèdent ou pas l'armement théorique et organisationnel que réclame la situation.
Ce test opère à deux niveaux étroitement liés de l'activité révolutionnaire. En premier lieu, les événements à l'Est ont inauguré toute une nouvelle phase dans la vie du capitalisme mondial, une période de bouleversement et d'incertitude, de chaos grandissant, qui rend absolument indispensable pour les révolutionnaires le développement d'une analyse de l'origine et de l'orientation des événements, leurs implications pour les principales classes de la société. Une telle analyse doit être basée sur des fondements théoriques solides, capables de résister aux tempêtes et doutes du moment, et doit cependant aussi rejeter tout attachement conservateur aux hypothèses et schémas qui sont devenus obsolètes.
En second lieu, l'effondrement du bloc de l'Est a ouvert une période difficile pour la classe ouvrière, dans laquelle nous avons vu les ouvriers à l'Est être engloutis par une marée d'illusions démocratiques et nationalistes, et dans laquelle la bourgeoisie mondiale toute entière a saisi l'opportunité d'assaillir les ouvriers avec une campagne assourdissante sur "la faillite du communisme" et le "triomphe de la démocratie". Face à ce torrent idéologique, les révolutionnaires sont dans l'obligation d'intervenir à contre-courant, de s'attacher aux principes de classe fondamentaux en réponse à une cacophonie de mensonges qui a un réel impact sur la classe ouvrière.
Pour ce qui concerne le CCI, nous renvoyons aux articles de cette Revue Internationale et du numéro précédent, ainsi qu'à la presse territoriale sur les événements. Comment les autres groupes du milieu révolutionnaire ont répondu à cette épreuve, tel est l'objet du présent article. ([1] [41])
Le BIPR : un pas en avant, mais combien en arrière
Les composantes du BIPR sont le Parti communiste internationaliste Battaglia Comunista en Italie, et la Communist Workers organisation en Grande-Bretagne. Ce sont des groupes sérieux, avec une presse régulière, et il est normal que leurs numéros récents se soient axés sur les événements à l'Est. C'est en soi important puisque, comme nous le verrons, une des principales caractéristiques de la réponse du milieu politique aux événements a été... pas de réponse du tout, ou au mieux, un retard lamentable dans la réponse. Mais comme nous prenons le BIPR au sérieux, notre souci principal est ici celui du contenu ou de la qualité de leur réponse. Et bien qu'il soit trop tôt pour tracer un bilan définitif, nous pouvons dire que jusqu'à présent, bien que quelques points clairs soient contenus dans les articles écrits par le BIPR, ces éléments positifs sont affaiblis sinon sapés par une série d'incompréhensions et de franches confusions.
La CWO (Workers’Voice)
L'impression première est que des deux composantes du BIPR, c'est la CWO qui a répondu de la manière la plus adéquate. L'effondrement du bloc de l'Est n'est pas seule ment un événement d'une importance historique considérable : il n'a aussi aucun précédent dans l'histoire. Jamais auparavant un bloc impérialiste s'était écroulé non pas sous la pression d'une défaite militaire ou d'une insurrection .prolétarienne, mais d'abord et avant tout par sa totale incapacité à faire face à la crise économique mondiale. Dans ce sens, la manière avec laquelle ces événements se sont déroulés, sans parler de leur extraordinaire rapidité, ne pouvait être prévue. Le résultat a été, non seulement que la bourgeoisie a été prise par surprise, mais que les minorités révolutionnaires l'ont été tout autant, y compris le CCI. Sur ce plan, il faut porter au crédit de la CWO d'avoir vu dès avril-mai de l'an dernier que la Russie perdait le contrôle sur ses satellites est-européens, position critiquée à tort dans World Révolution comme concession aux campagnes pacifistes de la bourgeoisie, ceci résultant du retard à voir la désintégration véritable du système stalinien.,
Le numéro de Workers'Voice de janvier 1990. le premier à être publié depuis l'effondrement effectif du bloc, commence par un article qui dénonce correctement le mensonge que le "communisme est en crise", et, dans d'autres articles, montre un niveau de clarté sur les trois points centraux suivants : - la désintégration des régimes staliniens est le produit de la crise économique mondiale, qui touche ces régimes avec une sévérité particulière :
- la crise n'est pas le résultat du "pouvoir du peuple", encore moins de la classe ouvrière ; les manifestations massives en RDA et Tchécoslovaquie ne sont pas sur un terrain prolétarien ;
- ce sont des "événements d'une importance historique mondiale", signifiant "l’amorce d'un effondrement de l'ordre mondial créé vers la fin de la 2e guerre mondiale", et ouvrant une période de "reformation de blocs impérialistes."
Cependant, ces intuitions, pour importantes qu'elles soient, ne sont pas menées à leur conclusion. Ainsi, bien que la fin du montage impérialiste post-1945 soit vu comme "amorce", il n'est pas clairement dit si le bloc russe est réellement fini ou non. Les événements sont présentés comme "d'une importance historique mondiale", mais ceci est à peine suggéré du fait de la tonalité assez frivole de deux des articles de première page, et par le fait que cette position est repoussée en page cinq du journal.
Plus important, les intuitions de la CWO sont plus basées sur une observation empirique des événements que sur un cadre analytique clair, ce qui signifie qu'elles peuvent être aisément éclipsées avec l'évolution des événements. Dans nos "Thèses sur la crise économique et politique en URSS et dans les pays de l'Est" en septembre 1989 {Revue Internationale n° 60), nous avons tenté de fournir un tel cadre : en particulier, nous avons expliqué pourquoi l'effondrement a été si soudain et achevé par la mise en évidence de la rigidité particulière et l'immobilité de la forme politico-économique stalinienne, forme prise par le fait que ce régime a été l'expression même de la contre-révolution ^accomplissant en Russie. En l'absence d'un tel cadre, ce que dit la CWO est équivoque sur la profondeur réelle de l'effondrement du stalinisme. Aussi, bien qu'un article dise que la politique de Gorbatchev de non-intervention -signifiant en fait qu'il n'y avait rien qui eût pu maintenir les gouvernements staliniens en Europe de l'Est - était "très peu volontaire mais imposée au Kremlin par l'état épouvantable de l'économie soviétique", ailleurs on a l'impression qu'au fond la non-intervention est une stratégie de Gorbatchev pour intégrer la Russie dans une nouvel impérialisme basé en Europe, et pour améliorer l'économie par l'importation de technologie occidentale. Ceci sous-estime le degré de perte de contrôle de la situation auquel en est la bourgeoisie soviétique, qui est simplement entrain de combattre pour survivre au jour le jour, sans aucune stratégie sérieuse à long terme.
Une fois encore, la position de la CWO sur les manifestations massives en Europe de l'Est, et l'exode énorme de réfugiés de RDA, ne saisit pas la gravité de la situation. Ces phénomènes sont écartés de façon désinvolte comme faisant partie de "la révolte de la classe moyenne contre le capitalisme d'Etat", et motivés par un désir des belles marchandises occidentales : "ils veulent des BMW (...) Les écouter parler d'attendre 10 ans pour une nouvelle voiture fait saigner le coeur démocratique de certains !" Cette attitude contemplative manque un point crucial : les ouvriers de RDA et Tchécoslovaquie ont participé en masse dans ces manifestations, non pas comme classe, mais comme individus atomisés dans le "peuple". C'est une question sérieuse pour les révolutionnaires, parce que cela signifie que la classe ouvrière a été mobilisée derrière les drapeaux de son ennemi de classe. La CWO a eu une attitude assez stupide vis-à-vis du CCI, parce que la répression que nous avions vue comme une possibilité pour la bourgeoisie d'Allemagne de l'Est n'avait pas eu lieu. Mais, les conséquences tragiques et sanglantes de l'enrôlement d'ouvriers sur le faux terrain de la démocratie ont été très clairement illustrées par les événements en Roumanie, un mois plus tard, et ensuite par le développement d'affrontements violents en Azerbaïdjan et dans d'autres républiques de l'URSS.
De plus, WV de décembre 1989 ne répond pas vraiment aux campagnes sur la "démocratie" à l'Ouest, ni ne prend position sur les conséquences négatives que ces événements ont pour la lutte de classe, à l'Est et à l'Ouest.
Le PCInt (Battaglia Comunista)
Bien que la CWO et le PCInt fassent partie du même regroupement international, il y a toujours eu une hétérogénéité considérable entre les deux groupes, sur le niveau programmatique et dans leur réponse aux développements immédiats de la situation mondiale. Avec les événements de l'Est, cette hétérogénéité ressort très clairement. Et dans ce cas, il semble que le PCInt - bien que ce soit le groupe qui ait la plus grande expérience politique - ait été envahi par de pires confusions que la CWO. C'est évident lorsqu'on examine les quelques derniers numéros de Battaglia Comunista.
En octobre 1989, BC publie un article "La bourgeoisie occidentale applaudit l'ouverture des pays de l'Est", qui affirme que les régimes staliniens sont capitalistes et que la source de leurs troubles est la crise économique mondiale. Mais là se termine le bon point ([2] [42]), et le reste du texte montre une sous-estimation extraordinaire du niveau de l'effondrement économique et politique à l'Est. Alors que nos "Thèses", adoptées à peu près au même moment, c'est-à-dire avant les événements spectaculaires en Allemagne de l'Est, Tchécoslovaquie, Bulgarie, Roumanie, reconnaissaient la désintégration effective du bloc russe, BC voit "l'empire oriental encore solidement sous la botte russe." Et, encore une fois en comparaison avec nos "Thèses", il semble dans cet article que BC pense que la formation de régimes "démocratiques" (c'est-à-dire multipartis) en Europe de l'Est est parfaitement compatible avec la cohésion du bloc. En même temps, pour BC, la crise économique qui est derrière ces événements peut avoir touché les pays occidentaux dans les années 1970, mais touche seulement les régimes staliniens "plus récemment" - alors qu'en fait, ces pays ont sombré dans un bourbier économique depuis les vingt dernières années. Peut-être que cette étrange illusion sur la santé relative des économies staliniennes explique leur croyance touchante que l'ouverture du "marché" de l'Est représente un véritable espoir pour l'économie capitaliste mondiale :
"L'effondrement des marchés de la périphérie du capitalisme, par exemple l'Amérique Latine, a créé de nouveaux problèmes d'insolvabilité pour la rémunération du capital... Les nouvelles opportunités ouvertes en Europe de l’Est pourraient représenter une soupape de sécurité par rapport au besoin d'investissement... Si ce large processus de collaboration est-ouest se concrétise, ce serait une bouffée d'oxygène pour le capital international."
Nous avons déjà publié une réponse aux affirmations de la bourgeoisie sur les "nouvelles opportunités" ouvertes à l'Est (voir la Revue Internationale n° 60 et dans ce n°), nous n'y reviendrons pas ici : les économies de l'Est sont pas dans un état de ruines moins sévères que les économies d'Amérique latine. Marquées par l'endettement, l'inflation, le gaspillage et la pollution, elles n'offrent pas grand chose à l'ouest en termes d'occasions d'investissement et d'expansion. L'idée que l'Est est un "nouveau marché" est purement de la propagande bourgeoise, et il faut conclure que BC est tombé tout droit dans le piège.
En novembre, au moment des manifestations massives en RDA et Tchécoslovaquie, dans lesquelles des millions d'ouvriers ont marché derrière les drapeaux de la "démocratie" sans une seule revendication de classe, BC titre malheureusement un éditorial "Résurgence de la lutte de classe à l'Est". Cet article fait référence non pas aux événements en Europe de l'Est, mais principalement à la lutte des mineurs en URSS qui, bien qu'elle se soit développée sur une échelle massive au cours de l'été 89, avait ensuite été complètement éclipsée par la "révolution" démocratique et nationaliste parcourant tout le bloc. De plus, l'article contient quelques ambiguïtés sur les revendications démocratiques soulevées par les ouvriers en même temps que les revendications exprimant leurs véritables intérêts comme classe. Bien que BC admette que les premières peuvent aisément être utilisées par l'aile "radicale" de la classe dominante, on trouve aussi le passage suivant :
"... Pour ces masses imprégnées d'anti-stalinisme et de l'idéologie du capitalisme occidental, les premières revendications possibles et nécessaire sont celles pour le renversement du régime 'communiste', pour une libéralisation de l'appareil productif, et pour la conquête de libertés démocratiques."
Sans aucun doute, les ouvriers dans les régimes staliniens ont, au cours de leurs luttes, avancé des revendications politiques bourgeoises (même lorsqu'ils ne sont pas infiltrés de l'extérieur par des agents de l'ennemi de classe). Mais ces revendications ne sont pas "nécessaires" à la lutte prolétarienne ; au contraire, elles sont toujours utilisées pour amener les luttes dans des impasses, et les révolutionnaires ne peuvent que s'y opposer. Mais l'utilisation de BC du terme "nécessaire" n'est pas du tout due à un écart de plume. Elle est dans la droite ligne des théorisations sur la "nécessité" de revendications démocratiques contenue dans leurs "Thèses sur les tâches des communistes dans les pays de la périphérie" ([3] [43]) ; il est clair que la même logique est maintenant appliquée au pays de l'ancien bloc de l'Est.
Au total, ce numéro de BC constitue une réponse très inadéquate au flot des mystifications "démocratiques" qui a été déchaîné sur le prolétariat mondial. Après avoir refusé de reconnaître la vraie reprise de la lutte de classe depuis plus de 20 ans, BC commence brusquement à la voir et la proclame au moment précis où l'offensive "démocratique" de la bourgeoisie l'a faite temporairement refluer !
En décembre 1989, même après les événements en RDA, Tchécoslovaquie et Bulgarie, BC publie un article "Effondrement des illusions sur le socialisme réel", qui contient beaucoup d'idées différentes, mais qui semble être dirigé contre les thèses du CCI de l'effondrement du bloc :
"La perestroïka russe entraîne un abandon de l'ancienne politique vis-à-vis des pays satellites, et a pour objectif de transformer ces derniers. L'URSS doit s'ouvrir aux technologies occidentales et le COMECON doit faire de même, non - comme le pensent certains - dans un processus de désintégration du bloc de l'Est et de désengagement total de l'URSS des pays d'Europe, mais pour faciliter, en revitalisant les économies du COMECON, la reprise de l'économie soviétique. "
Une fois encore, comme la CWO, on nous donne une description d'un processus qui correspondrait à un plan bien établi de Gorbatchev destiné à intégrer la Russie dans une nouvelle prospérité économique européenne. Mais, quelles que soient les fantaisies auxquelles Gorbatchev, ou BC, peut se livrer, les politiques actuelles de la classe dominante russe lui sont imposées par un processus de désintégration interne sur lequel elle n'a aucun contrôle, et dont elle ne peut attendre aucune issue dans l'avenir.
En janvier, le numéro contient un long article "La dérive du continent soviétique" qui développe des idées similaires sur les buts de la politique étrangère de Gorbatchev, mais, qui en même temps, semble admettre qu'il peut en réalité y avoir une "dislocation" du bloc de l'Est. Peut-être que BC a fait là quelques progrès. Mais si ceci est un pas en avant, l'article sur les événements en Roumanie constitue plusieurs pas en arrière, vers l'abîme gauchiste.
La propagande bourgeoise, de la droite à la gauche, dresse le portrait des événements en Roumanie en décembre dernier, comme une authentique "révolution populaire", un soulèvement spontané de toute la population contre le haï Ceaucescu. C'est vrai qu'à Timisoara, à Bucarest et dans beaucoup d'autres villes, des centaines de milliers de personnes, entraînées par une répugnance légitime pour le régime, ont pris la rue en défiant la Securitate et l'armée, prêts à donner leurs vies pour le renversement de ce monstrueux appareil de terreur. Mais il est aussi vrai que ces masses, ce "peuple" amorphe au sein duquel la classe ouvrière n'a jamais été présente comme force autonome, étaient simplement trop facilement utilisées comme chair à canon par les opposants bourgeois de Ceaucescu, ceux qui conduisent aujourd'hui la machine plus ou moins inchangée de répression étatique. Les politiciens staliniens réformistes, les généraux de l'armée, et les anciens patrons de la Securitate qui constituent le "Front de Salut National", avaient dans une large mesure préparé leurs plans bien à l'avance : le FSN lui-même avait été formé, en secret, six mois avant les événements de décembre. Ils attendaient simplement que le moment arrive, et il est arrivé avec les massacres de Timisoara et les manifestations massives qui ont suivi. Une minute avant, les généraux de l'armée donnaient l'ordre à leurs soldats de tirer sur les manifestants, la minute suivante, ils ralliaient le peuple, c'est-à-dire qu'ils utilisaient le peuple comme marchepied pour s'asseoir dans le siège du gouvernement. Ce n'était pas une révolution, qui, dans notre période, ne peut avoir lieu que lorsque le prolétariat s'organise lui-même comme classe et dissout l'appareil d'Etat bourgeois, en particulier la police et l'armée. Au mieux, c'était une révolte désespérée qui a été immédiatement canalisée sur le terrain politique capitaliste par les forces encore très intactes de l'opposition bourgeoise. Face à cette tragédie, dans laquelle des milliers de travailleurs ont donné leur sang pour une cause qui n'était pas la leur, les révolutionnaires ont le devoir clair de parler contre la marée de la propagande bourgeoise qui la décrit comme une révolution.
Mais comment BC répond ? En tombant la tête la première dans le piège : "La Roumanie est le premier pays dans les régions industrialisées dans lequel la crise économique mondiale a donné naissance à une réelle et authentique insurrection populaire dont le résultat a été le renversement du gouvernement en place." ("Ceaucescu est mort, mais le capitalisme vit encore"). En réalité, "en Roumanie, toutes les conditions objectives et presque toutes les conditions subjectives étaient réunies pour transformer l’insurrection en une réelle et authentique révolution sociale." (ibid.). Et il n'est pas difficile de deviner quel "facteur subjectif particulier manquait : "L'absence d'une force politique de classe véritable laissait le terrain ouvert aux forces qui travaillaient au maintien des rapports de production bourgeois." (ibid.)
"Une réelle et authentique insurrection populaire", quel genre de créature est-ce ? Stricto sensu, insurrection signifie la prise armée du pouvoir par une classe ouvrière consciente, organisée, comme en octobre 1917. Une "insurrection populaire" est une contradiction dans les termes, parce que le "peuple" comme tel, qui pour le marxisme ne peut signifier qu'un conglomérat amorphe de classes (quand ce n'est pas un mot codé pour désigner des forces de la bourgeoisie), ne peut pas prendre le pouvoir. Ce qui arrive ici est, une fois encore, qu'on ouvre largement la porte aux campagnes de la bourgeoisie sur la "révolution populaire", campagnes dans lesquelles les gauchistes ont joué un rôle particulièrement important.
Ces passages révèlent aussi l'idéalisme profond de BC sur la question du parti. Comment peuvent-ils affirmer que le seul élément "subjectif manquant en Roumanie était l'organisation politique ? Un élément subjectif indispensable pour la révolution est aussi une classe ouvrière qui s'organise elle-même dans ses organes autonomes, unitaires, les conseils ouvriers. En Roumanie, non seulement ce n'était pas le cas, mais la classe ouvrière n'était même pas en train de combattre sur son plus élémentaire terrain de classe ; au cours des événements de décembre, il n'y a eu aucun signe de quelques revendications de classe mises en avant par les ouvriers. Toute grève était immédiatement canalisée dans la "guerre civile" bourgeoise qui ravageait le pays.
L'organisation politique de la classe n'est pas un deus ex machina. Elle peut seulement gagner une influence significative dans la classe, elle peut seulement peser dans le sens de la révolution, lorsque les ouvriers s'engagent dans des confrontations massives et ouvertes avec la bourgeoisie, mais en Roumanie, les ouvriers ne luttaient même pas pour leurs plus élémentaires intérêts de classe : tout leur courage et toute la combativité ont été mobilisés au service de la bourgeoisie. Dans ce sens, ils étaient plus loin de la révolution que toutes les luttes défensive en Europe de l'Ouest au cours de la dernière décennie, luttes que BC a eu tellement de difficulté à voir.
Si on considère que le BIPR est le second principal pôle du milieu politique international, le désarroi de BC face au "vent de l'Est" est une triste indication des faiblesses plus générales du milieu. Et étant donné le poids de BC au sein du BIPR lui-même, il y a de fortes possibilités que la CWO soit poussée vers les confusions de BC, plutôt que poussée vers une plus grande clarté. (En particulier, nous devons attendre de voir ce que dit CWO sur la "révolution" en Roumanie). Quoi qu'il en soit, l'incapacité du BIPR à parler d'une seule voix sur ces événements historiques est révélatrice d'une faiblesse qui se paiera très cher dans la période à venir.
Bordiguisme, neo-bordiguisme, conseillisme, neo-conseillisme, etc.
Comme nous l'avons dit, en dehors du CCI et du BIPR, la réponse la plus caractéristique a été soit le silence, soit un refus de laisser de côté la routine de publications irrégulières et peu fréquentes, et de faire un effort particulier pour répondre à ces changements mondiaux historiques. Bien que sur ce plan aussi, il y ait différents degrés.
Ainsi, après un long silence, le Ferment Ouvrier Révolutionnaire en France a publié un numéro d'Alarme en réponse aux événements. L'éditorial est une réponse relativement claire aux campagnes de la bourgeoisie sur "la faillite du communisme". Mais lorsque dans un second article, le FOR descend de ce niveau général aux événements concrets de Roumanie, il en arrive à des positions proches de BC : ça n'a peut-être pas été une révolution, mais c'était une "insurrection". Et "bien que probablement personne en Roumanie n'eût songé à parler alors de communisme, des mesures comme l'armement des ouvriers, le maintien des comités de vigilance et leur prise en main de l'organisation de la lutte, de la production (nécessités alimentaires et médicales, à définir dans leurs natures, leurs qualités et quantités), l'exigence de dissolution des corps armés étatiques (armée, milice, polices...), et la jonction avec par exemple le comité occupant le palais présidentiel, eussent constitué les premiers pas d'une révolution communiste. "
Comme BC, le FOR a longtemps été déprimé par "l'absence" de lutte de classe ; maintenant, il voit les "premiers pas d'une révolution communiste" au moment où la classe ouvrière a été dévoyée sur le terrain de la bourgeoisie. C'est la même chose lorsqu'il considère les effets "positifs" de l'effondrement du bloc russe (qu'il semble reconnaître, puisqu'il écrit "on peut considérer que le bloc stalinien est vaincu (...)" Selon le FOR, ceci va aider les ouvriers à voir l'identité de leur condition internationalement. Ceci peut être éventuellement vrai, mais insister sur ce point en ce moment est ignorer l'impact essentiellement négatif que l'offensive idéologique actuelle de la bourgeoisie a sur le prolétariat.
Le courant bordiguiste "orthodoxe" possède encore une certaine solidité politique, du fait qu'il est le produit d'une tradition historique dans le mouvement révolutionnaire. Nous pouvons voir les "restes" de cette solidité par exemple dans le dernier Le Prolétaire, publication en France du Parti communiste international (Programme Communiste). Au contraire de l'enthousiasme déplacé pour les événements en Roumanie manifesté par BC et le FOR, le numéro de décembre 89-février 90 du Prolétaire prend position clairement contre l'idée qu'une révolution, ou tout au moins les "premiers pas" vers une révolution, ont surgi dans les manifestations de masse en Europe de l'Est :
"En plus des aspirations à la liberté et à la démocratie, le trait commun aux manifestants de Berlin, de Prague et de Bucarest, c'est le nationalisme. Le nationalisme et l'idéologie démocratiques qui prétendent englober 'tout le peuple', sont des idéologies de classe, des idéologies bourgeoises. Et en fait, ce sont des couches bourgeoises et petites-bourgeoises, frustrées d'être tenues à l'écart du pouvoir, qui ont été les véritables acteurs de ces mouvements et qui ont finalement réussi à placer leurs représentants au sein des nouveaux gouvernements. La classe ouvrière ne s'est pas manifestée en tant que classe, pour ses intérêts propres. Lorsqu'elle a fait grève, comme en Roumanie et en Tchécoslovaquie, c'est à l'appel des étudiants, en tant que simple composante indifférenciée du 'peuple'. Jusqu'à présent, elle n'a pas eu la force de refuser les appels au maintien de l'union du peuple, de l'union nationale entre les classes. "
Même si ces mobilisations ont pris un caractère violent, elles ne parviennent pas au stade d'une "insurrection populaire" : "Et en Roumanie, les combats meurtriers qui ont décidé de l'issue ont opposé l'armée régulière à des éléments des corps spéciaux ‘Securitate') ; c'est-à-dire que les combats se sont déroulés entre fractions de l'appareil d'Etat, non contre cet appareil lui-même."
Concernant les causes historiques et les résultats de ces événements, Le Prolétaire semble reconnaître le rôle-clé de la crise économique, et il affirme également que la désintégration du bloc occidental est la conséquence nécessaire de la désintégration du bloc de l'Est. Il est aussi conscient que le soi-disant effondrement du "socialisme" est utilisé pour embourber la conscience des ouvriers partout, et dénonce ainsi correctement le mensonge selon lequel les régimes du bloc de l'Est n'avaient rien à voir avec le capitalisme.
Côté négatif, Le Prolétaire semble encore sous-estimer la véritable dimension de l'effondrement à l'Est, puisqu'il défend que "l’URSS est peut-être affaiblie, mais elle est encore, pour le capitalisme mondial, comptable du maintien de l'ordre dans sa zone d'influence", alors qu'en fait, le capitalisme mondial est bien conscient qu'on ne peut même plus s'appuyer sur l'URSS pour maintenir l'ordre à l'intérieur de ses propres frontières. En même temps, il surestime la capacité des ouvriers à l'Est de surmonter les illusions sur la démocratie par leurs propres luttes. En effet, il semble penser qu'il y aura des luttes contre les nouvelles "démocraties" à l'Est qui aideront les ouvriers à l'Ouest à rejeter leurs illusions, alors que c'est le contraire qui est vrai.
Ceci étant, ce PCI Programme Communiste a, au cours des deux dernières décennies, été de plus en plus poussé vers des positions ouvertement bourgeoises, sur des questions aussi critiques que la "libération nationale" et la question syndicale. La réponse relativement saine du Prolétaire aux événements de l'Est prouve qu'il y a encore une vie prolétarienne dans cet organisme. Mais nous ne pensons pas que ceci représente réellement un nouveau regain de vie : c'est l'antipathie "classique" des bordiguistes vis-à-vis des illusions démocratiques, plus qu'un réexamen critique des bases opportunistes de leur politique, qui leur a permis de défendre une position de classe sur cette question.
On pourrait en dire de même pour "l'autre" PCI, qui publie Il Partito Comunista en Italie et La Gauche Communiste en France. Par rapport à la fois aux événements du printemps en Chine et de l'automne en Allemagne de l'Est, il est capable d'affirmer clairement que la classe ouvrière n'a pas surgi sur son propre terrain. Dans l'article "En Chine, l'Etat défend la liberté du capital contre les ouvriers", il arrive à la difficile mais nécessaire conclusion que "même si les mitraillettes qui ont balayé les rues furent aussi tournées vers lui (le prolétariat chinois), il a eu la force et la volonté de ne pas se laisser attirer par un exemple sûrement héroïque, mais qui ne le concerne pas. "
En ce qui concerne l'Allemagne de l'Est, il écrit "pour le moment il s'agit de mouvements interclassistes qui se situent sur un terrain démocratique et national. Le prolétariat se trouve noyé dans la masse petite-bourgeoise et ne se différencie guère sur le plan des revendications politiques. "
Bon. Mais comment ce PCI peut-il réconcilier cette sobre réalité avec l'article qu'il a publié sur les grèves des mineurs en Russie, dans lequel il clame que le prolétariat dans les régimes staliniens est moins perméable à l'idéologie démocratique que les ouvriers à l'Ouest ? ([4] [44])
En dehors du courant bordiguiste "orthodoxe" il existe nombre de sectes qui aiment leur "Gauche italienne" épicée d'un trait de modernisme, ou d'anarchisme, mais surtout, d'académisme. Et ainsi, tout au long de mois où se sont déroulés ces événements qui font l'histoire actuelle, rien n'a dérangé la tranquillité de groupes comme Communisme ou Civilisation ou Mouvement Communiste ("pour le Parti communiste mondial", bien sûr !), qui continuent avec leurs recherches dans la critique de l'économie politique, convaincus de marcher dans les traces de Marx quand ils se retirent du "parti formel" pour se concentrer sur Das Kapital. Comme si Marx serait un moment resté silencieux face à des développements historiques d'une telle dimension ! Mais aujourd'hui, même les éléments les plus activistes de ce courant, comme le Groupe communiste internationaliste, semblent être repliés dans la chaleur de leurs bibliothèques. Il fait froid et il y a du vent dehors après tout...
Qu'en est-il des conseillistes ? Peu à rapporter. En Grande-Bretagne, silence de Wildcat et de Subversion. Un groupe de Londres, The Red Menace, s'est excusé pour n'avoir rien publié sur l'Europe de l'Est dans le numéro de janvier 1990 de son bulletin. Ses énergies ont été concentrées sur la nécessité bien plus pressante de dénoncer... l'Islam, puisque c'est le contenu principal d'un tract qu'il a sorti récemment. Toutefois, comme ce tract trace aussi un trait d'égalité entre bolchevisme et stalinisme, entre la révolution d'octobre 1917 et la contre-révolution bourgeoise, il fournit ainsi un rappel utile sur comment le conseillisme se fait l'écho des campagnes de la bourgeoisie, qui sont aussi extrêmement ardentes à montrer qu'il y a un trait de continuité entre 1917 et les camps de travail staliniens.
Pour les néo-conseillistes de la Fraction externe du CCI, nous ne pouvons pas en dire beaucoup jusqu'à présent, puisque leur numéro actuel date de l'été dernier et qu'ils n'ont pas jugé bon de publier un quelconque numéro spécial en réponse à la situation. Mais le numéro en cours n'inspire pas beaucoup confiance, pour le moins. Pour la FECCI, l'installation de Solidarnosc au gouvernement en Pologne n'a impliqué aucune perte de contrôle par les staliniens : au contraire, elle a révélé leur capacité à utiliser la carte démocratique pour tromper les ouvriers. De même, on ne peut attendre aucune réponse de classe claire au bain de sang en Roumanie, puisqu'ils ont vu, derrière les massacres en Chine, non pas une bataille sauvage entre fractions bourgeoises, mais une grève de masse embryonnaire, et qu'ils ont dénoncé le CCI pour ne pas le voir. Et pour autant qu'on puisse se référer à des prises de position récentes dans des réunions publiques en Belgique, la FECCI continuera à être guidée par ce vieux principe du mouvement ouvrier : dire le contraire de ce que dit le CCI ! Ils semblent être particulièrement zélés pour nier que le bloc de l'Est s'est effondré : un bloc impérialiste ne peut s'effondrer que par la défaite militaire ou la lutte de classe, parce que ça s'est passé comme ça dans le passé. Pour un groupe qui prétend être le rempart contre toute version dogmatique, ossifiée, du marxisme, ceci ressemble à une tentative pathétique de se raccrocher à des schémas éprouvés et sûrs. Nous n'en dirons pas plus avant d'avoir pris connaissance de leurs positions clairement exprimées.
La nouvelle période et la responsabilité des révolutionnaires
Bien que nous traitions d'une situation encore en évolution, nous avons déjà assez d'éléments pour conclure que les événements à l'Est ont violemment mis en évidence les faiblesses du milieu prolétarien existant. En dehors du CCI, qui, malgré quelques retards et erreurs, a été capable de prendre ses responsabilités face à ces développements, et à part quelques éléments de clarté montrés par les groupes politiques les plus sérieux, nous avons vu des degrés variés de confusion ou une complète incapacité à dire quoi que ce soit. Pour nous, une telle situation ne provoque aucun sentiment victorieux de "supériorité", mais elle met en évidence l'énorme responsabilité qui pèse sur le CCI. Etant donné que nous entrons dans une période de reflux dans la conscience de la classe, les difficultés du milieu ne vont pas s'atténuer. Au contraire. Mais ceci n'est pas un argument pour tomber dans la passivité ou le pessimisme. D'un côté, l'accélération de l'histoire va accélérer le processus de décantation que nous avions déjà observé dans le milieu. Les groupes éphémères et parasitaires qui se sont montrés complètement incapables de répondre à la nouvelle période vont être emportés par la roue implacable de l'histoire, mais même les courants les plus importants vont être secoués jusque dans leurs fondements s'ils ne sont pas capables de surmonter leurs erreurs et équivoques. Ce processus sera certainement douloureux, mais il n'est pas nécessairement négatif, à condition que les éléments les plus avancés dans le milieu, et le CCI en particulier, soient capables de mettre en avant une orientation claire qui puisse servir dans un moment difficile de l'histoire.
Une fois encore, un reflux général de la conscience de la classe, c'est-à-dire au niveau de l'extension de la conscience dans la classe, ne signifie pas la "disparition" de la conscience de classe, une fin de son développement en profondeur. Nous avons déjà vu, en fait, que les événements à l'Est ont fourni un stimulant considérable pour une minorité d'éléments qui cherchent à comprendre ce qui se passe, et qui ont repris contact avec l’avant-garde politique. Même ce développement sera sujet à fluctuations, mais le processus sous-jacent continuera. Notre classe n'a pas souffert de défaite historique, et il y a de réelles possibilités qu'elle ressorte de ce présent repli pour défier le capitalisme de façon plus profonde que jamais.
Pour la minorité révolutionnaire, c'est indubitablement un moment où les tâches de clarification politique et de propagande générale vont tendre à prendre le pas sur une manière plus agitationnelle d'intervention. Mais ceci ne signifie pas que les révolutionnaires devraient se retirer dans leurs études. Notre tâche est de rester dans et avec notre classe, même si notre intervention se mène dans de plus difficiles conditions et sera souvent appelée à être "à contre-courant". Plus que jamais, les voix des révolutionnaires doivent se faire entendre aujourd'hui ; c'est en effet une des pré conditions pour que la classe surmonte ses difficultés présentes et reprenne le chemin du coeur de la scène historique.
CDW, Février 1990.
[1] [45] Au moment du bouclage de ce numéro, nous avons reçu de nouvelles publications : Workers'Voice, Battaglia Comunista, Supplément à Perspectives Internationaliste, dont nous ne pouvons intégrer la critique dans cet article. Globalement, WV maintient la même analyse de la période, tout en dénonçant plus clairement les dangers pour le prolétariat. BC semble revenir en partie de ses délires lors de "l'insurrection populaire" en Roumanie. PI louvoie et minimise l'effondrement du bloc, et, tout en faisant silence sur leur grande trouvaille "théorique" sur "la transition de la domination formelle à la domination réelle du capital" comme explication de la situation en URSS, voit la situation assez bien contrôlée par Gorbatchev. La position minoritaire du même PI admet plus clairement l'effondrement du bloc russe et ses racines dans la crise économique.
Les évolutions des positions montrent que les événements poussent à une clarification, mais le problème du cadre général d'analyse reste toujours posé tel que nous l'envisageons dans ce présent article, avant ces dernières parutions.
[2] [46] Voir Révolution internationale n° 187.
[3] [47] Voir notre critique de ce texte dans la Revue Internationale n° 46, 3e trimestre 1986.
[4] [48] Voir l'article "La responsabilité des révolutionnaires" dans Rivoluzione Internazionale n° 62.
Courants politiques:
- Gauche Communiste [49]
Heritage de la Gauche Communiste:
Polémique avec Battaglia Comunista : le rapport fraction-parti dans la tradition marxiste (2° partie)
- 2880 reads
Deuxième partie : la Gauche communiste internationale, 1937-1952
La polémique dont nous poursuivons ici la publication n'est pas un débat d'histoire académique. Le prolétariat ne possède comme arme que sa capacité d'organisation et sa conscience. Cette conscience est historique parce qu'elle est l'instrument de l'avenir, mais aussi parce qu'elle se nourrit de l'expérience historique de deux siècles de luttes prolétariennes. Il s'agit ici de transformer en armes, pour le présent et l'avenir, la terrible expérience des révolutionnaires dans les années qui ont précédé et suivi la 2e guerre mondiale, en particulier comment et dans quelles conditions les groupes révolutionnaires peuvent se transformer en véritables partis politiques du prolétariat Mais pour faire cela, il faut rétablir certains faits historiques dans leur vérité, et combattre les falsifications qui ont malheureusement été développées, même au sein du milieu révolutionnaire.
Dans la première partie de cet article [1] [50], nous avons montré comment, dans les années cruciales de 1935 à 1937, la Fraction de la Gauche italienne à l'étranger a été capable, au prix d'un terrible isolement politique, de sauvegarder le fil rouge de la continuité marxiste, face au naufrage dans l'antifascisme démocratique des autres courants de gauche, et du premier parmi eux, le courant trotskiste [2] [51]. C'est cette démarcation historique dramatique qui a jeté les bases politiques et programmatiques sur lesquelles se fondent encore aujourd'hui les forces de la Gauche communiste internationale. Nous y avons aussi montré que pour les camarades de BC, (Battaglia Comunista, organe du Partito Comunista Internazionalista) tout ceci n'est valable que jusqu'à un certain point, étant donné que pour eux, en 1935, la question centrale était de répondre au passage des vieux partis dans la contre-révolution par la transformation de la Fraction en un nouveau parti communiste. Cette position, défendue en 1935 par une minorité activiste (qui rompt l'année suivante avec la Gauche communiste pour donner son adhésion à la guerre "antifasciste" d'Espagne) a été rejetée par la majorité de la fraction qui, fidèle à la position de toujours de la Gauche, liait la transformation en parti à la reprise de la lutte de classe. Selon les camarades de Battaglia, la majorité "attentiste" qui en 1935 avait défendu cette position, erronée selon eux, l'aurait corrigée en 1936, pour ensuite la reprendre en 1937, avec des conséquences désastreuses.
En particulier, son porte-parole le plus prestigieux, Vercesi, "en 1936, pour trancher la controverse entre l’attentiste Bianco et Piero-Tito (partidiste), penchait plus pour ces derniers : 'il faut considérer que, dans la situation actuelle, bien que nous n'ayons pas et ne pouvons pas avoir encore une influence sur les masses, nous nous trouvons devant la nécessité d'agir non plus comme fraction d'un parti qui a trahi, mais comme parti en miniature'. (Bilan n° 28). En pratique, dans cette phase, Vercesi paraît se rapprocher d'une vision plus dialectique, selon laquelle à la trahison des partis centristes on devait répondre en faisant naître de nouveaux partis, non pour guider de façon velléitaire des masses (qu'il n'y avait pas encore) vers la conquête du pouvoir, (...) mais pour représenter la continuité de classe qui s'était interrompue, pour combler ce vide politique qui s'était produit, pour redonner à la classe ce point de référence politique indispensable même dans les phases de reflux qui fut en mesure, même si c'était de façon minuscule, de grandir au fur et à mesure des événements au lieu de les attendre comme le messie. Mais, en 1937, il revient en arrière, pour reproposer dans son 'rapport sur la situation internationale' les fractions comme unique expression politique possible du moment renonçant implicitement à quelque transformation que ce soit. (...) Au delà des retournements personnels de Vercesi, avec l'éclatement de la guerre, la fraction devient pratiquement inopérante. C'est la fin de toutes les publications (bulletins internes, Prometeo, Bilan et Octobre), c'est l'espacement, sinon l’arrêt, des contacts entre les sections française et belge. En 1945, la Fraction se dissout sans avoir résolu sur le terrain de la pratique un des problèmes les plus importants qui avait provoqué sa création à Pantin en 1928. Le parti naît quand même à la fin de 1942 sous l'impulsion de camarades restés en Italie (Partito Comunista Intemazionalista), parti que rejoindront à la fin de la guerre beaucoup d'éléments de la Fraction dissoute." [3] [52]
Comme d'habitude, les camarades de BC réécrivent notre histoire à leur façon. D'abord, Vercesi n'était pas le porte-parole de la majorité "attentiste" (comme l'appelle Battaglia) mais le porteur d'une tentative de compromis entre les deux positions qui s'affirmaient, même si c'était de façon ambiguë, à la fin du congrès de 1935. Au début de 1936, Vercesi recourt encore à une expression qui contient effectivement toute l'ambiguïté combattue par la majorité et qui est citée dans les extraits ci-dessus. C'est vrai que la citation exacte parle de la nécessité d'agir "non plus comme fraction d'un parti qui a trahi, mais comme -si on peut s'exprimer ainsi - un parti en miniature". Mais même avec la forme conditionnelle, que les camarades de BC ont fait disparaître avec une certaine fourberie, l'expression conserve toute l'ambiguïté qui consiste à présenter la fraction comme un parti qui aurait peu de militants, alors qu'il s'agit d'une forme d'organisation propre aux phases de lutte de classe qui ne permettent pas l'existence d'un parti, qu'il soit petit ou grand. Les véritables porte-parole de la majorité avaient toutes les raisons de protester contre ces formulations contradictoires qui introduisaient en catimini l'idée qu'on aurait pu s'orienter vers une activité de parti, quand il n'en existait absolument pas les conditions. Ce n'est pas par hasard que l'article de Bianco, dans Bilan n° 28, qui s'oppose à celui de Vercesi s'intitule "Un peu de clarté, s'il vous plaît". La clarté sur le fait que seule pouvait exister une fraction, dans de telles conditions est effectivement ré établie, mais pas en 1937, comme l'affirme l'article de Battaglia. Ce qui a rendu les choses claires, c'est la minorité qui face aux événements d'Espagne, largue définitivement les amarres, en sombrant dans l'antifascisme et clarifiant dans la pratique où mènent les discours sur la nécessité de "rompre avec l'attentisme". Confronté à cette culbute, Vercesi reprend pied et abandonne momentanément au placard (seulement momentanément, hélas !) les discours "sur les nouvelles phases". En se maintenant fermement sur ses positions, dans la période cruciale qui va de juillet 1936 à mai 1937 (massacre des travailleurs de Barcelone), la fraction a été capable de jeter les bases de l'actuelle Gauche communiste internationale, au prix toutefois d'un isolement total vis-à-vis du milieu politique en pleine décomposition démocratique. Cette terrible pression ambiante ne pouvait pas ne pas laisser de traces au sein même de la Fraction italienne et de la toute nouvelle Fraction belge. Chez quelques camarades, on commence à voir ressortir l'idée que, tout compte fait, le fait même qu'on aille à la guerre rapproche le moment de la riposte prolétarienne de la guerre elle même et que pour être prêt pour ces futures réactions, il fallait immédiatement commencer à avoir une activité "différente". Vers la fin de 1937, Vercesi commence à théoriser le fait qu'à la place de la guerre mondiale il y aura nombres de "guerres locales" dont la nature véritable serait d'être des massacres préventifs contre la menace prolétarienne, qui planerait on ne sait comment. Pour se préparer à ces convulsions, il faut "faire plus", et voilà que ressort, sous d'autres mots, la théorie selon laquelle la fraction doit agir - en un certain sens - comme un parti en miniature. Pour avoir une "activité" de parti, en septembre 1937, les fractions s'embarquent dans une entreprise absurde de collecte de fonds pour les victimes de la guerre d'Espagne, pour faire concurrence sur le plan du travail "de masse" aux organismes socio-staliniens comme le Secours Rouge, en descendant sur leur terrain. Si en décembre 1936, Bilan n° 38 republiait le projet de 1933 d'un Bureau International des Informations, en constatant amèrement qu'il n'existait encore aucune possibilité d'accepter cette proposition minimum, en septembre 1937, dans Bilan n° 43, Vercesi déclare qu'un simple Bureau des informations serait désormais "dépassé et que nous devons entrer dans une autre phase de travail" avec la constitution du Bureau International des fractions de gauche. En elle même, l'exigence de constituer un organe de coordination entre les deux seules fractions existantes était tout à fait juste. Le problème, c'est que ce bureau au lieu de coordonner l'action de clarification et de formation des cadres, seul travail possible pour les fractions dans ces conditions, était toujours plus conçu comme l'organe qu'on devait trouver prêt dès la reprise de classe pour coordonner "la construction des nouveaux partis et de la nouvelle Internationale". Toujours en mettant la charrue avant les boeufs, en janvier 1938, on arrête la publication de Bilan, en la remplaçant par une revue dont le nom, Octobre, anticipe sur les convulsions révolutionnaires qu'on ne pouvait entrevoir nulle part et dont auraient du sortir des éditions française, anglaise et allemande ! Le résultat de cette folie de vouloir agir "comme un parti en miniature" était prévisible : la revue qui devait sortir en trois langues n'arrive même pas à sortir régulièrement en français, le Bureau cesse pratiquement de fonctionner et, - ce qui est pire - la démoralisation et les démissions se multiplient chez les militants complètement déboussolés.
Avec l'éclatement de la guerre, en août 1939, la débandade atteint son comble, aggravée par le passage à la clandestinité, l'assassinat de quelques uns des meilleurs cadres et l'arrestation de beaucoup d'autres ; ainsi, les fractions se trouvent-elles désorganisées de fait. A cela contribue fortement le fait que Vercesi, qui jusqu'alors avait soutenu que le travail de fraction ne servait à rien, mais qu'il fallait celui d'un mini-parti, avec l'éclatement de la guerre, commence à théoriser que - vu que le prolétariat ne réagit pas - il est "socialement inexistant" et que dans ces conditions, le travail de fraction ne sert plus à rien.
Comme on le voit, ce qui revient constamment, c'est la remise en discussion de la fraction comme organe de l'activité révolutionnaire dans les phases historiquement défavorables. De tout cela, BC tente de tirer la conclusion que ceux qui pendant la guerre ont fait un travail de fraction n'en ont rien conclu. Mais ceux qui pendant la guerre n'en ont rien conclu - comme Vercesi - étaient précisément ceux qui ont refusé le travail de fraction. Contrairement à ce que Battaglia essaie de faire croire, la fraction ne cesse pas toute activité, mais - à l'initiative de la section de Marseille qui était le chef de file de l'opposition à Vercesi - se réorganise déjà début 1940, tient des conférences annuelles clandestines, rétablit des sections à Lyon, Toulouse, Paris, reprend les contacts avec les camarades restés en Belgique. Malgré des difficultés matérielles inimaginables, la publication régulière d'un bulletin de discussion reprend, outil de formation des militants et de circulation des textes d'orientation de la Commission Executive, qui servaient de base aux discussions avec les autres groupes avec lesquels on prenait contact. Ce travail clandestin conduisit à la constitution (de 1942 à 1944) d'une nouvelle fraction, la Fraction française, et au rapprochement des positions de la Gauche italienne de la part d'un bon nombre de communistes allemands et autrichiens qui avaient rompu avec le trotskisme, désormais passé dans le camp de la contre-révolution.
En vérité, on ne comprend pas comment auraient réussi à faire tout cela, dans des conditions extrêmement difficiles, des éléments qui, selon Battaglia, restaient "au chaud", en se réfugiant dans leurs "théorisations", dans l'attente "messianique" que les masses deviennent capables par elles mêmes de les reconnaître comme la juste direction.
Ici, on touche à un des points fondamentaux de la question. Battaglia présente la fraction comme un organe (on ferait mieux de dire un cercle culturel) qui, dans les périodes où le prolétariat n'est pas à l'offensive, se limite à des études théoriques, puisque intervenir dans la classe ne sert à rien. La fraction est, au contraire, l'organe qui permet de maintenir la continuité de l'intervention communiste dans la classe, même dans les périodes noires, dans lesquelles cette intervention ne trouve pas d'écho immédiat. Et toute l'histoire des fractions de la Gauche communiste est là pour le démontrer. A côté de la revue théorique Bilan, la Fraction italienne publiait un journal en italien, Prometeo, qui avait en France une diffusion supérieure à celle du journal des trotskistes français, ces maîtres de l'activisme. Les militants de la fraction étaient tellement connus pour leur engagement dans la lutte de classe qu'il fallait nécessairement des interventions brutales des directions nationales des syndicats pour les expulser des structures de base qui les défendaient. Ces camarades diffusaient la presse, malgré la chasse qui leur était faite conjointement par la police et les syndicats tricolores ; frappés jusqu'au sang, ils retournaient diffuser des tracts, le pistolet bien en vue à la ceinture, pour signifier leur volonté de se faire massacrer sur place plutôt que de renoncer à leur intervention dans la classe. Un ouvrier comme Piccino, attrapé par les staliniens alors qu'il diffusait la presse et livré à la police française, fut tellement battu qu'il en resta handicapé pendant toute sa vie, mais n'en retourna pas moins diffuser la presse. Dans une lettre d'avril 1929, Togliatti demandait l'aide de l'appareil répressif de Staline contre les "débris bordiguistes" avouant que leur acharnement lui créait plus que des petits problèmes partout où il y avait des ouvriers italiens. Venant de l'ennemi de classe, c'était la meilleure des reconnaissances.
Il faut vraiment du courage pour présenter comme des théoriciens en pantoufles des militants qui ont été liquidés dans les camps de concentration, ceux qui sont tombés aux mains de la Gestapo pendant qu'ils traversaient clandestinement la frontière pour maintenir les contacts avec les camarades en Belgique, ceux qui, recherchés par la police et sans papiers, participaient aux grèves illégales, ceux qui à la sortie de l'usine passaient au milieu des "killers" staliniens chargés de les tuer et qui ne s'en sortaient qu'en sautant par dessus le mur d'enceinte. Battaglia écrit que les camarades à l'étranger auraient du se battre pour la transformation de la guerre impérialiste en guerre civile et que "renseignement de Lénine (...) aurait dû avoir un plus grand crédit" surtout chez "des camarades qui avaient grandi dans la tradition léniniste". Mais les camarades des fractions italienne et française, ont-ils fait autre chose quand ils diffusaient des appels au défaitisme révolutionnaire rédigés en français et en allemand jusque dans les trains militaires allemands, quand, en plein milieu de l'orgie patriotique de la "libération" de Paris, ils risquaient leur vie pour appeler les ouvriers à déserter l'encadrement des partisans ?
Comme on le voit, il est complètement faux d'écrire que l’unique possibilité d'organiser une quelconque opposition aux tentatives de l'impérialisme de résoudre ses l contradictions dans la guerre passait par la constitution de nouveaux partis". S'il n'y a pas eu de transformation en guerre civile, ce n'est pas du fait de l'absence d'une "quelconque opposition" de la part des fractions, mais du fait que le capitalisme mondial avait réussi à briser les premières tentatives faites dans ce sens, d'abord en Italie, puis en Allemagne, faisant reculer ainsi toute perspective révolutionnaire. Selon Battaglia, cependant, si la Fraction s'était malgré tout transformée en parti, la présence de ce parti aurait changé les choses. Mais dans quel sens auraient-elles changé ?
Pour répondre à cette question, considérons l'action du Parti Communiste Internationaliste fondé en Italie à la fin de 1942 par des camarades rassemblés autour d'Onorato Damen. Ce camarade, à la différence de la fraction qui rompt tous les liens avec le PCI en 1928, reste dans le parti jusqu'à la moitié des années 1930, en dirigeant encore en 1933 la révolte des détenus inscrits au parti dans les prisons de Civitavecchia. Battaglia Comunista (dont Damen a été un des dirigeants jusqu'à sa mort) dans l'article que nous avons cité, ironise sur l'appel à sortir des partis communistes passés à la contre-révolution, appel lancé par le Congrès de la Fraction en 1935. BC se demande : s'il ne pouvait y avoir de transformation en parti parce que les masses restaient sourdes à ce moment là aux appels de la fraction, alors, à qui diable pouvait bien s'adresser cet appel ? "On ne peut s'empêcher de se demander si le mot d'ordre en question n'a pas été lancé avec le dernier espoir que le prolétariat ne l'entende point de façon à ne pas créer de problèmes qui mettraient en question le schéma abstrait du rapporteur". L'ironie de Battaglia tombe particulièrement mal à propos : l'appel s'adressait à ces camarades qui, comme Damen, se trouvaient encore dans les rangs du PC avec l'espoir d'y défendre des positions de classe, et aurait concerné personnellement Damen lui même, si les staliniens n'avaient déjà veillé à résoudre le problème en l'expulsant du parti à la fin de 1934. Ou alors est-ce que Battaglia pense que Bilan n'aurait pas du faire appel à ces camarades pour qu'ils sortent des partis passés à la bourgeoisie et s'intègrent à la fraction, seul lieu où on continuait la bataille pour la reconstitution du parti de classe ?
En fait, Battaglia affirme qu'en 1935, pour n'importe quel marxiste, il était clair que la sortie définitive du PCI impliquait automatiquement la fondation du nouveau parti. Mais si c'était si clair, pourquoi Damen n'a-t-il pas fondé ce nouveau parti en 1935 ? Pourquoi s'est-il consacré à un patient travail clandestin de sélection et de formation des cadres, exactement comme la Fraction à l'étranger ? S'il est vrai que c'est par la fondation de nouveaux partis que passait l’unique possibilité d'organiser une opposition quelconque " à la guerre, pourquoi n'a-t-on pas fondé ce parti au moins en 1939, quand la guerre a éclaté, alors qu'on a attendu la fin de 1942, après trois années et demie de massacre impérialiste ? Selon les analyses de BC, ces sept années de retard devraient être considérées comme une folie ou une trahison. Selon nos analyses, c'est la meilleure démonstration de la fausseté de la thèse qui veut que pour fonder un nouveau parti, il suffit que le vieux ait trahi.
Si la naissance du PC Internationaliste a eu lieu fin 1942, c'est parce qu'il se développait alors une forte tendance à la reprise de la lutte de classe contre le fascisme et la guerre impérialiste, tendance qui conduit en quelques mois aux grèves de mars 1943, à la chute du fascisme et à la demande de la bourgeoisie italienne d'une paix séparée. Même si la bourgeoisie mondiale a rapidement réussi à dévoyer cette réaction de classe du prolétariat italien, c'est un fait que ce n'est que sur la base de cette réaction que les camarades en Italie ont estimé que le temps était venu de se constituer en parti. Ce n'est pas par hasard que la même évaluation est faite - tout à fait indépendamment - par les camarades à l'étranger, aussitôt qu'ils prirent connaissance des grèves de mars 1943 : la Conférence de la Fraction en août de la même année déclare que s'est ouverte "la phase de la rentrée de la fraction en Italie et de sa transformation en parti". Cependant, cette rentrée organisée n'a pas été possible, en partie à cause de difficultés matérielles quasi insurmontables (rappelons nous que le PC Internationaliste lui même fondé en Italie ne put faire connaître qu'en 1945 son existence à l'étranger), difficulté aggravée par l'assassinat et l'arrestation de nombreux camarades.
Mais la faiblesse fondamentale était d'ordre politique : la minorité de la Fraction italienne liée à Vercesi et forte de la Fraction belge déniait tout caractère de classe aux grèves de 1943, s'opposant à toute activité organisée parce que "volontariste". La conférence annuelle de 1944 condamna les positions de la tendance Vercesi et, au début de 1945, Vercesi fut exclu de la Fraction pour avoir participé au Comité de coalition antifasciste de Bruxelles. Cette longue lutte avait cependant contribué à réduire les énergies pour la rentrée de la Fraction en Italie, à laquelle fut substituée dans les faits, une politique de rentrée individuelle d'un grand nombre de ses militants qui, une fois en Italie, découvraient l'existence du parti, y rentraient, toujours à titre individuel. Cette politique allait être durement critiquée par une partie de la Fraction et surtout par la Fraction reconstituée en France qui développait de façon croissante un travail clandestin contre la guerre et critiquait le manque de décision de la Fraction italienne pour la réalisation d'un retour organisé en Italie. C'est alors, au printemps 1945, qu'arrive comme une bombe la nouvelle qu'il existe depuis des années en Italie un parti qui compte déjà "des milliers de membres" et auquel participent des camarades comme Damen et Bordiga. La majorité de la Fraction fut transportée d'enthousiasme et décide, dans une conférence précipitée en mai 1945, de sa propre dissolution et de l'adhésion de ses militants à un parti dont elle ignorait complètement les positions programmatiques. Comme la Fraction en France appuyait la minorité qui s'opposait à ce suicide politique, la majorité de la Conférence rompit tout lien organisationnel avec le groupe français, en prenant comme prétexte le travail que les camarades français avaient mené sur le défaitisme révolutionnaire avec des internationalistes allemands et autrichiens qui n'appartenaient pas aux fractions de la Gauche communiste.
La décision de s'auto dissoudre a eu des conséquences très graves sur le développement ultérieur de la Gauche communiste. La Fraction était le dépositaire des leçons politiques fondamentales qui avaient été tirées par la sélection des forces communistes opérée entre 1935 et 1937, et elle avait le devoir historique de garantir que le nouveau parti se forme sur la base de ces leçons, qui ont été résumées de la façon suivante dans l'article précédent :
1) le parti se formera par adhésion individuelle aux positions programmatiques de la Gauche, élaborées par les fractions, en excluant toute intégration de groupes de camarades se situant à mi-chemin entre la Gauche et le Trotskisme ;
2) la garantie du défaitisme révolutionnaire du parti sera la dénonciation frontale de toute forme de "milice partisane", destinée à enrôler les ouvriers dans la guerre, comme les "milices ouvrières" espagnoles de 1936. Comme l'absence de rentrée organisée et la dissolution de 1945 n'ont pas permis à la Fraction de remplir cette fonction, nous devons maintenant regarder si le parti fondé en Italie a été capable de se constituer tout de même sur ces bases. Et ceci, non pour décider de quelle appréciation devrions nous avoir de ce parti en particulier, mais pour comprendre s'il est vrai ou non que le travail de fraction est une condition indispensable de la constitution du parti de classe.
Procédons par ordre, en partant des positions politiques et de la méthode de recrutement. Le premier Congrès du PC Internationaliste (28 décembre 1945 - 1 janvier 1946), qui se tient après l'intégration des militants de la Fraction dans le parti, déclare que le PC Internationaliste a été fondé en 1942, "Sur la base de cette tradition politique précise" ([4] [53]) représentée par la Fraction à l'étranger à partir de 1927. Les premiers noyaux se référaient à "une plate-forme constituée par un bref document dans lequel étaient fixées les directives que devait suivre le parti et que pour l'essentiel, il suit encore maintenant". Il est difficile de dire jusqu'à quel point ce document était sur les positions de la Fraction, pour la simple raison que - pour autant que nous le sachions - Battaglia n'a jamais veillé à le republier (et pourtant il était "bref "!) et dans sa brochure de 1974 sur les plate-formes du PC Internationaliste, elle ne mentionne même pas son existence. Quel sort étrange pour la plateforme de constitution du Parti... Nous sommes donc obligés de nous référer à la Plate-forme rédigée par Bordiga en 1945 et approuvée par le premier Congrès au début de 1946.
Sans entrer dans une analyse détaillée, il suffira de souligner que ce texte admet la possibilité de participer aux élections (position rejetée par la Gauche dès l'époque de la Fraction Abstentionniste du PSI), que, comme bases doctrinales du parti, on prend "les textes constitutifs de "l’Intemationale de Moscou" (en rejetant donc les critiques qu'en avait fait la Fraction à partir de 1927), qu'on ne parle pas vraiment de dénoncer les luttes de libération nationale (position acquise par la Gauche dès 1935), et que, pour terminer en beauté, on exalte comme "fait historique de premier ordre" l'enrôlement des prolétaires dans les bandes armées des partisans. La Plate-forme est aussi inacceptable sur d'autres questions (syndicale, en premier lieu), mais nous nous sommes limités à ne considérer que ces points sur lesquels la Plate-forme se situe en dehors de frontières de classe déjà tracées grâce à l’élaboration programmatique de la Gauche communiste.
La méthode de recrutement du parti est en harmonie avec ce fatras idéologique, bien plus, le fatras idéologique est le résultat obligé de la méthode de recrutement suivie, basée sur l'absorption successive de groupes de camarades aux positions les plus disparates, sinon complètement contraires. On pouvait ainsi trouver à la fin dans le Comité central les premiers camarades de 1942, les dirigeants de la Fraction qui avaient exclu Vercesi en 1944 et Vercesi lui-même qui a été admis en même temps que les membres de la minorité expulsés en 1936 du fait de leur participation à la guerre antifasciste en Espagne. Sont admis des groupes comme la "Fraction des communistes et socialistes de gauche" du sud, qui en 1944 croyaient encore à la possibilité de "redresser" le parti stalinien et dans la foulée le parti socialiste (!), et qui, en 1945, se dissout pour rejoindre directement le parti. En revanche, le principal théoricien et rédacteur de la Plate-forme de 1945, Amedeo Bordiga, lui n'est même pas inscrit (il semblerait qu'il ne se soit inscrit qu'en 1949).
Sur la seconde question clarifiée dans les années 1935-37, celle du danger représenté par les milices partisanes, la dégénérescence du PC Internationaliste va de pair avec son élargissement numérique aux dépens des principes. En 1943, le PC Internationaliste s'aligne sur une courageuse position qui dénonce sans équivoque le rôle impérialiste du mouvement partisan. En 1944, on est déjà obligé de faire des concessions aux illusions sur la guerre "Démocratique" :
"Les éléments communistes croient sincèrement à la nécessité de la lutte contre le nazi-fascisme et pensent qu'une fois cet obstacle abattu, ils pourront marcher vers la conquête du pouvoir, en battant le capitalisme", (Prometeo, n° 15, août 1944).
En 1945 le cercle se referme avec la participation de fédérations entières (comme celle de Turin) à l'insurrection patriotique du 25 avril et l'adoption d'une Plate-forme qui définit le mouvement partisan comme une "tendance de groupes locaux prolétariens à s'organiser et à s'armer pour conquérir et conserver le contrôle des situations locales" en déplorant seulement que ces mouvements n'aient pas "une orientation politique suffisante" (!). Il s'agit de la même position que celle défendue par la minorité en 1936 sur la guerre d'Espagne et qui lui avait valu d'être expulsée de la Gauche communiste.
Jusque là, il est assez clair que les positions globalement exprimées par le PC Internationaliste se situaient en deçà du niveau de clarification déjà atteint par la Fraction et des bases considérées comme intangibles pour la constitution du nouveau parti. Les camarades de Battaglia, au contraire, considèrent le parti "né à la fin de 1942" comme le summum de la clarté existant à l'époque. Comment peuvent-ils concilier cette affirmation avec l'existence de confusions et d'ambiguïtés que nous venons à peine d'évoquer ? Très simplement : en niant que ces confusions étaient celles du parti et en les attribuant exclusivement aux adeptes de Bordiga qui en sortiront ensuite en 1952 pour fonder Programme Communiste. On leur répondait déjà dans la Revue internationale : " en d'autres termes : eux et nous avons participé à la constitution du parti : ce qu'il y avait de bon, c'était nous, le mauvais, c'était eux. En admettant qu'il en ait été ainsi, il reste le fait qu'il y avait ce 'mauvais' qui constituait un élément fondamental et unitaire au moment de la constitution du parti et que personne n'a rien trouvé à redire."
Ce que nous voulons montrer maintenant, c'est que les faiblesses étaient celles du parti dans son ensemble et pas celles d'une fraction particulière qui serait passée par là. La première chose que BC a toujours niée, c'est que les portes du parti étaient ouvertes à quiconque avait la bonne volonté d'adhérer. Mais c'est ensuite BC même qui affirme que la présence de Vercesi, qui venait du Comité de coalition antifasciste, s'explique par le fait que ce dernier "estimait devoir adhérer au parti" ([5] [54]). Mais qu'est ce que c'est que ce parti, un club de golf ? (encore que même dans les clubs, on doive être accepté par les autres membres pour pouvoir rentrer...). En plus, il faut se rappeler que Vercesi "estimait devoir adhérer" directement au Comité central du PC Internationaliste, devenant un des principaux dirigeants. BC nous informe que Vercesi était dans le CC, mais que le parti n'était pas responsable de ce qu'il faisait ou disait :
"Les positions exprimées par le camarade Perrone (Vercesi) à la Conférence de Turin (1946) (...) étaient de libres manifestations d'une expérience toute personnelle et avec une perspective politique fantaisiste à laquelle il n'est pas licite de se référer pour formuler des critiques à la formation du PC Internationaliste". ([6] [55])
Bien dit. Dommage cependant qu'en lisant le compte-rendu de cette première Conférence nationale du PC Internationaliste, on découvre à la page 13, que ces "libres* affirmations "de politique fantaisiste" n'étaient rien d'autre que le rapport sur "Le parti et les problèmes internationaux" présenté par le CC à la Conférence, dont Vercesi était le rapporteur officiel. Mais les surprises ne s'arrêtent pas là, parce que page 16, à la fin du rapport de Vercesi, pour tirer les conclusions, c'est Damen lui-même qui prend la parole et qui affirme que jusque là, "il n'y a pas de divergences, mais des sensibilités particulières qui permettent une clarification organique des problèmes". Si Damen pensait que le rapport de Vercesi relevait de la politique fantaisie, pourquoi a-t-il nié qu'il y avait des divergences ? Peut-être parce que l'alliance sans principe avec Vercesi était alors utile ?
Mais ne nous attardons pas et passons directement à la Plate-forme, écrite en 1945 par Bordiga. Battaglia l'a republiée en 1974 en même temps qu'un projet de Programme diffusé en 1944 par les camarades groupés autour de Damen, avec une introduction dans laquelle il est affirmé que le projet de 1944 est beaucoup plus clair que la Plate-forme de 1945. Effectivement, c'est tout à fait vrai pour quelques points (bilan de la révolution russe par exemple), mais sur d'autres points, les glissements sont beaucoup plus importants que dans le document de 1945. En particulier, sur le point de la tactique, on dit que : "notre parti, qui ne sous-estime pas l'influence des autres partis de masse, se fait le défenseur du front unique'". Or, si on retourne au compte-rendu de la Conférence de Turin, on y trouve le rapport de Lecci (Tullio) qui fait le bilan du travail de la fraction à l'étranger et de sa délimitation par rapport au trotskisme : "cette démarcation présupposait en premier lieu la liquidation de la tactique de front unique des blocs politiques" (p 8). A la Conférence de 1946 donc, quelques points clés du projet étaient déjà considérés comme incompatibles avec les positions de la Gauche communiste. Mais venons en maintenant à ce que dit l'introduction de 1974 à la Plate-forme de 1945 :
"En 1945, le CC reçoit un projet de Plate-forme politique du camarade Bordiga qui, nous le soulignons, n’était pas inscrit au parti. Le document dont l’acceptation fut demandée en termes d'ultimatum, est reconnu comme incompatible avec les fermes prises de position adoptées désormais par le parti sur des problèmes plus importants, et, malgré les modifications apportées, le document a toujours été considéré comme une contribution au débat et pas comme une plate-forme de fait.(...) Le CC ne pouvait, comme on l'a vu, qu'accepter le document comme une contribution tout à fait personnelle pour le débat du congrès futur, qui, reporté à 1948, mettra en évidence des positions très différentes (cf. Compte-rendu du Congrès de Florence)." ([7] [56])
Telle est la reconstitution des faits présentée par les camarades de Battaglia en 1974. Pour voir si elle correspond à la réalité, retournons à la Conférence de janvier 1946 qui aurait dû se prononcer sur la "demande en termes d'ultimatum de l'acceptation " de la plate-forme faite par Bordiga. A la page 17 du Compte-rendu, on lit : "A la fin du débat, puisque aucune divergence substantielle ne s'est manifestée, la 'Plate-forme du Parti' est acceptée et on renvoie au prochain congrès la discussion sur le 'Schéma de Programme' et sur d'autres documents en voie d'élaboration". Comme on le voit, il est arrivé exactement le contraire de ce que Battaglia raconte aujourd'hui : à la conférence de 1946, les camarades de Battaglia eux-mêmes ont voté à l'unanimité pour l'acceptation de la Plate-forme écrite par Bordiga et qui est devenue la base officielle d'adhésion au parti depuis ce moment-là (et qui a été publiée comme telle à l'extérieur). Les délégués français eux-mêmes donnent leur adhésion à la Conférence sur la base de la reconnaissance de l'adéquation de la plate-forme (p.6) et la résolution de constitution d'un Bureau International de la Gauche communiste commence par ces mots : "le CC, tenant compte du fait que la Plate-forme du PC Internationaliste est le seul document qui donne une réponse marxiste aux problèmes rencontrés avec la défaite de la révolution russe et la deuxième guerre mondiale, affirme que c'est sur cette base et sur le patrimoine de la Gauche italienne que peut et doit être constitué le Bureau International de la Gauche communiste". Pour conclure, remarquons qu'il y a effectivement eu un document considéré comme une simple contribution au débat et dont la discussion fut renvoyée au congrès suivant, sauf que ce ne fut pas la plate-forme de Bordiga mais... le Schéma de programme élaboré en 1944 par le groupe de Damen et qu'aujourd'hui Battaglia cherche à faire passer pour la plate-forme effective du PC Internationaliste de années 1940.
On n'a pas assez de mots pour condamner la falsification totale de l'histoire du PC Int. effectuée toutes ces années par les camarades de Battaglia. On en est au niveau des falsifications staliniennes qui réécrivent l'histoire du parti bolchevik en faisant disparaître les noms des camarades de Lénine fusillés ou en attribuant à Trotsky les erreurs commises par Staline. Battaglia, pour faire que les choses aient l'air de se tenir, a été capable de faire disparaître de l'histoire du parti sa propre plate-forme et dans d'autres documents ([8] [57]), n'a pas hésité à attribuer aux "pères du CCI", les camarades de la Gauche communiste de France, les pirouettes de Vercesi, avec qui ses pères avaient noué une alliance opportuniste en 1945, en l'admettant dans le CC du Parti. Nous savons bien qu'il s'agit d'un jugement très dur, mais nous le fondons sur les documents officiels de PC Int., comme le Compte-rendu de la Conférence de janvier 1946, que Battaglia a bien pris soin de cacher, alors qu'elle a republié le compte-rendu du congrès de 1948, parce qu'à cette date, l'alliance opportuniste avec Vercesi était désormais rompue. Nous soumettons nos conclusions et nos jugements à la volonté critique de tous les camarades du milieu international de la Gauche communiste. Si les documents que nous avons cités n'existent pas, que Battaglia le dise et le démontre. Dans le cas contraire, on saura une fois de plus d'où viennent les falsifications.
Il reste de toute façon un problème à clarifier : comment est-il possible que des camarades de valeur comme Onorato Damen, des camarades qui ont tenu le flambeau de l'internationalisme dans les moments les plus durs pour notre classe, aient pu s'abaisser à un tel niveau de falsification de cette période de leur histoire ? Comment est-il possible que les camarades de Programme Communiste (qui s'était séparé en 1952 de Battaglia Comunista) aient pu en arriver à faire disparaître dans le néant leur histoire depuis 1926 jusqu'en 1952 ? Sur la base de tout ce qui a été re parcouru dans cet article, la réponse est claire : ni les uns ni les autres, dans les années cruciales autour de la deuxième guerre mondiale, n'ont été capables d'assurer fondamentalement la continuité historique de la Fraction de Gauche, seule base possible pour le parti de demain. On ne peut certainement pas leur reprocher d'avoir cru en 1943 que les conditions de la renaissance du parti avait mûri, étant donné que même les Fractions à l'étranger partageaient cette illusion, fondée sur le début d'une riposte prolétarienne à la guerre qui s'était manifestée avec les grèves de 1943 en Italie. Mais en janvier 1946, quand le congrès de Turin se tient, il était clair alors que le capitalisme avait réussi à briser toute réaction prolétarienne et à la transformer en un moment de la guerre impérialiste, à travers l'encadrement dans les bandes partisanes. Dans cette situation il était nécessaire de reconnaître que les conditions indispensables à la constitution du parti n'existaient absolument pas et de dédier ses forces à un travail de fraction, un travail de bilan et de formation de cadres sur la base de ce bilan. Ni les uns ni les autres n'ont été capables de s'engager jusqu'au bout sur cette voie et cela explique leurs contorsions par la suite. La tendance Damen commença à théoriser que la formation du parti n'avait rien à voir avec la reprise de la lutte de classe, démentant ainsi sa propre expérience de 1943. La tendance Vercesi (proche de Bordiga) recommença à louvoyer entre quelque chose qui n'était pas encore le parti mais qui n'était plus la fraction (le vieux "parti-miniature" de 1936 est recyclé en 1948 en "fraction élargie",), anticipant sur les futurs tours d'équilibre de Programme Communiste sur "parti historique/parti formel". Seule la Gauche communiste de France (Internationalisme), dont le CCI se réclame aujourd'hui, a été capable de reconnaître ouvertement les erreurs qui avaient été faites en croyant qu'en 1943 les conditions de la transformation de la fraction en parti existaient, et de se dédier au travail de bilan historique que les temps exigeaient. Pour aussi partiel qu'il soit, ce bilan reste la base indispensable sur laquelle on doit partir pour la reconstitution du parti de demain.
Dans la suite de ce travail, nous analyserons la contribution que ce bilan représente et doit représenter dans le processus de regroupement des révolutionnaires qui est en cours au niveau mondial.
Beyle
[1] [58] Revue internationale n° 59, 4c trimestre 1989.
[2] [59] Voir la brochure "La Gauche communiste d'Italie, 1917-1952", et le supplément sur les rapports de la Gauche italienne et de l'Opposition de gauche internationale, publiés par le CCI.
[3] [60] « Frazione-Partito nell » esperenza della Simstra Italiana", Prometeo n°2. mars 79.
[4] [61] "Compte-rendu de la première conférence nationale du Parti Communiste Internationaliste d'Italie". Publications de la Gauche communiste internationale, 1946.
[5] [62] 'Lettre de BC au CCI’, reproduite dans la Revue internationale n° 5 décembre 1976, avec notre réponse.
[6] [63] Prometeo n° 18, ancienne série, 1972.
[7] [64] Documents de la Gauche italienne n° 1, Cd. Prometco, janvier 1974.
[8] [65] Battaglia Comunista n° 3, février 1983, article reproduit dans la Revue Internationale n° 34, 3e trimestre 1983, avec notre réponse.
Courants politiques:
- Battaglia Comunista [66]
Questions théoriques:
- Parti et Fraction [67]
Revue Internationale no 62 - 3e trimestre 1990
- 2676 reads
Editorial : pays de l'est : crise irréversible, restructuration impossible
- 4376 reads
Les événements de ces derniers mois dans l’ex-bloc soviétique ont révélé de plus en plus clairement l'énorme délabrement de l'économie, dans tous les pays d'Europe de l'Est sans exception, et en URSS en particulier. Au fur et à mesure que la réalité est mieux connue, les derniers espoirs et toutes les théories sur une possibilité d'amélioration de la situation volent en éclats. Les faits parlent d'eux-mêmes : il est impossible de relever l'économie de ces pays ; leurs gouvernements, quelles qu'en soient les diverses composantes, l'ancien appareil "réformé" avec ou sans participation des anciennes "oppositions", ou de "nouvelles" formations politiques, sont totalement impuissants à maîtriser la situation. C'est la plongée dans un chaos sans précédent qui se confirme chaque jour davantage. ([1] [68])
Les pays occidentaux ne renfloueront ni les pays de l'Est, ni l'URSS
Partout c'est la débandade et les pays de PEst aimeraient bien voir les grands pays industrialisés venir au secours de leur économie complètement sinistrée. Walesa ne cesse de quémander pour la Pologne de l'aide à l’"Occident". Gorbatchev plaide auprès de Bush la "clause de la nation la plus favorisée", accord préférentiel en matière contractuelle que les Etats-Unis ont toujours refusé à l'URSS, qui fut souvent conclu avec la Roumanie, pays le plus pauvre de l'ancien bloc de l'Est. La RDA attend de la réunification avec la RFA des subsides pour sauver les quelques rares secteurs de son appareil productif qui ne sont pas dévastés.
Mais les pays occidentaux ne sont pas prêts à engager le dixième des dépenses qui seraient nécessaires, dans une entreprise qui est, non seulement des plus hasardeuses, mais dès à présent vouée à un échec certain. Il n'y a plus guère d'illusions sur une perspective de redressement économique des pays de l'Est. Il n'y a aucun profit tangible à retirer d'un appareil productif à l'infrastructure et aux moyens de production totalement obsolètes, et à la main-d'oeuvre non rompue aux normes de productivité draconiennes imposées par la guerre commerciale sur le marché mondial que se livrent les principales puissances industrielles occidentales, essentiellement Etats-Unis, Japon, Allemagne de l'Ouest, et les autres pays d'Europe occidentale.
Et même si le FMI octroyait plus de crédits, il se trouverait confronté à une situation semblable à celle des pays du "tiers-monde" insolvables, avec des dettes de milliards de dollars qui n'ont aucune chance d'être jamais remboursés.
Il est symptomatique que la rencontre Bush-Gorbatchev, en cours au moment de sortir ce numéro, ne donne lieu à aucun accord économique particulier, sinon la reconduction timide d'anciens accords existants. Personne ne mise plus sur une quelconque réussite de la fameuse "perestroïka". Les considérations qui entrent en ligne de compte, dans l'entretien des relations occidentales avec les pays de l'Est, relèvent de préoccupations générales sur les moyens de contenir la généralisation d'un désordre en Europe de l'Est qu'aucune puissance occidentale ne voit d'un bon oeil. Il n'est pas question d'accords commerciaux ou industriels susceptibles d'apporter un véritable ballon d'oxygène à l'économie complètement asphyxiée de ces pays.
Les pays de l'Est ne peuvent compter sur aucun "plan Marshall" (le financement de la "reconstruction" de l'Europe de l'Ouest et du Japon par les Etats-Unis après la 2e guerre mondiale). S'il y a quelques illusions, parmi les défenseurs de la "victoire du capitalisme", sur l'intérêt économique offert par le démantèlement du "rideau de fer", l'expérience douloureuse actuelle pour l'économie ouest-allemande que constitue la réunification de l'Allemagne et la prise en charge de la RDA ([2] [69]), risque de les balayer complètement. Pour le capital allemand, il y a bien un intérêt ponctuel pour la main-d'oeuvre qualifiée très mal payée en RDA, mais il y a surtout la perspective d'une ponction financière terriblement élevée et de l'afflux de millions de chômeurs et immigrés. ([3] [70])
Alors que le système financier international menace à chaque instant de s'écrouler sous le poids de la dette mondiale, alors que des licenciements massifs ont déjà commencé, aux Etats-Unis notamment, et ne vont faire qu'augmenter partout dans les grands pays capitalistes développés, ces derniers n'ont aucun intérêt strictement économique, aucun "marché" dans les pays de l'Est, à quelques très rares exceptions près. Seuls des "théoriciens" attardés, et il en existe malheureusement encore quelques-uns y compris dans le camp prolétarien ([4] [71]), croient encore au mirage de la restructuration de l'économie des pays de l'Est.
Le délabrement complet de l'économie
Les chiffres officiels avoués aujourd'hui en URSS sur l'état exsangue de l'économie, à tous les niveaux, pulvérisent à la baisse les anciennes estimations officieuses, que les spécialistes occidentaux opposaient déjà depuis plusieurs années au mensonge institutionnel des "statistiques" soviétiques.
Les nouvelles statistiques qui font le constat d'un taux de croissance de l'économie qui s'approche inexorablement de zéro rendent plus compte de la réalité que celles d'avant la "Glasnost". Cependant, en incluant dans son calcul le secteur militaire, seul secteur où l'économie russe a connu une croissance réelle depuis le milieu des années 1970, il donne une indication qui sous-estime encore l'ampleur de la crise de l'économie soviétique.
C'est, au mieux, au niveau économique d'un pays comme le Portugal que se trouve actuellement l'URSS, disposant, selon les estimations, de 30 000 F de revenu par tête et par an, revenu pouvant aller de 9 000 à 54 000 F. Ce qui signifie, pour une majorité de la population, un "niveau de vie" en fait certainement plus près de celui de pays tels que l’Algérie que de celui des régions les plus pauvres de l'Europe du sud.
De plus les caractéristiques "classiques" de la crise à l'occidentale, l'inflation et le chômage, commencent déjà à ravager les pays de l’Est, à des taux dignes des pays du "tiers-monde" les plus touchés. Et ces fléaux "classiques" du capitalisme viennent s'ajouter à ceux, tout aussi capitalistes, hérités du stalinisme : rationnement et pénurie permanents des biens de consommation courante. Même les plus violents pourfendeurs du stalinisme et glorificateurs zélés du capitalisme à l'occidentale sont stupéfaits de l'état de délabrement de l'économie de l'URSS : "La réalité soviétique n'est pas une économie développée nécessitant diverses rectifications, c'est un gigantesque bric-à-brac inutilisable et imperfectible." ([5] [72]).
La "perestroïka" est une coquille vide et la popularité de Gorbatchev est désormais au plus bas en URSS, les récentes "mesures" du gouvernement consistant à entériner la catastrophe : une reconnaissance officielle d'augmentation des prix à la consommation jusqu'à 100 %, et la promesse de 15 % d'augmentation des salaires comme... "compensation financière" ! A brève échéance, dans cinq ans pour les "optimistes", dans un an pour d'autres, c'est le chômage massif pour des millions de travailleurs, les prévisions faisant état du chiffre de 40 ou 45 ou 50 millions de chômeurs, ou même "peut-être plus", soit plus d'une personne sur cinq, et sans allocation d'un quelconque "minimum vital" !
Et si la situation en URSS est une des plus catastrophiques, celle dans les autres pays de l'Est n'est guère plus brillante. Dans l'ex-RDA, avec la mise en place de l’"union monétaire" allemande de juillet 1990, ce sont 600 000 chômeurs qui se retrouvent immédiatement sur le pavé, et ce chiffre atteindra quatre millions dans les années qui viennent, soit une personne sur quatre ! ([6] [73]) En Pologne, après que les prix aient augmenté de 300 % en moyenne en 1989, jusqu'à des flambées à 2000 % sur certains produits, le gouvernement a bloqué les salaires "pour enrayer l'inflation". En fait, officiellement, l'inflation est aujourd'hui de 40 % et le nombre de chômeurs devrait atteindre cette année les deux millions. Partout, le bilan des "mesures de libéralisation" est clair : elles ne font qu'ajouter au désastre.
La forme stalinienne du capitalisme d'Etat héritée, non de la révolution d'octobre 1917, mais de la contre-révolution qui l'a tuée dans le sang, a sombré avec la ruine complète et la désorganisation totale des formes de l'économie capitaliste qu'elle a engendrées dans les ex-pays soi-disant "socialistes". Mais la forme "libérale" du capitalisme occidental, qui n'est pas moins du capitalisme d'Etat, mais sous une forme beaucoup plus sophistiquée, ne peut pas constituer une solution de rechange. C'est le système capitaliste comme un tout au niveau mondial qui est en crise, et les pays "démocratiques" développés doivent y faire face pour défendre leurs propres intérêts. Le manque de marchés n'est pas l'apanage des pays de l'Est ruinés, il frappe au coeur du capitalisme le plus développé.
L'échec de la "libéralisation"
L'accélération de la crise a mis à nu la totale absurdité des .méthodes du capitalisme d'Etat à la façon du stalinisme sur le plan de la gestion économique : l'irresponsabilité complète de plusieurs générations de fonctionnaires dont la seule préoccupation était de s'en mettre plein les poches en respectant, sur le papier, des directives de "plans" complètement déconnectés du fonctionnement normal du marché. Le constat, au sein même de la classe dominante, de l'obligation d'en finir avec cette irresponsabilité, d'abandonner la tricherie permanente avec les "lois du marché" que constitue la totale prise en main de la vie économique par l'appareil d'Etat, ne signifie pas que la classe dominante puisse opérer un rétablissement de l'économie par une "libéralisation", et une reprise en main de la situation par une "démocratisation". Ce constat n'est que la reconnaissance de la pagaille généralisée qui existe à tous les niveaux. Mais comme c'est de cette tricherie permanente que cette même classe dominante tient ses privilèges depuis des décennies, ce constat ne peut en rester qu'à l'état d'un constat, ce que l'expérience de la "perestroïka" et de la "glasnost" depuis cinq ans illustre largement. Comme nous le disions dès septembre 1989 :
"(...) De même que la 'réforme économique' s'est donné des tâches pratiquement irréalisables, la 'réforme politique' comporte de bien faibles chances de succès. Ainsi, l'introduction effective du 'pluripartisme' et d'élections 'libres', qui est la conséquence logique d'un processus de 'démocratisation', constitue une menace véritable pour le parti au pouvoir. Comme on l'a vu récemment en Pologne, et dans une certaine mesure également en URSS l'an passé, de telles élections ne peuvent conduire qu'à la mise en évidence du complet discrédit, de la véritable haine, qui s'attachent au Parti au sein de la population. Dans la logique de telles élections, la seule chose que le Parti puisse en attendre est donc la perte de son pouvoir. Or c'est quelque chose que le Parti, à la différence des partis 'démocratiques' d'Occident, ne peut pas tolérer du fait que :
- s'il perdait le pouvoir par les élections, il ne pourrait jamais, contrairement à ces autres partis, le reconquérir par ce moyen;
- la perte de son pouvoir politique signifierait concrètement l'expropriation de la classe dominante puisque son appareil est justement la classe dominante.
Alors que dans les pays à économie 'libérale' ou 'mixte', où se maintient une classe bourgeoise classique, directement propriétaire des moyens de production, le changement du parti au pouvoir (à moins justement qu'il ne se traduise par l'arrivée d'un parti stalinien) n'a qu'un faible impact sur ses privilèges et sa place dans la société, un tel événement dans un pays de l'Est signifie, pour la grande majorité des bureaucrates, petits et grands, la perte de leurs privilèges, la mise au chômage, et même des persécutions de la part de leurs vainqueurs. La bourgeoisie allemande a pu s'accommoder du 'kaiser', de la république social-démocrate, de la république conservatrice, du totalitarisme nazi, de la république 'démocratique' sans que soit remis en cause l'essentiel de ses privilèges. En revanche, un changement de régime en URSS signifierait dans ce pays la disparition de la bourgeoisie sous sa forme actuelle en même temps que celle du parti. Et si un parti politique peut se suicider, prononcer son autodissolution, une classe dominante et privilégiée, elle, ne se suicide pas" ([7] [74])
En URSS, le stalinisme est, par les circonstances historiques de son apparition, une organisation particulière de l’Etat capitaliste. Avec la dégénérescence de la révolution russe, l'Etat qui avait surgi après l'expropriation de l'ancienne bourgeoisie par la révolution prolétarienne de 1917, est devenu l'instrument de la reconstitution d'une nouvelle classe capitaliste, sur les cadavres de dizaines de millions de prolétaires, ouvriers et révolutionnaires, dans la contre-révolution depuis la fin des années 1920 jusque dans les années 1930, puis dans l'embrigadement meurtrier dans la 2e guerre mondiale. La forme prise par cet Etat est le produit direct de la contre-révolution dans laquelle la classe dominante s'est totalement identifiée à l’Etat-Parti unique. Avec la faillite définitive du système, la classe dominante a perdu tout contrôle de la situation, non seulement sur les anciens Etats "socialistes", mais aussi au sein même de l'URSS, et n'a pas de marge de manoeuvre pour enrayer cet engrenage.
La situation dans les pays de l'Est est un peu différente. C'est à la fin de la 2e guerre mondiale que l'URSS, avec la bénédiction des "Alliés", a imposé, dans les gouvernements des pays passés dans sa zone d'influence, la prépondérance des Partis Communistes qui lui étaient inféodés. Dans ces pays, l'ancien appareil d'Etat n'a pas été détruit par une révolution prolétarienne. Il a été adapté, plié à l'impérialisme russe, laissant subsister, plus ou moins selon les pays, des formes classiques de la domination de la bourgeoisie, à l'ombre du stalinisme. C'est pourquoi, avec la mort du stalinisme et l'incapacité de l'URSS à maintenir son emprise impérialiste, la classe dominante dans ces pays, pour la plupart moins sous-développés que l'URSS économiquement, s'est empressée de tenter de se débarrasser du stalinisme en essayant de réactiver les résidus de ces formes antérieures.
Cependant, si les pays de l'Est disposent théoriquement de plus de possibilités que l'URSS pour essayer de faire face à la situation, les derniers mois montrent que l'héritage des quarante dernières années de stalinisme et le contexte de la crise mondiale du capitalisme posent des problèmes énormes à une véritable "démocratie" bourgeoise. En Pologne par exemple, la classe dominante s'est montrée incapable de maîtriser cette "démocratisation". Elle s'est retrouvée dans la situation aberrante d'avoir au gouvernement le syndicat Solidarnosc. En RDA, c'est la "démocratie chrétienne", la CDU, qui a gouverné avec le SED (Parti communiste) pendant quarante ans, qui est le principal protagoniste de la "démocratisation" pour la réunification avec la RFA. Mais loin de constituer une force politique responsable capable d'assurer une quelconque réorganisation dans le pays, cette formation politique n'a pour seule dynamique que l'appât du gain de son personnel, et ne fait rien d'autre qu'attendre les subsides de RFA, au grand dam de la CDU ouest-allemande, principal bailleur de fonds de l'opération.
L'évolution inexorable commencée l'été dernier depuis l'accession de Solidarnosc au gouvernement de Pologne, le virage à l'Ouest de la Hongrie, l'ouverture du mur de Berlin, le séparatisme des "républiques asiatiques", jusqu'à la sécession des "républiques baltes", et l'investiture récente d'Eltsine en Russie même, n'est pas le fruit d'une politique voulue et choisie délibérément par la bourgeoisie. Elle est l'expression jour après jour de la perte de contrôle de la classe dominante, et indique la plongée dans une dislocation et un chaos jusque là inconnus dans toutes ces régions du monde. Il n'y a pas "libéralisation", mais impuissance de la classe dominante face à la décomposition du système.
Les illusions démocratiques et les nationalismes
La "libéralisation" n'est qu'un discours vide, un rideau de fumée idéologique, qui utilise les illusions sur la "démocratie" très fortes dans la population qui a vécu quarante années d'encasernement du stalinisme, pour essayer de faire accepter la dégradation continue des conditions d'existence. Déjà, la "libéralisation" de Gorbatchev a fait long feu avec cinq années de discours qui n'ont aucun résultat concret sinon une situation de plus en plus pénible pour la population. Et ce n'est pas seulement le fait des hommes de l'appareil à la Gorbatchev. Les anciens opposants, même les plus "radicaux", champions de la "démocratisation", se démasquent et montrent leur vrai visage dès que leur échoit une responsabilité gouvernementale. En Pologne par exemple, on voit un Kuron, emprisonné par Jaruzelsky il y a quelques années, autrefois "trotskiste" ([8] [75]), après s'être vanté, lorsqu'il prit ses fonctions de Ministre du Travail, de pouvoir "éteindre des milliers" (de grèves) pour avoir été capable d'en "organiser cent", menacer aujourd'hui de répression directe les grévistes des transports, et ne se distinguer en rien de l'attitude classique du stalinisme contre la classe ouvrière. Quelles que soient les fractions et cliques politiques qui occupent à un moment ou à un autre le pouvoir, il n'y a pas de véritable "démocratie" possible sous la forme de la démocratie bourgeoise des pays les plus développés, et encore moins une démocratie "socialiste".
Cette idée de démocratie "socialiste", selon laquelle il suffirait d'écarter la bureaucratie du pouvoir pour permettre aux "rapports de production socialistes" soi-disant existant dans les pays de l'Est, de s'épanouir, idée chère à nombre de sectes trotskistes, n'est qu'une invention de dernier rabatteur du stalinisme que constitue ce courant politique, et tous les événements récents en apportent chaque jour un peu plus la confirmation.
Tous les "oppositionnels", pour la plupart issus de l'appareil, ou tout l'ancien appareil repenti, ou encore des personnalités converties par les circonstances à se mettre "au service de leur pays", tous candidats à la défense du maigre capital national en danger, utilisent les illusions démocratiques nourries par la plus grande majorité dans les pays de l'Est, pour se chercher des masses de manoeuvre pour leurs desseins et aspirations au pouvoir. Mais seuls les grands pays développés peuvent se permettre de véritables formes "démocratiques" de domination de la classe capitaliste. La force relative de l'économie et l'expérience politique leur permettent d'entretenir tout l'appareil, des médias à la police, et toutes les institutions nécessaires à une emprise sur la société qui cache son totalitarisme sous l'apparence de "libertés". Le stalinisme, capitalisme d'Etat poussé à l'absurdité jusqu'à tenter de nier la loi de la valeur, a forgé une classe dominante totalement inapte, ignorante du BA. BA de cette même loi sur laquelle elle fonde pourtant sa domination de classe. Jamais une classe dominante n'a été aussi faible.
Et cette faiblesse entraîne aussi, avec la dislocation du bloc de l'Est et de l'URSS, l'éclatement des multiples nationalismes qui n'étaient attachés à l'URSS que par la répression militaire, et qui se réveillent automatiquement avec l'impuissance de leur chef de file à exercer cette suprématie par la force des armes.
Gorbatchev a pu donner un moment l'impression qu'il favorisait l'expression des "nationalités" en URSS. En réalité, le pouvoir central soviétique ne peut pas utiliser les nationalismes au profit du renforcement de sa puissance. Au contraire, les flambées de nationalismes, régionalismes, particularismes à tous les niveaux, sont une manifestation de l'incapacité du régime russe et de la perte définitive de sa puissance, de son statut de tête de bloc impérialiste, de sa place parmi les "grandes puissances" ([9] [76]). Ce sont les conditions de la situation qui alimentent le nationalisme : sans Moscou et l'Armée rouge, les cliques au pouvoir se retrouvent "nues", et la voie est libre pour les débordements de tous les particularismes qui n'étaient tenus que par la terreur militaire. Les conséquences de cet effondrement n'en sont qu'au début de leurs pires manifestations. A terme, par sa logique propre, c'est au mieux une "démocratisation" comme en connaissent des pays tels que la Colombie ou le Pérou, ou plus vraisemblablement une "libanisation" de tout l'ancien bloc de l'Est et de l'URSS elle-même, qui est inscrite dans la situation actuelle, avec aucune politique de rechange de la bourgeoisie, et le chacun pour soi.
Le capitalisme "libéral" occidental a son tour dans la crise
Fondamentalement la crise en URSS est en dernier ressort l'expression de la crise économique généralisée du capitalisme, une des manifestations de la crise historique de ce dernier, de sa décomposition. Il ne peut y avoir de restructuration du capitalisme possible à l'Est, de la même manière qu'aucun "pays en voie de développement" n'a pu s'arracher du "sous-développement" depuis que la terminologie de "tiers-monde" a été inventée. Au contraire, la crise amène la perspective d'un effondrement mondial irréversible.
Depuis son ouverture à la fin des années 1960, la crise économique ouverte a entraîné :
- dans les années 1970-80 la chute inexorable des pays du "tiers-monde" dans le sous-développement et la misère la plus noire pour d'immenses masses de la population mondiale,
- à la fin des années 1980, la mort définitive du stalinisme, régime capitaliste hérité de la contre-révolution du "socialisme en un seul pays", plongeant à grande vitesse la majorité de la population des pays soi-disant "communistes" dans une aussi grande sinon pire situation de paupérisation absolue.
Au cours des années 1990 la crise va entraîner cette même paupérisation absolue au coeur du "premier-monde", dans les métropoles industrielles déjà rongées par vingt ans de croissance du chômage massif et de longue durée, d'augmentation de l'insécurité et de la précarité, à tous les niveaux de la vie sociale. Il n'y aura pas de "restructuration" du capitalisme, ni à l'Est, ni à l'Ouest.
MG, 3 juin 1990.
[1] [77] Voir les analyses développées sur l'analyse de l'effondrement du bloc russe et ses implications pour la situation mondiale dans la Revue internationale, n°60 et 61.
[2] [78] Voir le "La situation en Allemagne", dans ce numéro.
[3] [79] Certains milieux gouvernementaux russes ont envisagé un "moyen" pour renflouer les caisses de l'URSS : envoyer 16 millions d'immigrés soviétiques en Europe de l'ouest dans les années qui viennent, pour rapporter des devises...
[4] [80] Voir l'article "Face aux bouleversements de l'Est, une avant-garde en retard", dans ce numéro.
[5] [81] Le Point, 9-10 juin 1990.
[6] [82] Voir le "La situation en Allemagne", dans ce numéro.
[7] [83] Revue internationale, n°60, "Thèses sur la crise économique et politique dans les pays de l'Est", thèse 16.
[8] [84] Cf. "Lettre ouverte au Parti Ouvrier Polonais", K.Modzelewski et J.Kuron, 1968, supplément à Quatrième Internationale, mars 1968.
[9] [85] Voir l'article "La barbarie nationaliste", dans ce numéro.
Questions théoriques:
- L'économie [86]
Heritage de la Gauche Communiste:
Pays de l'Est : la barbarie nationaliste
- 3147 reads
Nous assistons dans toute l'Europe orientale et en URSS, à une violente explosion de nationalisme.
La Yougoslavie est en voie de désintégration. La "civilisée" et "européenne" Slovénie demande son indépendance et, en même temps, soumet les républiques "soeurs" de Serbie et de Croatie à un blocage économique rigoureux. En Serbie, le nationalisme encensé par le stalinien Milosevic a donné lieu à des pogroms, à l'empoisonnement des eaux, à la répression la plus brutale contre les minorités albanaises. En Croatie, les premières élections "démocratiques" donnent la victoire au CDC, groupe violemment revanchard et nationaliste. Un match de football du Dynamo de Zagreb contre un club de Belgrade (en Serbie) dégénère en affrontements violents.
Toute l'Europe de l'Est est secouée par des tensions nationalistes. En Roumanie une organisation para fasciste, Cuna Rumana, composée essentiellement d'éléments de l'ancienne Securitate et qui peut compter sur l'appui indirect des "libérateurs " du FSN, persécute les Hongrois et les passe à tabac. Ceux-ci, à leur tour, ont profité de la chute de Ceaucescu pour perpétrer des pogroms anti-Roumains. Pour sa part, le gouvernement central de Bucarest, enfant chéri des gouvernements "démocratiques", poursuit avec acharnement les minorités gitanes et d'origine allemande. La Hongrie, pionnier des changements "démocratiques", pratique une politique discriminatoire à l'égard des gitans, et encourage les revendications de la minorité hongroise en Transylvanie roumaine. En Bulgarie, le régime "démocratique" flambant neuf, cautionne grèves et manifestations massives contre les minorités turques. Dans la Tchécoslovaquie de la "révolution de velours", le gouvernement du "rêveur" Havel poursuit "démocratiquement" les gitans et une violente polémique, assaisonnée de manifestations et d'affrontements, s'est déclenchée entre Tchèques et Slovaques autour de la question transcendantale de savoir si le nom de la "nouvelle" République "libre" serait "Tchécoslovaquie" ou "Tchéco-Slovaquie"...
Mais c'est surtout en URSS que l'explosion nationaliste atteint des proportions qui mettent en question l'existence même de cet Etat, seconde puissance mondiale il y a encore six mois. Cette explosion y est particulièrement sanglante et chaotique.
Massacres d'Azéris par des Arméniens et d'Arméniens par des Azéris, Abkhazes victimes de Géorgiens, Turkmènes lynchés par des Ouzbéks, Russes passés à tabac par des Kazakhs... Entre temps, la Lituanie, l'Estonie, la Lettonie, la Géorgie, l'Arménie, l’Azerbaïdjan, l'Ukraine, demandent l'indépendance.
L’explosion nationaliste : la décomposition capitaliste a vif
Pour les propagandistes de la bourgeoisie, ces mouvements seraient une "libération", produit de la "révolution démocratique" grâce à laquelle les peuples de l'Est se sont débarrassés du joug "communiste".
Si une "libération" a eu lieu c'est celle de la boîte de Pandore. L'effondrement du stalinisme a libéré les violentes tensions nationalistes, les fortes tendances centrifuges qui, avec la décadence du capitalisme, ont couvé, se sont radicalisées, approfondies dans ces pays, renforcées par leur arriération insurmontable et par la domination du stalinisme, expression et facteur actif de cette arriération ([1] [87]).
Le dénommé "ordre de Yalta", qui a dominé le monde pendant quarante-cinq ans, contenait ces énormes tensions et contradictions que la décadence du capitalisme faisait mûrir inexorablement vers l'holocauste total d'une troisième guerre impérialiste mondiale. La renaissance de la lutte prolétarienne depuis 1968 a bloqué ce cours "naturel" du capitalisme décadent. Mais étant donné que la lutte prolétarienne n'a pas été capable d'aller jusqu'à ses ultimes conséquences -l'offensive révolutionnaire internationale- les tendances centrifuges, les aberrations toujours plus destructrices propres à la décadence capitaliste, continuent de se manifester et de s'aggraver, donnant naissance à un pourrissement sur pied de l'ordre capitaliste, qui est ce que nous appelons, sa décomposition généralisée ([2] [88]).
Dans les anciens domaines de l'Ours Russe cette décomposition a "libéré" les pires sentiments de racisme, de revanchisme nationaliste, de chauvinisme, d'anti-sémitisme, de fanatisme patriotique et religieux... qui ont fini par s'exprimer avec toute leur fureur destructrice.
"Souillée, déshonorée, pataugeant dans le sang, couverte de crasse ; voilà comment se présente la société bourgeoise, voilà ce qu'elle est Ce n'est pas lorsque, bien léchée et bien honnête, elle se donne les dehors de la culture et de la philosophie, de la morale et de l'ordre, de la paix et du droit, c'est quand elle ressemble à une bête fauve, quand elle danse le sabbat de l'anarchie, quand elle souffle la peste sur la civilisation et l'humanité qu'elle se montre toute nue, telle qu'elle est vraiment" (Rosa Luxemburg, La crise de la social-démocratie, Chap 1, p. 55).
D'habitude la bourgeoisie fait une distinction entre le nationalisme "sauvage", "fanatique", "agressif, et le nationalisme "démocratique", "civilisé", "respectueux des autres". Cette distinction est une pure supercherie, fruit de l'hypocrisie des grands Etats "démocratiques" occidentaux, dont la position de force permet d'utiliser avec plus d'intelligence et d'astuce la barbarie, la violence et la destruction inhérentes par principe à toute nation et à tout nationalisme dans le capitalisme décadent.
Le nationalisme "démocratique", "civilisé" et "pacifique" de la France, des USA et compagnie, est celui des massacres et des tortures au Viet-Nam, en Algérie, au Panama, en Centrafrique, au Tchad, c'est le nationalisme "démocratique" de l'appui non-dissimulé à l'Irak dans la guerre du Golfe. C'est celui des deux guerres mondiales qui ont fait plus de 70 millions de morts et dans lesquelles l'exaltation du patriotisme, de la xénophobie, du racisme, ont été la couverture idéologique d'actes de barbarie qui n'ont tien à envier à ceux des nazis : les bombardements américains de Dresde ou de Hiroshima et Nagasaki, ou les atrocités de la France à l'égard des populations allemandes dans sa zone d'occupation, tant après la première guerre mondiale qu'après la deuxième.
C'est la "civilisation" et le "pacifisme" de la "libération" française lors de la défaite des nazis : les forces "républicaines" de De Gaulle et le P "C" F encourageant conjointement à la délation, aux pogroms contre les Allemands : "A chacun son boche", était la consigne "civilisée" de la "France éternelle" incarnée par ces surenchérisseurs du nationalisme le plus hystérique et agressif qu'ont toujours été les staliniens.
C'est le cynisme hypocrite qui consiste à favoriser l'immigration illégale d'ouvriers africains pour avoir une main d'œuvre bon marché, soumise en permanence à l'intimidation et au chantage de la répression policière (qui suit les besoins de l'économie nationale, n'hésitant pas à renvoyer dans des conditions atroces des milliers de travailleurs immigrés dans leur pays d'origine) et qui exhibe en même temps, avec des larmes de crocodile, un "antiracisme" attendrissant.
C'est le pharisaïsme éhonté de Thatcher qui, tout en se disant "désolée et horrifiée" par la barbarie en Roumanie, renvoie au Viet-Nam 40 000 émigrants illégaux capturés brutalement par la police de Sa Majesté à Hong Kong.
Toute forme, toute expression de nationalisme, fût-il grand ou petit, porte obligatoirement et fatalement la marque de l'agression, de la guerre, du "tous contre tous", de l'exclusivisme et de la discrimination.
Dans la période ascendante du capitalisme, la formation de nouvelles nations constituait un progrès pour le développement des forces productives, en tant qu'étapes nécessaires à la constitution d'un marché mondial permettant leur extension et leur développement. Au 20e siècle, avec la décadence du capitalisme, éclate brutalement la contradiction entre le caractère mondial de la production et la nature inévitablement privée-nationale des rapports capitalistes. Dans cette contradiction, la nation, base de regroupement des bandes capitalistes dans la guerre à mort qu'elles se livrent pour le repartage d'un marché sursaturé, révèle son caractère réactionnaire, sa nature congénitale de force de division, d'entrave au développement des forces productives de l'humanité.
"D'un côté, la formation d'un marché mondial internationalise la vie économique, marquant profondément la vie des peuples ; mais d'un autre côté, cela produit la nationalisation, toujours plus accentuée, des intérêts capitalistes, ce qui traduit de la façon la plus manifeste l’anarchie de la concurrence capitaliste dans le cadre de l'économie mondiale et conduit à de violentes commotions et catastrophes, à une immense perte d'énergies, posant de façon impérieuse le problème de l'organisation de nouvelles formes de vie sociale. " (Boukharine, L'économie mondiale et l'impérialisme, 1916).
Tout nationalisme est impérialiste
Les trotskistes, extrême-gauche du capital, appuis "critiques" permanents de l'impérialisme russe, font une analyse "positive" de l'explosion nationaliste à l'Est ; ils y voient la mise en pratique du "droit à l'autodétermination des peuples", ce qui supposerait un coup porté contre l'impérialisme, une déstabilisation des blocs impérialistes.
Nous avons déjà argumenté amplement pour démontrer la supercherie du mot d'ordre d'"autodétermination des peuples", y compris dans la période d'ascendance du capitalisme ([3] [89]). Ici nous voulons démontrer que l'explosion nationaliste, si elle est une conséquence de l'effondrement du bloc impérialiste russe et s'inscrit dans un processus de déstabilisation des constellations impérialistes qui ont dominé le monde ces quarante dernières années ("l'ordre" de Yalta), elle n'implique aucune remise en cause de l'impérialisme et, ce qui de loin est le plus important, qu'un tel processus de décomposition n'apporte rien de favorable au prolétariat.
Toute mystification s'appuie, pour être efficace, sur des fausses vérités ou fies apparences de vérité. Ainsi, il est évident que le bloc impérialiste occidental voit avec embarras et préoccupation le processus actuel d'éclatement de l'URSS en mille morceaux. Mis à part les bravades propagandistes du genre "ne touchez pas à la Lituanie !" et les tapes sur l'épaule à Landsbergis et sa clique, son attitude face à l'indépendance de la Lituanie a été d'offrir un appui très peu dissimulé à Gorbatchev.
Les Etats-Unis et leurs alliés occidentaux n'ont, pour l'instant, aucun intérêt à l'éclatement de l'URSS. Ils savent qu'un tel éclatement donnera naissance à une énorme déstabilisation, avec des guerres civiles et nationalistes sauvages, où les arsenaux nucléaires accumulés par la Russie pourraient entrer en jeu. Par ailleurs, une déstabilisation des frontières actuelles de l'URSS aurait inévitablement des répercussions au Moyen-Orient et en Asie, libérant les tensions nationalistes, religieuses, ethniques, tout aussi énormes, qui y sont accumulées et contenues à grand peine.
Néanmoins, cette attitude, pour le moment unanime, des grandes puissances impérialistes de l'Occident est circonstancielle. Inévitablement, à mesure que s'aiguise le processus, déjà en cours, de dislocation du bloc occidental -dont le principal facteur de cohésion, l'unité contre le danger de l'Ours Russe, a disparu- chaque puissance commencera à jouer ses propres cartes impérialistes, attisant le feu de telle ou telle bande nationaliste, appuyant telle ou telle nation contre telle autre, soutenant telle ou telle indépendance nationale.
Dans ce sens, la spéculation grossière sur la déstabilisation de l'impérialisme est clairement démentie, mettant en évidence ce que les révolutionnaires défendent depuis la première guerre mondiale :
"Les 'luttes de libération nationale' sont des moments de la lutte à mort entre les puissances impérialistes, grandes et petites, pour acquérir un contrôle sur le marché mondial. Le slogan de 'soutien aux peuples en lutte' n'est en fait qu'un appel à défendre une puissance impérialiste contre une autre, tous un verbiage nationaliste ou 'socialiste’ ". (Principes de base du CCI).
Cependant, même en admettant que la phase actuelle de décomposition du capitalisme accentue l'expression anarchique et chaotique des appétits impérialistes de chaque nation aussi petite soit-elle, et qu'une telle "libre expression" tende à échapper toujours plus au contrôle des grandes puissances, cette réalité n'élimine pas l'impérialisme, ni les guerres impérialistes localisées, de même qu'elle ne les rend pas moins meurtrières. Bien au contraire, cette réalité avive les tensions impérialistes, les radicalise et aggrave leurs capacités de destruction.
Ce que tout cela démontre, c'est une autre position de classe des révolutionnaires : tout capital national, aussi petit soit-il, est impérialiste, et ne peut survivre sans recourir à une politique impérialiste. Cette position, nous l'avons défendue avec le maximum de fermeté face aux spéculations dans le milieu révolutionnaire, exprimées particulièrement par la CWO, selon laquelle les capitaux nationaux ne seraient pas tous impérialistes, ce qui donne prise à toutes sortes d'ambiguïtés dangereuses ; entre autres celle 4e réduire l'impérialisme, en dernière instance, à une "superstructure" propre à un groupe restreint de superpuissances, ce qui entraîne, qu'on le veuille ou non, que "l'indépendance nationale" des autres nations pourrait avoir quelque chose de "positif ([4] [90]).
Ce que l'époque actuelle de décomposition du capitalisme rend manifeste, c'est que toute nation, toute petite nationalité, tout groupe de gangsters capitalistes, qu'il ait pour domaine privé le territoire gigantesque des USA ou un minuscule quartier de Beyrouth, est nécessairement impérialiste ; son objectif, son mode de vie, c'est la rapine et la destruction.
Si la décomposition du capitalisme et, en conséquence, l'expression chaotique et incontrôlée de la barbarie impérialiste, résulte de la difficulté du prolétariat à hisser sa lutte au niveau requis par son propre être -l'être d'une classe internationale et par conséquent révolutionnaire-, logiquement, tout appui au nationalisme, même déguisé en "tactique marxiste" (le fameux "appui aux petites nations pour déstabiliser l'impérialisme" des trotskistes), éloigne le prolétariat de sa voie révolutionnaire et alimente le pourrissement du capitalisme, sa décomposition jusqu'à la destruction de l'humanité.
La seule attaque réelle, radicale, contre l’impérialisme, c'est la lutte révolutionnaire internationale du prolétariat, sa lutte autonome comme classe, dégagée et clairement opposée à tout terrain nationaliste, interclassiste.
La fausse communauté nationale
L'actuel "printemps des peuples" est perçu par les anarchistes comme une "confirmation" de leurs positions. Cela correspond à leur idée de la "fédération" des peuples regroupés librement en petites communautés selon des affinités de langue, de territoire, etc., ainsi qu'à leur autre idée, "l'autogestion", c'est-à-dire la décomposition de l'appareil économique en petites unités, supposées être ainsi plus accessibles au peuple.
La barbarie anarchique et chaotique de l'explosion nationaliste à l'Est confirme le caractère radicalement réactionnaire des positions anarchistes.
La décomposition en cours de vastes parties du monde, plongées dans un chaos terrible, confirme que "l'autogestion" est une façon pseudo-radicale, "assembléiste", de s'adapter à cette décomposition, et donc de la nourrir.
Si le capitalisme a apporté quelque chose à l'humanité c'est la tendance à la centralisation des forces productives à l'échelle de la planète, avec la formation d'un marché mondial. Ce que révèle la décadence du capitalisme, c'est une incapacité à aller plus loin dans un tel processus de centralisation et sa tendance inévitable à la destruction, à la dislocation.
"La réalité du capitalisme décadent, malgré les antagonismes impérialistes qui le font apparaître momentanément comme deux unités monolithiques opposées, c'est la tendance à la dislocation et à la désintégration de ses composantes. La tendance du capitalisme décadent c'est le schisme, le chaos, d'où la nécessité essentielle du socialisme qui veut réaliser l'unité du monde." (Internationalisme : "Rapport sur la situation internationale", 1945)
Ce que la décomposition du capitalisme met en évidence avec acuité c'est le développement de tendances croissantes à la dislocation, au chaos, à l'anarchie toujours plus incontrôlable dans des segments entiers du marché mondial.
Si les grandes nations constituaient au siècle dernier des unités économiques cohérentes, elles sont aujourd'hui un cadre trop étroit, un obstacle réactionnaire pour tout développement réel des forces productives, une source de concurrence destructive et de guerres ; la dislocation en petites nations accentue encore plus fortement ces tendances vers la distorsion et le chaos de l'économie mondiale.
D'autre part, dans cette époque de décomposition du capitalisme, l'absence de perspective pour la société, l'évidence du caractère destructeur et réactionnaire de l'ordre social régnant, entraînent une terrible absence de valeurs, de points de repère, d'objectifs crédibles pouvant soutenir la vie des individus. Cela augmente encore les tendances, que l'anarchisme stimule avec son mot d'ordre de "petites communes fédérées", à rester attaché à toute sorte de fausses communautés -comme la communauté nationale-, qui procurent une sensation illusoire de sécurité, de "soutien collectif".
Bien entendu, la clientèle privilégiée de telles manipulations sont les classes moyennes, petites-bourgeoises, marginalisées qui, faute de perspective et de cohésion comme classe, ont besoin de la fausse garantie de la "communauté nationale".
"Ecrasées matériellement, sans aucun avenir devant elles, végétant dans un présent aux horizons complètement bouchés, piétinant dans une médiocrité quotidienne sans bornes, elles sont dans leur désespoir la proie facile à toutes les mystifications, des plus pacifiques (sectes religieuses, naturistes, anti-violence, anti-bombe atomique, hippies, écologistes, antinucléaire, etc.) aux plus sanglantes (Cent-noirs, pogromistes, racistes, Ku-Klux-Klan, bandes fascistes, gangsters et mercenaires de tout acabit, etc.). C'est surtout dans ces dernières, les plus sanglantes, qu'elles trouvent la compensation d'une dignité illusoire à leur déchéance réelle que le développement du capitalisme accroît de jour en jour. C'est l'héroïsme de la lâcheté, le courage des poltrons, la gloire de la médiocrité sordide."
(Revue Internationale n° 14 : "Terreur, terrorisme et violence de classe", p. 7).
Dans les tueries nationalistes, dans les affrontements interethniques qui secouent l'Est, on voit la marque de ces masses petites-bourgeoises, désespérées par une situation qu'elles ne peuvent améliorer, avilies par la barbarie de l'ancien régime dans lequel elles ont souvent assumé les tâches les plus basses, prenant le parti de forces politiques bourgeoises, ouvertement réactionnaires.
Mais ce poids de la "communauté nationale" comme fausse communauté, comme racine illusoire, pèse aussi sur le prolétariat. Dans les pays de l'Est, la faiblesse du prolétariat, sa terrible arriération politique, produit de la barbarie stalinienne, ont déterminé son absence comme classe autonome dans les événements qui ont entraîné la chute des régimes du "socialisme réel", et cette absence a donné encore plus de force à l'action irrationnelle et réactionnaire des couches petites-bourgeoises ce qui a à son tour augmenté la vulnérabilité du prolétariat.
Ce que la classe ouvrière doit affirmer contre les illusions réactionnaires du nationalisme, propagées par la petite-bourgeoisie, c'est que la "communauté nationale" est le masque qui recouvre la domination de chaque Etat capitaliste.
La nation n'est pas le domaine souverain de tous ceux qui sont "nés sur la même terre", mais la propriété privée de l'ensemble des capitalistes qui organisent à partir de là, et à travers l'Etat national, l'exploitation des travailleurs et la défense de leurs intérêts face à la concurrence sans merci des autres Etats capitalistes.
"Etat capitaliste et nation sont deux concepts indissociables subordonnés l'un à l'autre. La nation sans l'Etat est aussi impossible que l'Etat sans la nation. En effet, cette dernière est le milieu social nécessaire pour mobiliser toutes les classes autour des intérêts de la bourgeoisie luttant pour la conquête du monde, mais comme expression des positions de la classe dominante, la nation ne peut avoir d'autre axe que l'appareil d'oppression de celle-ci : l'Etat." (Bilan, n° 14 : "Le problème des minorités nationales", p. 474).
La culture, la langue, l'histoire, le territoire communs, que les intellectuels et les plumitifs à la solde de l'Etat national présentent comme "le fondement" de la "communauté nationale", sont le produit de siècles d'exploitation, le sceau marqué du sang et du feu grâce auquel la bourgeoisie est parvenue à se doter d'une zone privée sur le marché mondial. "Pour les marxistes il n'existe véritablement aucun critère suffisant pour indiquer où commence et où finit une nation, un peuple et le droit, pour des minorités nationales, à s'ériger en nations... Ni du point de vue de la raison, ni de l'histoire, le conglomérat que représentent les Etats nationaux bourgeois ou les groupes nationaux, ne se justifient. Deux faits seulement animent la charlatanerie académique sur le nationalisme : la langue et le territoire communs, et ces deux éléments ont varié continuellement à travers des guerres et des conquêtes. (Bilan, idem p. 473).
La fausse communauté nationale est le masque de l'exploitation capitaliste, l'alibi de tout capital national pour embarquer ses "citoyens" dans les crimes que sont les guerres impérialistes, la justification pour demander aux ouvriers d'accepter les licenciements, les coupes dans les salaires, etc., "parce que l'économie nationale ne peut pas faire autrement", le prétexte pour les embarquer dans la bataille de la "compétitivité" avec les autres capitalismes nationaux ce qui, avec la même force, les sépare et les monte contre leurs frères de classe des autres pays, les condamne à de nouveaux sacrifices encore plus durs, à la misère et au chômage.
La seule communauté qui soit progressiste aujourd'hui est l'unification autonome de toute la classe ouvrière. 'Tour que les peuples puissent réellement s'unifier, leurs intérêts doivent être communs. Pour que leurs intérêts soient réellement communs, il est nécessaire d'abolir les rapports de propriété actuels, car ceux-ci conditionnent l'exploitation des peuples entre eux; l'abolition des rapports de propriété actuels est de l'intérêt exclusif de la classe ouvrière. Elle est aussi la seule qui possède les moyens de le faire. La victoire de la classe ouvrière sur la bourgeoisie c'est, en même temps, la victoire sur les conflits nationaux et industriels qui opposent aujourd'hui les divers peuples entre eux." (Karl Marx: "Discours sur la Pologne", 1847).
La lutte du prolétariat contient en germe la suppression des divisions d'ordre national, ethnique, religieux, linguistique, avec lesquelles le capitalisme -continuant l'oeuvre oppressive des modes de production antérieurs-, a tourmenté l'humanité. Dans le corps commun de la lutte unie pour les intérêts de classe, ces divisions disparaissent de manière naturelle et logique. La base commune ce sont les conditions d'exploitation qui tendent à empirer partout avec la crise mondiale ; l'intérêt commun c'est l'affirmation de ses besoins en tant qu'êtres humains contre les besoins inhumains, toujours plus despotiques, de la marchandise et de l'intérêt national.
Le but du prolétariat, le communisme, c'est-à-dire la communauté humaine mondiale, représente une centralisation et une unité nouvelles de l'humanité, à la hauteur du niveau atteint par les forces productives, capables de leur donner le cadre qui permettra leur vrai développement et leur pleine expansion. C'est l'unité de la centralisation consciente, basée sur les intérêts communs, permise par l'abolition des classes, de l'exploitation salariée et des frontières nationales.
"La communauté apparente que les individus avaient jusqu'alors constituée, prit toujours une existence indépendante vis-à-vis d'eux et, en même temps, du fait qu'elle représentait l'union d'une classe face à une autre, elle représentait non seulement une communauté tout à fait illusoire pour la classe dominée, mais aussi une nouvelle chaîne. Dans la communauté réelle, les individus acquièrent leur liberté simultanément à leur association, grâce à cette association et en elle."
(Marx, Engels, L'idéologie allemande, lre partie, "Communisme", Editions Sociales).
Adalen, 16 mai 1990
[1] [91] Voir dans la Revue Internationale, n° 60, "Thèses sur la crise économique et politique dans les pays de l'Est".
[2] [92] Voir "La décomposition, phase ultime de la décadence capitaliste", dans ce numéro.
[3] [93] Voir "Les révolutionnaires face à la question nationale", Revue Internationale, n° 34 et 42.
[4] [94] Voir "Sur l’impérialisme", Revue Internationale, n° 19
Géographique:
- Europe [95]
- Russie, Caucase, Asie Centrale [2]
Questions théoriques:
- Décomposition [3]
Heritage de la Gauche Communiste:
La situation en Allemagne : Rapport sur la situation nationale de la section du CCI en Allemagne (mai 1990)
- 2705 reads
L'évolution des contradictions qui aujourd'hui se concentrent en Allemagne constitue une clé fondamentale de l'évolution de la situation mondiale. Nous publions ici un rapport de notre section dans ce pays qui en dégage la dynamique globale et les différentes hypothèses qu'elle ouvre.
Le
développement de l'économie allemande avant
l'union économique et monétaire
Alors qu'à la fin des années 1980, début des années 1990, l'économie mondiale rencontre des problèmes toujours plus grands, l'économie allemande est encore en plein boom. De nombreux records de production, en particulier dans le secteur automobile, ont été battus plusieurs années de suite. Un nouveau record a été atteint dans le surplus commercial en 1989. Le taux d'utilisation des capacités industrielles a atteint son plus haut point depuis le début des années 1970. Dans beaucoup de secteurs, le manque de main-d'oeuvre qualifiée a été le principal facteur empêchant l'expansion de la production, dans les derniers mois. De nombreuses entreprises ont dû refuser de nouvelles commandes à cause de cela.
Ce boom n'est pas l'expression de la santé de l'économie mondiale, mais de l'écrasante compétitivité du capital ouest-allemand, la loi de la survie du plus adapté. L'Allemagne s'est développée brutalement au détriment de ses concurrents, comme le montrent amplement ses excédents à l'exportation.
La position de l'Allemagne dans la compétition s'est notablement renforcée tout au long des années 1980. Au niveau économique, la tâche principale du gouvernement Kohl-Genscher a été de permettre une énorme augmentation des capitaux propres pour les grandes entreprises, afin de mettre en place une modernisation et une automatisation gigantesques du processus de production. Le résultat en a été une vague de "rationalisation" incroyable, comparable dans son étendue à celle qui a eu lieu en Allemagne dans les années 1920. Les axes principaux de cette politique étaient :
- plus de 100 milliards de marks économisés grâce à des réductions des dépenses sociales, et à peu près directement transférés dans les mains des capitalistes, via des réductions massives d'impôts ;
- une série de nouvelles lois qui ont été adoptées, autorisant les entreprises à accumuler d'énormes réserves complètement exonérées d'impôt - par exemple la création de compagnies d'assurance privées, à travers lesquelles les fonds d'investissement, en grande partie produit de gigantesques spéculations, s'accumulent.
Le résultat est qu'aujourd'hui, le grand capital "baigne dans l'argent". Tandis qu'au début des années 1980, environ 2/3 des investissements des plus grandes entreprises étaient financés par des emprunts bancaires, aujourd'hui, les 40 affaires les plus importantes sont capables de financer leurs investissements presque entièrement par leurs fonds propres - situation tout à fait unique en Europe.
En plus de ces moyens financiers, le gouvernement a considérablement accru le pouvoir des dirigeants d'entreprises sur leur force de travail : flexibilité, dérégulation, journée continue en échange d'une réduction minimum de la semaine de travail.
Il ne fait aucun doute que l'industrie allemande est profondément satisfaite du travail du gouvernement Kohl pendant les années 1980, à ce niveau. Au début de 1990, le porte-parole libéral des industriels, Lambsdorff, annonçait fièrement : "L'Allemagne de l'Ouest est aujourd'hui le leader mondial des pays industriels, et celle qui a le moins besoin de mesures protectionnistes ".
Par exemple, alors que tous les autres pays de la CEE ont pris des mesures protectionnistes radicales contre les importations de voitures japonaises, l'Allemagne a été capable de limiter le pourcentage japonais sur le marché allemand de l'automobile un peu au-dessus de 20 %, et en terme de valeur, elle exporte plus de voitures au Japon que le Japon n'en exporte en Allemagne.
Le plan de la bourgeoisie allemande pour les années 1990 avant l'effondrement de l'est
Malgré cette relative force, la vague de rationalisations des années 1980 était supposée n'être que le commencement. Face à une surproduction massive, à la perspective de la récession, à la banqueroute du tiers-monde et de l'Europe de l'est, il était clair que les années 1990 allaient être celles de la lutte pour la survie, et cela même pour les pays les plus industrialisés. Et cette survie ne pourrait se faire qu'aux dépens des autres rivaux industrialisés.
Face à ce défi, l'Allemagne de l'ouest est loin d'être aussi bien préparée qu'il peut paraître de prime abord.
- Le secteur de la production des moyens de production (machines, électronique, chimie) est terriblement fort. Dans la mesure ou l'Allemagne n'a jamais eu de marché colonial fermé, et où elle est un producteur classique de moyens de production, créant constamment sa propre concurrence, ce secteur a appris historiquement que la survie n'est possible qu'à la condition d'être toujours un pas en avance sur les autres.
- L'Allemagne a été, initialement, beaucoup plus lente que les USA, la Grande-Bretagne ou la France pour développer la production de masse de biens de consommation, et en particulier l'industrie automobile. Cela s'est fait essentiellement après la seconde guerre mondiale, avec l'ouverture du marché mondial aux exportations allemandes, tandis qu'en même temps l'Allemagne, tout comme le Japon, était exclue en grande partie du secteur militaire, ce qui lui a permis de rattraper son retard et de devenir un des leaders mondiaux dans l'automobile. Aujourd'hui, face à la surproduction absolue (on estime que l'industrie occidentale a, pour l'année 1990, une capacité de production excédentaire de 8 millions de voitures !) et, avec une concurrence internationale devenant de plus en plus intense dans ce domaine, la très grande dépendance de l'Allemagne vis-à-vis de l'industrie automobile (environ 1/3 des emplois industriels dépendent directement ou indirectement d'elle) ouvre aujourd'hui des perspectives réellement catastrophiques pour l'économie allemande.
- Le principal domaine dans lequel l'Allemagne a souffert de la défaite dans la deuxième guerre mondiale, c'est le secteur de la haute technologie, qui a été développé historiquement en lien avec le secteur militaire, et dont l'Allemagne a été largement exclue. Le résultat c'est qu'aujourd'hui, malgré son appareil productif hautement moderne, l'Allemagne a un retard massif vis-à-vis des USA mais aussi du Japon dans ce domaine.
La perspective des années 1990 était, par conséquent, de réduire radicalement la dépendance de l'économie allemande à l'égard de l'industrie automobile, non pas en abandonnant volontairement des parts de marché, bien sûr, mais en développant fortement le secteur de la haute technologie. En fait la bourgeoisie allemande est convaincue que dans les années 1990, soit elle fera une percée parmi les nations leaders de la haute technologie aux côtés des USA et du Japon, soit elle disparaîtra complètement comme puissance industrielle majeure indépendante. Cette lutte à mort a été préparée pendant les années 1980, non seulement par la rationalisation et l'accumulation d'énormes investissements, mais aussi par la constitution symbolique de la plus grande entreprise européenne de haute technologie, sous la direction de Daimler- Benz et de la Deutsche Bank. Daimler et Siemens sont supposés être les fers de lance de cette offensive. Cette tentative de l'industrie allemande vers l'hégémonie mondiale dans les années 1990 requiert :
- des investissements absolument gigantesques, laissant ceux des années 1980 loin derrière, et impliquant un transfert encore plus massif de revenus de la classe ouvrière vers la bourgeoisie ;
- l'existence d'une stabilité politique à la fois internationale ment (discipline du bloc US) et à l'intérieur, en particulier vis-à-vis de la classe ouvrière.
Effondrement de l'Est : les buts de guerre allemands finalement atteints.
Après la chute du mur de Berlin, le monde impérialiste a tremblé à la pensée d'une Allemagne unifiée plus grande. Non seulement à l'étranger, mais en Allemagne même, le SPD (social-démocratie), les syndicats, l'église, les médias, tous ont mis en garde contre un nouveau revanchisme allemand, danger apparemment présent avec les ambiguïtés de Kohl sur la frontière Oder-Neisse. De telles visions d'une nouvelle Allemagne mettant en cause les frontières de ses voisins, dans les traces d'Adolf Hitler, n'inquiètent pas vraiment la bourgeoisie allemande. En fait, ces mises en garde ne servent qu'à masquer l'état réel des affaires : à savoir qu'avec la course à l'Europe 92 et l'effondrement du bloc de l'Est, la bourgeoisie allemande a déjà atteint les objectifs qui ont été la cause de deux guerres mondiales. Aujourd'hui, la bourgeoisie allemande triomphante n'a absolument pas besoin de remettre en question une frontière quelconque pour être la puissance dominante en Europe. L'établissement d'une "Grossraumwirtschaft" (zone étendue d'économie et d'échange) dominée par l'Allemagne, en Europe de l'Ouest, et d'un réservoir de main-d'oeuvre bon marché et de matières premières en Europe de l'Est, lui aussi dominé par l'Allemagne, objectifs de l'impérialisme allemand, déjà formulés avant 1914, sont aujourd'hui pratiquement une réalité. C'est pourquoi tout le tapage autour de la frontière Oder-Neisse, ne sert en fait qu'à cacher la réelle victoire de l'impérialisme allemand aujourd'hui en Europe.
Mais une chose doit être claire: cette victoire de l'impérialisme allemand, dont le ministre libéral des affaires étrangères Genscher (et non les extrémistes de droite) est le meilleur représentant, n'implique pas que l'Allemagne puisse aujourd'hui dominer l'Europe de la façon dont Hitler envisageait de le faire. Il n'y a pas actuellement, de bloc européen constitué, et dirigé par l'Allemagne. Alors que dans les lre et 2e guerres mondiales, l'Allemagne se croyait assez forte pour dominer l'Europe de façon dictatoriale, cette illusion est impossible aujourd'hui. Alors qu'à l'époque, l'Allemagne était le seul pays industriel important sur le contiennent européen (sans compter la Grande-Bretagne), ce n'est plus le cas aujourd'hui (France, Italie). L'unification allemande ne fera passer que de 21 % à 24 % le pourcentage de l'Allemagne dans la production de la CEE. Qui plus est, alors que la tentative allemande de domination de l'Europe, dans les lre et 2e guerres mondiales, n'était possible qu'avec l'isolationnisme des USA, aujourd'hui l'impérialisme US est massivement et immédiatement présent sur le vieux continent et sera très attentif à prévenir l'émergence de telles ambitions. Enfin, l'Allemagne est aujourd'hui trop faible militairement et ne possède pas d'armes de destruction massive. Pour toutes ces raisons, la formation d'un bloc européen n'est possible, dans les conditions présentes, que s'il y a une puissance assez forte pour soumettre toutes les autres. Ce n'est pas le cas aujourd'hui.
La victoire de l'Allemagne : victoire a la Pyrrhus
A la différence des années 1930, l'Allemagne d'aujourd'hui n'est pas la "nation prolétarienne" (formulation du KPD dans les années 1920 !), exclue du marché mondial et poussée à renverser les frontières tout autour d'elle. Aussi longtemps qu'elle n'est pas coupée du marché mondial et des fournitures de matières premières, la bourgeoisie allemande n'a absolument aucune ambition ni aucun intérêt à former un bloc militaire en opposition aux USA. En fait l'Allemagne aujourd'hui est, dans un certain sens, plutôt une puissance "conservatrice" qui a "obtenu ce qu'elle voulait" et qui est plus préoccupée de ne pas "perdre ce qu'elle a". Et c'est vrai : l'Allemagne est une puissance qui a tout à perdre dans le chaos et la décomposition actuels. Son souci principal aujourd'hui est d'éviter que sa victoire ne se transforme en catastrophe - une catastrophe qui est très probable.
Les coûts de l'unification
Ces coûts sont si gigantesques qu'ils mettent en danger la santé des finances de l'Etat, et la position immédiate de l'Allemagne dans la concurrence internationale. Il est plus que probable que les capitaux, qui vont être utilisés pour l'unification, sont ceux-là mêmes qui étaient prévus pour financer la fameuse percée sur le marché de la haute technologie, pour rejoindre les USA et le Japon. En d'autres termes, l'unification, loin d'être un renforcement à ce niveau, pourrait être, pour la bourgeoisie allemande, le facteur même de la destruction de ses espoirs de rester une des puissances industrielles dominantes dans le monde.
Les coûts de l'Europe de l'Est
De la même manière qu'elle essaiera d'ériger un nouveau "mur de Berlin" le long de la ligne "Oder-Neisse" pour contenir le chaos de l'Est, il est certain que l'Allemagne sera obligée d'investir dans les pays limitrophes afin de créer une sorte de "cordon sanitaire" contre la totale anarchie se développant plus à l'Est. Bien sûr, l'Allemagne va dominer et domine déjà les marchés de l'Europe de l'Est. Cependant, il est intéressant de noter que la bourgeoisie allemande, loin d'être triomphante à ce propos, lance aujourd'hui un cri d'alarme à propos des dangers que cela implique :
- danger que l'obligation d'investir à l'Est n'entraîne en permanence des pertes de marchés à l'Ouest, alors que ceux-ci sont beaucoup plus importants dans la mesure où ils paient comptant et sont beaucoup plus solvables ;
- danger d'une baisse de niveau technique de l'industrie allemande, dans la mesure où les marchandises que l'Europe de l'Est commandera seront plus simples et rudimentaires que celles exigées par le marché mondial.
Les coûts de la rupture du bloc US
Cela présente le danger, à long terme, de la désagrégation du marché mondial, jusqu'alors tenu par la discipline du bloc et surveillé militairement par les USA. Une telle éventualité serait un désastre pour l'Allemagne de l'ouest, en tant que nation leader à l'exportation, et en tant que puissance ayant été, avec le Japon la principale bénéficiaire industrielle de l'ordre d'après-guerre.
Les coûts de tout affaiblissement du Marché commun européen
Le marché européen, et surtout le projet de l'Europe 92, sont menacés aujourd'hui par la montée du "chacun pour soi", par la volonté d'éviter le partage des coûts liés à l'Europe de l'Est, par les réactions françaises à la perte du leadership conjoint avec l'Allemagne de l'ouest en Europe occidentale, leadership qui sera maintenant assuré par la seule Allemagne.
Si l'Europe de 92 (ce par quoi nous entendons l'établissement de normes pour la "libéralisation" des échanges, de règles pour régir la bataille de tous contre tous, favorisant toujours les plus forts, et non les irréalisables "Etats-Unis d'Europe") devait échouer, et si le marché européen devait se rompre, ce serait une catastrophe totale pour l'Allemagne de l'Ouest, dans la mesure où c'est là que se trouvent ses principaux marchés d'exportation. C'est donc une formulation incorrecte, souvent utilisée par la presse bourgeoise, de dire que Bonn, en menant la réunification rapidement, a mis en avant ses propres intérêts contre ceux de la CEE'. L'intérêt particulier de Bonn, c'est la CEE. Elle a été obligée de faire l'unification immédiatement du fait de l'incroyable accélération du chaos.
L'effondrement de l'Union Soviétique
Aussi longtemps que l'URSS tenait encore debout, l'Europe de l'Est était, d'une part, un territoire ennemi et une menace militaire pour l'Allemagne de l'ouest, mais d'autre part une garantie de voisinage stable à la frontière est de l'Allemagne. Le terrible chaos qui se développe aujourd'hui en URSS est une préoccupation majeure pour les USA, et extrêmement inquiétant pour la France et la Grande-Bretagne. Mais pour la bourgeoisie allemande, qui est juste à côté, c'est une vision de cauchemar absolu. Dans la nouvelle Allemagne unifiée, il n'y aura que la Pologne pour la séparer de l'URSS. Le Ministère des affaires étrangères de Genscher est hanté par la vision d'horreur de guerres civiles sanglantes, de monceaux d'armements et de centrales nucléaires explosant, de millions de réfugiés d'Union Soviétique déferlant à l'Ouest, menaçant de détruire complètement la stabilité politique de l'Allemagne. Mais si ce "scénario du pire" doit être évité, la bourgeoisie allemande devra accepter une responsabilité importante dans la tentative de limiter l'anarchie en Union Soviétique, ce qui représentera aussi une énorme charge économique. Par exemple : le gouvernement ouest-allemand s'est engagé à respecter et honorer tous les engagements de livraison passés entre l'Allemagne de l'est et l'Union Soviétique, promesse qui est d'inspiration politique et qui ne sera tenue qu'à contre-coeur. De la même manière que la rupture de la CEE signifierait l'annulation de la victoire des buts de guerre de l'impérialisme allemand (Grossraumwirtschaft), le déclenchement d'une totale anarchie en Union Soviétique détruirait le second plan, celui d'une Europe de l'est fournisseuse de matières premières bon marché. Ce serait pour le moins tragique pour le capitalisme allemand, dans la mesure où l'Union Soviétique est le seul réservoir disponible de matières premières qui ne viennent pas d'outre-mer, et ne dépend donc pas du bon vouloir des USA. Un exemple des effets de l'anarchie de l'Est sur les ambitions de l'impérialisme allemand : un des projets favoris de Gorbatchev est la création d'une zone industrielle exonérée d'impôts à Kaliningrad, qui est supposée devenir la nouvelle fenêtre de la Russie sur l'Ouest. Il a l'intention de transférer des Allemands de la Volga dans cette zone de l’ex-ville allemande de Königsberg, comme mesure incitatrice supplémentaire pour drainer les capitaux allemands. Kaliningrad est ainsi censée être une fenêtre allemande sur l'Est, c'est-à-dire sur une "voie sûre" pour les matières premières sibériennes, évitant les républiques asiatiques d'Union Soviétique. Aujourd'hui, le séparatisme et le mini-impérialisme des républiques de la Baltique sèment la pagaille dans ces plans. Landbergis a déjà laissé les Lituaniens revendiquer Kaliningrad.
Les mesures de la bourgeoisie allemande contre le chaos et la décomposition
Au vu de l'effrayante accélération de la crise, des guerres économiques, de la décomposition, de l'effondrement de l'Est, il y a un réel danger :
- que le combat de la bourgeoisie allemande en vue de se frayer un passage dans la lutte pour l'hégémonie sur le marché mondial contre les USA et le Japon, ait lieu dans des conditions beaucoup moins favorables ;
- que l'Allemagne perde complètement sa place privilégiée de "surfer" sur la vague de la crise au détriment de ses rivaux. Au contraire, le danger est réel que la position de l'Allemagne devienne même particulièrement fragile, comme c'était le cas dans les années 1930, mais cette fois face à une classe ouvrière non défaite ;
- que la fameuse stabilité politique allemande puisse être ruinée par la décomposition et le chaos mondiaux.
La tendance à la ruine économique totale et au chaos complet est historiquement irréversible. Néanmoins, toute tendance a des contre-tendances, qui dans ce cas n'arrêteront pas, mais pourront ralentir ou de toute façon influencer, le cours de ce mouvement à certains moments, ce qui fait qu'il ne se développera pas de la même manière dans tous les pays. En particulier, il est nécessaire d'examiner les mesures que la bourgeoisie allemande est en train de prendre pour se protéger. La bourgeoisie allemande n'est pas seulement la plus puissante en Europe au plan économique, et l'une des plus riches d'amères expériences, mais elle a aussi les structures politiques et étatiques les plus modernes (par exemple, la modernité politique de l'Etat allemand en comparaison du britannique est aussi marquée que leur différence au niveau économique). La bourgeoisie allemande a été capable de combiner ses "qualités traditionnelles" et tout ce qu'elle a appris de son mentor américain à la fin des années 1940 (l'Allemagne de l'ouest est dans beaucoup de domaines, sans aucun doute, le plus "américanisé" des pays européens).
Faire l'unification au meilleur coût
A travers l'union monétaire, Bonn envisage de donner aux Allemands de l'est de l'argent de l'Ouest, mais aussi peu que possible, et par là d'avoir la justification politique pour arrêter leur venue à l'Ouest. Le but est de faire porter, le plus possible, la charge de l'unification à la RDA elle-même, à la CEE, et surtout (nous reviendrons sur ce point), à la classe ouvrière de l'Est et de l'Ouest. Par ailleurs, la bourgeoisie ouest-allemande s'efforce de conserver exclusivement pour elle les aspects bénéfiques de cette unification, c'est-à-dire, des sources de force de travail incroyablement bon marché grâce auxquelles elle pourra aussi exercer des pressions sur les salaires de l'Ouest, ou l'accès aux matières premières soviétiques et à la technologie spatiale par les liens historiques avec les entreprises est-allemandes.
Eviter la désagrégation de la CEE
S'il y a une tendance dans cette direction, il y a aussi d'importantes contre-tendances. Parmi ces contre-tendances :
- l'intérêt impérieux de l'Allemagne elle-même d'éviter cela ;
- l'intérêt des autres pays européens qui sont terrifiés par le risque d'être dépassés par le Japon. Même s'il est vrai que la tendance est aujourd'hui au "chacun pour soi", les gangsters tendent malgré tout à se regrouper pour affronter d'autres gangsters.
L'Europe 92 n'est pas un nouveau bloc contre les USA. Et elle n'a probablement aucune chance de le devenir si les Américains décident de la saboter. Bonn est actuellement en train d'essayer de convaincre Washington que l'Europe 92 est essentiellement dirigée contre le Japon, et non contre les USA. La bourgeoisie ouest-allemande est convaincue que l'une des bases principales de la terrible compétitivité japonaise sur le marché mondial, est la fermeture complète du marché intérieur japonais, et que les prix élevés à l'intérieur du Japon financent leur dumping sur le marché mondial. Bonn proclame que si le Japon est contraint, par des mesures protectionnistes, de construire des usines en Europe, celles-ci ne sont pas plus compétitives que les européennes, ou au moins que les allemandes. Le message est clair : si l'Europe 92 peut servir à obliger le Japon à ouvrir son marché intérieur, il est possible de vaincre le géant asiatique. De plus, Bonn souligne sans cesse que le marché européen, qui sera alors le plus grand marché unifié du monde, est le seul moyen grâce auquel les USA peuvent combler leur gigantesque déficit commercial, c'est-à-dire que Bonn propose un partage germano-américain du marché européen.
Avant les 1e et 2e guerres mondiales, les marxistes ont alerté la classe ouvrière à propos des massacres à venir, et ont exprimé quelle attitude le prolétariat devrait prendre à ce propos. Aujourd'hui, notre tâche est d'alerter les ouvriers contre la guerre mondiale commerciale qui vient de se déclencher à une échelle sans précédent dans l'histoire, et de les armer contre le danger mortel du nationalisme économique, c'est-à-dire de prendre partie pour leur propre bourgeoisie. Le coût de cette guerre pour la classe ouvrière sera réellement horrible.
L’unification allemande et la possibilité d'une brutale récession
Jusqu'à maintenant nous avons montré les énormes implications du chaos et de la décomposition actuels pour le capital allemand dans la perspective des années 1990. Mais il y a aussi une perspective immédiate, celle des effets de l'union économique et monétaire notamment. Ces effets vont être catastrophiques en particulier pour la classe ouvrière, et spécialement celle de RDA.
Il est difficile de prédire l'issue immédiate de cette affaire, dans la mesure ou c'est une situation inédite dans l'histoire. Mais il y a une possibilité que cela puisse freiner temporairement la tendance de l'économie mondiale à la récession ouverte, au prix de la ruine des finances d'Etat de l'Allemagne, et en aiguisant encore plus les contradictions globales. L'autre possibilité que nous ne devons pas exclure, au vu de la grande fragilité de la conjoncture économique mondiale actuelle, est que les désordres monétaires et des taux d'intérêt, la panique de l'investissement et des bourses qui pourraient survenir soient la goutte d'eau qui fait déborder le vase, plongeant l'économie mondiale dans la récession ouverte.
Ce qu'on peut avancer avec certitude, c'est que l'arrivée du Deutsche Mark en Allemagne de l'est va provoquer des millions de licenciements et une explosion de paupérisation de masse qui, dans leur soudaineté et leur brutalité, seront, peut-être, sans précédent dans un pays industrialisé dans l'histoire du capitalisme, en dehors d'une période de guerre. Il est vrai également que le coût incalculable de ces mesures drastiques ne peut être assuré sans pressurer les ouvriers d'Allemagne de l'ouest... Les systèmes de chômage et de sécurité sociale de l'Ouest, par exemple, vont être amenés au bord de l'insolvabilité, dans la mesure où il leur faudra financer ce qui se passe à l'Est. Qui plus est, il n'y a absolument aucune garantie que le principal but politique immédiat de l'union monétaire - éviter la venue des Allemands de l'Est à l'Ouest - soit un succès. Et encore, le dilemme de la bourgeoisie ouest-allemande face à un monde capitaliste qui s'effondre est mis en évidence par le fait que les effets économiques de la non-réalisation immédiate de l'unification seraient certainement encore plus désastreux. Lambsdorff ne plaisantait pas quand il déclarait récemment que si des élections ne se tenaient pas rapidement dans toute l'Allemagne, non seulement l'Allemagne de l'est mais aussi celle de l'ouest se trouveraient bientôt en faillite. (Il faisait référence à la survivance de la bourgeoisie stalinienne d'Allemagne de l'est, qui rêve maintenant de continuer ses 40 ans de mauvaise gestion, mais cette fois directement financée par l'Ouest).
Le désarroi de la bourgeoisie après la chute du mur
Quand le mur est tombé, la bourgeoisie s'est trouvée déroutée, surprise et divisée. Il y a eu un enchaînement de crises politiques :
- Genscher appuyait, de façon originale, l'appartenance rapide mais séparée de la RDA à la CEE, avec seulement des liens fédératifs avec l'Allemagne de l'ouest ;
- Brandt devait se battre en coulisses pour amener le SPD sur la position de la réunification ;
- une coalition régionale et communale SPD-CDU a été nécessaire pour obliger Kohl à mettre un terme aux lois incitant l'émigration de l'Est, lois utiles pendant la guerre froide, mais conduisant aujourd'hui au désastre ;
- Bonn a été obligé de supporter à la fois les gouvernements de Krenz et de Modrow, aussi longtemps que le vide du pouvoir ne pouvait être comblé ;
- Bonn a dû changer sa politique initiale d'aide économique hésitante, pour celle de l'union monétaire immédiate et de l'unification accélérée ;
- la lutte de l'appareil d'Etat stalinien de RDA pour une place dans la nouvelle Allemagne a causé une série de crises, depuis l'aggravation de l'immigration vers l'Ouest, jusqu'aux chantages sur des leaders politiques (pas seulement de l'Est) exercés par la Stasi (police d'Etat-Staatssicherheit) ;
- les manoeuvres de Kohl sur la frontière Oder-Neisse ont causé des crises internes et des scandales internationaux.
Offensive de stabilisation vers l'unité nationale
Le premier axe de l'offensive de restabilisation a été le rétablissement de l'unité des courants bourgeois dominants. En dépit de tous les conflits et du chaos, très rapidement le sentiment s'est développé que cette sorte de crise historique nécessitait un certain type d'unité nationale. Aujourd'hui il y a un réel accord entre la CDU, le FDP et le SPD sur les problèmes fondamentaux soulevés par l'ouverture du mur : unification rapide, union monétaire immédiate (soutenue politiquement, même par la Bundesbank, bien qu'elle la considère comme suicidaire au plan économique), politique anti-immigration à l'égard de l'Est, maintien au sein de POTAN (qui sera étendue par étapes à la RDA), reconnaissance de la frontière Oder-Neisse.
Deuxième phase d'instabilité : la digestion de la RDA
L'autre axe de la "stabilisation" ne fait que déplacer le chaos d'un niveau à un autre. L'unification précipitée n'est pas possible sans un certain niveau de chaos. Elle provoque des conflits avec les grandes puissances et menace de déstabiliser encore plus l'URSS. Et l'union monétaire est une des politiques les plus aventuristes de l'histoire humaine, peut-être comparable à l'offensive "Barberousse" de Hitler contre la Russie. Le massacre économique de l'industrie de la RDA va être si sanglant, le chômage massif si élevé (certains parlent de 4 millions de chômeurs), que cela pourrait même manquer totalement son but immédiat - celui de stopper l'immigration massive vers l'Ouest. Le remède contre le chaos mènera probablement... au chaos.
Malgré l'opposition directe, en particulier des "grandes puissances" européennes, à la perspective de l'unification immédiate de l'Allemagne après l'ouverture du mur de Berlin, ce processus a aussi été accéléré dans le même temps, en particulier avec le soutien des Etats-Unis (dont la formule de l'appartenance d'une Allemagne unie à l'OTAN sert surtout à maintenir la présence américaine en Allemagne et en Europe, aux dépens non seulement de l'Allemagne, mais aussi de la Grande-Bretagne, de la France, et de l'URSS), et même au risque d'une plus grande déstabilisation du régime de Gorbatchev et de l'URSS. Deux raisons à cela :
- toutes les puissances majeures sont effrayées par le vide créé en Europe centrale, vide que seule l'Allemagne peut combler ;
- c'est l'effondrement de l'URSS qui fait automatiquement de l'Allemagne la puissance dirigeante de l'Europe, qui amène la disparition de l'impératif, pour Bonn, de partager la direction de l'Europe de l'ouest avec Paris, etc. Au contraire, il est peu probable, et pas prouvé, que l'actuelle unification allemande conduise au renforcement de l'Allemagne comme puissance majeure. Economiquement, l'unification est à coup sûr un affaiblissement, et tous les avantages stratégico-militaires seront probablement plus que contrebalancés par les effets du chaos de l'Est. C'est la compréhension du fait que l'unification ne signifie pas du tout automatiquement un renforcement de l'Allemagne qui a permis de la rendre acceptable pour ses "alliés".
Chronologiquement parlant :
- Après l'ouverture du mur, il y a eu une explosion nationaliste au sein de la bourgeoisie allemande, de Kohl à Brandt. "Nous autres, Allemands, sommes les meilleurs" etc., en dépit des mises en garde immédiates des plus modérées (par exemple Lafontaine). La panique, l'effroi et la jalousie parmi les "alliés" a été symbolisée par l'opposition ouverte à l'unification, et la visite-éclair de Mitterrand à Berlin-Est et Budapest, pour s'assurer que la France aurait un morceau de ce gâteau, était typique.
- La bourgeoisie s'est réveillée de ses stupides illusions. Plus Bonn réalise clairement que "le gâteau est empoisonné", plus la bourgeoisie allemande est obligée de le manger rapidement, du fait du développement du chaos. Maintenant c'est Bonn qui panique et qui est rendue furieuse par la nouvelle attitude des alliés, qui laissent l'Allemagne de l'ouest seule avec les problèmes et surtout avec le coût de cette pagaille.
- Bonn a réussi à convaincre les autres qu'elle ne peut pas se charger seule du problème et que s'ils ne participent pas activement, le résultat pourrait être la déstabilisation de toute l'Europe de l'ouest.
Les élections à venir ; une tentative de mettre en place des structures de stabilisation
En novembre 1989, nous avions noté que dans la nouvelle situation, la présence du SPD dans l'opposition, afin de mieux contrôler la classe ouvrière, n'est plus une obligation pour la bourgeoisie, du fait du recul de la conscience de classe provoquée par les événements à l'Est, et que la continuation du gouvernement Kohl-Genscher dépend du dépassement de leurs divergences. A présent, il semble que de telles divergences ne seront plus au coeur des élections (hormis l'extension de la stabilité, c'est-à-dire l'application des structures politiques de l'Allemagne de l'ouest à la RDA). La CDU reste légèrement plus forte que le SPD dans une Allemagne unie, le FDP reste le "faiseur de coalition", les "Républicains" sont maintenus hors du Parlement. Il n'y a pas de raison de penser qu'un gouvernement dirigé par Lafontaine serait fondamentalement différent de l'actuel.
Un problème qui se pose est celui des tensions et des confusions au sein de l'appareil politique :
- rivalités entre CDU et CSU concernant l'influence en RDA;
- rivalités entre le SPD et les staliniens pour le contrôle des syndicats en RDA ;
- divergences aiguës au sein des Verts sur l'unification ;
- désorientation chez les gauchistes, dont la plupart s'accrochent à l'Etat de RDA et au PDS (ex-SED) dont personne ne veut plus, ni à l'Est (à part les principaux fonctionnaires staliniens), ni à l'Ouest.
Aussi importantes que soient les tentatives de stabilisation, de nouvelles vagues d'anarchie sont déjà à l'horizon :
- l'effondrement définitif de l'URSS ;
- la crise économique mondiale (après l'URSS, les USA sont probablement le prochain gros bateau qui va faire naufrage) ;
- les tensions au sein de l'OTAN.
Lutte de classes : la combativité de la classe reste intacte
Il est évident que l'Allemagne n'est pas une exception dans le reflux, en particulier de la conscience, au sein de la classe ouvrière. Au contraire :
- le reflux a commencé en Allemagne plus tôt qu'ailleurs, dès 1988-89, et déjà, essentiellement, du fait de la situation à l'Est:
- les propositions de réductions d'armement par Moscou ont provoqué des illusions réformistes à propos d'un capitalisme plus pacifique ;
- l'afflux, en provenance de l'Est, de près d'un million de personnes par an ;
- l'énorme battage à propos de la "faillite du communisme", dès les massacres de Pékin ;
- un impact plus profond, du fait de la proximité de l'Est, des illusions démocratiques, réformistes, pacifistes, et inter-classistes qui y sont encore plus importantes que partout ailleurs. Les questions de l'unification des luttes et de la contestation des syndicats, bien qu'elles aient déjà été posées par les luttes à Krupp en décembre 1987, étaient par avance posées moins fortement qu'ailleurs, et elles sont donc aujourd'hui plus affaiblies.
D'autre part, la combativité, après avoir souffert d'une paralysie momentanée sous l'impact de l'immigration de l'Est, au lieu de reculer encore, après l'ouverture du mur, comme on aurait pu s'y attendre, a réellement commencé à reprendre (comme l'ont montré récemment les débrayages symboliques pendant les négociations syndicales). L'absence du moindre indice, pour le moment, indiquant que les ouvriers d'Allemagne de l'ouest soient prêts à de quelconques sacrifices matériels pour l'unification, est le problème central de la bourgeoisie. Cette idée même semble chasser les derniers vestiges de patriotisme de la tête de nombreux ouvriers
Crise et unification : bilan des années 1980
La crise joue un rôle essentiel pour l'unification, même quand la bourgeoisie parvient à éviter la concrétisation de cette dernière dans les luttes. L'apparition, au début des années 1980, du chômage de masse, de la "nouvelle pauvreté" au milieu de ces années, et de la dramatique crise du logement datant de l'après-guerre, et se révélant à la fin de ces années, tout cela a puissamment accru le potentiel de l'unification. Mais ce développement est contradictoire et non-linéaire.
L'offensive de modernisation des années 1980, l'attaque la plus forte en Allemagne depuis les années 1920, a partiellement transformé le monde du travail. L'ouvrier industriel moderne, contrôlant souvent plusieurs machines à la fois, est confronté à de telles exigences meurtrières, en énergie, en concentration, en qualification et requalification permanente, etc., qu'une part croissante de la population est automatiquement exclue du processus de production (trop vieux, trop malade, pas assez fort mentalement pour supporter la pression, pas assez qualifié, etc.).
Cela explique en grande partie le paradoxe d'avoir, d'un côté, le chômage de masse, et simultanément des centaines et des milliers d'emplois vacants dans les secteurs qualifiés. L'anarchie est totale. Des millions d'ouvriers sont au chômage, pas seulement parce qu'il n'y a pas d'emplois, mais aussi parce qu'ils ne peuvent pas répondre aux incroyables exigences actuelles. Cette masse toujours croissante n'est plus utile au capital comme moyen de pression sur les salaires et sur ceux qui ont encore un emploi, il n'y a donc pas de raison économique de les garder en vie. Aussi, les mesures les plus radicales ont été appliquées dans ce secteur ; c'est pourquoi, dans les années 1980, Bonn a arrêté la construction de logements sociaux.
Les effets immédiats de l'offensive de rationalisation-modernisation du capital allemand n'ont pas eu que des effets positifs sur l'unification des luttes. Ils ont aussi impliqué une certaine tendance à diviser les ouvriers entre :
- ceux qui peuvent encore répondre aux impératifs actuels de la production, et qui, malgré le contrôle des salaires, ont plus de revenus aujourd'hui qu'il y a cinq ans, du fait des heures supplémentaires innombrables (cela vaut probablement pour la majorité des ouvriers). Ceux-là pensent que, du fait du manque actuel de main-d'oeuvre qualifiée, le capital a besoin d'eux: ce qui favorise les illusions individualistes et corporatistes ("nous sommes assez forts tous seuls" ;
- ceux qui ne peuvent pas répondre à ces impératifs, qui sont sans cesse plus marginalisés et exclus de la production, qui tombent dans une pauvreté croissante, et sont souvent les premières victimes de la décomposition sociale (désespoir, drogues, explosions de violence aveugle ; par exemple Kreuzberg à Berlin), et qui se sentent isolés du reste de leur classe. En rapport avec cela (mais non identique), nous devons voir l'échec des luttes de chômeurs, et de leur lien avec les ouvriers actifs.
La crise et l'unification en perspective
Parmi les effets les plus immédiats du changement historique, il y a :
- les illusions sur un boom durant des années, du fait de :
. l'Europe de l'est,
. l'Europe 92,
. une "prime de paix", liée à une réduction radicale des dépenses militaires.
- la peur d'un nouvel appauvrissement, à cause de l'unification, cela n'ayant pas seulement des effets de radicalisation, mais aussi des tendances à la division de la classe (Ouest contre Est) ; ([1] [96])
- l'union monétaire doublera en fin de compte le nombre des chômeurs en Allemagne ;
- un véritable massacre d'emplois semble inévitable dans les secteurs où la surproduction est la plus importante, en particulier dans l'automobile ;
- le coût des années 1990, les énormes programmes d'investissement, l'annulation des dettes impayables de pays de la périphérie, etc., tout cela exigera des transferts de richesse encore plus importants du prolétariat vers le capital ;
- si la "rationalisation" continue au rythme actuel, vers le milieu des années 1990, des millions d'ouvriers seront confrontés à l'épuisement total et à une usure complète avant l'âge de 40 ans. Des forces essentielles de la classe seraient menacées.
Les principales difficultés pour l'unification politique de la classe
Le renforcement de la social-démocratie, des syndicats, de l'idéologie réformiste, du pacifisme, de l'inter-classisme, cela ne peut être dépassé facilement, ni rapidement ou automatiquement, mais requiert :
- l'engagement dans des luttes répétées ;
- la mobilisation et la discussion collectives ;
- l'intervention communiste.
Les leçons des 20 dernières années de crise et de luttes n'ont pas disparu, mais ont été rendues moins accessibles, enfouies sous un amas de confusions. Il n'y a pas de place pour la complaisance, le trésor doit être ramené à la surface, sinon la classe échouera dans sa tâche historique.
LE RETARD DU PROLETARIAT DE RDA
Bien que la RDA ait fait partie de l'Allemagne jusqu'en 1945, les effets du stalinisme ont été profondément catastrophiques pour la classe ouvrière. Il y a un retard fondamental qui va plus loin encore que le manque d'expérience sur la démocratie, les syndicats "libres", la haine virulente du "communisme". L'isolement derrière le mur a conduit les ouvriers à une véritable provincialisation. L'"économie de pénurie" les a amenés à voir les étrangers comme des ennemis qui "achètent tout et nous laissent sans rien". L'"internationalisme" soviétique et l'isolement du marché mondial ont encouragé un puissant nationalisme. Alors qu'en Allemagne de l'ouest un ouvrier sur dix, peut-être, est raciste, en RDA un sur dix n'est pas raciste. L'économie de commandement a conduit à une perte de dynamisme et d'initiative, à l'apathie et à la passivité, à l'incessante "attente des ordres", à une certaine servilité (pas même atténuée par un marché noir florissant, comme en Pologne). Et le retard technique : la plupart des ouvriers n'ont même pas l'habitude d'utiliser le téléphone. Le stalinisme laisse la classe profondément divisée par le nationalisme, les questions ethniques, les conflits religieux, la délation (probablement un ouvrier sur cinq informait régulièrement la Stasi sur ses collègues).
Nous pouvons nous réjouir de ce que, quand l'Allemagne a été divisée après la guerre, 63 millions de personnes se soient trouvées à l'Ouest et seulement 17 millions à l'Est, et pas l'inverse.
Le rôle crucial des ouvriers de l'Ouest ; l'alternative historique est encore ouverte
L'immense vague nationaliste réactionnaire venue de l'Est s'est brisée, jusqu'à maintenant, sur le rocher du prolétariat d'Allemagne de l'ouest. Nous n'entendons pas dire par là, que la contre-révolution a obtenu, à l'Est, une victoire irréversible. Mais s'il est encore possible qu'ils participent à des mouvements révolutionnaires dans le futur, c'est parce que les ouvriers de l'Ouest n'ont pas été entraînés sur le même terrain bourgeois qui, à l'Est, est aujourd'hui aussi efficace qu'il l'était en Espagne pendant la guerre civile. La classe ouvrière d'Allemagne de l'ouest a montré qu'elle n'a pas, pour le moment, les mêmes penchants au nationalisme.
L'ouvrier ouest-allemand typique associe aujourd'hui le nationalisme avec les défaites dans les guerres mondiales et avec la plus terrible pauvreté, et, au contraire, assimile une certaine prospérité à la CEE, au marché mondial, etc. Un emploi industriel sur deux en Allemagne, dépend du marché mondial. Et même l'immigration massive venant de l'Est n'a eu des effets de division importants que sur les secteurs faibles, et non sur les "bataillons" principaux de la classe. Le prolétariat reste une force décisive dans la situation mondiale. Par exemple, si la bourgeoisie allemande, malgré le coût incroyable de l'unification, la lutte sur le marché mondial, etc., devait s'engager dans une course pour le réarmement pour devenir une superpuissance militaire, le prix en serait tellement élevé, que cela conduirait probablement à la guerre civile. La classe ouvrière dans les pays industriels de l'Ouest reste invaincue, elle demeure une force avec laquelle la bourgeoisie doit compter en permanence
Nous ne savons pas avec certitude si la classe peut sortir des difficultés présentes et rétablir sa propre perspective de classe. Et nous ne pouvons pas même nous consoler avec l'illusion déterministe selon laquelle "le communisme est inévitable". Cependant nous savons que le prolétariat, aujourd'hui, n'a pas que ses chaînes à perdre, mais son existence-même. Par contre il a toujours un monde à gagner, et pour ce faire, Il n'est pas encore trop tard.
Weltrevolution, 8 mai 1990
[1] [97] L'économie ne constitue pas automatiquement et immédiatement un antidote au reflux sur la question de l'unification des luttes. Mais à long terme, la récession est une force puissante pour l'unification. Cependant la situation du capital mondial est désastreuse même sans récession ouverte.
Géographique:
- Allemagne [98]
Questions théoriques:
- L'économie [86]
- Décadence [32]
Polémique : Face aux bouleversements à l'Est, une avant-garde en retard
- 2915 reads
L'effondrement du bloc de l'Est est l'événement historique le plus important :
- depuis les accords de Yalta en 1945, qui établissaient la division et le partage du monde entre deux blocs impérialistes antagonistes dominés respectivement par les USA et l'URSS ;
- depuis la reprise de la lutte de classe à partir de 1968, mettant fin aux noires années de la contre-révolution qui régnait depuis la fin des années 1920.
Un événement d'une telle importance est une épreuve, un test déterminant, pour les organisations révolutionnaires et le milieu prolétarien dans son ensemble. Il n'est pas un simple révélateur de la clarté ou de la confusion des organisations politiques, il a des implications extrêmement concrètes. De leur capacité à y répondre clairement dépend non seulement leur propre avenir politique mais aussi la capacité de la classe à s'orienter dans la tempête de l'histoire.
L'activité des révolutionnaires n'est pas gratuite, elle a des conséquences pratiques pour la vie de la classe. La capacité de développer une intervention claire contribue au renforcement de la conscience dans la classe, et l'inverse aussi est vrai, l'impuissance à intervenir, la confusion des organisations prolétariennes, constituent des entraves à la dynamique révolutionnaire dont la classe est porteuse.
Face au séisme économique, politique et social qui ravage les pays du pacte de Varsovie depuis l'été 1989, comment le milieu politique prolétarien et les organisations révolutionnaires qui le constituent ont réagi ? Comment les événements ont été compris ? Quelle intervention a été faite ? Ce ne sont pas là des questions secondaires et des prétextes à des polémiques stériles, ce sont des questions essentielles qui influencent très concrètement les perspectives du futur.
Le retard du milieu politique face à de l'importance des événements [1] [99]
Le PCI, Battaglia Comunista commence une prise de position évolutive durant l'automne 1989, mais il faut attendre la nouvelle année pour que paraissent les premières prises de position de la CWO, du PCI-Programme Communiste, Le prolétaire, et du FOR, fin février 1990, paraissent deux textes de débat interne de la FECCI sur la situation dans les pays de l'Est, mais il faudra attendre avril pour voir paraître sa publication : Perspective internationaliste, n° 16, datée de l'hiver ! Avec le printemps, les petites sectes retrouvent un peu de vigueur et publient enfin des prises de position. Communisme ou civilisation, Union prolétarienne, le GCI, Mouvement communiste pour la formation du parti mondial, sortent de leur léthargie. De longs mois se sont écoulés jusqu'à la fin de l'année 1989 durant lesquels, en dehors des prises de position du CCI, les prolétaires désireux de se clarifier et de connaître le point de vue des groupes révolutionnaires n'avaient à se mettre sous la dent qu'un maigre numéro de BC et du Prolétaire. Lorsque le CCI publie dans la Revue internationale n° 61, une polémique écrite fin février [2] [100], celle-ci ne peut traiter que des positions de trois organisations: le BIPR qui regroupe la CWO et BC, le PCI Le prolétaire et le FOR, pourtant, six mois se sont écoulés depuis les premiers événements marquants et significatifs.
Certes, l'effondrement d'un bloc impérialiste sous les coups de la crise économique mondiale n'a pas de précédent dans l'histoire du capitalisme, la situation est historiquement nouvelle, et donc difficile à analyser. Cependant, indépendamment même du contenu des positions développées, ce retard traduit avant tout une incroyable sous-estimation de l'importance des événements et du rôle des révolutionnaires. La passivité des organisations politiques qui environnent le CCI face à l'implosion du bloc de l'Est et aux interrogations nécessaires qu'un tel fait soulève au sein de la classe ouvrière en dit long sur l'état de décrépitude politique dans lequel elles s'enfoncent.
Ce n'est certes pas un hasard si les organisations qui ont réagi le plus rapidement sont celles qui se rattachent par leur histoire le plus clairement aux traditions communistes des Gauches, et particulièrement de la Gauche italienne, celles qui, dans la durée, ont déjà montré une relative solidité. Elles constituent les pôles politiques et historiques du milieu prolétarien. Les petites sectes qui gravitent autour, produits des multiples scissions, fondamentalement, n'expriment pas de points de vue si originaux ou nouveaux qu'ils puissent justifier leur existence séparée. Pour se distinguer, elles ne peuvent que, soit de "découverte" en "découverte", s'enfoncer dans la confusion et le néant, soit singer de manière caricaturale et stérile les positions classiquement en débat au sein du milieu révolutionnaire.
Dans cet article polémique, nous privilégions donc d'abord le BIPR, qui, en dehors du CCI, reste le principal pôle de regroupement, et les groupes bordiguistes, car même si ce courant s'est effondré en tant que pôle de regroupement, il n'en reste pas moins un pôle politique important des débats au sein du milieu révolutionnaire. Pour autant, nous essayerons de ne pas négliger les prises de position des groupes "parasites" tels la FECCI, Communisme pu Civilisation, et même celles du GCI, dont on peut raisonnablement se demander s'il a encore le bout d'un doigt de pied au sein du camp prolétarien. La liste, évidemment, n'est pas exhaustive. Ces derniers groupes traduisent, le plus souvent de manière outrancière, les faiblesses qui s'expriment au sein du milieu prolétarien et sont un révélateur de la logique où mènent les confusions véhiculées par les groupes les plus sérieux.
Face aux bouleversements intervenus dans les pays de l'Est, dans l'ensemble, toutes les organisations révolutionnaires ont su afficher clairement à un niveau théorique général deux positions de base qui, le plus souvent, à défaut même d'analyse de la situation, ont fait office de première prise de position :
- l'affirmation de la nature capitaliste de l'URSS et des pays satellites ;
- la dénonciation du danger que constituent pour la classe ouvrière les illusions démocratiques.
La clarté sur ces deux principes de base qui fondent l'existence et l'unité du milieu politique prolétarien est bien le moins qu'on pouvait attendre de la part d'organisations révolutionnaires. Mais, sorti de là, c'est une confusion cacophonique qui règne quant à l'analyse des événements. Le retard dans la prise de position de la plupart des groupes du camp révolutionnaire n'est pas un simple retard pratique, une incapacité à bouleverser le rythme douillet des échéances des publications pour faire face aux événements historiques qui le nécessitent, c'est un retard à reconnaître l'évidence de la réalité, à simplement constater les faits et en premier lieu l'effondrement et l'éclatement du bloc de l'Est.
En octobre 1989, "BC voit l’empire oriental encore solidement sous la botte russe", en décembre 1989, elle écrit : "L'URSS doit s'ouvrir aux technologies occidentales et le Comecon doit faire de même, non -comme le pensent certains- dans un processus de désintégration du bloc de l'Est et de désengagement total de l'URSS des pays d'Europe, mais pour faciliter, en revitalisait les économies du Comecon, la reprise de l'économie soviétique". Ce n'est qu'en janvier 1990 qu'apparaît une première prise de position claire du BIPR dans Workers'Voice, la publication de la CWO : ces "événements d'une importance historique mondiale" signifient "l’amorce d’un effondrement de l'ordre mondial créé vers la fin de la 1e guerre mondiale" et ouvrent une période de "reformation de blocs impérialistes".
Les deux principaux groupes de la diaspora bordiguiste vont montrer plus de rapidité de réflexe que le BIPR. Dans son numéro de septembre 1989, 77 Programma comunista envisage la désagrégation du pacte de Varsovie et la possibilité de nouvelles alliances, comme le fait au même moment Il Partito comunista. Cependant, ces prises de position posées comme hypothèses né sont pas dépourvues d'ambiguïtés. Ainsi, en France Le Prolétaire peut encore écrire que "l'URSS est peut-être affaiblie, mais elle est encore comptable du maintien de l'ordre dans sa zone d'influence".
En janvier, le FOR annonce timidement, sans autre développement, qu"'on peut considérer que le bloc stalinien est vaincu".
La FECCI, au printemps 1990, nous offre deux positions. Celle majoritaire, position officielle de cette organisation, ne voit dans les événements de l'Est qu'"une tentative de l'équipe Gorbatchev de réunir progressivement toutes les conditions qui permettraient à l'Etat russe de mener une réelle contre-offensive dirigée contre l'Ouest". La minorité, plus lucide, note que la situation échappe au contrôle de la direction soviétique et que les réformes ne font qu'aggraver la débâcle du bloc russe.
Pour Communisme ou Civilisation, qui publie sur le sujet un texte dans le n° 5 de la Revue internationale du Mouvement communiste, "l'importance historique des événements en cours tient en premier lieu à leur situation géographique" ! Et après un long pensum académique où une multitude d'hypothèses de toutes sortes sont envisagées, aucune prise de position claire ne se dégage : en fait, en Europe de l'Est, c'est à une simple crise de restructuration à laquelle nous assisterions.
Quant au GCI et à son avatar le Mouvement communiste pour la formation du Parti communiste mondial dont les publications nous parviennent au printemps, l'effondrement du bloc de l'Est n'est même pas envisagé ; il s'agirait pour eux de simples manoeuvres de restructuration pour faire face à la crise et surtout à la lutte de classe.
On le voit, les organisations du milieu prolétarien ont mis des mois à mesurer la signification des événements et le plus souvent, l'ambiguïté subsiste, la porte reste ouverte à l'illusion d'une possible reprise en main par l'URSS de son ex-bloc. Six mois après le début des événements, le BIPR ne voit que l’"amorce" d'un processus alors que l'URSS a fondamentalement déjà perdu tout contrôle sur son glacis est-européen. Quant aux sectes parasites, elles n'ont pour ainsi dire rien vu. Solidarnosc a gagné les élections en Pologne durant l'été, avec l'automne, le mur de Berlin est tombé, les partis staliniens ont été jetés hors du pouvoir en Tchécoslovaquie et en Hongrie, Ceaucescu a été mis à bas en Roumanie tandis qu'en URSS même, l'agitation du Caucase et des pays baltes ont montré la perte de maîtrise du pouvoir central et la dynamique d'éclatement qu'implique le "réveil des nationalités", mais, face à tout cela, le milieu politique révolutionnaire a été comme frappé de léthargie. Cela manifeste un incroyable aveuglement face à la simple réalité des faits. Ce qu'un simple pisse-copie de la presse bourgeoise ne pouvait que constater : l'effondrement du bloc russe, nos docteurs en théorie marxiste engoncés dans un conservatisme peureux refusaient de le voir. Le manque de réflexe politique qui a sévi dans le milieu prolétarien ces derniers mois est la manifestation des faiblesses profondes qui le marquent. Incapable ces dernières années d'intervenir avec détermination dans les luttes de la classe ouvrière, qu'elle ne reconnaissait pas, une grande partie du milieu prolétarien s'est avérée impuissante à faire face à la brutale accélération de l'histoire de ces derniers mois. Enfermée dans un repli frileux tout au long de la décennie 80, elle est restée sourde, aveugle et muette. Une telle situation ne peut s'éterniser. Même si elles se réclament de la classe ouvrière, des organisations qui sont incapables d'assumer leur rôle ne sont d'aucune utilité pour celle-ci et deviennent au contraire des entraves. Elles perdent leur raison d'être.
Quand on voit avec quelle difficulté les organisations du milieu politique ont ouvert les yeux à la réalité, pourtant de plus en plus aveuglante au fur et à mesure des mois qui s'écoulaient, de l'effondrement du bloc russe, on peut déjà avoir une idée de la confusion des analyses qui vont être développées et du déboussolement politique qui règne. Il ne s'agit pas ici de reprendre en détail tous les avatars théoriques que les groupes politiques révolutionnaires ont pu élaborer, plusieurs numéros de la Revue internationale du CCI n'y suffiraient pas. Nous nous attacherons avant tout à cerner les implications des prises de position du milieu sur deux plans : la crise économique et la lutte de classe. Nous verrons ensuite quelles ont été les implications de tout cela, sur la vie même du milieu prolétarien.
La crise économique a l'origine de l'effondrement du bloc de l'est : une sous-estimation générale
Toutes les organisations du milieu prolétarien voient bien la crise économique à l'origine des bouleversements qui secouent l'Europe de l'Est, à l'exception du FOR, qui n'y fait aucune référence conformément à sa position surréaliste selon laquelle il n'y a pas de crise économique du capitalisme aujourd'hui. Cependant, au-delà de cette pétition de principe, l'appréciation même de la profondeur de la crise et de sa nature détermine la compréhension des événements actuels et cette appréciation varie profondément d'un groupe à l'autre.
BC, en octobre, écrit: "Dans les pays à capitalisme avancé d'Occident, la crise s'est surtout manifestée dans les années 70. Plus récemment, la même crise du processus d'accumulation du capital a explosé dans les pays 'communistes' moins avancés." C'est-à-dire que BC ne voit pas la crise ouverte du capital dans les pays de l'Est avant les années 1980. Et dans la période antérieure, il n'y avait donc pas de "crise du processus d'accumulation du capital" en Europe de l'Est ? Le capital russe était-il en pleine expansion comme le prétendait la propagande stalinienne ? En fait, BC sous-estimait profondément la crise chronique et congénitale qui durait depuis des décennies. Dans ce même article, BC continue :
"L'effondrement des marchés de la périphérie du capitalisme, par exemple l'Amérique latine, a créé de nouveaux problèmes d'insolvabilité à la rémunération du capital (...). Les nouvelles opportunités qui s'ouvrent à l'est de l'Europe peuvent représenter une soupape de sécurité par Rapport à ce besoin d'investissement (...) Si ce large processus de collaboration Est-Ouest vient à se concrétiser, ce sera une bouffée d'oxygène pour le capitalisme international." On le voit, ce n'est pas seulement la crise à l'Est que BC sous-estime, c'est aussi la crise en Occident. Où ce dernier trouvera-t-il ces nouveaux crédits nécessaires à la reconstruction des économies ravagées des pays de l'Est ? Simplement pour remettre à niveau l'économie de l'Allemagne de l'Est, la RFA se prépare à investir plusieurs milliers de milliards de marks sans être sûre du résultat et, pour se les procurer, elle devra se transformer de principal prêteur sur le marché mondial après le Japon qu'elle était jusque là, en gros emprunteur, accélérant encore la crise du crédit de l'Occident. On peut imaginer les sommes colossales qu'il faudrait pour sortir l'ensemble de l’ex-bloc de l'Est de la catastrophe économique dans laquelle il n'a cessé de s'enfoncer depuis sa naissance : l'économie mondiale à bout de souffle n'a pas les moyens de cette politique, un nouveau plan Marshall n'est pas à l'ordre du jour. Mais surtout, en quoi les économies sinistrées d'Europe de l'Est seraient-elles plus solvables que celles d'Amérique latine alors qu'elles sont déjà comme la Pologne et la Hongrie incapables de rembourser les emprunts qu'elles ont contractés depuis des années ? En fait, BC ne voit pas que l'effondrement du bloc de l'Est, une décennie après l'effondrement économique des pays du "tiers-monde", vient marquer un nouveau pas en avant de l'économie capitaliste mondiale dans sa crise mortelle. L'analyse du BIPR va à l'envers de la réalité. Et là où il y a un enfoncement dramatique dans la crise, il y voit une perspective pour le capitalisme de trouver une nouvelle "bouffée d'oxygène", un moyen de freiner la dégradation économique ! Il est logique qu'avec une telle vision, BC surestime la capacité de manoeuvre de la bourgeoisie russe et puisse envisager une restructuration possible de l'économie du bloc de l'Est, sous la houlette de Gorbatchev et avec l'appui de l'Occident.
Le PCI-Programme communiste reconnaît la crise économique comme étant à l'origine de l'effondrement du pacte de Varsovie. Cependant, dans une polémique avec le CCI publiée dans Le Prolétaire d'avril 1989, il trahit sa sous-estimation profonde et traditionnelle de la gravité de la crise économique : "L'extralucide CCI développe en effet une analyse effarante selon laquelle les événements actuels seraient rien moins qu'un 'effondrement du capitalisme' à l'Est ! D'ailleurs, pour faire bonne mesure, le numéro de mars de RI nous apprend que c'est toute l'économie mondiale qui s'effondre." Bien évidemment, le CCI ne prétend pas, comme voudrait le faire croire le PCI, qu'en Europe de l'Est, les rapports de production capitalistes auraient disparu mais, avec cette mauvaise polémique, le PCI montre sa propre sous-estimation de la crise économique et nie d'une phrase la réalité de la catastrophe qui submerge le monde et qui plonge la majorité de la population mondiale dans une misère économique sans fond. Le PCI-Programme Communiste croit-il vraiment que nous sommes encore dans les crises cycliques du 19e siècle ou reconnaît-il que la crise économique présente, qu'il a mis des années à voir, est une crise mortelle qui ne peut se traduire que par une catastrophe mondiale toujours plus large avec des pans entiers de l'économie capitaliste qui s'effondrent effectivement. Le PCI, qui, autrefois nous accusait d'indifférentisme, est toujours myope face à la crise économique ; fondamentalement, il la voit à peine et surtout il ne la comprend toujours pas.
Les petites sectes académistes se sont souvent fait une spécialité de longues analyses économiques ennuyeuses et d'innovations théoriques pseudo-marxistes.
Il faut un long pensum insipide à Communisme ou Civilisation pour rester aveugle à l'évidence de la crise économique ouverte : il en est toujours à attendre "l'éclatement d'une nouvelle crise cyclique du MPC (on suppose qu'il doit s'agir du mode de production capitaliste) dans les années 1990 à l'échelle mondiale". Pour lui, les bouleversements actuels en Europe de l'Est sont l'expression du fait que "le plein passage de la société soviétique au stade du capitalisme le plus développé ne pouvait se faire sans une crise profonde, comme c'est le cas". Autrement dit, la présente crise est une simple, crise de restructuration, de croissance, d'un capitalisme en plein développement !
La FECCI, qui, depuis des années, glose sur une "nouvelle" théorie du développement du capitalisme d'Etat comme produit du passage du capital de la domination formelle à la domination réelle, est tout d'un coup devenue muette sur cette élucubration de ses têtes savantes. Ce point, il y a peu si fondamental qu'il justifiait une diatribe enflammée de la FECCI contre le CCI, accusé de "stérilité théorique", de "dogmatisme", tout d'un coup n'est plus d'actualité face à la crise dans les pays de l'Est. Comprenne qui pourra ![3] [101]
La sous-estimation de la profondeur de la crise et les incompréhensions sur sa nature sont une constante des organisations prolétariennes. De là résultent des incompréhensions majeures sur la nature des événements qui se développent aujourd'hui. Ce n'est que devant la pression insistante des faits que certains groupes commencent seulement à se résigner à l'évidence de l'effondrement du bloc impérialiste de rEst sous le poids de la crise économique. Mais la signification profonde d'un tel événement, la situation qui l'a rendu possible, la dynamique qui l'a déterminé échappent totalement à leur entendement. Alors qu'il y a un blocage de la situation historique, que le rapport de forces entre les classes ne permet ni à la bourgeoisie de fuir en avant dans la guerre impérialiste généralisée, ni au prolétariat d'imposer à court terme la solution de la révolution prolétarienne, la société capitaliste est entrée dans une phase de pourrissement sur pied, de décomposition. Les effets de la crise économique prennent une dimension qualitative nouvelle. L'effondrement du bloc russe est la manifestation éclatante de la réalité du développement de ce processus de décomposition qui se manifeste à des degrés et sous des formes diverses sur l'ensemble de la planète [4] [102].
Mais la myopie politique qui rend déjà bien difficile à ces groupes le discernement de l'évidence pourtant criante des bouleversements dans l'Est, les laisse au surplus bien incapables d'en comprendre la raison et d'en saisir toute la dimension. Les errements sur la crise et ses implications, qui ont grandement contribué à paralyser le milieu face aux récents événements, annoncent des incompréhensions encore plus grandes par rapport aux bouleversements importants encore à venir.
Des organisations révolutionnaires incapables d'identifier la lutte de classe
Face aux luttes ouvrières qui se sont développées depuis 1983 au coeur des pays capitalistes les plus avancés, dans son ensemble, en dehors du CCI, le milieu prolétarien a fait la fine bouche. Le CCI a alors été accusé de surestimer la lutte de classe. Dans son numéro d'avril, BC accuse encore le CCI de se fier "plus à ses désirs qu'à la réalité" car, dit-elle, ces mouvements "n'ont rien produit d'autre que des luttes revendicatives qui n'ont jamais été capables de se généraliser". Il est vrai que, pour BC, ces luttes revendicatives n'ont pas grande signification puisque, selon elle, nous sommes toujours dans une période de contre-révolution, suivant en cela la position de tous les groupes bordiguistes issus des diverses scissions du PCI depuis son origine à la fin de la guerre.
BC qui est incapable de reconnaître la lutte de classe quand il l'a devant les yeux et par conséquent encore plus incapable d'y intervenir concrètement, par contre va s'empresser de l'imaginer là où elle n'est pas. Dans les événements de Roumanie en décembre 1989, BC voit une "authentique insurrection populaire" et précise :
"Toutes les conditions objectives et presque toutes les conditions subjectives étaient réunies pour que l'insurrection puisse se transformer en véritable révolution sociale, mais l'absence d'une force politique authentiquement de classe a laissé le champ libre justement aux forces qui étaient pour le maintien des rapports de production de classe. "
Cette position a déjà été critiquée dans notre polémique publiée dans la Revue internationale, n° 61, et a provoqué une réponse de BC qui persiste et signe dans son numéro d'avril 1990, mais précise en même temps :
"Nous ne pensions pas qu'il pouvait surgir des doutes sur le fait que l'insurrection est comprise comme conséquence de la crise et qu'elle est qualifiée de populaire et pas de socialiste ou de prolétarienne. "
Visiblement BC ne comprend pas, ou ne veut pas comprendre le débat. Le simple usage du terme "insurrection" dans un tel contexte ne peut que semer la confusion et le fait d'y adjoindre "populaire" en rajoute encore. Dans le monde capitaliste présent, seul le prolétariat est la classe capable de mener une insurrection, c'est-à-dire la destruction de l'Etat bourgeois en place. Pour cela, la première condition est son existence en tant que classe qui se bat et s'organise sur son terrain. Ce n'est évidemment pas le cas en Roumanie. Les ouvriers sont atomisés, dilués dans le mécontentement de toutes les couches de la population qui a été utilisé par une fraction de l'appareil d'Etat pour renverser Ceausescu. La mise en scène médiatique de la "révolution" roumaine a été un vulgaire coup d'État. Dans cette situation où les ouvriers ont été dilués dans le mouvement "populaire", c'est-à-dire où le prolétariat comme classe a été absent, BC voit "presque toutes les conditions subjectives pour que l'insurrection puisse se transformer en révolution sociale" ! Dans cette situation d'extrême faiblesse de la classe ouvrière, BC aperçoit au contraire une force grandiose.
Toutes les dénonciations du poison démocratique que le BIPR peut faire à longueur de page deviennent lettre morte si cette organisation est incapable d'en voir les effets dévastateurs comme élément diluant de la conscience de classe dans le concret, et croit discerner le mécontentement ouvrier dans le triomphe de la mystification démocratique.
Dans cette ornière que BC a commencé à creuser, la FECCI est déjà bien engagée. Elle qui, comme le BIPR, avait il y a un an des visions du côté de la Chine et croyait voir la colère ouvrière prête à se manifester, aujourd'hui affirme que : "Les illusions actuelles, l'entrée du prolétariat roumain dans la danse macabre de la lutte pour la démocratie, ne doivent pas éclipser le potentiel de combativité pour des revendications de classe qui est pourtant celui du prolétariat roumain." La FECCI se console comme elle peut, mais elle manifeste ainsi ses propres illusions quant aux potentialités ouvrières qui subsistent dans l'immédiat après un tel débauchage démocratique.
Le FOR dans un article intitulé : "Une insurrection pas une révolution" distingue en Roumanie "la présence des ouvriers en armes" et précise que "les prolétaires y ont rapidement abandonné la direction aux 'spécialistes' de la confiscation du pouvoir". Pour le FOR, le prolétariat a "largement contribué à mettre en oeuvre" les changements à l'Est. Evidemment, le FOR qui ne voit rien de la crise économique doit bien aller chercher ailleurs son explication.
La porte que BC ouvre à la confusion, le Mouvement communiste et le GCI vont s'empresser de la franchir. Le premier va intituler sa longue brochure entièrement consacrée à la Roumanie, alors que rien n'est dit sur la situation globale du bloc de l'Est : "Roumanie : entre restructuration de l'Etat et poussées insurrectionnelles prolétariennes" ; et le second va publier un "Appel à la solidarité avec la révolution roumaine" ! Cela se passe de commentaire.
Il faut signaler et porter au crédit du PCI-Programme communiste que celui-ci n'est pas tombé dans le piège roumain, notant clairement que, dans les pays de l'Est, "la classe ouvrière ne s'est pas manifestée en tant que classe, pour ses intérêts propres" et qu'en Roumanie, "les combats se sont déroulés entre fractions de l'appareil d'Etat, et non contre cet appareil lui-même". De même, le PCI-Il Partito comunista de Florence pose clairement que la lutte de classe dans les pays de l'Est a été, pour le moment, submergée par l'orgie populiste, nationaliste et démocratique et que "le mouvement roumain a été tout sauf une révolution populaire". Cependant, ces défenseurs du bordiguisme, s'ils sont encore capables de dénoncer et d'identifier le mensonge démocratique, s'ils n'ont pas encore complètement dilapidé leur héritage politique de la Gauche italienne, comme le prouvent leurs prises de position sur la situation en Europe de l'Est, sont toujours incapables de reconnaître la lutte de classe quand eue se développe réellement au coeur des pays industrialisés. Comme BC, les groupes issus du bordiguisme analysent la période actuelle comme étant celle de la contre-révolution.
Le tableau est éloquent. Une des caractéristiques majeures de ces organisations politiques est leur incapacité à reconnaître la lutte de classe, à l'identifier. Ne la voyant pas là où elle se développe et l'imaginant là où elle n'est pas. Ce déboussolement profond prive évidemment tous ces groupes de la capacité de mener une intervention claire au sein de la classe. Alors que la classe dominante met à profit l'effondrement du bloc de l'Est pour lancer une offensive idéologique massive pour la défense de la démocratie, offensive devant laquelle succombe le prolétariat des pays est-européens, de nombreux groupes voient dans cette situation le développement de potentialités ouvrières. Une telle inversion de la réalité traduit une très grave incompréhension non seulement de la situation mondiale, mais aussi de la nature même de la lutte ouvrière. Tous ces groupes, après avoir fait durant les années 1980 la fine bouche devant les luttes dans les pays développés (qui, malgré toutes les difficultés et les pièges auxquels elles furent exposées, n'en sont pas moins restées ancrées sur leur terrain de classe), préfèrent aujourd'hui chercher la preuve de la combativité du prolétariat dans des expressions du mécontentement général où le prolétariat en tant que classe est absent et qui se mènent, pour des objectifs qui ne sont pas les siens, derrière le drapeau de la "démocratie", comme en Chine ou en Roumanie.
Dans de telles conditions, il est bien difficile de demander à ces organisations du milieu prolétarien qui, pour la plupart, n'ont rien vu du développement de la lutte de classe ces dernières années ou, du moins, l'ont toujours profondément sous-estimé, de comprendre quelque chose aux effets de l'effondrement du bloc russe et de l'intense campagne démocratique actuelle sur le prolétariat. Le déboussolement présent de celui-ci face à ces grands bouleversements historiques se traduit dans un recul de la conscience dans la classe [5] [103]. Mais comment comprendre un recul quand on n'a pas vu d'avancée ? Comment comprendre le développement en dents de scie de la lutte de classe quand on pose que nous sommes toujours dans une période de contre-révolution ?
La faiblesse politique du milieu trouve sa concrétisation dans le poids renforceé du sectarisme
Dans le numéro précédent de la Revue internationale, nous notions : "Si on considère que le BIPR est le second principal pôle du milieu politique international, le désarroi de BC face au 'vent de l'Est' est une triste indication des faiblesses plus générales du milieu." Malheureusement, le développement des prises de position, ces derniers mois, ne font que confirmer ce constat qui n'est pas pour nous surprendre. Depuis des années, le CCI met en garde au travers de ses polémiques les groupes du milieu contre les confusions dangereuses qui les traversent, mais comme ces groupes sont restés aveugles à la lutte de classe, à l'effondrement du bloc de l'Est, au recul présent, à l'évidence des faits qui se déroulent pourtant devant leur nez, ils sont aussi restés sourds à nos appels [6] [104]. En conséquence, ils sont restés muets sur le plan de l'intervention, s'enfonçant toujours plus dans une impuissance inquiétante, mise on ne peut plus clairement en relief ces derniers mois.
Mais ce n'est pas seulement sur le plan de leurs analyses que ces organisations ont échoué à être, par rapport aux éléments avancés de la classe à la recherche d'un cadre cohérent de compréhension de la situation présente, un facteur de clarification. Leur attitude, traditionnellement marquée par le poids du sectarisme, parallèlement au développement de la confusion, a été marquée ces derniers mois par une dégradation.
Là encore, Battaglia comunista, qui nous avait habitués à beaucoup mieux, s'illustre tristement. L'intervention d'un camarade du CCI à une réunion publique de BC, dans laquelle celui-ci met en lumière la gaffe monumentale du BIPR face aux événements en Roumanie, en affirmant simplement que ce qui a eu lieu est un vulgaire "coup d'Etat", est le prétexte à un raidissement de camarades de BC qui, en colère, menacent dans ces conditions de refuser dorénavant la vente habituelle de nos publications dans le cadre de ses réunions ouvertes. Le fait que dans la publication en France du CCI -Révolution internationale n° 151- nous ayons fait référence à cette poussée de sectarisme va provoquer l'ire de BC qui a adressé une "circulaire" incendiaire "à tous les groupes et contacts à l'échelle internationale'' pour dénoncer "les mensonges du CCI" et "la nature désormais objectivement de brigand de l'activité du CCI" et conclure : "Tandis que nous défions le CCI de continuer au-delà cette campagne diffamatoire basée sur le mensonge et sur la calomnie, afin d'éviter des réactions plus graves, nous invitons tous ceux au courant des faits à en tirer les conclusions politiques nécessaires dans l'évaluation de cette organisation." Une telle réaction, hors de toute proportion, puisque le prétexte officiel en est une intervention d'un de nos militants dans une discussion à une réunion de BC, traduit en fait l'embarras grandissant de ce groupe face à nos critiques.
Le sectarisme qui pèse lourdement dans le milieu politique est l'expression de l'incapacité à débattre, à confronter les analyses et les positions. La réaction de BC est dans la continuité de son attitude sectaire et opportuniste, lorsqu'elle avait mis fin aux Conférences des groupes de la Gauche communiste, en 1980. Le sectarisme a toujours fait bon ménage avec l'opportunisme. Au même moment où BC envoie cette circulaire ridicule dans tout le milieu, le BIPR, dont elle constitue le groupe principal, signe une adresse commune sur la situation dans les pays de l'Est avec des petits groupes comme le Gruppe Internationalistische Komunismen (Autriche) ou Comunismo (Mexique) dont le contenu traduit plus des concessions opportunistes que la recherche de la clarté. BC est pour le regroupement des révolutionnaires, mais sans le CCI. Cette attitude de concurrence ridicule mène tout droit au pire des opportunismes et accroît la confusion des débats dans le milieu.
L'ostracisme qui frappe le CCI de la part des anciens groupes du milieu politique, et des multiples sectes qui le parasitent, n'est pas, comme on l'a vu, contradictoire avec l'opportunisme le plus plat sur la question du regroupement des forces révolutionnaires. La FECCI, ces dernières années a été une parfaite illustration de ce fait : dans le même temps où eue abreuvait le CCI d'insanités, elle se lançait dans une dynamique de pseudo-conférences avec des groupes aussi hétérogènes que Communisme ou Civilisation, Union prolétarienne, Jalons, A Contre-Courant et des individus isolés. Les sectes se payaient leur conférence, on peut imaginer ce que cela a pu donner, pas grand chose, tout aux plus de nouvelles sectes. Aujourd'hui, la FECCI a entamé un nouveau flirt avec le Communist Bulletin Group, groupe dont la naissance s'était déroulée sous les auspices d'un acte de brigandage envers le CCI un vrai, cette fois, pas comme ceux, imaginaires, que BC prête au CCI. La FECCI tourne en ridicule l'idée même de regroupement mais, malheureusement, cette organisation s'est aussi singularisée par la bêtise méchante, la mauvaise foi et l'aveuglement haineux de ses polémiques et, ce faisant, c'est toute l'activité révolutionnaire qui est dénaturée.
Les événements dans les pays de l'Est se sont traduits pour la FECCI par une aggravation de son déboussolement et de son irresponsabilité. La FECCI, la vision obscurcie par son aigreur, a vu dans nos prises de position sur l'effondrement du bloc russe une négation de l’"impérialisme" et "un abandon du cadre marxiste de la décadence." La FECCI n'en est pas à un faux débat près, c'est ce qui lui sert de raison d'existence. Combien de temps lui faudra-t-il pour simplement reconnaître la réalité de l'effondrement du bloc de l'Est ? A ce moment-là, la FECCI pourra-t-elle reconnaître la validité des positions du CCI ? En tirera-t-elle les conclusions par rapport à son attitude présente ?
Les organisations bordiguistes ne reconnaissent pas l'existence d'un milieu politique et pour chacune d'entre elles, il n'y a qu'un seul parti, elle-même: Le sectarisme est là théorisé et justifié. Cependant, le PCI-Programme communiste, semble quelque peu tirer les leçons de sa crise passée et commence à publier des polémiques avec d'autres groupes du milieu politique. Ainsi, le CCI a eu droit à une réponse polémique dans Le Prolétaire, sa publication en France. A quoi réagit le PCI ? Au fait que nous ayons salué sa prise de position correcte ! Et il précise : "Ce qui nous importe dans cette note c'est de réfuter le plus clairement possible l’idée que notre position serait analogue à celle du CCI" Que cette organisation se rassure, le fait que nous reconnaissons la relative clarté de sa prise de position par rapport aux événements de l'Est ne nous fait pas oublier ce qui nous sépare d'elle, mais le PCI a-t-il atteint un tel niveau de gangrène sectaire que même la reconnaissance sur un point de la validité de ses positions lui soit si complètement insupportable ? Peut-être le rappel de ce que nous concluions à son propos dans l'article de la précédente Revue internationale, consacré au milieu politique, le rassurera dans ce cas : "La réponse relativement saine du Prolétaire aux événements de l'Est prouve qu'il y a encore une vie prolétarienne dans cet organisme. Mais nous ne pensons pas que ceci représente réellement un nouveau regain de vie : c'est l'antipathie 'classique' des bordiguistes vis-à-vis des illusions démocratiques, plus qu'un réexamen critique des bases opportunistes de leur politique, qui leur a permis de défendre une position de classe sur cette question. "
Un des constats des plus inquiétants qu'il faut tirer, c'est l'incapacité de ces organisations, face à des faits nouveaux, de reconsidérer leur cadre de compréhension, de l'enrichir pour s'élever à la compréhension de ce qui a changé. En fait, l'accélération historique a mis en lumière l'incroyable conservatisme qui sévit dans le milieu. Le sectarisme qui s'est développé à l'occasion des polémiques à propos du "vent d'Est" est le corollaire de ce conservatisme. Incapables de reconnaître l'actuel processus de décomposition sociale, considéré comme un "gadget" du CCI, ces organisations sont évidemment bien incapables d'en identifier les manifestations dans la vie du milieu prolétarien, dans leur propre vie et donc de s'en défendre. La dégradation des relations entre les principales organisations ces dernières années en est pourtant une expression très claire.
Dans ces conditions il n'est pas même question de développer dans cet article à propos de l'intervention qu'ont menée ces groupes par rapport au séisme qui secoue l'Europe de l'Est. Aucun autre groupe que le CCI n'a su briser la routine pour simplement accélérer ses publications ou publier des suppléments. Le déboussolement politique et la sclérose sectaire ont rendu ces organisations impuissantes à intervenir. Dabs la situation présente de désarroi où l'a plongée le "vent d'Est", accentuée par l'offensive de la propagande bourgeoise, la classe ouvrière subit un recul dans sa conscience, et ce ne sont pas les lumières apportées par la majorité des groupes révolutionnaires qui lui auront été d'une grande utilité pour sortir de cette passe difficile.
Le développement du cours historique impose au milieu un irrésistible processus de décantation. La clarification que ce processus implique, dans la situation présente de dégradation des relations entre les groupes prolétariens, n'arrive pas à se faire par la confrontation claire et volontaire des positions. Elle doit néanmoins se faire, et dans ces conditions elle ne peut que tendre à prendre la forme d'une crise de plus en plus forte des organisations qui, à l'accélération de l'histoire répondent par le développement de la confusion, posant ainsi la question de leur survie politique. La clarification qui ne parvient pas à se faire par le débat risque de s'imposer par le vide. Tels sont les enjeux du débat présent pour les organisations politiques révolutionnaires.
JJ, 31mai l990
[1] [105] Dans cet article seront souvent utilisés les sigles des organisations, ce qui donne:
- Parti communiste internationaliste (PCint) et ses publications Battaglia Comunista (BC) et Prometeo
- Comunist workers' organisation (CWO) et sa publication Workers Voice - Bureau international pour le parti révolutionnaire (BIPR), publication Communist Review, regroupement des deux précédentes organisations.
- Parti communiste international (PCI), publications Programme communiste et Le Prolétaire
- Ferment ouvrier révolutionnaire (FOR), publications Alarme et l’Arme de la critique
- Fraction externe du Courant communiste international (FECCI), publication Perspective internationaliste
-Groupe communiste internationaliste (GCI)
[2] [106] Revue Internationale n°61. « Le vent d’Est et la réponse des révolutionnaires ».
[3] [107] Voir sur cette question : "La domination réelle" du capital et les réelles confusions du milieu politique", Revue internationale, n° 60.
[4] [108] Voir sur cette question : "La décomposition du capitalisme", Revue internationale n° 57, et l'article de ce numéro.
[5] [109] Voir "Des difficultés accrues pour le prolétariat", Revue internationale, n°60.
[6] [110] Voir "Le milieu politique depuis 1968", Revue internationale, n° 53-54-56.
Courants politiques:
Heritage de la Gauche Communiste:
Revue Internationale no 63 - 4e trimestre 1990
- 2683 reads
Golfe persique : le capitalisme, c'est la guerre
- 3259 reads
Au moment où nous écrivons, les forces armées américaines encerclent et asphyxient l'Irak. De toute évidence, nous allons vers un affrontement meurtrier dont les populations de la région vont faire les frais, victimes des privations, victimes des bombardements, des gaz, de la terreur. Victimes de la guerre. Victimes du capitalisme.
L'invasion du Koweït par l'Irak résulte fondamentalement de la nouvelle situation historique ouverte par l'effondrement du bloc de l'Est. Elle est aussi une manifestation de la décomposition croissante qui touche le système capitaliste. Et le gigantesque déploiement de forces armées des grandes puissances, essentiellement des USA à vrai dire, révèle, pour sa part, la préoccupation croissante de ces dernières à l'égard du désordre qui s'étend de plus en plus. Mais, à terme, les réactions des grandes puissances ne pourront donner que le résultat inverse de celui attendu, se transformant en un facteur supplémentaire de déstabilisation et de désordre. A terme, elles ne peuvent qu'accélérer encore la chute dans le chaos et y entraîner l'humanité entière. Il n'est qu'une seule force qui puisse offrir une alternative, c'est le prolétariat mondial. Et cette alternative a pour nom : le communisme.
Que n'a-t-on entendu depuis la disparition du bloc de l’Est ? Une ère nouvelle de paix et de prospérité s'ouvrait. En collaborant, les USA et PURSS allaient permettre d'en terminer avec les conflits qui n'ont cessé de ravager le monde depuis 1945. Perpétuant le mensonge stalinien sur le caractère socialiste de l'URSS et des pays de l'Est, la bourgeoisie occidentale proclamait la victoire du capitalisme sur "le communisme", sur "le marxisme". Les pays de l'Est allaient connaître les délices du capitalisme sous sa forme occidentale et leur marché relancer l'économie mondiale. Le meilleur des mondes enfin s'offrait à nous. Marx était rangé au rayon des vieilleries, au mieux une curiosité. Lénine était triomphalement sacré "le mort de l'année" dans la presse. Certains idéologues bourgeois, enthousiastes, allaient même jusqu'à proclamer la fin de l'histoire !
Six mois. Six mois auront suffi pour mettre à bas toutes ces chimères, tous ces mensonges. Comme l'affirmaient et continuent d'affirmer les groupes communistes, les organisations qui sont réellement fidèles au marxisme, le capitalisme s'enfonce inexorablement dans la catastrophe économique ([1] [112]). Les pays de la périphérie, dits du "tiers-monde", sont un enfer quotidien pour l'immense majorité de leurs habitants ; un enfer qui ne cesse d'empirer. Les pays de l'ex-bloc de l'Est plongent du marasme économique propre au capitalisme d'Etat stalinien, dans le désastre le plus complet et le plus dramatique pour des millions d'êtres humains. Sans espoir aucun d'amélioration, ni même d'arrêt dans la détérioration. Les USA entrent dans la récession ouverte, et ouvertement reconnue par la bourgeoisie elle-même. C'est la première puissance économique qui chute, entraînant déjà, telle la Grande-Bretagne, les principaux pays industriels du monde.
Six mois plus tard, les grandes proclamations sur la paix sont réduites à néant par le conflit au Moyen-Orient. Et, "le mort de l'année", Lénine, revient affirmer avec force qu"'e/2 régime capitaliste, et particulièrement à son stade impérialiste, les guerres sont inévitables". ([2] [113])
L'illusion n'aura duré que six mois. Les masques tombent et la réalité du capitalisme en décomposition s'impose à tous, barbare, implacable, faite de misère, de faim, de catastrophes, de chantages et de prises d'otages, d'assassinats et de répressions, de massacres, de guerres, réalité de sang et de boue comme disait déjà K. Marx en son temps à propos d'un capitalisme encore en plein développement, et qui se révèle bien pire dans sa période actuelle de sénilité.
Les mensonges s'effondrent et la nouvelle situation historique, ouverte par l'effondrement des pays capitalistes d'Etat staliniens et la disparition des deux blocs impérialistes Ouest et Est, loin d'ouvrir une période de paix, nous apparaît dans toute son horreur. La fin de la "Guerre froide" ne signifie pas la fin des conflits impérialistes.
"Dans la période de décadence du capitalisme, TOUS les Etats sont impérialistes et prennent les dispositions pour assumer cette réalité: économie de guerre, armements, etc. C'est pour cela que l’aggravation des convulsions de l’économie mondiale ne pourra qu'attiser les déchirements entre ces différents Etats, y compris, et de plus en plus, sur le plan militaire. La différence avec la période qui vient de se terminer, c'est que ces déchirements et antagonismes, qui auparavant étaient contenus et utilisés par les deux grands blocs impérialistes, vont maintenant passer au premier plan. La disparition du gendarme impérialiste russe, et celle qui va en découler pour le gendarme américain vis-à-vis de ses principaux 'partenaires' d'hier, ouvrent la porte au déchaînement de toute une série de rivalités plus locales. Ces rivalités et affrontements ne peuvent pas, à l'heure actuelle, dégénérer en un conflit mondial (même en supposant que le prolétariat ne soit plus en mesure de s'y opposer). En revanche, du fait de la disparition de la discipline imposée par la présence des blocs, ces conflits risquent d'être plus violents et plus nombreux, en particulier, évidemment, dans les zones où le prolétariat est le plus faible." {Revue Internationale n°61, 10 février 1990).
Six mois plus tard, la réalité de la société capitaliste, réalité d'un système pourrissant, se décomposant et s'enfonçant chaque jour plus dans le chaos, est venue avec éclat confirmer nos propos d'alors.
L’invasion du Koweït par l'Irak est un moment de la chute dans le chaos.
La prospérité et la paix, nous disait-on après la chute du mur de Berlin. La crise et la guerre, oui ! Voilà ce que signifie le conflit au Moyen-Orient. La guerre avec l'Irak n'est pas simplement le fait d'un nouvel "Hitler". Après les événements d'Europe de l'Est, elle est une autre manifestation d'ampleur de la période de décomposition que vit le capitalisme. Elle est le produit de la nouvelle situation historique ouverte avec l'effondrement du bloc de l'Est, le produit de la tendance croissante à la perte de contrôle de la situation par la bourgeoisie mondiale, du développement du chacun pour soi, de la guerre de tous contre tous, de l'instabilité et de l'anarchie croissante du monde capitaliste.
Contrairement à ce qu'on nous rabâche, l'aspect marquant dans la crise du Golfe n'est pas tant l'unanimité des grandes puissances pour condamner et contrer l'Irak - nous y reviendrons - mais bel et bien, le fait nouveau qu'un pays comme l'Irak s'aventure à défier l'ordre établi dans la région par la première puissance mondiale, sans l'assentiment, le soutien, d'une autre grande puissance. Hier, c'est-à-dire il y a encore un an, Saddam Hussein eut été vite ramené à la raison par la logique supérieure de l'opposition des deux blocs impérialistes. Aujourd'hui, son aventure a déjà irrémédiablement changé et déstabilisé tout le Moyen-Orient. Ce sont maintenant tous les pays de la région, ceux de la péninsule arabe, la Jordanie, la Syrie même, qui entrent dans une ère d'instabilité. C'est toute la région qui tend à se "libaniser" à son tour.
Inévitablement, les conflits de ce type, de plus en plus nombreux, de plus en plus incontrôlés par les grandes puissances, vont se multiplier dans le monde à cause de la catastrophe économique qui touche tous les pays, petits ou grands et d'une situation mondiale où a cessé d'exister la discipline de chacun des deux blocs. De ce fait, les petits Etats dans l'impasse sont de plus en plus poussés dans des aventures militaires.
Après la guerre contre l'Iran, horrible boucherie qui a fait un million de morts, l'Irak s'est retrouvé avec une dette de plus de 70 milliards de dollars pour une population de 17 millions d'habitants (4 000 dollars de dette par personne, femmes, enfants et vieillards compris !) et une armée... d'un million de soldats.
Le pays est incapable de rembourser quoi que ce soit. Complètement asphyxié, il n'avait pas d'autre alternative que de jouer son va-tout avec la seule carte à sa disposition : la plus grande armée de la région. Non seulement, il a essayé de réaliser un hold-up sur le trésor du Koweït, mais aussi de s'affirmer comme la puissance dominante de toute cette partie du monde, si importante du point de vue économique et stratégique. C'est là l'inéluctable voie, impérialiste, que la situation de crise économique croissante et la décadence de la société capitaliste imposent de suivre à tous les Etats. Et qui, de manière encore plus exacerbée dans la période de décomposition, mènent de la guerre commerciale à la guerre impérialiste.
Hussein n'est pas qu'un fou. Il est aussi l'homme de la situation, le produit du capitalisme, du capitalisme actuel. Il est la créature même de ceux qui le combattent aujourd'hui. Hier, les grandes puissances occidentales n'avaient pas assez de mots pour louer sa clairvoyance, son courage, son mérite, sa grandeur, quand l'Irak se faisait l'instrument de leur politique visant à remettre au pas l'Iran de Khomeiny. Hier, les grandes démocraties occidentales ont elles-mêmes armé l'Irak des engins de morts les plus modernes. Et elles ont continué à le faire sans retenue, ni le moindre état d'âme, alors même qu'il utilisait ces moyens pour bombarder et terroriser les populations civiles des grandes villes d'Iran, et gazer, en Irak même, des villes kurdes.
Elles n'ont arrêté, ou limité les livraisons militaires, que lorsque l'Irak n'a pu payer plus longtemps, et les fournitures, et ses dettes. Voilà ce qu'entend la bourgeoisie mondiale par la défense du "droit international" et des "Droits de l'homme".
Particulièrement répugnante est l'utilisation cynique des milliers d'otages par l'Irak et par... les puissances occidentales. Il est vrai que la prise d'otages par Saddam Hussein est particulièrement odieuse. Elle est le fait d'une bête traquée, encerclée, qui ne sait comment se sortir d'affaire.
Mais elle est surtout utilisée sciemment par la bourgeoisie occidentale pour développer une campagne propagandiste terrible afin de justifier et d'essayer d'enrôler les populations derrière ses objectifs guerriers. Si nécessaire, elle n'hésitera pas à sacrifier les otages, reportant sur le "boucher de Bagdad", comme on le présente aujourd'hui dans la presse bourgeoise, ses propres responsabilités. Est-il besoin de rappeler l'utilisation éhontée des otages de l'ambassade américaine en Iran en 1979 dont on vient de révéler qu'elle 1a permise à la CIA - dont le directeur à l'époque était G. Bush ! - de faire élire Reagan et d'augmenter les crédits militaires. ([3] [114])
N'ayons aucune illusion : tous les moyens, et les plus ignobles, et les plus barbares, la terreur et le terrorisme tout particulièrement, vont être de plus en plus utilisés dans les conflits à venir par les différents Etats. Car, inévitablement d'autres conflits vont surgir, d'autres Hussein armés par les grandes puissances, soutenus par elles, produits par le capitalisme, vont se lancer dans des guerres du même type. Les conflits impérialistes locaux, produits du chaos croissant dans lequel s'enfonce le capitalisme mondial, vont devenir facteur aggravant et accélérateur de ce chaos.
LES USA S'IMPOSENT COMME SEULS CAPABLES DE JOUER LE ROLE DE GENDARME AU NIVEAU MONDIAL
Face à cette tendance irréversible au chaos, les grandes puissances mondiales essayent de réagir. Tout comme les pays occidentaux continuent d'apporter leur soutien à Gorbatchev face à l'explosion et à l'anarchie en URSS, de 1 même, face à l'aventure irakienne, aux dangers de déstabilisations qu'elle contient, ils ne pouvaient rester passifs. L'unanimité des grandes puissances pour condamner l'Irak exprime la conscience du danger et la volonté de limiter et de s'opposer à l'éclatement de ce type de conflits. Non pour la paix universelle évidemment, ni même pour le bien-être des populations, mais pour assurer leur puissance et leur main-mise sur le monde. Ce qu'elles appellent la "paix" et la "civilisation", et qui n'est que l'impérialisme brutal et barbare, le pouvoir du plus fort sur le plus faible. Bien sûr, ce sont les Etats-Unis, la première puissance mondiale, qui ont réagi avec le plus de détermination et d'ampleur. Les mesures de blocus adoptées à PONU ont été imposées avant tout par les USA. L'intervention des forces militaires occidentales s'est faite sous le leadership inflexible de cette puissance.
Ces derniers ne pouvaient laisser, sans réaction, la péninsule arabe plonger dans la guerre, et laisser à l'Irak d'Hussein le contrôle des principales réserves mondiales de pétrole. Surtout, ils veulent mettre le holà aux aspirations impérialistes, aventuristes et guerrières de tous ceux, de plus en plus nombreux de par le monde, qui seraient tentés d'imiter Saddam Hussein.
Le parrain de la mafia toute puissante n'aime pas que des petits truands de quartier se croient tout permis, et gênent la bonne marche des affaires en provoquant des braquages intempestifs qu'il n'a pas autorisés. De plus, il ne peut accepter que son autorité, et la peur qu'il inspire, soient mises en question. De là vient le formidable déploiement militaire américain, non seulement pour laver l'affront dans le sang, pour punir l'Irak, et probablement même se débarrasser d'Hussein, mais aussi pour faire un exemple aux yeux du monde et tenter de porter un coup d'arrêt au développement du chaos.
L'engagement américain est le plus important depuis la guerre du Vietnam et s'appuie sur la plus grosse opération logistique depuis la seconde Guerre mondiale, selon les généraux US. Plus de 100 000 hommes se trouvent déjà sur le terrain en Arabie Saoudite. Deux porte-avions dans la mer d'Oman, et deux autres en Méditerranée. Les bombardiers les plus sophistiqués, les F-lll et les F-117, dits "furtifs" car indétectables, sont basés en Turquie et en Arabie. Jusqu'à 700 avions, dont 500 de chasse, sont présents du côté américain. D'innombrables missiles sont braqués sur l'Irak. Bien que cette information soit supposée secrète, les journalistes bourgeois admiratifs et va-t-en guerre, tout excités à l'approche de la guerre franche et joyeuse, nous révèlent que des sous-marins nucléaires d'attaque sont présents autour des porte-avions. De la mer d'Oman, ou de l'Ouest de Chypre, ils pourraient bombarder Bagdad avec une précision de 500 mètres nous dit-on. Mais, ce n'est rien à côté des missiles de croisière que peuvent lancer les cuirassés américains également présents qui peuvent, eux, frapper une cible à Bagdad à quelques mètres près. Fantastique, non ? Pour les journalistes : une merveille d'efficacité. A vrai dire, un cauchemar.
Un cauchemar parce que nous savons très bien que la bourgeoisie, quelle que soit sa nationalité, est tout à fait capable de bombardements massifs de civils. Parce que nous savons très bien que la bourgeoisie américaine, saluée par ses alliées de l'époque, n'avait pas hésité à balancer des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki en août 1945 alors que le Japon demandait l'armistice depuis un mois, simplement # pour arrêter l'avancée de... l'URSS en Extrême-Orient ([4] [115]). Parce que l'aviation US a montré son savoir-faire sur cible réelle et humaine en bombardant Panama (décembre 1989), les quartiers pauvres de préférence, faisant 10 000 morts, tout comme Tripoli (mars 1986). Parce que nous savons très bien que Bush et ses alliés peuvent décider de raser Bagdad - avec ou sans otages - pour faire un exemple, tout comme Saddam Hussein avait gazé la population kurde. C'est le capitalisme, le meilleur des mondes, qui prend des millions d'êtres humains en otages et n’hésite pas à les sacrifier quand nécessaire.
Les armes déployées sont en quantités énormes et incroyablement meurtrières. Bush a menacé de riposter à l'utilisation de gaz par l'Irak par d'autres gaz, et même par des moyens atomiques. L'horreur se banalise et la menace de l'emploi de l'arme nucléaire devient naturelle, dans l'ordre des choses. Plus personne ne s'en offusque. Pas même les pacifistes bourgeois qui ne sont pacifistes en général qu'en temps de paix, et d'autant plus violemment bellicistes lorsque éclatent les conflits.
Mais l'hypocrisie et le cynisme ne s'arrêtent pas là. Certes, discrètement, il apparaît que les USA auraient délibérément laissé l'Irak s'engager dans l'aventure guerrière. La presse bourgeoise internationale a fait part d'informations dans ce sens. Par exemple, les services de renseignement français "ne s'interdisent pas dépenser que les services américains disposaient d'informations précises tendant à prouver les préparatifs irakiens d'invasion du Koweït (...) Auraient-ils profité de cette 'circonstance attendue', selon le mot d'un haut fonctionnaire, pour justifier un face à face militaire depuis plusieurs mois ? Les arrière-pensées américaines n'auraient-elles pas consisté à attendre que M. Saddam Hussein aille 'à la faute', provoquant de lui-même l'occasion pour les Etats-Unis sinon de le renverser, du moins de détruire, 'en toute légitimité', des infrastructures militaires irakiennes stratégiques susceptibles de doter le régime de Bagdad de l'arme nucléaire ?" ([5] [116]). Vrai ou faux, et c'est sans doute vrai ([6] [117]), cela nous éclaire sur les moeurs et les pratiques de la bourgeoisie, sur ses mensonges, ses manipulations, sur l'utilisation qu'elle fait des événements. Si c'est vrai, et c'est sans doute vrai, on mesure encore mieux l'utilisation cynique qu'elle fait des milliers d'otages retenus par l'Irak pour préparer les "opinions publiques" à l'intervention militaire directe.
Mais vrai ou faux, il n'empêche que l'Irak n'avait pas le choix comme nous l'avons vu précédemment. Ce pays était acculé à une telle politique. Et les USA ont laissé faire, favorisé et exploité l'aventure guerrière de Saddam Hussein, conscients qu'ils étaient de la situation de chaos croissant, conscients de la nécessité de faire un exemple.
L'URSS : une puissance impérialiste de second ordre
Chaque jour il se confirme que l'URSS est tombée au niveau d'une puissance de deuxième ordre. Dans ce conflit, en dépit de la perte du marché irakien pour ses armements, elle n'avait pas d'autre issue que de se ranger derrière la politique et la puissance américaines. C'est ce qu'elle a fait depuis le début, tout particulièrement à l'ONU. De ce point de vue, l'attitude des Etats-Unis envers Gorbatchev est significative : Bush n'hésite pas à le convoquer quand il l'estime nécessaire. Certes à Helsinki, il y met des formes. Mais celles-ci doivent être comprises comme une aide visant à renforcer le pouvoir fragile de Gorbatchev en URSS même, en échange, évidemment, de son soutien dans le conflit avec l'Irak.
L'économie de l'URSS, dont le délabrement atteint des niveaux hallucinants, dépend de façon croissante du soutien des pays occidentaux. Les émeutes se multiplient contre les pénuries. L'absence de tabac et de vodka ont donné lieu à des violentes émeutes faisant de nombreux blessés. Même les biens de première nécessité, comme le pain, commencent à manquer ! De véritables famines ne sont plus très loin.
La situation de guerre civile dans laquelle se trouve un grand nombre de Républiques - dont presque toutes se sont déclarées souveraines ou indépendantes -, les pogroms et les massacres entre nationalités, les affrontements au sein même des communautés entre milices rivales (Arménie), en disent long sur l'état d'éclatement et de désordre dans lequel se trouve l'URSS. Sa principale préoccupation : que le chaos externe, et particulièrement au Moyen-Orient, si proche de ses frontières et de ses républiques musulmanes, se développe sans retenue et vienne à son tour aggraver encore le chaos, déjà dramatique, interne à l'URSS. Voilà pourquoi, elle se range derrière les USA dans le conflit. On est loin de la situation où l'URSS, à la tête du bloc de l'Est, tentait de verser de l'huile sur le feu du moindre conflit local afin de remettre en cause un statu quo favorable au bloc occidental.
Sa faible participation à l'opération de police du Golfe, dont, pourtant, elle partage pleinement les objectifs, révèle l'état d'affaiblissement de sa puissance militaire, qui ne peut pas se mesurer en nombre de navires, avions, missiles, tanks et soldats, mais en niveau de désagrégation d'une "Armée rouge" déjà incapable de maîtriser la situation interne (comme par exemple de désarmer les milices arméniennes). Les arguments donnés par un officiel russe pour justifier cette faible participation ("contrairement à Vannée américaine, l’armée rouge n'a pas pour vocation d'intervenir en dehors des frontières et ne Va jamais fait") - quel culot !-en dit long sur l'impuissance de l'URSS.
La guerre au Moyen-Orient confirme que l’URSS ne peut plus jouer le rôle de tête d'un bloc impérialiste, qu'elle ne peut avoir la moindre politique étrangère propre. En moins d'un an, l’ex-deuxième puissance mondiale a été ramenée à un statut inférieur à celui de l'Allemagne, du Japon et même de la Grande-Bretagne ou de la France.
Le nouvel ordre impérialiste : la guerre de tous contre tous
L'ampleur des moyens militaires mis en oeuvre par les USA et l'intransigeance dont ils font preuve, témoignent de leur volonté de mettre à profit la situation créée par l'aventure irakienne pour affirmer clairement leur "leadership" sur l'ensemble du monde. Alors que le Japon ou les pays européens (en particulier l'Allemagne) pourraient être tentés, à la faveur de la disparition de toute menace provenant de l'URSS, de rompre quelque peu la discipline qu'ils avaient observée jusqu'à présent, et de pousser leurs avantages économiques face à une économie américaine de moins en moins compétitive, la démonstration de force des Etats-Unis permet fort opportunément à ce pays de faire la preuve qu'il est le principal "gendarme" du monde.
D'ores et déjà, les USA vont sortir renforcés de cette guerre locale vis-à-vis des autres grands pays avancés qui auront fait la preuve de leur impuissance pour assurer la stabilité du monde par eux-mêmes. Avec la tendance croissante à une dislocation de tout le système de relations internationales, il revient bien aux seuls Etats-Unis de ne plus compter sur aucun autre pays pour faire la police dans une zone aussi cruciale, et dont l'instabilité ne disparaîtra pas après la punition infligée à l'Irak. Les Etats-Unis sont décidés à maintenir une présence militaire massive au Moyen-Orient. Les premières déclarations d'officiels parlent déjà de rester au moins jusqu'en 1992.
De plus, le contrôle américain sur cette région du monde, éminemment stratégique, première réserve de pétrole de la planète, va se trouver accentué. Or, ce contrôle va se révéler précieux dans le cadre de l'accentuation de la guerre commerciale avec l'Europe et Je Japon.
Et afin de lever tout malentendu éventuel, la presse américaine met les points sur les "i", profitant du marchandage sur la participation aux frais de l'opération US "Bouclier du désert" : "ni l'Allemagne, ni le Japon n'ont commencé à contribuer à un niveau équivalent à leur besoin d'un approvisionnement sûr en pétrole. Bien sûr, Bonn est occupée par la réunification. Cependant, l'Allemagne aurait tort de sous-estimer sa dette face au sacrifice américain. C'est encore plus vrai pour Tokyo." ([7] [118])
Nous le voyons, l’unanimité des grands pays industrialisés pour condamner et contrer l'Irak n'est pas le produit d'une bonne volonté pacifique, comme l'a présentée la presse bourgeoise, mais le fruit d'un rapport de forces entre elles, dans lequel les USA imposent leur domination militaire, et dans lequel aucune autre puissance ne se dégage pour jouer le rôle, tenu par l'URSS auparavant, de chef d'un bloc impérialiste antagonique. Dans ce sens, l'unanimité entre les grandes puissances pour condamner l'Irak, n'est pas le produit de la paix, ni un facteur de paix, mais le produit des rivalités d'intérêts impérialistes et facteur d'aggravation de celles-ci.
Cette unanimité, imposée, a mis en évidence aux yeux des bourgeoisies allemande et japonaise leur impuissance politique, alors qu'elles sont des "géants économiques". D'où des déclarations croissantes en leur sein, pour changer leurs Constitutions héritées de la défaite de 1945, qui limitent leurs forces armées et leur champ d'intervention. On ne peut être plus clair sur ce que signifie, pour la bourgeoisie, la diplomatie et la politique internationale : c'est la diplomatie et la politique des armes, de la force militaire. Mais même si des changements sont adoptés dans ces Constitutions, il en coûtera de l'argent, et surtout du temps, avant que ces deux pays puissent se doter d'une force militaire adaptée à leurs ambitions impérialistes, c'est-à-dire capable de rivaliser avec les USA sur ce terrain.
Le capitalisme précipite l'humanité dans le gouffre de la barbarie.
Au moment où nous écrivons, depuis le 2 Août, jour de l'invasion du Koweït, aucun élément n'est venu contredire, ou ralentir, la dynamique vers une action militaire US contre l'Irak. Toutes les démarches diplomatiques apparaissent clairement pour ce qu'elles sont : une préparation à la guerre. D'ailleurs, toutes les offres de négociation proposées par Hussein ont été rejetées par Bush qui exige que l'armée irakienne se retire du Koweït. C'est à ce prix, et encore ce n'est même pas sûr, que la guerre pourrait être évitée. Ce retrait constituerait pour Saddam Hussein un suicide politique et, sans doute aussi, un suicide tout court. On le voit mal, maintenant, se plier au diktat des grandes puissances. Il ne peut qu'aller de l'avant dans son aventure.
Dans un premier temps, l'intervention US va marquer un coup d'arrêt à la déstabilisation au Moyen-Orient. Mais juste un coup d'arrêt, et non un renversement de la tendance croissante à la "libanisation" de la région. De même, elle va tendre à marquer un coup d'arrêt à l'éclatement de ce genre de conflit dans le monde, mais, là aussi, sans réussir à inverser la tendance. Car la remise en ordre, leur ordre, que les USA vont imposer, sera basé sur la force militaire. Et uniquement sur celle-ci. Or un ordre basé sur la terreur n'est jamais tout à fait stable, et encore moins aujourd'hui, dans une période de crise économique mondiale catastrophique, de tensions locales croissantes. Le futur est à l'explosion des guerres locales et civiles. Et ce futur est proche. A vrai dire, il est même déjà, en grande partie, le présent.
Tant de conflits existent. Les affrontements militaires sont réguliers à la frontière entre le Pakistan et l'Inde. Et ces deux pays, eux, sont déjà dotés de la bombe atomique... La guerre en Afghanistan se poursuit sans discontinuer, meurtrière. Au Cambodge. Au Liban. La liste est longue. C'est ça, le capitalisme.
Au Libéria, la population est livrée à la terreur depuis des mois (2 000 Ghanéens pris en otages), aux viols, aux exactions et massacres de bandes armées, essentiellement tribales, ivres de sang et de tueries. Et cela, d'ailleurs, sous l'oeil impavide des médias occidentaux et d'une flottille militaire US ancrée au large de Monrovia. Mais le Libéria ne présente pas d'intérêts économiques et stratégiques comme le Moyen-Orient.
En fait, c'est une grande partie de l'Afrique que les bourgeoisies occidentales abandonnent à sa détresse. Le désintérêt croissant des grandes puissances pour la situation de chaos qui prévaut en Afrique en dit long, à la fois sur leur cynisme et leur impuissance à contrecarrer la chute dans la décomposition.
Car l'Afrique est particulièrement exemplaire de ce que nous prépare le capitalisme pourrissant sur pied. Les émeutes, les massacres, les guerres, de plus en plus nombreuses, et de plus en plus meurtrières, presque toujours d'ordre tribal, se multiplient : au Libéria, nous l'avons vu, mais aussi au Soudan, en Ethiopie, dans les anciennes colonies françaises, en Afrique du Sud même, opposant les partisans de Mandela aux partisans de Buthelezi, etc. Est-il besoin de rappeler ici les famines, les épidémies de maladies qui avaient pratiquement disparu (comme le paludisme), du Sida, etc., tout cela au milieu d'une corruption effrénée. Mais n'est-ce pas là ce qui se passe aussi déjà dans nombre de pays d'Asie, voire en URSS ? Et c'est la seule perspective que peut nous offrir aujourd'hui le capitalisme.
Cette plongée dans le gouffre de la misère la plus noire s'accompagne d'une décomposition de toutes les valeurs d'ordre moral que pouvait avoir le capitalisme. On le voit très bien avec le conflit au Moyen-Orient. L'impudence, l'hypocrisie, le mensonge et la corruption à tous les niveaux, le gangstérisme et le chantage à échelle planétaire sur la vie de millions d'êtres humains, le terrorisme aveugle, le meurtre et l'assassinat, sont érigés en principes de gouvernement. Ils sont même la marque de l'homme d'Etat accompli : est un grand stratège celui qui prend eh otage des milliers d'hommes. Est encore plus grand et respecté celui qui n'hésitera pas à sacrifier ces mêmes otages sur l'autel des principes et du droit bourgeois.
Que ce soit au niveau économique, social, politique, idéologique, au niveau même de sa morale et de ses principes, ce système a fait faillite et entraîne de plus en plus vite l'humanité entière dans la catastrophe économique et guerrière.
La classe ouvrière mondiale est la seule force qui puisse présenter une autre perspective
"Historiquement, le dilemme devant lequel se trouve l'humanité d'aujourd'hui se pose de la façon suivante : chute dans la barbarie, ou salut par le socialisme. (...) Ainsi nous vivons aujourd'hui la vérité que justement Marx et Engels ont formulée pour la première fois, comme base scientifique du socialisme dans le grand document qu'est le Manifeste Communiste : le socialisme est devenu une nécessité historique (...) non seulement parce que le prolétariat ne veut plus vivre dans les conditions matérielles que lui préparent les classes capitalistes, mais aussi parce que, si le prolétariat ne remplit pas son devoir de classe en réalisant le socialisme, l'abîme nous attend tous, tant que nous sommes. " ([8] [119])
Soixante-douze ans plus tard, ces paroles sont toujours d'actualité. Elles pourraient avoir été écrites aujourd'hui. Seule la classe ouvrière mondiale, le prolétariat, peut offrir l'unique perspective alternative à l'effroyable cataclysme du capitalisme en putréfaction : le communisme.
La terrible récession ouverte qui commence aux USA, et par contrecoup sur l'économie mondiale, va représenter pour l'ensemble du prolétariat mondial, et tout particulièrement des pays industrialisés d'Europe, des attaques encore exacerbées sur leurs conditions de vie : licenciements par millions, salaires en baisse, conditions de travail aggravées comme jamais, etc. alors qu'il subit déjà depuis longtemps une détérioration drastique de sa situation, détérioration qui s'est déjà énormément accélérée ces derniers mois. Et qui plus est, la bourgeoisie mondiale profite, sans attendre, du conflit au Moyen-Orient, pour faire passer les sacrifices au nom de l'unité nationale et du... choc pétrolier. On nous l'a déjà fait deux fois ce coup-là ! C'est clair : ce sont les ouvriers qui vont payer la note de l'intervention militaire, les ouvriers en uniforme enrôlés dans l'armée irakienne, mais aussi ceux des pays occidentaux.
La classe ouvrière ne doit pas céder aux sirènes de l'unité nationale et de la défense de l'économie capitaliste. Elle ne doit pas suivre la bourgeoisie et prendre part au conflit contre l'Irak. Ce conflit n'est pas le sien. Elle a tout à y perdre et rien à y gagner. Son combat, le seul terrain sur lequel elle puisse se battre, c'est celui de la lutte contre le capitalisme comme un tout, c'est la lutte pour la défense de ses conditions de vie, contre les attaques économiques, contre l'austérité et les sacrifices, contre la logique du capital qui ne conduit qu'à la misère et à la guerre, partout dans le monde, mais aussi contre l'unité nationale, contre la défense de la nation et de la démocratie bourgeoise dans tous les pays.
Aujourd'hui, un an après la dislocation du stalinisme et l'effondrement du bloc de l'Est, après l'énorme propagande sur la victoire du capitalisme et la paix, il est clair pour tout ouvrier que le capitalisme mondial est dans une faillite insoluble et irréversible. Il est tout aussi clair que le capitalisme décadent, c'est inévitablement la guerre impérialiste. Crise et guerre sont deux moments du capitalisme qui ne font que s'alimenter et se renforcer l’un l'autre. Les deux faces d'une même pièce. Mais en plus, fait historique nouveau, la pièce se décompose entraînant avec elle l'ensemble de l'humanité dans un cours où crise et guerre vont de plus en plus tendre à s'entremêler, à se confondre.
Plus l'agonie du capitalisme se prolonge, plus dévastateurs sont ses ravages de tout ordre. La décomposition du rapport social qu'est le capital, en se prolongeant, commence à hypothéquer chaque fois un peu plus la perspective même de la révolution prolétarienne, et à handicaper la construction future du communisme. La destruction massive et croissante de forces productives, usines, machines, ouvriers rejetés de la production, la destruction de l'environnement, des campagnes, l'accroissement anarchique de villes-dépotoirs de millions d'êtres humains, vivant dans des conditions atroces, la plupart du temps sans travail, l’atomisation et la destruction des rapports sociaux, les dégâts causés par les nouvelles épidémies, la drogue, la faim, les guerres - et nous en oublions -, autant de drames et de catastrophes qui rendront plus difficile la construction de la société communiste.
Les enjeux deviennent de plus en plus dramatiques. Le prolétariat ne dispose pas d'un temps illimité pour accomplir sa tâche historique. Révolution prolétarienne triomphante ou destruction de l'humanité, telle est l'alternative. Pour le prolétariat, il n'est d'autre voie que la destruction du capitalisme et la construction d'une autre société, où la faim, la guerre et l'exploitation auront disparu.
Le chemin jusqu'à la société communiste sera long et ardu. Mais il n'en est pas d'autre.
RL. 4/9/90
"Souillée, déshonorée, pataugeant dans le sang, couverte de crasse ; voilà comment se présente la société bourgeoise, voilà ce qu'elle est. Ce n'est pas lorsque, bien léchée et bien honnête, elle se donne les dehors de la culture et de la philosophie, de la morale et de l'ordre, de la paix et du droit, c'est quand elle ressemble à une bête fauve, quand elle danse le sabbat de l'anarchie, quand elle souffle la peste sur la civilisation et l'humanité qu'elle se montre toute nue, telle qu'elle est vraiment...
"Nous sommes placés aujourd'hui devant ce choix : ou bien triomphe de l'impérialisme et décadence de toute civilisation, avec pour conséquences, comme dans la Rome antique, le dépeuplement, la désolation, la dégénérescence, un grand cimetière ; ou bien, victoire du socialisme, c'est à dire de la lutte consciente du prolétariat international contre l'impérialisme et contre sa méthode d'action : la guerre. C'est là un dilemme de l'histoire du monde, un ou bien-ou bien encore indécis dont les plateaux balancent devant la décision du prolétariat conscient. Le prolétariat doit jeter résolument dans la balance le glaive de son combat révolutionnaire : l'avenir de la civilisation est de l'humanité en dépendent."
Rosa Luxembourg, Brochure de Junius.
[1] [120] Voir l'article sur la crise dans ce numéro.
[2] [121] Lénine, Résolution sur "Le pacifisme et la consigne de la
paix" de la Conférence des sections du POSDR à l'étranger, mars 1915.
[3] [122] Un ancien membre de la CIA a récemment fait des déclarations (reproduites par divers journaux dans différents pays : Libération en France, Cambio 16 en Espagne), rendant compte d'accords secrets établis entre la CIA et les autorités iraniennes de l'époque, pour faire durer suffisamment longtemps la prise d'otages afin d'assurer la défaite de Carter aux élections...
[4] [123] Comme le rappellent le New-York Times et Le Monde Diplomatique, août 1990.
[5] [124] "Le Monde", 29/8/90.
[6] [125] Ce ne serait pas la première fois que la bourgeoisie américaine procède de cette façon. Ainsi, à une échelle bien plus vaste, cette bourgeoisie a eu l'occasion de tendre la perche à son futur ennemi pour que celui-ci fasse le premier pas dans une guerre devenue inévitable et se présente de la sorte comme l'"agresseur". Il s'agit de l'attaque japonaise du 8 décembre 1941 contre la flotte américaine du Pacifique basée à Pearl Harbour (Hawaii), qui provoqua l'entrée officielle des USA dans la seconde guerre mondiale. Il a été clairement démontré, à posteriori, que c'est le président américain Roosevelt qui a tout fait pour inciter le Japon à prendre une telle initiative, notamment en réduisant au minimum les moyens de défense de la base (la presque totalité des soldats US étaient en permission) alors qu'il savait pertinemment que ce pays s'apprêtait à entrer dans la guerre. L'attaque japonaise de Pearl Harbour allait ainsi permettre de constituer, autour de Roosevelt, l'"union nationale" pour la guerre et faire taire les résistances, tant dans la population que dans certains secteurs de la bourgeoisie US, contre cette politique.
[7] [126] "As for Germany and Japon, neither has begun to contribute at a level equal to its need for secure oil suppty. To be sure, Bonn is preoccupied with reunification. Yet Germany would be shortsighted to underestimate its debt to America's sacrifice. That is even more true for Tokyo", The New-York Times for the International Herald Tribune, 31/8/90.
[8] [127] Rosa Luxembourg, Discours sur le Programme du Parti Communiste Allemand, dec. 1918, édition Spartacus.
Géographique:
- Irak [128]
Questions théoriques:
- Décomposition [3]
- Guerre [129]
Crise économique : le pétrole : un faux alibi pour une vrais crise
- 6283 reads
La récession de l'économie américaine est là. L'annonce officielle en a été faite dans la presse du monde entier. L'explication qu'en donne la bourgeoisie mondiale est toute trouvée : c'est la faute du renchérissement du cours du pétrole, c'est la faute du dictateur irakien Saddam Hussein et de son coup de force au Koweït. Et les classes dirigeantes du monde entier, désolées, s'empressent d'annoncer ce que tout cela va signifier, dans un proche avenir, pour les prolétaires : moins de croissance, et donc des licenciements, une inflation en hausse et une attaque contre les salaires et le niveau de vie, bref, plus de misère et de pauvreté. Mais évidemment, les travailleurs n'auront qu'à s'en prendre au grand responsable de cette situation, au bouc émissaire tout trouvé dans le contexte de xénophobie antiarabe et anti-islamique cultivé depuis des années : la brute sanguinaire Saddam Hussein. Ce n'est pas la première fois que la bourgeoisie mondiale nous ressort ce scénario, c'est déjà celui qui a servi après le choc pétrolier de 1973 pour justifier la récession de 1974 ; à cette époque, ce sont les émirs cupides de la péninsule arabe qui étaient montrés du doigt ; la récession de 1981, elle, a trouvé son explication avec ce qui a été appelé le "deuxième choc pétrolier", attribué à la folie des mollahs et de Khomeiny. Aujourd'hui, le même mensonge éculé, mais qui a cependant montré par le passé son efficacité idéologique, nous est servi sur un plateau par les médias du monde entier.
Cette explication de la crise et de la récession de l'économie mondiale par les fluctuations brutales du cours du pétrole, liées à l'instabilité politico-militaire de la principale région productrice de l'or noir, le Moyen-Orient, est un pur mensonge de la propagande capitaliste destiné à cacher la véritable nature de la crise économique, son origine, ce qui la détermine réellement. La crise ouverte de l'économie mondiale, qui s'aggrave constamment depuis plus de vingt ans, est le produit des contradictions insolubles du mode de production capitaliste, lequel est en train d'entraîner l'ensemble de l'humanité dans sa banqueroute catastrophique.
Cette vérité de la tragédie historique où mène la domination du capital, la classe dominante, la bourgeoisie, qui contrôle la destinée du monde, s'efforce évidemment par tous les moyens de la cacher, car elle porte en germe la nécessité de sa propre disparition et celle du système capitaliste qui l'a fait naître.
Quelle récession ?
Depuis la récession de 1981-1982, la bourgeoisie occidentale, à l’unisson des rodomontades d'un Ronald Reagan, n'a cessé tout au long des années 1980 de célébrer la santé retrouvée de l'économie mondiale et d'aligner les chiffres montrant la croissance record et l'inflation enfin vaincue. Cependant, cette fameuse croissance et la chute de l'inflation tant saluées relevaient plus d'un trucage grandissant des statistiques économiques et d'une politique artificielle de fuite en avant dans l'endettement et l'économie de guerre que d'une réelle prospérité. Loin des indices officiels trompeusement optimistes des officines étatiques, le prolétariat, avec l'immense majorité de la population mondiale, a subi dans sa chair la dégradation dramatique de la situation économique mondiale durant toutes ces années. Les années 1980 se sont ouvertes avec l'effondrement économique des pays d'Amérique latine, d'Afrique et d'une partie de l'Asie, mettant définitivement fin à leurs rêves de développement, et se sont terminées par l'effondrement de l'économie des pays de l'Est, entraînant la dislocation du bloc russe. Des centaines de millions d'habitants des pays les plus pauvres ont sombré dans la misère absolue, selon un rapport de la Banque mondiale plus d'un milliard d'hommes vivent avec moins de 370 $ par an. La famine s'est étendue (100 000 morts rien qu'au Soudan en 1989), les épidémies se sont développées, non seulement le SIDA mais encore les anciennes maladies sont en pleine recrudescence, tel le paludisme, qui tue deux millions de personnes par an. Dans les pays développés, là où dit-on a régné la prospérité, les conditions de vie se sont profondément dégradées sous les coupes claires des programmes d'austérité permanents, le chômage massif s'est maintenu, tandis que le travail précaire et mal rémunéré s'est développé, la pauvreté a gagné du terrain et une misère inconnue depuis les années noires de la guerre s'est étendue au coeur des métropoles du capitalisme "avancé". Sinistre bilan, bien éloigné de l'euphorie intéressée des chantres de l'économie capitaliste.
Loin de l'enthousiasme de la propagande bourgeoise, les années 1980 ont été en fait des années de récession de l'économie mondiale marquées par un enfoncement dramatique de la planète dans la misère. A l'évidence, il y a deux manières de considérer la situation économique : celle de la bourgeoisie, qui truque ses indices, qui a besoin de faire croire, et dans une certaine mesure de croire elle-même, à la prospérité de son système, et celle des exploités du monde entier, qui, dans le concret des souffrances quotidiennes, ont subi durement la dégradation générale de leurs conditions de vie.
Etat des lieux avant les événements du golfe
Cependant, les chiffres officiels de la classe dominante, s'ils sont un travestissement optimiste de la réalité, n'en expriment pas moins, dans leur évolution, les fluctuations de la situation économique mondiale. En effet, pour les besoins de sa gestion, la classe dominante éprouve aussi la nécessité d'une certaine vérité de ses statistiques. De fait, même si, toutes ces dernières années, les taux de croissance positifs des principales puissances industrielles ont perpétué le mensonge d'une bonne santé de l'économie mondiale, le lent déclin, année après année, mois après mois, traduit l'enfoncement tout à fait réel dans une récession toujours plus profonde.
Depuis de nombreux mois, la croissance industrielle des USA, de la GB, du Canada, de la Suède, de l'Italie, plonge irréversiblement vers la barre fatidique de la croissance zéro. Cela bien avant le coup de force de l'Irak.
Les résultats inquiétants qui sont annoncés aujourd'hui, et qui affolent les bourses du monde entier, sont antérieurs à ce que les journalistes nomment déjà le "troisième choc pétrolier".
Le moteur qui a permis de maintenir l’économie des pays les plus industrialisés à flot est en panne. L'économie américaine est au plus mal. Après la récession du début des années 1980, c'est au travers d'une politique d'endettement faramineuse que les USA ont entamé une relance de leur économie, accumulant des déficits budgétaires et commerciaux inimaginables jusque-là, permettant ainsi au Japon et aux pays industrialisés d'Europe de développer leurs exportations et de faire tourner leur appareil productif.
Les estimations de la dette globale des USA, interne et externe, varient aujourd'hui de 8 000 à 10 000 milliards de dollars, à comparer avec l'évaluation de la dette de l'ensemble des pays sous-développés à 1 300 milliards de dollars en 1989. Au début de l'année 1990, la dette fédérale a atteint le chiffre de 3 120 milliards de dollars, et une nouvelle loi a dû être votée pour autoriser le dépassement de ce seuil. L'endettement extérieur net, c'est-à-dire en défalquant les créances des USA à l'étranger, atteint, fin 1989, 663 milliards de dollars, en croissance de 25 % sur l'année précédente. A ce niveau, les chiffres deviennent surréalistes, et pas plus que n'importe quel pays sous-développé, les Etats-Unis ne sont capables de rembourser leur dette.
Et pourtant, ces injections massives de liquidités n'ont pas permis à la principale puissance économique du globe d'empêcher l'enfoncement irrésistible de son économie dans une nouvelle récession ouverte, tout au plus ont-elles permis de freiner le mouvement. Au dernier trimestre 1989, la croissance était de 0,5 %, au deuxième trimestre 1990, de 1,2 %. Les taux de croissance record du milieu des années 1980 sont définitivement oubliés.
Avec le marasme qui s'approfondit, les bénéfices des sociétés américaines sont en chute libre. Ainsi, pour le premier semestre de 1990, Chrysler et General Motors voient leurs profits se réduire respectivement de 45 % et 39 % par rapport à la même période de l'année précédente. Parmi les géants de l'informatique, en 1989, Unisys a annoncé des pertes de 640 millions de dollars et Wang de 425 millions. En conséquence, les faillites se sont multipliées, et tout à fait significatives ont été les banqueroutes en chaîne de centaines de caisses d'épargne, laissant une ardoise officielle de plus de 500 milliards de dollars (alors que certaines estimations parlent de 1000 milliards) à l'Etat fédéral.
Après avoir été officiellement déclaré vaincu, le chômage, aux USA, recommence à augmenter brutalement, même dans les statistiques officielles truquées : durant le seul mois de juillet 1990, il passe de 5,2 % à 5,5 % de la population active. Et le pire est à venir, pas un jour ne s'écoule sans que de nouvelles réductions d'effectifs ne soient annoncées. Les fleurons de l'industrie technologique américaine, censés être le secteur le plus compétitif, licencient massivement : General Electric, McDonnell-Douglas, Pratt & Whitney, Lockheed, NAS, etc. La liste n'est évidemment pas exhaustive, tous les secteurs sont touchés.
La déroute de l'économie américaine et son enfoncement dans la récession ne peuvent qu'entraîner l'ensemble de l'économie mondiale dans un cours catastrophique. Malgré la persistance d'énormes déficits commerciaux américains, les exportations des pays industrialisés baissent avec le ralentissement de l'économie US. Même les puissances industrielles les plus compétitives sur le marché mondial voient leurs exportations dégringoler : l'excédent commercial du Japon a plongé de 19 % en 1989 et de 22,8 % sur les six premiers mois de 1990, celui- de la RFA sur le premier semestre de 1990 de 8 %, alors que la balance des paiements de ce dernier pays chutait de 18 % d'une année sur l'autre. Quant aux pays industrialisés moins bien lotis, ils commencent déjà à subir la contagion de la récession américaine (selon les statistiques officielles). Il en est ainsi du Canada, dont l'économie est étroitement imbriquée dans celle des USA, qui a vu son PIB diminuer de 0,1 % en avril, de 0,2 % en mai et juin, et de l'Italie dont la croissance industrielle retombe à zéro à la fin du printemps.
A la suite de celle des USA, l'ensemble de l'économie mondiale est en train de plonger. Partout, les mêmes symptômes se manifestent. Les bénéfices des grandes compagnies sont en chute libre, les pertes s'accumulent. Ainsi, dans le secteur informatique européen, Bull (France) annonce 1,8 milliards de francs de pertes sur six mois, et Nixdorf (RFA) a subi 3,3 milliards de francs de pertes en 1989, avant de se faire racheter par Siemens. Les faillites se multiplient, elles sont par exemple en augmentation de 31 % en Suède pour le premier semestre de 1990 et, sur les six premiers mois de 1990, de 30 % en GB par rapport au semestre correspondant de l'année précédente. Quant au chômage, comme conséquence du ralentissement de l'économie, il connaît aussi une nouvelle poussée en Europe : en RFA, il est passé significativement de 6,4 % à 6,6 % de la population active en juillet 1990, et pas un jour ne s'écoule sans que, dans tous les pays d'Europe de l'ouest, ne soient annoncés de nouveaux licenciements, qui préfigurent la future croissance fulgurante de la masse des ouvriers sans emploi, laquelle, selon les chiffres officiels, comptant déjà 25 millions de travailleurs au sein de l'OCDE.
Avec l'effondrement du bloc russe, la bourgeoisie avait cru trouver dans l'ouverture des marchés est-européens un palliatif au ralentissement de l'économie américaine, un nouvel eldorado pour réaliser ses profits. Avec l'accélération de la crise ces derniers mois, le mythe a fait long feu. Sur le plan économique, l'unification de l'Allemagne se révèle être une catastrophe. La production industrielle de la RDA a chuté de 7,3 % en juin tandis que la liste des chômeurs s'allonge vertigineusement au point que l'on envisage pour la période qui vient des taux de chômage de 25 % à 30 % de la population active. La réunification est un puits sans fond pour toute l'économie ouest-allemande, qui prévoit pour l'année 1991 une augmentation de sa dette de 30 %, de 1 000 milliards à 1300 milliards de marks, sans compter le fond spécial prévu de plus de 100 milliards de marks. La réalité sera pourtant, selon toute vraisemblance, encore bien plus désastreuse. La situation des autres pays d'Europe de l'Est est encore pire. Ils n'ont pas, eux, une grande puissance occidentale pour les soutenir, leur dette croît de manière accélérée, la production chute brutalement : pour les six pays anciennement satellites de l'URSS, la production industrielle a plongé de 13,4 % durant le premier semestre de 1990, comparé à la même période de l'année 1989 et les exportations de 14,2 %. Les travailleurs subissent de plein fouet les charmes de l'économie libérale à coups de programmes d'austérité draconiens : durant le seul mois de juin dernier, 125 000 chômeurs de plus se sont retrouvés sur le pavé en Pologne ; en Tchécoslovaquie, début juillet, les prix de 3 000 produits ont augmenté de plus de 25 %.
Voilà l'état des lieux de l'économie mondiale avant le 2 août, jour de l'invasion du Koweït par les troupes irakiennes. La "récession" était déjà là, l'accélération de la plongée dans la crise avait déjà grandement commencé à faire sentir ses effets depuis de longs mois. Les événements du golfe Persique n'ont fait qu'accentuer et accélérer une tendance déjà fortement affirmée de l'économie mondiale vers une plongée dramatique dans un ralentissement toujours plus fort de l'économie.
Ce ne sont pas les menaces de guerre qui sont à l'origine de la crise économique, mais c'est exactement l'inverse, c'est l'approfondissement de la crise économique qui pousse vers les tensions guerrières. La situation de l'Irak à cet égard est parfaitement claire : incapable de rembourser une dette écrasante de 70 milliards de dollars, mais bénéficiant d'une puissance militaire surclassant celle de ses voisins, l'Irak a utilisé son armée pour s'emparer des richesses tentantes du Koweït, et essayer ainsi de surmonter ses difficultés économiques. Les USA aussi, qui constituent pourtant la puissance économique majeure, et de loin, sont poussés, pour défendre leurs intérêts économiques et leur situation de puissance mondiale dominante, à utiliser de plus en plus le gigantesque arsenal militaire qu'ils ont constitué depuis des années. Là où leur puissance économique ne suffit pas à faire prévaloir leurs intérêts, la force des armes est employée de plus en plus pour imposer la discipline.
Bien sûr, le renchérissement du prix du pétrole, qui a été catapulté brutalement de 14 $ le baril à plus de 30, va être un facteur accélérateur, aggravant, de la crise, mais il n'en est pas la cause. En fait, toute la propagande actuelle de la bourgeoisie sert à minimiser l'accélération dramatique de la crise et ses conséquences.
La panique boursière actuelle trouve bien plus son origine dans les résultats catastrophiques des économies des pays développés que dans l'évolution des cours pétroliers. Même si ce dernier élément a été un facteur accélérateur de l'effondrement boursier, il faut à l'évidence constater que depuis l'effondrement des bourses en 1987, les alertes se sont succédées, malgré tous les dispositifs de contrôle mis progressivement en place. Encore récemment, dans une longue glissade au début de cette année, la bourse de Tokyo, devenue le haut heu de la spéculation mondiale, avait déjà perdu 28 %. Le 23 août, cette perte se chiffrait à 39% depuis janvier 1990. D'ailleurs, la chute catastrophique des cours boursiers de l'été 1990 n'a pas commencé avec les hostilités du 2 août mais dès la mi-juillet.
Quelles perspectives ?
La tourmente, qui souffle aujourd'hui sur toutes les places boursières de la planète, annonce l'ouragan qui va secouer l'économie mondiale. Les places boursières, à notre époque, n'ont plus le même rôle central que lors de la crise de 1929. Même si, durant les années 1980, elles étaient devenues un haut lieu de la spéculation où grenouillaient les affairistes de tout poil, elles ne constituaient pas pour autant le coeur de l'économie. Le développement du capitalisme d'Etat, depuis des décennies, a déplacé le centre de gravité du capital vers les officines discrètes des bureaux ministériels. Cependant, l'effondrement boursier actuel est lourd de signification, relativement à l'instabilité grandissante qui menace l'ensemble du système économique mondial dans ses différents aspects : productif, monétaire, financier. Il traduit la perte de confiance de la bourgeoisie dans sa propre économie et manifeste l'impasse où elle se trouve.
La politique menée au lendemain de l'effondrement des valeurs boursières d'octobre 1987 et qui avait permis, en relançant la spéculation, de sauver les apparences d'une santé maintenue de l'économie mondiale n'est plus possible. Cette politique avait été celle de la baisse des taux d'intérêt, celle du crédit facile. Elle a eu pour premier résultat de développer l'inflation sans pour autant permettre une croissance de l'économie réelle : la production, qui a continué a décliner irrésistiblement.
L'inflation, que les chantres de l'économie capitaliste prétendaient avoir vaincue au milieu des années 1980 (et elle avait effectivement, au moins au vu des indices officiels, rejoint un niveau relativement bas) n'a cessé de se développer régulièrement depuis plusieurs années dans les pays industrialisés. Elle est passée ainsi, entre 1987 et 1989, de 3,7 % à 4,8 % aux USA, de 4,2 % à 7,8 % en GB, et globalement, pour les sept grands pays industrialisés de 2,9 % à 4,5 %. Même si ces chiffres paraissent encore faibles par rapport aux records des années 1970, la progression n'en est pas moins très importante sur les deux dernières années : respectivement, selon les exemples cités, les indices ont progressé de 29 %, 85 % et 55 %. Les premiers mois de l'année 1990 ont été marqués par une accélération brutale. D'après les indices de juillet 1990, la progression en rythme annuel a été de 5,6 % aux Etats-Unis et de 9,8 % en GB. Dans les pays de la périphérie, l'inflation, durant les années 1980, a continué sur sa lancée des années 1970, atteignant des sommets inconnus jusqu'alors et des indices à quatre chiffres. L'augmentation brusque des cours du pétrole de l'été va signifier une nouvelle accélération. Les économistes les plus optimistes prévoient que, pour tous les pays industrialisés, celle-ci va se traduire par de nouvelles hausses rapides supérieures à 1 %, et entraîner un retour à la situation inflationniste des années 1970. Quant aux pays du "tiers-monde", nul n'ose prévoir les effets désastreux d'un baril de pétrole à plus de 30 $.
Dans ces conditions, il n'est nulle part question de faire baisser les taux d'escompte des grandes banques centrales au moment où, sous la poussée des tarifs pétroliers, l'inflation flambe. Au contraire, partout, les taux d'intérêts sont à la hausse, rendant le crédit toujours plus cher. Il y a déjà quelques années, Volker, le président d'alors de la Banque fédérale, avait déclaré : "La question de la dette est une bombe placée au coeur du système financier international". Cette bombe se rapproche toujours plus de son point d'explosion, le détonateur est amorcé. Le surenchérissement du crédit ne peut avoir pour conséquence que de faire peser encore plus lourdement le poids de la dette, et de rendre encore moins possible son remboursement, même de la part des pays les plus développés qui étaient, jusqu'à présent, les garants de la stabilité du système financier international. La situation est particulièrement grave à un moment où les besoins en capitaux se font plus importants.
Durant les années 1980, l'endettement de la plupart des pays industrialisés n'a cessé de croître. De 1981 à 1989 la dette publique nette en pourcentage du PNB est passée de 37,2 % à 51,4 % pour les USA, de 57,1 % à 68 % pour le Japon, de 61 % à 97 % pour l'Italie par exemple. La pseudo croissance des années 1980, qui a permis de maintenir l'illusion de la prospérité des économies développées de l'Occident, s'est faite à crédit. Alors que les marchés, les débouchés pour la production se fermaient pour manque de solvabilité, le recours au crédit permettait d'écouler des marchandises qui, autrement, n'auraient jamais trouvé preneur sur un marché sursaturé en rétrécissement permanent.
Cependant, cette politique artificielle trouve ses limites dans l'incapacité de la classe capitaliste à créer de nouveaux crédits alors que les anciens ne sont pas remboursés, et ne pourront jamais l'être. On assiste ainsi à des phénomènes aberrants depuis des années : les pays endettés payent leurs traites en contractant de nouveaux crédits qui alourdissent encore le poids de leur dette et des traites à payer ; les pays industriels, pour exporter leur production, prêtent de l'argent qui ne sera Jamais remboursé, et par cela, ils s'endettent eux-mêmes. Un tel système ne peut perdurer longtemps, il se fonde sur une tricherie constante avec la loi de la valeur, et ne repose que sur une illusion, celle de la croissance infinie du capital. C'est cette illusion qui est en train de s'écrouler avec l'entrée de l'économie mondiale dans une nouvelle phase de récession.
Aujourd'hui, la nécessité de payer la facture pétrolière ne peut qu'aggraver les déficits commerciaux et les balances des paiements, c'est-à-dire renforcer les besoins de liquidités, de financement, donc de crédits des différents Etats. Mais là n'est pas le pire : le recours de plus en plus massif à l'endettement s'est révélé incapable de suffire à créer les débouchés artificiels nécessaires pour maintenir la croissance de la production qui décline depuis des années. La chute de l'économie mondiale, et notamment celle des pays industrialisés, dans la récession ouverte signifie une moins grande rentrée des impôts dans les caisses de l'Etat et une aggravation des déficits budgétaires. Sur ce point, l'exemple le plus significatif reste les USA ; lors de la récession de 1973-1975, le déficit budgétaire avait grimpé de 2 à 8 milliards de dollars, lors de la récession de 1979-1982, de 50 à 200 milliards de dollars, c'est-à-dire qu'il avait chaque fois quadruplé. Avec la récession actuelle, cela signifierait que le déficit budgétaire actuel de plus de 190 milliards de dollars serait propulsé à près de 800 milliards de dollars. On peut imaginer les besoins de crédits américains dans cette hypothèse. Mais alors où trouver des prêteurs ? L'un des principaux bailleurs de fonds de ces dernières années, la RFA, étant en train de se transformer lui-même, pour financer la réunification de l'Allemagne, en un des plus gros emprunteurs sur le marché mondial, reste le Japon, qui, avec la récession, voit ses marchés se rétrécir, sa balance commerciale positive se réduire et ses capacités de financement s'amoindrir. Une nouvelle relance par le crédit n'est donc plus possible.
Même une relance par l'économie de guerre, dans la mesure où celle-ci, pour son financement, a aussi besoin de crédit, ne peut constituer une solution. D'ailleurs, il suffit de constater que le premier effet de l'intervention US au Moyen-Orient est, sur le plan économique, d'aggraver le déficit budgétaire américain ; la relance des programmes d'armement que la situation peut impliquer, de toute façon, devrait être financée sur le budget, ce qui ne contribuerait qu'à en détériorer encore plus le déficit.
Une des solutions pour le gouvernement américain, pour réduire son déficit, est de lever de nouveaux impôts, mais cela signifie un ralentissement encore plus fort de l’économie et une plongée plus dramatique dans la récession. La quadrature du cercle ! Tous les spécialistes de la conjoncture économique sont dans le cirage ; depuis de nombreux mois, la panique montait et la guerre dans le Golfe a été le détonateur pour qu'elle s'exprime ouvertement. Les maigres espoirs d'une relance ont définitivement sombré avec l'explosion des cours du pétrole, qui signifie une perte rapide de plus d'un point de croissance pour les pays industrialisés. Les événements du Golfe, tout en n'étant pas directement à l'origine de la crise, se sont produits à un moment où l'économie mondiale se trouvait extrêmement fragilisée, précipitant et aggravant grandement les effets dévastateurs de la crise.
Les perspectives sont on ne peut plus sombres pour les capitalistes du monde entier : chute de la production, faillites en chaîne des entreprises industrielles et des banques, crise du crédit et donc du système financier international avec, au coeur de la tourmente, le dollar, qui, au mois d'août, a rejoint ses niveaux historiques les plus bas, inflation galopante, concurrence exacerbée pour les maigres marchés encore solvables, déstabilisation grandissante du marché mondial. La catastrophe est là. La perspective, après l'effondrement économique des pays sous-développés de la périphérie et des pays d'Europe de l'Est est maintenant à l'écroulement de l'économie des pays les plus développés. Même si on ne peut prévoir précisément les formes que prendra cette nouvelle phase de la crise catastrophique du capital, ni l'enchaînement des événements qui vont la caractériser, ses principales caractéristiques, elles, ne font aucun doute.
Les travailleurs des pays du monde entier vont payer le prix fort de la banqueroute du capital. Le chômage va grimper à des niveaux jamais atteints jusqu'alors. L'inflation et les politiques d'austérité vont dégrader le niveau de vie de la classe ouvrière des pays développés à un point qui, jusque là, était l'apanage malheureux des pays les plus pauvres. Partout dans le monde, la crise va exercer ses effets désastreux, accélérant encore le processus de décomposition général, à l'oeuvre depuis des années ; les famines, les épidémies vont connaître un nouveau bond en avant.
Avec une économie qui descend sous le seuil fatidique de la croissance zéro des indices officiels, c'est un seuil psychologique fondamental que la classe dominante est en train de franchir. La panique présente des spéculateurs sur les marchés boursiers en est une expression frappante.
Dans un premier temps, le bain de sang qui se prépare dans le golfe Persique constitue un facteur de déboussolement du prolétariat mondial. Le martelage incessant des organes de propagande de la bourgeoisie que celui-ci subit lui masque provisoirement la réalité de la profondeur de la crise qui s'annonce et entrave sa capacité à se situer sur son terrain de classe.
Cependant, les effets des attaques brutales contre ses conditions de vie que la situation implique nécessairement, signifient que la combativité toujours présente de la classe ouvrière va, à court terme, tendre à s'exprimer dans des luttes revendicatives d'ampleur. La perspective de luttes sociales massives face à la paupérisation brutale qui va frapper le prolétariat mondial ne peut qu'aviver davantage les frayeurs de la classe dominante. La propagande incessante des années 1980 sur les indispensables sacrifices à consentir pour maintenir la prospérité, qui a été une réelle entrave au développement de la lutte et de la conscience de classe, va se trouver balayée devant la réalité du fait que tous ces sacrifices n'ont finalement mené qu'à la catastrophe présente. Le capitalisme est en train de faire la preuve absolue de l'impasse historique où il mène l'humanité, et plus que jamais se pose la nécessité urgente de la révolution communiste mondiale, seule solution à la barbarie présente. L'enfoncement accéléré dans la misère qui est en train de se produire déblaie le terrain pour que la compréhension de cette nécessité se développe dans la classe ouvrière.
JJ, 4/9/1990.
Récent et en cours:
- Guerre en Irak [130]
- Crise économique [28]
Résolution sur la situation internationale (juin 1990)
- 3324 reads
Lors de son adoption, cette résolution ne pouvait intégrer la "crise du Golfe" déclenchée depuis le 2 août 1990. Elle traite des perspectives générales de la situation internationale sous ses principaux aspects et conserve une pleine validité aujourd'hui. Et en particulier, les événements au Moyen-Orient survenus depuis la rédaction de ce document illustrent de façon immédiate et complète ce qui y était tracé : le futur que nous offre le capitalisme n'est pas seulement celui d'une crise insoluble aux effets économiques de plus en plus dévastateurs (famines dans les pays arriérés, paupérisation absolue dans les pays avancés, misère généralisée pour l'ensemble de la classe ouvrière), il est aussi celui d'affrontements militaires de plus en plus brutaux là où le prolétariat n'aura pas la force de les empêcher, il est enfin celui d'un chaos grandissant, d'une perte de contrôle croissante par la classe dominante de l'ensemble de la société, d'une barbarie de plus en plus extrême et déchaînée..."
La situation mondiale est dominée aujourd'hui, et pour un moment encore, par l'événement historique considérable que constitue l’effondrement brutal et définitif du bloc impérialiste de l'Est. Il en est ainsi parce que cet effondrement :
- constitue une illustration de la profondeur, de la gravité et du caractère insoluble de la crise de l'économie capitaliste ;
- vient confirmer l'entrée, au cours des années 1980, du capitalisme décadent dans une nouvelle phase - la phase ultime- de son existence, celle de la décomposition générale de la société ;
- débouche sur une déstabilisation générale de toute l'organisation géopolitique du monde instaurée à la fin de la seconde guerre mondiale ;
- exerce un impact de première importance sur la conscience et la lutte du prolétariat dans la mesure où ce bloc a été présenté depuis ses origines, par tous les secteurs de la bourgeoisie, comme le "bloc socialiste", l'héritier de la révolution prolétarienne d'octobre 1917.
1) L'effondrement du bloc de l'Est trouve ses origines fondamentales dans :
- la faiblesse et l'arriération congénitales de l'économie de sa puissance dominante, l'URSS, résultant de l'arrivée tardive de ce pays dans le développement historique du capitalisme et l'empêchant, de ce fait, de constituer une tête de bloc viable (l'accession de l'URSS à une place qu'elle ne pouvait pas tenir provenant des conditions politiques et militaires particulières qui se présentaient à la fin de la seconde guerre mondiale) ;
- la faillite complète de l'économie des pays qui constituaient ce bloc et, en premier lieu évidemment, de l'URSS elle-même.
Cette faillite résulte de l'incapacité de la forme du capitalisme d'Etat existant dans ces pays (et qui avait été instaurée en URSS sur les ruines de la révolution prolétarienne victime de son isolement international) à affronter l'aggravation inexorable de la crise mondiale du capitalisme. Cette forme de capitalisme d'Etat, si elle avait pu se montrer capable d'affronter victorieusement une situation de guerre impérialiste généralisée, s'est, en revanche, révélée inapte à faire face à la situation de concurrence exacerbée provoquée sur le marché mondial par une crise de surproduction du fait :
- du handicap considérable que représente pour la compétitivité de chaque capital national l'économie de guerre qui avait trouvé en URSS une de ses manifestations les plus extrêmes et caricaturales ;
- et, surtout, de la totale déresponsabilisation de l'ensemble des acteurs de la production (depuis les directeurs d'usine jusqu'aux manoeuvres et aux kolkhoziens) qui découle d'une centralisation complète de l'économie, de la fusion, sous l'égide du Parti-Etat, de l'appareil politique et de l'appareil productif, de l'élimination de toute sanction du marché.
En fait, l'effondrement économique spectaculaire de l'ensemble de l'économie dite "socialiste" traduit la revanche, sous les coups de boutoir de la crise mondiale, de la loi de la valeur avec laquelle cette forme particulière de l'économie capitaliste avait, pendant des décennies, tenté de tricher à grande échelle.
2) En ce sens, la disparition de l'économie de type stalinien, la réintroduction en catastrophe des mécanismes du marché dans les pays de l'Est, n'ouvre aucune perspective réelle de relance de l'économie mondiale dont le maintien à flot depuis deux décennies repose également sur une tricherie avec cette même loi de la valeur. En effet, à part quelques exceptions et situations spécifiques (comme l'Allemagne de l'Est), l'ensemble des pays de l'Est, et particulièrement l'URSS, ne saurait constituer un nouveau marché pour la production des pays industrialisés. Les besoins y sont immenses, mais les moyens de paiement totalement absents et les conditions historiques actuelles interdisent toute mise en place d'un quelconque nouveau "plan Marshall". En effet, celui-ci a pu relever l'économie d'Europe occidentale de ses ruines parce qu'il intervenait dans une période de reconstruction faisant suite à la guerre mondiale. Aujourd'hui, en revanche, le développement dans les pays de l'Est d'une industrie compétitive se heurte de façon insurmontable à la saturation générale du marché mondial. Comme ce fut déjà le cas durant les années 70 dans les pays du "tiers-monde", les crédits occidentaux destinés à financer un tel développement dans les pays de l'Est ne pourraient aboutir à d'autre résultat que d'accroître encore leur endettement déjà considérable et alourdir, de ce fait, le fardeau de la dette qui pèse sur l'ensemble de l'économie mondiale.
3) En fait, le mythe de la "sortie de la crise" par le "libéralisme" et les "reaganomics", et qui a connu son heure de gloire au milieu des années 1980, est aujourd'hui en train de crever comme une bulle de savon. Les prétendus "succès" des économies occidentales étaient en réalité basés sur une fuite en avant à corps perdu constituée principalement par un endettement gigantesque, notamment de la part de la première puissance mondiale, les Etats-Unis. Par d'énormes déficits de sa balance commerciale et de son budget, par une course effrénée aux dépenses d'armements, ce pays a permis de repousser pendant des années l'échéance d'une nouvelle récession ouverte, laquelle constitue, pour la bourgeoisie, la hantise majeure dans la mesure où c'est la manifestation de la crise qui met le mieux en évidence la faillite complète du mode de production capitaliste. Mais une telle politique, forme "occidentale" de la tricherie avec la loi de la valeur, ne pouvait qu'exacerber encore plus les contradictions de fond de l'économie mondiale. Aujourd'hui, l'entrée des Etats-Unis, de même que de la Grande-Bretagne, dans une nouvelle récession ouverte constitue une illustration de cette réalité. Cette nouvelle récession de la première économie mondiale, au même titre que les précédentes, ne peut, à terme, qu'entraîner celle des autres économies occidentales.
4) En effet, la fermeture du marché américain, qui se profile, va se répercuter (et a déjà commencé à se répercuter pour un pays comme le Japon) sur l'ensemble du marché mondial, faisant notamment plonger la production des pays d'Europe de l'Ouest (même si, dans l'immédiat, cette production se trouve soutenue en RFA par l'unification des deux Allemagnes). De plus, le facteur d'atténuation des effets et du rythme de la crise que pouvait constituer la politique de capitalisme d'Etat à l'échelle du bloc occidental pourra de moins en moins jouer son rôle avec la désagrégation de ce dernier, désagrégation qu'entraîne nécessairement la disparition du bloc adverse. Ainsi la perspective de l'économie mondiale est, plus que jamais, celle de la poursuite et de l'aggravation de son effondrement. Pendant toute une période, les pays du centre du capitalisme ont pu repousser les manifestations les plus brutales de la crise, dont l'origine se situe pourtant en ce même centre, vers la périphérie. De plus en plus, comme un choc en retour, ces formes les plus extrêmes de la crise vont revenir frapper de plein fouet ces pays centraux. Ainsi, après le "tiers-monde", après les pays du bloc de l'Est, et même si elles disposent de plus d'atouts pour en atténuer quelque peu les dégâts, les métropoles capitalistes d'Occident sont inscrites sur la liste noire de la catastrophe économique.
5) L'aggravation de la crise mondiale de l'économie capitaliste va nécessairement provoquer une nouvelle exacerbation des contradictions internes de la classe bourgeoise. Ces contradictions, comme par le passé, vont se manifester sur le plan des antagonismes guerriers : dans le capitalisme décadent, la guerre commerciale ne peut déboucher que sur la fuite en avant de la guerre des armes. En ce sens, les illusions pacifistes qui pourraient se développer à la suite du "réchauffement" des relations entre l'URSS et les Etats-Unis doivent être résolument combattues : les affrontements militaires entre Etats, même s'ils ne sont plus manipulés et utilisés par les grandes puissances, ne sont pas près de disparaître. Bien au contraire, comme on l'a vu dans le passé, le militarisme et la guerre constituent le mode même de vie du capitalisme décadent que l'approfondissement de la crise ne peut que confirmer. Cependant, ce qui change avec la période passée, c'est que ces antagonismes militaires ne prennent plus à l'heure actuelle la forme d'une confrontation entre deux grands blocs impérialistes :
- d'une part, le bloc de l'Est a cessé d'exister comme l'illustre le fait que, dès maintenant, sa puissance dominante en soit réduite à lutter pour sa simple survie comme Etat ; la perspective de la situation en URSS est celle d'une réduction de ce pays à la seule Russie qui ne sera plus qu'une puissance de deuxième ordre, bien plus faible que les grands Etats d'Europe de l'Ouest ;
- d'autre part, avec la disparition de sa principale raison d'existence, c'est-à-dire la menace militaire du bloc russe, le bloc occidental lui-même est entré dans un processus de désagrégation qui ne peut aller qu'en s'amplifiant dans la mesure où, comme l'a démontré depuis longtemps le marxisme, U ne peut exister de "super-impérialisme" dominant le monde entier.
6) C'est aussi pour cette dernière raison que la
disparition des deux constellations impérialistes qui se sont partagées
le monde depuis plus de quarante ans porte avec elle la tendance à la
reconstitution de deux nouveaux blocs : un bloc dominé par les Etats-Unis et
l'autre dominé par un nouveau leader, rôle pour lequel l'Allemagne (du fait de
sa puissance économique et de sa place géographique) serait la mieux placée.
Mais une telle perspective n'est pas aujourd'hui à l'ordre du jour du fait :
- de la relative faiblesse militaire de l'Allemagne actuelle (qui ne dispose même pas de l'arme atomique), faiblesse qui ne peut être surmontée du jour au lendemain ;
- de la persistance formelle des structures d'organisation du bloc de l'Ouest (OTAN, CEE, OCDE, etc.) et, surtout, de l'importance de la puissance économique des Etats-Unis qui tendent à limiter la marge de manoeuvre des différents "alliés" (et qui vont freiner des quatre fers tout processus de renforcement de la puissance militaire de l'Allemagne) ;
- du frein majeur que constitue le phénomène de décomposition qui affecte l'ensemble de la société et dont le chaos croissant qu'il provoque au sein de la classe dominante limite les capacités de celle-ci à se donner la discipline nécessaire à l'organisation de nouveaux blocs impérialistes.
7) En fait, si les structures héritées de l'ancienne organisation du bloc occidental ont désormais perdu leur fonction première, elles sont utilisées, à l'heure actuelle, pour limiter la tendance croissante à la désorganisation, au "chacun pour soi", qui se développe au sein de la classe bourgeoise. En particulier, le chaos politique qui, d'ores et déjà, s'est instauré en URSS (notamment sous la forme de l'exacerbation des multiples revendications nationalistes), et qui ne fera que s'accroître, contient une menace réelle de contamination vers l'Europe centrale et occidentale. C'est bien là une des raisons majeures du soutien unanime dont bénéficie Gorbatchev de la part de toutes les fractions de la bourgeoisie occidentale. C'est aussi pour cette raison que la RFA, qui, avec la périlleuse opération d'absorption de la RDA, se trouve en première ligne de cette menace de chaos venue de l'Est, s'est convertie pour le moment en "fidèle" allié au sein de l'OTAN. Cependant, le fait même qu'un pays comme l'Allemagne, qui constituait un "modèle" de stabilité tant économique que politique, soit aujourd'hui durement secoué par le cyclone venu de l'Est en dit long sur la menace générale de déstabilisation qui pèse sur l'ensemble de la bourgeoisie européenne et mondiale. Ainsi, le futur que nous offre le capitalisme n'est pas seulement celui d'une crise insoluble aux effets économiques de plus en plus dévastateurs (famines dans les pays arriérés, paupérisation absolue dans les pays avancés, misère généralisée pour l'ensemble de la classe ouvrière), il est aussi celui d'affrontements militaires de plus en plus brutaux là où le prolétariat n'aura pas la force de les empêcher, il est enfin celui d'un chaos grandissant, d'une perte de contrôle croissante par la classe dominante de l'ensemble de la société, d'une barbarie de plus en plus extrême et déchaînée qui, au même titre que la guerre mondiale, ne peut avoir d'autre aboutissement que la destruction de l'humanité.
8) Le chaos grandissant au sein de la classe bourgeoise, l'affaiblissement qu'il représente pour elle, ne constituent pas en soi, à l'heure actuelle, une condition favorisant la lutte et la prise de conscience du prolétariat. En effet, en de nombreuses reprises, l'histoire a démontré que, face à une menace de la classe ouvrière, la bourgeoisie est parfaite ment capable de surmonter ses contradictions et antagonismes internes pour lui opposer un front uni et redoutable. Plus généralement, la classe ouvrière ne saurait compter, pour combattre et renverser la bourgeoisie, sur la faiblesse de celle-ci mais avant tout et fondamentalement sur sa propre force. En outre, les années 1980 qui marquent l'entrée de la société capitaliste décadente dans sa phase de décomposition, ont mis en relief la capacité de la classe dominante à retourner contre le prolétariat les différentes manifestations de cette décomposition :
- campagnes aclassistes sur des thèmes écologiques, humanitaires ou anti-fascistes contre les menaces sur l'environnement, les famines, les massacres et les manifestations de xénophobie ;
- utilisation du désespoir, du nihilisme, du "chacun pour soi" découlant de la décomposition de l'idéologie bourgeoise pour attaquer la confiance en l'avenir de la classe, saper sa solidarité et l'enfermer dans les pièges corporatistes.
9) Ce poids négatif de la décomposition sur la classe ouvrière s'est fait notamment sentir autour de la question du chômage. Si ce dernier peut constituer un facteur de prise de conscience de l'impasse historique dans laquelle se trouve le mode de production capitaliste, il a plutôt contribué, tout au long des années 1980, à rejeter dans le désespoir, le "chacun pour soi" et même la lumpénisation des secteurs non négligeables de la classe ouvrière, particulièrement parmi les jeunes générations qui n'ont jamais eu l'occasion de s'intégrer dans une collectivité de travail et de lutte. Plus concrètement, alors que dans les années 1930, dans des circonstances historiques bien plus défavorables qu'aujourd'hui (puisque dominées par la contre-révolution), les chômeurs avaient pu s'organiser et mener des luttes significatives, il n'en a rien été ces dernières années. En fait, il s'avère que, pour l'essentiel, seuls les combats massifs des ouvriers au travail pourront entraîner dans la lutte les secteurs au chômage de la classe ouvrière.
10) La capacité de la bourgeoisie à retourner
contre la classe ouvrière la décomposition de sa société s'est particulièrement
illustrée au cours de la dernière période avec l'effondrement du bloc de l'Est
et du stalinisme. Alors que ce dernier avait constitué le fer de lance de la
terrible contre-révolution qui s'était abattue sur le prolétariat entre
les années 1920 et les années 1960, sa crise historique et sa disparition, loin
de déblayer le terrain politique pour le combat et la prise de conscience de la
classe, ont au contraire provoqué au sein de celle-ci un recul très sensible dans
la dynamique de cette prise de conscience. Le fait que le bloc
"socialiste" ait péri de ses propres contradictions internes
(exacerbées par la crise mondiale et le développe ment de la décomposition) et
non de la main du prolétariat a, en effet, permis à la bourgeoisie d'accentuer
la difficulté de ce dernier à dégager les perspectives de son combat, ainsi que
le poids des illusions réformistes, syndicalistes et démocratiques.
Ce recul de la classe ouvrière est à la hauteur de l'importance de l'événement
qui l'a provoqué : il est le plus important qu'elle ait subi depuis la reprise
historique de ses combats à la fin des années 1960 ; en particulier, il se
situe à un niveau bien plus élevé que le recul qui avait accompagné sa défaite
de 1981 en Pologne.
11) La profondeur indiscutable du recul actuel dans le processus de prise de conscience du prolétariat ne remet nullement en cause, cependant, le cours historique aux affrontements de classe tel qu'il s'était développé pendant plus de deux décennies. En effet, l'ampleur de ce recul est limitée par le fait que :
- contrairement aux années 1930 et au lendemain de la seconde guerre mondiale, ce n'est pas le prolétariat des pays centraux qui se trouve aujourd'hui en première ligne des campagnes démocratiques ; ce que la bourgeoisie utilise, c'est le "vent d'Est" provenant de régions où vivent des secteurs secondaires du prolétariat mondial ;
- ce "vent d'Est", lui-même, a grandement perdu de son souffle avec les premiers résultats des politiques de "libération du marché" vantées comme remède enfin trouvé aux maux de l'économie de type stalinien ; l'aggravation irrémédiable de la situation économique, la perte du minimum de sécurité existant pour l'emploi et la consommation, ne peuvent que saper les illusions, à l'Est et à l'Ouest, sur les "bienfaits" du capitalisme "libéral" appliqué aux pays de l'Est ;
- en dépit du désarroi qui pèse sur lui, le prolétariat n'a pas subi de défaite directe, d'écrasement de ses luttes ; de ce fait, sa combativité n'a pas été réellement entamée ;
- cette combativité ne pourra qu'être stimulée par les attaques de plus en plus vives que la bourgeoisie sera contrainte de déchaîner contre lui et qui lui permettront de se rassembler sur son propre terrain de classe en dehors de toutes les campagnes aclassistes.
De façon plus fondamentale, le tableau de la faillite croissante de l'économie capitaliste sous toutes ses formes, et particulièrement celles qui dominent dans les pays avancés, va constituer un facteur essentiel de mise à nu des mensonges sur le thème du "capitalisme victorieux du socialisme" qui sont au coeur de la campagne idéologique déchaînée par la bourgeoisie contre le prolétariat.
12) C'est un chemin difficile et encore long qui attend la classe ouvrière pour parvenir à son émancipation. Il est d'autant plus difficile que, désormais, et à l'opposé des années 1970, le temps ne travaille plus pour elle du fait de l'enfoncement irréversible et croissant de l'ensemble de la société dans la décomposition. Mais pour elle, la classe ouvrière a le fait que son combat représente la seule perspective de sortie de la barbarie, le seul espoir de survie de l'humanité. Avec l'aggravation inéluctable de la crise du capitalisme, avec les luttes qu'elle devra nécessairement développer, la porte lui reste entièrement ouverte à la prise de conscience de sa tâche historique. Le rôle des révolutionnaires est de participer pleinement aux combats présents de la classe afin de planter des jalons lui permettant de sortir la mieux armée possible de la situation difficile d'aujourd'hui et de mettre en avant avec assurance sa perspective révolutionnaire.
CCI, juin 1990.Vie du CCI:
- Résolutions de Congrès [131]
Géographique:
- Moyen Orient [132]
Heritage de la Gauche Communiste:
Ecologie : c'est le capitalisme qui pollue la Terre
- 6343 reads
Plus la civilisation capitaliste dure, plus elle nous rapproche d'une catastrophe écologique aux proportions planétaires, une catastrophe qui ne peut être évitée sans la destruction du système capitaliste.
Les faits eux-mêmes sont bien connus et on peut les trouver dans un nombre croissant de publications spécialisées ou de vulgarisation scientifique, aussi ne les décrirons-nous pas en détail ici. Une simple liste suffit à montrer l'étendue et la profondeur du danger : le frelatage croissant de la nourriture par les différents additifs ou les maladies du bétail ; la contamination des réserves d'eau par l'utilisation incontrôlée de fertilisants et les décharges de déchets toxiques ; la pollution de l’air, en particulier dans les grandes villes, du fait des effets combinés des fumées industrielles et des gaz d'échappement des automobiles ; la menace de contamination radioactive à partir des réacteurs nucléaires et des décharges de produits irradiés éparpillés dans tous les pays industrialisés, y compris ceux de l'ex-bloc russe, menace qui est déjà devenue une réalité de cauchemar avec les désastres de Windscale, de Three Miles Island et surtout de Tchernobyl ; l'empoisonnement des rivières, des lacs et des mers utilisés, depuis des décennies, comme les dépotoirs du monde, ce qui aboutit maintenant à la rupture de la chaîne alimentaire et à la destruction d'organismes dont le rôle est important dans la régulation du climat mondial ; la destruction accélérée des forêts, en particulier les forêts tropicales, ce qui, outre des effets qui modifient aussi le climat de la planète, implique l'érosion des terres, qui entraîne à sont tour d'autres calamités, comme l'avancée du désert en Afrique et les raz-de-marée au Bengladesh.
Qui plus est, il apparaît maintenant que la quantité se change en qualité et que les effets de la pollution deviennent à la fois plus globaux et plus incalculables. Ils sont globaux au sens où chaque pays du monde est affecté ; non seulement les pays hautement industrialisés de l'Ouest, mais aussi les pays sous-développés du "tiers-monde" et les pays staliniens ou ex-staliniens, qui sont dans une telle banqueroute qu'ils ne peuvent même pas s'offrir les contrôles minimaux qui ont été introduits en Occident. Les anciens pays "socialistes" comme la Pologne, l'Allemagne de l'Est et la Roumanie sont peut-être les Etats les plus pollués du monde; virtuellement, chaque ville de l'Europe de l'Est a ses histoires d'horreur/à propos d'usines locales qui vomissent des toxiques mortels provoquant des cancers, des maladies respiratoires et autres, ou bien à propos de rivières qui s'enflamment dès qu'on y jette une allumette, etc. Mais des villes du "tiers-monde" comme Mexico ou Cubatao (au Brésil), ne sont sûrement pas loin derrière.
Mais il y a un autre sens, et plus terrifiant encore, au mot "global" dans ce contexte ; à savoir que le désastre écologique est maintenant une menace tangible pour l'écosystème de la planète lui-même. L'amincissement de la couche d'ozone, qui semble résulter principalement de l'émission de gaz CFC, en est une claire illustration, dans la mesure où la couche d'ozone protège toutes les formes de vie sur la terre des rayons ultraviolets mortels ; et il est impossible de dire, à ce stade, ce que seront les conséquences à long terme de ce processus. Il en va de même avec le problème de l'effet de serre, qui est maintenant reconnu comme une menace réelle par un nombre croissant d'experts scientifiques, le dernier en date étant la Commission Intergouvernementale sur les changements climatiques (CICC) de l'ONU. Cet organisme et d'autres n'ont pas seulement alerté sur les inondations massives, les sécheresses et les famines qui pourraient en résulter s'il n'y a pas une diminution significative du niveau actuel d'émission de gaz favorisant l'effet de serre, en particulier le gaz carbonique, ils ont aussi souligné le risque d'un processus "rétroactif-actif", dans lequel chaque aspect de pollution et de destruction de l'environnement agit sur les autres pour produire une spirale irréversible de désastres.
Il est évident aussi que la classe dont le système a provoqué cette pagaille est incapable d'y rien changer. Bien sûr, dans les dernières années presque toutes les lumières de la bourgeoisie se sont miraculeusement converties à la cause de la sauvegarde de l'environnement. Les supermarchés sont remplis de produits proclamant l'absence d'additifs artificiels ; les étiquettes des cosmétiques, des détergents, des couches pour bébés, rivalisent pour prouver à quel point ils respectent la couche d'ozone, l'air et les rivières. Et les dirigeants politiques, de Thatcher à Gorbatchev, parlent de plus en plus du fait que nous devons tous agir ensemble pour protéger notre planète en danger.
Comme d'habitude, l'hypocrisie de cette classe de gangsters ne connaît pas de limite. La préoccupation réelle qu'a la bourgeoisie de sauver la planète peut se mesurer en regardant ce qu'elle se prépare à faire. Par exemple, elle a mené un grand tapage à propos de la récente conférence sur l'ozone à Londres, où les principaux pays du monde, y compris les géants du "tiers-monde", l'Inde et la Chine, qui y étaient autrefois récalcitrants, se sont mis d'accord pour supprimer progressivement les CFC d'ici à l'an 2000. Mais cela signifie encore que 20 % de plus de la couche d'ozone pourrait être détruit durant la prochaine décennie ; pendant cette période, la diminution du volume d'ozone qui s'opérerait représenterait la moitié du volume total qui a été supprimé depuis que les CFC ont été inventés.
La situation est encore pire en ce qui concerne l'effet de serre. L'administration US a banni la phrase "réchauffement global" de ses communiqués officiels. Et les pays qui acceptent sur le papier les prévisions de la CICC se sont seulement engagés à stabiliser les émissions de gaz carbonique à leur niveau actuel, pas d'avantage. Et surtout, ils n'ont pas de stratégie sérieuse pour réduire la dépendance de leurs économies vis-à-vis du pétrole et des automobiles privées, qui sont les causes principales de l'effet de serre. Rien n'est fait pour arrêter la destruction des forêts, ravage qui, tout à la fois, ajoute à l'accumulation des gaz favorisant l'effet de serre et a réduit la capacité de la planète de les absorber : le Plan d'action de l'ONU pour la forêt tropicale est lui-même entièrement dominé par les entreprises forestières. En outre, la destruction de la forêt par les coupes, par le bétail, et par les intérêts industriels de même que par les paysans affamés, avides de terres cultivables et de bois de chauffage, cette destruction ne pourrait être arrêtée que si le "tiers monde" était tout à coup libéré de la masse écrasante de la dette et de la pauvreté. Quant aux plans pour construire des défenses contre les inondations ou pour prévoir les famines, les populations des régions les plus menacées, telles que le Bengladesh, peuvent espérer le même genre d'aide que celle accordée aux habitants des régions sujettes aux tremblements de terre, ou aux victimes de la sécheresse en Afrique.
Les réponses de la bourgeoisie à tous ces problèmes mettent en lumière le fait que la structure même de son système la rend incapable de régler les problèmes écologiques qu'elle a créés. Les problèmes écologiques globaux demandent une solution globale. Mais en dépit de toutes les conférences internationales, en dépit de tous les voeux pieux sur la coopération internationale, le capitalisme est irréductiblement fondé sur la compétition entre des économies nationales. Son incapacité à réaliser le moindre degré de coopération globale ne fait que s'exacerber aujourd'hui du fait que les vieilles structures de bloc s'effondrent et que le système s'enfonce dans la guerre de tous contre tous. L'approfondissement de la crise économique mondiale qui a mis le bloc russe à genoux va aggraver la compétition et les rivalités nationales; cela signifie que chaque entreprise, chaque pays, agira avec encore plus d'irresponsabilité dans la folle bousculade pour la survie économique. Même si de petites concessions sont faites aux considérations d'environnement, la tendance dominante sera de jeter par la fenêtre les contrôles de santé, de sécurité et de pollution. Cela a déjà été le cas dans la décennie passée, au cours de laquelle on a vu une nette augmentation du nombre de catastrophes dans l'industrie, les transports et autres secteurs, résultat des coupes claires dues à la crise économique. Dans la mesure où la guerre commerciale entre les nations s'exacerbe, les choses ne pourront qu'empirer rapidement.
Qui plus est, ce chacun pour soi va accroître le danger de conflits militaires localisés dans les régions où la classe ouvrière est trop faible pour y faire obstacle. Maintenant que ces conflits ne sont plus contenus par la discipline des anciens blocs impérialistes, le risque est très grand de voir se développer les horreurs de la guerre chimique ou même nucléaire à une échelle locale, avec le massacre de millions d'êtres humains et un empoisonnement encore pire de l'atmosphère de la planète. Qui peut croire que, prises dans une spirale montante de chaos et de confusion, les bourgeoisies du monde vont travailler harmonieusement ensemble pour s'occuper des menaces pesant sur l'environnement? Si les difficultés écologiques - la baisse des ressources en eau, les inondations, les conflits à propos des réfugiés, etc. - ont un effet, ce sera celui d'accroître encore les tensions impérialistes locales. La bourgeoisie le sait déjà. Comme le ministre des affaires étrangères d'Egypte, Boutros Ghali, l'a dit récemment : "La prochaine guerre dans notre région portera sur les eaux du Nil, pas sur des questions politiques."
Dans la phase actuelle de décomposition avancée, la classe dominante perd de plus en plus le contrôle de son système social. L'humanité ne peut plus se permettre de laisser le sort de la planète entre les mains des bourgeois. La "crise écologique" est une preuve de plus que le capitalisme doit être détruit avant qu'il n'entraîne l'ensemble du monde à l'abîme.
La pollution idéologique
Mais si la bourgeoisie est incapable de réparer les dommages qu'elle a causés à la planète, elle n'hésite certainement pas à utiliser les thèmes écologiques pour alimenter ses campagnes de mystification dirigées contre la seule force dans la société en mesure d'apporter une solution au problème : le prolétariat mondial.
La question écologique est idéale de ce point de vue, c'est pourquoi la bourgeoisie ne cache guère la gravité du problème (et peut même donner libre cours à quelque exagération quand ça la sert). Sans arrêt, on nous dit que des problèmes comme le trou dans la couche d'ozone, le réchauffement du globe, "nous affectent tous", qu'ils ne font pas de "distinction" de couleur, de classe ou de pays. Et c'est vrai que la pollution, comme d'autres aspects de la décomposition de la société capitaliste, (drogue, crimes, etc.), affecte toutes les classes de la société (même si c'est généralement les plus exploitées et opprimées qui en souffrent le plus). Aussi, quelle meilleure base pourrait-il y avoir pour diluer le prolétariat, lui faire oublier ses propres intérêts de classe, le noyer dans une masse amorphe où il n'y aurait plus de distinction d'intérêts entre les ouvriers, les boutiquiers... ou la classe dominante elle-même ? Le bourrage de crâne relatif à l'environnement complète donc toutes les campagnes idéologiques au sujet de la démocratie et du "pouvoir au peuple" déchaînées après l'écroulement du bloc de l'Est.
Regardons comment ils déforment les solutions écologiques pour les adapter à leurs besoins. Ces problèmes si terrifiants, si urgents, ne sont-ils pas, disent-ils, sûrement plus importants que votre lutte égoïste pour des augmentations salariales ou contre les licenciements ? En effet, la plupart de ces problèmes ne sont-ils pas dus au fait que les ouvriers, dans les pays avancés "consomment trop" ? Ne devraient-ils pas se préparer à manger moins de viande, à utiliser moins d'énergie, à accepter aussi la fermeture de telle ou telle usine "pour le bien de la planète" ? Quelle meilleure excuse pourrait avancer la bourgeoisie pour les sacrifices demandés par la crise de l'économie capitaliste ?
Et on trouve donc ici tous les arguments soutenant le mythe des "réformes" ou du "changement réaliste". Quelque chose peut certainement être fait maintenant, disent-ils. Aussi, ne devrions-nous pas chercher à voir quel candidat aux élections offre la meilleure politique écologique ? Quel parti promet de faire le plus pour l'environnement ? Les préoccupations exprimées par Gorbatchev, Mitterrand ou Thatcher ne prouvent-elles pas que les politiciens peuvent effectivement répondre à la pression populaire ? Est-ce que les expériences sur la conservation de l'énergie, l'énergie solaire ou éolienne qui sont effectuées aujourd'hui par des gouvernements "éclairés" comme ceux de la Suède ou des Pays-Bas, ne démontrent pas que les changements sont juste une question de volonté et d'initiative de la part des politiciens, combinée avec la pression à la base des citoyens ? Le changement pour des produits respectant l'environnement n'atteste-t-il pas que les grosses compagnies peuvent être réellement touchées par "l'action des consommateurs" ?
Et si toutes ces approches "pleines d'espoir" et "positives" ne réussissent pas à convaincre, la bourgeoisie peut toujours profiter des sentiments d'impuissance et de désespoir qui ne peuvent qu'être renforcés quand le citoyen isolé met la tête à sa fenêtre et voit un monde entier en train d'être empoisonné. Si la bourgeoisie n'arrive pas à convaincre les exploités que ses mensonges sont la vérité, au moins, une classe ouvrière atomisée et démoralisée ne menace-t-elle pas la survie de son système.
Les fausses alternatives des "verts"
Mais, au cours de la dernière décennie, une nouvelle force politique a fait son apparition sur la scène, un courant qui revendique avoir une approche radicale pour mettre la défense de l'environnement au-dessus de toutes autres considérations : les "verts". En Allemagne, ils sont devenus une force estimée dans la vie politique nationale. En Europe de l'Est, des groupes écologiques ont figuré fortement dans les oppositions démocratiques qui ont colmaté la brèche ouverte par l'effondrement des régimes staliniens. Des partis "verts" et des groupes de pression naissent dans les pays les plus industrialisés, et même dans le "tiers-monde".
Mais les "verts" sont aussi une partie du capitalisme pourrissant. Constat d'évidence quand on observe leur jeu en Allemagne de l'Ouest : ils sont devenus un parti parlementaire respectable, avec de nombreux sièges au Bundestag (organe confédéral) et différents postes de responsabilité dans les Lander (instances régionales). L'intégration déclarée des "verts" dans la normalité capitaliste a été symbolisée, il y a quelques années, par l'"extra-parlementaire", le rebelle anarchiste de 1968, Daniel Cohn-Bendit lui-même (rappelez-vous le slogan : "Elections, piège à cons") devenu mais oui, un député et qui a même exprimé son désir de devenir ministre. Au Bundestag, les "verts" s'engagent dans toutes les manoeuvres sordides typiques des partis bourgeois -tantôt agissant comme un "frein" pour garder le SPD dans l'opposition, tantôt formant une alliance avec les sociaux-démocrates contre la CDU au pouvoir. C'est vrai que les "verts" sont divisés en une aile "réaliste", qui se contente de se focaliser sur le terrain parlementaire et une aile "puriste", qui est pour des formes d'action plus radicales, extraparlementaires. Et beaucoup de l'attrait des partis "verts" et des groupes de pression tient de ce qu'ils profitent du dégoût des gens envers les gouvernements centralisés bureaucratiques et la corruption parlementaire. Comme solution de rechange, ils proposent des campagnes contre les cas locaux de pollution, des actions de protestation à l'éclat spectaculaire du type Greenpeace, des marches et des manifestations, tout en appelant à la décentralisation du pouvoir politique et à toutes sortes d'"initiatives de citoyens". Mais aucune de ces activités ne s'écarte d'un pouce des campagnes générales de la bourgeoisie. Au contraire, elles servent à garantir que ces campagnes prennent profondément racine dans le sol de la société.
Les "verts" radicaux sont champions de l’interclassisme, Ils s'adressent eux-mêmes à l'individu responsable", à la "communauté locale", à la bonne conscience de l'humanité en général. Les actions qu'ils entreprennent tentent de mobiliser tous les citoyens, sans considération de classe, dans la lutte contre la pollution. Et quand ils critiquent la bureaucratie et l'éloignement du gouvernement central, c'est seulement pour mettre en avant une vision de "démocratie locale" tout aussi bourgeoise dans son contenu.
Ils ne sont pas moins zélés dans leur soutien à l'illusion réformiste. Les actions qu'ils organisent ont invariablement pour but de rendre les compagnies industrielles, les gouvernements, plus responsables, plus propres, plus "verts". Juste un exemple : un tract des Amis de la Terre ("Eliminer la dette, pas les forêts équatoriales") expliquait que la dette du "tiers monde" conduisait à la destruction des forêts équatoriales. Quelle était donc la solution ? Les grandes banques occidentales, répondait ce groupe de pression, "devraient annuler toutes les dettes des pays les plus pauvres du monde, et réduire les dettes des autres pays les plus endettés d'au moins la moitié". Elles pouvaient maintenant s'offrir ce luxe". Et comment convaincrait-on les banques ? "Les banques ne bougeront pas, à moins que les consommateurs leur montrent fortement leur sentiment sur cette question. Tamponner vos chèques avec 'éliminer la dette, pas les forêts équatoriale et prendre le 'Gage de dette' sont deux moyens puissants pour leur montrer ce que vous en pensez. "
Les "verts" nous invitent donc à croire en l'efficacité du "pouvoir du consommateur", et en la possibilité d'appeler à de meilleurs sentiments les riches qui n'ont cure de condamner des millions de gens à la famine rien qu'en passant leur capital d'un pays à l'autre. C'est la même chose quand les "verts" peignent leur tableau d'un futur possible : un monde où de petites entreprises, bonnes écologiquement, ne se transforment jamais en géants capitalistes rapaces, une vision pacifiste de* l'entente entre les nations, bref, un capitalisme gentil, charitable, pacifique, impossible.
Mais il y a aussi des courants à l'intérieur et autour du mouvement "vert" qui se parent d'une radicalité plus poussée, qui critiquent le capitalisme et vont jusqu'à parler de révolution. Certains d'entre eux sont à ce point radicaux qu'ils proclament que le marxisme lui-même n'est rien de plus que l'autre face de la "mégamachine" capitaliste. Ils disent : regardez les régimes à l'Est, c'est le résultat logique du culte du marxisme pour le "progrès" technologique, l'industrie. Inspirés par des "penseurs" comme Baudrillard, ils se risquent même à expliquer dans un langage très recherché que le marxisme est simplement une autre idéologie "productiviste" (en cela, ils rejoignent les staliniens défroqués tel que Martin Jacques, qui, à une récente conférence du PC britannique en ruines, disait : "On ne peut ignorer le fait que la tradition marxiste est productionniste au fond : conquête de la nature, forces de production, engagement à la croissance économique." Des anarcho-primitivistes comme le journal Fifth Estate à Détroit appellent à rien de moins que l'éradication de la société technologique industrielle et à un retour au communisme primitif. Les "écologistes profonds" de Earth First vont même plus loin : pour leurs idéologues, le problème n'est pas simplement la société industrielle, ou la civilisation, mais l'homme lui-même...
Le marxisme contre les mystifications des "verts"
La notion qu'une entité abstraite appelée "homme" est responsable de la pagaille écologique présente n'est pas restreinte à quelques idéologues "verts" ésotériques ; c'est en fait un poncif courant. Mais, de toute façon, cette idée ne peut mener qu'au désespoir, car si le problème vient des êtres humains, comment pourront-ils trouver une solution ? Ce n'est pas un hasard si quelques "écologistes profonds" ont accueilli le SIDA comme un facteur nécessaire pour élaguer le monde des hommes en trop...
La position des anarcho-primitivistes conduit aux mêmes sombres conclusions. Etre "contre la technologie" c'est aussi être contre le genre humain ; l'homme s'est créé lui-même à travers le travail, et "le travail commence avec la fabrication des outils" (Engels, "Le rôle du travail dans la transformation du singe en homme", in "La dialectique de la nature"). La logique de la position anti technologique est d'essayer de revenir à un passé pré humain, quand la nature n'était pas dérangée par les bouleversements de l'activité humaine : "L'animal utilise seulement son environnement et y apporte des changements par sa simple présence ; l'homme par ses changements l'adapte à ses fins, le maîtrise. C'est la distinction finale, essentielle entre l'homme et les autres animaux. " (ibid.)
Mais même si les anti technologistes pouvaient se contenter d'un retour à une culture humaine à l'étape de la cueillette et de la chasse, le résultat serait identique puisque les conditions matérielles d'une telle société présupposent une population mondiale inférieure à quelques millions. Ces conditions ne pourraient être instaurées que par une "élimination sélective" massive des êtres humains, quelque chose que le capitalisme, dans son agonie, nous prépare dès à présent. Donc ces écologistes "radicaux", produits de la désintégration de la petite-bourgeoisie, classe qui n'a pas de futur historique et qui ne peut que se retourner sur un passé qu'elle idéalise, deviennent les théoriciens et apologistes d'une descente dans la barbarie qui est déjà bien en marche.
Contre ces idéologies nihilistes, le marxisme, exprimant le point de vue de la seule classe qui possède un futur aujourd'hui, insiste sur le fait que le cauchemar écologique actuel ne peut pas être expliqué en invoquant des catégories comme l'homme, la technologie ou l'industrie d'une façon totalement vague et a-historique. L'homme n'existe pas en dehors de l'histoire, et la technologie ne peut pas être séparée des relations sociales dans lesquelles elle s'est développée. L'interaction de l'homme et de la nature peut seulement être comprise dans son véritable contexte social et historique.
L'humanité existe sur la planète depuis environ trois millions d'années. Jusqu'à il y a très peu de temps, à cette échelle géologique, elle vécut au stade du communisme primitif, formant des sociétés qui vivaient de la chasse et de la cueillette et dans lesquelles régnait un équilibre relativement stable entre l'homme et la nature (fait reflété dans les mythes et les rituels des peuplades anciennes). La dissolution de cette communauté archaïque et le surgissement d'une société de classes, si elle représente un saut qualitatif dans l'aliénation de l'humanité, a déterminé aussi de nouvelles aliénations de l'homme à la nature. Les premiers cas de destruction écologique intensive coïncident avec les premières villes-Etats. Il ne fait pas de doute que le tout début du processus de déforestation, en même temps qu'il permettait à des civilisations telles que la Sumérienne, la Babylonienne, l'Egyptienne ou autres de développer ainsi une base agricole de large échelle, constituait également un élément qui, à terme, jouera un rôle considérable dans leur déclin et leur disparition.
Mais c'étaient des phénomènes locaux, limités. Avant le capitalisme, toutes les civilisations étaient basées sur une "économie naturelle" : la plus grande partie de la production était encore orientée vers la consommation immédiate des valeurs d'usage, même si, à la différence du communisme primitif, une large partie était accaparée par la classe dominante. Le capitalisme, par contre, est un système où toute la production est orientée vers le marché, en fonction de la reproduction élargie de la valeur d'échange ; c'est une formation sociale de loin plus dynamique que tout système antérieur, et cette dynamique l'a contraint à marcher inexorablement vers la création d'une économie mondiale. Mais le profond dynamisme et la globalité du capital ont fait que le problème de la destruction écologique a maintenant atteint un niveau planétaire. Parce que ce n'est pas le marxisme, mais le capitalisme, qui est "productionniste dans le fond". Aiguillonné par la compétition, par la rivalité anarchique des unités capitalistes luttant pour le contrôle des marchés, il obéit à une force interne pour s'étendre aux limites les plus lointaines possibles, et dans sa marche sans trêve vers son auto expansion, il ne peut pas s'arrêter pour prendre en considération la santé ou le bien-être de ses producteurs, ou les conséquences écologiques de ce qu'il produit et comment il le produit. Le secret de la destruction écologique, aujourd'hui, se trouve dans le secret profond de la production capitaliste : "Accumulez, accumulez ! C'est Moïse et les prophètes... L'accumulation pour l'intérêt de l’accumulation, la production pour l’intérêt de la production..." (Marx, Le Capital, Livre I, chap. 24, "La transformation de la plus-value en capital").
Le problème, donc, derrière la catastrophe écologique, n'est pas la "société industrielle" dans l'abstrait, comme tant d'écologistes le proclament : jusqu'ici, la seule société industrielle qui ait jamais existé est le capitalisme. Celui-ci inclut bien sûr les régimes staliniens, qui sont une véritable caricature de la subordination capitaliste de la consommation à l'accumulation. Ceux qui blâment le marxisme pour les ravages écologiques dans les pays de l'Est accordent simplement leur voix à la clameur sur la "faillite du communisme" que la bourgeoisie occidentale pousse depuis l'effondrement du bloc impérialiste de l'Est. Le problème ne réside pas dans telle ou telle forme du capitalisme, mais dans les mécanismes essentiels d'une société qui ne se développe pas en harmonie consciente avec les besoins de l'homme et avec ce que Marx appelait le "corps inorganique" de l'homme, la nature, mais une société qui se développe "pour se développer".
Toutefois, le problème écologique a également une histoire spécifique dans le capitalisme. Déjà, dans la période ascendante du capitalisme, Marx et Engels avaient, à de nombreuses occasions, dénoncé la façon dont la soif de profit de ce système empoisonnait les conditions de travail et d'existence de la classe ouvrière. Ils considéraient même que les grandes cités industrielles étaient dès cette époque devenues trop grandes pour fournir les bases de communautés humaines viables, et ils considéraient "l'abolition de la séparation entre les villes et la campagne" comme une composante à part entière du programme communiste (on imagine ce qu'ils auraient dit au sujet des mégalopoles de la fin du 20e siècle...).
Mais c'est essentiellement dans la période présente du capitalisme, époque qui depuis 1914, a été définie par les marxistes comme celle de la décadence de ce mode de production, que la destruction impitoyable de l'environnement par le capital prend une autre dimension et une autre qualité, tout en perdant la moindre justification historique. C'est l'époque dans laquelle toutes les nations capitalistes sont obligées de se concurrencer dans un marché mondial sursaturé ; une époque, par conséquent, d'économie de guerre permanente, avec une croissance disproportionnée de l'industrie lourde ; une époque caractérisée par l'irrationnel, le dédoublement inutile de complexes industriels dans chaque unité nationale, le pillage désespéré des ressources naturelles par chaque nation essayant de survivre dans un combat de rats sans merci pour le marché mondial. Les conséquences de tout ça pour l'environnement sont claires comme le cristal ; l'intensification des problèmes écologiques peut être mesurée selon les différentes phases de la décadence capitaliste. Le premier développement des émissions de dioxyde de carbone s'est effectué durant ce siècle avec un accroissement considérable depuis les années 1960. Les CFC ont été inventés au cours des années 1930 et ont été utilisés massivement seulement lors de ces dernières décennies. Le surgissement des "mégalopoles" est surtout un phénomène d'après la seconde guerre mondiale, de même que le développement des types d'agriculture qui n'ont pas été moins dommageables écologiquement que la plupart des types d'industrie. La destruction effrénée des forêts amazoniennes s'est opérée dans la même période, et particulièrement entre 1980 et 1990 : son taux a alors probablement doublé.
Ce que nous voyons aujourd'hui est la culmination de décennies d'activité militaire et économique anarchique, de gaspillage et d'exploitation irrationnelle de la part du capitalisme décadent ; l'accélération qualitative de la crise écologique au cours des années 1980 "coïncide" avec l'ouverture de la phase finale de la décadence capitaliste - la phase de décomposition. Par cela nous voulons dire qu'après vingt ans de crise économique profonde et toujours pire, pendant lesquelles aucune des forces sociales déterminantes de la société n'a été capable d'imposer sa propre perspective historique de guerre ou de révolution mondiale, tout l'ordre social commence à s'effriter, à descendre dans une spirale incontrôlée de chaos et de destruction (voir dans Revue Internationale, n° 62, "La décomposition, phase finale de la décadence capitaliste").
Le système capitaliste a depuis longtemps cessé de représenter un quelconque progrès pour l'humanité. Les conséquences écologiques désastreuses de sa "croissance" depuis 1945 sont une démonstration de plus que son développement a pris place sur une base malade, destructive, et constitue un camouflet pour tous les "experts" - dont malheureusement certains figurent dans le mouvement politique prolétarien - qui mettaient en avant ce développement afin de combattre la notion marxiste de la décadence du capitalisme.
Mais cela ne signifie pas que les marxistes -à la différence de la bourgeoisie aujourd'hui, et de tous ses parasites petits-bourgeois- abandonnent la notion de progrès ou font de quelconques concessions aux préjugés anti technologie des "verts" radicaux.
Le concept marxiste de progrès n'a jamais été le même que celui, unilatéral, de la bourgeoisie, la notion linéaire d'une ascension stable des ténèbres primitives et de la superstition à la clarté de la raison moderne et de la démocratie. Le concept marxiste est une vision dialectique qui reconnaît que le progrès historique s'est fait à travers le choc des contradictions, qu'il a entraîné des catastrophes et même des régressions, que l'avancée de la "civilisation" a aussi signifié raffinement de l'exploitation et l'aggravation de l'aliénation de l'homme par rapport à lui-même et du divorce de l'homme d'avec la nature. Mais il admet aussi que la capacité croissante de l'homme à transformer la nature à travers le développement de ses forces productives, à soumettre les processus inconscients de la nature à son propre contrôle conscient, fournit les seules bases pour dépasser cette aliénation et arriver à une forme plus élevée de la communauté que le communisme limité des temps primitifs, c'est-à-dire à un monde élargi, une communauté unifiée qui sera fondée non pas sur la pénurie et la submersion de l'individu dans le collectif, mais sur un niveau d'abondance sans précédant qui fournira "les conditions matérielles pour le développement total, universel des forces productives de l'individu" (Marx, Grundrisse). En créant les bases pour la communauté humaine totale, le capitalisme a représenté un pas immense pour dépasser les économies naturelles qui l'ont précédé.
Aujourd'hui, la notion de "contrôle" de la nature a été vilement déformée par l'expérience du capitalisme, qui a traité toute la nature simplement comme une autre marchandise, comme un sujet mort, comme quelque chose d'essentiellement externe à l'homme. A l'opposé de cette vision -mais aussi contre le culte passif de la nature qui prévaut parmi beaucoup de "verts" aujourd'hui-, Engels a défini la position communiste quand il écrivait :
- "A chaque pas il nous est rappelé, qu'en aucune façon, nous ne régnons pas sur la nature comme un conquérant sur un peuple étranger, comme quelqu'un étant en dehors de la nature, mais que nous, avec notre chair, notre sang et notre cerveau, appartenons à la nature, existons en son sein, et que toute notre supériorité consiste dans le fait que nous avons l'avantage sur toutes les autres créatures d'être capables d'apprendre ses lois et de les appliquer correctement." (Ibid.)
En vérité, en dépit de toutes ses prétendues conquêtes, le capitalisme dévoile aujourd'hui que son contrôle sur la nature est le "contrôle" des apprentis sorciers, pas du sorcier lui-même. Il a jeté les bases pour une maîtrise réellement consciente de la nature, mais sa pratique profonde transforme toutes ses réussites en catastrophe. Comme disait Marx :
- "Au fur et à mesure que l'humanité maîtrise la nature, l'homme semble être de plus en plus soumis aux autres hommes ou à sa propre infamie. Même la clarté pure de la science semble incapable de briller si ce n'est sur un fond d'ignorance noire. Toutes nos inventions et tous nos progrès semblent aboutir à doter les forces matérielles d'une vie intellectuelle et à déshumaniser la vie humaine en la réduisant à une force matérielle". (Discours à l'anniversaire de Peoples Paper, avril 1856). Aujourd'hui, cette contradiction a atteint un tel degré que l'humanité se trouve à un moment fatidique de son histoire, devant le choix entre, d'un coté, le contrôle conscient de ses propres forces sociales et productives, et donc une "application correcte" des lois de la nature, et de l'autre, la destruction aux mains des forces mêmes qu'elle a mises en marche. Autrement dit, le choix entre le communisme ou la barbarie.
Seule la révolution prolétarienne peut sauver la planète
Si le communisme est la seule réponse à la crise écologique, la seule force capable de créer une société communiste, c'est la classe ouvrière.
Tout comme les autres aspects de la décomposition de la société capitaliste, la menace qui pèse sur l'environnement souligne le fait que, plus le prolétariat tarde à faire sa révolution, plus grand est le danger que la classe révolutionnaire soit minée et épuisée, que le cours vers la destruction et le chaos n'atteigne le point de non-retour qui rendrait la lutte pour la révolution et la construction d'une société nouvelle une tâche impossible. Dans la mesure où elle souligne l'urgence grandissante de la révolution communiste, la conscience de la profondeur des problèmes écologiques actuels jouera un rôle dans la transition entre les luttes prolétariennes défensives au niveau économique et un combat conscient et politique contre le capital dans son ensemble.
Mais il serait faux de croire qu'aujourd'hui, la question de l'écologie puisse en soi être un axe pour la mobilisation du prolétariat sur son propre terrain de classe. Bien que certains aspects limités du problème (par exemple, la santé, la sécurité dans le travail) puissent s'intégrer dans des revendications de classe véritables, la question en tant que telle ne permet pas au prolétariat de s'affirmer comme force sociale distincte. Au contraire, comme nous l'avons vu, elle fournit à la bourgeoisie un prétexte idéal pour ses campagnes interclassistes, et les ouvriers vont devoir résister activement aux tentatives de la bourgeoisie, et particulièrement de ses éléments "verts" et gauchistes, de se servir de la question pour les dévoyer de leur propre terrain de classe. Il reste donc vrai que c'est surtout en se battant contre les effets de la crise économique - contre les baisses de salaire, le chômage, l'appauvrissement à tous les niveaux - que les ouvriers vont pouvoir se constituer en force capable d'affronter l'ensemble de l'ordre bourgeois.
La classe ouvrière ne pourra prendre en charge la question écologique dans sa totalité qu'après avoir pris le pouvoir politique au niveau mondial. Il doit même être évident que cela constituera une des tâches les plus urgentes de la période de transition, intimement liée qu'elle est de toute façon avec d'autres problèmes pressants tels que la faim et la réorganisation de l'agriculture.
Nous ne pouvons pas, faute de place, entrer ici dans une discussion détaillée des mesures que devra prendre le prolétariat afin de redresser la situation désastreuse que nous lègue le capitalisme, et aller vers un rapport qualitativement nouveau entre l'homme et la nature. Ici, nous voulons seulement souligner un point : les problèmes auxquels sera confronté un prolétariat victorieux seront fondamentalement d'ordre non pas technique mais politique et social.
L'infrastructure technique et industrielle est profondément déformée par l'irrationalité du développement capitaliste dans l'époque présente, et il faudra certainement en démolir une bonne partie avant de pouvoir créer une base de production qui ne nuise pas à l'environnement naturel. Cependant, au niveau purement technique, de nombreuses alternatives ont déjà été développées, ou pourraient l'être si on y consacrait des ressources suffisantes. Il est dès maintenant possible, par exemple, dans les centrales électriques brûlant des hydrocarbures, d'éliminer la plupart des émissions de dioxyde de carbone et autres substances nuisibles, tout en réutilisant 100 % des déchets ou presque. De la même façon, il est déjà possible de développer d'autres sources d'énergie - solaire, éolienne, marine, etc.- qui sont à la fois renouvelables et non polluantes; des possibilités énormes existent également dans la fusion nucléaire, qui pourrait résoudre beaucoup des difficultés rencontrées avec la fission.
Le capitalisme a déjà développé ses capacités techniques au point de pouvoir résoudre le problème de la pollution. Mais le fait que la véritable question est de nature sociale est souligné par les nombreux cas où les intérêts capitalistes économiques ou militaires à court terme n'ont pas permis à la bourgeoisie de développer des technologies non polluantes. Nous savons par exemple qu'après la seconde guerre mondiale, les industries américaines du pétrole, du gaz, et de l'électricité ont monté toute une campagne pour étouffer l'énergie solaire; nous avons récemment appris que le gouvernement britannique a collaboré à l'élaboration d'un rapport dont les chiffres étaient falsifiés afin de démontrer que les centrales nucléaires coûteraient moins cher que les centrales maritimes ; l'industrie automobile, de même, a longtemps résisté au développement de moyens de transport moins polluants, etc.
Mais la question est plus profonde que la politique consciente de tel ou tel gouvernement ou industrie. Comme nous l'avons vu, le problème se trouve à la base même du mode de production capitaliste, et ne peut être résolu qu'en s'attaquant aux racines de ce mode de production.
Le capital détruit l'environnement sans s'en soucier, parce qu'il doit croître pour croître ; la seule réponse est donc de supprimer le principe même de l'accumulation capitaliste, de produire non pas pour le profit, mais pour satisfaire les besoins humains. Le capital ravage les ressources du monde parce qu'il est divisé en unités nationales concurrentes, parce qu'il est fondamentalement anarchique et produit en ne pensant pas au futur ; la seule solution consiste par conséquent dans l'abolition de l'Etat national, la mise en commun de toutes les ressources naturelles et humaines de la terre, et l'établissement de ce que Bordiga appelait "un plan de vie pour l'espèce humaine". Bref, le problème ne eut être résolu que par une classe ouvrière consciente du besoin de révolutionner les bases mêmes de la vie sociale, et qui détienne les instruments politiques pour assurer une telle transition à la société communiste.
Organisé à l'échelle mondiale, amenant dans son sillage toutes les masses opprimées du monde, le prolétariat international peut et doit mettre en oeuvre la création d'un univers où une abondance matérielle sans précédent ne compromettra pas l'équilibre de l'environnement naturel, ou plutôt, où l'une sera la condition de l'autre ; un monde où l'homme, enfin libéré de la domination du travail et de la pénurie, pourra commencer à jouir de la planète. C'est cela sûrement le monde que Marx a entrevu, à travers l'épais brouillard d'exploitation et de pollution dans lequel la civilisation capitaliste a plongé la terre, quand il prévoyait, dans les Manuscrits de 1844, une société qui exprimerait l’unité de l'être de l'homme avec la nature - la véritable résurrection de la nature -, la naturalisation de l'homme et l'humanisation de la nature enfin accomplies"
CDW.
Questions théoriques:
- Décadence [32]
- L'économie [86]
POLEMIQUE : Les révolutionnaires face aux émeutes de la faim
- 3108 reads
-
Quelle signification revêtent, pour la classe ouvrière, les “émeutes de la faim”, ces révoltes des populations les plus misérables et marginalisées des pays sous-développés et qui ont vu leur nombre augmenter au cours des dernières années : Algérie (1988); Venezuela, Argentine, Nigeria, Jordanie (1989) ; Côte d’ivoire, Gabon (1990) pour ne citer que les plus Importantes ? Quelle doit être l’attitude de l’avant-garde révolutionnaire à leur égard ?
La réponse que les organisations révolutionnaires apportent à ces questions relève de leur analyse globale de la situation internationale actuelle et des perspectives à long terme qu’elles envisagent pour le prolétariat dans le chemin qu’il aura encore à parcourir pour aller vers la révolution, des formes de lutte et d’organisation qu’il adoptera et de la fonction qu’elles attribuent au parti de classe. Dans la mesure où les émeutes tendent à gagner du terrain, à devenir chaque fois plus fréquentes, elles posent aux révolutionnaires la nécessité d’y intervenir directement, avec des orientations claires pour la classe ouvrière, ce qui souligne l’importance pratique et immédiate d’avoir une position claire à leur égard.
Devant la confusion des différents groupes du milieu politique prolétarien qui ont salué les émeutes de la faim comme des pas en avant de la lutte de classe du prolétariat, leur attribuant même une importance plus grande qu’aux grèves dans les usines, seul le CCI a souligné que ces actions contiennent le danger d’éloigner le prolétariat de son terrain de classe.
Une expression de la décomposition du capitalisme
Plusieurs organisations du milieu politique prolétarien ont abordé dans leurs publications la question des émeutes de la faim[1] [133], mettant en relief que leur cause profonde est l’approfondissement de la crise du système capitaliste et l’augmentation de l’exploitation et de la misère qui en découle pour la classe ouvrière et les autres couches déshéritées. Elles ont démontré comment les “plans” et les “mesures économiques” que la classe capitaliste applique pour essayer d’éviter la ruine des pays sous-développés -c’est-à-dire, pour essayer de sauver leurs profits-, entraînent des attaques renouvelées et brutales aux conditions de vie de millions de personnes ; et que les révoltes de la faim, les pillages massifs de magasins, sont la réponse la plus élémentaire à une situation insupportable et désespérée. Nous-mêmes avons écrit, par exemple, que “Les émeutes sont tout d’abord la réponse des masses marginalisées aux attaques de plus en plus barbares du capitalisme mondial en crise. Elles font partie des secousses qui ébranlent de plus en plus fortement les fondements mêmes de la société capitaliste en décomposition” (Revue Internationale n° 57, p. 14, 2e trimestre 1989).
D’autres groupes y font référence en ces termes :
- “La révolte se manifeste (...) comme réponse aux coups de la crise. Si l’on considère le fait que les masses prolétariennes et semi-prolétariennes de ces pays [la périphérie] ont participé dans le mouvement (...) on doit nécessairement conclure qu’un tel mouvement constitue primordialement une action de la classe exploitée contre les effets de sa condition”. (Prometeo n° 13, nov. 1989 p. 33).
- “La crise du capitalisme argentin, qui enfonce jour après jour dans la misère la plus absolue des masses toujours plus grandes de prolétaires et de salariés, de la même façon qu’au Venezuela ou en Algérie, a lancé les affamés dans une lutte pour la survie”. (Le Prolétaire, n° 403, oct-nov. 1989)
Le fait que l’on partage ce point de vue général sur les causes des émeutes de la faim indique l’existence d’une frontière de classe qui sépare les organisations politiques prolétariennes des organisations de la bourgeoisie. Car, bien que ces dernières ne puissent pas nier l’augmentation de la misère qui est à l’origine de ces actions, elles ne pourront jamais admettre que c’est le système capitaliste comme un tout qui en est la cause (et pas seulement la “mauvaise politique économique” de tel ou tel gouvernement, ou “les mesures du FMI contre les pays pauvres”), car cela remettrait en question leur propre existence.
Cependant, ce point de vue commun aux organisations du milieu politique prolétarien est en fait très général. Au-delà de celui-ci il existe de grandes divergences par rapport à l’analyse de la crise (sur ses racines: baisse tendancielle du taux de profit ou saturation des marchés, sur sa nature : cyclique ou permanente...), divergences qui ne cessent de s’approfondir. C’est ainsi que seul le CCI a relevé la signification du fait que la crise dure déjà depuis vingt ans sans trouver d’issue. Le cours aux affrontements de classe signifie que la bourgeoisie n’a pas réussi à assener au prolétariat une défaite historique telle qu’elle lui permette de l’entraîner vers une guerre mondiale ; cependant, le prolétariat n’a pas non plus été capable encore d’imposer son alternative historique : la révolution communiste. Ce blocage historique entre les classes a rendu possible que la crise continue de s’approfondir. Cependant tous les aspects de la société ne demeurent pas stables, mais sont entrés dans ce que nous avons appelé “la période de décomposition du capitalisme” (voir “La décomposition, phase ultime de la décadence capitaliste” Revue Interna4onale n° 62).
Pour le CCI il est clair que le capitalisme peut mener à la destruction de l’humanité, pas seulement par la guerre atomique entre les grandes puissances impérialistes (danger momentanément écarté à cause de l’effondrement dans le chaos du bloc de l’URSS), mais que cette destruction peut aussi provenir de la multiplication de plus en plus incontrôlable des expressions de ladite décomposition : famines, épidémies, drogues, catastrophes nucléaires... Les autres organisations révolutionnaires feraient mieux d’analyser sérieusement le contenu de toutes ces données, qui semblent à première vue sans rapport les unes avec les autres, et les tendances actuelles de la société capitaliste qui en découlent, plutôt que de taxer simplement le CCI de “catastrophiste”.
Pour ce qui concerne les pays sous-développés, nous disions que la crise capitaliste y impose une misère telle qu’elle est à l’origine des émeutes massives de la faim. Cependant, cette misère acquiert aussi un contenu différent en tant que produit de la décomposition du capitalisme.
Les pays sous-développés ont été moins résistants aux coups de la crise et, l’un après l’autre, ils se voient précipités dans la ruine la plus complète et irréversible. Dans la décennie des années 80, avec l’arrivée à échéance des délais de paiement des dettes contractées dans la décennie précédente, et devant l’impossibilité de les honorer, le flux de capitaux vers ces pays s’est tari, provoquant la récession mondiale de 1980-82, que seuls les pays les plus industrialisés ont pu surmonter.
Les pays sous-développés n’ont jamais pu s’en remettre. Dans les années 80, la croissance de leur production a été pratiquement égale à zéro. La faiblesse de leur industrie les rend incapables d’être concurrentiels sur le marché mondial et leurs marchés internes sont occupés par les produits en provenance de pays plus développés, ce qui les conduit à la faillite. La production de matières premières (minerais, agriculture, pétrole), leur principale source de revenus, s’est aussi écroulée, par suite de la chute des prix due à la saturation du marché mondial. Ils sont maintenant entrés dans une phase de décapitalisation et de désindustrialisation ; les champs cultivés sont laissés à l’abandon ou consacrés à la culture de produits destinés à la fabrication de drogues à la place de produits alimentaires ; on ferme les mines qui ne sont pas assez rentables ; des réserves de pétrole restent inexploitées parce que les capitaux sont investis dans la spéculation en bourse, placés dans les banques des pays riches ou bien partent dans le remboursement de l’intérêt des dettes.
Dans ces pays le capital et les bourgeoisies “locales” -avec l’appui des grandes puissances- tiennent grâce à une exploitation extrême de la classe ouvrière : les salaires réels ont été réduits de moitié au cours des dernières dix années, principalement par le biais de la formule infernale “inflation-plans de choc”, et rien n’arrête cette tendance à la baisse. En même temps, le chômage croissant a créé une situation sans précédent dans l’histoire, qui doit être sérieusement analysée.
Avec la stagnation et la chute de la production capitaliste, des millions d’ouvriers ont été expulsés des industries. S’y ajoutent les millions de jeunes qui arrivent à l’âge de travailler sans que le capitalisme soit capable de les intégrer à un travail productif ; autant de millions de paysans ruinés émigrent sans arrêt vers les villes. D’après les chiffres très partiels publiés par la bourgeoisie, 50 % de la population de ces pays est au chômage et le pourcentage atteint même 70 à 80 % dans certains endroits. S’il est vrai que l’expulsion de la paysannerie, l’existence d’une armée industrielle de réserve et le chômage massif sont tous des aspects inhérents au capitalisme en période de crise, l’ampleur qu’ils atteignent à l’époque actuelle leur confère un nouveau contenu et démontre la tendance du capitalisme à la décomposition, à la désagrégation complète.
Comment ces masses ont-elles pu survivre jusqu’à mainte nant ? Au moyen de ce qu’on appelle l’“économie immergée”. Cette “économie immergée” est constituée par un dense réseau de relations à la tête duquel se trouvent de puissants trafiquants capitalistes (trafiquants de n’importe quoi, depuis les drogues jusqu’aux appareils électroménagers) qui concurrencent avantageusement l’“économie officielle”, au point d’obtenir dans certains pays des profits équivalents ou même supérieurs à ceux de cette dernière. Cette “économie immergée” fournit des “emplois” à ces millions de personnes, essentiellement en tant que vendeurs à la sauvette dans les rues. Ces masses de “sous-employés”, chômeurs en réalité, constituent l’élément central des émeutes de la faim. Marginalisées par le capitalisme, elles sont proches du prolétariat du fait qu’elles ne possèdent que leur force de travail et qu’en ce sens elles constituent potentiellement une force anticapitaliste ; cependant, l’analyse ne peut pas les assimiler sans plus à l’ensemble de la classe ouvrière, comme l’ont fait les différents groupes du milieu révolutionnaire. Car le fait de se trouver exclus d’un processus de travail collectif est un obstacle qui empêche leur réflexion et leur lutte comme partie de la classe ouvrière. Il faut noter que tout au long des dernières vingt années, on n’a pas assisté à des mouvements de sans-travail, luttant et s’organisant comme tels. Cela traduit, en même temps que la perte des traditions de la classe ouvrière, produit de la contre-révolution entre les années 20 et la fin des années 60, l’influence croissante du “sauve qui peut” propre à l’idéologie capitaliste en décomposition. Mais en outre, comme nous le disions plus haut, à ces chômeurs viennent s’ajouter les paysans ruinés qui abandonnent les campagnes et qui conservent leur point de vue individuel de petit propriétaire, et les jeunes toujours plus nombreux qui n’ont jamais pu travailler. Même si ceux-ci restent en rapport avec la classe ouvrière, car beaucoup sont des fils d’ouvriers et habitent les mêmes quartiers, cette masse n’échappe pas à l’influence du lumpenprolétariat, car d’elle proviennent aussi les vendeurs de drogue, les criminels, les mouchards, les hommes de main...
Ainsi, la compréhension du fait que la cause des pillages est la crise capitaliste, et qu’ils constituent la seule réponse que peut donner une masse désespérément affamée, ne doit pas nous voiler les yeux sur le caractère dénué de perspective de classe de ces émeutes et sur le danger que la classe ouvrière soit diluée dans cette masse de marginalisés, si elle ne réussit pas à affirmer son terrain de classe.
La classe ouvrière face aux émeutes
Une nouvelle divergence s’ouvre entre le CCI et les autres groupes du milieu politique prolétarien avec la prise de position sur les émeutes de la faim. Pour eux :
-
“La nature prolétarienne de ces événements” réfute “ceux qui voient dans les émeutes de la faim et de la misère une sorte de déviation de la lutte de classe” (Le Prolétaire n° 403).
-
"On affirme -sans démontrer- que ce genre d’émeutes ne relève pas directement de la lutte des classes, on les présente comme un processus de décomposition sociale (et non également de lutte contre ce processus), comme une révolte sans profil de classe qui accentue la “lumpen-prolétarisation de la société” (Emancipacién Obrera - “Rapport sur l’explosion sociale en Argentine”).
-
“Dire, comme certains, que ces mouvements illustrent seulement l’état de décomposition de la société comme aspect générique de la décadence du capitalisme impérialiste, c’est du bavardage complètement inutile si ce n’est pour cacher son propre aveuglement politique et sa propre absence de méthode marxiste (...) Mais la signification principale et plus importante de ces luttes est qu’en leur sein s’exprime un fort mouvement matériel de larges couches de notre classe contre les effets de la crise capitaliste. Et c’est le mouvement matériel des classes que les marxistes considèrent comme condition indispensable à un développement du mouvement subjectif politique.” (“Prometeo” n° 13).
Pour ces groupes donc, contrairement au CCI, les pillages massifs de magasins ont un caractère prolétarien, ils sont partie intégrante de la lutte de classe du prolétariat. Nous devons revenir sur ce que nous entendons par “luttes de la classe ouvrière”.
Bien entendu, et c’est une lapalissade, la première condition de la lutte de classe du prolétariat est... que des prolétaires y participent. Et effectivement, nous ne nions pas que des ouvriers participent dans ces émeutes. Bien au contraire, nous n’avons pas cessé de souligner cette réalité, mais en signalant que cela constitue un danger pour la lutte de la classe. S’il est vrai que dans toute lutte de classe prolétarienne participent forcément des ouvriers, l’inverse n’est pas toujours vrai ; toute action à laquelle participent des ouvriers n’est pas forcément un mouvement de la classe. Par exemple : les mouvements nationalistes, ethniques, dans lesquels sont entraînées des masses d’ouvriers, qui peuvent aussi se trouver dans une situation désespérée, ont un caractère bourgeois.
Dans ces émeutes les ouvriers participent, effectivement, mais non pas regroupés comme classe, mais en tant qu’individus dispersés dans les masses affamées, désoeuvrées, dont nous parlions plus haut.
D’autres groupes, tels que le PCI/Le Prolétaire ou la CWO, ne font simplement pas de différence dans ce sens, et voient dans les révoltes uniquement le prolétariat en action. Il faut noter cependant que BC remarque une différence, puisqu’il nous demande : “Les masses misérables et marginalisées [d’autres endroits il parle de “semi-prolétaires”] sont-elles du côté du prolétariat ou du côté de la bourgeoisie ? (Cette question implique déjà que ces masses marginalisées ne sont pas exactement identiques au prolétariat). “Leur potentialité de lutte est-elle en faveur de la révolution prolétarienne ou de la conservation bourgeoise ?” Et il répond tout de suite à cette question, mais par la tangente : “C’est avec les masses pauvres et marginalisées que le prolétariat des pays périphériques pourra vaincre lors de son attaque décisive contre l’Etat capitaliste”.
Certainement. C’est avec les masses marginalisées que le prolétariat peut et doit mener son combat révolutionnaire. Mais il ne suffit pas de dire “avec les masses marginalisées”. La question est que le prolétariat doit guider ces masses, les attirer à sa lutte, s’efforcer de faire qu’elles adoptent son point de vue de classe et sa perspective historique ; et non pas le contraire, comme cela arrive dans les émeutes de la faim, où c’est le prolétariat qui se laisse entraîner derrière la réponse désespérée de ces masses marginalisées.
BC poursuit : “Mais surtout la lutte de ces masses est, tout compte fait, une révolte contre l’ordre capitaliste et non contre le prolétariat et ses revendications immédiates et historiques.” Que les émeutes sont “contre l’ordre capitaliste”, nous l’avons déjà dit aussi : “Réveillée brusquement de ses rêves par une explosion de violence sociale qu’elle n’avait jamais imaginée, la bourgeoisie a assisté au dramatique écroulement de sa “paix sociale” (Section du CCI au Venezuela, “Communiqué sur la révolte”).
Mais, ici encore, on doit faire attention aux termes. Car si la lutte de la classe ouvrière brise nécessairement l’ordre bourgeois, la réciprocité n’est pas vraie : toute déstabilisation de l’ordre bourgeois n’implique pas en soi une lutte prolétarienne anticapitaliste. “Emancipacion Obrera” exprime la même confusion que BC de manière encore plus crue, quand il fait référence au “triomphe récupérable” de la révolte en Argentine: “Et ce n’est pas n’importe quelle lutte qui a eu lieu, mais une lutte qui brisait non seulement l’encadrement syndical et politique-démocratique, mais aussi le cadre légal.” (“Communiqué sur l’explosion sociale en Argentine”)
On trouve ici dans E.O. des relents de gauchisme, pour qui l’“illégalité” est synonyme de révolutionnaire. Les actions terroristes, les attaques de lumpenprolétaires troublent aussi l’ordre et sont aussi “illégales”, et pourtant on ne les considère pas comme faisant partie de la lutte prolétarienne. Est-ce que nous voulons dire par là que les émeutes sont le fait de lumpenprolétaires, ou de terroristes ? Non. Mais il faut voir que ces deux excroissances sociales -tant les lumpenprolétaires que les “guérilleros”- se trouvent dans ces émeutes comme des poissons dans l’eau, dans leur élément (“expropriations”, “exécutions”, actions violentes sans lendemain...), et c’est pour cela qu’ils les encouragent avec tant d’ardeur -ce sur quoi nous devons également mettre en garde le prolétariat.
Ce que nous voulons dire est que, s’il est vrai que la lutte ouvrière brise nécessairement la légalité bourgeoise -puisque toute grève de résistance s’affronte à l’appareil juridico-politique du capital et doit le surmonter pour réussir à s’étendre-, par contre, toute action “illégale” n’est pas en soi une lutte de la classe ouvrière.
Mais alors, si la participation d’ouvriers et le fait de briser l’ordre bourgeois ne sont pas des facteurs suffisants, qu’est- ce qui caractérise une action qui fait partie de la lutte de la classe ouvrière ? Les revendications immédiates et les objectifs historiques qui leur sont indissociables. C’est-à-dire, l’orientation, la perspective de ces luttes. Ce que nous appelons toujours : “le terrain de classe”.
A ce sujet, voyons la position des différents groupes. A notre connaissance, seul E.O. est arrivé à affirmer que les émeutes de la faim obtiennent la satisfaction de revendications immédiates, ce qui serait -avec la rupture de la légalité-, le deuxième volet du “triomphe récupérable” de la révolte en Argentine.
“Pour commencer, face à une situation concrète de faim et de très bas salaires, le mouvement de lutte [c’est-à-dire la révolte] a impliqué une amélioration réelle du “salaire” des participants [sic]. En outre, il leur a démontré à eux-mêmes qu’on peut faire des choses, [?] qu’on peut lutter et que cette lutte porte des fruits.” (p. 12).
Cette affirmation à la légère qui tend à identifier la lutte pour les salaires avec les pillages, est tout simplement démentie dans le même document d’E.O., quand il rapporte comment, pendant la répression sauvage de la révolte, les forces de police ont perquisitionné les maisons des quartiers pauvres en confisquant tout sur leur passage. Mais pour la classe ouvrière, le plus grand danger est précisément qu’elle abandonne ses mouvements de grèves et ses manifestations de rue sur son terrain de classe, pour ses propres revendications et dans la perspective révolutionnaire, et qu’elle commence à penser que les pillages sont la seule solution à la misère de sa situation. Et les affirmations d’E.O. poussent dans ce sens quand elle dit que la révolte “porte des fruits”. D’autres groupes n’ont pas affirmé cela, mais autant BC que le PCI ont salué le document d’E.O. sans critiquer cette position, soucieux surtout d’utiliser ce document pour s’en prendre au CCI.
Quant à la perspective que contiennent les émeutes, voyons ce qu’en disent certains groupes.
- CWO : “Pour les révolutionnaires le problème se pose en ces termes : comment la classe ouvrière vénézuélienne peut-elle transformer cette résistance, combative mais désespérée, en quelque chose qui n’aboutisse pas à une brutale répression.” (Workers’Voice, n° 46, avril-mai 1989)
- PCI : “Nul doute que dans cette situation, le prolétariat continuera à occuper le devant de la scène sociale, et ce que nous pouvons espérer [?], c’est qu’à la spontanéité des révoltes des quartiers, se substitue une lutte plus organisée, en dehors du giron des appareils réformistes, unifiant l’action de la lutte du prolétariat et la protégeant plus efficacement contre les coups de la répression.” (Le prolétaire, n° 406)
- E.O. : “Sa limite réside dans l’absence de perspective révolutionnaire, le manque d’objectifs, ne fût-ce qu’à moyen terme et, évidemment, l’absence d’une organisation prolétarienne révolutionnaire, ce qui rend le mouvement totalement vulnérable.”
Cette dernière et franche affirmation d’E.O., sur l’absence de perspective révolutionnaire, n’a été démentie par personne dans le milieu politique prolétarien. Les groupes se contentent d’esquiver le problème. Posons-nous alors la question : si ces révoltes font partie de la lutte de classe du prolétariat, pourquoi faudrait-il que les révolutionnaires se battent pour faire que ces luttes “deviennent autre chose” (CWO), ou pour qu’il s’y “substitue une lutte plus organisée” (PCI), au lieu de, par exemple, lutter pour que ces émeutes s’organisent, s’étendent et s’élèvent à un niveau supérieur ?
La réponse semble évidente : parce que, suivant leur propre dynamique, la poursuite de ces émeutes de la faim ne peut conduire qu’à une impasse sans issue. En tant que réaction désespérée, désorganisée, incapable d’affronter sérieusement la répression, elles ne peuvent conduire qu’à l’écrasement des masses aux mains des forces de répression, et à une situation encore pire que celle qui les a engendrées, dans tous les domaines : matériel, organisationnel, conscience.
C’est justement cela que nous avons souligné. C’est pour cela que nous avons mis en garde la classe ouvrière contre toute tendance à se laisser entraîner dans ces émeutes, l’appelant à se maintenir sur son propre terrain de lutte, au lieu de l’inviter -explicitement ou implicitement- de façon irresponsable, à se plonger dans ce type d’actions, à coups de saluts aux “luttes de la classe ouvrière”.
BC se hasarde cependant à affirmer que ces émeutes de la faim possèdent une perspective :
- “...au-delà de la question de leur nombre, il existe une différence qualitative entre les luttes qui se sont toujours déroulées dans les pays de la périphérie et les émeutes des dernières années.., on ne peut que noter la différence qui existe entre une grève ordinaire [?], revendicative.., et une révolte, accompagnée d’affrontements dans la rue, comme réponse à une attaque extraordinaire et générale... L’intensité de l’affrontement détermine non seulement l’intensité de la répression qui en découle de la part de la bourgeoisie, mais aussi, dans certaines limites, sa politique...”
- “Si la paix sociale permettait l’acceptation sans conditions des diktats du FMI, ou, plus généralement, de la situation de crise au niveau international, la rupture de la paix sociale oppose à ceux-ci des limites, ou, du moins, de sérieux obstacles... Le changement d’attitude... de la part des gouvernements des pays de la périphérie, s’il parvenait à avoir une influence sur la part de plus-value qui est drainée de la périphérie vers le centre, déterminerait une détérioration des conditions qui ont rendu possible la gestion de la crise et le maintien de la paix sociale dans les métropoles... Nous tenons à souligner que nous parlons de possibilité.., car il n’est pas du tout certain que cela se produise...”
BC ne reconnaît pas la continuité qui lie les grèves ouvrières des dernières années dans un même mouvement. Dans une autre partie du document cité, il ne voit, dans les grèves en Europe, que des “épisodes” sans conséquences, “les luttes ordinaires de toujours qui ne troublent en rien la paix sociale”. Les vagues de grèves au niveau international de ces dernières vingt années, ne sont, pour BC, que pure imagination du CCI. Mais il n’y a ici rien de nouveau chez ce groupe, qui nous a habitués à ne pas voir de luttes ouvrières là où il y en a, et à les voir là où il n’y en a pas.
Ce qui est nouveau c’est que BC, en partant de l’idée que les émeutes de la faim sont “qualitativement différentes” des grèves ouvrières, considère les premières comme les plus fortes et les plus importantes, et cela non pas à cause des “fruits” immédiats auxquels pense E.O., mais à cause des grandes perspectives qu’elles ouvrent. Car, d’après BC, les pillages de magasins :
- opposent des limites, créent des obstacles à la politique économique des gouvernements de la périphérie ;
- peuvent faire changer d’opinion ces gouvernements quant à l’application des plans dictés par le FMI ;
- peuvent, en conséquence, provoquer un affaiblissement de la fragile stabilité économique des métropoles ;
- et pourraient de ce fait rompre la paix sociale au sein de celles-ci.
En résumé, d’après BC, les pillages de magasins font plier le capitalisme mondial. A cette affirmation, pour le moins légère, nous pouvons répondre tout simplement qu’aucune de ces émeutes n’a “limité” ni “créé des obstacles” à l’application des plans du capital à moins de croire naïvement aux larmes de crocodiles des banquiers et des gouvernements. La seule chose qui change c’est la plus grande brutalité avec laquelle ces plans sont appliqués. Et tout le reste des spéculations de BC perd son sens. Il est vrai que l’économie des pays centraux s’oriente vers la récession ouverte, mais ceci n’est pas dû aux émeutes qui auraient empêché la “gestion de la crise”. Au contraire, c’est parce que la “gestion de la crise” a déjà donné tout ce qu’elle pouvait donner, parce que tous les plans ont déjà été appliqués, que la récession ouverte vient frapper de nouveau le capitalisme des pays centraux.
BC parle aussi d’“intenses émeutes avec des affrontements de rue”, donnant l’impression qu’il s’agit de combats entres forces comparables. A ce propos, nous préférons laisser la parole à la CWO qui, avec BC, fait partie du BIPR, mais qui a cependant une opinion très différente au sujet de ces “affrontements de rue” :
-
“Dans les rues de Caracas et d’autres villes, en particulier dans les quartiers pauvres, il y a eu une résistance armée aux forces de l’Etat. Mais d’où est venue cette résistance ? S’agissait-il d’une provocation de la droite... ? S’agissait-il d’un nouveau réveil de la guérilla urbaine... ? Ou était-ce les habitants de ces zones qui essayaient désespérément de venger les victimes de la terreur ? Ce qui est certain c’est qu’il ne s’agissait pas de l’expression armée d’un nouveau mouvement prolétarien. Les mouvements prolétariens n’ont pas besoin de sacrifier les ouvriers qu’ils défendent ni de les faire agir en dehors d’un mouvement de masses politiquement préparé pour faire avancer la lutte.”
Ce qui est vrai, c’est que ce n’est pas seulement dans sa phase de “résistance”, mais dès son départ, que la révolte “n’est pas une expression du mouvement prolétarien”.
Où en est-on après tout cela? Qu’en est-il des émeutes de la faim ? En fait, il s’agit d’actions désespérées dans lesquelles les ouvriers, dans la mesure où ils y participent, n’agissent pas comme classe ; des actions qui n’ont comme résultat immédiat que la répression féroce du capital et qui ne contiennent aucune perspective révolutionnaire. Il s’agit d’actions qui devraient “devenir autre chose”
Cependant, les groupes du milieu politique prolétarien que nous avons mentionnés peuvent continuer à saluer ces révoltes de la faim comme des “luttes de la classe ouvrière”, car, pour eux, le manque de perspectives de classe de ces actions a une explication : elles ne sont pas dirigées par le parti.
“Si le parti existait...”
-
PCI : “Ces actions spontanées, si elles montrent bien la faiblesse de la classe… et l’absence de l’organisation révolutionnaire… laissent voir cependant une lueur d’espoir, parce qu’elles témoignent que la classe n’est pas disposée à laisser, les bras croisés, ses enfants mourir de faim. La tâche des révolutionnaires consiste à constituer et à développer l’organisation révolutionnaire, le parti de classe capable de recueillir cette volonté de lutte et de diriger cette énergie révolutionnaires vers des objectifs de classe.” (Le prolétaire, n° 403, oct-nov 1989)
-
E.O. “Sa limite réside dans l’absence de perspective révolutionnaire et, évidemment, l’absence d’une organisation prolétarienne révolutionnaire, ce qui rend le mouvement totalement vulnérable”.
-
BC : “Y avait-t-il, dans cette révolte, plus de semi-prolétaires ou de sous prolétaires que de prolétaires d’usine ? La question porte à rire… Si le prolétariat n’était pas encore suffisamment présent dans le mouvement, il s’agissait d’une limite du prolétariat et de son organisation politique (encore virtuellement inexistante) et non de la révolte elle même.” (Prometeo n° 13)
Ainsi, suivant la voie “bordiguiste” qui fait du parti le démiurge du mouvement révolutionnaire, ces groupes croient avoir résolu tout questionnement sur la nature des émeutes. Mais cette position, qui se veut très ferme, cache, en réalité, leur incapacité à offrir actuellement au prolétariat une orientation face aux émeutes
Rappelons ici que le CCI considère que le parti est un organe indispensable pour le prolétariat dont il oriente le combat révolutionnaire. Mais ce dont il s’agit ici ce n’est pas de savoir ce qu’il adviendra de ces émeutes lorsque le parti existera, mais de l’attitude que doivent avoir les révolutionnaires aujourd’hui, lorsque les conditions existantes engendrent la multiplication de ces révoltes.
Si les émeutes de la faim constituent des luttes prolétariennes d’une importance égale ou même supérieure à celle des mouvements de grèves “ordinaires”, alors ces groupes révolutionnaires devraient agir en conséquence.
Par exemple, face aux grèves, les révolutionnaires tirent des leçons des expériences et les font connaître à l’ensemble de la classe, afin que les prochaines grèves soient plus fortes, affrontent en de meilleures conditions l’appareil étatique. Face à une grève qui éclate, les révolutionnaires bandent leurs forces, interviennent activement en son sein, appellent à son extension, demandent à d’autres secteurs de se joindre au combat, dénoncent les manoeuvres des syndicats et des autres ennemis, ils font des propositions de marche et d’organisation, ils réalisent, enfin, tout un travail d’agitation et de propagande en vue de l’extension de la conscience révolutionnaire parmi les travailleurs...
Quelle devrait donc être l’attitude des révolutionnaires face à cette autre forme de la “lutte de classe” que seraient ces émeutes ? Faut il encourager celles-ci ? Faut-il y participer ? Faut-il appeler les ouvriers à participer aux pillages ? Faut-il faire de la propagande expliquant que ces révoltes permettent d’arracher des “fruits” et qu’elles déstabilisent le système capitaliste ?
Ce que nous disons semble faire rire certains. Mais il n’y a pas de quoi. Tous ces groupes ne font que tourner autour d’un très grave problème : ils appellent “lutte de classe” des actions dans lesquelles ils ne sont pas prêts à s’engager eux mêmes. Tout ce qu’ils parviennent à dire c’est des formules du genre :
- “Nous espérons qu’à ces révoltes se substituera une lutte plus organisée.” (PCI) ;
- “Les mouvements prolétariens n’ont pas besoin de sacrifier les ouvriers qu’ils défendent.” (CWO) ;
- “Il est évident qu’un mouvement similaire ne pourra pas se reproduire au cours des prochains mois car la bourgeoisie provoquerait un terrifiant bain de sang et une très grave défaite, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui [?]. Et tous ceux qui y ont participé le savent.” (E.O.) ;
- “Nous tenons à souligner que [à propos des spéculations sur les perspectives des émeutes] nous parlons de possibilité et que nous employons le mode conditionnel, car il n’est pas du tout certain qu’il en adviendra ainsi.” (Prometeo)
Telle est l’attitude de ces groupes face aux émeutes de la faim :
- Ils les saluent aux quatre vents comme des jalons importants de la lutte de classe.., mais ils sont incapables de leur offrir la moindre alternative de marche concrète. Cette tâche ils la laissent... au futur parti.
- Du bout des lèvres, ils admettent que les émeutes n’ont d’autre destin que celui de s’écraser contre le mur de la répression ; qu’elles ne portent pas en elles une alternative prolétarienne révolutionnaire et que l’énergie gaspillée dans ces combats devrait être utilisée d’une façon différente, dans un autre type d’actions, dans une véritable lutte de classe.
- Cela ne les empêche pas, cependant, de continuer à “critiquer” le CCI parce qu’il est la seule organisation qui a ouvertement dénoncé le danger que constituent ces émeutes pour le prolétariat, et qui distingue clairement ce type d’actions de la lutte sur le terrain de la classe ouvrière.
L’attitude de ces groupes peut être synthétisée en deux phrases :
- incapacité à comprendre les bouleversements accélérés de la vie du capitalisme que nous sommes en train de vivre ;
- irresponsabilité face à la fonction que leur a désignée la classe à laquelle ils appartiennent.
Ldo.
[1] [134] Dans cet article nous ferons référence aux organisations suivantes :
- le PCI (Parti Communiste Internationaliste), qui publie “Battaglia Comunista” et “Prometeo”, en Italie, auquel il sera fait référence sous le sigle “BC” ;
- le PCI (Parti Communiste International), qui publie “Le Prolétaire” et “Programme Communiste” en France, auquel il sera fait référence sous le sigle “PCI” ;
- la Communist Workers’Organisation, qui publie “Workers’Voice” en Grande-Bretagne, à laquelle il sera fait référence sous le sigle “CWO”;
- “Emancipaciôn Obrera” en Argentine, à laquelle il sera fait référence sous le sigle “EO”.
Situations territoriales:
Récent et en cours:
- Banlieues [136]
Courants politiques:
- TCI / BIPR [137]
- Battaglia Comunista [66]
- Communist Workers Organisation [138]
Revue Int. 1991 - 64 à 67
- 4295 reads
Revue Internationale no 64 - 1e trimestre 1991
- 2916 reads
Editorial : Face à la spirale de la barbarie guerrière, une seule solution : développement de la lutte de classe
- 2599 reads
L'année 1991 s'ouvre avec la menace d'une guerre terriblement meurtrière, impliquant massivement l'armée de la première puissance capitaliste, les Etats-Unis, avec une plongée dans la récession ouverte de l'économie mondiale, d'énormes attaques contre la classe ouvrière des pays développés, une misère de plus en plus épouvantable, non seulement dans le "tiers-monde", mais aussi dans les pays de l'ancien "bloc de l'Est", au premier rang desquels l'URSS, ravagée par la famine.
Le monde n'entre pas dans un "nouvel ordre international", mais se trouve de plain-pied dans la phase ultime de la décadence du mode de production capitaliste, la décomposition ([1] [139]), avec, au coeur du tourbillon de la barbarie, la guerre de tous contre tous, au premier rang de laquelle les Etats-Unis, déterminés à défendre par tous les moyens militaires dont ils disposent, leur prépondérance mondiale sur I' "ordre" existant.
La guerre du golfe, vers le massacre
Au moment où nous écrivons, Baker, deuxième personnage de l’Etat US, vient de terminer sa tournée de rencontre des chefs d'Etat en Arabie, en Syrie, en URSS, en France, au cours de laquelle il a rappelé la détermination des Etats-Unis dans la "crise du Golfe" face à l’Irak. Bush revient de Tchécoslovaquie où il a relancé l’appel à suivre et soutenir les Etats-Unis dans leur croisade militaire. L'armée américaine effectue des grandes manoeuvres. Le nombre de soldats doit être porté après de 400 000. Des centaines de milliers d'irakiens férocement embrigadés sont sur le front. L'armée israélienne est sur le pied de guerre et toutes les armées, polices, milices de la région sont en effervescence. Le Moyen-Orient est à la veille d'une nouvelle tuerie, d'une violence sans précédent.
Contrairement à la propagande sur la fin de la "guerre froide" qui devait marquer l'ouverture d'un "nouvel ordre mondial" de paix, c'est le "réchauffement" de la guerre à tous les niveaux, c'est le chaos de la situation internationale et la décomposition du système capitaliste qui s'accélèrent.
Le "désarmement" ? Une course à des armes encore plus efficaces et plus adaptées à la guerre "moderne", avec mise au rebut du matériel inutilisable, et un engagement armé direct accru dans des conflits de la part des principaux pays protagonistes des 'conférences" et autres "accords^ sur ce soi-disant "désarmement", au premier rang desquels, le plus puissant, les Etats-Unis.
La "paix" ? C'est la multiplication des conflits, l'entrée dans la guerre directement et massivement de l'armée américaine, l'envoi de troupes et de matériel de plusieurs pays, y compris des pays développés, en quantité jamais vue depuis plusieurs décennies sur les champs de bataille, avec, en toile de fond, une récession sans précédent de toute l'économie mondiale. ([2] [140])
La "communauté internationale" ? Les résistances et les oppositions s'aiguisent entre les anciens "alliés" des Etats-Unis d'un "bloc de l'Ouest" désormais rangé au placard de l'histoire.
Les résistances des pays développes
La dislocation de la coalition anti-irakienne, vers le chacun pour soi
Alors que les Etats-Unis parvenaient à afficher l'unanimité de façade de la "communauté internationale" en août 1990, en déclenchant la "crise du Golfe" face au "fou Saddam", à peine deux mois plus tard, c'est ouvertement le chacun pour soi dans la dite "communauté".
La libération de tous les otages français fin octobre 1990, à l'initiative de Saddam Hussein, sans négociation apparente, a montré ce que valait la détermination des "alliés" des USA et le "solennel engagement" pris quelques jours plus tôt... de "ne pas négocier séparément avec l'Irak". C'est apparemment Cheysson, ancien ministre français des affaires étrangères, qui a eu des "contacts" avec son homologue irakien. A sa suite, Bagdad a accueilli une procession de personnalités politiques de premier plan, venant négocier ouvertement la libération d'otages, et certainement bien d'autres choses plus discrètement : Willy Brandt, ex-chancelier de RFA, président de l’"Internationale socialiste", prix Nobel de la Paix, Nakasone, ex-premier ministre du Japon, Primakov, conseiller particulier de Gorbatchev, le ministre Chinois des affaires étrangères, d'ex-premiers ministres de pays plus secondaires, Danemark et Nouvelle-Zélande, des délégations de parlementaires italiens et irlandais, et d'autres.
Ce défilé n'était pas le résultat d'initiatives individuelles. C'est avec la bénédiction de Kohl que Brandt fait le voyage, c'est évidemment un voyage officiel que fait le ministre chinois, Cheysson n'a pas été démenti lorsqu'il a vendu la mèche sur sa véritable mission. Nous sommes loin de la réprobation générale qui avait marqué le voyage, durant l'été 1990, d'un Kurt Waldheim, lorsqu'il alla chercher des ressortissants autrichiens. Il ne s'agit pas non plus d'un partage des tâches pour piéger l'Irak, entre les Etats-Unis jouant les intransigeants et les autres jouant les conciliants. Les réactions américaine et anglaise sont là pour le montrer. Là réaffirmation brutale du refus de négocier avec l'Irak, les critiques fermes et intransigeantes de Bush, Thatcher et Baker prouvent que les désaccords sont bien réels au sein de la coalition "onusienne".
Les "traitements de faveur" consentis par l'Irak à l'égard d'un certain nombre de pays, notamment à l'égard de la France, ne sont pas des fleurs gratuites. Ils visent à enfoncer un coin entre les différents "alliés" de la coalition anti-Irak. Si Saddam Hussein a mené une telle politique de marchandage de son stock d'otages contre la venue de tel ou tel homme politique de renom, c'est bien parce qu'il était conscient des clivages existant entre ces divers pays. Et cette politique a rencontré un succès certain.
Alors que les USA demandent au Conseil de sécurité de PONU de voter une résolution autorisant "le recours aux armes", les résistances de la France, de l'URSS et de la Chine, membres permanents de ce Conseil, font que celui-ci accouche finalement d'une résolution appelant au... "renforcement de l'embargo" ! Alors que les USA fidèlement secondés par la Grande-Bretagne, renforcent constamment leur potentiel militaire dans le Golfe, que leur discours se fait de plus en plus menaçant, la France traîne les pieds, fait reculer ses troupes du front, relance l'option diplomatique, avec le discours de Mitterrand à PONU, la réunion Gorbatchev-Mitterrand, et la première déclaration, depuis le début de la crise, de Rocard, le premier ministre en voyage à Singapour, sur les nécessités... d'"explorer toutes les voies de la négociation". Le Japon et l'Allemagne restent silencieux.
L'unité du "monde libre" a vécu. Les événements d'octobre 1990 auront été les premières manifestations dans les faits de la tendance de fond inscrite dans les nouvelles conditions créées par la disparition du bloc impérialiste russe en 1989 : la disparition du "bloc de l'Ouest", l'accélération de la décomposition, le chacun pour soi de tous les Etats capitalistes, la lutte de tous contre tous, et, au premier rang de celle-ci, l'empoignade entre les principaux pays industrialisés.
La loi du plus fort
Les Etats-Unis sont prêts à passer outre leurs "alliés", PONU et tout le monde. Si la bourgeoisie américaine est prête à la guerre contre l'Irak, au sacrifice de milliers de "boys and girls", ce n'est pas pour le Koweït, pour la défense du "droit international", mais pour montrer sa force et signifier sa détermination aux autres pays les plus développés. La bourgeoisie française, par exemple, s'est ainsi faite expulser de ses zones d'influence traditionnelles au Moyen-Orient, de l'Irak d'abord, et aussi de Beyrouth, les Etats-Unis donnant le feu vert à la Syrie pour une annexion du Liban, aussi musclée et meurtrière que celle de Hussein au Koweït.
Dans tous les domaines se multiplient les accrocs dans les relations :
- dissolution du réseau secret d'influence et de contrôle mis en place par les USA au lendemain de la 2e guerre mondiale (le "scandale" du "Gladio" en Italie, mais aussi en Belgique, en France, en Hollande, en Allemagne) ;
- diktat des USA dans les négociations du GATT, sur les subventions des pays d'Europe en soutien à leur secteur agricole ;
- multiplication des "affaires" d'"espionnage industriel", vis-à-vis du Japon notamment, mais aussi de la France ; etc.
Et tout ceci n'est encore que de l'anecdote à côté des formidables divergences d'intérêts qui vont grandir, de plus en plus ouvertement, entre les plus grands pays industrialisés, avec une guerre économique et commerciale redoublée, du fait de l'accélération brutale de la crise.
L'opposition entre les USA, secondés par la Grande-Bretagne, et les autres
C'est tout l'ancien rapport des forces politico-militaire et géo-stratégique de la planète qui a été bouleversé de fond en comble avec l'écroulement du bloc impérialiste russe. Et cette situation a non seulement ouvert une période de chaos total dans les pays et régions de cet ancien bloc, mais elle a aussi accéléré partout les tendances au chaos, menaçant P"ordre" capitaliste mondial dont les Etats-Unis sont les principaux bénéficiaires. Ces derniers ont été les premiers à réagir. Ils ont suscité la "crise du Golfe" en août 1990, non seulement pour prendre pied de façon définitive dans la région, mais surtout, et c'est ce qui a été décisif dans leur détermination, pour en faire un exemple destiné à servir d'avertissement à quiconque voudrait s'opposer à leur place prépondérante de super-puissance dans l’arène capitaliste mondiale.
Pour les USA, la situation est claire. Leur intérêt national, comme première puissance mondiale (et de loin), s'identifie parfaitement à l’"ordre" existant, à l'intérêt global du capital face à la décomposition qui entraîne l'éclatement de tout le système de relations internationales. Parmi les grandes puissance la Grande-Bretagne est le seul pays qui ait manifesté un soutien indéfectible envers les Etats-Unis, du fait de l'orientation traditionnelle de sa politique étrangère, de ses intérêts au Koweït, et surtout du fait de son expérience particulière du "leadership" mondial, qui lui permet de mieux comprendre les enjeux de la situation présente.
Par contre, pour les autres puissances, la situation est beaucoup plus contradictoire. Si tous ont intérêt à freiner la tendance à la décomposition, ce qui motive la condamnation unanime de l'invasion du Koweït, leur intérêt propre n'est pas pour autant que les USA renforcent encore leur prépondérance, ce qu'ils ne peuvent faire qu'au détriment de leurs principaux concurrents.
L'opération militaire engagée par les USA qui devait amener la paix au Moyen-Orient, par une guerre justifiée aux yeux de tous parce qu'elle devait maintenir l'ordre des grandes "démocraties" et des "libertés", n'a pas vu la soudure des grandes puissances "démocratiques", mais le début de la débandade.
En fait, ces différents pays sont pris dans un piège. En jouant son rôle de gendarme contre un pays arriéré et de deuxième ordre, dès le début, les Etats-Unis ne visent pas seulement à contenir le chaos qui se développe dans le "tiers-monde", mais aussi celui qui menace de s'établir entre les pays avancés. Ce ne sont pas seulement les ambitions des Etats périphériques qu'ils se proposent de contenir, mais aussi et surtout celles des Etats centraux. Par contre, ces derniers sont évidemment intéressés au premier objectif des Etats-Unis, le maintien de l'ordre dans les zones périphériques, mais nullement au second.
En faisant étalage de leur surpuissance militaire, les USA montrent la faiblesse relative des autres. Les américains ont envoyé leurs troupes dès le début sans attendre l'accord des "alliés", qui ont du se rallier sous la pression plus que par conviction. Tant que l'action contre l'Irak prenait la forme d'un blocus ou d'un isolement diplomatique, ils pouvaient prétendre jouer un petit rôle, et ainsi faire valoir leurs intérêts particuliers. En revanche l'offensive militaire ne peut que faire ressortir l'énorme supériorité des Etats-Unis et l'impuissance de leurs "alliés".
Ces pays ne sont pas aujourd'hui, et pour longtemps encore, aptes à rivaliser avec les Etats-Unis sur le plan politico-militaire. Le Japon et l'Allemagne accusent un retard important dans le domaine militaire. La mobilisation et l'armement français n'existent qu'intégrés dans le système militaire américain, comme le montre la lamentable prestation française en Arabie Saoudite, totalement dépendante de la couverture des Etats-Unis. Il en est de même de l'engagement de la Grande-Bretagne. Les principaux rivaux économiques ne sont pas armés, et ceux qui le sont, dotés d'un armement cent fois moins puissant et efficace, ne peuvent rivaliser avec les Etats-Unis. Le moment est donc propice pour les USA. L'Irak lui en a fourni l'occasion, et comme il est de notoriété publique aujourd'hui, les Etats-Unis connaissaient les préparatifs de l'Irak pour l'invasion du Koweït, ils 'ont laissé faire, sinon plus.
Les USA, gendarme du Moyen-Orient, gendarme du monde
Le contexte général dans lequel se débat la première puissance capitaliste mondiale ne peut que la pousser a la guerre, à défendre son hégémonie face à l'effondrement de pans entiers du capitalisme qui entraîne les bourgeoisies locales, les impérialismes régionaux, étranglés, dans des aventures militaires dangereuses pour la bonne marche de la "pax americana", remise en cause par la nouvelle situation. Les Etats-Unis ont été déterminés, dès la fin de la guerre Iran-Irak, à empêcher que la puissance militaire de l'Irak rompe 1'"équilibre" des forces de la région. C'est par cet "équilibre" entre les différents pays sur le plan militaire, qu'ils peuvent renforcer leur contrôle sous couvert du rôle de 1' "arbitre".
A l'heure où l'économie s'effondre, les USA savent que, pour garder leur contrôle de l'économie mondiale, ils devront utiliser leur force militaire. Si c'est surtout de l'arme économique que les USA ont joué dans les décennies précédentes depuis la fin de la guerre du Vietnam, face au rival impérialiste russe, avec l'effondrement économique actuel, c'est de plus en plus de leur suprématie militaire qu'ils doivent user pour garder leur "leadership" du système capitaliste.
Une seule solution : la lutte de classe
La guerre USA-URSS n'aura pas lieu, mais la "logique de guerre" engagée aujourd'hui montre que le déchaînement de l'impérialisme ne cesse pas pour autant. Il menace dès aujourd'hui de mettre à feu et à sang le Moyen-Orient. Et ce n'est que le début d'une série de conflits armés et d'opérations militaires, de guerres "ethniques" ou "nationales" meurtrières.
Dans les pays les plus développés, la classe ouvrière ne se trouve pas confrontée à une mobilisation générale, comme ce fut le cas lors des Ire et 2e guerre mondiale. Elle n'est pas embrigadée militairement comme c'est le cas pour le prolétariat d'Irak et des pays en guerre aujourd'hui. Mais pour autant, la guerre au Moyen-Orient, le déséquilibre total de toute cette région, les énormes destruction que va entraîner la spirale guerrière, le bain de sang ourdi par le capitalisme mondial pour le maintien (fun résidu d' "ordre" international, ne sont pas "lointains", étrangers à la classe ouvrière des métropoles industrialisées. Ce n'est pas encore ce prolétariat qui paie de son sang dans des tranchées ou sous des bombardements, mais ce prolétariat est déjà au premier rang pour payer la facture du "maintien de l'ordre" capitaliste, avec 1’attaque redoublée de ses conditions d'existence. Une exploitation renforcée, l'inflation et le chômage, les baisses des salaires, des retraites et de toutes les allocations, la "flexibilité" des heures de travail, la dégradation continue de la santé, des transports, du logement, de l'éducation, de la sécurité, sont des attaques économiques sans précédent depuis la 2e guerre mondiale.
La mobilisation générale sous les drapeaux pour combattre dans l'armée nationale n'est pas à l'ordre du jour dans les pays développés, parce que le prolétariat n'a pas subi de défaite massive et décisive dans ses luttes économiques contre l'austérité, dans les tentatives d'extension et de prise en mains de celles-ci tout au long des années 1980. Mais le lourd tribut déjà payé aujourd'hui du sang des prolétaires enrôlés directement dans des massacres impérialistes, annonce celui qui menace le prolétariat des grandes concentrations industrielles.
La classe ouvrière a pu repousser au cours des vingt dernières années la destruction totale de la planète par l'holocauste inter-impérialiste, en particulier lors des périodes de luttes ouvrières importantes, internationalement, dans les années 1968-75, 1978-81, puis 1983-89. Aujourd'hui, le capitalisme pourrit sur pied, se décompose, et la menace de destruction totale est plus que jamais présente. Dans le fait qu'il n'existe plus l’"équilibre de la terreur", il n'y a certainement plus l’"équilibre" que constituait la présence de deux super-puissances, mais la "terreur" subsiste et va s'accentuer encore, à tous les niveaux.
L'alternative socialisme ou barbarie est plus que jamais à l'ordre du jour. Le capitalisme ne mourra pas de lui-même. Il n'a pas pu entraîner l'humanité à sa fin dans la terreur nucléaire instantanée, mais, par sa dynamique propre, sa survie ne peut mener qu à une horreur sans fond pour l'humanité, qui ne pourra aboutir qu'au même résultat.
Ce cours catastrophique, vers lequel conduit la persistance des rapports de production capitaliste dans le monde, ne peut être enrayé que par le développement de la lutte de classe du prolétariat, une lutte consciente de sa propre force comme classe sociale, antagoniste à tous les intérêts particuliers des autres classes et couches de la société et qui, en défendant ses propres intérêts, est la seule force capable de prendre en charge la destruction du pouvoir politique du capitalisme à l'échelle mondiale, garant de l’"ordre" de ce monde à l'agonie.
Seules les luttes du prolétariat, les luttes ouvrières, internationalement, et en premier lieu dans les grands pays industrialisés, peuvent enrayer le bras armé du capitalisme mondial. La dynamique propre du système capitaliste ne peut mener qu'à la barbarie guerrière. Il ne peut y avoir de "paix dans le capitalisme, aujourd'hui moins encore qu'au cours des vingt dernières années.
JM, 18 novembre 1990.
Récent et en cours:
- Guerre en Irak [130]
- Luttes de classe [143]
Crise économique : l'économie mondiale au bord du gouffre
- 5296 reads
L'effondrement économique des pays d'Europe de l'Est, qui a déterminé, il y a un an, la disparition de fait du bloc impérialiste dominé par l'URSS, a été l'occasion pour les "démocraties" industrialisées d'impulser une campagne idéologique intense, sur le thème de la supériorité du capitalisme. Cette campagne qui est venue faire l'apologie du capitalisme face au "communisme" de l'Est reposait sur un double mensonge :
- celui de la nature "communiste" du système de production des pays de l'ex-bloc russe, qui n'était en fait que du bon vieux capitalisme, marqué par le poids du sous-développement, d'une bureaucratie absurde et omniprésente, et par les spécificités historiques du stalinisme, issu de l'écrasement de la révolution russe, notamment la mainmise de l'Etat sur l'ensemble des moyens de production ;
- celui de la santé économique de l'Occident qui, malgré les rodomontades d'un Reagan sur la prospérité retrouvée de l'économie capitaliste, n'a cessé tout au long des années 1980 de s'enfoncer dans une récession larvée.
Les fameux remèdes miracles du "libéralisme", n'ont finalement consisté qu'en une remise à jour et une utilisation plus massive que jamais des vieilles recettes du capitalisme d'Etat : fuite en avant dans le crédit, développement de l'économie de guerre, manipulation des marchés et tricheries grandissantes avec la loi de la valeur. Tout cela n'a pas empêché l'économie des pays industrialisés de sombrer, peu à peu, dans le marasme, même si la chute a été freinée. Le bilan soi-disant positif n'a pu être tiré que par contraste avec la catastrophe qui se développait à la périphérie, et grâce à une manipulation éhontée des indices économiques.
Fin 1989, la bourgeoisie occidentale sombrait dans une douce euphorie : aveuglée par ses propres statistiques trompeuses, la classe dominante rêvait à l'inflation contenue, à la croissance du chômage arrêtée, à la croissance économique solide avec la perspective de l'ouverture de nouveaux débouchés en Europe de l'Est. Rien ne semblait entamer ce bel enthousiasme, ni la misère insondable dans laquelle sombrait irrémédiablement et toujours plus profondément la majorité de la population mondiale habitant la partie sous-développée de la planète, ni l'avertissement renouvelé que constituait, après l'effondrement économique du tiers-monde au début des années 1980, celui des pays de l'Est à la fin de la décennie. Les cris d'alarme des économistes encore lucides étaient ignorés.
Un an plus tard, le climat a bien changé, l'euphorie s'est transformée en une panique grandissante qu'est venu illustrer l'affolement des spéculateurs face à la chute dramatique du cours des actions et l'effondrement des places boursières du monde entier durant l'été 1990.
Les mirifiques marchés de l'Est se sont envolés devant l'évidence de leur manque de solvabilité, et surtout, la principale économie du monde, celle des USA, est en train de plonger de manière accélérée dans les gouffres de la récession entraînant l'ensemble de l'économie mondiale, et notamment ses pôles les plus développés d'Asie et d'Europe, à sa suite.
La prospérité des années 80 : le mensonge d'une campagne idéologique de la bourgeoisie
La nécessité pour la classe bourgeoise, afin d'assurer sa domination sur les autres classes de la société, et avant tout sur la classe ouvrière, d'affirmer la force, la santé de son système économique, de rendre crédible ses perspectives de développement futur, est un impératif idéologique fondamental. Cette vérité s est exprimée avec de plus en plus de force tout au long des années 1980. Ce n'est évidemment pas par hasard si l'économie est devenue un thème de plus en plus central et constant des campagnes d intoxication idéologiques au fur et à mesure que la situation de l'économie mondiale se détériorait. Masquer la réalité de la dégradation économique a été un des thèmes dominants de la présidence Reagan.
Le recours massif au crédit a permis de créer des débouchés artificiels pour maintenir la production. La discipline imposée par les USA, au groupe des sept plus grands pays industrialisés, a permis de faire accepter une baisse du dollar pour soutenir la compétitivité de l'économie américaine. Mais toutes ces mesures n'ont pas été suffisantes pour sortir l'économie du marasme et, tout au plus, celles-ci ont surnagé dans la catastrophe générale.
Pour faire croire que cette récession larvée était en fait la preuve de la prospérité retrouvée, pour jouer cette comédie, il fallait bien un acteur hollywoodien ! Mais la bourgeoisie mondiale ne s'est pas contentée des rodomontades gratuites du matamore Reagan proclamant avoir vaincu la crise, terrassé l'inflation, bridé le chômage et créé les conditions d'une croissance que rien ne pourrait entraver. Pour donner du sérieux à ses affirmations, elle a avancé une montagne de chiffres, d'indices, de statistiques, tous plus "sérieux" et "officiels" les uns que les autres, et pour les besoins de la cause, dans un zèle à la mesure de ses propres illusions, elle a affiné ses méthodes statistiques, modifié ses modes de calcul, réformé sa comptabilité. Bref elle s'est livrée à une gigantesque manipulation pour gommer cette réalité qu'il lui faut à tout prix cacher, celle de l'enfoncement de plus en plus profond du capitalisme dans la crise. Les données économiques de la bourgeoisie, même si elles reflètent dans une certaine mesure la réalité, car cela est nécessaire à la gestion de son système, n'en constituent pas moins une gigantesque tricherie. La croissance est gonflée par les chiffres, tandis que, par exemple, les indices d'inflation ou le nombre de chômeurs sont profondément minimisés. C'est ainsi que le mythe de la prospérité des années 1980 a été entretenu.
Ces campagnes de mystification ont eu un effet sur le prolétariat et ont entravé sa capacité de lutter. Même si, fondamentalement, les années 1980 ont été marquées par une reprise de la lutte du prolétariat face à la dégradation évidente de ses conditions de vie, cette lutte de classe a été freinée, notamment dans les centres principaux du capitalisme développé. Le réel développement de la pauvreté pouvait, relativement à la misère indescriptible qui grandissait dans les pays du "tiers-monde", y paraître comme un moindre mal, et, dans une certaine mesure, rendre plus crédible l'idée qu'en acceptant de se serrer la ceinture, peut-être que demain, cela pourrait aller mieux, ou que le pire pourrait pour le moins être évité. La faillite économique du bloc de l'Est, l'identification de celle-ci avec la faillite du communisme, l'apparente victoire du capitalisme à la sauce démocratico-libérale, dans la continuité des campagnes médiatiques intenses sur la santé prétendument retrouvée de l'économie bourgeoise, a été un facteur de déboussolement profond du prolétariat mondial, qui s'est traduit par un recul provisoire de sa capacité de confronter la classe adverse.
Comme une caricature de cette situation, le prolétariat des pays d'Europe de l'Est qui, pendant des décennies, a été confronté au mensonge stalinien, à l'incurie bureaucratique la plus crasse, au pouvoir féroce des petits chefs du Parti, à la pénurie et au rationnement, tout cela au nom du "communisme", a cru qu'enfin son rêve d'abondance et de prospérité, identifié avec le capitalisme à l'occidentale, allait se réaliser, avec la fin de la tutelle russe, et la mise en place de mesures d'économie libérale, qui étaient soi-disant la condition du succès. Que d’illusions qui, seulement un an après l'ouverture du mur de Berlin, sont en train de s effondrer comme le niveau de vie dans les pays de l'Est.
La fin des illusions: la plongée dans la récession
Quelques mois après que les médias du monde entier aient claironné sur tous les tons, dans un vacarme assourdissant, la victoire du capitalisme, la promesse d'une nouvelle ère de prospérité et de paix, patatrac, le rêve trompeur est brutalement brisé durant l'été 1990. L'invasion du Koweït par les troupes irakiennes, la flambée des cours de l'or noir qui en a résulté, ont été le facteur déclenchant le plus grand effondrement boursier depuis 1929. Cette situation va être mise à profit par la classe dominante pour tenter de faire croire que Saddam Hussein est le principal responsable de la crise économique mondiale ! Mais avec les semaines, le tableau va se préciser : en fait, depuis des mois, l'économie américaine a accéléré sa plongée dans la récession, et ce titan, qui représente 20 % de la production mondiale, entraîne l'économie planétaire dans son saut dans le vide, bien avant les événements du golfe.
Graphique 1 : Indicateur avancé de la production industrielle - États-Unis
Avec le ralentissement de l'économie américaine, ce sont les exportations de tous les pays de la planète vers le principal marché du monde qui chutent, et par réaction en chaîne, chacun essayant de rééquilibrer sa balance commerciale, ce sont toutes les exportations qui chutent, et partout la production diminue. Le Japon et l'Allemagne ont vu leurs exportations baisser de 22,8 % et de 8 % au premier semestre 1990. En septembre, la France a vu son déficit commercial battre un record avec -10 milliards de francs, et significativement les 4/5 sont dus à la baisse des exportations, alors qu'1/5 "seulement" est dû au surenchérissement de la facture pétrolière. Partout, les signes de la récession se précisent. La RFA, premier exportateur mondial, vient de revoir à la baisse ses prévisions de croissance, l'estimant pour l'année qui vient à un petit 1,5% (à comparer au 4,2% de 1989). Au Canada, proche voisin des USA dont il est dépendant économiquement, depuis un an les chiffres officiels indiquent la récession, -1 % pour 1990. A l'autre bout du continent, le Brésil annonce une baisse de 5 % de sa production, chiffre probablement profondément sous-estimé. Qui se souvient encore qu'à la fin des années 1970 ce pays était considéré comme le modèle d'une économie en voie de développement ? Les petits dragons d'Asie, le nouveau mythe, sont en train de prendre le même chemin. Taiwan et la Corée du Sud divisent par deux leurs espoirs de croissance.
En Europe de l'Est, l'Eldorado annoncé se révèle être un champ de ruines. Dotés d'un appareil productif complètement obsolète, les pays de 1’ex-bloc de l'Est sont incapables, après avoir perdu leurs marchés privilégiés du COMECON en voie de disparition, de faire face à l'ouverture vers le marché mondial. La production s'effondre. Dans l'ex-RDA, qui était pourtant le pays le plus compétitif d'Europe de l'Est, a réunification met en évidence que 4/5 des usines devront être soit fermées, soit reconstruites, car elle sont absolument inadéquates aux critères de compétitivité occidentaux, c'est-à-dire, ceux du marché mondial. Résultat, la production s'effondre brutalement : -10 % au premier semestre. Et dans les autres pays: Bulgarie, -10%; Hongrie, -10%; Pologne, -28 % ; Roumanie, -18 % ; Tchécoslovaquie, -3 %.
L’édifice capitaliste se lézarde : faillites et chômage
C'est à un véritable effondrement de la production mondiale auquel nous assistons. En conséquence, tout l'édifice capitaliste, qui repose sur les fondations de son appareil productif, se lézarde : les bénéfices des entreprises tondent comme neige au soleil et cèdent la place à des pertes de plus en plus colossales ; les faillites se multiplient ; la spéculation s'effondre et les marchés boursiers, immobiliers, financiers, etc., sont gagnés par la panique. Après la crise boursière s'annoncent les crises financières et monétaires. Les bourses ont perdu la moitié de leur valeur, et sont aujourd'hui dans le coma, maintenues artificiellement en survie par les artifices étatiques. Aux USA, l'immobilier a plongé de 30%, en GB, l'immobilier de bureau en fait autant, tandis qu'en France et au Japon, la spéculation immobilière est en train de s'arrêter, annonçant la future baisse des prix.
L'évidence de la plongée des pôles les plus développés de l'économie mondiale dans la crise ne peut plus être masquée par les manipulations statistiques. Ainsi, alors que, face à l'inquiétude grandissante, Washington annonce le chiffre prévisionnel de croissance de 1,8 % pour le quatrième trimestre 1990, personne n'y croit, et, selon un sondage, 77 % des américains sont persuadés aujourd'hui de la réalité de la récession, lus que tous les indices obscurs balancés par les médias, plus que les chiffres colossaux qui perdent tout sens commun, plus que les gesticulations surréalistes dans les bourses du monde entier, c'est dans la réalité de la dégradation de ses conditions de vie que le prolétariat constate durement la faillite du capitalisme. Avec la baisse d'activité, les programmes dits d'"assainissement", de "restructuration", de "rigueur", appliqués par les gestionnaires capitalistes, signifient : licenciements, chômage, salaires réels en baisse, pouvoir d'achat rongé par l'inflation, augmentation des impôts, bref une misère grandissante. Ces derniers mois, les attaques de la classe dominante contre les conditions de vie de la classe ouvrière se sont intensifiées, et le pire est encore à venir, tout le monde le sait.
Pas un jour ne passe sans que l'annonce d'une mauvaise nouvelle ne vienne assombrir toujours plus le tableau calamiteux de l'économie mondiale. Ces dernières semaines, la liste des ténors de la production mondiale en difficulté s'est démesurément allongée, dans tous les secteurs et dans tous les pays. Ainsi dans l'automobile, secteur clé de l'économie mondiale, General Motors est confronté à une perte record de 2 milliards de dollars au troisième trimestre, et 20 000 employés seront affectés par les fermetures d'usines prévues ; Ford annonce pour cette même période une chute de 78 % de ses bénéfices ; Chrysler, pour ce troisième trimestre catastrophique perd 214 millions de dollars. Les firmes européennes ne sont pas mieux loties. Avec un marché européen qui s'est contracté de 3 % en 1990, Renault est confronté à une baisse de 60 % de ses bénéfices, Peugeot a réduit ses effectifs de 5 %, et pour faire face à la baisse des commandes, Fiat met 70 000 ouvriers au chômage technique. Dans l'industrie connexe du pneumatique, le numéro un mondial, Michelin, doit faire face à une perte de 2,3 milliards de francs et annonce plusieurs milliers de licenciements ; son second, Goodyear, évalue ses pertes à 61,4 millions de dollars, et prévoit 3 000 licenciements. Dans les transports aériens, pourtant en plein boom ces dernières années, pour l'ensemble de la profession les pertes à assumer cette année sont évaluées à 3 milliards de dollars. Air France affiche, pour le premier trimestre 1990, une perte de 263 millions de francs ; Lufthansa, 500 millions de francs ; et, au même moment, KLM voit ses bénéfices fondre de 78 % et annonce dans la foulée 500 suppressions d'emplois. Air Canada licencie 2 900 employés, tandis qu'US Air et Pan Am réduisent leurs effectifs respectivement de 7 et 9 %. Les secteurs de pointe ne sont pas épargnés : dans l'électronique, Philips annonce 45 000 licenciements, et Thomson annonce des résultats nets en baisse de 80 % sur les six premiers mois de l'année 1990. Dans l'industrie informatique, Unisys souffre de 356 millions de dollars de pertes au troisième trimestre 1990, et, après avoir déjà réduit ses effectifs de 20 000 employés, décide 5 000 nouveaux licenciements. En Europe, Bull doit supporter 2 milliards de francs de pertes pour le premier trimestre. En aval, dans l'industrie des composants, Texas Instruments doit faire face à 7 millions de dollars de perte, et National Semi Conductor a réduit de 6 % ses effectifs.
Cette liste, pourtant déjà longue, est tout sauf exhaustive. Elle pourrait se poursuivre sur des pages et des pages.
Les faillites se multiplient. En conséquence, le chômage connaît une nouvelle flambée. Les taux du début des années 1980 ne sont pas encore officiellement atteints, mais cela ne saurait tarder au rythme actuel des suppressions d'emplois. Depuis le début de l'année 1990, 600 000 emplois ont été perdus par l'industrie américaine, 100 000 pour le seul mois d'octobre. Depuis 3 mois consécutifs, le chômage progresse, ce qui ne s'était pas vu depuis 1982. De juillet à septembre, il est passé de 5,4 a 5,7 % selon l'indice officiel, tel qu'il est comptabilisé par les statistiques truquées. Pour l'ensemble de la CEE, le chômage, qui est resté à un niveau élevé depuis le début de la décennie 1980, recommence, après un an de baisse, à augmenter, +0,1 %, pour atteindre 8,4 % de la population active. Tout indique que le chômage va battre de nouveaux records au coeur du monde industrialisé.
En Europe de l'Est, les prolétaires qui n'avaient jamais réellement été confrontés au chômage, découvrent brutalement les "délices" du capitalisme de marché. Ainsi, pour la fin de l'année, sont attendus : 100 000 licenciements en Hongrie et Tchécoslovaquie ; 1 500 000 chômeurs en Pologne, 2 000 000 en RDA et 3 000 000 en URSS.
Parallèlement au développement du chômage, avec la même logique d'austérité les entreprises s’attaquent aux salaires. Le pouvoir d'achat diminue et le marché se rétrécit d'autant, accélérant la spirale descendante de la récession, les ventes de biens de consommation baissent, la production diminue, et en conséquence, les entreprises réduisent leurs achats en biens de production, accélérant encore plus la récession.
Avec la baisse de l'activité, les rentrées en impôts de l'Etat se réduisent, les déficits budgétaires se creusent, et les gouvernements, avec la logique des gestionnaires capitalistes qu'ils sont, dégraissent à leur tour leurs effectifs, pour équilibrer leur comptes, attaquent les salaires des fonctionnaires, lèvent de nouveaux impôts, taillent dans les programmes sociaux : santé, éducation, allocations chômage, etc. L'activité économique se contracte encore plus et les conditions de vie de la classe ouvrière plongent dans la misère.
Des dettes qui ne seront jamais remboursées : vers la crise financière
Cette dynamique de la récession, à laquelle se confronte le capital, incapable de trouver de nouveaux débouchés solvables à la mesure de ses capacités productives, est à l'oeuvre depuis la fin des années 1960. Mais cette tendance, inhérente aux contradictions de l'économie capitaliste, a pu être en partie contrecarrée par la création de marchés artificiels résultant d'un recours massif à la planche à billet et au crédit. Durant vingt ans, les capitalistes ont vendu leur trop-plein de marchandises a crédit, mais cette politique rencontre maintenant ses limites, et les échéances arrivent à terme.
La fuite en avant dans le crédit, durant les années 1980, traduit, de manière caricaturale, l'absurdité du fonctionnement du capitalisme en crise. Afin d'écouler leurs marchandises, les grands pays industrialisés ont prêté massivement de l'argent. Aujourd'hui, il apparaît clairement que toutes ces dettes ne seront jamais remboursées. C’est-à-dire que pour entretenir l'illusion d'une activité économique prospère, les pays centraux payent de fait, ce qu’ils vendent, avec des crédits qui ne seront jamais remboursés, donc de la monnaie de singe !
Le développement du crédit ne traduit donc pas la prospérité, mais au contraire les contradictions insolubles et explosives dans lesquelles s’enfonce l'économie mondiale.
Cette politique d'endettement n'a pas permis d'empêcher 1’affaissement croissant de l'économie mondiale. Seuls ses pôles les plus développés, les pays les plus industrialisés, ont été préservés de l'effondrement économique dramatique qui a submergé la majeure partie de la planète. Pour autant, eux aussi ont subi les effets de la crise, et le marasme, dans lequel ils s'enfoncent, n'a pu passer pour un semblant de prospérité que par rapport à la catastrophe qui s'étendait à la périphérie sous-développée.
Avec les années 1980, les Etats-Unis sont devenus le pays le plus endetté du monde : la dette interne se monte à 10 000 milliards de dollars, et la dette externe à plus de 700 milliards, pulvérisant tous les records. En 1989, la dette extérieure a crû de 25 %, et pourtant cette manne n'a pas suffi à alimenter les carnets de commande de l'industrie et empêcher l'appareil productif de s'enfoncer dans la récession. La fuite en avant dans le crédit est non seulement de plus en plus difficile par rapport aux disponibilités du marché mondial, mais aussi, étant donné le niveau actuel d'endettement, elle ne peut se faire sans provoquer, à terme, une crise financière et monétaire majeure.
La recette appliquée sous la présidence Reagan a perdu son "efficacité", et la récession entamée en 1981, dont le plus gros des effets négatifs a été répercuté, dans un premier temps, sur les pays de la périphérie, revient en force ébranler l'édifice économique et social des grandes puissances développées.
La montagne de dette est une montagne d'impayés. Avec la baisse de l'activité, les entreprises à la trésorerie déficiente ne peuvent plus faire face aux traites ; les particuliers, le niveau de vie rongé par l'austérité, ont de plus en plus de mal à rembourser les crédits, et les banques voient grimper le solde des créances douteuses dans les grandes métropoles capitalistes. Après les déboires dans le "tiers-monde", c'est à des défauts de paiement au coeur de leur système que les banques sont confrontées. De plus, à ce bilan inquiétant, viennent s'ajouter les pertes dues à l'effondrement de la spéculation. Résultat : les banques elles aussi voient leurs comptes entrer dans le rouge et les faillites se multiplier.
Aux USA, les plus grandes banques sont dans la tourmente : Citycorp annonce, pour le troisième trimestre 1990, des pertes de 38,3 millions de dollars, et prévoit 2 000 licenciements ; Chase Manhattan, pour a même période, se paie le luxe d'un déficit de 623 millions de dollars, et, du coup, dégraisse ses effectifs de 5 000 personnes. Dans le secteur boursier, où les faillites se sont multipliées, Drexel Burnham par exemple, les survivants sont mal en point, et la firme de courtage Merryll Lynch envisage une réduction de 10 % de ses effectifs, soit environ 4 000 personnes. Les faillites en cascade des caisses d'épargne ("Saving and loans") laisse une ardoise officiellement estimée à 500 milliards de dollars à l'Etat fédéral qui garantit les dépôts à concurrence de 100 000 dollars. Le General Accounting Office, un organisme officiel, prévoit que 35 des 400 premières banques américaines devront être assistées ou mises en faillite.
En Europe ou au Japon, la situation n'est guère meilleure : en France par exemple, les bénéfices semestriels des banques ont baisse de 15 à 20 %, au Japon, Nomura, la plus grande maison de titres mondiale, a annoncé une baisse de 48,5 % de ses bénéfices. La crise boursière de l'été est en train de laisser la place à une crise financière majeure.
La chute de la production n'en finit pas d'ébranler tout l'édifice capitaliste. Les rentrées en impôts dans les caisses de l'Etat se réduisent avec l'activité économique, les déficits se creusent. Malgré toutes les promesses de la loi Graham-Rudman, qui prévoyait de ramener le déficit budgétaire à 60 milliards de dollars en 1990, ce déficit rejoint cette année le record historique de 1986, culminant à 220 milliards de dollars. Comment financer de tels déficits ? Le problème se pose de plus en plus. Les deux principaux bailleurs de fond des USA durant les années 1980, ont d'autres chats à fouetter :
- le géant allemand se retrouve avec un véritable boulet aux pieds pour financer la reconstruction de l'ex-RDA, la réunification. Le déficit de l'Etat germanique a brusquement gonflé de 50 %, 150 milliards de deutschemarks prévu pour 1991. De second prêteur sur le marché mondial, l'Allemagne est en train de devenir un du principal emprunteur ;
- haut lieu de la spéculation mondiale dans les années 1980, principal bailleur de fonds du monde, le Japon est, comme un lutteur de sumo fatigué, menacé d'apoplexie. Pour faire face aux conséquences de l'effondrement de la spéculation qui fait plonger son économie dans la crise financière, il doit rapatrier en masse ses capitaux et assèche d'autant le marché international.
Dans ces conditions, les dirigeants US n'ont d'autre choix que de lever de nouveaux impôts, et pratiquer des coupes sombres dans les dépenses de 1’Etat. La comédie médiatique aux USA autour des palabres entre le gouvernement et le Congrès n'avait pas d'autre but que de faire passer la pilule amère. Cependant, une telle politique de rigueur budgétaire ne peut qu'accélérer la plongée dans la récession et ses conséquences néfastes.
On comprend que dans ces conditions un certain sentiment de panique se développe au sein de la classe dominante : les remèdes traditionnels ont perdu de leur efficacité, et la plongée accélérée de l'économie mondiale dans la récession ouvre une porte vers l'inconnu. Ces dernières années, les économistes optimistes envisageaient pour l'économie américaine un atterrissage en douceur ("soft landing"), le terme à la mode aujourd'hui est celui de "crash landing", pas besoin de traduction.
La fuite en avant dans l'inflation : vers la crise monétaire
Cependant, l'économie américaine est la première du monde, et les Etats-Unis sont de loin la première puissance impérialiste. Nul doute que les dirigeants américains ne vont pas rester les bras croisés, ils vont tenter d'utiliser toutes les cartes dont ils disposent pour essayer de maintenir leur économie la tête hors de l'eau. La mobilisation dans le Golfe arabo-persique montre bien comment les USA peuvent jouer de leur puissance militaire, pour imposer aux pays plus faibles un soutien économique à leur économie défaillante. De même, les négociations du GATT illustrent parfaitement comment les USA jouent de leur puissance, pour affirmer leur autorité et imposer un partage en leur faveur des marchés.
Une arme essentielle de la puissance économique américaine reste le dollar, monnaie mondiale par régulière du dollar ces dernières années a été organisée, afin de permettre à la production américaine de retrouver, par cette mesure artificielle, sa compétitivité. Cependant, son efficacité a été toute relative. Même si les déficits commerciaux se sont réduits, ils n'en atteignent pas moins une somme toujours gigantesque
Graphique 2 : États-Unis, balance commerciale et taux de change du dollar
La récente baisse des taux de la Banque Fédérale sur le dollar indique que, loin des belles phrases sur la rigueur, les dirigeants de Washington préfèrent la fuite en avant dans la dévaluation de fait, pour freiner la débandade de leur économie. Devenu premier emprunteur en dollars, les USA ont tout intérêt à laisser se dévaluer leur monnaie, afin de baisser la valeur de leur dette. En conséquence, le dollar atteint maintenant son seuil historique le plus bas, par rapport aux principales autres monnaies concurrentes. La compétitivité des produits américains se retrouve artificiellement dopée par rapport à celle des autres pays.
Cependant, une telle politique, si elle peut freiner la récession aux USA, ce que rien ne garantit, comme le montre le fait que Wall Street ait salué par un recul la dernière baisse du taux d'escompte, ne peut que renforcer encore plus la concurrence internationale, sur des marchés sursaturés, et elle aura surtout pour conséquence de reporter plus fortement les effets de la récession sur les concurrents européens et japonais. La concurrence internationale se trouye aiguisée comme jamais, et, à un moment où l'effondrement du bloc de l'Est signifie aussi le relâchement corollaire de la discipline interne dans ce qui fut le "bloc occidental", le "chacun pour soi" est en train de se conjuguer avec le "sauve-qui-peut".
Mais surtout, la principale conséquence négative d'une telle politique est d'abord une relance de l'inflation. Partout, celle-ci est à la hausse, dynamisée par la flambée des cours du pétrole. Sur les douze derniers mois, elle a crû de 6 % aux USA, 10,4 % en Grande-Bretagne, 6,1 % pour l'ensemble de la CEE. Les niveaux des années 1970 ne sont pas loin. A la périphérie, elle continue ses ravages : 1 800 % au Brésil en 1989, par exemple. Les pays de l'Est, après avoir dissimulé les chiffres de leur inflation durant des années, annoncent pour 1990 des prévisions catastrophiques : Bulgarie 70%, Hongrie 40%, Pologne 50%, Tchécoslovaquie 20%. En URSS, elle a été de 34% sur le marché « libre », durant le seul mois de septembre 1990.
La politique de dévaluation actuelle du dollar ne peut que conduire à une nouvelle explosion de l'inflation, et, à terme, soumettre le marche monétaire à de telles tensions, que, là aussi, une crise majeure menace, centrée autour du roi-dollar, qui se retrouve de plus en plus nu, dont la valeur réelle est de plus en plus hypothétique, alors que des milliers de milliards de dollars de crédits ne pourront jamais être remboursés.
L'euphorie de la fin de l'année 1989 est bien terminée. L'inquiétude de l'année 1990 est confirmée. La faillite mondiale de l'économie est de plus en plus évidente. Les faillites se multiplient, les files de chômeurs s'allongent démesurément, le niveau de vie est rongé par les attaques contre les salaires, l'inflation croissante et l'augmentation des impôts. La vérité de l'impasse totale où le capitalisme mène l'ensemble de l'humanité s'impose de plus en plus clairement à l'ensemble du prolétariat mondial. La base de la domination idéologique de la bourgeoisie se trouve sapée. La crise est le principal allié du prolétariat sur le chemin difficile de sa prise de conscience.
JJ, 17 novembre 1990
«Dans chaque crise, la société étouffe sous le faix de ses propres forces productives et de ses propres produits inutilisables pour elle, et elle se heurte impuissante à cette contradiction absurde : les producteurs n'ont rien à consommer, parce qu'on manque de consommateurs. La force d'expansion des moyens de production fait sauter les chaînes dont le mode de production capitaliste l'avait chargée. Sa libération de ces Chaînes est la seule condition requise pour un développement des forces productives ininterrompu, progressant à un rythme toujours plus rapide, et par suite, pour un accroissement pratiquement sans bornes de la production elle-même. L'appropriation sociale des moyens de production élimine non seulement l'inhibition artificielle de la production qui existe maintenant, mais aussi le gaspillage et la destruction effectifs des forces productives et des produits, qui sont actuellement les corollaires inéluctables de la production et atteignent leur paroxysme dans les crises.»
Engels, Anti-Dûhring, III, II.
Récent et en cours:
- Crise économique [28]
Texte d’orientation: militarisme et décomposition
- 4310 reads
Le marxisme est une pensée vivante
1) Contrairement au courant bordiguiste, le CCI n'a jamais considéré le marxisme comme une "doctrine invariante", mais bien comme une pensée vivante pour laquelle chaque événement historique important est l'occasion d'un enrichissement. En effet, de tels événements permettent, soit de confirmer le cadre et les analyses développés antérieurement, venant ainsi les conforter, soit de mettre en évidence la caducité de certains d'entre eux, imposant un effort de réflexion afin d'élargir le champ d'application des schémas valables auparavant mais désormais dépassés, ou bien, carrément, d'en élaborer de nouveaux, aptes à rendre compte de la nouvelle réalité. Il revient aux organisations et aux militants révolutionnaires la responsabilité spécifique et fondamentale d'accomplir cet effort de réflexion en ayant bien soin, à l'image de nos aînés comme Lénine, Rosa Luxemburg, la Fraction Italienne de la Gauche Communiste Internationale (Bilan), la Gauche Communiste de France, etc., d'avancer à la fois avec prudence et audace :
- en s'appuyant de façon ferme sur les acquis de base du marxisme ;
- en examinant la réalité sans œillères et en développant la pensée sans "aucun interdit non plus qu'aucun ostracisme" (Bilan).
En particulier, face à de tels événements historiques, il importe que les révolutionnaires soient capables de bien distinguer les analyses qui sont devenues caduques de celles qui restent valables, afin d'éviter un double écueil : soit s'enfermer dans la sclérose, soit "jeter le bébé avec l'eau du bain". Plus précisément, il est nécessaire de bien mettre en évidence ce qui, dans ces analyses, est essentiel, fondamental, et conserve toute sa validité dans les circonstances historiques différentes, par rapport à ce qui est secondaire et circonstanciel ; en bref : de savoir faire la différence entre l'essence d'une réalité et ses différentes manifestations particulières.
2) Depuis un an, la situation mondiale a connu des bouleversements considérables qui ont modifiés de façon très sensible la physionomie du monde telle qu’il était sorti de la seconde guerre impérialiste. Le CCI s’est appliqué à suivre de très prés ces bouleversements :
- pour rendre compte de leur signification historique ;
- pour examiner dans quelle mesure ils infirmaient ou confirmaient les cadres d'analyse valables auparavant.
C'est ainsi que ces événements historiques (agonie du stalinisme, disparition du bloc de l'Est, désagrégation du bloc de l'Ouest), s'ils n'avaient pu être prévus dans leur spécificité, s'intégraient parfaitement dans le cadre d'analyse et de compréhension de la période historique présente élaboré antérieurement par le CCI : la phase de décomposition.
Il en est ainsi, également, de la présente guerre du golfe Persique. Mais l'importance même de cet événement, comme la confusion qu'il met en évidence parmi les révolutionnaires, donnent à notre organisation la responsabilité de comprendre clairement l'impact et la répercussion des caractéristiques de la phase de décomposition sur la question au militarisme et de la guerre, d'examiner comment se pose cette question dans cette nouvelle période historique.
Le militarisme au coeur de la décadence du capitalisme
3) Le militarisme et la guerre constituent une donnée fondamentale de la vie du capitalisme depuis l'entrée de ce système dans sa période de décadence. Dès lors que le marché mondial a été complètement constitué, au début de ce siècle, que le monde a été partagé en chasses gardées coloniales et commerciales pour les différentes nations capitalistes avancées, l'intensification et le déchaînement de la concurrence commerciale qui en découlaient entre ces nations n'ont pu déboucher que sur l'aggravation des tensions militaires, sur la constitution d'arsenaux de plus en plus imposants et sur la soumission croissante de l'ensemble de la vie économique et sociale aux impératifs de la sphère militaire. En fait, le militarisme et la guerre impérialiste constituent la manifestation centrale de l'entrée du capitalisme dans sa période de décadence (et c'est bien le déclenchement de la première guerre mondiale qui signe le début de cette période), à tel point que, pour les révolutionnaires d'alors, l'impérialisme et le capitalisme décadent deviennent synonymes. L'impérialisme n'étant pas une manifestation particulière du capitalisme mais son mode de vie pour toute la nouvelle période historique, ce ne sont pas tels ou tels Etats qui sont impérialistes, mais tous les Etats, comme le relève Rosa Luxemburg. En réalité, si l'impérialisme, le militarisme et la guerre s'identifient à ce point à la période de décadence, c'est que cette dernière correspond bien au fait que les rapports de production capitalistes sont devenus une entrave au développement des forces productives : le caractère parfaitement irrationnel, sur le plan économique global, des dépenses militaires et de la guerre ne fait que traduire l'aberration que constitue le maintien de ces rapports de production. En particulier, l'autodestruction permanente et croissante du capital qui résulte de ce mode de vie constitue un symbole de l'agonie de ce système, révèle clairement qu'il est condamné par l'histoire.
Capitalisme d'Etat et blocs impérialistes
4) Confronté à une situation où la guerre est omniprésente dans la vie de la société, le capitalisme, dans sa décadence, a développé deux phénomènes qui constituent des caractéristiques majeures de cette période : le capitalisme d'Etat et les blocs impérialistes. Le capitalisme d'Etat, dont la première manifestation significative date de la première guerre mondiale, répond à la nécessité pour chaque pays, en vue de la confrontation avec les autres nations, d'obtenir le maximum de discipline en son sein de la part des différents secteurs de la société, de réduire au maximum les affrontements entre classes mais aussi entre fractions rivales de la classe dominante, afin, notamment, de mobiliser et contrôler l'ensemble de son potentiel économique. De même, la constitution de blocs impérialistes correspond au besoin d'imposer une discipline similaire entre différentes bourgeoisies nationales afin de limiter leurs antagonismes réciproques et de les rassembler pour l'affrontement suprême entre les deux camps militaires. Et à mesure que le capitalisme s'est enfoncé dans sa décadence et sa crise historique, ces deux caractéristiques n'ont fait que se renforcer. En particulier, le capitalisme d'Etat à l'échelle de tout un bloc impérialiste, tel qu'il s'est développé au lendemain de la seconde guerre mondiale, ne faisait que traduire l'aggravation de ces deux phénomènes. Ce faisant, tant le capitalisme d'Etat que les blocs impérialistes, de même que la conjugaison des deux, ne traduisent une quelconque "pacification" des rapports entre différents secteurs du capital, encore moins un "renforcement" de celui-ci. Au contraire, ils ne sont que des moyens que secrète la société capitaliste pour tenter de résister à une tendance croissante à sa dislocation ([3] [146]).
L'impérialisme dans la phase de décomposition du capitalisme
5) La décomposition générale de la société constitue la phase ultime de la période de décadence du capitalisme. En ce sens, dans cette phase ne sont pas remises en cause les caractéristiques propres à la période de décadence : la crise historique de l'économie capitaliste, le capitalisme d'Etat et, également, les phénomènes fondamentaux que sont le militarisme et l'impérialisme. Plus encore, dans la mesure où la décomposition se présente comme la culmination des contradictions dans lesquelles se débat de façon croissante le capitalisme depuis le début de sa décadence, les caractéristiques propres à cette période se trouvent, dans sa phase ultime, encore exacerbées :
- résultant de l'enfoncement inexorable du capitalisme dans la crise, la décomposition ne fait que l'aggraver ;
- la tendance au capitalisme d'Etat n'est nullement remise en cause, bien au contraire, par la disparition de certaines de ses formes les plus aberrantes et parasitaires, telle que le stalinisme aujourd'hui ([4] [147]).
Il en est de même pour le militarisme et l'impérialisme, comme on a pu déjà le constater tout au long des années 1980, durant lesquelles le phénomène de décomposition est apparu et s'est développé. Et ce n'est pas la disparition du partage du monde en deux constellations impérialistes résultant de l'effondrement du bloc de l'Est qui pouvait remettre en cause une telle réalité. En effet, ce n'est pas la constitution de blocs impérialistes qui se trouve à l'origine du militarisme et de l'impérialisme. C'est tout le contraire qui est vrai : la constitution des blocs n'est que la conséquence extrême (qui, à un certain moment peut aggraver les causes elles-mêmes), une manifestation (qui n'est pas nécessairement la seule) de l'enfoncement du capitalisme décadent dans le militarisme et la guerre. D'une certaine façon, il en est de la formation des blocs vis-à-vis de l'impérialisme comme du stalinisme vis-à-vis du capitalisme d'Etat. De même que la fin du stalinisme ne remet pas en cause la tendance historique au capitalisme d'Etat, dont il constituait pourtant une manifestation, la disparition actuelle des blocs impérialistes ne saurait impliquer la moindre remise en cause de l'emprise de l'impérialisme sur la vie de la société. La différence fondamentale réside dans le fait que, si la fin du stalinisme correspond à l'élimination d'une forme particulièrement aberrante du capitalisme d'Etat, la fin des blocs ne fait qu'ouvrir la porte à une forme encore plus barbare, aberrante et chaotique de l'impérialisme.
6) Cette analyse, le CCI l'avait déjà élaborée dès la mise en évidence de l'effondrement du bloc de l'Est :
- "Dans la période de décadence du capitalisme, tous les Etats sont impérialistes et prennent des dispositions pour assumer cette réalité : économie de guerre, armements, etc. C'est pour cela que l'aggravation des convulsions de l'économie mondiale ne pourra qu'attiser les déchirements entre ces différents États, y compris, et de plus en plus, sur le plan militaire. La différence avec la période qui vient de se terminer, c'est que ces déchirements et antagonismes, qui auparavant étaient contenus et utilisés par les deux grands blocs impérialistes, vont maintenant passer au premier plan. La disparition du gendarme impérialiste russe, et celle qui va en découler pour le gendarme américain vis-à-vis de ses principaux partenaires d'hier, ouvrent la porte au déchaînement de toute une série de rivalités plus locales. Ces rivalités et affrontements ne peuvent pas, à l'heure actuelle, dégénérer en un conflit mondial (même en supposant que le prolétariat ne soit plus en mesure de s'y opposer). En revanche, du fait de la disparition de la discipline imposée par la présence des blocs, ces conflits risquent d'être plus violents et plus nombreux, en particulier, évidemment, dans les zones où le prolétariat est le plus faible." (Revue Internationale [148]n° 61 [148], 3e trimestre 1990).
- "L'aggravation de la crise mondiale de l'économie capitaliste va nécessairement provoquer une nouvelle exacerbation des contradictions internes de la classe bourgeoise. Ces contradictions, comme par le passé, vont se manifester sur le plan des antagonismes guerriers : dans le capitalisme décadent, la guerre commerciale ne peut déboucher que sur la fuite en avant de la guerre des armes. En ce sens, les illusions pacifistes qui pourraient se développer à la suite du "réchauffement" des relations entre l'URSS et les Etats-Unis doivent être résolument combattues : les affrontements militaires entre Etats, même s'ils ne sont plus manipulés et utilisés par les grandes puissances, ne sont pas près de disparaître. Bien au contraire, comme on l'a vu dans le passé, le militarisme et la guerre constituent le mode même de vie du capitalisme décadent que l'approfondissement de la crise ne peut que confirmer. Cependant, ce qui change avec la période passée, c'est que ces antagonismes militaires ne prennent plus à 'heure actuelle la forme d'une confrontation entre deux grands blocs impérialistes... " ("Résolution sur la situation internationale", juin 1990, Revue internationale n°63 [149]).
Cette analyse est aujourd'hui amplement confirmée par la guerre du golfe Persique.
La guerre du golfe : première manifestation de la nouvelle situation mondiale
7) Cette guerre constitue la première manifestation majeure de la situation dans laquelle se trouve le monde après l'effondrement du bloc de l'Est (en ce sens, elle revêt à présent une importance bien plus considérable) :
- elle confirme, avec l'aventure "incontrôlée" de l'Irak faisant main basse sur un autre pays de son ex-bloc de tutelle, la disparition du bloc de l'Ouest lui-même ;
- elle révèle l'accentuation de la tendance (propre à la décadence capitaliste) pour tous les pays a utiliser la force des armes pour tenter de se dégager de l'étau dans lequel la crise les enserre de façon de plus en plus intenable ;
- elle met en évidence, avec le déploiement hallucinant des moyens militaires des Etats-Unis et de leurs "alliés", le fait que, de façon croissante, seule cette même force militaire sera en mesure de maintenir un minimum de stabilité dans un monde menacé par un chaos croissant.
En ce sens, la guerre du Golfe n'est pas, comme l'affirme la plus grande partie du milieu politique prolétarien, une "guerre pour le prix du pétrole". Elle ne saurait se réduire non plus à une "guerre pour le contrôle du Moyen-Orient", aussi importante que puisse être cette région. De même, ce n est pas seulement le chaos qui se développe dans le "tiers-monde" que vise à prévenir l'opération militaire qui se déploie dans le Golfe. Tous ces éléments peuvent jouer un rôle, évidemment. C'est vrai que la majorité des pays occidentaux est intéressée à un pétrole à bas prix (contrairement à l'URSS qui, pourtant, participe pleinement -à la mesure de ses moyens réduits- à l'action contre l'Irak), ce n'est cependant pas avec les moyens oui ont été employés (et qui ont fait bondir le prix du brut bien au-delà des exigences de l'Irak) qu'on obtiendra une telle baisse des prix. C'est vrai aussi que le contrôle des champs pétroliers par les Etats-Unis présente pour ce pays un intérêt incontestable et renforce sa position vis-à-vis de ses rivaux commerciaux (Europe de l'Ouest, Japon) : mais alors, pourquoi ces mêmes rivaux les soutiennent-ils dans cette entreprise ? De même, il est clair que l'URSS est intéressée au premier chef par la stabilisation de la région du Moyen-Orient proche de ses provinces d'Asie centrale et du Caucase déjà particulièrement agitées. Mais le chaos qui se développe en URSS ne concerne pas que ce pays ; les pays d'Europe centrale, et partant d'Europe occidentale, sont particulièrement concernés par ce qui se passe dans la zone de l'ancien bloc de l'Est. Plus généralement, si les pays avancés se préoccupent du chaos qui se développe dans certaines régions du "tiers-monde", c'est qu'eux-mêmes se retrouvent fragilisés face à ce chaos, du fait de la nouvelle situation dans laquelle se trouve le monde aujourd'hui.
8) En réalité, c'est fondamentalement le chaos régnant déjà dans une bonne partie du monde et qui menace maintenant les grands pays développés et leurs rapports réciproques que tentent de contenir l'opération "Bouclier au désert" et ses annexes. En effet, avec la disparition du partage du monde en deux grands blocs impérialistes a disparu un des facteurs essentiels qui maintenaient une certaine cohésion entre ces Etats. La tendance propre à la nouvelle période est bien au "chacun pour soi" et, éventuellement, pour les Etats les plus puissants, à poser leur candidature au "leadership" d'un nouveau bloc. Mais en même temps, la bourgeoisie de ces pays, en mesurant les dangers que comporte une telle situation, essaie de réagir face à une telle tendance. Avec le nouveau degré dans le chaos général que traduisait l'aventure irakienne (favorisée en sous-main par l'attitude "conciliante" affichée par les Etats-Unis avant le 2 août à l'égard de l'Irak dans le but de "faire un exemple" par la suite), la "communauté internationale", comme l'appellent les médias, et qui est loin de recouvrir l'ancien bloc de l'Ouest puisque, aujourd'hui, l'URSS en fait partie, n'avait d'autre ressource que de se placer derrière l'autorité de la première puissance mondiale, et particulièrement de sa force militaire, la seule capable d'aller faire la police en n'importe quel point du monde.
Ce que montre donc la guerre du Golfe, c'est que, face à la tendance au chaos généralisé propre a la phase de décomposition, et à laquelle l'effondrement du bloc de l'Est a donné un coup d'accélérateur considérable, il n'y a pas d'autre issue pour le capitalisme, dans sa tentative de maintenir en place les différentes parties d'un corps qui tend à se disloquer, que l'imposition du corset de fer que constitue la force des armes ([5] [150]). En ce sens, les moyens mêmes qu'il utilise pour tenter de contenir un chaos de plus en plus sanglant sont un facteur d'aggravation considérable de la barbarie guerrière dans laquelle est plongé le capitalisme.
La reconstitution de nouveaux blocs n'est pas à l'ordre du jour
9) Alors que la formation des blocs se présente historiquement comme la conséquence du développement du militarisme et de l'impérialisme, l'exacerbation de ces deux derniers dans la phase actuelle de vie du capitalisme constitue, de façon paradoxale, une entrave majeure à la reformation d’un nouveau système de blocs prenant la suite de celui qui vient de disparaître. L'histoire (notamment celle du deuxième après-guerre) a mis en évidence le fait que la disparition d'un bloc impérialiste (par exemple l'"Axe") met à l'ordre du jour la dislocation de l'autre (les "Alliés") mais aussi la reconstitution d'un nouveau "couple" de blocs antagoniques (Est et Ouest). C'est pour cela que la situation présente porte effectivement avec elle, sous l'impulsion de la crise et de l'aiguisement des tensions militaires, une tendance vers la reformation de deux nouveaux blocs impérialistes. Cependant, le fait même que la force des armes soit devenue -comme le confirme la guerre du Golfe- un facteur prépondérant dans la tentative de la part des pays avancés pour limiter le chaos mondial, constitue une entrave considérable à cette tendance. En effet, cette même guerre est venue souligner la supériorité écrasante (pour ne pas dire plus) de la puissance militaire des Etats-Unis vis-à-vis de celle des autres pays développés (une telle démonstration constituait en fait un des objectifs majeurs de ce pays) : en réalité, cette puissance militaire, à elle seule, est aujourd'hui au moins équivalente à celle de tous les autres pays du globe réunis. Et un tel déséquilibre n'est pas près d'être compensé, il n'existe aucun pays en mesure, dans un avenir proche, d'opposer à celui des Etats-Unis un potentiel militaire lui permettant de prétendre au poste de chef d'un bloc pouvant rivaliser avec celui qui serait dirigé par cette puissance. Et pour une échéance plus éloignée, la liste des candidats à un tel poste est extrêmement limitée.
10) En effet, il est hors de question, par exemple, que la tête du bloc qui vient de s'effondrer, l'URSS, puisse un jour reconquérir une telle place. En réalité, le fait que ce pays ait joué un tel rôle dans le passé constitue, en soi, une sorte d'aberration, un accident de l'histoire. L'URSS, du fait de son arriération considérable sur tous les plans (économique, mais aussi politique et culturel), ne disposait pas des attributs lui permettant de constituer "naturellement" autour d'elle un bloc impérialiste ([6] [151]). Si elle a pu accéder à un tel rang, c'est par la "grâce" de Hitler, qui l'a fait entrer dans la guerre en 1941, et des "allies" qui, à Yalta, l'ont "récompensée" pour avoir constitué un second front face à l'Allemagne et lui ont remboursé le tribut de 20 millions de morts payé par sa population sous forme de la pleine disposition des pays d'Europe centrale que ses troupes avaient occupés lors de la débâcle allemande ([7] [152]). C'est d'ailleurs bien parce que l'URSS ne pouvait pas tenir ce rôle de tête de bloc qu'elle a été contrainte, pour conserver son empire, d'imposer à son appareil productif une économie de guerre qui a complètement ruiné celui-ci. L'effondrement spectaculaire du bloc de l'Est, outre qu'il sanctionnait la faillite d'une forme de capitalisme d'Etat particulièrement aberrante (du fait que, lui non plus, ne découlait pas d'un développement "organique" du capital, mais résultait de l'élimination par la révolution de 1917 de la bourgeoisie classique), ne pouvait que traduire la revanche de l'histoire vis-à-vis de cette aberration d'origine. C'est pour cette raison que jamais plus l'URSS ne pourra jouer, malgré ses arsenaux considérables, de rôle majeur sur la scène internationale. Et cela d'autant plus que la dynamique de dislocation de son empire extérieur ne peut que se poursuivre à l'intérieur, dépouillant en fin de compte la Russie des territoires qu'elle avait colonisés au cours des siècles passés. Pour avoir tenté de jouer un rôle de puissance mondiale qui était au-dessus de ses forces, la Russie est condamnée à retrouver la place de troisième ordre qui était la sienne avant Pierre le Grand.
Les deux seuls candidats potentiels au titre de tête de bloc, le Japon et l'Allemagne, ne sont pas en mesure non plus, a une échéance prévisible, d'assumer un tel rôle. Pour sa part, le Japon, malgré sa puissance industrielle et son dynamisme économique, ne pourra jamais prétendre à un tel rang du fait de sa localisation géographique excentrée par rapport à la région qui concentre la plus forte densité industrielle : l’Europe occidentale. Quant à l'Allemagne, le seul pays qui pourrait éventuellement un jour tenir un rôle qui a déjà été le sien par le passé, sa puissance militaire actuelle (elle ne dispose même pas de l'arme atomique, rien que cela !) ne lui permet pas d'envisager rivaliser avec les Etats-Unis sur ce terrain avant longtemps. Et cela d'autant plus qu'à mesure que le capitalisme s'enfonce dans sa décadence, il est toujours plus indispensable à une tête de bloc de disposer d'une supériorité militaire écrasante sur ses vassaux pour être en mesure de tenir son rang.
Les Etats-Unis : seul gendarme du monde
11) C'est ainsi qu'au début de la période de décadence, et jusqu'aux premières années de la seconde guerre mondiale, il pouvait exister une certaine "parité" entre différents partenaires d'une coalition impérialiste, bien que le besoin d'un chef de file se soit toujours fait sentir. Par exemple, dans la première guerre mondiale, il n'existait pas, en terme de puissance militaire opérationnelle, de disparité fondamentale entre les trois "vainqueurs" : Grande-Bretagne, France et Etats-Unis. Cette situation avait déjà évolué de façon très importante au cours de la seconde guerre, où les "vainqueurs" étaient placés sous la dépendance étroite des Etats-Unis qui affichaient une supériorité considérable sur leurs "alliés". Elle allait encore s'accentuer durant toute la période de "guerre froide" (qui vient de se terminer), où chaque tête de bloc, Etats-Unis et URSS, notamment par le contrôle des armements nucléaires les plus destructeurs, disposaient d'une supériorité absolument écrasante sur les autres pays de leur bloc. Une telle tendance s'explique par le fait que, avec l'enfoncement du capitalisme dans sa décadence :
- les enjeux et l'échelle des conflits entre blocs acquièrent un caractère de plus en plus mondial et général (plus il y a de gangsters à contrôler, plus le "caïd" doit être puissant) ;
- les armements requièrent des investissements de plus en plus faramineux (en particulier, seuls les très grands pays pouvaient dégager les ressources nécessaires à la constitution d'un arsenal nucléaire complet et consacrer suffisamment de moyens pour les recherches sur les armes les plus sophistiquées) ;
- et, surtout, les tendances centrifuges entre tous les Etats, résultant de l'exacerbation des antagonismes nationaux, ne peuvent que s'accentuer.
Il en est de ce dernier facteur comme du capitalisme d'Etat : plus les différentes fractions d'une bourgeoisie nationale tendent à s'entre-déchirer avec l'aggravation de la crise qui attise leur concurrence, et plus l'Etat doit se renforcer afin de pouvoir exercer son autorité sur elles. De même, plus la crise historique, et sa forme ouverte, exercent des ravages, plus une tête de bloc doit être forte pour contenir et contrôler les tendances à sa dislocation entre les différentes fractions nationales qui le composent. Et il est clair que dans la phase ultime de la décadence, celle de la décomposition, un tel phénomène ne peut que s'aggraver encore à une échelle considérable.
C'est pour cet ensemble de raisons, et notamment pour la dernière, que la reconstitution d'un nouveau couple de blocs impérialistes, non seulement n'est pas possible avant de longues années, mais peut très bien ne plus jamais avoir heu : la révolution ou la destruction de l'humanité intervenant avant une telle échéance. Dans la nouvelle période historique où nous sommes entrés, et les événements du Golfe viennent de le confirmer, le monde se présente comme une immense foire d'empoigne, où jouera à fond la tendance au "chacun pour soi", où les alliances entre Etats n'auront pas, loin de là, le caractère de stabilité qui caractérisait les blocs, mais seront dictées par les nécessités du moment. Un monde de désordre meurtrier, de chaos sanglant dans lequel le gendarme américain tentera de faire régner un minimum d'ordre par l'emploi de plus en plus massif et brutal de sa puissance militaire.
Vers le "super-impérialisme" ?
12) Le fait que, dans la période qui vient, le monde ne soit plus divisé en blocs impérialistes, qu'il revienne à une seule puissance -les Etats-Unis- d'exercer le "leadership" mondial, ne signifie nullement que soit aujourd'hui correcte la thèse du "super-impérialisme" (ou "ultra-impérialisme") telle qu'elle fut développée par Kautsky au cours de la première guerre mondiale. Cette thèse avait été élaborée dès avant la guerre par le courant opportuniste qui se développait dans la Social-Démocratie. Elle trouvait sa racine dans la vision gradualiste et réformiste qui considérait que les contradictions (entre classes et entre nations) au sein de la société capitaliste étaient destinées à s'atténuer jusqu'à disparaître. La thèse de Kautsky supposait que les différents secteurs du capital financier international seraient en mesure de s'unifier pour établir une domination stable et pacifique sur l'ensemble du monde. Cette thèse, qui se présentait comme "marxiste", était évidemment combattue par tous les révolutionnaires, et en particulier par Lénine (notamment dans L'impérialisme, stade suprême du capitalisme), qui mettaient en évidence qu'un capitalisme dont on retranche l'exploitation et la concurrence entre capitaux n'est plus le capitalisme. Il est bien clair que cette position révolutionnaire reste tout à fait valable aujourd'hui.
De même, notre analyse ne saurait être confondue avec celle développée par Chaulieu (Castoriadis), et qui avait au moins l'avantage, pour sa part, de rejeter explicitement le "marxisme". Dans cette analyse, le monde s'acheminait vers un "troisième système" non pas dans l'harmonie chère aux réformistes, mais à travers des convulsions brutales. Chaque guerre mondiale conduisait à l'élimination d'une grande puissance (la seconde guerre ayant éliminé l’Allemagne). La troisième guerre mondiale était appelée à ne laisser en place qu'un seul bloc faisant régner son ordre sur un monde où les crises économiques auraient disparu et dans lequel l'exploitation capitaliste de la force de travail serait remplacée par une sorte d'esclavage, un règne des "dominants" sur les "dominés".
Le monde d'aujourd'hui, tel qu'il sort de l'effondrement du bloc de l'Est et tel qu'il se présente face à la décomposition générale, n'en reste pas moins totalement capitaliste. Crise économique insoluble et de plus en plus profonde, exploitation de plus en plus féroce de la force de travail, dictature de a loi de la valeur, exacerbation de la concurrence entre capitaux et des antagonismes impérialistes entre nations, règne sans frein du militarisme, destructions massives et massacres à la chaîne : voilà la seule réalité qui puisse être la sienne. Et avec comme seule perspective ultime la destruction de l'humanité.
Le prolétariat face a la guerre impérialiste
13) Plus que jamais, donc, la question de la guerre reste centrale dans la vie du capitalisme. Plus que jamais, par conséquent, elle est fondamentale pour la classe ouvrière. L'importance de cette question n'est évidemment pas nouvelle. Elle était déjà centrale dès avant la première guerre mondiale (comme le mettent en évidence les congrès internationaux de Stuttgart en 1907 et de Bâle en 1912). Elle devient encore plus décisive, évidemment, au cours de la première boucherie impérialiste (comme le mettent en évidence le combat de Lénine, de Rosa Luxemburg, de Liebknecht, de même que la révolution en Russie et en Allemagne). Elle garde toute son acuité entre les deux guerres mondiales, en particulier lors de la guerre d'Espagne, sans parler, évidemment, de l'importance qu'elle revêt au cours du plus grand holocauste de ce siècle, entre 1939 et 1945. Elle a conservé enfin toute son importance au cours des différentes guerres de "libération nationale" après 1945, moments de l'affrontement entre les deux blocs impérialistes. En fait, depuis le début du siècle, la guerre a été la question la plus décisive qu'aient eu à affronter le prolétariat et ses minorités révolutionnaires, très loin devant les questions syndicale ou parlementaire, par exemple. Et il ne pouvait en être qu'ainsi dans la mesure où la guerre constitue la forme la plus concentrée de la barbarie du capitalisme décadent, celle qui exprime son agonie et la menace qu'il fait peser sur la survie de l'humanité.
Dans la période présente où, plus encore que dans les décennies passées, la barbarie guerrière (n'en déplaise à MM. Bush et Mitterrand avec leurs prophéties d'un "nouvel ordre de paix") sera une donnée permanente et omniprésente de la situation mondiale, impliquant de façon croissante les pays développés (dans les seules limites que pourra lui fixer le prolétariat de ces pays), la question de la guerre est encore plus essentielle pour la classe ouvrière. Le CCI a depuis longtemps mis en évidence que, contrairement au passé, le développement d'une prochaine vague révolutionnaire ne proviendrait pas de la guerre mais de l'aggravation de la crise économique. Cette analyse reste tout à fait valable : les mobilisations ouvrières, le point de départ des grands combats de classe proviendront des attaques économiques. De même, sur le plan de la prise de conscience, l'aggravation de la crise sera un facteur fondamental en révélant l'impasse historique du mode de production capitaliste. Mais, sur ce même plan de la prise de conscience, la question de la guerre est appelée, une nouvelle fois, à jouer un rôle de premier ordre :
- en mettant en relief les conséquences fondamentales de cette impasse historique : la destruction de l'humanité ;
- en constituant la seule conséquence objective de la crise, de la décadence et de la décomposition que le prolétariat puisse dès à présent limiter (à l'opposé des autres manifestations de la décomposition) dans la mesure où, dans les pays centraux, il n'est pas, à l'heure actuelle, embrigadé derrière les drapeaux nationalistes.
L'impact de la guerre sur la conscience dans la classe
14) Il est vrai que la guerre peut être utilisée contre la classe ouvrière beaucoup puis facilement que la crise elle-même et les attaques économiques :
- elle peut favoriser le développement du pacifisme ;
- elle peut lui donner un sentiment d'impuissance, permettant à la bourgeoisie de placer ses attaques économiques.
C'est bien d'ailleurs ce qui est arrivé jusqu'à présent avec la guerre du Golfe. Mais ce type d'impact ne pourra être que limité dans le temps. A terme :
- avec la permanence de la barbarie guerrière mettant en relief toute la vanité des discours pacifistes ;
- avec la mise en évidence du fait que la classe ouvrière est la principale victime de cette barbarie, que c'est elle qui en paie les frais comme chair à canon et par une exploitation accrue ;
- avec la reprise de la combativité face aux attaques économiques de plus en plus massives et brutales ;
la tendance ne pourra que se renverser. Et il appartient évidemment aux révolutionnaires d'être au premier rang de cette prise de conscience : leur responsabilité sera de plus en plus décisive.
15) Dans la situation historique présente, l'intervention des communistes au sein de la classe est déterminée, outre, évidemment, par l'aggravation considérable de la crise économique et des attaques qui en résultent contre l'ensemble du prolétariat, par :
- l'importance fondamentale de la question de la guerre ;
- le rôle décisif des révolutionnaires dans la prise de conscience par la classe de la gravité des enjeux présents.
Il importe donc que cette question figure en permanence au premier plan dans la propagande des révolutionnaires. Et dans les périodes, comme celle d'aujourd'hui, où cette question se trouve aux avant plans immédiats de l'actualité internationale, il importe qu'ils mettent à profit la sensibilisation particulière des ouvriers à son sujet en y apportant une priorité et une insistance toute particulière.
En particulier, les organisations révolutionnaires auront pour devoir de veiller à :
- dénoncer les manœuvres des syndicats faisant semblant d'appeler à des luttes économiques pour mieux faire passer la politique de guerre (par exemple au nom d'un "juste partage" des sacrifices entre ouvriers et patrons) ;
- dénoncer avec la dernière virulence l'hypocrisie répugnante des gauchistes qui, au nom de l’"internationalisme" et de la "lutte contre l'impérialisme", appellent en fait au soutien d'un des camps impérialistes ;
- traîner dans la boue les campagnes pacifistes qui constituent un moyen privilégie pour démobiliser la classe ouvrière dans sa lutte contre le capitalisme en l'entraînant sur le terrain pourri de l'interclassisme ;
- souligner toute la gravité des enjeux de la période présente, notamment en comprenant pleinement toutes les implications des bouleversements considérables que vient de subir le monde, et particulière ment la période de chaos dans laquelle il est entré.
CCI, 4 octobre 1990.
[1] [153] Voir "Guerre, militarisme et blocs impérialistes" dans la Revue Internationale n° 52 et n° 53.
[2] [154] Pour l'analyse du CCI sur la question de la décomposition, Revue Internationale n° 57 et n° 62.
[3] [155] Il convient toutefois de souligner une différence majeure entre capitalisme d'Etat et blocs impérialistes. Le premier ne peut être remis en cause par les conflits entre différentes fractions de la classe capitaliste (ou alors, c'est la guerre civile, qui peut caractériser certaines zones arriérées du capitalisme, mais non pas ses secteurs les plus avancés) : en règle générale, c'est l'Etat, représentant du capital national comme un tout, qui réussit à imposer son autorité aux différentes composantes de ce dernier. En revanche, les blocs impérialistes ne présentent pas le même caractère de pérennité. En premier lieu, ils ne se constituent qu'en vue de la guerre mondiale : dans une période où celle-ci n'est pas momentanément à l'ordre du jour (comme au cours des années 1920), ils peuvent très bien disparaître. En second lieu, il n'existe pas pour les Etats de "prédestination" définitive en faveur de tel ou tel bloc : c'est de façon circonstancielle que les blocs se constituent, en fonction de critères économiques, géographiques, militaires, politiques, etc. En ce sens, l'histoire comporte de nombreux exemples d'Etats ayant changé de bloc suite a la modification d'un de ces facteurs. Cette différence de stabilité entre l'Etat capitaliste et les blocs n'est nullement mystérieuse. Elle correspond au fait que le niveau le plus élevé d'unité auquel la bourgeoisie puisse parvenir est celui de la nation, dans la mesure où l'Etat national est, par excellence, l'instrument de défense de ses intérêts (maintien de 1' "ordre", commandes massives, politique monétaire, protection douanière, etc). C'est pour cela qu'une alliance au sein d'un bloc impérialiste n'est pas autre chose que le conglomérat d'intérêts nationaux fondamentalement antagoniques, conglomérat destiné à préserver ces intérêts dans la jungle internationale. En décidant de s'aligner dans un bloc plutôt que dans un autre, une bourgeoisie n'a pas d'autre préoccupation que la garantie de ses intérêts nationaux. En fin de compte, si l'on peut considérer le capitalisme comme une entité globale, il faut toujours garder en vue que, concrètement, c'est sous forme de capitaux concurrents et rivaux qu'il existe.
[4] [156] En réalité, c'est bien le mode de production capitaliste comme un tout qui, dans sa décadence et plus encore dans sa phase de décomposition, constitue une aberration du point de vue des intérêts de l'humanité. Mais dans cette agonie barbare du capitalisme, certaines formes de celui-ci, comme le stalinisme, découlant de circonstances historiques spécifiques (comme nous le verrons plus loin) comportent des caractéristiques qui les rendent encore plus vulnérables et les condamnent a disparaître avant même que l'ensemble du système soit détruit par la révolution prolétarienne ou à travers la destruction de l'humanité.
[5] [157] En ce sens, la façon dont sera garanti l'"ordre" du monde dans la nouvelle période tendra à ressembler de plus en plus à la façon dont l'URSS maintenait l'ordre dans son ancien bloc : par la terreur et la force des armes. Dans la période de décomposition, et avec l'aggravation des convulsions économiques du capital à l'agonie, ce sont les formes les plus brutales et barbares des rapports entre Etats utilisées auparavant qui tendront à devenir la règle pour tous les pays du monde.
[6] [158] En fait, les raisons pour lesquelles la Russie ne pouvait représenter une locomotive pour la révolution mondiale (c est pour cette raison que les révolutionnaires comme Lénine et Trotsky attendaient la révolution en Allemagne pour qu'elle prenne en remorque la révolution russe) étaient les mêmes qui en faisaient un candidat tout à fait inapproprié au rôle de tête de bloc.
[7] [159] Une autre raison pour laquelle les alliés occidentaux ont donné à l'URSS une pleine disposition des pays d'Europe centrale réside dans le fait qu'il comptaient sur cette puissance pour "faire la police" contre le prolétariat de cette région. L'histoire a montré (à Varsovie, notamment) combien cette confiance était méritée.
Questions théoriques:
- Décomposition [3]
- Guerre [129]
Polémique : le milieu politique prolétarien face à la guerre du golfe
- 2864 reads
La guerre impérialiste constitue une épreuve de vérité pour les organisations qui se réclament de la classe ouvrière. En réalité, c'est une des questions qui permet le plus sûrement de déterminer la nature de classe d'une formation politique. Le conflit du Golfe vient d'en constituer une nouvelle illustration. Les partis bourgeois classiques, y compris les partis "socialistes" et "communistes", ont évidemment agi conformément à leur nature en s'alignant ouvertement sur la politique de guerre, ou en appelant à l’"arbitrage international" qui constitue la feuille de vigne de cette politique. Pour leur part, les organisations qui se présentent comme "révolutionnaires", telles les organisations trotskistes, ont également montré clairement dans quel camp elles se trouvaient en appelant ouvertement ou hypocritement, selon les cas et les circonstances ([1] [160]), au soutien de l'Irak. Cette épreuve de vérité a donc permis que se distinguent clairement les groupes qui se situent sur le terrain de classe prolétarien, elle leur a donné l'occasion de faire entendre la voix de l'internationalisme, à l'image des courants révolutionnaires aux cours des deux guerres mondiales. Mais si, dans l'ensemble, Tes groupes du milieu prolétarien ont affirmé une position de classe principielle face à la guerre, la plupart d'entre eux l'ont fait avec des arguments et des analyses qui, loin d'apporter une clarté au prolétariat, sont plutôt un facteur de confusion.
Dès le début de la crise du Golfe, la plupart de ces organisations n'ont pas failli à leur responsabilité internationaliste élémentaire : que ce soit dans la presse ou sous forme de tracts, l'ensemble du milieu politique prolétarien a pris position clairement pour dénoncer la guerre impérialiste, rejeter toute participation dans l'un ou l'autre camp et appeler les ouvriers à engager le combat contre le capitalisme sous toutes ses formes et dans tous les pays ([2] [161]). En somme, les organisations prolétariennes existantes ont montré qu'elles étaient... dans le camp du prolétariat.
Cependant, pour être en mesure d'affirmer leur internationalisme, il a fallu à certaines d'entre elles recouvrir d'un mouchoir pudique des élucubrations qui constituent habituellement leur fond de commerce. Il en est ainsi, par exemple, à propos du soutien que le prolétariat devrait apporter aux "luttes d'indépendance nationale" dans certains pays sous-développés.
Internationalisme et luttes d'«indépendance nationale»
Le mouvement ouvrier du début du siècle avait été traversé par un débat très animé sur la question des luttes de libération nationale (voir en particulier notre série d'articles dans la Revue Internationale n°34 et 37). Dans ce débat, Lénine était le chef de file d'une position qui estimait possible, alors que le phénomène de l'impérialisme avait déjà envahi toute la société, le soutien par le prolétariat de certaines luttes d'indépendance nationale. Cela ne l'avait pas empêché, cependant, de prendre, au cours de la première guerre mondiale, une position parfaitement internationaliste, plus claire, par certains côtés, que celle de Rosa Luxemburg, qui défendait, sur la question nationale, la position opposée. Lors du deuxième congrès de l'Internationale Communiste (IC), c'est la position de Lénine qui était devenue celle de l'Internationale. Cependant, la réalité (en particulier lors de la révolution chinoise de 1927) allait rapidement démontrer la non-validité de cette position de Lénine et de PIC, au point que la Fraction de Gauche du Parti communiste d'Italie, pourtant de "tradition léniniste", allait, au cours des années 1930, l'abandonner. Mais aujourd'hui encore, la plupart des croupes qui se réclament de la Gauche italienne continuent à défendre la position de PIC, comme si rien ne s'était passé, ce qui les conduit à des contorsions invraisemblables.
Ainsi, nous ne pouvons que saluer le souci internationaliste du Parti Communiste International lorsqu'il nous dit que :
"Les travailleurs n'ont rien à gagner et tout à perdre à soutenir les conflits impérialistes... (...) Que la rente pétrolière enrichisse des bourgeois irakiens, koweïtiens ou français ne changera pas le sort des prolétaires d'Irak, de Koweït ou de France : seule ta lutte de classe contre l'exploitation capitaliste peut le faire. Et cette lutte de classe n'est possible qu'en rompant l’ 'union nationale' entre les classes qui impose toujours des sacrifices aux prolétaires, qui les divise par le patriotisme et le racisme avant de les faire se massacrer sur les champs de bataille. " (Tract du 24 août 1990, publié par Le Prolétaire). Mais cette organisation ferait bien de se demander en quoi les prolétaires arabes défendent leurs intérêts de classe lorsqu'ils sont enrôlés, comme elle les y appelle, dans la guerre pour la constitution d'un Etat national palestinien. Un tel Etat palestinien, s'il arrivait à voir le jour, ne serait pas moins impérialiste (même si moins puissant) que ne l'est aujourd'hui l'Irak, et les ouvriers n'y seraient pas moins férocement exploités. Ce n'est pas pour rien que Yasser Arafat compte parmi les meilleurs amis de Saddam Hussein. Pour le courant "bordiguiste" (auquel appartient Le Prolétaire), il serait temps de se rendre compte que l'histoire a démontré depuis 70 ans, et en de nombreuses reprises, l'inconsistance de ces positions. Sinon, ses exercices de corde raide entre internationalisme et nationalisme ne pourront que le conduire à la chute, soit dans le néant, soit dans le camp bourgeois (comme c'est arrivé, au début des années 1980, pour une bonne partie de ses composantes, telles Combat en Italie et El Oumami en France).
Cette contradiction entre l'internationalisme, qui constitue une condition essentielle d'appartenance au camp du prolétariat, et le soutien aux luttes nationales, une autre organisation du courant bordiguiste l'a résolue à sa façon, mais qui n'est malheureusement pas celle de la clarté. Ainsi on peut lire dans 77 Programma comunista d'octobre 1990 : "On peut comprendre que, dans leur désespoir, les masses palestiniennes, s'agrippent aujourd'hui au mythe de Saddam, comme hier et en d'autres circonstances à celui de Assad : le développement des événements ne tardera pas à démontrer que le 'héros' d'aujourd'hui, au même titre que celui d'hier, n'est que volonté étatique de puissance, et que le chemin de leur émancipation passe uniquement à travers la révolution socialiste contre tous les potentats, arabes comme non arabes, du Moyen-Orient."
On constate ici toute l'ambiguïté de la position de Programma.
En premier lieu, le concept de "masses" est confusionniste par excellence. Dans les "masses", on peut tout mettre, y compris des couches sociales comme la paysannerie qui, l’histoire l'a montré, sont loin d'être des alliés de la révolution prolétarienne. Ce qui constitue la question centrale pour les communistes, celle pour laquelle ils existent, c'est la prise de conscience du prolétariat. Or il existe un prolétariat palestinien, relativement nombreux et concentré, mais qui est particulièrement intoxiqué par le nationalisme (au même titre, d'ailleurs, que le prolétariat israélien qu'il côtoie). En second lieu, on ne voit pas pourquoi on tient à "comprendre" particulièrement la soumission de la population palestinienne à l'idéologie nationaliste. Que les couches petites-bourgeoises qui constituent cette population soient infectées par le nationalisme, c'est un phénomène courant dans l'histoire, qui correspond à leur nature et à leur place dans la société. Que le prolétariat lui-même soit victime de cette infection constitue, comme toujours et dans toutes les circonstances, une tragédie témoignant de sa faiblesse face à la bourgeoisie. On peut toujours "comprendre" les causes historiques, sociales et politiques d'une telle faiblesse (comme on pouvait, par exemple, "comprendre" en 1914 les causes de 1’embrigadement du prolétariat européen derrière les drapeaux nationaux), mais cela ne signifie pas qu'il faille faire la moindre concession politique à cette faiblesse. Ceux qui, au cours de la première guerre mondiale, passaient leur temps à comprendre" le nationalisme des ouvriers français, allemands ou russes, c'étaient bien les "social-chauvins" à la Plekhanov et les "centristes" à la Kautsky, et sûrement pas les révolutionnaires comme Lénine, Rosa Luxemburg ou Karl Liebknecht qui, eux, consacraient tous leurs efforts à combattre ce nationalisme.
A quoi bon, en fin de compte, s'intéresser particulièrement "aux masses" palestiniennes si c'est pour les appeler (en fait, seul le prolétariat est réellement capable d'entendre un tel appel) à faire la révolution socialiste ? Cet appel, c'est aux ouvriers de tous les pays qu'il doit s'adresser. Ce n'est pas seulement au Moyen-Orient que le combat révolutionnaire doit se mener, mais dans le monde entier. Et les ennemis à abattre, ce ne sont pas seulement tous les "potentats", mais tous les régimes bourgeois, et particulièrement les régimes "démocratiques" qui dominent les pays les plus avancés. On voit là toute l'absurdité de la position "bordiguiste". Par une fidélité stupide à la position "classique" de Lénine et de l'Internationale Communiste, les bordiguistes continuent à réciter, comme une litanie, des phrases sur les "masses" des pays coloniaux ou semi-coloniaux. Après ce qu'il est advenu du Vietnam, du Cambodge et autres nations "libérées", la Palestine constituait un des derniers lieux où la "libération nationale" pouvait faire illusion (auprès de ceux, évidemment, qui avaient envie de s'illusionner). Aujourd'hui, cependant, avec l'évidence de l'impasse que représente la lutte pour un Etat palestinien "indépendant et démocratique", on en vient à abandonner cette position classique (puisque celle-ci appelait les ouvriers à un soutien de certaines luttes nationales), mais sans le dire, et de façon honteuse, comme c'est de façon honteuse qu'on se tortille pour "comprendre" les mystifications bourgeoises.
Cependant, ce ne sont pas ces contorsions ridicules qui, en soi, constituent le problème fondamental posé par la "fidélité" aux positions erronées de l'IC. La véritable gravité du maintien, contre vents et marée, de cette position (et même si on en abandonne, par la force des réalités, la substance) réside dans le fait qu'elle constitue la feuille de vigne favorite derrière laquelle se réfugie toute l'ignominie des différentes variétés de gauchistes dans leur soutien à la guerre impérialiste. C'est au nom des luttes de "libération nationale" contre 1' "impérialisme" que ces gauchistes, comme les staliniens "pur jus", ont participé à l'enrôlement de multitudes de prolétaires des pays arriérés dans les massacres inter impérialistes (souvenons-nous du Vietnam !). Aujourd'hui, c'est au nom de cette même lutte "anti-impérialiste" que les
gauchistes, et particulièrement les trotskistes, appellent les prolétaires irakiens à aller se faire massacrer. En ce sens, toute confusion, tout manque de clarté sur la question nationale, ne peut que favoriser, même si on s'en défend, le sale travail des secteurs "radicaux" de la bourgeoisie.
«défaitisme révolutionnaire» et internationalisme
Il n'est pas que la position de soutien aux luttes de "libération nationale" qui conduise à des concessions aux campagnes gauchistes. Il en est de même du mot d'ordre de "défaitisme révolutionnaire" qui, au nom également de la "tradition", a été utilisé par certains groupes lors de la guerre du Golfe. Ce mot d'ordre a été mis en avant par Lénine au cours de la première guerre mondiale. Il répondait à la volonté de dénoncer les tergiversations des éléments "centristes" qui, bien que d'accord "en principe" pour rejeter toute participation à la guerre impérialiste, préconisaient cependant d'attendre que les ouvriers des pays "ennemis" soient prêts a engager le combat contre celle-ci avant d'appeler ceux de "leur" propre pays à en faire autant. A l'appui de cette position, ils avançaient l'argument que, si les prolétaires d'un pays devançaient ceux des pays ennemis, ils favoriseraient la victoire de ces derniers dans la guerre impérialiste. Face à cet "internationalisme" conditionnel, Lénine répondait très justement que la classe ouvrière d'un pays n'avait aucun intérêt en commun avec "sa" bourgeoisie, précisant, en particulier, que la défaite de celle-ci ne pouvait que favoriser son combat, comme on l'avait déjà vu lors de la Commune de Paris (résultant de la défaite face à la Prusse) et avec la révolution de 1905 en Russie (battue dans la guerre contre le Japon). De cette constatation, il concluait que chaque prolétariat devait "souhaiter" la défaite de "sa" propre bourgeoisie. Cette dernière position était déjà erronée à l’époque, puisqu'elle conduisait les révolutionnaires de chaque pays à revendiquer pour "leur" prolétariat les conditions les plus favorables à la révolution prolétarienne, alors que c'est au niveau mondial et, dans un premier temps, dans les grands pays avancés (qui étaient tous impliqués dans a guerre) que la révolution devait avoir lieu. Cependant, chez Lénine, la faiblesse de cette position n'a jamais conduit à une remise en cause de l'internationalisme le plus intransigeant (c'est même cette intransigeance qui l'avait conduit à un tel "dérapage"). En particulier, il ne serait jamais venu à Lénine 1’idée d'apporter un soutien à la bourgeoisie du pays "ennemi", même si, en toute logique, une telle attitude pouvait découler de ses "souhaits". En revanche, cette position incohérente a été par la suite utilisée en de multiples reprises par des partis bourgeois à coloration "communiste" pour justifier leur participation à la guerre impérialiste. C'est ainsi, par exemple, que les staliniens français ont brusquement "redécouvert", après la signature du pacte germano-russe de 1939, les vertus de 1'"internationalisme prolétarien" et du "défaitisme révolutionnaire", vertus qu'ils avaient oubliées depuis longtemps et qu'ils ont répudiées avec la même rapidité dès que l'Allemagne est entrée en guerre contre l'URSS en 1941. C'est le même "défaitisme révolutionnaire" que les staliniens italiens ont pu utiliser pour justifier, après 1941, leur politique à la tête de la1'résistance" contre Mussolini. Aujourd'hui, c'est au nom du même "défaitisme révolutionnaire" que les trotskistes des pays (et ils sont nombreux) impliqués dans le combat contre Saddam Hussein justifient le soutien de ce dernier.
C'est pour cela que, dans la guerre du Golfe, il est nécessaire que les révolutionnaires soient particulièrement clairs sur le mot d'ordre de "défaitisme révolutionnaire" s'ils ne veulent pas, même involontairement, favoriser les campagnes gauchistes.
Cette faiblesse dans le point de vue internationaliste, tel qu'il est exprimé au travers du mot d'ordre de "défaitisme révolutionnaire", nous la trouvons sous une forme tout à fait caricaturale dans 77 Partito Comunista n° 186 : "Nous ne sommes pas cependant indifférents à l'issue de la guerre : nous sommes, en premier lieu, comme communistes révolutionnaires, défaitistes, nous sommes de ce fait favorables à la défaite de notre pays et plus généralement des pays occidentaux ; nous souhaitons la défaite la plus retentissante pour l'impérialisme états unien qui, étant le plus puissant du monde, représente le pire ennemi pour le mouvement prolétarien international, le chien de garde du capitalisme au niveau planétaire. " 77 Partito "souhaite" la défaite de l'impérialisme américain... comme les gauchistes, pour qui les croisades "anti impérialistes" ne sont rien d'autre que des prétextes pour appeler à participer à la guerre impérialiste, évidemment, Il Partito rejette une telle participation. Mais à quoi sert alors de "souhaiter", si c'est pour s'interdire tout moyen d'agir pour que le "souhait" devienne réalité. Pour les communistes, la réflexion théorique n'a pas pour objectif la spéculation gratuite, c'est un guide pour l'action. Les gauchistes, eux, sont conséquents. Et c'est justement le grand danger présenté par la position d'Il Partito. Avec ses "souhaits", cette organisation encourage, au lieu de les combattre fermement, les mystifications "anti impérialistes" qui pèsent sur une partie de la classe ouvrière. Et, à partir de là, ses protestations internationalistes en porte-à-faux ne pèsent pas lourd face à la logique des gauchistes. Qu’il le veuille ou non, Il Partito se fait ainsi le rabatteur pour le compte de ces derniers. Il est heureux, cependant, que la position de ce groupe ait peu de chances d'être entendue. C'est vrai que la défaite du principal gendarme mondial affaiblirait plus l'ensemble de la bourgeoisie que sa victoire. L'ennui, c'est que ce genre de chose n'existe que "dans l'abstrait" où l'on peut échafauder tous les plans sur la comète que l'on veut. Dans la réalité, et en l'absence d'intervention divine, la victoire va à l'impérialisme le plus fort : aujourd'hui, même Saddam Hussein, malgré sa mégalomanie, ne croit pas qu'il puisse vaincre les Etats-Unis ([3] [162]). Ainsi, en révélant ouvertement sa nature de spéculation futile et puérile, en affichant son ridicule et son absurdité, '"analyse" de Il Partito a au moins la qualité de réduire le danger constitué par une position fausse, celle du "défaitisme révolutionnaire".
Cependant, les erreurs des groupes prolétariens n'ont pas toujours le mérite d'être rendues inoffensives par leur absurdité. En particulier, il faut se garder de slogans tels que "Pour nous ouvriers de tous les pays, notre plus grand ennemi est 'notre' propre Etat", slogan qui figure dans la prise de position du Bureau International pour le Parti Révolutionnaire (BIPR) intitulée : "Contre Bush et l'impérialisme occidental, Contre Saddam et l'expansionnisme irakien, Non à la guerre au Moyen-Orient" (Déclaration reproduite dans Battaglia Comunista de septembre 1990 et Workerç Voice n° 53). Ce n'est pas un hasard si ce slogan est le même que "L'ennemi principal est notre propre bourgeoisie" qui est le titre d'un tract diffusé en France par un groupe appelé "Internationale ouvrière pour reconstruire la 4e Internationale", c'est-à-dire un groupe trotskiste. Ce slogan (qui s'apparente à celui de "défaitisme révolutionnaire") aussi avait été mis en avant au cours de la première guerre mondiale, notamment par les spartakistes en Allemagne. On peut constater aujourd'hui à quel point il peut facilement être récupéré par la bourgeoisie. En fait, tout mot d'ordre qui s'adresse à tel ou tel secteur du prolétariat en particulier, en lui assignant des tâches distinctes, sinon différentes de celles des autres secteurs, est ambigu et peut être retourné plus facilement contre la classe ouvrière par les gauchistes. Même si le prolétariat mondial est, à l'origine, séparé en secteurs nationaux, du fait de la division de la société bourgeoise elle-même, le sens de sa lutte historique est de tendre vers une unité mondiale. Il appartient justement aux révolutionnaires de contribuer activement à la constitution de cette unité mondiale. C'est pour cela qu'il ne peut exister aujourd'hui qu'un seul programme pour une organisation communiste (et non un programme par pays) comme c'est le cas pour le CCI. Comme l'écrivait Marx : "Le prolétariat ne peut exister qu'à l'échelle de l'histoire universelle, de même que le communisme, qui en est l'action, ne peut absolument pas se rencontrer autrement qu'en tant qu'existence historique universelle." Dans le même sens, les perspectives que doivent mettre en avant les révolutionnaire sont les mêmes pour tous les pays et tous les secteurs du prolétariat mondial, contrairement à ce que fait le BIPR dans son document pour expliciter le slogan signalé plus haut. En effet, ce document, présenté comme l'émanation d'un même organe, existe en deux versions, et il faut constater que celle destinée aux ouvriers de langue anglaise a une allure bien plus gauchiste que celle en langue italienne (nous attendons la version française et allemande de ce texte). Dans cette version anglaise (et non dans l'autre) on peut lire, en effet :
"Nous devons combattre ses plans et préparatifs de guerre [de notre "propre" Etat, NDLR]. Cela signifie en premier lieu que nous exigeons le retrait immédiat de toutes les forces occidentales envoyées dans le Golfe. Toutes les tentatives d'envoyer de nouvelles forces doivent être combattue par des grèves aux ports et aux aéroports par exemple. Si les combats éclatent nous devons appeler à la fraternisation entre les soldats irakiens et les soldats occidentaux et à ce qu'ils retournent leurs fusils contre leurs officiers. En second lieu, cela signifie combattre les tentatives d'imposer plus d'austérité et de réduction des prestations sociales au nom de l’'intérêt national' (...) La crise du pétrole, comme en 1974, va fournir [à la bourgeoisie] un alibi parfait pour expliquer l'effondrement du système. Notre réponse doit être de repousser les mensonges, repousser l'hystérie nationaliste, et combattre pour un niveau de vie plus élevé. En particulier, nous appelons les ouvriers britanniques du pétrole de la mer du Nord à développer leur lutte et à empêcher les patrons d'augmenter la production. Cette grève doit être étendue afin d'inclure tous les ouvriers du pétrole et tous les autres ouvriers. Pas de sacrifice pour les guerres impérialistes."
Il faut malheureusement constater que la branche britannique du BIPR place au premier plan de son intervention le mot d'ordre classique de tous les gauchistes au sein du prétendu mouvement "anti-guerre" : "Retrait des troupes occidentales du Golfe". Il apporte ainsi sa petite contribution aux campagnes des secteurs d'extrême gauche de la bourgeoisie visant, non seulement à permettre que le Golfe soit contrôlé par le "peuple arabe" (c'est-à-dire par les impérialismes locaux), mais surtout à répandre les illusions dans la possibilité de bloquer la politique de guerre de la bourgeoisie au moyen d'une campagne légaliste de "manifestations pour la paix", de "mobilisation de l'opinion publique", etc. Et on sait que ces illusions constituent le meilleur moyen pour détourner les ouvriers de la seule arme avec laquelle ils puissent combattre le développement de la guerre : la lutte sur leur propre terrain de classe rejetant l'inter-classisme des campagnes pacifistes. Une telle politique erronée n'est pas nouvelle de la part de la Communist Workers Organisation (CWO), puisque c'est le même slogan gauchiste, "Impérialisme hors du Golfe", qu'elle avait mis en avant lors de l'intervention de 1 armada occidentale dans la guerre Irak-Iran en 1987 ([4] [163]).
Concernant l'appel à la grève dans les ports et les aéroports lancé par la CWO, on pourra signaler, pour sa gouverne et celle de ses supporters, qu il a rencontré un écho en France où les marins du port de Marseille ont arrêté le travail pour retarder (d'une journée) le départ de troupes vers le Golfe. Précisons toutefois que c'était à l'appel du syndicat CGT contrôlé par les staliniens. Et cela n'a rien de surprenant : si ces crapules se sont permises de lancer une telle "action d'éclat", c'est qu'elles savaient pertinemment qu'à l'heure actuelle une telle méthode de "lutte" ne présente aucun danger pour la bourgeoisie. En réalité, ce n'est pas à travers des luttes particulières de tel ou tel secteur de la classe ouvrière que celle-ci peut combattre la politique de guerre de la bourgeoisie (et c'est également valable pour les ouvriers du pétrole dont la solidarité avec leurs frères de classe irakiens ne passe en aucune façon par une lutte spécifique dans cette branche, même si, pris d'un scrupule, la CWO l'appelle ensuite à s'élargir). Cette politique est la seule "réponse" que cette classe, dans son ensemble, puisse apporter à la crise sans issue de son système et à la décomposition généralisée que cette crise engendre aujourd'hui. Seule la lutte de l'ensemble du prolétariat, comme classe, sur le terrain de classe, et non en tant que telle où telle catégorie spécifique peut s'opposer réellement à la guerre impérialiste. Elle seule, en particulier, ouvre le chemin vers l'unique réponse historique que la classe ouvrière puisse apporter à la guerre impérialiste : le renversement du capitalisme lui-même.
C'est pour cela, également, que l'appel "à la fraternisation entre les soldats irakiens et tes soldats occidentaux et à ce qu'ils retournent leurs fusils contre leurs officiers" est erroné dans la situation présente en tant que perspective immédiate. Ce mot d ordre est tout à fait juste en général. Il constitue une application de la vision internationaliste qui consiste à appeler le prolétariat à "transformer la guerre impérialiste en guerre civile" ; et c'est comme tel qu'il s'est concrétisé à la fin de la première guerre mondiale, notamment entre les soldats russes et les soldats allemands. Mais cette concrétisation suppose un degré de maturité important dans la conscience du prolétariat, lequel n'existait pas au début de la guerre mais s'est justement développé au cours de celle-ci. Un degré de conscience qui allait permettre aux ouvriers de Russie, puis à ceux d'Allemagne, de se lancer dans le combat révolutionnaire. Cette conscience, en revanche, n'existait pas à la fin de la seconde guerre mondiale. Par exemple, les soldats allemands, qui étaient prêts à déserter, y renonçaient dans la mesure où, dans les pays occupés, le chauvinisme était tel parmi les ouvriers, qu'ils risquaient de se faire lyncher par ces derniers. Aujourd'hui, nous ne sommes évidemment pas dans la contre-révolution telle qu'elle existait en 1945, mais la situation présente est également loin de celle de la fin de la première guerre mondiale, sur le plan de la conscience dans la classe ouvrière. C'est pour cela que la guerre du Golfe ne permet pas de réponse immédiate, sur le terrain, de la part du prolétariat. Encore une fois, la réponse de classe de celui-ci se joue essentiellement à l'arrière des combats actuels, dans les grandes métropoles du capitalisme, et se situe fondamentalement à l'échelle historique. Le rôle des révolutionnaires n'est pas, avec un "radicalisme" uniquement verbal, de mettre en avant des "recettes" qui pourraient "tout de suite" arrêter la guerre du Golfe. Il consiste à défendre au sein de l'ensemble du prolétariat mondial une vision claire des enjeux véritables qui sont posés par la guerre du Golfe et des responsabilités qui en découlent pour lui et pour ses luttes.
Et, justement, l'incapacité politique des différents groupes du milieu prolétarien à mettre en avant des mots d'ordre appropriés à la situation présente se retrouve lorsqu'il s'agit de comprendre les véritables enjeux de celle-ci, ces deux faiblesses étant liées, évidemment.
Les incompréhensions des enjeux de la guerre
Comme beaucoup de commentateurs sérieux de la presse bourgeoise, la plupart des groupes ont réussi à mettre en évidence les origines immédiates de l'aventure irakienne : non pas la "folie mégalomane" d'un Saddam Hussein, mais le fait que l'Irak, après 8 ans de guerre terriblement meurtrière et ruineuse contre l'Iran, était pris à la gorge par une situation économique catastrophique et un endettement extérieur de près de 80 milliards de dollars. Comme l'écrit Battaglia Comunista dans son numéro de septembre 1990 : "L'attaque contre le Koweït est donc le geste classique de celui qui, sur le point de se noyer, tente le tout pour le tout". En revanche, les raisons fondamentales du formidable déploiement militaire des Etats-Unis et de ses acolytes passent complètement par dessus la tête de ces mêmes groupes.
Pour Le Prolétaire, en effet : "Les Etats-Unis ont défini sans fard l’'intérêt national américain' qui les faisait agir : garantir un approvisionnement stable et à un prix raisonnable du pétrole produit dans le Golfe : le même intérêt qui les faisait soutenir l'Irak contre l'Iran les fait soutenir maintenant l'Arabie Saoudite et les pétro-monarchies contre l'Irak." (tract déjà cité). C'est la même idée qu'énonce la CWO, elle aussi, dans un tract : "En fait, la crise du Golfe est réellement une crise pour le pétrole et pour qui le contrôle. Sans pétrole bon marché, les profits vont chuter. Les profits du capitalisme occidental sont menacés et c'est pour cette raison et aucune autre que les Etats-Unis préparent un bain de sang au Moyen-Orient...". Quant à Battaglia Comunista, c'est, avec un langage plus prétentieux qu'elle défend la même idée : « Le pétrole, présent directement ou indirectement dans presque tous les cycles productifs, a un poids déterminant dans le procès de formation de la rente monopoliste et, en conséquence, le contrôle de son prix est d'une importance vitale (...) Avec une économie qui donne clairement des signes de récession, une dette publique d'une dimension affolante, un appareil productif en fort déficit de productivité par rapport aux concurrents européens et japonais, les Etats-Unis ne peuvent le moins du monde se permettre en ce moment de perdre le contrôle d'une des variables fondamentales de toute l'économie mondiale : le prix au pétrole. »
A cet argument, qui est également celui de beaucoup de groupes gauchistes qui n'ont qu'une idée en tête : vilipender la rapacité de l'impérialisme américain afin de justifier leur soutien a Saddam Hussein, 77 Programma Comunista apporte un début de réponse : « Dans tout cela, le pétrole (...) n'entre que comme dernier facteur. Dans les grands pays industriels, les réservoirs sont pleins et, dans tous les cas, la majorité de l'OPEP (...) est prête à augmenter la production et ainsi stabiliser les prix du brut ». En fait, 1’argument du pétrole pour expliquer la situation actuelle ne va pas très loin. Même si les Etats-Unis, de même que l'Europe et le Japon, sont évidemment intéressés à pouvoir importer un pétrole à bon marché, cela ne saurait expliquer l'incroyable concentration de moyens militaires opérée par la première puissance mondiale dans la région du Golfe. Une telle opération ne fait que grever encore plus les déficits déjà considérables des Etats-Unis et coûtera bien plus à l'économie de ce pays que l'augmentation du prix du pétrole demandée initialement par l'Irak. D'ailleurs, dès à présent, avec la perspective d'affrontements majeurs, ce prix a grimpe bien au delà du niveau qui aurait pu être établi par des négociations avec ce pays si les États-Unis avaient voulu de telles négociations (ce n'est certainement pas pour faire "respecter" les intérêts du cheikh Jaber et de son peuple que les Etats-Unis font preuve d'une intransigeance totale vis-à-vis de l'occupation du Koweït). Et les destructions qui résulteront de l'affrontement militaire risquent fort d'aggraver encore les choses. Si vraiment c'était le prix du pétrole qui préoccupait fondamentalement les Etats-Unis, on peut dire qu'ils ne s'y prennent pas de la meilleure façon : leur démarche évoquerait plutôt celle d'un éléphant voulant mettre de l'ordre dans un magasin de porcelaine.
En réalité, l'ampleur même du déploiement militaire fait la preuve que l'enjeu, pour les Etats-Unis, comme pour tous les autres pays, va bien au delà d'une question de prix du pétrole. C'est ce que touche du doigt Battaglia Comunista en essayant d'élargir son cadre d'analyse : "La rupture des équilibres issus de la seconde guerre mondiale a, en réalité, ouvert une phase historique dans laquelle nécessairement d'autres devront se constituer accentuant de ce fait la concurrence entre les différents appétits impérialistes (...) une chose est sûre, [quelle que soit l'issue de ce conflit] aucune des questions que la crise du golfe a mises en évidence ne pourra trouver de solution de cette façon". Mais c'était trop lui demander : immédiatement, cette organisation se noie de nouveau dans... le pétrole : "Une fois l'Irak éliminé, pour l'exemple, il ne se passera pas longtemps avant que quelqu'un d'autre ne pose la même question : modifier la répartition de la rente [pétrolière] à l'échelle mondiale : parce que c'est cette répartition qui détermine la hiérarchie internationale que la crise de l'URSS a remise en cause. " C'est là un point de vue original : qui contrôle le pétrole (ou la "rente pétrolière, pour faire plus "marxiste") contrôle la planète : pauvre URSS qui ne le savait pas et dont l'économie, en même temps que la puissance impérialiste, s'est effondrée alors qu'elle était le premier producteur mondial... de pétrole. Quant à Programma, s'il comprend bien qu'il y a autre chose de plus important que le pétrole, il n'arrive pas à dépasser les généralités : "l’enchevêtrement d'un conflit né d'intérêts de puissance colossaux, qui en se résolvant ne pourra qu'en susciter de nouveaux, défaisant et recomposant les alliances...". Comprenne qui pourra. Voila qui n'apporte pas beaucoup de clarté à la classe ouvrière, en tout cas. Il est clair, par contre, que Programma ne comprend pas grand chose, lui non plus.
La sous estimation de la gravite de la situation actuelle
En fin de compte, s'il y a un point commun entre les différentes analyses de la signification de la guerre du Golfe, c'est bien la sous-estimation dramatique de la gravité de la situation dans laquelle se trouve le monde capitaliste aujourd'hui. Tels des montres arrêtées, les groupes prolétariens, même lorsqu'ils parviennent a reconnaître le bouleversement que vient de subir l'arène impérialiste mondiale avec la disparition du bloc russe, sont incapables d'en mesurer la dimension et les implications réelles. Ils ne font que plaquer des schémas du passé à cette nouvelle situation, de la même façon qu'ils se contentent de répéter des mots d'ordre qui, des leur origine, étaient erronés. Nous ne développerons pas ici notre analyse suivant laquelle le capitalisme est entré aujourd'hui dans la phase ultime de sa décadence : celle de la décomposition générale de la société (voir Revue Internationale n°57 et 61). De même, nous ne reviendrons pas en détail sur notre propre prise de position sur la guerre du Golfe (voir éditorial de la Revue internationale n° 63 et 64), ni sur la question du militarisme dans la période actuelle (voir l'article "Militarisme et décomposition" dans ce numéro). Mais c'est notre devoir de dire que le refus des groupes communistes de regarder en race la réalité actuelle dans toute sa gravité (lorsqu'ils ne nient pas, purement et simplement, que le capitalisme est un système décadent, comme le font les bordiguistes) ne saurait leur permettre d'assumer pleinement leur responsabilité face à la classe ouvrière.
La guerre du Moyen-Orient, en effet, n'est pas simplement une guerre comme les autres, face à laquelle il suffit de réaffirmer les positions classiques de l'internationalisme, surtout sous la forme erronée du "défaitisme révolutionnaire". Le formidable déploiement militaire des Etats-Unis ne vise pas uniquement l'Irak, loin de là. La mise au pas de ce pays n'est qu'un prétexte pour "faire un exemple" afin de dissuader toute velléité future, d'où qu'elle vienne, de jouer un jeu qui pourrait déstabiliser 1'"ordre mondial". Cet "ordre" était en parti assuré lorsque le monde était partagé entre deux grands "gendarmes". Si l'antagonisme entre ces derniers alimentait et attisait toute une série de guerres, il contraignait celles-ci, en même temps, à ne pas échapper au contrôle des "superpuissances", et en particulier, à ne pas prendre une extension qui aurait risqué de conduire à une guerre généralisée pour laquelle les pays avancés n'étaient pas prêts du fait du non-embrigadement du prolétariat. Mais l'effondrement complet du bloc de 'Est n'a pu qu'ouvrir la boîte de Pandore de tous les antagonismes impérialistes existant entre les différentes composantes du bloc occidental lui-même, et qui avaient été bridés tant qu'existait la menace du bloc adverse. L'acte de décès du bloc de l'Est constituait donc la condamnation à mort du bloc de l'Ouest. C'est bien ce qu'exprimait le rapt du Koweït par l'Irak, lequel, jusqu'alors, s'était comporté en bon défenseur des intérêts occidentaux contre l'Iran. Cependant, le principal antagonisme impérialiste entre anciens "alliés" du bloc américain ne concerne pas les pays de la périphérie mais bien les pays centraux, c'est-à-dire les puissances économiques que sont les Etats d'Europe occidentale, le Japon et les Etats-Unis eux-mêmes. Si les ex-alliés de cette puissance au sein de feu le bloc occidental, sont bien intéressés à mettre au pas les seconds couteaux du "tiers-monde" lorsqu'ils tentent de sortir de leur rôle, ils sont beaucoup moins intéressés dans une opération de police dont l'objectif principal est d'assurer leur allégeance à cette même puissance. L'intervention militaire des Etats-Unis, même si elle contraint cette fois-ci leurs ex-vassaux à rabattre leurs prétentions, ne pourra mettre un terme définitif aux déchirements impérialistes, puisque ces déchirements font partie de la vie même du capitalisme, et qu'ils ne pourront qu'être encore exacerbés par l'aggravation irréversible de la crise de ce système, son enfoncement irrémédiable dans les convulsions de sa décadence et de sa décomposition. Sans être une guerre mondiale, la guerre du Golfe est donc la première manifestation majeure d'un chaos et d'une barbarie comme jamais la société humaine n'en a connus.
Voilà ce que les organisations révolutionnaires doivent affirmer clairement à leur classe afin que celle-ci puisse prendre pleinement conscience des enjeux de son combat contre le capitalisme. Sinon, elles seront totalement incapables d'assumer la tâche pour laquelle le prolétariat les a faites surgir et elles seront impitoyablement balayées par l'histoire.
FM, 1/11/90.
[1] [164] Pour certaines organisations trotskistes, le langage diffère en fonction du support de leur prise de position : dans leur presse à grande diffusion, leur soutien à l'impérialisme irakien est masqué derrière toutes sortes de contorsions (il ne faut pas choquer le public !), mais dans leur publication "théorique" et leurs réunions publiques, qui s'adressent à un public plus "initié", c'est de façon ouverte qu'ils appellent au soutien de l'Irak. Là encore, les moyens et le but sont bien en accord : comme n'importe quel secteur de la bourgeoisie impliqué dans la guerre, le trotskisme utilise, pour parvenir à ses fins, les "techniques" classiques de dissimulation, de désinformation et de mensonge.
[2] [165] Le silence
dans lequel s'est maintenu jusqu'à présent le Ferment Ouvrier Révolutionnaire
n'en est que plus inacceptable. Apparemment, le FOR est beaucoup plus en verve
lorsqu'il s'agit de faire des procès stupides aux autres organisations
révolutionnaires, en leur faisant dire n'importe quoi (voir son article
"Encore un plat piquant du CCI" dans L'arme de la critique n°
6) qu'au moment où il faut faire entendre la voix internationaliste contre la
barbarie guerrière du capitalisme. Mais peut-être ce silence indique-t-il tout
simplement que le FOR a cessé d'exister comme organisation. Une telle
éventualité ne serait nullement surprenante : lorsqu'une organisation
révolutionnaire continue à affirmer, contre toute évidence, que le capitalisme
n'est pas aujourd'hui en crise, comme l'a toujours fait le FOR, elle perd
toute capacité à contribuer à la prise de conscience du prolétariat et devient
sans objet.
[3] [166] Il faut rendre à César ce qui est à César et à Bordiga la paternité de cette position. En effet, c'est lui qui, au début de la "guerre froide", avait mis en avant que la défaite du bloc impérialiste américain face au bloc russe plus faible, créerait les conditions les plus favorables au développement de la lutte prolétarienne. Cette position était dangereuse et pouvait parfaitement faire le jeu des trotskistes et des staliniens. D'autant plus qu'elle n'avait pas la même stupidité que celle de ses épigones d'aujourd'hui puisqu'elle concernait des adversaires impérialistes d'une force comparable. Parmi ces épigones, on peut signaler également le "Mouvement communiste pour la formation du parti communiste mondial" qui a publié un tract intitulé "Pour arrêter la guerre, il faut arrêter économie". En soi, ce nouveau groupuscule ne représente pas grand-chose, mais son document est significatif des aberrations qui constituent le "patrimoine" du bordiguisme. En effet, outre les "souhaits" classiques en faveur d'une défaite des Etats-Unis, ce texte, en bonne fidélité bordiguiste, reprend à son compte des slogans mis en avant par Lénine au début du siècle tels que "Contre toute oppression des nationalités" et "Contre toute annexion". Aujourd'hui, ces deux slogans peuvent parfaitement convenir à la bourgeoisie et favoriser ses campagnes mystificatrices. Ainsi, c'est au nom de la lutte contre "l'oppression des nationalités" que les prolétaires des différentes républiques de l'URSS sont à l'heure actuelle appelés, et malheureusement avec succès, à abandonner leur terrain de classe pour le terrain pourri du nationalisme sur lequel ils vont s'entre-massacrer. De même, la "lutte contre les annexions" est, en ce moment même, le cheval de bataille de l'ONU, et particulièrement des Etats-Unis, dans leur croisade contre l'Irak.
[4] [167] Dans le document signé en commun par Workers'Voice et Battaglia Communista, l'Irak est considéré, fort justement, comme un pays impérialiste. Il faut constater, cependant, que c'est une première pour la CWO qui, jusqu'à présent, considérait que seules les superpuissances étaient impérialistes. Il est dommage que cette organisation n'ait pas fait part aux lecteurs de sa presse de son changement d'analyse. A moins que la CWO ne conserve encore, malgré tout, sa vieille (et stupide) position. Cela expliquerait la raison du titre ambigu du document signé en commun avec Battaglia, où on fait une différence entre "l'impérialisme occidental et "l'expansionnisme irakien". Décidément, le BIPR et la clarté politique sont toujours aussi fâchés l'un avec l'autre ! Pour sa part, l'opportunisme du BIPR continue à bien se porter. Merci pour lui !
Récent et en cours:
- Guerre en Irak [130]
Courants politiques:
- Gauche Communiste [49]
Questions théoriques:
- Guerre [129]
Milieu politique prolétarien : «Emancipacion Obrera» à la dérive
- 2794 reads
Les convulsions qui secouent actuellement le monde, manifestations de l'entrée du capitalisme dans une phase de décomposition, imposent aux organisations du milieu politique prolétarien une décantation politique plus rigoureuse. La confrontation de leurs prises de position devrait contribuer a cette décantation, permettant une intervention qui soit un facteur de clarification et non de plus grande confusion pour l'ensemble de la classe ouvrière. Malheureusement, il n'en est rien.
L'accélération de l'histoire met en relief la paralysie et le retard des analyses des organisations politiques prolétariennes. Au lieu d'une confrontation de positions sérieuse, nous voyons des accords superficiels, d'occasion, pour quelque «publication commune», dont la seule raison d'être semble un accord tacite pour intensifier les attaques non fondées contre le CCI, parce qu'il est la seule organisation qui essaie d'aller au fond des choses dans les analyses de la situation actuelle, et parce qu'il en appelle à la responsabilité du milieu révolutionnaire. La persistance d'une telle attitude est porteuse du risque que ces organisations restent fixées à des formes d'existence parasitaires. Et si cela constitue un risque pour les organisations qui puisent leurs racines dans des fractions de la gauche communiste, et donc sont capables de se maintenir sur un terrain de classe, le risque est encore plus grand pour les regroupements politiques prolétariens relativement jeunes qui n'ont pas pu - ou pas voulu - s'accrocher au fil des positions historiques de la classe. C'est ce qui arrive au groupe Emancipacion Obrera (Argentine).
Défendre le milieu politique prolétarien, même des attaques des amis
Il y a quelques mois, Emancipacion Obrera (EO) a publié une brochure sous le titre «Nous voulons tout» dans laquelle ce groupe, outre qu'il disperse ses idées sur la lutte de résistance du prolétariat et autres thèmes, donne pesamment dans la calomnie à la mode dans le milieu politique prolétarien, contre le CCI, avec des envolées du style :
«Les mots d'ordre du CCI se réduisent plus ou moins à « pain, paix et travail », mot d'ordre connu de tout le réformisme mondial, du stalinisme, du trotskisme et de tous les "ismes" qui composent la gauche du capital, y compris des secteurs bourgeois qui ne sont pas de gauche».
Ce «plus ou moins» avec lequel commence la citation, est représentatif de l’esprit qui anime toute la brochure : l'esprit de l'ambiguïté dans les prises de position de EO, l'esprit de «jeter la pierre et cacher la main». Ainsi dès l’introduction nous lisons que :
«A côté dépositions qui gardent des ressemblances avec les nôtres, nous avons d'importants désaccords avec des points qu'ils (le CCI) ont en commun avec la gauche du capital (...).». Et : «ce n'est pas parce que le CCI n'est pas exactement identique à nous, mais parce qu'il n'a pas achevé la rupture avec la gauche du capital...».
Ainsi, selon ces camarades, le CCI aurait les mêmes positions que la gauche du capital... sans être exactement des leurs. C'est confus. Cependant la confusion ne vient pas de l'organisation analysée, mais de l'analyste. Il ne peut pas exister en effet une organisation qui soit en même temps bourgeoise et prolétarienne (EO ne parle pas de faiblesses ou de déviations, mais de mots d'ordre et de positions). Donc, ou bien le CCI est une organisation bourgeoise et EO devrait expliquer pourquoi il a maintenu des relations politiques pendant des années avec cette organisation. Ou bien EO a la position opportuniste selon laquelle une organisation prolétarienne pourrait maintenir des liens avec une organisation bourgeoise. Ou le CCI est une organisation prolétarienne et alors EO substitue la calomnie à la critique et au débat.
Mais le CCI n'est pas la seule victime de la confusion. En parlant de Rosa Luxemburg et en particulier de son oeuvre Réforme ou révolution, EO la situe avec le plus grand mépris comme l'exemple le plus pur du réformisme, dont le CCI serait imbibé. EO n'est pas capable de comprendre que précisément l'oeuvre citée constitue un outil fondamental avec lequel l'aile révolutionnaire - dont Rosa était une des principales représentantes - du parti prolétarien de l'époque (la social-démocratie de la fin du 19e siècle au début du 20e siècle) combattait le réformisme.
Ensuite, citant l'oeuvre de Lénine, Explication du projet de Programme, EO suppose qu il traite de «l'exposition la plus traditionnelle du problème (de la conscience), conception sur laquelle se retrouve d'accord la majorité des groupes politiques qui se disent révolutionnaires à l'intérieur et à l'extérieur de la gauche du capital», et, plus loin : «... A côté de choses correctes, on voit ses limites, son point faible. Il ne sort pas de la problématique de la résistance au capitalisme et l'alternative politique en reste à obtenir de l'influence dans le pouvoir d'Etat».
Récemment, EO considérait que des organisations prolétariennes et capitalistes pourraient «s'accorder» sur quelque chose, c'est-à-dire, avoir des positions politiques communes. En plus, la pensée révolutionnaire de Lénine est complètement détournée, la citation critiquée est de fait un commentaire inspiré du premier chapitre du Manifeste Communiste sur «comment s'accroît la force de la classe ouvrière à partir de sa lutte de résistance pour se convertir en lutte pour le pouvoir politique». EO rabaisse Lénine au niveau d'un vulgaire chercheur de poste. Son raisonnement est le même que celui dont il gratifie le CCI.
A propos du CCI : «A côté de positions semblables aux nôtres... des points communs avec la gauche du capital».
A propos de Lénine : «A côté de choses correctes, on voit ses limites.»
Mais la «limite» n'est pas ici le fait de Lénine, mais bien de EO qui se trompe sur l'histoire du mouvement révolutionnaire du prolétariat, la rend confuse, et la dévalorise. Dans une autre partie de la brochure, on peut lire :
«Le mot d'ordre traditionnel (repris par Engels, la social-démocratie, Lénine, Staline, Trotsky, Mao, Fidel, Tito, etc.) selon lequel après la révolution il doit en être "de chacun selon ses possibilités, à chacun selon son travail" s'est révélé être un moyen de perpétuer le capitalisme». Ici EO va jusqu'à établir une ligne de continuité entre les dirigeants du prolétariat comme Engels, Lénine ou Trotsky, et les bourreaux du prolétariat, les chiens sanglants du capital comme Staline, Mao, Fidel ou Tito. C'est tout juste si Marx et Engels sont épargnés par les traits ignorants de ces camarades : «Le même mot d'ordre qui a rendu fameux le Manifeste de Marx et Engels "Prolétaires de tous les pays, unissez-vous" a démontré sa grave (sic) insuffisance».
Ainsi donc, la brochure «Nous voulons tout» est en premier lieu une manifestation du fait qu'EO perd la boussole et n'est pas capable de distinguer clairement les frontières de classe qui séparent une organisation prolétarienne d'une organisation du capital. Et ce, parce qu'elle n'est pas non plus capable de comprendre que les positions révolutionnaires de la classe ouvrière, de même que la forme dans laquelle elles sont exprimées dans l'oeuvre de tel ou tel révolutionnaire, ont une évolution, en même temps qu'une continuité, tout au long de l'histoire du mouvement ouvrier. Continuité des positions de classe auxquelles tout regroupement politique prolétarien doit s'accrocher, s'il ne veut pas se voir ballotté d'un côté à l'autre par l'idéologie bourgeoise, fréquemment présentée sous les dehors d'idées «nouvelles» et «originales». Et attention. La question n'est pas qu'il faut s'incliner devant les révolutionnaires du passé comme s'ils étaient sacrés ou s'ils ne pouvaient pas avoir des insuffisances et commettre des erreurs, ou s'interdire toute critique envers eux ainsi qu'envers les organisations révolutionnaires. La question est que, pour pouvoir entreprendre une critique qui exprime mieux les positions de classe, ou qui leur permette d'avancer, il faut d'abord les comprendre, tout au moins il faut pouvoir les différencier des positions ennemies.
De fait, et sûrement sans s'en rendre compte, EO a apporté sa pierre dans la campagne idéologique que la bourgeoisie mondiale a lancée contre le prolétariat avec le motif de l'effondrement du bloc impérialiste de l'Est, campagne qui identifie la révolution d'octobre avec le capitalisme d'Etat qui s'est instauré après sa défaite, et qui prétend établir une ligne de continuité entre Marx, Lénine et Staline, pour «prouver» que le marxisme conduit au stalinisme.
D'autre part, le silence complice et opportuniste d'autres groupes du milieu envers cette brochure de EO est préoccupant. Enchantés des attaques que EO lance contre le CCI, ils ne se sont pas préoccupés du fait que EO remet en question les frontières de classe qui définissent le milieu politique prolétarien, le marxisme en général. Dans ces conditions, le moins que puisse faire le CCI est de défendre les positions de base de la classe et du milieu politique révolutionnaire, même si, à cette occasion, l'attaque ne provient pas de l'ennemi que nous avons en face de nous, mais des amis.
Luttes de résistance et révolution
Mais quelle est cette «grave insuffisance» qui selon EO provient de Marx et Engels, passe par Rosa Luxemburg et Lénine et arrive jusqu'au CCI ? Quel est ce point sur lequel tous «s'accordent» avec la gauche du capital, «y compris avec des secteurs bourgeois qui ne sont pas de gauche» ? Il s'agit de la position la plus fondamentale, essentielle, du marxisme, avec laquelle les camarades s'embrouillent pendant les 60 pages de leur brochure sans en venir à bout : la position selon laquelle, la lutte de résistance des ouvriers contre les effets de l'exploitation capitaliste conduit dans son développement (dans son extension, unification, approfondissement, sa radicalisation) à la lutte révolutionnaire de la classe ouvrière contre le capitalisme, comme un tout, pour le détruire et construire la société communiste. Et comme cette position se maintient tout au long de l'histoire du mouvement ouvrier et est répétée constamment de multiples façons dans la littérature marxiste - il n'y a qu'à relire le premier chapitre du Manifeste Communiste -, il est naturel que EO finisse par vouloir jeter le marxisme dans le camp bourgeois. Voyons un des paragraphes qui résume sa position. Il se réfère aux luttes pour des augmentations de salaires et dit :
«... c'est une illusion criminelle de croire que l'unification des luttes actuelles (nous sommes dans ces luttes, nous y participons, et c'est pour cela que nous savons ce qu'elles sont) puissent créer la force qui nous permette de détruire le capitalisme et de créer le communisme. Principalement pour quatre raisons :
1) Les luttes actuelles se font en majorité sur un terrain limité, essayer de conserver la force de travail... Bien sûr, il faut les faire, mais il ne faut pas nier leurs limites et pire encore quand elles sont encadrées par des mots d'ordre tels que pain, paix et travail... D'autres sortes de luttes sont aussi nécessaires, d'autres sortes d'orientations, d'objectifs (souligné par EO).
2) Ces luttes en elles-mêmes ne créent pas la force, pas plus que leur unité ne permet de détruire le capitalisme : cela se fait avec un autre type de lutte, et un autre type de méthode (l'insurrection en est un exemple) et, certainement, avec d'autres objectifs.
3) Si l'avant-garde prolétarienne n'est pas organisée en parti... il n'y a pas de possibilité pour que mûrisse une alternative prolétarienne réellement capable de vaincre le capital.
4) Ce parti ne surgit pas spontanément de ces luttes... pas plus qu'il ne peut surgir de façon isolée de la lutte de classe réelle...».
Tout cela se réduit à une contradiction qu'établit EO entre les «luttes actuelles» et les «luttes d'un autre type qui sont nécessaires». EO nie que les luttes de résistance font partie du processus de l'unification de la classe en vue de la révolution, pour ce groupe elles ne font pas partie de la lutte de classe «réelle». Deux questions s'imposent :
Pourquoi EO pense que ces luttes doivent être, «bien sûr», soutenues. Réponse : «nous devons lutter pour ces simples raccommodages parce que nous n'avons pas encore la force pour faire la révolution». Ici est exprimé clairement que pour EO il n'existe pas de relation entre la lutte de résistance et la révolution, et que si on lutte pour ces «raccommodages» c'est parce qu'on ne peut pas faire autre chose. Non parce que cette lutte contribue en quoi que ce soit à la révolution, puisque ce sont deux choses opposées. Ceci est d'une inconséquence totale, puisque si EO considère que les luttes actuelles ne servent qu'à «obtenir des raccommodages» mais à chaque moment affirme qu'on doit «les faire» et qu'ils participent à ces luttes, c'est que ce groupe rabaisse le rôle de l'organisation révolutionnaire à celui d'une oeuvre de charité. En réalité, les révolutionnaires interviennent dans les luttes de résistance parce qu'ils ont la conviction qu'en principe elles constituent un point de départ pour le développement de la lutte révolutionnaire. C'est une autre question que de savoir comment, à partir de ces luttes, avec l'intervention du parti, de la conscience, se développe la lutte révolutionnaire.
Seconde question : quel serait cet autre «type de luttes», cette «lutte de classe réelle» qui créerait la force et l'unité de la classe. Là, la confusion de EO est encore plus grande.
D'un côté ils mentionnent l'insurrection, mais ce n'est pas de cela qu'on parle. Il ne suffit pas de définir le point culminant pour attaquer le pouvoir bourgeois, encore faut-il définir le chemin que le prolétariat doit prendre pour atteindre ce point culminant. L'histoire de la classe ouvrière ne connaît d'autre chemin que celui qui passe par le développement de ses luttes de résistance, de son mouvement de grèves. C'est dans ces luttes qu'il peut forger son unité, sa conscience, ses organisations, qui lui permettent d'aller à l'assaut révolutionnaire.
D'un autre côté, bien qu'on n'ait pas une idée claire, explicite de ce que EO veut dire par la «lutte de classe réelle», qui devrait se substituer aux «luttes actuelles», la brochure y fait allusion. Par exemple, elle se réfère à des émeutes de la faim pour dire : «il est certain que ce sont des réactions sans perspectives (...) mais il y a une composante des luttes que nie le CCI». Ailleurs, par rapport aux réactions de colère des ouvriers (comme bastonner un délégué syndical ou se battre avec la police) contre les abus dont ils sont l'objet de la part des forces du capital dans le travail et la vie quotidienne, ils disent : «Ces petites luttes, font aussi partie de la lutte et en de nombreux cas comportent des caractéristiques très importantes pour la lutte révolutionnaire...»; ou bien, à propos des actions comme dresser des barricades, brûler des voitures qu'on voit dans certaines grèves, ils approuvent : «il est certain que beaucoup d’actions, y compris désespérées, n'ont pas de perspectives et ne se produiraient pas si la classe ouvrière répondait comme une seule personne (...) mais aujourd'hui ce n'est pas la situation et si nous voulons intervenir dans la lutte réelle, nous devons partir des réalités (...)».
Il s'agit là de trois situations différentes :
- de révoltes de masses affamées et désespérées (voir "Les révolutionnaires face aux émeutes de la faim", Revue Internationale n° 63) ;
- de réactions isolées d'ouvriers ;
- de grèves de résistance (qui sont rejetées à certains moments, et ici saluées, pourquoi ?).
Qu'est ce qu'elles ont en commun ? Quelle est cette «composante de lutte très importante», cette «lutte réelle» ? Simplement, la violence désespérée. Selon EO, «Dans la mesure où la nécessité de détruire l'Etat n'apparaît pas intégrée à la façon dont le CCI pose les problèmes, (nous nous référons plus loin à cette question) (...) il est logique qu'ils sous-estiment ou méprisent les moments d affrontements avec les forces de l'ordre capitaliste (...)».
EO s'avance sur une pente glissante. De fait, la violence de classe (qu'on lise bien) est une «composante» de la lutte du prolétariat, et, évidemment non seulement dans l'insurrection pour abattre définitivement le pouvoir bourgeois, mais aussi dans toute la période qui la précède. Déjà les luttes de résistance, pour s’étendre sous le contrôle des ouvriers eux-mêmes, impliquent un affrontement avec l'appareil étatique, avec les syndicats, la police, la justice. Ce à quoi nous nous opposons sans cesse, ce que nous dénonçons dans tous les cas, c'est que les ouvriers s'enferment, ou mieux, soient enfermés par les radicaux petit-bourgeois, les syndicats ou la police, dans des actes de violence désespérés, isoles, minoritaires, qui empêchent ou entravent les tendances à l'unité de la classe, qui impliquent l'affrontement direct avec des organismes de répression pouvant mobiliser et concentrer une force très supérieure à celle d'un quelconque groupe d'ouvriers ou d'une grève isolée. Nous appelons à ne pas tomber dans cette violence désespérée «sans perspectives», qui conduit à des impasses, a des défaites et à la démoralisation de secteurs entiers de la classe ouvrière.
Rien n'est plus stupide et dangereux que de poser la question comme le fait EO : «il est criminel aujourd'hui d'appeler à s'armer de mitraillettes pour défendre un piquet de grève de la police, mais il est aussi criminel de ne pas chercher des moyens d'autodéfense en fonction des forces réelles d'aujourd'hui». Nous avons là, dans son essence, le piège du radicalisme petit bourgeois provocateur : inciter un groupe d'ouvriers à l'affrontement avec la police, mais en leur disant de ne pas utiliser d'armes à feu, sachant que la police peut en faire usage quand elle le veut. L’alternative relative au type de défense que devraient employer les ouvriers dans un piquet de grève est fausse. Les ouvriers se défendent toujours le mieux qu'ils peuvent, il n'y a qu'à se souvenir de la grève des aciéries au Brésil il y a deux ans, où les ouvriers avaient posé des pièges dans les installations de l'usine et inventé avec talent des artifices avec les outils pour affronter l'armée... et pourtant, malgré leur vaillante riposte, ils furent écrasés. La véritable alternative est : ou les ouvriers s'enferment dans leur usine jusqu'à ce qu'ils soient réprimés par une force policière plusieurs fois supérieure, qui aura inévitablement le dessus, ou ils sortent pour chercher la solidarité de classe, l'extension de la lutte, la force de la masse. Bien que ce chemin soit plus difficile et plus long, c'est le seul qui puisse conduire non seulement à l'obtention de revendications et à faire échec à la répression, mais encore est le seul moyen de contribuer à forger l'unité de la classe nécessaire pour renverser le capitalisme. Est-ce que les camarades de EO comprennent maintenant notre position ?
Le dernier point sur les luttes ouvrières. Mêlé à la critique faite au CCI d'appuyer les luttes de résistance, EO utilise l'argument que le CCI met en avant «une unité sans aucune perspective anti-capitaliste et intégrée au capitalisme... qui obligatoirement amène à de nouvelles défaites», «le principal problème du CCI... n'est pas son appui à ces luttes (de résistance) mais sa tentative de les enfermer dans un schéma politique économiciste».
C'est-à-dire, il ne s'agit pas là du «caractère limité des luttes», mais du fait que le CCI essaie de les limiter. Ceci est une accusation réellement grave parce qu'elle identifie le CCI à un instrument de la bourgeoisie, comme les syndicats, dont la fonction est précisément de tenter d'encadrer les luttes et de les mener à la défaite. EO devrait au moins avoir quelque solide argument pour la lancer. Et pourtant, il n en a pas. Cette accusation est soutenue par des phrases des plus floues, faisant référence à ce que le CCI ne parle pas toujours de l'objectif final ou de la lutte armée, du style de «ce thème n'est pas traité avec l'importance qu'il doit avoir»; «quelques textes isolés semblent reconnaître... mais c'est insuffisant» ; «soit dit en passant (oui, camarades, ce que vous dites est toujours dit "en passant"), il semble que le CCI ne défende pas non plus la dictature du prolétariat dans ses tracts».
Que signifie tout cela ? Qu'une fois que EO a perdu de vue la délimitation des frontières de classes, des positions qui séparent une organisation du capital d'une organisation révolutionnaire du prolétariat, elle est amenée à penser qu'une organisation révolutionnaire se juge... a la quantité de fois qu'elle écrit «prendre le pouvoir !», «guerre révolutionnaire !», «nous voulons tout !». C'est regrettable, mais cela nous fait penser au «travail politique dans les masses» que prône le gauchisme petit bourgeois le plus radical : balancer des tracts et couvrir les murs de mots d'ordre aussi ultraradicaux et ultra-révolutionnaires... que vides de contenu. Où va donc le groupe EO?
Emancipacion Obrera à la dérive
Il y a maintenant plus de quatre ans que nous avons établi des relations politiques avec EO, avec la publication dans les pages de cette revue de sa «Proposition internationale» et d'un début de correspondance (Revue Internationale n°46 et 49, 1986-87). A cette époque, nous avons salué la préoccupation et l'effort des camarades de contribuer à l'unification des forces révolutionnaires dans le monde. Pourtant, nous ne nous sommes pas privés de signaler ce qui, de notre point de vue, constituait les faiblesses de ce regroupement. En particulier, nous l'avons prévenu contre l'idée que le critère pour «reconnaître» les groupes révolutionnaires pourrait être «la pratique» sans plus. Nous disions que :
«Une "pratique" séparée de tout fondement politique, de toute orientation, de tout cadre de principes, n'est qu'une pratique suspendue en l'air, un immédiatisme borné, mais ne saurait jamais être une activité vraiment révolutionnaire. Toute séparation entre théorie et pratique optant soit pour la théorie sans pratique, soit pour la pratique sans théorie, détruit l'unité des luttes immédiates et du but historique». (Revue Internationale n° 49)
Ainsi nous signalions l'urgente nécessité, encore plus grande pour les groupes «jeunes», face à la rupture organique de plus de cinquante ans, produit de la défaite de la vague révolutionnaire du début de ce siècle, de s'efforcer de «tenter de rétablir la continuité historique et politique du mouvement», (id.) Nous l'avons alerté à l'époque du danger de tomber dans l'attitude de certains groupes à qui «il paraît plus avantageux de rester dans l'ignorance et même d'effacer purement et simplement le passé et de considérer que l'histoire de la lutte des classes commence avec eux... dans leur volonté d'effacer le passé, se considérant être sortis du néant, ils se condamnent à n'être que du néant», (id.) Ce qui à cette époque apparaissait comme des «faiblesses» passagères d un corps jeune, tend aujourd’hui à se convertir en maladie chronique : le mépris pour la théorie, la négation de la continuité historique du mouvement ouvrier. Et que nous offre EO en échange ? Peu, réellement peu.
Ainsi, le problème de la conscience de classe, apparaît à EO comme un «noeud gordien» qu'ils ne tentent pas de dénouer, mais qu'ils préfèrent «trancher d'un coup de hache» (p. 50 de «Nous voulons tout»). Pour EO, le débat de deux siècles dans le mouvement ouvrier est «résolu» sans grande difficulté. Pour eux, nul besoin de marxisme, ils ont simplement besoin... d'un dictionnaire :
«Si nous y prêtons réellement attention (EO nous fait la leçon), en réalité le spontané non seulement n'est pas l'inconscient mais suppose que ce qu'on fait spontanément, on le fasse volontairement... du dictionnaire, "spontané" : volontaire et de son propre mouvement"
(...)». Et de ce jeu sur les mots infantile, EO tire la conclusion : «au spontané ne s'oppose pas le conscient, mais l'organisé... et notre tâche fondamentale n'est pas que les ouvriers prennent conscience, mais de prendre part à leurs prises de position, à ce qu'il prennent parti», et plus loin : «la tâche du parti (...) n'est pas de "développer la conscience" ou qu'il y ait prise de conscience, mais qu'il y ait prise de parti (...)", "la tâche du parti est de défendre une position, un parti (sic)» : «la situation du prolétariat ne trouvera pas de solution quand les ouvriers "prendront conscience" qu'ils sont exploités, ou que la bourgeoisie est l'ennemi, que le capitalisme est une merde ! Combiens d'ouvriers et d'ouvrières le savent déjà sans l'aide des "révolutionnaires" ? Est-ce que cela change la réalité de cette situation? (...) la question est en premier lieu la position, le parti qu 'ils prennent (...)»
Nous posons la question : pourquoi personne n'a eu avant l'idée de regarder un dictionnaire, où il est clairement dit que le spontané et le volontaire sont identiques, ce qui supprime le problème de la spontanéité ? Est-ce parce que jusqu'à présent personne ne s'est rendu compte du «nombre d’ouvriers qui ont déjà pris conscience sans que cela change la réalité», fait qui anéantit le problème de la conscience ? Pourquoi, avoir construit tant de partis sans que jusqu'à maintenant personne ne se soit rendu compte que la tâche du Parti était - comme son nom l'indique - de «faire que la classe prenne parti» ? Peut-on prendre au sérieux les balivernes que nous sert aujourd'hui EO, après nous avoir fait découvrir les «graves insuffisances» du marxisme ?
Si nous prenons au sérieux EO, nous pourrions essayer d'expliquer que le problème de la conscience n'est pas un problème de définition du dictionnaire, mais la question fondamentale de la lutte du prolétariat ; la lutte pour la conscience de classe, qui est aussi la lutte pour briser et dépasser l'idéologie bourgeoise, n'est que l'expression de la lutte de classe du prolétariat pour faire prévaloir ses objectifs historiques en mettant à bas la société dominante. Nous pourrions aussi essayer d'expliquer que la conscience de classe n'est pas ce que chaque ouvrier «sait» ou croit savoir, mais ce que la classe ouvrière est appelé historiquement à réaliser. Que la conscience de classe ne peut être séparée de la pratique, c'est-à-dire que la conscience du prolétariat s'exprime en tant que lutte révolutionnaire. Nous pourrions aussi tenter de définir le cadre du débat dans le camp révolutionnaire sur la question de la conscience de classe : est-ce que ce sont les masses qui atteignent cette conscience ou seulement l'avant-garde, et en fonction de la position adoptée, les différentes organisations ont un certain type d'intervention et d'orientation au sein de la classe... Mais est que cela servirait à quelque chose pour EO ?
Certainement, dans la position de EO on peut reconnaître une certaine influence du courant bordiguiste, qui considère que la conscience à laquelle parviennent les masses est limitée à la reconnaissance du parti révolutionnaire, à leur capacité de «parti pris» dont parle EO, et que le parti est dépositaire de la conscience de classe globale. Pourtant, cette ressemblance s'arrête là. EO suit une toute autre route. Ses considérations sur les «insuffisances» des positions marxistes sont un rejet des luttes de résistance à cause de leurs «limites» ; sa préoccupation de rencontrer une lutte de classes réelle» ; ses difficultés à distinguer les frontières de classe ; son insistance sur une phraséologie «radicale» ; son idée que la classe a déjà pris conscience et qu'il lui reste seulement à se donner un parti, etc. ; tout cela n'est pas l'expression d'une position politique ferme, cohérente mais d'un désespoir. Désespoir parce qu'il n'existe pas de parti, parce que la révolution n'est pas encore immédiatement réalisable. Le titre même de la brochure, «Nous voulons tout» en est l'expression. Comme s'il suffisait de publier des millions de petits papiers, avec la même consigne «nous voulons tout, prenons tout», pour que l'insurrection ait lieu.
Le désespoir n'est pas l'essence de l'organisation révolutionnaire, qui est d'être capable de saisir, au moins dans ses grandes lignes, le cours historique de la lutte de classe, ce qui lui donne de l'assurance et de la patience. Le désespoir est propre au radicalisme petit bourgeois et EO dérive malheureusement dans ce sens. Nous considérons comme étant de notre devoir d'alerter les camarades d'EO de ce risque, de les appeler à réagir contre des tendances radicaloïdes, plus évidentes à chaque nouvelle publication. Quant aux groupes du milieu politique prolétarien, et particulièrement ceux qui aujourd'hui maintiennent des relations étroites avec EO, nous les appelons à assumer leurs responsabilités et de débattre avec EO de ses faiblesses... l'attitude de «laisser passer» sous le prétexte d'un accord occasionnel est de d'opportunisme : la gangrène des organisations révolutionnaires.
Ldo, octobre 1990
Courants politiques:
Heritage de la Gauche Communiste:
Polémique avec Battaglia Comunista : le rapport fraction-parti dans la tradition marxiste (3° partie - I. De Marx à la 2e Internationale)
- 3189 reads
Troisième partie : de Marx à Lénine, 1848-1917 I. De Marx à la 2e Internationale
L'accélération actuelle de l'histoire, pleinement rentrée dans la phase de décomposition du capitalisme, pose de façon aiguë la nécessité de la révolution prolétarienne, comme seule issue à la barbarie du capitalisme en crise. L'histoire nous a enseigné qu'une telle révolution ne peut triompher que si la classe réussit à s'organiser de manière autonome par rapport aux autres classes (conseils ouvriers) et à sécréter l'avant-garde qui la guide vers la victoire : le parti de classe. Cependant, aujourd'hui, ce parti n'existe pas, et Beaucoup baissent les bras parce que face aux tâches gigantesques qui nous attendent, l'activité des petits groupes révolutionnaires existants paraît dénuée de sens. Au sein même du camp révolutionnaire, la majorité des groupes réagit à l'absence de parti en répétant à l'infini son très Saint Nom, invoqué comme le deus ex machina capable, grâce à sa seule évocation, de résoudre tous les problèmes de la classe. La désimplication individuelle et l'engagement déclamatoire sont deux manières classiques de fuir la lutte pour le parti, lutte qui se mène ici, aujourd'hui, en continuité avec l'activité des fractions de gauche qui se sont séparées dans les années 1920 de l'Internationale Communiste dégénérescente.
Dans les deux premières parties de ce travail, nous avons analysé l'activité de la Gauche Communiste Italienne, organisée en fraction dans les années 1930-40, et la fondation prématurée d'un Parti Communiste Internationaliste, complètement artificiel, par des camarades de Battaglia Comunista en 1942 ([1] [171]). Dans cette troisième partie, nous montrerons que la méthode de travail de fraction, dans les périodes défavorables, où il n'était pas possible qu'existe un parti de classe, a été la seule méthode employée par Marx lui môme. Nous montrerons en plus qu'une telle méthode marxiste de travail pour le parti a trouvé sa définition essentielle grâce à la lutte tenace de la Fraction Bolchevique des socio-démocrates russes. Contre tous ceux qui se gargarisent des éloges du parti de fer de Lénine et d'ironie envers «les petits groupuscules des fractions de gauche», nous répétons que «l'histoire des fractions est l’histoire de Lénine» ([2] [172]) et que ce n'est que sur la base du travail qu'elles ont accompli qu'il sera possible de reconstruire le Parti Communiste Mondial de demain.
Dans l'article, que nous avons déjà largement cité dans les parties précédentes de ce travail, les camarades de Battaglia Comunista, après avoir critiqué l'oeuvre de la Fraction de Gauche du PCI dans les années qui vont de 1935 à 1945, concluent leur présentation avec une condamnation sans appel du concept de fraction en général :
«Quel sens cela a-t-il de ne lier exclusivement la notion de parti qu'au concept de pouvoir ou de possibilité de guider de grandes masses, en déniant à l'organe politique de la lutte de classe toute possibilité d'existence si ce n'est dans les phases révolutionnaires, en déléguant à des organismes jamais bien définis ou à des succédanés la tâche de défendre les intérêts de classe dans les phases contre-révolutionnaires. (...)
Soutenir que le parti ne peut que surgir de façon correspondante aux situations révolutionnaires dans lesquelles la question du pouvoir est à l’ordre du jour, alors que dans les phases contre-révolutionnaires le parti "doit" disparaître ou laisser la place aux fractions, signifie non seulement priver la classe, dans les moments les plus dangereux et les plus difficiles, d'un minimum de référence politique, ce qui finit par favoriser le jeu conservateur de la bourgeoisie, mais aussi créer de propos délibéré .des vides qui peuvent difficilement être colmatés dans l'espace de 24heures. (...)
Il ne faut pas soutenir de telles thèses mettant sens dessus dessous l'expérience historique en attribuant au parti bolchevique lui même le rôle de "fraction" de la social-démocratie russe jusqu'en 17 (thèses soutenues par le CCI dans la Revue Internationale N° 3). (...)
La Russie a été l'unique pays européen, impliqué dans la crise guerrière de 1914-18 dans lequel, malgré des conditions plus défavorables qu'ailleurs, s'est manifestée une révolution prolétarienne, justement parce qu'il y avait un parti qui oeuvrait en tant que tel, au moins à partir de 1912. Le bolchevisme, dès ses origines ne s'est pas limité à combattre sur le plan politique l'opportunisme des mencheviques, à élaborer théoriquement les principes de la révolution, à former des cadres et à faire du prosélytisme, mais il a tissé ces premiers liens entre le parti et la classe, destinés à devenir plus tard, dans le feu d'une situation montante, de véritables canaux collecteurs entre la spontanéité de la classe et le programme tactique et stratégique du parti. (...)
En 1902 déjà, Lénine avait jeté les bases tactiques et organisationnelles sur lesquelles avait dû se construire l'alternative à l'opportunisme de la social-démocratie russe, alternative de parti, à moins qu'on ne veuille faire passer le "Que Faire ?" pour les dix commandements du bon fractionniste». ([3] [173])
Pour résumer, selon les camarades de BC :
1) on ne sait pas d'où sort la théorie selon laquelle, dans les périodes contre-révolutionnaires, les fractions devraient se substituer aux partis ;
2) ces fractions sont des «organismes jamais bien définis», et donc incapables de donner une orientation
|
Ç |
olitique au prolétariat ; ) si la révolution russe s'est faite, c'est parce que Lénine, dès 1902, avait jeté les bases du parti bolchevique, et non de la fraction bolchevique comme le soutient au contraire le CCI.
Trois affirmations, trois fissures dans la cohérence théorico-politique de Battaglia, et un beau trois en histoire du mouvement ouvrier. Voyons pourquoi.
Marx, la ligue des communistes, l'A.I.T., et les leçons de la contre-révolution
«Je te ferai d'abord observer qu'après que, sur ma demande, la Ligue a été dissoute en novembre 1852, je n'ai appartenu ni n'appartiens, à aucune organisation, secrète ou publique ; autrement dit, le parti, dans le sens tout à fait éphémère du terme a cessé d'exister pour moi depuis huit ans. (...) A la suite de quoi, j'ai été attaqué à plusieurs reprises, sinon ouvertement, du moins de façon compréhensible, à cause de mon "inactivité". (...) En conséquence, du parti tel que tu m'en parles, dans ta lettre, Je ne sais plus rien depuis 1852. (...) La Ligue, aussi bien que la Société des Saisons de Paris et cent autres organisations n'ont été qu'un épisode dans l'histoire du parti qui naît spontanément du sol de la société moderne. (...) En outre, j'ai essayé d'écarter ce malentendu qui ferait comprendre par "parti" une Ligue morte depuis huit ans ou une rédaction de journal dissoute depuis douze ans. Quand Je parle cependant de parti, j'entends le terme Parti dans son sens historique le plus large.» (Marx à Freiligrath, 1860).
Comme on le voit, la même théorie selon laquelle les partis prolétariens "disparaissent" dans les phases contre-révolutionnaires n'est pas un apport des camarades de Bilan dans les années 1930 de ce siècle, mais une ferme conviction de Marx depuis la moitié du siècle dernier déjà. En répondant à l’ex-militant de la Ligue des Communistes, Ferdinand Freiligrath, qui l'invitait à reprendre la direction du "parti", Marx précise que ce parti s'est dissout huit ans avant, à la fin de la vague révolutionnaire qui avait débuté en 1848, comme s'était dissoute auparavant la Société des Saisons des ouvriers parisiens et d'autres organisations, une fois fini le cycle de luttes dont elles étaient l'expression. Il est clair que cette attitude profondément matérialiste, Marx l'a toujours eue contre les préjugés activistes de ceux qui ne voulaient pas accepter de reconnaître la profondeur de la défaite et qui voulaient immédiatement «recommencer comme avant». Lorsqu'en 1850, Marx déclara que la reprise économique mondiale éloignait toute perspective révolutionnaire en Europe, la majorité des militants de la Ligue (fraction de Willich-Schapper) s'opposa à lui en dénonçant sa tentative de «renvoyer dormir tout le monde». Il n'y eut qu'une minorité pour lui rester fidèle, et -même après la dissolution formelle de la Ligue en 1852 pour se dédier à la tâche difficile de «tirer les leçons de la défaite», en en comprenant les causes et en forgeant les instruments théoriques qui serviraient au prolétariat dans les prochaines vagues de lutte. Il est important de souligner que les camarades qui voulaient à tout prix maintenir la Ligue en vie ont d'abord été contraints de revenir sur les positions politiques, en se laissant aller aux intrigues, aux alliances artificielles avec les démocrates, pour se dissoudre ensuite eux aussi, mais sans rien laisser derrière eux, sinon les feux d'artifice de l'activisme pour le maintien du parti. Au contraire, le patient travail de clarification et de formation des révolutionnaires mené par la fraction liée à Marx devait donner «ses fruits avec la reprise du mouvement» ouvrier : les quelques révolutionnaires marxistes se trouveront tout naturellement à la tête des différentes sections de l'Association Internationale des Travailleurs, quand celle-ci se formera en 1864 (en se développant «spontanément du sol de la société moderne»), en même temps que s'effectue la reprise internationale du mouvement ouvrier. La position de Marx ne change pas, quand en 1871, la défaite de la Commune de Paris ouvre la voie à une nouvelle période de reflux du mouvement ouvrier. Dans ces conditions, Marx et Engels comprirent aussitôt que les jours de l'AIT étaient comptés et, au congrès de La Haye en 1872, ils feront voter le transfert du Conseil Général à New York, ce qui revenait à dissoudre l'organisation : «étant donné les conditions actuelles de l'Europe, il est absolument utile, à mon avis, de faire passer à l'arrière-plan pour le moment l'organisation formelle de l'Internationale. (...) Les événements de l'inévitable involution et évolution des choses pourvoiront d'eux-mêmes à une résurrection de l'Internationale sous une forme plus parfaite. En attendant, il suffit de ne pas laisser glisser entièrement de nos mains les meilleurs éléments dans les divers pays (...)». (Marx à Sorge, 1873). Encore une fois, pour Marx et Engels, maintenir en vie artificiellement une façade de parti en période contre-révolutionnaire est absolument inutile, alors qu'il est fondamental que se poursuive l'activité collective de cette fraction de militants capables de résister à la démoralisation et de préparer la reprise future «sous une forme plus parfaite».
Pour consoler les camarades de BC, terrorisés par la possibilité que quelqu'un puisse "décider" que le parti, à un certain moment, "doit" disparaître, il faut souligner que Marx et Engels n'ont jamais pensé prendre de telles "décisions". "Décider" de dissoudre le parti est un acte volontariste, exactement comme décider de le maintenir artificiellement. Marx n'a pas dissout autoritairement la Ligue en 1850, pas plus que PAIT en 1872. Il a simplement expliqué que les révolutionnaires doivent se préparer à affronter la prochaine désagrégation de ces partis, en s'organisant pour maintenir même en leur absence le fil rouge de l'activité communiste. Si la dissolution de ces organes s'est effectivement vérifiée ensuite, dans tous les cas, selon les prévisions de Marx, c'était dû à la force même des choses, et pas à la force des ordres de Marx.
La dialectique fraction-parti se précise au cours du développement historique du mouvement ouvrier
Maintenant que nous avons clarifié que "l'étrange" théorie sur la disparition des partis prolétariens en périodes contre-révolutionnaires a été développée par Marx lui-même, occupons-nous donc de ces organes qui, dans ces périodes, assurent la continuité de 1’activité révolutionnaire, c'est-à-dire les fractions. Selon Battaglia, il s'agit d'«organismes jamais bien définis». Il est certainement tout à fait vrai que Marx n'a jamais écrit un bel ouvrage propagandiste (du style "Travail salarié et capital") sur la fonction du réseau de camarades, qui étaient restés autour de lui, après la dissolution de la Ligue et de l’AIT. Mais cela ne veut pas dire que, pour Marx, ce travail de bilan était peu important. Cela est dû au fait que la notion de fraction du parti de classe est, de par sa nature, liée à la notion même de parti. La définition de ses contours va donc de pair avec le processus historique, qui va de la Ligue clés Communistes, qui «marchera avec une fraction de la bourgeoisie», à l'Internationale Communiste qui «se donne pour tâche historique celle de réaliser la révolution dans le monde entier» ([4] [174]).
C'est au fur et à mesure, dans l'expérience historique de la classe, que se précisent les contours de son parti d'avant-garde, que s'accumulent parallèlement les matériaux nécessaires à la définition du travail de la fraction marxiste, qui apparaît en réaction aux déviations opportunistes du parti. Ce n'est que lorsque le capitalisme rentre dans sa phase finale, que la nécessite et la possibilité de la révolution communiste est enfin à l'ordre du jour, que le parti de classe peut se développer sous sa forme achevée, devenant par la même capable de sécréter des vraies fractions, en réaction a un cours à l'opportunisme et à la dégénérescence. La Gauche Italienne avait tiré cette leçon des années 1930 :
«Le problème de la fraction - ainsi que nous le concevons - c'est-à-dire comme un moment de la reconstruction du parti de classe ne fut ni ne pouvait être conçu au sein de la Première et de la Deuxième Internationales. Celles qui s'appelèrent alors "fraction" ou plus communément "aile droite" ou "aile gauche", ou "courant intransigeant", ou courant "transigeant", ou, enfin, "révolutionnaire" et "réformiste" ne furent - dans la plus grande partie des cas, à l'exception des bolcheviks- que des ententes fortuites à la veille ou au cours des congrès, dans le but de faire prévaloir certains ordres du jour sans aucune continuité organisationnelle, en une phase où le problème de la prise du pouvoir n'étant pas posé, il ne pouvait exister un parti de classe ([5] [175]). L'écroulement de la Deuxième Internationale, lors de l'éclatement du conflit mondial, ne peut être considéré comme une trahison brusque, mais comme la conclusion de toute une courbe qui ta conduisait au terme de son évolution. La notion exacte de la tâche d'une fraction ne peut être que le corollaire de la notion exacte du parti de classe. » ([6] [176]).
Le processus de maturation et de définition du concept de fraction trouve donc son origine (mais pas sa conclusion) dans ce premier réseau de camarades lui avaient survécu à la dissolution de la Ligue des Communistes. Puisque comprendre d'où nous sommes partis est toujours indispensable pour comprendre où nous allons, nous allons chercher à analyser en profondeur l'activité de cette première " fraction.
Certaines phrases de la lettre à Freiligrath, ou d'autres citations isolées de la correspondance privée de Marx et Engels, ont souvent été utilisées pour démontrer que ces camarades se seraient retirés dans leurs vies privées, s'adonnant à leurs études théoriques, que, par la suite, ils auraient mis à la disposition des masses désireuses d'apprendre. La réalité est complètement différente.
Engels le clarifie aussitôt : «Pour l'heure, l'essentiel c'est que nous ayons la possibilité de nous faire imprimer, soit dans une revue trimestrielle dans laquelle nous attaquerons directement et où nous assurerons nos positions face aux personnes, soit dans de gros ouvrages où nous pourrons faire la même chose sans même avoir à mentionner l'un quelconque de ces cafards. L'une comme l'autre de ces solutions me convient ; encore qu'il me semble que si la réaction tend à se renforcer, la première éventualité s'avérera moins sûre à ta longue, et la seconde constituera de plus en plus la seule ressource sur laquelle nous devrons nous rabattre.» (Engels à Marx, 1851). Marx le réaffirme : «Je lui ai dit que nous ne pouvions collaborer directement à aucun petit journal, pas même à un journal de parti ([7] [177]), à moins qu'il ne soit rédigé par nous-mêmes. Mais qu'en ce moment, il manquait toutes les conditions nécessaires pour atteindre un tel but.» (Marx à Engels, 1959).
Ce n'est pas du tout se retirer dans la vie privée, c'est autre chose que de «s'adonner aux études» en attendant de revenir à une action militante. «L'essentiel» pour Marx et Engels, le but auquel ils consacrent tous leurs moyens, c'était la publication la plus régulière possible d'une presse révolutionnaire pour défendre et approfondir publiquement la perspective du communisme et la critique de la société capitaliste. Ce qu'ils ont réfuté, ce n'est pas cette activité organisée et formalisée, mais le recours fallacieux pour la rendre possible, à une collaboration avec des éléments confus et activistes, qui auraient rendu leur travail complètement inutile. S'ils n'ont pu maintenir un cadre d'activité aussi formellement organisé, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas essayé, mais parce qu’il « manquait toutes les conditions nécessaires pour atteindre un tel but». Et ces conditions manquaient parce que le développement du mouvement ouvrier était encore tellement faible que, dans les phases de reflux, il ne permettait pas même l'existence d'un petit groupe révolutionnaire organisé. Encore une fois, personne ne décide que le parti "doit" disparaître, que la fraction "doit" se limiter à un réseau informel de camarades. Ce sont les conditions objectives des affrontements de classe qui le déterminent, les camarades ne peuvent que décider s'ils reconnaissent cette réalité et s organisent en conséquence, ou au contraire, s'ils ferment les yeux et s'abusent eux-mêmes et les autres avec, les miroirs aux alouettes qui font que, de l'organe de classe, il ne reste que le nom et l'apparence. En réalité, il n'y a que ceux qui ne s'amusent pas dans des Comités Centraux qui flottent dans le vide, qui jouent un rôle de "parti" dans les phases contre-révolutionnaires : le petit groupe informel de camarades regroupés autour de Marx travaillait de manière tellement continue et collective qu'on se référait communément à lui dans le milieu révolutionnaire comme au «parti Marx», à tel point que ce dernier fut obligé de préciser dans sa lettre à Freiligrath que ce parti n'existait pas. Marx précise que, quand il parle d'activité de parti, il l'entend «dans te sens historique le plus large» du terme, comme activité «de parti», qui tend à assurer la continuité politique entre les différents partis. Les croupes de camarades qui ont assuré cette continuité, après la dissolution de la Ligue et de l’AIT -par delà leur nature informelle -, peuvent être considérés comme des fractions sous tous les aspects, parce qu'il ne s'agit pas de nouveaux regroupements, mais de véritables fractions des vieux partis. Le «parti Marx» des années 1853-1863 n'est rien d'autre que la «fraction Marx» des années 1850-1852 au sein de la Ligue. Les «camarades les plus capables des différents pays» dans la période qui va de la dissolution de l'AIT à la naissance de la 2e Internationale, ne sont rien d'autre que la vieille fraction marxiste «autoritaire» au sein de l'AIT. Les fractions, quelle que soit la façon dont elles se définissent et s'organisent en fonction de la maturité des temps, représentent donc la continuité historique entre les différents épisodes de l'histoire du parti.
Le problème de la fraction dans la 2e internationale
La simple affirmation du fait que Lénine - chef de la fraction bolchevique du Parti Ouvrier Social-démocrate Russe - a quelque chose à voir avec les fractions, provoque le mépris de Battaglia, pour qui Lénine est l'homme du parti, un point c'est tout. Selon BC, c'est parce qu'il existait un parti bolchevique -et pas une quelconque fraction «mal définie» - que la révolution a pu vaincre en Russie.
Avant de démontrer l'énième falsification historique de BC, il convient de rappeler le cadre historique dans lequel s'est développée l'action des bolcheviks et de la gauche socialiste en général, à l'intérieur de la 2e Internationale. Celle-ci a été fondée dans une période historique difficile pour les révolutionnaires : d'un côté, dans toute l'Europe se termine la phase dans laquelle le prolétariat pouvait s'inscrire de façon autonome dans les révolutions démocratiques bourgeoises (qui étaient désormais menées à bien «par le haut», voir Bismark en Allemagne) ; de l'autre, les conditions pour mettre la révolution prolétarienne à l'ordre du jour n'existaient pas encore, étant donné que le capitalisme se trouvait en plein dans sa dernière et plus impétueuse phase de développement économique. Dans ces conditions, Marx (et Engels après la mort de ce dernier) considérait l'existence d une puissante aile opportuniste dans les partis social-démocrates comme un «fait inévitable». Il recommandait donc aux composantes marxistes d'éviter des scissions prématurées, pour se concentrer sur la défense politique intransigeante des positions de classe au sein du parti, en attendant que se rapproche une crise révolutionnaire qui conduirait «automatiquement» à la scission et au surgissement de véritables partis marxistes ([8] [178]).
Les révolutionnaires doivent être les défenseurs les plus résolus de l'unité du parti, renonçant momentanément à former des courants bien définis organisationnellement, ce qui les aurait exposés au risque d'expulsion et en conséquence, de transformation en secte détachée du mouvement réel. Dans cette situation, il s'agissait de la seule ligne d'action adéquate, et, dans les faits, elle a réussi à recueillir plus d'un succès (approbation du programme marxiste d'Erfurt en 1881). Cependant, la prolongation pendant des décennies de la phase de développement économique et de paix sociale posait de plus en plus comme un «fait inévitable» non seulement l'existence de l'aile opportuniste, mais aussi qu'elle s'infiltre dans la majorité du parti, ce qui rendait problématique sa capacité à s’auto-épurer face à une situation prérévolutionnaire. Au début de ce siècle commençait à se poser pour les marxistes la question de réagir à cette involution, en passant de la défense du marxisme «en ordre dispersé» à une action plus coordonnée au sein du parti. Il s'agissait cependant d'un passage extrêmement difficile, parce que le mythe de l'unité avant tout était profondément enraciné dans les fondements mêmes du parti, et que les directions du parti avaient beau jeu de présenter les radicaux comme les diviseurs du parti unitaire.
En 1909, la tentative de militants de gauche hollandais de s'organiser en tendance autour d'un organe, Die Tribune, fut brisée dans l'oeuf, par une expulsion en bloc, ce qui les obligea à se constituer momentanément en mini-parti, qui ne tarda pas à reproduire en petit les vices du parti d'origine ([9] [179]).
L'unique exception, comme le rappelaient les citations déjà faites de Bilan n° 24, ce furent les bolcheviks russes qui s'organisèrent en fraction autonome du POSDR à partir de 1904. On pourrait s'étonner que les premiers à bouger aient été ces attardés de russes, mais l'explication de leur rôle d'avant-garde vient justement des conditions particulières de l'empire russe (qui s'étendait alors de la Sibérie à la Pologne). Dans cette zone immense et dans les premières années de ce siècle, cette révolution démocratique bourgeoise, qui était déjà largement achevée en Europe, était encore à l'ordre du jour. De plus, le développement tardif de la bourgeoisie russe 1’avait empêchée de jouer un rôle d'avant-garde dans la révolution démocratique, en même temps que le caractère super-arriéré du tsarisme russe l'empêchait de réaliser la révolution «par le haut» comme Bismarck l'avait fait en Allemagne. Le prolétariat russe n'était donc pas destiné à saisir la dernière chance historique de s inscrire de manière autonome dans une révolution bourgeoise.
Mais, comme nous l'avons vu, Engels avait déjà prévu que le rapprochement d'une crise révolutionnaire mettrait à l'ordre du jour la séparation organisationnelle entre les marxistes et les opportunistes. Le mûrissement d'une situation révolutionnaire dans les territoires tsaristes a pleinement confirmé les prévisions d'Engels, en rendant toujours plus difficile la cohabitation entre les marxistes révolutionnaires et les opportunistes, qui, dans la logique même des choses, étaient enclins à faire des compromis non seulement avec les démocrates, mais avec la réaction même. En Pologne, les révolutionnaires conduits par Rosa Luxemburg avaient déjà résolu le problème en 1894, en créant un nouveau petit parti, le SDCP, en opposition au vieux parti socialiste, le PPS, profondément infecté par le nationalisme. De cette façon, Rosa Luxembourg eut aussitôt les mains libres, mais elle n'eut jamais la possibilité de faire l'expérience d'une lutte de fraction pour défendre un parti menacé de dégénérescence. C'est pour cela qu'elle n'a jamais réussi à développer et comprendre vraiment le concept de fraction. C'est une faiblesse qui sera chèrement payée pendant la lutte héroïque des spartakistes contre la dégénérescence du SPD allemand, et 3ui sera en grande partie responsable du retard fatal dans la constitution du nouveau parti communiste allemand en 1918.
Au contraire, toute la bataille que mènera Lénine pendant plus de dix ans, se déroulera à l'intérieur du parti, lui permettant de développer et d'élaborer la notion politique de fraction de gauche, posant ainsi les bases de la 3e Internationale.
Beyle
[1] [180] Les deux premières parties ont été publiées dans les Revue Internationale n° 59 et 61. Pour une analyse approfondie de l'activité de la Gauche Communiste Italienne, il est recommandé de lire nos deux volumes : "La Gauche Communiste d'Italie, 1927-1952" et "La GCI et l'Opposition Internationale de Gauche".
[2] [181] Intervention de Bordiga au 6e Comité exécutif élargi de l'Internationale Communiste, en 1926.
[3] [182] "Fraction et parti dans l'expérience de la Gauche italienne", in Prometeo n° 2, mars 1979.
[4] [183] "Vers l'Internationale 2 et 3/4 ?", in Bilan n° 1, novembre 1933.
[5] [184] On doit évidemment comprendre qu'il ne pouvait exister un parti de classe pleinement développé. La Ligue et l'AIT ont toutes deux été des partis de classe, complètement adéquats à ce niveau de développement du mouvement de la classe ouvrière. (Note du CCI).
[6] [185] ' Le problème des fractions dans la 2e Internationale", in Bilan n°24, 1935.
[7] [186] Marx entend car là un journal authentiquement socialiste. L'usage indifférencié du mot 'parti" montre clairement qu'on en était encore aux premiers pas de la définition historique delà structure et de la fonction du parti de classe.
[8] [187] Pour la tactique de Marx et Engels dans cette période, voir en particulier leur correspondance avec les dirigeants du parti allemand, reproduite dans "Marx, Engels et la Social-démocratie allemande-, Ed. 10-18.
[9] [188] Pendant la première guerre mondiale, la direction du SPD hollandais vacille dans une politique de soutien ambigu à l'impérialisme anglo-américain, censurant les écrits internationalistes des militants de gauche comme Gorter. Voir "La Gauche Communiste hollandaise" en cours de parution.
Courants politiques:
- Battaglia Comunista [66]
Questions théoriques:
- Parti et Fraction [67]
Revue Internationale no 65 - 2e trimestre 1991
- 2658 reads
Guerre du Golfe : massacres et chaos capitalistes
- 2668 reads
Seule la classe ouvrière Internationale peut Instaurer un véritable nouvel ordre mondial
Au moment où nous mettons sous presse, la guerre du Golfe est officiellement terminée. Elle a été rapide, bien plus rapide que les états-majors ne le laissaient prévoir ou peut-être même ne l'escomptaient. L'article éditorial qui suit a été écrit au début de l'offensive terrestre de la coalition américaine contre l'Irak, il est donc daté, cependant, la dénonciation qu'il contient de la boucherie qu'a représentée cette guerre est toujours d'actualité. L'introduction reprend en quoi les positions politiques et les analyses qui y sont défendues sont confirmées dès les premiers jours de I'« après-guerre ».
Introduction
Fin de la guerre du Golfe : les USA, « gendarme du monde »
La fin de la guerre est venue confirmer les véritables objectifs de la bourgeoisie américaine : la démonstration de son énorme supériorité militaire vis-à-vis, non seulement des pays périphériques, tel l'Irak, que l'impasse économique risque de plus en plus de pousser vers des aventures militaires, mais aussi et surtout vis-à-vis des autres puissances du monde, et particulièrement celles qui constituaient le bloc occidental : le Japon et les grands pays européens.
La disparition du bloc de l'Est, en faisant disparaître, pour ces/puissances, le besoin du « parapluie » militaire américain, portait avec elle la disparition du bloc occidental lui-même et la tendance vers la reconstitution d'un nouveau bloc impérialiste. L'effacement complet, au cours de la guerre, des deux seuls candidats sérieux au « leadership » d'un tel nouveau bloc éventuel, l'Allemagne et le Japon, la mise en évidence de leur impuissance militaire constituent un avertissement pour l'avenir : quel que soit le dynamisme économique de ces pays (en réalité, leur capacité à mieux résister à la crise que leurs rivaux), les USA ne sont nullement disposés a les laisser piétiner leurs plates-bandes. De même, toutes les petites velléités de la France « d'affirmer sa différence » (voir l'éditorial de la Revue Internationale, n° 64) jusqu'à la veille du 17 janvier, se sont volatilisées dès que les USA ont réussi à imposer LEUR « solution » à la crise : l'écrasement militaire de l'Irak. Aujourd'hui, la bourgeoisie française en est réduite à frétiller de la queue comme un petit caniche lorsque Schwarzkopf félicite les troupes françaises pour leur « absolutely superb job » et que Bush reçoit Mitterrand en lui prodiguant des amabilités. Quant à la Communauté européenne, que certains présentaient comme le futur grand rival des USA, elle a été parfaitement inexistante tout au long de la guerre. En somme, s'il était encore nécessaire d'identifier les véritables objectifs des USA eh rendant cette guerre inévitable et en la menant, ses résultats sont la pour mettre en évidence ces objectifs.
Une « victoire à la Pyrrhus »
De même, avec la fin des combats est apparu très vite ce que nous annoncions dès le début du conflit (voir Revue Internationale, n° 63) : à la guerre ne succédera pas la paix, mais le chaos et encore la guerre. Chaos et guerre en Irak même comme l'illustrent tragiquement les affrontements et les massacres dans les villes du sud ainsi qu'au Kurdistan. Chaos, guerre et désordres dans toute la région : Liban, Israël et les territoires occupés. Bref, la glorieuse victoire des « alliés », l'instauration du « nouvel ordre mondial » que l'on veut mettre en oeuvre, donnent leurs premiers fruits : le désordre, la misère et les massacres pour les populations, les guerres qui couvent. Le nouvel ordre mondial ? D’ores et déjà c'est une instabilité encore plus grande dans tout le Moyen-Orient !
Et cette instabilité n'est pas prête à se limiter à cette région. La fin de la guerre contre l'Irak n'ouvre pas la perspective d'une baisse des tensions entre grandes puissances impérialistes. Bien au contraire. Ainsi, les différentes bourgeoisies européennes se préoccupent toutes déjà de la nécessité d’adapter, moderniser et renforcer leurs armements. Ce n'est sûrement pas en vue d'une « nouvelle ère de paix ». En outre, on commence à voir des pays comme le Japon, l'Allemagne et même l'Italie, revendiquer une réévaluation de leur statut international, par leur entrée au Conseil de Sécurité de l'ONU comme membres permanents. Ainsi, les USA, s'ils ont réussi avec la guerre à administrer la preuve de leur énorme supériorité militaire, s'ils sont parvenus, de ce fait, à ralentir pour un temps la tendance au chacun pour soi, ont remporté en réalité une victoire à la Pyrrhus. L'exacerbation des tensions impérialistes et l'engloutissement de la planète dans un chaos croissant sont inévitables, au même titre que l'aggravation de la crise économique qui se trouve à leur origine. Et il faudra encore bien d'autres « punitions » comme celle infligée à l'Irak, bien d'autres « exemples » sous forme de monstrueux massacres pour « garantir le droit et l'ordre ».
Le « nouvel ordre mondial » : ,
Misère, famines, barbarie, guerres
Il y a encore un an, après la chute du mur de Berlin, la bourgeoisie, les gouvernements, les médias, nous ont clamé triomphalement que le capitalisme «libéral» avait gagné, qu'une ère de paix et de prospérité s'ouvrait avec la disparition du bloc impérialiste de l'Est et l'ouverture des marchés de ces pays. Ces mensonges ont été anéantis : à la place clés marchés de l'Est, se trouvent des économies ravagées et le chaos; à la place de la prospérité retrouvée, se développe la récession mondiale à partir des USA. A la place de la paix, nous avons eu l'intervention sanglante de la force militaire la plus gigantesque depuis la seconde guerre mondiale. Aujourd'hui, toujours aussi triomphalement, les secteurs dominants de la bourgeoisie internationale nous affirment qu'avec la défaite de l'Irak, l'instauration d'un « nouvel ordre mondial » est maintenant une chose acquise : la paix sera atteinte, la stabilité internationale gagnée. Le mensonge ne pourra que tomber à son tour.
La conclusion rapide de la guerre, le faible nombre de tués du côté des « coalisés », ont permis à la bourgeoisie de plonger momentanément dans le désarroi la classe ouvrière des métropoles capitalistes, celle dont dépend en fin de compte le sort de l'affrontement entre le prolétariat et la bourgeoisie à l'échelle mondiale et historique. Même si beaucoup d'ouvriers ressentent comme une blessure l'extermination de dizaines ou de centaines de milliers d'exploités irakiens, ils se sentent impuissants face à la campagne de triomphalisme chauvin qui, pour un temps, grâce aux mensonges des médias, étourdissent les esprits. Mais l'avenir de misère, de famine, de chaos, de massacres impérialistes toujours plus monstrueux qui est le seul que la classe dominante puisse proposer va nécessairement ouvrir les yeux des masses ouvrières et permettre que leurs combats s'imprègnent de plus en plus de la conscience de la nécessité de renverser ce système. C'est à cette prise de conscience que doivent participer activement les révolutionnaires.
RF, 11/3/91
Editorial
Horreur, barbarie et terreur. Voilà la réalité du capitalisme mise à nu par la guerre contre l'Irak.
Horreur et barbarie. La guerre, la guerre entre gangsters impérialistes, continue. C'est l'heure de l'offensive terrestre des forces de la coalition. Et l'Irak en sortira défait. Des centaines de milliers de morts -on ne sait exactement pour l'instant-, sans doute autant de blessés, de disparus, des destructions massives en Irak, au Koweït seront, et sont déjà, le résultat sanglant et terrible du conflit.
Horreur et cynisme de la bourgeoisie des pays « coalisés ». Sans aucune pudeur, se vautrant dans le sang et en jouissant, elle se vante de ses prouesses techniques dans la guerre. Dans un premier temps, afin d'endormir les réticences à la boucherie, c'était « la guerre propre »: les missiles ne touchaient que des cibles militaires, rentraient par les fenêtres et les cages d'escalier, mais ne tuaient personne, tout au moins parmi les civils. Quelle merveille. Il s'agissait d'une opération « chirurgicale ». Puis la macabre réalité ne put être plus longtemps masquée. Des milliers de civils sont morts sous les bombardements massifs des B52 et des missiles de croisière. Saurons-nous jamais l'effroyable vérité? Comble du cynisme: lorsque l'explosion de l'abri de Bagdad a fait sans doute 400 morts, c'est tout juste si le Pentagone ne désignait pas comme coupables ces civils qui n'auraient pas du se réfugier dans cet abri et se mettre sur le chemin des bombes !
L'admiration sans borne des médias, des journalistes, des spécialistes militaires, à l'égard des prouesses techniques, scientifiques, mises au service de la mort et de la destruction, est absolument écoeurante. Pendant ce temps, le capitalisme est incapable d'enrayer les épidémies de toutes sortes dans le monde, le choléra en Amérique Latine, le SIDA, et combien d'autres encore. La science et la technique sont au service de la mort et de la destruction à une échelle de masse. Voilà la réalité du capitalisme.
La terreur, la terreur capitaliste, la terreur d'une société pourrissante, s'est abattue sur les populations. Terreur à grande échelle sur l'Irak et sur le Koweït. La coalition américaine use des armes les plus sophistiquées, les plus meurtrières, les plus « scientifiques » et massives. Nous ne sommes pas des spécialistes militaires, et reconnaissons-le, ne trouvons aucun goût dans le sinistre décompte. Au bas mot: 100 000 tonnes de bombes ont été larguées, 108 000 sorties aériennes accomplies. Combien de missiles lancés des bateaux de guerre croisant dans 1e Golfe Persique, dans la Méditerranée ? La bourgeoisie américaine et ses alliées n'hésitent pas à utiliser les moyens de destruction les plus massifs -exception faite de l'arme nucléaire, la prochaine fois sans doute - tels que les bombes à souffle et le napalm. En comparaison les exactions, tout aussi horribles, de la soldatesque de Saddam Hussein ne sont que de l'artisanat.
Même au sein des abris, les populations civiles ne sont pas en sécurité. Peut-on imaginer les dégâts, les peurs, la panique, l'angoisse, des enfants, des femmes, des hommes vieux ou jeunes au milieu des bombardements, des explosions - quand Bassorah est touchée, la terre tremble jusqu'en Iran -, des sirènes, et souvent des morts et des blessés lorsqu'on sait que l'aviation US bombardait 24 heures sur 24. Lorsqu'on sait que, la première nuit de guerre, il avait été largué sur l’Irak une fois et demi équivalent de la bombe atomique d'Hiroshima. Lorsqu'on sait qu'au bout d'un mois, l'Irak et le Koweït ont reçu plus de bombes que l'Allemagne durant toute la deuxième guerre mondiale !
Le coût d'un missile « Patriot » est d'un million de dollars US. Le coût d'un avion furtif de 100 millions de dollars. Le coût total de la guerre va très certainement dépasser les 80 milliards de dollars dans les cas de figure les plus minimes. En fait, certainement beaucoup plus, ne serait-ce qu'en prenant en compte les destructions massives de l'Irak, du Koweït, des puits de pétrole. Au bas mot, on parle déjà de 100 milliards de dollars pour chacun des deux pays. Vingt années de travail des prolétaires en Irak viennent d'être anéanties. Est-il besoin de rappeler que la dette de l'Irak avant l'invasion du Koweït était seulement -si l'on peut dire - de 70 milliards ? Nous assistons à un immense gaspillage de biens et de richesses qui partent en fumée.
Pendant ce temps, les trois quarts de l'humanité ne mangent pas à leur faim et vivent dans le dénuement le plus total, et chaque jour plus tragique. Pendant ce temps, 40 000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque jour de sous-alimentation dans le monde ! Combien, sans en mourir, en souffrent et en seront marqués de manière irréversible, à vie ?
Les capacités de production sont au service des moyens de destruction et de mort, non au service de l'humanité et de son bien-être. Telle est la réalité sans fard du capitalisme.
La dictature et le totalitarisme du capitalisme
Horreur et mensonges éhontés. Au bombardement de l'Irak, répond le bombardement médiatique, propagandiste, des populations, et spécialement de la classe ouvrière, du monde entier. Les médias apparaissent réellement pour ce qu'ils sont : au service de la bourgeoisie, au service de ses buts de guerre. Depuis le premier jour de celle-ci, du temps de la « guerre propre », la mobilisation et l'enthousiasme des médias sont à vomir. Mais la manipulation des informations et les propos « va-t-en-guerre » des journalistes bourgeois ne devaient pas suffire encore. Les différents Etats capitalistes belligérants, surtout les plus « démocratiques », en premier lieu les USA, ont imposé la censure militaire, tout comme de vulgaires Etats fascistes ou staliniens, afin d'imposer la dictature la plus complète sur les informations et sur «l'opinion publique». Voilà ce qu'il en est de la démocratie bourgeoise tant vantée.
Autre mensonge: il s'agirait d'une guerre pour le respect du Droit international transgressé par la bourgeoisie irakienne. De quel Droit s'agit-il, sinon de celui du plus fort, du droit capitaliste ? C'est soit par intérêt, telles la Syrie, l'Egypte, la Grande-Bretagne, soit par le chantage et les menaces, envers l'URSS, la Chine, la France, etc., que les USA ont obtenu l'accord de l'ONU pour intervenir militairement.
Saddam Hussein a beau jeu de crier au scandale quand il affirme qu'il y a deux poids, deux mesures et que jamais l'ONU, ni bien sûr les USA, n'ont déployé les mêmes forces armées pour qu'Israël respecte les résolutions lui enjoignant de quitter les territoires occupés. La bourgeoisie ne s'embarrasse guère du Droit, de son Droit, du Droit capitaliste, quand celui-ci ne la sert plus directement.
Apres la guerre, ni paix, ni reconstruction : encore la guerre impérialiste
Une fois le conflit déclenché, toute « raison », toute « morale », ont complètement disparu. Les USA veulent mettre à genoux l'Irak, lui infliger des destructions colossales et insurmontables. A n'importe quel prix. Tel est le processus implacable de la guerre impérialiste. La bourgeoisie américaine n'a pas le choix. Pour remplir ses objectifs politiques, pour affirmer sans ambiguïté son hégémonie impérialiste sur le monde, son leadership, elle est contrainte d'aller jusqu'au bout de la guerre en utilisant les énormes moyens de destruction dont elle dispose. Raser l'Irak, raser le Koweït, jusqu'à la capitulation complète, sont les objectifs de la bourgeoisie US. Telles sont ses consignes aux militaires.
Saddam Hussein, dans sa tentative désespérée de s'en sortir, est poussé à l'utilisation sans retenue, sans frein, suicidaire, de tout ce qui lui tombe sous la main: les Scuds, la marée noire dans le Golfe Persique, l'incendie des puits de pétrole pour se protéger des vagues incessantes des bombardiers. Lui non plus, il n'a pas le choix.
Les deux pays, l'Irak et le Koweït, à feu et à sang. Leur principale richesse, le pétrole, flambe et les puits seront certainement dévastés pour un bon moment. C'est tout l'environnement de la région qui est gravement menacé. Les dégâts sont sans doute déjà considérables. Peut-être même en grande partie irréversibles.
Et dans ce bain de sang, nous avons entendu les pleurs mensongers et hypocrites des opposants bourgeois à la guerre. Les pacifistes, les gauchistes qui quant ils ne soutiennent pas ouvertement 1’impérialisme irakien comme le font les trotskistes appellent à manifester « contre la guerre pour le pétrole » et pour la paix. La paix est impossible dans le capitalisme. Elle n'est qu'un moment de préparation a la guerre. Le capitalisme porte en lui la guerre impérialiste. La guerre au Proche-Orient vient encore de le confirmer avec éclat.
Même si le contrôle du pétrole reste important, l'objet central de la guerre n'est pas là. La paralysie depuis le 2 août des puits de pétrole d'Irak et du Koweït, leur embrasement par la suite, n'ont pas vu un renchérissement du baril, mais au contraire sa baisse. Il n'y a aucun risque de pénurie. Il y a surproduction de pétrole comme il y a surproduction généralisée de marchandises, et récession mondiale.
La guerre n'est pas encore finie et que ne voit-on pas déjà ? Les ignobles vautours baptisés « hommes d'affaires » fondre sur les décombres et s'arracher, au titre de la reconstruction, les dépouilles du carnage. Les compagnies anglaises s'indigner de la rapacité de leurs concurrentes américaines. Mener la guerre ensemble est une chose morale et juste, mais business is business. Contre ces nouveaux mensonges, soyons clairs il n'y aura pas de reconstruction qui puisse permettre une reprise de l'économie mondiale. Un pays comme l'Irak était déjà incapable de rembourser sa dette de 70 milliards de dollars avant la guerre. C'est d'ailleurs une des raisons de son aventure tragique. Alors comment, avec quoi, reconstruire? Alors que le capitalisme mondial s'avère impuissant à remettre un tant soit peu en état de fonctionner les économies ruinées des pays de l'ex-bloc capitaliste stalinien.
Tout cela n'est que mensonges et propagande afin de faire passer la guerre et ses sacrifices auprès des populations et, tout particulièrement auprès de la classe ouvrière des pays les plus industrialisés. Afin de présenter des « raisons » de soutenir l'effort de guerre.
Mais de raison pour soutenir cette guerre, comme dans toute guerre impérialiste, pour l'humanité comme un tout il n'y en a pas. Pour le prolétariat comme classe exploitée et révolutionnaire, il y en a encore moins. Ni sur un plan historique, ni économique, ni humanitaire (voir "Le prolétariat face à la guerre", p.14). Ce n'est qu'un massacre de vies humaines, un gaspillage incroyable de moyens techniques et de forces productives, qui disparaissent à jamais. Et au bout, ce n'est pas la « paix» qui apparaît, mais de nouveau la guerre, la guerre impérialiste.
Car, contre tous les mensonges dont on nous abreuve, de paix il n'y en aura pas. Ni au Proche-Orient, ni sur le reste de la planète. Bien au contraire.
La guerre contre l'Irak prépare les guerres de demain
La défaite de l'Irak bien évidemment va marquer une grande victoire des USA. Loin de ses déclarations pacifiques, morales sur le bien et le mal, la bourgeoisie américaine menace en réalité tous ceux qui vont être tentés ou contraints de suivre l'exemple de Saddam Hussein. Les USA sont la première puissance impérialiste mondiale, la seule « super-puissance » depuis l'effondrement de l'URSS. A ce titre, parce que c'est le seul pays qui puisse réellement le faire, ils ne resteront pas sans réaction face à la multiplication des guerres locales, aux remises en cause des frontières, au développement du chacun pour soi entre Etats, au chaos. Tel est l'avertissement. Il en va de leur autorité, de leur hégémonie, d'un « ordre mondial » dont ils sont le principal bénéficiaire. Voilà une des raisons du jusqu’au-boutisme sanglant des USA, de leur volonté délibérée de raser l'Irak, de mener la guerre jusqu'à la reddition complète. Mais cet avertissement ne s'adresse pas qu'aux imitateurs potentiels - ils sont nombreux - de Saddam Hussein. Il y a une autre raison plus fondamentale au jusqu'auboutisme américain.
C'est aussi et surtout un avertissement aux autres grandes puissances, l'Allemagne, le Japon, les pays européens, et dans une moindre mesure l'URSS. La domination impérialiste américaine est toujours d'actualité. Envoyer les forces armées au Proche-Orient, faire la démonstration évidente et meurtrière de leur immense supériorité militaire, entraîner les autres - la France par exemple - dans l'intervention, mener la guerre jusqu'au bout, écraser l'Irak dans le feu et le sang, est l'occasion de renforcer leur « leadership » mondial. Et surtout d'essayer d'éteindre toute velléité de politique indépendante alternative, d'émergence d'un éventuel autre pôle impérialiste concurrent capable de remettre en cause leur domination. Même si ce dernier est hautement improbable dans l'immédiat.
Voilà la raison de leur refus systématique de tous les plans de paix et propositions de négociation menant au retrait de l'Irak, proposés tour à tour par la France le 15 janvier, et par l'URSS avant l'offensive terrestre -à chaque fois soutenus par l'Allemagne, l'Italie... Voilà la raison des réponses à chaque fois plus intransigeantes, des ultimatums chaque fois plus durs, renvoyés à la figure de ceux qui présentaient ces plans de paix.
La guerre, les dizaines de milliers de tonnes de bombes, les centaines de milliers de morts, les destructions innombrables, l'Irak et le Koweït rasés pour que la bourgeoisie américaine affirme et renforce sa domination et son pouvoir impérialistes dans un monde en crise, en guerre, en pleine décomposition. Voilà les véritables buts de la guerre !
C'est par la perspective de la guerre et son déclenchement que la bourgeoisie américaine a réussi tant bien que mal à imposer aux autres puissances la « coalition » derrière ses buts de guerre. A chaque fois que la pression s'est relâchée, Tes tendances centrifuges, a l'opposition aux USA, à l'émergence d'une alternative aux menées guerrières des USA, se sont exprimées (voir Revue internationale, n°64, Editorial). Preuve que ces pays étaient bien conscients du piège et du terrain dans lesquels leur rival impérialiste américain les menait, les enfermait et les rendait impuissants, encore plus affaiblis.
Une fois la guerre finie, les tensions entre les USA et les pays européens, l'Allemagne tout particulièrement, et le Japon, vont se développer inévitablement. Devant la force économique de ces pays, leur montée en puissance, les USA vont être amenés de plus en plus à imposer un corset de fer sur ces antagonismes naissants, à utiliser la force dont ils disposent, c'est-à-dire la force militaire et donc la guerre.
La guerre contre l'Irak est la préparation des autres guerres impérialistes. Non de la paix. D'un côté, l'aggravation de la crise économique et la situation de décomposition, de chaos, dans laquelle s'enfonce le capitalisme, poussent inévitablement à d'autres aventures guerrières de même nature que celle de l'Irak. De l'autre, et dans cette situation, la première puissance impérialiste, face au chaos, face à ces nivaux potentiels, va utiliser de plus en plus sa force militaire et les guerres pour essayer d'imposer son « ordre » et sa domination. Tout pousse à l'accentuation des tensions économiques et guerrières. Tout pousse à la multiplication des guerres impérialistes.
Voilà ce qu'annonce la victoire militaire sanglante de la coalition occidentale.
Cette guerre impérialiste au Proche-Orient, comme toute guerre impérialiste, c'est en premier lieu la classe ouvrière qui la paye, qui en est la victime. De sa vie quand elle est sous 1’uniforme, enrôlée de force sur les terrains de bataille, ou quand elle se trouve tout simplement sous les bombes et les missiles. De sa sueur, de son labeur et de sa misère, quand elle a le « bonheur » de n'être pas directement massacrée.
Marx et Lénine sont morts et enterrés, clamait la bourgeoisie lors de l'effondrement du stalinisme. Pourtant le «Prolétaires de tous les pays, unissez-vous » de K.Marx est d'une actualité et d'une urgence brûlantes face à la folie nationaliste et guerrière qui s'abat sur l'ensemble de l'humanité.
Oui, le prolétariat international reste bien la seule force, la seule classe sociale qui puisse s'opposer à cette machine chaque fois plus infernale et folle qu'est le capitalisme en décomposition. Elle est la seule force qui puisse mettre à bas cette barbarie et construire une autre société où toute cause de guerre et de misère aura disparu.
Le chemin est encore long. Il faut pourtant s'y engager avec détermination car les échéances dramatiques se rapprochent chaque jour.
Refuser les sacrifices économiques, la logique de la défense de l'économie nationale, est la première des étapes. Refuser l'unité et la discipline nationale, la logique de la guerre impérialiste, refuser la paix sociale, voilà le chemin. Voilà les mots d'ordre que les révolutionnaires doivent lancer.
La crise économique, la guerre commerciale accrue, exacerbent l'impérialisme et la guerre. Crise et guerre sont au capitalisme ce que pile et face sont à la pièce de monnaie. La première, la crise, mène à la guerre. Celle-ci à son tour aggrave la crise. Les deux sont liées. La lutte économique, revendicative, de la classe ouvrière contre les attaques et les sacrifices, et la lutte contre la guerre impérialiste, sont une seule et même lutte: la lutte révolutionnaire de la classe ouvrière, la lutte pour le communisme.
Prolétaires de tous les pays, unissez-vous !
RL, 2/3/91.
Récent et en cours:
- Guerre en Irak [130]
Questions théoriques:
- Guerre [129]
Où en est la crise ? : crise économique et militarisme
- 3184 reads
La guerre dans le Golfe est présentée tour à tour et de manière contradictoire par la bourgeoisie, comme étant à l'origine de la crise et comme étant un moyen de surmonter celle-ci en instaurant un « nouvel ordre mondial » de « prospérité » et de « stabilité ». Ce ne sont là que mensonges destinés à masquer la réalité d'une crise qui se développe depuis plus de vingt ans et s'accélère dramatiquement aujourd'hui. Le résultat de la guerre ne peut être qu'une aggravation de la crise dont les prolétaires du monde entier vont subir les effets.
LA GUERRE PERMANENTE DANS LE CAPITALISME DECADENT
La guerre est indissociable de la vie du capital ([1] [189]). Depuis la seconde guerre mondiale, quasiment aucune année ne s'est écoulée, sans que, dans une partie ou l'autre du monde, ne se fasse entendre le fracas des armes. En général, lorsque la classe dominante a pu parler de période de paix, cela signifiait seulement que les grandes puissances impérialistes n'étaient pas massivement impliquées dans une confrontation directe. Et même cette simple affirmation reste à relativiser : depuis la seconde guerre mondiale on a vu sans discontinuer, la France en Indochine puis la guerre en Algérie, les Etats-Unis en Corée et la guerre du Vietnam, l'affaire de Suez, les guerres israélo-arabes, l'Armée rouge en Afghanistan, la guerre Iran-Irak, les troupes US au Liban et au Panama, et aujourd'hui le Koweït. Autant de conflits où les « grandes puissances » se sont trouvées, peu ou prou, directement impliquées. On peut dénombrer actuellement une douzaine de conflits rien qu'en Afrique. Les multiples guerres depuis 1945 ont fait pratiquement autant de morts que la 2e guerre mondiale.
La réalité de la nature intrinsèquement guerrière du capital a marqué d'une empreinte de plus en plus profonde l'ensemble de son économie. Au lendemain de la seconde guerre mondiale, s'ils interdisent aux puissances vaincues, l'Allemagne et le Japon, toute politique importante de réarmement, les pays vainqueurs ne relâchent pas pour autant leur effort guerrier. Au contraire, avec la nouvelle rivalité entre F« Est » et l'« Ouest », l'ensemble de l'économie mondiale va être soumise aux nécessités de la course aux armements. Le mode d'organisation « économique » qui apparaît avec la guerre de 1914-1918, et qui s impose durant les années 1930, celui du capitalisme d'Etat, qui met les moyens de l'économie au service du militarisme, n'a cessé de se développer, de se perfectionner depuis cinquante ans.
La situation des deux puissances impérialistes majeures durant les années 1980, les USA et l'URSS, est particulièrement significative.
La première puissance économique du globe, les USA, consacre, durant cette période, environ 6 % de son PNB annuel au budget d'armement. Une telle somme représente en valeur l'équivalent de 7 à 8 fois le PNB annuel de tout le continent africain, et 3 fois et demie celui de toute l'Amérique latine. L'ensemble des industries de pointe dépend des commandes d'armement du Pentagone. Les Boeing, MacDonnell-Douglas, Texas Instruments, General Electric, Chrysler, etc., seraient en faillite s'ils devaient se passer de cette manne, qui sert aussi à les subventionner.
L'ex-grand, l'URSS, n'a pu soutenir son effort d'armement, pour rester au niveau de son grand rival, qu'en y consacrant une part de plus en plus prépondérante de son économie. Alors qu'il y a peu, au début de sa présidence, Gorbatchev prétendait que seulement 7 % du PNB de l'URSS était consacré au budget militaire, en 1989 ses conseillers déclaraient qu en fait, la réalité se situait plus près des 30 % ! Il serait tout à fait erroné de croire que, durant toutes ces années, la Nomenklatura stalinienne a eu le monopole du mensonge à propos de ses dépenses d'armement.
Par définition, les programmes militaires sont soumis au secret et constamment minimisés. Ce qui est vrai pour l'URSS, l'est aussi, même si c'est probablement dans une moindre mesure, pour tous les autres pays. Et si d'un coté, on constate que les commandes de l'armée subventionnent les industries de pointe et orientent la recherche, de l'autre, de nombreux programmes, budgets de recherche et d'équipement « civils » sont en fait utilisés à des fins militaires. Ainsi par exemple, si la France se retrouve aujourd'hui dotée d'un des parcs de centrales atomiques « civiles » les plus importants du monde, c'est d'abord parce que cela correspondait aux besoins de son armée de se doter de plutonium pour sa «force de frappe» nucléaire. Les français ont ainsi financé l'armée même, en payant leur facture d'électricité. Ce n'est pas seulement en URSS que les usines de tracteurs servent à produire des chars d'assaut, ou bien en Irak et en Libye que les usines d'engrais produisent des gaz de combat. Aux USA, 90 % des laboratoires et centres de recherche sont contrôlés et financés plus ou moins directement et discrètement par le Pentagone.
Non seulement la part de la production consacrée aux armes de toutes sortes est partout sous-évaluée, mais surtout, aucun chiffre ne peut traduire la distorsion qualitative que le développement de l'économie de guerre impose à l'ensemble de l'économie : implantation de centres de production en fonction d'impératifs stratégico-militaires plus qu'économiques, orientation de la recherche civile en fonction des besoins des armées aux dépens d'autres nécessités.
Les exemples ne manquent pas, depuis les premières autoroutes construites durant les années 1930 en Allemagne et en Italie, avant tout pour faire passer les chars le plus rapidement possible d'un bout à l'autre du pays, jusqu'au premier ordinateur, l'ENIAC, construit aux USA pour les besoins du Pentagone, dont le centre d'expérimentation nucléaire de Los Alamos est, depuis lors, systématiquement doté du premier exemplaire de l'ordinateur le plus puissant du moment.
La production d'armements est une destruction de richesses
Aujourd'hui, les armes cristallisent le nec plus ultra du perfectionnement technologique. La fabrication de systèmes de destruction sophistiqués est devenue le symbole d'une économie moderne et performante. Pourtant, ces «merveilles» technologiques qui ont montré leur efficacité meurtrière au Moyen-Orient ne sont, du point de vue de la production, de l'économie, qu'un gigantesque gaspillage.
Les armes, contrairement à la plupart des autres marchandises; ont ceci de particulier qu'une fois produites elles sont éjectées du cycle productif du capital. En effet, elles ne peuvent servir ni à élargir ni à remplacer le capital constant (contrairement aux machines par exemple), ni à renouveler la force de travail des ouvriers qui mettent en oeuvre ce capital constant. Non seulement les armes ne servent qu'à détruire, mais elles sont déjà en elles-mêmes une destruction de capital, une stérilisation de la richesse.
Lorsque les USA, par exemple, annoncent que le budget de la défense représente 6 % du PNB, cela, signifie en fait que 6% de la richesse produite annuellement est détruite. Ces 6 % doivent donc être retirés de la richesse globale, ce qui signifie que la production militaire doit être soustraite de la croissance annuelle et non y être ajoutée comme le font les économistes.
La réalité de la ponction stérilisatrice de l'économie de guerre sur l'appareil productif se trouve parfaitement illustrée par l'évolution économique des grandes puissances ces dernières années. L'exemple de l'URSS est lumineux : loin de dynamiser l'économie, le sacrifice de celle-ci aux besoins de l'Armée rouge s'est traduit par un délabrement de plus en plus dramatique de r appareil productif. Alors que, pour ses besoins impérialistes, PURSS a développé une indus-\ trie aérospatiale de pointe, dans le même temps, faute d'investissements, la production agricole, exemple parmi tous les autres, a stagné. L'ancien grenier à blé de l'Europe doit aujourd'hui importer des céréales pour éviter la famine. L'économie russe s'est finalement effondrée essentiellement sous le poids de son économie de guerre monstrueuse.
Ce qui est vrai pour l'URSS, l'est pour les USA, même si c'est évidemment de manière moins spectaculaire. Il suffît pour cela de constater la perte de compétitivité des USA vis-à-vis de leurs principaux concurrents économiques que sont l'Allemagne et le Japon. Ces derniers, qui se sont vus interdire toute politique de réarmement au lendemain de la dernière guerre mondiale, ont donc subi une ponction relativement faible sur leur économie, pour 1’entretien de leurs armées. Il ne faut pas chercher ailleurs, même si elle n'est pas la seule, la raison principale des records de productivité atteints par ces pays.
Dans ces conditions, pourquoi entretenir une armée, si le résultat en est finalement un affaiblissement de tout l'appareil productif ?
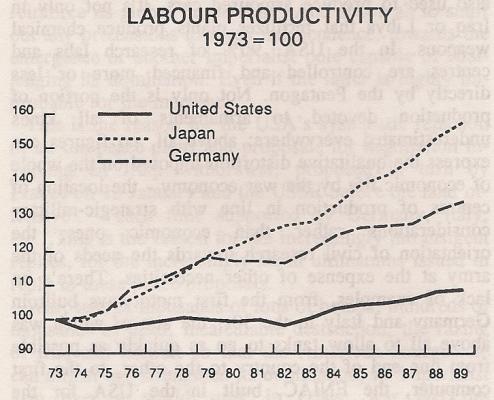
La crise pousse le capital a la fuite en avant dans la guerre
Du strict point de vue économique, la production d'armements est en effet une aberration. Cependant, la production n'est pas tout. Bien sûr, il s'agit pour chaque capital national de s'assurer des sources d'approvisionnement stables en matières premières, et des débouchés rentables pour écouler les produits de ses industries, afin de réaliser la plus-value qu'ils contiennent. Mais ces intérêts économiques s'insèrent dans la géostratégie globale de l'impérialisme qui est déterminante et impose ses propres objectifs.
Depuis le début du siècle, alors que l'ensemble des marchés de la planète sont contrôlés par l'une ou l'autre des grandes puissances, les pays les plus mal lotis sont contraints, pour sauver leur économie, pour trouver les nouveaux marchés à exploiter, ou simplement à piller, afin de maintenir le processus d'accumulation, de se les ouvrir à coups de canon.
C'est ce qu'a tenté de faire l'Allemagne en 1914 et 1939, le Japon en 1941, et l'URSS depuis 1945. Plus la concurrence s'est exacerbée sur un marché mondial fondamentalement saturé, plus la tendance à la fuite en avant dans la politique d'armement, dans le renforcement de la puissance militaire, c'est-à-dire le développement de l'impérialisme, s'est renforcée.
Face à l'impasse économique, les solutions du militarisme tendent à imposer leur propre logique qui n'est pas simplement économique. Si la guerre peut être, pour un pays vainqueur, un moyen de renforcer sa position, de faire main basse sur de nouvelles richesses, cela n'est pas le cas en général. Il suffit, pour le vérifier, de constater, au lendemain de la 2e guerre mondiale, l'affaiblissement de la Grande-Bretagne et de la France, pourtant pays « vainqueurs ». Et, quoi qu'il en soit, du point de vue du capital global, c'est-à-dire des valeurs accumulées mondialement, le bilan est absolument négatif, des richesses ont été irrémédiablement détruites. Cela démontre amplement l'irrationalité même de la guerre, du point de vue économique.
La situation présente, caractérisée :
- par une plongée accélérée de l'économie dans la récession ouverte dans les principales puissances industrielles ;
- par l'effondrement de pans entiers du capital mondial, en dernier lieu tout l'ancien « bloc de l'Est»;
- par une guerre au Moyen-Orient qui mobilise la plus importante concentration de forces de destruction depuis la seconde guerre mondiale ; est caractéristique de la spirale apocalyptique dans laquelle le capitalisme mondial est enfermé.
Crise, chaos et guerre
La « guerre du Golfe » est, en dernière analyse, le produit de la crise économique qui, depuis la fin des années 1960, secoue le capitalisme mondial ([2] [190]). L'effondrement économique de l'URSS a eu pour première conséquence l'éclatement de son bloc et, par contrecoup, un effet déstabilisateur sur l'ensemble de la situation mondiale. La tendance au « chacun pour soi », exacerbée car la crise, s'est engouffrée dans le vide béant laissé par la disparition de la discipline imposée par les blocs.
Les pays du glacis est-européen se sont empressés de se débarrasser de la tutelle russe. Les vassaux des USA, quant à eux, n'ayant plus besoin de la protection américaine face au danger russe, ont multiplié leurs velléités d'indépendance, tandis que beaucoup de puissances régionales de la périphérie du capitalisme se sont retrouvées devant la tentation de profiter de la situation pour améliorer leur position. L'Irak est dans ce dernier cas : confronté à une dette pharamineuse, estimée à 70 milliards de dollars (près de deux fois son PNB annuel), dans l'incapacité de la rembourser, il a mis à profit sa surpuissance militaire dans la région pour faire main basse sur le richissime Koweït.
Un tel exemple est significatif du chaos qui se développe internationalement et dont l'éclatement de l'URSS est un aspect marquant. La détermination des USA d'en découdre avec l'Irak, de faire un exemple est d'abord l'expression de la nécessité de mettre un frein au chaos planétaire.
L'analyse de ceux qui ne voient dans la guerre du Golfe qu'une lutte pour le pétrole ne résiste pas à la réalité économique. Même si l'Irak se trouve au centre de la principale zone de production pétrolière du monde, il n'en reste pas moins vrai que les sources d'approvisionnement se sont diversifiées et accrues, et le pétrole de cette région ne joue plus aujourd'hui le même rôle central que dans les années 1970. Il suffît de constater, après une brève poussée spéculative, la nouvelle chute des cours du pétrole, malgré l'arrêt de la production de l'Irak et du Koweït, pour mesurer à quel point la surproduction sévit, et pour comprendre que la question de l'heure n'est pas celle du danger d'une pénurie d'or noir.
Même si d'autres facteurs existent qui justifient l'intervention US : démanteler la puissance militaire de l'Irak, renforcer la « pax americana » au Moyen-Orient et le contrôle des USA sur la manne pétrolière, ils restent secondaires par rapport à l'objectif essentiel du capital américain : faire face au chaos grandissant.
La première puissance mondiale, parce que l'intérêt de son capital national coïncide avec la défense de l’« ordre mondial » qui est avant tout le sien, est particulièrement sensible au désordre grandissant dans les relations internationales. Elle est aussi la seule oui ait les moyens militaires d'assumer le rôle de gendarme du monde.
Et c'est avec inquiétude que les principaux compétiteurs économiques des USA voient se déployer la supériorité américaine, eux qui rêvent, depuis la fin du bloc de l'Est, de s'émanciper de la tutelle US. L'illusion d'un nouveau bloc en Europe autour de la puissance de l'Allemagne a été réduite en miettes, comme le montre la cacophonie de la politique étrangère européenne devant les exigences américaines. Les puissances économiques d'Europe et du Japon savent bien que les Etats-Unis vont mettre à profit leur position de force présente, pour exiger de leur part plus de sacrifices sur le plan économique, à un moment où, avec l'accélération de la crise économique, s'exacerbe la guerre commerciale.
La récession ouverte frappe de plein fouet
Le premier effet de la guerre dans le golfe a été de repousser la crise économique au second plan des préoccupations, de la masquer. Le contraste, à 'écoute et à la lecture des médias bourgeois, est étonnant entre la période qui précède l'éclatement de la guerre et la période qui suit.
L'alarmisme au sujet d'un nouvel effondrement boursier, d'une flambée catastrophique des cours du pétrole, qui prévalait avant la guerre s'est révélé sans fondement jusqu'à présent, et du coup, un optimisme de façade est de nouveau de mise. La propagande bat son plein pour minimiser l'importance de la crise et de ses effets dramatiques.
Avec la guerre, la récession, à peine officialisée par le gouvernement américain a « trouvé » une « explication » toute prête : c'est Saddam le grand responsable, la cause des difficultés actuelles, et donc, en toute logique, avec la fin de la guerre, celles-ci devraient disparaître. C'est ce que sous-entend Bush lorsqu'il déclare que la récession américaine devrait trouver son terme dans l'année qui vient, et que, finalement, ce sont des facteurs «psychologiques » qui aggravent la situation ! Alan Greenspan, président de la FED, quant à lui, a déclaré que, sans la crise du Golfe, l'économie américaine « serait peut-être passée à coté de la récession », et ajoute que « l'essentiel du choc initial de la crise est déjà absorbé» et que «les tendances à la baisse d'activité devraient actuellement s'atténuer». (La Tribune de l'Expansion).
La réalité est évidemment bien loin de ces déclarations optimistes.
L'économie américaine s'enfonce de plus en plus rapidement dans la récession et n'a pas attendu la guerre pour cela.
La crise aux USA et dans les pays industrialisés
En novembre 1990, les commandes de biens durables aux USA ont chuté de 10,1 %, et l'embellie de décembre, + 4,4 %, est due essentiellement à une progression de 57 % des commandes militaires. Pour l'ensemble de l'année 1990, c'est en fait une baisse de 1,6 %, le plus mauvais score de l'économie américaine depuis 1982, année de pleine récession.
Certains secteurs et non des moindres sont carrément sinistrés. Par exemple l'automobile et les compagnies de transport aériens. A la mi-décembre 1990, la chute des ventes dans l'automobile prend des allures de catastrophe avec -19 %. Les pertes de General Motors atteignent 2 milliards de dollars en 1990, celles de Ford pourtant le plus compétitif des constructeurs américains, s'établissent, pour les deux derniers trimestres de l'année 1990, à 736 millions de dollars. Les compagnies aériennes voient leurs ailes brisées : TWA est a déclarée en faillite, Eastern Airlines est en liquidation, PanAm et Continental sont en très mauvaise posture. Au total, les compagnies aériennes américaines ont cumulé 2 milliards de dollars de pertes en 1990. Record historique.
En conséquence les licenciements se multiplient. Au second semestre 1990, le chômage aux USA a progressé à une allure record.
Alors qu'aux USA, en 1989, 2 500 000 emplois ont été créés, il y en eut seulement 500 000 en 1990, et encore, ce résultat global sur Tannée cache la réalité catastrophique du second semestre durant lequel 900 000 emplois ont été supprimés.
Résultat, les banques américaines, déjà bien ébranlées par l'effondrement de la spéculation immobilière et boursière, voient les impayés s'accumuler. Durant le dernier trimestre 1990, 11,6% des banques ont enregistré des pertes sèches, et la plupart n'ont pu maintenir un solde positif que par la vente d'actifs qui permettait de restaurer les bilans, ce qui en définitive représente en fait un affaiblissement. En 1990, 169 banques ont fait faillite, totalisant 16 milliards d'actifs. Pour 1991, est prévue la faillite de 180 banques qui totaliseraient 70 milliards d'actifs. A cela, il faut ajouter la faillite, depuis 1988, de plus de 500 caisses d'épargne qui ont laissé à l'Etat une ardoise dont l'estimation oscille entre 500 et 1000 milliards de dollars !
Lorsque la première économie du monde subit une telle crise, l'économie mondiale en essuie évidemment le contrecoup. Au sein de l'OCDE, la Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande sont entrés en récession ouverte. La production industrielle de la France et de l'Italie reflue. Partout la croissance diminue.
En Europe, les ventes d'automobiles ont baissé de 3,7 % en un an, notamment : -5 % en Italie, -8 % en France, -18 % en GB. Les ventes de poids lourds ont chuté quant à elles de 5 %. Les bénéfices de Fiat se sont effondrés de 55 %. Symboliquement, Rolls Royce décide de cesser sa production d'automobiles prestigieuses, et Saab enterre le « modèle » suédois en fermant sa toute nouvelle usine de Malmô ouverte en 1989.
A l'instar de leurs concurrentes américaines, les compagnies aériennes européennes s'enfoncent dans la crise. Pour la première fois depuis 1981, le résultat d'exploitation global devrait être négatif pour 1990. Air France, Lufthansa, British Airways, Swissair suppriment les lignes les moins rentables. Air France demande un report de la livraison des nouveaux Airbus déjà commandés. British Airways annonce 4 900 suppressions d'emploi et la compagnie Scandinave SAS prévoit de mettre 3 500 salaries à la porte.
Au coeur du monde industrialisé, la concurrence s'exacerbe et prend la dimension d'une guerre commerciale acharnée. La guerre des tarifs des transports aériens bat son plein : British Airways, le 11 février, annonce une baisse de 33 % sur Londres - New-York et, dans les heures qui suivent, TWA et PanAm lui emboîtent le pas. Ces compagnies, pourtant financièrement déjà mal en point, rognent encore sur leur marge bénéficiaire, pour protéger leur marché et grappiller quelques clients. Une telle politique ne peut avoir pour résultat final que d'accélérer la dégradation du bilan global de ce secteur. Et ce qui est vrai pour le transport aérien est vrai ailleurs. Dans tous les secteurs, de nombreuses entreprises voient leur bilan virer au rouge, et dans un réflexe de survie, tous les coups sont permis pour se maintenir sur le marché.
« Le chacun pour soi » dans la concurrence économique exacerbée
La concurrence économique ne se limite pas simplement à une guerre des tarifs. Chaque Etat, soucieux de défendre son économie nationale, utilise toutes les ressources que lui permet sa puissance. Du plan strictement économique les rivalités ont tendance à se déplacer sur un terrain qui n'a plus grand chose à voir avec les règles de la « libre concurrence ».
Depuis des décennies, la puissance tutélaire de ce qui a constitué le « bloc occidental », les USA, a impose à ses vassaux un contrôle du fonctionnement de l'économie mondiale, qui lui était d'abord profitable, et cela au prix d'une gigantesque tricherie avec la loi de la valeur. Les avocats intransigeants de la « loi du marché », de la « libre concurrence », du « capitalisme libéral», sont ceux qui ont certainement le plus distordu ces règles pour la défense des intérêts de leur capital national. Les derniers événements sur la scène internationale en sont une preuve flagrante. Avec la fin de l'année 1990, les négociations du GATT qui duraient depuis des années se sont brutalement envenimées. Agacés par les résistances européennes sur le dossier des subventions à l'agriculture et à l'industrie, les USA ont ajourné sine die ces réunions.
La démonstration de force américaine face à l'Irak a remis les pendules à l'heure. Elle a montré que l'Europe n avait pas les moyens de ses ambitions, et cela pas tant sur le plan économique, que sur le plan militaire. Il suffit de constater le changement de ton des médias à propos de l'Allemagne ou du Japon. Ces derniers, jusqu'alors présentés comme 1’exemple même des économies solides et fortes, les nouveaux géants, les nouveaux challengers d'une puissance américaine sur le déclin, se retrouvent aujourd'hui au banc des accusés pour leur égoïsme économique. Géants économiques, l'Allemagne et le Japon restent des nains sur le plan politique et militaire. Face à la super-puissance impérialiste américaine, ils sont bien obligés, pour le moment, de constater leur faiblesse. Malgré toutes les velléités de résistance sur le front économique qu'ils peuvent encore manifester, ils ne peuvent que céder du terrain.
Depuis le début de la « guerre du Golfe », les signes d'allégeance se sont multipliés de la part de ceux qui, il y a encore quelques semaines, manifestaient des réticences. La Commission européenne propose aujourd'hui de réduire les subventions agricoles et de supprimer les subventions au nouveau programme Airbus. Ce sont précisément ces deux points qui avaient constitué la pomme de discorde durant de nombreux mois de négociations entre la CEE et les USA, au sein du GATT. Sans nouvelles discussions, devant l'évidence des faits militaires, la CEE a donc cédé, toute honte bue, aux demandes US, et ces concessions seront encore probablement insuffisantes aux yeux des USA. Quant au Japon et à l'Allemagne, ils ont finalement accédé aux sollicitations pressantes de Washington, pour financer l'opération « Tempête du désert », en acceptant de verser respectivement 13 et 7,7 milliards de dollars, une « obole » significative.
Parce qu'ils sont les plus forts, les USA imposent leur loi sur le marché mondial. Cela est particulièrement illustré par le rôle du dollar. La valeur du dollar ne correspond que de loin à la réalité économique. Elle est d'abord l'expression de la domination US sur le marché mondial, et un instrument essentiel de cette domination. La baisse organisée du dollar a pour but premier de restaurer artificiellement la compétitivité des produits américains aux dépens de leurs concurrents européens et japonais. Son résultat est de faire diminuer le déficit commercial US, et par conséquent de réduire les excédents des autres pays.
La baisse du taux d'escompte a aussi pour résultat de rendre le crédit moins cher, et donc de freiner la chute de la production en facilitant la consommation et l'investissement.
La situation encore apparemment prospère de l'Allemagne et du Japon est tout à fait provisoire. Pendant des années, ces pays ont constitue les exceptions qui permettaient de perpétuer le mythe qu'une saine gestion capitaliste était la condition nécessaire pour surmonter la crise. Non seulement ces deux pays sont, aujourd'hui, dans la ligne de mire des exigences US pour la sauvegarde de leur propre capital, mais aussi et surtout, ils commencent a leur tour à être fortement secoués par les effets de la crise.
La chute du dollar commence à se faire sentir fortement sur leurs exportations qui diminuent encore plus rapidement que ne se redresse la balance commerciale US. Pour le seul mois de novembre 1990, l'excédent commercial allemand s'est contracté de 60 %. Du fait de l'effet dollar, qui a atteint son plus bas niveau historique face au Yen et au Mark, les pertes de change des entreprises exportatrices commencent à atteindre un niveau catastrophique. Ainsi, en Allemagne, Deutsche Airbus a perdu pour cette raison la moitié de son capital.
Le chiffre de croissance record de la production allemande, 4,6% pour 1990, est à relativiser pour deux raisons. Premièrement il ne tient pas compte de la chute de moitié de la production dans l'ex-RDA. Deuxièmement il n'est pas le produit d'une croissance des exportations qui, pour leur part, ont diminué, mais de l'endettement de l'Etat pour subventionner la reconstruction de l'Allemagne de l'Est. Indice de la mauvaise santé de l'économie allemande, le chômage recommence à croître à l'Ouest, tandis qu'à l'Est, si le chômage officiel est de 800 000 personnes, en fait 1800 000 sont en chômage partiel, tandis que plus d'un million de licenciements est annoncé dans la période qui vient !
Le Japon voit aussi ses exportations chuter rapidement. Mais surtout, la crise économique se manifeste par une crise financière d'une ampleur jamais vue. Le Japon a été le haut lieu de la spéculation internationale, et aujourd'hui, plus que tout autre pays, il en paye le prix.
La chute de la bourse de Tokyo a été la plus importante, avec -39 % en 1990. Les banques japonaises sont aujourd'hui menacées d'un côté par l'effondrement de la spéculation immobilière, et de l'autre, par le non-remboursement des crédits astronomiques consentis partout dans le monde. La Far Eastern Review estime ainsi que la moitié du crédit privé international qui a été consenti, l'a été par les banques nipponnes entre 1985 et 1990. Comme, pour l'essentiel, ces crédits ont été consentis en dollars, et que celui-ci se dévalue chaque jour, les remboursements ne représenteront en fait qu'une faible part de la valeur qu ils représentaient à un moment où le dollar valait bien plus. Ceci en dehors du fait que, avec la récession qui se développe, une bonne partie de ces crédits ne seront jamais remboursés du tout. La dette US, la principale, libellée en dollars, se trouve aujourd'hui dévalorisée de 50 % par rapport au yen. La catastrophe financière est dans ces conditions prévisible et inévitable, et elle pèsera de tout son poids sur l'économie japonaise.
Les économies japonaise et allemande ont mangé leur pain blanc, et l'avenir pour elles, comme pour toutes les autres fractions du capital mondial, s'annonce noir.
S'ils sont de loin la première puissance mondiale, les USA n'en sont pas pour autant omnipotents : ils restent évidemment soumis aux contradictions insurmontables du capitalisme qui font aujourd'hui plonger l'économie mondiale dans une crise d'une ampleur inconnue jusque là.
La plongée irréversible de l'économie des USA
La politique américaine est aujourd'hui une politique de fuite en avant. La baisse du dollar porte en elle ses limites. En restaurant la balance commerciale américaine, elle diminue les excédents des autres pays exportateurs, et aura donc pour conséquence de limiter leurs importations, donc à terme les exportations US. La baisse du taux d'escompte américain a pour but, en rendant le crédit plus Facile, de relancer le marché intérieur. Mais là aussi, cette politique se heurte à la réalité économique.
Alors que la dette globale des USA se situe autour de 10 000 milliards de dollars, la fuite présente dans l'endettement ne peut avoir pour résultat que de polariser toujours plus les contradictions de l'économie mondiale autour du « roi-dollar», annonçant la crise monétaire qui se rapproche inéluctablement. Pour le vérifier il suffît de constater l'attitude présente des banques américaines qui, malgré les sollicitations incessantes de l'Etat fédéral, sont rétives à desserrer es vannes du crédit, car elles sont déjà confrontées à la réalité des dettes impayées qui s'accumulent. Visiblement, la confiance ne règne guère au sein de la bourgeoisie américaine sur la solvabilité de son économie.
Avec la récession, le futur déficit budgétaire des Etats-Unis est estimé à 350 milliards de dollars, nouveau record historique en perspective, sans compter le coût de la guerre, estime pour le moment, pour les seuls USA, à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Le premier résultat de la guerre va donc être d'aggraver encore les effets de la crise mondiale, en dégradant les déficits budgétaires des pays participants. Les gigantesques destructions en Irak et au Koweït sont présentées de manière cynique par les médias, comme la source de nouveaux débouchés, avec la reconstruction en «perspective». Si tant est que celle-ci ait lieu, ces nouveaux marchés seront de toute façon bien insuffisants pour éponger le trop-plein de la production sous lequel croule l'économie mondiale. Reconstruire les capacités de production pétrolière de l'Irak et du Koweït n'aura pour seul résultat que d'aggraver la crise de surproduction du pétrole.
Le répit que les Etat-Unis essayent de s'octroyer, par leur démonstration de force, ne peut être que de très courte durée, si répit il y a. Il ne permettra certainement pas de sortir de la récession, qui sévit en fait depuis le début des années 1980 de manière larvée, et qui n'a pas attendu la reconnaissance officielle de la fin 1990 pour faire subir ses effets. Au contraire, la récession va s'en trouver aggravée.
La seule question réelle n'est pas l'existence de la crise, mais la vitesse de son développement et sa profondeur. Pour toutes les fractions du capital mondial, le problème n'est plus de prétendre la surmonter, mais d'en limiter les dégâts sur son propre capital et de tenter d'en reporter les effets les plus pernicieux sur les autres. C'est ce qui se passe déjà.
Depuis le début de la crise, à la fin des années 1960, les pays les plus puissants ont reporté les effets les plus brutaux de la crise de surproduction généralisée, qui trouve son origine au coeur des grands centres de production du monde capitaliste, sur les pays les plus faibles. La situation dramatique de l'Afrique, ravagée par les guerres, les épidémies et la famine ; la situation de l’Amérique Latine, qui est en train de prendre le même chemin, où en 1990, la richesse par habitant a diminué de 6 % officiellement, et où se développe aujourd'hui une épidémie de choléra à l'échelle du continent, la situation des pays du défunt COMECON où la production 1’année dernière a chuté globalement de 30 % ; témoignent de l'effondrement croissant de l'économie mondiale qui aujourd'hui menace à leur tour les grands centres industriels des pays développés.
***
Comme elles paraissent lointaines les belles paroles de Bush au lendemain de l'effondrement au bloc russe, il n'y a encore que quelques mois. La promesse d'un nouveau monde de « paix » et de « prospérité » a été un mensonge de plus. La guerre commerciale qui est en train de s'exacerber porte en elle l'abandon des « belles » idées sur le « libre-échange », sur la « fin des frontières européennes », sur « la croissance et la sécurité ». Les prolétaires du monde entier vont subir de plein fouet la vérité du capitalisme : guerre, misère, chômage, famine, épidémies.
L'irrationalité de la guerre, qui n'aura pour seul résultat que d'aggraver la crise économique, exprime de manière brutale la dimension catastrophique de l'impasse du capitalisme.
JJ, 24/2/91
« Le mode de production capitaliste a cette particularité que la consommation humaine qui, dans toutes les économies antérieures, était le but, n'est plus qu'un moyen au service du but proprement dit : l'accumulation capitaliste. La croissance du capital apparaît comme le commencement et la fin, la fin en soi et le sens de toute la production. L'absurdité de tels rapports n'apparaît que dans la mesure où la production capitaliste devient mondiale. Ici, à l'échelle mondiale, l'absurdité de l'économie capitaliste atteint son expression dans le tableau d'une humanité entière gémissant sous le joug terrible d'une puissance sociale aveugle qu'elle a elle-même créée inconsciemment : le capital. Le but fondamental de toute forme sociale de production : l'entretien de la société par le travail, la satisfaction des besoins, apparaît ici complètement renversé et mis la tête en bas, puisque la production pour le profit et non plus pour l'homme devient la loi sur toute la terre et que la sous-consommation, l'insécurité permanente de la consommation et par moments la non-consommation de l'énorme majorité de l'humanité deviennent la règle. »
Rosa Luxemburg
Introduction à l'économie politique, chap. 6, "Les tendances de l'économie capitaliste"
[1] [191] Lire « Guerre, militarisme et blocs impérialistes », Revue internationale n° 52 et 53, 1er et 2e trimestres 1988.
[2] [192] Lire « La guerre dans la décomposition du capitalisme », Revue internationale, n° 63, 4e trimestre 1990, « Militarisme et décomposition », Revue internationale, n°64, 1er trimestre 1991
Récent et en cours:
- Guerre en Irak [130]
- Crise économique [28]
Résolution sur la situation internationale 1991
- 2817 reads
Qu'y a-t-il derrière le « nouvel ordre mondial » annoncé par les puissances occidentales ? Quelle est la signification historique de la guerre du Golfe ? Où en est la crise économique mondiale ? Quelles sont les perspectives pour la lutte de classe ? Quels doivent être les axes de l'intervention des révolutionnaires ?
Ce sont ces questions que traite cette résolution adoptée par le CCI en janvier 1991.
Le phénomène d'accélération de l'histoire, déjà mis en évidence par le CCI au début des années 1980, a connu depuis un an et demi une accentuation considérable. En quelques mois, c'est toute la configuration du monde, telle que l'avait laissée la fin de la seconde guerre mondiale, qui s'est trouvée bouleversée. En fait, l'effondrement du bloc impérialiste de l'Est, qui a clos les années 1980, annonce et ouvre la porte à une fin de millénaire dominée par une instabilité et un chaos comme jamais l'humanité n'en a connus.
l) La scène immédiatement la plus significative et dangereuse sur laquelle s'exprime aujourd'hui, non pas le « nouvel ordre », mais bien le nouveau chaos mondial, est celle des antagonismes impérialistes. La guerre du Golfe a mis en évidence la réalité d'un phénomène oui découlait nécessairement de la disparition du bloc de l'Est : la désagrégation de son rival impérialiste, le bloc de l'Ouest. Ce phénomène était déjà à l'origine du « hold up » irakien contre le Koweït : c'est bien parce que le monde avait cessé d'être partagé en deux constellations impérialistes qu'un pays comme l'Irak a cru possible de faire main basse sur un ex-allié du même bloc. Ce même phénomène a révélé de façon évidente, courant octobre, toute son ampleur avec les diverses tentatives des pays européens (notamment la France et l'Allemagne) et du Japon de torpiller, à travers des négociations séparées menées au nom de la libération des otages, la politique américaine dans le Golfe. Cette politique vise à faire de la punition de l'Irak un «exemple» censé décourager toute tentation future d'imiter le comportement de ce pays (et c'est bien en vue de cet « exemple » que les Etats-Unis ont tout fait, avant le 2 août, pour provoquer et favoriser l'aventure irakienne ([1] [193]). Elle s'applique aux pays de la périphérie où le niveau des convulsions constitue un facteur puissant d'impulsion de ce genre d'aventures. Mais elle ne se limite pas à cet objectif. En réalité, son but fondamental est beaucoup plus général : face à un monde de plus en plus gagné par le chaos et le «chacun pour soi», il s'agit d'imposer un minimum d'ordre et de discipline, et en premier lieu aux pays les plus importants de l'ex-bloc occidental. C'est bien pour cette raison que ces pays (à l'exception de la
2) En fait, la guerre du Golfe constitue un révélateur particulièrement significatif des principaux enjeux de la nouvelle période sur le plan des antagonismes impérialistes. Le partage de la domination mondiale entre deux super-puissances a cessé d'exister, et, avec lui, la soumission de l'ensemble des antagonismes impérialistes à l'antagonisme fondamental qui les opposait. Mais en même temps, et comme le CCI l'avait annoncé il y a plus d'un an, une telle situation, loin de permettre une résorption des affrontements impérialistes, n'a fait que déboucher, en l'absence du facteur de discipline que représentaient malgré tout les blocs, sur un déchaînement de ces affrontements. En ce sens, le militarisme, la barbarie guerrière, l'impérialisme, qui sont des caractéristiques essentielles de la période de décadence du capitalisme, ne pourront qu'être encore aggravés dans la phase ultime de cette décadence que nous vivons aujourd'hui, celle de la décomposition générale de la société capitaliste. Dans un tel monde dominé par le chaos guerrier, par la « loi de la jungle », il revient à la seule superpuissance qui se soit maintenue, parce que c'est le pays qui a le plus à perdre dans le désordre mondial, et parce que c'est le seul qui en ait les moyens, de jouer le rôle de gendarme du capitalisme. Et ce rôle, il ne sera en mesure de le tenir qu'en enserrant de façon croissante l'ensemble du monde dans le corset d'acier du militarisme. Dans une telle situation, pour longtemps encore, et peut-être jusqu'à la fin du capitalisme, les conditions n'existent pas pour un nouveau partage de la planète en deux blocs impérialistes. Des alliances temporaires et circonstancielles pourront se nouer, autour ou contre les Etats-Unis, mais en l'absence d'une autre super-puissance militaire capable de rivaliser avec eux (et ils feront tout leur possible pour en empêcher la constitution), le monde sera livré au déchaînement d'affrontements militaires de tous ordres qui, même s'ils ne pourront pas déboucher sur une troisième guerre mondiale, risquent de provoquer des ravages considérables, y compris, en se combinant avec d'autres calamités propres à la décomposition (pollution, famines, épidémies, etc.), la destruction de l'humanité.
3) Une autre conséquence immédiate de l'effondrement du bloc de l'Est réside dans l'aggravation considérable de la situation qui se trouvait à son origine : le chaos économique et politique dans les pays de l'Est européen, et particulièrement le premier d'entre eux, celui qui se trouvait à leur tête il y a moins de deux ans, l'URSS. En fait, dès à présent, ce pays a cessé d'exister en tant qu'entité étatique : par exemple, la réduction considérable de la participation de la Russie au budget de l’« Union », décidée le 27 décembre 1990 par le parlement de cette république, ne fait que confirmer l'éclatement, la dislocation sans retour de l'URSS. Une dislocation que la probable réaction des forces « conservatrices », et particulièrement des organes de sécurité (mise en évidence par la démission de Chevarnadze), ne pourra que retarder quelque peu tout en déchaînant un chaos encore plus considérable en même temps que des bains de sang.
Pour ce qui concerne les ex-démocraties populaires, leur situation, tout en n'atteignant pas le degré de gravité de celui de PURSS, ne peut que plonger vers un chaos croissant comme le révèlent dès a présent les chiffres catastrophiques de la production (chutant jusqu'à 40 % pour certains pays) et l'instabilité politique qui s'est manifestée ces derniers mois dans des pays comme la Bulgarie, la Roumanie, la Pologne (élections présidentielles) et la Yougoslavie (déclaration d'indépendance de la Slovénie).
4) La crise du capitalisme, qui se trouve, en dernière instance, à l'origine de toutes les convulsions que subit le monde à l'heure actuelle, est elle-même aggravée par ces convulsions :
- la guerre au Moyen-Orient, l'accroissement des dépenses militaires qui en résulte, ne peuvent qu affecter de façon négative la situation économique du monde (contrairement à ce qui fut le cas, par exemple, pour la guerre du Vietnam qui permit de repousser l'entrée en récession de l'économie américaine et mondiale, au début des années 1960), dans la mesure où l'économie de guerre constitue, depuis longtemps déjà, un des facteurs de premier ordre d'aggravation de la crise ;
- la dislocation du bloc de l'Ouest ne peut que porter un coup mortel à la coordination des politiques économiques à l'échelle du bloc qui, par le passé, avait permis de ralentir le rythme d’effondrement de l'économie capitaliste ; la perspective est à une guerre commerciale sans merci (comme vient de 'illustrer l'échec récent des négociations du GATT) dans laquelle tous les pays laisseront des plumes ;
- les convulsions dans la zone de l'ancien bloc de l'Est vont également constituer un facteur croissant d'aggravation de la crise mondiale en participant a l'amplification du chaos général, et, en particulier, en contraignant les pays occidentaux à consacrer des crédits importants a la limitation de ce chaos (par exemple avec l'envoi d'une « aide humanitaire » destinée à ralentir les émigrations massives vers l'Occident).
5) Ceci dit, il importe que les révolutionnaires mettent bien en évidence ce qui constitue le facteur ultime de l'aggravation de la crise :
- la surproduction généralisée propre à un mode de production qui ne peut créer des débouchés en mesure d'absorber la totalité des marchandises produites, et dont la nouvelle récession ouverte, qui frappe dès à présent la première puissance mondiale, constitue une illustration flagrante ;
- la fuite effrénée dans l'endettement extérieur et intérieur, public et privé, de cette même puissance tout au long des années 1980, qui, si elle a permis de relancer momentanément la production d'un certain nombre de pays, a fait des Etats-Unis de très loin le premier débiteur mondial ;
- l'impossibilité de poursuivre éternellement cette fuite en avant, d'acheter sans payer, de vendre contre des promesses dont il est de plus en plus évident qu'elles ne seront jamais tenues, fuite en avant qui n'a fait que rendre les contradictions encore plus explosives.
La mise en évidence de cette réalité est d'autant plus importante qu'elle constitue un facteur de premier ordre dans la prise de conscience du prolétariat contre les campagnes idéologiques actuelles. Comme en 1974 (avec la « cupidité des rois du pétrole ») et en 1980-1982 (avec la «folie de Khomeiny»), la bourgeoisie va tenter encore une fois (et elle a déjà commencé) de faire endosser la responsabilité de la nouvelle récession ouverte à un « méchant ». Aujourd'hui, Saddam Hussein, le « dictateur mégalomane et sanguinaire », le « nouvel Hitler » de notre époque, est tout à fait bien dans ce rôle. Il est donc indispensable que les révolutionnaires fassent clairement ressortir que la récession actuelle, pas plus que celles de 1974-1975 et de 1980-1982, ne résulte pas de la simple hausse des prix pétroliers, mais qu elle avait débuté dès avant la crise du Golfe et qu'elle révèle les contradictions fondamentales du mode de production capitaliste.
6) Plus généralement, il importe que les révolutionnaires fassent ressortir, de la réalité présente, les éléments les plus aptes à favoriser la prise de conscience du prolétariat.
Aujourd'hui, cette prise de conscience continue à être entravée par les séquelles de l'effondrement du stalinisme et du bloc de l'Est. Le discrédit qu'a subi il y a un an, sous l'effet notamment d'une campagne gigantesque de mensonges, l'idée même de socialisme et de révolution prolétarienne est encore loin d'avoir été surmonté. En outre, l'arrivée massive qui s'annonce d'immigrants originaires d'une Europe de l'Est en plein chaos, ne pourra que créer un surcroît de désarroi dans la classe ouvrière des deux côtés de feu le « rideau de fer » : parmi les ouvriers qui s'imagineront pouvoir échapper à une misère insupportable en s'exilant vers l'« Eldorado » occidental et parmi ceux qui auront le sentiment que cette immigration risque e les priver des maigres « acquis » qui sont les leurs et qui seront, de ce fait, plus vulnérables aux mystifications nationalistes. Et un tel danger sera particulièrement redoutable dans les pays, tel l'Allemagne, qui se retrouveront en première ligne face aux flux d'immigrants.
Cependant, la mise en évidence croissante tant de la faillite irréversible du mode de production capitaliste, y compris et surtout sous sa forme « libérale », que de la nature irrémédiablement guerrière de ce système, vont constituer un facteur puissant d'usure des illusions issues des événements de la fin 1989. En particulier, la promesse d'un « ordre mondial de paix », telle qu'elle nous a été faite avec la disparition du bloc russe, a subi en moins d'un an un coup décisif.
En fait, la barbarie guerrière dans laquelle se vautre de plus en plus le capitalisme en décomposition va imprimer sa marque de façon croissante dans le processus de développement dans la classe de la conscience des enjeux et des perspectives de son combat. La guerre ne constitue pas en soi et automatiquement un facteur de clarification de la conscience du prolétariat. Ainsi, la seconde guerre mondiale a débouché sur un renforcement de l'emprise idéologique de la contre-révolution. De même, les bruits de bottes qui se sont faits entendre depuis l'été dernier, s'ils ont eu le mérite de démentir les discours sur « la paix éternelle », ont aussi engendré dans un premier temps un sentiment d'impuissance et une paralysie indiscutable dans les grandes masses ouvrières des pays avancés. Mais les conditions actuelles de développement du combat de la classe ouvrière ne permettront pas que se maintienne de façon durable un tel désarroi :
- parce que le prolétariat d'aujourd'hui, contrairement à celui des années 1930 et 1940, s'est dégagé de la contre-révolution, qu'il n'est pas embrigadé, tout au moins ses secteurs décisifs, derrière les drapeaux bourgeois (nationalisme, défense de la « patrie socialiste », de la démocratie contre le fascisme) ;
- parce que la classe ouvrière des pays centraux n'est pas directement mobilisée dans la guerre, soumise au bâillon que représente l'enrôlement sous l'autorité militaire, ce qui lui laisse beaucoup plus de latitude pour développer une réflexion de fond sur la signification de la barbarie guerrière dont elle supporte les effets par un surcroît d'austérité et de misère ;
-parce que l'aggravation considérable, et de plus en plus évidente, de la crise du capitalisme, dont les ouvriers seront évidemment les principales victimes et contre laquelle ils seront contraints de développer leur combativité de classe, les conduira de façon croissante à faire le lien entre la crise capitaliste et la guerre, entre le combat contre celle-ci et les luttes de résistance aux attaques économiques, leur permettant de se garantir contre les pièges du pacifisme et des idéologies a-classistes.
En réalité, si le désarroi provoqué par les événements du Golfe peut ressembler, en surface, à celui résultant de l'effondrement du bloc de l'Est, il obéit à une dynamique différente : alors que ce qui vient de l'Est (élimination des restes du stalinisme, affrontements nationalistes, immigration, etc.) ne peut, et pour un bon moment encore, qu'avoir un impact essentiellement négatif sur la conscience du prolétariat, la présence de plus en plus permanente de la guerre dans la vie de la société va tendre, au contraire, à réveiller cette conscience.
7) Si, malgré un désarroi temporaire, le prolétariat mondial détient donc toujours entre ses mains les clés du futur, il importe de souligner que tous ses secteurs ne se trouvent pas au même niveau dans la capacité d'ouvrir une perspective pour l'humanité. En particulier, la situation économique et politique qui se développe dans les pays de l'ex-bloc de l'Est témoigne de l'extrême faiblesse politique de la classe ouvrière dans cette partie du monde. Ecrasé par la forme la plus brutale et pernicieuse de la contre-révolution, le stalinisme, ballotté par les illusions démocratiques et syndicalistes, déchiré par les affrontements nationalistes et entre cliques bourgeoises, le prolétariat de Russie, d'Ukraine, des pays baltes, de Pologne, de Hongrie, etc., se trouve confronté aux pires difficultés pour développer sa conscience de classe. Les luttes que les ouvriers de ces pays seront contraints de mener, face à des attaques économiques sans précédent, se heurteront, quand elles ne seront pas directement dévoyées sur un terrain bourgeois comme le nationalisme, à toute la décomposition sociale et politique qui est en train de s'y développer, étouffant de ce tait leur capacité à constituer un terreau pour la germination de la conscience. Et il en sera ainsi tant que le prolétariat des grandes métropoles capitalistes, et particulièrement celles d'Europe occidentale, ne sera pas en mesure de mettre en avant, même de façon embryonnaire, une perspective générale de combat.
8) La nouvelle étape du processus de maturation de la conscience dans le prolétariat, dont la situation actuelle du capitalisme détermine les prémisses, n'en est, pour le moment, qu'à ses débuts. D'une part, c'est un chemin important que doit parcourir la classe pour se dégager des séquelles du choc provoqué par l'implosion du stalinisme et l'utilisation qu'en a faite la bourgeoisie. D'autre part, même si sa durée sera nécessairement moindre que celle de l'impact de cet événement, le désarroi produit par les campagnes entourant la guerre du Golfe n'est pas encore surmonté. Pour franchir ce pas, le prolétariat se trouvera confronté aux difficultés que la décomposition générale de la société sème devant lui, de même qu'aux pièges des forces bourgeoises, et en particulier syndicales, qui tenteront de canaliser sa combativité dans des impasses, y compris en le poussant dans des engagements prématurés. Dans ce processus, les révolutionnaires auront une responsabilité croissante :
- dans la mise en garde contre l'ensemble des dangers que représente la décomposition, et particulièrement, il va de soi, la barbarie guerrière ;
- dans la dénonciation de toutes les manoeuvres bourgeoises, dont un des aspects essentiels sera de dissimuler, ou de dénaturer, le lien fondamental entre la lutte contre les attaques économiques et le combat plus général contre une guerre impérialiste de plus en plus présente dans la vie de la société ;
- dans la lutte contre les campagnes visant à saper la confiance du prolétariat en lui-même et en son devenir ;
-dans la mise en avant, contre toutes les mystifications pacifistes et, plus généralement, contre l'ensemble de l'idéologie bourgeoise, de la seule perspective qui puisse s'opposer à l'aggravation de a guerre : le développement et la généralisation du combat de classe contre le capitalisme comme un tout en vue de son renversement.
4 janvier 1991.
[1] [194] Mais s'ils n'en étaient pas totalement maîtres (l'Irak aussi y était pour quelque chose), la date choisie par les Etats-Unis pour le début du conflit, le 2 août 1990, n'est pas le fait du hasard. Pour cette puissance, il fallait faire vite avant que ne s'accentue encore plus la dislocation de son ancien bloc, mais aussi avant que ne se manifeste trop ouvertement (après la « gueule de bois » consécutive à l'effondrement du bloc de 1 Est) la tendance à la reprise des luttes ouvrières, impulsée par la récession mondiale, qui avait commencé à s'exprimer avant l'été 1990.
Grande-Bretagne qui a choisi depuis longtemps une alliance indéfectible avec les Etats-Unis) ont fait plus que traîner les pieds pour s'aligner sur la position américaine et s'associer à son effort de guerre. S'ils ont besoin de la puissance américaine comme gendarme du monde, ils redoutent qu'un étalage trop important de celle-ci, inévitable lors d'une intervention armée directe, ne porte ombrage à leur propre puissance.
Vie du CCI:
- Résolutions de Congrès [131]
Récent et en cours:
- Guerre en Irak [130]
Questions théoriques:
- Guerre [129]
Le prolétariat face à la guerre
- 3384 reads
LE PROLÉTARIAT FACE À LA GUERRE
Avec une violence inouïe, la guerre du Golfe est venue rappeler que le capitalisme c'est la guerre. La responsabilité historique de la classe ouvrière mondiale, seule force capable de s'opposer au capital, n'en a été que plus mise en relief. Mais, pour assumer cette responsabilité, la classe révolutionnaire doit se réapproprier sa propre expérience théorique et pratique de lutte contre le capital et la guerre. C'est dans cette expérience qu'il doit puiser la confiance dans sa capacité révolutionnaire et les moyens pour mener à bien son combat.
LE PROLÉTARIAT FACE A LA GUERRE DU GOLFE : L'ENJEU DE LA SITUATION HISTORIQUE
La classe ouvrière mondiale a subi la guerre du Golfe comme un massacre d'une partie d'elle-même, mais aussi comme un gigantesque coup de massue, comme une gifle monumentale assenée par la classe dominante.
Mais les rapports de force entre prolétariat et classe dominante locale ne sont pas les mêmes dans les deux parties belligérantes.
En Irak, le gouvernement a pu envoyer au massacre le contingent, les ouvriers, les paysans et leurs enfants (15 ans d'âge parfois). La classe ouvrière y est minoritaire, noyée dans une population agricole ou semi-marginalisée dans les bidonvilles. Elle ne possède quasiment aucune expérience historique de combat contre le capital. Et surtout, l'absence de luttes suffisamment significatives de la part des prolétaires des pays les plus industrialisés l'empêche de concevoir la possibilité d'un véritable combat internationaliste. Aussi lui a‑t‑il été impossible de résister à l'embrigadement idéologique et militaire qui l'a contrainte à servir de chair à canon pour les visées impérialistes de sa bourgeoisie. Le dépassement des mystifications nationalistes ou religieuses, parmi les travailleurs de ces régions, dépend tout d'abord de l'affirmation internationaliste, anti‑capitaliste des prolétaires des pays centraux.
Dans les métropoles impérialistes comme les Etats-Unis, la Grande‑Bretagne, la France, la situation est différente. La bourgeoisie n'a pu envoyer à la boucherie qu'une armée de professionnels. Pourquoi ? Parce que le rapport de forces entre les classes est différent. La classe dominante sait que les prolétaires n'y sont pas prêts à payer, encore une fois, l'impôt du sang. Depuis la fin des années 1960, depuis la reprise des luttes marquée par les grèves massives de 1968 en France, la plus vieille classe ouvrière du monde ‑ qui a déjà subi deux guerres mondiales ‑ a développé la plus grande méfiance vis‑à‑vis des hommes politiques de la bourgeoisie et leurs promesses, tout comme vis‑à‑vis des organisations dites « ouvrières » (partis de gauche, syndicats) destinées à l'encadrer. C'est cette combativité, ce détachement de l'idéologie dominante. Qui a empêché jusqu'à présent l'issue d'une troisième guerre mondiale et, cette fois encore, l'embrigadement des prolétaires dans un conflit impérialiste.
Mais, comme le démontrent les derniers événements, cela ne suffit pas pour empêcher le capitalisme de faire la guerre. Si la classe ouvrière doit n'en rester qu'à cette sorte de résistance implicite, le capital finira par mettre à feu et à sang l'ensemble de la planète jusqu'à y plonger ses principaux centres industriels.
Face à la guerre impérialiste, le prolétariat a démontré par le passé, lors de la vague révolutionnaire de 1917‑23 qui mit fin à la Première guerre mondiale, qu'il était la seule force capable de s'opposer à la barbarie guerrière du capitalisme décadent. La bourgeoisie fait tout aujourd'hui pour le lui faire oublier et l'enfermer dans un sentiment d'impuissance, en particulier à travers la gigantesque campagne autour de l'effondrement de l'URSS avec son ignoble mensonge : « La lutte ouvrière révolutionnaire ne peut mener qu'au goulag et au militarisme le plus totalitaire ».
Pour le prolétariat aujourd'hui, « oublier » sa nature révolutionnaire c'est aller au suicide, et y entraîner l'humanité entière. Dans les mains de la classe capitaliste, la société humaine va au désastre définitif. La barbarie technologique de la guerre du Golfe vient encore de le rappeler. Si le prolétariat producteur de l'essentiel des richesses, y compris des armes les plus destructrices, se laisse endormir par les sirènes pacifistes et leurs hymnes hypocrites à la possibilité d'un capitalisme sans guerres, s'il se laisse dévorer par l'ambiance décomposée du « chacun pour soi », s'il ne parvient pas à retrouver le chemin de la lutte révolutionnaire contre le capitalisme comme système, l'espèce est définitivement condamnée à la barbarie et à la destruction. « Guerre ou révolution. Socialisme ou barbarie », plus que jamais, c'est ainsi qu'est posée la question.
Plus que jamais, il est indispensable, urgent, que le prolétariat se réapproprie sa lucidité historique et son expérience, le résultat de près de deux siècles de lutte contre le capital et ses guerres.
LA LUTTE DU PROLETARIAT CONTRE LA GUERRE
Parce qu'il est la classe porteuse du communisme, le prolétariat est la première classe de l'histoire à pouvoir considérer la guerre autrement que comme un inévitable et éternel fléau. Dès les premiers moments, le mouvement ouvrier affirma son opposition générale aux guerres capitalistes. Le Manifeste Communiste, dont la parution en 1848 correspond aux premières luttes où le prolétariat s'affirme comme, force indépendante sur la scène de l'histoire, est sans équivoque : « Les travailleurs n'ont pas de patrie... Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! »
Le prolétariat et la guerre au XIXe siècle
L'attitude des organisations politiques prolétariennes vis‑à‑vis de la guerre a logiquement été différente suivant les périodes historiques. Au XIXe siècle, certaines guerres capitalistes possèdent encore un caractère progressiste anti‑féodal ou permettent, par la constitution de nouvelles nations, le développement des conditions nécessaires à la future révolution communiste. C'est ainsi que le courant marxiste fut amené en plusieurs occasions à se prononcer en faveur de la victoire de tel ou tel camp dans telle ou telle guerre nationale, ou à soutenir la lutte pour la libération nationale de certaines nations (par exemple, la Pologne contre l'empire russe, bastion du féodalisme en Europe).
Mais, dans tous les cas, le mouvement ouvrier a considéré la guerre comme un fléau capitaliste dont les classes exploitées sont les premières victimes. Il eut des confusions importantes du fait de l'immaturité des conditions historiques puis du poids du réformisme en son sein. Ainsi, à l'époque de la fondation de la Ie Internationale (1864), on croyait avoir trouvé un moyen de supprimer les guerres en exigeant la suppression des armées permanentes et leur remplacement par des milices du peuple. Cette position trouva au sein même de l'Internationale sa propre critique qui affirmait, dès 1867 « qu'il ne suffit pas de supprimer les armées permanentes pour en finir avec la guerre, mais qu'une transformation de tout l'ordre social était à cette fin également nécessaire. » La IIe Internationale, fondée en 1889, se prononce aussi vis-à‑vis des guerres en général. Mais c'est l'époque dorée du capitalisme et du développement du réformisme. Son premier congrès reprend l'ancien mot d'ordre de « substitution des milices populaires aux armées permanentes ». Au congrès de Londres, en 1896, une résolution sur la guerre affirme : « la classe ouvrière de tous les pays doit s'opposer à la violence provoquée par les guerres ». En 1900, les partis de l'Internationale ont grandi et ont même des députés aux parlements des principales nations. Un principe est solennellement affirmé : « les députés socialistes de tous les pays sont tenus de voter contre toutes les dépenses militaires, navales et contre les expéditions coloniales. »
En réalité la question de la guerre ne se pose pas encore dans toute son acuité. Mis à part les expéditions coloniales, la période charnière entre les deux siècles est encore marquée par la paix entre les principales nations capitalistes. C'est le temps de « la Belle époque ». Alors que mûrissent les conditions qui vont conduire à la Première guerre mondiale, le mouvement ouvrier semble aller de conquêtes sociales en triomphes parlementaires, et la question de la guerre apparaît pour beaucoup comme une question purement théorique.
« Tout cela explique ‑ et nous écrivons d'après une expérience vécue ‑ le fait que nous, de la génération qui lutta avant la guerre impérialiste de 1914, avons peut-être considéré le problème de la guerre plus comme une lutte idéologique que comme un danger réel et imminent : le dénouement de conflits aigus, sans le recours aux armes, tels Fachoda ou Agadir, nous avait influencés dans le sens de croire fallacieusement que grâce à "l'interdépendance" économique, aux liens toujours plus nombreux et plus étroits entre pays, il s'était ainsi constitué une sûre défense contre l'éclosion d'une guerre entre puissances européennes et que l'augmentation de préparatifs militaires des différents impérialistes, au lieu de conduire inévitablement à la guerre, vérifiait le principe romain "si vis pacem para bellum", si tu veux la paix prépare la guerre. » Gatto Mammone, in Bilan n° 21, 1935. ([1] [195])
Les conditions de cette période d'apogée historique du capitalisme, le développement des partis de masses avec leurs parlementaires et leurs énormes appareils syndicaux, les réformes réelles arrachées à la classe capitaliste, tout cela favorise le développement de l'idéologie réformiste au sein du mouvement ouvrier et son corollaire, le pacifisme. L'illusion d'un capitalisme sans guerres gagne les organisations ouvrières.
Face au réformisme, et contre lui, se dégage une gauche qui maintient les principes révolutionnaires et comprend que le capitalisme est en train d'entrer dans sa phase de décadence impérialiste. Rosa Luxemburg et la fraction bolchevique du parti social‑démocrate russe maintiennent et développent les positions révolutionnaires sur la question de la guerre. En 1907, au congrès de l'Internationale, à Stuttgart, ils parviennent à faire adopter un amendement qui ferme la porte aux conceptions pacifistes. Celui‑ci stipule qu'il ne suffit pas de lutter contre l'éventualité d'une guerre ou de la faire cesser le plus rapidement possible mais qu'il s'agit au cours de celle‑ci de « tirer de toute façon parti de la crise économique et politique pour soulever le peuple et précipiter, par là même, la chute de la domination capitaliste. » En 1912, sous la pression de cette même minorité, le congrès de Bâle dénonce la future guerre européenne comme « criminelle » et « réactionnaire » et ne pouvant qu ’» accélérer la chute du capitalisme en provoquant immanquablement la révolution prolétarienne. »
Malgré ces prises de position, deux ans plus tard, lorsqu'éclate la Première guerre mondiale, l'Internationale s'effondre. Rongées en profondeur par le réformisme et le pacifisme, les directions des différents partis nationaux se rangent du côté de leurs bourgeoisies au nom de la « défense contre l'agresseur ». Les parlementaires sociaux‑démocrates votent les crédits de guerre.
La reprise de la lutte des classes depuis 1968
Depuis la Seconde guerre mondiale, le monde n'a pas connu une minute de paix. Essentiellement à travers des conflits locaux, guerre de Corée, guerres israélo-arabes, mais aussi les soi‑disant luttes de libération nationale (Indochine, Algérie, Vietnam, etc.), les principales puissances impérialistes ont continué de s'affronter militairement. La classe ouvrière n'a pu que subir ces guerres comme l'ensemble des aspects de la vie du capitalisme.
Mais avec la grève massive de 1968 en France, et l'ensemble des luttes qui la suivent en Italie 1969, Pologne 1970 et dans la plupart des pays, le prolétariat revient sur la scène de l'histoire. Retrouvant le chemin du combat massif sur son terrain de classe, il se dégage du poids de la contre‑révolution. Au moment même où la crise capitaliste, provoquée par la fin de la reconstruction, pousse le capital mondial vers l'issue d'une troisième guerre mondiale, la classe ouvrière se détache lentement, mais suffisamment de l'idéologie dominante pour rendre impossible un embrigadement immédiat pour une troisième boucherie impérialiste.
Aujourd'hui, après vingt ans de cette situation de blocage, où la bourgeoisie n'a pas pu se lancer vers sa « solution » apocalyptique généralisée, mais où le prolétariat n'a pas eu la force d'imposer sa solution révolutionnaire, le capitalisme vit sa décomposition en engendrant un nouveau type de conflit, dont la guerre du Golfe constitue la première grande concrétisation.
Pour la classe ouvrière mondiale, et celle des principaux pays industrialisés en particulier, l'avertissement est clair : ou bien elle parvient à développer ses combats jusqu'à leur aboutissement révolutionnaire ou bien la dynamique guerrière du capitalisme en décomposition, de guerre « locale » en guerre « locale », finira par mettre en question la survie même de l'humanité.
COMMENT LUTTER CONTRE LA GUERRE AUJOURD'HUI ?
Et tout d'abord, ce que la classe ouvrière doit rejeter.
Le pacifisme c'est l'impuissance
Avant la guerre du Golfe, comme avant la Première et la Seconde guerres mondiales, à côté de la préparation de ses armes matérielles, à côté du bourrage de crâne belliciste, la bourgeoisie a préparé cette autre arme idéologique qu'est le pacifisme.
Ce qui définit le « pacifisme » ce n'est pas la revendication de la paix. Tout le monde veut la paix. Les va-t-en-guerre eux‑mêmes ne cessent de clamer qu'ils ne veulent la guerre que pour mieux rétablir la paix. Ce qui distingue le pacifisme c'est de prétendre qu'on peut lutter pour la paix, en soi, sans toucher aux fondements du pouvoir capitaliste. Les prolétaires qui, par leur lutte révolutionnaire en Russie et en Allemagne, mirent fin à la Première guerre mondiale, voulaient eux aussi la paix. Mais s'ils ont pu faire aboutir leur combat, c'est parce qu'ils ont su mener leur combat non pas AVEC les « pacifistes » mais malgré et CONTRE ceux‑ci. À partir du moment où il devint clair que seule la lutte revolutionnaire permettrait d'arrêter la boucherie impérialiste, les travailleurs de Russie et d'Allemagne se sont trouvés confrontés non seulement aux « faucons » de la bourgeoisie mais aussi et surtout à tous ces pacifistes de la première heure, les « mencheviks », les « socialistes révolutionnaires », les sociaux‑démocrates qui, armes à la main, défendaient ce dont ils ne pouvaient plus se passer et qui leur était le plus cher : l'ordre capitaliste.
La guerre n'existe pas « en soi », en dehors des rapports sociaux, en dehors des rapports de classes. Dans le capitalisme décadent, la guerre n'est qu'un moment de la vie du système et il ne peut y avoir de lutte contre la guerre qui ne soit lutte contre le capitalisme. Prétendre lutter contre la guerre sans lutter contre le capitalisme, c'est se condamner à l'impuissance. Rendre inoffensive pour le capital la révolte des exploités contre la guerre, tel a toujours été le but du pacifisme.
Sur ces manœuvres, l'histoire nous livre des expériences édifiantes. La même entreprise que nous voyons à l'œuvre aujourd'hui, les révolutionnaires la dénonçaient déjà il y a plus de cinquante ans avec la dernière énergie : « La bourgeoisie a précisément besoin que, par des phrases hypocrites sur la paix, on détourne les ouvriers de la lutte révolutionnaire », énonçait Lénine en mars 1916. L'usage du pacifisme n'a pas changé : « En cela réside l'unité de principe des sociaux‑chauvins (Plekhanov, Scheidemann) et des sociaux‑pacifistes (Turati, Kautsky) que les uns et les autres, objectivement parlant, sont les serviteurs de l'impérialisme : les uns le servent en présentant la guerre impérialiste comme "la défense de la patrie", les autres servent le même impérialisme en le déguisant par des phrases sur la paix démocratique, la paix impérialiste qui s'annonce aujourd'hui. La bourgeoisie impérialiste a besoin des larbins de l'une et de l'autre sorte, de l'une et de l'autre nuance : elle a besoin des Plekhanov pour encourager les peuples à se massacrer en criant : "À bas les conquérants" ; elle a besoin des Kautsky pour consoler et calmer les masses irritées pas des hymnes et dithyrambes en l'honneur de la paix. » (Lénine, janvier 1917)
Ce qui était vrai au moment de la Première guerre mondiale s'est, depuis, invariablement confirmé. Aujourd'hui encore, face à la guerre du Golfe, dans toutes les puissances belligérantes, la bourgeoisie a organisé la machine pacifiste. Des partis ou des fractions de partis politiques « responsables », c'est‑à‑dire ayant fait largement leurs preuves de fidélité absolue à l'ordre bourgeois (ayant participé au gouvernement, au sabotage des grèves et autres formes de lutte des classes exploitées, ayant joué le rôle de sergents recruteurs dans des guerres passées) sont chargés de prendre la tête de mouvements pacifistes. « Demandons ! », « Exigeons ! », « Imposons ! » ... un capitalisme pacifique. De Ramsey Klark (ancien conseiller du président Johnson) aux USA, à la social-démocratie en Allemagne (celle‑là même qui envoya le prolétariat allemand à la Première guerre mondiale et se chargea directement de l'assassinat des principales figures du mouvement révolutionnaire de 1918/19 Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg), des fractions pacifistes du Labour Party britannique à celles de Chevènement et Cheysson dans le PS français, en passant pas les PC staliniens de France, d'Italie, d'Espagne (avec leurs inévitables acolytes trotskystes), devenus depuis longtemps maîtres dans l'art de recruter la chair a canon, tout ce beau monde s'est retrouvé à la tête des grandes manifestations pacifistes de janvier 1991 à Washington, Londres, Bonn, Rome ou Paris. Tous ces patriotes (qu'ils défendent de grandes ou de petites patries ‑ l'Irak par exemple ‑ ne change rien à l'affaire) ne croient évidemment pas plus à la paix aujourd'hui qu'hier. Tout simplement ils remplissent le role du pacifisme : canaliser le mécontentement et la révolte provoqués par la guerre dans une impasse d'impuissance.
Après les signatures de « pétitions », après les balades dans la rue, en compagnie des « bonnes consciences » de la classe dominante, les prêtres « progressistes », les vedettes du spectacle et autres « amoureux de la paix »... capitaliste, que reste‑t‑il dans l'esprit de ceux qui sincèrement ont cru y trouver un moyen de s'opposer à la guerre, si ce n'est un sentiment de stérilité et d'amère impuissance ? Le pacifisme n'a jamais empêché les guerres capitalistes. Il n'a fait que les préparer et les accompagner.
Le pacifisme s'accompagne presque toujours d'un frère « radical » : l'antimilitarisme. Celui‑ci se caractérise en général par le refus total ou partiel du pacifisme « pacifique ». Pour combattre la guerre il préconise des méthodes plus radicales, directement orientées contre la force militaire : désertion individuelle et « exécution des officiers » sont ses mots d'ordre les plus caractéristiques. À la veille de la Première guerre mondiale, Gustave Hervé en fut le représentant le plus connu. Face à la mollesse du pacifisme ambiant de la social‑démocratie réformiste, il eut un certain écho. Il y eut même à Toulon, en France, un pauvre soldat qui, influencé par ce langage « radical », alla jusqu'à tirer sur son colonel. Cela ne mena évidemment nulle part... sauf Hervé qui aboutit au cours de la guerre au plus abject patriotisme et à l'appui de Clemenceau.
Il est évident que la révolution se traduit par la désertion des soldats de l'armée et par le combat contre les officiers. Mais il s'agit alors, comme pendant les révolutions russe et allemande, d'actions massives des soldats se fondant dans la masse des prolétaires en lutte. Il est absurde de penser qu'il puisse y avoir une solution individualiste a un problème aussi éminemment social que la guerre capitaliste. Il s'agit dans le meilleur des cas de l'expression du désespoir suicidaire de la petite‑bourgeoisie incapable de comprendre le rôle révolutionnaire de la classe ouvrière, et dans le pire, d'une impasse sciemment mise en avant par des forces policières pour renforcer le sentiment d'impuissance face au problème du militarisme et de la guerre. La dissolution des armées capitalistes ne peut être l'œuvre d'actions individuelles de révolte nihiliste, mais le résultat de l'action révolutionnaire, consciente, massive et collective du prolétariat.
Les conditions de la lutte ouvrière aujourd'hui
La lutte contre la guerre ne peut être que la lutte contre le capital. Mais aujourd'hui les conditions de cette lutte sont radicalement différentes de celles qui ont présidé aux mouvements révolutionnaires du passé. De façon plus ou moins directe, les révolutions prolétariennes du passé ont été liées à des guerres : la Commune de Paris fut le résultat des conditions créées par la guerre franco‑allemande de 1870 ; la révolution de 1905 en Russie répondait à la guerre russo‑japonaise ; la vague de 1917‑23 à la Première guerre mondiale. Certains révolutionnaires en ont déduit que la guerre capitaliste constitue une condition nécessaire, ou du moins très favorable pour la révolution communiste. Cela n'était que partiellement vrai dans le passé. La guerre crée des conditions qui poussent effectivement le prolétariat à agir de façon révolutionnaire. Mais, premièrement, cela ne se produit que dans les pays vaincus. Le prolétariat des pays vainqueurs reste généralement beaucoup plus soumis idéologiquement à ses classes dirigeantes, ce qui contrecarre l'indispensable extension mondiale qu exige la survie du pouvoir révolutionnaire. Deuxièmement, lorsque la lutte parvient à imposer la paix à la bourgeoisie, elle se prive par là même des conditions extraordinaires qui ont fait naître cette lutte ([2] [196]). En Allemagne par exemple, le mouvement révolutionnaire APRÈS l'armistice pâtira fortement de la tendance de toute une partie des soldats, revenant du front et n'ayant qu'un désir : jouir de cette paix tant désirée et si chèrement acquise.
Nous avons vu par ailleurs comment, lors de la Deuxième guerre mondiale, la bourgeoisie avait su tirer les leçons de la Première guerre et agir en vue d'éviter des explosions sociales révolutionnaires.
Mais surtout, et au‑delà de toutes ces considérations, si le cours historique actuel est renversé, si jamais il devait y avoir une guerre à laquelle seraient appelés à participer massivement les prolétaires des métropoles impérialistes, elle impliquerait la mise en œuvre de moyens de destruction si terribles que toute possibilité de fraternisation et d'action révolutionnaire serait extrêmement difficile, voire impossible.
S'il est une leçon que les prolétaires doivent retenir de leur expérience passée c'est que, pour lutter contre la guerre aujourd hui, ils devront agir AVANT une guerre mondiale ; pendant, il sera trop tard.
L'analyse des conditions historiques actuelles permet d'affirmer que les conditions d'une nouvelle situation révolutionnaire internationale pourront se créer sans que le capitalisme ait pu embrigader le prolétariat des pays centraux dans une boucherie généralisée.
Les processus qui conduisent à une réponse révolutionnaire du prolétariat ne sont ni rapides ni faciles. Ceux qui aujourd'hui se lamentent de ne pas voir le prolétariat des pays industrialisés répondre immédiatement à la guerre, oublient qu'il lui fallut trois ans de souffrances indescriptibles, entre 1914 et 1917, pour parvenir à engager sa réponse révolutionnaire. Nul ne peut dire quand et comment la classe ouvrière mondiale pourra cette fois‑ci porter son combat à la hauteur de ses tâches historiques. Ce que nous savons, c'est qu'il se heurte aujourd'hui à des difficultés énormes, dont la moindre n'est pas l'ambiance de la décomposition délétère qu'engendre la décadence avancée du capitalisme avec sa généralisation de l'esprit du « chacun pour soi » et l'odeur nauséabonde du stalinisme en putréfaction. Mais nous savons aussi que, contrairement à la période de la crise économique des années 1930, contrairement à la période de la Seconde guerre mondiale, le prolétariat des pays centraux n'est ni écrasé physiquement, ni vaincu dans sa conscience.
Le fait même que le prolétariat des grandes puissances n'ait pu être embrigadé dans la guerre du Golfe, obligeant les gouvernements à recourir à des professionnels, les multiples précautions auxquelles ont dû recourir ces gouvernements pour justifier la guerre, sont une manifestation de ce rapport de forces.
Quant aux effets de cette guerre sur la conscience dans la classe, ils se sont traduits par une relative paralysie de la combativité dans l'immédiat mais aussi par une réflexion inquiète et profonde sur les enjeux historiques.
À ce niveau, la guerre du Golfe se distingue des guerres mondiales du passé sur un aspect particulièrement important : les guerres mondiales ont eu la particularité de cacher, aux yeux des prolétaires, la crise économique qui était à leur origine. Pendant la guerre, les chômeurs disparaissaient sous l'uniforme de soldats, les usines arrêtées reprenaient leur activité pour fabriquer les armes et les marchandises nécessaires à une guerre totale : la crise économique semblait disparue. Il en est tout autrement aujourd'hui. Au moment même où la bourgeoisie déclenchait son enfer de feu au Moyen‑Orient, son économie, au cœur de ses zones les plus industrialisées, plongeait dans une récession sans précédent... sans espoir de nouveau plan Marshall. Nous avons assisté simultanément à une guerre qui a clairement révélé la perspective apocalyptique qu'offre le capital, et à 1'approfondissement de la crise économique. La première a donné la mesure de l'enjeu historique pour le prolétariat, la seconde crée et créera les conditions pour que celui‑ci, contraint de répondre aux attaques, s'affirme en tant que classe et se reconnaisse comme tel.
La situation actuelle est pour les générations présentes de prolétaires un nouveau défi de l'histoire. Celles‑ci peuvent le relever si elles savent tirer profit des vingt dernières années de luttes revendicatives au cours desquelles elles ont appris ce que valent les promesses des capitalistes sur l'avenir de ce système ; si elles savent porter jusqu'au bout la méfiance et la haine qu'elles ont développées contre les organisations soi‑disant ouvrières (syndicats, partis de gauche) qui ont systématiquement saboté tous les combats importants; si elles savent comprendre que leur lutte n'est que la suite de deux siècles de combats de la classe révolutionnaire de notre époque.
Pour cela, loin du terrain interclassiste du pacifisme et autres pièges nationalistes, le prolétariat n'a d'autre chemin que le développement de sa lutte contre le capital, sur son propre terrain de classe.
Un terrain qui se définit de façon simple et tranchante comme une façon de concevoir chaque moment de la lutte : se battre en tant que classe en mettant en avant les intérêts qui sont communs à tous les ouvriers ; défendre ces intérêts de façon intransigeante contre ceux du capital. Ce n'est pas le terrain syndicaliste, qui divise les ouvriers par nations, régions, corporations... Ce n'est pas le terrain des syndicats et partis de gauche, qui prétendent que « la défense des intérêts ouvriers est la meilleure défense de la nation », pour en conclure que les ouvriers doivent tenir compte, dans leurs luttes, des intérêts de la nation, donc du capital national. Le terrain de classe est défini par l'irréconciliabilité entre les intérêts de la classe exploitée et ceux du système capitaliste moribond.
Le terrain de classe n'a pas de frontières nationales, mais des frontières de classe. Il est par lui‑même la négation de la base des guerres capitalistes. Il est le terrain fertile où se développe la dynamique qui conduit le prolétariat à assumer, à partir de la défense de ses intérêts « immédiats », la défense de ses intérêts historiques : la révolution communiste mondiale.
La guerre capitaliste n'est pas plus une fatalité que les aberrations du capitalisme en décomposition. Pas plus que la société antique esclavagiste ou que la société féodale, le capitalisme n'est un mode de production éternel. Seule la lutte pour le bouleversement de cette société, pour la construction d'une société vraiment communiste, sans exploitation ni nations, peut débarrasser l'humanité de la menace de disparition dans le feu de la guerre capitaliste.
Seule la lutte contre le capitalisme est une lutte contre la guerre. C'est la seule « guerre » qui vaille la peine d'être menée.
RV
[1] [197] ) Les travailleurs qui comme Gatto Mammone croyaient voir dans la question de la guerre, avant 1914 une question « idéologique », oubliaient (comme ceux qui, il y a peu, se laissaient endormir par les hymnes à « la fin de la guerre froide » et l'Europe unie de 1992) que le développement de « l'interdépendance » économique, loin de résoudre les antagonismes inter‑impérialistes, ne fait que les exacerber. Ils oubliaient une des découvertes fondamentales du marxisme : la contradiction irrémédiable qui oppose d'une part le caractère de plus en plus international de la production capitaliste et, d'autre part la nature privée, nationale de l'appropriation de cette production par les capitalistes.
La recherche de fournitures comme de débouchés solvables pour sa production, conduit inévitablement chaque capital national, sous la pression de la concurrence, à développer irréversiblement la division internationale du travail. Il se développe ainsi en permanence une interdépendance économique internationale de tous les capitaux nationaux â l'égard des autres. Cette tendance, effective depuis les premiers temps du capitalisme, s'est vue renforcée par l'organisation du monde en blocs au lendemain de la Seconde guerre mondiale, tout comme par le développement des entreprises dites « multinationales ». Cependant le capitalisme ne peut pas pour autant abandonner la base de son existence : la propriété privée et son organisation en nations. Qui plus est, la décadence capitaliste s'est accompagnée simultanément du renforcement de la tendance au capitalisme d'État, c'est‑à‑dire â la dépendance de chaque capital national à l'égard de son appareil d'État national devenu maitre d'œuvre de toute la vie sociale. Cette contradiction essentielle entre production organisée internationalement et maintien de l'appropriation par nations, constitue un des bases objectives de la nécessité et de la possibilité d'une société communiste sans propriété privée ni nations. Mais pour le capitalisme, elle est une impasse insoluble qui ne peut le conduire qu'au chaos et à la barbarie guerrière.
[2] [198] « La guerre, incontestablement, a joué un rôle énorme dans le développement de noire révolution, elle a désorganisé matériellement l'absolutisme ; elle a disloqué l'armée ; elle a donné de l'audace à la masse des hésitants. Mais heureusement elle n'a pas créé la révolution et c'est une chance parce que la révolution née de la guerre est impuissante : elle est le produit de circonstances extraordinaires, repose sur une force extérieure et en définitive se montre incapable de conserver les positions conquises. » Trotsky dans « Notre révolution », parlant du rôle de la guerre russo‑japonaise dans l'éclatement de la Révolution de 1905 en Russie.
Approfondir:
Questions théoriques:
- Guerre [129]
Heritage de la Gauche Communiste:
MARC : De la révolution d'octobre 1917 à la deuxième guerre mondiale
- 3884 reads
Comme les lecteurs de notre presse territoriale l'ont déjà appris, notre camarade Marc est mort. Dans le numéro de décembre de notre publication territoriale en France, on pouvait trouver, associé à une souscription, le texte suivant signé MC : "En réponse à de nombreuses lettres qui m'ont profondément touché et pour un premier dur combat, livré et gagné, cette souscription pour la presse du CCI..." C'est avec beaucoup de lucidité et de courage, comme à son habitude, que notre camarade avait livré combat contre la maladie. Mais celle-ci, une des formes les plus foudroyantes du cancer, devait finalement prendre le dessus, le 20 décembre 1990. Avec Marc, ce n'est pas seulement notre organisation qui perd son militant le plus expérimenté et le plus fécond ; c'est tout le prolétariat mondial qui se trouve privé d'un de ses meilleurs combattants.
Depuis longtemps, et contre toutes les visions propres à l’individualisme bourgeois, le marxisme a montré que ce ne sont pas les individualités qui font l'histoire mais que, depuis l'apparition des classes sociales : "L'histoire de toutes les sociétés, jusqu'à ce jour, est l'histoire de la lutte des classes". Il en est de même, et c'est particulièrement vrai, de l'histoire du mouvement ouvrier dont le principal protagoniste est justement la classe qui, bien plus que toutes les autres, travaille de façon associée et mène son combat de façon collective. Au sein du prolétariat, c'est également, et en conséquence, de façon collective qu'agissent les minorités communistes qu'il secrète comme manifestation de son devenir révolutionnaire. En ce sens, l'action de ces minorités revêt un caractère avant tout anonyme et n'a pas à sacrifier au culte des personnalités. Leurs membres n'ont de raison d'exister, en tant que militants révolutionnaires, que comme partie d'un tout, l'organisation communiste. Cependant, si l'organisation doit pouvoir compter sur tous ses militants, il est clair que tous ne lui apportent pas une contribution équivalente. L'histoire personnelle, l'expérience, la personnalité de certains militants, de même que les circonstances historiques, les conduisent à jouer dans les organisations où ils militent un rôle tout à fait particulier et marquant en tant qu'élément d'impulsion des activités de ces organisations, et notamment de l'activité qui se trouve à la base de leur raison d'existence : l'élaboration et l'approfondissement des positions politiques révolutionnaires.
Marc était justement un de ceux-là. En particulier, il appartenait à la toute petite minorité de militants communistes qui a survécu et résisté à la terrible contre-révolution qui s'est abattue sur la classe ouvrière entre les années 1920 et les années 1960, tels Anton Pannekoek, Henk Canne-Meijer, Amadeo Bordiga, Onorato Damen, Paul Mattick, Jan Appel ou Munis. De plus, outre sa fidélité indéfectible à la cause du communisme, il a su à la fois conserver sa pleine confiance dans les capacités révolutionnaires du prolétariat, faire bénéficier les nouvelles générations de militants de toute son expérience passée, et ne pas rester enfermé dans les analyses et positions dont le cours de l'histoire exigeait le dépassement [1] [200]. En ce sens, toute son activité de militant constitue un exemple concret de ce que le marxisme veut dire : la pensée vivante, en constante élaboration, de la classe révolutionnaire, porteuse de l'avenir de l'humanité.
Ce rôle d'impulsion de la pensée et de l'action de l'organisation politique, notre camarade l'a joué de façon éminente dans le CCI, évidemment. Et cela, jusqu'aux dernières heures de sa vie. En fait, toute sa vie militante est animée par la même démarche, par la même volonté de défendre bec et ongles les principes communistes, tout en gardant en permanence l'esprit critique en éveil afin d’être capable, chaque fois que nécessaire, de remettre en cause ce qui semblait à beaucoup des dogmes intangibles et "invariants". Une vie militante de plus de soixante-dix ans et qui a trouvé ses sources à la chaleur même de la révolution.
L'engagement dans la lutte révolutionnaire
Marc est né le 13 mai 1907 à Kichinev, capitale de la Bessarabie (Moldavie), à une époque où cette région faisait partie de l'ancien Empire tsariste. Il n’a donc pas encore dix ans lorsque éclate la révolution de 1917. Voici comment lui-même, à l'occasion de son 80e anniversaire, décrit cette formidable expérience qui a marqué toute sa vie :
"J'ai eu la chance de vivre et de connaître, tout en étant enfant, la révolution russe de 1917, aussi bien de Février que d'Octobre. Je l'ai vécue intensément. Il faut savoir et comprendre ce qu'est un Gavroche, ce qu'est un enfant dans une période révolutionnaire, où on passe ses journées dans des manifestations, de l'une à l'autre, d'un meeting à l'autre ; où on passe les nuits dans des clubs où sont les soldats, les ouvriers, où ça parle, où ça discute, où ça s'affronte ; lorsque,à chaque coin de rue, tout d'un coup, brusquement, un homme se lève sur le bord d'une fenêtre et commence à parler : immédiatement, il y a 1000 personnes qui sont autour et ça commence à discuter. C'est quelque chose d'inoubliable comme souvenir, qui a marqué toute ma vie, évidemment. J'ai eu la chance, par dessus le marché, d'avoir mon frère aîné qui était soldat et qui était bolchevik, le secrétaire du parti dans la ville, et avec qui je pouvais courir, la main dans la main, d'un meeting à l'autre où il portait la défense des positions des bolcheviks.
J'ai eu la chance d'être le dernier enfant - le cinquième- d'une famille où tous les membres furent, les uns après les autres, militants du Parti jusqu'à être tués ou exclus. Tout cela m'a permis de vivre dans une maison qui était toujours pleine de gens, de jeunes, où il y avait toujours des discussions car, au début, un seul était bolchevik, les autres étant plus ou moins socialistes. C'était un permanent débat avec tous leurs camarades, tous leurs collègues, etc. Et c'était une chance énorme pour la formation d'un enfant."
En 1919, durant la guerre civile, lorsque la Moldavie est occupée par les troupes blanches roumaines, toute la famille de Marc, menacée par les pogroms (le père était rabbin), émigré en Palestine. Ce sont d'ailleurs ses frères et soeur aînés qui sont à l'origine de la fondation du parti communiste de ce pays. C'est à ce moment là, début 1921, que Marc (qui n'a pas encore 13 ans) devient militant, puisqu'il entre aux jeunesses communistes (en fait, c'est l'un de leurs fondateurs) et au parti. Très vite, il se heurte à la position de l'Internationale communiste sur la question nationale qui, suivant ses propres termes, lui "passait difficilement par la gorge". Ce désaccord lui vaut d'ailleurs, en 1923, sa première exclusion du parti communiste. Dès cette époque, alors qu'il est encore adolescent, Marc manifeste donc déjà ce qui sera une de ses principales qualités tout au long de sa vie militante : une intransigeance indéfectible dans la défense des principes révolutionnaires, même si cette défense devait le conduire à s'opposer aux "autorités" les plus prestigieuses du mouvement ouvrier comme l'étaient à ce moment-là les dirigeants de l'Internationale communiste, notamment Lénine et Trotsky [2] [201]. Son adhésion totale à la cause du prolétariat, son implication militante dans l'organisation communiste et l'estime profonde qu'il portait aux grands noms du mouvement ouvrier ne l'ont jamais conduit à renoncer au combat pour ses propres positions lorsqu'il estimait que celles de l'organisation s'écartaient de ces principes ou qu'elles étaient dépassées par les nouvelles circonstances historiques. Pour lui, comme pour tous les grands révolutionnaires, tels Lénine ou Rosa Luxemburg, l'adhésion au marxisme, la théorie révolutionnaire du prolétariat, n'était pas une adhésion à la lettre de cette théorie mais à son esprit et à sa méthode. En fait, l'audace dont a toujours su faire preuve notre camarade, à l'image des autres grands révolutionnaires, était le pendant, l'autre face, de son adhésion totale et indéfectible à la cause et au programme du prolétariat. C'est parce qu'il était profondément attaché au marxisme, qu'il en était pénétré jusqu'au bout des ongles, qu'il n'a jamais été paralysé par la crainte de s'en écarter lorsqu'il critiquait, sur la bse du même marxisme, ce qui était devenu caduc dans les positions des organisations ouvrières. La question du soutien aux luttes de libération nationale qui, dans le seconde, puis dans la troisième internationale était devenue une sorte de dogme, fut donc le premier terrain sur lequel il eut l'occasion d'appliquer cette démarche [3] [202].
Le combat contre la dégénérescence de l'Internationale
En 1924, Marc, en compagnie d'un de ses frères, vient vivre en France. Il obtient alors son intégration dans la section juive du Parti communiste, redevenant membre de cette même Internationale dont il avait été exclu peu avant. Immédiatement, il fait partie de l'opposition qui combat le processus de dégénérescence de l’IC et des partis communistes. C'est ainsi qu'avec Albert Treint (secrétaire général du PCF de 1923 à 1926) et Suzanne Girault (ancienne trésorière du Parti), il participe à la fondation, en 1927, de l'Unité léniniste. Lorsque parvient en France la plateforme de l'Opposition russe rédigée par Trotsky, il se déclare en accord avec elle. En revanche, et contrairement à Treint, il rejette la déclaration de Trotsky affirmant que sur toutes les questions où il y avait eu désaccord entre lui et Lénine avant 1917, c'est Lénine qui avait raison. Marc estimait qu'une telle attitude n'était absolument pas correcte, d'abord parce que Trotsky n'était pas réellement convaincu de ce qu'il avançait, ensuite parce qu'une telle déclaration ne pouvait qu'enfermer Trotsky dans des positions fausses défendues dans le passé par Lénine (notamment au moment de la révolution de 1905 sur la question de la "dictature démocratique du prolétariat et de la paysannerie"). De nouveau se manifeste cette capacité de notre camarade à conserver une attitude critique et lucide face aux grandes "autorités" du mouvement ouvrier. Son appartenance à l'Opposition de gauche internationale, après son exclusion du PCF en février 1928, ne signifiait pas une allégeance à toutes les positions de son principal dirigeant, malgré toute l'admiration qu'il pouvait, par ailleurs, lui porter. C'est en particulier grâce à cet esprit qu'il est capable, par la suite, de ne pas se laisser entraîner dans la dérive opportuniste du mouvement trotskiste contre laquelle il engage la lutte au début des années 1930. En effet, après sa participation, avec Treint, à la formation du Redressement communiste, il adhère en 1930 à la Ligue communiste (l'organisation qui représente l'Opposition en France) dont il devient, de même que Treint, membre de la commission exécutive en octobre 1931. Mais tous deux, après y avoir défendu une position minoritaire face à la montée de l'opportunisme, quittent cette formation en mai 1932 avant de participer à la constitution de la Fraction communiste de gauche (dite Groupe de Bagnolet). En 1933, cette organisation connaît une scission et Marc rompt avec Treint qui commence à défendre une analyse de l'URSS comparable à celle développée plus tard par Burnham et Chaulieu ("Socialisme bureaucratique"). Il participe alors, en novembre 1933, à la fondation de l'Union communiste en compagnie de Chazé (Gaston Davoust, mort en 1984), avec qui il avait entretenu des relations étroites, depuis le début des années 1930, alors que ce dernier était encore membre du PCF (il est exclu en août 1932) et qu'il animait le 15e Rayon (banlieue ouest de Paris) qui défendait des orientations d'opposition.
Les grands combats des années 1930
Marc est resté membre de l'Union communiste jusqu'au moment de la guerre d'Espagne. Nous vivons une des périodes les plus tragiques du mouvement ouvrier : suivant les termes de Victor Serge, "il est minuit dans le siècle". Comme Marc le dit lui-même : "Passer ces années d'isolement terrible, voir le prolétariat français arborer le drapeau tricolore, le drapeau des Versaillais et chanter la Marseillaise, tout cela au nom du communisme, c'était, pour toutes les générations qui étaient restées révolutionnaires, source d'une horrible tristesse". Et c'est justement au moment de la guerre d'Espagne que ce sentiment d'isolement atteint un de ses points culminants lorsque nombre d'organisations qui avaient réussi à maintenir des positions de classe sont entraînées par la vague "antifasciste". C'est notamment le cas de l'Union communiste qui voit dans les événements d'Espagne une révolution prolétarienne dans laquelle la classe ouvrière aurait l'initiative du combat. Cette organisation ne va certes pas jusqu'à soutenir le gouvernement de "Front populaire". Mais elle préconise l'enrôlement dans les milices antifascistes et elle noue des relations politiques avec l'aile gauche du POUM, une organisation antifasciste qui participe au gouvernement de la "Generalitat" de Catalogne.
Défenseur intransigeant des principes de classe, Marc ne peut évidemment pas accepter une telle capitulation devant l'idéologie antifasciste ambiante, même si elle se pare de justifications comme la "solidarité avec le prolétariat d'Espagne". Après avoir mené le combat minoritaire contre une telle dérive, il quitte l'Union communiste et rejoint individuellement, début 1938, la Fraction de gauche italienne avec qui il était resté en contact. Celle-ci avait été pour sa part, également, confrontée à un minorité favorable à l'enrôlement dans les milices anti-fascistes. Au milieu de la tourmente que représente la guerre d'Espagne, de toutes les trahisons qu'elle occasionne, la Fraction italienne, fondée à Pantin, dans la banlieue parisienne, en mai 1928, est une des rares formations à résister sur des principes de classe. Elle base ses positions de rejet intransigeant de toutes les sirènes antifascistes sur la compréhension du cours historique dominé par la contre-révolution. Dans une telle période de recul profond du prolétariat mondial, de victoire de la réaction, les événements d'Espagne ne peuvent être compris comme l'essor d'une nouvelle vague révolutionnaire, mais comme une nouvelle étape de la contre-révolution. Au bout de la guerre civile qui oppose non pas la classe ouvrière à la bourgeoisie, mais la République bourgeoise, alliée au camp impérialiste "démocratique", contre un autre gouvernement bourgeois, allié au camp impérialiste "fasciste", il ne peut y avoir la révolution mais la guerre mondial. Le fait que les ouvriers d'Espagne aient pris spontanément les armes face au putsch de Franco en juillet 1936 (ce qui est évidemment salué par la Fraction) ne leur ouvre aucune perspective révolutionnaire à partir du moment où, embrigadés par les organisations antifascistes telles le PS, le PC et la CNT anarcho-syndicaliste, ils renoncent au combat sur leur terrain de classe pour se transformer en soldats de la République bourgeoise dirigée par le "frente popular". Et une des meilleures preuves de l'impasse tragique dans laquelle se trouve le prolétariat en Espagne est, pour la Fraction, constituée par le fait qu’il n'y a dans ce pays aucun parti révolutionnaire [4] [203].
C'est donc comme militant de la Fraction italienne, qui est exilée en France et en Belgique [5] [204], que Marc poursuit le combat révolutionnaire. En particulier, il devient très proche de Vercesi (Ottorino Perrone) qui en est le principal animateur. Bien des années après, Marc a souvent expliqué aux jeunes militants du CCI combien il avait appris aux cotés de Vercesi pour qui il avait une estime et une admiration considérables. "C'est auprès de lui que j'ai appris vraiment ce qu'était un militant", a-t-il dit à plusieurs reprises. En effet, la remarquable fermeté dont fait preuve la Fraction, elle la doit en grande partie à Vercesi qui, militant depuis la fin de la première guerre mondiale dans le PSI puis dans le PCÎ, a mené de façon permanente le combat pour la défense des principes révolutionnaires contre l'opportunisme et la dégénérescence de ces organisations. A la différence de Bordiga, principal dirigeant du PCI lors de sa fondation en 1921 et animateur de la gauche de celui-ci par la suite, mais qui s'est retiré de la vie militante après son exclusion du PCI en 1930, il a mis son expérience au service de la poursuite du combat face a la contre-révolution. En particulier, il apporte une contribution décisive à l'élaboration de la position concernant le rôle des fractions dans la vie des organisations prolétariennes, notamment dans les périodes de réaction et de dégénérescence du Parti [6] [205]. Mais sa contribution est bien plus vaste. Sur la base de la compréhension des tâches qui incombent aux révolutionnaires après l'échec de la révolution et la victoire de la contre-révolution, faire un bilan (d'où le nom de la publication de la Fraction en langue française) de l'expérience passée afin de préparer "les cadres pour les nouveaux partis du prolétariat", et cela sans "aucun interdit non plus qu'aucun ostracisme" (Bilan, n°1), il impulse dans la fraction tout un travail de réflexion et d’élaboration théorique qui en fait une des organisations les plus fécondes de l'histoire du mouvement ouvrier. En particulier, bien que de "Léniniste", il n'a pas peur de reprendre à son compte les positions de Rosa Luxemburg rejetant le soutien aux luttes d'indépendance nationale et sur l'analyse des causes économiques de l'impérialisme. Sur ce dernier point, il tire profit des débats avec la Ligue des communistes internationalistes de Belgique (une formation issue du trotskisme mais qui s'en est éloignée), dont la minorité rejoint les positions de la fraction lors de la guerre d'Espagne, pour constituer avec elle, à la fin de 1937, la Gauche communiste internationale. Par ailleurs, Vercesi (en compagnie de Mitchell, membre de la LCI), en s'appuyant sur les enseignements du processus de dégénérescence de la révolution en Russie et du rôle de l'Etat soviétique dans la contre-révolution, élabore la position suivant laquelle il ne peut y avoir identification entre la dictature du prolétariat et l'Etat qui surgit après la révolution. Enfin, en matière d'organisation, il donne un exemple, au sein de la commission exécutive de la Fraction, de comment il s'agit de mener un débat lorsque surgissent des divergences graves. En effet, face a la minorité qui rompt toute discipline organisationnelle en allant s'engager dans les milices antifascistes, qui refuse de payer ses cotisations, il combat l'idée d'une séparation organisationnelle précipitée (alors que, conformément aux règles de fonctionnement de la Fraction, les membres de la minorité auraient parfaitement pu être exclus) afin de donner le maximum de chances au développement de la plus grande clarté dans le débat. Pour Vercesi, comme pour la majorité de la Fraction, la clarté politique constitue en effet une priorité essentielle dans le rôle et l'activité des organisations révolutionnaires.
Tous ces enseignements qui, sur bien des points correspondent déjà à sa démarche politique antérieure, Marc les a pleinement assimilés au cours des années où il a milité aux côtés de Vercesi. Et c'est d'ailleurs sur ces mêmes enseignements qu'il va s'appuyer lorsque, à son tour, Vercesi commencera à les oublier et à s'écarter des positions marxistes. En effet, celui-ci, au moment même où se constitue la GCI, où Bilan est remplacé par Octobre, commence à développer une théorie de l'économie de guerre comme antidote définitif à la crise du capitalisme. Désorienté par le succès momentané des politiques économiques du New Deal et du nazisme, il en conclut que la production d'armes, qui ne vient pas encombrer un marché capitaliste sursaturé, permet au capitalisme de surmonter ses contradictions économiques. Selon lui, le formidable effort d'armement réalisé par tous les pays à la fin des années 1930 ne correspond donc pas aux préparatifs de la future guerre mondiale mais constitue au contraire un moyen d'y échapper en éliminant sa cause fondamentale : l'impasse économique du capitalisme. Dans ce contexte, les différentes guerres locales qui se sont développées, notamment la guerre d'Espagne, ne doivent pas être considérées comme les prémisses d'un conflit généralisé, mais comme un moyen pour la bourgeoisie d'écraser la classe ouvrière face à une montée des combats révolutionnaires. C'est pour cela que la publication que se donne le Bureau international de la GCI s'appelle Octobre : nous sommes entrés dans une nouvelle période révolutionnaire. De telles positions constituent une sorte de victoire posthume pour l'ancienne minorité de la Fraction.
Face à un tel dérapage, qui remet en cause l'essentiel des enseignements de Bilan, Marc engage le combat pour la défense des positions classiques de la Fraction et du marxisme. C'est pour lui une épreuve très difficile puisqu'il doit combattre les errements d'un militant à qui il porte la plus haute estime. Dans ce combat, il est minoritaire car la majorité des membres de la fraction, aveuglés par leur admiration envers Vercesi, le suivent dans cette impasse. En fin de compte, cette conception conduit la Fraction italienne, de même que la Fraction belge, à une totale paralysie au moment de l'éclatement de la guerre mondiale face à laquelle Vercesi estime qu il n'y a plus lieu d'intervenir puisque le prolétariat a "disparu socialement". A ce moment-là, Marc qui a été mobilisé dans l'armée française (bien qu'apatride) ne peut engager immédiatement le combat [7] [206]. Ce n'est qu'en août 1940, à Marseille, dans le Sud de la France, qu'il peut se replonger dans l'activité politique pour regrouper les éléments de la Fraction italienne qui se sont retrouvés dans cette ville.
Face a la guerre impérialiste
Ces militants refusent pour la plupart la dissolution des fractions prononcée, sous 1’influence de Vercesi, par le Bureau international de celles-ci. Ils tiennent en 1941 une conférence de la Fraction reconstituée qui se base sur le rejet de la dérive introduite à partir de 1937 : théorie de l'économie de guerre comme dépassement de la crise, guerres "localisées" contre la classe ouvrière, "disparition sociale du prolétariat", etc. De même, la Fraction abandonne sa vieille position sur l'URSS présentant celle-ci comme un "Etat ouvrier dégénéré" [8] [207] et reconnaît sa nature capitaliste. Tout au long de la guerre, dans les pires conditions de clandestinité, la Fraction va tenir des conférences annuelles regroupant des militants de Marseille, Toulon, Lyon et Paris de même que, malgré l'occupation allemande, elle va établir des liens avec les éléments de Belgique. Elle publie un Bulletin intérieur de discussion abordant toutes les questions qui ont conduit à la faillite de 1939. Quand on lit les différents numéros de ce bulletin, on peut constater que la plupart des textes de fond combattant les dérives impulsées par Vercesi ou élaborant les nouvelles positions requises par l'évolution de la situation historique sont signés Marco. Notre camarade, qui n'avait rejoint la Fraction italienne qu'en 1938, et qui en était le seul membre "étranger", en est durant toute la guerre le principal animateur.
En même temps, Marc a entrepris un travail de discussion avec un cercle de jeunes éléments, dont la plupart viennent du trotskisme, et avec qui, en mai 942, il constitue le Noyau français de la Gauche communiste sur les bases politiques de la GCI. Ce noyau se donne pour perspective la formation de la Fraction française de la Gauche communiste mais, rejetant la politique de "campagnes de recrutement" et de "noyautage" pratiquée par les trotskistes, il se refuse, sous l'influence de Marc, à proclamer de façon précipitée la constitution immédiate d'une telle fraction.
La Commission exécutive de la Fraction italienne reconstituée, dont Marc fait partie, ainsi que le noyau français, sont conduits à prendre position face aux événements d'Italie de 1942-1943 où des combats de classe très importants conduisent au renversement de Mussolini le 25 juillet 1943 et à son remplacement par l'amiral Badoglio qui est pro-allié. Un texte signé Marco pour la CE affirme que "les révoltes révolutionnaires qui arrêteront le cours de la guerre impérialiste créeront en Europe une situation chaotique des plus dangereuses pour la bourgeoisie" tout en mettant en garde contre les tentatives du "bloc impérialiste anglo-américano-russe" de liquider ces révoltes de l'extérieur, et contre celles des partis de gauche de "museler la conscience révolutionnaire". La conférence de la Fraction qui, malgré l'opposition de Vercesi, se tient en août 1943, déclare, suite à l'analyse des événements d'Italie, que "la transformation de la fraction en Parti" est à l'ordre du jour dans ce pays. Cependant, à cause des difficultés matérielles et, aussi, de l'inertie que Vercesi oppose à une telle démarche, la Fraction ne réussit pas à rentrer en Italie pour intervenir activement dans les combats qui ont commencé à s'y dérouler. En particulier, elle ignore qu'à la fin 1943 s'est constitué dans le nord de ce pays, sous l'impulsion d'Onorato Damen et de Bruno Maffi, le Partito comunista internazionalista (PCInt), auquel participent d'anciens membres de la Fraction.
Durant cette même période, la Fraction et le Noyau ont entrepris un travail de contacts et de discussions avec d'autres éléments révolutionnaires et particulièrement avec des réfugiés allemands et autrichiens, les Revolutionäre Kommunisten Deutschlands (RKD), qui se sont dégagés du trotskisme. Avec eux, ils vont mener, et particulièrement le Noyau français, une action de propagande directe contre la guerre impérialiste adressée aux ouvriers et soldats de toutes les nationalités, y compris aux prolétaires allemands en uniforme. C'est évidemment une activité extrêmement dangereuse car elle doit affronter non seulement la Gestapo mais aussi la Résistance. C'est d'ailleurs cette dernière qui se montre la plus dangereuse pour notre camarade qui, fait prisonnier avec sa compagne par les FFI où grouillent les staliniens, échappe a la mort que ces derniers lui promettaient en s'évadant au dernier moment. Mais la fin de la guerre va sonner le glas de la Fraction.
A Bruxelles, fin 1944, après la "Libération", Vercesi sur la lancée de ses positions aberrantes tournant le dos aux principes qu'il avait défendus par le passé, est conduit à prendre la tête d'une "Coalition antifasciste" qui publie ltalia di Domani, un journal qui, sous couvert d'aide aux prisonniers et émigrés italiens, se situe clairement aux côtés de l'effort de guerre des Alliés. Dès qu'elle a pu vérifier la réalité d'un tel fait, qui avait d'abord rencontré son incrédulité, la CE de la Fraction, sous l'impulsion de Marc, exclut Vercesi, le 25 janvier 1945. Une telle décision ne résultait pas des désaccords qui existaient sur les différents points d'analyse entre ce dernier et la majorité de la Fraction. Comme avec l'ancienne minorité de 1936-37, la politique de la CE, et de Marc en son sein qui reprenait à son compte l'attitude de Vercesi à l'époque, était de mener les débats avec la plus grande clarté. Mais ce qui était reproché à Vercesi en 1944-1945, ce n'était pas simplement des désaccords politiques, c'était sa participation active, et même dirigeante, à un organisme de la bourgeoisie impliqué dans la guerre impérialiste. Mais cette dernière manifestation d'intransigeance de la part de la Fraction italienne n'était que le chant du cygne.
Découvrant l'existence du PCInt en Italie, la majorité de ses membres, à la conférence de mai 1945, décide l’auto-dissolution de la Fraction et l'intégration individuelle de ses militants dans le nouveau "parti". Marc combat avec la dernière énergie ce qu'il considère comme une complète négation de toute la démarche sur laquelle s'était fondée la Fraction. Il demande le maintien de celle-ci jusqu'à la vérification des positions politiques de cette nouvelle formation qui sont mal connues. Et l'avenir donnera parfaitement raison à sa prudence quand on constatera que le parti en question, auquel se sont ralliés les éléments proches de Bordiga se trouvant dans le Sud de l'Italie et dont certains pratiquaient l'entrisme dans le PCI), a évolué vers les positions les plus opportunistes qui soient, jusqu'à se compromettre avec le mouvement des partisans antifascistes (voir Revue Internationale n°8, 4e trimestre 1976, et n°32, 1er trimestre 1983). Pour protester contre un tel reniement, Marc annonce sa démission de la CE et quitte la conférence, laquelle a également refusé de reconnaître la Fraction française de la Gauche communiste (FFGC) qui avait été constituée à la fin 1944 par le Noyau français et qui avait fait siennes les positions de base de la Gauche communiste internationale. De son côté, Vercesi a rejoint le nouveau "Parti" qui ne lui demande aucun compte sur sa participation à la coalition antifasciste de Bruxelles. C'en est fini de tout l'effort que lui même avait mené durant des années pour que la Fraction puisse servir de "pont" entre l'ancien parti passé à l'ennemi et le nouveau parti qui devrait se constituer avec le ressurgissement des combats de classe du prolétariat. Loin de reprendre le combat pour ces positions, il oppose au contraire une hostilité farouche, et avec lui l'ensemble du PCInt, à la seule formation qui soit restée fidèle aux principes classiques de la Fraction italienne et de la Gauche communiste internationale : la FFGC. Il va même encourager, au sein de celle-ci, une scission qui constitue une FFGC bis ([9] [208]. Ce groupe publie un journal portant le même nom que celui de la FFGC, L'Etincelle. Il accueille dans ses rangs les membres de l'ex-minorité de Bilan, combattue à l'époque par Vercesi, de même que d'anciens membres de l'Union Communiste. C'est la FFGC bis que le PCInt et la Fraction belge (reconstituée après la guerre autour de Vercesi resté à Bruxelles) reconnaîtront comme "seul représentant de la Gauche communiste".
Désormais, Marc reste le seul membre de la Fraction italienne à poursuivre le combat et les positions qui avaient fait la force et la clarté politique de cette organisation. C'est au sein de la Gauche communiste de France, nouveau nom que s'est donné la FFGC, qu'il engage cette nouvelle étape de sa vie politique.
CCI
Lorsqu'il s'agit de traiter de la vie d'un camarade et d'un hommage à son engagement, il s'agit d'un tout, et il eût été préférable de publier in extenso l'article que nous lui consacrons dans cette Revue internationale. Mais parce que sa vie se confond avec l'histoire de ce siècle et des minorités révolutionnaires du mouvement ouvrier, nous avons pensé nécessaire de ne pas traiter seulement de la vie du camarade, mais également de développer plus longuement quelles furent les questions politiques les plus importantes auxquelles il fut confronté, ainsi que la vie des organisations dans lesquelles il a milité. Etant donné les impératifs de la situation internationale d'aujourd'hui, l'article a donc été divisé en deux parties, pour des raisons de place, et la suite paraîtra dans le prochain numéro de la Revue Internationale.
[1] [209] Les militants qui sont évoqués ici ne sont que les plus connus parmi ceux qui ont réussi à traverser la période de contre-révolution sans abandonner leurs convictions communistes. Il faut signaler que, contrairement à Marc, la plupart d'entre eux n'ont pas réussi à fonder ou à maintenir en vie des organisations révolutionnaires. Il en est ainsi, par exemple, de Mattick, Pannekoek et Canne-Meijer, figures de proue du mouvement "conseilliste" qui ont été paralysés par leurs conceptions sur l'organisation ou même, comme ce fut le cas du dernier (voir dans notre Revue Internationale n° 37, "La faillite du conseillisme, Le socialisme perdu") par l'idée que le capitalisme serait capable de surmonter ses crises indéfiniment écartant toute possibilité pour le socialisme. De même Munis, valeureux et courageux militant venu de la section espagnole du courant trotskiste, n'ayant jamais pu rompre complètement avec les conceptions de ses origines et enfermé dans une vision volontariste qui rejetait le rôle de la crise économique dans le développement de la lutte de classe, n'a pu donner aux nouveaux éléments qui l'ont rejoint dans le Ferment ouvrier révolutionnaire (FOR) un cadre théorique les rendant capables de poursuivre sérieusement l'activité de cette organisation après la disparition de son fondateur. Bordiga et Damen, pour leur part, se sont montrés capables d'animer des formations qui leur ont survécu (le Parti communiste international et le Parti communiste internationaliste) ; cependant, ils ont éprouvé les plus grandes difficultés (surtout Bordiga) à dépasser les positions de l'Internationale communiste devenues caduques, ce qui a constitué un handicap pour leurs organisations, qui leur a valu une crise extrêmement grave au début des années 1980 (dans le cas du PCI) ou une ambiguïté permanente sur des questions vitales comme celles du syndicalisme, du parlementarisme et des luttes nationales (cas du PCInternationaliste, comme on a pu voir lors des conférences internationales de la fin des années 1970). C'était d'ailleurs un peu le cas de Jan Appel, un des grands noms du KAPD qui est resté marqué par les positions de cette organisation sans être vraiment en mesure de les actualiser. Cependant, dès la constitution du CCI, ce camarade s'est reconnu dans l'orientation générale de notre organisation et lui a apporté tout le soutien que lui permettaient ses forces. Il faut noter qu'à l'égard de tous ces militants, malgré les désaccords souvent très importants qui pouvaient le séparer d'eux, Marc nourrissait la plus grande estime et qu'il éprouvait pour la plupart d'entre eux une profonde affection. Cette estime et cette affection ne se limitaient pas d'ailleurs à ces camarades. Elles s'étendaient à des militants moins en vue mais qui avaient, aux yeux de Marc, l'immense mérite d'avoir conservé leur fidélité à la cause révolutionnaire dans les pires moments de l'histoire du prolétariat.
[2] [210] Marc aimait évoquer cet épisode de la vie de Rosa Luxemburg qui, lors du congrès de l'Internationale socialiste, en 1896 (elle a 26 ans) ose se dresser contre toutes les "autorités" de l'Internationale pour combattre ce qui semblait être devenu un principe intangible du mouvement ouvrier : la revendication de l'indépendance de la Pologne.
[3] [211] Cette démarche se trouve à l'opposé de celle d'un Bordiga pour qui le programme du prolétariat est "invariant" depuis 1848. Cela dit, elle n'a évidemment rien à voir avec celle des "révisionnistes" à la Bernstein ou, plus récemment, à la Chaulieu, mentor du groupe "Socialisme ou Barbarie" (1949-1965). Elle est également complètement différente de celle du mouvement conseilliste qui, parce que la révolution russe de 1917 avait débouché sur une variante du capitalisme, a considéré qu'il s'agissait d'une révolution bourgeoise, ou qui se revendiquait d'un "nouveau" mouvement ouvrier par opposition à l'"ancien" (la deuxième et la troisième Internationales) qui aurait fait faillite.
[4] [212] Concernant l'attitude de la Fraction face aux événements d'Espagne, voir notamment la Revue internationale n°4, 6 et 7, 1976
[5] [213] Sur la Fraction italienne, voir notre brochure La Gauche communiste d'Italie.
[6] [214] Sur la question des rapports parti-fraction voir notre série d'articles dans la Revue Internationale n° 59, 61, 64 et 65 (1989-91).
[7] [215] Pendant quinze ans, notre camarade n'avait eu d'autre papier officiel qu'un ordre d'expulsion du territoire français dont il était obligé, toutes les deux semaines, de faire prolonger le délai d'exécution auprès des autorités. C'était une épée de Damoclès que le très démocratique gouvernement de la France, "terre d'asile et des droits de l'homme", avait suspendu au-dessus de sa tête, puisque Marc était obligé en permanence de s'engager à ne pas avoir d'activités politiques, engagement que, évidemment, il ne respectait pas. Au moment de la guerre, ce même gouvernement décrète que cet "apatride indésirable" est tout à fait apte à servir de chair à canon pour la défense de la patrie. Fait prisonnier par les troupes allemandes, il réussit à s'évader avant que les autorités d'occupation ne découvrent qu'il est juif. Il se rend alors, avec sa compagne Clara, à Marseille où la police, redécouvrant sa situation d'avant guerre, refuse de lui délivrer le moindre papier. Ironiquement, ce sont les autorités militaires qui obligeront les autorités civiles à changer d'avis en faveur de ce "serviteur de la France" d'autant plus "méritoire" à leurs yeux que ce n'était pas son pays.
[8] [216] Il faut noter que cette analyse, similaire à celle des trotskistes, n'a jamais conduit la Fraction à appeler à la "défense de l'URSS". Depuis le début des années 1930, et les événements d'Espagne ont parfaitement illustré cette position, la Fraction considérait l'Etat "soviétique" comme un des pires ennemis du prolétariat.
[9] [217] Il faut signaler que, malgré les errements de Vercesi, Marc lui a toujours conservé une grande estime personnelle. Cette estime s'étendait d'ailleurs à l'ensemble des membres de la Fraction italienne qu'il évoquait toujours dans les termes les plus chaleureux. Il faut l'avoir entendu parler de ces militants, presque tous des ouvriers, les Piccino, Tulio, Stefanini, dont il a partagé le combat dans les heures les plus sombres de ce siècle, pour mesurer tout l'attachement qu'il leur portait.
Conscience et organisation:
Personnages:
- Marc Chirik [219]
Courants politiques:
- Gauche Communiste [49]
Polémique avec Battaglia Comunista : le rapport fraction-parti dans la tradition marxiste (3° partie - II. Lénine et les bolcheviks)
- 2820 reads
Troisième partie : de Marx à Lénine, 1848-1917. II. Lénine et les bolcheviks
L'accélération actuelle de l'histoire, pleinement rentrée dans la phase de décomposition du capitalisme, pose de façon aiguë la nécessité de la révolution prolétarienne, comme seule issue à la barbarie du capitalisme en crise. L'histoire nous a enseigné qu'une telle révolution ne peut triompher que si la classe réussit à s'organiser de manière autonome (conseils ouvriers) par rapport aux autres classes et à sécréter l'avant-garde qui la guide vers la victoire : le parti de classe. Cependant, aujourd'hui, ce parti n'existe pas, et beaucoup baissent les bras parce que face aux tâches gigantesques qui nous attendent, l'activité des petits groupes révolutionnaires existants paraît dénuée de sens. Au sein même du camp révolutionnaire, la majorité des groupes réagit à l'absence de parti en répétant à l'infini son Très Saint Nom, invoqué comme le deus ex machina capable, grâce à sa seule évocation, de résoudre tous les problèmes de la classe. La désimplication individuelle et l'engagement déclamatoire sont deux manières classiques de fuir la lutte pour le parti, lutte qui se mène ici, aujourd'hui, en continuité avec l'activité des fractions de gauche qui se sont séparées dans les années 1920 de l'Internationale Communiste en dégénérescence.
Dans les deux premières parties de ce travail, nous avons analysé l'activité de la Gauche Communiste d'Italie, organisée en fraction dans les années 1930-1940, et la fondation prématurée d'un Parti Communiste Internationaliste, complètement artificiel, par des camarades de Battaglia Comunista en 1942.([1] [220])
Dans cette troisième partie, nous avons d'abord montré ([2] [221]) que la méthode de travail de fraction, dans les périodes défavorables où il n'était pas possible qu'existât un parti de classe, a été la seule méthode, employée par Marx lui-même. Dans ce numéro, nous montrerons en plus qu'une telle méthode marxiste de travail pour le parti a trouvé sa définition essentielle grâce à la lutte tenace de la fraction bolchevik du Parti Ouvrier Social-Démocrate de Russie (POSDR). Contre tous ceux qui se gargarisent des éloges du parti de fer de Lénine et d'ironie envers « les petits groupuscules des fractions de gauche », nous répétons que « l'histoire des fractions est l'histoire de Lénine » ([3] [222]) et que c'est seulement sur la base du travail qu'elles ont accompli qu'il sera possible de reconstruire le parti communiste mondial de demain.
« Sans les fractions, Lénine lui-même serait reste un rat de bibliothèque »
Avec les citations que nous avons données dans le numéro précédent, nous avons vu comment Battaglia Comunista (BC) ne perd pas une occasion d'ironiser sur le fait que le « Que Faire ?» de Lénine, de 1902, serait le vade-mecum du parfait fractionniste et, en conséquence, ne laisse pas passer une opportunité de faire le dégoûté pour la énième fois ([4] [223]). Si ces camarades arrêtaient de s'exciter à scander le mot parti et commençaient plus sobrement à étudier l'histoire du parti, ils découvriraient que « Que Faire ? » pouvait difficilement parler de la fraction bolchevik, étant donné qu'elle s'était constituée à Genève en juin... 1904 (réunion des «22») ([5] [224]). C'est à partir de là que les bolcheviks ont commencé à développer la notion de la fraction et de ses rapports avec l'ensemble du Parti, notion qui prendra sa forme définitive avec 'expérience de la révolution de 1905 et surtout de la phase de réaction qui suivit sa défaite ([6] [225]) :
« Une fraction est une organisation à l'intérieur du parti, qui est unie non pas par le lieu de travail, par la langue ou par quelque autre condition objective, mais par un système de conceptions communes sur les problèmes qui se posent au parti. » ([7] [226])
«A l'intérieur du parti, on peut trouver toute une gamme d'opinions diverses dont les extrêmes peuvent être tout à fait contradictoires (...). Mais dans une fraction, les choses sont différentes. Une fraction est un groupe fondé sur l'unité de pensée, dont l'objectif premier est d'influencer le parti dans une direction bien déterminée et de faire adopter ses principes, sous leur forme la plus pure, par le parti. Pour cela, une unité de pensée véritable est indispensable. Quiconque veut comprendre comment se pose réellement le problème des divergences internes au sein de la fraction bolchevik doit bien se rendre compte que l'unité de la fraction et celle du parti ne relèvent pas pour nous des mêmes exigences. » ([8] [227])
«Mais une fraction, en tant qu'expression d'une unité de pensée dans le parti, ne peut subsister si ses militants «ne se rencontrent pas sur les problèmes fondamentaux. Quitter une fraction, ce n est pas quitter le parti. Les camarades qui se sont séparés de notre fraction ont toujours la possibilité de travailler dans le parti. » ([9] [228])
La fraction est donc une organisation à l'intérieur du parti, bien identifiée par une plate-forme précise, qui se bat pour influencer le parti, et qui se donne pour objectif final le triomphe dans le parti de ses principes « sous leur forme la plus pure » c'est-à-dire sans médiation ou non-homogénéité. Pendant ce temps, la fraction travaille dans le parti, avec les autres fractions qui défendent d'autres plates-formes, de façon à ce que l'expérience pratique et le débat politique public permettent à l'ensemble du parti de se rendre compte de quelle est la plate-forme qui est juste. Cette coexistence est possible à condition que, dans le parti, il n'y ait pas de place pour ceux qui ont déjà fait des choix qui les mènent à l'extérieur du parti et dont le maintien à l'intérieur de l'organisation ne peut que mener à la liquidation de l'organisation elle-même. C'est ce que représentait en Russie le courant des « liquidateurs » qui se battait pour la dissolution du parti illégal et sa soumission à la « légalité » tsariste. a divergence de fond entre les bolcheviks et les autres fractions résidait justement en ceci que les autres, tout en condamnant en général les liquidateurs, continuaient à les considérer comme des membres du parti, alors que les bolcheviks estimaient qu'il devait y avoir de la place dans le parti socialiste pour toutes les opinions, exceptées celles qui étaient anti-socialistes :
« C'est le fondement de la conciliation qui est erroné ; sa volonté d'édifier l'unité du parti du prolétariat sur l'alliance de tous, y compris des fractions anti-social-démocrates, non prolétariennes, c'est l'absence de principes de sa perspective " unificatrice " qui est erronée et conduit à l'absurde, ce sont les phrases contre les "fractions" (qui s'accompagnent en fait de la formation d'une nouvelle fraction). » ([10] [229])
Il est intéressant de noter que ces lignes de Lénine sont dirigées contre Trotsky qui fut dans le POSDR le principal ennemi de l'existence organisée de fractions qu'il rejetait comme inutiles et dommageables pour le parti. L'incompréhension totale de la part de Trotsky de la nécessité du travail de fraction aura des conséquences catastrophiques pendant et après la dégénérescence de la révolution russe.
« On doit noter que Trotsky - dans toutes les questions relatives à la révolution de 1905, comme pendant toute la période qui suivit - fut généralement avec les bolcheviks pour toutes les questions de principe et avec les mencheviks pour toutes les questions d'organisation. Son incompréhension de la juste notion du Parti, au cours de cette période, détermina sa position "hors fraction" en faveur de l'unité à tout prix. Sa pitoyable position actuelle - qui le pousse dans les bras de la social-démocratie- nous prouve que Trotsky n'a, à ce sujet, rien appris des événements. » ([11] [230])
Naturellement, Lénine a été violemment attaqué, soit dans le mouvement russe, soit dans le mouvement international, pour sa folie sectaire et scissionniste, pendant que tous en choeur réclamaient la « fin du ractionnisme ». En fait, le premier à vouloir la fin du fractionnisme, c'était Lénine lui-même, qui savait bien que l'existence de fractions était un symptôme de crise dans le parti. Mais il savait aussi que la lutte ouverte, pratique, de fraction, était l'unique remède valable pour la maladie du parti, parce que ce n'était que de la confrontation publique des plates-formes que pouvait naître la clarté sur la voie à suivre :
« Toute fraction est convaincue que sa plate-forme et sa politique sont les meilleures pour supprimer les fractions, car personne ne considère l'existence de celles-ci comme un idéal. La différence est seulement que les fractions qui ont une plate-forme claire, conséquente, cohérente, défendent ouvertement leur plate-forme, tandis que les fractions sans principe se cachent derrière des protestations gratuites de vertu, de non-fractionnisme). » ([12] [231])
Un des principaux mensonges hérités du stalinisme est celui d'une tradition bolchevik monolithique, où il n'y avait pas de place pour les vains bavardages et les débats pour intellectuels, mensonge par ailleurs dans le fil des accusations mencheviks de « fermeture aux débats » constamment adressées aux bolcheviks. Bien sur, il est tout à fait vrai qu'entre les mencheviks et les conciliateurs, la discussion était « libre », alors que, entre les bolcheviks, elle était « obligée». Mais c est vrai dans le sens où les premiers se sentaient libres de discuter quand cela les arrangeait et de se taire quand ils avaient des divergences à cacher. Pour les bolcheviks au contraire, la discussion n'était pas libre mais obligatoire et devenait d'autant plus obligatoire que des divergences naissaient à l'intérieur de la fraction, divergences qu'il fallait discuter publiquement pour qu'elles se résorbent ou soient poussées jusqu'au bout avec une séparation organisationnelle fondée sur des motifs clairs :
« C'est dans ce but que nous avons ouvert une discussion sur ces problèmes dans les colonnes du Proletari. Nous avons publié tous les textes qui nous ont été envoyés et nous avons reproduit tout ce qui, en Russie, a été écrit sur la question par des bolcheviks. Jusqu'à présent nous n'avons pas refusé une seule contribution à la discussion et nous continuerons à agir ainsi. Malheureusement les camarades otzovistes et ceux qui sympathisent avec leurs idées ne nous ont encore envoyé que peu de matériaux, et, d'une façon générale, ils se sont montres réticents à exposer leur credo théorique clairement et complètement dans la presse, préférant les conversations "privées". Mous invitons tous les camarades, qu'ils soient otzovistes ou bolcheviks orthodoxes à exposer leur opinion dans les colonnes du Proletari. Il le faut, nous éditerons les textes qui nous parviendront en brochure spéciale. (...) Notre fraction, par contre, ne doit pas craindre la lutte idéologique interne, à partir du moment où elle est nécessaire. Dans cette lutte en effet, elle va encore se renforcer). »([13] [232])
Tout ceci démontre largement l'énorme contribution faite par Lénine à la définition historique de la nature et de la fonction de la fraction, malgré toute l'ironie que Battaglia réserve aux « dix commandements du bon fractionniste». Notons en passant que c'est ce même BC qui, dans une phrase, parle d'alternative de Parti à partir de 1902, et qui, dans une autre, dit que e parti a agi en tant que tel « au moins à partir de 1912 ». Et alors, de 1902 à 1912, qu'a donc fait Lénine - étant donné qu'il ne faisait pas de travail de fraction -, de la cuisine macrobiotique ? En réalité, pour BC, ce qui lui tient à coeur, c'est d'affirmer que es bolcheviks ne se sont pas limités à faire du travail théorique et de formation de cadres, mais qu'ils faisaient aussi un travail en direction des masses et, donc, qu'ils ne pouvaient pas être une fraction. Dans les faits, pour Battaglia, le choix de travailler comme fraction est un choix de fuir la lutte de classe, de refuser de se salir les mains avec les problèmes des masses, ce qui mène « à se limiter à une politique édulcorée de prosélytisme mesuré et de propagande et à se centrer sur les études des soi-disant problèmes de fond, réduisant ainsi les tâches du parti à des tâches de fraction sinon de secte.» ([14] [233])
Les jeux sont faits : d'un côté, il y a Lénine, qui pense aux masses, et qui ne peut donc qu'être le parti, de l'autre, en opposition, il y a la Gauche Italienne à l'étranger, dans les années 1930, qui oeuvre comme fraction et qui ne peut donc être qu'un cénacle d'étudiants et de petits professeurs. Nous avons déjà vu quelle a été la véritable activité de Lénine, examinons maintenant quelle a été la véritable activité de la Gauche Italienne :
« Il pourrait sembler que les tâches de la fraction soient exclusivement didactiques. Mais une telle critique peut être repoussée par les marxistes avec les mêmes arguments à l'égard de tous les charlatans qui considèrent la lutte du prolétariat pour la révolution et pour la transformation du monde au même titre que l'action électorale..
Il est parfaitement exact que le rôle spécifique des fractions est surtout un rôle d'éducation de cadres au travers des événements vécus, et grâce à la confrontation rigoureuse de la signification de ces événements. Cependant, il est vrai que ce travail, surtout idéologique, est fait en considération des mouvements de masse et fournit constamment la solution politique pour la réussite. Sans le travail des fractions, Lénine lui-même serait resté un rat de bibliothèque et ne serait pas devenu un chef révolutionnaire
Les fractions sont donc les seuls endroits historiques où le prolétariat continue son travail pour son organisation en classe. De 1928 jusqu'à maintenant, le camarade Trotsky a complètement négligé ce travail de construction des fractions, et, de ce fait, il n'a pas contribué à réaliser les conditions effectives pour les mouvements de masse ). »([15] [234])
Comme on le voit, l'ironie de Battaglia sur la fraction comme secte, qui fuit les masses, tombe encore une fois mal à propos. Le souci qui anime Bilan est le même que celui qui animait les bolcheviks, celui de contribuer à réaliser les conditions effectives pour les mouvements de masse. Le fait que l'ampleur des liens avec les masses qu'avaient les bolcheviks dans les années 1910 et la Gauche italienne dans les années 1930 ait été très différente, ne dépend certes pas des tendances personnelles de celui-ci ou de celui-la, mais des conditions objectives de la lutte de classe, qui différaient énormément. La fraction bolchevik n'était pas constituée d'un groupe de camarades qui avaient survécu au passage du parti à l'ennemi de classe dans une période de contre-révolution et de profonde défaite du prolétariat. C'était une partie (souvent majoritaire) d'un parti prolétarien de masse (comme tous les partis de la 2e Internationale), qui s'était constituée dans une phase immédiatement prérévolutionnaire (1904) et qui s'était développée au sein d'une gigantesque vague révolutionnaire qui, pendant deux ans (1905-1906), va secouer l'empire russe tout entier, de l'Oural à la Pologne. Si on veut faire des comparaisons quantitatives entre l'action de la fraction de gauche italienne et celle des bolcheviks, il faut se référer à une période qui a certains aspects historiquement comparables, c'est-à-dire aux années révolutionnaires entre 1917 et 1921. Dans ces années-là, la Fraction Communiste Abstentionniste (fraction de gauche du PSI) se développe au point qu'elle finit par comprendre, au moment de sa constitution en Parti Communiste d'Italie, un tiers des inscrits au vieux parti socialiste de masse et la totalité de la fédération des jeunes. Les camarades qui ont été capables d'orienter ce processus militaient, dix ans après, dans la Fraction de Gauche à l'étranger, en nombre réduit à une dizaine de cadres. Qu'est-ce qui avait changé ? Est-ce que ces camarades n'avaient plus la volonté de diriger des mouvements de masse ? Evidemment non :
« Depuis que nous existons, il ne nous a pas été possible de diriger des mouvements de classe, il faut bien se mettre en tête que cela n'a pas dépendu de notre volonté, de notre incapacité, ou du fait que nous étions fraction, mais d'une situation dont nous avons été les victimes comme en est victime le prolétariat révolutionnaire du monde entier. » (Bilan n° 28, 1935)
Ce qui avait changé, c'était donc la situation objective de la lutte de classe, qui était passée d'une phase pré-révolutionnaire mettant à l'ordre du jour la transformation de la fraction en parti, à une phase contre-révolutionnaire qui obligeait la fraction à résister à contre-courant, contribuant par son travail au développement de nouvelles situations qui remettraient à 1 ordre du jour sa transformation en parti.
De la fraction bolchevik du POSDR au parti communiste russe
Comme toujours, quand on critique les positions de BC, on revient au point crucial, c'est-à-dire aux conditions pour la naissance du parti. On a vu comment BC aimerait bien blanchir Lénine de l'infâme qualificatif de « bon fractionniste », à partir de 1902 déjà. En voulant faire des concessions, BC est prête à admettre, du bout des lèvres, que le parti bolchevik n'a existé qu'à partir de 1917, a condition qu'il soit clair qu'il existait avant la période révolutionnaire qui s'est ouverte en février 1917. Ce qu'il faut éviter à tout prix d'admettre, c'est que la lutte de la fraction bolchevik du POSDR s'est conclue sur sa transformation en Parti Communiste Russe (bolchevik) en 1917 seulement, parce que ce serait admettre que «la transformation de la fraction en parti est conditionnée (...) par le surgissement de mouvements révolutionnaires qui pourront permettre à la fraction de reprendre la direction des luttes pour l'insurrection » (Bilan n° 1, 1933). Il faut donc clarifier si cette transformation s'est produite ou non en 1912, cinq ans avant la révolution.
Qu'est-il arrivé en 1912? Il s'est tenu à Prague une conférence des organisations territoriales du POSDR qui travaillent en Russie, conférence qui a réorganisé le parti démoli par la réaction qui a suivi la défaite de la révolution de 1905, et élu un nouveau comité central, pour remplacer l'ancien désormais dissout. La Conférence et le nouveau comité central sont dominés par les bolcheviks, alors que les autres tendances du POSDR ne participent pas à l'initiative « scissionniste » de Lénine. A première vue, il semblerait que Battaglia ait raison : une conférence de bolcheviks a pris l'initiative de reconstruire le parti, indépendamment des autres fractions, donc, à partir de ce moment-là, les bolcheviks agissent comme parti, sans attendre l'ouverture d'une phase prérévolutionnaire. Mais si nous regardons les choses de plus près, nous voyons qu'il en va tout à fait différemment. La naissance d'une fraction révolutionnaire au sein du vieux parti se produit en réaction aux maladies du parti, à son incapacité à élaborer des réponses adéquates aux nécessités historiques, aux lacunes de son programme. La transformation de la fraction en parti ne veut pas dire qu'on retourne simplement au statu quo antérieur, au vieux parti épuré des opportunistes ; cela veut dire formation d'un nouveau parti, fondé sur un nouveau programme qui élimine les ambiguïtés précédentes en recourant aux principes de la fraction révolutionnaire «sous leur forme la plus pure ». Dans le cas contraire, on retournerait au point de départ en posant les bases pour que ressurgisse inévitablement la même déviation opportuniste qui vient d'être chassée. Et c'est ce qu'aurait fait Lénine en 1912, la transformation de la fraction en parti basé sur un nouveau programme ? Pas même en idée. En premier lieu, la résolution approuvée par la conférence déclare s'être réunie «pour rassembler toutes les organisations russes du parti sans distinction de fractions et pour reconstituer notre parti. » ([16] [235]) Il ne s'agit donc pas d'une conférence purement bolchevik, d'autant plus que son organisation a été en grande partie confiée au comité territorial de Kiev dominé par les mencheviks partidistes, et que ce fut justement un menchevik qui présidait la commission de vérification des mandats ([17] [236]). Modifier le vieux programme, on n'en parla pas, et les décisions prises consistaient simplement à mettre en pratique des résolutions condamnant les liquidateurs, approuvées en 1908 et en 1910 par « les représentants de toutes les fractions». Donc la Conférence non seulement se compose de « membres du partisans distinction de fractions», mais se base encore sur une résolution approuvée par « des représentants de toutes les fractions». Il est évident qu'il ne s'agit pas de la constitution du nouveau parti bolchevik, mais de la simple réorganisation du vieux parti social-démocrate. Cela vaut la peine de souligner qu'une telle réorganisation n'était considérée comme possible qu'« en rapport avec le resurgissement du mouvement ouvrier» ([18] [237]) après les années de réaction de 1907 à 1910. Comme on le voit. Lénine, non seulement ne pensait pas du tout fonder un nouveau parti avant les batailles révolutionnaires, mais ne se donnait même pas l'illusion de réorganiser ce vieux parti en l'absence d'une nouvelle période de lutte de classe. Les camarades de Battaglia - et pas seulement eux - sont tellement hypnotisés par le mot parti qu'ils en deviennent incapables d'analyser les faits lucidement, prenant pour un tournant décisif ce qui n'était qu'une étape très importante dans le processus de démarcation d’avec 1'opportunisme. L'élection en 1912 du comité central par une conférence à prédominance bolchevik ne peut pas être considérée comme la preuve de la fin de la phase de fraction et le début de celle du parti, pour le simple motif que, à Londres en 1905, il y avait déjà eu une conférence exclusivement bolchevik qui s'était proclamée 3e congrès du parti et qui avait élu un comité central entièrement bolchevik, considérant les mencheviks en dehors du parti. Mais l'année suivante déjà, Lénine s'était rendu compte de l'erreur qui avait été commise et, au congrès de 1906, le parti s'était réunifié en maintenant les deux fractions comme fractions d'un même parti. De manière analogue, de 1912 à 1914, Lénine estime que la phase de lutte de fraction est désormais en voie d'extinction et que l'heure de la sélection définitive a sonné. Cela pouvait être vrai d'un point de vue strictement russe, mais c'était certainement prématuré d'un point de vue international :
« Ce travail fractionnel de Lénine s'effectue uniquement au sein du parti russe, sans qu'il essayât de le porter à l'échelle internationale. Il suffit, pour s'en convaincre, de lire ses interventions aux différents congrès et l'on peut affirmer que ce travail resta complètement inconnu en dehors des sphères russes. » ([19] [238])
Dans les faits, la sélection définitive se fera entre 1914 et 1917, face à la double épreuve de la guerre et de la révolution, divisant les socialistes en sociaux-patriotes et internationalistes. Lénine s'en est parfaitement rendu compte et, de même qu'en 1906 il s'était battu pour la réunification du parti, de même, en février 1915, en répondant au groupe « Naché Slovo » de Trotsky, il écrivait : « Nous sommes absolument d'accord avec vous pour dire que le rassemblement de tous les véritables sociaux-démocrates internationalistes est l’une des tâches les plus urgentes du moment présent. » ([20] [239]) Le problème tenait en cela que, pour Lénine, l'unification des internationalistes ans un parti effectivement communiste n'était possible qu'a condition d'en écarter ceux qui ne se montraient pas vraiment internationalistes jusqu'au bout, alors que Trotsky - comme d'habitude - voulait concilier l'inconciliable, entendait fonder l'unité du parti internationaliste « sur l'union de toutes les fractions », y compris celles qui n'étaient pas disposées à rompre avec les ennemis de l'internationalisme. Pendant trois années, Lénine s'est battu de façon incessante contre ces illusions en transférant sa lutte de fraction pour la clarté du terrain purement russe à celui, international, de la « gauche de Zimmerwald » ([21] [240]).
Cette grandiose lutte internationale constitue l'apogée et la conclusion du travail de fraction des bolcheviks qui allaient avoir les cartes en main à l'éclatement de la révolution en Russie. Grâce à cette tradition de lutte et au développement d'une situation révolutionnaire, Lénine peut, dès son retour en Russie, proposer l'unification des bolcheviks avec les autres internationalistes conséquents, sur la base d'un nouveau programme et sous le nom de Parti Communiste, en remplacement du vieux terme social-démocrate. C'est alors qu'intervient la dernière sélection avec la droite bolchevik (Voitinsky, Goldenberg), qui passe au menchevisme, tandis que le centre des « vieux bolcheviks » (Zinoviev, Kamenev) s'oppose à Lénine au nom ... du vieux programme sur lequel s'était basée la conférence de 1912. Lénine sera accusé d'être le «fossoyeur de la tradition du parti » et répliquera en démontrant que toute la lutte des bolcheviks n'a été qu'une préparation à un vrai parti communiste : « Fondons un parti communiste prolétarien ; les meilleurs partisans du bolchevisme en ont déjà créé les éléments. » ([22] [241])
C'est ici que se conclut la grande lutte de la fraction bolchevik, c'est ici qu'on a la réelle transformation en parti. Nous disons réelle parce que, d'un point de vue formel, le nom de Parti Communiste ne sera adopté qu'en mars 1918, alors que la version définitive du nouveau programme sera ratifiée seulement en mars 1919. Mais le passage -en substance- se produit en avril 1917 (8e conférence pan-russe bolchevik). Il ne faut pas oublier que ce qui différencie un parti d'une fraction, c'est sa capacité à influer directement sur les événements. Le parti est en fait « un programme, mais aussi une volonté d'action » (Bordiga), à condition, évidemment, que cette volonté puisse s'exprimer dans des circonstances objectivement favorables au développement d'un parti de classe. En février 1917, les bolcheviks étaient quelques milliers et n'avaient joué aucun rôle de direction dans le soulèvement spontané qui ouvrit la période révolutionnaire. A la fin d'avril, ils sont plus de 60 000 et ils se profilent déjà comme l'unique opposition réelle au gouvernement provisoire bourgeois de Kérenski. Avec l'approbation des Thèses d'avril et de la nécessité d'adopter un nouveau programme, la fraction devient parti et pose les bases de 1’octobre Rouge.
***
Dans la prochaine partie de ce travail, nous verrons comment les conditions particulières et historiquement originales de la dégénérescence de la révolution russe ont empêché le surgissement d'une fraction de gauche pour reprendre, dans le parti bolchevik en dégénérescence, la bataille de Lénine à l'intérieur du parti social-démocrate. L'incapacité de l'opposition russe de se constituer en fraction sera ensuite a la base de la faillite historique de l'Opposition Internationale trotskiste, alors que la Gauche Italienne, en reprenant la méthode de travail de Marx et de Lénine, arrivera à partir de 1937 à se constituer en Gauche Communiste Internationale ([23] [242]). Nous verrons de plus comment l'abandon de cette méthode de travail par les camarades qui ont fondé le PC Internationaliste en 1943 a été à la base de leur incapacité d'agir comme pôle de regroupement révolutionnaire entre les organisations (Battaglia Comunista et Programma Comunista) qui provenaient de ce parti.
Beyle
[1] [243] Les deux premières parties ont été publiées dans les Revue Internationale n° 59 et 61. Pour une analyse approfondie de l'activité de ce courant, il est recommandé de lire nos deux volumes : La Gauche Communiste d'Italie, 1927-1952 et Rapports entre la fraction de gauche du PC d'Italie et l'Opposition de Gauche Internationale, 1929-1933.
[2] [244] Voir «Troisième partie : de Marx à Lénine, 1848-1917. Lénine et les bolcheviks » dans la Revue Internationale n° 64.
[3] [245] Intervention de Bordiga au 6e comité exécutif élargi de l'Internationale Communiste, en 1926.
[4] [246] «En 1902 déjà, Lénine avait jeté les bases tactiques et organisationnelles sur lesquelles avait dû se construire l'alternative à l'opportunisme de ta social-démocratie russe, alternative de parti, à moins qu'on ne veuille faire passer le «Que Faire?» pour les dix commandements du bon fractionniste » (« Fraction et parti dans l'expérience de la Gauche italienne», dans Prometeo n°2, mars 1979.)
[5] [247] Les bolcheviks du Congrès de 1903 du POSDR étaient le fruit de l'alliance temporaire entre Lénine et Plekhanov. La fraction de 1904 s'appelle bolchevik (majoritaire) pour se réclamer des positions défendues par la majorité au congrès de 1903.
[6] [248]Il est significatif que la théorisation complète du concept de fraction effectuée par Lénine arrive seulement dans les années de féroce réaction à la suite de la révolution de 1905. Ce n'est que l'activité de fraction qui permet de résister dans les périodes défavorables.
[7] [249] «Au sujet d'une nouvelle fraction de conciliateurs, les vertueux», Social-Démocrate n°24, 18(31) octobre 1911, Lénine, Oeuvres complètes, tome 17, Editions de Moscou.
[8] [250] « Conférence de la rédaction élargie du "Proletari", 8-17 (21-30) juin 1909, supplément au n°46 du Proletari, Oeuvres complètes, tome 15, p. 40l.
[9] [251] « La liquidation en voie d'être liquidée », Proletari n° 46, 11 (24) juillet 1909. Cité par Lénine, Oeuvres complètes, tome 15, p. 490.
[10] [252] Au même endroit, note n° 7.
[11] [253] « Le problème des fractions dans la 2e Internationale», dans Bilan n° 24, 1935.
[12] [254] Au même endroit, note n° 7.
[13] [255] « A propos de l'article "Sur les questions actuelles" », Proletari n°42, 12 (25) février 1909. Cité par Lénine, Oeuvres complètes, tome 15, p. 383. L'otzovisme constituait une dissidence interne à la fraction bolchevik dans les années les plus noires du reflux, tendant à tomber d'un travail de fraction dans celui d'un réseau.
[14] [256] Plate-forme politique du PC Internationaliste (BC) de 1952. Dans une récente remise à jour de 1982, ce morceau a été reproduit sans changement.
[15] [257] «Vers l'internationale 2 et 3/4 ». dans Bilan n° 1, 1933, extraits publiés dans le Bulletin d'Etude et de Discussion publié par Révolution Internationale, n° 6, avril 1974.
[16] [258] « Résolution de la conférence, point sur la commission d'organisation de Russie chargée de la convocation de la conférence », texte de la 6e conférence générale (dite de Prague) du POSDR, 6-17 (18-30) janvier 1912. Cité par Lénine, Oeuvres complètes, tome 17, p. 467.
[17] [259] « La situation dans le POSDR et les tâches immédiates du Parti », texte du 16 juillet 1912, Gazeta Robotnicza n° 15-16. Cité par Lénine, Oeuvres complètes, tome 18, p. 155 : « (...) C'est précisément le délégué de cette organisation (de Kiev) qui fut président de la commission des mandats a la conférence ! ».
[18] [260] Tiré des résolutions de la conférence. Lénine revient encore en 1915 sur ce sujet : « Les années 1912-1914 ont marqué le début d'un nouvel et prodigieux essor révolutionnaire en Russie. Nous avons de nouveau assiste à un vaste mouvement de grève, sans précédent dans le monde. La grève révolutionnaire de masse a englobe en 1913, selon les estimations les plus modestes, un million et demi de participants ; en 1914, elle en comptait plus de 2 millions et se rapprochait du niveau de 1905. » (Le socialisme et la guerre, juillet-août 1915, chap. 2. « Les classes et les partis en Russie. La classe ouvrière et la guerre. ». Oeuvres complètes 6e Lénine, tome 21, p. 330).
[19] [261] « Le problème des fractions dans la 2e Internationale », dans Bilan n° 24, 1935.
[20] [262] Lettre du comité central du POSDR à la rédaction du Naché Slovo, 10 (23) mars 1915. Cité par Lénine, Œuvres complètes, tome 21, p.164.
[21] [263] Pour mieux comprendre le rôle des bolcheviks dans la gauche de Zimmerwald, voir l’article publié dans la Revue Internationale, n°57.
[22] [264] « Sur la dualité de pouvoir », Pravda n°28, 9 avril 1917. Cité par Lénine, Œuvres complètes, tome 24, p.31.
[23] [265] Pour une analyse du travail de la fraction italienne du PC d’Italie dans les années 1930, voir la première partie du présent article dans la Revue Internationale, n°59
Courants politiques:
- Battaglia Comunista [66]
Questions théoriques:
- Parti et Fraction [67]
Revue Internationale no 66 - 3e trimestre 1991
- 2737 reads
Editorial : LE CHAOS
- 3015 reads
Un mot revient sur toutes les bouches à propos de la situation mondiale : chaos. Un chaos qu'on constate comme une réalité criante ou comme une menace imminente. La guerre du Golfe n'a pas ouvert les portes d'un « nouvel ordre mondial ». Elle a permis au capital américain de rétablir son autorité, en particulier sur ses alliés-concurrents d'Europe et du Japon, et de s'affirmer comme le « gendarme du monde ». Mais le tourbillon de désordres dans lequel s'enfonce la société ne cesse de s'accélérer, poussé par les vents dévastateurs de l'entrée en récession ouverte des premières puissances économiques mondiales.
Quatre mois après la fin de la guerre, en Irak même, dans les zones Kurdes et Chiites le sang continue de couler et le feu de la guerre n'est pas éteint. Au Moyen-Orient, derrière les discours sur les conférences de paix, les antagonismes militaires s'exacerbent et Israël reprend les bombardements au Sud-Liban. Dans les républiques soviétiques, les affrontements armés, loin de s'atténuer s'intensifient concrétisant l'éclatement de l'ancien Empire. En Afrique du Sud la population noire, soi-disant libérée de l'Apartheid, vit ensanglantée par les plus meurtriers affrontements entre l'ANC et l'Inkatha. Dans les bidonvilles de Lima s'étend le choléra au milieu des incendies allumés par les staliniens du Sentier Lumineux. En Corée du Sud, des jeunes se suicident par le feu pour protester contre la répression gouvernementale. En Inde l'assassinat du dernier des Gandhi met a nu la dislocation de « la plus grande démocratie du monde », déchirée par les conflits de castes, de religions et de nationalités. En Ethiopie, une des zones de la planète les plus frappées par la famine, l'effondrement du gouvernement Mengistu, abandonné par son protecteur soviétique, laisse le pays aux mains de trois bandes armées nationalistes rivales qui veulent se partager le pays. La Yougoslavie est au bord de l'éclatement sous la pression des affrontements quotidiens entre les nationalités qui la composent. En Algérie de jeunes chômeurs embrigadés par les « islamistes » du FIS sont envoyés contre les chars du gouvernement FLN. Dans les ghettos des banlieues de Washington, Bruxelles ou Pans se multiplient pillages et affrontements stériles contre la police. Au coeur de l'Europe, dans l'ex-Allemagne de l'Est le capital s'apprête a mettre au chômage prés de la moitié des travailleurs...
La classe dominante ne peut pas comprendre pourquoi la société, « sa » société plonge irréversiblement dans un désordre croissant où la guerre le dispute à la misère, la dislocation au désespoir. Son idéologie, l'idéologie dominante, n'a pas d'explication. Elle n'existe que pour vanter les vertus de l’ordre existant. Pour continuer à maintenir son emprise, elle n'a d'autre moyen que le mensonge et la confusion sciemment organisés. Une confusion qui traduit tout autant le stupide aveuglement historique de la bourgeoisie décadente que le cynisme mensonger dont celle-ci est capable pour protéger et justifier son « ordre » en décrépitude.
La guerre, telle qu'elle est venue se rappeler à nous dans toute son horreur dans le Golfe, reste la manifestation la plus tragique de cette réalité où le mensonge organisé accompagne en permanence le chaos le plus barbare.
LE BILAN DE LA GUERRE DU GOLFE
Avec le plus abject des cynismes, la classe dominante des pays de la Coalition, gouvernement américain en tête, s'est attachée et s'attache à travestir le massacre du Golfe. Alors que face à l'effondrement des régimes de l'Est, elle a multiplié les hymnes aux «libertés démocratiques occidentales qui triomphent sur l'obscurantisme stalinien », elle a au même moment réalisé une des plus colossales opérations de mensonge et de désinformation de l'histoire.([1] [266]) Une opération marquée aussi bien par l'ampleur des moyens employés (le gouvernement US disposait, entre autres, d'une chaîne de télévision diffusant son poison d'informations-propagande vingt-quatre heures sur vingt-quatre sur la totalité de la planète), comme par l’énormité des contrevérités distillées : Michael Deaver, ancien conseiller « à la communication » de Reagan, actuel secrétaire général adjoint à la Maison Blanche avait clairement défini l'objectif à atteindre : la guerre doit être présentée comme « une combinaison de Lawrence d'Arabie et de la Guerre des étoiles » ([2] [267]). Ce fut fait. Les écrans de télévision furent inondés par les armes les plus sophistiquées et tout fut entrepris pour donner l'impression d'un véritable Wargame, as une image des victimes du déluge de feu qui s'abattit sur les soldats et la population civile irakienne, ne vint troubler cet ignoble spectacle de «guerre propre».
Le bilan de la guerre en Irak est pourtant atroce. On ne saura vraisemblablement jamais le nombre exact des victimes côté irakien. ([3] [268]) Mais toutes les estimations comptent en centaines de milliers. Probablement près de 200 000 tués parmi les soldats : jeunes paysans, ouvriers, enrôlés de force, le fusil derrière le dos, postés en masse devant l'ennemi, coincés entre des champs de mines à l'avant et la Garde Républicaine à l'arrière, prête à fusiller sur le champ tout déserteur. ([4] [269]) Près des deux tiers des soldats tués l'ont été pendant les bombardements aériens, enterrés vivants dans leurs bunkers ; ceux qui sont morts pendant la guerre terrestre, ont en grande partie été lâchement massacrés alors qu'ils battaient en retraite. Dans la population civile - enfants, femmes, vieillards et hommes qui ont échappé à l'enrôlement forcé - on compte un nombre analogue de tués par les bombardements.
Le pays a été en grande partie rasé par la guerre. Toutes les infrastructures ont été touchées. « Pour les temps qui viennent, l'Irak a été relégué à un âge préindustriel», déclarait une commission d'enquête des Nations Unies envoyée en mars en Irak. L’état des installations hospitalières, le manque de médicaments condamnent à mort des milliers de blessés et de victimes des épidémies, du manque d'eau et d'aliments. Tel est le premier résultat de l'opération menée par les « héroïques armées » des puissances occidentales.
Il faudra ajouter à ce bilan, les destructions et les victimes du massacre des populations Kurdes et Chiites. Car au moment même où le gouvernement américain organisait le spectacle grotesque d'une orgie patriotarde à New York, faisant défiler les « vainqueurs » de la boucherie du Golfe entre les gratte-ciels de Broadway, en Irak, les populations Kurdes et Chiites subissaient encore la plus sanglante répression de la part du gouvernement de Saddam Hussein.
De quelle victoire s'agissait-il ? Ces soldats n'étaient-ils pas partis dans le Golfe pour empêcher l’« Hitler du Moyen Orient » de continuer à sévir ?
La réalité, clairement confirmée par les déclarations de dirigeants nationalistes Kurdes, est bien que c'est le gouvernement américain qui a froidement et cyniquement provoqué le massacre des populations Kurdes et Chiites. ([5] [270]) Et si l'équipe de Bush a gardé « le boucher de Bagdad » au pouvoir c'est, entre autres, parce que celui-ci lui était utile pour se charger de la besogne, avec le talent qu'on lui connaît dans ce domaine. Les destructions massives résultant de cette répression, montrées cette fois-ci en détail par les médias, ont été utilisées pour tenter de faire oublier celles provoquées par la Coalition. Les armées alliées, après avoir assisté immobiles à cette nouvelle boucherie, ont pu jouer sur tous les écrans du monde le rôle de sauveurs humanitaires auprès des réfugiés kurdes. (Voir dans ce numéro : « Les massacres et les crimes des grandes démocraties »).
La barbarie du militarisme et du chaos, travestie par la plus gigantesque machine de manipulation idéologique, c'était cela la guerre du Golfe. C'est cela 'avenir qu'elle annonce.
Pour les classes exploitées de la région, en uniforme ou non, le bilan de la guerre est celui d'un carnage auquel elles n'ont participé que comme chair à canon, comme cobaye pour tester l'efficacité des derniers modèles des armes les plus sophistiquées. Pour le prolétariat mondial c'est une défaite, un crime de plus du capital, qu'il n'aura pas pu empêcher. Mais c'est aussi une leçon, un rappel de ce qui l'attend s'il ne sait pas s'unifier pour mettre fin à cette société.
LA VERITABLE VICTOIRE DU CAPITAL AMERICAIN
Il en est tout autrement pour les criminels qui ont provoqué cette guerre. Pour le gouvernement américain, la mission des soldats envoyés dans le Golfe n'était évidemment pas de protéger les populations locales contre les exactions de Saddam Hussein. Contrairement à ce qu'ils croyaient eux-mêmes, contrairement à ce que racontait la propagande de leurs gouvernements, les soldats de la Coalition avaient pour seule et vraie mission de faire une violente démonstration de force et de détermination de la part du capital US. Un étalage sanglant de puissance, devenu indispensable face au chaos international déclenché par l'effondrement de l'URSS, et qui menaçait de remettre en question la position de la première puissance mondiale.([6] [271])
C'est le gouvernement de Washington qui a voulu et provoque cette guerre. C'est son ambassadrice April Glaspie qui, au cours d'entretiens avec Saddam Hussein, alors que celui-ci envisageait pratiquement l'invasion du Koweït, a déclaré que les USA étaient indifférents à la querelle Irak-Koweit, querelle qu'ils considéraient comme <r interne au monde arabe », ([7] [272]) laissant entendre que la Maison Blanche donnait son feu vert au « hold-up ».
Pour le capital américain, l'enjeu dans cette opération était autrement plus important que le seul contrôle de l'Irak-Koweit et du pétrole. L'enjeu c'était le monde, la place de première puissance dans ce monde en pleine déstabilisation. La menace militaire soviétique, ce chantage avec lequel le capital américain tenait les autres puissances de son bloc depuis quarante-cinq ans, ce carcan venait de se rompre. Et la poussière provoquée par l'effondrement du mur de Berlin n'était pas encore retombée, que déjà des responsables politiques allemands et français parlaient de création d'une force militaire européenne, « plus indépendante des Etats-Unis». Au Japon, la revendication d'une révision de la constitution imposée par le gouvernement américain à la fin de la seconde guerre mondiale qui interdit à ce pays la possession d'une véritable armée, refaisait surface.
Le principaux concurrents économiques et créanciers des Etats-Unis réclamaient une nouvelle place dans la nouvelle situation, une nouvelle place politique et militaire en accord avec leur puissance économique.
Pour les Etats-Unis, la guerre du Golfe devait être une brutale réaffirmation de leur autorité sur le monde, et en premier lieu sur l'Europe et le Japon. Et de ce point de vue, elle a constitué une véritable victoire du « parrain » américain, du moins pour l'immédiat. Les événements des mois qui ont suivi la guerre l'ont clairement illustré.
« Les Etats-Unis, tirant profit de leur récente victoire militaire, sont en train de transformer leur avantage en victoire politique dans chaque continent. » C'est ainsi que Boucheron ([8] [273]), président de la commission de la défense de l'Assemblée Nationale française, résumait récemment la situation internationale. Il sait de quoi il parle. En Europe, après les fanfaronnades franco-allemandes mettant en question le rôle de l'OTAN, toutes les puissances sont rentrées dans le rang sous la pression américaine. Les militaires américains ont même imposé la formation au sein de l'OTAN d'une « force d’intervention rapide » dont l'essentiel des forces terrestres reposera sur l'Allemagne, mais oui sera placée sous le commandement du plus fidèle allié de Washington, le capital- britannique, Pour ce dernier, comme pour certains pays de l'Est nouvellement acquis à l'influence occidentale (Pologne, Tchécoslovaquie), la crainte première est celle du capital allemand réunifié, et ils voient dans la présence américaine un antidote efficace à cette menace. Le gouvernement japonais a aussi baissé d'un ton ses récriminations, et, tout comme l'Allemagne, il a payé au grand rival américain sa « contribution à la guerre ».
Quant aux pays de la zone d'influence japonaise, ils considèrent généralement d'un bon oeil la pression .américaine dans la région car ils craignent le chaos que provoquerait une montée en puissance politique et militaire du Japon. Bob Hawke, le premier ministre d'Australie s'est ouvertement prononcé pour un maintien de la présence militaire américaine dans cette partie du monde afin de dissuader les puissances régionales « d'acquérir de nouvelles capacités militaires qui pourraient déstabiliser et déclencher une course aux armements dans la région ».
La crainte du chaos n'est pas le fait du seul gouvernement américain. En s'affirmant comme « gendarme » politique et militaire du monde, celui-ci intervient comme « dernier recours » face aux tendances centrifuges qui se manifestent sur toute la planète, et il impose son « ordre » avec une arrogance sans précédent.
-En Irak il a réglé comme on le sait le problème Kurde, se débarrassant ainsi du danger d'une déstabilisation plus grande encore de la région qu'aurait impliqué 1 autonomie politique de cette population qui vit sur cinq pays clés de la région (Irak, Syrie, Turquie, URSS et Iran).
- En URSS il a refusé tout véritable appui aux indépendantistes des républiques baltes pour ne pas déstabiliser davantage l'ancien « Empire du mal » ; sur le gouvernement de Moscou lui-même, il exerce un pouvoir direct, moyennant le chantage à l'aide économique (voir dans ce numéro « L’URSS en miettes »).
- En Ethiopie, en proie à l'éclatement après la victoire des « rebelles », c'est le même gendarme qui a autoritairement organisé la conférence de Londres permettant de constituer une gouvernement éthiopien autour des Tigréens du FDRPE, et c'est lui qui a fait pression sur les organisations séparatistes de l'Erythrée (FPLE) ou des Oromos pour qu'ils coopèrent avec le nouveau pouvoir.
- En Yougoslavie c'est encore le gouvernement US qui a menacé de suspendre l'aide économique si les cliques bourgeoises serbes ne changeaient pas leur attitude à l'égard des revendications croates, ce qui menaçait le pays de dislocation.
- Au Pakistan Washington a arrêté la fourniture d'armes conventionnelles et une partie de l'aide économique tant que le gouvernement d'Islamabad n'aura pas fourni la preuve qu'il ne construit pas un armement nucléaire.
- La bourgeoisie américaine s'est même permise d'interdire à la Chine de vendre au Pakistan certains matériaux pouvant être utilisés à cet effet.
Telle est la « victoire » que fête le capital américain : la consolidation immédiate de sa position de premier gangster de la planète. C'est une victoire sur ses concurrents directs et une action décidée pour limiter certains aspects de la décomposition qui menace son empire. Mais la tendance mondiale au chaos et à la barbarie n'est pas arrêtée pour autant.
L'INEVITABLE ENFONCEMENT DANS LE CHAOS
La puissance du capital américain peut s'exercer aux quatre coins de la planète et modérer momentanément tel ou tel aspect du chaos. Elle ne peut cependant renverser le cours du gigantesque torrent de boue et de sang qui envahit la planète. Le nouveau désordre mondial n'est pas une fortuite coïncidence entre différents phénomènes sans lien entre eux et qui pourraient être résolus les uns après les autres. Derrière le chaos actuel il y a une logique, celle de la décadence avancée d'une forme d'organisation sociale. Comme l'avait analysé et prévu le marxisme, et lui seul (celui-là même que la classe dominante croit, ou fait semblant de croire, qu'elle enterre aujourd'hui sous les décombres du stalinisme), c'est au coeur même des rapports de production capitalistes que se trouve l'impasse qui condamne la société à cette situation apocalyptique.
La crise économique capitaliste a progressivement rasé les moindres capacités économiques des pays du « tiers-monde ». En mai 1991, au lendemain du gigantesque gaspillage destructif de la guerre du Golfe, au moment ou les grandes puissances agricoles occidentales décident de stériliser de nouveaux millions d'hectares cultivables pour faire face à la « surproduction », le secrétaire général de ce repaire de gangsters que sont les Nations-Unies, lançait un appel « en faveur de l'Afrique », où 30 millions d'êtres humains sont menacés de famine cette année.
C'est cette même impasse économique qui a provoqué l'effondrement de 1’édifice vermoulu du capitalisme d'Etat des pays de l'Est.
C'est elle qui, dans les nations les plus industrialisés d'Occident, a provoqué la désertification industrielle de zones entières, généralisé la précarité de l'emploi et le chômage. C'est cette crise qui connaît aujourd'hui une nouvelle accélération en frappant de plein fouet le coeur du système. (Voir dans ce numéro « La relance... de la chute de l'économie mondiale »).
La machine économique ne parvient à exploiter qu'un nombre toujours moindre de prolétaires. Une partie croissante de la société se trouve rejetée des relations productives capitalistes elles-mêmes et se voit atomisée, marginalisée, contrainte de vivre de « petits travaux » ou d'expédients. C'est la généralisation de la misère. ([9] [274]) C'est la décomposition du tissu social capitaliste.
Au sein de la classe possédante, la crise économique est aussi synonyme de concurrence accrue. Que ce soit entre nations ou au sein même de chaque nation, la compétition s'intensifie sur le plan économique et militaire. La violence aveugle, le langage militaire remplace de plus en plus le langage économique. La guerre de tous contre tous, caractéristique du capitalisme depuis sa naissance, atteint son paroxysme dans cette phase finale du système. C'est le « chacun pour soi » dans un monde sans perspectives.
Les rapports de production capitalistes sont devenus une aberration historique dont la survie ne peut plus être que source de barbarie, tout comme en leur période de déclin historique le furent les rapports esclavagistes antiques ou ceux de la féodalité. Mais contrairement au passé où les nouveaux rapports sociaux (féodaux après l'esclavagisme antique, capitalistes après le féodalisme) pouvaient commencer à se développer au sein des anciennes institutions, l'instauration d'une nouvelle société fondée sur des rapports communistes, ne pourra se faire que sur les ruines politiques de l'ancienne. La logique capitaliste conduit à l'effondrement économique du système, mais non à son dépassement. Celui-ci ne peut être que l'oeuvre consciente et volontaire du prolétariat mondial. Si la classe ouvrière ne parvient pas à assumer la portée révolutionnaire de son combat contre le capital, si elle n'ouvre pas concrètement la perspective d'une nouvelle société, ce n'est pas le communisme qui se développe mais le pourrissement barbare de la vieille société capitaliste et la menace de disparition de l'espèce humaine, soit par la guerre mondiale, soit par la décomposition et le chaos généralisés. La résistance du prolétariat des pays centraux à l'embrigadement idéologique du capital a empêché l'issue de la guerre mondiale entre les deux blocs, mais elle n'a pu retenir le pourrissement qui en découle pour la société capitaliste. C'est cette décomposition sur pied de la société, privée de perspectives, que nous vivons et qui est à la base du chaos actuel.
C'est pourquoi l'action du capital américain, quelle que soit la puissance des moyens que celui-ci utilise, ne peut véritablement renverser le cours vers l'abîme. Que ce soit au niveau du rapport entre nations ou entre fractions capitalistes au sein de chaque nation, les tendances centrifuges, à l'exacerbation des rivalités, ne peuvent que continuer à s'intensifier.
Sur le plan des conflits inter-impérialistes, le Moyen-Orient reste une poudrière instable où, malgré les efforts déployés par la diplomatie musclée de Washington, l'explosion de nouveaux conflits armés est inévitable. Déjà Israël a repris les bombardements du Sud-Liban, et ne cesse de résister aux pressions qui le poussent à « échanger des territoires pour la paix », en répondant par des accusations contre la Syrie qui «dévore le Liban». ([10] [275]) La guerre du Golfe n'a pas apporté une paix définitive ; elle n'a fait qu'annoncer par quels moyens le capital américain entend défendre sa suprématie.
Quant à la concurrence économique entre nations rien ne permet d'envisager un quelconque apaisement. L aggravation de la crise économique ne pourra que continuer à l'exacerber. Ici encore l'action du capital américain n'est qu'un coup de force pour compenser sa faiblesse à l'égard de ses concurrents. ([11] [276]) « Je ne crois pas que le leadership des Etats-Unis devrait se limiter aux domaines de la sécurité et de la politique. Je pense que ce leadership doit s’étendre aussi au domaine économique. » Cette déclaration de J.Baker ([12] [277]) n'annonce pas une attitude conciliante du capital américain, mais encore une fois, la méthode avec laquelle celui-ci entend faire face à la guerre économique.
Que ce soit sur le plan politique et militaire ou sur le an économique, la perspective n'est pas à la paix et ordre mais à la guerre et au chaos entre nations.
Mais la tendance à la désagrégation s'exprime tout autant à l'intérieur de chaque nation. Qu'il s'agisse de la dislocation de l'URSS (Voir l'article « L'URSS en miettes» dans ce numéro), de celle de l'Inde, de l'Ethiopie, de la Yougoslavie ou de la plupart des pays africains, les ravages de la misère et de la guerre pour la survie de chaque clique de la classe dominante ne pourront que l'intensifier. Et ce ne sont pas les quelques miettes d'aide « humanitaire » des Etats-Unis, ou autre puissance, qui permettront de renverser les tendances de fond qui déchirent ces nations.
LA LUTTE DE CLASSE
Il ne peut y avoir de lutte contre le chaos et la dislocation de la société qu'en s'attaquant à ce qui en est à la source : les rapports sociaux capitalistes. Or seule la lutte du prolétariat est véritablement un combat irréconciliable contre le capital. Seul l'antagonisme capital-travail possède cette dimension internationale et historique indispensable pour répondre à l'ampleur des enjeux.
Le sort de l'humanité dépend de l'issue du combat qui oppose les prolétaires de tous les pays au capital mondial. Mais avant cela, il dépend de la capacité des prolétaires de reconnaître le vrai combat à mener. Si le prolétariat ne parvient pas à échapper au tourbillon chaotique qui le pousse à se diviser pour des questions d'origines nationales, de religions, de races, d'ethnies ou autres, s'ils ne parvient pas à s'unifier en imposant le terrain de classe comme seul terrain de combat, la porte restera grand ouverte à l'accélération du chaos et de la décomposition.
Dans les pays sous-développés, là où la classe ouvrière est le plus minoritaire et possède le moins de traditions de combat, les prolétaires ont les plus grandes difficultés pour échapper à l'emprise de divisions archaïques, étrangères a leur lutte de classe. Dans les pays de l'Est, malgré une forte combativité au cours des derniers mois (en particulier chez les mineurs et les travailleurs de Biélorussie en URSS), la classe ouvrière subit tout le poids des mystifications nationalistes, « démocratiques » et, évidemment, de « l'anti-communisme » ambiant.
C'est dans les pays centraux du capitalisme occidental que l'antagonisme prolétariat-capital existe sous sa forme la plus complète et directe. La classe prolétarienne y représente la large majorité de la population et son expérience historique y est la plus riche, aussi bien au niveau des mystifications bourgeoises que de celui du combat de masse. Elle constitue les bataillons décisifs de l'armée prolétarienne mondiale. De sa capacité à déjouer les pièges que la décomposition capitaliste lui tend, (concurrence face à la menace du chômage, oppositions entre travailleurs d'origines nationales différentes, marginalisation des chômeurs), de sa capacité à affirmer clairement l'irréconciliable antagonisme qui l'oppose au capital, dépend l'ouverture de perspectives nouvelles pour les prolétaires du monde entier. Sur ses épaules repose le sort de l'ensemble de sa classe, et par là même de l'humanité entière.
La guerre du Golfe avait engendré une profonde inquiétude dans la population mondiale et en particulier parmi les prolétaires des pays industrialisés. La fin du conflit a provoqué un sentiment de soulagement, renforcé par les gigantesques campagnes idéologiques sur la nouvelle « paix », le « nouvel ordre mondial ». Mais ce sentiment ne peut être que relatif et de courte durée, tant les nuages noirs du chaos s'amoncellent sur la planète et ruinent les discours « optimistes» de la classe dominante. Rien ne serait plus dangereux pour la classe révolutionnaire que d'oublier ce que fut la guerre du Golfe et ce qu'elle annonce. Face à l'aggravation de la crise économique et aux attaques que la classe dominante porte et portera sur ses conditions d'existence, dans les luttes de résistance que ces attaques entraîneront, il est crucial qu'elle sache tirer profit de toute la réflexion que 1’inquiétude causée par la guerre a provoqué en son sein. Elever son niveau de conscience et comprendre la globalité de son combat, c'est seulement en regardant la réalité en face, en refusant de se laisser « consoler » par les discours lénifiants de la classe dominante, en retrouvant son programme révolutionnaire et l'arme de combat que constitue le marxisme, que la classe ouvrière pourra à travers ses luttes s acquitter de sa tâche historique.
RV, 16/6/91
[1] [278] Depuis la première guerre mondiale, la manipulation de l'opinion est considérée par la classe capitaliste comme une tâche gouvernementale à part entière. Au cours des années 1930, avec le fascisme en Italie et en Allemagne, avec le Stalinisme en URSS, mais aussi et surtout avec la subtile « démocratie » hollywoodienne aux Etats-Unis, cette mission est devenue une entreprise gigantesque, objet des premières préoccupations de tout pouvoir politique. Gœbbels, le maître d’oeuvre de la propagande hitlérienne, résumait cyniquement la méthode qui sera adoptée par tous les gouvernements de la planète : « Un mensonge répété mille fois devient une vérité ».
[2] [279] Le Monde diplomatique, mai 1991.
[3] [280] Les militaires restent systématiquement flous ou silencieux lorsqu'ils sont interrogés à ce sujet : « Nous ne sommes pas ici pour discuter de la pornographie de la guerre. » - répondit un colonel bri tannique pendant une conférence de presse sur le bilan de la guerre. {Libération, 26 mars 1991) Pour les armées alliées, les chiffres officiels des pertes sont par contre très précis : 236 hommes, dont 115 américains, plus 105 au cours d'accidents de transport en se rendant sur place.
[4] [281] On sait maintenant qu'il y a eu dans certains cas des désertions massives dans l'armée irakienne et que cela a entraîné une féroce répression de la part des corps d'élite de Saddam Hussein.
[5] [282] Il est prouvé que l'aviation américaine à jeté des tracts à la fin de la guerre sur les zones Kurdes appelant au soulèvement contre le régime de Hussein et que des officiers américains ont encouragé les chefs de mouvements bourgeois nationalistes kurdes à se lancer dans une telle aventure.
[6] [283]Lorsque nous affirmons que l'empire US a entrepris cette guerre pour lutter contre le chaos, ils nous est parfois reproché de présenter la guerre comme « une action désintéressée des dirigeants américains » (sic). Ce n'est pas parce que les intérêts les plus sordides et particuliers de USA s'opposent à un chaos qui remettrait en question leur position prépondérante dans le monde, qu'il faut conclure que les USA agissent de façon « altruiste » à l'égard des autres capitaux. Celui qui bénéficie d un ordre établi s'opposera toujours à la remise en question de celui-ci. Pour une analyse développée des causes de la guerre du Golfe, voir les numéros 63, 64, 65 de cette revue.
[7] [284] Cité par Claude Julien dans Le monde diplomatique d'octobre 1990.
[8] [285] Cité par J. Fitchctt dans Herald Tribune, 12/6/91.
[9] [286] L'analyse de Marx qui prévoyait une « paupérisation absolue » de la société, et qui fut pendant les années 1960 si décriée par les pré tendus fossoyeurs théoriques du marxisme, trouve aujourd’hui encore une éclatante et tragique confirmation.
[10] [287] Le capital américain ne se fait d'ailleurs aucune illusion à ce sujet. Ainsi, en même temps qu'il apparaît multipliant les pressions sur Israël pour que celui-ci adopte une position plus conciliante à l'égard des alliés arabes, l'Etat US décide de livrer à Tsahal d'importants nouveaux stocks d'armes : 46 chasseurs F-16, 25 F- 15, 700 millions de dollars d'armes, transmis directement des « surplus d'armement » américains ; constitution de nouveaux stocks d'armes en Israël pouvant être utilisés indifféremment par les armées des deux pays. Les USA financent en outre 80 % du programme israélien de missiles anti-missiles.
[11] [288] Toutes proportions gardées, les Etats-Unis sont comme l'URSS, en position de faiblesse économique à l'égard de leurs principaux vassaux. C'est en grande partie le résultat du poids des dépenses militaires que devait inévitablement supporter les chefs de blocs. (Voir « Où en est la crise ? » dans le n° 65 de cette revue).
[12] [289] Herald Tribune, 21 /2/91.
Questions théoriques:
- Décomposition [3]
- Guerre [129]
Où en est la crise économique ? : La relance... de la chute de l'économie mondiale
- 3282 reads
LES RAVAGES DE LA RECESSION INTERNATIONALE
Après les récessions de 1967, 1971, 1975 et 1982, le capitalisme entrait en 1986 dans une nouvelle phase de ralentissement. Mais, tel un animal à l'agonie, il connut un ultime répit ; la brutale chute des prix pétroliers conjuguée avec une utilisation massive du crédit (Tableau 1), a permis de freiner la chute de la croissance. Mais aujourd'hui, la réalité crue de la récession ouverte, pour un temps repoussée, est belle et bien là : une remontée de l'inflation et du chômage accompagne la chute du taux de croissance (Graphique 1).
|
Table 1: Debt
|
1980
|
|
1990
|
|
|
||||
|
|
Mil$
|
%GNP
|
|
Mil$
|
%GNP
|
|
|
|
|
|
Total public
|
1250
|
46%
|
|
4050
|
76%
|
|
|
|
|
|
Business
|
829
|
30%
|
(1)
|
2100
|
40%
|
|
|
|
|
|
Consumer
|
1300
|
48%
|
(2)
|
3000
|
57%
|
|
|
|
|
|
Total internal
|
3400
|
124%
|
|
9150
|
173%
|
|
|
|
|
|
Debt external
|
+181
|
|
|
-800
|
15%
|
|
|
|
|
|
GNP
|
2732
|
|
|
5300
|
|
|
|
|
|
|
(1) 4 times their cash flow (ie company savings, used to self-finance investments)
(2) In 1989, consumer debt represented 89% of their income.
|
|||||||||
|
Public debt (% of GNP)
|
1973
|
1986
|
|
|
|
|
|
||
|
USA
|
39.9%
|
56.2%
|
|
|
|
|
|
||
|
Canada
|
45.6%
|
68.8%
|
|
|
|
|
|
||
|
France
|
25.4%
|
36.9%
|
|
|
|
|
|
||
|
Italy
|
52.7%
|
88.9%
|
|
|
|
|
|
||
|
Japan
|
30.9%
|
90.9%
|
|
|
|
|
|
||
|
Germany
|
18.6%
|
41.1%
|
|
|
|
|
|
||
|
Spain
|
13.8%
|
49.0%
|
|
|
|
|
|
||
Fer de lance de la reprise artificielle des années 1980, les USA ont été les premiers à entrer en récession. Le PNB a commencé à régresser : + 1,4%, - 1,6% et -2,8 %, respectivement pour les 3e et 4e trimestres de 1990, et le 1er trimestre de 1991. Les autres grands pays industrialisés, soit les accompagnent, soit connaissent un ralentissement notable de leur taux de croissance. Mais la situation est encore bien plus catastrophique dans d'autres parties de la planète. D'une part, c'est à une véritable chute de la production que l'on assiste dans les pays de l'Est (Tableau 2), où l'ouverture du rideau de fer, loin de constituer un nouveau champ d'accumulation pour le capitalisme, a encore accéléré la crise (voir 1’article "L’URSS en miettes" dans ce numéro). D'autre part, la dette du "tiers-monde", malgré de nombreux rééchelonnements et réajustements, continue de croître (Tableau 3). L'Amérique du sud, sous-continent soi-disant promis à un bel avenir, s'enfonce dans une terrible récession : son PNB croissait à peine de +0,9% en 1989, il régresse de -0,8% en 990. Exprimé en PIB/habitant, il est revenu au même niveau qu'en 1978. Et ne parlons pas de l'Afrique, véritable continent à la dérive. Son PNB, pour une population de 500 millions d'habitants, est l'équivalent de celui de la Belgique peuplée de 10 millions d'habitants.
La récession larvée des années 1980 ([1] [290]) se confirme actuellement à travers la plongée de l'économie mondiale dans la récession ouverte. Les années 1980, années d'illusions dans les discours de la bourgeoisie, furent en réalité des années de vérité : vérité de l'absence totale d'issue à la crise, vérité de l’inéluctabilité de l'enfoncement dans la récession, vérité de l'épuisement des palliatifs. La récession actuelle est une nouvelle convulsion de la tendance de fond à l'enfoncement du capitalisme depuis la fin des années 1960 (Graphique 2).
LES MENSONGES SUR L'IMMINENCE D'UNE REPRISE
S'il arrive parfois à la bourgeoisie de reconnaître la réalité de la récession, c'est pour immédiatement la minimiser et annoncer la toute proche reprise. Le développement du crédit, la baisse des taux d'intérêt, la réunification allemande, l'ouverture des pays de l'Est, la reconstruction et le développement économique des pays du Moyen-Orient, l'économie d'armement ou la fin de la guerre sont tour à tour invoqués pour apaiser l'inquiétude de la classe ouvrière. Qu'en est-il exactement ?
La guerre peut-elle relancer l'économie US comme après la guerre de Corée ?
La guerre du Golfe et l'accroissement des dépenses militaires depuis les années 1970 ne peuvent qu'aggraver la crise car le contexte économique est très différent de celui d'après la seconde guerre mondiale :
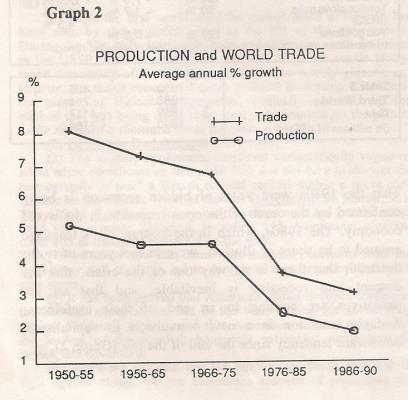
Quant à la fin de la guerre elle ne peut qu'aggraver la crise malgré les dires de la bourgeoisie. Le poids du coût de la guerre sur les déficits budgétaires et les faibles retombés économiques l'attestent ([2] [291]).
La réunification allemande et l'ouverture des pays de l'Est peuvent-elles constituer la nouvelle locomotive de l'économie ?
L’Allemagne doit faire face au coût de la réunification, aux frais de la guerre du Golfe et de l'aide à l'Europe de l'Est pour freiner le chaos en son sein et à ses portes. Economiquement, la RDA est une ruine peu intéressante, dont presque toute l'industrie est à reconstruire. En fait, sa remise sur pied est un leurre, une illusion savamment entretenue par la bourgeoisie : la réunification est un « véritable désastre économique» pour reprendre les termes du gouverneur de la Bundesbank ([3] [292]).
L'autre illusion entretenue par la bourgeoisie, et dans laquelle nombre de groupes du milieu politique sont tombés, est l'idée de la possibilité d une nouvelle jeunesse pour le capitalisme suite à la chute du mur de Berlin. La comparaison a souvent été faite entre la situation d'après-guerre pour les pays de l'Ouest et celle que connaissent actuellement les pays de l'Est (fin d'une économie de guerre, plan Marshall pour la reconstruction, etc.), mais le contexte global est radicalement différent (voir ci-contre).
Les pays de l'Est sont déjà fortement endettés, les nouveaux crédits servent à couvrir les anciens prêts, plutôt qu'à investir. Hyperinflation, insolvabilité, succession de plans anti-crises, dévaluations et remplacement de la monnaie, développement de l'économie parallèle et maffieuse deviennent le lot de ces pays en voie de tiers-mondisation ([4] [293]). Même dans le pays le plus ouvert à l'Occident, la Hongrie, « il n'y a pas eu jusqu'à présent de véritable percée des capitaux étrangers» reconnaît M. Gyorgy Matolcsy, secrétaire d'Etat et véritable responsable économique du gouvernement. Si les capitalistes ne veulent déjà pas racheter les entreprises de RDA, pourtant les plus performantes à l'Est et bénéficiant du soutien de l'Ouest, ce n'est pas demain que les autres seront rachetées et modernisées par l'occident ! Il est d'ailleurs significatif que la BERD ([5] [294]), vu le manque d'investissements intéressants, a réorienté ses activités vers la prestation de services, surtout en conseils institutionnels pour modifier les législations de l'Est. Et compte tenu aussi du faible pouvoir d'achat, l'Est n'est en rien un marché solvable.
Le Moyen Orient peut-il constituer un marché permettant de relancer l'économie mondiale ?
La guerre a asséché les économies du Golfe, rendant impossible toute relance de l'économie mondiale par la manne des pétrodollars ou le développement de l’activité économique dans cette région :
- les caisses des Etats du Golfe sont vides ; or, dans ces pays d'économie de rentes, c'est l'Etat qui est le principal moteur de la vie économique ;
- le prix du pétrole est retombé à son niveau d'avant-guerre, et la reprise de la production du Koweït et de 'Irak menace de le faire chuter à nouveau ;
- les coûts de guerre pour l'Arabie Saoudite s'élèvent à la somme colossale de 64 milliards de dollars et, pour la première fois, le pays doit emprunter 3,5 milliards de dollars sur le marché international des capitaux ; le Koweït devra vivre sur ses réserves et l'Irak qui, avant la guerre, possédait un fond de 80 milliards de dollars, en doit aujourd'hui 100 ;
- la peur du conflit a fait fuir 60 milliards de dollars de capitaux du Golfe qui ont été placés ailleurs.
La politique qui a permis de soutenir la croissance mondiale au cours des années 1980 n'est plus possible aujourd'hui
Les USA se trouvent à la croisée des chemins : ils doivent significativement baisser les taux d'intérêt ([6] [295]) pour éviter la récession au risque de faire fuir les capitaux étrangers qui financent leur déficit ([7] [296]) et de relancer l'inflation. Outre la diminution du taux d'intérêt, la FED a également assoupli les contraintes de réserves des banques afin d'encourager le crédit. Bref, une nouvelle fuite en avant qui accroît encore plus les contradictions explosives et semble bien mince pour pouvoir infléchir l'évolution économique. La bourgeoisie tente à nouveau de relancer la machine mais ces remèdes, si puissants par le passé, se révèlent aujourd'hui inopérants : la machine, totalement déglinguée, répond de moins en moins aux sollicitations. Par exemple, les banques américaines, surendettées et minées par les faillites, retardent la répercussion de la baisse du coût du crédit sur les taux du marché et sélectionnent drastiquement les clients auxquels elles accordent encore des crédits ([8] [297]).
Le développement des crédits au "tiers-monde" n'est plus possible
La bourgeoisie crie victoire parce que l'endettement du "tiers-monde" ne menace plus l'ordre financier international. Les statistiques montrent un tassement de la croissance du volume de la dette et une diminution du service de la dette exprimé en proportion des exportations annuelles (28 % en 1988, 22% en 1989). Mais cette soi-disant amélioration cache une réalité bien pire. Ces chiffres ont été obtenus au prix d'une austérité et d'une récession drastiques. En l'espace de quelques années la bourgeoisie est passé du plan Baker (1985), qui stipulait que, pour que la dette puisse être remboursée,.il fallait prêter davantage, au plan Brady (1989), qui constatait que, puisque les pays sont incapables de payer, les banques devaient annuler une partie de leurs créances. Mais en privilégiant les réductions de créances sur les flux de capitaux nouveaux, les "chances" de "développement économique" sont reportées aux calendes grecques. Ceci ferme à tout jamais, s'il était encore besoin de s'en convaincre, la possibilité de relancer l'économie mondiale par l'octroi de crédits au "tiers-monde". D'ailleurs, depuis 1983, les transferts nets de capitaux se sont inverses : il y a plus d'argent qui sort des pays sous-développés vers les pays développés (170 milliards de dollars de 1983 a 1989) que d’argent qui entre. Les taux d'intérêt élevés, la diminution relative du prix des matières premières et la récession internationale ne pourront qu'aggraver encore plus la situation.
Le rapport de l’UNICEF de 1990 estime que chaque années 500 000 enfants meurent en raison de l'endettement et des programmes d'austérité que le FMI impose aux pays du "tiers-monde", il évalue à 40 000 par jour le nombre d'enfants qui y mourront de faim. Les rapports économiques inégaux, le poids de la dette, le maintien des prix des matières premières ridiculement bas, la fermeture des marchés occidentaux, engendrent un génocide équivalent à l'éclatement, tous les deux jours, d'une bombe atomique de la puissance de celle d'Hiroshima. En cette année 1991, 27 millions d'êtres humains mourront de faim en Afrique, un tiers de la population active des pays de l'Est sera réduit au chômage, tandis que, dans les pays centraux, la classe ouvrière subit une austérité sans précédent, et que des pans entiers de celle-ci tombent dans la misère absolue ([9] [298]) : un enfant sur huit souffre de la faim aux USA et un septième de la population vit en dessous du seuil de la pauvreté dans la CEE. Des épidémies massives (comme le choléra en Amérique du sud, en Irak, au Bangladesh) déciment des masses considérables de force de travail. Un bilan aussi hallucinant condamne irrémédiablement ce système barbare et appelle à son renversement au profit d'une société sans classes.
GA, 1er juin 1991
[1] [299] Concernant la soi-disant prospérité des années 1980 nous mettions en avant (Revue Internationale, n° 59, 4e trimestre 1989) le danger de ne considérer que « l'accroissement des chiffres bruts de la production sans se préoccuper de quoi était faite cette production ni se demander qui allait la payer», et le texte de conclure : « En fin de compte, pendant des années, une bonne partie de la production mondiale n'a pas été vendue mais tout simplement donnée. Cette production, qui peut correspondre à des biens réellement fabriqués, n'est pas une production de valeur, c'est-à-dire la seule chose oui intéresse le capitalisme. Elle n'a pas permis une réelle accumulation de capital. Le capital s'est reproduit sur des bases de plus en plus étroites, pris comme un tout, le capitalisme ne s'est donc pas enrichi. Au contraire, il s'est appauvri ».
[2] [300] Le "marché du siècle" se dégonfle déjà comme une baudruche : le Koweït revoit à la baisse les estimations de coût pour sa reconstruction. De 40 à 50 milliards de dollars, voir 100 (!) estimés au départ, on passe aujourd'hui à 10 ou 30 milliards, tout au plus.
[3] [301] A ce jour, seules 455 firmes sur les 4500 à privatiser ont été rachetées, à peine un dixième du parc industriel.
[4] [302] On assiste déjà à l'apparition de véritables processus de tiers mondisation :
-la privatisation en RDA fonctionne à l'envers: 70,3% des investissements vont vers la mise sur pied de chaînes de distribution, le reste seulement vers la production ;
- en Pologne, pays qui s'est pourtant le plus transformé, ce sont les secteurs à faibles valeurs ajoutés qui résistent le mieux ; ce pays, comme les autres de l'Est, va être confiné à la production de matières premières ou de marchandises de secteurs banalisés requérant beaucoup de main d'oeuvre mal payée ;
- les conditions offertes en matière d'autonomie de gestion et de rapatriement des bénéfices empêchent toutes retombées ou effets d'entraînements économiques locaux importants.
[5] [303] Banque pour la reconstruction à l'Est.
[6] [304] Le taux d'escompte US est passé de 7 % à 5,5 % entre décembre 1990 et avril 1991. Cette succession de baisses montre le pessimisme croissant des autorités américaines pour une reprise rapide de l'économie.
[7] [305] Déjà, les capitaux ont tendance à quitter les USA pour s'investir en Allemagne et au Japon. En août 1990, une émission de 32 milliards de dollars US de l'Etat n'a pu trouver preneur chez les japonais que pour 10% de la somme, alors que d'habitude, ils assuraient au minimum du tiers à la moitié des souscriptions. De ce fait, les taux US ne pourront être maintenus très longtemps aussi bas.
[8] [306] A l'heure actuelle l'écart entre le taux d'escompte et le taux de base offert par les banques est très élevé : 3 %.
[9] [307] Selon une enquête menée par l'université de Bristol, 5,5 millions d'anglais vivaient dans la pauvreté en 1984 (critère retenu : absence à la fois d'un lit, d'une toilette et d'un frigo), ils sont 11 millions aujourd'hui, soit 18 % de la population, presque 1 personne sur 5. Dix millions de personnes vivent dans des maisons non chauffées et 5 millions n'ont qu'un repas par jour.
Récent et en cours:
- Crise économique [28]
Questions théoriques:
- L'économie [86]
L’URSS en miettes
- 4687 reads
« Je réalise que nous nous trouvons sur la ligne au-delà de laquelle commence la dislocation de l'économie et de l'Etat», qui parle ainsi? Gorbatchev lui-même! Chaque jour qui passe l'URSS, le plus vaste pays du monde, s'enfonce encore plus dans le chaos. Le navire est à la dérive, et Gorbatchev, recevant le président français Mitterrand début mai, faisait le bilan calamiteux de la Perestroïka en déclarant que les soviétiques sont a dans le brouillard», que «les instruments ne fonctionnent pas », que « l'équipage n'est pas très homogène ». Sinistre constat que vient préciser le nouveau premier ministre Pavlov, digne représentant de la Nomenklatura du parti, insistant sur le fait que l'URSS est menacée par «une décomposition colossale »([1] [308]).
LE PARCOURS CATASTROPHIQUE DU CAPITALISME RUSSE
Le temps, pas si lointain, où la puissance impérialiste de l'URSS faisait trembler le monde appartient à un passé irrémédiablement révolu. L'URSS n'a définitivement plus les moyens de sauvegarder son rang de super-puissance impérialiste mondiale. Sur le plan économique, elle ne les a jamais eus. Ce n'est qu'en concentrant toute l'économie aux mains de l'Etat, et en la sacrifiant totalement aux besoins de sa puissance militaire que l'URSS a pu, un temps, malgré son sous-développement, prétendre au rôle de challenger, de son rival américain dont le PNB en 1990 représentait près de trois fois le sien.
Durant des décennies de 20 à 40 % du revenu national de l'URSS ont été consacrés à la production d'armement et à l'entretien de l'"armée rouge". Cette priorité a été imposée au prix d'un délabrement de tous les autres secteurs de l'économie. Le retard technologique s'est de plus en plus accentué dans les secteurs de pointe. Par ricochet, ce retard s'est concrétisé par une supériorité technologique grandissante des armements occidentaux, handicapant de plus en plus gravement la puissance militaire de l'URSS. Là où la technologie manquait, où les machines étaient absentes, la débrouillardise et la sueur, la tête et les muscles des prolétaires ont été exploités de manière brutale. Sous la poigne de fer du parti stalinien, l'URSS a été transformée en un gigantesque camp de travail forcé.
La guerre à laquelle elle s'était tant préparée, l'URSS n'a pas pu finalement la mener. Non seulement ses armements étaient surclassés, mais le rejet total du régime par la population rendait impossible la mobilisation totale nécessaire à une telle fuite en avant.
La crise économique chronique s'est précipitée, et avec les années 1980 c'est une véritable dynamique d'effondrement de l'économie qui s'est ouverte. Les ambitions impérialistes de l'URSS vont être refoulées dans le monde des rêves sans lendemains.
Des révisions déchirantes s'imposent à la Nomenklatura devant l'écroulement économique. Il devient urgent de moderniser l'appareil de production et pour cela de procéder à des réformes. Gorbatchev va être le porte-flambeau de la nouvelle politique économique, la Perestroïka. Cependant, la remise en cause des dogmes économiques qui sont le fondement du capitalisme d'Etat stalinien implique nécessairement une remise en cause des dogmes politiques qui sont à la base du stalinisme. Et notamment, celui du pouvoir dictatorial du parti unique. Loin de remettre l'économie en ordre, de redresser la barre, la Perestroïka précipite l'effondrement du système politico-économique mis en place par Staline. Ce n’est plus simplement aux aberrations de son économie que la bourgeoisie russe doit faire face, mais à la plongée accélérée de l'URSS dans la spirale infernale au chaos économique, politique et social.
La question qui se pose aujourd'hui, c'est celle de l'existence même de 1’URSS.
La prétention du stalinisme, la forme la plus brutale du capitalisme d'Etat, à représenter le communisme a été le plus grand mensonge du siècle. De l'Est à l'Ouest, de l'extrême-droite à l'extrême-gauche, toutes les fractions de la bourgeoisie l'ont entretenu. Dans la phraséologie stalinienne, le vocabulaire du marxisme a été mis au service des ambitions impérialistes de l'URSS, lui a servi de paravent idéologique, ainsi que d'alibi, pour les exactions de son régime. La décomposition présente de l'URSS met à nu, dans ses rouages les plus intimes, cette vérité que les révolutionnaires n'ont cessé d'affirmer durant des décennie: la nature capitaliste de l'URSS et la nature bourgeoise du PCUS.
L'EFFONDREMENT ECONOMIQUE S'ACCELERE
Pour le premier trimestre 1991 rapporté au même trimestre de l'année précédente, le Bureau des statistiques, organisme officiel de l'Etat, annonce un recul de 8 % du produit national brut, une chute de 13 % de la production agricole, un plongeon de 40 % des exportations, tandis que le déficit budgétaire fédéral s'est accru de près de 27 milliards de roubles. Les estimations occidentales sont encore plus pessimistes, estimant la chute de la production à 15 %.
Le secteur militaro-industriel, le seul qui jusque là fonctionnait avec un minimum d'efficacité est devenu quasiment inutile. L'URSS a du refouler ses rêves impérialistes, elle n'a pas besoin de plus d'armes, elle en a déjà trop alors qu'elle doit rapatrier des milliers de chars et de tonnes d'armements divers des bases qu'elle évacue en Europe de l'Est. Le coeur technologique de l'industrie tourne au ralenti, dans l'attente d'une reconversion hypothétique vers la production de biens d'équipement ou de consommation qui de toutes façon prendrait des années. En attendant, le capital russe ne sait que faire de ses principaux fleurons techno-industriels devenus inutiles.
Alors que les clients traditionnels de ses produits industriels, les pays d'Europe de l'Est, se tournent vers d'autres fournisseurs, l'industrie de l'URSS ne peut espérer trouver d'autres débouchés pour ses produits, car ceux-ci relèvent d'une technologie complètement périmée et dépassée, ils sont de mauvaise qualité et peu fiables. La encore, alors que la guerre commerciale fait race sur le marché mondial, il n'existe aucune possibilité d'amélioration dans la période qui vient.
Caractéristique de sa situation de pays sous-développé, l'URSS est avant tout exportatrice de matières premières et notamment de pétrole, et parallèlement importatrice de produits agricoles. Ainsi, en 1988, les produits du sous-sol représentaient les 3/4 des rentrées en devises fortes, tandis que la balance agricole était déficitaire de plus de 12 milliards de dollars.
L'industrie pétrolière doit cependant réduire sa production car, n'ayant pas été modernisée durant de nombreuses années, son matériel ne fonctionne plus, les machines tombent en panne, les pièces de rechange manquent cruellement. En conséquence, le volume des exportations pétrolières chute de 36 % au 1er trimestre par rapport à la même période de l'année précédente.
La situation de l'agriculture est dramatique. Le spectre de la famine, repoussé l'hiver dernier grâce à une récolte céréalière abondante, continue de rôder. La chute annoncée de la production de céréales de plus de 10 % pour la prochaine récolte vient le raviver, le manque d’équipement, silos, transports, machines fait que 30% des récoltes sont perdues. L'URSS va devoir se procurer sur le marché mondial ce qui lui manque, pour faire simplement face aux besoins immédiats pour nourrir sa population déjà sévèrement rationnée. Et pour cela s'endetter encore plus.
Naguère pays traditionnellement peu endetté et très solvable, l'URSS ploie aujourd'hui sous le fardeau d'une dette estimée à 60 milliards de dollars, et accumule depuis plusieurs mois les retards et les défauts de paiements, ce qui a conduit le Japon à refuser à 'URSS tout nouveau crédit. Gorbatchev en est maintenant à multiplier les appels au secours pour quémander des aides et de nouveaux prêts internationaux.
Mais ce tableau de l'effondrement économique ne serait pas complet s'il n'incluait les effets destructeurs sur l'économie de la dynamique de chaos dans laquelle l'URSS s'enfonce.
Dans plusieurs républiques la production est quasiment paralysée par les déchirements nationalistes. La situation dans le Caucase en est un exemple parlant. Le blocus ferroviaire et routier imposé à l'Arménie par l’Azerbaïdjan empêche non seulement l'approvisionnement des usines d'Arménie qui sont donc nombreuses à ne pas produire, mais de plus crée un gigantesque embouteillage qui entrave la circulation des marchandises dans tout le sud de l'URSS, obligeant ainsi des usines pourtant situées loin du Caucase à s'arrêter.
Le mécontentement des ouvriers qui voient leurs conditions de vie, pourtant déjà bien misérables, se dégrader constamment s'amplifie. Les arrêts de travail se multiplient, des grèves massives explosent. Ces derniers mois les mineurs ont ainsi bloqué la production de charbon pendant de longues semaines.
Face à cette situation cataclysmique la bourgeoisie est paralysée, affiche son impuissance. Une fraction importante de l’appareil du parti est profondément hostile aux réformes et les sabote sciemment, accélérant encore les dysfonctionnements de l'économie. Face à l'indécision et à l'impuissance dont fait montre le centre des hiérarques du Kremlin, la tendance naturelle à la passivité de l'appareil bureaucratique s'en trouve renforcée. Avec l'éclatement des centres de décisions, les responsables locaux préfèrent attendre prudemment, ne rien faire avant de savoir comment le vent va tourner.
Pendant ce temps l'économie se délabre toujours plus, dans l'attente des décisions qui ne viennent pas, la désorganisation la plus totale règne. Sur fond de misère grandissante, la corruption généralisée est la règle, le marché noir a imposé sa loi à l'ensemble de l'économie.
LA PARALYSIE DE LA CLASSE DOMINANTE
La forme même qu'a prise la contre-révolution a déterminé le mode d'organisation de la classe dominante en URSS. L'Etat issu de la révolution russe et le parti bolchevik qui s'y était identifié ont été dévorés de l'intérieur par la contre-révolution stalinienne. Alors que la vieille classe possédante avait été expropriée par la révolution prolétarienne, une nouvelle classe capitaliste s'est reconstituée dans le parti-Etat stalinien, contrôlant tous les moyens de production et l'ensemble de la vie sociale. La forme politique, le parti unique, correspond à la forme juridique, l'étatisation de la propriété des moyens de production.
Les membres de la Nomenklatura du Parti bénéficient de privilèges qui leur garantissent un niveau de vie sans comparaison avec celui du prolétariat qui croupit dans une misère généralisée. L'Etat assure un train de vie luxueux à ceux qui en contrôlent le fonctionnement : résidences dans des quartiers réservés, accès à des magasins abondamment pourvus en produits de consommation de toutes sortes, notamment occidentaux, voitures de fonction, au-delà du simple salaire les postes de responsabilités bureaucratiques sont une source de revenu occulte par la corruption et tous les trafics qu'ils permettent, etc. Plus encore que n'importe quelle analyse théorique, la réalité des faits prouve amplement qu'il existe bien une classe privilégiée en URSS, une bourgeoisie capitaliste qui au travers de l'Etat exploite le prolétariat de ce pays. Les formes sont différentes de celles des pays occidentaux, mais le résultat est le même.
Au cours des décennies écoulées, derrière la façade monolithique du Parti soi-disant communiste, des clans se sont érigés en féodalité, des maffias et des dynasties se sont créées. Les guerres de cliques ont laissé leur lot de cadavres au cours des purges successives. A tous les niveaux de l'Etat, l'incurie, l'incapacité règnent chez les responsables du Parti plus préoccupés des rivalités exacerbées pour le pouvoir dispensateur de richesses et de puissance, ainsi que de leur trafics en tout genre, que de la gestion de l'appareil de production.
A la mort de Brejnev, fin 1982, la guerre de succession fait rage, le parti unique est en crise, les tendances centrifuges se renforcent. Lorsque, après les courts intermèdes d'Andropov et de Tchernenko, l'accession de Gorbatchev à la tête du Bureau politique sanctionne la victoire de la tendance réformatrice, en 1985, l'effondrement économique de l'URSS est déjà patent, la décomposition du parti en cours, et la dynamique de chaos déjà bien entamée.
La Perestroïka se proposant de promouvoir des réformes économiques sans vouloir remettre en cause le parti unique, et son contrôle sur l'Etat, a accéléré le processus d'effondrement du régime stalinien. Gorbatchev, pour préserver l'unité du Parti doit pratiquer un subtil équilibre entre les tendances conservatrices et réformatrices qui le condamne aux demi-mesures, et donc à l'impuissance. De fait, depuis qu'il a accédé au pouvoir suprême en URSS, tout l'art de Gorbatchev a été de faire passer pour une politique, voulue et décidée, de réformes hardies ce qui n'était que la reconnaissance tardive de la réalité d'une situation qui tend à échapper de plus en plus au contrôle de l'Etat. Sans peur de se contredire Gorbatchev a avalisé ce qu'il refusait la veille. Alors que le but de la Perestroïka était par les réformes de sauver l'URSS et donc son bloc, il a du sanctionner, après avoir tenté de maintenir des fractions réformatrices inféodées à Moscou, l'abandon de tout contrôle de l'URSS sur les pays qui constituaient son glacis en Europe de l'Est. Après avoir annoncé son refus des mesures de répression, il a envoyé l'armée pour réprimer l'agitation nationaliste à Bakou et dans le Caucase, lancé ses séides contre le parlement Lituanien. Après s'être allié avec les réformateurs, il s'est appuyé sur les conservateurs, et vice-versa.
Les tentatives de crédibilisation démocratiques font un flop retentissant. Les élections mettent en évidence l'absolue impopularité des apparatchiks du parti. Les nationalistes et réformateurs radicaux monopolisent les votes. En l'absence de nourriture pour Remplir des frigos inexistants, aucune mascarade démocratique ne pourra jamais combler le divorce total entre l'Etat stalinien et les habitants de l'URSS. Les années d'horreurs durant lesquelles des millions de prolétaires et de paysans sont tombés sous la répression d'un Etat féroce et corrompu ne seront jamais oubliées. Dans ces conditions, malgré son adresse médiatique, Gorbatchev est bien incapable de contrôler un quelconque processus démocratique. Le dernier référendum sur 1’Union en est un bel exemple. Après des années de préparation, le résultat en est que, finalement, plus que les perspectives d'union, il consacre la désunion: les arméniens, géorgiens, baltes qui lui sont hostiles n'y ont pas participé ; plus que la popularité de Gorbatchev en chute libre, il consacre 1 influence grandissante de son rival réformateur Eltsine.
Le parti a implosé, ses contours sont devenus flous. Une myriade de nouvelles organisations politiques est apparue. Les nostalgiques du stalinisme, partisans de la manière forte pour rétablir l'ordre s acoquinent avec les anti-sémites ultra-nationalistes russes de Pamiat. Les réformateurs radicaux quittent le parti pour fonder des associations démocratiques. Dans les républiques périphériques des scissions ont marqué la naissance de nouveaux partis "communistes" sur une base nationaliste consacrant l'éclatement du PCUS. L'opportunisme fait rage, pour nombre d'anciens apparatchiks la démagogie populiste et la surenchère nationaliste sont la seule issue dans le climat général de sauve-qui-peut qui sévit dans le parti. Sous les drapeaux des diverses nationalités qui s'agitent en URSS se nouent de nouvelles alliances de circonstance entre de vieilles féodalités locales du PCUS, un milieu affairiste issu du marché noir florissant, des réformateurs qui mêlent des opportunistes de la pire espèce à des naïfs aux illusions démocratiques, des groupes nationalistes qui expriment le plus souvent le poids d'archaïsmes historiques.
Des régions de plus en plus larges de l'URSS échappent à l'autorité du pouvoir central. Dans les pays baltes, en Moldavie, en Arménie, les courants indépendantistes sont au pouvoir. Partout, les prérogatives du pouvoir central se sont restreintes, le nationalisme dominant encourage la désobéissance face aux ordres du Kremlin, l'appareil bureaucratique de l'Etat face à la paralysie du centre hésite entre l'immobilisme et le ralliement aux nouveaux pouvoirs locaux qui surgissent. Les centres de décision, de pouvoir se sont multipliés.
De haut en bas de l'appareil du parti et de l'Etat les lignes de fracture se sont élargies. Le récent accord entre Gorbatchev et Eltsine concernant la dévolution par le pouvoir central de la gestion de l'ensemble des mines par les républiques et la création d'un KGB sous le contrôle du gouvernement russe est l'expression de l'état d'impuissance du pouvoir central.
La longue grève des mineurs a démontré l'incapacité du Kremlin à imposer une remise en route de la production, à se faire écouter. N'ayant plus aucun contrôle sur des pans entiers de l'économie, l'Etat n'a d'autre solution que d'en laisser la gestion aux divers pouvoirs locaux. L'économie de l'URSS est en train de se disloquer entre différents pôles. Même le contrôle du commerce international est en train d'échapper au pouvoir central, d'ores et déjà les diverses républiques commercent directement avec les pays voisins et avec l'Occident, accélérant la dynamique centrifuge de l'économie soviétique.
Comme le parti, l'appareil policier qui lui est intimement lié se divise de plus en plus, se mettant au service des nouveaux centres de pouvoir nationalistes. De nouvelles forces de police, les milices nationalistes se substituent aux anciennes forces de l'ordre trop liées à Moscou.
Des frontières se sont érigées, au sein de l'URSS, défendues les armes à la main par les militants indépendantistes. La Lituanie a posté des gardes sur ses frontières et des affrontements sporadiques avec la police de Moscou ont occasionné plusieurs morts. Le conflit entre les milices arméniennes et azéris ne s'est pas calmé avec l'intervention de 1'"armée rouge" dans la région. Les pogroms, la guerre et la répression à Bakou et dans le Caucase ont fait des centaines de morts. L'"armée rouge" s'est enlisée sans parvenir à une solution du conflit. En Géorgie, les affrontements entre milices géorgiennes et ossètes ces derniers mois montrent l'émergence d'une nouvelle zone de tension. Partout en URSS, les conflits ethniques se multiplient.
Dans ce contexte d'éclatement, d'affaiblissement et de perte de contrôle du pouvoir central la seule structure qui ait un tant soit peu résisté à la décomposition générale et qui permet de maintenir encore une apparence de cohésion de l'URSS, c'est l'armée. Cependant, la même dynamique qui domine aujourd'hui l'URSS est à l'oeuvre là aussi. Les centaines de milliers de soldats rapatriés d'Europe de l'Est se retrouvent avec leur famille sans logement, sans occupation, dans des conditions de misère d'autant plus mal ressenties qu'ils viennent de quitter des pays au niveau de vie plus élevé que l'URSS, ce qui aggrave le malaise profond qui mine 1'"armée rouge" depuis le retrait d'Afghanistan. Des batailles rangées mettent aux prises des soldats de différentes nationalités dans les casernes. Les refus d'incorporation, les désertions, les refus d'obéissance se généralisent.
La bourgeoisie soviétique n'a plus aujourd'hui les moyens de la répression généralisée. Si son armée peut encore assumer le maintien de l'ordre dans certaines régions troublées, sa capacité d'action sur ce plan se trouve néanmoins grandement limitée. Les tergiversations de l'appareil répressif face aux tensions en Lituanie ou dans le Caucase, les déclarations contradictoires à ce propos traduisent bien la situation de désarroi et d'impuissance dans laquelle se trouve le gouvernement du Kremlin. Il n'y a guère que les plus imbéciles des nostalgiques de l'époque révolue du stalinisme pour croire encore que la répression à grande échelle serait possible sans précipiter l'URSS plus rapidement encore dans la guerre civile.
LE PROLETARIAT DANS LA TOURMENTE
Ni le mécontentement général, ni le discrédit total du régime, et encore moins la lutte de classe ne sont à l'origine de l'effondrement de l'Etat stalinien. Le mécontentement n'est pas nouveau, pas plus que le discrédit dont pâtit l'Etat. Quant à la lutte de classe, il suffît de constater, qu'avant la grève des mineurs de l'été 1989, il n'y avait pas eu de lutte significative en URSS.
C'est au nom de la défense du communisme, de l'internationalisme prolétarien, que des générations de prolétaires ont subi la bestialité du stalinisme, produit de l'écrasement de la Révolution russe. Le rejet du régime s'est accompagné, pour les ouvriers de l'URSS, d un rejet de la tradition révolutionnaire du prolétariat, de son expérience de classe, conduisant es descendants des prolétaires de la révolution à un déboussolement politique total, identifiant la pire des dictatures capitalistes au socialisme. En réaction au stalinisme les aspirations au changement des travailleurs soviétiques se sont orientées vers un folklore nationaliste issu d'un passé mythique ou vers les mirages merveilleux des "démocraties" affairistes occidentales.
Dans la mesure où il n'a pas provoqué l'effondrement du régime stalinien, le prolétariat subit d'autant plus fortement les conséquences dévastatrices de la dynamique d'éclatement et de décomposition. Plus qu’aux illusions démocratiques qui ne correspondent à aucune tradition historique en URSS, et sont plutôt réservées à la petite-bourgeoisie intellectuelle, le prolétariat est particulièrement réceptif à la démagogie nationaliste et populiste. Le poids du nationalisme sur le prolétariat est dû à la fois à l'arriération du capitalisme russe qui, étant donné sa faiblesse économique, n'a pu intégrer la population colonisée par l'empire tsariste, et au rejet viscéral du gouvernement central symbole des années de dictature et de terreur.
Avec la Perestroïka, au nom des réformes et du changement, les attaques contre les conditions de vie des ouvriers se sont intensifiées. Les augmentations de salaire ne suivent pas les hausses successives des produits de première nécessité. Pour l'année 91 on attend une inflation à trois chiffres. Début avril le pain a augmenté de 200 %, le sucre de 100 %. Et il en est ainsi de tous les produits de première nécessité. Sous prétexte de renouvellement des billets de banques, l'Etat pratique; un hold-up sur les économies des salariés et des retraités. Le rationnement s'est étendu à une gamme toujours plus large de produits. Dans ces conditions, le mécontentement s'est exacerbé. Depuis le début de l'année, de nombreuses grèves se sont déroulées en URSS, témoignant de la combativité des ouvriers. Selon le Bureau des statistiques, les grèves ont coûté 1,17 millions d'heures de travail durant le premier trimestre 1991. Cependant, ces grèves qui se développent, si elles montrent la combativité retrouvée des travailleurs, et leur volonté de résister aux attaques contre leurs conditions de vie, illustrent aussi leur faiblesse politique et leur déboussolement. Comme le montre la grève des mineurs du printemps dans toute l'URSS, ou la grève générale qui touche la Biélorussie à la même époque.
Alors que ces grèves démarrent sur le terrain économique, ce sont les représentants des tendances les plus nationalistes gui prennent le contrôle des comités de grève qui se forment. Alors que la grève des mineurs avait paralysé la production de centaines de puits et mobilisé des centaines de milliers de travailleurs dans toute l'URSS, alors que toutes les propositions du gouvernement central ont été rejetées durant des semaines, la négociation séparée des comités de grève locaux avec les représentants de chaque république, va conduire à la dislocation du mouvement. En Russie, la démagogie populiste et nationaliste d'un Eltsine qui promet aux mineurs qu'ils « auront le droit de choisir leur mode de gestion et leur régime de propriété, a plus d'effet que les propositions de doublement des salaires de Pavlov pour arrêter la grève. Sitôt effectuée la reprise du travail, Eltsine qui quelques semaines plus tôt appelait à la démission de Gorbatchev et se donnait ainsi un vernis radical à bon compte, noue une nouvelle alliance avec ce dernier, instaurant de concert un régime d'exception », c'est-à-dire l'interdiction des grèves dans les secteurs des transports, les secteurs industriels de base et les entreprises consacrées aux consommateurs soviétiques.
La faiblesse du prolétariat de l'URSS face aux mystifications démocratiques et nationalistes, fait que non seulement, il n'est pas capable de défendre une quelconque perspective face au chaos, mais ses luttes actuelles sont dévoyées de leur terrain de classe, vouées à la défaite. Eltsine a pu utiliser la grève des mineurs pour renforcer sa crédibilité politique et son pouvoir économique. Le récent abandon de souveraineté sur la production de charbon en annonce bien d'autres et exprime la dynamique d'éclatement du capital soviétique.
Le prolétariat, trop faible pour résister, est lui aussi marqué par la dynamique d'éclatement et de décomposition qui ravage l'URSS. Le poison nationaliste est une gangrène qui n'a pas pour effet simplement d'handicaper le prolétariat dans ses luttes, mais il est un facteur mortel de destruction de l'identité de classe, de division des travailleurs. La situation en Arménie, en Azerbaïdjan, en Géorgie, dans les pays baltes, où les ouvriers ne se manifestent pas sur leur terrain de classe, mais où ils sont atomisés, dilués dans le mécontentement général que cristallise le nationalisme, enrôlés dans les milices nationalistes, embrigadés dans de nouveaux conflits comme dans le Caucase. La situation de décomposition qui atteint le prolétariat dans les républiques périphériques est celle qui menace la classe ouvrière dans toute l'URSS.
LA PEUR DES GRANDES PUISSANCES FACE A L'ECLATEMENT DE L'URSS
Loin de se réjouir des déboires de leur ancien rival impérialiste qu'elles avaient craint durant, de longues décennies, les puissances occidentales sont gagnées par l'inquiétude devant les conséquences de l'effondrement du système stalinien.
La fin du bloc russe, a déterminé le délitement de son rival occidental qui perdait sa principale raison d'être, libérant mondialement la tendance naturelle du capitalisme au chacun pour soi. L'effondrement politique du stalinisme en URSS entraîne avec lui celui de ses alliés dans le monde. Dans tous les pays d'Europe de l'Est les divers partis communistes doivent abandonner le pouvoir, de nouveaux régimes instables et fragiles s'installent qui sanctionnent la perte de contrôle de l'URSS et leur nouvelle indépendance. A la périphérie les dictatures qui ne trouvaient leur légitimité que du soutien politique et militaire de 'URSS doivent céder de leur pouvoir. En Angola, les troupes de l’ex-bloc de l'Est se sont retirées, le MPLA doit passer sous les fourches caudines des diktats occidentaux. En Ethiopie, Mengistu privé des approvisionnements d'armes que lui livrait l'URSS n'a pu sauver sa peau que par une fuite précipitée à l'étranger. On se demande combien de temps Castro va pouvoir encore tenir à Cuba. L'exemple contagieux fragilise toutes les dictatures. L'effondrement politique de l'URSS est un facteur profondément déstabilisateur de la situation mondiale.
Le réveil des nationalités s'accompagne d'une exacerbation des tensions nationalistes, la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan préfigure l'état de désordre dans lequel se précipitent ces futurs Etats qui basent leur existence sur les aspects les plus archaïques et anachroniques des différentes cultures nationales.
Le gigantesque arsenal que s'est constitué l’"armée rouge" est menacé d'être dispersé suivant les multiples lignes de fracture de la dislocation de l'URSS. Demain, les armes nucléaires, les centrales atomiques, les milliers de chars, canons, fusils risquent de se trouver sous le contrôle des forces les plus anachroniques auxquelles peut donner naissance la putréfaction du régime stalinien, rendant à jamais caduque toute idée de contrôle de la dissémination des armes nucléaires par les grandes puissances et aggravant la menace d"'accidents" nucléaires majeure. Tchernobyl n'est pas un hasard, mais l'exacte concrétisation de la situation en URSS.
Face à une telle situation de déstabilisation, les autres grandes puissances du globe et en premier lieu les USA et les Etats européens n'ont aucun intérêt à ce que l'effondrement de l'URSS et sa désagrégation en de multiples Etats rivaux s'accélère. Tous leurs efforts vont se conjuguer pour soutenir les facteurs de cohésion politique de l'URSS, et promouvoir des réformes pour tenter de stabiliser la situation économique et sociale.
Dans ces conditions, l'Occident ne peut que soutenir Gorbatchev, dernier garant de l'unité de l'URSS et partisan proclamé des réformes. Depuis des années, c'est la politique qui est suivie strictement, mais ce faisant les bourgeoisies occidentales s'enferment dans la même contradiction que la Perestroïka. Les fractions les moins décomposées du Parti sur lesquelles s'appuie Gorbatchev regroupent les éléments les plus hostiles aux réformes ou timides vis-à-vis de celles-ci. Avec Pavlov comme premier ministre, c'est la vieille garde du parti qui est aux commandes. Les fractions es plus réformatrices ont rejoint les courants nationalistes, et leur victoire signifierait aujourd'hui une accélération de la dynamique d'éclatement. Au nom du maintien des frontières internationales et de la volonté de préserver l'existence de plus en plus théorique de 1’URSS, les "démocraties" occidentales soutiennent, en fermant opportunément les yeux, la répression qui vise à calmer la fièvre indépendantiste des Lituaniens, des Arméniens et des Géorgiens.
L'incapacité des divers gouvernements de la Perestroïka à réformer l'économie et à relancer la production se concrétise dans les appels désespérés à l'aide internationale, à de nouveaux crédits. Pavlov, le premier ministre qui il y a peu accusait l'Occident de distribuer des produits radioactifs lors des opérations d'aides alimentaires de l'hiver dernier, déclare aujourd'hui que «sans l'aide de l'Occident, nous n'y arriverons pas».
Cependant, les principaux pays occidentaux dont les économies sont secouées par le développement de la récession n'ont pas les moyens de venir en aide à l'économie soviétique défaillante. La pénurie générale de liquidités et d'autres priorités rendent impossible l'instauration d'un plan Marshall tant souhaité par les pays d'Europe de l'Est et l'URSS. On mesure simplement à la vue de la situation en Allemagne de l'Est, pourtant naguère le pays le plus développé de l'Est, comment dans le chaos de l'URSS, des centaines de milliards pourraient être injectés sans grand résultats productifs. Les prêts occidentaux servent surtout à parer au plus pressé et à soulager la tension sociale immédiate, sans autre résultat que de reporter les échéances à plus tard.
Mais si l'Occident est bien obligé de mesurer son aide économique à Gorbatchev, il ne va pas, en revanche, lésiner sur l'appui politique qu'il peut lui apporter. Reconnu comme seul interlocuteur valable, le chef de l'Etat soviétique va bénéficier d'une couverture médiatique mondiale de première classe. Lors de leurs voyages à l'étranger les représentants des diverses nationalités qui ressurgissent en URSS se voient sermonnés. On leur conseille la patience pour calmer leurs ardeurs indépendantistees, et on les renvoie au dialogue avec Moscou. Lors de son voyage européen, au printemps, alors qu'il vient de demander la démission de Gorbatchev, Eltsine essuie rebuffade sur rebuffade. Il n'est pas question pour les occidentaux de donner une plus grande crédibilité internationale au leader russe dont la victoire signifierait une accélération de l'éclatement de l'URSS. Apparemment, le message a été compris, puisque, des son retour, Eltsine fait un virage à 180° et s'allie à Gorbatchev. L'Occident utilise tous les moyens de pression dont il dispose sur les principaux acteurs du drame qui se joue en URSS pour tenter de calmer le jeu.
Cependant, avec leurs moyens les pays occidentaux n'ont pas plus la capacité d'empêcher un éclatement inéluctable, tout au plus peuvent-ils permettre de freiner, de retarder une telle perspective, gagner du temps afin d'essayer de contrôler les aspects les plus explosifs de la situation. L'impuissance de l'Occident rejoint en définitive celle de Gorbatchev, traduisant le fait que les mêmes contradictions fondamentales qui déterminent l'effondrement de l'URSS, sont aussi à l'oeuvre dans le reste du monde ([2] [309]). Le "tiers-monde" a précédé l'URSS dans cette plongée dans le chaos qu'elle connaît maintenant. La décomposition de 1 URSS n'est pas le simple produit des spécificités de l'URSS, elle est l'expression d'une dynamique mondiale dont la concrétisation a été rendue plus rapide et % Elus explosive par les spécificités historiques et la faiblesse du capital russe.
Dans l'incapacité de trouver un palliatif ou une issue à ses contradictions, le capital mondial depuis plus de 20 ans s'enfonce dans la crise économique. L'effondrement économique de l'URSS, après celui du tiers-monde, et son "africanisation" présente, montrent la progression de la gangrène de la décomposition qui aujourd'hui pèse de plus en plus fortement sur 1 ensemble de la planète ([3] [310]).
JJ
[1] [311] Voir Revue internationale, n° 60, 1er trimestre 1990 : "Thèses sur la crise économique et politique dans les pays de l'Est" et "La faillite définitive du stalinisme , Revue internationale, n° 61, 2e trimestre 1990 : "Après l'effondrement du bloc de l'Est, déstabilisation et chaos".
[2] [312] Voir Revue Internationale, n°57, 2e trimestre 1989: "La décomposition du capitalisme", Revue Internationale, n°62, 3e trimestre 1990 : "La décomposition, phase ultime de la décadence capitaliste".
[3] [313] Voir l’éditorial de ce numéro de la Revue Internationale.
Géographique:
Questions théoriques:
- Décadence [32]
- Décomposition [3]
Souvenons-nous : les massacres et les crimes des « grandes démocraties »
- 5197 reads
La guerre du Golfe est venue rappeler avec force à la classe ouvrière que le capitalisme c'était aussi la guerre, ce summum de la barbarie, et cela ne peut que l'interpeller et la pousser à la réflexion. C'est pourquoi la bourgeoisie des "pays démocratiques", durant toute la guerre, a systématiquement caché l'ampleur des destructions et des massacres, et, qu'après la guerre, elle a monté une gigantesque campagne humanitaire et démocratique autour du massacre des Kurdes, dans le but de tenter de faire oublier aux ouvriers ses propres crimes et sa responsabilité dans ces massacres. La bourgeoisie des "grandes démocraties" a une longue expérience en ce domaine, tant en termes de tueries que de mensonges et de cynisme. Le prolétariat doit se rappeler les multiples crimes accomplis par la bourgeoisie "démocratique" ainsi que sa complicité directe ou indirecte dans les massacres et destructions commis tant par le stalinisme que par le fascisme.
Les mensonges et le cynisme de la bourgeoisie pendant et après la "guerre du golfe"
Durant toute la durée de la guerre, pratiquement aucune image ne nous est parvenue des massacres et des destructions infligés à la population irakienne. Black-out total et médias aux ordres, telle a été la règle absolue. Encore aujourd'hui, aucun chiffre précis n'est fourni, mais il est certain que plus de 200.000 civils et près de 250 000 soldats irakiens ont été tués, sans parier des blessés et de tous ceux qui resteront infirmes à vie. Alors que l’on nous a vanté de façon obscène « la précision des bombardements chirurgicaux », un général américain, responsable de l’US Air Force a depuis admis que sur les 88 500 tonnes de bombes déversées sur l'Irak, moins de 7 % étaient à guidage laser, 70 % des bombes auraient raté leurs cibles et il avouait que les aviateurs avaient "arrosé" sans trop se soucier d'une précision millimétrique, selon la vieille et sinistre méthode du «tapis de bombes » ! On mesure l'ampleur des destructions des zones civiles opérées dans de telles conditions. Mais de tout ceci, rien ou presque n'a filtré. Par contre, on a étalé dans tous les médias, avec une complaisance morbide, le spectacle de milliers de Kurdes, femmes, enfants, vieillards crevant de faim et de froid, lapant comme des chiens l'eau croupie d'une flaque d'eau et se battant autour des camions pour un bout de pain ou une bouteille d'eau. Le cynisme et l'incroyable duplicité des bourgeoisies américaine, française et anglaise se sont révélés une fois de plus dans toute leur sinistre crapulerie. Car non seulement elles utilisent ces massacres pour tenter de faire oublier leurs propres crimes de guerre, mais elles sont directement responsables de cette tuerie aux allures de génocide qui fait que le total des victimes de la guerre approche désormais du million !
Elles ont en effet poussé sciemment à la révolte les Chiites et les Kurdes, encouragé la clique bourgeoise kurde à proclamer la rébellion, en lui laissant entendre qu'elles l'aideraient, tout en se gardant dans les faits d'apporter la moindre aide et en laissant soigneusement à Saddam Hussein les forces suffisantes pour assurer le succès de la répression. En dressant ce piège dans lequel sont mortes au moins 250 000 personnes, elles faisaient d'une pierre deux coups : tenter de faire oublier leurs propres massacres en braquant tous les projecteurs de leurs médias sur le nouveau crime de « Hitler du Moyen-Orient », et empêcher, par cette répression massive, la libanisation de l'Irak, voire de toute la région, en cas de succès de la rébellion kurde et chiite, sans avoir à se salir eux-mêmes les mains, puisque le « diabolique Saddam Hussein » se chargeait, une fois de plus, de jouer le rôle du boucher. C'est pourquoi, alors que la répression s'est déroulée sous les yeux de l'armée américaine, ce n'est qu'une fois celle-ci complètement achevée que les pleureuses de l'action humanitaire sont entrées en scène.
Le machiavélisme de la bourgeoisie, son art de la mise en scène, sa capacité à entraîner à la tuerie des centaines de milliers d'êtres humains, ne datent pas d'aujourd'hui. Les horreurs du Golfe ne sont de ce point de vue que la suite d'une longue série macabre, tout au long de la décadence du capitalisme, les "grandes démocraties" ont largement expérimenté ce type de scénarios et leur conclusion toujours sanglante, que ce soit à l'occasion de la situation toujours dangereuse qui prévaut dans le cas d'un pays vaincu à la fin d'une guerre, ou pour faire oublier ou tenter de justifier leurs propres crimes, en focalisant toute l'attention sur les crimes des "autres", en les "diabolisant".
La deuxième guerre mondiale : les crimes et massacres de la « démocratie » et de l’«anti-fascisme »
La liste des crimes et boucheries perpétrés par ces parangons du droit et de la morale que sont les vieilles démocraties bourgeoises est si longue qu'un numéro entier de cette revue y suffirait à peine. Rappelons pour mémoire la première boucherie mondiale, où tous les protagonistes étaient des démocraties, y compris la Russie de 1917 du très "socialiste et démocratique" Kerenski, et le rôle qu'y a joué la social-démocratie comme grand pourvoyeur de chair à canon. Cette dernière, endossant résolument l'habit du boucher lors de la répression sanglante de la révolution en Allemagne en janvier 1919, où des milliers d'ouvriers périrent rien que dans la ville de Berlin. Souvenons-nous encore des corps expéditionnaires anglais, français et américains envoyés pour réduire à merci, par le sang, la révolution d'Octobre ; le génocide des Arméniens par l'État turc avec la complicité directe des gouvernements français et britannique ; le gazage des Kurdes par l'armée anglaise en 1925, etc. Au fur et à mesure que le système capitaliste s'enfonçait dans sa décadence, sa seule béquille, son seul moyen de survie fut de plus en plus la guerre et la terreur, et cela tant dans les États "démocratiques" que dans les États "totalitaires". Mais dans le cadre forcément limité d'un article, nous nous attacherons tout d'abord à dénoncer ce qui constitue sans nul doute, avec la monstrueuse identification entre communisme et stalinisme, le plus grand mensonge de ce siècle : la nature de la seconde guerre mondiale, soi-disant « guerre de la démocratie contre le fascisme, guerre du droit et de la morale contre la barbarie nazie », comme l'enseignent encore aujourd'hui tous les manuels scolaires. Guerre où la barbarie aurait été essentiellement d'un seul côté, celui des puissances de l'Axe et où, dans le camp de nos vertueuses démocraties, la guerre n'aurait été que défensive et essentiellement, pour reprendre les termes actuels de la propagande bourgeoise, « une guerre propre ». L'étude de la seconde guerre impérialiste mondiale permet non seulement de mesurer l’énormité de ce mensonge, mais encore de comprendre comment, pendant et après la guerre du Golfe, la bourgeoisie démocratique a largement puisé dans l'expérience qu'elle a acquise durant cette période historique cruciale.
La terreur des bombardements sur la population allemande
Dès son arrivée au pouvoir en 1940, le chef d'État de la plus vieille démocratie du monde, l’Angleterre, en même temps que le véritable dirigeant politique de la guerre, côté Alliés, Sir Winston Churchill, met sur pied le "Bomber Command", noyau central des bombardiers lourds devant aller semer la terreur dans les villes allemandes. Pour justifier cette mise au point d'une véritable stratégie de la terreur, pour couvrir idéologiquement son lancement, Churchill utilisera les bombardements massifs allemands sur Londres et Coventry durant l'automne 1940 et celui sur Rotterdam, en exagérant délibérément la portée de ce dernier. Les médias anglo-américains parleront de 30 000 victimes alors qu'il n'y en eut en fait qu'un millier. La couverture idéologique ainsi assurée, Lindemann, conseiller de Churchill, peut en mars 1942 lui faire la suggestion suivante : « Une offensive de bombardements extensifs pourrait saper le moral de l’ennemi pourvu qu'elle soit dirigée contre les zones ouvrières des 58 villes allemandes, ayant chacune une population de 100.000 habitants... », et il concluait en disant « qu'entre mars 1942 et le milieu de 1943, il devait être possible de rendre sans abris un tiers de la population totale de l'Allemagne. » La bourgeoisie britannique adopte alors cette stratégie de terreur, mais dans toutes ses déclarations officielles, le gouvernement de sa gracieuse Majesté insistait sur le fait que le « Bomber Command ne bombardait qu'à des fins d'ordre militaire et ne visait que des objectifs militaires, toute allusion à des attaques contre des zones ouvrières ou civiles étant rejetée comme absurde et attentatoire à l'honneur des aviateurs qui sacrifiaient leur vie pour la patrie » !
Première et sinistre illustration de ce cynique mensonge, le bombardement de Hambourg en juillet 1943. L'utilisation massive des bombes incendiaires provoque la mort de 50.000 personnes, fait 40.000 blessés et ce, pour l'essentiel, dans des zones résidentielles et ouvrières. Le centre-ville fut entièrement détruit et, en deux nuits, le nombre total de victimes fut, à Hambourg, égal au nombre de tués sous les bombardements, côté anglais, durant toute la durée de la guerre ! À Kassel, en octobre 1943, près de 10.000 civils périrent dans une gigantesque tempête de feu. Face à certaines questions sur l'ampleur des dommages causés aux populations civiles, le gouvernement anglais répondait invariablement «qu’aucune instruction n'avait été donnée pour détruire des maisons d'habitation et que les cibles du Bomber Command étaient toujours des cibles militaires. » Début 1944, les raids de terreur sur Darmstadt, Königsberg, Heilbronn, firent plus de 24 000 victimes parmi les civils. À Braunschweig, perfectionnant leur technique au point qu'aucun mètre carré des zones d'habitations ne put échapper aux bombes incendiaires lâchées par les bombardiers, 23.000 personnes furent prises au piège du brasier gigantesque qu'était devenu le centre-ville et périrent carbonisées ou asphyxiées. Cependant le black-out était total, et un général américain (les forces US commençant à participer massivement à ces « bombardements extensifs ») déclare à cette époque : « A aucun prix nous ne devrions permettre aux historiens de cette guerre de nous accuser d'avoir dirigé des bombardements stratégiques sur l'homme de la rue. » Quinze jours avant cette déclaration, un raid US sur Berlin avait provoqué la mort de 25.000 civils, ce dont était parfaitement au courant ce général. Les mensonges et le cynisme qui ont prévalu pendant toute la guerre du Golfe sont une longue et solide tradition de nos "grandes démocraties".
Cette stratégie de la terreur inspirée et dirigée par Churchill visait trois objectifs : accélérer la chute et la défaite militaire de l'Allemagne en sapant le moral de la population, étouffer par le feu toute possibilité de révoltes, et plus encore, de surgissements prolétariens. Ce n'est pas un hasard si les bombardements de terreur se sont systématisés au moment même où des grèves ouvrières éclataient en Allemagne et où, depuis la fin 1943, les désertions au sein de l'armée allemande tendaient à s'amplifier. Churchill, qui avait fait ses premières armes de boucher contre la révolution russe, était particulièrement attentif à ce danger. Enfin, en 1945, avant notamment la conférence de Yalta de février, il s'agissait de se placer, grâce à ces bombardements, en position de force lace à une avancée de l'armée russe jugée trop rapide par Churchill.
Le déchaînement de barbarie et de mort entraîné par ces raids aériens, dont les principales victimes étaient des ouvriers et des réfugies, trouva son paroxysme à Dresde en février 1945. À Dresde, il n'y avait aucune industrie importante, ni installation militaire ou stratégique, et c'est cette absence qui fit de Dresde une ville refuge pour des centaines de milliers de réfugiés fuyant les bombardements et l'avancée de "l'armée rouge", aveuglés qu'ils étaient par la propagande "démocratique" des Alliés, persuadés que Dresde ne serait jamais bombardée. Les autorités allemandes se laissèrent elles aussi aveugler par cette propagande, puisqu'elles installèrent un grand nombre d’hôpitaux civils dans cette ville. Cette situation était parfaitement connue par le gouvernement britannique, à tel point que certains chefs militaires du Bomber Command, émirent de sérieuses réserves quant à la validité militaire d'un tel objectif. On leur répondit sèchement que Dresde était un objectif prioritaire pour le premier Ministre et tout fut dit.
En bombardant Dresde les 13 et 14 février 1945, la bourgeoisie anglaise et américaine savait parfaitement qu'il s'y trouvait alors près d'un million et demi de personnes, dont un grand nombre de femmes et d'enfants réfugiés, de blessés et aussi de prisonniers de guerre. 650.000 bombes incendiaires tombèrent sur la ville produisant la plus gigantesque tempête de feu de toute la seconde guerre mondiale. Dresde brûla pendant huit jours, on voyait l'incendie à plus de 250 kilomètres. Certains quartiers de la ville étaient si brûlants qu'il fallut attendre plusieurs semaines avant de pénétrer dans certaines caves. Sur 35.000 immeubles d'habitation, seuls 7000 restèrent debout, tout le centre-ville avait disparu et la plupart des hôpitaux furent détruits. Le 14 février, 400 forteresses volantes américaines, prenant le relais des bombardiers anglais, déversèrent encore 771 tonnes de bombes incendiaires. Le bilan de ce qui fut sans conteste l'un des plus grands crimes de guerre de la seconde boucherie mondiale fut de 250 000 morts, dont presque tous étaient des civils. À titre de comparaison, cet autre crime odieux que fut Hiroshima fit 75.000 victimes et les terribles bombardements américains sur Tokyo en mars 1945 provoquèrent 85.000 morts !
Ordonnant le bombardement de Chemnitz les jours suivants, le commandement ne s'embarrasse plus d'aucune précaution oratoire. Il déclare aux aviateurs : « Vos raisons d'aller là-bas cette nuit sont d'achever tous les réfugiés qui peuvent avoir échappé de Dresde. » Langage de bouchers s'il en fût, on peut mesurer à travers tout ceci qu'en termes de barbarie, la coalition anti-fasciste n’avait rien à envier aux nazis. Le 1er novembre 1945, en 18 mois de bombardements, 45 des 60 principales villes allemandes avaient été quasiment complètement détruites. Au moins 635.000 civils périrent au cours de ces raids de terreur.
De même, en termes de cynisme et de mensonge éhonté, elle n'a pas non plus grand chose à envier à un Goebbels ou à un Staline. Face aux questions suscitées par ces terrifiants massacres, la bourgeoisie anglo-américaine répondit, contre toute évidence, que Dresde était un centre industriel et plus encore militaire très important. Churchill, quant à lui, ajouta d'abord que c'était les Russes qui avaient demandé qu'on effectue un tel bombardement, ce que tous les historiens s'accordent aujourd'hui à considérer comme faux, puis il tenta de rejeter la responsabilité sur les militaires, d'en faire une sorte de bavure ! Les "travaillistes", ces chiens sanglants, ces tartuffes immondes de la démocratie bourgeoise, enfourchèrent le même cheval de bataille pour tenter de se laver les mains d'une telle horreur. Le travailliste C. Attlee qui avait succédé à Churchill, s'attira cette réponse du chef militaire du Bomber Command : « La stratégie de la force de bombardement critiquée par Lord Attlee fut décidée par le gouvernement de Sa Majesté dont lui (Lord Attlee) a été un des chefs pendant presque toute la guerre. La décision de bombarder les villes industrielles fut prise, et prise avec une grande netteté, avant que je ne devienne commandant en chef du Bomber Command ». La stratégie de la terreur fut une décision politique prise par l'ensemble de la bourgeoisie anglaise à laquelle s'est pleinement rallié cet autre "grand démocrate" qu'a été Roosevelt, qui, quant à lui, décida la fabrication de la bombe atomique. La barbarie démocratique a été pleinement à la hauteur de la barbarie fasciste et stalinienne. Les petits-fils de Churchill et Roosevelt que sont les Bush, Mitterrand et Major ont bien appliqué leurs leçons pendant la guerre du Golfe, que ce soit en termes de massacre, de lock-out, de mensonges ou de cynisme le plus total[1].
L'utilisation des camps de concentration nazis par le camp « démocratique »
Autre exemple de cette longue tradition démocratique consistant à masquer et justifier ses propres crimes et abominations en braquant tous les projecteurs sur d'autres crimes, d'autres horreurs : l'utilisation qui a été faite des camps de concentration pour justifier la barbarie de la boucherie impérialiste côté Alliés. Loin de nous l'idée de nier la sordide et sinistre réalité de ces camps de la mort[2], mais la publicité obscène qui en a été faite depuis n'a rien à voir avec des considérations humanistes et encore moins avec l'horreur légitime provoquée par une telle barbarie. La bourgeoisie, tant anglaise qu'américaine, savait parfaitement ce qui se passait dans ces camps. Et pourtant, chose étrange en apparence, elle n'en parle pratiquement pas pendant toute la guerre et n'en fait pas un thème central de sa propagande. Ce n'est qu'après la guerre qu'elle en fit l’axiome principal de sa justification de la seconde boucherie impérialiste mondiale et plus largement de la défense de la sacro-sainte démocratie. En fait, les gouvernements de Churchill et Roosevelt craignaient comme la peste que les nazis n'expulsent massivement les Juifs et ne vident les camps. Dès la rencontre anglo-américaine des Bermudes en 1943, le ministre anglais des affaires étrangères A. Eden faisait part d'une telle inquiétude et la décision fut prise « qu’aucun navire des Nations Unies ne peut être habilité à effectuer le transfert des réfugiés d'Europe. » En termes clairs, ils peuvent crever en toute tranquillité dans les camps ou ailleurs ! Lorsque la Roumanie, alliée de l'Allemagne, veut libérer 60.000 Juifs, lorsque la Bulgarie veut faire de même, elles se heurtent à un refus catégorique de la part de ce « grand combattant de la liberté » qu'était Roosevelt, pour qui « transporter tant de monde désorganiserait l'effort de guerre ». La mésaventure survenue à Joël Brandt en avril 1944, dirigeant d'une organisation de Juifs hongrois, confirme de manière particulièrement éclatante que les "grandes démocraties" anglaise et américaine n'avaient strictement rien à faire des souffrances des Juifs entassés dans les camps en Allemagne. Lorsque la bourgeoisie invoque à tout bout de champ les Droits de l'Homme, ce n'est que pour les besoins de sa propagande et pour perpétuer tranquillement ses crimes derrière cette feuille de vigne. Eichmann, chef SS de la section juive, confie à J. Brandt, avec l'accord de Himmler lui-même, que le gouvernement nazi veut libérer un million de Juifs en échange de 10.000 camions, voire même de moins. Muni de cette proposition, Brandt va voir les anglo-américains persuadés que ceux-ci vont accepter. Comme le souligne la brochure du PCI (Programme Communiste) "Auschwitz ou le grand alibi" : «Non seulement les Juifs mais aussi les SS s'étaient laissés prendre à la propagande humanitaire des Alliés ! Les Alliés n'en voulaient pas de ce million de Juifs ! Pas pour 10.000 camions, pas pour 5000, même pour rien ! » Brandt se heurta à un refus complet et catégorique tant de la part du gouvernement de Churchill que de Roosevelt, et ce alors même que les nazis avaient proposé de libérer 100.000 Juifs sans contrepartie pour preuve de leur bonne foi, et ce million de juifs resta à crever dans les camps
S'il est vrai que la plupart des camps furent, avant de se transformer en camps de la mort, d'abord des camps de travail ; s'il est encore plus vrai que toute la publicité morbide faite autour des camps et des chambres à gaz, de 1945 à aujourd'hui, vise avant tout à blanchir et à faire oublier tous les crimes commis par le "camp démocratique", il ne s'agit en aucune façon d'une inexistence des génocides monstrueux, malheureusement bien réels, perpétrés ans ces camps, comme le prétendent ces nazillons de la pensée que sont les "révisionnistes" de l'histoire des camps de concentration. Cette tendance soi-disant radicale ne vise en fait qu'à participer à l'entreprise générale de la bourgeoisie de banalisation de l’horreur, de la barbarie du capitalisme en décadence, sous toutes ses formes, et dont les crimes et les massacres accomplis par les nazis furent l'un des sommets.
À la fin de la guerre, les USA gardent l'essentiel des prisonniers juifs dans les mêmes camps que les Allemands, dans des conditions effroyables. Le général américain Patton déclara même à cette époque : « Les Juifs sont inférieurs aux animaux. » Là encore, où est la différence entre la crapule nazie et la crapule galonnée démocratique ? La bourgeoisie du camp anti-fasciste s'est souciée comme d’une guigne pendant toute la guerre du sort des Juifs comme du sort de la population en général. Elle n'a ensuite utilisé le génocide juif que pour masquer et dissimuler ses propres crimes de guerre, pour masquer que c'est le capitalisme comme un tout qui est responsable de la boucherie de 1939-45 et de son cortège d'horreurs indicibles[3].
La "démocratie" face aux grèves ouvrières en Italie (1943) et à l'insurrection de Varsovie (août 1944)
La répression massive des populations kurde et chiite en Irak et la complicité totale dans ces massacres des «patries des Droits de l'Homme », peut se comparer jusqu'à un certain point avec l'attitude des Alliés durant la seconde guerre mondiale. Il ne s'agit pas ici de comparer des mouvements foncièrement bourgeois, dans lesquels les ouvriers ne jouent aucun rôle, si ce n'est celui de chair à canon, tel le mouvement nationaliste kurde, avec ce qui s'est passé en Italie où, en 1943, les ouvriers tendaient, du moins au début, à se tenir sur un terrain de classe. Mais une fois cette distinction fondamentale opérée, il s'agit de voir ce qu'il y a de commun dans 1’attitude de la bourgeoisie démocratique entre hier et aujourd'hui.
En Italie fin 1942 et surtout en 1943, des grèves éclatent un peu partout dans les principaux centres industriels du Nord. Partout on revendique pour un meilleur ravitaillement, de meilleurs salaires, et certains ouvriers appellent même à la constitution de conseils d'usine et de soviets, et ceci contre les staliniens du PCI de Togliatti. Le mouvement est d'autant plus dangereux pour la bourgeoisie que les ouvriers italiens immigrés en Allemagne se mettent eux aussi en grève et rencontrent souvent l'appui de leurs frères de classe allemands. C'est notamment face aux grèves ouvrières que fut prise la décision de renverser Mussolini et de le faire remplacer par Badoglio. Les Alliés, qui avaient appelé le peuple italien à se révolter contre le fascisme, débarquent alors en Sicile et à l'automne 43 occupent totalement et solidement tout le Sud de l'Italie. Mais, inquiets de cette situation potentiellement révolutionnaire, ils stoppent vite, sur la demande de Churchill, leur avance et restent cantonnés dans le Sud. Churchill, fort de son expérience de la vague révolutionnaire qui mit fin à la première guerre mondiale, craint comme la peste le renouvellement d'un semblable scénario. Il convainc alors les USA de «laisser l'Italie mijoter dans son jus», et ralentit alors sciemment la progression de l'armée alliée vers le Nord. Son but : laisser à l'armée allemande le soin de mater et briser la classe ouvrière, en occupant militairement tout le Nord de l'Italie et toutes ses grandes concentrations ouvrières. Il laisse ainsi délibérément l'armée allemande fortifier ses positions et l'armée alliée mettra dix-huit mois à conquérir l'ensemble de la péninsule, dix-huit mois pendant lesquels les ouvriers seront brisés par la soldatesque allemande avec la complicité objective des staliniens qui appellent à l'Union Sacrée derrière Badoglio. La sale besogne accomplie par les Allemands, les armées alliées pourront alors se poser en« libérateurs de l'Italie » et imposer tranquillement leurs vues en imposant la "Démocratie-Chrétienne" au pouvoir.
En Grèce, pays laissé à l'Angleterre dans le grand partage entre requins impérialistes, Churchill va aussi exercer ses talents de « champion de la liberté et de la démocratie». Des grèves et manifestations ouvrières éclatèrent fin 1944, grèves rapidement encadrées et dévoyées par les staliniens qui dominaient, via l'ELAS, toute la résistance grecque. L'ELAS va entraîner la population athénienne à affronter pratiquement à mains nues les tanks britanniques occupant alors la ville. Les tanks démocratiques de Sa Très Gracieuse Majesté rétablirent l'ordre dans le sang, au point qu'Athènes qui, jusqu'alors, vu sa qualité de ville historique, n'avait jamais été bombardée, fut bientôt une ville à moitié en ruine. Churchill dira au général anglais commandant les troupes : « Vous êtes responsable du maintien de l'ordre à Athènes, et devez détruire ou neutraliser toutes les bandes ELAS qui approcheront de la ville... L'ELAS essaiera bien entendu de pousser des femmes et des enfants en avant partout où la fusillade pourra être ouverte. N'hésitez pas cependant à agir comme si vous vous trouviez dans une ville conquise où se serait déclenchée une révolte locale. » (A. Stinas, Mémoires d'un révolutionnaire). Résultat : pris entre l'enclume stalinienne et le marteau démocratique, des milliers d'ouvriers périront.
Ce qui se passe à Varsovie peut encore plus directement être rapproché de la stratégie cynique employée par la bourgeoisie occidentale à la fin de la guerre du Golfe. L'"armée rouge" est aux portes de Varsovie, à 15 kilomètres de la ville le 30 juillet 44 ; éclate alors le soulèvement de la population de Varsovie contre l'occupation allemande. Depuis des mois, les Alliés et l'URSS n'avaient cessé d'exhorter cette population au soulèvement, promettant dans ce cas toute leur aide, et, à la veille du soulèvement, Radio Moscou appelait Varsovie à l'insurrection armée, en assurant du soutien de l’"armée rouge". Toute la population se révolte alors et, dans un premier temps, cette insurrection populaire, dans laquelle les ouvriers jouent un grand rôle, bien que le poids de l'encadrement nationaliste soit très fort, réussit à libérer une bonne partie de la ville de l'occupation militaire allemande. La population se lance d'autant plus massivement dans cette aventure qu'elle est convaincue de recevoir rapidement de l’aide : «L'aide alliée à notre soulèvement paraissait aller de soi. Nous combattions l'hitlérisme, par conséquent nous avions le droit de supposer que toutes les nations unies dans cette lutte nous fourniraient un secours efficace... Nous espérions que les secours viendraient immédiatement. » (Z. Zaremba, La Commune de Varsovie). Staline avait initialement prévu de rentrer dans Varsovie au tout début d'août : l'armée allemande était en déroute, et aucun obstacle militaire sérieux ne s'opposait plus à cette entrée. Mais devant l'insurrection et son ampleur, il chance de plan et retarde délibérément l'avancée de l’armée russe qui va rester cantonnée aux portes de Varsovie pendant deux mois. Elle ne reprendra son avancée qu'une fois l'insurrection écrasée dans le sang par l’armée allemande, au bout de soixante-trois jours. Il déclare froidement que « cette insurrection était réactionnaire et qu'il se dissociait d'une aventure imprudente et terrible dont les instigateurs étaient des criminels. » (Z. Zaremba). Pendant tout ce temps, dans la ville, les troupes allemandes regagnent position après position, il n'y a plus d'eau ni d'électricité, et les munitions, côté insurgés, se font de plus en plus rares. Les insurgés attendent toujours une aide de l'armée russe. Non seulement celle-ci ne vient pas, mais encore Staline les dénonce comme des «séditieux fascistes». La population attendait aussi de l'aide côté anglo-américain. Cette aide, au-delà de bonnes paroles affirmant «l'enthousiasme et la solidarité envers l'insurrection » des gouvernements britannique et américain, ne prendra que la forme dérisoire de quelques maigres parachutages d'armes, totalement insuffisants pour permettre de s'opposer à l'avancée des troupes allemandes et ne servant, de fait, qu'à accroître encore le nombre des tués et des blessés et à prolonger les souffrances vaines de la population de la capitale polonaise. En fait, Staline, devant l'ampleur de l'insurrection, décide, comme Churchill en Italie, « de laisser Varsovie mijoter dans son jus », dans le but évident d'avaler la Pologne sans rencontrer d'obstacle sérieux du côté de la population polonaise. En cas de succès de l'insurrection de Varsovie, le nationalisme se serait trouvé considérablement renforcé et aurait pu dès lors mettre de sérieux bâtons dans les roues des visées de l'impérialisme russe. Il inaugurait en même temps le rôle de gendarme anti-prolétarien, face à une menace ouvrière potentielle à Varsovie, qui lui fut dévolu et qu'il remplit avec zèle à la fin de la seconde guerre mondiale pour tout l'est de l'Europe, Allemagne comprise. En laissant l'armée allemande écraser l'insurrection, il ne trouverait devant lui, ce qui fut le cas, qu'une population décimée et exsangue, donc peu capable de résister efficacement à l'occupation russe et ce sans avoir, de plus, à se salir lui-même les mains puisque les « hordes barbares nazies » faisaient le sale boulot à sa place.
Du côté anglo-américain, où l'on savait parfaitement ce qui se passait, on laisse faire, car Roosevelt avait tacitement laissé la Pologne à l'impérialisme russe. La population de Varsovie fut ainsi froidement sacrifiée sur l'autel des grands marchandages entre requins impérialistes. Le bilan de ce piège mortel lancé aux habitants de Varsovie par Staline et ses complices démocrates fut particulièrement lourd : 50 000 tués, 350 000 déportés en Allemagne, un million de personnes condamnées à l'exode et une ville complètement en ruine[4].
Vis-à-vis des événements de Varsovie, le cynisme de la bourgeoisie apparaît encore plus monstrueux si l'on se souvient que ce fut l'invasion de la Pologne qui décida l'Angleterre et la France à entrer en guerre pour sauver « la liberté et la démocratie en Pologne » lorsqu'on compare la situation d'août 1944 à Varsovie avec la situation de l'après-guerre du Golfe cette année, et si on remplace les polonais par les kurdes, Hitler par S. Hussein et Staline par Bush, on retrouve le même cynisme impitoyable et les mêmes pièges sanglants où la bourgeoisie, pour ses sordides intérêts impérialistes, tout en ayant partout à la bouche les mots de liberté, démocratie et Droits de l'Homme, condamne froidement au massacre des dizaines, des centaines de milliers d'êtres humains.
La seconde boucherie mondiale constitua pour la bourgeoisie une formidable expérience, pour tuer et massacrer des millions de civils sans défense, mais aussi pour dissimuler, masquer, justifier ses propres crimes de guerre monstrueux, en "diabolisant" ceux de la coalition impérialiste antagoniste. Au sortir de la seconde guerre mondiale, les "grandes démocraties", maigre tous leurs efforts pour se donner un air respectable, apparaissent plus que jamais maculées des pieds à la tête par le sang de leurs innombrables victimes.
« Démocratie » et massacres coloniaux
« Le capitalisme est né dans le sang et dans la boue », comme le disait Marx, et les crimes et génocides qu'il a accomplis tout au long de la colonisation illustrent de façon saisissante ce monstrueux accouchement. « Transformation de l'Afrique en une sorte de garenne commerciale pour la chasse aux peaux noires », « os des tisserands indiens blanchissant les plaines de l'Inde » (Marx), résultat de la colonisation britannique du continent indien, etc. La liste exhaustive de tous ces génocides serait, elle aussi, beaucoup trop longue pour le cadre de cet article. Par ailleurs, avec les terribles souffrances qu'il infligeait à l'humanité, le système capitaliste était pendant toute sa phase ascendante encore progressiste, car, en permettant le développement des forces productives, il développait en même temps, et la classe révolutionnaire, le prolétariat, et les conditions matérielles nécessaires à l'avènement du communisme. Plus rien de tel à « l'ère des guerres et des révolutions » marquant l'entrée en décadence d'un système devenu purement réactionnaire. Désormais, les massacres coloniaux n'étaient plus que le terrible prix du sang dû à la survie d'un moloch menaçant maintenant jusqu'à la survie de l'espèce humaine. Dans ce cadre, les multiples crimes et massacres coloniaux commis par les «patries des Droits de l'Homme » que sont les vieilles démocraties bourgeoises n'apparaissent plus que pour ce qu'ils sont : de purs actes de barbarie[5].
Au sortir de la seconde boucherie mondiale, les vainqueurs et notamment ces trois vieilles démocraties que sont les USA, la Grande-Bretagne et la France, promettaient au monde entier l'avènement partout de la liberté et de la démocratie, car «n'était-ce pas pour elles qu'elles avaient consenti tant de sacrifices?» Voyons, puisque l'on a beaucoup parlé auparavant du rôle joué par les Anglais et les Américains, comment s'est comportée le troisième larron de cet inestimable trio du florilège démocratique, « la patrie par excellence des Droits de l'Homme » : la France.
En 1945, le jour même de la capitulation de l'Allemagne, le gouvernement très démocratique de De Gaulle, comprenant alors des ministres "communistes", ordonne à l'aviation française, dont le ministre était le stalinien Tillon, de bombarder Sétif et Constantine, où des mouvements nationalistes osaient remettre en cause la domination coloniale de la gracieuse démocratie française. Les victimes et blessés se comptèrent par milliers et certains quartiers populaires furent réduits en cendres. En 1947, le ministre de la France d'Outre-Mer, le très "démocrate et socialiste" Marius Moutet, organise la terrible répression du mouvement indépendantiste malgache, en utilisant là encore l'aviation, relayée ensuite par les tanks et l'artillerie. De nombreux villages seront rasés, l'on expérimente là, pour la première fois, la sinistre tactique de jeter des prisonniers du haut des avions pour qu'ils s'écrasent sur des villages : il y aura au total 80.000 morts !
À peu près à la même époque, le même M. Moutet ordonne le bombardement de Haïphong en Indochine, sans déclaration de guerre préalable. Durant la guerre d'Indochine, l'armée française se fait les dents, en systématisant la torture : gégène, baignoire, tout l'arsenal y est. Elle établira une règle des plus démocratiques en ordonnant que pour un soldat français tué, huit villages soient brûlés ! Un témoin raconte qu'en Indochine a l'armée française se comportait comme les boches le faisaient chez nous », et il ajoute que «comme à Buchenwald où l'on trouva une tête humaine coupée dans le bureau du commandant du camp, l'on trouvait le même semblable objet, servant de presse-papier, dans nombre de bureaux d'officiers français. » Décidément, encore une fois, la soldatesque galonnée démocratique n'a rien à envier à la soldatesque galonnée nazie ou stalinienne ! Et les "Viets" et leurs atrocités, dont la presse de l'époque faisait sa "Une" (rappelons au passage qu'en 1945 Ho Chi Minh aide les « impérialistes étrangers » à écraser la commune ouvrière de Saigon, voir notre brochure Nation ou Classe), ou plus tard le FLN en Algérie, étaient à bonne école et appliquaient les leçons fournies par la très démocratique armée française.
Lors du début de l'insurrection et rébellion nationaliste algérienne, les "socialistes" étaient au pouvoir en France et le gouvernement comprenait alors Guy Mollet, Mendes-France et le jeune F. Mitterrand, alors ministre de l'intérieur. Le sang de tous ces "authentiques démocrates" ne fît qu'un tour et les pleins pouvoirs furent confiés à l'armée en 1957 pour rétablir "l'ordre républicain". Très vite les grands moyens furent employés, en représailles d'un attentat contre des colons ou l'armée, on rasa des villages et des douars entiers, l'aviation mitrailla systématiquement des caravanes. Deux millions d'Algériens, soit près du quart de la population totale, furent chassés de leur village et zones de résidence, pour être parqués à la totale merci de l'armée dans des "camps de regroupements" où, selon un rapport de M. Rocard, alors inspecteur des finances: «Les conditions sont déplorables et au moins un enfant meurt par jour. » Très vite le général Massu et son complice Bigeard, devenu ensuite ministre de Giscard, se découvrent des talents de tortionnaires. La torture devient partout systématique et à Alger un mot devient vite célèbre, celui de "disparu". Une bonne partie de ceux qui sont livrés à la soldatesque ne réapparaîtra plus jamais. Comme le souligne une note de l'inspecteur général Guilhaume adressée à Mitterrand courant 1957 : « Les coups, la baignoire, le tuyau d'eau, l'électricité sont partout employés. » «A Boulemane, comme dans beaucoup de petites villes des Aurès, la salle de torture fonctionnait jour et nuit... et il n'était pas rare qu'au mess des officiers on boive le Champagne dans des crânes de fellagas (combattants du FLN). » En 1957 le secrétaire général de la préfecture d'Alger, P. Teitgen, dit à propos des tortures à l'avocat P. Vergés :«(...) Tout cela Je le sais hélas et vous comprendrez bien que l'ancien déporté que je suis ne peut le supporter (et il va d'ailleurs démissionner). On se conduit parfois comme les Allemands se conduisaient», et il ajoute qu'il connaît toutes les villas d'Alger où l'on torture...
Cette déclaration d'un haut fonctionnaire est particulièrement intéressante car elle met en lumière, une fois de plus, l'incroyable duplicité de ceux qui nous gouvernent, et particulièrement des sociaux-démocrates. Ainsi G. Mollet déclare le 14 avril 1957 à la fédération socialiste de la Marne : « Sans doute des actes de violence extrêmement rares ont été à déplorer. Mais ils ont été, je l'affirme, consécutifs aux combats et atrocités des terroristes. Quant aux actes de torture prémédités et réfléchis, je dis que si cela était ce serait intolérable. On a comparé à ce sujet le comportement de l'armée française à celui de la Gestapo. Cette comparaison est scandaleuse. Hitler donnait des directives qui préconisaient ces méthodes, tandis que Lacoste et moi avons toujours donné des ordres dans un sens absolument contraire. » Ceux-ci prétendent tout ignorer, alors qu'ils sont parfaitement au courant de la situation, et que ce sont eux qui donnent les ordres. Comme dans toute bande de gangsters, il y a toujours ceux qui commanditent le crime, et ceux qui l'exécutent. On focalise toujours l'attention sur les "flingueurs", qui sont dans ce cas Massu et Bigeard, pour blanchir les véritables responsables, en 'occurrence la canaille social-démocrate qui est au pouvoir. La bourgeoisie française, "socialistes" en tête, a par la suite toujours présenté les massacres et atrocités commises en Algérie (par exemple, de 1957 à l'arrivée de De Gaulle au pouvoir en 1958, 15.000 enfants algériens disparaissaient chaque mois) comme étant l'œuvre de militaires sanguinaires, outrepassant les ordres, mais celui qui a donné ces ordres est sans conteste le gouvernement "socialiste". Encore une fois, qui est le plus criminel : celui qui exécute le crime ou celui qui l’ordonne ?[6]
La bourgeoisie, dans sa version démocratique, s'est toujours acharnée à présenter ses crimes, dès que ceux-ci sont trop évidents pour qu'on ne puisse plus les cacher, comme une bavure, un accident, ou comme l'œuvre de militaires outrepassant la mission qui leur était dévolue. On l'a vu en r rance à propos de l’Algérie, on l'a vu aux USA à propos du Viêt-Nam. Tout ceci n'est que sinistre tartufferie dont le seul but est de préserver le grand mensonge démocratique.
Pour perpétuer sa domination sur la classe ouvrière, il est vital pour la bourgeoisie de maintenir en vie la mystification démocratique, et elle s'est servie et continue de se servir de la faillite définitive du stalinisme pour renforcer cette fiction. Contre ce mensonge d'une prétendue différence de nature entre "démocratie et totalitarisme", toute l'histoire de la décadence du capitalisme nous montre que la démocratie s'est tout autant largement vautrée dans le sang que le totalitarisme, et que ses victimes se comptent par millions. Le prolétariat doit aussi se rappeler que jamais la bourgeoisie "démocratique" n'a hésité, pour défendre ses intérêts de classe ou ses sordides intérêts impérialistes, à soutenir et encenser les plus féroces dictateurs. Souvenons-nous du temps où les Bleu, les Churchill, etc., appelaient Staline «Monsieur Staline » et où celui-ci était nommé « l'homme de la Libération » ! Plus près de nous, rappelons-nous du soutien apporté à S. Hussein ou encore à Ceausescu, félicité par De Gaulle et décoré par Giscard.
La classe ouvrière doit faire sien le fait que la démocratie, hier, aujourd'hui, et plus encore demain, n'a jamais été et ne sera jamais autre chose que le masque hypocrite avec lequel la bourgeoisie recouvre le visage hideux de sa dictature de classe, pour mieux l'enchaîner et la réduire à merci.
R.N.
[1] Les citations de cette partie sont tirées de La destruction de Dresde de David Irvine, Éditions Art et Histoire d'Europe et de La seconde guerre mondiale de Henri Michel, Éditions PUF.
[2] Depuis quelques années, il y a en France toute une campagne montée par des résidus de 1'"ultra-gauche" autour des "révélations" du Sieur Faurisson à propos de la soi-disant non-existence des camps de la mort nazis, campagne récupérée pour une large part par l'extrême-droite. Notre point de vue n'a rien à voir, ni de près, ni de loin avec cette mouvance pour le moins fort suspecte.
[3] Sur ces questions, voir également le livre "A bas la guerre", Pierre Hempel, 1990.
[4] La Commune de Varsovie trahie par Staline, massacrée par Hitler, Zygmunt Zaremba, Editions Spartacus.
[5] A propos de la différence entre la démocratie bourgeoise dans 1’ascendance et dans la décadence du capitalisme on consultera utilement la Plate-forme du CCI et la brochure La décadence du capitalisme
[6] Les crimes de l’armée française, Pierre Vidal-Naquet, Editions Maspéro. Alors que la bourgeoisie française essaye de présenter l'Algérie comme son dernier € péché colonialiste» (sous-entendu, depuis elle aurait "les mains propres"), d'autres massacres ont été perpétrés depuis la guerre d'Algérie, notamment au Cameroun où de sanglantes exactions furent commises par l'armée française.
Questions théoriques:
Bilan de 70 années de luttes de « libération nationale » 1ere partie
- 3566 reads
I. La vague révolutionnaire mondiale de 1917-23 affaiblie par le soutien aux mouvements de « libération nationale »
La tragédie kurde est la énième manifestation de la barbarie sanglante déchaînée au nom de la soi-disant « libération nationale des peuples ». Des Etats-Unis à la Grande-Bretagne, de la Turquie à l'Iran, tous les divers impérialismes qui ont participé à la boucherie guerrière du Golfe ont, peu ou prou, poussé les Kurdes au soulèvement armé au nom de la « libération nationale », et nous pouvons aujourd'hui voir comment ils laissent Saddam Hussein les massacrer, les précipiter dans l'exil et perpétrer un nouveau génocide. Tous sont complices du massacre, tous ont utilisé le mythe de la « libération nationale », comme monnaie d'échange et comme feuille de vigne, dans leur brutale concurrence impérialiste. Dans cette meute, gardons-nous d'oublier les leaders kurdes eux-mêmes, qui sont parvenus à un accord avec le boucher de Bagdad pour réduire la revendication d' « indépendance nationale » à celle de « premiers pas vers l'autonomie », "premiers pas" déjà faits... en 1970, 1975, 1981, etc !
Le capitalisme est entré dans sa phase ultime : celle de sa décomposition. Celle-ci va faire proliférer à un rythme accéléré les guerres comme celle du Golfe, les massacres ethnico-nationalistes comme ceux de Yougoslavie, d'URSS ou entre arabes et kurdes en Irak. Leur drapeau commun est celui de la « libération nationale » qui, dans certains cas, peut être le masque cynique des ambitions impérialistes des Etats et principalement celui des grandes puissances, et dans d'autres être une ivresse irrationnelle qui entraîne et abrutit les masses désespérées. Dans tous les cas, elle est l'expression tant de la faillite mortelle du système capitaliste que de la menace que fait planer celle-ci sur la survie de l'humanité.
Seul le prolétariat est à même de s'opposer à cet avenir en proposant une perspective de réorganisation de la société qui instaure des rapports sociaux basés sur l'unification réelle de l'humanité, sur la production consacrée à la pleine satisfaction des besoins, la communauté mondiale des hommes libres et égaux qui travaillent par et pour eux-mêmes. Pour orienter ses luttes vers cette perspective, le prolétariat doit rejeter en bloc les mystifications du style « libération nationale » qui ne font que l'attacher au vieux monde ([1] [314]). Dans la première partie de cet article, nous allons analyser comment cette mystification fut un élément important dans l'échec de l'expérience révolutionnaire de 1917-23, et comment elle donna aux Etats capitalistes une planche de salut à laquelle ils s'agrippèrent, avec comme tragique conséquence la survie du système capitaliste et la longue série de guerres et de barbarie qu'il a charriée avec lui depuis 70 ans.
Le 2e Congrès de l'Internationale Communiste (mars 1920) adopte les « Thèses et additions sur les questions nationales et coloniales » dont l'idée de base est : « (...) tous les événements de la politique mondiale se concentrent inévitablement autour d’un centre de gravité : la lutte de la bourgeoisie internationale contre la République des Soviets, qui doit grouper autour d'elle d'une part les mouvements soviétistes des travailleurs avancés de tous les pays, de l’autre tous les mouvements émancipateurs nationaux des colonies et des nationalités opprimées qu'une expérience amère a convaincues qu'il n'est pas de salut, pour elles, eti dehors d'une alliance avec le pouvoir soviétiste victorieux de l'impérialisme mondial ». ([2] [315])
Cet espoir a rapidement été démenti pas les faits dès le début de la Révolution russe. L'appui aux luttes de « libération nationale » pratiqué par l’I.C. et le bastion prolétarien en Russie a au contraire constitué une barrière contre l'extension mondiale de la révolution prolétarienne, et a profondément affaibli la conscience et l'unité du prolétariat international, contribuant à l'échec de ses tentatives révolutionnaires.
Une corde au cou de la Révolution russe
La révolution d'Octobre était le premier pas dans le mouvement révolutionnaire du prolétariat à l'échelle mondiale : « ce qui montre la vision politique des bolcheviques, leur fermeté de principes et leur large perspective, c'est qu'ils aient basé toute leur politique sur la révolution prolétarienne mondiale » (Rosa Luxemburg, La Révolution Russe).
En accord avec cette vision qui privilégiait l'extension internationale de la révolution, l'appui aux mouvements de libération nationale dans les pays soumis par les grandes métropoles impérialistes a été conçu comme une tactique, destinée à gagner des soutiens additionnels à la révolution mondiale.
Dès octobre 1917, les bolcheviks impulsèrent l'indépendance des pays que l'empire tsariste avait maintenus sous domination : les pays baltes, la Finlande, la Pologne, l'Ukraine, l'Arménie, etc. Ils pensaient qu'une telle attitude gagnerait au prolétariat révolutionnaire des appuis indispensables pour se maintenir au pouvoir en Russie, dans l'attente de la maturation et de l'éclatement de la révolution prolétarienne dans les grands pays européens et spécialement en Allemagne. Ces espoirs ne se sont pas du tout réalisés.
* Le gouvernement soviétique reconnut l'indépendance de la Finlande le 18 décembre 1917. Le mouvement ouvrier était très fort dans ce pays, il était en pleine poussée révolutionnaire, maintenait de forts liens avec les ouvriers russes et avait participé de manière active à la Révolution de 1905 et à celle de 1917. En réalité, il ne s'agissait pas d'un pays dominé par le féodalisme mais d'un territoire capitaliste très développé où la bourgeoisie profita du cadeau soviétique pour écraser l'insurrection ouvrière quand elle éclata en janvier 1918. La lutte dura presque trois mois et malgré l'aide décidée que les Soviets prêtèrent aux ouvriers finlandais, le nouvel Etat réussit à détruire le mouvement révolutionnaire grâce aux troupes allemandes appelées à la rescousse.
* En Ukraine, le nationalisme local ne représentait pas un véritable mouvement bourgeois mais exprimait plutôt, de manière dévoyée, les vagues ressentiments des paysans contre les propriétaires fonciers d'origine russe et surtout polonais. Le prolétariat de la région provenait de tous les territoires de Russie et était très développé. Dans de telles circonstances, la bande d'aventuriers nationalistes qui constituèrent la « Rada » ukrainienne cherchèrent rapidement la protection de l'impérialisme allemand et autrichien, tout en consacrant leurs forces à attaquer les soviets ouvriers qui s'étaient formés à Kharkov et autres villes. Face à la défaite des impérialismes centraux, le général français Tabouis se substitua à l'influence allemande et utilisa les phalanges réactionnaires ukrainiennes dans la guerre que livraient les gardes blancs contre les soviets.
«Le nationalisme ukrainien n'était qu'une lubie, l'élucubration de quelques douzaines d'intellectuels petits bourgeois sans la moindre racine dans la vie économique, politique ou intellectuelle du pays, sans une trace de tradition historique, car l'Ukraine n'a jamais été ni un Etat ni une nation, n'a jamais possédé de culture nationale... (...) Lénine et ses amis (...) ont conféré de l'importance à ce qui n'était au début qu'une farce, jusqu'au jour où la farce a pris une gravité des plus sanglantes, où elle s'est transformé non pas en un mouvement national sérieux, qui n'avait de toutes façons pas de racines, mais en pavois, en drapeau de ralliement de la contre-révolution ! Cette bulle pleine d'air a enfanté à Brest les baïonnettes allemandes » (Rosa Luxemburg, La Révolution russe).
* Dans les pays baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie), les soviets ouvriers prirent le pouvoir au moment de la révolution d'Octobre. La « libération nationale » fut réalisée par la marine britannique ! «A la fin des hostilités contre l'Allemagne, des unités navales britanniques apparurent dans la Baltique. La république soviétique d'Estonie tomba en janvier 1919 ; la république soviétique lettonne tint bon à Riga pendant cinq bons mois, et succomba finalement devant la menace des canons de la marine britannique » (EH. Carr : La Révolution bolchevik, T. I, p. 318).
* En Arménie, Géorgie, Azerbaïdjan, en "Russie asiatique", « Un gouvernement bachkir, sous un certain Validov, qui avait proclamé un Etat bachkir autonome après la révolution d'Octobre, passa du côté des cosaques d'Orenbourg qui étaient en guerre ouverte contre le gouvernement soviétique et cela était caractéristique de l'attitude qui prévalait chez les "nationalistes"» (EH. Carr, ibid., p. 325). Le gouvernement « national-révolutionnaire » de Kokand, de son côté, avec tout un programme qui comprenait l'instauration de la loi islamique, la défense de la propriété privée et la réclusion obligatoire des femmes, combattit férocement le soviet ouvrier de Tachkent (principale ville industrielle du Turkestan russe).
* Dans le Caucase se forma une république transcaucasienne dont se disputèrent la tutelle la Turquie, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, ce qui conduisit à son éclatement en trois Etats « indépendants » (la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan) qui à leur tour s'affrontèrent férocement entre eux pour des raisons ethniques, encouragés en cela par les impérialismes en lice. Tous se trouvèrent d'accord cependant pour harceler férocement le soviet ouvrier de Bakou qui eut à subir, entre 1917 et 1920, les bombardements et les massacres répétés des anglais.
* En Turquie : le gouvernement soviétique appuya dès le début Kemal Atatûrk, le « nationaliste-révolutionnaire » père de la « nouvelle Turquie ». Au nom de l’I.C., Radek exhorta le tout nouveau Parti communiste de Turquie à le soutenir : « Dès que vous vous serez constitué en parti indépendant, votre première tâche sera de soutenir le mouvement en faveur de la liberté nationale de la Turquie » (Procès-verbaux des quatre premiers Congrès de PIC). Le résultat fut catastrophique : Kemal écrasa sans états d'âme les grèves et mobilisations du jeune prolétariat turc. Une fois défaites les troupes grecques et après que l'impérialisme britannique ait offert l'abandon de Constantinople en échange de la loyauté turque, Kemal rompit son alliance avec les soviets et offrit aux anglais la tête des communistes turcs qui furent férocement persécutés.
* Le cas de la Pologne mérite d'être mentionné à part. L'émancipation nationale de la Pologne avait été presque un dogme dans la 2e Internationale. Quand, vers la fin du 19e siècle, Rosa Luxemburg démontra que ce mot d'ordre était erroné et dangereux, car le développement capitaliste avait associé étroitement la bourgeoisie polonaise à la bourgeoisie russe et à la caste impériale tsariste, cela souleva au sein de l'Internationale des polémiques orageuses. Le fait était cependant que les ouvriers de Varsovie, de Lodz, etc., s'étaient trouvés à l’avant-garde de la révolution de 1905, et que de leur sein avaient surgi d'éminents militants révolutionnaires comme Rosa Luxemburg elle-même. Lénine avait reconnu pratiquement que « l'expérience de la révolution de 1905 a démontré que même dans ces deux nations -il fait référence à la Pologne et à la Finlande- les classes dirigeantes, les propriétaires fonciers et la bourgeoisie renoncent à la lutte révolutionnaire en faveur de la liberté, et cherchent leur rapprochement avec les classes dirigeantes de la Russie et avec la monarchie tsariste par peur du prolétariat révolutionnaire de Finlande et de Pologne» (Procès-verbaux de la conférence du parti à Prague, en 1912, souligné dans le texte). Malheureusement, les bolcheviks, prisonniers du dogme sur l’ "autodétermination nationale des peuples", favorisèrent, à partir d'octobre 1917, l'indépendance de la Pologne. Le 29 août 1918, le Conseil des commissaires du peuple déclarait : « Tous les traités et actes signés par le gouvernement de l'ancien empire russe avec les gouvernements du royaume de Prusse ou l'empire a Autriche-Hongrie concernant la Pologne, sont annulés irrévocablement par le présent texte, vu leur incompatibilité avec le principe d'autodétermination des nations et avec le sens révolutionnaire du droit du peuple russe, qui reconnaît le droit du peuple polonais à réclamer son indépendance et son unité. »
S'il est juste que le bastion prolétarien dénonce et annule les traités secrets des gouvernements bourgeois, par contre, c'est une grave erreur que de le faire au nom de "principes" qui n'appartiennent pas au terrain prolétarien, mais au terrain bourgeois, tel que le "droit des peuples". Et cela s'est rapidement vérifié dans la pratique : la Pologne est tombée sous la dictature de fer de Pilsduski, vétéran social-patriote, qui écrasa les grèves ouvrières, qui fit alliance avec la France et la Grande-Bretagne, et appuya activement les armées blanches contre-révolutionnaires en envahissant l'Ukraine en 1920.
Quand, pour riposter à cette agression, les troupes de l’ "armée rouge" sont entrées en territoire polonais et ont marché sur Varsovie avec l'espoir que les ouvriers se soulèveraient contre le pouvoir bourgeois, une nouvelle catastrophe s'est produite pour la cause de la révolution mondiale : les ouvriers de Varsovie, les mêmes qu'en 1905, resserrèrent les rangs autour de la "nation polonaise" et participèrent à la défense de la ville contre les troupes soviétiques. C'était la tragique conséquence d'années de propagande de la 2e Internationale, et ensuite du bastion prolétarien en Russie, en faveur de l’"indépendance nationale" de la Pologne. ([3] [316])
Le bilan de cette politique est catastrophique : les prolétariats locaux furent défaits, les nouvelles nations ne « remercièrent » en rien le cadeau bolchevik et s'installèrent rapidement dans l'orbite de l'impérialisme britannique, collaborant au blocus qui réduisit à la famine le pays des soviets et soutenant par tous les moyens la contre-révolution blanche qui provoqua une guerre civile sanglante.
« Les bolcheviks ont dû apprendre à leurs dépens et à ceux de la révolution que sous l'hégémonie au capitalisme, il n'y a pas d'autodétermination de la nation, que dans une société de classes, chaque classe tend à s'"autodéterminer" différemment, et que pour les classes bourgeoises, les considérations sur ta liberté nationale viennent bien après celles qui touchent à la domination de classe. La bourgeoisie finlandaise et la petite-bourgeoisie ukrainienne sont tombées tout à fait d'accord pour préférer le régime autoritaire de l'Allemagne à la liberté nationale, si celle-ci devait être liée aux dangers du "bolchevisme" » (Rosa Luxemburg, La Révolution russe, p. 71).
La « libération nationale » ne guérit pas des oppressions nationales
Les bolcheviks pensaient que « pour affirmer l'unité internationale des ouvriers, il faut d'abord déraciner tous les vestiges de l'ancienne inégalité et discrimination entre nations ». Les ouvriers de ces pays n'avaient-ils pas été soumis au nationalisme réactionnaire de l'empire tsariste ? Ceux-ci ne représentaient-ils pas un obstacle à l'unité avec les ouvriers russes qui pouvaient passer pour des complices du chauvinisme grand-russien ? Et, plus généralement, les jeunes prolétariats des pays coloniaux et semi-coloniaux ne seraient-ils pas opposés au prolétariat des grandes métropoles tant que leurs pays n'auraient pas obtenu l'indépendance nationale ?
c
Il est vrai que le capitalisme a créé le marché mondial de façon anarchique et violente, semant partout une quantité d'oppressions et de discriminations de toutes sortes, particulièrement d'ordre national, ethnique, linguistique, etc. ; celles-ci pèsent lourdement sur la conscience des ouvriers de tous ces pays, rendant plus difficile son processus d'unification et de prise de conscience. Il n'en est pas moins erroné et dangereux de prétendre soigner ces maux en aidant à la formation de nouvelles nations, qui non seulement ne sont économiquement pas viables du fait de la saturation du marché mondial, mais en outre ne font que reproduire ces maux à une échelle plus vaste. L'expérience de la "libération nationale" des peuples périphériques de l'empire tsariste fut à cet égard concluante. Les nationalistes polonais se servirent de l'« indépendance » pour persécuter les minorités juives, lituaniennes et allemandes ; dans le Caucase, les géorgiens persécutèrent les arméniens et les abkhazes, les arméniens persécutèrent turkmènes et azéris oui, à leur tour, persécutèrent les arméniens... La Rada d'Ukraine déclara officiellement sa haine contre les russes, les polonais et les juifs... En vérité, toutes ces persécutions ne furent que le pâle reflet annonciateur de l'horrible cauchemar qui s'est développé par la suite dans le capitalisme en décadence. Rappelons simplement l'orgie de massacres des hindous contre les musulmans en 1947, celle des croates contre les serbes durant l'occupation nazie et la vengeance des serbes à la « Libération » de Tito. Que dire des insupportables pogromes nationalistes qui font actuellement baigner dans le sang toute l'Europe de l'Est jusqu'à la Russie asiatique 7 Soyons clairs : la « libération nationale » ne guérit en rien les maux de l'oppression nationale, elle ne fait que les reproduire encore plus irrationnels. On n'éteint pas un incendie avec de l'essence.
Seul le prolétariat, dans son être et par sa lutte révolutionnaire, peut trouver les bases permettant de combattre et dépasser toutes les discriminations engendrées par la société de classe, qu'elles soient de type national, ethnique ou linguistique. «La grande industrie a créé une classe dont les intérêts sont les mêmes dans toutes les nations et pour laquelle la nationalité est déjà abolie, une classe qui s est réellement débarrassée du monde ancien et qui s'oppose à lui en même temps (Marx-Engels, L'Idéologie allemande, « Feuerbach, l'Histoire, IV », p. 90).
La « libération nationale » précipite les couches non-exploiteuses dans les bras du capital
Toujours dans le but de renforcer le développement de la révolution mondiale, les bolcheviks pensaient qu'ils pouvaient gagner à leur cause les couches non exploiteuses de ces nations (paysannerie, certaines couches intermédiaires, etc.) en appuyant la « libération nationale » et quelques autres mesures classiques du programme des révolutions bourgeoises (réforme agraire, libertés politiques, etc.).
Ces couches occupent une position instable et hétérogène dans la société bourgeoise, elles n'ont en tant que telles aucun avenir. Bien qu'opprimées par le capitalisme, elles souffrent cependant de n'avoir pas d'intérêts qui leur soient propres, clairs et définis ; et quand elles s'en trouvent un, il est directement et sans équivoque lié à la sauvegarde du capitalisme. Le prolétariat ne peut les gagner à sa cause en leur offrant une plate-forme basée sur la « libération nationale » ou autres revendications issues tout droit de l'idéologie de la bourgeoisie. Ce faisant, il ne peut que les précipiter dans les bras de la bourgeoisie qui, elle, peut les manipuler avec des promesses démagogiques pour ensuite les lancer contre le prolétariat.
Il faut dire que les points du programme bourgeois auxquels sont le plus sensibles les couches paysanne et petite-bourgeoise (réforme agraire, liberté sur le plan linguistique, national, etc.) n'ont jamais été totalement réalisés par la bourgeoisie. Pire encore, durant toute la décadence du capitalisme, les nations nouvelles ont été incapables d'accomplir le moindre de ces points programmatiques car ceux-ci ne sont, bien évidemment, qu'une utopie réactionnaire impossible à réaliser dans un système capitaliste qui ne tend plus à l'expansion mais bien à des convulsions toujours plus violentes.
Mais cela implique-t-il que le prolétariat doive reprendre toutes ces revendications jetées dans les poubelles de l'histoire par l'évolution historique afin de démontrer qu'il est, pour ainsi dire, plus « conséquent » que la bourgeoisie ? En aucun cas ! Cette façon de voir, qui pesa indiscutablement sur les bolcheviks et sur d'autres fractions révolutionnaires, n'est qu'un résidu mal éliminé des objectifs gradualistes et réformistes qui avaient conduit la social-démocratie à la trahison. C'est une vision spéculative et idéaliste du capitalisme que de penser que le « programme » de la bourgeoisie doit être accompli de fond en comble dans tous les pays pour que l'humanité soit prête pour le communisme. C'est là une utopie réactionnaire qui ne correspond en rien à la réalité d'un système d'exploitation dont la finalité n'est en aucun cas de mener à bien un projet social quelconque, mais simplement d'extirper de la plus-.value. Déjà, durant la période ascendante, la bourgeoisie qui parvenait au pouvoir abandonnait bien souvent son « programme » à peine ébauché pour pactiser avec les restes des vieilles classes féodales ; une fois formé le marché mondial et le système entré dans sa phase de déclin, historique, ce « programme » s'est converti en une grossière mystification.
Le prolétariat, s'il se propose de réaliser le « programme inachevé » de la bourgeoisie, ouvre une brèche dans son propre projet historique révolutionnaire, brèche dans laquelle s’engouffre la bourgeoisie. La meilleure façon de gagner à sa cause les couches non exploiteuses ou, du moins, de les neutraliser dans l'affrontement décisif avec l'Etat bourgeois, est d'affirmer pleinement et de façon conséquente son propre programme. C'est la perspective de l'abolition des privilèges de classe, l'espérance d'une nouvelle organisation de la société qui assure l'existence à l'ensemble de l'humanité, c'est l'affirmation claire et résolue du prolétariat en tant que classe autonome, en tant que force sociale qui se présente ouvertement comme candidate à la prise de pouvoir, c'est l'organisation massive de cette classe dans les Conseils ouvriers.
« Ne pouvant s'assigner comme but celui de constituer de nouveaux privilèges, le prolétariat, lorsqu'il aura détruit la société capitaliste, ne pourra fonder sa classe, ni l'accroître, sur un ensemble de principes qui puissent exprimer des positions économiques. Il ne pourra établir sa base de lutte que sur des notions politiques qui, tout en résultant de son programme particulier de classe - le prolétariat représentant parmi les différentes classes de la société capitaliste, la seule qui puisse construire la société de demain - peuvent entraîner, dans la lutte, les couches sociales moyennes qui n'ont pas un intérêt économique et réel au triomphe de la dictature du prolétariat. (...) Ces classes moyennes ne se rallieront au prolétariat que dans des circonstances historiques particulières où les contradictions du régime capitaliste venant à leur éclosion, et, la classe ouvrière passant à l'assaut révolutionnaire, elles éprouveront le besoin de mêler leurs luttes désespérées à la lutte consciente du prolétariat pour la victoire révolutionnaire. » (Bilan, n° 5, mars 1934, ", "Les principes : armes de la révolution", chap. "Automatisme économique ou conscience de classe").
La « libération nationale » facteur de désagrégation de la conscience prolétarienne
La révolution prolétarienne n'est pas une fatalité découlant des conditions objectives, qui rendrait valable n'importe quelle tactique pourvu qu'on arrive au but. Même si la révolution est une nécessité historique dont les bases objectives ont été fournies par la constitution du marché mondial et celle du prolétariat, elle n'en reste pas moins essentiellement un acte conscient.
En outre, à la différence des classes révolutionnaires du passé, le prolétariat ne possède aucune parcelle de pouvoir économique dans la vieille société ; il est une classe exploitée et une classe révolutionnaire. Ceci fait que les armes dont il dispose pour détruire la vieille société, son unité et sa conscience, sont décisives et uniques dans l'histoire et constituent aussi les bases de la nouvelle société.
Il est, par conséquent, vital pour l'avancée de sa lutte que : «A chaque occasion, le problème que le prolétariat doit se poser, ce n'est pas celui d'obtenir le plus grand avantage, le plus grand nombre d'alliés, mais bien celui de rester cohérent avec le système principiel qui régit sa classe (...)» (Bilan, n° 5, mars 1934, "Les principes : armes de la révolution", chap. "Genèse et développement de la conscience de classe : le parti").
De ce point de vue, le soutien aux « luttes de libération nationale » pendant la période révolutionnaire de 1917-23 a eu des conséquences désastreuses pour le prolétariat mondial tout entier, et pour son avant-garde, l'Internationale Communiste.
A cette époque historique de lutte décisive entre capital et travail, période ouverte par la Première Guerre mondiale, où la seule alternative qui reste est celle de la révolution internationale du prolétariat ou la soumission du prolétariat à l'intérêt national de chaque bourgeoisie, le soutien à la « libération nationale », même conçue en tant qu'élément « tactique », conduit à la désagrégation, la corruption et la décomposition de la conscience prolétarienne.
On a déjà vu que la « libération » des peuples périphériques du vieil empire tsariste n'apporta aucun avantage à la Révolution russe mais contribua, au contraire, à la création d'un cordon sanitaire autour d'elle : un groupe de nations, avec des prolétariats combatifs, avec une vieille tradition, s'est fermé à la pénétration des positions révolutionnaires, creusant un abîme infranchissable entre ouvriers russes et allemands.
Comment est-il possible que les ouvriers de Pologne, d'Ukraine, de Finlande, de Bakou, de Riga, qui avaient été à la tête des révolutions de 1905 et 1917, qui avaient fait surgir de militants communistes aussi clairvoyants et dévoués que Rosa Luxemburg, Piatakov, Jogiches..., aient pu aussi rapidement être écrasés et défaits en 1918-20 par leur propre bourgeoisie et se soient opposés, parfois avec rage, aux consignes bolcheviks ?
Il n'y a pas le moindre doute là-dessus : c'est le poison nationaliste qui a eu une influence décisive. « Le fait qu'en somme la question des revendications et tendances séparatistes nationales ait été jetée au milieu des luttes révolutionnaires, que même la paix de Brest-Litovsk Va amenée au premier plan et estampillée en shibboleth de la politique socialiste et révolutionnaire, a porté le plus grand trouble dans les rangs du socialisme et a ébranlé la position du prolétariat justement dans les pays limitrophes » (Rosa Luxemburg, idem).
La « libération nationale » poussa les ouvriers de ces pays vers le mirage de l’« indépendance et le développement du pays, libéré du joug russe » avec la même force qu'elle les éloigna de plus en plus du prolétariat russe, avec lequel ils avaient partagé tant et tant de luttes, de ce prolétariat qui venait de faire le premier pas dans le combat décisif.
L'Internationale, le Parti communiste mondial, est le facteur clé dans la conscience de classe du prolétariat, sa clarté et cohérence politique sont vitales. Le soutien à la libération nationale joua un rôle décisif dans la dégénérescence opportuniste de l’I.C..
L'I.C. s'est constituée sur un principe central : le capitalisme est entré dans sa décadence historique, la tâche du prolétariat ne peut plus être de le réformer ou de l'améliorer, mais de le détruire : « Une nouvelle époque vient de surgir. Epoque de désagrégation du capitalisme, de son enfoncement interne. Epoque de la révolution communiste du prolétariat». Cependant, l'appui à la "libération nationale" a ouvert une brèche très dangereuse dans cette clarté de base, il a ouvert la porte à 1’opportunisme car il a introduit une tâche qui appartenait à l'ancien ordre social dans le programme de destruction de cet ancien ordre. La tactique de combiner la lutte révolutionnaire dans les métropoles et la "lutte de libération nationale" dans les colonies et les semi-colonies, portait à conclure que l'heure de la destruction du capitalisme n'avait pas encore sonné, soit en affirmant que le monde était divisé en deux zones (l'une « mûre » pour la révolution prolétarienne, l'autre étant une zone où le capitalisme n'était pas encore développé), soit en reconnaissant sans détours qu'il existe encore des possibilités d'expansion du capitalisme (c'est la seule raison qui permet à des marxistes de parler de possibilité de « libération nationale»).
Ce germe de confusion, cette porte ouverte à l'opportunisme, se développa de plus en plus avec le reflux des luttes révolutionnaires du prolétariat en Europe.
Le parti n'est pas un produit passif du mouvement de la classe, mais un facteur actif de son développement. Si sa clarté et détermination sont cruciales pour le succès de la révolution prolétarienne, ses confusions, ambiguïtés et incohérences contribuent fortement à la confusion et à la défaite de la classe. L'évolution de PIC dans sa position sur la question nationale en est un témoignage.
Le Premier Congrès, qui eut lieu en pleine montée des luttes, se propose comme tâche la disparition des frontières nationales : « Le résultat final des procédés capitalistes de production est le chaos, - et ce chaos ne peut être vaincu que par la classe productrice la plus nombreuse, la classe ouvrière. C'est elle qui doit instituer l'ordre véritable, l'ordre communiste. Elle doit briser la domination du capital, rendre les guerres impossibles, effacer les frontières entre les Etats, transformer le monde en une vaste communauté travaillant pour elle-même, réaliser la solidarité fraternelle et la libération des peuples. » (Plate-forme de PIC)
De même, ce Congrès mit en évidence que les petits Etats sont incapables de rompre le joug de l'impérialisme et ne peuvent que se soumettre a leur jeu : « dans les Etats vassaux et dans les républiques que l'Entente vient de créer (la Tchécoslovaquie, les pays slaves méridionaux, auxquels il faut ajouter la Pologne, la Finlande, etc.), la politique de l'Entente, appuyée sur les classes dominantes et les sociaux-nationalistes, vise à créer des centres d'un mouvement national contre-révolutionnaire. Ce mouvement doit être dirigé contre les peuples vaincus, doit maintenir en équilibre les forces des nouveaux Etats et les soumettre à l'Entente, il doit freiner les mouvements révolutionnaires qui surgissent dans les nouvelles républiques "nationales" et finalement fournir des gardes blancs pour la lutte contre la révolution internationale et surtout contre la révolution russe. » (Thèses sur la situation internationale et la politique de l'Entente). Et, finalement, il démontre que « l'Etat national, après avoir donné une impulsion vigoureuse au développement capitaliste, est devenu trop étroit pour l'expansion des forces productives. » (Manifeste de PIC aux prolétaires du monde entier).
On voit là comment le 1er Congrès de l’I.C. jette les bases pour corriger les erreurs initiales sur la question nationale, mais ces jalons de clarté ne vont pas se développer, ils seront peu à peu engloutis par l'opportunisme à cause des défaites prolétariennes et de la difficulté de la majorité de l’I.C. pour avancer dans la clarification. Le 4e Congrès (1922), avec ses Thèses sur la question d'Orient, fera un pas important dans la régression, car : « On exigeait du prolétariat et des paysans qu'ils fassent passer leur programme social après les besoins immédiats d'une lutte nationale commune contre l'impérialisme étranger. On tenait pour acquis qu'une bourgeoisie nationaliste, et même une aristocratie féodale nationaliste, serait prête à mener une lutte de libération nationale contre l'impérialisme étranger, alliées à des prolétaires et des paysans potentiellement révolutionnaires qui n'attendaient que la victoire pour se retourner contre leurs anciens maîtres et alliés et les renverser» (EH. Carr, La révolution bolchevik, T. III, p. 490).
Dans les événements ultérieurs, à la suite de la proclamation du « socialisme dans un seul pays », avec le bastion prolétarien de Russie définitivement défait et intégré dans la chaîne impérialiste mondiale, la « libération nationale » deviendra tout simplement la feuille de vigne des intérêts de l'Etat russe. Mais, celui-ci ne sera pas le seul à utiliser une telle bannière ; tous les Etats concurrents l'adopteront aussi, avec de multiples variantes, mais avec un seul but : la guerre à mort pour le partage d'un marché mondial définitivement saturé. Les innombrables guerres impérialistes déguisées en « libérations nationales » seront traitées dans la deuxième partie de cet article.
Pour systématiser le processus de clarification mené par les fractions de la Gauche Communiste face à la dégénérescence de PIC, Internationalisme, organe de la Gauche communiste de France, adoptait en janvier 1945 une Résolution sur les mouvements nationalistes qui finissait ainsi : « Etant donné que, par sa nature de classe capitaliste, les mouvements nationalistes ne présentent pas la moindre continuité organique et idéologique avec les mouvements de classe du prolétariat, celui-ci, pour gagner ses positions de classe, doit rompre et abandonner tout lien avec les mouvements nationalistes».
Ad, 20 mai 1991
[1] [317] Voir la brochure Nation ou Classe et les articles de la Revue Internationale, n° 4, 19, 34, 37, 42 et 62.
[2] [318] "Thèses, manifestes et résolutions adoptés par les Ier, IIe, IIIe et IVe Congrès de l'Internationale Communiste (1919-1923)", Librairie du Travail, Juin 1934, Réimpression en fac-similé, Maspéro, 1971).
[3] [319] D'un autre côté, la révolution prolétarienne ne peut jamais s'étendre par des méthodes militaires comme l'avait dit très clairement le Comité exécutif des soviets lui-même : <r Nos ennemis et les vôtres vous trompent quand ils vous disent que le gouvernement soviétique russe souhaite implanter le communisme en territoire polonais avec les baïonnettes des soldats de V ** armée rouge*. L'ordre communiste n'est possible que quand l'immense majorité des travailleurs est convaincue de l'idée de te créer avec ses propres forces. » ("Appel au peuple polonais", 28 janvier 1920). Le parti bolchevik chaque fois plus rongé par l'opportunisme, dans un virage vers une fausse compréhension de l'internationalisme, encouragea -malgré une importante opposition en son sein, Trotsky, Kirov, etc.- l'aventure du printemps 1920 qui oubliait complètement ce principe.
Courants politiques:
- Gauche Communiste [49]
Approfondir:
- La question nationale [320]
Questions théoriques:
- Impérialisme [321]
Heritage de la Gauche Communiste:
- La question nationale [322]
MARC : II - De la deuxième guerre mondiale à la période actuelle
- 3625 reads
La première partie de cet article, parue dans le numéro précédent de la Revue Internationale, en hommage à notre camarade Marc disparu en décembre 1990, évoquait la période de 1917 à la fin de la deuxième guerre mondiale.
«Marc appartenait à la toute petite minorité de militants communistes qui a survécu et résisté à la terrible contre-révolution qui s'est abattue sur la classe ouvrière entre les années 1920 et les années 1960, tels Anton Pannekoek, Henk Canne-Meijer, Amadeo Bordiga, Onorato Damen, Paul Mattick, Jan Appel ou Munis. De plus, outre sa fidélité indéfectible à la cause du communisme, il a su à la fois conserver sa pleine confiance dans les capacités révolutionnaires du prolétariat, faire bénéficier les nouvelles générations de militants de toute son expérience passée, et ne pas rester enfermé dans les analyses et positions dont le cours de l'histoire exigeait le dépassement. En ce sens, toute son activité de militant constitue un exemple concret de ce que le marxisme veut dire : la pensée vivante, en constante élaboration, de la classe révolutionnaire, porteuse de l'avenir de l'humanité. » (Revue Internationale, n°65)
Cette deuxième partie retrace l'activité de notre camarade au sein de la Gauche communiste de France puis lors de la dernière période de sa vie où sa contribution a été décisive dans la constitution et le développement du CCI.
« INTERNATIONALISME »
La Gauche Communiste de France (GCF) tient sa deuxième conférence en juillet 1945. Elle adopte un rapport sur la situation internationale rédigé par Marc (republié dans la Revue Internationale, n°59, 4e trimestre 1989) qui fait un bilan global des années de guerre. Tout en rappelant les positions classiques du marxisme sur la question de l'impérialisme et de la guerre, notamment face aux aberrations développées par Vercesi, ce document constitue un réel approfondissement dans la compréhension des principaux problèmes affrontés par la classe ouvrière dans la décadence du capitalisme. Ce rapport est à l'image de toute la contribution qui sera apportée par la GCF à la pensée révolutionnaire et dont les différents articles publiés dans sa revue théorique. Internationalisme, nous donnent une idée ([1] [323]). En effet, L'Etincelle cesse d'être publiée fin 1946. C'est la conséquence de la compréhension par la GCF que ses prévisions d'une sortie révolutionnaire de la guerre impérialiste (à l'image de ce qui s'était passé au cours de la première guerre mondiale) ne se sont pas réalisées. Grâce aux leçons qu'elle a tirées du passé, comme la Fraction le craignait dès 1943, la bourgeoisie des pays "vainqueurs" a réussi à empêcher un surgissement du prolétariat. La "Libération" ne constitue pas un marchepieds pour la révolution, mais au contraire, un des sommets de la contre-révolution. La GCF en tire les conséquences et estime que la constitution du parti n'est pas à l'ordre du jour de même que n'est pas a l'ordre du jour l'agitation dans la classe ouvrière dont L'Etincelle se voulait un des outils. C'est un travail comparable à celui de Bilan qui attend les révolutionnaires. C'est pour cela que la GCF se consacre désormais à un effort de clarification et de discussion théorique-politique à l'inverse du PCInt qui, durant des années, sera agité par un activisme fébrile qui aboutira à la scission de 1952 entre la tendance de Damen, plus activiste, et celle de Bordiga (avec qui se retrouve Vercesi). Cette dernière tendance se replie complètement dans le sectarisme et dans une prétendue invariance (en fait, une véritable fossilisation des positions de la Gauche communiste de 1926) qui seront la marque du Parti communiste international qui publie Programma Comunista. De son côté, le PCInt de Damen (qui, majoritaire, a conservé les publications Battaglia Comunista et Prometeo), auquel on ne peut pas reprocher un tel sectarisme à cette époque, se lance dans toute une série de tentatives de conférences et d'activités en commun avec des courants non prolétariens tels les trotskistes et les anarchistes.
Pour sa part, la GCF a maintenu l'esprit d'ouverture qui avait caractérisé la Gauche italienne avant et au cours de la guerre. Mais, contrairement au PCInt qui s'ouvre aux quatre vents et n'est pas très regardant sur la nature de ses fréquentations, les contacts établis par la GCF sont basés, à l'image de ceux de Bilan, sur des critères politiques précis permettant de se distinguer clairement des organisations non prolétariennes. C'est ainsi qu'en mai 1947, la GCF participe à une conférence internationale organisée a l'initiative du Communistenbond des Pays-Bas (de tendance "conseilliste") en compagnie, notamment, du groupe Le Prolétaire issu des RKu, de la Fraction belge et de la Fédération autonome de Turin qui avait scissionné du PCInt dû fait de ses désaccords au sujet de la participation aux élections. Dans la préparation de cette conférence, à laquelle le Bond a convié la Fédération anarchiste, la GCF insiste sur la nécessité de critères de sélection plus précis écartant les groupes, tels les anarchistes officiels, qui avaient participé au gouvernement de la République espagnole et à la Résistance ([2] [324]).
Cependant, l'apport essentiel de la GCF au combat du prolétariat, dans cette période dominée par la contre-révolution, se situe bien dans le domaine de l'élaboration programmatique et théorique. L'effort considérable de réflexion réalisé par la GCF dans ce domaine la conduit notamment à préciser la fonction du parti révolutionnaire, en dépassant les conceptions "léninistes" classiques, ou à reconnaître l'intégration définitive et irréversible des syndicats et du syndicalisme dans l'Etat capitaliste. Sur ces questions, la Gauche germano-hollandaise avait, dès les années 20, fait une critique sérieuse des positions erronées de Lénine et de l'Internationale communiste. La confrontation de la Fraction italienne, avant la guerre, et de la GCF, après celle-ci, avec les positions de ce courant, ont permis à la GCF de reprendre à son compte certaines de ses critiques à l'IC. Cependant, la GCF se montre capable de ne pas tomber dans l'excès de ce courant sur la question du parti (auquel il a fini par dénier toute fonction) de même que d'aller bien plus loin que lui sur la question syndicale (puisqu'à coté du rejet du syndicalisme classique, la Gauche germano-hollandaise préconisait une forme de syndicalisme "de base" s'appuyant, par exemple sur les "Unions"). Sur la question syndicale, notamment, se manifeste toute la différence de démarche gui distingue la Gauche allemande de la Gauche italienne. C’est très rapidement que la première a réussi à comprendre, au cours des années 20, les grands traits d'une question (par exemple sur la nature capitaliste de l'URSS ou sur la nature des syndicats) mais, en faisant l'économie de toute une réflexion systématique dans l'élaboration des nouvelles positions, elle a été conduite à remettre en cause certains des fondements du marxisme ou à s'interdire tout approfondissement ultérieur de ces questions. La Gauche italienne, pour sa part, est beaucoup plus prudente. Avant les dérapages de Vercesi a partir de 1938, elle a le souci permanent de soumettre à une critique systématique les pas qu'elle effectue dans la réflexion afin de vérifier qu'ils ne s'écartent pas du cadre du marxisme. Ce faisant, elle s'est rendue capable d'aller beaucoup plus loin dans la réflexion et d'élaborer, en fin de compte, une pensée bien plus audacieuse, en particulier, sur la question fondamentale de l'Etat. C'est une telle démarche, dont Marc s'était pleinement pénétré au sein de la Fraction italienne, qui lui permet d'impulser l'énorme travail de réflexion effectué par la GCF. Un travail qui conduit également cette organisation à poursuivre 1’élaboration de la position de Ta Fraction sur la question de l'Etat dans la période de transition du capitalisme au communisme de même qu'à donner à la question du capitalisme d'Etat une vision dépassant la seule analyse de l'URSS pour faire ressortir le caractère universel de cette manifestation essentielle de la décadence du mode de production capitaliste.
Cette analyse, on la trouve notamment dans l'article "L'évolution du capitalisme et la nouvelle perspective" publié dans internationalisme n°46 (republié dans la Revue internationale n° 21). Ce texte rédigé en mai 1952 par Marc, constitue, en quelque sorte, le testament politique de la GCF. En effet, Marc quitte la France pour le Venezuela en juin 1952. Ce départ correspond à une décision collective de la GCF qui, face à la guerre de Corée, estime qu'une troisième guerre mondiale entre le bloc américain et le bloc russe est devenu inévitable à brève échéance (comme il est dit dans le texte en question). Une telle guerre, qui ravagerait principalement l'Europe, risquerait de détruire complètement les quelques groupes communistes, et notamment la GCF qui ont survécu à la précédente. La "mise à l'abri" en dehors d'Europe d'un certain nombre de militants ne correspond donc pas au souci de leur sécurité personnelle (tout au long de la seconde guerre mondiale Marc et ses camarades ont fait la preuve qu'ils étaient prêts à prendre des risques énormes pour défendre les positions révolutionnaires dans les pires conditions qui soient) mais au souci de préserver la survie de l'organisation elle-même. Cependant, le départ sur un autre continent de son élément le plus expérimenté et formé va porter un coup fatal à la GCF dont les éléments qui sont restés en France, malgré la correspondance suivie que Marc entretient avec eux, ne parviennent pas, dans une période de profonde contre-révolution, à maintenir en vie l'organisation. Pour des raisons sur lesquelles on ne peut revenir ici, la troisième guerre mondiale n'a pas eu lieu. Il est clair que cette erreur d'analyse a coûté la vie de la GCF (et c'est probablement l’erreur, parmi celles commises par notre camarade tout au cours de sa vie militante, qui a eu les conséquences les plus graves). Cependant, la GCF avait laissé tout un bagage politique et théorique sur lequel allaient s'appuyer les groupes qui ont été à l'origine du CCI.
LE « COURANT COMMUNISTE INTERNATIONAL »
Pendant plus de dix ans, alors que la contre-révolution continue de peser sur la classe ouvrière, Marc connaît un isolement particulièrement pénible. Il suit les activités des organisations révolutionnaires qui se sont maintenues en Europe et reste en contact avec elles et certains de leurs membres. De même, il continue sa réflexion sur un certain nombre de questions que la GCF n'avait pu élucider suffisamment. Mais, pour la première fois de sa vie, il est privé de cette activité organisée qui constitue le cadre par excellence d'une telle réflexion. C'est une épreuve très douloureuse comme il l'exprime lui-même :
« Dans la période de réaction d'après-guerre, ce fut une longue marche dans le désert, en particulier suite à la disparition du groupe Internationalisme après dix ans d'existence. C était le désert de l’isolement pendant une quinzaine d'années. »
Cet isolement se poursuit jusqu'au moment où il réussit à rassembler autour de lui un petit groupe de lycéens qui vont constituer le noyau d'une nouvelle organisation :
«Et c'est en 1964 qu'au Venezuela se constituait un groupe d'éléments très jeunes. Et ce groupe continue aujourd'hui. Vivre quarante ans dans la contre-révolution, dans la réaction, et sentir tout d'un coup l'espoir, sentir que, de nouveau, la crise du capital est là, que les jeunes sont là et, à partir de là, sentir ce groupe pousser peu à peu, se développer à travers 1968, à travers la France et s'élargir dans dix pays, tout cela est vraiment une joie pour un militant. Ces années-là, ces derniers vingt-cinq ans, sont certainement mes années les plus heureuses. C'est dans ces années que j'ai pu réellement sentir la joie de ce développement et la conviction que ça recommençait, que nous étions sortis de la défaite et que le prolétariat se reconstituait, que les forces révolutionnaires reprenaient. Avoir la joie de participer soi-même, de donner tout ce qu'on peut, le meilleur de soi-même, à cette reconstruction, c'est une énorme joie. Et cette joie, je la dois au CCI... »
A la différence des autres organisations dans lesquelles Marc avait milité, nous n'évoquerons pas ici 1 histoire du CCI dont nous avons donné des éléments à l'occasion de son dixième anniversaire (Revue Internationale n°40). Nous nous bornerons à signaler quelques faits mettant en relief l'énorme contribution e notre camarade au processus qui a conduit à la formation de notre organisation. Ainsi, dès avant la constitution formelle du CCI, c'est à lui essentiellement que revient la capacité du petit groupe qui, au Venezuela, publie Internationalisme) (le même nom que la revue de la GCF) de s'orienter vers une grande clarté, notamment sur la question de la libération nationale particulièrement sensible dans ce pays et sur laquelle il subsiste énormément de confusions dans le milieu prolétarien. De même, la politique, que mène Internacionalismo, de recherche de contacts avec les autres groupes de ce milieu, sur le continent américain et en Europe, se trouve dans la droite ligne de celle de la GCF et de la Fraction. Et, en janvier 1968, alors qu'on ne parle (y compris certains révolutionnaires) que de la "prospérité" du capitalisme et de sa capacité à éliminer les crises, que fleurissent les théories de Marcuse sur l’« intégration de la classe ouvrière», que les révolutionnaires que Marc a rencontrés au cours d'un voyage en Europe durant l'été 1967 font, pour la plupart, preuve d'un total scepticisme sur les potentialités de lutte du prolétariat supposé se trouver encore en pleine contre-révolution, notre camarade ne craint pas d'écrire, dans Internacionalismo n° 8 :
« Nous ne sommes pas des prophètes, et nous ne prétendons pas deviner quand et de quelle façon vont se dérouler les événements futurs. Mais ce dont nous sommes effectivement sûrs et conscients concernant le processus dans lequel est plongé actuellement le capitalisme, c'est qu'il n'est pas possible de l'arrêter (...) et qu'il mène directement à la crise. Et nous sommes sûrs également que le processus inverse de développement de la combativité de la classe, qu'on vit actuellement de façon générale, va conduire la classe ouvrière à une lutte sanglante et directe pour la destruction de l'Etat bourgeois. »
Quelques mois plus tard, la grève généralisée de mai 68 en France apporte une confirmation éclatante de ces prévisions. Ce n'est évidemment pas encore l'heure d'«une lutte directe pour la destruction de l'Etat bourgeois » mais bien celle d'une reprise historique du prolétariat mondial, attisée par les premières manifestations de la crise ouverte du capitalisme, après la plus profonde contre-révolution de l'histoire. Ces prévisions ne relèvent pas de la voyance mais tout simplement de la remarquable maîtrise du marxisme par notre camarade et de la confiance que, même aux pires moments de la contre-révolution, il a conservée envers les capacités révolutionnaires de la classe. Immédiatement, Marc se rend en France (il parcourt même la dernière partie de son voyage en auto-stop puisque lès transports de ce pays sont paralysés). Il reprend contact avec ses anciens camarades de la GCF et entre en discussion avec toute une série de groupes et d'éléments du milieu politique ([3] [325]). Cette action, comme celle d'un jeune membre d'Internacionalismo venu en France dès 1966, sera déterminante dans l'apparition et le développement du groupe Révolution internationale qui va jouer le rôle de pôle de regroupement à l'origine du CCI.
Nous ne pourrons pas rendre compte, non plus, de tous les apports politiques et théoriques de notre camarade au sein de notre organisation une fois qu'elle a été constituée. Il suffît de dire que, sur toutes les questions essentielles qui se sont posées au CCI, comme à l'ensemble de la classe, sur toutes les avancées que nous avons pu réaliser, la contribution de notre camarade a été décisive. En fait, c'était en général Marc qui, le premier, était amené à soulever les points nouveaux sur lesquels il importait de se pencher. Cette vigilance permanente, cette capacité à identifier rapidement, et en profondeur, les questions nouvelles auxquelles il était nécessaire d'apporter une réponse, de même d'ailleurs que les questions plus anciennes sur lesquelles il pouvait subsister des confusions dans le milieu politique, notre Revue Internationale en a rendu compte tout au long de ses soixante-quatre numéros précédents. Les articles publiés sur ces questions n'étaient pas toujours rédigés directement par Marc car, n'ayant jamais fait d'études et, surtout, contraint de s'exprimer dans des langues, tel le français, qu'il n'avait apprises qu'à l'âge adulte, écrire représentait pour lui un effort très pénible. Cependant, il a toujours été le principal inspirateur des textes permettant à notre organisation d'accomplir sa responsabilité d'actualisation permanente des positions communistes. Ainsi, pour ne citer qu'un des derniers exemples où notre organisation a dû réagir rapidement face à une nouvelle situation historique, l'effondrement irréversible du bloc de l'Est et du stalinisme, la grande vigilance de notre camarade, en même temps, évidemment, que sa profondeur de pensée, ont joué un rôle essentiel dans la capacité du CCI à apporter une réponse adéquate dont les faits n'ont cessé, depuis, de confirmer la validité.
Mais la contribution de Marc à la vie du CCI ne se limitait pas à l'élaboration et à l'approfondissement des positions politiques et des analyses théoriques. Jusqu'aux derniers instants de sa vie, tout en continuant à réfléchir sur l'évolution de la situation mondiale et à faire part, malgré l'effort surhumain que cela représentait pour lui, de ses réflexions aux camarades qui lui rendaient visite à l'hôpital, il a continué également à se préoccuper des moindres détails de la vie et du fonctionnement du CCI. Pour lui, il n'y a jamais eu de questions "subalternes" qu'on aurait pu réserver à des camarades moins formés théoriquement. De même qu'il a toujours eu comme préoccupation que l'ensemble des militants de l'organisation soit capable de la plus grande clarté politique possible, que les questions théoriques ne soient pas réservées à des "spécialistes", il n'a jamais hésité à "mettre la main à la pâte" de toutes les activités pratiques et quotidiennes. Ainsi, Marc a toujours donné aux jeunes militants du CCI l'exemple d'un militant complet, engagé avec toutes ses capacités dans la vie de cet organe indispensable du prolétariat, son organisation révolutionnaire. En fait, notre camarade a su en permanence transmettre aux nouvelles générations de militants toute l'expérience qu'il avait accumulée sur tous les plans au cours d'une vie militante d'une longueur et d'une intensité exceptionnelles. Et une telle expérience, ce n'est pas seulement dans la lecture des textes politiques que ces générations pouvaient l'acquérir, c'est dans la vie quotidienne de l'organisation et avec la présence de Marc qu'ils pouvaient y parvenir pleinement.
En ce sens, Marc a occupé une place tout à fait exceptionnelle dans la vie du prolétariat. Alors que la contre-révolution a éliminé, ou a plongé dans la sclérose, les organisations politiques que la classe ouvrière avait sécrétées dans le passé, il a constitué un pont, un maillon irremplaçable, entre les organisations qui avaient participé a la vague révolutionnaire du premier après-guerre et celles qui seront confrontées à la prochaine vague révolutionnaire. Dans son Histoire de la révolution russe, Trotsky est conduit à s'interroger sur la place particulière et exceptionnelle qu'y a prise Lénine. Tout en reprenant à son compte les thèses classiques du marxisme sur le rôle des individus dans l'histoire, il en conclut que, sans Lénine qui a réussi à impulser le redressement et 1’"armement" politique du parti bolchevik, la révolution n'aurait pu avoir lieu, ou qu'elle se serait soldée par un échec. Il est clair que, sans Marc, le CCI n'existerait pas, tout au moins sous sa forme actuelle d'organisation la plus importante du milieu révolutionnaire international (sans parler de la clarté de ses positions sur laquelle, évidemment, d'autres groupes révolutionnaires peuvent avoir un point de vue différent du nôtre). En particulier, sa présence et son activité ont permis que ne disparaisse pas dans l'oubli mais, au contraire, que fructifie le travail énorme et fondamental effectué par les fractions de gauche, et particulièrement la Fraction italienne, qui ont été exclues de l'Internationale communiste. En ce sens, si notre camarade n'a jamais eu dans la classe ouvrière une notoriété ne serait-ce que comparable à celles de Lénine, de Rosa Luxemburg, de Trotsky ou même de Bordiga ou Pannekoek, et il ne pouvait en être autrement alors que la plus grande partie de sa vie militante s'est passée dans la période de contre-révolution, et justement à cause de cela, il ne faut pas craindre d'affirmer que sa contribution à la lutte du prolétariat se situe au même niveau que celle de ces révolutionnaires.
Notre camarade s'est toujours montré réfractaire à ce type de comparaisons. Et c'est toujours avec la plus grande simplicité qu'il a accompli ses tâches militantes, qu’il n'a jamais revendiqué de "place d'honneur" au sein de l'organisation. Sa grande fierté, ce n'est pas dans sa contribution exceptionnelle qu'il l'a placée mais dans le fait que jusqu'au bout, il est reste fidèle, de tout son être, au combat du prolétariat. Et cela aussi était un enseignement précieux pour les nouvelles générations de militants qui n'ont pas eu l'occasion de connaître l'énorme dévouement à la cause révolutionnaire qui était celui des générations du passé. C'est en premier lieu sur ce plan que nous voulons être à la hauteur du combat que, désormais sans sa présence vigilante et lucide, chaleureuse et passionnée, nous sommes déterminés à poursuivre.
CCI
[1] [326] Les articles d'Internationalisme publiés dans la Revue
Internationale sont les suivants :
" L'évolution du capitalisme et la nouvelle perspective "
(n° 21,2e trim. 1980)
"La tâche de l'heure : formation du parti ou formation des cadres"
(n°32, ler trim. 1983)
"Contre la conception du chef génial", (n° 33, 2e trim. 1983)
"La discipline... Force principale... ", (n° 34, 3e trim. 1983)
"Le 2e congrès du Parti Communiste Internationaliste", juillet 1948 (n°36, ler trim. 1984)
" Rapport sur la situation internationale, GCF, juillet 1945 ", extraits sous le titre "Les vraies causes de la 2e guerre mondiale"
Ainsi que :
" le "Manifeste" de L'Etincelle, janvier 1945, (n° 59, 4e trim. 1989)
"L'expérience russe", (n° 61, 2e trim. 1990)
Ou la série d'articles :
"Critique de « Lénine philosophe » de Pannekoek, Politique et philosophie de Lénine à Harper", (n° 25, 27, 28, 30).
[2] [327] Cette même préoccupation d'établir des critères précis dans la convocation de conférences de croupes communistes a été manifestée par le CCI, contre le flou dans lequel se complaisait le PCInt lors de la Ire conférence tenue en mai 1977. Voir à ce sujet la Revue Internationale n° 10, 13, 17, 22, 40, 41, 53, 54, 55 et 56.
[3] [328] Il a alors l'occasion de manifester un des traits de son caractère qui n'a rien à voir avec celui d'un "théoricien en chambre" : présent sur tous les lieux où vit le mouvement, dans les discussions mais aussi dans les manifestations, il passe une nuit entière derrière une barricade bien décidé, avec un groupe déjeunes éléments, à "tenir jusqu'au matin" face à la police... comme l'avait fait la petite chèvre de Monsieur Seguin race au loup dans le conte d'Alphonse Daudet.
Conscience et organisation:
Personnages:
- Marc Chirik [219]
Courants politiques:
- Gauche Communiste [49]
Revue Internationale no 67 - 4e trimestre 1991
- 2603 reads
Crise économique : crime, mensonges et misère
- 3975 reads
Durant l'année 1991, la crise est passée au second plan des préoccupations, occultée par la guerre dans le Golfe et les massacres qu'elle a causé, par le développement de la guerre civile en Yougoslavie, et évidemment par les événements de l'été en URSS. Cependant, cela ne signifie certainement pas que cet aspect de l'évolution dramatique de la situation internationale soit devenu secondaire ou, comme voudrait le faire croire la classe dominante, que sur ce plan, les choses, finalement, n'Iraient pas aussi mal que ça. L'économie mondiale s'enfonce dans la récession, et toutes les mesures mises en avant par les différents gouvernements parviennent de moins en moins à freiner cette plongée irrésistible. La chronique économique de l'été 1991 est, à cet égard, très révélatrice.
La crise financière qui se développe depuis plusieurs années, et dont témoignent les faillites bancaires en série, est particulièrement significative de la crise du capital et des limites des moyens mis en oeuvre pour y remédier. Le développement gigantesque du crédit, c'est-à-dire de l'endettement, a été le moyen essentiel pour maintenir la production à flot en créant des débouchés artificiels et pour entretenir, durant les années 1980, l'illusion de la croissance et du boom économique. Le système financier international, donc les banques, ont été au coeur de ce processus. Elles payent aujourd'hui les pots cassés. Les montagnes de crédits qu'elles ont généreusement octroyé ne sont plus remboursés par des clients insolvables, et leurs bilans qui virent au rouge ont été encore plus gravement dégradés par l'effondrement de la spéculation boursière et immobilière dans laquelle elles s'étaient engouffrées.
Derrière les scandales qui, depuis des mois, secouent le monde bancaire et qui vont en s'accroissant, c'est en fait la réalité du développement de la crise financière et l'annonce d'un prochain séisme de première grandeur au coeur du système financier international qui s'annoncent. Les banques sont au coeur du fonctionnement du capitalisme, le symbole même de l'argent, du capital. Elles sont le système sanguin, proche du centre de décision de l'Etat, qui irrigue, en finançant et en permettant l'échange, tout l'organisme capitaliste. La forme scandaleuse que prennent les faillites bancaires n'est pas seulement liée au fait que la classe dominante utilise le scandale pour faire croire à l'exception et, en pointant du doigt a brebis galeuse, veut montrer la "moralité" de ses institutions, elle est surtout le produit du fait que la faillite met à nu le fonctionnement putride du capitalisme décadent, toutes les activités délictueuses et criminelles qui se déroulent derrière les portes feutrées des banques dans la course effrénée à la richesse où tous les coups sont permis, alors que les enjeux se chiffrent en milliards.
Le récent scandale de la BCCI qui laisse un trou dont l'estimation varie de 5 à 15 milliards de dollars montre l'envers du décor du monde capitaliste, ce qui se trame et se manigance dans les bureaux confortables des financiers "respectables". Recyclage de l'argent de la drogue, financement et organisation du trafic d'armes à l'échelle internationale, détournement de fonds, gestion des comptes des hommes politiques corrompus, organisation de l'évasion des capitaux, falsification de documents, trafic d'influence, magouilles diverses avec les services secrets et les groupes terroristes, corruption, espionnage industriel, et même entretien d'une équipe de tueurs pour "faciliter" ces activités, etc. Une véritable organisation du crime se cachait derrière l'honorable institution bancaire. Mais aussi caricaturale que soit la situation de la BCCI, elle n'est pas une exception, loin de là. Il suffit, pour constater cela, de faire simplement l'énumération des scandales bancaires de ces derniers mois : la filiale du Crédit Lyonnais en Hollande qui s'acoquine avec un financier italien, Paretti, dont la fortune est d'origine plus que douteuse, le fils de Bush, ancien directeur d'une caisse d'épargne en faillite qui passe en procès pour escroquerie ; les plus grandes banques japonaises qui sont prises la main dans le sac pour avoir escroqué les petits épargnants au profit des plus gros clients, tandis que le chef de la police japonaise vient de les avertir de cesser de faire des affaires avec les parrains de la pègre locale ; Salomon Brothers qui est accusée de trafiquer illégalement sur les bons du trésor; une escroquerie bancaire sur les actions de la bourse de Milan et qui porte sur des centaines de milliards de Lires est dévoilée en Suisse ; des fonctionnaires du ministère des finances de Pologne qui sont renvoyés pour avoir avec l'aide de banques locales, détourné es fonds de l'Etat. Et encore cette liste sur les derniers mois seulement est-elle loin d'être exhaustive. La crise qui pousse les capitalistes dans une concurrence effrénée, les pousse aussi, dans la quête avide de capital, à outrepasser leurs propres lois et à se jeter sur les activités les plus profitables, les plus spéculatives, celles du crime.
Pour une classe décadente qui, dans sa recherche assoiffée du profit, n'hésite pas à développer des activités criminelles vis-à-vis de ses propres lois, le mensonge est une peccadille, surtout s'il est dirigé vers la classe ennemie, le prolétariat. Cacher, masquer la réalité de la crise économique tant que faire se peut, a toujours été un axe essentiel de la propagande bourgeoise. Tous les Etats manipulent a qui mieux mieux les chiffres du chômage et de l'inflation, mais avec la récession qui se développe depuis des années ce sont ceux de la croissance qui sont soumis à une tricherie permanente. Le gouvernement américain est un spécialiste en la matière. Depuis des années le même sketch rituel est mis en scène : il annonce des chiffres de croissance optimistes, lance une campagne sur le thème du "tout va bien, la situation s'améliore" pendant quelques semaines et trois mois après, publie des chiffres révisés à la baisse qui montrent qu'il n'en a rien été. L'été dernier on a pu assister à une nouvelle répétition de cette manoeuvre : après avoir fêté en juillet, la fin de la récession en divulguant une hausse annuelle du PNB de 0,4 % pour le deuxième trimestre, finalement dans les derniers jours d'août c'est une baisse de -0,1 % qui est annoncée. Après les baisses de -1,6% du 4e trimestre 1990 et de -2,8% au 1er trimestre 1991, cela montre que, contrairement à la propagande de l'été, non seulement l'économie américaine n'est pas sortie de la récession, même en chiffres officiels, mais surtout que toutes les mesures mises en place pour relancer la machine, baisse du taux d'escompte à un niveau très bas pour faciliter le crédit, creusement d'un déficit budgétaire qui va atteindre un nouveau record pour l'année en cours où il devrait avoisiner les 400 milliards de dollars- n'ont pas suffit. La faiblesse de l'amélioration relative de l'économie américaine, plus qu'une source d'espoir pour le futur, comme le désirerait la bourgeoisie, est en fait le signe annonciateur d'une plongée encore plus profonde de la récession dans la période qui vient.
Alors que l'économie américaine continue à battre de l'aile et à s'enfoncer dans le marasme, les deux autres puissances économiques du monde qui semblaient jusque là à l'abri de la récession avec des taux de croissance confortables, commencent à montrer des signes de faiblesse :
- l'Allemagne après une croissance record de 4,8 % en 1990, table pour l'année 1991 sur une croissance en baisse à 3 % malgré la reconstruction de l'Allemagne de l'Est qui tire sa production ;
- au Japon aussi, même si la croissance se maintient à un haut niveau, les signes avant-coureurs d'une baisse future sont là, la consommation intérieure stagne, les importations ont baissé de - 5,4 % au mois de juillet, tandis que le bâtiment est en crise avec un recul de - 21 % des mises en chantiers en juillet 1991 par rapport au même mois de l'année précédente.
Alors que la fuite en avant dans le crédit n'est plus possible, comme le montre la crise du système financier et les faillites bancaires en série, la perspective s'assombrit toujours plus pour l'économie mondiale, les nuages s'accumulent qui annoncent l'orage.
Cette crise qui s'intensifie, les prolétaires n'ont pas besoin d'en lire les nouvelles et les indices dans les journaux pour la constater, ils la vivent dans leur chair. Plus que toute autre question, le développement du chômage a été significatif de l'accélération de la crise ces derniers mois. Depuis le début de l'année pas un jour qui ne passe sans que de nouveaux licenciements ne soient annoncés. Dans tous les pays développés l'accroissement du nombre de chômeurs prend l'allure d'une catastrophe sociale et offre un contraste frappant avec les déclarations faussement rassurantes de nos dirigeants.
De juin 1990 à mai 1991, le nombre de chômeurs est passé officiellement aux USA de 6 580 000 à 8 640 000, une croissance de 30 % ! En Grande-Bretagne, sur la même période, il a grimpé de 1 618 000 à 2 244 000, et depuis le printemps, il croît au rythme de 80 à 90 000 nouveaux demandeurs d'emploi par mois, et l'OCDE prévoit déjà 2 700 000 chômeurs pour la mi-1992. En France, de juillet 1990 à juillet 1992, il est passé de 2 503 000 à 2 703 000. En Allemagne, même si le chômage a régressé à l'ouest depuis un an, ce qui est lié à la situation particulière de ce pays dopé par la réunification, à l'est on prévoit un taux de chômage de 30 % dans la période qui vient.
Ce sombre bilan montre ce qui attend les prolétaires du monde entier, car il n'est que provisoire. Avec le développement de la récession mondiale, le pire est à venir. En fait, ce bref survol de l'actualité économique de ces derniers mois montre, sous un éclairage particulièrement cru, ce que le capitalisme a à offrir aux prolétaires et exploités du monde entier : le crime, le mensonge et la misère.
JJ, 02/09/1991
Récent et en cours:
- Crise économique [28]
Questions théoriques:
- Décadence [32]
Présentation du 9e congres du CCI et résolution sur la situation internationale
- 2591 reads
Quelques semaines avant les événements d'URSS, le CCI a tenu son 9e Congrès international. Comme le lecteur pourra s'en rendre compte en prenant connaissance des documents adoptés à cette réunion que nous publions par la suite, l'éclatement de l'URSS -ainsi que la guerre civile en Yougoslavie -qui s'inscrit complètement dans la dynamique ouverte depuis la disparition du bloc impérialiste de l'Est, ne nous a pas surpris et est venu illustrer les travaux et les orientations que nous venions tout juste de confirmer à ce congrès. Tout juste de confirmer disions-nous, car, à vrai dire, c'est depuis le tout début de l'explosion du bloc impérialiste de l'Est, en été 1989, que notre organisation a su analyser les grandes tendances de la nouvelle situation historique qui s'ouvrait, et tout spécialement la perspective du chaos et de l'explosion du bloc de l'Est et de l'URSS.
Véritable assemblée générale du CCI, moment privilégié de sa vie et expression la plus haute de son caractère centralisé et international, un congrès doit tirer un bilan du travail accompli dans la période qui le précède, et, sur cette base, définir des orientations d'activités en rapport avec les perspectives qu'il dégage de la situation internationale, spécialement quant au rapport de force entre le capital et le prolétariat au niveau mondial. Par conséquent, ce congrès avait pour tâche essentielle la discussion de la validité de nos analyses (en particulier l'analyse générale sur la phase historique de décomposition dans laquelle est entré le capitalisme) et de nos prises de position face aux immenses bouleversements historiques que nous avons vécus depuis la fin 1989 :
- l'effondrement des régimes staliniens,
- la disparition de la configuration impérialiste Est-Ouest issue de 1945, de Yalta,
- face à la situation qui s'en est suivie, la guerre du Golfe qui a vu la destruction de l'Irak et du Koweït,
- le chaos touchant un grand nombre de pays et tout particulièrement les pays de l'Est européen, e recul de la lutte de classe internationale.
La nouvelle situation : une rupture historique et le recul de la lutte de classe
Quel bilan le congrès a-t-il tiré des analyses élaborées et des prises de position du CCI - toutes publiées dans la presse et auxquelles nous allons faire référence -face aux événements gigantesques que nous avons vécus ? Comme le dit la résolution d'activités adoptée :
« Les événements de portée historique qui ont jalonné ces deux années ont mis l'organisation à l'épreuve en lui imposant le réexamen de {ensemble de ses analyses et de son activité à la lueur des nouvelles données de la situation internationale (...) Le critère central pour apprécier le bilan de l'activité du CCI durant ces deux dernières années est nécessairement, vue l'importance des événements, sa capacité à avoir perçu et analysé ce qu'ils signifiaient et impliquaient. »
Que signifiaient ces événements ? Qu'impliquaient-ils ? C'est là-dessus que le congrès a du revenir et se prononcer.
La phase historique de décomposition du capitalisme a l'origine de la disparition du bloc de l'Est et de l'URSS
Dans les conditions dramatiques et catastrophiques de la crise économique ouverte, irréversible du capitalisme, la bourgeoisie est incapable d'imposer au prolétariat mondial la seule perspective qu'elle puisse offrir à l'humanité : une troisième guerre mondiale aux effets dévastateurs. Mais par ailleurs, le prolétariat est lui-même incapable pour le moment de dégager clairement, ni même de présenter, sa propre perspective révolutionnaire de destruction de la société capitaliste. Aucune perspective historique n'ayant réussi à se dégager, la société capitaliste - dont la crise économique, elle, ne s'arrête pas - se trouve dans une impasse et pourrit sur pied tel un fruit non cueilli. C'est ce que nous appelons la nouvelle phase historique de décomposition du capitalisme ("La décomposition, phase ultime du capitalisme", Revue Internationale n° 62, 3e trimestre 1990).
Cette phase de décomposition, de blocage et d'impasse historique, est a l'origine de l'éclatement du bloc impérialiste de l'Est, de PURSS et de la mort du stalinisme que nous avions su entrevoir dès octobre 1989 :
«Dès à présent, le bloc de l'Est nous présente le tableau d'une dislocation croissante. Par exemple, les invectives entre l'Allemagne de l'Est et la Hongrie, entre les gouvernements "réformateurs" et les gouvernements "conservateurs", ne sont nullement du cinéma. Elles rendent compte des réels clivages qui sont en train de s'établir entre les différentes bourgeoisies nationales. Dans cette zone, les forces centrifuges sont tellement fortes qu'elles se déchaînent dès qu'on leur en laisse l'occasion. Et aujourd'hui, cette occasion s'alimente des craintes suscitées au sein des partis dirigés par les "conservateurs" que le mouvement parti d'URSS, et qui s'est amplifié en Pologne et en Hongrie, ne vienne, par contagion, les déstabiliser.
C'est un phénomène similaire qu'on retrouve dans les Républiques périphériques de l'URSS. Ces régions sont en quelque sorte des colonies de la Russie tsariste ou même de la Russie stalinienne (par exemple les pays baltes annexés suite au pacte germano-soviétique de 1939). (...) Les mouvements nationalistes qui, à la faveur du relâchement du contrôle central du parti russe, s'y développent aujourd'hui avec près d'un demi-siècle de retard par rapport aux mouvements qui avaient affecté les empires français ou britannique, portent avec eux la dynamique de séparation d'avec la Russie.
En fin de compte, si le pouvoir central de Moscou ne réagissait pas, nous assisterions à un phénomène d'explosion, non seulement du bloc russe, mais également de sa puissance dominante. Dans une telle dynamique, la bourgeoisie russe, qui, aujourd'hui, domine la deuxième puissance mondiale, ne serait plus à la tête que d'une puissance de second plan, bien plus faible que l'Allemagne, par exemple. »
("Thèses sur la crise économique et politique dans les pays de l'Est", adoptées en Octobre 1989, Revue Internationale n° 60, 1er trimestre 1990).
La décomposition du capitalisme exacerbe encore plus les antagonismes impérialistes, les guerres et le militarisme
Les effets de cette phase historique, dans ce cas l'explosion du bloc de l'Est et de l'URSS, à leur tour, viennent accentuer et renforcer la décomposition de la société. Elle est marquée par l'exacerbation de toutes les caractéristiques du capitalisme décadent, tout particulièrement, la guerre, l'impérialisme, le militarisme (telles que nous les avons mises en évidence dans le texte "Militarisme et décomposition" en octobre 1990, Revue Internationale n° 62), le capitalisme d'Etat, et ce dans un chaos croissant. Voilà ce 3ue nous écrivions au lendemain de la chute du mur e Berlin, alors que la bourgeoisie mondiale chantait à tue-tête les vertus du capitalisme et se vantait d'offrir à l'humanité une ère de paix et de prospérité... ainsi que sa victoire sur le marxisme :
« Cette disparition du bloc de l'Est signifie-t-elle que, désormais, le monde sera dominé par un seul bloc impérialiste ou que le capitalisme ne connaîtra plus d'affrontements impérialistes ? De telles hypothèses seraient tout à fait étrangères au marxisme. (...). Dans la période de décadence du capitalisme, TOUS les Etats sont impérialistes et prennent les dispositions pour assumer cette réalité : économie de guerre, armements, etc. C'est pour cela que l'aggravation de l'économie mondiale ne pourra qu'attiser les déchirements entre ces différents Etats, y compris, et de plus en plus, sur le pian militaire. La différence avec la période qui vient de se terminer, c'est que ces déchirements et antagonismes qui auparavant étaient contenus et utilisés par les deux grands blocs impérialistes, vont maintenant passer au premier plan. La disparition du gendarme impérialiste russe, et celle qui va en découler pour le gendarme américain vis-à-vis de ses principaux "partenaires" d'hier (note : nous entendions par là la disparition du bloc de l'Ouest face à la mort subite de son rival oriental), ouvrent la porte au déchaînement de toute une série de rivalités plus locales. Ces rivalités et affrontements ne peuvent pas, à l'heure actuelle, dégénérer en un conflit mondial (même en supposant que le prolétariat ne soit plus en mesure de s y opposer). En revanche, du fait de la disparition de la discipline imposée par la présence des blocs, ces conflits risquent d’être plus violents et plus nombreux, en particulier, évidemment, dans les zones où le prolétariat est le plus faible. »
("Après l'effondrement du bloc de l'Est, décomposition et chaos", Revue Internationale n°61, 2 trimestre 1990,).
C'est exactement ce qui allait se réaliser quelques mois plus tard de manière ô combien sanglante avec la guerre du Golfe.
L'effondrement du bloc de l'est : une rupture historique dans la situation mondiale
La disparition du bloc impérialiste de l'Est, l'agonie du capitalisme d'Etat stalinien, la guerre impérialiste du Golfe, marquent une rupture nette dans l'évolution historique. En particulier pour la lutte de classe du prolétariat mondial.
La fin des années 1960 avait ouvert une période de développement lent, non linéaire, mais réel, des luttes ouvrières dans le monde entier face aux attaques dues à l'aggravation inexorable de la crise économique : 1968 à 1975 (France, Italie, Pologne, etc.), Pologne 1980, luttes des années 1983-1988 en Europe occidentale. Cette force relative, cette résistance de la classe ouvrière mondiale, en empêchant les différentes bourgeoisies nationales d'embrigader l'ensemble du prolétariat, est à l'origine du blocage historique qui a vu le phénomène de la décomposition devenir déterminant dans la vie du capitalisme. L'effondrement des régimes staliniens, qui est à comprendre dans ce cadre de la décomposition, devait occasionner un profond recul dans la conscience de la classe ouvrière (article de la Revue Internationale n°60, "Des difficultés accrues pour le prolétariat" rédigé en novembre 1989 et la thèse 22 des "Thèses sur la crise économique et politique dans les pays de l'Est" déjà citées). Il pesait encore sur la classe ouvrière lorsque la guerre du Golfe est venue à son tour influer sur le rapport de force entre les classes :
«Aujourd'hui, cette prise de conscience continue à être entravée par les séquelles de l'effondrement du stalinisme et du bloc de t'Est. Le discrédit qu'a subi il y a un an et demi, sous l'effet notamment d'une campagne gigantesque de mensonges, l'idée même de socialisme et de révolution prolétarienne est encore loin d'avoir été surmonté. (...) De même, la crise et la guerre du Golfe, si elles ont eu le mérite de démentir les discours sur la "paix éternelle", ont aussi engendré dans un premier temps un sentiment d'impuissance et une paralysie indiscutable dans les grandes masses ouvrières des pays avancés. »
("Résolution sur la situation internationale" adoptée par le congrès et publiée dans ce numéro).
Est-il besoin de préciser que, depuis notre congrès, l'échec du putsch des "conservateurs" en URSS au mois d'août, la mort du PC stalinien d'URSS, la dislocation de l'URSS, sont l'occasion pour la bourgeoisie mondiale de relancer la campagne contre la classe ouvrière sur "la mort du communisme", usant et abusant du plus grand mensonge historique de tous les temps qui assimile le capitalisme d'Etat stalinien au communisme. Nul doute que cette campagne ne fait que prolonger un peu plus encore les effets négatifs sur le prolétariat de la putréfaction nauséabonde du stalinisme. Le prolétariat mondial aura payé cher, très, très cher, la contre-révolution stalinienne, dans sa chair et dans son esprit.
Le 9e congrès du CCI s'est prononcé en accord avec cette analyse et avec les différentes prises de position adoptées face aux événements. Il a donc tiré un bilan positif de ses activités sur le plan de l'élaboration théorique et de l'analyse de la situation internationale, ainsi que sur le plan des prises de position.
Bilan des activités
La rupture historique, les événements que nous avons vécus depuis l'effondrement du bloc de l'Est, le recul du prolétariat, ont nécessité une adaptation de notre intervention générale. De ce point de vue aussi, le congrès a tire un bilan positif. L'ensemble de notre intervention a su prendre position de façon militante sur les principales questions posées dans la situation actuelle, en particulier à travers : la mise en lumière de la nouvelle phase historique de décomposition, la gravité des enjeux, l'explication des causes historiques et particulières de l'effondrement des régimes staliniens, la dénonciation des campagnes bourgeoises en particulier celle identifiant la révolution russe à la barbarie du stalinisme, identifiant le communisme au capitalisme d'Etat stalinien, la dénonciation de la barbarie meurtrière et cynique de la bourgeoisie, de son système et de la "démocratie" durant a guerre du Golfe, etc.
Par ailleurs, avec le recul de la lutte de classe et les circonstances de celui-ci, « l'aspect propagande a largement pris le pas dans notre intervention, avec la presse comme instrument principal de celle-ci (...) Les publications territoriales ont été globalement capables de répondre à l'irruption des événements majeurs, en avançant leur date de parution, par la sortie de suppléments quand nécessaire » (Résolution sur les activités). Le CCI, comme un tout uni et centralisé, a diffusé un supplément international à ses publications lors de l'éclatement du bloc de l'Est, et deux tracts internationaux dans les douze pays où il est présent et partout où il pouvait intervenir, dénonçant le conflit impérialiste dans le Golfe lors de son éclatement et de sa fin.
Sur le plan de la vie organisationnelle, le CCI a su renforcer ses liens et sa centralisation internationale suivant en cela les orientations tracées par son congrès international précédent. La mobilisation de l'organisation, de tous ses militants, et le resserrement des liens entre toutes ses parties et sections territoriales, ont constitué une arme fondamentale de l'organisation pour faire face à la nouvelle situation.
Si le congrès a tiré un bilan positif de nos activités, cela ne veut pas dire que nous n'ayons pas manifesté des faiblesses, notamment des retards dans les différentes presses territoriales, en particulier pour répondre à l'effondrement des régimes staliniens. Ces faiblesses ont résulté fondamentalement de la difficulté réelle qu'il y avait pour appréhender dans toute sa mesure l'ampleur de la rupture historique ; pour remettre en cause le cadre d'analyse correspondant à la période précédant la disparition du bloc de l'Est ; pour voir rapidement et comprendre l'éclatement de ce bloc ; pour saisir les répercussions négatives pour la classe ouvrière de l'effondrement du stalinisme ; pour reconnaître le recul de la lutte de classe.
Faire face à l'accélération dramatique de l'histoire
L'histoire s'accélère dramatiquement. Inutile de revenir encore sur les événements et sur le dernier d'entre eux à l'heure où nous écrivons : la fin de l'URSS. Il suffit de lire les journaux, ou de regarder la TV. La bourgeoisie ne peut le cacher. La décomposition de la société capitaliste dans l'impasse historique, est la cause de cette accélération. Elle touche toute la société, toutes les classes, y compris le prolétariat. Les caractéristiques du phénomène de la décomposition font que s'exerce sur la classe ouvrière, les organisations révolutionnaires - y inclus bien sûr le CCI - et les militants, une pression particulière de l'idéologie petite-bourgeoise qui mine la confiance et la conviction dans la force historique du prolétariat et dans le rôle des organisations politiques révolutionnaires.
La pression de l'idéologie bourgeoisie et petite-bourgeoise gangrenées par la décomposition, et la fuite dans les illusions les plus réactionnaires qu'elle provoque, telles le nationalisme, le corporatisme, voire le racisme ; le rejet de grandes masses d'ouvriers dans le chômage, sans perspective de retrouver du travail, ou d'en trouver quand il s'agit des jeunes, la lumpénisation, la marginalisation qui s'ensuit, le désespoir (la chute dans la drogue et dans la délinquance ou la constitution par exemple), et nous en passons, sont es dangers qui menacent de plus en plus violemment et massivement le prolétariat mondial. Ils entravent le développement de sa conscience et de la confiance en sa force révolutionnaire. Cette situation connaît un développement terrible et se révèle dans toute son ampleur dans les pays de l'ex-bloc de l'Est. Le déboussolement, l'aveuglement et le désespoir qui frappent les grandes masses d'ouvriers de ces pays sont particulièrement dramatiques. Nul doute que l'explosion de l'URSS, l'indépendance des républiques et le nationalisme qui va avec, les illusions démocratiques et celles sur la pseudo prospérité des pays occidentaux, vont renforcer encore le désarroi et 'impuissance du prolétariat dans cette partie du monde.
Le même type de dangers pèse sur les militants communistes et leurs organisations politiques. Les doutes, le scepticisme, la démoralisation, le manque de confiance dans la classe ouvrière vont de pair avec les tentations de fuite dans la "vie privée", dans l'individualisme, dans le rejet, le dénigrement amer et cynique de toute activité militante organisée et collective, ou dans le refus de la théorie, de la réflexion.
De même au plan collectif, du fonctionnement de l'organisation révolutionnaire, le dilettantisme, le laisser-aller, le chacun pour soi, le localisme, représentent eux aussi des dangers autrement plus menaçants que par le passé sur le fonctionnement même des organisations politiques communistes.
Cette pression s'effectue encore sur le plan théorico-politique. L'absence de perspective historique qui produit cette situation inédite de décomposition du capitalisme, se manifeste dans la déliquescence de la pensée, dans la perte de toute méthode, dans la confusion et le mélange des genres, dans une vision immédiate, a-historique. Pour les organisations communistes, cette pression se traduit dans des tendances accrues à une vision immédiate et superficielle, au jour le jour, des événements - ce que nous appelons l'immédiatisme - sans comprendre, ni même bien souvent essayer de voir, l'unité et l'ensemble du processus historique.
Le manque de rigueur dans la pensée, le manque d'intérêt pour la théorie - caractéristiques qui touchent l'ensemble de la société capitaliste et qui connaissent un développement effarant - se manifestent par une pression à l'abandon de la lecture des ouvrages théoriques et historiques, par l'oubli ou l'ignorance des "classiques du marxisme", de l'histoire du mouvement ouvrier et de la société capitaliste.
Cette pression s'illustre aussi - nous le voyons dans nombre de groupes révolutionnaires - dans la mise en cause des acquis théoriques et politiques du mouvement ouvrier, quand ce n'est pas tout simplement -ouvertement ou non - dans le rejet du marxisme.
C'est la raison pour laquelle le 9e congrès a appelé l'ensemble de notre organisation, de ses parties, de ses militants, à renforcer les liens et la centralisation internationale du CCI, à faire preuve de la plus grande vigilance organisationnelle et militante, mais aussi à développer tout particulièrement l'implication et la mobilisation de l'ensemble de nos forces dans la réflexion et l'approfondissement théorique et dans l'élaboration de nos analyses. Ce sont la les conditions indispensables pour pouvoir intervenir de la manière la plus adéquate et la plus efficace possible dans la classe ouvrière.
L'intervention dans la période qui vient
Dans cette situation de pression renforcée de la décomposition sur le prolétariat et les révolutionnaires, dans cette situation d'accélération terrible de l'histoire, le 9e congrès du CCI a tracé ses perspectives d'activités générales, et tout particulièrement ses perspectives d'intervention envers la classe ouvrière et e milieu politique prolétarien.
Bien évidemment, la disparition de l'URSS et l'ignoble campagne de la bourgeoisie contre le communisme prolongent les effets du recul subi par le prolétariat depuis maintenant plus de deux ans. Elles renforcent aussi la nécessité pour nous de renforcer la dénonciation du mensonge assimilant le communisme au stalinisme. En s'inscrivant dans le cadre de nos analyses, cet événement ne nous surprend pas et vient confirmer l'orientation de notre intervention que le 9e Congrès avait définie :
« Notre intervention va être confrontée à la fois à la nécessité d'aider la classe ouvrière à surmonter les séquelles toujours présentes du recul dans sa conscience, consécutif à l'effondrement du bloc de l'Est et à celle de favoriser la décantation de cette même conscience qu a suscité la guerre du Golfe et que ne fera qu'approfondir la menace déplus en plus présente de la guerre. C'est pourquoi l'axe principal de l'intervention est de contribuer du mieux possible à l'approfondissement de la conscience, à travers la dénonciation générale de la bourgeoisie et de son système, à la mise en relief des enjeux dans la nouvelle situation historique en lien avec la perspective générale du combat de classe.
De ce fait la question de la guerre doit rester un axe de notre intervention. » (Résolution sur les activités).
Car en fait, la classe ouvrière va devoir lutter dans une situation déterminée par le développement du chaos, des guerres et de la crise économique. C'est aussi dans cette situation que va se déployer notre activité et notre intervention.
« Le chaos général qui caractérise la phase ultime de la décadence capitaliste, celle de la décomposition, ne pourra être marqué que par un déchaînement de ce qui constitue la caractéristique dominante de la période de décadence: les conflits impérialistes et le militarisme. » (Résolution sur la situation internationale).
Les guerres impérialistes qui vont éclater, même si elles ne prendront pas la forme de guerre mondiale avec deux blocs impérialistes antagoniques - du moins pour le moment -, n'en seront pas moins meurtrières, provoquant des ravages considérables et, combinées aux autres effets de la décomposition, pollution, famines, épidémies, elles peuvent très bien mener à la destruction de l'humanité. En effet, chaque fois plus aigus encore sous les coups redoublés de la crise économique, les antagonismes impérialistes entre les alliés d'hier dans l'ex-bloc occidental, vont venir entretenir et propager les différents feux guerriers qui éclatent dans la phase de décomposition.
Cette perspective de multiplication de conflits impérialistes sanglants et la perspective d'un développe ment catastrophique des effets de la décomposition tout particulièrement dans les pays d'Europe de l'Est ne sont pas sans conséquences sur la lutte de classe. Nous l'avons dit, le prolétariat subit un recul de sa conscience et de sa combativité. Mais comme classe mondiale, il n'est pas défait et le cours historique reste à des affrontements de classe décisifs. Tout particulièrement, et c'est ce qui est déterminant, la classe ouvrière concentrée et expérimentée d'Europe de l'Ouest n'est pas embrigadée derrière les drapeaux de la bourgeoisie.
« En réalité, si le désarroi provoqué par les événements du Golfe peut ressembler, en surface, à celui résultant de l'effondrement du bloc de l'Est, il obéit à une dynamique différente : alors que ce qui vient de l'Est (élimination des restes du stalinisme, affrontements nationalistes, immigration, etc.) ne peut, et pour un bon moment encore, qu 'avoir un impact essentiellement négatif sur la conscience du prolétariat, la présence de plus en plus permanente de la guerre dans la vie de la société va tendre, au contraire, à réveiller cette conscience. (...). La mise en évidence croissante tant de la faillite irréversible du mode de production capitaliste, y compris et surtout sous sa forme "libérale", que de la nature irrémédiablement guerrière de ce système, vont constituer pour les secteurs centraux du prolétariat un facteur puissant d'usure des illusions issues des événements de la fin 1989. » (idem).
La barbarie guerrière et la multiplication des attaques économiques vont pousser le prolétariat à reprendre le chemin de la lutte, et à prendre conscience des terribles enjeux historiques qui se présentent. C'est à cette perspective que le 9e congrès a voulu préparer le CCI.
Appel au milieu politique prolétarien
C'est dans cette situation historique mondiale chaque jour plus dramatique, que le 9e congrès adresse un "Appel au milieu politique prolétarien" (publié dans ce numéro). En effet, malgré les difficultés importantes du milieu politique prolétarien, le CCI doit participer et oeuvrer à la clarification politique et à 1’unification de ce qui constitue l'avant-garde politique du prolétariat. Depuis sa fondation, notre organisation a toujours inscrit cette tâche au sein de ses préoccupations.
« Le CCI qui, par l'importance de sa place dans ce milieu, possède une responsabilité de premier ordre (...), doit savoir mettre à profit toute occasion pour agir dans le sens d'un dépassement de l'actuelle situation (de dispersion et de sectarisme). La guerre du Golfe, qui a provoqué une claire prise de position internationaliste de la part des groupes révolutionnaires, mais de façon très dispersée, et dans une bien moindre mesure l'effondrement du bloc de l'Est, vis-à-vis duquel les groupes ont réaffirmé sa nature capitaliste mais dans un cadre d'analyse aussi insuffisant que confus, fournissent une telle occasion. (...)
Le 9e Congrès du CCI décide d'adresser aux groupes dont l'existence repose sur des bases historiques réelles et à l'exclusion des groupes parasites, un appel mettant en avant la nécessité :
- de prendre conscience de l'importance des enjeux historiques actuels et des positions de classe que partagent ces groupes ;
- de combattre les attitudes marquées par le sectarisme de chapelle (...);
- d'agir en vue d'un développement des contacts et du débat ouvert à travers la presse (...), l'assistance aux réunions publiques et permanences des groupes du milieu, d éventuelles interventions communes (à travers des tracts par exemple) face à des questions particulièrement importantes. » (Résolution sur le milieu politique prolétarien).
Le 9e congres, moment d'homogénéisation et de renforcement du CCI
C'est un bilan positif que nous tirons de ce congrès. Ce fut un moment d'homogénéisation et de regroupement du CCI. Après les faits historiques bouleversant toute la société capitaliste telle qu'elle était sortie de la 2e Guerre mondiale, il s'agissait de "digérer" ce bouleversement, cette rupture Historique, de vérifier nos analyses, de se regrouper derrière nos perspectives, pour affronter l'intense période qui vient.
L'histoire s'accélère et s'accélère encore. Les événements dramatiques se succèdent à une cadence chaque fois plus effrénée. L'immense majorité de la population mondiale vit dans la misère extrême sous a menace mortelle des guerres, des maladies, des catastrophes en tous genres, et de la famine.
Le prolétariat mondial subit les attaques économiques redoublées dans une ambiance croissante de décomposition et de guerre. Même si aujourd'hui il subit un recul de sa conscience et aussi de sa combativité, il est la seule force capable d'en finir à jamais avec ce cloaque immonde qu'est devenu le capitalisme en putréfaction. Inévitablement, sous les coups du capital, il va devoir s'affronter implacablement, dans une lutte à mort, à la bourgeoisie mondiale. L'enjeu de cet affrontement terrible et gigantesque ? La destruction du capital, l'instauration du communisme et la survie de l'humanité.
CCI, 01/09/91
9e CONGRES DU CCI
La guerre impérialiste, la crise et les perspectives de la lutte de classe dans la décomposition du capitalisme
Nous publions ci-dessous la résolution sur la situation internationale adoptée par le 9e congrès du CCI. Ce texte constitue la synthèse des deux rapports présentés à ce congrès : sur la situation économique et sur les autres aspects de la situation internationale. Afin de préciser et expliciter certains points de la résolution, nous reproduisons à sa suite des extraits de ce deuxième rapport. Faute de place, les passages retenus ne sont pas toujours articulés entre eux et sont loin de recouvrir l'ensemble des points abordés dans le rapport de même que dans les discussions du congrès. Ces passages ne concernent pas toujours non plus les points les plus importants de la situation internationale, lesquels ont déjà été amplement traités dans d'autres articles de la Revue Internationale. Nous avons plutôt privilégié dans ce choix les questions, également importantes, sur lesquelles le rapport était plus explicite que ces articles.
Résolution sur la situation internationale
Le phénomène d'accélération de l'histoire, déjà identifie par le CCI au début des années 1980, a connu, depuis son dernier congrès, une accentuation considérable. Jamais, depuis la constitution de notre organisation, et même depuis la seconde guerre mondiale, il ne s'était déroulé, et ceci en moins de deux ans, des événements d'une telle importance historique. En quelques mois, c'est toute la configuration du monde, telle qu'elle était sortie de cette guerre, qui s'est trouvée bouleversée. En fait, l'effondrement du bloc impérialiste de l'Est, qui clôt les années 1980, ouvre la porte à une fin de millénaire dominée par une instabilité et un chaos comme jamais l'humanité n'en a connus. Il appartient aux révolutionnaires, s'ils veulent être en mesure d'assumer leur rôle d'avant-garde du prolétariat mondial, de comprendre pleinement la signification des convulsions que nous venons de connaître afin de dégager la perspective qu'elles annoncent pour l'ensemble de la société et, en premier lieu, pour la classe ouvrière. En particulier, il leur revient de faire ressortir que l'effondrement du bloc de l'Est et la guerre du Golfe constituent des manifestations de l'entrée du système capitaliste dans la phase ultime de sa période de décadence : celle de la décomposition générale de la société.
1) Comme il a été mis en évidence dans plusieurs autres textes de l'organisation, la phase de décomposition :
- «constitue l'étape ultime vers laquelle tendent les convulsions phénoménales qui, depuis le début du siècle, à travers une spirale infernale de crise-guerre-reconstruction-nouvelle crise, ont secoué la société et ses différentes classes (...); elle apparaît [dans la mesure où les contradictions et manifestations de la décadence du capitalisme... ne disparaissent pas avec le temps, mais se maintiennent et même s'approfondissent] comme celle résultant de l'accumulation de toutes ces caractéristiques d'un système moribond, celle qui parachève et chapeaute trois quarts de siècle d'agonie d'un mode de production condamné par l'histoire. Concrètement, non seulement la nature impérialiste de tous les Etats, la menace de guerre mondiale, l'absorption de la société civile par le Moloch étatique, la crise permanente de l'économie capitaliste, se maintiennent dans la phase de décomposition, mais cette dernière se présente comme la conséquence ultime, la synthèse achevée de tous ces éléments »
- « est déterminée fondamentalement par des conditions historiques nouvelles, inédites et inattendues : la situation d'impasse momentanée de la société, de "blocage", du fait de la "neutralisation" mutuelle de ses deux classes fondamentales qui empêche chacune d'elles d'apporter sa réponse décisive à la crise ouverte de l’économie capitaliste (...): l'incapacité de la bourgeoisie à offrir la moindre perspective pour l'ensemble de la société et l'incapacité du prolétariat à affirmer ouvertement la sienne dans l'immédiat». ("La décomposition, phase ultime de la décadence du capitalisme", Revue Internationale, n°62, 3e trimestre 1990)
Cette incapacité du mode de production capitaliste à proposer la moindre perspective à la société, en dehors d'une résistance au jour le jour face à l'avancée inéluctable de ses convulsions économiques, débouche nécessairement sur des tendances croissantes vers un chaos généralisé, vers une débandade des différentes composantes du corps social dans le "chacun pour soi".
En outre, cette phase de décomposition ne débute pas avec sa manifestation la plus spectaculaire : l'effondrement du stalinisme et du bloc de l'Est dans la seconde moitié de 1989. C'est tout au long des années 1980 que le phénomène de décomposition générale de la société prend son essor et imprègne de Façon croissante tous les aspects de la vie sociale.
2) Un événement aussi considérable et inédit que l'effondrement de tout un bloc impérialiste en dehors d'une guerre mondiale ou d'une révolution prolétarienne, tel qu'on l'a vécu en 1989, ne peut s'expliquer pleinement sans prendre en considération l'entrée du capitalisme décadent dans une phase nouvelle de son existence : la phase de décomposition. Cependant, les particularités de la décomposition ne permettent pas, a elles seules, de comprendre les causes d'un tel événement. Celui-ci trouve ses origines dans l'existence d'un phénomène, le stalinisme, qui ne peut être analysé qu'en faisant intervenir le cadre général de la décadence du mode de production capitaliste et de l'histoire de cette décadence tout au long du 20e siècle :
a) Le stalinisme constitue une manifestation particulière de la tendance générale au capitalisme d'Etat qui caractérise justement la décadence capitaliste.
b) Cependant, et au contraire des manifestations de cette tendance dans la plupart des autres pays (particulièrement les plus avancés), il ne se développe pas de façon progressive et organique au sein des rouages de la société capitaliste, mais il résulte de circonstances spécifiques et "accidentelles" (si on se place du point de vue de la bourgeoisie) mais qui ne pouvaient se produire que dans la décadence : la révolution prolétarienne momentanément victorieuse dans un pays à laquelle fait suite une contre-révolution prise en charge dans ce même pays par l'appareil de l'Etat post-révolutionnaire et non par les secteurs classiques de la classe dominante.
c) Ce même caractère "accidentel" se retrouve dans la constitution du bloc dirigé par l'Etat qui a vu naître le stalinisme. En effet, ce sont les circonstances spécifiques de la seconde guerre mondiale (qui constitue justement la manifestation la plus saillante à ce jour de la décadence capitaliste) qui ont permis à cet Etat arriéré d'établir sa domination sur une partie du monde avec comme seul instrument la même force brute qu'il utilisait à l'intérieur de ses frontières, ce qui a conduit à la formation d'un bloc impérialiste particulièrement bancal.
Les caractéristiques aberrantes de la forme stalinienne du capitalisme d'Etat (totale centralisation de l'économie, absence de la sélection du marché éliminant les entreprises non rentables, sélection du personnel gérant le capital national sur des critères uniquement politiques) liées à son origine historique pouvaient être compatibles avec les circonstances de la guerre mondiale. En revanche, elles ont imposé à ce type de régime des limites radicales avec la prolongation, sans qu'elle puisse déboucher sur un nouvel holocauste généralise, de la crise ouverte du capitalisme. Dans une telle situation d'aggravation de la guerre commerciale entre nations, ces caractéristiques, en privant l'économie stalinienne de toute compétitivité et d'une quelconque motivation de ses agents, n'ont pu que déboucher sur son implosion.
En ce sens, l'effondrement économique de l'URSS et de ses "satellites", qui est à l'origine de la dislocation du bloc de l'Est, trouve ses racines dans les mêmes conditions historiques qui ont permis l'entrée du capitalisme dans la phase de décomposition : la prolongation de la crise ouverte alors qu'aucune des deux classes fondamentales de la société ne peut affirmer sa propre perspective. Ainsi, il se confirme que l'effondrement du bloc de l'Est, fait historique le plus important depuis la reprise mondiale des combats de classe à la fin des années 1960, est bien une manifestation, au delà des particularités de ce bloc et de l'URSS, de l'entrée dans la phase ultime de la décadence capitaliste, celle de la décomposition.
3) S'il est un domaine où s'est immédiatement confirmée la tendance au chaos croissant, dont l'éclatement du bloc de l'Est constituait la première grande manifestation sur la scène mondiale, c'est bien celui des antagonismes impérialistes. La fin du bloc russe était présentée par la bourgeoisie d'Occident comme l'aube d'un "nouvel ordre mondial" censé promouvoir la paix et la prospérité. En moins d'un an, la guerre du Golfe est venue apporter un démenti cinglant à ce mensonge. Elle a mis en évidence la réalité d'un phénomène qui, comme le CCI l'avait relevé immédiatement, découlait nécessairement de la disparition du bloc de l'Est : la désagrégation de son rival impérialiste, le bloc de l’Ouest. Ce phénomène était déjà à l'origine du "hold-up" irakien contre le Koweït en août 1990 : c'est bien parce que le monde avait cessé d'être partagé en deux constellations impérialistes qu'un pays comme l'Irak avait cru possible de faire main basse sur un ex-allié du même bloc. Ce même phénomène a révélé de façon évidente, courant octobre 1990, toute son ampleur avec les diverses tentatives des pays européens (notamment la France et l'Allemagne) et du Japon de torpiller, à travers des négociations séparées menées au nom de la libération des otages, la politique américaine dans le Golfe. Cette politique visait à faire de la punition de l'Irak un "exemple" censé décourager toute tentation future d'imiter le comportement de ce pays (et c'est bien en vue de cet "exemple" que les Etats-Unis avaient tout fait, avant le 2 août, pour provoquer et favoriser l'aventure irakienne). Elle s'applique aux pays de la périphérie où le niveau des convulsions constitue un acteur puissant d'impulsion de ce genre d'aventures. Mais elle est loin de se limiter à cet objectif. En réalité, son but fondamental est beaucoup plus général : face à un monde de plus en plus gagné par le chaos et le "chacun pour soi", il s'agit d'imposer un minimum d'ordre et de discipline, et en premier lieu aux pays les plus importants de l’ex-bloc occidental. C'est bien pour cette raison que ces pays (à l'exception de la Grande-Bretagne gui a choisi depuis longtemps une alliance indéfectible avec l'Oncle Sam) ont fait plus que traîner les pieds pour s'aligner sur la position des Etats-Unis et s’associer à leur effort de guerre. S'ils avaient besoin de la puissance américaine comme gendarme du monde, ils redoutaient qu'un étalage trop important de celle-ci, inévitable lors d'une intervention armée directe, ne porte ombrage à leur propre puissance. Et c'est bien ce que les opérations militaires du début de l'année ont clairement mis en évidence : il n'existe aujourd'hui qu'une seule superpuissance ; aucun autre pays ne peut songer à rivaliser militairement avec les Etats-Unis.
4) En fait, il s'agit là de la clé essentielle de la guerre du Golfe et de l'ensemble de la perspective mondiale. Dans un monde où l'impasse économique totale et de plus en plus évidente du mode de production capitaliste ne peut qu'attiser de façon croissante les antagonismes guerriers entre nations, la disparition des deux blocs issus de la seconde guerre mondiale a mis à l'ordre du jour la tendance à la reconstitution de deux nouveaux blocs militaires, c'est-à-dire de la structure classique que se donnent les principaux Etats, dans la période de décadence, pour "organiser" leurs affrontements armés. Avant même la guerre du Golfe, il était clair qu'aucun des deux seuls prétendants possibles à la direction d'un éventuel nouveau bloc rival de celui qui serait dirigé par les Etats-Unis, le Japon et surtout l'Allemagne, n'était pour le moment en mesure de tenir un tel rang du fait de son extrême faiblesse militaire. Mais compte tenu de la puissance économique et du dynamisme de ces pays, qui en font déjà des concurrents commerciaux redoutables pour les Etats-Unis, il importait pour cette puissance de prendre les devants face à toute évolution des rapports internationaux pouvant s'orienter vers une telle redisposition des forces impérialistes. C'est pour cela que la guerre du Golfe ne saurait être réduite à une "guerre pour le pétrole" ou à une guerre "Nord-Sud". Une telle vision (défendue notamment par les gauchistes qui l'ont utilisée pour justifier leur soutien à l'impérialisme irakien), ne fait qu'amoindrir son importance et sa signification. Au même titre que l'ensemble des manifestations de la décadence capitaliste (militarisme, capitalisme d'Etat, crise ouverte, etc.), les antagonismes fondamentaux qui déchirent le monde trouvent leur origine au coeur du capitalisme et opposent nécessairement les puissances qui tiennent le premier rôle sur la scène mondiale. De ce point de vue, la guerre du Golfe, imposée par les Etats-Unis à leurs alliés, a donné les résultats qu'ils en attendaient : elle a fait la preuve éclatante de l'immense décalage existant entre cette puissance et ses rivaux potentiels. Elle a notamment mis en relief l'incapacité totale des pays européens de mettre en avant une politique extérieure commune indépendante qui aurait pu représenter la prémisse politique de la constitution, à terme, d'un "bloc européen" dirigé par l'Allemagne.
5) Cependant, cette réussite immédiate de la politique américaine ne saurait constituer un facteur de stabilisation durable de la situation mondiale dans la mesure où elle ne pouvait affecter les causes mêmes du chaos dans lequel s'enfonce la société. Si les autres puissances ont du remiser pour un temps leurs ambitions, leurs antagonismes de fond avec les Etats-Unis n'ont pas disparu pour autant : c'est bien ce qui se manifeste avec l'hostilité larvée que témoignent des pays comme la France et l'Allemagne vis-à-vis des projets américains de réutilisation des structures de 'OTAN dans le cadre d'une "force de réaction rapide" dont le commandement reviendrait, comme par hasard, au seul allié fiable des Etats-Unis : la Grande-Bretagne. En outre, au Moyen-Orient même, les conséquences de la guerre du Golfe (chaos dans le Koweït "libéré", révoltes des chiites et des kurdes) ont mis en relief que les moyens employés par les Etats-Unis pour imposer leur "nouvel ordre mondial" constituaient des facteurs d'aggravation du désordre. En ce sens, il n'existe pour le capitalisme aucune perspective de modération, encore moins d'élimination, des affrontements militaires. Bien au contraire, le chaos général qui caractérise la phase ultime de la décadence capitaliste, celle de la décomposition, ne pourra être marquée que par un déchaînement de ce qui constitue la caractéristique dominante de la période de décadence : les conflits impérialistes et le militarisme. Un déchaînement où, contrairement au passé, et c'est là un indice majeur du pas qualitatif franchi par le capitalisme en putréfaction, ce ne seront plus les puissances les plus mal loties dans le partage impérialiste qui joueront le rôle de "boutefeu", mais bien la puissance qui conserve la position dominante, les Etats-Unis, et dont la préservation de cette position la conduira nécessairement à garder ou à prendre de façon croissante l'initiative des affrontements militaires puisque c'est le terrain par excellence où elle peut affirmer sa supériorité. Dans cette situation, et même si les conditions n'étaient plus jamais réunies pour l'établissement d'une nouvelle division du monde en deux blocs impérialistes, c'est-à-dire la prémisse indispensable pour que les affrontements militaires puissent déboucher sur une troisième guerre mondiale, ces affrontements, qui ne pourront que s'amplifier, risquent de provoquer des ravages considérables, y compris, en se combinant avec d'autres calamités propres à la décomposition (pollution, famines, épidémies, etc.), la destruction de l'humanité.
6) La fin de la "guerre froide" et la disparition des blocs n'a donc fait qu'exacerber le déchaînement des antagonismes impérialistes propres à la décadence capitaliste et qu'aggraver de façon qualitativement nouvelle le chaos sanglant dans lequel s'enfonce toute la société. Mais, en même temps qu'il faut souligner l'extrême gravité de la situation présente à l'échelle du monde entier et non seulement de telle ou telle de ses parties, il importe de mettre en évidence que cette gravité n'affecte pas celles-ci de façon immédiatement identique. Il en est ainsi, en premier lieu, du phénomène qui se trouve à l'origine de la nouvelle configuration de la situation mondiale : la fin du bloc de l'Est et celle du bloc de l'Ouest. Ce ne sont pas là deux phénomènes identiques : en particulier, il n'y a pas eu des processus parallèles d'affaiblissement de chacun des deux blocs impérialistes aboutissant à leur disparition simultanée. L'un des blocs s'est effondré brutalement sous la pression de la faillite économique totale de sa puissance dominante alors que le leader de l'autre bloc conservait encore l'essentiel de ses capacités. C'est la disparition du premier qui a provoqué celle du second, non pas à la suite d un effondrement interne, mais tout simplement parce qu'il avait perdu sa raison essentielle d'existence. Cette différence permet de comprendre pleinement les caractéristiques présentes des conflits impérialistes : au même titre que le Japon et l'Allemagne au lendemain de la seconde guerre mondiale, l'URSS ne peut plus jouer un rôle de premier plan dans l'arène impérialiste mondiale. Désormais, c'est entre les "vainqueurs" de la "guerre froide" que vont se jouer fondamentalement ces antagonismes et c'est pour cela qu'il revient à la puissance dominante du camp victorieux de jouer, pour son compte propre mais aussi pour le compte de l'ensemble du capitalisme, le rôle de "gendarme du monde".
7) D'autre part, cette différence dans les processus de disparition des deux blocs est à l'image de l'évolution de la situation interne dans chacune des composantes de l'un et l'autre : alors que, globalement, les Etats de l’ex-bloc de l'Ouest sont encore capables de contrôler la situation politique et même économique à l'intérieur de leurs frontières, il en est tout autrement des Etats de l'ex-bloc de l'Est ou à régime stalinien. Dès à présent, ces pays nous présentent une caricature de ce que la phase de décomposition porte avec elle ; outre le chaos économique on y voit se développer à une vitesse foudroyante les plaies du capitalisme pourrissant : chômage massif provoquant la lumpénisation de secteurs importants de la classe ouvrière, explosion de la drogue, de la criminalité, de la corruption. Le chaos économique et politique qui se répand dans les pays de l'Est européen frappe en premier lieu celui qui se trouvait à leur tête il y a moins de deux ans, l'URSS. En fait, ce pays a pratiquement cessé d'exister en tant que tel puisque les organes du pouvoir central se révèlent de plus en plus incapables d'exercer leur contrôle sur des parties croissantes du territoire. La seule perspective qui puisse exister pour ce qui fut la deuxième puissance mondiale est celle d'une dislocation sans retour. Une dislocation que la réaction des forces "conservatrices", et particulièrement des organes de sécurité, telle qu'on ra vue dans les pays baltes et en Transcaucasie, ne pourra que retarder quelque peu tout en déchaînant à terme un chaos encore plus considérable en même temps que des bains de sang.
Pour ce qui concerne les ex-démocraties populaires, leur situation, tout en n'atteignant pas le degré de gravité de celle de l'URSS, ne peut que plonger vers un chaos croissant comme le révèlent dès a présent les chiffres catastrophiques de la production (chutant jusqu'à 40 % pour certains pays) et l'instabilité politique qui s'est manifestée ces derniers mois dans pratiquement tous les pays de la région (Bulgarie, Roumanie, Albanie) et particulièrement en Yougoslavie qui est au bord de l'éclatement.
8) La crise du capitalisme, qui se trouve, en dernière instance, à l'origine de toutes les convulsions que subit le monde à l'heure actuelle, est elle-même aggravée par ces convulsions :
- la guerre au Moyen-Orient, l'accroissement des dépenses militaires qui en résulte, les crédits nécessaires à la reconstruction d'une partie des destructions (pour l'essentiel, un pays comme l'Irak ne pourra jamais surmonter les dommages considérables subis durant la guerre), ne peuvent qu'affecter de façon négative la situation économique du monde (contrairement à ce qui fut le cas, par exemple, pour la guerre du Vietnam qui permit, au début des années 1960, de repousser l'entrée en récession de l'économie américaine et mondiale), dans la mesure où l'économie de guerre et l'endettement généralisé constituent, depuis longtemps déjà, des facteurs de premier ordre d’aggravation de la crise ;
- la dislocation du bloc de l'Ouest ne peut que porter un coup mortel à la coordination des politiques économiques à l'échelle du bloc qui, par le passé, avait permis de ralentir le rythme d’effondrement de l'économie capitaliste ; la perspective est à une guerre commerciale sans merci dans laquelle tous les pays laisseront des plumes ;
- les convulsions dans la zone de l'ancien bloc de l'Est vont également constituer un facteur croissant d'aggravation de la crise mondiale en participant à l'amplification du chaos général, et en particulier, en contraignant les pays occidentaux à consacrer des crédits importants a la limitation de ce chaos (par exemple avec l'envoi d'une "aide humanitaire" destinée à ralentir les émigrations massives vers l'Occident).
9) Ceci dit, il importe que les révolutionnaires mettent bien en évidence ce qui constitue le facteur ultime de l'aggravation de la crise :
- la surproduction généralisée propre à un mode de production qui ne peut créer des débouchés en mesure d'absorber la totalité des marchandises produites, et dont la nouvelle récession ouverte, qui frappe actuellement la plupart des pays avancés, à la suite de la première puissance mondiale, constitue une illustration flagrante ;
- la fuite effrénée dans l'endettement extérieur et intérieur, public et privé, de cette même puissance tout au long des années 1980, qui, si elle a permis de relancer momentanément la production d'un certain nombre de pays, a fait des Etats-Unis de très loin le premier débiteur mondial ;
- l'impossibilité de poursuivre éternellement cette fuite en avant, d'acheter sans payer, de vendre contre des promesses dont il est de plus en plus évident qu'elles ne seront jamais tenues, fuite en avant qui n'a fait que rendre les contradictions encore plus explosives, notamment par une fragilisation croissante du système financier international.
La mise en évidence de cette réalité est d'autant plus importante qu'elle constitue un facteur de premier ordre dans la prise de conscience du prolétariat contre les campagnes idéologiques qui se sont déchaînées ces derniers mois, qu'elles aient prétendu "démontrer" que seul le capitalisme "libéral" peut offrir la prospérité aux populations ou que les causes des difficultés économiques sont à imputer aux ambitions du "dictateur mégalomane et sanguinaire" Saddam Hussein. Il est donc indispensable que les révolutionnaires soulignent clairement que la récession actuelle, pas plus que celles de 1974-1975 et de 1980-1982, ne résulte des convulsions politiques et guerrières du Moyen-Orient, mais qu'elle avait débuté dès avant la crise du Golfe et qu'elle révèle les contradictions fondamentales du mode de production capitaliste.
10) Plus généralement, il importe que les révolutionnaires fassent ressortir, de la réalité présente, les éléments les plus aptes à favoriser la prise de conscience du prolétariat.
Aujourd'hui, cette prise de conscience continue à être entravée par les séquelles de l'effondrement du stalinisme et du bloc de l'Est. Le discrédit qu'a subi il y a un an et demi, sous l'effet notamment d'une campagne gigantesque de mensonges, l'idée même de socialisme et de révolution prolétarienne est encore loin d'avoir été surmonté. En outre, l'arrivée massive qui s'annonce d'immigrants originaires d'une Europe de l'Est en plein chaos, ne pourra que créer un surcroît de désarroi dans la classe ouvrière des deux côtés de feu le "rideau de fer" : parmi les ouvriers qui s'imagineront pouvoir échapper à une misère insupportable en s'exilant vers l’"Eldorado" occidental et parmi ceux qui auront le sentiment que cette immigration risque de les priver des maigres "acquis" oui leur restent et qui seront, de ce fait, plus vulnérables aux mystifications nationalistes. Et un tel danger sera particulièrement redoutable dans les pays, tel l'Allemagne, qui se retrouveront en première ligne face aux flux d'immigrants.
Cependant, la mise en évidence croissante tant de la faillite irréversible du mode de production capitaliste, y compris et surtout sous sa forme "libérale", que de la nature irrémédiablement guerrière de ce système, vont constituer pour les secteurs centraux du prolétariat un facteur puissant d'usure des illusions issues des événements de la fin 1989. En particulier, la promesse d'un "ordre mondial de paix", telle qu'elle nous a été faite avec la disparition du bloc russe, a subi en moins d'un an un coup décisif.
11) En fait, la barbarie guerrière dans laquelle se vautre de plus en plus le capitalisme en décomposition va imprimer sa marque de façon croissante dans le processus de développement dans la classe de la conscience des enjeux et des perspectives de son combat. La guerre ne constitue pas en soi et automatiquement un facteur de clarification de la conscience du prolétariat. Ainsi, la seconde guerre mondiale a débouché sur un renforcement de l'emprise idéologique de la contre-révolution. De même, la crise et la guerre du Golf, si elles ont eu le mérite de démentir es discours sur "la paix éternelle", ont aussi engendré dans un premier temps un sentiment d'impuissance et une paralysie indiscutable dans les grandes masses ouvrières des pays avancés. Mais les conditions actuelles de développement du combat de la classe ouvrière ne permettront pas que se maintienne de façon durable un tel désarroi :
-parce que le prolétariat d'aujourd'hui, contrairement à celui des années 1930 et 1940, s'est dégagé de la contre-révolution, qu'il n'est pas embrigadé, tout au moins ses secteurs décisifs, derrière les drapeaux bourgeois (nationalisme, défense de la "patrie socialiste , de la démocratie contre le fascisme) ;
- parce que la classe ouvrière des pays centraux n'est pas directement mobilisée dans la guerre, soumise au bâillon que représente l'enrôlement sous l'autorité militaire, ce qui lui laisse beaucoup plus de latitude pour développer une réflexion de fond sur la signification de la barbarie guerrière dont elle supporte les effets par un surcroît d'austérité et de misère ;
- parce que l'aggravation considérable, et de plus en plus évidente, de la crise du capitalisme, dont les ouvriers seront évidemment les principales victimes et contre laquelle ils seront contraints de développer leur combativité de classe, développera les conditions leur permettant de façon croissante de faire le lien entre la crise capitaliste et la guerre, entre le combat contre celle-ci et les luttes de résistance aux attaques économiques, renforçant leur capacité de se garantir contre les pièges du pacifisme et des idéologies aclassistes.
12) En réalité, si le désarroi provoqué par les événements du Golfe peut ressembler, en surface, à celui résultant de l'effondrement du bloc de l'Est, il obéit à une dynamique différente : alors que ce qui vient de l'Est (élimination des restes du stalinisme, affrontements nationalistes, immigration, etc.) ne peut, et pour un bon moment encore, qu'avoir un impact essentiellement négatif sur la conscience du prolétariat, la présence de plus en plus permanente de la guerre dans la vie de la société va tendre, au contraire, à réveiller cette conscience. De même, si l'effondrement du stalinisme n'a eu qu'un impact limité sur la combativité de la classe ouvrière, comme on pouvait déjà le constater au printemps 1990 par une tendance à la reprise des luttes, la crise et la guerre du Golfe, par le sentiment d'impuissance qu'elles ont suscité parmi les ouvriers des principaux pays avancés (qui étaient pratiquement tous impliqués dans la "coalition") ont d'ores et déjà provoqué un recul important de la combativité, de plus longue durée que celui de l'hiver 1989-90. Cependant, cette pause dans la combativité ouvrière, loin de constituer en soi un obstacle sur le chemin du développement historique des combats de classe, se présente surtout comme un moment de décantation, de réflexion en profondeur de l'ensemble du prolétariat. C'est bien pour cette raison que les appareils de gauche de la bourgeoisie ont tenté déjà depuis plusieurs mois de lancer des mouvements de lutte prématurés afin d'entraver cette réflexion et de semer un surcroît de confusion dans les rangs ouvriers.
13) Si, malgré un désarroi temporaire, le prolétariat mondial détient donc toujours entre ses mains les clés du futur, il importe de souligner que tous ses secteurs ne se trouvent pas au même niveau dans la capacité d'ouvrir une perspective pour l'humanité. En particulier, la situation économique et politique qui se développe dans les pays de l'ex-bloc de l'Est témoigne de l'extrême faiblesse politique de la classe ouvrière dans cette partie du monde. Ecrasé par la forme la plus brutale et pernicieuse de la contre-révolution, le stalinisme, ballotté par les illusions démocratiques et syndicalistes, déchiré par les affrontements nationalistes et entre cliques bourgeoises, le prolétariat de Russie, d'Ukraine, des pays baltes, de Pologne, de Hongrie, etc., se trouve confronté aux pires difficultés pour développer sa conscience de classe. Les luttes que les ouvriers de ces pays seront contraints de mener, face à des attaques économiques sans précédent, se heurteront, quand elles ne seront pas directement dévoyées sur un terrain bourgeois tel que le nationalisme (comme ce fut en partie le cas lors de la grève des mineurs en URSS au printemps dernier), à toute la décomposition sociale et politique qui est en train de s'y développer, étouffant de ce fait leur capacité à constituer un terreau pour la germination de la conscience. Et il en sera ainsi tant que le prolétariat des grandes métropoles capitalistes, et particulièrement celles d'Europe occidentale, ne sera pas en mesure de mettre en avant, même de façon embryonnaire, une perspective générale de combat.
14) En réalité, les difficultés considérables affrontées aujourd'hui par les ouvriers des pays de l'Est du fait, notamment, de la décomposition sociale qui se déchaîne dans cette partie du monde, constituent un révélateur de l'impact que la décomposition du capitalisme exerce sur le développement de la lutte et de la conscience du prolétariat mondial. Par la confusion et les illusions aclassistes qu'un certain nombre d'aspects de la décomposition (tels les désastres écologiques, les catastrophes "naturelles", la montée de la criminalité, etc.) provoquent en son sein, par l'attaque contre sa confiance et soi et en son avenir que représente l'atmosphère de désespoir qui envahit la société, par l'obstacle à la solidarité et à l'unification des combats que constitue l'idéologie du "chacun pour soi" aujourd'hui omniprésente, la décomposition croissante de la société, le pourrissement sur pieds du capitalisme, s'inscrivent fondamentalement comme une difficulté supplémentaire que doit affronter le prolétariat sur le chemin de son émancipation. Mais le fait même :
- que les formes les plus extrêmes et brutales de la décomposition affectent moins le prolétariat des pays centraux du capitalisme, celui qui sera au coeur de l'affrontement décisif avec la bourgeoisie, que les autres secteurs du prolétariat mondial ;
- que ce même prolétariat ait réussi dans la plus grande partie des années 1980 à développer ses luttes et sa conscience alors que la décomposition faisait déjà sentir ses effets, ces deux éléments illustrent le fait que la classe ouvrière détient toujours entre ses mains les clés de l'avenir. Et c'est particulièrement vrai dans la mesure où les deux manifestations majeures de la vie du capitalisme auxquelles elle sera confrontée, la crise économique du mode de production capitaliste et la guerre impérialiste (qui ne sont pas des manifestations typiques de la phase de décomposition, mais appartiennent à la décadence capitaliste), la contraindront à développer ses luttes sur son terrain de classe, à prendre conscience de la faillite de ce système et de la nécessité de le renverser.
15) La nouvelle étape du processus de maturation de la conscience dans le prolétariat, dont la situation actuelle du capitalisme détermine les prémisses, n'en est, pour le moment, qu'à ses débuts. En particulier, c'est un chemin important que doit parcourir la classe pour se dégager des séquelles du choc provoqué par 'implosion du stalinisme et l'utilisation qu'en a faite la bourgeoisie. De même, ce n'est pas de façon immédiate que l'ensemble du prolétariat sera en mesure de dégager de la barbarie guerrière croissante la perspective historique de ses luttes.
Dans ce processus, les révolutionnaires auront une responsabilité croissante :
- dans la mise en garde contre l'ensemble des dangers que représente la décomposition, et particulièrement, il va de soi, le déchaînement de la barbarie guerrière qu'elle porte en elle ;
- dans la dénonciation de toutes les manoeuvres bourgeoises, dont un des aspects essentiels sera de dissimuler, ou de dénaturer, le lien fondamental entre la lutte contre les attaques économiques et le combat plus général contre une guerre impérialiste de plus en plus présente dans la vie de la société ;
- dans la lutte contre les campagnes visant à saper la confiance du prolétariat en lui-même et en son devenir ;
- dans la mise en avant, contre toutes les mystifications pacifistes ou interclassistes et, plus généralement, contre l'ensemble de l'idéologie bourgeoise, de la seule perspective qui puisse s'opposer à l'aggravation de la guerre : le développement et la généralisation du combat de classe contre le capitalisme comme un tout en vue de son renversement et de son remplacement par la société communiste.
CCI, juillet 1991
Vie du CCI:
- Résolutions de Congrès [131]
Conscience et organisation:
Heritage de la Gauche Communiste:
Rapport sur la situation internationale (extraits)
- 2975 reads
La décomposition de la société capitaliste
(...) Le troisième point qu'il faut faire ressortir (voir dans la résolution la présentation des deux premier) est la durée du phénomène de la décomposition. Celui-ci a été identifié pour la première fois par le CCI lors des attentats terroristes de Paris, à l'automne 1986. Cela ne veut pas dire, évidemment, qu'il n'ait commencé à se manifester qu'à ce moment-la. En réalité, c'est tout au long des années 1980 que ce phénomène connaît son essor.
Ainsi, le CCI avait déjà implicitement pointé un tel phénomène dans la résolution sur la situation internationale adoptée lors de son 6e congrès, en novembre 1985 (et qui reprenait l'analyse d'un document interne d'octobre 198$). Dans ce document, il était mis en évidence l'aggravation considérable des convulsions politiques des pays de la périphérie qui interdisait de façon croissante aux grandes puissances de s'appuyer sur eux dans les guerres contre le bloc adverse ou dans le "maintien de l'ordre" régional et les contraignait à intervenir de plus en plus directement dans les affrontements militaires. Un tel constat se basait notamment sur la situation au Liban et surtout en Iran. Dans ce dernier pays, en particulier, on relevait déjà une relative nouveauté par rapport aux situations qu'on pouvait rencontrer dans le passé : un pays d'un bloc, et important dans son dispositif militaire, échappait pour l'essentiel à son contrôle sans pour autant tomber, ou même avoir la possibilité de tomber, sous la tutelle de l'autre. Cela n'était pas dû à un affaiblissement du bloc dans son ensemble, ni à une option permettant une amélioration de la position du capital national de ce pays, bien au contraire, puisqu'une telle politique devait conduire à une catastrophe politique et économique. En fait, l'évolution de la situation en Iran ne correspondait à aucune rationalité, même illusoire, du point de vue des intérêts du capital national, la meilleure illustration en étant l'accession au pouvoir d'une couche de la société, le clergé, qui n'a jamais eu de compétence pour gérer les affaires économiques et politiques du capitalisme.
Ce phénomène de la montée de l'intégrisme musulman, et de la victoire politique de celui-ci dans un pays relativement important, était lui-même une des premières manifestations de la phase de décomposition. Cette percée de la religion dans un certain nombre de pays du tiers-monde ne pouvait et ne peut être considérée comme un retour en arrière à Page d'or de l'influence dominante de la religion dans la vie sociale. La roue de l'histoire ne saurait tourner à l'envers. Les pays du tiers-monde, de même qu'un certain nombre de pays de l'ancien bloc de l'Est particulièrement infestés par la religion, ne reviennent pas au féodalisme ; le capital a, depuis longtemps déjà, soumis ces contrées a ses lois non pas, évidemment, par un développement significatif des forces productives sur des bases capitalistes, mais par la destruction irréversible de leur économie "naturelle". Dans ces pays, la poussée de l'intégrisme religieux constitue une manifestation de la décomposition des superstructures idéologiques de la société capitaliste qu'il faut ranger sur le même plan que la montée, dans les pays avancés, du mysticisme et de la drogue.
On peut donc constater que l'entrée du capitalisme décadent dans sa phase de décomposition révèle ses premières manifestations dès la fin des années 70 et prend sa pleine dimension tout au long des années 80 (en ce sens, ces années ont bien été pour le capitalisme, et aussi pour la classe ouvrière, des années de vérité au cours desquelles l'un et l'autre ont commencé à se trouver confrontés à la phase ultime du mode de production capitaliste). C’est un élément important dans la mesure où sa prise en compte conditionne une pleine compréhension, tant du point de vue de leurs causes que de leurs perspectives, des bouleversements qui ont secoué le monde ces deux dernières années. Il conditionne également, comme nous le verrons plus loin, une claire compréhension de la dynamique de la lutte et de la prise de conscience de la classe depuis le début des années 1980.
L'effondrement du bloc de l'est
(...) La tendance historique au capitalisme d'Etat, dont la mise en évidence est la condition élémentaire à la compréhension du stalinisme, connaît ses premières manifestations marquantes non pas dans des secteurs arriérés du capitalisme mais au contraire dans ses secteurs les plus avancés. L'Allemagne de la première guerre mondiale en constituait, pour les révolutionnaires de cette époque (particulièrement pour Lénine), l'exemple typique. Classiquement, la prise en main par l'Etat de l'ensemble de l'économie s'est présentée comme un processus organique du capital national, affectant en premier lieu les secteurs les plus développés de celui-ci et de la bourgeoisie, notamment par une imbrication croissante entre cette dernière et l’appareil d'Etat. Ce caractère organique et généralement progressif (même si dans certains cas, tel le fascisme, il a pu s'accompagner de règlements de comptes violents au sein de l'appareil politique bourgeois) du développement du contrôle de la société civile, et particulièrement de l'économie, par l'Etat, a permis de garantir, dans les pays avancés, la pérennité des mécanismes classiques de l'économie capitaliste, et particulièrement la sanction du marché comme stimulant de la compétitivité des entreprises, d'une exploitation "rationnelle" de la force de travail. Il a eu également pour mérite de maintenir en place l'essentiel du personnel économique de la classe dominante permettant au capital national de bénéficier de toute l'expérience de ce personnel.
Tout autre est le processus de développement de la forme stalinienne du capitalisme d'Etat. Ce développement n'a rien d'"organique". Il se présente au contraire comme une sorte "d'accident" de l'histoire résultant de la révolution et de la contre-révolution en Russie. Dans la mesure où c'est l'Etat surgi après la révolution qui assume la contre-révolution, c'est à lui qu'il revient de prendre en charge, de façon exclusive, la gestion du capital national abolissant de ce fait les mécanismes du marché intérieur et se privant (pour l'essentiel) des compétences des anciens spécialistes de l'exploitation capitaliste. Les critères d'appartenance à la classe exploiteuse, chargée de diriger la valorisation du capital, ne sont plus d'ordre économique comme dans le capitalisme classique (ce qui permet de sélectionner et de former un personnel compétent pour cette tâche de valorisation) mais d'ordre politique. C'est la place dans la hiérarchie du Parti-Etat, le grade dans la "nomenklatura", qui déterminent fondamentalement l'accession aux responsabilités économiques importantes. La servilité, a ruse, l'absence de scrupules qui constituent les talents essentiels pour l'ascension dans l'appareil du parti ne sont pas nécessairement les plus utiles pour une bonne gestion du capital national, d'autant plus qu'il n'y a pas de sanction du marché pour opérer une sélection et provoquer l'émulation au sein des "responsables" de l'économie. Sur ces bases, l'ensemble du personnel chargé de gérer le capital national est tout sauf motivé par la valorisation de celui-ci, désimplication et cynisme oui se répercutent à tous les niveaux de l'appareil productif, et particulièrement chez les ouvriers. Un tel mode de "gestion" du capital, où le "stimulant" principal de la force de travail exploitée est la contrainte policière, peut convenir à une économie relativement arriérée protégée par l'autarcie mais ne saurait faire face aux exigences du marché mondial. C'est principalement à ce caractère "accidentel" de sa constitution que le capitalisme d'Etat de modèle stalinien doit son extrême fragilité face à la crise économique ainsi que son effondrement brutal.
Les causes de la faiblesse du bloc de l'Est sont du même ordre. Traditionnellement, les blocs impérialistes se sont constitués de façon progressive, avec une véritable volonté des bourgeoisies des principaux pays les composant de s'associer, ou tout au moins de se rallier à la puissance dominante, laquelle tirait sa prééminence en premier lieu de son potentiel économique. Il n'en a rien été pour ce qui concerne la constitution du bloc russe. Celui-ci se présente aussi comme une sorte d'accident de l'histoire. En effet, le pays qui se retrouve à sa tête est un pays arriéré sur tous les plans, faiblement industrialisé, moins développé que beaucoup de ses vassaux et donc nullement qualifie pour tenir ce rang. Il ne doit un tel privilège qu'aux circonstances spécifiques dans lesquelles se termine la seconde guerre mondiale (...). C’est donc contrainte et forcée par la puissance militaire que la bourgeoisie de ces derniers se "rallie" à l'URSS au lendemain de la seconde guerre mondiale. Et c'est encore, pour l'essentiel, avec cette même puissance militaire que l'URSS maintient son emprise sur ses "alliés" (Hongrie 1956, Tchécoslovaquie 1968) alors même que ceux-ci sont dirigés par des partis staliniens. Un tel mode de maintien de la cohésion du bloc exprime une extrême faiblesse de celle-ci. C'est bien cette faiblesse considérable qui s'est révélée en 89.
Il importe donc de souligner l'écart qui sépare le capital des pays centraux de celui des pays de l'ex-bloc de l'Est du point de vue de leur capacité de résistance face à la crise. En effet, même si le chaos qui est en train de s'instaurer dans ces derniers indique la tendance générale de l'évolution du capitalisme à l'échelle mondiale, il serait erroné de considérer qu'à une brève échéance les pays les plus avancés vont connaître une situation du même type. (...)
Ceci dit, il est clair que la mise en évidence de la faiblesse particulière du capitalisme d'Etat stalinien ainsi que de l'ancien bloc russe ne permet pas de tout expliquer. En particulier, elle ne permet pas de comprendre pourquoi c'est à la fin des années 1980, et non au début par exemple, que s'est produit leur effondrement. C'est ici que le cadre de la décomposition se révèle indispensable.
...) L'absence d'une perspective (exceptée celle de sauver les meubles" de son économie au jour le jour) vers laquelle elle puisse se mobiliser comme classe, et alors que le prolétariat ne constitue pas encore une menace pour sa survie, détermine au sein de la classe dominante, et particulièrement de son appareil politique, une tendance croissante à l'indiscipline et au "sauve qui peut". C'est ce phénomène qui permet en particulier d'expliquer l'effondrement du stalinisme et de l'ensemble au bloc impérialiste de l'Est. (...) La débandade générale au sein même de l'appareil étatique, la perte du contrôle sur sa propre stratégie politique, telles que l'URSS et ses satellites nous en donnent aujourd'hui le spectacle, constitue, en réalité, la caricature (du fait des spécificités des régimes staliniens) d'un phénomène beaucoup plus général affectant l'ensemble de la bourgeoisie mondiale, un phénomène propre à la phase de décomposition. ("La décomposition, phase ultime de la décadence du capitalisme", point 9, Revue Internationale n°62)
Ainsi l'effondrement du stalinisme est bien une des manifestations de la décomposition. En particulier, il traduit clairement cette donnée essentielle de celle- ci : l'absence totale de perspective pour la société capitaliste. De même, la situation actuelle de l'URSS elle-même (et d'une partie de l'Europe de l'Est) qui est en train de se disloquer sous le coup des mouvements nationalistes, constitue une autre illustration d'une des conséquences majeures de cette absence de perspective : la tendance à l'éclatement de la vie sociale, au "chacun pour soi". (...)
La nouvelle configuration des conflits impérialistes
Au même titre que pour l'examen de l'effondrement I du stalinisme et du bloc de l'Est, celui de l'évolution des conflits impérialistes doit prendre en compte ce qui relève du cadre général de la décadence et ce qui relève plus particulièrement de la phase de décomposition. C'est évidemment vrai pour la guerre du Golfe. (...)
Contrairement à la FECCI, par exemple, qui identifie impérialisme, blocs impérialistes et capitalisme d'État, nous avons mis en relief le fait que si l'impérialisme (de même que le capitalisme d'Etat) est une donnée permanente et universelle de la décadence, il n'en est pas de même des blocs impérialistes. C'est pour cela que nous avons pu annoncer que l'effondrement du bloc de l'Est portait avec lui la disparition du bloc occidental tout en prévoyant que la fin des blocs n'augurait nullement une période de paix, bien au contraire.
Ceci dit, il importe de souligner que, même s'il n'y a pas besoin de blocs pour que la guerre puisse se déchaîner, même si la formation de blocs impérialistes ne découle pas automatiquement de l'impérialisme,celui-ci exerce en permanence une i pression très forte vers cette formation. C'est pour cela que, en janvier 1990, nous écrivions : "La disparition des deux constellations impérialistes qui étaient sorties de la seconde guerre mondiale porte, avec elle, la tendance à la recomposition de deux nouveaux blocs. " ("Après l'effondrement du bloc de l'Est, déstabilisation et chaos", Revue Internationale n°61)
C'est un point important pour bien comprendre tous les enjeux de la guerre du Golfe. Si on ne le prend pas en compte, on passe à côté des véritables antagonismes qui sont en cause dans la période présente et qui se trouvaient en toile de fond de cette guerre.
En effet, un des objectifs essentiels de la démonstration de force des Etats-Unis était de prendre immédiatement les devants, de tirer un coup de semonce face à toute velléité de constitution d'un nouveau bloc impérialiste. Il est évident qu'aujourd'hui les conditions n'existent pas pour une telle constitution. (...) Cependant, (...) il importait dès à présent pour la première puissance mondiale -en réalité la seule super-puissance- de barrer le chemin d'une telle perspective afin de dissuader de s'y engager tous les pays qui auraient pu envisager une telle démarche. De façon plus concrète, un certain nombre de secteurs de la bourgeoisie ont pu miser, après l'effondrement du bloc de l'Est, sur un renforcement de la "Communauté européenne" et sur l'instauration d'une force armée de celle-ci, ce qui pourrait à terme constituer les bases d'un éventuel bloc dirigé par l'Allemagne. (...)
La guerre du Golfe a détruit tout espoir pour ceux qui pouvaient miser sur un éventuel futur bloc européen. S'il y a un résultat particulièrement clair de ce conflit, que tous les secteurs de la bourgeoisie ont souligné 'ailleurs, c'est bien la mise en évidence, outre de l'inexistence militaire du Japon et de l'Allemagne, de la totale inexistence politique (sans même parler du militaire) de l'Europe, puisqu'il est apparu pratiquement autant de positions face à la guerre qu'il y a d'Etats sur ce continent. (...) On peut donc affirmer que, au moins sur le plan de la liquidation de toute velléité de démarche vers la constitution d'un nouveau bloc, l'objectif des Etats-Unis a été atteint, pour le moment, au delà de toute espérance..
La compréhension de cette fonction de la guerre du Golfe comme barrière à la constitution d'un nouveau bloc impérialiste est essentielle face aux interprétations fausses qui ont pu se développer (...). [En particulier, il est nécessaire de réfuter la thèse, chère aux gauchistes, qu'il s'agit d'un conflit Nord-Sud, entre pays avancés et pays sous-développés.]
Un conflit entre les pays avancés et les pays arriérés ?
C'est vrai qu'il existe des intérêts communs entre les grandes puissances pour limiter au maximum l'extension du chaos existant dès à présent dans le tiers-monde. D'ailleurs, c'est également une des clés delà guerre du Golfe. La croisade pour "l'ordre mondial" et le respect du "droit international" a pu obtenir (difficilement) l'assentiment de tous les membres permanents du Conseil de Sécurité et le soutien financier de l'Allemagne et du Japon grâce au chantage exercé par les Etats-Unis sur leurs ex-alliés et sur leur ex-rival.
Mais sur quoi portait ce chantage ? En partie sur des aspects économiques et financiers (attitude dans les négociations sur les tarifs douaniers pour l'Europe et le Japon, montant de l'aide financière consentie à l'URSS). Mais ce n'est là que la partie visible de l'iceberg. En réalité, le marché tel qu'il a été mis en main par les Etats-Unis à ses "alliés", notamment lors de la tournée de Baker en novembre 1990 qui a permis d'obtenir le vote du Conseil de Sécurité en faveur de l'intervention militaire, consistait à reconnaître cette puissance comme gendarme du monde en échange de sa "protection" et de son "aide" en cas de difficultés résultant de l'instabilité mondiale. Pour que la démonstration soit bien probante, les Etats-Unis ont fait comme n'importe quel racketteur : on brise la vitrine du magasin (ici le piège tendu à l'Irak) pour convaincre le boutiquier de l'intérêt qu'il a d'acheter une "protection". Dans le monde chaotique qui sort de la fin de la "guerre froide", les occasions de "désordres" régionaux ne manquent pas : en Afrique, en Indochine, entre l'Inde et le Pakistan ainsi que, avec l'éclatement du bloc de l'Est et de son chef de file, en Asie centrale, en Europe centrale et dans les Balkans. En outre, la prolifération de l'arme nucléaire (qui, à l'heure actuelle, en plus des cinq "grands" membres permanents du Conseil de Sécurité, est déjà détenue par des pays comme Israël, l'Inde, le Pakistan, le Brésil, et qui demain sera à la portée de n'importe qui constitue un facteur supplémentaire de danger. Les grands pays avancés sont évidemment intéressés à limiter cette instabilité qui menace ce qu'il leur reste de zones d'influence et de marchés. C'est pour cela qu'ils ont fini par se ranger derrière la seule puissance qui ait réellement les moyens de faire la police à l'échelle planétaire, comme elle l'ajustement démontré avec la guerre du Golfe.
Mais "l'ordre mondial" tel qu'il est proposé par le grand gendarme est loin de convenir entièrement aux autres pays puisqu'il est conçu principalement à son avantage et au détriment de leurs intérêts impérialistes. Dans le chaos qui s'annonce, il appartenait à la bourgeoisie la plus puissante du monde de jouer pleinement son rôle parce que c'est celle qui a le plus à perdre dans ce chaos et qui seule dispose des moyens de tenter d'y faire barrage. Et c'est ce qu'elle a fait. Mais par la manière employée, par le caractère on ne peut plus spectaculaire et brutal de son action, elle a en même temps signifié qu'elle ne tolérerait pas plus de "désordres" (c’est-à-dire d'empiétements de ses propres intérêts) de la part des pays avancés que de la part de pays comme l'Irak. C'est pour cela que, contrairement à la plupart de ses "alliés" qui pouvaient miser sur une simple pression économique et politique, la bourgeoisie américaine n'avait d’autre option que la destruction de l'essentiel du potentiel économique et militaire du "fautif (option que ces autres pays ont tenté jusqu'au dernier moment de saboter) ([1] [329]). Avec la méthode classique des gangsters, le parrain a donc "flingué" un truand de seconde zone pour obtenir l'allégeance des autres "caïds". Et pour que la leçon soit bien comprise, que la démonstration ait toute la portée nécessaire, sans commune mesure avec ce qu avait pu représenter l'intervention au Panama, les Etats-Unis n'ont pas choisi n'importe quel "bouc émissaire". Il fallait que "l'ennemi à abattre" présente une certaine crédibilité, qu'il soit puissamment armé et justifie l'énorme déploiement militaire américain, un étalage bien impressionnant de toute la panoplie : satellites espions, Awacs, 6 porte-avions, énormes cuirassés crachant des obus de 1200 kg, missiles de croisière et "patriots", bombes de 7 tonnes, bombes "air-fuel combustible", char Abrams, etc., tout cela servi par près de 600 000 soldats. Il fallait en outre que cette intervention concerne une partie du monde ayant une réelle importance stratégique : avec l'opération "Tempête du désert", les Etats-Unis ont bien démontré aux pays d'Europe et au Japon, qui sont les plus tributaires du pétrole du Moyen-Orient, qu'il dépendait de leur bon vouloir que ces pays puissent continuer à disposer de cette matière première indispensable à l'économie et la force militaire.
En fait, la thèse d'une "Sainte-Alliance" des pays avancés contre l'instabilité et le chaos régnant dans le tiers-monde s'apparente à une théorie extrêmement dangereuse, et fermement combattue par le passé par les révolutionnaires, qui est celle du "super-impérialisme". Elle se base sur l'hypothèse que les grandes puissances pourraient surmonter, ou au moins contenir, leurs antagonismes impérialistes afin d'établir une espèce de "condominium" sur le monde. C'est une thèse qui est démentie par toute l'histoire de l'impérialisme et que la phase de décomposition ne saurait rendre valable. En réalité, depuis qu'existe le capitalisme et particulièrement depuis que ce système a établi sa domination sur l'ensemble du monde, l'ensemble des phénomènes majeurs de son mode de vie ne sont pas partis de sa périphérie pour ensuite gagner son centre mais ont pris au contraire leur essor dans les pays centraux. Il en est ainsi en particulier de l'ensemble des caractéristiques majeures de la décadence telles que l'impérialisme, le militarisme et le capitalisme d’Etat dont les premières manifestations majeures ont affecté d'abord essentiellement les pays avancés de la vieille Europe avant qu'ils ne s'étendent par la suite dans le reste du monde pour y prendre des ormes souvent caricaturales. Il en est de même pour la crise ouverte de l'économie capitaliste, notamment celle qui se développe à partir du milieu des années 60, même si ses effets les plus désastreux sont repoussés pour un temps vers les pays de la périphérie. En fait, comme toutes les sociétés de l'histoire, le capitalisme ne s'effondre pas à partir de sa périphérie mais à partir de son centre. Et la décomposition ne fait pas exception qui est un phénomène que nous avons identifié d'abord pour les pays avancés même si elle prend dans le tiers-monde ses formes les plus caricaturales.
Les conflits dans la phase de décomposition
Pour ce qui concerne les antagonismes impérialistes, manifestation typique de la décadence capitaliste et que la décomposition ne peut qu'exacerber, il ne sauraient échapper à la règle. C'est d'abord et fondamentalement à travers les pays centraux du capitalisme qu'ils sont appelés à se déchaîner, même s'ils trouveront dans l'instabilité et le chaos qui déferlent sur les pays de la périphérie un terrain particulièrement propice à leur expression notamment dans la mesure où ils ne peuvent encore s'opposer directement sur un plan militaire aux pays avancés du fait du non embrigadement du prolétariat. Donner crédit à la thèse du "conflit Nord-Sud", ou à une de ses variantes c'est finalement considérer que le capitalisme est capable de surmonter ses contradictions fondamentales. C'est tomber dans la vision réformiste. (....)
Ainsi, comme on l'a vu pour l'effondrement du bloc de l'Est, c'est bien d'abord dans le cadre des caractéristiques de la décadence qu'il convient de comprendre les conflits impérialistes d'aujourd'hui avant que de pouvoir examiner les particularités que la phase de décomposition y introduit. Ces particularités ne sont pas étrangères à la décadence ; c'est au contraire leur exacerbation et leur accumulation à une échelle toujours plus étendue qui introduit dans la vie du capitalisme d aujourd'hui une qualité nouvelle qui constitue justement la différence entre les phases précédentes de la décadence et la phase de décomposition.
La guerre du Golfe illustre bien cette réalité. Elle constitue en particulier une confirmation tout à fait probante du caractère parfaitement irrationnel de la guerre dans la période de décadence. (...)
Cette irrationalité économique de la guerre n'est pas une "découverte" récente du CCI. En particulier, elle était largement traitée dans la Revue Internationale n°52 et n°53 ("Guerre, militarisme et blocs impérialistes"). En fait, ce n'est même pas une découverte du CCI puisqu'il a plus de 45 ans la Gauche Communiste de France pouvait écrire : "La décadence de la société capitaliste trouve son expression éclatante dans le fait que des guerres en vue au développement économique (période ascendante), l'activité économique se restreint essentiellement en vue de la guerre (période décadente). Cela ne signifie pas que la guerre soit devenue le but de la production capitaliste, le but restant toujours pour le capitalisme la production de la plus-value, mais cela signifie que la guerre, prenant un caractère de permanence, est devenue le mode de vie du capitalisme décadent." (voir Revue Internationale n°59)
En ce sens, il importe de rejeter toute conception tendant à chercher pour la guerre du Golfe clés causes directement économiques, telles le pétrole ou l'ouverture de nouveaux marchés pour les "vainqueurs", etc. Nous avons déjà vu combien était insuffisant l'argument du pétrole : s'il peut effectivement constituer un élément du chantage des Etats-Unis sur leurs "alliés", la fixation de son prix ou les revenus qu'il représente pour le capital américain ne sauraient motiver une opération militaire d'une telle envergure et d'un tel coût. De même, si évidemment les sociétés américaines se sont taillées la part du lion dans les contrats pour la reconstruction du Koweït, il serait absurde de voir dans la guerre récente un moyen de relancer l'économie des Etats-Unis ou du reste du monde. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : les bénéfices que ce pays pourra rapatrier avec ces contrats sont bien en deçà du coût de la guerre, même en comptant les chèques japonais et allemands. Quant à la "relance" économique de l'économie mondiale, il est clair qu'elle n'est pas à l'ordre du jour (...). Comme nous l'avons souligné en de multiples reprises, la guerre et le militarisme ne sont nullement des contrepoisons à la crise capitaliste, mais au contraire des facteurs de premier plan d'aggravation de celle-ci.
En outre, il serait incorrect de présenter l'accentuation des antagonismes impérialistes, dont la guerre du Golfe a constitué, jusqu'à présent, la manifestation la plus évidente, comme le résultat de l'aggravation immédiate de la situation économique, et particulièrement de la récession ouverte qui se développe à l'heure actuelle. S'il est clair que la guerre impérialiste découle, en dernière instance, de l'exacerbation des rivalités économiques entre nations résultant, elles-mêmes, de l'aggravation de la crise du mode de production capitaliste, il ne faut pas établir un lien mécanique entre ces différentes manifestations de la vie du capitalisme décadent ([2] [330]). En fait, la cause majeure expliquant pourquoi cette guerre s'est déchaînée en 1990-91 est évidemment à rechercher dans la situation créée par l'effondrement du bloc de l'Est. De même dans le futur, le facteur qui va accentuer encore les antagonismes impérialistes ne sera pas constitué par chacune des étapes successives marquant l'évolution de la crise mais bien par le caractère de plus en plus absolu de l'impasse historique dans laquelle se trouve le mode de production capitaliste.
Si la guerre du Golfe constitue une illustration de l'irrationalité d'ensemble du capitalisme décadent, elle comporte cependant un élément supplémentaire et significatif d'irrationalité qui témoigne de l'entrée de ce système dans la phase de décomposition. En effet, les autres guerres de la décadence pouvaient, malgré leur irrationalité de fond, se donner malgré tout des buts apparemment "raisonnables" (comme la recherche d'un "espace vital" pour l'économie allemande ou la défense des positions impérialistes des alliés lors de la seconde guerre mondiale). Il n'en est rien pour ce qui concerne la guerre du Golfe. Les objectifs que s'est donnée celle-ci, tant d'un côté comme de l'autre, expriment bien l'impasse totale et désespérée dans laquelle se trouve le capitalisme :
- Du côté irakien, l'invasion du Koweït avait incontestablement un objectif économique bien clair : faire main basse sur les richesses considérables de ce pays en espérant que les grandes puissances, comme elle Pavaient fait en de multiples autres reprises, fermeraient les yeux sur un tel "hold-up". En revanche, les objectifs de la guerre avec les "coalisés", telle qu'elle a été acceptée par les dirigeants irakiens à partir du moment ou ils sont restés sourds à l'ultimatum du 15 janvier 1991, n'avait d'autre but que de "sauver la face" et d'infliger le maximum de pertes à ces ennemis et cela au prix de ravages considérables et insurmontables de l'économie nationale.
- Du côté "allié", les avantages économiques obtenus, ou même visés, sont nuls y compris pour le principal vainqueur, les Etats-Unis. L'objectif central de la guerre, pour cette puissance, donner un coup d'arrêt a la tendance au chaos généralisé, même s'il s'habille de grandes phrases sur le "nouvel ordre mondial", ne contient aucune perspective réelle sur le plan de l'amélioration de la situation économique, ni même de la préservation de la situation présente. Les Etats-Unis ne sont pas entrés en guerre, contrairement à la seconde guerre mondiale, pour améliorer, ou même préserver leurs marchés, mais tout simplement pour éviter une amplification trop rapide du chaos politique international qui ne ferait qu'exacerber encore plus les convulsion économiques. Ce faisant, ils ne peuvent faire autre chose qu'accentuer l'instabilité d'une zone de première importance tout en aggravant encore les difficultés de leur propre économie (notamment l'endettement) comme celles de l'économie mondiale. (...)
Par certains côtés, la situation présente des Etats-Unis s'apparente à celle de l'Allemagne avant les deux guerres mondiales. Ce dernier pays, en effet, a essayé de compenser ses désavantages économiques, illustrés par le fait qu'il ne disposait pas d'empire colonial significatif (en fait bien plus réduit que celui de la Belgique, de la Hollande ou du Portugal avant la première guerre et nul avant la seconde), en bouleversant le partage impérialiste par la force des armes. C'est pour cela que, lors des deux guerres, il a fait figure "d'agresseur" puisque les puissances mieux loties n'étaient pas intéressées à une remise en cause des équilibres. De même, l'atout essentiel dont disposent aujourd'hui les Etats-Unis, face à la menace économique constituée par l'Allemagne et le Japon, réside principalement dans sa supériorité militaire écrasante. Tant qu'existait le bloc de l'Est, cette puissance pouvait utiliser cette supériorité comme "bouclier" de ses alliés, ce oui lui permettait, en échange, de leur imposer ses "vues" notamment en matière économique. Dans un tel contexte, les Etats-Unis n'avaient pas besoin, à priori, de faire un usage important de leurs armes puisque l'essentiel de la protection accordée à leurs alliés était de nature défensive (bien qu'au début des années 1980, les Etats-Unis aient engagé une offensive générale contre le bloc russe). Avec la disparition de la menace russe, "l'obéissance" des autres grands pays avancés n'est plus du tout garantie (c'est bien pour cela que le bloc occidental est désagrégé). Pour obtenir une telle obéissance, les Etats-Unis ont désormais besoin d'adopter une démarche systématiquement offensive sur le plan militaire (comme on l'a vu justement avec la guerre du Golfe) qui s'apparente clone à celle de l'Allemagne par le passé. La différence avec la situation du passé, et elle est de taille, c'est qu'aujourd'hui ce n'est pas une puissance visant à modifier le partage impérialiste qui prend les devants de l'offensive militaire, mais au contraire la première puissance mondiale, celle qui pour le moment dispose de la meilleure part du gâteau.
Cette différence est significative. Le fait qu'à l'heure actuelle, le maintient de "l'ordre mondial", c'est-à-dire, fondamentalement de l'ordre américain, ne passe plus par une attitude "défensive" (qui était celle de l'Entente et des Alliés par le passé) de la puissance dominante mais par un utilisation de plus en plus systématique de l'offensive militaire, et même à des opérations de déstabilisation de toute une région afin de mieux s'assurer de la soumission des autres puissances, traduit bien le nouveau degré de l'enfoncement du capitalisme décadent dans le militarisme le plus déchaîné. C'est justement là un des éléments gui distingue la phase de décomposition des phases précédentes de la décadence capitaliste. (...)
Les rapports de force entre prolétariat et bourgeoisie
Le prolétariat dans la décomposition
(...) Il importe d'être particulièrement lucide sur le danger que représente la décomposition pour la capacité du prolétariat à se hisser à la hauteur de sa tâche historique. (...) la décomposition de la société, qui ne pourra aller qu'en s’aggravant, peut faucher, dans les années à venir, les meilleures forces du prolétariat et compromettre définitivement la perspective du communisme. Il en est ainsi parce que l’empoisonnement de la société que provoque la putréfaction du capitalisme n'épargne aucune de ses composantes, aucune de ses classes, ni même le prolétariat. En particulier, si l'affaiblissement de l'emprise de l'idéologie bourgeoise résultant de l'entrée du capitalisme dans sa phase de décadence était une des conditions de la révolution, le phénomène de décomposition de cette même idéologie, tel qu'il se développe aujourd'hui, se présente essentiellement comme un obstacle à la prise de conscience du prolétariat. ("La décomposition, phase ultime de la décadence du capitalisme", point 14) (...)
" Tout au long des années 1980, c'est malgré ce poids négatif de la décomposition, systématiquement exploité par la bourgeoisie, que le prolétariat a été en mesure de développer ses luttes face aux conséquences de l'aggravation de la crise" (Revue Internationale n°59, Présentation de la résolution sur la situation internationale du 8e Congrès du CCI)
Jusqu'à l'effondrement du bloc de l'Est, les difficultés résultant du poids de la décomposition n'avaient pas réussi à remettre fondamentalement en cause la dynamique d'ensemble du combat de classe. Mais cet événement allait déterminer une rupture sensible dans cette dynamique. (...)
Dès le mois d'octobre 89, le CCI mettait en évidence les difficultés nouvelles que cet événement historique considérable allait provoquer sur la conscience du prolétariat (voir les "Thèses sur la crise économique et politique en URSS et dans les pays de l'Est", Revue Internationale n° 60) (...)
C'est dans ce contexte que la classe ouvrière a reçu un deuxième choc particulièrement brutal : la guerre du Golfe.
L'impact de la guerre du Golfe
(...) la paralysie des luttes ouvrières provoquée par la guerre du Golfe s'est révélée beaucoup plus importante et durable que celle qui a accompagné l'effondrement du stalinisme. Il en est ainsi parce la classe ouvrière des pays centraux s'est sentie beaucoup plus directement affectée par les événements du Golfe dans lesquels étaient (plus ou moins) directement impliqués ces pays que par ceux de l'Est qui pouvaient apparaître comme quelque peu "extérieurs" (c’est pour cette raison d’ailleurs qu'en Occident il n'y a pas eu de manifestations à propos des événements de l'Est). L'effondrement du stalinisme, s'il a suscité dans la classe un surcroît d'illusions très dangereuses (illusions démocratiques, croyances en un monde de paix") ainsi qu'un recul considérable de la perspective d'un possible remplacement du capitalisme par une autre société, n'a pas provoqué de sentiment d'inquiétude mais plutôt un sentiment d'euphorie. En revanche, la crise du Golfe et la guerre ouverte ont provoqué parmi des dizaines de millions d'ouvriers une profonde inquiétude qui a fait passer au second plan, de façon bien plus profonde et durable que l'effondrement du bloc de l'Est, les préoccupations liées à la dégradation des conditions de vie en même temps qu'elle entraînait un fort sentiment d'impuissance.
Ainsi, au niveau des apparences, la guerre du Golfe a eu un impact encore plus négatif sur la classe ouvrière que l'effondrement du bloc de l'Est. Mais c'est justement la responsabilité des organisations révolutionnaires, fraction la plus consciente de la classe, de savoir reconnaître, au delà de ces apparences, les véritables tendances qui travaillent la société en profondeur.
Si on passe en revue la façon dont les principales forces de la bourgeoisie ont manoeuvré pour faire accepter l'intervention militaire au Moyen-Orient à la classe ouvrière des pays centraux on est frappé par leur extrême habileté :
- au début de la crise, lorsque la majorité de la population, et particulièrement de la classe ouvrière, est réticente face à une telle intervention, les "démocraties" occidentales, avec les Etats-Unis à leur tête, focalisent l'attention sur le "boycott" de l'Irak, alors qu'est acheminé sur place le dispositif militaire le plus considérable depuis la seconde guerre mondiale ;
- en même temps se multiplient les manoeuvres politiques pour faire apparaître Saddam Hussein comme "celui qui veut le guerre" alors qu'on ne lui laisse de toutes façons pas d'autre issue ;
- durant la même période, les mouvements pacifistes se mettent en branle pour canaliser dans une impasse les éléments (et particulièrement les ouvriers) qui refusent de s'associer à la croisade pour le "Droit" ;
- lors du déclenchement de la guerre elle-même, celle-ci est présentée comme une "guerre propre" qui ne fait pas de victimes civiles en Irak ni de pertes parmi les "coalisés" ;
- à la veille de l'offensive terrestre, c'est un son de cloche opposé qui se fait entendre avec toute une insistance sur l'étendue des pertes qu'elle va occasionner parmi les coalisés, ce qui permet, avec la rapidité et les faibles pertes de cette offensive, de provoquer un sentiment de soulagement dans les populations (et donc la classe ouvrière) des pays concernés ;
- après la guerre elle-même, l'horrible massacre des kurdes, voulu par les vainqueurs, est exploité pour justifier a posteriori l'intervention militaire contre l'Irak et susciter le sentiment que cette intervention aurait dû se poursuivre jusqu au renversement de Saddam Hussein et la destruction complète de ses forces militaires.
Ces manoeuvres, systématiquement appuyées par les médias aux ordres, ont atteint leur objectif mais leur sophistication prouve à elle seule à quel point la bourgeoisie était consciente qu'elle n'avait pas les coudées franches pour mener sa politique guerrière. En particulier, elle savait pertinemment que si cette politique était indispensable dans la défense de ses intérêts (avec les nuances que nous avons vues suivant les pays) elle pouvait constituer, contrairement à l'effondrement du bloc de l'Est, un facteur non négligeable de clarification de la conscience du prolétariat. (...)
Au delà des apparences, l'effondrement du bloc de l'Est et la guerre du Golfe (non pas à elle seule mais par ce qu'elle annonce) s'inscrivent dans des dynamiques opposées du point de vue du processus de prise de conscience dans la classe ouvrière.
(...) Dans le second cas, nous étions confrontés à une réelle inquiétude, à des interrogations en profondeur, faisant suite à l'euphorie qui avait accompagné les événements de l'Est. (...) Et contrairement à ce type d'euphorie, l'inquiétude, si elle peut dans un premier temps provoquer une paralysie de la combativité ouvrière, constitue dans la période historique présente, un puissant stimulant de la réflexion en profondeur.
Il importe donc d'insister sur le fait (...) que les événements de ces deux dernières années ne sauraient en aucune façon remettre en cause le cours historique mis en évidence par le CCI depuis plus de deux décennies. (...)
Le cours historique
Un renversement du cours historique supposerait, en effet, une défaite considérable de la classe ouvrière et la capacité de la bourgeoisie de s'appuyer sur cette défaite pour embrigader la classe ouvrière derrière ses drapeaux idéologiques. Or, tant l'effondrement du bloc de l'Est que la guerre du Golfe ne peuvent être considérés comme des défaites du prolétariat ni des occasions pour la bourgeoisie de l'embrigader.
Le premier événement s'est produit de façon indépendante vis-à-vis de l'action de la classe ouvrière (et c'est bien pour cette raison qu'il a provoqué un recul dans le processus de la prise de conscience en son sein). De ce fait, il n'a pu, malgré les difficultés importantes qu'il a fait surgir sur le chemin du prolétariat vers les affrontements révolutionnaires, lui faire rebrousser de façon durable ce chemin (c'est ce que nous mettions en évidence il y a un an en signalant la fin de la dynamique de recul). En particulier, pour les secteurs décisifs du prolétariat, il n'y a pas eu de réel embrigadement (et, notamment, pas de manifestations) derrière les mystifications qui ont affaibli sa conscience car "les secteurs de la classe qui se trouvent aujourd'hui en première ligne de ces mystifications, ceux des pays de l'Est, sont relativement périphériques. C'est principalement à cause du "vent d'Est" qui souffle aujourd'hui, et non parce qu'il serait dans "l'oeil du cyclone", que le prolétariat de l'Ouest doit affronter ces difficultés."Après l'effondrement du bloc de l'Est, déstabilisation et chaos", Revue Internationale n°61).
Quant au second événement, il constitue fondamentalement, comme on l'a vu, un antidote contre le poison idéologique déversé lors de l'effondrement du stalinisme, venant renforcer les effets salubres de la mise en évidence de la faillite économique du mode de production capitaliste. La guerre du Golfe n'a pu avoir lieu que parce que le prolétariat des pays avancés n'a pas trouvé la force de s'y opposer. Mais il ne s'agit pas là d'une défaite directe puisque ses grandes masses n'ont pas eu à être mobilisées dans cette guerre que l'on a confiée uniquement à des professionnels, en insistant d'ailleurs bien fort sur le fait que les ouvriers en uniforme du contingent (là où existe la conscription) n'y seraient pas envoyés. Cette insistance, de même que celle sur le faible nombre de tués dans les troupes "coalisées", constitue une des meilleures preuves de la crainte éprouvée par la bourgeoisie que la guerre ne devienne un facteur de développement des luttes et de la conscience de la classe ouvrière. (...)
Et s'il en est ainsi, c'est que, bien qu'aujourd'hui la guerre impérialiste s'inscrive de plain pied dans la décomposition, elle ne constitue pas une manifestation typique de celle-ci mais le mode de vie même du capitalisme depuis le début de sa décadence. Et c'est bien la décadence qui constitue la condition objective nécessaire au renversement de ce système.
Ceci dit, la décomposition elle-même, bien qu'elle comporte uniquement des conséquences négatives pour la classe ouvrière jusqu'au moment de la période révolutionnaire, ne saurait être invoquée aujourd'hui pour étayer la thèse d'une remise en cause du cours historique. Certes, c'est, comme on l'a vu, un danger extrêmement grave qui menace la classe ouvrière et plus globalement l'humanité puisqu'elle peut conduire à sa destruction. Et ce danger est d'autant plus grave "que si le déchaînement de la guerre mondiale requiert l'adhésion du prolétariat aux idéaux de la bourgeoisie, (...) la décomposition n'a nul besoin d'une telle adhésion pour détruire l'humanité." (Ibid, page 8). Mais, contrairement à la guerre mondiale, les effets de la décomposition (à part, évidemment l'effondrement du stalinisme) sont relativement lents et n'ont pas été capables jusqu'à présent de bloquer le développement des luttes et de la prise de conscience du prolétariat (comme on l'a vu notamment au milieu des années 1980 avec la troisième vague de luttes). En outre, la permanence de la guerre associée à l'effondrement croissant de l'économie capitaliste provoquant nécessairement la riposte et la mobilisation du prolétariat sur son terrain de classe, va constituer un antidote puissant contre les poisons typiques sécrétés par la décomposition. (...)
De même, les combats que le prolétariat devra nécessairement développer vont constituer un facteur de premier plan, par la solidarité de classe qu'ils supposent, de dépassement des tendances à l'atomisation entre ouvriers, au "chacun pour soi", notamment sous sa forme du corporatisme.
Cela ne veut pas dire que, désormais, la décomposition n'exercera plus de pression néfaste sur la classe. Cela signifie tout simplement que cette pression n'a pu jusqu'à présent, et n'est pas près de provoquer une défaite et un embrigadement du prolétariat. C'est pour cela que les révolutionnaires ont la responsabilité de mettre en avant toutes les potentialités de développement des combats et de la conscience que la classe porte en elle. (...)
20/4/1991
[1] [331] La fidélité à toute épreuve témoignée par la bourgeoisie britannique à l'égard de la politique américaine témoigne à la fois de l'intelligence toute particulière de celle-ci qui a compris que les enjeux sont trop importants pour l'ensemble du capitalisme pour prendre le risque de participer à une aggravation de l'instabilité mondiale en tentant de s'opposer aux Etats-Unis et aussi d'une défense bien comprise de ses intérêts nationaux que, depuis la première guerre mondiale, elle a décidé d'associer fermement à celui de la bourgeoisie américaine qui venait de la supplanter. Par cette fidélité envers la bourgeoisie la plus puissante, la bourgeoisie anglaise s'est en même temps acquise une position de "bras droit", d'"homme de confiance" de celle-ci dont elle attend, en contrepartie des garanties. Une telle alliance présente en outre l'avantage de ne pas risquer d'aboutir à une simple colonisation (comme c'est le cas du Canada) dans la mesure où le "grand frère" est éloigné de près de 5000 kilomètres. Si un pays comme la France ne fait pas montre, en général, de la même docilité envers les Etats-Unis, c'est qu'il n'y a pas de place pour deux "bras-droits" auprès des Etats-Unis. C'est le sens de l'alliance privilégiée de ce pays avec l'Allemagne depuis plus de 30 ans, une alliance qui, avec la montée en puissance de ce grand voisin, risque de devenir un peu pesante, ce qui constitue une entrave supplémentaire à la constitution d'un "bloc européen".
[2] [332] Cela était déjà vrai pour la première guerre mondiale qui ne se déchaîne pas comme conséquence directe de la crise. Il y a effectivement, en 1913, une certaine aggravation de la situation économique, mais qui n'est pas sensiblement plus importante que celles de 1900-1903 ou de 1907. En fait, les causes essentielles du déclenchement de la guerre mondiale, en août 1914, résident dans :
- la fin du partage du monde entre les grandes puissances capitalistes, dont la crise de Fachoda (où les deux grandes puissances coloniales, la Grande-Bretagne et la France se retrouvent face à face après avoir conquis l'essentiel de l'Afrique), en 1898, constitue une sorte de symbole et qui marque la fin de la période ascendante du capitalisme ;
- l'achèvement des préparatifs militaires et diplomatiques permettant la constitution des alliances qui allaient s'affronter ;
- la démobilisation du prolétariat européen sur son terrain de classe face à la menace de guerre mondiale (contrairement à la situation de 1912, lorsque se tient le Congrès de Bâle) et son embrigadement derrière les drapeaux bourgeois permis, en premier lieu, par la trahison avérée (et vérifiée par les principaux gouvernements) de la majorité des chefs de la Social-Démocratie.
Ce sont donc principalement des facteurs politiques qui déterminent, une fois que le capitalisme est entré en décadence, qu'il a fait la preuve qu'il arrivait à une impasse historique, le moment du déclenchement de la guerre.
Le même phénomène se renouvelle lors de la seconde guerre mondiale. Les conditions objectives de celle-ci sont données dès le début des années 30, lorsque ce système, une fois la reconstruction achevée, se retrouve confronté à son impasse. Encore une fois, ce sont principalement des données politiques du même ordre qui font que la guerre n'éclate qu'à la fin de cette décennie.
De même, si la raison majeure qui empêche le capitalisme de déchaîner une troisième guerre mondiale au cours des années 50 réside dans le fait que la reconstruction lui donne momentanément une certaine marge de manoeuvre, il faut également prendre en compte, comme autre facteur, la faiblesse du bloc de l'Est et particulièrement de sa puissance dominante. Celle-ci, qui se retrouve dans une situation similaire à celle de l'Allemagne avant les deux guerres mondiales puisqu'elle est la plus mal lotie dans le partage du gâteau impérialiste, fait un certain nombre de tentatives pour améliorer ses positions (blocus de Berlin en 48, guerre de Corée en 52). Mais ces tentatives sont facilement repoussées par les Etats-Unis et leur bloc, ce qui les empêche de constituer les prémisses d'une troisième guerre mondiale.
Conscience et organisation:
Questions théoriques:
- Décomposition [3]
- Impérialisme [321]
Appel au milieu politique prolétarien
- 2967 reads
Avec les violents massacres du Golfe Persique, le capitalisme mondial a jeté son masque et a montré ce que nous réserve son « nouvel ordre mondial » : un avenir fait de chaos, de barbarie et de guerre.
La réalité de la guerre impérialiste, qui a impliqué, même si c'est indirectement, l'ensemble du prolétariat des métropoles impérialistes, a stimulé une décantation salutaire au sein du camp politique prolétarien.
D'un côté, un groupe comme l'Organisation Communiste Internationaliste (OCI) en Italie, qui s'était spécialisé depuis des années dans le soutien aux « bourgeoisies opprimées », s'est rangé avec armes et bagages dans le camp de l'impérialisme irakien, montrant par là qu'il était complètement étranger et ennemi du camp politique prolétarien.
D'un autre côté, l'ensemble du milieu a su réagir au défi de la guerre, en défendant fermement les deux critères désormais essentiels pour rester solidement à l'intérieur des frontières de l'internationalisme prolétarien :
1) Non à la guerre impérialiste. Aucun soutien à un quelconque camp impérialiste en guerre, même et surtout s'il se proclame « anti‑impérialiste ».
2) Non au pacifisme, le capitalisme c'est la guerre ! Seule la guerre au capitalisme, seule la révolution prolétarienne, peuvent permettre un avenir sans guerre.
En défendant unanimement ces deux places fortes prolétariennes, les groupes internationalistes ont démontré qu'ils étaient dignes des minorités révolutionnaires qui, en pleine Première guerre mondiale, ont fait entendre leur voix contre le massacre impérialiste.
Il y a cependant une différence qui saute aux yeux :
‑ En 1916, les divergences énormes qui existaient entre les différents courants qui s'opposaient à la guerre ne les ont pas empêché de lancer un appel unitaire au prolétariat de tous les pays, avec le fameux manifeste de Zimmerwald, qui a été un rayon de lumière pour des millions de prolétaires qui souffraient et mouraient dans les tranchées.
‑ Aujourd'hui, les groupes internationalistes ont défendu avec les mêmes mots les critères essentiels contre la guerre, démontrant une homogénéité bien plus grande que celle qui existait à Zimmerwald, mais malgré cela ils n'ont pas été capables de parler d'une seule voix, au moins en cette occasion, au prolétariat de tous les pays.
C'est une honte qui pèse sur l'ensemble de l'actuel mouvement communiste et qu'on ne peut absolument pas minimiser. Et qu'on ne vienne pas nous dire que « l'essentiel est qu'on a dit les mêmes choses et que cela est suffisant ». Aujourd'hui, l'hypothèque que le capitalisme en décomposition fait peser sur la classe ouvrière est la perte de son unité de classe, à travers mille affrontements fratricides, des sables du Golfe aux frontières de la Yougoslavie. C'est pour cela que la défense de cette unité est une question de vie ou de mort pour notre classe. Mais quelle espérance pourrait désormais avoir le prolétariat de maintenir cette unité, si son avant‑garde consciente, elle‑même, renonçait à combattre pour son unification ? Qu'on ne vienne pas nous dire non plus que c'est un « embrassons‑nous tous », un « escamotage opportuniste des divergences », un appel à une « unité indifférenciée au mépris des principes ». Rappelons‑nous que ce fut justement la participation aux discussions de Zimmerwald qui a permis aux Bolcheviks de réunir la Gauche de Zimmerwald, embryon de la future Internationale Communiste et de la séparation définitive avec les sociaux‑démocrates. C'est justement parce qu'il existe entre les internationalistes des divergences profondes qui les empêchent de parler toujours d'une même voix, qu'il est nécessaire que ces divergences soient ouvertement discutées entre les révolutionnaires, comme nous l'a enseigné l'exemple des discussions entre Rosa Luxemburg, Lénine et les autres camarades qui nous ont précédés. Enfin, qu'on ne vienne pas nous dire que notre appel est le « classique appel dans le vide », qu'on fait tous les ans « juste pour démontrer que nous ne sommes pas sectaires et que les autres le sont ».
Quand, en 1983, nous nous retournions vers l'ensemble du mouvement prolétarien, celui‑ci était en proie à une crise profonde, illustrée par l'explosion de Programma Comunista. La transformation de son ex‑section algérienne, El Oumami, en groupe nationaliste arabe, est passée quasiment inaperçue dans le climat général d'arriération et de fermeture sectaire. Notre appel à ce moment‑là était une invitation à combattre les tendances alors dominantes dans le milieu.
Aujourd'hui, la situation est différente. À l'intégration définitive de l'OCI dans le camp de la bourgeoisie, a répondu le rejet explicite du soutien aux « bourgeoisies nationales opprimées » par les groupes internationalistes de tradition bordiguiste, rejet qui marque une clarification importante pour l'ensemble du milieu. À la place du total isolement sectaire, nous trouvons aujourd'hui dans les différents groupes une plus grande disposition à exposer leurs critiques réciproques dans la presse ou dans les réunions publiques. Il existe en plus un appel explicite des camarades de Battaglia Comunista à surmonter la dispersion actuelle, appel dont nous partageons en grande partie les arguments et les buts. Il existe enfin ‑ et ce doit être encouragé au maximum ‑ une poussée contre l'isolement sectaire, qui vient d'une nouvelle génération d'éléments que le tremblement de terre de ces deux dernières années pousse vers les positons de la Gauche communiste et qui restent pantois devant l'extrême dispersion dont ils n'arrivent pas à comprendre les raisons politiques.
Nous savons bien que les difficultés sont énormes, et que, pour le moment, la disposition à la discussion ‑ quand elle existe ‑ est très limitée. Il y a ceux qui affirment que le débat doit se cantonner à des groupes qui ne se réclament que de la Gauche communiste d'Italie, excluant donc le CCI. Il y a ceux qui conçoivent le débat exclusivement comme un anéantissement des autres groupes dans leur presse. Il y a ceux qui pensent que le vrai débat ne sera possible que dans une phase pré‑révolutionnaire et il y a ceux qui sont disposés à discuter avec les nouveaux éléments en recherche mais pas avec les « vieux ». Comme on le voit, les racines du sectarisme sont trop profondes pour qu'il soit aujourd'hui possible de faire des propositions trop ambitieuses, tant dans leur contenu (travail à la reconstruction du parti) que dans leur forme (par exemple une conférence internationale). Que faire alors pour dépasser concrètement cet état actuel de dispersion ? Il faut favoriser tout ce qui va dans le sens de la multiplication des contacts et des débats entre internationalistes ([1] [333]). Il ne s'agit pas de cacher les divergences pour rendre possible un « mariage » entre groupes, mais de commencer à exposer et à discuter ouvertement des divergences qui sont à l'origine de l'existence des différents groupes.
Le point de départ, c'est de systématiser la critique réciproque des positions dans la presse. Cela peut paraître une banalité, mais il y a encore des groupes révolutionnaires qui, dans leur presse, font semblant d'être seuls au monde.
Un autre pas qui peut être fait immédiatement, c'est de systématiser la présence et l'intervention aux réunions publiques des autres groupes.
Un pas plus important est la confrontation des positions dans des réunions publiques, convoquées conjointement par plusieurs groupes, face à des événements d'une importance particulière, comme la guerre du Golfe.
Il est clair que tout cela, et en particulier ce dernier point, ne sera pas immédiatement réalisable partout et entre tous les groupes. Même si il n'y a que deux organisations qui réussissent à discuter publiquement de leurs accords et de leurs divergences, ce sera déjà un pas en avant pour le milieu politique internationaliste tout entier, et le CCI appuiera avec conviction de telles initiatives, même s'il n'est pas parmi les participants directs de cette discussion particulière.
Nos propositions peuvent paraître modestes, et en fait elles le sont. Face à des décennies de sectarisme débridé, il est déjà ambitieux de vouloir seulement contribuer à enclencher un processus de confrontation et de regroupement entre internationalistes, mais c'est le seul chemin pour que se fasse le processus de décantation politique et de démarcation programmatique qui conduira les minorités communistes à jouer pleinement leur rôle essentiel dans les batailles de classe qui se préparent.
CCI, juillet 1991
[1] [334] Il est évident que les groupes résidus et organisations de type gauchiste (trotskystes, maoïstes, anarchistes) ne sont pas pour nous des internationalistes. Quant à la myriade de groupuscules qui gravitent en parasites autour des principaux courants du milieu prolétarien, par la dispersion militante et la confusion qu'ils alimentent, ils ne peuvent en rien contribuer dans un tel débat.
Courants politiques:
- Gauche Communiste [49]
Approfondir:
Questions théoriques:
- Guerre [129]
Heritage de la Gauche Communiste:
Revue Int. 1992 - 68 à 71
- 4362 reads
Revue Internationale no 68 - 1e trimestre 1992
- 3016 reads
Explosion de l'URSS, massacres en Yougoslavie - Seule la classe ouvrière internationale peut sortir l'humanité de la barbarie
- 4788 reads
Le «nouvel ordre mondial» annoncé il y a moins de deux ans par le président Bush n'en finit pas d'accumuler l'horreur et les cadavres. A peine les massacres de la guerre du Golfe étaient-ils terminés (ceux provoqués directement par la coalition, car ceux des Kurdes se poursuivent encore) que la guerre se rallumait en pleine Europe, dans ce qui était la Yougoslavie. L'horreur qu'on a découvert avec la prise de Vukovar par l'armée serbe illustre donc, une nouvelle fois, à quel point étaient mensongers tous les discours sur l'«ère nouvelle», faite de paix, de prospérité et de respect des droits de l'homme, qui devait accompagner l'effondrement des régimes staliniens d'Europe et la disparition de l'ancien bloc de l'Est. En même temps, l'indépendance de l'Ukraine et, plus encore, la constitution d'une «Communauté d'Etats» comprenant cette dernière, la Russie et la Biélorussie1] [335] viennent contresigner le constat de ce qui était patent depuis l'été : l’URSS n'existe plus. Cela n'empêche pas, d'ailleurs, les différents morceaux de cet ex-pays de continuer à se décomposer: aujourd'hui c'est la fédération de Russie elle-même, c'est-à-dire la plus puissante des républiques de feu l'Empire soviétique, qui est menacée d'éclatement. Face à ce chaos dans lequel s'enfonce chaque jour un peu plus la planète, les pays les plus avancés, et particulièrement le premier d'entre eux, les Etats-Unis, veulent se présenter comme des îlots de stabilité, garants de l'ordre mondial. Mais, en réalité, ces pays eux-mêmes ne sont pas préservés des convulsions mortelles dans lesquelles s'enfonce la société humaine. En particulier, l'Etat le plus puissant de la terre, s'il met à profit son énorme supériorité militaire sur tous les autres pour revendiquer le rôle de gendarme du monde, comme on vient de le voir encore avec la conférence sur le Moyen-Orient, ne peut rien contre l'aggravation inexorable de la crise économique qui se trouve à l'origine de toutes les convulsions qui déferlent sur l'humanité. La barbarie du monde d'aujourd'hui met en relief l'énorme responsabilité qui repose sur les épaules au prolétariat mondial, un prolétariat qui doit faire face au déchaînement d'une campagne et de manoeuvres d'une intensité sans précédent destiné à le détourner non seulement de sa perspective historique mais aussi de la lutte pour la défense de ses intérêts élémentaires.
Nous avons régulièrement, dans notre revue, analysé l'évolution de la situation dans l'ancienne URSS2] [336]. En particulier, depuis la fin de l'été 1989 (c'est-à-dire près de deux mois avant la disparition du mur de Berlin), le CCI a mis en avant l'extrême gravité des convulsions qui secouaient l'ensemble des pays dits « socialistes»3] [337]. Aujourd'hui, chaque jour qui passe vient illustrer un peu plus l'ampleur de la catastrophe qui se déchaîne dans cette partie du monde.
L'ex-URSS dans le gouffre
Depuis le putsch avorté d'août 1991, les événements n'ont cessé de se précipiter dans l'ancienne URSS. Le départ des pays baltes de l’«Union» semble appartenir maintenant à un passé lointain. Aujourd'hui, c'est l'Ukraine qui devient indépendante, c'est-à-dire la deuxième république de l'Union, forte de 52 millions d'habitants, qui constitue son «grenier à blé» et représente 25% de sa production industrielle. De plus, cette république possède sur son territoire une quantité considérable des armes atomiques de l'ancienne Union. A elle seule, elle dispose d'un potentiel de destruction nucléaire supérieur à ceux de la Grande-Bretagne et de la France réunis. En ce sens, la décision par Gorbatchev, le 5 octobre, de réduire de 12.000 à 2.000 le nombre des charges nucléaires tactiques de l'URSS n'était pas seulement la réponse à la décision similaire adoptée par Bush une semaine auparavant ni la simple concrétisation de la disparition de l'antagonisme impérialiste, qui avait dominé le monde pendant quatre décennies, entre les Etats-Unis et l'URSS. Elle constituait une mesure de prudence élémentaire pour empêcher les républiques sur lesquelles sont déployées ces armes, et particulièrement l'Ukraine, de s'en servir comme instrument de chantage.
C'est d'ailleurs pour cette même raison que les autorités ukrainiennes ont refusé, jusqu'à présent, de restituer ces armements. Et il n'a pas fallu longtemps pour que ne s'illustre à quel point était justifiée l'inquiétude de Gorbatchev, et de la majorité des dirigeants du monde, face au problème de la dissémination nucléaire. C'est ainsi que, début novembre, éclatait le conflit entre l'autorité centrale de Russie et la république autonome de Tchétchéno-Ingouchie qui venait, elle aussi de proclamer son «indépendance». Face à la décision de Eltsine d'instaurer sur place l'état d'urgence grâce aux forces spéciales du KGB, Doudaev, ex général de l'armée «rouge» reconverti en petit potentat indépendantiste, menaçait de recourir a des actions terroristes sur les installations nucléaires de la région. De plus, face à la menace d'affrontements sanglants, les troupes chargées de la répression ont refusé d'obéir et c'est finalement le Parlement de Russie qui a sauvé la mise de Eltsine en annulant sa décision. Cet événement, outre qu'il soulignait la réelle menace que représentent les énormes moyens nucléaires déployés dans toute l'URSS au moment où cette ancienne puissance se désintègre, mettait également en relief le niveau de chaos dans lequel se trouve aujourd'hui cette partie du monde. Ce n'est pas seulement l'URSS qui est en train de se désintégrer, c est sa plus grande république, la Russie, qui est maintenant menacée d'explosion sans avoir les moyens, sinon par de véritables bains de sang à l'issue incertaine, de faire respecter l'ordre.
Une banqueroute économique totale
Cette tendance à la dislocation de la Russie même s'exprime également par les dissensions qui se développent au sein de la clique des «réformateurs» actuellement aux postes de commande de cette république. C'est ainsi que les mesures de «libéralisation sauvage» mises en avant par le président russe fin octobre ont déclenché une levée de boucliers de la part des maires des deux plus grandes villes du pays. Gavril Popov, maire de Moscou, a déclaré qu' «il ne portera pas la responsabilité de la libération des prix», et son collègue de Saint-Pétersbourg, Anatoh Sobtchak, a accusé Eltsine de vouloir «affamer la Russie». En fait, ces affrontements entre politiciens sur les questions économiques ne font que révéler l'impasse totale dans laquelle se trouve l'économie de l'URSS. Tous ses dirigeants politiques, à commencer par Gorbatchev, ne cessent de jeter des cris d'alarme face aux menaces de famine pour l'hiver qui vient. Le 10 novembre, Sobtchak prévenait : «Nous n'avons pas constitué les réserves alimentaires suffisamment importantes sans lesquelles les grandes villes soviétiques et les grands centres industriels du pays ne pourront simplement pas survivre».
Sur le plan financier, la situation est devenue également cauchemardesque. La banque centrale, la Gosbank, est obligée de faire tourner ses planches à billets à rythme intensif, ce qui conduit à une dévaluation du rouble de 3% par semaine. Le 29 novembre, cette même banque annonce que les salaires des fonctionnaires ne seront plus payés. A l'origine de cette décision, le refus par les députés russes (majoritaires) au Congres de voter une autorisation de crédit de 90 milliards de roubles demandée par Gorbatchev. Le lendemain, Eltsine, afin de pouvoir marquer un nouveau point dans sa lutte d'influence contre Gorbatchev, a assuré que la Russie se chargeait de prendre à son compte le paiement des fonctionnaires.
En réalité, la banqueroute de la banque centrale ne provient pas seulement du refus par les républiques de verser au «centre» le produit des impôts. Elles-mêmes sont incapables de collecter les fonds indispensables à leur fonctionnement. Ainsi, les républiques autonomes de Yakoutie et de Bouriatie, appartenant à la fédération de Russie, bloquent depuis plusieurs mois leurs livraisons d'or et de diamants qui permettaient d'alimenter en devises les caisses de la Russie et de l'Union. Pour leur part, les entreprises payent de moins en moins leurs impôts, soit parce que leurs propres caisses sont a sec, soit qu'elles considèrent (comme c'est le cas d'entreprises privées plus «prospères») que « libéralisation » veut dire abolition de la fiscalité. Ainsi, l'ex-URSS se trouve prise dans une spirale infernale. Aussi bien les reformes que les conflits politiques découlant de la catastrophe économique ne font qu'aggraver encore cette catastrophe, ce qui aboutit à une nouvelle fuite en avant dans ces «réformes» mort-nées et dans les affrontements entre cliques.
Les gouvernements des pays les plus avancés sont bien conscients de l'ampleur de cette catastrophe dont il est clair que les répercussions ne sauraient s'arrêter aux frontières de l'ancienne URSS4] [338]. C'est pour cette raison que sont élaborés des plans d'urgence pour acheminer vers cette région des produits de première nécessité, mais il n'y a aucune garantie que cette aide puisse parvenir à ses destinataires du fait de l'incroyable corruption qui règne à tous les échelons de l'économie, de la paralysie qui frappe l'ensemble de l'appareil politique et administratif (devant l'instabilité politique et les menaces de limogeage, la plupart des « décideurs » ont comme principale préoccupation de... ne pas prendre de décision), et la désorganisation totale des moyens de transport (manque de pièces détachées pour entretenir le matériel, rupture des approvisionnements en combustible, troubles affectant régulièrement différentes parties du territoire).
C'est également pour relâcher un peu l'étranglement financier de l'ex-URSS que le G7 a accordé un délai d'un an pour le remboursement des intérêts de la dette soviétique, laquelle se monte aujourd'hui à 80 milliards de dollars. Mais ce ne sera qu'un emplâtre sur une jambe de bois tant les crédits alloués semblent disparaître dans un puits sans fond. Il y a deux ans avaient été colportées toutes sortes d'illusions sur le «marché nouveau» ouvert par l'effondrement des régimes staliniens. Aujourd'hui, alors même que la crise économique mondiale se traduit, entre autres, par une crise aiguë des liquidités5] [339], es banques sont de plus en plus réticentes à placer leurs capitaux dans cette partie du monde. Comme le déplorait récemment un banquier français : «On ne sait plus à qui on prête ni auprès de qui on devra exiger les remboursements.»
Même pour les politiciens bourgeois les plus optimistes, il est difficile d'imaginer comment pourrait être redressée la situation tant sur le plan économique que politique dans ce qui était, il y a peu de temps encore, la deuxième puissance mondiale. L'indépendance de chacune des républiques, présentée par les différents démagogues locaux comme une «solution» pour ne pas sombrer avec l'ensemble du navire, ne pourra qu'aggraver encore plus les difficultés d'une économie basée pendant des décennies sur une extrême division du travail (certains articles ne sont produits que dans une seule usine pour toute l'URSS). En outre, une telle indépendance des républiques porte avec elle le surgissement des revendications particulières des minorités réparties sur l'ensemble du territoire (il existe une quarantaine de «régions autonomes» et encore plus d'ethnies). Dès à présent, avec des affrontements sanglants entre arméniens et azéris à propos du Haut-Karabakh, entre Ossètes et Géorgiens en Ossétie du Sud, entre Kirghizes, Ouzbeks et Tadjiks au Kirghizstan, on peut se faire une idée de ce qui attend l'ensemble du territoire de l'ex-URSS. En outre, les populations russes qui sont réparties dans toute l'Union (par exemple, 38 % de la population au Kazakhstan, 22% en Ukraine) risquent de faire les frais de ces « indépendances ». D'ailleurs, Eltsine a prévenu qu'il se considérait comme le «protecteur» des 26 millions de russes vivant hors de Russie et qu'il faudrait reconsidérer la question des frontières de cette république avec certaines autres. C'est un discours qu'on a entendu, il y a peu de temps, dans la bouche du dirigeant serbe Milosevic : en voyant la situation actuelle en Yougoslavie on comprend aisément quelle sinistre réalité il peut annoncer pour demain à une échelle bien plus vaste6] [340].
LA YOUGOSLAVIE : BARBARIE ET ANTAGONISMES ENTRE GRANDES PUISSANCES
En quelques mois, la Yougoslavie a plongé dans l'enfer. Tous les jours, tes journaux télévisés nous renvoient l'image de la barbarie sans nom qui se déchaîne à quelques centaines de kilomètres des métropoles industrielles d'Italie du Nord et d'Autriche. Des villes entièrement détruites, des monceaux de cadavres jonchant les rues, les mutilations, les tortures, les charniers. Jamais depuis la fin de la seconde guerre mondiale, un pays d'Europe n'avait connu de telles atrocités. Désormais, l'horreur qui semblait jusqu'à présent réservée aux pays du «tiers-monde», atteint des zones immédiatement voisines du coeur du capitalisme. Voici le «grand progrès» que vient de réaliser la société bourgeoise : créer un Beyrouth-sur-Danube à une petite heure de Milan et de Vienne. L'enfer que vivent depuis des décennies les pays les plus mal lotis de la planète a toujours été atroce, il a toujours constitué une honte pour l'humanité. Que cet enfer se trouve maintenant à nos portes n'est pas en soi plus scandaleux. Cependant, c'est le signe indiscutable du degré de pourriture atteint par un système qui avait réussi pendant quarante ans à reporter à sa périphérie les aspects les plus abominables de la barbarie qu'il engendre. C'est la manifestation évidente de l'entrée du capitalisme mondial dans une nouvelle étape, la dernière, de sa décadence : celle de la décomposition générale de la société7] [341].
Une des illustrations de cette décomposition est constituée par la totale irrationalité de la conduite de la plupart des forces politiques en présence.
Du côté des autorités de la Croatie, la revendication de l'indépendance pour cette république ne se base sur aucune possibilité d'une amélioration des positions de son capital national. La simple lecture d'une carte, par exemple, met en évidence les difficultés supplémentaires qui ne manqueront pas de surgir lorsque cette « nation » aura accédé à son «indépendance», du fait de la position et de la forme de ses frontières. Ainsi, pour aller de Dubrovnik à Vukovar, en supposant, ce qui aujourd'hui est peu vraisemblable, que ces deux villes soient reconstruites et reviennent un jour à la Croatie, ce n'est pas par Zagreb qu'il faut passer (sauf à parcourir 500 kilomètres supplémentaires) mais par Sarajevo, capitale d'une autre république, la Bosnie-Herzégovine.
Du côté des autorités «fédérales» (en réalité Serbes), la tentative de soumettre la Croatie, ou tout au moins de conserver au sein d'une «Grande Serbie» le contrôle des provinces croates où vivent des Serbes, ne permet pas non plus d'espérer de grands bénéfices sur le plan économique : le coût de la guerre actuelle et les destructions qu'elle provoque ne feront qu'aggraver encore plus le marasme économique total dans lequel se trouve le pays.
Les dissensions entre Etats européens
Depuis le début des massacres en Yougoslavie, les professionnels des bons sentiments médiatiques se sont émus : «il faut faire quelque chose !» Il est vrai que l'horreur réservée aux Kurdes d'Irak se vend moins bien aujourd'hui qu'il y a quelques mois8] [342]. Cependant, pour la Yougoslavie, la «sollicitude» a largement dépassé le niveau du « charity business » puisque la Communauté européenne a organisé une conférence spéciale, dite de la Haye, pour mettre fin à la guerre. Après une vingtaine de cessez-le-feu dérisoires et de multiples voyages du négociateur Lord Carrington, les massacres continuent de plus belle. En fait, cette impuissance de l'Europe à mettre fin à un conflit, dont chacun souligne la totale absurdité, constitue une illustration flagrante des dissensions qui existent entre les Etats qui la composent. Ces oppositions ne sont nullement de circonstance ou secondaires. Elles recouvrent des intérêts impérialistes bien déterminés et antagoniques. En particulier, le fait que l'Allemagne ait été, depuis le début, favorable à l'indépendance de la Slovénie et de la Croatie n'est pas fortuit. C'est, pour cette puissance, la condition de son accès à la Méditerranée dont l'importance stratégique n'est pas à démontrer9] [343]. Pour leur part, es autres puissances impérialistes présentes en Méditerranée ne sont nullement intéressées à ce retour de l'Allemagne dans cette zone. C'est pour cela que, au début du conflit yougoslave, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France (sans compter l'URSS, traditionnel «protecteur» de la Serbie mais qui aujourd'hui a d'autres chats à fouetter) se sont prononcés pour le maintien d'une Yougoslavie unifiée10] [344].
Ainsi la tragédie yougoslave a mis en évidence que le «nouvel ordre mondial» était synonyme d'exacerbation des tensions non seulement entre des nationalités et des ethnies dans les parties du monde, comme eir Europe centrale et de l'Est, où le développement tardif du capitalisme a interdit la constitution d'un Etat national viable et stable, mais également entre les vieux Etats capitalistes constitués depuis longtemps et qui, jusqu'à présent, étaient alliés contre la puissance impérialiste soviétique. Le chaos dans lequel s'enfonce aujourd'hui la planète n'est pas seulement le fait des pays de la périphérie du capitalisme. Ce chaos concerne également, et concernera de plus en plus, les pays centraux dans la mesure où il trouve ses origines, non pas dans des problèmes spécifiques aux pays sous-développés mais bien dans un phénomène mondial : la décomposition générale de la société capitaliste qui ne pourra que s'aggraver en même temps que la crise irréversible de son économie.
La conférence sur le Moyen-Orient : affirmation du leadership des Etats-Unis
Face au chaos dans lequel bascule l'ensemble de la planète, il revient à la première puissance de celle-ci déjouer le rôle de «gendarme». Il n'y a évidemment pas à cette tache des Etats-Unis le moindre motif désintéressé. C'est à celui qui profite le plus de l’«ordre mondial» actuel d'en assurer, pour l'essentiel, la préservation. La guerre du Golfe a constitué une opération de police exemplaire pour dissuader tous les autres pays, petits ou grands, de participer à la déstabilisation de cet ordre. Aujourd'hui, la «conférence de paix» sur le Moyen-Orient constitue l'autre volet, complémentaire de la guerre, dans la stratégie américaine. Après avoir démontré qu'ils étaient prêts à «maintenir l’ordre» de la façon la plus brutale qui soit, les Etats-Unis devaient faire la preuve qu'eux seuls étaient en mesure d'être efficace dans le règlement des conflits qui ensanglantent la planète depuis des décennies. Et, pour ce faire, la question du Moyen-Orient est évidemment parmi les plus significatives.
En effet, il est nécessaire de souligner l'importance historique considérable d'un tel événement. C'est la première fois depuis 43 ans (depuis la partition de la Palestine par l'ONU en novembre 1947 et la fin du mandat anglais en mai 1948) qu'Israël se retrouve à la même table que l'ensemble de ses voisins arabes avec qui elle a mené déjà cinq guerres (1948, 1956, 1967, 1973, 1982). En fait, cette conférence internationale constitue une conséquence directe de l'effondrement du bloc russe en 1989 et de la guerre du Golfe du début de l'année 1991. Elle a été possible parce que les Etats arabes (y compris l'OLP) de même qu'Israël ne peuvent désormais plus jouer sur la rivalité Est-Ouest pour essayer de faire prévaloir leurs intérêts.
Les Etats arabes qui tentaient d'affronter Israël ont définitivement perdu leur «protecteur» soviétique. De ce fait, Israël a été privé d'une des attributions qui lui valaient un soutien sans faille des Etats-Unis : jouer le rôle de principal gendarme du bloc US dans la région face aux prétentions du bloc russe11] [345].
Cependant, bien qu'en soi la question du Moyen-Orient, par son importance historique et stratégique, donne à la conférence ouverte à Madrid fin octobre, et qui doit se poursuivre à Washington en décembre, un relief tout particulier, sa signification va bien au-delà des problèmes liés à cette partie du monde. Ce n'est pas seulement vis-à-vis des pays de la région que les Etats-Unis affirment leur autorité, mais aussi, et surtout vis-à-vis des autres grandes puissances qui seraient tentées de jouer une carte «indépendante» à leur égard.
La mise au pas des puissances européennes
En effet, à Madrid, du fait que l'ONU12] [346] n'ait eu aucune place (à la demande d'Israël, mais cela arrangeait bien les américains), la seule grande puissance présente, à côté des Etats-Unis, était... l'URSS (si on peut parler de «grande puissance» !) Le simple fait que Bush ait proposé la co-présidence de cette conférence à Gorbatchev, alors que ce dernier est complète ment dévalué et que son pays n'existe plus, constitue un véritable camouflet pour des pays qui, il y a peu encore, avaient des prétentions au Moyen-Orient. C'est notamment le cas de la France (définitivement chassée du Liban avec la prise de contrôle de ce pays par la Syrie), et même de la Grande-Bretagne (principale puissance de la région jusqu'à la seconde guerre mondiale et «ex-protecteur» de la Palestine, de l'Egypte et de la Jordanie). La chose n'est pas trop grave pour cette dernière puissance qui ne conçoit la défense de ses intérêts impérialistes que dans le cadre d'une alliance étroite avec le grand frère américain. En revanche, pour la France, c'est une nouvelle manifestation de la place de second ordre que les Etats-Unis lui assignent désormais malgré (et en partie à cause de) ses tentatives de mener une politique «indépendante». Et, au delà de la France, c'est également l'Allemagne qui est indirectement visée. En effet, même si cette puissance n'avait plus, depuis longtemps, d'intérêts (autres qu'économiques, évidemment) dans cette région, la gifle reçue par le pays sur qui elle tente de s'appuyer, à l'heure actuelle, notamment au sein des institutions européennes et sur le plan militaire, pour affirmer ses intérêts, ne peut que l'atteindre également, d’ailleurs, la place réservée à l'Europe à la conférence de Madrid : la présence, comme observateur, du ministre des affaires étrangères des Pays-Bas, en dit long sur le rôle que, désormais, les Etats-Unis comptent assigner aux Etats européens ou à toute alliance entre eux dans les grandes affaires du monde : un rôle de comparse.
Enfin, la tenue de la conférence sur le Moyen-Orient alors que ces mêmes Etats européens affichent, jour après jour, leur impuissance face à la situation en Yougoslavie, vient souligner une nouvelle fois que le seul «gendarme» en mesure d'assurer un peu d'ordre dans le monde est bien l'oncle Sam. Ce dernier a été capable d'apporter une «solution» à un des conflits les plus anciens et graves de la planète (qui pourtant se déroulait à 10 000 kilomètres de ses frontières), alors que les pays européens n'arrivent pas à faire la police de l'autre côté de leurs frontières. Ainsi, avec la conférence sur le Moyen-Orient est réaffirmé le message essentiel que les Etats-Unis avaient déjà envoyé avec la guerre du Golfe : c'est exclusivement de la puissance américaine, de son énorme supériorité militaire (et aussi économique) que dépend «l’ordre mondial.» Tous les pays, y compris ceux qui essaient de jouer leur propre carte, ont besoin de ce gendarme13] [347]. Leur intérêt est donc de faciliter la politique de la première puissance mondiale.
Ceci dit, la discipline que la première puissance mondiale réussit encore à imposer ne doit pas masquer la situation catastrophique ans laquelle se trouve le monde capitaliste aujourd'hui et qui ne pourra aller qu'en s'aggravant. En particulier, la méthode employée pour garantir cette discipline est elle-même génératrice de nouveaux désordres. C'est ce que nous avions déjà vu avec la Guerre du Golfe (avec toutes ses conséquences catastrophiques dans la région et particulièrement en ce qui concerne la question kurde) et que nous voyons aujourd'hui avec la Yougoslavie, où le maintien de 1 autorité américaine passait par une mise à feu et à sang du pays. Comme les marxistes l'ont toujours affirmé, il n'y pas de place, dans le capitalisme décadent, pour une quelconque « paix générale ». Même s'ils s'éteignent au Moyen-Orient, les foyers de tension entre bandes rivales des gangsters capitalistes ne peuvent que surgir ailleurs. Et cela d'autant plus que la crise économique du mode de production capitaliste qui, en dernière instance, se trouve à l'origine des affrontements impérialistes, est insoluble et ne peut que s'aggraver, comme on le voit à 1 heure actuelle.
Aggravation de la crise et attaques contre la classe ouvrière
Alors même que Bush célèbre ses triomphes diplomatiques et militaires, son «front intérieur» ne cesse de se dégrader, notamment sous la forme d'une nouvelle aggravation de la récession. Pendant quelques mois, la bourgeoisie américaine, et, avec elle, l'ensemble de la bourgeoisie mondiale, avait rêvé que la récession ouverte qui avait pris son essor avant la guerre du Golfe serait de courte durée. Aujourd'hui, c'est le temps des déceptions : malgré tous les efforts des gouvernements (qui continuent de prétendre, tout en faisant le contraire, qu'il ne faut pas intervenir dans l'économie et qu'il importe de laisser jouer les lois du marché) le marasme se prolonge sans qu'on en voit la sortie. En réalité, c'est une nouvelle aggravation considérable de la crise du capital qui s'annonce et qui déjà plonge de nombreux secteurs de la bourgeoisie dans la panique. Cette aggravation de la crise ne peut avoir d'autre conséquence que 'intensification des attaques contre la classe ouvrière. Dès à présent, ces attaques se sont déchaînées un peu partout dans le monde : licenciements massifs (y compris dans les secteurs «de pointe» comme l'informatique), blocage des salaires, érosion des prestations sociales (pensions de retraite, allocations chômage, remboursement des frais de maladie, etc.), intensification des cadences de travail : il serait fastidieux de faire la liste de ce type d'attaques dans les différents pays. Ce sont tous les ouvriers de tous les pays qui subissent maintenant dans leur chair les atteintes de la crise capitaliste. Ces attaques provoquent évidemment le developpement d'un mécontentement considérable au sein de la classe ouvrière. Et, dans beaucoup de pays, on voit effectivement se déployer toute une agitation sociale, lais ce qui est significatif, c'est que, contrairement aux grandes luttes qui avaient marqué le milieu des années 1980, et qui faisaient l'objet d'un black-out pratiquement total, l'agitation présente est répercutée de façon spectaculaire par toutes les médias. En réalité, nous assistons à l'heure actuelle à une vaste manoeuvre de la bourgeoisie de la plupart des pays les plus développés pour miner le terrain des véritables combats de classe.
Pour la classe ouvrière, il n'y a pas identité entre colère et combativité, ni entre combativité et conscience, même si, évidemment, il y a un lien entre elles. La situation des ouvriers des pays anciennement «socialistes» nous le démontre chaque jour. Ces ouvriers sont aujourd'hui confrontés à des conditions de vie, à une misère inconnues depuis des décennies. Pourtant, leurs luttes contre l'exploitation sont de faible ampleur, et lorsqu'elles se développent, c'est pour tomber dans les pièges les plus grossiers que leur tend la bourgeoisie (notamment les pièges nationalistes comme on l'a vu, par exemple au printemps 1991 avec la grève des mineurs d’Ukraine). La situation est loin évidemment d'être aussi catastrophique dans les pays «avancés», tant du point de vue des attaques capitalistes que des mystifications pesant sur la conscience des ouvriers. Cependant, il est nécessaire de mettre en évidence les difficultés que rencontre à l'heure actuelle le prolétariat de ces pays, justement parce que la classe ennemie emploie tous les moyens pour les utiliser et les renforcer.
Les événements considérables qui se sont succédés depuis deux ans ont été amplement utilisés par la bourgeoisie pour asséner des coups à la combativité et surtout à la conscience de la classe ouvrière. C'est ainsi que, en répétant à satiété, que le stalinisme était du «communisme», que les régimes staliniens, dont la faillite était devenue patente, constituaient la conséquence inévitable de la révolution prolétarienne, les campagnes de propagande bourgeoises ont visé à détourner les ouvriers de toute perspective d'une autre société et à leur faire entendre que la « démocratie libérale » était le seul type de société viable. Alors que c'était une forme particulière de capitalisme qui s'effondrait dans les pays de l'Est sous la pression de la crise générale de ce système, tous les médias n'ont cessé de nous présenter ces événements comme un «triomphe» du capitalisme.
Une telle campagne a obtenu un impact non négligeable parmi les ouvriers, affectant leur combativité et surtout leur conscience. Alors que cette combativité connaissait un nouvel essor au printemps 1990, notamment à la suite des attaques résultant du début d'une récession ouverte, elle a été de nouveau atteinte par la crise et la guerre du Golfe. Ces événements tragiques ont permis de faire justice du mensonge sur le «nouvel ordre mondial» annoncé par la bourgeoisie lors de la disparition du bloc de l'Est sensé être le principal responsable des tensions militaires. Les massacres perpétrés par les «grandes démocraties », par les «pays civilisés», contre les populations irakiennes ont permis à beaucoup d'ouvriers de comprendre combien étaient mensongers les discours de ces mêmes «démocraties» sur la «paix» et les «droits de l'homme». Mais en même temps, la grande majorité de la classe ouvrière des pays avancés, à la suite des nouvelles campagnes de mensonges bourgeois, a subi cette guerre avec un tort sentiment d'impuissance qui a réussi à affaiblir considérablement ses luttes. Le putsch de l'été 1991 en URSS et la nouvelle déstabilisation qu'il a entraînée, de même que la guerre civile en Yougoslavie, ont contribué à leur tour à renforcer ce sentiment d'impuissance. L'éclatement de l'URSS et la barbarie guerrière qui se déchaîne en Yougoslavie sont des manifestations du degré de décomposition atteint aujourd'hui par la société capitaliste. Mais grâce à tous les mensonges assénés par ses médias, la bourgeoisie a réussi à masquer la cause réelle de ces événements pour en faire une nouvelle manifestation de la « mort du communisme », ou bien une question de «droit des peuples à disposer d'eux-mêmes» face auxquelles les ouvriers n'ont d'autre alternative que d'être des spectateurs passifs et de s'en remettre à la « sagesse » de leurs gouvernements.
Les manoeuvres de la bourgeoisie contre la classe ouvrière
Après avoir subi pendant deux ans un tel tir de barrage, la classe ouvrière ne pouvait qu'accuser le coup sous forme d'un important désarroi et d'un fort sentiment d'impuissance. Et c'est justement ce sentiment d'impuissance que la bourgeoisie s'est employée à utiliser et à renforcer, par une série de manoeuvres visant à tuer dans l'oeuf toute renaissance de la combativité, grâce à des affrontements prématurés, sur un terrain choisi par la bourgeoisie elle-même, afin que ces affrontements s'épuisent ans l'isolement et s'enlisent dans des impasses. Les méthodes employées sont variées, mais elles ont pour point commun de toujours aire appel à une participation intensive des syndicats.
Ainsi, en Espagne c'est le terrain pourri du nationalisme qui a été utilisé par les syndicats (notamment les Commissions Ouvrières proches du PC et l'UGT proche du PS) pour conduire les ouvriers dans l'isolement. Le 23 octobre, ils ont appelé à une grève générale dans les Asturies, où ce sont près de 50 000 emplois qui vont disparaître avec les plans de « rationalisation » des mines et de la sidérurgie, derrière le mot d'ordre de « Défense des Asturies ». Avec un tel mot d'ordre, le «mouvement» a reçu le soutien des commerçants, des artisans, des paysans, des curés et même des joueurs de football. Du fait de la colère et de l'inquiétude qui anime les ouvriers, le mouvement a été très suivi mais, avec une telle revendication, il ne pouvait que favoriser l'enfermement des ouvriers dans leurs provinces ou même dans leurs localités comme on l'a vu au Pays-Basque où ils ont été appelés à se mobiliser derrière une motion du Parlement provincial pour «sauver la rive gauche de la rivière de Bilbao».
Aux Pays-Bas et en Italie, les syndicats ont utilisé d'autres moyens. Ils ont appelé à une mobilisation nationale avec de grandes manifestations de rue dès qu'a été connu le projet de budget pour l'année 1992 qui contient des attaques considérables contre les prestations sociales, les salaires et les emplois. Aux Pays-Bas, le mouvement a été un succès pour les syndicats : les deux manifestations du 17 septembre et du 5 octobre 1991 étaient lés plus importantes depuis la dernière guerre. C'était l'occasion pour les appareils syndicaux de renforcer leur encadrement de la classe ouvrière en prévision des futures luttes tout en dévoyant le mécontentement sur le terrain de la «défense des acquis sociaux de la démocratie néerlandaise». En Italie, où se trouve un des prolétariats les plus combatifs du monde et où les syndicats officiels sont largement discrédités, la manoeuvre a été plus subtile. Elle a consisté principalement à diviser et à décourager les ouvriers grâce à un partage des taches entre, d'un côté, les trois grandes centrales (CGIL, CSIL et UIL) qui ont appelé à une grève et à des manifestations pour le 22 octobre et, de l'autre côte, les syndicats «de base» (les COBAS) qui ont appelé à une «grève alternative» pour le... 25 octobre.
En France, la tactique a été différente. Elle a surtout consisté à enfermer les ouvriers dans le corporatisme. C'est ainsi que les syndicats ont lancé toute une série de « mouvements » amplement répercutés par les médias à des dates et pour des revendications différentes : dans les chemins de fer, les transports aériens et urbains, les ports, la sidérurgie, l'enseignement, chez les assistantes sociales, etc. On a assisté à une manoeuvre particulièrement répugnante dans le secteur de la santé où les syndicats officiels, largement déconsidérés, prônaient «l’unité» entre les différentes catégories alors que les coordinations, qui s'étaient déjà illustrées lors de la grève de l'automne 198814] [348], cultivaient le corporatisme et les «spécificités», notamment parmi les infirmières. Le gouvernement s'est d'ailleurs arrangé pour «radicaliser» très opportunément le mouvement de celles-ci grâce à des violences policières fortement médiatisées lors d'une de leurs manifestations. Le sommet a été atteint lorsque les travailleurs de ce secteur ont été appelés à manifester en compagnie des médecins libéraux, des «grands patrons» et des pharmaciens pour la «défense de la santé». En même temps, les syndicats, avec le soutien actif des organisations gauchistes, ont lance la grève dans l'usine de Cléon de Renault, c'est-à-dire l'entreprise «phare» pour le prolétariat en France. Pendant des semaines ils ont tenu des discours radicaux, tout en enfermant les ouvriers dans cette usine, jusqu'au moment où ils ont brusquement tourné casaque en appelant à la reprise alors que la direction n'avait cédé que des broutilles. Et dès que le travail a repris à Cléon, ils ont lancé la grève dans une autre usine du même groupe, au Mans.
Ce ne sont là que des exemples parmi beaucoup d'autres, mais ils sont significatifs de la stratégie d'ensemble élaborée par la bourgeoisie contre les ouvriers. Et c'est bien parce qu'elle se rend compte qu'elle n'a pas remporté un succès définitif avec les campagnes déchaînées depuis deux ans que la classe dominante déploie aujourd'hui toutes ces manoeuvres en s'appuyant sur les difficultés présentes de la classe ouvrière.
En effet ces difficultés ne sont pas définitives. L'intensification et le caractère de plus en plus massif des attaques que le capitalisme devra nécessairement déchaîner vont obliger la classe ouvrière à reprendre des combats de grande envergure. En même temps, et c'est ce que craint en fin de compte le plus la bourgeoisie, le constat de la faillite croissante d'un capitalisme qu'on nous présentait comme «triomphant» permettra de saper les mensonges déchaînés avec la mort du stalinisme. Enfin, l'intensification inévitables des tensions guerrières impliquant, non seulement des petits Etats de la périphérie, mais bien les pays centraux du capitalisme, là où sont concentrés les plus forts détachements du prolétariat mondial, comme la guerre du Golfe nous en a donné un avant-goût, contribuera à porter un coup majeur aux mensonges de la bourgeoisie et à mettre en évidence les dangers que représente pour l'ensemble de l'humanité le maintien du capitalisme.
C'est un chemin encore long et difficile qui attend la classe ouvrière. Il appartient aux organisations révolutionnaires, par leur dénonciation, aussi bien des campagnes idéologiques sur «la fin du communisme» que des manoeuvres visant aujourd'hui à entraîner les ouvriers dans des impasses, de contribuer activement à la future reprise des combats de la classe sur ce chemin vers son émancipation.
FM, 6/12/91[1] [349] La nouvelle de la constitution de cette « communauté » étant parvenue au moment du bouclage de ce numéro, voir l'ajout de dernière minute note 6 sur cet événement.
[2] [350] Voir Revue Internationale n° 66 et 67.
[3] [351] «... Quelle que soit l’évolution future de la situation dans les pays de l'Est, les événements oui les agitent actuellement signent la crise historique, l'effondrement définitif du stalinisme... Dans ces pays s'est ouverte une période d'instabilité, de secousses, de convulsions, de chaos sans précédent dont les implications dépasseront très largement leurs frontières» (...). Les mouvements nationalistes qui, à la faveur du relâchement du contrôle central du parti russe, s'y [en URSS] développent aujourd'hui... portent avec eux une dynamique de séparation d'avec la Russie. En fin de compte, si le pouvoir central de Moscou ne réagissait pas, nous assisterions à un phénomène d'explosion, non seulement du bloc russe, mais également de sa puissance dominante. Dans une telle dynamique, la bourgeoisie russe, qui aujourd'hui domine la deuxième puissance mondiale, ne serait plus à la tête que d'une puissance de second plan, bien plus faible que l'Allemagne, par exemple ». (« Thèses sur la crise économique et politique dans les pays de l'Est », 15/9/89, Revue Internationale n°60)
[4] [352] Voir éditorial, Revue Internationale n° 67.
[5] [353] Voir article sur la récession
dans ce numéro.
[6] [354] La constitution le 8 décembre d'une « communauté d'Etats » par la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie ne peut qu'aggraver cette situation. Cet ersatz d'Union qui ne regroupe que des républiques slaves ne peut qu'attiser le nationalisme parmi les populations non-slaves dans les autres républiques de l'ex-URSS mais aussi en Russie même. Loin de stabiliser la situation, l'accord entre Eltsine et ses acolytes contribue à la dégrader encore un peu plus dans une région du monde truffée d'armes nucléaires.
[7] [355] Sur la décomposition, voir notamment Revue Internationale n° 57, n° 62 et n° 64.
[8] [356] Avec l'approche de l'hiver, la situation des populations Kurdes est encore pire qu'elle n'était après la Guerre du Golfe. Mais comme on ne sait décidément pas qu'en faire et qu'elles deviennent « encombrantes » pour les pays voisins (notamment pour la Turquie qui n'hésite pas, bien qu'elle fasse partie des « bons », à utiliser contre elles les mêmes méthodes que Saddam Hussein, tels les bombardements aériens), il est préférable de suspendre discrètement toute aide internationale à leur égard et de se retirer sur la pointe des pieds en leur conseillant de retrouver leurs localités d'origine, c'est-à-dire de se jeter dans les bras de leurs bourreaux. Le massacre des Kurdes par la soldatesque de Saddam Hussein était un excellent sujet pour les « unes » des journaux télévisés lorsqu'il s'agissait de justifier a posteriori la guerre contre l'Irak. C'est pour cela que les « coalisés » avaient préparé ce massacre en incitant, pendant la guerre, ces populations à se soulever contre Bagdad et en laissant à Saddam, après celle-ci, les troupes nécessaires à cette « opération de police». Mais, aujourd'hui, le calvaire des Kurdes a perdu son intérêt pour les campagnes de propagande : désormais, pour la bourgeoisie « civilisée », il est préférable qu'ils crèvent en silence.
[9] [357] Voir « Vers le plus grand chaos de l'histoire » dans ce numéro.
[10] [358] Cela ne veut pas dire, d'ailleurs, qu'il y ait une réelle « harmonie » entre ces autre puissances. Ainsi, la France, par exemple, qui ambitionne de résister au leadership américain, a constitué, contre la Grande- Bretagne notamment, une alliance avec l'Allemagne au sein de la CEE avec l'objectif, à la fois de faire contre-poids à l'influence des Etats-Unis et « d'encadrer » les ambitions de grande puissance de son al lié allemand (sur lequel elle a au moins l'avantage de disposer de l'arme atomique). C'est bien pour cette raison, d'ailleurs, que la France est le plus chaud partisan des projets permettant à la communauté européenne, comme un tout, d'affirmer une certaine indépendance militaire : construction d'une navette spatiale européenne, constitution d'une division mixte franco-allemande, renforcement des compétences diplomatiques de l'exécutif européen, soumission de l'Union de l'Europe Occidentale (seul organisme européen ayant des attributions militaires) au Conseil de l'Europe (et non à l'OTAN oui est dominé par les Etats-Unis). Et c'est, bien entendu, ce dont la Grande- Bretagne ne veut pas.
[11] [359] Ceci dit, même si Israël n'a plus la même marge de manoeuvre que par le passé, ce pays, oui a su faire preuve lors de la guerre du Golfe de « sens des responsabilités » à l'avantage des Etats-Unis, reste le pion essentiel de la politique américaine dans la région : c'est lui qui dispose de l'armée la plus puissante et moderne (avec notamment plus de deux cents têtes nucléaires) et il ne cesse (grâce notamment aux 3 milliards de dollars annuels de l'aide américaine) de renforcer son potentiel militaire. En outre, il est dirigé par un régime bien plus stable que celui de tous les pays arabes. C'est pour cela que les Etats-Unis ne sont pas prêts de lâcher la proie pour l'ombre en renversant leurs alliances privilégiées. En ce sens, toutes les tergiversations d'Israël face à la pression des Etats-Unis avant la rencontre de Madrid et celle de Washington, étaient bien plus un moyen de faire monter les enchères auprès des pays arabes que l'expression d'une opposition de fond entre entre les deux Etats.
[12] [360] Ainsi on peut voir à quel point cette organisation est devenu un simple instrument de la politique américaine : elle est vivement sollicitée lorsqu'il s'agit de «mouiller» des alliés récalcitrants (comme lors de la guerre du Golfe) mais elle est mise à l'écart lorsqu'elle pourrait permettre à ces mêmes alliés de jouer un rôle sur la scène internationale.
[13] [361] C'est pour cela que, malgré la disparition du bloc occidental (résultant de celle de son rival de l'Est, .il n'existe pas actuellement de menace sur la structure fondamentale que s'était donné ce bloc et que dominent totalement les Etats-Unis, ÎOTAN. C'est bien ce qui s'exprime clairement dans le document adopté le 8 novembre par la réunion au sommet de cette organisation : « La menace d'attaque massive et simultanée sur tous les fronts européens de l'OTAN a bel et bien été éliminée ... [les nouveaux risques proviennent] des conséquences négatives d'instabilités qui pourraient découler des graves difficultés économiques, sociales et politiques, y compris les rivalités ethniques et tes litiges territoriaux que connaissent de nombreux pays d'Europe centrale et orientale. » Dans le contexte mondial de disparition des blocs, on assiste donc, à l'heure actuelle, à une reconversion de l'OTAN, ce qui a permis à Bush d'affirmer avec satisfaction à la fin de la rencontre : « Nous avons montré que nous n'avons pas besoin de la menace soviétique pour exister. »
[14] [362] Voir« France : les "coordinations" sabotent les luttes », Revue Internationale n° 56, 1er trimestre 1989
Questions théoriques:
- Décomposition [3]
- Impérialisme [321]
Crise économique : crise du crédit, relance impossible, une récession toujours plus profonde
- 3319 reads
L'économie américaine poursuit sa plongée dans l'enfer de la récession et entraîne la production mondiale dans son sillage. L'optimisme de façade affiché par les dirigeants américains depuis le printemps 1991 n'a pas survécu à l'été. Depuis septembre les chiffres pleuvent qui rendent toute illusion impossible. La confiance dans la perspective toujours renouvelée du capitalisme, qui, tel un phénix renaissant de ses cendres, serait toujours capable, après une récession passagère, de retrouver le chemin vers une croissance sans limite, n'est plus de mise. La dure réalité de la crise économique se charge défaire ravaler leurs déclarations triomphantes, à ceux qui, il y a à peine deux ans, avec l'effondrement économique du «modèle» stalinien du capitalisme, saluaient la victoire du capitalisme libéral comme seule forme viable de survie de l'humanité.
Le plongeon dans la récession
L'économie américaine patine depuis deux ans, incapable de sortir du marasme. Depuis l'arrivée de Bush a la présidence, la «croissance» du PNB a été, en moyenne, de 0,3%. Après trois trimestres de récession du PNB, en chiffres officiels, l'embellie du 3e trimestre, avec 2,4 % de croissance, n'a rassuré aucun capitaliste. Les responsables économiques s'attendaient à un résultat bien meilleur, de 3 à 3,5 %. La publication au même moment du chiffre de la croissance mensuelle de la production industrielle de septembre 1991: 0,1%, en baisse régulière depuis juin, est venue renforcer la sinistrose ambiante dans les milieux responsables de la bourgeoisie.
Le mensonge de la prospérité de l'économie capitaliste, le CCI l'a constamment dénoncé dans sa presse. La récession ouverte présente, dans toutes ses caractéristiques, n'est pas une surprise, mais la confirmation éclatante de la nature catastrophique et inéluctable de la crise de l'économie capitaliste mise en évidence par les marxistes depuis des générations, et que le CCI s'est attaché à démontrer tout au long de son histoire.
Sur l'analyse de la situation actuelle, voir les articles publiés ces dernières années dans la rubrique sur la crise économique de la Revue Internationale, que nous conseillons aux lecteurs intéressés :
« La perspective d'une récession n'est pas écartée, au contraire » (n° 54, 2e trim. 1988),
« Le crédit n'est pas une solution éternelle » (n° 56),
« Bilan économique des années 1980 : l'agonie barbare du capitalisme décadent » (n° 57),
« Après l'Est, l'Ouest » (n° 60),
« La crise du capitalisme d'État, l'économie mondiale s'enfonce dans le chaos » (n° 61),
« L'économie mondiale au bord du gouffre » (n° 64),
« La relance de la chute de l'économie mondiale » (n°66, 3e trim. 1991).
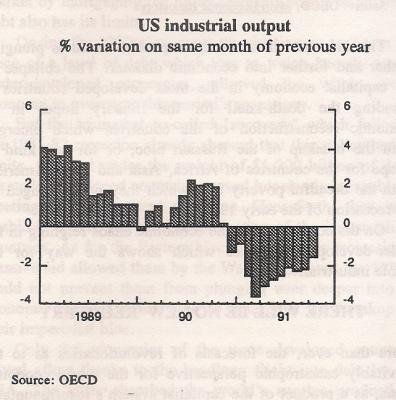
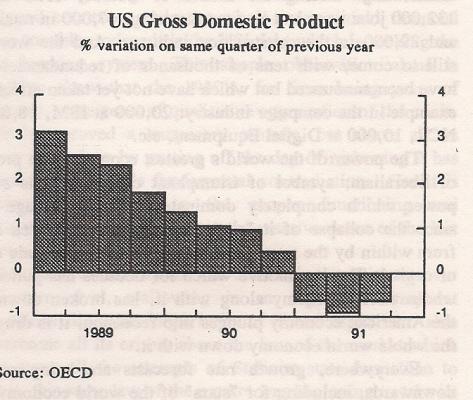
L'économie américaine voit s'avancer devant elle la perspective d'une plongée encore plus profonde dans a récession. Et toute l'économie capitaliste mondiale en tremble sur ses bases.
Au-delà des indices de toutes sortes qui sont quotidiennement publiés dans le monde entier, chaque jour qui passe amène son flot de mauvaises nouvelles.
Le chiffre « optimiste » de 2,4 % de croissance pour le 3e trimestre 1991 ne signifie même pas une amélioration pour les entreprises. Au contraire, la concurrence s'exacerbe, la guerre des prix fait rage et les marges bénéficiaires tondent comme neige au soleil. En conséquence, ce ne sont pas simplement les profits qui sont en chute libre, mais ce sont surtout des pertes énormes qui s'accumulent. Tous les secteurs sont touchés. On peut citer, comme exemples spectaculaires parmi bien d'autres, les résultats de quelques ténors de l'économie américaine durant cette période.
Pour redresser ces bilans désastreux les «plans de restructuration » succèdent aux « plans de redressement», ce qui concrètement signifie fermetures d'usines, donc licenciements, et attaques contre les salaires. Les entreprises les plus faibles font faillite et leurs employés, mis sur le pavé, viennent grossir la cohorte grandissante des chômeurs et des miséreux.
Tableau 1 : La chute des profits des grandes entreprises US
Alors qu'il y a peu, Reagan prétendait avoir terrassé le chômage, surtout en fait en permettant le développement des « petits boulots » précaires et mal rémunérés, et en truquant honteusement les modalités de calcul, celui-ci a crû régulièrement de 5,3 % de la population active, fin 1988, à 6,8%, en octobre 1991. Il faut savoir qu'un pourcentage de 0,1 % d'augmentation de ce taux, apparemment insignifiant, représente environ 130 000 chômeurs de plus. Tout cela, bien sur, en chiffres gouvernementaux, dont on sait combien ils sous-estiment la réalité. Et la tendance ne fait que s'accélérer. Pour le seul mois d'octobre 1991, 132000 emplois ont été perdus dans l'industrie manufacturière, 47 000 dans le commerce de détail, et 29 000 dans la construction. Et le plus dur est à venir, avec des dizaines de milliers de licenciements annoncés qui ne sont pas encore comptabilisés, entre autres dans le secteur informatique : 20 000 chez IBM, 18 000 chez NCR, 10 000 chez Digital Equipment, etc.
Le potentiel de la première économie du monde, chantre du libéralisme, symbole du capitalisme triomphant, super-puissance impérialiste qui, après l'effondrement économique de son grand rival « soviétique », domine de loin l'arène internationale, est miné de l'intérieur par les ravages de la crise économique du capital dans le monde entier. La locomotive qui tirait 1’économie mondiale depuis des décennies, est en panne. Avec la plongée de l'économie américaine dans la récession, c'est toute l'économie mondiale qui se ralentit et s'enfonce avec elle.
Dans tous les pays, les taux de croissance sont revus à la baisse, y compris pour les « stars » de l'économie mondiale que sont le Japon et l'Allemagne. Pour ceux qui étaient déjà dans la récession, tels le Canada et la rrande-Bretagne, les illusions de renouer avec la croissance s'envoient avec celles des USA.

Sur tous les plans, les USA donnent le LA à l'économie mondiale, et tout comme aux USA, la dynamique de récession en Europe et au Japon s'accompagne de son cortège de faillites, avec fermetures d'usines, entraînant bien entendu des licenciements massifs.

Le coeur industriel du monde capitaliste est en train de s'enfoncer plus encore dans la catastrophe économique. L'effondrement de l'économie capitaliste dans les pays les plus développés sonne le glas des espoirs illusoires d'une reconstruction économique des pays issus de l'éclatement du bloc russe, ou d'une quelconque sortie des pays d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Asie de la misère horrible dans laquelle les a fait plonger la récession du début des années 1980.
Dans la dynamique d'effondrement où se trouve l'économie mondiale, c'est au contraire le chaos économique qui règne dans les pays sous-développés qui représente la perspective vers laquelle se précipite l'ensemble du monde industriel.
Une nouvelle « relance » est impossible
Plus que jamais se trouvent confirmées les prévisions des révolutionnaires sur la perspective catastrophique inéluctable de la crise économique mondiale, comme produit des contradictions insurmontables du système capitaliste.
Ce constat de la faillite implacable de l'économie capitaliste, la classe dominante, évidemment, ne peut l'accepter, car il signifie sa propre perte. C'est pour cette raison, que les belles phrases sur la « relance » future de l'économie relèvent autant de la nécessaire propagande destinée à rassurer les foules inquiètes, que de l'auto persuasion de la bourgeoisie, qui a besoin de croire à l'éternité de son système. Il est vrai, d'ailleurs, que la capacité qu'a eu le capitalisme dans le passé pour pallier et masquer les effets les plus brutaux de la crise, ne peut que renforcer cette illusion.
Les mesures pour « relancer » sont usées et aggravent la situation
Depuis la fin des années 1960, depuis le retour de la crise ouverte du capitalisme qui met fin aux années de croissance de la reconstruction d'après la 2e guerre mondiale, l'économie américaine, et l'économie mondiale à sa suite, se sont offertes plusieurs plongeons successifs dans la récession : en 1967, en 1969-70, en 1974-75, en 1981-82. Chaque fois, les capitalistes ont cru avoir définitivement vaincu le spectre du recul de la production, avoir découvert le remède efficace qui renverrait aux poubelles de l'histoire les prévisions du marxisme authentique. Mais chaque fois, les effets de la crise se sont redéployés, de manière toujours plus large, toujours plus forte et toujours plus profonde.
Les fameux remèdes, chaque fois présentés comme des innovations décisives (il y a peu, les économistes parlaient encore pompeusement des « reaganomics », pour saluer les <r apports » déterminants de Reagan à a science économique), sont en fait les mesures théorisées et préconisées par Keynes, appliquées depuis les années 1930. C'est une politique de capitalisme d'Etat, qui se caractérise par : la baisse du taux d'escompte des banques centrales, le déficit budgétaire, une intervention de plus en plus massive et contraignante de l'Etat dans tous les secteurs de l'économie, avec, en plus, la mise en pratique généralisée de l'économie de guerre, qui relève autant de l'imitation de la politique économique de capitalisme d'Etat mise en place par Hitler, que de l'application des théories keynésiennes. Ces artifices économiques reposent en fait essentiellement sur le développement du crédit et un endettement croissant.
La crise économique du capitalisme est en réalité une crise de surproduction généralisée, produite par l'incapacité a trouver, à l'échelle mondiale, des débouchés solvables, capables d'absorber la production. Le développement du crédit est par excellence le moyen pour élargir artificiellement le marché en tirant des traites sur l'avenir. Mais cette politique d'endettement généralisé trouve aussi ses limites.
Durant les années 1970, la relance par le crédit facile, au prix d'un endettement qui va lourdement peser sur l'économie des pays sous-développés, permet à l'ensemble de l'économie mondiale de surmonter les phases de récession de cette période. Mais, la soi-disant «reprise» triomphale de l'économie qui succède à la récession de 1981-82 va déià montrer les limites de cette politique. Ecrasés par le poids d'une dette qui atteint alors 1 200 milliards de dollars, les pays sous-développés sont définitivement incapables de faire face aux échéances de leur dette. Ils sont dorénavant incapables d'absorber le surplus de la production des pays industrialisés. Quant aux pays de 'Est, malgré les crédits de plus en plus massifs octroyés par l'Occident tout au long des années 1980, ils vont s enfoncer dans le marasme économique qui déterminera l'implosion du bloc impérialiste qu'ils constituent.
Seules les économies des pays les plus développés sont maintenues à flot par la politique de fuite en avant dans l'endettement des USA. Ceux-ci absorbent le surplus de la production mondiale, qui ne peut plus s'écouler vers le « tiers-monde », en laissant se creuser des déficits commerciaux colossaux, et maintiennent la « croissance » de leur économie en accumulant des déficits budgétaires gigantesques qui financent essentiellement la production d'armements. Le développement d'une spéculation effrénée sur les marchés immobilier et boursier permet d'attirer aux USA des capitaux du monde entier. Mais il va surtout gonfler artificiellement les bilans des entreprises et créer l'illusion dangereuse d'une activité économique intense.
A la fin des années 1980 le capital US nage sur un océan de dettes phénoménal. Elles sont d'autant plus difficiles à quantifier que le dollar s'est imposé comme monnaie internationale utilisée dans le monde entier et que, par conséquent, il n'est pas réellement possible de distinguer la dette interne et externe. Si la dette extérieure des USA peut être estimée aujourd'hui à environ 900 milliards de dollars, et bat donc ainsi déjà tous les records, la dette interne atteint quant à elle le chiffre astronomique de 10 000 milliards de dollars, près de deux fois le PNB annuel des Etats-Unis. C'est-à-dire que, pour la rembourser, il faudrait que tous les travailleurs américains restent deux années à travailler sans toucher un sou !
Cette fuite effrénée des USA dans l'endettement, non seulement n'a pas permis de relancer réellement l'ensemble de l'économie mondiale durant les années 1980, mais surtout, elle n'a pas pu empêcher que, peu à peu, les signes de la crise ouverte et de la récession, ne ressurgissent avec déplus en plus de vigueur à la fin de la décennie. L'effondrement à répétition de la spéculation boursière à partir de 1987, l'effondrement de la spéculation immobilière depuis 1988 qui provoquent des faillites bancaires en série ont été les indicateurs de la chute de la production qui a déterminé la récession ouverte, officiellement reconnue fin 1990.
Le crédit à bout de souffle
Dans ces conditions, la nouvelle plongée dans la récession qui commence avec cette décennie, ne traduit pas seulement l'incapacité fondamentale du capitalisme à trouver des débouchés solvables pour écouler sa production, mais aussi l'usure des moyens économiques qu'il a jusque-là employés pour pallier cette contradiction insurmontable. Les différentes « reprises » qui ont eu lieu depuis 20 ans débouchent sur une crise du crédit avec, au coeur de cette crise, la première puissance économique mondiale : les USA.
Alors qu'au début des années 1980, c'est la dette des pays sous-développés qui faisait trembler le système financier international, au début des années 1990, c'est la dette des Etats-Unis qui fait vaciller le système bancaire mondial sur ses bases. Ce simple constat montre amplement que, loin d'être des années de prospérité, les années 1980 ont été des années d'aggravation qualitative de la crise. La potion du crédit a été un remède provisoire, et surtout illusoire, car en reculant les échéances, il ne pouvait que pousser les contradictions à s'aggraver toujours plus. Si le crédit est traditionnellement nécessaire au bon fonctionnement et au développement du capital, employé à dose massive, comme c est le cas depuis plus de 20 ans, il constitue un poison violent.
Alors même que le capitalisme occidental fêtait sa victoire sur son rival du bloc de l'Est, se vautrant avec délices dans une orgie de déclarations triomphantes sur la « supériorité du capitalisme libéral », capable de surmonter toutes les crises, sur la vérité de la loi du marché, qui balayait toutes les tricheries brutales et caricaturales du capitalisme d'Etat à la sauce stalinienne, cette même loi du marché commençait rapidement à prendre une revanche éclatante sur tous les mensonges qui se déversaient à l'Ouest. Bien que depuis deux ans, la Banque Fédérale américaine ait fait baisser 19 fois consécutivement son taux de base, mesure classique de capitalisme d'Etat s'il en est, l'économie réelle ne répond plus à cette stimulation. Non seulement l'offre de nouveaux crédits n'est pas suffisante pour relancer les investissements et la consommation intérieure, et donc ainsi la production, mais surtout les banques veulent de moins en moins prêter des capitaux, sachant pertinemment qu'ils ne leur seront jamais remboursés, ce qui, somme toute, est dans la logique du marché capitaliste.
Après les débâcles boursières de 1987 et 1989, Wall Street le 15 novembre 1991, enregistre la cinquième plus forte baisse de son histoire. Ce nouvel accès de faiblesse malgré la mise en place, après 1989, de toute une série de mesures de contrôle draconiennes, est le reflet de la contradiction de fond entre le développement de la spéculation effrénée, qui avait repris de plus belle après 1989, et la réalité de l'économie qui s'enfonce de plus en plus dans le rouge.
Cependant, l'événement conjoncturel, facteur déclenchant aux USA ce nouvel affaissement des cours de la bourse, est aussi significatif. Ce fut le mécontentement des banques devant la volonté du gouvernement d'imposer autoritairement la baisse des taux d'intérêt sur les cartes bancaires. Alors que les banques accumulent les défauts de remboursement et sont obligées de provisionner des pertes de plus en plus importantes, le haut niveau des taux sur les crédits à la consommation : 19 %, demeure le seul moyen pour rétablir leurs comptes déficients. Devant la ronde des milieux bancaires, Bush a du faire marche arrière pour rassurer le marché, comme il avait du reculer quelques jours plus tôt devant le refus du Congrès d'entériner son premier projet de réforme du système bancaire qui aurait signifié la faillite en série des banques les plus faibles. Tout le système de crédit aux USA est au bord de l'asphyxie, à un moment où l'Etat le sollicite toujours plus pour tenter de financer la relance. De nouvelles faillites retentissantes se profilent à l'horizon. Pour tenter d'y faire face le Congrès vient de voter l'allocation de 70 milliards de dollars au FDIC, le fond de garantie fédéral des banques. Cependant, cette somme qui déjà paraît énorme sera à l'évidence bien insuffisante pour combler les pertes qui s'annoncent. Pour s'en rendre compte il suffit de se remémorer le trou laissé par la faillite de centaines de caisses d'épargne avec l’effondrement du marché immobilier depuis 1989 : 1000 milliards de dollars !
Le fait que l'Etat vienne au secours des banques en faillite ne résout rien du tout. Au contraire, ceci ne fait que reporter le problème à un niveau plus élevé. Ces nouvelles ponctions sur le budget creusent un peu plus le déficit de l'Etat, accroissant les dépenses, au moment où les rentrées fiscales diminuent avec le ralentissement de l'activité économique. Pour 1991, certaines estimations tablent sur un nouveau déficit budgétaire record de 400 milliards de dollars. Pour combler ce trou qui ne cesse, année après année, de s'élargir, l'Etat américain a besoin de faire appel aux capitaux du monde entier en tentant de placer ses bons du trésor.
Plus de « locomotive » pour l'économie mondiale
Cette fuite en avant dans l'endettement de l'Etat américain commence elle aussi à trouver ses limites. Les investisseurs du monde entier commencent à considérer l'économie américaine avec une méfiance grandissante. Non seulement, l'endettement pharamineux du capital US pose la question de la capacité de celui-ci à rembourser les crédits contractés, mais en plus, la situation de récession présente fait à juste titre craindre le pire. Et, non seulement les faibles taux d'intérêts offerts, tentative de reprise oblige, ne sont guère attrayants, mais en plus 1’ensemble de la planète est confrontée à une pénurie de crédit.
Les principaux bailleurs de fond de la décennie précédente n'ont plus la même disponibilité: l'Allemagne, elle aussi, a besoin de capitaux pour financer la réintégration de l'ex-RDA, et le Japon, qui a prêté au monde entier, et qui ne voit pas ses crédits remboursés, commence à montrer des signes de faiblesse. L'effondrement de la spéculation immobilière locale et l'affaissement de la bourse de Tokyo placent les banques japonaises dans une situation délicate. La crise de confiance qui touche l'Amérique se voit concrètement dans la baisse de 70 % des investissements étrangers aux USA durant le 1er semestre 199 par rapport au même semestre de l'année précédente. Quant aux investissements japonais, qui ont été les pus importants durant les années 1980, ils ont chuté dans le même temps de 12,3 à 0,8 milliards de dollars.
Dans le monde entier la demande de nouveaux crédits augmente, alors que l'offre se contracte. L'URSS, dont les jours sont comptés, quémande avec insistance de nouveaux prêts simplement pour pouvoir passer l'hiver sans famine ; le Koweït a besoin de capitaux pour reconstruire ; les pays sous-développés ont besoin de nouveaux crédits pour pouvoir continuer à rembourser les anciens ; etc. Alors que l'économie mondiale plonge irrésistiblement dans la récession, tous les pays sont à la recherche frénétique de la même drogue qui les a rendus dépendants et les a plongés, durant des années, dans le rêve illusoire ? D’une sortie de la crise. Partout les mêmes signes sont là qui annoncent une crise financière majeure avec au coeur de la tourmente la principale monnaie du monde, le dollar.
Les capitalistes du monde entier attendent avec angoisse le moment fatidique où les USA n'arriveront plus à placer leurs bons du trésor sur le marché mondial, moment qui se rapproche inéluctablement et qui va ébranler tout le système financier, bancaire et monétaire international, précipitant l'économie mondiale encore plus profondément dans le gouffre insondable d'une crise généralisée qui l'affecte de manière explosive sur tous les plans de son existence.
Quelles que soient les fluctuations immédiates de l'économie américaine, qui focalisent, au jour le jour, l'attention des capitalistes du monde entier, la dynamique vers la chute est déjà tracée. Un sursaut de croissance dans ces conditions ()[1] [363] ne pourra que prolonger de quelques mois les illusions sur l'état du malade, sans rien résoudre. Face à une telle situation les économistes de toute la planète cherchent désespérément une solution. Toutes les mesures envisagées se heurtent à la réalité têtue des faits. Elles sont soit illusoires, soit porteuses de conséquences inévitablement catastrophiques, en tout cas impuissantes à juguler la crise.
Une récession inévitable et le retour de l'inflation
La méthode de la purge brutale, telle que l’avait pratiquée Reagan, après son arrivée à la présidence en 1980, en remontant le taux d'intérêt, ce qui avait provoqué la récession mondiale commencée en 1981, n'aurait pour seul résultat que d'accélérer immédiatement et dramatiquement la récession déjà là. Elle mènerait à déstabiliser violemment l'ensemble de l'économie mondiale, ouvrant une véritable « boite de Pandore» de phénomènes complètement chaotiques et incontrôlables, tout comme ce qu'il reste d'URSS nous en offre déjà l'exemple, mais à l'échelle mondiale.
Il faut d'ailleurs se rappeler que Reagan avait lui-même rapidement mis fin à cette politique de rigueur à haut risque, pour pratiquer ensuite exactement la politique inverse, ce qui permit au capitalisme américain de préserver une stabilité relative dans les pays les plus industrialisés, et donc aussi la défense de ses intérêts impérialistes.
C'est ce second volet de la politique reaganienne, celui de la «reprise», qui est aujourd'hui a bout de souffle. Relancer la consommation par la baisse des impôts est de moins en moins possible, alors que le déficit budgétaire a atteint une profondeur abyssale. Quant à la relance par le crédit, comme on l'a vu, elle se heurte aux limites du marché des capitaux, asséché par les emprunts à répétition de l'Etat américain depuis des années.
L'argent frais que l'Amérique ne peut plus trouver sur le marché mondial, pour faire carburer sa machine économique, elle n'a d'autre solution que de le produire par l'usage intensif de la « planche à billets ». Le retour en force de l'inflation sera le seul résultat d'une telle politique. Cette « solution », du « moins pire » en quelque sorte, freinera probablement quelque peu la chute dans la récession.
En dehors du fait qu'elle mettra définitivement fin au dogme de la lutte contre l'inflation, cheval de bataille de la classe dominante durant des années pour justifier les sacrifices imposés aux prolétaires, elle signifiera aussi un chaos croissant pour l'économie capitaliste, notamment sur le plan du système monétaire international.
La politique suivie par l'administration Bush est typiquement une politique inflationniste qui se traduit par une baisse des cours du dollar. Si l'inflation a pu, jusqu'à présent, être contenue aux USA et dans les pays développés, cela a été dû essentiellement à la concurrence qui s'exacerbe face à un marché qui se rétrécit, provoquant la chute des cours des matières premières, et poussant les entreprises à rogner sur leurs marges bénéficiaires, ainsi qu'aux attaques contre les conditions de vie de la classe ouvrière qui ont fait baisser le « coût de la force de travail ».
Ces aspects typiques des effets de la récession vont aussi rencontrer, à terme, leurs limites. Les conditions pour une nouvelle flambée inflationniste sont en train de se réunir. D'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'en dehors des pays les plus industrialisés, 1 inflation est toujours la, qui ravage l'économie des les pays sous-développés et qui est en train de se développer avec force dans les pays de l'ancien bloc de l'Est.
Jamais dans toute l'histoire du capitalisme la perspective n'a été aussi sombre sur le plan de son économie. Ce que les chiffres et les indices abstraits et froids des économistes annoncent, c'est la catastrophe dans laquelle le monde est en train de plonger.
Le coeur du capitalisme mondial, les pays les plus développés, où sont concentrés les principaux bastions du prolétariat mondial, est maintenant au centre de la tempête. Le grand manteau de misère qui recouvre les exploités du « tiers-monde » et des pays de l’ex-bloc de l'est depuis des années, se prépare à étendre son ombre sur les ouvriers des pays « riches ».
Cette vérité de l'impasse absolue dans laquelle le capitalisme mène l'humanité, de la perspective de misère et de mort qu'il représente, et face a cette tragédie, de la nécessité vitale pour toute l'espèce humaine de remettre à l'ordre du jour la véritable perspective communiste, les prolétaires et les exploités du monde entier vont devoir l'apprendre et la comprendre dans la douleur d'une amputation brutale et dramatique de leurs conditions de vie, à un point qu'ils n'ont jamais connu auparavant.
JJ, 28/11/1991
[1] [364] Dans la mesure où la classe dominante américaine est entrée en plein cirque électoral, il est probable qu'elle va tenter par tous les moyens à sa disposition de maintenir un tant soit peu son économie à flot, afin de perpétuer encore l’illusion, quitte pour cela à tricher encore plus avec ses statistiques. Cette situation ne peut évidemment qu’être tout à fait provisoire, même si un sursis de quelques mois est obtenu.
Récent et en cours:
- Crise économique [28]
Questions théoriques:
- Décadence [32]
Notes sur l'impérialisme et la décomposition : vers le plus grand chaos de l'histoire
- 4369 reads
Les gigantesques bouleversements provoqués par l'effondrement du bloc de l'Est et la dislocation de l'URSS ouvrent-ils une ère plus pacifique ? Face à la menace du chaos, la férocité des rapports entre puissances capitalistes va-t-elle s'atténuer ?La constitution de nouveaux blocs impérialistes est-elle encore possible ? Quelles nouvelles contradictions fait surgir la décomposition capitaliste au niveau de l'impérialisme mondial ?
Les rivalités entre puissances ne disparaissent pas : elles s'exacerbent
Si le monde s'est effectivement profondément modifié depuis l'effondrement du bloc de l'Est, les lois barbares qui régissent la survie de ce système moribond sont, elles, toujours bien présentes. Et, au fur et à mesure que le capitalisme s'enfonce dans la décomposition, leur caractère destructeur, et la menace qu'elles font peser sur la survie même de l'humanité, se renforcent. Le fléau de la guerre, cet enfant monstrueux, mais naturel, de l'impérialisme, est et sera toujours plus présent, et la lèpre du chaos, après avoir plongé les populations du « tiers-monde » dans un enfer sans nom, exerce maintenant ses ravages dans tout l'est de l'Europe.
En fait, derrière les proclamations pacifistes des grandes puissances impérialistes du désormais défunt « bloc » américain, derrière les masques de respectabilité et de bonne entente dont celles-ci s'affublent, les relations entre ces Etats sont en réalité régies par la loi des gangsters. Dans les coulisses, comme n'importe quel truand, c'est à qui volera à l'autre sa part de trottoir, avec qui s'allier pour se débarrasser d'un concurrent aux dents trop acérées, comment faire pour se débarrasser d'un parrain trop puissant. Telles sont les véritables questions qui font l'objet des « débats » entre les bourgeoisies de ces « grands pays civilisés et démocratiques».
«La politique impérialiste n'est pas l’oeuvre d'un pays ou d'un groupe de pays. Elle est le produit de l'évolution mondiale du capitalisme...C'est un phénomène international par nature... auquel aucun Etat ne saurait se soustraire. »([1] [365]). A partir de l'entrée en décadence du capitalisme, l'impérialisme domine la planète toute entière, il est « devenu le moyen de subsistance de toute nation grande ou petite » ([2] [366]). Ce n'est pas une politique «choisie» par la bourgeoisie, ou telle ou telle de ses fractions, c'est une nécessité absolue qui s'impose.
De ce fait, la disparition du bloc de l'Est et celle du bloc de l'Ouest qui en résulte, ne sauraient signifier la fin du «règne de l'impérialisme». La fin du partage du monde entre « blocs », tel qu'il était sorti de la 2e guerre mondiale, ouvre au contraire toute grande la porte au déchaînement de nouvelles tensions impérialistes, à la multiplication des guerres locales et à l'aiguisement des rivalités entre les grandes puissances auparavant disciplinées par le « bloc de l'Ouest».
Les rivalités au sein même des blocs ont toujours existé, et ont parfois éclaté ouvertement, comme par exemple entre la Turquie et la Grèce, tous deux membres de l'OTAN, à propos de Chypre en 1974. Ces rivalités étaient cependant solidement contenues par le corset de fer du bloc de tutelle. Ce corset ayant disparu, les tensions, jusque-là endiguées, ne peuvent que s'exacerber.
Le capital américain face au nouvel appétit de ses vassaux
Pendant des décennies, la soumission de l'Europe et du Japon aux Etats-Unis était le prix de la protection militaire que ces derniers leur accordaient face à la menace soviétique. Cette menace ayant aujourd'hui disparu, l'Europe et le Japon n'ont plus le même intérêt à suivre les diktats américains et le «chacun pour soi» tend à se déchaîner.
C'est ce qui s'est manifesté avec force durant tout l'automne 1990, l'Allemagne, le Japon et la France, essayant d'empêcher le déclenchement d'une guerre qui ne pouvait que renforcer la supériorité américaine ([3] [367]). Les Etats-Unis, en imposant la guerre, en obligeant l'Allemagne et le Japon à payer pour elle et en forçant la France à y participer, ont remporté une claire victoire, car ils ont fait la preuve de la faiblesse des moyens à la disposition de tous ceux qui pourraient être tentés de disputer leur domination. Ils ont fait étalage de leur énorme surpuissance militaire, visant à démontrer qu'aucun autre Etat, quelle que soit sa puissance économique, ne pourrait rivaliser avec eux sur le terrain militaire.
Le « Bouclier » puis la « Tempête du désert » de sinistre mémoire, guerre imposée et menée d'un bout à l'autre par Bush et son équipe, en faisant taire momentanément les velléités de « chacun pour soi » dans les pays centraux, avait en fait, en dernière instance, pour principale fonction de prévenir et de contrecarrer la reconstitution potentielle d'un bloc rival, à préserver pour les Etats-Unis leur statut de seule super-puissance.
«Cependant, cette réussite immédiate de la politique américaine ne saurait constituer un facteur de stabilisation durable de la situation mondiale dans la mesure où elle ne pouvait affecter les causes mêmes du chaos dans lequel s'enfonce la société. Si les autres puissances ont dû remiser pour un temps leurs ambitions, leurs antagonismes de fond avec les Etats-Unis n'ont pas disparu pour autant, c'est bien ce qui se manifeste avec l'hostilité larvée que témoignent des pays comme la France et l'Allemagne vis-à-vis des projets américains de réutilisation des structures de l'OTAN dans le cadre d'une "force de réaction rapide", dont le commandement reviendrait, comme par hasard, au seul allié fiable des Etats-Unis, la Grande-Bretagne. » ([4] [368])
Depuis, l'évolution de la situation a confirmé pleinement cette analyse. L'état des relations entre Etats de la CEE, et plus particulièrement entre certains d'entre eux comme la France et l'Allemagne, et les Etats-Unis, que ce soit à propos de l'avenir de l'OTAN et de la « défense européenne », ou vis-à-vis de la crise yougoslave, est une illustration des limites du coup de frein que la guerre du Golfe a exercé face au chacun pour soi au sein des principales puissances capitalistes.
Aujourd'hui, remettre en cause l'actuel partage impérialiste, partage qui est toujours imposé par la force, c'est obligatoirement s'attaquer à la première puissance mondiale, les Etats-Unis, ceux-ci étant les principaux bénéficiaires de ce partage. Et, comme l'ex-URSS n'a plus du tout les moyens de participer au premier rang à la curée impérialiste, désormais les plus grandes tensions impérialistes se situent au sein même des « vainqueurs de la guerre froide », c'est-à-dire entre Etats centraux du défunt bloc de l'Ouest ([5] [369]).
Mais dans la foire d'empoigne de l'impérialisme, la disparition d'un système de blocs engendre organiquement une tendance à la constitution de nouveaux blocs, chaque Etat ayant besoin d'alliés pour mener une lutte par définition mondiale. En effet, les blocs sont «la structure classique que se donnent les principaux Etats dans la période de décadence pour "organiser" leurs affrontements armés, ([6] [370])
Vers de nouveaux blocs ?
L'accroissement actuel des tensions impérialistes contient la tendance vers la reconstitution de nouveaux blocs, dont l'un serait forcément dirigé contre les Etats-Unis. Cependant, l'intérêt à une telle reconstitution varie considérablement selon les Etats.
Qui?
La Grande-Bretagne n'y a, elle, aucun intérêt, puisqu'elle trouve largement son compte dans son alliance indéfectible avec la politique américaine ([7] [371]).
Pour toute une série de pays, comme, par exemple, les Pays-Bas et le Danemark, il y a l'appréhension d'être absorbés pratiquement au cas où ils se feraient les alliés d'une super-puissance allemande en Europe, ce qui serait favorisé par les liens économiques qui existent déjà et par la proximité géographique et linguistique. Suivant le vieux principe de stratégie militaire qui recommande de ne pas s'allier avec un voisin trop puissant, ils n'ont que très peu d'intérêts à remettre en cause la domination américaine.
Pour une puissance plus importante mais moyenne comme la France, contester le leadership américain et participer à un nouveau bloc n'est pas non plus très évident car, pour ce faire, elle doit suivre la politique allemande, alors que l'Allemagne est pour l'impérialisme français le rival le plus immédiat et le plus dangereux, comme les deux guerres mondiales l'ont montré. Coincée entre l'enclume allemande et le marteau américain, la politique impérialiste de la France ne peut qu'osciller entre les deux. Cependant, à l'image du mode de production dont il est le reflet, l'impérialisme n'est pas un phénomène rationnel. La France, bien qu'elle ait beaucoup à y perdre et bien que ses futurs gains éventuels soient des plus hasardeux, joue plutôt, pour le moment, la carte allemande, et tend à s'opposer à la tutelle américaine, à propos de l'OTAN et avec la constitution d'une brigade franco-allemande. Ceci, cependant, ne saurait exclure d'autres retournements.
En revanche, les choses sont beaucoup plus claires pour des puissances de premier plan comme l'Allemagne et le Japon. Pour elles, retrouver un rang impérialiste en conformité avec leur force économique, ne peut signifier qu'une remise en cause de la domination mondiale exercée par les USA. De plus, seuls ces deux Etats ont potentiellement les moyens de pouvoir prétendre jouer un rôle mondial. Mais les chances de l'un et de l'autre, dans la course au leadership d'un futur bloc antagoniste aux USA, ne sont pas les mêmes.
Il ne faut pas sous-estimer la force et l'ambition de l'impérialisme japonais. Lui aussi tend à rentrer dans la curée impérialiste. En attestent le projet de modification de la constitution en vue d'autoriser l'envoi à l'extérieur de troupes nippones, le renforcement important de sa marine de guerre, sa volonté de plus en plus fermement affichée de récupérer les îles Kouriles aux dépens de l'URSS, ou encore certaines déclarations sans ambages de ces responsables japonais disant « il est temps que le Japon se libère de ses liens avec les Etats-Unis.([8] [372]) ». Mais le Japon, par sa position géographique excentrée vis-à-vis de la plus grande concentration industrielle mondiale, qui reste le champ principal des rivalités impérialistes, c'est-à-dire l'Europe, ne peut pas véritablement rivaliser dans cette course avec l'Allemagne.
L'impérialisme japonais cherche donc à étendre son influence et à avoir les coudées plus franches en essayant pour le moment de ne pas s'opposer trop ouvertement au grand parrain nord-américain. L'Allemagne, au contraire, par sa place centrale en Europe et sa puissance économique, est de plus en plus poussée à s'opposer à la politique américaine, et se retrouve de façon croissante au centre des tensions impérialistes, comme le manifestent ses réticences devant les projets américains concernant l'OTAN, sa volonté de la mise sur pied d'un embryon de « défense européenne », et plus encore son attitude en Yougoslavie.
Le capital allemand, « pousse-au-crime » en Yougoslavie
L'impérialisme allemand a joué en Yougoslavie le rôle de véritable « pousse-au-crime » en soutenant les velléités sécessionnistes Slovènes et surtout croates, comme en témoigne la volonté répétée de l'Allemagne de reconnaître unilatéralement l'indépendance de la Croatie. Historiquement, l'Etat yougoslave avait été créé de toutes pièces pour contrer l'expansionnisme impérialiste allemand en lui interdisant l'accès à la Méditerranée ([9] [373]). On comprend dès lors que la volonté d'indépendance croate ait représenté une véritable aubaine pour la bourgeoisie allemande qui a cherché à en tirer un maximum de profit. Vu ses liens étroits avec les dirigeants de Zagreb, l'Allemagne espérait bien pouvoir, en cas d'indépendance, utiliser les précieux ports croates sur l'Adriatique. Elle aurait pu ainsi réaliser un objectif stratégique vital : l'accès à la Méditerranée. C'est pourquoi l'Allemagne, avec l'aide de l'Autriche,([10] [374]) n'a cessé d'attiser les braises en soutenant ouvertement ou en coulisses le sécessionnisme croate, ce qui ne pouvait qu'accélérer la dislocation de la Yougoslavie.([11] [375])
Les Etats-Unis font échec à l'Allemagne
Consciente de la gravité de l'enjeu, la bourgeoisie américaine a tout fait, au delà de son apparente discrétion, pour contrer et briser, avec l'aide de l'Angleterre et des Pays-Bas, cette tentative de percée de l'impérialisme allemand. Son Cheval de Troie au sein de la CEE, la Grande-Bretagne, s'est systématiquement opposée à tout envoi d'une force militaire européenne d'intervention. L'appareil militaro-stalinien serbe, signant et violant autant de cessez-le-feu organisés par l'impuissante et pleurnicharde CEE, a pu méthodiquement mener en Croatie une véritable guerre de reconquête, avec le silence consentant des Etats-Unis.
D'ores et déjà, l'échec allemand en Yougoslavie est patent, comme sont patentes la division et l'impuissance totale de la CEE. Cet échec exprime bien toute la force, tous les atouts que conserve la première puissance mondiale dans la lutte pour le maintien de son hégémonie, et souligne les énormes difficultés qu'aura l'impérialisme allemand pour pouvoir être en mesure de disputer réellement la domination mondiale des Etats-Unis.
Cependant, cela ne signifie, ni le retour à une certaine stabilité en Yougoslavie, car la dynamique enclenchée condamne ce pays à s'enfoncer toujours plus dans une situation à la libanaise, ni que désormais l'Allemagne va renoncer et se plier docilement aux diktats de l’ « Oncle SAM». L'impérialisme allemand a perdu une bataille, mais il ne peut renoncer à chercher à soulever la tutelle américaine, ce dont témoigne déjà sa décision de mettre sur pied un corps d'armée, conjointement avec la France, marquant clairement une volonté de plus grande autonomie vis-à-vis de l'OTAN et donc des USA.
Le chaos entrave la constitution de nouveaux blocs
Si on doit reconnaître l'existence, dès à présent, d'une tendance à la reconstitution de nouveaux blocs impérialistes, processus au sein duquel l'Allemagne occupe, et occupera de plus en plus, une place centrale, rien ne permet d'affirmer que cette tendance pourra réellement aboutir, parce qu'elle se heurte, du fait de la décomposition, à toute une série d'obstacles et de contradictions particulièrement importants et pour une large part totalement inédits.
Tout d'abord l'Allemagne n'a pas pour le moment, et c'est une différence fondamentale avec la situation qui précède la première comme la deuxième guerre mondiale, les moyens militaires de ses ambitions impérialistes. Elle est largement démunie face à la formidable surpuissance américaine ([12] [376]). Pour réunir des moyens conformes à ses ambitions, il lui faudrait du temps, au minimum 10 à 15 ans, alors même que les USA font tout pour empêcher le développement de tels moyens. Mais plus encore, pour parvenir à instaurer l'économie de guerre nécessaire à un tel effort d'armement, la bourgeoisie doit arriver à imposer au prolétariat en Allemagne une véritable militarisation du travail. Et cela elle ne peut l'obtenir qu'en infligeant une totale défaite à la classe ouvrière, défaite dont les conditions sont pour le moment loin d'être réunies. Ainsi, même si l'on s'en tient là, les obstacles à franchir sont déjà de taille.
Mais, par ailleurs, il existe un autre facteur, tout aussi essentiel, qui contrarie l'évolution vers la reconstitution d'un « bloc » sous leadership allemand : le chaos qui envahit un nombre toujours plus grand de pays. Non seulement celui-ci rend beaucoup plus difficile l'obtention de la discipline nécessaire à la mise sur pied d'un «bloc» d'alliances impérialistes, mais la bourgeoisie allemande, comme toutes les autres bourgeoisies des pays les plus développés, et avec encore beaucoup plus d'acuité étant donnée sa position géographique, redoute l'avancée de ce chaos. C'est d'ailleurs cette crainte, à laquelle se sont ajoutées les pressions des USA, qui ont fait que l'Allemagne, malgré toutes ses réticences, a finalement soutenu Bush, comme l'ont fait le Japon et la France, dans sa guerre du Golfe. Malgré son désir d'échapper à la tutelle américaine, la bourgeoisie allemande sait que, pour le moment, seuls les Etats-Unis ont les moyens de freiner quelque peu le chaos.
Aucune grande puissance impérialiste n'a intérêt à la propagation du chaos : arrivée massive d'immigrés, immigrés qui ne peuvent pas être intégrés dans la production alors qu'on procède déjà à des licenciements massifs ; dissémination incontrôlée des armements, y compris d'énormes stocks d'armes atomiques ; risques de catastrophes industrielles majeures, en particulier nucléaires ; etc. Tout ceci ne peut que déstabiliser les Etats qui y sont exposés, et rendre beaucoup plus difficile la gestion de leur capital national. Si le pourrissement sur pied du système est, dans les conditions actuelles, profondément négatif pour l'ensemble de la classe ouvrière, il menace également la bourgeoisie et la conduite de son système d'exploitation. En première ligne face aux conséquences les plus dangereuses de l'effondrement du bloc de l'Est, face à l'implosion de l'URSS, l'Allemagne est contrainte de rallier, au moins en partie, les injonctions des seuls qui ont la capacité de faire le «gendarme» au niveau international : les USA.
Ainsi, dans cette période de décomposition, chaque bourgeoisie nationale des pays les plus développés est placée devant une nouvelle contradiction :
- assumer la défense de ses propres intérêts impérialistes, et affronter ses principaux concurrents de même rang, au risque d'accélérer le développement d'une situation de chaos ;
- se défendre contre l'instabilité et les manifestations dangereuses de cette décomposition, en préservant l’« ordre » mondial qui lui a permis de garder son rang de puissance capitaliste, au détriment de ses propres intérêts impérialistes face à ses plus grands rivaux.
La tendance à la constitution de nouveaux blocs impérialistes, inscrite dans la tendance générale de l'impérialisme à l'affrontement entre les plus grandes puissances, face à cette contradiction, ne pourra probablement jamais arriver jusqu'à son terme.
Même le «gendarme du monde», les USA, pour qui la lutte contre le chaos s'identifie le plus complètement et immédiatement à la lutte pour le maintien du statu quo dominant, celui de sa position hégémonique, n'échappe pas à ce dilemme. En déclenchant la guerre du Golfe, les Etats-Unis voulaient faire un exemple de leur capacité de «maintien de l’ordre» et obliger à rentrer dans le rang ceux qui pourraient contester leur leadership mondial. Le résultat de cette guerre n'a été qu'une instabilité plus grande dans toute la région de la Turquie à la Syrie, avec notamment la continuation des massacres des populations au Kurdistan, non seulement par la soldatesque irakienne, mais aussi .par l'armée turque ! En Yougoslavie, le soutien implicite des Etats-Unis au camp serbe a permis de barrer la route à la tentative de l'Allemagne d'accéder à la Méditerranée, mais il a aussi mis de l'huile sur le feu, contribuant à ce que la barbarie s'étende à tout le territoire yougoslave, poussant à l'instabilité de toute la région des « Balkans». Le seul moyen, en dernier ressort, dont dispose le « gendarme mondial », le militarisme et la guerre, ne peut qu'aggraver le développement de cette barbarie et la pousser à son paroxysme.
La dislocation de l'URSS aiguise la contradiction entre le « chacun pour soi » et la confrontation au chaos
La dislocation de l'URSS, par ses dimensions, sa profondeur (c'est la Russie qui est maintenant menacée de désintégration), est un facteur d'aggravation considérable du chaos à l'échelle mondiale : risque des plus grands exodes de populations de l'histoire, de dérapages nucléaires majeurs ([13] [377]). Face à un tel cataclysme, la contradiction dans laquelle se trouvent placées les grandes puissances, ne peut qu'être portée à incandescence. D'un côté, un minimum d'unité est nécessaire pour faire face à la situation, de l'autre l'effondrement de l'ex-empire soviétique ne fait qu'aiguiser les appétits impérialistes.
Là encore l'Allemagne se retrouve dans une position particulièrement délicate. L'est de l'Europe, y compris la Russie, représente pour l'impérialisme allemand une zone d'influence et d'expansion privilégiée. Alliances et affrontements avec la Russie ont toujours été au centre de l'histoire du capitalisme allemand. L'histoire comme la géographie poussent le capital allemand à étendre son influence à l'est, et il ne peut que chercher à tirer profit de l'effondrement du bloc de l'Est et de son leader. Depuis l'effondrement du mur de Berlin, c'est évidemment le capital allemand qui est le plus présent, tant au niveau économique que diplomatique, en Tchécoslovaquie, en Hongrie, et plus généralement partout à l'est, à l'exception de la Pologne qui, quels que soient ses liens économiques, s'efforce de résister, pour des raisons historiques.
Mais face à la dislocation totale de l'URSS, la situation devient beaucoup plus complexe et difficile pour la première puissance économique européenne. L'Allemagne peut essayer de profiter de la situation pour défendre ses intérêts, en particulier tenter de constituer une véritable «Mittel Europa», une «Europe centrale» sous son influence prépondérante, mais la dislocation soviétique, avec l'effondrement de tous les pays de l'Est, est en même temps une menace directe, plus dangereuse pour l'Allemagne que pour tout autre pays du coeur du système capitaliste international.
« L'unification », l'intégration de l'ex-RDA, est déjà un lourd fardeau qui entrave, et entravera de plus en plus, la compétitivité du capital allemand. L'arrivée massive d'immigrants pour qui l'Allemagne reste la « terre promise », conjuguée aux risques nucléaires mentionnés plus haut, provoquent une grave inquiétude dans la classe dominante allemande.
Contrairement à la situation en Yougoslavie, qui, malgré sa gravité, touche un pays de 22 millions d'habitants, la situation dans l'ex-URSS pousse la bourgeoisie allemande à la plus grande prudence. C'est pourquoi, tout en cherchant à étendre son influence, elle s'efforce par tous les moyens de stabiliser un minimum la situation, et évite soigneusement pour le moment de jeter de l'huile sur le feu ([14] [378]). C'est pourquoi elle continue à être le plus ferme appui à Gorbatchev et le principal soutien économique de l'ex-empire. Elle suit globalement la politique menée par les Etats- Unis vis-à-vis de l'ex-URSS. Elle n'a pu que soutenir la récente initiative en matière de « désarmement » du nucléaire tac tique, dans la mesure où celle-ci vise à aider et contraindre ce qui reste de pouvoir central dans l'ex- URSS à se débarrasser d'armes, dont la dissémination fait peser une véritable épée de Damoclès nucléaire sur l'URSS, mais aussi sur une bonne partie de l'Europe. ([15] [379])
L'ampleur des dangers du chaos contraint les Etats les plus développés à une certaine unité pour y faire face, et aucun d'entre eux ne joue, pour le moment, la carte du pire dans l'ex-URSS. Cependant cette unité est tout à fait ponctuelle et limitée. En aucun cas le chaos et sa menace ne permettent aux grandes puissances d'étouffer leurs rivalités impérialistes. Cela signifie que le capitalisme allemand ne peut pas et ne va pas renoncer à tout appétit impérialiste, pas plus d'ailleurs que n'importe quelle autre puissance centrale.
Même confronté aux graves dangers induits par la désintégration du bloc de l'Est et de l'URSS, chaque impérialisme va essayer de préserver au mieux ses propres intérêts. Ainsi, lors de la rencontre de Bangkok, à propos de l'aide économique à apporter au leader déchu de l’ex-bloc de l'Est, tous les gouvernements présents étaient conscients de la nécessité de renforcer cette aide, afin de prévenir l'explosion de catastrophes majeures dans un futur proche. Mais chacun a essayé que ça lui coûte le moins cher possible, et que ce soit l'autre, le rival et concurrent, qui en supporte la plus lourde charge. Les USA ont « généreusement » proposé d'annuler une partie de la dette soviétique, ce qu'a fermement refusé l'Allemagne, pour la bonne raison qu'elle supporte déjà à elle seule près de 40 % de cette dette.
Cette contradiction entre le besoin des principales puissances de freiner le chaos, de limiter au maximum son extension, et celui tout aussi vital de défendre leurs propres intérêts impérialistes, est portée à son paroxysme au fur et à mesure que ce qui reste de l'Union Soviétique se délite et se désagrège.
Le chaos l'emporte
La décomposition, en aiguisant tous les traits de la décadence, et notamment ceux de l'impérialisme, bouleverse de façon qualitative la situation mondiale, en particulier les rapports inter-impérialistes.
Dans un contexte de barbarie toujours plus sanguinaire, où l'horreur côtoie de plus en plus l'absurdité absolue, absurdité à l'image d'un mode de production qui est devenu totalement caduc du point de vue historique, le seul avenir que la classe exploiteuse puisse désormais offrir à l'humanité, c'est celui du plus grand chaos de toute l'histoire.
Les rivalités impérialistes entre les Etats les plus développés du défunt bloc de l'Ouest se déchaînent dans le contexte du pourrissement sur pied, généralisé, du système capitaliste. Les tensions entre les a grandes démocraties» ne peuvent que s'aviver, en particulier entre les États-Unis et la puissance dominante du continent européen, l'Allemagne. Le fait que, jusqu'à présent, cet antagonisme se soit exprimé de façon feutrée, n'enlève rien à sa réalité.
Même si les fractions nationales les plus puissantes de la bourgeoisie mondiale peuvent avoir un intérêt commun face au chaos, cette communauté d'intérêts ne peut être que circonstancielle et limitée. Elle ne peut annuler la tendance naturelle et organique de l'impérialisme au déchaînement de la concurrence, des rivalités et des tensions guerrières. Aujourd'hui elle participe pleinement du chaos et de son aggravation. La foire d'empoigne à laquelle se livrent, et se livreront de plus en plus les grandes puissances impérialistes, ne peut avoir comme résultat que l'avancée de ce chaos au coeur de l'Europe, comme l'illustre tragiquement la barbarie guerrière en Yougoslavie.
La politique oscillante et incohérente de la part des Etats les plus solides du monde capitaliste se traduit par une instabilité croissante des alliances. Celles-ci sont et seront de plus en plus circonstancielles et sujettes à de multiples retournements. Ainsi la France, après avoir plutôt joué la carte allemande, peut très bien jouer demain la carte américaine, pour plus tard effectuer un nouveau virage. L'Allemagne, soutenant aujourd'hui le «centre» en Russie, peut choisir demain les républiques sécessionnistes. Le caractère contradictoire et incohérent de la politique impérialiste des grandes puissances exprime en dernière instance la tendance de la classe dominante à perdre le contrôle d'un système ravagé par sa décadence avancée : la décomposition.
Putréfaction, dislocation grandissante de l'ensemble de la société, voilà la perspective « radieuse» qu'offre à l'humanité ce système à l'agonie. Cela ne fait que souligner l'importance et l'extrême gravité des enjeux de la période historique actuelle, en même temps que l'immense responsabilité de la seule classe porteuse d'un réel avenir : le prolétariat.
RN, 18/11/91.
[1] [380] Rosa Luxemburg, La crise de la Social-démocratie, "Brochure de Junius ".
[2] [381] Plateforme du Courant Communiste International.
[3] [382] Sur la fausse
unité des pays industrialisés pendant la guerre du Golfe, voir l'article éditorial
de la Revue Internationale n° 64, 1er trimestre 1991.
[4] [383] "Résolution sur la situation internationale", point 5, idem.
[5] [384] Voir les articles "L'URSS en miettes", "Ex-URSS : Ce n'est pas le communisme qui s'effondre" (Revue Internationale) n° 66 et n° 67, 3e et 4e trimestres 1991).
[6] [385] "Résolution sur la situation internationale", point 4, juillet 1991, 9e congrès du CCI, Revue Internationale n° 67.
[7] [386] Sur l'attitude
respective de la Grande-Bretagne et de la France vis-à-vis des USA, voir
"Rapport sur la situation internationale" extraits", note
1, page 23 de la Revue Internationale
N° 67.
[8] [387] T. Kunugi, ex-secrétaire adjoint de l'ONU. Libération, 27/9/91.
[9] [388] Voir l'article "Bilan de 70 années de 'libération nationale'", dans ce numéro.
[10] [389] La France et l'Italie, avec d'interminables oscillations, ont aussi contribué à cette entreprise de déstabilisation meurtrière.
[11] [390] L'Allemagne, pas plus que n'importe quel autre Etat
capitaliste, ne saurait échapper aux lois de l'impérialisme régissant toute la
vie du capitalisme dans sa décadence. Le problème face aux poussées de
impérialisme allemand n'est pas, en soi, le désir ou la volonté de la
bourgeoisie allemande. Nul doute que cette bourgeoisie, ou du moins certaines
de ses fractions, sont inquiètes face à cette plongée dans la curée
impérialiste. Mais quelles que soient ces inquiétudes, elle sera contrainte
(ne serait-ce que pour empêcher qu'un concurrent prenne la place), d'affirmer
de plus en plus ses visées impérialistes. Comme dans le cas de la bourgeoisie
japonaise en 1940, où beaucoup de ses fractions étaient réticentes à entrer en
guerre, ce qui compte ce n'est pas la volonté, mais ce que la bourgeoisie est contrainte de faire.
[12] [391] L'Allemagne est encore occupée militairement par les USA et, pour l'essentiel, le contrôle sur l'ensemble des munitions de l'armée allemande est encore exercé par l'état-major américain. Les troupes allemandes n'ont pas d'autonomie au-delà de quelques jours. La brigade franco-allemande a notamment pour but de permettre une plus grande autonomie à l'armée allemande.
[13] [392] Récemment, les nationalistes « tchétchènes » menaçaient d'attentats les centrales nucléaires ; des trains de blindés, pouvant contenir des armes nucléaires tactiques, circulaient aux frontières de l'URSS en échappant à tout contrôle.
[14] [393] Voir d'un côté l'attitude de l'Allemagne vis-à-vis des « Pays baltes » et ses velléités de pousser à la création d'une « République allemande de la Volga m, et de l'autre son soutien à ce qui reste de « centre » en URSS.
[15] [394] Ceci au delà du mensonge du « désarmement » qui ne supprime que les armes devenues obsolètes qui devaient de toute façon être mises à la casse et être remplacées par des armes plus modernes et sophistiquées.
Questions théoriques:
- Décomposition [3]
- Impérialisme [321]
Bilan de 70 années de luttes de « libération nationale » 2eme partie
- 6613 reads
II. Au 20e siècle, la « libération nationale », maillon fort de la chaîne impérialiste
Marx disait que la validité d'une théorie se démontre dans la pratique.
Soixante dix ans d'expériences tragiques pour le prolétariat ont tranché
clairement le débat sur la question nationale en faveur de la position de Rosa
Luxemburg, développée par la suite par les groupes de la Gauche Communiste et
surtout par Bilan, Internationalisme et notre Courant. Dans la première partie
de cet article, nous avons vu comment l'appui à la « libération nationale des peuples » a joué un rôle clé dans la
défaite de la première tentative révolutionnaire internationale du prolétariat
dans les années 1917-1923 (Revue
Internationale, n° 66). Dans cette seconde partie, nous allons voir comment
les luttes de libération nationale ont été un instrument des guerres et des
affrontements impérialistes qui ont dévasté la planète au cours des 70
dernières années.
1919-1945 derrière la « libération nationale » les manœuvres impérialistes
Pour le capitalisme, la première guerre mondiale marque la fin de sa période ascendante, et le début de son enfoncement dans le marasme de la lutte entre Etats nationaux pour le repartage d'un marché mondial fondamentalement saturé. Dans ce cadre, la formation de nouvelles nations et les luttes de libération nationale ont cessé d'être un instrument de l'expansion des rapports capitalistes et du développement des forces productives, et se sont transformées en une partie de l'engrenage des tensions impérialistes généralisées entre les différents camps capitalistes. Déjà avant la première guerre mondiale, lors des guerres dans les Balkans qui avaient donné lieu à 1’indépendance de la Serbie, du Monténégro, de l'Albanie, Rosa Luxemburg avait constaté que ces nouvelles nations avaient un comportement aussi impérialiste que les vieilles puissances, et qu'elles s'intégraient clairement dans la spirale sanglante qui menait à la guerre généralisée.
« Formellement, la Serbie mène sans nul doute une guerre de défense nationale. Mais les tendances de sa monarchie et de ses classes dirigeantes vont dans le sens de l'expansion, comme les tendances des classes dirigeantes de tous les Etats actuels (...). Il en est ainsi pour la tendance de la Serbie vers la côte adriatique, où elle a vidé avec l’Italie un véritable différend impérialiste sur le dos des albanais (...) Cependant, le point capital est le suivant : derrière l’impérialisme serbe, on trouve l’impérialisme russe. » ([1] [395])
Le monde tel qu'il est sorti de la première guerre mondiale, stoppée par l'affirmation révolutionnaire du prolétariat, était marqué par deux perspectives historiques opposées : l'extension de la révolution mondiale ou la survie du capitalisme englué dans une spirale de crises et de guerres. L'écrasement de la vague prolétarienne mondiale a signifié l'aiguisement des tensions entre le bloc vainqueur (Grande-Bretagne et France) et le grand vaincu (Allemagne), le tout aggravé par l'expansion des Etats-Unis qui constituait une menace pour tous.
Dans ce contexte historico-mondial, la « libération nationale » ne peut pas être considérée du point
de vue de la situation d'un pays particulier, puisque «Du point de vue marxiste il serait absurde d'examiner la situation d'un
seul pays pour parler d'impérialisme, parce que les différents pays capitalistes
sont rattachés par des liens très étroits. Et aujourd'hui, en pleine guerre,
ces liens sont incommensurablement plus forts. Toute l'humanité s'est convertie
en champ de bataille sanguinolent, et il n'est pas possible d'en sortir
isolément. Il y a des pays plus développés et d'autres moins développés, mais
la guerre actuelle les a tous frappés de telle manière qu'il est impossible
qu'aucun pays ne puisse sortir de lui-même de la conflagration. » ([2] [396]) Avec
cette méthode nous pouvons comprendre comment la « libération nationale » s'est transformée en mot d'ordre de
la politique impérialiste de tous les Etats : les vainqueurs directs de la première
guerre mondiale, la Grande-Bretagne et la France, l'ont employée pour
justifier le démembrement des empires vaincus (les empires austro-hongrois,
Ottoman et tsariste) et créer un cordon sanitaire autour de la Révolution
d'Octobre. Les USA l'ont élevée au rang de doctrine universelle, «principe» de la Société des Nations,
pour, d'un côté, combattre la révolution prolétarienne, et de l'autre, miner
les empires coloniaux de la Grande-Bretagne et de la France qui constituaient
l'obstacle principal à son expansion impérialiste. L'Allemagne, dès le début
des années 1920 avait fait de son « indépendance
nationale », contre le Traité de Versailles, le drapeau de son combat pour
redevenir une puissance impérialiste. Le principe «juste et progressiste» de la
« libération nationale de l'Allemagne » défendue en 1923 par le Parti communiste d'Allemagne (KPD) et l'Internationale Communiste (IC) à partir du second congrès s'est
transformé dans les mains du parti nazi en « droit pour l'Allemagne d'avoir un espace vital». Pour sa part,
l'Italie de Mussolini se considérait comme une «nation
prolétarienne» ([3] [397]) qui
revendiquait ses «droits naturels» en Afrique, dans les Balkans, etc.
L'oeuvre du Traité de Versailles
Au début des années 1920, les puissances victorieuses ont tenté d'implanter un «nouvel ordre mondial » qui corresponde à leurs intérêts. Leur principal instrument en fut le Traité de Versailles (1919), basé officiellement sur la «paix démocratique » et le « droit à l'autodétermination des peuples », qui octroyait l'indépendance à un ensemble de nations en Europe orientale et centrale : Finlande, Pays Baltes, Tchécoslovaquie, Hongrie, Yougoslavie, Pologne.
L'indépendance de ces nations répondait à deux objectifs des impérialismes britannique et français : d'un côté, comme nous l'avons analysé dans la première partie de cette série d'arl’I.C.les (Revue internationale, n° 66), affronter la révolution prolétarienne, et de l'autre, créer autour de l'impérialisme allemand vaincu, une chaîne de nations hostiles qui bloqueraient son expansion dans cette zone qui, pour des raisons d'ordre stratégique, économique et historique, est son terrain d'influence naturel.
Le machiavélisme le plus retors n'aurait pu concevoir Etats plus instables, plus exposés dès le départ à de violents conflits internes, plus contraints à se mettre sous la tutelle de puissances supérieures pour servir leurs visées guerrières. La Tchécoslovaquie contenait deux nationalités historiquement rivales, tchèque et slovaque, et une importante minorité allemande dans les Sudètes. Les Etats Baltes incluaient de fortes minorités polonaises, russes et allemandes. En Roumanie, des minorités hongroises. En Bulgarie des minorités turques. En Pologne, des minorités allemandes. Mais le chef d'oeuvre fut sans nul doute, la Yougoslavie (aujourd'hui de triste actualité à cause des horribles bains de sang qui la meurtrissent). La «nouvelle» nation contenait six nationalités avec les niveaux de développement économique les plus disparates qu'on puisse imaginer (allant du développement économique de haut niveau de la Croatie ou de la Slovénie, au niveau semi-féodal du Monténégro). De plus, les zones d'intégration économique de ces différentes régions étaient situées dans les pays frontaliers : la Slovénie est un complément de l'Autriche, la Voïvodine, qui appartient à la Serbie, est une prolongation naturelle de la plaine hongroise. La Macédoine est séparée es autres par une barrière montagneuse qui l'unit à la Grèce et à la Bulgarie. Enfin, ces différentes nationalités se réclamaient de trois religions classiquement opposées dans l'histoire : catholiques, orthodoxes et musulmans. Pour comble, chacune de ces « nationalités » contenait elle-même des minorités de la nationalité voisine, et, pire encore, des Etats voisins : des minorités albanaise et hongroise en Serbie ; des minorités italienne et serbe en Croatie ; des minorités serbe, musulmane et croate en Bosnie-Herzégovine.
« Les petits Etats bourgeois récemment crées ne sont que les sous-produits de l'impérialisme. En créant, pour y trouver un appui provisoire, toute une série de petites nations, ouvertement opprimées ou officiellement protégées, mais en réalité vassales -l'Autriche, la Hongrie, la Pologne, la Yougoslavie, la Bohème, la Finlande, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, l'Arménie, la Géorgie, etc.- en les dominant au moyen des banques, des chemins de fer, du monopole des charbons, l’impérialisme les condamne à souffrir de difficultés économiques et nationales intolérables, de conflits interminables, de querelles sanglantes. » ([4] [398])
Les nouvelles nations ont adopté dès le début un comportement impérialiste clair, comme le disait l’I.C. : « Les petits Etats créés par des moyens artificiels, morcelés, étouffant au point de vue économique dans les bornes qui leur ont été prescrites, se prennent à la gorge et combattent pour s'arracher des ports, des provinces, de petites villes de rien au tout. Ils cherchent la protection des Etats plus forts, dont l'antagonisme s’accroît de jour en jour » ([5] [399]) Ainsi la Pologne manifeste ses ambitions sur l'Ukraine, provoquant une guerre contre le bastion prolétarien en 1920. Elle exerçait aussi une pression sur la Lituanie, appelant à la défense de la minorité polonaise dans ce pays. Pour contrecarrer l'Allemagne, elle s'est alliée à la France, se soumettant fidèlement aux desseins impérialistes de cette dernière.
La Pologne « libérée » tomba sous la dictature féroce de Pildsuski. Cette tendance à annuler rapidement les formalités de la démocratie parlementaire qui se développait dans la plupart des nouveaux pays (à l'exception de la Finlande et de la Tchécoslovaquie) contredisait l'illusion, sur laquelle L’I.C. en dégénérescence avait spéculé, selon laquelle la « libération nationale » devait s'accompagner d'une «plus grande démocratie». Au contraire, ce contexte impérialiste mondial, leurs propres tendances impérialistes, la crise économique chronique et leur instabilité congénitale, ont fait que ces nouvelles nations ont exprimé d'une façon extrême et caricaturale, les dictatures militaires, la tendance générale du capitalisme décadent au capitalisme d'Etat.
Les années 1930 ont fait tourner la tension impérialiste au rouge vif, démontrant que le Traité de Versailles n'était pas un instrument de la «paix démocratique» mais le combustible pour de nouveaux incendies impérialistes, plus importants encore. L'impérialisme allemand reconstruit entreprenait une lutte ouverte contre « l’ordre de Versailles », tentant de reconquérir l'Europe centrale et orientale. Sa principale arme idéologique était la « libération nationale » : il invoquait le « droit des minorités nationales » pour s'allier avec les sudètes en Tchécoslovaquie, impulsait la « libération nationale » de la Croatie pour vaincre l'hostilité serbe et mettre un pied en Méditerranée ; en Autriche, le discours était « union avec l’Allemagne », et dans les Etats baltes il offrait une «protection» contre la Russie.
L’« ordre de Versailles » se démantelait à grande vitesse. Le prétexte selon lequel ces nouveaux Etats auraient pu être une garantie de « paix et de stabilité», sur lequel avaient tant insisté les Kautskystes et les Social-démocrates quand ils ont donné leur aval à la «paix de Versailles », était totalement démenti. Pris dans le tourbillon impérialiste mondial, ils n'avaient d'autre choix que de s'y engloutir, contribuant ainsi à l'amplifier et l'aggraver.
Chine : le massacre du prolétariat donne le feu vert aux antagonismes impérialistes
Avec l'Europe centrale et orientale, la Chine allait constituer un des points chauds de la tension impérialiste mondiale. La bourgeoisie chinoise avait tenté en 1911 une révolution démocratique tardive, faible et rapidement condamnée à l'échec. L'effondrement de l'Etat impérial ouvrit la porte à la désintégration générale du pays en mille royaumes dominés par des Seigneurs de la Guerre qui s'affrontaient entre eux, lesquels, à leur tour, étaient manipulés par la Grande-Bretagne, le Japon, les USA et la Russie, dans la bataille sanglante que tous se livraient pour la domination de la position stratégique que représentait le sous-continent chinois.
Pour, l'impérialisme japonais, la Chine était une clé pour dominer tout l'Extrême-Orient. C'est avec ce but qu'il a soutenu « de façon désintéressée» la cause de l'indépendance de la Mandchourie, une des zones les plus industrielles de Chine, centre névralgique pour le contrôle de la Sibérie, de la Mongolie, et de tout le centre de la Chine. Après avoir utilisé entre 1924 et 1928 les services de Chang Tso Line, un ancien bandit converti en Maréchal et ensuite en Vice-roi de Mandchourie, le Japon s'en est débarrassé (par un attentat) pour pouvoir en 1931, envahir et occuper la Mandchourie, la transformer en un Etat souverain et l'élever au niveau d'un « empire » à la tête duquel on plaça Pou-Yi, le dernier descendant de la dynastie mandchoue.
L'expansion japonaise se heurtait à la Russie stalinienne dont la Chine était le champ d'expansion naturel. Pour faire valoir ses intérêts, Staline utilisa la trahison ouverte contre le prolétariat chinois dans les événements qui devaient mettre en évidence l'antagonisme irréconciliable qui existe entre « libération nationale» et révolution prolétarienne, et à l'inverse, la solidarité totale qui est établie entre «libération nationale» et impérialisme : « En Chine où se développait une lutte révolutionnaire prolétarienne, la Russie stalinienne chercha ses alliances dans le Kuomintang de Tchang Kai Tchek, obligeant le jeune parti communiste chinois à renoncer à son autonomie organisationnelle, le forçant à adhérer au Kuomintang, proclamant pour l’occasion le "Front des quatre classes"... Malgré cela, la situation économique désespérée et la poussée de millions de travailleurs ont provoqué l'insurrection des ouvriers de Shanghai : ils ont pris la ville contre les impérialistes et le Kuomintang en même temps. Les ouvriers insurgés, organisés par la base du Parti Communiste Chinois, ont décidé d'affronter l'armée de Libération de Tchang kai Tchek appuyée par Staline. Cela a contraint les cadres de l'Internationale à l'ignominie d'appeler une nouvelle fois les ouvriers à se soumettre aux ordres de Tchang Kai Tchek, ce qui fut lourd de conséquences. » ([6] [400])
Ce feu croisé d'intérêts impérialistes, auquel se joignaient activement les manoeuvres des impérialismes yankee et britannique, a provoqué une longue guerre de plus de trente ans, qui sema la mort, la destruction, la désolation aux dépens des ouvriers et des paysans chinois.
La guerre d'Ethiopie : un moment crucial dans le cours à la seconde guerre mondiale
L'impérialisme italien qui avait occupé la Libye et ensuite la Somalie tenta d'envahir l'Ethiopie, menaçant l'Egypte et la domination de l'impérialisme britannique sur la Méditerranée, sur l'Afrique et sur les communications avec l'Inde.
La guerre d'Ethiopie marqua un pas décisif, avec celle d'Espagne de 1936 ([7] [401]), dans le cours à la seconde guerre mondiale. Un aspect important de ce massacre fut les énormes efforts de propagande et de mobilisation idéologique de la population assaillie par les deux camps adverses, et surtout par le camp « démocratique » (France et Grande-Bretagne). Ces derniers, qui avaient intérêt à 1’« indépendance » de l'Ethiopie, levèrent l'étendard de sa « libération nationale», pendant que l'impérialisme italien invoquait une mission « humanitaire » et « libératrice » pour justifier l’invasion : le Negus n'avait pas aboli l'esclavage comme il l'avait promis.
La guerre éthiopienne a mis en évidence le fait que la « libération nationale» n'est qu'un cheval de bataille idéologique pour la guerre impérialiste, une préparation à l'orgie de nationalisme et de chauvinisme qu'allaient déployer les deux camps impérialistes, un moyen de mobilisation pour les boucheries de la seconde guerre mondiale. Comme le dénonçait Rosa Luxemburg :«(...) La phrase nationale (...) ne sert plus qu'à masquer tant Bien que mal les aspirations impérialistes, à moins qu'elles ne soient utilisées comme cri de guerre, dans les conflits impérialistes, seul et ultime moyen idéologique de capter l'adhésion des masses populaires et de leur faire jouer leur rôle de chair à canon dans les guerres impérialistes. »([8] [402])
1945 -1989 : La « libération nationale » instrument des blocs impérialistes
L'achèvement de la seconde guerre mondiale avec la victoire des impérialismes alliés s'est accompagné d'une aggravation qualitative des tendances du capitalisme décadent au militarisme et à l'économie de guerre permanente. Le bloc vainqueur se divisa en deux blocs impérialistes rivaux, les USA et l'URSS, qui délimitèrent leurs zones a'influence avec des réseaux serrés d'alliances militaires, l'OTAN et la Pacte de Varsovie, en soumettant ces pays sous influence au contrôle d'une myriade d'organisations de « coopération économique », de régulations monétaires, etc. Tout cela accompagné par un développement hallucinant des arsenaux nucléaires dont la puissance aurait déjà permis, dès le début des années 1960, de détruire le monde entier.
Dans de telles conditions, parler de « libération nationale » est une farce macabre : « (...) L’indépendance nationale est concrètement impossible, irréalisable dans le monde capitaliste actuel. Les grands blocs impérialistes dirigent la vie de tout le capitalisme, aucun pays ne peut s'échapper hors d'un bloc impérialiste sans aussitôt retomber sous la coupe d'un autre. (...) Il est absolument évident que les mouvements de libération nationale ne sont pas des pions que Staline ou Truman déplacent à leur guise l'un contre l'autre. Il n'en reste pas moins vrai que le résultat est le même. Ho Chi Minh, expression de la misère annamite, s il veut asseoir sont pouvoir de misère, devra, tout en faisant lutter ses hommes avec l'acharnement du désespoir, être à la merci de compétitions impérialistes, et se résigner à embrasser la cause d'un quelconque d'entre eux (...). » ([9] [403])
Dans cette période historique, les guerres régionales, présentées systématiquement comme «mouvements de libération nationale» n'ont été que différents épisodes de la concurrence sanglante entre les impérialismes des deux blocs.
La décolonisation
La vague d’ « indépendances nationales» en Afrique, en Asie, en Océanie, etc., qui a submergé le monde entre 1945 et 1960 s'inscrit dans une longue lutte de l'impérialisme américain pour évincer les vieux impérialismes coloniaux de leurs positions, et principalement leur rival le plus direct à cause de sa richesse économique, de la position stratégique de ses possessions, et de sa puissance navale : l'impérialisme britannique.
En même temps, les vieux empires coloniaux s'étaient transformes en fardeau pour les métropoles : avec la saturation du marche et le développement de la concurrence à l’échelle mondiale, avec les coûts chaque fois plus élevés de l'entretien des armées et des administrations coloniales, ils s'étaient transformés, de source de bénéfices en poids chaque jour plus lourd.
Certainement, les bourgeoisies locales avaient intérêt à ôter le pouvoir aux vieilles puissances, et leur organisation en mouvement de guérilla, ou en partis de « désobéissance civile», tous sous le drapeau de l'Union Nationale qui préconisait la soumission du prolétariat local à la « libération nationale », a joué un rôle dans ce processus. Mais ce rôle fut essentiellement secondaire et toujours dépendant des visées du bloc américain ou des tentatives du bloc russe de mettre à profit la « décolonisation » pour conquérir des positions stratégiques au delà de sa zone d'influence eurasiatique.
La décolonisation de l'empire britannique a illustré cela de la façon la plus claire possible : « Les retraits britanniques en Inde et en Palestine ont été les moments les plus spectaculaires de la démolition de l'empire, et le "fiasco" du canal de Suez en 1956 a mis fin à toute illusion que la Grande Bretagne était encore une "puissance mondiale de premier ordre ". » ([10] [404])
Les nouveaux Etats « décolonisés » naquirent avec des tares encore pires que ceux de la fournée de Versailles en 1919. Des frontières totalement artificielles tracées à la règle ; des divisions ethniques, tribales, religieuses ; des économies de monoculture agricole ou basées sur un type d'extraction minière ; des bourgeoisies faibles voire inexistantes ; des élites administratives et techniques peu préparées et dépendantes des vieilles puissances coloniales. Un exemple de cette situation catastrophique nous est donné par l'Inde : l'Etat récemment créé a subi en 1947 une guerre apocalyptique entre musulmans et hindous qui s'acheva par la sécession du Pakistan où se regroupa la grande majorité des musulmans. Les deux Etats ont livré depuis bien des guerres dévastatrices, et aujourd'hui la tension impérialiste qui y croît est un des plus grands facteurs d'instabilité mondiale. Ces deux pays, où le niveau de vie des populations est un des plus bas du monde, maintiennent cependant de coûteux investissements dans des installations nucléaires qui leur permettent de posséder la bombe atomique.
En 1971, dans le cadre de cette confrontation impérialiste permanente, l'Inde a patronné une «libération nationale» de la partie orientale du Pakistan, le Bengladesh, laquelle, entre autres absurdités de l'impérialisme, se trouve à plus de 2 000 kilomètres du Pakistan ! Cette guerre qui a coûté des centaines de milliers de morts, a donné lieu à un nouvel Etat, «indépendant», qui n'a rien connu d'autre que des coups d'Etat, des massacres, des dictatures, alors que la population meurt de faim ou 'inondations dévastatrices.
Les guerres israélo-arabes
Depuis 40 ans, le Moyen-Orient n'a pas cessé d'être un foyer de tension impérialiste à l'échelle mondiale à cause des énormes réserves de pétrole et de son rôle stratégique vital. Quand, avant la guerre de 1914, il était encore aux mains de l'Empire Ottoman moribond, il avait été la proie des ambitions expansionnistes de l'Allemagne, de la Russie, de la France, de la Grande Bretagne. Après la guerre mondiale, ce fut l'impérialisme britannique qui emporta le morceau avec quelques miettes pour le français (la Syrie et le Liban).
A cette époque les bourgeoisies locales de la zone commençaient à pousser vers l'indépendance. Mais ce qui a été fondamentalement déterminant pour la configuration de cette région, ce sont les manoeuvres de l'impérialisme britannique qui, au lieu d'atténuer les tensions et les rivalités existantes, les a multipliées et portées à une échelle plus vaste. «L'impérialisme anglais comme on le sait, en poussant ces latifundistes et la bourgeoisie arabe à entrer en lutte à ses côtés pendant la guerre mondiale, leur avait promis la constitution d'un Etat national arabe. La révolte arabe fut, en effet, d'une importance décisive dans l'écroulement du front turco-allemand au Proche-Orient. » ([11] [405]) Comme « récompense », la Grande-Bretagne a crée une série d'Etats «souverains» en Irak, en TransJordanie, en Arabie, au Yémen, opposés entre eux, avec des territoires économiquement incohérents, minés par les divisions ethniques et religieuses. Une manipulation savante et typique de l'impérialisme britannique qui, en les tenant tous divisés et avec des contentieux permanents, soumettait l'ensemble de la zone à ses projets. Mais il ne se contenta pas de cela, en plus « il ne tarda pas, pour la défense de ses intérêts propres, à solliciter, comme contrepartie, l’appui des sionistes juifs en leur disant que la Palestine leur serait remise tant au point de vue de l’administration que de la colonisation. » ([12] [406])
Si les juifs avaient été expulsés de beaucoup de pays durant le bas Moyen-âge, au 19e siècle nous assistons à leur intégration, tant des hautes couches, la bourgeoisie, comme des basses couches, le prolétariat, au sein des nations dans lesquelles ils vivaient. Cela révèle la dynamique d'intégration et de dépassement relatif des différences raciales et religieuses que développaient les nations capitalistes dans leur époque progressive. C'est seulement à la fin du siècle, c'est à dire, avec l'épuisement croissant de la dynamique d'expansion capitaliste, que des secteurs de la bourgeoisie juive lancèrent l'idéologie du sionisme (création d'un Etat sur la « terre promise »). Sa création en 1948 ne constitue pas seulement une manoeuvre de l'impérialisme américain pour déloger le britannique de la zone et pour entraver les tentatives russes de s'y immiscer, mais elle révèle aussi, en lien avec cet objectif impérialiste, le caractère réactionnaire de la formation de nouvelles nations : ce n'est pas une manifestation d'une dynamique d'intégration de populations comme au siècle passé, mais de séparation et d'isolement d'une ethnie pour l'utiliser comme moyen d'exclusion d'une autre, l'arabe.
Depuis le début, l'Etat israélien est une immense caserne en permanence sur pied de guerre qui utilise la colonisation des terres désertiques comme une arme militaire : les colons sont encadrés par l'armée et reçoivent une instruction militaire. En réalité, l'Etat d'Israël est dans son ensemble une entreprise économiquement ruineuse soutenue par d'énormes crédits des USA et basée sur une exploitation draconienne des ouvriers, aussi bien juifs que palestiniens. ([13] [407])
L'option américaine pour Israël, a rendu les Etats arabes plus instables, avec de plus grandes contradictions internes et externes, et a conduit ces derniers à l'alliance avec l'impérialisme russe. Leur drapeau idéologique a été depuis le début la « cause arabe » et la « libération nationale du peuple palestinien » qui est devenue le thème préféré de la propagande du bloc russe.
Comme dans beaucoup d'autres cas, ce qui leur importait le moins, c'était les palestiniens. Ces derniers furent entassés dans des camps de réfugiés en Egypte, en Syrie, etc., dans des conditions épouvantables, et utilisés comme main d'oeuvre bon marché au Koweït, en Arabie, en Egypte, au Liban, en Syrie, en Jordanie, etc., tout comme le faisait Israël. L'OLP, créée en 1963 comme mouvement de «libération nationale », s'est constituée depuis le début comme une bande de gangsters qui vole les ouvriers palestiniens les obligeant à déduire un impôt de leurs misérables salaires ; en Israël, au Liban, etc., l'OLP est un vulgaire fournisseur de main d'oeuvre palestinienne de laquelle elle extorque jusqu'à la moitié du salaire que paient les patrons. Ses méthodes de discipline dans les camps de réfugiés et dans les communautés palestiniennes n'ont rien à envier à celles de l'armée et de la police israélienne.
Nous devons nous rappeler finalement que les pires massacres de palestiniens ont été perpétrés par les gouvernements «frères » arabes : au Liban, en Syrie, en Egypte et, surtout, en Jordanie, où « ami » Hussein a bombardé brutalement les camps palestiniens causant des milliers de victimes en septembre 1970.
Il est important de souligner l'utilisation systématique des divisions ethniques, religieuses, etc., particulièrement importantes dans les zones les plus attardées de la planète, faite par l'impérialisme, tant de la part des grandes puissances comme des petites : « Que les populations juives et arabes de Palestine servent de pions aux intrigues impérialistes internationales, cela ne fait de doute pour personne. Que pour cela les meneurs du jeu suscitent et exploitent à fond les sentiments et préjugés nationaux, arriérés et anachroniques, grandement renforcés dans les masses par les persécutions dont elles furent l’objet, cela non plus n'est pas fait pour étonner. C est sur ce terrain que vient d'être ranimé un de ces incendies locaux : la guerre en Palestine, où les populations juives et arabes s'entretuent avec une frénésie chaque jour croissante et plus sanglante. » ([14] [408]) Avec ces manipulations, l'impérialisme joue à l'apprenti sorcier : il les exalte, les radicalise, les rend insolubles, car la crise historique du système n'offre aucun terrain pour pouvoir les absorber, jusqu'au point où, en certaines occasions, elles finissent par acquérir « une autonomie propre » aggravant et rendant plus contradictoires et chaotiques les tensions impérialistes.
Les guerres du Moyen-Orient n'ont pas eu comme objectif réel les « droits palestiniens », ni la « libération nationale » du peuple arabe. Celle de 1948 a servi à déloger l'impérialisme britannique de la zone. Celle de 1956 marque le renforcement du contrôle américain. Celles de 1967, 1973 et 1982 ont marqué la contre-offensive de l'impérialisme américain contre la pénétration croissante de l'impérialisme russe qui avait noué des alliances, plus ou moins stable, avec la Syrie, l'Egypte et l'Irak.
De toutes ces guerres, les Etats arabes sortirent affaiblis et l'Etat juif militairement renforcé. Mais le vrai vainqueur était le capital américain.
La guerre de Corée (1950-53)
Dans cette guerre ouverte en Extrême-Orient, entre le bloc impérialiste russe et l'américain, était en jeu l'arrêt de l'expansion russe, objectif qui fut atteint par le camp américain.
Le camp russe présentait son entreprise comme un « mouvement de libération nationale » : «La propagande stalinienne s'est particulièrement attachée à mettre en valeur ce fait que les "démocrates" auraient lutté pour l'émancipation nationale et dans le cadre du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. L'extraordinaire corruption régnant à l'intérieur de la clique dirigeante en Corée du Sud, ses méthodes "japonaises" en matière de police, son incapacité de féodaux à résoudre la question agraire (...) lui fournissaient des arguments indiscutables. Et Kim Ir Sen, de faire figure d'un nouveau Garibaldi. » ([15] [409])
L'autre élément mis en lumière par la guerre de Corée, est la formation, comme résultat direct de la confrontation inter-impérialiste, de deux Etats nationaux sur le sol d'une même nation : la Corée du Nord et du Sud, l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest, le Vietnam du Nord et du Sud. Cela, du point de vue du développement historique du capitalisme, est une aberration complète qui met encore plus en évidence la farce sanglante et ruineuse qu'est la « libération nationale ». L'existence de ces Etats a été directement liée non à un fait « national » mais à un fait impérialiste de la lutte d'un bloc contre l'autre. Dans la majorité des cas, ces «nations» se sont maintenues comme telles, au moyen d'une répression barbare, et leur caractère artificiel et contre-productif a pu être vérifié par l'écroulement retentissant, dans le cadre général de l'effondrement historique du stalinisme, de l'Etat d'Allemagne Orientale.
Vietnam
La lutte de « libération nationale » du Vietnam, commencée dans les années 1920, est toujours tombée dans l'orbite d'un camp impérialiste contre l'autre. Durant la 2e Guerre Mondiale, Ho Chi Minh et son Viet-Minh ont été approvisionnés en armes par les américains et les anglais, car ils jouaient un rôle contre l'impérialisme japonais. Après la 2e Guerre Mondiale, les américains et les anglais appuyèrent la France, puissance coloniale en Indochine, vu l'alignement prorusse des dirigeants vietnamiens. Même ainsi, les deux parties arrivent à un « compromis » en 1946 car, entre-temps, une série de révoltes ouvrières a éclaté à Hanoï et, pour les écraser, «(...) La bourgeoisie vietnamienne a dans le fond tout de même besoin des troupes françaises pour maintenir l'ordre dans ses affaires. » ([16] [410])
Cependant, à partir de 1952-53, avec la défaite de la guerre de Corée, l'impérialisme russe se tourne de manière décidée vers le Vietnam. Durant 20 ans, le Vietcong s'affrontera d'abord à la France, et ensuite aux Etats-Unis, dans une guerre sauvage où les deux camps commettront toutes les atrocités imaginables. Cela laissera comme résultat un pays ruiné qui, aujourd'hui, 16 ans après la « libération » non seulement ne s'est pas reconstruit, mais s'est effondré encore plus dans une situation catastrophique. Le caractère absurde et dégénéré de cette guerre se vérifie lorsque l'on voit que le Vietnam a pu être « libre » et « uni » seulement parce que les Etats-Unis, entre-temps, avaient gagné à leur bloc impérialiste l'énorme pièce constituée par la Chine stalinienne et parce que, en conséquence, le pygmée vietnamien devenait secondaire pour leurs visées.
Il faut souligner que le «nouveau Vietnam anti-impérialiste » agit, même avant 1975, comme puissance impérialiste régionale dans l'ensemble de l'Indochine : soumettant à son influence le Laos et le Cambodge où, sous prétexte de « libérer » le pays de la barbarie des Khmers Rouges, attachés à Pékin déjà lié au bloc américain, il a envahi le pays et a installé un régime basé sur une armée d'occupation.
La guerre du Vietnam, spécialement dans les années 1960, a suscité une formidable campagne des staliniens, des trotskistes, en compagnie d'autres secteurs bourgeois aux couleurs « libérales », présentant cette barbarie comme un facteur du réveil du prolétariat des pays industrialisés. De manière grotesque, les trotskistes prétendaient ressusciter les erreurs de l'Internationale Communiste sur la question nationale et coloniale sur «l'union entre les luttes ouvrières dans les métropoles et les luttes d'émancipation nationale dans le Tiers-Monde. » ([17] [411])
Un des « arguments » employé pour faire avaler cette mystification, était que la multiplication de manifestations contre la guerre du Vietnam aux USA et en Europe, était un facteur du réveil historique des luttes ouvrières depuis 1968. En réalité, la défense des luttes de « libération nationale », avec la défense des «pays socialistes », à la mode surtout dans les milieux étudiants, ont joué au contraire un rôle mystificateur et ont plutôt constitué une barrière de premier ordre contre la reprise de la lutte prolétarienne.
Cuba
Au cours des années 1960, Cuba a constitué un maillon fort de toute la propagande « anti-impérialiste ». Chaque étudiant politisé se devait d'avoir dans sa chambre des posters de 1' « héroïque guérillero » : Che Guevara. Aujourd'hui, la situation désastreuse que nous voyons à Cuba (émigrations massives, totale pénurie, même de pain), illustre parfaitement l'impossibilité totale d'une «indépendance nationale». Au début, les barbus de la Sierra Maestra n'avaient pas de sympathie spéciale pro-russe. Mais simplement, leur volonté de mener une politique un minimum « autonome » par rapport aux Etats-Unis, les a fatalement et inévitablement poussés dans les bras du capital russe.
En réalité, Fidel Castro était à la tête d'une fraction nationaliste de la bourgeoisie cubaine qui a adopté le «socialisme scientifique», éliminant nombre de ses « camarades » de la première heure, qui ont fini à Miami, c'est à dire, du côté du bloc américain, car sa seule chance de survie était dans le bloc russe. Celui-ci s'est payé avec intérêts de son « aide », entre autres manières, en se servant de Cuba comme sergent impérialiste en Ethiopie, en appui du régime pro-russe, au Yémen du Sud et, surtout, en Angola, où Cuba est arrivé à détacher 60 000 soldats. Ce rôle impérialiste de fournisseur de chair à canon dans les guerres africaines a coûté la vie à beaucoup d'ouvriers cubains, à ajouter aux africains morts pour leur «libération», et a influé tout autant que les manoeuvres du bloc yankee dans la misère atroce à laquelle ont été soumis le prolétariat et la population cubaine.
Les années 1980 : les « combattants de la liberté »
Après avoir arraché les unes après les autres les positions russes au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, le bloc américain a continué son offensive d'encerclement complet de l'URSS. C'est dans ce cadre que se situe la guerre d'Afghanistan où les USA répondent au coup de patte soviétique envahissant ce pays en 1979, par le parrainage d'une coalition de 7 groupes de guérilleros afghans. Ils les dotent des armes les plus sophistiquées avec lesquelles ils finissent par engluer les troupes russes dans une impasse. Ceci va accentuer l'énorme mécontentement existant dans toute l'URSS et va contribuer à l'écroulement spectaculaire du bloc russe en 1989.
Comme illustration de ce renforcement important du bloc américain, celui-ci pourra arracher le drapeau idéologique de la « libération nationale » au bloc russe que ce dernier avait pratiquement monopolisé durant les 30 dernières années.
Comme nous l'ayons montré tout au long de cet article, la « libération nationale » a été une arme que peuvent utiliser à leur guise les différents impérialismes : le camp fasciste l'a employée à toutes les sauces imaginables, tout comme le camp « démocratique». Cependant, depuis les années 1950, le stalinisme avait réussi à se présenter comme le bloc «progressiste» et « anti-impérialiste », habillant ses desseins du voile idéologique de la représentation des « pays socialistes» qui ne seraient pas « impérialistes » mais au contraire des «militants anti-impérialistes». Au comble du délire, il arrivait ainsi à présenter la « libération nationale» comme le passage direct au « socialisme », supercherie contre laquelle les Thèses sur la question nationale et coloniale, de 1’I.C. en 1920, malgré leurs erreurs, avaient insisté clairement sur la nécessité « de combattre énergiquement les tentatives faites par des mouvements émancipateurs qui ne sont en réalité ni communistes, ni révolutionnaires, pour arborer les couleurs communistes. »([18] [412])
Tout ce stratagème a été mis à bas dans les années 1980. Avec comme facteur principal le développement des luttes et de la conscience ouvrière, les innombrables virages et volte-face dictés par les nécessités impérialistes de la Russie, provoquèrent son usure : rappelons-nous, entre autres, le cas éthiopien. Jusqu'en 1974, le régime du Négus était dans le camp occidental, la Russie appuyait le Front de Libération Nationale de l'Erythrée converti en paladin du « socialisme ». Avec la chute du Négus, remplacé par les militaires «nationalistes» qui s'orientaient vers la Russie, les choses changèrent : alors l'Ethiopie s'est convertie en un régime «socialiste marxiste-léniniste » et le Front Erythréen s'est transformé du jour au lendemain en un « agent de l'impérialisme » en s'alignant derrière le bloc américain.
Apres 1989, la « libération nationale » fer de lance du chaos
Les événements de 1989, la chute retentissante du bloc de l'Est et l'effondrement des régimes staliniens, ont donné lieu a la disparition de la configuration impérialiste antérieure du monde, caractérisée par la division en deux grands blocs ennemis et par conséquent, à une explosion de conflits nationalistes.
L'analyse marxiste de cette nouvelle situation, déterminée par la compréhension du processus de décomposition du capitalisme ([19] [413]), permet de vérifier de manière concluante les positions de la Gauche Communiste contre la « libération nationale ».
Par rapport au premier aspect de la question, l'explosion nationaliste, nous voyons comment le tourbillon de l'effondrement du stalinisme crée une spirale sanglante de conflits inter-ethniques, des massacres, des pogromes ([20] [414]). Ce phénomène n'est pas spécifique aux anciens régimes staliniens. La majorité des pays africains a de vieux contentieux tribaux et ethniques qui, dans le cadre du processus de décomposition, se sont accélérés dans les dernières années conduisant à des massacres et des guerres interminables. De la même manière, l'Inde souffre de tensions nationalistes, religieuses et ethniques identiques, qui causent des milliers de victimes.
« Les conflits ethniques absurdes où les populations s'entre-massacrent parce qu'elles n'ont pas la même religion ou la même langue, parce qu'elles perpétuent des traditions folkloriques différentes, semblaient réservés, depuis des décennies, aux pays du "tiers-monde", l'Afrique, l'Inde ou le Moyen-Orient. Maintenant, c'est en Yougoslavie, à quelques centaines de kilomètres des métropoles industrielles d'Italie du Nord et d'Autriche, que se déchaînent de telles absurdités.
L'ensemble de ces mouvements révèle une absurdité encore plus grande : à l'heure où l'économie a atteint un degré de mondialisation inconnu dans l'histoire, où la bourgeoisie des pays avancés essaye, sans y parvenir, de se donner un cadre plus vaste que celui de la nation, comme celui de la CEE, pour gérer son économie, la dislocation des Etats qui nous avaient été légués par la seconde guerre mondiale en une multitude de petits Etats est une pure aberration, même du point de vue des intérêts capitalistes.
Quant aux populations de ces régions, leur sort ne sera pas meilleur qu'avant mais pire encore : désordre économique accru, soumission à des démagogues chauvins et xénophobes, règlements de comptes et pogroms entre communautés qui avaient cohabité jusqu'à présent et, surtout, division tragique entre les différents secteurs de la classe ouvrière. Encore plus de misère, d'oppression, de terreur, destruction de la solidarité de classe entre prolétaires face à leurs exploiteurs : voila ce que signifie le nationalisme aujourd'hui. »([21] [415])
Cette explosion nationaliste est la conséquence extrême, l'aggravation à leur plus haut niveau des contradictions, de la politique de l'impérialisme durant les 70 dernières années. Les tendances destructrices et chaotiques de la « libération nationale » occultées par les mystifications de « l’antiimpérialisme », du « développement économique », etc., et qui ont été clairement dénoncées par la Gauche Communiste, apparaissent aujourd'hui de manière brutale et extrême, dépassant les prévisions les plus pessimistes dans leur furie dévastatrice. La «libération nationale » dans la phase de décomposition se présente comme le fruit mûr de toute l'oeuvre aberrante, destructrice, développée par l'impérialisme.
« La phase de décomposition apparaît comme celle résultant de l'accumulation de toutes ces caractéristiques d'un système moribond, celle qui parachève et chapeaute trois quarts de siècle d'agonie d'un mode de production condamné par l'histoire. Concrètement, non seulement la nature impérialiste de tous les Etats, la menace de guerre mondiale, l'absorption de la société civile par le Moloch étatique, la crise permanente de l'économie capitaliste, se maintiennent dans la phase de décomposition, mais cette dernière se présente encore comme la conséquence ultime, la synthèse achevée de tous ces éléments. » ([22] [416])
Les mini-Etats qui émergent de la dislocation de l'ex-URSS ou de la Yougoslavie font preuve d'emblée de l'impérialisme le plus brutal. La Fédération Russe du « héros démocratique » Eltsine menace ses voisins et réprime l'indépendantisme de la République autonome tchétchène ; la Lituanie réprime sa minorité polonaise ; la Moldavie, sa minorité russe ; l'Azerbaïdjan s'affronte ouvertement à l'Arménie. L'immense sous-continent ex-soviétique donne lieu à 16 mini-Etats impérialistes qui peuvent très bien s'empêtrer dans des conflits mutuels qui feraient apparaître en comparaison la boucherie yougoslave insignifiante car, entre autres dangers, ils pourraient mettre en jeu les arsenaux atomiques dispersés dans l'ex-URSS.
Les grandes puissances utilisent, de manière relative vu le chaos existant, ces tensions nationalistes et toutes les poussées indépendantistes des nouveaux mini-Etats. Cette énième utilisation de la « libération nationale » ne peut avoir que des conséquences encore plus catastrophiques et chaotiques que par le passé. ([23] [417])
Plus que jamais, le prolétariat doit reconnaître la «libération nationale », l’« indépendance » ou l’« autonomie » nationales, comme une politique, des mots d'ordre, des drapeaux, partie intégrante à cent pour cent de l'ordre réactionnaire et destructeur du capitalisme décadent. Contre celle-ci, il doit développer sa propre politique : l'internationalisme, la lutte pour la révolution mondiale.
Adalen, 18 novembre 1991
[1] [418] La crise de la social-démocratie, Rosa Luxemburg, chapitre 7.
[2] [419] Lénine : intervention à la 7e conférence du POSDR en mai 1917, « Rapport sur la situation actuelle».
[3] [420] Concept qui sera repris plus tard par le « marxiste-léniniste » Mao-Tsé-Toung.
[4] [421] 2e congrès de l’I.C. : « Le monde capitaliste et l'Internationale Communiste », 1e partie, « Les relations internationales après Versailles. »
[5] [422] 2e congrès de l’I.C., op.cité, idem.
[6] [423] Internacionalismo, n° 1 : « Paix démocratique, lutte armée et marxisme ».
[7] [424] Nous n'analyserons pas la guerre d'Espagne dans cet article, étant donné que nous avons publié de nombreux articles sur cette question dans notre Revue Internationale (n° 7, 25, 47) ainsi qu'une brochure qui rassemble tous les textes de Bilan sur ce sujet. Les mystifications antifasciste et nationaliste qui ont inondé en masse le prolétariat local et international ont caché la réalité,: la guerre espagnole fut une épisode clé, avec l'Ethiopie, dans la maturation de la seconde guerre mondiale.
[8] [425] La crise de la social-démocratie, ch.7.
[9] [426] Internationalisme, n°21, p. 25, mai 1947, « Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ».
[10] [427] Revue Internationale, n° 17, p. 33, «La Grande Bretagne depuis la seconde guerre mondiale ».
[11] [428] Bilan, n° 32, « Le conflit Arabo-Juif en Palestine », juin-juillet 1936. M. Idem.
[12] [429] Idem.
[13] [430] «Les derniers événements nous ont gratifiés d'un nouvel Etat : l'Etat d'Israël. Nous n'avons pas l'intention, dans le cadre de cet article, de nous étendre sur le problème juif. (...) Le devenir du "peuple" juif, ne consiste pas dans la réinstallation de son autonomie et de son droit national, mais dans la disparition de toute frontière et de toute notion d'autonomie et d'existence nationale. Les persécutions sanglantes des dernières années et de la dernière guerre contre les juifs pour aussi tragiques qu'elles furent, signifient cependant moins un fait particulier que la barbarie de la société décadente, se débattant dans les convulsions de son agonie, et d'une humanité ne parvenant pas à trouver la voie de son salut : le Socialisme. »
[14] [431] « Sur les cas particuliers », Internationalisme, n°35, juin 1948, p.18, organe de la Gauche Communiste de France.
[15] [432] Internationalisme, n°45, p. 23 : «La guerre en Corée », 1950.
[16] [433] Internationalisme, n° 13, «La question nationale et coloniale », septembre 1946.
[17] [434] Voir la critique de cette position dans la première partie de cet article, Revue Internationale, n° 66.
[18] [435] « Thèses sur la question nationale et coloniale», point 11/5, 2 Congrès de L’I.C., mars 1920.
[19] [436] Voir Revue Internationale, n° 57 et n° 62.
[20] [437] Pour une analyse de ces événements, voir « La barbarie nationaliste » dans Revue Internationale n° 62.
[21] [438] Révolution communiste ou destruction de l’humanité, Manifeste du 9e congrès du C.C.I.
[22] [439] Revue Internationale, n° 62, « La décomposition, phase ultime de la décadence du capitalisme », mai 1990.
[23] [440] Voir l'article « Vers le plus grand chaos de l'histoire », dans ce n°.
Courants politiques:
- Gauche Communiste [49]
Approfondir:
- La question nationale [320]
Questions théoriques:
- Impérialisme [321]
Heritage de la Gauche Communiste:
- La question nationale [322]
Le communisme n'est pas un bel idéal mais une nécessité matérielle [1° partie]
- 5159 reads
Du communisme primitif au socialisme de l'utopie
Introduction
Depuis sa fondation, et encore plus depuis les événements considérables qui ont provoqué l'effondrement du bloc de l'Est et de l'URSS elle-même, le CCI a publié de nombreux articles combattant le mensonge selon lequel les régimes staliniens seraient un exemple de « communisme », et donc la mort du stalinisme signifierait la mort du communisme.
Nous avons démontré l'énormité d'un tel mensonge en confrontant la réalité du stalinisme aux buts et aux principes véritables du communisme. Le communisme est international et internationaliste, et vise à un monde sans nations. Le stalinisme est férocement nationaliste et impérialiste. Le communisme veut dire l'abolition du salariat et de toutes les formes d'exploitation. Le stalinisme a imposé un niveau d'exploitation des plus cruels précisément à travers le système salarial. Le communisme signifie une société sans État et sans classe dans laquelle les être humains contrôlent librement leur propre pouvoir social. Le stalinisme, c'est l'omniprésence d'un État totalitaire, d'une discipline militariste et hiérarchique imposée sur la majorité par une minorité privilégiée de bureaucrates. Et ainsi de suite ([1] [441]). Bref, le stalinisme n'est qu'une expression brutale, aberrante du capitalisme décadent.
Nous avons également montré comment cette campagne de mensonges a été utilisée pour désorienter et déboussoler la seule force sociale capable de construire une société communiste authentique : la classe ouvrière. A l'Est, la classe ouvrière a vécu directement à l'ombre du mensonge stalinien, ce qui a eu sur elle un effet désastreux, la remplissant pour sa grande majorité, d'une haine totale envers tout ce qui a à voir avec le marxisme, le communisme et la Révolution prolétarienne d'Octobre 1917. Le résultat, c'est qu'avec la chute de la prison stalinienne, elle est tombée sous l'emprise des idéologies les plus réactionnaires, le nationalisme, le racisme, la religion, et de la croyance pernicieuse dans le fait que le salut réside dans la voie de « l'occident démocratique ». A l'Ouest, cette campagne a eu pour but principal de bloquer la maturation de la conscience qui s'est développée dans la classe ouvrière au cours des années 1980. Là où réside l'essentiel du piège, c'est qu'il ôte à la classe ouvrière toute perspective à ses combats. Dans le sillage des événements catastrophiques des deux dernières années (la guerre du Golfe, la guerre en Yougoslavie, la famine, la récession), tout le blabla triomphant sur la victoire du capitalisme, le « nouvel ordre » de paix et d'harmonie que devait engendrer la fin de la « guerre froide » résonne déjà bien creux. Mais ce qui intéresse vraiment le capitalisme, c'est que la partie négative du message passe : la fin du communisme signifie la mort de tout espoir de changer l'ordre existant ; les révolutions ne peuvent aboutir qu'à créer des choses bien pires que celles qu'elles ont combattues ; il n'y a rien d'autre à faire sinon se soumettre à l'idéologie des loups qui se mangent entre eux, du capitalisme en décomposition. Dans cette « philosophie » bourgeoise du désespoir, non seulement le communisme mais aussi la lutte de classe deviennent des utopies démodées et discréditées.
La force de l'idéologie bourgeoise réside essentiellement dans le fait que c'est la bourgeoisie qui a le monopole des moyens de propagande de masse ; elle répète sans fin les mêmes mensonges et ne laisse aucune place à l'expression de réels points de vue alternatifs. Dans ce sens, Goebbels est vraiment le « théoricien » de la propagande bourgeoise : un mensonge suffisamment répété devient une vérité, et plus le mensonge est énorme, plus il marche. Et le mensonge selon lequel le stalinisme c'est le communisme est certainement énorme, un mensonge stupide, évident, ignoble mais qui, à première vue, marche.
Le mensonge est si évident pour quiconque s'y arrête quelques minutes, que la bourgeoisie ne peut se payer le luxe de le répandre tel quel. Dans tous les discours politiques qu'on nous tient, on peut entendre toutes sortes de boniments sur les régimes staliniens, des gens qui s'y réfèrent comme si c'était du communisme et les opposent au capitalisme, mais qui, dans la phrase suivante, admettent « bien sûr » que ce n'est pas du vrai communisme, que ce n'est pas ce que Karl Marx avait comme idée du communisme. Cette contradiction contient des dangers en puissance pour la classe dominante, et c'est pourquoi elle a besoin de tuer de telles idées dans l’œuf, avant qu'elles n'amènent à une réelle clarification.
Elle le fait de diverses manières. Face aux éléments politiques les plus conscients, elle offre des alternatives « marxistes » sophistiquées comme le « trotskisme » qui se spécialise dans la dénonciation du « rôle contre-révolutionnaire du stalinisme », tout en développant en même temps qu'il y aurait des « acquis ouvriers » à défendre dans les régimes staliniens, comme la propriété étatique des moyens de production, et que ceux-ci représenteraient, pour d'obscures raisons, quand même une « transition » vers le communisme authentique. En d'autres termes, le même mensonge sur l'identité du stalinisme et du communisme, mais dans un emballage « révolutionnaire ».
Mais nous vivons dans un monde où la majorité des ouvriers se désintéresse de la politique. Et c'est en grande partie dû au cauchemar stalinien lui-même qui a, des décennies durant, servi à dégoûter les ouvriers de toute activité politique. Si elle veut étayer son grand mensonge sur le stalinisme, l'idéologie bourgeoise a besoin de quelque chose qui touche plus massivement et qui soit beaucoup moins ouvertement politique que le trotskisme et ses variantes. Ce qu'elle offre, la plupart du temps, c'est le cliché banal sur lequel elle s'appuie pour réussir à piéger quand même ceux qui comprennent que le stalinisme n'est pas du communisme : nous faisons référence au refrain si souvent répété : c'est un bel idéal, mais ça ne marchera jamais.
Le premier but de la série d'articles que nous entamons ici, c'est de réaffirmer la position marxiste selon laquelle le communisme n'est pas une belle idée. Comme le dit Marx dans l'Idéologie allemande, « Le communisme n'est pas pour nous un état de choses qu'il convient d'établir, un idéal auquel la réalité devra se conformer. Nous appelons communisme le mouvement réel qui abolit l'état actuel des choses. Les conditions de ce mouvement résultent des données préalables telles qu'elles existent présentement. » ([2] [442])
Environ vingt ans plus tard, Marx exprimait la même pensée dans ses réflexions sur l'expérience de la Commune de Paris : « La classe ouvrière n'a pas d'utopies toutes faites à introduire par décret du peuple. Elle sait que pour réaliser sa propre émancipation, et avec elle cette forme de vie plus haute à laquelle tend irrésistiblement la société actuelle de par sa propre action économique, elle aura à passer par de longues luttes, par toute une série de processus historiques, qui transformeront complètement les circonstances et les hommes. Elle n'a pas d'idéal à réaliser mais seulement à libérer les éléments de la société nouvelle que porte dans ses flancs la vieille société bourgeoise qui s'effondre » ([3] [443]).
Contrairement à l'idée selon laquelle le communisme ne serait rien d'autre qu'une « utopie toute faite » inventée par Marx et d'autres bonnes âmes, le marxisme insiste sur le fait que la tendance au communisme est déjà contenue dans cette société. Juste avant le passage de L'idéologie allemande cité plus haut, Marx souligne « les prémisses qui existent maintenant » pour la transformation communiste :
- le développement des forces productives que le capital a lui-même créé et sans lequel il ne peut y avoir d'abondance ni de pleine satisfaction des besoins humains, sans lequel, en d'autres termes « seules l'indigence et la misère deviendraient générales et on verrait fondamentalement renaître la lutte pour le nécessaire ; ce serait le retour de toute la vieille misère » ([4] [444]) ;
- l'existence d'un marché mondial sur la base de ce développement sans lequel « le communisme ne pourrait avoir qu'une existence locale » alors que « le communisme n'est possible concrètement que comme le fait des peuples dominants, accompli d'un seul coup et simultanément, ce qui suppose le développement universel des forces productives et du commerce mondial qui s'y rattache » ([5] [445]) ;
- la création d'une grande masse non possédante, le prolétariat, qui affronte ce marché mondial comme une puissance étrangère intolérable ;
- la contradiction croissante entre la capacité du système capitaliste de produire des richesses et la misère que connaît le prolétariat.
Dans le passage de La guerre civile en France, Marx souligne une autre idée qui est plus que jamais valable aujourd'hui : le prolétariat n'a qu'à libérer le potentiel contenu dans « la vieille société qui s'effondre ». Comme on le développera ailleurs, le communisme est présenté ici à la fois comme possibilité et comme nécessité : une possibilité parce que sont créées les capacités productives qui peuvent satisfaire les besoins matériels de l'humanité, ainsi que la force sociale, le prolétariat, qui a des intérêts directs et « égoïstes » au renversement du capitalisme et à la création du communisme ; et une nécessité parce qu'à un certain degré de leur développement, ces forces productives elles-mêmes se révoltent contre les rapports capitalistes au sein desquels elles se sont développées et ont prospéré antérieurement, et que s'ouvre une période de catastrophes qui menace l'existence même de la société, l'humanité elle-même.
En 1871, Marx déclarait prématurément que la société bourgeoise s'effondrait ; aujourd'hui, dans les dernières étapes du capitalisme décadent, l'effondrement nous cerne et la nécessité de la révolution communiste n'a jamais été plus grande.
LE COMMUNISME AVANT LE PROLÉTARIAT
Le communisme est le mouvement réel, et le mouvement réel est le mouvement du prolétariat. Un mouvement qui commence sur le terrain de la défense des intérêts matériels contre les empiétements du capital, mais qui est contraint de mettre en question et en fin de compte, d'affronter les fondements mêmes de la société bourgeoise. Un mouvement qui devient conscient de lui-même à travers sa propre pratique, qui avance vers son but à travers une autocritique constante. Le communisme est donc « scientifique » (Engels) ; c'est le « communisme critique » (Labriola).
Le but principal de ces articles est de démontrer précisément que, pour le prolétariat, le communisme n'est pas une utopie toute faite, une idée statique, mais une conception en évolution, en développement, qui a grandi en âge et en sagesse avec le développement des forces productives et la maturation subjective du prolétariat au cours de l’expérience historique qu'il a accumulé. Nous examinerons donc comment la notion de communisme et les moyens de le réaliser ont gagné en profondeur et en clarté au travers des travaux de Marx et Engels, des contributions de l'aile gauche de la social-démocratie, de la réflexion sur le triomphe puis l'échec de la Révolution d'Octobre par les fractions communistes de gauche, etc. Mais le communisme est plus ancien que le prolétariat : selon Marx, nous pouvons même dire que « le mouvement de l'histoire (...) est un acte de genèse » du communisme ([6] [446]).
Pour montrer que le communisme est plus qu'un idéal, il faut montrer que le communisme surgit du mouvement prolétarien et précède donc Marx ; mais pour comprendre ce qui est spécifique au communisme prolétarien « moderne », il est également nécessaire de le comparer et de le distinguer des formes de communisme antérieures à l'existence du prolétariat, ainsi que des premières formes immatures du communisme prolétarien lui-même qui expriment un processus de transition entre le communisme pré-prolétarien et sa forme moderne, scientifique. Comme le dit Labriola, « Le communisme critique ne s'est jamais refusé, et il ne se refuse pas, à accueillir la multiple et riche suggestion idéologique, éthique, psychologique et pédagogique qui peut venir de la connaissance et de l'étude de toutes les formes de communisme, depuis Phalée de Calcédoine jusqu'à Cabet. Bien plus, c'est par l'étude et la connaissance de ces formes que se développe et se fixe la conscience de la séparation du socialisme scientifique d'avec tout le reste » ([7] [447]).
LA SOCIÉTÉ DE CLASSES, UNE ÉTAPE PASSAGÈRE DANS L'HISTOIRE DE L'HUMANITÉ
D'après la sagesse conventionnelle, le communisme ne peut pas marcher parce qu'il va à l'encontre de la « nature humaine ». L'esprit de compétition, l'avidité, la nécessité de faire mieux que le voisin, le désir d'accumuler des richesses, le besoin de l'État, tout cela, nous dit-on, est inhérent à la nature humaine, aussi ancré que le besoin de se nourrir et d'avoir une activité sexuelle. Rien qu'une connaissance minimale de l'histoire de l'humanité rejette cette version de la nature humaine.
Durant la plus grande part de son histoire, pendant des centaines de milliers, peut-être des millions d'années, l'humanité a vécu dans une société sans classe, formée de communautés où l'essentiel des richesses était partagé, sans que n'interviennent ni échange, ni argent ; une société organisée non par les rois ou les prêtres, les nobles ou la machine étatique mais par l'assemblée tribale. C'est à un tel type de société que se réfèrent les marxistes, lorsqu'ils parlent de « communisme primitif ». La notion de « communisme primitif » est profondément déconcertante pour la bourgeoisie et toute son idéologie ; aussi fait-elle tout ce qu'elle peut pour la nier ou la minimiser. Conscients du fait que la conception marxiste de la société primitive fut grandement influencée par les travaux de Lewis Henry Morgan sur les Iroquois et d'autres tribus d'« indiens d'Amérique », les anthropologues académiques modernes expriment beaucoup de mépris pour les recherches de Morgan, faisant ressortir telle ou telle inconsistance sur les faits, telle ou telle erreur secondaire, et ils finissent par mettre en question l'ensemble de sa contribution. Ou bien tombant dans l'empirisme le plus borné, ils nient toute possibilité de connaître quoi que ce soit de la préhistoire de l'humanité à partir de l'étude des peuples primitifs survivants. Ou bien encore ils soulignent tous les défauts et toutes les limitations des sociétés primitives en vue d'abattre un homme de paille : l'idée selon laquelle ces sociétés seraient une sorte de paradis, libéré des souffrances et de l'aliénation.
Mais le marxisme n'idéalise pas ces sociétés. Il est conscient qu'elles étaient le résultat nécessaire, non pas de quelque bonté humaine innée, mais du faible développement des forces productives qui contraignait les premières communautés humaines à adopter une structure « communiste » afin de survivre, tout simplement. L'appropriation par une partie de la société d'un quelconque surtravail, aurait signifié immédiatement la disparition de l'autre partie réduite à la misère totale. Les conditions ne permettaient pas la production d'un surplus suffisant à l'entretien d'une classe privilégiée. Le marxisme est conscient que ce communisme était restrictif et ne permettait pas le plein épanouissement de l'individu. C'est pourquoi, ayant parlé de « la dignité personnelle, la droiture, la force de caractère et la vaillance » des peuples primitifs survivants, Engels, dans ses fructueux travaux sur l'Origine de la famille, de la propriété privée et de l'État ([8] [448]), ajoutait l'explication suivante : dans ces communautés, « la tribu restait pour l'homme la limite, aussi bien en face de l'étranger que vis-à-vis de soi-même : la tribu, la gens et leurs institutions étaient sacrées et intangibles, constituaient un pouvoir supérieur, donné par la nature, auquel l'individu restait totalement soumis dans ses sentiments, ses pensées et ses actes. Autant les hommes de cette époque nous paraissent imposants, autant ils sont indifférenciés les uns des autres, ils tiennent encore, comme dit Marx, au cordon ombilical de la communauté primitive » ([9] [449]).
Ce communisme de petits groupes, souvent hostiles aux autres tribus ; ce communisme dans lequel l'individu était dominé par la communauté ; ce communisme de la pénurie est très différent du communisme plus avancé de demain qui sera celui de l'unification du genre humain, de la réalisation mutuelle de l'individu et de la société, le communisme de l'abondance. C'est pourquoi le marxisme n'a rien en commun avec les diverses idéologies « primitivistes » qui idéalisent l'ancienne condition de l'homme et expriment une aspiration nostalgique à y revenir ([10] [450]).
Néanmoins, le fait même que ces communautés aient existé, et existé comme produit de la nécessité matérielle, nous fournit une preuve supplémentaire que le communisme n'est ni une simple « bonne idée », ni quelque chose qui « ne marchera jamais ». C'est ce qu'a souligné Rosa Luxemburg dans son Introduction à l'économie politique :
« Morgan a fourni au socialisme scientifique un nouveau et puissant appui. Tandis que Marx et Engels avaient, par la voie de l'analyse économique du capitalisme, démontré pour le proche avenir l'inévitable passage de la société à l'économie communiste mondiale et donné ainsi aux aspirations socialistes un fondement scientifique solide, Morgan a fourni dans une certaine mesure à l’œuvre de Marx et Engels tout son puissant soubassement, en démontrant que la société démocratique communiste englobe, quoique sous des formes primitives, tout le long passé de l'histoire humaine avant la civilisation actuelle. La noble tradition du lointain passé tendait ainsi la main aux aspirations révolutionnaires de l'avenir, le cercle de la connaissance se refermait harmonieusement, et dans cette perspective, le monde actuel de la domination de classe et de l'exploitation, qui prétendait être le nec plus ultra de la civilisation, le but suprême de l'histoire universelle, n'était plus qu'une minuscule étape passagère dans la grande marche en avant de l'humanité » ([11] [451]).
LE COMMUNISME EN TANT QUE RÊVE DES OPPRIMÉS
Le communisme primitif n'était pas statique. Il est passé par diverses étapes, et, finalement, face aux contradictions insurmontables, s'est dissous et a donné naissance aux premières sociétés de classe. Mais les inégalités de la société de classe ont, a leur tour, donné naissance à des mythes et des philosophies où s'exprimait un désir plus ou moins conscient de se débarrasser des antagonismes de classe et de la propriété privée. Les classiques de la mythologie tels Hésiode et Ovide ont raconté le mythe de l'Age d'or, du temps où il n'y avait pas de différence entre « le mien » et « le tien » ; certains philosophes grecs ont ensuite « inventé » les sociétés parfaites où tout était mis en commun. Dans ces songeries, la mémoire pas si ancienne, d'une réelle communauté tribale est mélangée aux mythes bien plus anciens de la chute de l'homme d'un paradis originel.
Mais c'est dans les périodes de crise sociale et de révolte de masse contre le système de classe du moment que les idées communistes se généralisent, deviennent populaires et donnent lieu à de véritables tentatives de les mettre en pratique. Dans la grande révolte de Spartacus contre l'Empire romain décadent, les esclaves révoltés ont fait quelques tentatives désespérées et de courte durée pour établir des communautés. Mais la tendance au paradigme ([12] [452]) « communiste » à cette époque était bien sûr représentée par le christianisme qui a commencé, comme Engels et Luxemburg l'ont montré, comme une révolte des esclaves et d'autres classes écrasées sous le joug du système romain, avant d'être adopté par l'Empire romain décadent pour devenir ensuite l'idéologie officielle de l'ordre féodal. Les premières communautés chrétiennes prêchaient la fraternité humaine universelle et ont tenté d'instituer un communisme des biens. Mais comme Rosa Luxemburg le démontre dans son texte Le socialisme et les Églises, c'est là que résidait précisément la limitation du communisme chrétien : il ne posait pas l'expropriation révolutionnaire de la classe dominante, ni la mise en commun de la production comme le communisme moderne. Il demandait simplement que les riches soient charitables et partagent leurs biens avec les pauvres ; c'était une doctrine prônant le pacifisme social et la collaboration de classe qui pouvait être facilement adaptée aux besoins de la classe dominante. L'immaturité de cette vision du communisme provenait de l'immaturité des forces productives. Ceci s'applique d'une part aux capacités de production de l'époque, car dans une société mourant d'une crise de sous-production, ceux qui se révoltaient contre elle ne pouvaient rien envisager de mieux que le partage de la pauvreté ; et d'autre part au caractère des classes exploitées et opprimées qui constituaient la véritable force motrice à l'origine de la révolte chrétienne. Ces classes n'avaient ni objectif commun, ni perspective historique. « Pour tous ces éléments, il n'y avait absolument pas de voie commune vers l'émancipation. Pour tous, le paradis était perdu dans le passé : pour les hommes libres ruinés, c était tout en même temps l'ancienne « polis », la cité et l'État dont leurs ancêtres avaient été les citoyens ; pour les esclaves captifs de guerre, l'époque où ils étaient libres ; pour les petits paysans, le système social des Gentils aujourd'hui aboli et la propriété commune ». Voilà comment Engels, dans L'histoire du christianisme primitif ([13] [453]), décrit la vision essentiellement nostalgique de la révolte chrétienne, au regard tourné vers le passé. Il est vrai que le christianisme, en continuité de la religion hébraïque, avait fait un pas en avant par rapport aux diverses mythologies païennes, du fait qu'elle incarnait une rupture avec les anciennes visions cycliques du temps, et qu'elle développait une vision de l'humanité prise dans un drame historique tourné vers l'avenir. Mais les limitations internes des classes qui avaient exprimé cette révolte, faisaient que cette histoire était toujours vue en termes messianiques et mythifiés, et le salut futur qu'elle promettait était un Eschaton ([14] [454]) au-delà des frontières de ce monde.
On peut globalement dire la même chose des nombreuses révoltes paysannes contre le féodalisme, bien qu'on rapporte du fier prédicateur Lollard, John Ball, l'un des leader de la grande révolte des paysans en Angleterre en 1381, la déclaration suivante : « Rien ne pourra aller bien en Angleterre tant que tout ne sera pas géré en commun ; quand il n'y aura plus ni lords, ni vassaux… ». De telles revendications vont au-delà d'un simple communisme des biens, et nous mènent à la vision de la propriété commune de l'ensemble des richesses sociales (et ceci peut-être parce que les Lollards étaient déjà des précurseurs de mouvements ultérieurs caractéristiques de l'émergence du capitalisme). Mais de façon générale, les révoltes paysannes souffraient des mêmes limitations fondamentales que les révoltes d'esclaves. La fameuse devise de la révolte de 1381, « Quand Adam bêchait et qu'Ève filait, qui donc alors était seigneur ? », avait une merveilleuse puissance poétique, mais elle résumait aussi les limitations du communisme paysan qui, tout comme les premières révoltes chrétiennes, était condamné à regarder en arrière un passé idyllique, vers l'Eden lui-même, vers les premiers chrétiens, vers « la véritable liberté anglaise d'avant le joug normand » ([15] [455])... Ou bien s'il regardait de l'avant, c'était avec la vision des premiers chrétiens d'un millénium apocalyptique que le Christ de retour dans toute sa gloire viendrait instaurer. Les paysans n'étaient pas la classe révolutionnaire de la société féodale, même si leurs révoltes ont aidé à saper les fondements de l'ordre féodal et ont pavé le chemin de l'émergence du capitalisme. Et comme ils ne portaient aucun projet de réorganisation de la société, ils ne pouvaient voir le salut que venant de l'extérieur de Jésus, des « bons rois » mal instruits par de traîtres conseillers, de héros comme Robin des bois.
Le fait que ces rêves communistes aient pu avoir de l'emprise sur les masses, montre qu'ils correspondaient à de réels besoins matériels, de la même façon que les rêves des individus expriment de profonds désirs non réalisés. Mais comme les conditions historiques ne pouvaient permettre leur réalisation, ils étaient condamnés à ne rester que des rêves.
LES PREMIERS MOUVEMENTS DU PROLÉTARIAT
« Dès sa naissance, la bourgeoisie était grevée de son contraire : les capitalistes ne peuvent pas exister sans salariés et à mesure que le maître des corporations du Moyen-âge devenait le bourgeois moderne, dans la même mesure le compagnon des corporations et le journalier libre devenaient le prolétaire. Et même si, dans l'ensemble, la bourgeoisie pouvait prétendre représenter également, dans la lutte contre la noblesse, les intérêts des diverses classes laborieuses de ce temps, on vit cependant, à chaque grand mouvement bourgeois, se faire jour des mouvements indépendants de la classe qui était la devancière plus ou moins développée du prolétariat moderne. Ainsi, au temps de la Réforme et de la Guerre des Paysans en Allemagne, la tendance de Thomas Münzer ; dans la grande Révolution anglaise, les niveleurs ; dans la grande Révolution française, Babeuf » ([16] [456]).
Münzer et le royaume de Dieu
Dans La Guerre des Paysans en Allemagne, Engels élabore sa thèse sur Münzer et les anabaptistes. Il considérait que ceux-ci représentaient un courant prolétarien embryonnaire au sein d'un mouvement « plébéien-paysan » bien plus éclectique. Les anabaptistes étaient toujours une secte chrétienne, mais extrêmement hérétique, et les enseignements « théologiques » de Münzer s'approchaient dangereusement d'une forme d'athéisme, en continuité de tendances mystiques antérieures en Allemagne ou ailleurs (comme Meister Eckhart). Au niveau social et politique, « son programme politique frisait le communisme, et plus d'une secte communiste moderne, encore à la veille de la Révolution de mars, ne disposait pas d'un arsenal théorique plus riche que celui des sectes « münzeriennes » du XVIe siècle. Ce programme, qui était moins la synthèse des revendications des plébéiens de l'époque qu'une anticipation géniale des conditions d'émancipation des éléments prolétariens en germe parmi ces plébéiens, exigeait l'instauration immédiate sur terre du royaume de Dieu, du millénium des prophètes, par le retour de l'Église à son origine et par la suppression de toutes les institutions en contradiction avec cette Église soi-disant primitive, mais en réalité toute nouvelle. Pour Münzer, le royaume de Dieu n'était pas autre chose qu'une société où il n'y aurait plus aucune différence de classe, aucune propriété privée, aucun pouvoir d'État autonome étranger aux membres de la société. Toutes les autorités existantes, si elles refusaient de se soumettre et d'adhérer à la révolution, devaient être renversées ; tous les travaux et les biens devaient être mis en commun, et l'égalité la plus complète régner. Une ligue devait être fondée pour réaliser ce programme, non seulement dans toute l'Allemagne, mais dans l'ensemble de la chrétienté » ([17] [457]).
Il va sans dire que puisqu'on était seulement à l'aube de la société bourgeoise, les conditions matérielles pour une telle transformation radicale n'existaient pas. Sur le plan subjectif, ceci se reflétait dans l'emprise que les conceptions messianiques religieuses gardaient et qui déterminaient l'idéologie de ce mouvement. Sur le plan objectif, l'avancée inéluctable de la domination du capital faussait toutes ces revendications communistes radicales et les transformait en suggestions pratiques pour le développement de la société bourgeoise. Ceci ne fait pas l'ombre d'un doute quand on voit le parti de Münzer catapulté au pouvoir dans la ville de Mulhausen en mars 1525 : « La position de Münzer à la tête du « Conseil éternel » de Mulhausen était cependant beaucoup plus risquée encore que celle de n'importe quel gouvernement révolutionnaire moderne. Non seulement le mouvement de l'époque, mais aussi son siècle n'étaient pas encore mûrs pour la réalisation des idées qu'il avait seulement commencé lui-même à pressentir confusément. La classe qu'il représentait, bien loin d'être complètement développée et capable de dominer et transformer toute la société, ne faisait que de naître. La transformation sociale qui hantait son imagination était encore si peu fondée dans les conditions matérielles de l'époque que ces dernières préparaient même un ordre social qui était précisément le contraire de celui qu'il rêvait d'instituer. Cependant, il restait lié à ses anciens prêches sur l'égalité chrétienne et la communauté évangélique des biens. Il devait donc tout au moins essayer de les mettre en application. C’est pourquoi il proclama la communauté des biens, l'obligation au travail égale pour tous, et la suppression de toute autorité. Mais en réalité, Mulhausen resta une ville libre républicaine, avec une constitution un peu démocratisée, avec un sénat élu au suffrage universel soumis au contrôle de l'assemblée des citoyens et un système de ravitaillement des pauvres improvisé à la hâte. La révolution sociale qui épouvantait à tel point les contemporains bourgeois protestants, n'alla jamais au-delà d'une faible et inconsciente tentative pour instaurer prématurément la future société bourgeoise » ([18] [458]).
Winstanley et la véritable communauté (commonwealth)
Les fondateurs du marxisme ne connaissaient pas aussi bien la Révolution bourgeoise anglaise que la Réforme allemande ou la Révolution française. C'est dommage car, comme l'ont montré des historiens comme Christopher Hill, cette Révolution a provoqué une énorme explosion de pensée créative ainsi qu'une éblouissante profusion de partis, de sectes et de mouvements audacieusement radicaux. Les Niveleurs auxquels se réfère Engels, étaient davantage un mouvement hétérogène qu'un parti formel. Leur aile modérée n'était rien de plus qu'une tendance démocrate radicale défendant ardemment le droit de l'individu à disposer de sa propriété. Mais vue la profondeur de la mobilisation sociale qui poussait la bourgeoisie en avant, elle donna inévitablement naissance à une aile gauche de plus en plus préoccupée des besoins des masses sans propriété et qui développa un caractère clairement communiste. Cette aile était représentée par les « Véritables Niveleurs » ou « Diggers », dont le porte-parole le plus cohérent était Gerrard Winstanley.
Dans les écrits de Winstanley, en particulier son dernier travail, on s'éloigne bien plus clairement des conceptions messianiques religieuses que Münzer ne l'a jamais fait. Son important travail, La loi de la liberté en plate-forme, représente, comme le montre son titre, une évolution nette du discours sur un terrain explicitement politique : les références subsistantes à la Bible, en particulier au mythe de la chute, ont essentiellement une fonction allégorique ou symbolique. Surtout, pour Winstanley, contrairement aux Niveleurs modérés « il ne peut y avoir de liberté universelle tant que la communauté universelle ne sera pas établie » ([19] [459]).
Les droits politiques constitutionnels qui laissaient intacts les actuels rapports de propriété, étaient une imposture. Par conséquent, il développe très en détail sa vision d'une véritable communauté où tout travail salarié, tout échange ont été abolis, où à la place de l'obscurantisme religieux et de l'église sont promus l'éducation et la science et où les fonctions de l'État sont réduites au strict minimum. Il regarde même plus loin dans le temps, lorsque « la terre entière redeviendra un trésor commun comme elle le doit... alors cette hostilité de toutes les terres entre elles cessera et personne n'osera plus chercher à dominer les autres », car « défendre la propriété et les intérêts particuliers divise le peuple d'une terre et du monde entier en différentes parties, et constitue la cause de toutes les guerres, des massacres et des disputes partout » ([20] [460]).
Cependant, bien évidemment, ce qu'Engels dit de Münzer reste valable pour Winstanley : la nouvelle société qui émerge de cette grande Révolution n'a pas été la « communauté universelle » mais le capitalisme. La vision de Winstanley constituait une étape supplémentaire vers le communisme « moderne » mais restait totalement utopique. Cela s'est surtout exprimé dans l'incapacité des Véritables Niveleurs de voir comment la grande transformation pouvait se faire. Le mouvement Digger, apparu durant la guerre civile, s'est limité à quelques tentatives par de petites bandes de pauvres sans propriété, de cultiver des terrains vagues et communaux. Les communautés Diggers devaient servir d'exemple de non violence à tous les pauvres et les dépossédés, mais furent vite dispersées par les forces de l'ordre de Cromwell et, de toutes façons, leur horizon ne dépassa guère l'affirmation des anciens droits communaux à l'honneur dans le passé. C'est après la suppression de ce mouvement et du mouvement Niveleur en général que Winstanley écrivit La loi de la liberté pour tirer les leçons de la défaite. Mais l'ironie significative, c'est que tout en exprimant le plus haut niveau de la théorie communiste à cette époque, ce travail n'était pas dédié à quelqu'un d'autre qu'Oliver Cromwell qui, trois ans auparavant, en 1649, avait écrasé la révolte des Niveleurs par les armes afin de sauvegarder la propriété et l'ordre bourgeois. Ne voyant pas d'autre force capable de faire la révolution à partir d'en bas, Winstanley était réduit au vain espoir d'une révolution d'en haut.
Babeuf et la République des ÉgauxUn schéma très semblable est apparu pendant la grande Révolution française : durant le reflux du mouvement, surgit une aile d'extrême-gauche exprimant son mécontentement vis-à-vis des libertés purement politiques prétendument intégrées dans la nouvelle constitution puisque, par-dessus tout, elles favorisaient la liberté du capital d'exploiter la majorité sans propriété. Le courant de Babeuf exprimait les efforts du prolétariat des villes qui avait fait tant de sacrifices pour la révolution de la bourgeoisie, pour lutter pour ses propres intérêts de classe, et il aboutissait inéluctablement à la revendication du communisme. Dans le Manifeste des Égaux, il proclame la perspective d'une nouvelle révolution finale : « La Révolution française n'est que l'annonciatrice d'une autre Révolution, bien plus grande, bien plus solennelle, et qui sera la dernière... »
Au niveau théorique, les Égaux
étaient une expression beaucoup plus mûre de la poussée communiste que les
Véritables Niveleurs, un siècle et demi auparavant. Non seulement ils étaient
pratiquement complètement libérés de l'ancienne terminologie religieuse, mais
ils avançaient à tâtons vers une conception matérialiste de l'histoire en tant
qu'histoire de la lutte de classe. De façon peut-être encore plus
significative, ils reconnaissaient l'inévitabilité d'une insurrection armée
contre le pouvoir de la classe dominante : la « Conspiration des
Égaux » en 1796 en est la concrétisation. Se basant sur les expériences de
démocratie directe développée dans les sections de Paris et la
« Commune » de 1793, ils ont aussi
envisagé un État révolutionnaire qui aille plus loin que le
parlementarisme conventionnel en imposant le principe de la révocabilité des
officiels élus.
Cependant, une fois de plus, l'immaturité des conditions matérielles ne pouvait que trouver son expression dans l'immaturité du « parti » de Babeuf. Comme le prolétariat de Paris n'avait pas pleinement émergé en tant que force distincte parmi les « sans-culottes » et les pauvres des villes en général, les babouvistes eux-mêmes n'étaient pas clairs sur qui était le sujet révolutionnaire : le Manifeste des Égaux n'était pas adressé au prolétariat, mais au « Peuple de France ». Ne voyant pas qui était le sujet révolutionnaire, la vision babouviste de l'insurrection et de la dictature révolutionnaire était essentiellement élitiste ; quelques élus prendraient le pouvoir au nom des masses informes, et détiendraient ensuite le pouvoir ,jusqu'à ce que ces masses soient véritablement à même de se gouverner (des vues de ce genre allaient persister dans le mouvement ouvrier plusieurs décennies après la Révolution française, surtout à travers la tendance de Blanqui qui descendait à l'origine du babouvisme, en particulier à travers la personne de Buonarotti).
Mais l'immaturité de la tendance Babeuf ne s'exprimait pas seulement dans les moyens qu'elle mettait en avant (qui de toutes façons aboutirent au fiasco total du putsch de 1796), mais dans l'aspect rudimentaire de sa conception de la société communiste. Dans les Manuscrits économiques et philosophiques, Marx s'en prend aux héritiers de Babeuf comme expression de ce « communisme qui est encore tout vulgarité et instinct », qui « se manifeste comme une envie de tout ramener au même niveau » et qui « incarne cette envie et ce nivellement à partir d'un minimum chimérique. (...) L'abolition de la propriété privée n'y est point une appropriation réelle puisqu'elle implique la négation abstraite de toute la sphère de la culture et de la civilisation, le retour à une simplicité peu naturelle d'homme dépourvu et sans désir, qui non seulement ne se situe pas au-delà de la propriété privée mais qui n'y est même pas encore parvenu » ([21] [461]). Marx va même jusqu'à dire que ce communisme vulgaire serait en réalité la continuation du capitalisme : « Il s'agit là d'une simple communauté du travail où règne l'égalité du salaire payé par le capital collectif, par la communauté, en tant que capitaliste universel » ([22] [462]). Marx avait raison d'attaquer les héritiers de Babeuf dont les vues étaient entre-temps devenues complètement obsolètes, mais à l'origine, le problème était un problème objectif. A la fin du XVIIIe siècle, la France était encore une société en grande partie agricole et les communistes de l'époque ne pouvaient pas envisager facilement la possibilité d'une société d'abondance. Aussi leur communisme ne pouvait-il qu'être « ascétique, dénonçant tous les plaisirs de la vie, spartiate » ([23] [463]) un simple « nivellement à partir d'un minimum chimérique ». C'est une autre ironie de l'histoire qu'il ait fallu les immenses privations de la révolution industrielle pour éveiller la classe exploitée à la possibilité d'une société dans laquelle l'épanouissement des sens remplace la négation spartiate.
Les inventeurs de l'utopieLe reflux du grand mouvement révolutionnaire à la fin des années 1790, l'incapacité du prolétariat à agir comme force politique indépendante ne voulaient pas dire que le virus du communisme avait été éradiqué. Il prit une nouvelle forme, celle des Socialistes de l'Utopie. Les utopistes – Saint-Simon, Fourier, Owen et d'autres – étaient bien moins insurrectionnels, bien moins liés à la lutte révolutionnaire de masses que les babouvistes ne l'avaient été. A première vue, ils peuvent donc apparaître comme un pas en arrière. Il est vrai qu'ils étaient un produit caractéristique d'une époque de réaction, et représentaient un éloignement par rapport au monde du combat politique. Néanmoins, Marx et Engels ont toujours reconnu leur dette envers les utopistes et considéraient qu'ils avaient fait des avancées significatives par rapport au « communisme grossier » des Égaux, surtout dans leur critique de la civilisation capitaliste et leur élaboration d'une alternative communiste possible :
« Mais les écrits socialistes et communistes
renferment aussi des éléments critiques. Ils attaquent la société existante
dans ses bases. Ils ont fourni par
conséquent, en leur temps, des matériaux d'une grande valeur pour éclairer les ouvriers. Leurs propositions positives en vue de la société future – suppression de l'antagonisme
entre la ville et la campagne,
abolition de la famille, du gain privé
et du travail salarié, proclamation de l'harmonie sociale et transformation de
l'État en une simple administration de la production – toutes ces propositions ne font qu'annoncer la disparition de l'antagonisme des classes, antagonisme qui commence seulement à se dessiner
et dont les faiseurs de systèmes ne connaissent encore que les premières
formes indistinctes et confuses » ([24] [464]).
Dans Socialisme utopique et socialisme scientifique, Engels donne plus de détails sur les contributions spécifiques des principaux penseurs utopistes : Saint-Simon a le mérite de reconnaître la Révolution française comme une guerre de classe et de prévoir l'absorption totale de la politique par l'économie, et donc l'abolition possible de l'État. Fourier est présenté comme un critique et satire brillant de l'hypocrisie, de la misère et de l'aliénation bourgeoise, qui a su utiliser de main de maître la méthode dialectique pour comprendre les principales étapes de l'évolution historique. Il faut ajouter qu'avec Fourier en particulier, il y a une rupture définitive d'avec le communisme ascétique des Égaux, surtout à travers sa grande préoccupation de remplacer par l'activité créative et ludique le travail aliéné. La brève biographie que fait Engels de Robert Owen est centrée sur ses recherches plus pratiques, anglo-saxonnes, pour trouver une alternative à l'exploitation capitaliste, que ce soit dans les filatures de coton « idéales » de New Lanark ou ses diverses expériences de vie de coopérative et en commune. Mais Engels reconnaît aussi à Owen le courage d'avoir rompu avec sa propre classe et rejoint le prolétariat : ses derniers efforts pour monter un grand syndicat pour tous les ouvriers d'Angleterre ont marqué un pas en avant par rapport à la philanthropie bénévole, vers la participation aux premières tentatives du prolétariat de trouver sa propre identité de classe et sa propre organisation.
Mais, en dernière analyse, ce qui s'applique aux premiers mouvements du communisme prolétarien, s'applique également aux utopistes : la grossièreté de leurs théories était le résultat des conditions grossières de la production capitaliste dont elles ont surgi. Incapables de voir les contradictions économiques et sociales qui aboutiraient en dernière instance à la chute de l'exploitation capitaliste, ils ne pouvaient qu'envisager une nouvelle société à partir de plans et d'inventions développés dans leurs propres esprits. Incapables de reconnaître le potentiel révolutionnaire de la classe ouvrière, ils se considéraient « bien au-dessus de tout antagonisme de classes. Ils désirent améliorer les conditions matérielles de la vie pour tous les membres de la société, même les plus privilégiés. Par conséquent, ils ne cessent de faire appel à la société tout entière sans distinction, et même ils s'adressent de préférence à la classe régnante. Car, en vérité, il suffit de comprendre leur système pour reconnaître que c'est le meilleur de tous les plans possibles de la meilleure des sociétés possibles. Ils repoussent donc toute action politique et surtout toute action révolutionnaire ; ils cherchent à atteindre leur but par des moyens pacifiques et essayent de frayer un chemin à la nouvelle doctrine sociale par la force de l'exemple, par des expériences en petit qui échouent naturellement toujours » ([25] [465]).
Aussi
non seulement les utopistes ont fini en bâtissant des châteaux en Espagne, mais
encore en prêchant la collaboration de classe et le pacifisme social. Et ce
qui était compréhensible étant donné l'immaturité des conditions objectives
dans les premières décennies du XIXe siècle, n'était plus pardonnable
une fois qu'avait été écrit le
Manifeste communiste. A partir de
ce moment-là, les descendants des Utopistes constituent un obstacle majeur au
développement du communisme scientifique incarné par la fraction Marx-Engels de
la Ligue des communistes.
Dans le prochain article de cette série, nous examinerons l'émergence et la maturation de la vision marxiste de la société communiste et le chemin qui y mène.
CDW
[1] [466] Voir, par exemple, l'éditorial de la Revue Internationale, n°67. « Ce n'est pas le communisme qui s'effondre mais le chaos capitaliste qui s'accélère » ; et l'article « Le stalinisme est la négation du communisme » dans Révolution internationale, n°205 et World Revolution, n°148, ainsi que le Manifeste du 9 Congrès du CCI : Révolution communiste ou destruction de l'humanité.
[2] [467] Éditions La Pléiade, Tome III, p. 1067.
[3] [468] Ed.sociales, la Guerre civile en France.
[4] [469] Éditions La Pléiade, Tome III, p. 1066.
[5] [470] Idem.
[6] [471] Manuscrits philosophiques et économiques, Editions La Pléiade, T. II, p. 79.
[7] [472] En mémoire du Manifeste communiste, 1895, Ed. Gordon & Breach, p. 74.
[8] [473] Éditions sociales, p. 104.
[9] [474] Idem, p. 105-106.
[10] [475] Aujourd'hui, ces idéologies « primitivistes » sont le plus souvent l'expression caractéristique de la petite-bourgeoisie qui se décompose, en particulier des courants anarchistes désillusionnés non seulement par rapport à la classe ouvrière, mais par rapport à toute l'histoire depuis l'aube de la civilisation, et qui cherchent une consolation en projetant le mythe du paradis perdu sur les premières communautés primitives. Un exemple typique en est le journal américain Fifih Estate et le livre de Freddy Perlman Against Leviathan, Against History. L'ironie, que ces éléments ne voient pas, c'est que si on étudie de près les croyances des peuples primitifs, il est clair qu'eux aussi avaient leur « paradis perdu » dans un âge mythique encore bien plus ancien. Si l'on considère de tels mythes pour le reflet d'un désir irrésolu de transcender les frontières de l'aliénation, il devient alors évident que l'homme primitif subissait également une forme d'aliénation, conclusion cohérente avec la vision marxiste de ces sociétés.
[11] [476] Éditions 10-18, p. 121.
[12] [477] Du grec paradeigma : exemple, modèle.
[13] [478] Die Neue Zeit, vol. 1, 1894-95.
[14] [479] Une fin dernière.
[15] [480] La nature conservatrice de ces révoltes a été renforcée du fait que des vestiges des anciennes limites du communisme primitif ont survécu à un degré plus ou moins grand dans toutes les sociétés de classe antérieures au capitalisme. De ce fait, les révoltes des classes exploitées ont toujours été profondément influencées par un désir de défendre et de préserver les droits communaux traditionnels qu'avait usurpés l'extension de la propriété privée.
[16] [481] Engels, Socialisme utopique et socialisme
scientifique, Éditions sociales, p. 61.
[17] [482] Éditions sociales, p. 79.
[18] [483] Idem, p. 151.
[19] [484] Cité par Hill dans son introduction à La loi de la liberté et autres écrits, 1973, Penguin édition, p. 49.
[20] [485] Cité par Hill dans The world turned upside down, 1984, Peregrine edition, p. 139.
[21] [486] Éditions La Pléiade, Tome II, p. 77-78.
[22] [487] Idem.
Dans cette critique du babouvisme, on voit que Marx pressent déjà que le capitalisme ne se base pas sur la seule propriété privée individuelle, en parlant d'un « capital collectif », et combien sa conception du communisme n'a dès le début rien à voir avec le plus grand mensonge de ce 20e siècle qui nous a présenté le capitalisme d'État en URSS comme « communiste », parce que la bourgeoisie privée y avait été expropriée.
[23] [488] Engels, Socialisme utopique et socialisme scientifique.
[24] [489] Le Manifeste Communiste, Éditions sociales, « Le socialisme et le communisme critico-utopiques », p. 90.
[25] [490] Idem, p. 88.
Approfondir:
Questions théoriques:
- Communisme [492]
Heritage de la Gauche Communiste:
Revue Internationale no 69 - 2e trimestre 1992
- 2997 reads
Situation internationale : guerres, barbarie, lutte de classe
- 3224 reads
La seule solution à la spirale des guerres et de la barbarie est la lutte de classe internationale
Depuis le début de « l'ère de paix et de prospérité pour l'humanité » ouverte avec la chute du mur de Berlin, la disparition du bloc de l'Est et l'éclatement de l'URSS, jamais les guerres et conflits locaux n'ont été si nombreux. Jamais le militarisme n'a été si présent, jamais les ventes d'armes de toutes sortes n'ont pris une telle ampleur, jamais la menace de dissémination nucléaire n'a été si dangereuse, jamais les projets, la planification de nouvelles armes, n'ont été aussi loin, y compris dans l'espace. Jamais autant d'êtres humains n'ont souffert de la faim, de la misère, de l'exploitation, des guerres et des massacres, jamais, depuis que le capitalisme existe, une telle proportion de la population mondiale n'a été rejetée de la production, condamnée définitivement pour sa plus grande part au chômage, à la paupérisation absolue, à la mendicité, aux "petits boulots" de survie, souvent aussi à la délinquance, à la guerre et aux massacres nationalistes, interethniques.
La récession économique ouverte s'approfondit dans les pays industriels, les grandes puissances mondiales, et tout particulièrement la première d'entre elles les USA, précipitant des centaines de milliers d'ouvriers dans les affres du chômage et dans la misère. Une « ère de paix et de prospérité » promise par le président US Bush, par l'ensemble de la bourgeoisie mondiale, se révèle être l'ère des guerres et de la crise économique.
Chaos et anarchie dans tous les coins et recoins de la planète
L'URSS n'est plus. Exit Gorbatchev. La CEI est mort-née. Les tensions entre Républiques s'aiguisent et prennent chaque jour un tour plus agressif. Les Etats naissants s'arrachent les dépouilles de l'ex-Union. Le principal enjeu : les restes de l'armée rouge, ses armes conventionnelles bien sûr, mais aussi nucléaires (33 000 à 35 000 « têtes » !). Il s'agit de constituer des armées nationales les plus redoutables possibles afin d'assurer les intérêts impérialistes de chacun contre les voisins. C'est le règne sanglant du chacun pour soi qui domine sans fard dans l'ex-URSS, où le chantage au nucléaire est employé à tour de rôle par les uns et les autres : malgré les pressions internationales (occidentales), le Kazakhstan se refuse à dire s'il va rendre ou non les armes nucléaires tactiques et surtout stratégiques qui sont sur son territoire ; l'Ukraine s'empare d'une division de bombardiers nucléaires (le 17 février) et essaye de garder pour elle la flotte de la mer Noire. La Russie d'Eltsine aux commandes pourtant de l'armée « unifiée » de la CEI, c'est à dire en position de force par rapport aux autres, va même jusqu'à craindre l'éventualité d'un conflit nucléaire avec l'Ukraine dans le futur ([1] [494]) ! C'est dire la nature, l'état des relations, et le rôle joué par le militaire et la force entre les nouveaux Etats : les relations sont impérialistes et antagoniques ; le rapport de force s'établit sur la puissance militaire et spécialement nucléaire.
Cette situation conflictuelle est d'autant plus aiguë que la situation économique est catastrophique. 90 % de la population russe vit sous le seuil de pauvreté. La famine guette malgré l'aide occidentale. La production industrielle baisse brutalement alors que la libération des prix provoque une inflation à trois chiffres, une inflation à la sud-américaine. Cette faillite complète vient à son tour jeter de l'huile sur le feu des oppositions entre les nouveaux Etats. «La guerre économique entre les Républiques a déjà commencé» affirme Anatoli Sobtchak, le maire de St. Peters Bourg le 8 janvier dernier.
Cette opposition d'intérêts tant politiques qu'économiques vient accélérer le chaos, et multiplier les tensions, les conflits, les guerres locales et les massacres de populations, entre les différentes nationalités composant ce que nous pouvons déjà appeler Pex-CEI. Les républiques s'opposent sur l'héritage militaire laissé par la défunte URSS. Presque toutes s'affrontent sur le tracé des frontières qui les séparent : l'appartenance de la Crimée à l'Ukraine ou à la Russie, est le cas le plus connu. Chaque république est aux prises avec une ou des minorités nationales qui déclarent leur indépendance, par les armes, constituant des milices : le Haut-Karabakh et la minorité arménienne en territoire azéri; les Tchétchènes en Russie qui attaquent les casernes afin de se procurer des armes ; et partout des minorités russes qui s'inquiètent, en Moldavie, en Ukraine, dans le Caucase et dans les républiques d'Asie centrale. Et puis la Géorgie déchirée par les combats meurtriers entre partisans du président Gamsakhourdia «démocratiquement élu» d'un côté, et ses principaux ministres et leurs milices armées. Partout des morts, des blessés, des massacres de civils, des destructions, la haine et la terreur nationalistes de petites peuplades qui vivaient jusque là ensemble, qui, ensemble, avaient souffert de la terreur du capitalisme d'Etat, version Staline. Aujourd'hui, partout la désolation et le chaos règnent sans partage.
Cette situation d'explosion de l'ex-URSS, cette situation d'anarchie sanglante, a réveillé des appétits impérialistes locaux longtemps contenus par la toute-puissance «soviétique», qui sont porteurs d'affrontements encore plus larges. L'Iran et la Turquie se sont livrés à une véritable course de vitesse pour établir les premiers des ambassades dans les ex-républiques musulmanes. La presse iranienne accuse la Turquie de vouloir «imposer le modèle occidental» à ces républiques en leur faisant perdre leur «identité musulmane ». La Turquie appuyée par les USA, utilise des nationalités turcophones (Ouzbeks, Kazakhs, Kirghiz, Turkmènes) pour prendre le pas sur l'Iran qui essaye de s'appuyer sur le Pakistan dans cette lutte impérialiste...
La disparition de la division du monde en deux grands blocs impérialistes a signifié la fin de la discipline imposée et des règles établies, «stables», qui régissaient les conflits impérialistes locaux. Aujourd'hui, ils éclatent en tous sens et partout. L'explosion de l'URSS n'a fait qu'aggraver encore ce phénomène. Partout, sur tous les continents, de nouveaux conflits éclatent, se développent, alors que les vieux foyers de guerre ne disparaissent pas, bien au contraire.
Les Philippines et la Birmanie souffrent de guérillas sanglantes et permanentes (la Chine a vendu pour plus d'un milliard de dollars d'armes à la Birmanie !). L'état d'anarchie se développe en Asie centrale. Les affrontements militaires de toutes sortes (Kurdistan, Liban) continuent au Moyen-Orient malgré «l’accalmie » dans la région depuis le terrible écrasement de l'Irak lors de la guerre du Golfe.
L'Afrique est un continent à la dérive : répressions sanglantes d'émeutes de populations affamées, coups d'Etat, guérillas et affrontements interethniques se multiplient au milieu du désastre économique. Les tensions impérialistes s'exacerbent entre l'Egypte et le Soudan. Le chaos social gagne l'Algérie, les combats se poursuivent au Tchad, Djibouti est gagné par les affrontements entre Afars et Issas.
«L’Afrique n'en finit pas de se débattre avec le spectre de l'insécurité alimentaire. (...) Il faudra des aides d'urgence pour l'Ethiopie, le Sierra Leone et le Libéria, et même pour le Zaïre. Guerres civiles, déplacements massifs des populations, sécheresse, telles sont les causes invoquées par la FAO »([2] [495]) Est-il besoin de préciser qu'«insécurité alimentaire» évite, avec quelle élégance, l'emploi brutal du mot famine.
L'Amérique Latine semble être un havre de paix en comparaison. Il faut dire qu'elle bénéficie de l'attention particulière du grand voisin du Nord. Le sous-continent reste l'arrière-cour des USA. Pourtant si les antagonismes, nombreux, entre l'Argentine et le Chili, entre le Pérou et l'Equateur qui a encore donné lieu à des escarmouches militaires, pour ne citer que deux des multiples différents frontaliers, sont contenus, le continent n'en est pas moins marqué par la violence. Violence des guérillas (Pérou, Colombie, Amérique centrale), violence de la répression étatique face à des populations là aussi affamées (émeutes au Venezuela), violence due à la décomposition avancée qui touche ces Etats (guerres des gangs de la drogue en Colombie, au Pérou, au Brésil, en Bolivie ; les assassinats massifs par la police et les milices des gosses des rues, abandonnés par millions (!), souffrant de la faim et de la drogue, livrés à eux-mêmes dans les immenses bidonvilles, véritables cloaques, qui ceinturent les villes).
Cette liste du chaos et des guerres, cette liste des tueries et de la terreur sur les populations, ne serait pas complète sans mentionner la Yougoslavie. Cette dernière n'est plus. Elle explose dans un fracas de feu et de sang. Durant des mois, Croates et Serbes se sont entretués, et les tensions s'exacerbent entre les trois nationalités différentes qui composent la Bosnie-Herzégovine. De nouveaux affrontements se préparent à quelques centaines de kilomètres des grands centres industriels de l'Europe ! Tout comme l'explosion de l'URSS, l'explosion de la Yougoslavie réveille de vieilles tensions, et en crée de nouvelles : la volonté d'indépendance de la Macédoine, par exemple, ravive dangereusement les antagonismes entre la Grèce et la Bulgarie. Et surtout elle vient accroître encore plus les tensions entre grandes puissances, Allemagne, USA, et au sein de l'Europe.
Voilà en un court raccourci une photo instantanée et incomplète, effroyable et dramatique, du monde (nous excluons pour l'instant la situation dans les grands pays industrialisés, les USA, le Japon et l'Europe occidentale, situation sur laquelle nous allons revenir). Voilà en quelques mots la réalité du monde capitaliste. Du monde capitaliste qui pourrit et se décompose. De la société capitaliste qui n'offre que misère et guerres à l'humanité.
Les ventes d'armes tous azimuts
Douterait-on encore de cette perspective guerrière que l'explosion des ventes d'armes finirait par nous convaincre complètement.
Les ventes d'armes de tous ordres, des plus simples jusqu'aux plus sophistiquées et les plus meurtrières, échappent maintenant à tout contrôle. La planète n'est plus qu'un immense supermarché d'armes où les vendeurs se font une âpre concurrence. La disparition du bloc de l'Est et la catastrophe économique qui touche les pays d'Europe centrale et de la CEI (ex URSS) ont jeté sur le marché l'incroyable arsenal militaire de feu le Pacte de Varsovie, cassant ainsi les prix : des centaines de blindés vendus au poids, 10 000 dollars la tonne ! ([3] [496])
En 1991, l'ex-URSS aurait vendu pour 12 milliards de dollars d'armes. La Russie et le Kazakhstan ont vendu 1000 tanks T-72 et des sous-marins à l'Iran. «Des informations recueillies par les services occidentaux donnent à croire que la société Glavosmos qui est commune à ces deux Etats, propose à des clients étrangers des propulseurs de missiles balistiques SS-25, SS-24 et SS-18 pour qu'ils servent, le cas échéant, de lanceurs spatiaux. »([4] [497])
La Tchécoslovaquie de F« humaniste » Vaclav Havel a livré la plus grande partie des 300 tanks vendus à la Syrie. Cette dernière, l'Iran et la Libye achèteraient à la Corée du Nord des missiles Scuds « beaucoup plus précis et efficaces que les missiles Scuds soviétiques que l'Irak a lancés durant la guerre du Golfe. »([5] [498])
Bien qu'inquiètes de ces achats massifs et tous azimuts, les grandes puissances participent à cette gigantesque braderie. Les Etats-Unis veulent vendre plus de 400 chars à très bas prix à l'Espagne. «L'Allemagne a promis de livrer à la Turquie, pour environ 1 milliard de dollars, des matériels qui proviennent des stocks de l'ancienne armée "orientale"».{[6] [499])
Tous les Etats étant impérialistes, les achats par les uns obligent les autres à suivre, renforçant encore plus les tensions: «L'Iran achète au moins deux sous-marins d'attaque neufs construits par les Russes. L'Arabie Saoudite veut acheter 24 avions de chasse F-15E McDonnell Douglas pour transformer ses forces aériennes de façon à pouvoir s'opposer à ces sous-marins iraniens». ([7] [500])
Tous les Etats capitalistes, grands ou petits, puissants ou faibles, sont entraînés dans les rivalités impérialistes, dans les tensions croissantes, dans la course à l'armement, dans le gouffre du militarisme.
Bien que la peur du chaos pousse a l'action commune des grandes puissances derrière les USA ...
Il existe une réelle préoccupation face au chaos croissant qui a gagné le monde capitaliste. Celle-ci pousse les bourgeoisies nationales les plus puissantes à essayer de limiter l'expression de leurs différents impérialistes.
Avec l'éclatement du bloc de l'Est, les USA, l'Allemagne, les autres pays européens, ont d'abord pris garde de ne pas accélérer le désordre dans les pays de l'ex-Pacte de Varsovie. En particulier, tous ont soutenu les efforts de Gorbatchev pour tenter de maintenir l'unité et la stabilité de l'URSS, et pour qu'il se maintienne lui-même au pouvoir. Le pire est pourtant arrivé venant confirmer leurs craintes. Leur préoccupation maintenant est le chaos économique et social qui se propage, les conséquences des risques de famines telle l'émigration massive, les risques de dérapages militaires de tous ordres, et, particulièrement, la question brûlante du contrôle des armes nucléaires tactiques et stratégiques. Il y a un risque extrêmement grave de dissémination nucléaire. De fait, quatre nouveaux Etats instables, au lieu d'un seul, sont en possession de ces armes de destruction massive. Et s'il est facile pour les USA de surveiller les armes «stratégiques», il n'en va pas de même pour les armes «tactiques». En clair, les «petites» bombes atomiques sont très mobiles, dispersées, et n'importe qui peut s'en emparer, les utiliser ou les vendre, vu l'état d'anarchie et de chaos qui règne. Voilà le pourquoi des conférences d'aide à la CEI, des propositions de démontage des armes nucléaires, des accords entre les USA et l'Allemagne pour assurer l'emploi des savants atomistes de l'ex-URSS : essayer de maintenir un contrôle minimum sur le nucléaire et limiter l'extension du chaos.
... les antagonismes impérialistes chaque fois plus forts aiguisent les tensions
Présentant devant le Congrès les scénarios de guerre que les USA pourraient affronter dans l'avenir, le chef du Pentagone, le Général Powell, précise que «la menace réelle à laquelle nous nous confrontons maintenant est la menace de l'inconnu, de l'incertain».{[8] [501]) C'est en fonction de cet inconnu que les USA changent de stratégie militaire et mettent en place une version de la guerre des étoiles de Reagan adaptée à la nouvelle donne internationale, et à leur crainte d'éclatement de guerres nucléaires surprises et incontrôlables : le GPALS, «système de protection globale contre les lancements accidentels ou limités» (Global Protection Against Limited Strikes), qui aurait pour but de neutraliser complètement tout lancement de missile nucléaire d'où qu'il vienne, et où qu'il aille.
Les USA défendent leur hégémonie
Les USA sont les premiers intéressés à la lutte contre le chaos en général, et contre la dissémination nucléaire et le risque de conflits locaux atomiques incontrôlables en particulier, car cela pourrait remettre en cause leur position impérialiste dominante. Nous l'avions vu lors de la guerre du Golfe([9] [502]), lors des Conférences de paix sur le Moyen-Orient desquelles les pays européens étaient exclus.([10] [503]) Nous venons de le voir encore dernièrement lors de la Conférence sur l'aide à la CEI réunie à Washington, et où les USA ont tout organisé, dictant les ordres du jour, nommant les commissions et leurs présidences à leur convenance, réduisant une fois de plus les autres pays européens, l'Allemagne et surtout la France, au rôle de comparses impuissants, et ridiculisés lors de la mise en scène médiatique des premiers envois aériens de l'aide alimentaire à la Russie.
Le programme GPALS, qui, soit dit en passant, en dit long sur la croyance qu'a la bourgeoisie mondiale, américaine en particulier, sur «l'ère de paix» qui devait régner avec le nouvel ordre mondial de Bush, ce nouveau programme de «guerre des étoiles» est aussi la dernière expression, et de taille, de la volonté hégémonique des USA. En effet, il assurerait la «sécurité collective de Vancouver à Vladivostok (from V. to V.) ». Traduction : il assurerait, sans doute définitivement, en tout cas pour un long moment, la suprématie militaire américaine «de V. à V» sur l'Europe et le Japon.
Quant aux «réductions» des dépenses d'armement, aux «dividendes de la paix», pour la bourgeoisie américaine, il ne s'agit pas de réduire son effort d'armement et de guerre, mais simplement de mettre au rancart tout ce qui ne sert plus. C'est à dire en gros la partie de l'arsenal qui était braquée sur l'URSS et qui a moins de raison d'être. On va essayer d'en vendre une partie à des prix défiant toute concurrence. Le reste ? Une montagne de ferraille qui a coûté une fortune (la plus grande partie de l'immense déficit américain). Par contre, le budget de programme de guerre des étoiles (SDI) augmente de 31 %. Le coût total du programme serait de 46 milliards de dollars... La course aux armements continue.
L'Allemagne de plus en plus présente sur la scène impérialiste mondiale
Toute une série d'éléments viennent confirmer la tendance, inévitable à ce que l'Allemagne apparaisse comme la principale puissance impérialiste rivale des USA ([11] [504]). Et la bourgeoisie américaine ne s'y trompe pas. Dès le mois de septembre 1991, quelques mois après la démonstration de force US dans le Golfe, le Washington Post relevait les éléments de la nouvelle «arrogance» («assertiveness») allemande :
«L'Allemagne menace de reconnaître la Croatie et la Slovénie ; elle amène l'Europe à entériner l'indépendance des Etats baltes; elle fustige ses alliés occidentaux pour leurs hésitations sur la question de l'aide à l'URSS ; elle appelle à une interdiction rapide des missiles à courte portée, propose que la CSCE crée sa propre force de maintien de la paix, et somme ses alliés de lui donner plus de contrôle sur les troupes stationnées sur son sol.»([12] [505])
«En décembre, l'Allemagne a forcé la main à ses partenaires européens en reconnaissant les deux Républiques à peine un mois après le sommet de Maastricht où le principe d'une politique étrangère et de défense commune avait été accepté, à la demande de Bonn ; la Bundesbank a relevé unilatéralement ses taux d'intérêt d'un demi point, dix jours après ce même sommet, où avait été entériné un processus d'union monétaire ; l'Allemagne n'a pas facilité la discussion du GATT, malgré la promesse formulée par Helmut Kohl de céder sur les subventions aux agriculteurs. Enfin, les diplomates de RFA adoptent une attitude de plus en plus impérieuse en Europe et aux Etats-Unis : on le sait, Kohl souhaite imposer l'allemand comme langue de travail communautaire... »{[13] [506])
Les bourgeoisies américaine, anglaise, et française aussi, même si c'est à divers titre, s'offusquent de la nouvelle «assertiveness» allemande. Elles n'y étaient plus habituées. L'apparence d'unité qui prévalait, se lézarde chaque fois un peu plus, l'Allemagne étant inévitablement poussée à défendre ses intérêts impérialistes propres, qui sont antagoniques à ceux des USA. En particulier, la révision de la Constitution qui lui interdit d'envoyer des troupes à l'étranger devient urgente : «L'engagement de moyens militaires pour réaliser des objectifs politiques en Europe et dans les régions voisines ne (devrait) pas être exclu.» ([14] [507])
En effet, après la guerre du Golfe, l'Allemagne a aussi révélé ses limites actuelles dans l'affaire yougoslave : sans poids militaire, et surtout absente du Conseil de sécurité de l’ONU, elle n'a pu aider, comme il aurait été nécessaire, la Croatie. Les USA, paralysant les efforts de cessez-le-feu de la CEE, et retardant la décision d'envoi des casques bleus de l'ONU, ont laissé les mains libres à l'armée fédérale, tenue par la Serbie, pour mener une guerre sanglante et repousser les ambitions territoriales de la Croatie.
L'impérialisme français, entre deux maux, choisit le moindre
La bourgeoisie française qui ne se console pas d'être une puissance de second ordre sur la scène impérialiste mondiale, se trouve prise entre son désir de s'affranchir de la tutelle pesante des USA, et sa crainte «éternelle» depuis l'instauration du capitalisme, de la puissance allemande.
Elle croit avoir trouvé la solution à son problème dans l'Europe, dans la CEE. Dans le cadre d'une Europe Unie, elle pourrait rivaliser avec les USA, et en même temps, parmi douze nations, elle pourrait juguler et contrôler l'Allemagne.
Pour l'instant, elle joue donc la carte allemande et se fait aguicheuse : elle propose de mettre sa force nucléaire au service d'une défense européenne. Le ministre des affaires étrangères allemand a réagi avec «intérêt» à cette proposition. Alors que les Etats-Unis s'attribuaient tous les bons rôles dans la Conférence sur l'aide à la CEI - que Mitterrand avait jugée superfétatoire - et l'organisation de I’«Opération Espoir» (Provide Hope) d'acheminement de vivres à la Russie, la France proposait que ce soit le G7 qui organise cette opération. Le G7 est actuellement présidé par... l'Allemagne.
Cette dernière ne reste pas insensible aux charmes français : après la création de la brigade franco-allemande, des accords de coopération militaire se constituent pour la construction d'un « eurocopter » (militaire évidemment) et l'Allemagne songe à acheter l'avion de chasse français, le Rafale.
Mais si mariage il doit y avoir, il sera de raison. Il ne s'agit pas d'un coup de foudre comme on a pu le constater dans la question yougoslave, où la France, «puissance méditerranéenne», penchait au début du côté américano-anglais, redoutant que l'Allemagne gagne les rives de la Méditerranée par Croatie interposée et de voir ainsi amoindrie une partie de la valeur de sa dot. Toujours est-il que pour l'instant, l'idylle continue. Mais elle ne va pas sans poser des problèmes à la France.
Les tensions entre USA et Europe s'accentuent
En fait, la France se trouve au centre d'une bataille qui la dépasse. «Le regain de tension entre la France et les Etats-Unis marque l'avènement d'une nouvelle ère où les anciens alliés semblent s'apprêter, à devenir de nouveaux rivaux dans des domaines tels que le commerce, la stratégie militaire et le nouvel équilibre mondial, selon certains hauts fonctionnaires américains et français.»([15] [508])
Le point faible de l'alliance franco-allemande sur lequel tape la bourgeoisie américaine est bien sûr la France. Elle tape d'autant plus fort que la France pourrait aider l'Allemagne à accéder à l'arme nucléaire.
Les événements en Algérie, au Tchad et à Djibouti, l'instabilité sociale et politique de ces pays, sont mis à profit par les USA pour faire pression sur la France, remettant en cause la présence de celle-ci dans ses zones d'influence historiques, après l'avoir expulsée du Liban. Que se soit le FIS qui est financé par l'Arabie Saoudite, le gouvernement de Djibouti qui, sous l'influence de l'Arabie Saoudite, met en question la présence de l'armée française sur son territoire, ou Hissene Habré le protégé des américains. La main des USA est présente qui vient s'appuyer sur le chaos effroyable qui prévaut dans ces pays, et du coup l'aggraver encore plus, pour ses intérêts impérialistes, tout comme la défense des intérêts impérialistes allemands en Yougoslavie n'a fait qu'accroître la décomposition qui régnait.
La pression américaine se fait très forte aussi sur le plan économique dans le cadre des négociations du GATT avec la CEE. Là encore, c'est la France qui est la principale visée sur la questions des subventions agricoles. Liant les questions de sécurité, l'engagement américain en Europe, au règlement des différents sur le GATT ([16] [509]), les USA exercent un véritable chantage sur les pays européens visant à les diviser. Comme le dit un journal bulgare, Douma : «alors que l'Europe construit "la maison commune européenne de l'Atlantique à l'Oural" brique par brique, les Etats-Unis la détruisent, brique par brique, sous le mot d'ordre "de Vancouver à Vladivostok"» ([17] [510])
Le Japon, autre grande puissance Impérialiste montante
De plus en plus, le Japon joue un rôle politique international qui, certes, n'est pas encore à la hauteur des ses ambitions, mais qui s'en rapproche petit à petit. Le voyage de Bush en Asie, et au Japon, et qui a eu pour objet fondamental le redéploiement des forces militaires américaines du Pacifique (base militaire à Singapour), a donné suite à des déclarations répétées des dirigeants japonais sur «l'analphabétisme des ouvriers américains» et sur leur «manque d'éthique», suite aux pressions US pour l'ouverture du marché japonais aux produits américains. Au delà de ces péripéties secondaires, mais révélatrices du climat et du réveil de 1' «assertiveness» de la bourgeoisie japonaise, le Japon revendique de plus en plus de jouer un rôle politique de premier plan sur la scène impérialiste : il pose de plus en plus la question de la recomposition du conseil permanent de l'ONU ; il est à la tête de la force de l'ONU au Cambodge ; il intervient de plus en plus sur le continent asiatique (Chine, Corée) ce qui ne va pas sans inquiéter les USA([18] [511]); et il réclame chaque jour avec plus d'insistance la restitution par la Russie des îles Kouriles (avec le soutien de l'Allemagne).
Le Japon va beaucoup plus vite que l'Allemagne sur les questions militaires. La révision de la Constitution limitant l'envoi de forces armées à l'étranger est beaucoup plus avancée. Et surtout, «il amasse d'énormes quantité de plutonium. Une centaine de tonnes. Beaucoup plus qu'il ne peut en consommer dans ses 39 centrales nucléaires actuelles (...). Alors la perspective d'un Japon stable et pacifiste transformé en puissance nucléaire n'a à priori rien d'alarmant. Pourtant, le Japon se donne les moyens de fabriquer des armes nucléaires, et chaque pas de plus peut-être lourd de conséquences internationales» {[19] [512])
Il faut se rendre à l'évidence, le nouvel ordre mondial qui devait apporter la paix à l'humanité, est lourd de menaces. D'un côté le chaos et la décomposition envahissent la planète et exacerbent les conflits locaux de toutes sortes, les rivalités et les guerres impérialistes régionales, de l'autre, les antagonismes impérialistes entre les grandes puissances prennent une tournure chaque fois plus aiguë et tendue. Leur développement, encore relativement «soft», mesuré, poli, courtois si l'on peut dire, en surface du moins, va s'approfondir et venir accélérer et aggraver les effets de la décomposition du monde capitaliste, le chaos et la catastrophe sociale et économique. Et il les accélère et aggrave déjà.
Une seule alternative a la barbarie capitaliste : le communisme
Face à la barbarie du monde capitaliste, où le tragique le dispute à l'absurde, la seule force capable d'offrir une alternative à cette impasse historique subit encore le contrecoup des événements qui ont marqué la fin du bloc de l'Est et de l'URSS. Les campagnes idéologiques internationales que la bourgeoisie a lancées sur «la fin du communisme» (en l'assimilant mensongèrement au stalinisme), sur «la victoire définitive du capitalisme», ont réussi momentanément à gommer des consciences des grandes masses d'ouvriers toute perspective de possibilité quelconque d'une autre société, d'une alternative à l'enfer capitaliste.
Ce désarroi qui touche le prolétariat et la baisse de sa combativité ([20] [513]) sont venus s'ajouter aux difficultés croissantes dues à la décomposition sociale qu'il rencontre. La lumpénisation, le désespoir et le nihilisme qui touchent déjà de grandes fractions du prolétariat mondial (à l'Est), représentent un danger pour les couches d'ouvriers (particulièrement les jeunes) rejetés de la production et au chômage. L'utilisation cynique de ce désespoir par la bourgeoisie, représente aussi une difficulté supplémentaire. En particulier, elle développe et attise des sentiments anti-immigrés et racistes, ce qui risque d'être encore plus alimenté par les vagues massives d'immigration à venir (spécialement des pays de l'Est). Les fausses oppositions racisme et antiracisme, totalitarisme et démocratie, fascisme et antifascisme, sont des tentatives de détourner les ouvriers de leurs luttes, du terrain anti-capitaliste de défense de leurs conditions de vie et d'opposition à l'Etat bourgeois, que les révolutionnaires doivent dénoncer implacablement.
Néanmoins, les temps changent et la crise économique, la récession ouverte qui touche les plus grandes puissances mondiales, USA en tête, reviennent au premier plan des préoccupations ouvrières. Les attaques contre la classe ouvrière sont en train de s'accélérer brutalement dans les principaux pays industrialisés. Les salaires sont bloqués depuis longtemps et aux USA «les salaires réels moyens des ouvriers (sont) plus bas qu'il y a 10 ou 15 ans»([21] [514]). Mais surtout, les licenciements se multiplient dramatiquement, et tout particulièrement dans les branches centrales de l'économie mondiale. IBM pour l'informatique a supprimé 30 000 emplois en 1991 et en prévoie autant en 1992; General Motors, Ford et Chrysler dans l'automobile ont accumulé les pertes (7 milliards de dollars) et licencient massivement ; les industries d'armement (General Dynamic, United Technologies) aussi. Des milliers d'emplois sont supprimés dans ces secteurs. Des milliers d'autres le sont dans les services (banques, assurances) : «Le nombre de demandes d'allocations chômage laisse à penser que 23 millions de personnes ont perdu leur emploi Vannée dernière.»
Sur une population de 250 millions d'habitants aux USA, 9 % de la population, 23 millions de personnes, vivent des «food stamps», c'est à dire des bons de nourriture. Plus de 30 millions vivent sous le seuil de pauvreté, et, à ce titre, bénéficient d'une protection de santé, le «Medicaid». Mais 37 millions, qui ont un niveau de vie au dessus de ce seuil, ne bénéficient d'aucune couverture de santé, qu'ils ne peuvent se payer. Ces gens sont dans l'impossibilité de se soigner... et la moindre maladie se transforme en catastrophe pour ces familles. C'est-à-dire qu'au bas mot 70 millions de personnes vivent dans la misère ! Voilà ce qu'il en est de la «prospérité» tant vantée du «capitalisme triomphant».
Bien évidemment, les licenciements massifs ne touchent pas que les ouvriers américains. Les taux de chômage sont particulièrement élevés dans des pays comme l'Espagne, l'Italie, la France, le Canada, la Grande-Bretagne. Partout, ils s'envolent dans les secteurs centraux de l'économie, dans l'automobile, dans la sidérurgie, dans les industries d'armement. Même le fleuron de l'industrie allemande, Mercedes (tout comme BMW), va licencier.
C'est une attaque terrible que la classe ouvrière des pays industrialisés commence à subir, une attaque qui vise à ramener ses conditions d'existence au plus bas.
Les licenciements, les baisses de salaires, la détérioration générale des conditions de vie, vont contraindre la classe ouvrière à reprendre le chemin du combat et des luttes massives. Ces luttes vont devoir de nouveau se confronter aux impasses politiques des partis de gauche et des gauchistes, aux manoeuvres syndicalistes, tel le corporatisme, et rechercher l'extension et l'unification des luttes. Dans ce combat politique, les groupes révolutionnaires et les ouvriers les plus combatifs et conscients auront un rôle crucial d'intervention pour aider au dépassement des pièges posés par les forces politiques et syndicales de la bourgeoisie.
Parallèlement, ces attaques contre les conditions de vie ouvrière viennent démentir le mythe de la prospérité du capitalisme, et révèlent aux yeux des grandes masses d'ouvriers l'état de faillite du capitalisme, sa banqueroute historique sur le plan économique. Cette prise de conscience va les pousser à rechercher de nouveau une alternative au capitalisme et gommer ainsi petit à petit les effets des campagnes bourgeoisies sur «la fin du communisme» et accélérer la recherche d'une perspective de lutte plus large, plus ample, d'une lutte historique et révolutionnaire. Dans ce processus de prise de conscience, les groupes communistes ont un rôle indispensable de rappel des expériences historiques du passé, de réaffirmation de la perspective du communisme, de sa nécessité et de sa possibilité historiques.
Le futur va se jouer dans les affrontements de classes qui vont inévitablement intervenir. Seuls la révolution prolétarienne et la destruction du capitalisme peuvent sortir l'humanité de l'enfer qu'elle subit quotidiennement. Seuls, ils peuvent éviter l'approfondissement de la barbarie capitaliste jusqu'à ses ultimes et dramatiques conséquences. Seuls, ils peuvent permettre l'établissement d'une communauté humaine où l'exploitation, la misère, les fa mines et les guerres seront éradiquées à jamais.
RL, 23/2/92
« Dans une phase supérieure de la société communiste, quand auront disparu l'asservissante subordination des individus à la division du travail et, par suite, l'opposition entre travail intellectuel et travail corporel; quand le travail sera devenu non seulement le moyen de vivre, mais encore le premier besoin de la vie; quand avec l'épanouissement universel des individus, les forces productives se seront accrues, et que toutes les sources de la richesse coopérative jailliront avec abondance - alors seulement on pourra s'évader une bonne fois de l'étroit horizon du droit bourgeois, et la société pourra écrire sur ses bannières : "De chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins".»
Marx. Critique du Programme de Gotha
[1] [515] Le Monde, 31/1/1992.
[2] [516] Le Monde 19/1/1992.
[3] [517] Selon la presse Tchécoslovaquie traduite dans Courrier International n 66, et Le Monde du 11/2/1992.
[4] [518] Le Monde, 16/2/1992.
[5] [519] International Herald Tribune, 21/2/1992.
[6] [520] Le Monde, 16/2/1992.
[7] [521] Baltimore Sun repris par International Herald Tribune du 12/2/1992.
[8] [522] International Herald Tribune, 19/2/1992.
[9] [523] Voir Revue Internationale n° 63, 64, 65.
[10] [524] Voir Revue Internationale n° 68.
[11] [525] Voir "Vers le plus grand chaos de l'histoire, Revue Internationale n° 68.
[12] [526] Washington Post, 18/9/1991, traduit par Courrier International n° 65.
[13] [527] Editorial de Courrier International n° 65, 30/1/1992.
[14] [528] Déclaration du Ministre allemand de la Défense, G. Stoltenberg, Le Monde, 18/1/1992.
[15] [529] Washington Post repris par Y International Herald Tribune, 23/1/1992.
[16] [530] Voir les déclarations du vice-président américain, Dan Quayle, Le Monde 11/2/1992.
[17] [531] Cité par Le Monde, idem.
[18] [532] International Herald Tribune, 3/2/1992.
[19] [533] Financial Times, traduit par Courrier International n° 65.
[20] [534] Voir Revue Internationale, n° 67, "Résolution sur la situation internationale" du 9 Congrès du CCI.
[21] [535] International Herald Tribune,
Récent et en cours:
- Luttes de classe [143]
Questions théoriques:
- Guerre [129]
Où en est la crise économique ? : Guerre commerciale : l'engrenage infernal de la concurrence capitaliste
- 2880 reads
«Guerre», «bataille», «invasion»t le langage belliciste a envahi la sphère de l'économie et du commerce. Avec la crise économique qui sévit depuis de nombreuses années, la concurrence pour des marchés solvables qui rétrécissent comme peau de chagrin se fait de plus en plus âpre, et prend la dimension d'une véritable guerre commerciale.
La concurrence économique est une constante de la vie du capitalisme, un de ses fondements inhérent à son être. Mais il y a une différence fondamentale entre les périodes de prospérité, durant lesquelles les entreprises capitalistes luttent pour s'ouvrir des marchés et accroître leurs profits, et les périodes de crise aiguë, comme celle que nous traversons actuellement, où la question n'est plus tant d'accroître les profits, que de limiter les pertes et d'assurer sa survie dans la bataille économique de plus en plus sévère. Preuve irréfutable de la bagarre économique qui fait rage : le record historique du nombre de faillites dans tous les pays du monde. Celles-ci ont ainsi augmenté de 56 % en 1991 en Grande-Bretagne, de 20 % en France, une hécatombe qui touche tous les secteurs économiques.
Exemple parmi d'autres : le transport aérien
Exemple parmi d'autres, mais particulièrement significatif de la guerre commerciale, le secteur des transports aériens. L'avion est devenu le symbole du développement du commerce et des échanges mondiaux dans leurs aspects les plus modernes depuis des décennies.
De la deuxième guerre mondiale jusqu'au début des années 1970, le boom du développement de ce mode de transport va permettre aux entreprises de ce secteur de se partager un marché en pleine expansion qui laisse à chacune de larges marges de développement dans une situation de faible concurrence. Les plus grandes compagnies grandissent douillettement sous la protection des lois et des réglementations mises en place par les Etats qui les parrainent. Les faillites sont rares et touchent seulement des entreprises d'importance secondaire.
Avec le retour de la crise capitaliste à la fin des années 1960, la concurrence va se faire plus rude. Le développement des compagnies «charters» qui viennent concurrencer les grandes compagnies sur les lignes les plus rentables et briser ainsi leur monopole, est le signe annonciateur de la crise terrible qui se développe dans les années 1980. Sous la pression accrue de la concurrence, les réglementations qui la limitaient volent en éclat; la dérégulation du marché intérieur américain, au début de la présidence Reagan, va sonner le glas de la période de prospérité et de sécurité que connaissaient jusque là les grandes compagnies aériennes. En une décennie, le nombre des grandes compagnies intérieures US passe de 20 à 7. Ces dernières années, les plus grands noms du transport aérien américain font un atterrissage brutal dans la banqueroute; tout récemment encore TWA vient de déposer son bilan, rejoignant au cimetière des ailes brisées PanAm, Eastern, Braniff, et d'autres.
Les pertes s'accumulent. En 1990, Continental a totalisé 2 343 millions de dollars de pertes; US air 454 millions ; TWA 237 millions. En 1991, la situation est encore pire. United airlines et Delta airlines, qui étaient les seules grandes compagnies américaines à annoncer un profit en 1990, affichent respectivement 331 millions de dollars de pertes pour l'année et 174 millions pour le premier semestre.
En Europe, la situation des compagnies aériennes n'est pas plus florissante. Lufthansa vient d'annoncer 400 millions de Deutschemarks de provision pour perte, Air France annonce des pertes consolidées de 1,15 milliard de francs au premier semestre 1991, SAS accumule 514 millions de couronnes suédoises de pertes pour le premier trimestre 1991, Sabena est à vendre, tandis que c'est l'hécatombe parmi les petites compagnies de transport régional. Quant à la première compagnie aérienne mondiale, officiellement Aeroflot, elle ne trouve plus de kérosène pour faire voler ses avions et est menacée d'éclatement avec la disparition de l'URSS.
Ce sombre bilan a d'abord eu son explication officielle toute trouvée dans la guerre du Golfe, qui a, effectivement, fait baisser pendant plusieurs mois la fréquentation des lignes aériennes. Mais, celle-ci terminée, les comptes ne se sont pas redressés, et le mensonge a fait long feu. La récession de l'économie mondiale ne vient pas de la guerre du Golfe et le transport aérien est un parfait résumé de ses effets dévastateurs.
Les lignes les moins rentables sont délaissées et des régions entières du globe, les plus sous-développées, sont de moins en moins bien reliées aux centres industriels du capitalisme.
La concurrence fait rage sur les trajets les plus rentables. Ainsi, sur l'Atlantique nord, les vols se sont multipliés, aboutissant à une surcapacité et diminuant le coefficient de remplissage des avions, tandis que la guerre des prix aboutit à des tarifs de dumping, détruisant ainsi leur rentabilité.
Depuis des années, pour renforcer leur compétitivité, à un moment où le marché était plus florissant, les compagnies aériennes se sont lancées dans des programmes ambitieux d'achats de nouveaux avions, s'endettant très lourdement dans la perspective de lendemains prospères. Elles se retrouvent aujourd'hui avec des avions neufs dont elles n'ont pas l'usage et sont obligées d'annuler leurs commandes ou de demander aux constructeurs aéronautiques de retarder les livraisons. Les avions ne trouvent plus preneur sur le marché de l'occasion et des dizaines de «jets» se retrouvent immobilisés sur des aéroports-parkings, sans emploi.
Pour restaurer les trésoreries déficientes, les compagnies aériennes rognent sur tous les postes de leur budget d'exploitation :
- elles licencient à tour de bras ; de puis deux ans, pas une seule compagnie qui n'ait pas licencié ; des dizaines de milliers de travailleurs très qualifiés se sont retrouvés au chômage sans possibilité de retrouver un emploi dans un secteur en crise ;
- l'entretien des avions est «allégé » ; ces dernières années, plusieurs compagnies ont été surprises à ne pas respecter les règles très strictes de contrôle du bon état des appareils ;
- les budgets de formation du personnel ont été réduits et les exigences de qualification des pilotes et techniciens assouplies ;
- le personnel navigant est soumis à des conditions d'exploitation plus sévères.
De telles mesures n'ont pour conséquence qu'une dégradation de la sécurité sur les lignes aériennes et la multiplication des accidents.
Alors que d'un côté, les compagnies sont engagées dans une politique d'économies tous azimuts pour renflouer leurs bilans, de l'autre, les mêmes règles de la concurrence les poussent à des dépenses massives. Une des lois de la survie, dans une situation de concurrence exacerbée, est la recherche de la taille critique par le développement d'alliances commerciales, de fusions, de rachats d'autres compagnies. Mais si cette politique se traduit à terme par des «économies d'échelle», par une meilleure gestion du matériel volant et du réseau, elle signifie d'abord des investissements lourds. Un exemple parmi d'autres : Air France qui vient de racheter UTA, de fusionner avec Air Inter, de prendre une participation dans la compagnie tchèque, nouvellement privatisée et voudrait bien racheter la Sabena belge, non parce que cette dernière serait particulièrement intéressante économiquement, mais surtout parce qu'il s'agit de ne pas laisser la concurrence s'en emparer. Une telle politique est très dispendieuse et signifie d'abord un développement de l'endettement. Dans leur volonté de survie, toutes les compagnies sont engagées dans ce jeu à «qui-perd-gagne», où les victoire sont des victoires à la Pyrrhus qui ne peuvent qu'hypothéquer l'avenir.
La guerre commerciale qui secoue le transport aérien est une illustration de l'absurdité d'un système basé sur la concurrence et les contradictions catastrophiques dans lesquelles plonge le capitalisme en crise. Cette réalité domine tous les secteurs de l'économie et toutes les entreprises, des plus petites aux plus grandes. Mais elle met aussi a nu une autre vérité, caractéristique du capitalisme dans sa phase de décadence : le rôle dominant du capitalisme d'Etat.
Les états au coeur de la guerre commerciale
Le secteur du transport aérien est un secteur stratégique essentiel pour tout Etat capitaliste, non seulement sur le strict plan économique, mais aussi sur le plan militaire. On voit que, pour le transport de troupes, comme lors du conflit dans le Golfe, la réquisition et la mise à disposition de l'armée de l'aviation civile sont nécessaires. Chaque Etat, quand il en a les moyens, se dote d'une compagnie aérienne qui porte ses couleurs, qui a une position de quasi-monopole sur les lignes intérieures. Toutes les compagnies aériennes un tant soit peu importantes sont sous le contrôle d'un Etat ou d'un autre. Cela est évidemment vrai des compagnies comme Air France qui est directement la propriété de l'Etat français, mais cela est tout aussi vrai des compagnies à statut privé. Celles-ci dépendent totalement de tout l'arsenal juridico administratif que chaque Etat a mis en place pour les contrôler étroitement. Et ce sont même souvent des liens plus occultes du contrôle du capital qui sont en jeu, comme durant la guerre du Vietnam, où la compagnie Air America s'est en fait révélé appartenir à la CIA.. Derrière la guerre commerciale qui se mène dans le secteur du transport aérien, comme dans tous les domaines, ce ne sont pas simplement des entreprises qui s'affrontent, mais des Etats.
Le discours offensif du capitalisme américain, qui se drape dans les plis de l'étendard du «libéralisme», de la sacro-sainte «loi du marché» et de la «libre concurrence» est un mensonge. Le protectionnisme étatique est la règle générale. Chaque Etat veut protéger son marché intérieur, ses entreprises, son économie. Là encore, le marché du transport aérien est un bon exemple. Alors que les USA se font les champions de la dérégulation pour faire jouer la «libre concurrence», le marché intérieur US est protégé et réservé aux transporteurs américains. Chaque Etat édicté un fatras de lois, de règles, de normes dont le but essentiel est de limiter la pénétration de produits étrangers. Le discours sur le libéralisme vise surtout à imposer aux autres Etats l'ouverture de leur marché intérieur. L'Etat est partout le principal agent économique et les entreprises ne sont que les champions d'un capitalisme d'Etat ou d'un autre. La forme juridique de propriété, privée ou publique, ne change rien à l'affaire. Le mythe des «multinationales» véhiculé par les gauchistes dans les années 1970 a fait long feu. Ces entreprises ne sont pas indépendantes de l'Etat, elles ne sont que le vecteur de l'impérialisme économique des plus grands Etats du monde.
Les rivalités économiques dans la logique de l'impérialisme
L'effondrement du bloc russe, en mettant fin à la menace militaire de l'armée rouge, a brisé un des ciments essentiels qui permettait aux USA d'imposer leur discipline aux pays qui constituaient le bloc occidental. Des pays comme l'Allemagne ou le Japon, qui étaient les principaux concurrents économiques des USA, n'en restaient pas moins des alliés fidèles. En échange de la protection militaire américaine, ils acceptaient la discipline économique que leur imposait leur tuteur. Ce n'est aujourd'hui plus le cas. La dynamique du chacun pour soi, de la guerre commerciale à tout crin, s'en est trouvée relancée. Logiquement, aux armes de la compétition économique s'associent les moyens de l'impérialisme. C'est cette réalité que vient d'exprimer tout haut Dan Quayle, le vice-président américain en déclarant en Allemagne, début février : «Il ne faut pas remplacer la guerre froide par la guerre commerciale», ajoutant pour bien préciser sa pensée : «le commerce est une question de sécurité», et : «Une sécurité nationale et internationale exige une coordination entre sécurité politique, militaire et économique »
Dans la bataille économique, les arguments de la propagande idéologique sur le «libéralisme» n'ont que peu de lien avec la réalité. La dernière réunion du G7 ([1] [536]) et les négociations du GATT ([2] [537]) sont un exemple frappant de la situation présente de guerre économique où, au nom du «libéralisme», ce sont les Etats qui négocient.
Le temps où les Etats-Unis pouvaient imposer leur loi est révolu. Le G7 n'est parvenu à aucun accord pour tenter une relance mondiale ordonnée. L'Allemagne occupée à sa réunification fait cavalier seul en maintenant des taux d'escompte élevés, limitant la capacité des autres pays de baisser les leurs pour favoriser cette hypothétique relance. Le voyage du président Bush au Japon, qui avait pour but explicite d'ouvrir le marché japonais aux exportations américaines, a été un fiasco. Les négociations du GATT s'enlisent malgré le forcing des USA qui utilisent tous les atouts de leur puissance économique et impérialiste pour tenter d'imposer des sacrifices économiques à leurs concurrents européens.
De manière significative, ces négociations prennent l'allure d'une foire d'empoigne entre les USA et la CEE. Chacun accuse l'autre de subventionner ses exportations, donc de déroger aux sacro-saintes lois du libre-échange, et tous ont raison. Les Etats européens subventionnent directement le constructeur d'avions Airbus par des aides, des prêts, des garanties de change, tandis que l'Etat américain subventionne indirectement ses constructeurs aéronautiques par des commandes militaires ou des budgets de recherche. En 1990, les pays de l'OCDE ont consacré 600 milliards de dollars à aider leurs industries. Dans le secteur agricole, la même année, les subventions au sein de l'OCDE ont cru de 12%. Un fermier américain bénéficie en moyenne d'une subvention de 22 000 dollars ; pour un fermier japonais celle-ci atteint, toujours en moyenne, 15 000 dollars ; et pour un fermier européen 12 000 dollars. Les belles paroles libérales sur la «magie du marché» sont de l'hypocrisie : c'est l'intervention permanente et renforcée de l'Etat dans tous les domaines à laquelle on assiste.
Loin des phrases sur la «libre concurrence», le «libre-échange» et la «lutte contre le protectionnisme», tous les moyens sont bons à chaque capital national pour assurer la survie de son économie et de ses entreprises dans la bagarre sur le marché mondial : subventions, dumping, pots-de-vin sont pratiques courantes des entreprises qui agissent sous l'oeil bienveillant de leur Etat protecteur. Et quand cela ne suffit pas, les hommes d'Etat se font représentants de commerce, ajoutant aux arguments économiques ceux de la puissance impérialiste. Sur ce plan les USA donnent l'exemple. Alors que leur économie subit la récession et manque de compétitivité face à ses concurrents, le recours aux arguments concrets que lui fournit sa puissance impérialiste, est devenu un moyen essentiel pour lui ouvrir des marchés, moyen que le simple jeu de la concurrence économique ne peut lui permettre de gagner. Et tous les Etats font d'ailleurs de même, dans la mesure de leurs moyens.
Il n'y a plus de loi qui vaille que celle de la survie, tous les moyens sont bons pour gagner la bataille. Telle est la loi de la guerre commerciale, comme celle de toute guerre. «Exporter ou mourir» disait Hitler : c'est devenu la devise obsédante de tous les Etats du monde. L'anarchie et la pagaille règnent sur le marché mondial, la tension monte et ce n'est pas un accord formel du GATT qui pourra freiner cette dynamique vers le chaos. Alors que, depuis des années, des négociations se mènent à couteaux tirés pour essayer de mettre un peu d'ordre sur le marché, la situation échappe déjà à tout contrôle, les accords de troc se multiplient qui ne rentrent pas dans les réglementations du GATT. Chaque Etat se préoccupe déjà de trouver les moyens de contourner les accords futurs.
La perspective n'est pas à une atténuation des tensions.
Plongée dans la récession la guerre commerciale ne peut que s'intensifier
Malgré l'attente et les espoirs des dirigeants du monde entier, l'économie américaine ne parvient pas à sortir de la récession dans laquelle elle est officiellement plongée depuis un an. Les mesures de relance par la baisse du taux d'escompte de la Banque Fédérale, ont tout juste permis de freiner la chute et de limiter les dégâts. Finalement, l'année 1991 se solde par une baisse de 0,7 % du PNB américain. De manière significative, les autres pays industrialisés sont en train de suivre l'économie américaine dans sa chute.
Au Japon, la production industrielle a chuté de 4 % durant les douze mois précédant janvier 1992. Sur les trois derniers mois de l'année 1991, la production industrielle a baissé de 4 % dans la partie occidentale de l'Allemagne, de 29,4 % en Suède (!), de 0,9 % en France. En 1991, le PIB de la Grande-Bretagne a diminué de 1,7% par rapport à l'année précédente. La dynamique de récession est généralisée à tous les grands pays industrialisés.
Le récent discours du président Bush sur l'état de l'Union, qui devait annoncer des mesures pour sortir l'économie américaine du marasme est une déception. Pour l'essentiel, il s'agit d'un saupoudrage de recettes qui ont déjà démontré, tout au long de ces derniers mois, leur inefficacité et qui relèvent en fait plus de la démagogie électoraliste que d'une réelle efficacité économique. Les baisses des impôts vont essentiellement avoir pour effet de creuser encore plus le déficit budgétaire qui a déjà atteint 270 milliards de dollars en 1991 et doit, selon les prévisions officielles, culminer à 399 milliards de dollars en 1992, posant encore plus lourdement le problème de la dette américaine. Quant à la réduction du budget d'armement, les fameux <r dividendes de la paix », il n'aura pour seul résultat que de faire encore plus s'empêtrer l'économie US dans le marasme en diminuant les commandes de l'Etat à un secteur déjà en crise et pour lequel plus de 400 000 licenciements sont prévus dans les années qui viennent.
De fait, le seul aspect un tant soit peu positif pour le capital américain en 1991 est le redressement de sa balance commerciale, bien qu'elle soit encore très largement déficitaire. Sur les onze premiers mois de l'année 1991, il atteint 64,7 milliards de dollars, en résorption de 36 % par rapport à la même période de l'année précédente où il atteignait 101,7 milliards de dollars. Cependant ce résultat n'est pas le produit d'une plus grande compétitivité économique, mais de la capacité des USA d'utiliser tous les atouts conjugués, économique et impérialiste, que lui donne son statut de première puissance dans la guerre économique qui se joue sur la scène mondiale. Ce redressement de la balance commerciale américaine signifie, avant tout, une dégradation de celle des autres pays concurrents, et donc une aggravation de la crise mondiale et une concurrence toujours plus forte sur le marché mondial.
Le mensonge nationaliste, un danger pour la classe ouvrière
Le corollaire de la guerre commerciale, c'est le nationalisme économique. Chaque Etat essaie d'embrigader «ses» ouvriers dans la guerre économique, leur demandant d'accepter de se serrer la ceinture au nom de la solidarité autour de la nécessaire défense de l'économie nationale, lançant des campagnes pour encourager l'achat de produits nationaux. «Buy american» est le nouveau slogan des lobbies protectionnistes aux USA.
Depuis des années les prolétaires sont appelés à la sagesse, à la responsabilité, à se soumettre aux mesures d'austérités pour que demain la situation s'améliore, et depuis des années tout va de mal en pis. Partout, dans tous les pays, la classe ouvrière a été la première victime de la guerre économique. Ses salaires et son pouvoir d'achat ont été amputés au nom de la compétitivité économique, les licenciements ont été effectués au nom de la survie de l'entreprise. Le pire des pièges serait pour les prolétaires de croire le mensonge du nationalisme économique comme solution, ou moindre mal, face à la crise. Cette propagande nationaliste, martelée aujourd'hui pour que les ouvriers exsudent plus de sueur pour le capital, est la même que celle qui sert à justifier qu'ils donnent leur sang pour la « défense de la patrie».
La guerre commerciale, avec ses ravages sur l'économie mondiale, est l'expression de l'impasse absurde dans laquelle s'enfonce le capitalisme mondial en proie à la plus grande crise économique de son histoire. Alors que la pauvreté, la pénurie dominent la majeure partie de la population mondiale, la production chute, les usines ferment, les terres sont stérilisées, les travailleurs réduits au chômage, les moyens de production inutilisés. Telle est la logique du capitalisme basé sur la concurrence qui mène au chacun pour soi, à l'affrontement de tous contre tous, à la guerre, vers toujours plus de destructions. Seule la classe ouvrière, qui n'a pas d'intérêts particuliers à défendre, qu'elle soit d'un pays où d'un autre, elle qui partout subit l'exploitation et la misère, peut, par sa lutte, offrir une autre perspective à l'humanité. En défendant, par delà toutes les divisions et toutes les frontières du capitalisme, son unité et sa solidarité de classe internationale, elle seule peut permettre une sortie de la tragédie chaque jour plus dramatique dans laquelle le capitalisme est en train d'entraîner la planète.
JJ, 3/3/92
«La loi selon laquelle une masse toujours plus grande des éléments constituants de la richesse peut, grâce au développement continu des pouvoirs collectifs du travail, être mise en oeuvre avec une dépense de force humaine toujours moindre, cette loi qui met l'homme social à même de produire davantage avec moins de labeur, se tourne dans le milieu capitaliste - où ce ne sont pas les moyens de production qui sont au service du travailleur, mais le travailleur qui est au service des moyens de production - en loi contraire, c'est-à-dire que plus le travail gagne en ressources et en puissance, plus il y a pression des travailleurs sur les moyens d'emploi, plus la condition d'existence des salariés, la vente de sa force de travail devient précaire.»
Marx, Le Capital, livre I, 7e section.
[1] [538] Groupe des sept plus grands pays industrialisés qui organisent des réunions régulières afin de «tenter» de coordonner leurs politiques économiques pour faire face à la crise mondiale.
[2] [539] General agreement on tarifs and trade : négociations internationales destinées à établir des accords de régulation du marché mondial en «réglementant» les conditions de la concurrence.
Récent et en cours:
- Crise économique [28]
La plus grave crise économique de l'histoire du capitalisme : l'éclatante vérification du marxisme
- 8572 reads
Alors que le capitalisme connaît la plus grave crise économique de son histoire, les défenseurs de l'ordre établi ne cessent de proclamer la mort du marxisme, c'est à dire de la seule théorie qui permet de comprendre la réalité de cette crise, et qui l'a prévue. Usant jusqu'à la corde le vieux et ignoble mensonge qui identifie marxisme et stalinisme, révolution et contre-révolution, la bourgeoisie veut faire passer la faillite du capitalisme d'Etat stalinien pour la faillite du communisme et de sa théorie, le marxisme. C'est une des plus violentes attaques qu'ait eu à subir, sur le plan de la conscience, la classe ouvrière depuis des décennies. Mais les exorcismes hystériques de la classe dominante ne peu vent rien changer à la réalité crue : les théories bourgeoises s'avèrent totalement incapables d'expliquer l'actuel désastre économique, alors que l'analyse marxiste des crises du capitalisme trouve une éclatante vérification.
L'impuissance des «théories» bourgeoises
Il est frappant de voir les plus lucides des «penseurs et commentateurs» de la classe dominante constater l'ampleur du désastre qui bouleverse la planète, sans qu'ils puissent pour autant fournir le moindre début d'explication cohérente. Il peuvent se répandre pendant des heures à la télévision, remplir des pages entières dans les journaux sur les ravages de la misère et de la maladie en Afrique, sur l'anarchie destructrice qui menace de famine l'ancien empire « soviétique », sur la dévastation écologique de la planète qui met en péril la survie même de l'espèce humaine, sur les ravages de la drogue devenue un commerce aussi important que celui du pétrole, sur l'absurdité qui consiste à stériliser des terres cultivables en Europe alors que les famines se multiplient dans le monde, sur le désespoir et la décomposition qui rongent les banlieues des grandes métropoles, sur le manque de perspectives qui envahit toute la société mondiale... ils peuvent multiplier les études «sociologiques» et économiques dans tous les domaines, le pourquoi de tout cela reste pour eux un mystère.
Les moins stupides perçoivent vaguement qu'à l'origine il y a un problème économique. Sans le dire, ou le savoir, ils se rendent à cette vieille découverte du marxisme qui dit que, jusqu'à présent, l'économie constitue la clé de l'anatomie de la vie sociale. Mais cela ne fait qu'ajouter à leur perplexité. Car, dans la bouillie qui leur sert de cadre théorique, le blocage de l'économie mondiale demeure le mystère des mystères.
L'idéologie dominante repose sur le mythe de l'éternité des rapports de production capitalistes. Envisager, ne fût-ce qu'un instant, que ces rapports, le salariat, le profit, les nations, la concurrence, ne constituent plus le seul mode d'organisation économique possible, comprendre que ces rapports sont devenus la calamité à la source de tous les fléaux qui frappent l'humanité, voilà qui mettrait définitivement à terre les quelques pans qui subsistent de leur édifice philosophique.
Les économistes n'ont cessé d'avancer depuis deux décennies, dans un langage de plus en plus incompréhensible, des «explications» de la dégradation continue de l'économie mondiale. Ces «explications» ont toutes en commun deux caractéristiques : la défense du capitalisme comme seul système possible, et le fait d'avoir été, les unes après les autres, ouvertement ridiculisées par la réalité peu de temps après avoir été formulées. Qu'on se rappelle.
A la fin des années 1960, lorsque la «prospérité», qui avait accompagné la reconstruction d'après la seconde guerre mondiale, touchait à sa fin, il y a eu deux récessions : en 1967 et en 1970. Comparées aux secousses économiques que nous avons connues depuis, ces récessions peuvent aujourd'hui sembler bien insignifiantes ([1] [540]) Mais, à l'époque, elles constituaient un phénomène relativement nouveau. Le spectre de la crise économique, qu'on croyait avoir définitivement enterré depuis la dépression des années 1930, revenait hanter les esprits des économistes bourgeois ([2] [541]). La réalité parlait d'elle même : la reconstruction terminée, le capitalisme plongeait à nouveau dans la crise économique. Le cycle de vie du capitalisme décadent depuis 1914 se confirmait: crise -guerre - reconstruction - nouvelle crise. Mais les «experts» ont expliqué qu'il n'en était rien. Le capitalisme était tout simplement à l'aube d'une nouvelle jeunesse et il ne subissait qu'une crise de croissance. La raison de ces secousses n'aurait été que «la rigidité du système monétaire hérité de la seconde guerre mondiale» - les fameux accords de Bretton-Woods qui reposaient sur le dollar comme étalon et un système de taux de change fixe entre les monnaies. On créa donc une nouvelle monnaie internationale, les Droits de tirage spéciaux (DTS) du FMI et on décida que les taux de change flotteraient librement.
Mais, quelques années après, deux nouvelles récessions, beaucoup plus profondes, longues et étendues géographiquement ont frappé de nouveau le capitalisme mondial, en 1974-75 puis en 1980-82. Les «experts» ont alors trouvé une nouvelle explication : la pénurie de sources d'énergie. On baptisa ces nouvelles convulsions «chocs pétroliers». Par deux fois encore on expliqua que le système n'était pour rien dans ces difficultés. Il s'agissait seulement des effets de la cupidité des cheiks arabes, voire même de la revanche de certains pays sous-développés producteurs de pétrole. Et, comme pour mieux se convaincre de l'éternelle vitalité du système, la «reprise» économique des années 80 se fit au nom d'un retour à un « capitalisme pur ». Les «reaganomics», redonnant aux entrepreneurs privés les pouvoirs et la liberté que les Etats leur avaient prétendument confisqués, devaient enfin faire exploser toute la puissance créatrice du système. Privatisations, élimination impitoyable des entreprises déficitaires, généralisation de la précarité de l'emploi pour mieux permettre le jeu du marché au niveau de la force de travail, l'affirmation du «capitalisme sauvage» devait montrer à quel point les fondements du capitalisme restent sains et offrent la seule issue possible. Mais dès le début des années 80, les économies des pays du «tiers-monde» s'effondrent. Au milieu des années 80, l'URSS et les pays de l'Est de l'Europe, s'engagent dans une voie «libérale», essayant de s'arracher aux formes les plus rigides de leur capitalisme ultra étatisé. La décennie se termine avec une nouvelle aggravation du désastre : l'ancien bloc soviétique plonge dans un chaos sans précédent.
Dans un premier temps, les idéologues des démocraties occidentales ont présenté cela comme une confirmation de leur évangile : l'URSS et les pays d'Europe de l'Est s'écroulent parce qu'ils ne parviennent pas encore à devenir réellement capitalistes ; les pays du «tiers-monde» parce qu'ils gèrent mal le capitalisme. Mais au début des années 90, il se confirme que la crise économique frappe violemment les pays les plus puissants de la planète. Le coeur du capitalisme «pur et dur». Et, à l'avant-garde de ce nouveau plongeon se trouvent justement les champions du nouveau libéralisme, les pays qui étaient censés donner au monde entier l'exemple des miracles que peut accomplir «l'économie de marché» : les Etats-Unis et la Grande Bretagne.
Au début de 1992 les plus beaux fleurons du capitalisme occidental, les entreprises les mieux gérées de la planète annoncent que leurs profits s'écroulent et qu'elles s'apprêtent à supprimer des dizaines de milliers de postes de travail : IBM, premier constructeur d'ordinateurs du monde, le modèle des modèles, qui n'avait jamais connu de pertes depuis sa fondation ; General Motors, première entreprise industrielle du monde, dont on résume la puissance par la fameuse formule «Ce qui est bon pour General Motors est bon pour les Etats-Unis» ; United Technologies, un des premiers et plus modernes groupes industriels américains ; Ford ; Mercedes Benz, le symbole de la puissance du capital allemand, qui se flattait d'être le seul constructeur d'automobiles à avoir embauché au cours des années 80 ; Sony, champion du dynamisme et de l'efficacité du capital japonais... Quant au secteur bancaire et financier mondial, celui qui a connu la plus grande «prospérité» au cours des années 80, profiteur immédiat de cette période marquée par les plus gigantesques spéculations et les endettements les plus démentiels de l'histoire, il est frappé de plein fouet par la crise et menace de s'écrouler usé par ses propres abus. Des «abus» que certains économistes semblent découvrir aujourd'hui, mais qui ont constitué depuis deux décennies la véritable bouée de sauvetage de l'économie mondiale : la fuite en avant dans le crédit. La «machine à repousser les problèmes dans le temps» tombe en morceaux, écrasée par le poids des dettes cumulées pendant des années. ([3] [542])
Que reste-t-il des explications de la crise par «l'excessive rigidité du système monétaire» lorsque l'anarchie des taux de change est devenue un élément de l'instabilité économique mondiale ? Que reste-t-il du bavardage sur les «chocs pétroliers» lorsque les cours du pétrole se noient dans la surproduction ? Que reste-t-il des discours sur «le libéralisme» et «les miracles de l'économie de marché» lorsque l'effondrement économique se fait dans la plus sauvage des guerres commerciales pour un marché mondial qui se rétrécit à vitesse accélérée ? Que valent les explications basées sur une découverte tardive des dangers de l'endettement lorsqu'on ignore que cet endettement suicidaire était le seul moyen de prolonger la survie d'une économie agonisante ?
Ces prêtres de l’absurde que sont devenus les économistes dans le capitalisme décadent, ne parviennent pas plus à comprendre le pourquoi de la crise économique, qu'à dessiner une quelconque perspective sérieuse pour le proche ou le moyen avenir([4] [543]). Leur métier de défenseurs du système capitaliste leur interdit, aussi «intelligents» soient-ils, de comprendre la plus élémentaire réalité : le problème de l'économie mondiale ne réside pas dans une question de pays ou de façon de gérer le système capitaliste. C'est le système mondial, le capitalisme lui même qui est le problème. Leurs «raisonnements», leurs «pensées» resteront certainement dans l'histoire comme un des plus sinistres exemples de l'aveuglement et de la stupidité de la pensée d'une classe décadente.
Le marxisme, la première conception cohérente de l'histoire
Avant Marx, l'histoire humaine apparaissait généralement comme une suite d'événements plus ou moins disparates, évoluant au gré des batailles militaires ou des convictions idéologiques ou religieuses de tel ou tel puissant de ce monde. En dernière instance, la seule logique pouvant servir de fil conducteur à cette histoire devait être cherchée en dehors du monde matériel, dans les sphères éthérées de la divine Providence ou, dans le meilleur des cas, dans le développement de l'Idée Absolue de l'Histoire chez Hegel([5] [544]).
Aujourd'hui, les économistes et autres «penseurs» de la classe dominante en sont restés au même point, le retard en plus. Avec l'effondrement de ce qu'ils considèrent avoir été «le communisme», il en est même qui, reprenant une caricature de la pensée de Hegel, annoncent «la fin de l'histoire» : puisque maintenant tous les pays parviennent à la forme la plus achevée du capitalisme («le libéralisme démocratique»), puisqu'il ne peut rien y avoir au delà du capitalisme, nous serions au bout du chemin. Avec de telles conceptions, l'actuel chaos, le blocage économique de la société, sa désagrégation généralisée ne peuvent que demeurer un mystère de la Providence. Pour celui qui croit qu'au delà du capitalisme il ne peut rien exister, le terrifiant constat de faillite au bout de plusieurs siècles de domination capitaliste sur la planète, ne peut provoquer que stupeur, une stupeur à faire désespérer de l'humanité.
Pour le marxisme, par contre, il s'agit d'une éclatante confirmation des lois historiques qu'il a découvertes et formulées. Du point de vue du prolétariat révolutionnaire, le capitalisme n'est pas plus éternel que ne l'ont été les anciens modes d'exploitation, le féodalisme ou l'esclavagisme antique par exemple. Le marxisme se distingue justement des théories communistes qui l'ont précédé, par le fait qu'il fonde le projet communiste sur une compréhension de la dynamique de l'histoire : le communisme devient possible historiquement parce que le capitalisme crée simultanément les conditions matérielles permettant d'accéder à une véritable société d'abondance, et la classe capable d'entreprendre la révolution communiste : le prolétariat. Il devient une nécessité historique parce que le capitalisme aboutit à une impasse.
Autant l'impasse capitaliste déconcerte les bourgeois et leurs économistes, autant elle confirme les marxistes dans leurs convictions révolutionnaires.
Mais, comment les marxistes expliquent-ils cette situation de cul-de-sac historique ? Pourquoi le capitalisme ne peut-il pas se développer à l'infini ? Une phrase du Manifeste communiste, de Marx et Engels, résume la réponse : «Les institutions bourgeoises sont devenues trop étroites pour contenir la richesse qu'elles ont créée».
Quelle est la signification de cette formulation ? La réalité actuelle la confirme-t-elle ?
«Les institutions bourgeoises»
Un des pièges de l'idéologie bourgeoise, et dont les premières victimes sont les économistes eux-mêmes, consiste à croire que les rapports capitalistes seraient des rapports «naturels». L'égoïsme, la rapacité, l'hypocrisie et la cynique cruauté de l'exploitation capitaliste ne seraient que la forme la plus raffinée atteinte par une éternelle, et toujours «mauvaise», «nature humaine».
Mais quiconque jette un regard à l'histoire constate immédiatement qu'il n'en est rien. Les rapports sociaux actuels ne dominent la vie économique de la société que depuis 500 ans, si l'on situe, comme Marx, le début de cette domination au 16e siècle, lorsque la découverte de l'Amérique et l'explosion du commerce mondial qui s'ensuit, permettent aux marchands capitalistes de commencer à imposer définitivement leur pouvoir sur la vie économique de la planète. Auparavant, l'humanité a connu d'autres sociétés de classes, comme le féodalisme et l'esclavagisme antique, et avant cela, elle a vécu pendant des millénaires sous des formes diverses de «communisme primitif», c'est-à-dire dans des sociétés sans classes ni exploitation.
«Dans la production sociale de leur existence, - explique Marx([6] [545])- les hommes nouent des rapports déterminés, nécessaires, indépendants de leur volonté; ces rapports de production correspondent à un degré donné du développement de leurs forces productives matérielles. L'ensemble de ces rapports forme la structure économique de la société, la fondation réelle sur laquelle s'élève un édifice juridique et politique, et à quoi répondent des formes déterminées de la conscience sociale.»
Les institutions bourgeoises, les rapports de production capitalistes et leur «édifice juridique et politique», loin de constituer des réalités éternelles, ne sont qu'une forme particulière, momentanée de l'organisation sociale, correspondant «à un degré donné du développement des forces productives». Marx disait qu'au moulin à bras correspondait l'esclavagisme antique, au moulin à eau le féodalisme, au moulin à vapeur le capitalisme.
Mais en quoi consistent ces rapports ? Dans la mythologie qui identifie stalinisme et communisme, il est commun de définir les rapports capitalistes par opposition à ceux qui prédominaient dans les pays soi-disant communistes, tels l'ex-URSS. La question de la propriété des moyens de production par des capitalistes individuels ou par l'Etat serait le critère déterminant. Mais, commet l'avaient déjà démontré Marx et Engels dans leur combat contre le socialisme étatique de Lassalle, le fait que l'Etat capitaliste possède ; les moyens de production ne fait t que donner à cet Etat le statut de «capitaliste collectif idéal». '
Rosa Luxemburg, une des plus grandes marxistes depuis Marx, insiste sur deux critères principaux, deux aspects de l'organisation sociale pour déterminer les spécificités d'une mode d'exploitation par rapport aux autres : le but de la production et le rapport qui lie l'exploité à ses exploiteurs. Ces critères, définis bien avant la révolution russe et son étouffement, ne laissent d'ailleurs aucun doute sur la nature capitaliste des économies staliniennes. ([7] [546])
Le but de la production
Rosa Luxemburg résume la spécificité du but de la production capitaliste de la façon suivante : «Le propriétaire d'esclaves achetait des esclaves pour sa commodité et pour son luxe, le seigneur féodal extorquait des corvées et des redevances au serfs dans le même but: pour vivre largement avec sa parenté. L'entrepreneur moderne ne fait pas produire aux travailleurs des vivres, des vêtements, des objets de luxe pour sa consommation, il leur fait produire des marchandises pour les vendre et en retirer de l'argent.»([8] [547])
Le but de la production capitaliste c'est l'accumulation du capital, à tel point que les dépenses de luxe auxquelles se livrent les membres de la classe exploiteuse sont, dans les temps radicaux du capitalisme naissant, condamnées par le puritanisme bourgeois. Marx en parle comme d'un «vol du capital».
Les bourgeois-bureaucrates prétendent que dans leurs régimes, on ne poursuit pas des objectifs capitalistes et que le revenu des «responsables» est sous forme de «salaire». Mais le fait que le revenu soit distribué sous forme de revenu fixe (faussement appelé dans ce cas «salaire») et d'avantages de fonction, au lieu de l'être sous forme de revenus d'actions ou placements individuels, tout cela n'est pas significatif lorsqu'il s'agit de déterminer s'il s'agit d'un mode de production capitaliste ([9] [548]). Le revenu des grands i bureaucrates de l'Etat n'en est pas moins fait du sang et de la sueur des prolétaires. La «planification» stalinienne de la production ne poursuit pas d'autres objectifs que les investisseurs de Wall-Street : nourrir le dieu Capital National avec le sur-travail extirpé aux exploités, accroître la puissance du capital et en assurer la défense face aux autres capitaux nationaux. L'aspect «Spartiate» affiché, hypocritement, par les bureaucraties staliniennes, surtout lorsqu'elles viennent de s'emparer du pouvoir, n'est qu'une caricature dégénérée du puritanisme de l'accumulation primitive du capital, une caricature rendue difforme par les lèpres du capitalisme décadent : la bureaucratie et le militarisme.
Le lien exploité-exploiteur
Les spécificités du capitalisme, quant au rapport entre l'exploité et son exploiteur, ne sont pas moins importantes ni moins présentes dans le capitalisme d'Etat stalinien.
Dans l'esclavagisme antique, l'esclave est nourri tout comme le sont les animaux appartenant au maître. Il reçoit, de la part de son exploiteur, le minimum indispensable pour vivre et se reproduire. Cette quantité est relativement indépendante du travail qu'il fournit. Même s'il n'a pas travaillé, même si la récolte est détruite, le maître se doit de le nourrir, sous peine de le perdre, comme on perd un cheval qu'on a négligé d'alimenter.
Dans le servage féodal, le serf partage encore avec l'esclave, même si c'est sous des formes plus distendues et émancipées, sa condition d'objet personnellement rattaché à son exploiteur ou à une exploitation : on cède un château avec ses terres, ses bêtes et ses serfs. Cependant, le revenu du serf n'est plus véritablement indépendant du travail qu'il effectue. Son droit à prélever sur la production est défini comme une partie, un pourcentage de la production réalisée.
Dans le capitalisme, l'exploité, le / prolétaire est «libre». Mais cette «liberté» tant vantée par la propagande bourgeoise, se résume au j fait que l'exploité n'a aucun lien personnel avec son exploiteur. L'ouvrier n'appartient à personne, il n'est rattaché à aucune terre ou propriété. Son lien avec son exploiteur se réduit à une opération commerciale : il vend, non pas lui même, mais sa force de travail. Sa «liberté» c'est d'avoir été séparé de ses moyens de production. C'est la liberté du capital de l'exploiter en n'importe quel lieu, pour lui faire produire ce que bon lui semble. La part que le prolétaire a le droit de prélever sur le produit social (quand il y a droit) est indépendante du produit de son travail. Cette part équivaut au prix de la seule marchandise importante qu'il possède et reproduit : sa force de travail.
«Comme toute autre marchandise, la marchandise "force de travail" a sa valeur déterminée. La valeur de toute marchandise est déterminée par la quantité de travail nécessaire à sa production. Pour produire la marchandise "force de travail", une quantité déterminée de travail est également nécessaire, le travail qui produit la nourriture, les vêtements, etc., pour le travailleur. La force de travail d'un homme vaut ce qu'il faut de travail pour le maintenir en état de travailler, pour entretenir sa force de travail.»([10] [549]}
C'est le salariat.
Les staliniens prétendent que leurs régimes ne pratiquent pas cette forme d'exploitation car il n'y a pas de chômage. Il est vrai que, de façon générale, dans les régimes staliniens on «fait travailler les chômeurs». Le marché du travail est caractérisé par la situation de monopole de l'Etat qui achète pratiquement tout ce qui se trouve sur le marché, en échange de salaires de misère. Mais l'Etat, ce «capitaliste collectif», n'en est pas moins acheteur et exploiteur. Pour le prolétaire, la garantie d'emploi, il doit la payer de l'interdiction absolue de toute revendication et de l'acceptation des conditions de vie les plus misérables. Le stalinisme ce n'est pas la négation du salariat, mais la forme totalitaire de celui-ci.
Aujourd'hui, les économies des pays staliniens ne deviennent pas capitalistes, elles ne font que tenter d'abandonner les formes les plus rigidement étatiques du capitalisme décadent qui les caractérisent.
Production exclusivement en vue de la vente pour l'accumulation de capital, rémunération des travailleurs par le salariat, cela ne définit évidemment pas toutes les institutions bourgeoises, mais met en avant les plus spécifiques. Celles qui permettent de comprendre pourquoi le capitalisme est condamné à l'impasse.
«La richesse qu'elles ont créée... »
Au sortir de la société féodale, les rapports de production capitalistes, les «institutions bourgeoises» ont permis un bond gigantesque des forces productives de la société. A l'époque où le travail d'un homme permettait à peine de se nourrir lui-même et un autre, lorsque la société était encore morcelée en une multitude de fiefs quasiment autonomes les uns par rapport aux autres, le développement de la «liberté» du salariat et de l'unification de l'économie par le commerce, a constitué un puissant facteur de développement.
«La bourgeoisie... a montré ce que l'activité humaine est capable de réaliser. Elle a accompli des merveilles qui sont autre chose que les pyramides égyptiennes, les aqueducs romains, les cathédrales gothiques... Au cours de sa domination de classe à peine séculaire, la bourgeoisie a créé des forces productives plus massives et plus colossales que ne l'avaient fait dans le passé toutes les générations dans leur ensemble.»([11] [550])
Contrairement aux théories communistes pré-marxistes, qui disaient le communisme possible à tout moment de l'histoire, le marxisme reconnaît que seul le capitalisme crée les moyens matériels d'une telle société. Avant de devenir «trop étroites pour contenir la richesse qu'elles ont créée», les institutions bourgeoises étaient suffisamment larges pour apporter, « dans la boue et dans le sang » deux réalités indispensables à l'instauration d'une véritable société communiste : la création d'un réseau productif mondial (le marché mondial) et un développement suffisant de la productivité du travail. Deux réalités qui, on le verra, finiront par se transformer en un cauchemar pour la survie du capital.
« La grande industrie a fait naître te marché mondial, que la découverte de l'Amérique avait préparée... – dit le Manifeste communiste. Poussée par le besoin de débouchés toujours plus larges pour ses produits, la bourgeoisie envahit toute la surface du globe. Partout elle doit s'incruster, partout il lui faut bâtir 1 partout elle établit des relations..] Elle contraint toutes les nations\ sous peine de courir à leur perte, d'adopter le mode de production bourgeois; elle les contraint d'importer chez elles ce qui s'appelle la civilisation, autrement dit : elle en fait des nations de bour geois. En un mot, elle crée un monde à son image. »([12] [551])
Stimulant et produit de cette unification de l'économie mondiale, la productivité du travail fait les plus importants progrès de l'histoire. La nature même des rapports capitalistes, la concurrence à mort dans laquelle vivent les différentes fractions du capital, au niveau national ou international, contraint celles-ci à une course permanente à la productivité. Baisser les coûts de production, pour être plus compétitifs, est une condition de survie sur le marché.([13] [552])
Malgré le poids destructif de l'économie de guerre devenue quasi permanente depuis la première guerre mondiale, malgré les irrationalités introduites par un fonctionnement devenu de plus en plus militarisé, difficile et contradictoire depuis la constitution définitive du marché mondial, au début de ce siècle([14] [553]), le capitalisme a poursuivi un développement de la productivité technique du travail. On estime([15] [554]) que vers 1700, un travailleur agricole en France pouvait nourrir 1,7 personne, c'est-à-dire qu'il s'alimentait lui même et fournissait les trois quarts de l'alimentation d'une autre personne ; en 1975, un travailleur agricole aux Etats-Unis peut nourrir 74 personnes en plus de lui ! La production d'un quintal de blé coûtait 253 heures de travail en 1708 en France ; ce coût y est de 4 heures en 1984. Sur le plan industriel, les progrès ne sont pas moins spectaculaires : pour produire une bicyclette en France en 1891 il fallait 1500 heures de travail ; en 1975 il en fallait 15 aux Etats-Unis. Le temps de travail nécessaire pour produire une ampoule électrique en France a été divisé par plus de 50 entre 1925 et 1982, celui d'un poste de radio par 200. Au cours de la dernière décennie, marquée par une exacerbation sans frein de la guerre commerciale, guerre qui n'a fait que s'aiguiser entre les principales puissances occidentales depuis l'effondrement du bloc de î'Est([16] [555]), le développement de l'informatique et l'introduction croissante de « robots » dans la production ont donné une nouvelle accélération au développement de cette productivité.([17] [556])
Mais ces conditions qui rendent possible d'organiser consciemment, en fonction des besoins humains, la production au niveau mondial, qui permettraient en peu d'années d'éliminer définitivement faim et misère de la planète en faisant exploser le développement de la science et des autres forces productives, bref, ces conditions matérielles, qui rendent possible le communisme, se transforment pour la bourgeoisie en un véritable tourment. Et la subsistance des rapports bourgeois se transforme pour l'humanité en un véritable cauchemar.
« Des institutions trop étroites... »
« A un certain degré de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en collision avec les rapports de production existants, ou avec les rapports de propriété au sein desquels elles s'étaient mues jusqu'alors, et qui n'en sont que l'expression juridique. Hier encore formes de développement des forces productives, ces conditions se changent en de lourdes entraves. » Marx.([18] [557])
Dans le cas des sociétés d'exploitation pré-capitalistes, comme dans celui du capitalisme, cette «collision» entre «le développement des forces productives matérielles de la société» et «les rapports de propriété» se concrétise par une situation de pénurie, de disette. Mais, lorsque les rapports de l'esclavagisme antique ou ceux du féodalisme sont devenus «trop étroits», la société s'est trouvée devant l'impossibilité matérielle de produire plus, d'extraire suffisamment de biens et de nourriture à partir de la terre et du travail. Alors que, dans le cas du capitalisme, nous assistons à un blocage de type particulier : la «surproduction».
«La société se voit rejetée dans un état de barbarie momentanée ; on dirait qu'une famine, une guerre de destruction universelle lui ont coupé les vivres ; l'industrie, le commerce semblent anéantis. Et pourquoi? Parce que la société a trop de civilisations, trop de vivres, trop d'industrie, trop de commerce » (Manifeste communiste)
Ce que Marx et Engels décrivaient au milieu du 19e siècle, analysant les crises commerciales du capitalisme historiquement ascendant, est devenu une situation quasi chronique dans le capitalisme décadent. Depuis la première guerre mondiale, la «surproduction» d'armements est devenu une maladie permanente du système. Les famines se développent dans les pays sous-développés au même moment où le capital américain et le capital «soviétique» rivalisent dans l'espace au moyen des techniques les plus coûteuses et sophistiquées. Depuis la crise de 1929, le gouvernement américain a, presque chaque année, consacré une partie de ses subventions agricoles à payer des agriculteurs pour qu'ils ne cultivent pas une partie de leur terre. ([19] [558]) A la fin des années 80, alors que le secrétaire général des Nations Unies annonce plus de 30 millions de morts en Afrique du fait de la faim, aux Etats-Unis près de la moitié de la récolte d'oranges est volontairement détruite par le feu. Au début des années 90, la CEE engage un gigantesque plan de congélation de terres cultivables (15 % des terres consacrées aux céréales). La nouvelle récession ouverte, qui ne constitue qu'une aggravation de la crise dans laquelle se débat le système depuis la fin des années 60, frappe tous les secteurs de l'économie, et, dans le monde entier, les fermetures de mines et d'usines font suite à la stérilisation des terres.
Entre les besoins de l'humanité et les moyens matériels pour les satisfaire se dresse une «main invisible» qui contraint les capitalistes à ne plus produire, à licencier, et les exploités à croupir dans la misère. Cette «main invisible», c'est la «miraculeuse économie de marché», les rapports capitalistes de production devenus «trop étroits».
Aussi cynique et impitoyable que puisse être la classe capitaliste, elle n'engendre pas volontairement une telle situation. Elle ne demanderait qu'à faire tourner à pleine productivité son industrie et son agriculture, extirper une masse toujours croissante de surtravail aux exploités, vendre sans limites et cumuler du profit à l'infini. Si elle ne le fait pas, c'est parce que les rapports capitalistes qu'elle incarne, le lui interdisent. Comme on l'a vu, le capital ne produit pas pour satisfaire les besoins humains, pas même ceux de la classe dominante. Il produit pour vendre. Or, parce qu'il repose sur le salariat, le capitalisme est incapable de fournir à ses propres travailleurs, encore moins à ceux qu'il n'exploite pas, les moyens d'acheter toute la production qu'il est capable de faire réaliser.
Comme on l'a aussi vu, la part de la production qui revient au prolétaire est déterminée non pas par ce qu'il produit, mais par la valeur de sa force de travail, et, cette valeur, le travail nécessaire pour le nourrir, le vêtir, etc. ne fait que se réduire au même rythme que s'accroît la productivité générale du travail.
L'augmentation de la productivité, en baissant la valeur des marchandises, permet à un capitaliste de s'emparer des marchés d'un autre, ou d'empêcher un autre de s'emparer des siens. Mais elle ne crée pas de nouveaux marchés. Au contraire. Elle réduit le marché constitué par les producteurs eux-mêmes.
«Le pouvoir de consommation des travailleurs est limité en partie par les lois du salaire, en partie par le fait qu'ils ne sont employés qu'aussi longtemps que leur emploi est profitable pour la classe capitaliste. La raison unique de toutes les crises réelles, c'est toujours la pauvreté et la consommation restreinte des masses, face à la tendance de l'économie capitaliste à développer les forces productives comme si elles n'avaient pour limite que le pouvoir de consommation absolu de la société » Marx.([20] [559])
Telle est la contradiction fondamentale qui condamne le capitalisme à l'impasse. ([21] [560])
Cette contradiction, cette incapacité à créer ses propres débouchés commerciaux, le capitalisme la porte en lui depuis sa naissance. Il l'a surmontée à ses débuts par la vente aux secteurs féodaux, puis par la conquête des marchés coloniaux. C'est à travers la recherche de ces débouchés que la bourgeoisie a «envahi toute la planète». C'est cette recherche qui, à partir du moment où le marché mondial était constitué et partagé entre les principales puissances, au début de ce siècle, a conduit à la première, puis à la deuxième guerre mondiales.
Aujourd'hui, 20 ans après la fin du «répit» donné par la reconstruction des gigantesques destructions de la deuxième guerre, après 20 ans de fuite en avant, repoussant les échéances en s'octroyant crédit sur crédit, le capitalisme se retrouve confronté à sa même vieille et inévitable contradiction : un an et demi de production mondiale de dettes en plus.
L'étroitesse des institutions bourgeoises a fini par faire de la vie économique mondiale une monstruosité où moins de 10 % de la population produit plus de 70 % des richesses ! Contrairement aux hymnes de louanges aux futurs « miracles de l'économie de marché» qu'entonne aujourd'hui la bourgeoisie sur les ruines du stalinisme, la réalité fait apparaître dans toute son horreur le fléau barbare que constitue, pour l'humanité, le maintien de rapports capitalistes. Plus que jamais, la survie même de l'espèce humaine exige l'avènement d'une nouvelle société. Une société qui, pour dépasser l'impasse capitaliste, devra être fondée sur deux principes essentiels :
- la production exclusivement en vue des besoins humains ;
- l'élimination du salariat et l'organisation de la distribution d'abord en fonction des richesses existantes, puis, lorsque l'abondance matérielle sera enfin acquise au niveau mondial, en fonction des besoins de chacun.
Plus que jamais, la lutte pour une société fondée sur le vieux principe communiste : «De chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins», ouvre la seule issue à l'humanité.
L'attachement des économistes au mode d'exploitation capitaliste les aveugle et les empêche de voir et de comprendre la faillite de celui-ci. La révolte contre l'exploitation pousse au contraire le prolétariat à la lucidité historique. C'est en se situant du point de vue de cette classe que Marx, les marxistes, les vrais, ont pu s'élever à une vision historique cohérente. Une vision qui est capable non seulement de cerner ce qui constitue la spécificité du capitalisme par rapport aux autres types de société du passé, mais aussi de comprendre les contradictions qui font de ce système un mode de production aussi transitoire que les autres du passé. Le marxisme fonde la possibilité et la nécessité du communisme sur une base matérielle scientifique. Et, en ce sens, loin d'être enterré comme en rêvent les défenseurs de l'ordre établi, il demeure plus actuel que jamais.
RV, 6/3/92
[1] [561] En 1967 c'est surtout l'Allemagne qui est frappée. Pour la première fois depuis la guerre, son produit intérieur brut cesse de croître. Le «miracle allemand» cède la place à un recul de -0,1 % du PIB. En 1970 c'est au tour de la première puissance mondiale, les Etats Unis, de connaître un recul de sa production (-0,3 %).
[2] [562] En 1969, la revue économique française, L'expansion s'interroge en couverture : « 19z9 peut-il recommencer ? »
[3] [563] Certaines estimations évaluent l'endettement mondial à 30 000 milliards de dollars (Le monde diplomatique, février 1992). Cela équivaut à sept fois le produit annuel des USA, ou de la CEE, ou encore à près d'un an et demi de travail (dans les conditions actuelles) de toute l'humanité !
[4] [564] En décembre 1991, l'OCDE, une des principales organisations de prévision économique occidentales, présentait ses Perspectives économiques à la presse : celles-ci annonçaient une reprise économique imminente, encouragée, entre autre, par la baisse des taux d'intérêt allemands. Le jour même, la Bundesbank décidait une importante hausse de son taux d'intérêt et quelques jours plus tard la même OCDE révisait à la baisse ses prévisions, soulignant l'importance des incertitudes qui dominent l'époque...
[5] [565] Voir
dans ce numéro l'article « Comment le prolétariat a gagné Marx au communisme
».
[6] [566] .«Avant-propos» à la Critique de l’économie politique. Ed. La pléiade.
[7] [567] Les économistes ont du mal à comprendre que ce soit seulement du point de vue marxiste que l’on puisse réellement comprendre la nature capitaliste de ces économies.
[8] [568] Rosa Luxemburg, Introduction à l'économie politique, chap. 5, «Le travail salarié».
[9] [569] Cette différence est, par contre, importante pour comprendre la différence d'efficacité entre le capitalisme d'Etat stalinien et celui dit «libéral». Le fait que le revenu des bureaucrates soit indifférent du résultat de la production dont ils sont censés avoir la responsabilité, fait de ceux-ci des monuments d'irresponsabilité, de corruption et d'inefficacité. (Voir «Thèses sur la crise économique et politique dans les pays de l'est», Revue internationale, n° 60).
[10] [570] Rosa Luxemburg, Introduction à l'économie politique, idem.
[11] [571] Manifeste communiste, «Bourgeois et prolétaires».
[12] [572] Idem.
[13] [573] Dans le cas de pays comme l'URSS, où la concurrence à l'intérieur de la nation était émoussée par le monopole étatique, c'est au niveau de la concurrence militaire internationale que s'exerçait la pression à l'accroissement continu de la productivité.
[14] [574] Voir notre brochure La décadence du capitalisme.
[15] [575] Les données sur la productivité son tirées de divers ouvrages de Jean Fourastié : La productivité (ed.PUF, 1987), Pourquoi les prix baissent (éd. Hachette, 1984) Pouvoir d'achat, prix et salaires (té. Gallimard, 1977).
[16] [576] Voir dans cette revue l'article « Guerre commerciale : l'engrenage infernal de la concurrence capitaliste ».
[17] [577] On peut avoir une idée de l'importance de l'augmentation de la productivité du travail par l'évolution du nombre de personnes « improductives » entretenues par le travail réellement productif (au sens général du terme, c'est-à-dire utile pour la subsistance des hommes). Les agriculteurs, les travailleurs de l'industrie, des services et du bâtiment produisant des biens ou services destinés a la consommation ou à la production de biens de consommation, permettent à un nombre toujours croissant de personnes de vivre sans fournir un travail réellement productif : militaires, policiers, travailleurs de toutes les industries produisant des armes ou des fournitures militaires, une grande partie de la bureaucratie étatique, les travailleurs des services financiers et bancaires, du marketing et de la publicité, etc. La part du travail généralement productif dans la société capitaliste décadente ne cesse de diminuer au profit d'activités, indispensables pour la survie de chaque capital national, mais inutile sinon destructrice du point de vue des besoins de l'humanité.
[18] [578] «Avant-propos» à la Critique de l'économie politique.
[19] [579] Du simple point de vue technique, les Etats Unis sont capables de nourrir à eux seuls la planète entière.
[20] [580] Le capital, livre III, 5° section, p. 1206, éd. La Pléiade.
[21] [581] L'analyse marxiste ne décèle pas seulement cette contradiction dans les rapports de production capitalistes : la loi de la baisse tendancielle du taux de profit, la contradiction entre la nécessité (ravoir recours à des investissements toujours plus importants et les exigences de la rotativité du capital, la contradiction entre le caractère mondial du processus de production capitaliste et la nature nationale de l'appropriation du capital, etc., le marxisme a découvert d'autres contradictions essentielles qui sont moteur et impasse de la vie du capital. Mais toutes ces autres contradictions ne se transforment en entrave effective à la croissance du capital qu'à partir du moment où celui-ci se heurte à «la raison ultime» de ses crises : son incapacité à créer ses propres débouchés.
Questions théoriques:
- L'économie [86]
Heritage de la Gauche Communiste:
Bilan de 70 années de luttes de « libération nationale » 3e partie
- 4863 reads
Des nations mort-nées.
Tout au long du 20e siècle, toutes les « nouvelles nations », à peine nées, sont déjà moribondes.
Au début de ce siècle, il y avait à peine 40 Etats indépendants dans le monde. Aujourd'hui, ils sont 169, auxquels il faut ajouter les quelques 20 nouveaux Etats surgis dernièrement de l'explosion de l'URSS et de la Yougoslavie.
La faillite sans appel de la kyrielle de « nouvelles nations » construites tout au long du 20e siècle, la ruine certaine de celtes qui viennent d'être créées, sont une démonstration évidente de l'échec du capitalisme. Pour les révolutionnaires, depuis le début du 20e siècle, ce qui est à l'ordre du jour n'est pas la constitution de nouvelles frontières, mais leur destruction par la révolution prolétarienne mondiale. C'est l'axe central de cette série d'articles de bilan de 70 ans de luttes de « libération nationale ».
Dans le premier article, nous avons vu comment la « libération nationale » a été un poison mortel pour la première vague révolutionnaire internationale de 1917-23. Dans la seconde partie, nous avons démontré comment les guerres de « libération nationale » et les nouveaux Etats ont été happées dans un engrenage inséparable des impérialismes et de la guerre impérialiste. Dans cette troisième et dernière partie, nous voulons montrer le tragique désastre économique et social auquel aboutit l'existence de ces 150 « nouvelles nations » créées au cours du 20e siècle.
La réalité a réduit en poussières tous les discours sur les « pays en voie de développement », qui devaient devenir les nouveaux pôles dynamiques du développement économique. Les bavardages sur les nouvelles « révolutions bourgeoises », qui allaient faire exploser la prospérité à partir des richesses naturelles contenues dans les anciennes colonies, n'annonçaient qu'un gigantesque fiasco : celui du capitalisme, l'incapacité de celui-ci de mettre en valeur les deux tiers de la planète, d'intégrer à la production mondiale les milliards de paysans qu'il a ruinés.
Le contexte dans lequel sont nées les « nouvelles nations » : la décadence du capitalisme
Le critère déterminant pour juger si le prolétariat doit ou ne doit pas appuyer la formation de nouvelles nations a toujours été fonction de la période que traverse le capitalisme au niveau historique et mondial. Dans une période d'expansion et de développement, comme au 19e siècle, un tel appui pouvait avoir un sens, et encore seulement dans le cas où la formation d'une nation contribuait à accélérer le développement du capitalisme et la constitution de la classe ouvrière, et à condition que soit maintenue l'autonomie de cette dernière par rapport aux forces progressistes de la bourgeoisie. Cet appui n'a plus aucun sens et doit être rejeté catégoriquement dès que le capitalisme entre, avec la première guerre mondiale, dans son époque de décadence mortelle.
«Le programme national n'a joué un rôle historique, en tant qu'expression idéologique de la bourgeoisie montante aspirant au pouvoir dans l'Etat, que jusqu'au moment où la société bourgeoise s'est tant bien que mal installée dans les grands États du centre de l'Europe et y a créé les instruments et les conditions indispensables de sa politique.
Depuis lors, l'impérialisme a complètement enterré le vieux programme bourgeois démocratique : l'expansion au delà des frontières nationales (quelles que soient les conditions nationales des pays annexés) est devenue la plate-forme de la bourgeoisie de tous les pays. Certes, la phase nationale est demeurée, mais son contenu réel et sa fonction se sont mués en leur contraire. Elle ne sert plus qu'à masquer tant bien que mal les aspirations impérialistes, à moins qu'elle ne soit utilisée comme cri de guerre, dans les conflits impérialistes, seul et ultime moyen idéologique de capter l'adhésion des masses populaires et de leur faire jouer leur rôle de chair à canon dans les guerres impérialistes » ([1] [582]).
Ce critère global et historique est à l'opposé d'un critère basé sur des spéculations abstraites et sur des visions partielles ou contingentes. Ainsi, les staliniens, les trotskystes et même certains groupes prolétariens ont donné comme argument à l'appui de «l'indépendance nationale » des pays d'Afrique, d'Asie, le fait que ces pays conservaient d'importants vestiges féodaux et précapitalistes : de là, ils déduisaient que ce qui était à l'ordre du jour dans ces pays, c'était une « révolution bourgeoise » et non une révolution prolétarienne. Ce que nient ces messieurs, c'est que l'intégration dans le marché mondial de tous les principaux territoires de la planète ferme les possibilités d'expansion du capitalisme, pousse ce dernier à une crise sans issue, et que cette situation domine la vie de tous ces nouveaux pays : « Et si, se survivant, l'ancienne formation (sociale) restée maîtresse des destinées de la société, continue à agir et à guider la société, non plus vers l'ouverture des champs libres au développement des forces productives, mais d'après sa nouvelle nature désormais réactionnaire, elle oeuvre vers leur destruction. »([2] [583])
Un autre argument invoqué en faveur de la constitution de nouvelles nations, c'est qu'elles possèdent d'immenses ressources naturelles qu'elles pourraient et devraient développer en se libérant de la tutelle étrangère. Cet argument tombe comme le précédent, dans une vision abstraite et localiste. Certes, ces énormes potentialités existent, mais justement, elles ne peuvent se développer dans le contexte mondial de crise chronique et de décadence qui détermine la vie de toutes les nations.
Depuis ses origines, le capitalisme a été basé sur une concurrence féroce, au niveau des entreprises comme des nations. Ceci a produit un développement inégal de la production selon les pays :
« La loi du développement inégal du capitalisme, sur les extrapolations de laquelle Lénine et ses épigones basent leur thèse du "maillon le plus faible", se manifeste dans la période ascendante du capitalisme par une poussée impérieuse des pays retardataires vers un rattrapage et même un dépassement des pays plus développés. Par contre, ce phénomène tend à s'inverser au fur et à mesure que le système, comme un tout, approche de ses limites historiques objectives et se trouve dans l'incapacité d'étendre le marché mondial en rapport avec les nécessités imposées par le développement des forces productives. Ayant atteint ses limites historiques, le système en déclin n'offre plus de possibilité d'une égalisation dans le développement, mais au contraire dans la stagnation de tout développement, dans le gaspillage, dans le travail improductif et de destruction. Le seul "rattrapage" dont il peut être question est celui qui conduit les pays les plus développés à la situation qui existait auparavant dans les pays arriérés sur le plan des convulsions économiques, de la misère, et des mesures de capitalisme d'Etat. Si au 19ème siècle, c'est le pays le plus avancé, l'Angleterre, qui indiquait ce que serait l'avenir des autres, ce sont aujourd'hui les pays du «tiers-monde» qui indiquent d'une certaine façon de quoi est fait l'avenir des pays les plus développés.
Cependant, même dans ces conditions, il ne saurait exister de réelle "égalisation" de la situation des différents pays qui composent le monde. Si elle n'épargne aucun pays, la crise mondiale exerce ses effets les plus dévastateurs non dans les pays les plus développés, les plus puissants, mais dans les pays qui sont arrivés trop tard dans l'arène économique mondiale et dont la route au développement est définitivement barrée par les puissances les plus anciennes. »([3] [584])
Tout ceci se concrétise dans le fait que « la loi de l'offre et de la demande joue contre tout développement de nouveaux pays. Dans un monde où les marchés sont saturés, l'offre dépasse la demande et les prix sont déterminés par les coûts de production les plus bas. De ce fait, les pays ayant les coûts de production les plus élevés sont contraints de vendre leurs marchandises avec des profits réduits quand ce n'est pas à perte. Cela ramène leur taux d'accumulation à un niveau extrêmement bas, et, même avec une main d'oeuvre très bon marché, ils ne parviennent pas à réaliser les investissements nécessaires à l'acquisition massive d'une technologie moderne, ce qui a pour résultat de creuser encore plus le fossé qui sépare ces pays des grandes puissances industrielles. » ([4] [585])
Pour cela, «La période de décadence du capitalisme se caractérise par l'impossibilité de tout surgissement de nouvelles nations industrialisées. Les pays qui n'ont pas réussi leur "décollage" industriel avant la première guerre mondiale sont, par la suite, condamnés à stagner dans un sous-développement total, ou à conserver une arriération chronique par rapport aux pays qui "tiennent le haut du pavé" ». Dans ce cadre « Les politiques protectionnistes connaissent au 20e siècle une faillite totale. Loin de constituer une possibilité de respiration pour les économies les moins développées, elles conduisent à l'asphyxie de l'économie nationale. » ([5] [586])
Guerre et Impérialisme aggravent le retard et le sous-développement
Dans ces conditions économiques globales, la guerre et l'impérialisme, attributs inséparables du capitalisme décadent, s'imposent comme une loi implacable à tous les pays et pèsent comme une chape de plomb sur l'économie des nouvelles nations. Dans la situation de marasme qui règne sur l'économie mondiale, chaque capital national ne peut survivre qu'en s'armant jusqu'aux dents. En conséquence, chaque Etat national se voit obligé de bouleverser sa propre économie : création d'une industrie lourde, mise en place d'industries dans des zones stratégiques mais qui ont des effets dévastateurs sur la production globale, soumission des infrastructures et des communications à l'activité militaire, énormes dépenses pour la «défense». Tout ceci a de très graves répercussions sur l'ensemble de l'économie nationale des pays dont le tissu social est sous-développé à tous les niveaux (économique, culturel, etc.) :
- l'insertion artificielle d'activités technologiquement très avancées provoque un énorme gaspillage de ressources et un déséquilibre de plus en plus accentué de l'activité économique et sociale ;
- le renforcement de l'endettement et l'accroissement permanent de la pression fiscale pour faire face à une spirale de dépenses dont on ne peut jamais sortir : « L'Etat capitaliste, sous l'impérieuse nécessité d'établir une économie de guerre, est le grand consommateur insatiable, qui crée son pouvoir d'achat au moyen d'emprunts gigantesques drainant toute l'épargne nationale, sous le contrôle et avec le concours "rétribuée" du capital financier ; il paie avec des traites d'hypothèques les revenus futurs du prolétariat et des petits paysans. »([6] [587]).
En Oman, le poste de défense absorbe 46% des dépenses publiques, en Corée du Nord rien de moins que 24% du PIB. En Thaïlande, alors que la production chute, quelle n’a augmentée que de 1% dans l’agriculture, en qu’on réduit les dépenses d’éducation, « les militaires ont exprimés leur volonté de faire participer l’Europe et les USA à la modernisation de leur armée, soulignant plus clairement dans le camp occidental, et projetant un porte hélicoptère allemand, plusieurs Linx franco-britannique, une escadrille (12 avions) de bombardiers F-16 et 500 tanks M60-A1 et M48-A5 américains » ([7] [588]). En Birmanie, avec un taux de mortalité infantile de 6,45% (0,9% aux USA), une espérance de vie de 61 ans (75,9 aux USA), avec seulement 673 livres publiés (pour 41 millions d’habitants) : « de 1988 à 1990, l’armée birmane a augmenté de 170 000 à 230 000 hommes. Son armement aussi s’est amélioré. Ainsi en Octobre 1990, la Birmanie a commandé 6 avions G4 à la Yougoslavie et 20 hélicoptères à la Pologne. En Novembre, elle a signé un contrat de 1200 millions de dollars – la dette extérieure est de 4171 millions de dollars – avec la Chine pour acquérir, entre autre, 12 avions F-7, 12 avions F-6 et 60 blindés » ([8] [589])
L'Inde est un cas particulièrement grave. L'énorme effort guerrier de ce pays est en grande partie responsable de ce que « entre 1961 et 1970, le pourcentage de la population rurale qui vit en dessous du minimum physiologique est passé de 52% à 70%. Alors qu'en 1880 chaque hindou pouvait disposer de 270 kilos de céréales et de légumes secs, cette proportion était tombée à 134 kilos en 1966. » ([9] [590]). « Le budget militaire équivalait à 2% de son PNB en 1960, c'est-à-dire 600 millions de dollars. Pour rénover l'arsenal et le parc militaire, les usines d'armement se sont multipliées et ont diversifié leur production. Dix ans plus tard, le budget militaire s'élevait à 1600 millions de dollars, c'est à dire 3,5% du PNB (...) A tout cela s'est ajoutée une réforme de l'infrastructure, en particulier des routes stratégiques, des bases navales (...) Le troisième programme militaire, qui couvre 1974-1979, va absorber annuellement 2500 millions de dollars. »([10] [591]) Depuis 1973, l'Inde possède la bombe atomique et a développé un programme de recherche nucléaire, des centrales pour la fusion du plutonium, etc., qui place le niveau de ses dépenses dédiées à la « recherche scientifique» dans les plus hauts du monde : 0,9 % du PNB !
Le militarisme aggrave
les désavantages des pays neufs par rapport aux pays anciens. Ainsi, le nombre
de soldats des 16 plus grands pays du «tiers-monde» (l'Inde, la Chine, le Brésil, la Turquie, le Vietnam,
l'Afrique du Sud, etc.) est passé de 7 millions, en 1970, à 9,3 millions en
1990, c'est-à-dire, un accroissement de 32 %. Par contre, le nombre de soldats
dans les quatre pays les plus industrialisés (USA, Japon, Allemagne, et France)
est passé de 4,4 millions, en 1970,
a 3,3 millions en 1990, ce qui signifie une réduction de
26%.([11] [592]) Ce
n'est pas que ces derniers aient relâché leur effort militaire, mais c'est
qu'il est devenu beaucoup plus productif, leur permettant d'économiser sur les
dépenses en hommes. Dans les pays les moins développés, c'est la tendance
inverse, et de loin, qui domine : en plus d'augmenter les investissements en
armes sophistiquées et en technologie, ils doivent augmenter la participation
des hommes.
Cette nécessité de donner la priorité à l'effort de guerre a de graves conséquences politiques qui aggravent encore plus la faiblesse et le chaos économique et social de ces nations : elle impose l'alliance inévitable, contrainte et forcée, avec tous les restes de secteurs féodaux ou simplement retardataires, puisqu'il est plus important de maintenir la cohésion nationale, face à la jungle impérialiste mondiale, que d'assurer la « modernisation » de l'économie, qui passe pour un objectif secondaire et, en général, utopique, face à l'ampleur des impératifs impérialistes.
Ces survivances féodales ou précapitalistes expriment le poids du passé colonial ou semi-colonial qui leur a légué une économie spécialisée dans la production de matières premières agricoles ou minières, ce qui la déforme monstrueusement mil en découle le phénomène contradictoire par lequel l'impérialisme a exporté le mode de production capitaliste et a détruit systématiquement les formations économiques pré-capitalistes, tout en freinant simultanément le développement du capital indigène, en pillant impitoyablement les économies coloniales, en subordonnant leur développement industriel aux besoins spécifiques de l'économie des métropoles et en appuyant les éléments les plus réactionnaires et les plus soumis des classes dominantes indigènes (...) Dans les colonies et les semi-colonies, il ne devait pas naître de capitaux nationaux indépendants - pleinement formés avec leur propre révolution bourgeoise et leur base industrielle saine -, mais plutôt des caricatures grossières des capitaux des métropoles, affaiblies par le poids des vestiges en décomposition des modes de production antérieurs, industrialisées au rabais pour servir les intérêts étrangers, avec des bourgeoises faibles, nées séniles, à la fois au niveau économique et politique. » ([12] [593])
Pour aggraver encore les problèmes, les anciennes métropoles (France, Grande-Bretagne, etc.), ainsi que d'autres concurrents (USA, l'ancienne URSS, l'Allemagne), ont tissé autour des «nouvelles nations» une toile d'araignée complexe : investissements, crédits, occupations d'enclaves stratégiques, "traités d'assistance, de coopération et de défense mutuelles", intégration dans des organismes internationaux de défense, de commerce, etc. Tout cela les tient pieds et poings liés, et constitue un handicap particulièrement insurmontable.
Cette réalité est qualifiée par les trotskystes, les maoïstes et tous les « tiers-mondistes » comme du «néo-colonialisme». Ce terme est un rideau de fumée qui cache l'essentiel : la décadence de tout le capitalisme mondial et l'impossibilité de développement de nouvelles nations. Les problèmes des nations du « tiers-monde», ils les résument à la « domination étrangère ». Il est certain que la domination étrangère fait obstacle au développement des nouvelles nations, mais ce n'est pas le seul facteur et surtout il ne peut être compris que comme une partie, un élément constitutif des conditions globales du capitalisme décadent, dominées par le militarisme, la guerre et la stagnation de la production.
Pour compléter le tableau, les nouvelles nations surgissent avec un péché originel : ce sont des territoires incohérents, formés par un agrégat chaotique de différentes ethnies, religions, économies, cultures. Leurs frontières sont pour le moins artificielles et incluent des minorités appartenant aux pays limitrophes ; tout cela ne peut que mener à la désagrégation et à des confrontations permanentes.
Un exemple révélateur est l'anarchie gigantesque créée par la coexistence de races, religions et nationalités, dans une région stratégique vitale comme le Moyen-Orient. Il y a d'abord les trois religions les plus importantes : le judaïsme, le christianisme et l'islamisme. Chacune d'elles est ensuite divisée à son tour en de multiples sectes qui s'affrontent entre elles : la religion chrétienne comporte des minorités maronite, orthodoxe, copte ; la religion musulmane a ses obédiences sunnites, chiites, alaouites, etc. Enfin, « il existe, en plus des minorités eihnico-linguistiques. En Afghanistan, les persanophones (Tadjiks) et les turcophones (Ouzbeks, Turkmènes) ainsi que d'autres groupements. (...) Les turbulences politiques du 20e siècle ont fait de ces minorités des "peuples sans Etats". Ainsi, les 22 millions de Kurdes : 11 millions en Turquie (20% de la population), 6 millions en Iran (12%), 4,5 en Irak (25%), 1 en Syrie (9 %), sans oublier l’existence d'une diaspora kurde au Liban. Il existe aussi une diaspora arménienne au Liban et en Syrie. Et, enfin, les palestiniens constituent un autre "peuple sans Etat" : 5 millions de palestiniens sont répartis entre Israël (2,6 millions), la Jordanie (1,5 millions), le Liban (400 000), le Koweït (350 000) la Syrie (250 000).» ([13] [594])
Dans de telles conditions, les nouveaux Etats expriment de manière caricaturale la tendance générale au capitalisme d'Etat, lequel ne constitue pas un dépassement des contradictions mortelles du capitalisme décadent, mais une lourde entrave qui augmente encore les problèmes.
« Dans les pays les plus arriérés, la confusion entre l'appareil
politique et l'appareil économique permet et engendre le développement d'une
bureaucratie entièrement parasitaire, dont la seule préoccupation est de se
remplir les poches, de piller de façon systématique l'économie nationale en
vue de se constituer des fortunes colossales : les cas de Batista, Marcos, Duvalier,
Mobutu, sont bien connus, mais ils sont loin d'être les seuls. Le pillage, la
corruption et le racket sont des phénomènes généralisés dans les pays
sous-développés et qui affectent tous les niveaux de l'Etat et de l'économie.
Cette situation constitue évidemment un handicap supplémentaire pour ces
économies, qui contribue à les enfoncer toujours plus dans le gouffre. » ([14] [595])
Un bilan catastrophique
Ainsi, tout nouvel Etat national, loin de reproduire le développement des jeunes capitalismes du 19e siècle, se confronte dès le départ à l'impossibilité d'une accumulation réelle et s'enfonce dans le marasme économique, le gaspillage et l'anarchie bureaucratique. Loin de fournir un cadre où le prolétariat pourrait améliorer sa situation, il crée, au contraire, un appauvrissement constant, la menace de la famine, la militarisation du travail, les travaux forcés, l'interdiction des grèves, etc.
Pendant les années 1960-70, des politiciens, des experts, des banquiers, ont disserté jusqu'à la nausée sur le « développement » des pays du «tiers-monde». De pays «sous-développés» ils sont devenus «pays en voie de développement». Un des leviers de ce soi-disant « développement » fut l'octroi de crédits massifs qui s'est accéléré surtout avec la récession de 1974-75. Les grandes métropoles industrielles ont concédé à tour de bras des crédits aux nouveaux pays, avec lesquels ces derniers ont acheté des biens d'équipement, des installations « clés-en-mains » pour une production qu'ils n'ont pas pu vendre, victimes de la surproduction généralisée.
Ceci n'a pas entraîné, comme cela est amplement démontré aujourd'hui, un véritable développement, mais par contre un grave endettement des pays neufs qui les a plongés définitivement dans une crise sans issue comme cela s'est vu tout au long de la décennie 1980.
Nos publications ont mis en évidence ce désastre généralisé, il suffit de rappeler quelques faits : en Amérique Latine, le PIB par habitant a chuté en 1989 au niveau où il était en 1977. Au Pérou, le revenu par habitant était en 1990... le même qu'en 1957 ! Le Brésil, présenté dans les années 1970 comme le pays du « miracle économique », a subi, en 1990, une baisse du PNB de 4,5% et une inflation de 1657 % ! La production industrielle de l'Argentine a chuté, en 1990, au niveau de 1975. ([15] [596])
La population, et surtout la classe ouvrière, ont durement souffert de cette situation. En Afrique, 60 % de la population vivait en dessous du minimum vital en 1983 et pour 1995, la Banque Mondiale calcule qu'on arrivera à 80 %. En Amérique Latine, il y a 44 % de pauvres. Au Pérou, 12 millions d'habitants (sur une population totale de 21 millions) sont dépourvus de tout. Au Venezuela, un tiers de la population manque des revenus nécessaires pour acheter les produits de base.
La classe ouvrière s'est vue cruellement attaquée : en 1991, le gouvernement du Pakistan a fermé ou privatisé des entreprises publiques, mettant à la rue 250 000 ouvriers. En Ouganda, un tiers des employés publics a été licencié en 1990. Au Kenya, « le gouvernement a décidé en 1990 de ne pourvoir que 40 % des postes vacants dans la fonction publique, et que les usagers devaient payer les services publics. » ([16] [597]) En Argentine, la part des salariés dans le revenu national est passé de 49 %, en 1975, à 30 %, en 1983.
La manifestation la plus évidente de l'échec total du capitalisme mondial est le désastre agricole que subit l'immense majorité des nations qui ont accédé à l'indépendance au 19e siècle : « La décadence du capitalisme n'a fait que pousser à son comble le problème paysan et agraire. Ce n'est pas, si l'on prend un point de vue mondial, le développement de l'agriculture moderne qui s'est réalisé, mais son sous-développement. La paysannerie, comme il y a un siècle, constitue toujours la majorité de la population mondiale. » ([17] [598])
Les pays neufs, à travers l'Etat qui a créé une bureaucratie tentaculaire d'organismes de «développement rural», ont étendu les rapports de production capitalistes à la campagne, détruisant les anciennes formes d'agriculture de subsistance. Cependant, cela n'a pas produit un quelconque développement, mais au contraire un total désastre. Ces mafias du « développement », auxquelles se sont unis les caciques, les propriétaires terriens et les usuriers, ont ruiné les paysans, en les obligeant à introduire des cultures d'exportation qu'ils leur achètent à des prix dérisoires alors qu'ils leur vendent les semences, les machines, à des prix prohibitifs.
Avec la disparition des cultures de subsistance, « les menaces de famine sont aujourd'hui tout aussi réelles qu'elles l’étaient dans les économies antérieures : la production agricole par habitant est inférieure au niveau de 1940 (voir « Paysans sans terre » de R.Fabre). Signe de l'anarchie totale du système capitaliste, la plupart des anciens pays agricoles producteurs du "tiers-monde" sont devenus depuis la seconde guerre mondiale importateurs : l'Iran, par exemple, importe 40% des produits alimentaires qu'il consomme. » ([18] [599])
Dans un pays comme le Brésil, le plus grand potentiel agricole du monde, « à partir de février 1991, on a pu constater une pénurie de viande, de riz, de haricots, de produits laitiers et d'huile de soja, » ([19] [600]) . L'Egypte, grenier des Empires tout au long de l'histoire, importe aujourd'hui 60 % des aliments de base. Le Sénégal produit seulement 30 % de sa consommation de céréales. En Afrique, la production alimentaire parvient à peine à 100 kilos par an par habitant, alors que le minimum vital est de 145 kilos.
De plus, la canalisation de la production vers des monocultures destinées à l'exportation a coïncidé avec la baisse générale du prix des matières premières, tendance qui ne fait que s'aggraver avec l'approfondissement de la récession économique. En Côte d'Ivoire les rentrées de la vente du cacao et du café ont chuté de 55 % entre 1986 et 1989. Le cours du sucre a baissé dans les pays d'Afrique occidentale de 80% entre 1960 et 1985. Au Sénégal, un producteur de cacahuètes gagnait en 1984 moins qu'en 1919. En Ouganda, la production de café est passée de 186 000 tonnes en 1989 à 138 000 en 1990([20] [601])
Le résultat en est l'anéantissement croissant de l'agriculture, aussi bien de l'agriculture de subsistance que de l'agriculture industrielle d'exportation.
Dans ce contexte, contraints par la chute du prix des matières premières et forcés par le phénoménal endettement dans lequel ils sont piégés depuis le milieu des années 1970, la plupart des pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique, ont étendu encore la part des cultures industrielles destinées à l'exportation, ont massacré des forêts, entrepris des travaux de barrages pharaoniques, et des ouvrages d'irrigation très coûteux, en conséquence de quoi, les rendements ont décru de plus en plus, et l'épuisement de la terre est presque total. Le désert a avancé. Les ressources naturelles, si généreuses, ont été anéanties.
La catastrophe est d'une dimension incalculable : le fleuve Sénégal qui avait, en 1960, un débit de 24 000 millions de mètres cubes, avait baissé, en 1983, à seulement 7 000 millions de mètres cubes. La couverture végétale du territoire mauritanien était de 15 % en 1960, et avait chuté à 5 % en 1986. En Côte d'Ivoire, exportateur de bois précieux, la superficie des forêts est tombée de 15 millions d'hectares, en 1950, à seulement 2 millions, en 1986. Au Niger, 30 % des sols cultivables ont été abandonnés et le rendement par hectare des cultures de céréales est passé de 600 kilos en 1962 à 350 en 1986. En 1983, l'ONU chiffrait à 150 kilomètres par an l'avancée du désert saharien vers le sud.([21] [602])
Les paysans sont expulsés de leurs régions d'origine et ils s'agglutinent dans les grandes villes dans d'horribles camps de bidonvilles. «Lima, qui fut la cité jardin des années 40, a vu se tarir ses eaux souterraines et est envahie par le désert. De 1940 à 1981 sa population s'est multipliée par 7. Aujourd'hui, avec 400 kilomètres carré de superficie et un tiers de la population péruvienne, l'oasis s'est couverte d'ordures et de béton. (...) Dans la décharge du Callao, des enfants pieds nus et des familles entières travaillent au milieu d'un enfer où l'odeur est insupportable et où pullulent des millions de mouches. » ([22] [603])
« Le capital aime ses clients pré-capitalistes comme l'ogre aime les enfants : en les dévorant. Le travailleur des économies précapitalistes qui a eu "le malheur de toucher au commerce avec les capitalistes" sait que tôt ou tard, il finira, dans le meilleur des cas, prolétarisé par le capital, dans le pire - et c'est chaque jour le plus fréquent depuis que le capitalisme s'enfonce dans la décadence- dans la misère et l'indigence, au milieu des champs stérilisés, ou marginalisés, dans les bidonvilles d'une agglomération.» ([23] [604])
Cette incapacité à intégrer les masses paysannes dans le travail productif est la manifestation la plus évidente de Péchec du capitalisme mondial. Son essence même est de généraliser le travail salarié, en arrachant les paysans et les artisans à leurs vieilles formes de travail pré-capitalistes et en les transformant en ouvriers salariés. Cette capacité de création de nouveaux emplois s'enlise et recule à Péchelle mondiale tout au long du 20e siècle. Ce phénomène se manifeste de façon criante dans les pays neufs : alors qu'au 19e siècle, le chômage moyen était en Europe de 4 à 6 %, et pouvait être résorbé après les crises cycliques, aujourd'hui, dans les pays du « tiers-monde », le chômage est monté à 20 ou 30 %, il s'est transformé en un phénomène permanent et structurel.
Les premières victimes de la décomposition mondiale du capitalisme
Les premières victimes de l'entrée du capitalisme, depuis la fin des années 1970, dans son ultime étape de décomposition mondiale, ont été toute cette chaîne de « jeunes nations», qui, dans les années 1960-70, nous étaient présentées par les champions, « libéraux » ou staliniens, de l’ordre bourgeois comme les « nations du futur ».
L'effondrement des régimes staliniens depuis 1989 a rejeté au second plan de l'actualité la situation épouvantable dans laquelle s'enfoncent ces « nations du futur ». Les pays qui étaient sous la botte stalinienne appartiennent au peloton des pays arrivés trop tard sur le marché mondial et manifestent les mêmes caractéristiques que les a pays neufs» du 20e siècle, bien que leurs spécificités ([24] [605]) ont rendu leur effondrement beaucoup plus chaotique et lui ont donné une répercussion historico-mondiale incalculablement supérieure, surtout au niveau de l'aggravation du chaos impérialiste. ([25] [606])
Pourtant, sans
sous-estimer les particularités des pays staliniens, les autres pays
sous-développés présentent les mêmes caractéristiques de base quant au chaos,
à l'anarchie et à la décomposition généralisée.
L'explosion des Etats
En Somalie, les chefs
tribaux du Nord annonçaient le 24 avril 1991 la partition du pays et la
création de l'Etat de « Somaliland». L'Ethiopie est démembrée : le 28 mai,
l'Erythrée se déclare souveraine. Le Tigre, les Oromes, l’Ogaden, échappent
totalement au contrôle de l'autorité centrale. L'Afghanistan a été divisé en
quatre gouvernements différents, chacun contrôlant ses propres territoires :
celui de Kaboul, l'islamiste radical, l'islamiste modéré et le Chiite. Presque
deux tiers du territoire péruvien sont dans les mains des gangs du trafic de
drogue et des mafias des guérillas du Sentier Lumineux ou de Tupac Amaru. La
guerre au Libéria a fait 15 000 morts et provoqué la fuite de plus d'un million
de personnes (sur une population totale de 2,5 millions). L'Algérie, avec
l'affrontement ouvert entre le FLN et le FIS (qui couvre un affrontement
impérialiste entre la France
et les USA) plonge dans le chaos.
L'effondrement de l’armée
Les révoltes de soldats au Zaïre, l'explosion de l'armée ougandaise en multiples bandes qui terrorisent la population, la gangstérisation généralisée des polices en Asie, en Afrique ou en Amérique du Sud, expriment la même tendance, bien que de manière moins spectaculaire, que l'actuelle explosion de l'armée de l'ex-URSS.
La paralysie générale de l’appareil économique
L'approvisionnement, les transports, les services, s'effondrent totalement et l'activité économique se réduit à sa plus simple expression : dans la république Centrafricaine, Bangui, la capitale, « a été complètement isolée du reste du pays, l’ex-métropole coloniale vit des subsides que lui accorde la France et du trafic de diamants. » ([26] [607])
Dans ces conditions, la faim, la misère, la mort se généralisent, la vie ne vaut rien. A Lima des hommes et des femmes de forte corpulence sont séquestrés par des bandes qui les assassinent et vendent leur graisse à des entreprises pharmaceutiques ou cosmétiques américaines ! En Argentine, un demi-million de personnes survit de la vente de foies, reins et autres viscères. Au Caire, un million de personnes vivent dans les tombes du cimetière copte. Les enfants sont enlevés en Colombie ou au Pérou pour être envoyés dans des mines ou dans des exploitations agricoles où ils travaillent dans des conditions d'esclavage telles qu'ils meurent comme des mouches. La chute du prix des matières premières sur le marché mondial a conduit le capitalisme local à ces pratiques atroces pour compenser la baisse de ses profits. Au Brésil, l'impossibilité d'intégrer les nouvelles générations au travail salarié a développé la sauvagerie de bandes de policiers et de vigiles qui se livrent à l'extermination rémunérée de gosses des rues embrigadés dans les gangs mafieux de trafics de toutes sortes. La Thaïlande est devenue le plus grand bordel du monde, et le SIDA se généralise : 300 000 cas en 1990 ; on en prévoit deux millions pour l'an 2000.
La vague d'émigration qui s'est accélérée depuis 1986 en provenance de l'Amérique Latine, de l'Afrique et de l'Asie, sanctionne la faillite historique de ces nations et, à travers elle, la faillite du capitalisme.
La désintégration des structures sociales, nées comme les cellules dégénérées d'un corps mortellement malade, le capitalisme décadent, vomit littéralement des masses humaines qui fuient le désastre, affluant vers les vieilles nations industrielles, lesquelles, confirmant leur stagnation économique, ont depuis longtemps « affiché complet », et ne tiennent, vis-à-vis de ces masses affamées, que le langage de la répression, de la mort, de la déportation.
L'humanité n'a pas besoin de nouvelles frontières, mais de l'abolition de toutes les frontières
Les «nouvelles nations» du 20e siècle n'ont pas grossi les rangs prolétariens, mais, ce qui est le plus dangereux pour la perspective révolutionnaire, elles ont placé le prolétariat de ces pays dans des conditions de fragilité et de faiblesse extrêmes.
Le prolétariat est une minorité dans l'immense majorité des pays sous-développés : il constitue à peine 10 à 15 % de la population, contre plus de 50 % dans les grands pays industrialisés. De plus, il est très dispersé dans des centres de production éloignés des centres névralgiques du pouvoir politique et économique et n'a pas autant d'expérience politique de la confrontation comme classe à la bourgeoisie que dans les pays les plus développés. Il vit le plus souvent immergé dans une masse immense de marginalisés et de lumpen très vulnérables aux idéologies les plus réactionnaires et qui influent très négativement sur lui.
D'un autre côté, la forme dans laquelle se manifeste la faillite du capitalisme de ces pays y rend beaucoup plus difficile la prise de conscience du prolétariat :
-domination irrésistible des grandes puissances impérialistes, ce qui favorise l'influence du nationalisme ;
-corruption généralisée et gaspillage invraisemblable des ressources économiques, ce qui obscurcit la compréhension des véritables racines de la crise capitaliste ;
-domination ouvertement terroriste de l'Etat capitaliste, même lorsqu'il se donne une façade « démocratique », ce qui donne plus de poids aux mystifications démocratiques et syndicales ;
- formes particulièrement barbares et archaïques d'exploitation du travail, ce qui rend plus forte l'influence du syndicalisme et du réformisme.
Comprendre cette situation ne signifie pas nier que ces ouvriers, comme partie inséparable de la lutte du prolétariat mondial ([27] [608]), ont la force et la potentialité de lutter pour la destruction de l'Etat capitaliste et pour le pouvoir international des conseils ouvriers : « La force du prolétariat dans un pays capitaliste est infiniment plus grande que sa proportion numérique dans la population. Et il en est ainsi parce que le prolétariat occupe une position clé au coeur de l'économie capitaliste et aussi parce que le prolétariat exprime, dans le domaine économique et politique, les intérêts réels de l’immense majorité de la population laborieuse sous la domination capitaliste. » (Lénine)
La vraie leçon est que l'existence de ces « nouvelles nations », au lieu d'apporter quelque chose à la cause du socialisme, a eu l'effet exactement inverse : elle a créé de nouveaux obstacles, de nouvelles difficultés pour la lutte révolutionnaire du prolétariat.
« On ne peut pas soutenir, comme le font les anarchistes, qu'une perspective socialiste restait ouverte quand bien même les forces productives seraient en régression. Le capitalisme représente une étape indispensable et nécessaire pour l'instauration du socialisme dans la mesure où il parvient à développer suffisamment les conditions objectives. Mais, de même qu'au stade actuel il devient un frein par rapport au développement des forces productives, de même la prolongation du capitalisme, au delà de ce stade, doit entraîner la disparition des conditions du socialisme C'est en ce sens que se pose aujourd'hui l'alternative historique : socialisme ou barbarie. » ([28] [609])
Les « nouvelles nations » ne favorisent ni le développement des forces productives, ni la tâche historique du prolétariat, ni la dynamique vers l'unification de l'humanité. Au contraire, elles sont, comme expression organique de l'agonie du capitalisme, une force aveugle qui entraîne la destruction des forces productives, des difficultés pour le prolétariat, la dispersion, la division et l'atomisation de l'humanité.
Adalen, 8 février 1992.
[1] [610] Rosa Luxemburg, La crise de la social-démocratie, chap. 7.
[2] [611] Internationalisme, Rapport sur la situation internationale, juin 1945.
[3] [612] Revue Internationale n° 31, Le prolétariat d'Europe de l'Ouest au coeur de la généralisation internationale de la lutte de classe.
[4] [613] Revue Internationale n°23, La lutte du prolétariat dans la décadence du capitalisme.
[5] [614] Idem.
[6] [615] Bilan n°11, Crise et cycles dans l'économie du capitalisme à l'agonie.
[7] [616] El Estado del mundo, 1992.
[8] [617] Idem.
[9] [618] Révolution Internationale n° 10 : L'Inde : un cimetière à ciel ouvert.
[10] [619] Idem.
[11] [620] Les faits ont été tirés des statistiques sur les armées mentionnées dans la publication annuelle El estado del mundo, 1992. Le choix des pays et le calcul des moyennes sont de notre fait.
[12] [621] Revue Internationale n° 19 : Sur l'impérialisme.
[13] [622] Idem.
[14] [623] Revue Internationale n° 60 : Thèses sur la crise économique et politique des pays de l'Est.
[15] [624] Faits tirés de la publication annuelle El estado del mundo, 1992.
[16] [625] El estado del mundo, 1992.
[17] [626] Revue Internationale n° 24 : Notes sur la question agraire et paysanne.
[18] [627] Idem.
[19] [628] El estado del mundo, 1992.
[20] [629] Faits tirés du livre de René Dumont Pour l'Afrique, j'accuse.
[21] [630] Faits tirés du livre de R. Dumont.
[22] [631] De l'article «Le choiera des pauvres» publié par El Pais du 27 mai 1991.
[23] [632] Revue Internationale n° 30 : Critique de Boukharine, 2e partie.
[24] [633] Voir les « Thèses sur la crise économique et politique des pays de l'Est » dans la Revue Internationale n 60.
[25] [634] D'un autre côté, l'identification stalinisme = communisme qu'emploie aujourd'hui la bourgeoisie pour convaincre les prolétaires qu'il n'y a pas d'alternative à l'ordre capitaliste, est plus persuasive si elle amplifie les phénomènes de l'Est et relativise ou banalise ce qui arrive dans les nations du « tiers-monde ».
[26] [635] El estado del Mundo, 1992.
[27] [636] Le centre de la lutte révolutionnaire du prolétariat est constitué par les grandes concentrations ouvrières des pays industrialisés : voir, dans la Revue internationale n°31, « Le prolétariat d'Europe occidentale au centre de la généralisation de la lutte de classe ».
[28] [637] Internationalisme n°45 : L'évolution du capitalisme et la nouvelle perspective.
Courants politiques:
- Gauche Communiste [49]
Approfondir:
- La question nationale [320]
Questions théoriques:
- Impérialisme [321]
Heritage de la Gauche Communiste:
- La question nationale [322]
Le communisme n'est pas un bel idéal mais une nécessité matérielle [2° partie]
- 4070 reads
Comment le prolétariat a gagné Marx au communisme
« Les conceptions théoriques des communistes ne reposent nullement sur des idées, des principes inventés ou découverts par tel ou tel réformateur du monde.
Elles ne sont que l'expression générale des conditions réelles d'une lutte de classe existante, d'un mouvement historique qui s'opère sous nos yeux » ([1] [638]).
Dans le premier article de cette série, nous avons tenté de combattre le cliché bourgeois selon lequel « le communisme est un bel idéal mais ça ne marchera jamais », en montrant que le communisme n'était pas une « idée » inventée par Marx ou quelque « réformateur du monde », mais qu'il était le produit d'un immense mouvement historique remontant jusqu'aux premières sociétés humaines ; et, surtout, que la revendication d'une société sans classes, sans propriété privée ou étatique avait été mise en avant dans chaque grand soulèvement du prolétariat depuis ses toutes premières origines comme classe sociale.
Il existait un mouvement communiste prolétarien avant que Marx ne naisse, et, lorsque le jeune étudiant Marx ne faisait qu'entrer dans l'arène de la politique démocratique radicale en Allemagne, il y avait déjà une pléthore de groupes et de tendances communistes, en particulier en France où le mouvement de la classe ouvrière avait accompli les plus grands pas dans le développement d'une vision communiste. Ainsi, à la fin des années 1830 et au début des années 1840, Paris était le royaume de tels courants comme celui du communisme utopique de Cabet, prolongation des points de vue développés par Saint-Simon et Fourier ; il y avait Proudhon et ses adeptes, précurseurs de l'anarchisme mais qui, à cette époque, tentaient, de façon rudimentaire, de critiquer l'économie politique bourgeoise du point de vue des exploités ; il y avait les Blanquistes, plus insurrectionnels, qui avaient dirigé un soulèvement avorté en 1839 et étaient les héritiers de Babeuf et des Égaux de la grande Révolution française. A Paris vivait également tout un milieu d'ouvriers et d'intellectuels allemands exilés. Les ouvriers communistes étaient principalement regroupés dans la Ligue des Justes animée par Weitling.
Marx a commencé le combat politique en partant de la philosophie critique. Au cours de ses études universitaires, il est tombé sous le charme de Hegel – en rechignant au début car Marx ne s'est pas engagé à la légère. Hegel, à cette époque, était le « Maître » reconnu en Allemagne dans le champ de la philosophie, et, plus encore, ses travaux représentaient le sommet même de l'effort philosophique bourgeois car ils constituaient la dernière grande tentative de cette classe de saisir la totalité du mouvement de l'histoire et de la conscience humaine et cela, en utilisant la méthode dialectique.
Très rapidement cependant, Marx a rejoint les Jeunes Hégéliens (Bruno Bauer, Feuerbach, etc.) qui avaient commencé à voir que les conclusions du Maître n'étaient pas cohérentes avec sa méthode, et même que des éléments clé dans cette méthode étaient très imparfaits. Ainsi, alors que la démarche dialectique de Hegel vis-à-vis de l'histoire montrait que toutes les formes historiques étaient transitoires, que ce qui était rationnel durant une période était complètement irrationnel dans une autre, il aboutissait à poser une « Fin de l'Histoire » en présentant l'État prussien existant comme l'incarnation de la Raison. De même, et là le travail de Feuerbach fut particulièrement important, il était clair pour les Jeunes Hégéliens que tout en ayant effectivement ébranlé, par sa rigueur philosophique, la théologie et la foi irraisonnée, Hegel finissait par rétablir Dieu et la théologie sous la forme de l'Idée Absolue. Le but des Jeunes Hégéliens était, d'abord et avant tout, de mener la dialectique de Hegel jusqu'à sa conclusion logique et d'arriver à une critique convaincue de la théologie et de la religion. Aussi pour Marx et ses compagnons Jeunes Hégéliens, le fait que « la critique de la religion est la présupposition à toute critique » ([2] [639]) était vrai au sens littéral.
Mais les Jeunes Hégéliens vivaient dans un État semi-féodal où la critique de la religion était interdite par la censure ; la critique de la religion se transforma donc très vite en critique de la politique. Ayant laissé tomber tout espoir d'obtenir un poste de professeur à l'université après que Bauer fut démis du sien, Marx se tourna vers le journalisme politique et commença rapidement à porter ses attaques contre la lamentable stupidité des Junkers dans le système politique qui prévalait en Allemagne. Ses sympathies furent immédiatement républicaines et démocratiques comme on peut le voir dans ses premiers articles pour le Deutsche Jahrbuche et la Reinische Zeitung, mais ceux-ci étaient toujours formulés en termes d'opposition radicale bourgeoise au féodalisme et se polarisaient beaucoup sur des sujets concernant « les libertés politiques » telles que la liberté de la presse et le suffrage universel. En fait, Marx résistait explicitement aux attaques de Moses Hess qui défendait déjà ouvertement un point de vue communiste, même s'il se présentait dans un genre plutôt sentimental pour pouvoir faire passer des idées communistes dans les pages de la Reinische Zeitung. En réponse à une accusation de la Augsburger Allgemeiner Zeitung selon laquelle le journal de Marx avait adopté le communisme, Marx écrivait que « la Reinische Zeitung qui ne saurait accorder aux idées communistes sous leur forme actuelle ne fût-ce qu'une réalité théorique, donc moins encore souhaiter leur réalisation pratique, ou simplement les tenir pour possibles, soumettra ces idées à une critique sérieuse » ([3] [640]). Plus tard, dans une lettre fameuse et quasi programmatique à Arnold Ruge (septembre 1843), il écrivait que le communisme de Cabet, Weitling, etc., était une « abstraction dogmatique » ([4] [641]).
En fait ces hésitations pour adopter une position communiste étaient similaires à celles qu'il avait eues quand il fut confronté, au début, à Hegel. Il était vraiment gagné au communisme mais refusait toute adhésion superficielle et était tout à fait conscient des faiblesses des tendances existant alors. Aussi, dans le même article qui paraît pour rejeter les idées communistes, il poursuit en disant que « des écrits comme ceux de Leroux, Considérant et, entre tous, l'ouvrage si pénétrant de Proudhon ne peuvent être critiqués au moyen d'arguments superficiels inspirés du moment, mais, bien au contraire, seulement après des études longues, persévérantes et approfondies. Tout cela, l'Augsbourgeoise le comprendrait si elle était plus exigeante et si elle était capable d'autre chose que faire reluire ses phrases. » ([5] [642]). Et dans la « Lettre à Ruge » mentionnée ci-dessus, il dit clairement que sa réelle objection au communisme de Weitling et de Cabet n'est pas le communisme mais le fait que celui-ci est dogmatique, c'est-à-dire qu'il ne se conçoit pas autrement que comme une belle idée ou un impératif moral qu'un rédempteur supérieur devrait apporter aux masses souffrantes. En opposition à cela, Marx met en relief sa propre démarche :
« Rien ne nous empêche de rattacher notre critique à la critique de la politique et de prendre parti dans la politique, donc de participer à des luttes réelles et de nous identifier à elles. Nous ne nous présentons pas alors au monde en doctrinaires avec un nouveau principe : voici la vérité, mettez-vous à genoux ! Nous développons pour le monde des principes nouveaux que nous tirons des principes du monde. Nous ne lui disons pas : renonce à tes luttes, ce sont des bêtises, et nous te ferons entendre la vraie devise du combat. Nous ne faisons que montrer au monde pourquoi il lutte en réalité, et la conscience est quelque chose qu'il doit acquérir, quand bien même il s'y refuserait. » ([6] [643])
Ayant rompu avec la mystification hégélienne qui énonçait une auto-conscience éthérée se situant en dehors du monde réel des hommes, Marx n'allait pas reproduire la même erreur théorique au niveau politique. Pour lui, la conscience ne pré-existait pas au mouvement historique ; elle ne pouvait qu'être la prise de conscience du mouvement réel lui-même.
LE PROLÉTARIAT, CLASSE COMMUNISTE
Bien que dans cette lettre, il n'y ait pas de référence explicite au prolétariat et pas d'adoption définie du communisme, nous savons qu'à partir de cette date, Marx était dans un processus de le faire. Les articles écrits dans la période 1842-43 sur les questions sociales - la loi prussienne sur le vol du bois et la situation des vignerons de Moselle - l'avaient amené à reconnaître l'importance fondamentale des facteurs économiques et de classe dans les affaires politiques ; en fait, Engels a écrit plus tard qu'« il avait toujours entendu Marx dire que c'était précisément en s'occupant de la loi sur le vol du bois et la situation des vignerons de Moselle qu'il avait été amené à passer de la politique pure aux rapports économiques et ainsi au socialisme » ([7] [644]). Et l'article de Marx sur « La Question Juive », également rédigé fin 1843, est communiste en tout sauf de nom puisqu'il cherche une émancipation qui va au-delà du domaine purement politique jusqu'à l'émancipation de la société de l'achat et de la vente, de l'égoïsme des individus en concurrence et de la propriété privée.
Mais il ne faut pas croire que Marx a abouti à cette vision simplement grâce à ses propres capacités d'étude et de réflexion, aussi grandes qu'elles aient été. Ce n'était pas un génie isolé qui contemplait le monde d'en haut ; il menait constamment au contraire des discussions avec ses contemporains. Dans sa « conversion » au communisme, il reconnaît sa dette envers les écrits contemporains de Weitling, Proudhon, Hess et Engels ; et avec ces deux derniers en particulier, il a mené d'intenses débats face à face alors qu'ils étaient communistes et lui non. Engels avait, par-dessus tout, l'avantage d'avoir été le témoin direct du capitalisme le plus avancé d'Angleterre, et avait commencé à développer une théorie du développement et de la crise capitaliste qui était vitale pour élaborer une critique scientifique de l'économie politique. Engels avait également connu directement le mouvement chartiste en Grande-Bretagne qui n'était plus un petit groupe politique mais constituait un véritable mouvement de masse, ce qui révélait, de façon évidente, la capacité du prolétariat à se constituer en force politique indépendante dans la société. Mais peut-être que ce qui, par-dessus tout, a convaincu Marx que le communisme pouvait être plus qu'une simple utopie, c'est son contact direct avec les groupes d'ouvriers communistes à Paris. Les réunions de ces groupes firent une énorme impression sur lui :
« Lorsque les ouvriers communistes se réunissent, leur intention vise d'abord la théorie, la propagande, etc. Mais en même temps ils s'approprient par-là un besoin nouveau, le besoin de la société toute entière, et ce qui semble n'avoir été qu'un moyen est devenu un but. Ce mouvement pratique, on peut en observer les plus brillants résultats lorsqu'on voit s'assembler des ouvriers socialistes français. Fumer, boire, manger, etc., ne sont plus alors de simples occasions de se réunir, des moyens d'union. La compagnie, l'association, la conversation qui vise l'ensemble de la société les comblent ; pour eux la fraternité humaine n'est pas une phrase, mais une vérité, et, de leurs figures endurcies par le travail, la noblesse de l'humanité rayonne vers nous » ([8] [645]).
Nous pouvons pardonner à Marx une certaine exagération dans ce passage ; les associations communistes, les organisations ouvrières ne constituent en fait jamais une fin en elles-mêmes. La véritable question est ailleurs ; c'est-à-dire qu'en participant au mouvement prolétarien naissant, Marx fut capable de voir que le communisme, la fraternité concrète et réelle de l'homme, pouvait être autre chose que de nobles phrases mais bien un projet pratique. C'est à Paris en 1844 que pour la première fois, Marx s'est explicitement qualifié de communiste.
Ainsi, ce qui, par-dessus tout, permit à Marx de surmonter ses hésitations sur le communisme, fut la reconnaissance qu'il existait dans la société une force qui avait un intérêt matériel au communisme. Puisque le communisme avait cessé d'être une abstraction dogmatique, un simple bel idéal, le rôle des communistes n'était plus réduit à prêcher contre les maux du capitalisme et pour les bienfaits du communisme. Il signifiait s'identifier aux luttes de la classe ouvrière, montrant au prolétariat « pourquoi il lutte » et comment « il doit acquérir la conscience » des buts finaux de sa lutte. L'adhésion de Marx au communisme se confond avec son adhésion à la cause du prolétariat parce que le prolétariat est la classe porteuse du communisme. L'exposé classique de sa position se trouve dans le passage final de la Critique de la Philosophie du Droit de Hegel. Bien que cet article fût consacré à la question de savoir quelle force sociale pouvait permettre à l'Allemagne de s'émanciper de ses chaînes féodales, la réponse qu'il donnait était en fait plus appropriée à la question : comment l'humanité pouvait-elle s'émanciper du capitalisme puisqu'il développe que : « la possibilité positive de l'émancipation allemande » réside « dans la formation d'une classe aux chaînes radicales, d'une classe de la société civile qui ne soit pas une classe de la société civile ; d'un ordre qui soit la dissolution de tous les ordres, d'une sphère qui possède, par ses souffrances universelles, un caractère universel, qui ne revendique pas un droit particulier parce qu'on n'a pas commis envers elle une injustice particulière mais l'injustice pure et simple, qui ne peut prétendre à un titre historique mais seulement à un titre humain (... ), d'une sphère enfin qui ne peut s'émanciper sans s'émanciper de toutes les autres sphères et par là les émanciper toutes, qu'en un mot, elle soit la perte totale de l'homme et ne puisse se reconquérir qu'à travers la réacquisition complète de l'humanité. Cette dissolution de la société en tant qu'état (classe) particulier, c'est le prolétariat » ([9] [646]).
Malgré le fait que la classe ouvrière fût seulement en train de se former en Allemagne, les relations de Marx avec le mouvement ouvrier plus développé de France et de Grande-Bretagne l'avaient déjà convaincu du potentiel révolutionnaire de cette classe. C'était la classe qui personnifiait toutes les souffrances de l'humanité ; en cela, elle n'était pas différente des précédentes classes exploitées de l'histoire bien que la « perte d'humanité » fût poussée à un point encore plus avancé chez elle. Mais à d'autres égards, elle était tout à fait différente des précédentes classes exploitées, ce qui devint clair une fois que le développement de l'industrie moderne eut fait surgir le prolétariat industriel moderne. Contrairement aux classes exploitées du passé telles que la paysannerie sous le féodalisme, la classe ouvrière était, d'abord et avant tout, une classe qui travaillait de manière associée. Cela voulait dire, pour commencer, qu'elle ne pouvait défendre ses intérêts immédiats que par le moyen d'une lutte associée, en unissant ses forces contre toutes les divisions imposées par l'ennemi de classe. Mais cela voulait dire également que la réponse finale à sa condition de classe exploitée ne pouvait résider que dans la création d'une réelle association humaine, d'une société fondée sur la libre coopération et non sur la concurrence et la domination. Et parce qu'une telle association se baserait sur l'énorme progrès de la productivité du travail qu'avait apporté l'industrie capitaliste, elle ne reviendrait pas en arrière, vers une forme inférieure, sous la pression de la pénurie, mais constituerait la base de la satisfaction des besoins humains dans l'abondance. Aussi, le prolétariat moderne contenait-il en lui-même, dans son être même, la dissolution de la vieille société, l'abolition de la propriété privée et l'émancipation de toute l'humanité :
« Lorsque le prolétariat annonce la dissolution de l'ordre mondial traditionnel, il traduit seulement le secret de sa propre existence immédiate, car il est la dissolution effective de cet ordre mondial. Lorsque le prolétariat réclame la négation de la propriété privée, il érige seulement en principe de la société ce que la société a déjà érigé en principe du prolétariat, ce qui en lui - en tant que représentant négatif de la société - est déjà personnifié sans qu'il ait rien fait pour cela » ([10] [647]). C'est pourquoi, dans L'Idéologie Allemande, rédigée deux ans plus tard, Marx était capable de définir le communisme comme « le mouvement réel qui abolit l'état de choses existant » : le communisme n'était rien d'autre que le mouvement réel du prolétariat, conduit par sa nature inhérente, ses intérêts matériels les plus pratiques pour revendiquer l'appropriation de toute la richesse sociale.
A de tels arguments, les Philistins de l'époque répondaient de la même façon que ceux d'aujourd'hui :
« Combien
d'ouvriers connaissez-vous qui veulent une révolution communiste ? La
grande majorité d'entre eux semble tout à fait résignée à son lot dans le
capitalisme » Mais Marx avait
sa réponse prête dans La Sainte Famille (1844) :
« Peu importe ce que tel ou
tel prolétaire, ou même le prolétariat tout entier imagine momentanément
comme but. Seul importe ce qu'il est et ce qu'il sera historiquement contraint de faire en conformité de cet être » ([11] [648]).
Ici, il met en garde contre une vision purement instantanée et empirique du
prolétariat, représenté par le point de vue d'un ouvrier particulier, ou par la
conscience de la vaste majorité de la classe à un moment donné. Au contraire,
il faut voir le prolétariat et sa lutte dans un contexte qui contient
l'ensemble du mouvement de l'histoire, y compris son futur révolutionnaire.
C'est précisément sa capacité à voir le prolétariat dans son cadre historique
qui lui a permis de prédire qu'une classe qui, jusqu'alors, n'était encore
qu'une minorité de la société qui l'entourait et n'avait troublé l'ordre
bourgeois qu'à une échelle locale, serait un jour la force qui ébranlerait
l'ensemble du monde capitaliste dans ses fondements mêmes.
« LES PHILOSOPHES N'ONT FAIT QU'INTERPRÉTER
LE
MONDE, CE QUI IMPORTE C'EST DE LE TRANSFORMER »
Dans le même article où il annonçait sa reconnaissance de la nature révolutionnaire de la classe ouvrière, Marx avait également la témérité de proclamer que « la philosophie trouvait dans le prolétariat ses armes matérielles » ([12] [649]). Pour Marx, Hegel avait atteint le point suprême dans l'évolution historique de la philosophie, non seulement de la philosophie bourgeoise, mais de toute la philosophie, depuis ses origines dans la Grèce antique. Mais après avoir atteint le sommet, la descente fut très rapide. D'abord il y eut Feuerbach, matérialiste et humaniste, qui démasqua la Raison Absolue d'Hegel comme la dernière manifestation de Dieu, et, qui mit à nu Dieu comme étant une projection des pouvoirs supprimés de l'homme, pour élever le culte de l'homme à sa place. C'était déjà le signe que la philosophie en tant que philosophie arrivait à sa fin. Tout ce qui restait à faire à Marx, agissant comme avant-garde du prolétariat, était de délivrer le coup de grâce. Le capitalisme avait établi sa domination effective sur la société ; la philosophie avait dit son dernier mot parce que maintenant, la classe ouvrière avait formulé (même si c'était de façon plus ou moins rudimentaire) un projet réalisable pour l'émancipation pratique de l'humanité des chaînes de tous les âges. A partir de ce moment là, il est parfaitement correct de dire, comme l'a fait Marx que « la philosophie est à l'étude du monde réel ce que l'onanisme est à l'amour sexuel » ([13] [650]). La nullité ultérieure de quasiment toute la « philosophie » bourgeoise après Feuerbach le corrobore ([14] [651]).
Les philosophes avaient fait différentes interprétations du monde. Dans le champ de la philosophie naturelle, l'étude de l'univers physique, ils avaient déjà dû céder la place aux scientifiques de la bourgeoisie. Et maintenant, avec l'arrivée du prolétariat, ils devaient abandonner leur autorité sur tous les sujets relatifs au monde humain. Ayant trouvé ses armes matérielles dans le prolétariat, la philosophie était dissoute en tant que sphère séparée. En termes pratiques, cela signifiait pour Marx une rupture et avec Bruno Bauer et avec Feuerbach. Envers Bauer et ses adeptes, qui s'étaient retirés dans une véritable tour d'ivoire d'autocontemplation, connue sous le terme grandiose de la Critique critique, Marx était sarcastique à l'extrême : c'était vraiment de la philosophie qui s'auto-abuse. Envers Feuerbach, Marx avait beaucoup plus de respect et n'oublia jamais la contribution qu'il apporta en « remettant Hegel sur ses pieds ». La critique fondamentale portée à l'humanisme de Feuerbach, c'était que son homme était une créature abstraite, immuable, séparée de la société et de son évolution historique. Pour cette raison, l'humanisme de Feuerbach ne pouvait faire plus que proposer une nouvelle religion de l'unité de l'humanité. Mais comme Marx l'a souligné, l'humanité ne pouvait devenir réellement une unité tant que les divisions de classe n'avaient pas atteint le point ultime de leur antagonisme ; aussi, tout ce que pouvait faire le philosophe honnête à partir de maintenant, c'était de mettre sa destinée aux côtés du prolétariat dans cette société divisée.
Mais la totalité de la phrase dit : « De même que la philosophie trouve dans le prolétariat ses armes matérielles, le prolétariat trouve dans la philosophie ses armes spirituelles ». La suppression effective de la philosophie par le mouvement prolétarien ne signifiait pas que ce dernier doive réaliser une décapitation grossière de toute vie intellectuelle. Au contraire, il avait maintenant assimilé le « meilleur » de la philosophie, et par extension la sagesse accumulée par la bourgeoisie et les formations sociales antérieures, et s'était engagé dans la tâche de la transformer en une critique scientifique des conditions existantes. Marx n'est pas entré les mains vides dans le mouvement prolétarien. Il a apporté avec lui, en particulier, les méthodes et les conclusions les plus avancées élaborées par la philosophie allemande ; et, avec Engels, les découvertes des économistes politiques les plus lucides de la bourgeoisie : dans ces deux sphères, celles-ci représentaient l'apogée intellectuelle d'une classe qui non seulement gardait un caractère progressiste, mais venait juste de terminer son héroïque phase révolutionnaire. L'arrivée d'hommes tels que Marx et Engels dans les rangs du mouvement ouvrier a marqué un pas qualitatif dans la clarification ultérieure d'un mouvement parti d'un tâtonnement intuitif, spéculatif, à demi formé théoriquement vers l'étape de l'investigation et de la compréhension scientifiques. En termes organisationnels, ceci fut symbolisé par la transformation de la Ligue des Justes, genre de secte à demi conspiratrice, en Ligue des Communistes qui adopta le Manifeste communiste comme programme en 1848.
Mais répétons-le : cela ne signifiait pas que la conscience de classe ait été injectée dans le prolétariat à partir d'un niveau astral supérieur. A la lumière de ce qu'on vient d'écrire, on peut voir plus clairement que la thèse kautskyste selon laquelle la conscience socialiste est apportée à la classe ouvrière par des intellectuels bourgeois, est réellement une continuation de l'erreur des utopistes critiquée par Marx dans les Thèses sur Feuerbach :
« La doctrine matérialiste de la transformation par le milieu et par l'éducation oublie que le milieu est transformé par les hommes et que l'éducateur doit lui-même être éduqué. Aussi lui faut-il diviser la société en deux parties, dont l'une est au-dessus de la société. La coïncidence de la transformation du milieu et de l'activité humaine ou de la transformation de l'homme par lui-même ne peut être saisie et comprise rationnellement que comme praxis révolutionnaire » ([15] [652]).
En d'autres termes : la thèse kautskyste - que Lénine a reprise dans Que faire ? puis abandonnée par la suite ([16] [653]) - part d'un matérialisme vulgaire qui voit la classe ouvrière éternellement conditionnée par les circonstances de son exploitation, incapable de devenir consciente de sa situation réelle. Pour rompre ce cercle fermé, le matérialisme vulgaire se transforme alors, lui-même en idéalisme le plus abject, posant une « conscience socialiste » qui, pour quelque obscure raison, serait inventée... par la bourgeoisie ! Cette démarche renverse complètement la façon dont Marx lui-même a posé le problème. Ainsi, dans l'Idéologie allemande, il écrivait :
« Voici, pour finir, quelques résultats que nous obtenons encore de la conception de l'histoire que nous avons exposée : à un certain stade de l'évolution des forces productives, on voit surgir des forces de production et des moyens de commerce qui, dans les conditions existantes, ne font que causer des malheurs. Ce ne sont plus des forces de production mais des forces de destruction... Autre conséquence, une classe fait son apparition, qui doit supporter toutes les charges de la société sans jouir de ses avantages ; une classe qui, jetée hors de la société, est reléguée de force dans l'opposition la plus résolue à toutes les autres classes ; une classe qui constitue la majorité de tous les membres de la société et d'où émane la conscience de la nécessité d'une révolution en profondeur, la conscience communiste, celle-ci pouvant, naturellement, se former parmi les autres classes grâce à l'appréhension du rôle de cette classe » ([17] [654]).
C'est assez clair : la conscience communiste émane du prolétariat, et, comme produit de cela, des éléments d'autres classes sont capables d'atteindre la conscience communiste. Mais seulement en rompant avec 1'idéologie de classe dont ils ont « hérité » et en adoptant le point de vue du prolétariat. Ce dernier point est particulièrement souligné dans un passage du Manifeste Communiste :
« Enfin, au moment où la lutte des classes approche de l'heure décisive, le processus de décomposition de la classe dominante, de la vieille société tout entière, prend un caractère si violent et si âpre qu'une petite fraction de la classe dominante se détache de celle-ci et se rallie à la classe révolutionnaire, à la classe qui porte en elle l'avenir. De même que, jadis, une partie de la noblesse passa à la bourgeoisie, de nos jours une partie de la bourgeoisie passe au prolétariat, et, notamment, cette partie des idéologues bourgeois qui se sont haussés jusqu'à l'intelligence théorique de l'ensemble du mouvement historique » ([18] [655]).
Marx et Engels pouvaient seulement « apporter » au prolétariat ce qu'ils ont apporté en « se détachant de la classe dominante » ; ils ne pouvaient « se hausser à l'intelligence théorique de l'ensemble du mouvement historique » qu'en examinant de manière critique la philosophie et l'économie politique bourgeoises du point de vue de la classe exploitée. En fait, une meilleure façon de présenter cela, c'est de dire que le mouvement prolétarien, en gagnant à sa cause des gens de l'acabit de Marx et Engels, a renforcé sa capacité de s'approprier la richesse intellectuelle de la bourgeoisie et de l'utiliser à ses propres fins. Il n'aurait pas été capable de le faire s'il ne s'était déjà auparavant engagé dans la tâche de développer une théorie communiste. Marx était tout à fait explicite à ce sujet quand il présentait les ouvriers Proudhon et Weitling comme des théoriciens du prolétariat. En quelque sorte, la classe ouvrière a utilisé la philosophie et l'économie politique bourgeoises, pour forger une arme indispensable qui porte le nom de marxisme, et qui n'est autre chose que « l'acquis théorique fondamental de la lutte prolétarienne... la seule conception du monde qui se place réellement du point de vue de cette classe » ([19] [656]).
***
Dans la prochaine partie de cette série, nous examinerons les premières descriptions par Marx et Engels de la société communiste, et leurs conceptions initiales de la transformation révolutionnaire qui y mène.
[1] [657] Le Manifeste communiste, Éditions sociales.
[2] [658] Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel, Écrits de Jeunesse, Éditions Spartacus.
[3] [659] « Le communisme et la Allgemeine Zeitung d'Augsbourg », Oeuvres III, La Pléiade.
[4] [660] « Lettre à Ruge », Écrits de Jeunesse, Éditions Spartacus.
[5] [661] « Le communisme et la Allgemeine Zeitung d'Augsbourg », Oeuvres III, La Pléiade.
[6] [662] « Lettre à Ruge », Éditions Spartacus.
[7] [663] « Lettre à Ruge », Éditions Spartacus.
[8] [664] Manuscrits philosophiques et économiques, Oeuvres II, La Pléiade.
[9] [665] Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel, Éditions Spartacus.
[10] [666] Idem.
[11] [667] La Sainte Famille, Oeuvres III, La Pléiade.
[12] [668] Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel, Éditions Spartacus.
[13] [669] L'Idéologie Allemande, Oeuvres III, La Pléiade.
[14] [670] Depuis, seuls les philosophes qui ont reconnu la banqueroute du capitalisme, ont eu quelque chose à dire. Traumatisés par la barbarie croissante du système capitalisme déclinant, mais incapables de concevoir véritablement qu'il puisse exister autre chose que le capitalisme, ils décrètent non seulement que la société présente, mais l'existence elle-même, est une absurdité complète ! Mais le culte du désespoir n'est pas une très bonne publicité pour la santé de la philosophie d'une époque.
[15] [671] Thèses sur Feuerbach, Oeuvres III, La Pléiade.
[16] [672] Voir notre article dans la Revue Internationale n°43, « Réponse à la Communist Workers Organisation (CWO) : sur la maturation souterraine de la conscience ». La CWO et le Bureau International pour le Parti révolutionnaire (BIPR) auquel elle est affiliée, continuent à défendre une version légèrement affaiblie de la théorie kautskyste de la conscience de classe.
[17] [673] L'idéologie allemande, Oeuvres III, La Pléiade.
[18] [674] Le Manifeste Communiste, Éditions sociales.
[19] [675] Plateforme du CCI, point 1.
Approfondir:
Questions théoriques:
- Communisme [492]
Heritage de la Gauche Communiste:
Revue Internationale no 70 - 3e trimestre 1992
- 2935 reads
Editorial : Face au chaos et aux massacres, seule la classe ouvrière peut apporter une réponse
- 2588 reads
Nous publions en page 9 une résolution sur la situation internationale adoptée par le CCI en avril 1992. Depuis que ce document a été rédigé, les événements ont amplement illustré les analyses qu'il contient. C'est ainsi que la décomposition et le chaos, particulièrement au plan des antagonismes impérialistes, n'ont fait que s'aggraver comme on peut le voir, par exemple, avec les massacres en Yougoslavie. De même, la crise économique mondiale a poursuivi son cours catastrophique, créant les conditions d'une reprise des combats de classe auxquels la bourgeoisie se prépare de façon active, comme en témoignent les grandes manoeuvres syndicales en Allemagne.
L'effondrement, dans la deuxième moitié de 1989, du bloc de l'Est n'a pas fini de faire sentir ses conséquences. Le «nouvel ordre mondial» qu'il annonçait, au dire du président Bush, se présente en réalité comme un désordre encore plus catastrophique que le précédent, un chaos sanglant accumulant, jour après jour, les ruines et les cadavres en même temps que les anciens antagonismes entre grandes puissances ont cédé la place à de nouveaux antagonismes de plus en plus explosifs.
Le déchaînement des antagonismes impérialistes
Dans le capitalisme décadent, et particulièrement lorsque la crise économique ouverte témoigne de façon décisive de l'impasse où se trouve ce système, il n'y a pas de place pour une quelconque atténuation des conflits entre les différentes bourgeoisies nationales. Alors qu'il n'existe plus aucune issue pour l'économie capitaliste, que toutes les politiques destinées à surmonter la crise n’ont eu d'autre effet que de la rendre encore plus catastrophique, que les remèdes se sont révélés n'être que des poisons venant encore aggraver l'état du malade, il ne reste d'autre alternative à toute bourgeoisie, quels que soient ses moyens et sa puissance, que la fuite en avant dans la guerre et les préparatifs en vue de celle-ci. C'est pour cela que la disparition, en 1989, d'un des deux blocs militaires qui s'étaient partagé le monde depuis le lendemain de la seconde guerre mondiale n'a nullement débouché sur la «nouvelle ère de paix» que nous annonçaient les chantres du monde bourgeois. En particulier, puisque la menace de «l'Empire du mal» ne pesait plus sur eux, les «alliés» d'hier, c'est-à-dire les principaux pays du bloc occidental, se sont senti pousser des ailes pour mettre en avant leurs intérêts spécifiques face à ceux du «grand frère» américain.
Les alliances que contractent les différentes bourgeoisies nationales ne sont jamais des mariages d'amour mais nécessairement des mariages d'intérêt. En même temps qu'on peut assister à des «réconciliations» spectaculaires, où l'on découvre que la haine réciproque que les Etats avaient inculquée pendant des décennies aux populations doivent céder la place a une « amitié sans faille », les meilleurs amis d'hier, «unis à jamais par l'histoire», par leurs «valeurs communes» et par les «épreuves partagées», n'hésitent pas à se convertir en ennemis acharnés, dès lors que leurs intérêts ont cessé de converger. Il en avait été ainsi au cours et au lendemain de la seconde guerre mondiale où l'URSS avait été présentée par les «démocraties» occidentales, tour à tour, comme un suppôt du diable hitlérien, puis comme un «héroïque compagnon de combat», puis, de nouveau, comme l'incarnation du démon.
Aujourd'hui, même si les structures de base du bloc américain (OTAN, OCDE, FMI, etc.) subsistent encore formellement, si les discours bourgeois évoquent encore l'union des grandes «démocraties», c'en est fini dans les faits de l'Alliance atlantique. L'ensemble des événements qui se sont déroulés depuis près de deux ans n'a fait que confirmer cette réalité : l'effondrement du bloc de l'Est ne pouvait aboutir qu'à la disparition du bloc militaire qui lui faisait face et qui venait de remporter la victoire dans la guerre froide qui les avait opposés depuis plus de 40 ans. De ce fait, non seulement la solidarité entre les principaux pays occidentaux a volé en éclats, mais sont déjà en oeuvre, même si c'est de façon embryonnaire, les tendances vers la reconstitution d'un nouveau bloc impérialiste où l'antagonisme principal se situerait entre les Etats-Unis et leurs alliés d'un côté et, de l'autre, une coalition dirigée par l'Allemagne. Comme la presse du CCI l'a longuement mis en évidence, la Guerre du Golfe du début 1991 avait comme principale origine la tentative américaine de bloquer le processus de désagrégation du bloc occidental et de tuer dans l'oeuf toute velléité de reconstitution d'un nouveau système d'alliances. Les événements de Yougoslavie à partir de l'été 1991 ont montré que l'énorme opération mise au point par Washington n'avait eu que des effets limités et que sitôt terminés les combats dans le Golfe, et la «solidarité» qu'ils exigeaient entre les coalisés, les antagonismes de fond resurgissaient de plus belle. La reprise actuelle des combats dans 1’ex-Yougoslavie, cette fois en Bosnie-Herzégovine, vient, au-delà des apparences, confirmer cette aggravation des tensions entre les grandes puissances qui constituaient le bloc de l'Ouest.
Massacres et discours de paix dans l'ex-Yougoslavie : la guerre au coeur de l'Europe
A l'heure où ces lignes sont écrites, la guerre fait de nouveau rage dans l'ex-Yougoslavie. Après des mois de massacres dans différentes parties de la Croatie, et alors que la situation semblait s'apaiser dans cette région, c'est maintenant la Bosnie-Herzégovine qui se retrouve à feu et à sang. En deux mois, le chiffre des tués s'élève déjà à plus de 5000. Les blessés se comptent par dizaines de milliers alors que ce sont des centaines de milliers de personnes qui sont obligées de quitter les zones de combat, en même temps, d'ailleurs, que la mission de l'ONU à Sarajevo et autres organismes qui pouvaient apporter un minimum de protection à ces populations.
Aujourd'hui, la Serbie est mise «au ban des nations» comme disent les journalistes. Le 30 mai, l'ONU a adopté des mesures rigoureuses d'embargo contre ce pays, comparables à celles imposées à l'Irak avant la guerre du Golfe, pour le contraindre à cesser de déchaîner, en compagnie des milices serbes, le fer et le feu en Bosnie-Herzégovine. Et c'est l'oncle Sam qui a pris la tête de cette campagne de grande ampleur contre la Serbie en même temps qu'il se proclame le défenseur de la «Bosnie démocratique».
Ainsi, Baker n'hésitait pas à évoquer, le 23 mai, la possibilité d'une intervention militaire pour faire plier la Serbie. Et, c'est sous une très forte pression américaine, que les autres membres du Conseil de Sécurité qui pouvaient avoir des réticences, comme la Russie et la France, se sont finalement ralliés à une motion «dure» contre ce pays. Au passage, les Etats-Unis n'ont pas manqué une occasion pour faire ressortir que le maintien de l'ordre dans l’ancienne Yougoslavie incombait fondamentalement aux pays d'Europe et à la CEE, et qu'ils ne se mêlaient de cette question que dans la mesure où ces derniers faisaient la preuve de leur impuissance.
Pour qui a suivi le jeu des grandes puissances depuis le début des affrontements en Yougoslavie, la position actuelle de la première d'entre elles peut apparaître comme un mystère. Pendant des mois, notamment à la suite de la proclamation de l'indépendance de ta Slovénie et de la Croatie au cours de l'été 1991, les Etats-Unis se sont comportés comme de véritables alliés de la Serbie condamnant en particulier le démantèle ment de la Yougoslavie que devait provoquer nécessairement la sécession des deux républiques du Nord. Au sein de la CEE, les pays traditionnellement les plus proches des Etats-Unis, la Grande- Bretagne et les Pays-Bas, ont tout fait pour laisser les mains libres à la Serbie dans ses opérations visant à mettre au pas la Croatie, ou tout au moins à l'amputer d'un bon tiers de son territoire. Pendant des mois, les Etats-Unis fustigé «l'impuissance européenne», qu'ils avaient grandement contribué à aggraver, pour apparaître enfin sur le devant de la scène, tel le Zorro de la légende, et obtenir, à la suite de l'action de l'émissaire de l'ONU, le diplomate américain (quel hasard !) Cyrus Vance, un arrêt des combats en Croatie alors que la Serbie avait déjà atteint 1 essentiel de ses buts de guerre dans cette région.
Cette action de la diplomatie américaine se comprenait parfaitement. En effet, si l'indépendance de la Croatie avait été fortement encouragée par l'Allemagne, c'est parce qu'elle coïncidait avec les nouvelles ambitions impérialistes de ce pays dont la puissance et la position en Europe en fait le prétendant le plus sérieux au rôle de chef de file d'une nouvelle coalition dirigée contre les Etats-Unis, maintenant qu'a disparu toute menace venant de l'Est. Pour la bourgeoisie allemande, une Croatie indépendante et «amie» était la condition de l'ouverture d'un accès sur la Méditerranée qui constitue un atout indispensable pour toute puissance prétendant jouer un rôle mondial. Et c'est bien ce que les Etats-Unis voulaient éviter à tout prix. Leur soutien à la Serbie durant les affrontements en Croatie, qui ont causé à ce dernier pays des ravages considérables, leur permettait de signifier tant à la Croatie qu'à l'Allemagne ce qu'il en coûte de vouloir mettre en oeuvre une politique qui contrarie les intérêts US. Mais justement parce que la première puissance mondiale n'a pas eu à se «mouiller» directement dans toute la seconde partie de 1991 et au début 1992, laissant la CEE afficher son impuissance, elle pouvait opérer par la suite une arrivée en force ou elle allait désigner comme bouc émissaire son allié d'hier, la Serbie.
Aujourd'hui, la soudaine passion des Etats-Unis pour l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine n'a évidemment rien à voir avec le fait que les autorités de ce dernier pays seraient plus «démocratiques» que celles de la Croatie. Ce sont des gangsters de la même race qui gouvernent à Sarajevo, Zagreb, Belgrade et Washington. En réalité, du point de vue des Etats-Unis, la très grande supériorité de la Bosnie-Herzégovine sur la Croatie tient au fait qu'elle peut constituer un point d'appui de première importance pour contrecarrer la présence allemande dans la région. Pour des raisons tant géographiques qu'historiques, l'Allemagne était au départ le pays le mieux placé pour rattacher une Croatie indépendante à sa zone d'influence. C'est pour cela que les Etats-Unis n'ont pas cherché immédiatement à la concurrencer auprès de la Croatie, faisant au contraire tout leur possible pour s'opposer à l'indépendance de ce pays. Mais une fois que 'Allemagne a joué sa carte en Croatie, il revenait à la bourgeoisie américaine de réaffirmer sa place de gendarme du monde et donc de revenir en force dans une région normalement du ressort des Etats européens. Le cynisme et la brutalité de l'Etat serbe et de ses milices lui en a offert une occasion rêvée. En se déclarant le grand protecteur des populations de la Bosnie-Herzégovine victimes de cette brutalité, l’oncle Sam se propose de ramasser la mise à plusieurs niveaux :
- il fait une nouvelle fois la preuve, comme lors de la guerre du Golfe et de la conférence de Madrid sur le Moyen-Orient à la fin 1991, qu'aucun problème important ans les relations internationales ne peut être réglé en dehors de l'intervention de Washington ;
- il adresse un message aux sphères dirigeantes des deux grands voisins de l'ex-Yougoslavie bénéficiant d'une importance stratégique de premier ordre, l'Italie et a Turquie, pour les convaincre de la nécessité de lui rester fidèles ;
- il ravive les plaies que la question de la Yougoslavie avait provoquées dans l'alliance privilégiée entre la France et l'Allemagne (même si ces difficultés ne sont pas en mesure de remettre en cause la convergence d'intérêts qui existe par ailleurs entre ces eux pays, comme le démontre leur décision de constituer un corps d'armée commun)1] [676] ;
- il prépare son implantation en Bosnie-Herzégovine afin de priver l'Allemagne d'une libre disposition des ports croates de Dalmatie.
Concernant ce dernier point, la simple lecture d'une carte géographique permet de constater que la Dalmatie est constituée d'une bande étroite de terre coincée entre la mer et les hauteurs tenues par l'Herzégovine. Si l'Allemagne, grâce à son alliance avec la Croatie, rêvait d'installer des bases militaires dans les ports de Zadar, Split et Dubrovnik comme points d'appui d'une flotte méditerranéenne, elle serait confrontée au fait que ces ports se trouvent respectivement a 80, 40 et 10 km de la frontière «ennemie» (Dubrovnik a même la particularité d'être coupé du reste de la Croatie par un débouché de l'Herzégovine sur la mer). En cas de crise internationale, il ne serait pas difficile, pour la puissance américaine, de faire le blocus de ces ports, comme la Serbie l'a démontré jusqu'à présent, coupant les avant-postes allemands de leurs arrières et les rendant inutilisables.
En ce qui concerne le «message» transmis à l'Italie, il prend toute son importance à un moment où, à l'image d'autres bourgeoisies européennes (par exemple la bourgeoisie française dont le parti néo-gaulliste, le RPR, est partagé entre partisans et adversaires d'une alliance plus étroite avec l'Allemagne au sein de la CEE), celle de ce pays est divisée sur les alignements impérialistes, comme le démontre notamment la paralysie actuelle de son appareil politique. Compte tenu de la position de premier plan de ce pays en Méditerranée (contrôle du passage entre l'Ouest et l'Est de cette mer, présence à Naples du commandement de la 6e flotte US), les Etats-Unis sont prêts à «mettre le paquet» pour qu'il ne soit pas tenté de rejoindre l'alliance franco-allemande.
De même, une mise en garde des Etats-Unis à la Turquie se comprend tout à fait à 1 heure où ce pays est tenté de coupler ses propres ambitions régionales en direction des républiques musulmanes de l'ex-URSS (qu'elle compte arracher à l'influence d'une Russie aujourd'hui alliée aux Etats-Unis) à une alliance avec l'Allemagne et à un soutien aux ambitions impérialistes de ce pays au Proche-Orient. La Turquie occupe, elle aussi, une position stratégique de première importance puisqu'elle contrôle le passage entre la Mer Noire et la Méditerranée. Aussi, son rapprochement en cours avec l'Allemagne (mis en évidence, notamment, par le «scandale» de la livraison de matériel militaire destiné à la répression des Kurdes, scandale dévoilé grâce aux «bons offices» de Washington) constitue une menace très sérieuse pour les Etats-Unis. Ces derniers ont déjà commencé à réagir en soutenant les nationalistes Kurdes et ils sont prêts à employer des moyens encore plus importants pour stopper un tel rapprochement. En particulier, la «protection» apportée aujourd'hui par la première puissance mondiale aux populations musulmanes de Bosnie-Herzégovine (majoritaires dans ce pays) apparaît comme un pavé dans la mare de la Turquie qui se présente comme le «grand arrière» des musulmans de la région.2] [677])
Ce que démontrent cependant les massacres de Yougoslavie, c'est que même si l'avancée de la décomposition est un phénomène qui échappe au contrôle de tous les secteurs de la bourgeoisie mondiale, y compris ceux des pays les plus avancés et puissants, ces derniers secteurs ne restent pas inactifs et passifs face à un tel phénomène. Contrairement aux équipes nouvellement promues dans les pays de l'ancien bloc de l'Est (sans parler, évidemment de la situation dans le «tiers-monde») et qui sont complètement débordées par la situation économique et politique (notamment par l'explosion des nationalismes et des conflits ethniques), les gouvernements des pays les plus développés sont encore capables de mettre à profit la décomposition pour la défense des intérêts de leur capital national. C'est notamment ce qu'ont démontré, début mai, les émeutes de Los Angeles.
L'utilisation de la décomposition par la bourgeoisie
Comme le CCI l'a mis en évidence[3] [678] la décomposition générale de la société capitaliste, telle qu'elle se développe aujourd'hui, révèle l'impasse historique totale dans laquelle se trouve maintenant cette société. Tout comme la crise et les guerres, la décomposition n'est donc pas une question de bonne ou de mauvaise volonté de la bourgeoisie ou bien de politique erronée de sa part. Elle s'impose à elle de manière insurmontable et irréversible. Le fait que la décomposition, au même titre qu'une éventuelle 3e guerre mondiale, ne puisse avoir d'autre aboutissement, au sein du capitalisme, que la disparition de l'humanité n y change rien. C'est bien ce que révèle le «Sommet» de Rio sur la protection de la Terre qui s'est tenu au début du mois de mai. Comme il était prévisible, la montagne a accouché d'une souris malgré la gravité croissante des problèmes d'environnement mise en évidence par la majorité des scientifiques. Alors que, à cause de l'effet de serre, ce sont de terribles famines qui se profilent à l'horizon, voire la disparition de l'espèce humaine, chacun se renvoie la balle pour ne rien faire (le Nord contre le Sud et réciproquement, l'Europe contre les Etats-Unis, etc.).
Mais si la bourgeoisie se révèle absolument incapable de mettre en oeuvre une quelconque politique à long terme et à l'échelle mondiale, même quand c'est sa propre survie, en même temps que celle de l'ensemble de l’humanité qui est menacée, elle reste capable de réagir contre les effets de la décomposition, sur le court terme et au niveau de la défense de ses intérêts nationaux. Ainsi, les émeutes de Los Angeles sont venues mettre en relief toutes les capacités manoeuvrières que les bourgeoisies les plus puissantes sont encore capables d'utiliser.
Los Angeles constitue une sorte de concentré de toutes les caractéristiques de la société américaine : l'opulence et la misère, la «high tech» et la violence. Symbole du «rêve américain», c'est devenu aussi celui du «cauchemar américain». Comme nous l'avons mis en évidence dans nos textes sur la décomposition, celle-ci, au même titre que la crise économique, part du coeur du capitalisme, même si elle trouve à sa périphérie ses formes les plus extrêmes et catastrophiques. Et L'A (comme on dit en langage «branché») est bien le coeur de ce coeur. Depuis de nombreuses années déjà, la décomposition y exerce des ravages tragiques et particulièrement dans les ghettos noirs. Dans la plupart des villes américaines, ces ghettos sont devenus de véritables enfers, dominés par une misère insupportable, des conditions de logement et sanitaires dignes du «tiers-monde» (par exemple, la mortalité infantile y atteint des taux comparables à ceux des pays les plus arriérés, le SIDA y frappe de façon tragique) et surtout un désespoir généralisé qui conduit une proportion considérable des jeunes, dès la première adolescence, vers la drogue, la prostitution et le banditisme. De ce fait, la violence et le meurtre font partie du quotidien de ces quartiers : la première cause de décès des hommes noirs de la tranche d'âge 15-34 ans est l'assassinat, près d'un quart des hommes noirs entre 20 et 29 ans est en prison ou en liberté surveillée, 45 % de la population carcérale est noire (les noirs représentent 12% dans la population totale). Ainsi, à Harlem, ghetto noir de New-York, pour cause d'assassinat, d'overdose, de maladie, l'espérance de vie d'un homme est plus courte que celle d'un homme du Bangladesh.
Cette situation s'est aggravée tout au long des années 1980, mais la récession actuelle, avec une montée vertigineuse du chômage, lui a donné des proportions encore bien plus considérables. De ce fait, depuis des mois, de nombreux «spécialistes» ne cessaient de prédire l'imminence d'émeutes et d'explosions de violence dans ces quartiers. Et c'est justement face à une telle menace que la bourgeoisie américaine a réagi. Plutôt que de se laisser surprendre par une succession d'explosions spontanées et incontrôlables, elle a préféré organiser un véritable contre-feu lui permettant de choisir le lieu et le moment d'un tel surgissement de violence et de prévenir du mieux possible les surgissements futurs.
Le lieu : Los Angeles, véritable paradigme de l'enfer urbain aux Etats-Unis, où plus de 10 000 jeunes vivent du commerce de la drogue, dont les ghettos sont quadrillés par des centaines de bandes armées qui se massacrent pour le contrôle d'une rue, d'un point de vente de la «poudre d'ange».
Le moment : au début de la campagne pour les présidentielles, qui s'en trouve relancée, mais à distance respectable de l'élection elle-même, afin que de tels troubles, éclatant de façon incontrôlée, ne viennent déconsidérer au dernier moment un candidat, Bush, dont les sondages sont pour l'heure peu reluisants.
Les moyens : l'organisation en plusieurs temps d'une véritable provocation. D'abord, une campagne médiatique de grande ampleur autour du procès des quatre flics blancs qui avaient été filmés en train de tabasser sauvagement un automobiliste noir : c'est à satiété que les téléspectateurs ont pu voir et revoir cette scène révoltante. Ensuite l'acquittement des flics par un tribunal installé de façon délibérée dans un quartier réputé pour son conservatisme, son «goût de l'ordre» et ses sympathies envers la police. Enfin, dès que se sont produits, de façon parfaitement prévisible, les premiers troubles et les premiers rassemblements, une véritable désertion, sur ordre supérieur, des quartiers «chaud» par les forces de police, laissant ainsi l'émeute prendre un maximum d'ampleur. Ces mêmes forces de police, en revanche, sont restées très présentes dans les quartiers bourgeois proches, tels Beverley Hills. Cette tactique avait aussi l'avantage de priver les manifestants de leur ennemi traditionnel, le flic, permettant de canaliser encore plus leur colère vers le saccage des commerces, l'incendie des maisons appartenant à d'autres communautés de même que vers les règlements de comptes entre bandes. Avec une telle tactique, les 58 morts provoqués par cette explosion ne sont pas dus aux forces de police mais essentiellement aux affrontements entre habitants des ghettos (particulièrement entre les jeunes manifestants et les petits commerçants voulant protéger par les armes leurs échoppes).
Les moyens et les conditions du retour à l'ordre faisaient aussi partie de la manoeuvre : ce sont les mêmes soldats qui, il y a un an et demi à peine défendaient le «droit» et la «démocratie» dans le Golfe qui sont venus participer à la pacification des quartiers troublés. La répression, si elle n'a pas été sanglante, a été cependant conduite à grande échelle : près de 12000 arrestations et, pendant des semaines, à la télévision, les images des centaines de procès condamnant à la prison les émeutiers interpellés. Le message était clair : même si elle ne se comporte pas comme un quelconque régime du «tiers-monde», et si elle veille à ne pas faire couler le sang de ceux qui troublent l'ordre public (et cela était d'autant plus facile que, grâce à leur provocation, les autorités n'ont été à aucun moment débordées par les événements), la «démocratie américaine» sait faire preuve de fermeté contre eux. Avis a ceux qui, dans le futur, seraient tentés de recommencer de nouvelles émeutes...
La «gestion» des émeutes de L'A a permis à l'équipe dirigeante de la bourgeoisie américaine de démontrer à tous les secteurs de celle-ci qu'elle était, malgré toutes les difficultés qui s'accumulent, malgré le développement du cancer des ghettos et de la violence urbaine, à a hauteur de ses responsabilités. Dans un monde de plus en plus soumis à des convulsions de toutes sortes, la question de l'autorité du pouvoir, tant à l'extérieur qu'à 'intérieur, de la première puissance de la planète est de la plus haute importance pour la bourgeoisie de ce pays. Avec la provocation à Saddam Hussein durant l'été 1990 suivie de la «tempête du désert» au début 1991, Bush a fait la preuve qu'il savait manifester ce type d'autorité au niveau international. Los Angeles, avec des moyens spectaculaires, notamment dans les montages médiatiques qui rappelaient ceux mis en oeuvre autour de la guerre du Golfe, a démontré que l'administration actuelle était aussi capable de réagir sur le plan «domestique» et que, pour catastrophique qu'elle soit, la situation intérieure aux Etats-Unis restait «under control».
Cependant, les émeutes provoquées de L'A ne constituaient pas seulement un moyen pour l'Etat et le gouvernement de réaffirmer leur autorité face aux différentes manifestations de la décomposition. Elles étaient aussi un instrument d'une offensive de grande ampleur contre la classe ouvrière.
La bourgeoisie se prépare à une reprise des combats de classe
Comme la résolution le met en évidence : «l'aggravation considérable de la crise capitaliste, et particulièrement dans les pays les plus développés, constitue un facteur de premier ordre de démenti de tous les mensonges sur le "triomphe" du capitalisme, même en l'absence de luttes ouvertes. De même, l'accumulation du mécontentement provoqué par la multiplication et l'intensification des attaques résultant de cette aggravation de la crise ouvrira, à terme, le chemin à des mouvements de grande ampleur qui redonneront confiance à la classe ouvrière... Dans l'immédiat, les luttes ouvrières se situent à un des niveaux les plus bas depuis la dernière guerre mondiale. Mais ce dont il faut être certain c'est que, dès à présent, se développent en profondeur les conditions de leur surgissement...» (point 16). Dans tous les pays avancés, la bourgeoisie est bien consciente de cette situation, et particulièrement la première d'entre elles. C'est pour cela que les émeutes de L.A. ont constitué également un instrument de cette bourgeoisie pour affaiblir de façon préventive les futurs combats ouvriers. En particulier, grâce aux images faisant apparaître les noirs comme de véritables sauvages (telle l'image de jeunes noirs s'attaquant à des chauffeurs de camion blancs), la classe dominante a réussi à renforcer de façon significative un des facteurs de faiblesse de la classe ouvrière des Etats-Unis : la division entre les ouvriers blancs et les ouvriers noirs ou d'autres communautés. Comme le déclarait un expert de la bourgeoisie : «le niveau de sympathie que les blancs pouvaient éprouver pour les noirs a considérablement diminué du fait de la peur ressentie par les premiers devant la montée constante de la criminalité noire» (C. Murray de l'American Entreprise Institute, le 6/5/02). En ce sens, le «rétablissement de l'ordre contre des bandes de délinquants noirs pilleurs de magasins et dealers», tel que la bourgeoisie en a voulu donner l'image, a pu être accueilli avec satisfaction par une proportion non négligeable des ouvriers blancs oui sont souvent victimes de 1 insécurité urbaine. A cette occasion, l’«efficacité» des forces dépêchées par l'Etat fédéral (qui contraste avec l’«inefficacité» supposée des forces de la police locale) n'a pu que renforcer l'autorité de celui-ci.
En outre cette montée du racisme a été exploitée par les professionnels de P anti-racisme pour lancer de nouvelles campagnes a-classistes de diversion qui, loin de favoriser l'unité de classe du prolétariat, visent au contraire à le diluer dans l'ensemble de la population et à l'attacher au char de la «démocratie». De même, les syndicats et le Parti Démocrate ont profité de la situation pour dénoncer la politique sociale des administrations républicaines depuis le début des années 1980 rendues responsables de la misère dans les quartiers pauvres des villes. En d'autres termes, pour que les choses s'améliorent, il faut aller voter pour le «bon candidat», ce qui permet au passage de relancer une campagne électorale qui, jusqu'à présent, ne mobilisait pas les roules.
Les différentes manifestations de la décomposition, comme par exemple les émeutes urbaines dans le «tiers-monde» et les pays avancés, seront utilisées par la bourgeoisie contre la classe ouvrière tant que cette dernière n'aura pas été encore en mesure de mettre en avant sa propre perspective de classe vers le renversement du capitalisme. Et cela, que de tels événements soient spontanés ou provoqués sciemment. Mais le fait que la bourgeoisie soit en mesure de choisir le moment et les circonstances de telles explosions lui permet d'en rendre plus efficace l'impact pour la défense de son ordre social. Que les émeutes de L'A soient arrivées fort à propos comme instrument contre la classe ouvrière nous est confirmé par l'ensemble des manoeuvres que la classe dominante déploie contre les exploités dans les autres pays avancés. L'exemple le plus significatif de cette politique bourgeoise nous a été donné récemment dans un des pays les plus importants du monde capitaliste, l'Allemagne.
Offensive de la bourgeoisie contre la classe ouvrière en Allemagne
L'importance de ce pays ne tient pas seulement à son poids économique et à son rôle stratégique croissant. C'est aussi dans ce pays que vit, travaille et lutte un des prolétariats les plus puissants du monde, un prolétariat qui, compte-tenu de son nombre et de sa concentration au coeur de l'Europe industrialisée de même que de son expérience historique incomparable, détient une grande partie des clés du futur mouvement de la classe ouvrière vers la révolution mondiale. C'est bien pour cette raison que l'offensive politique de la bourgeoisie contre la classe ouvrière en Allemagne, et dont la grève du secteur public, la plus importante depuis 18 ans, menée de main de maître par les syndicats, était le fer de lance, ne visait pas seulement la classe ouvrière de ce pays. L'écho considérable qu'elle a eu dans les médias des différents pays européens (alors qu'habituellement les luttes ouvrières font l'objet d'un black-out presque complet à l'étranger) a fait a démonstration que c'est tout le prolétariat européen qui était visé par cette offensive.
Les conditions spécifiques de l'Allemagne permettent de comprendre pourquoi une telle action a pris part aujourd'hui dans ce pays, n effet, outre son importance historique et économique qui sont des données permanentes, outre le fait qu'elle doit faire face, comme toutes les bourgeoisies, à une nouvelle aggravation considérable de la crise, la bourgeoisie de ce pays se trouve à l'heure actuelle confrontée au problème de la réunification (en fait de la «digestion» de l'Est par l'Ouest). Cette réunification est un véritable gouffre à milliards de DM. Le déficit de l'Etat s'est élevé vers des sommets rarement atteints dans ce pays «vertueux». Il s'agit donc pour la bourgeoisie de préparer la classe ouvrière à des attaques d'un niveau sans précédent afin de lui faire accepter le coût de la réunification, il importe de lui faire comprendre que c'en est fini des «vaches grasses» et qu'elle devra désormais faire des sacrifices très importants. C'est pour cela que les propositions salariales dans le secteur public (4,9 %), alors même que se sont déjà multipliées les taxes de toutes sortes, étaient inférieures à l'inflation. C'est le cheval de bataille qu'ont enfourché les syndicats témoignant d'une radicalité inconnue depuis des décennies, organisant des crèves tournantes massives (plus de 100 000 ouvriers par jour) qui ont provoqué certains jours un véritable chaos dans les transports et autres services publics (ce qui a eu comme conséquence d'isoler les grévistes des autres secteurs de la classe ouvrière). Après des revendications salariales de l'ordre de 9 %, les syndicats ont rabattu leurs prétentions à 5,4 %, présentant ce chiffre comme une « victoire » pour les travailleurs et une «défaite» pour Kohl. Evidemment, la majorité des ouvriers a considéré, après trois semaines de grève, que c était nettement insuffisant (plus 0,5% par rapport à la proposition d'origine, environ 20 DM par mois) et la popularité de la très médiatique Monika Mathies, présidente de l’ÖTV, y a laissé quelques plumes. Mais, pour la bourgeoisie, plusieurs objectifs importants avaient été atteints :
- mettre en évidence que, malgré une grève très massive et des actions «dures», il était impossible de faire fléchir la bourgeoisie dans sa volonté de limiter les hausses de salaire ;
- présenter les syndicats, qui avaient systématiquement organisé toutes les actions, maintenant les ouvriers dans la plus grande passivité, comme les véritables protagonistes de la lutte contre les patrons en même temps que l'assurance sociale à laquelle faut s'affilier pour que soient (payés les jours de grève (pendant a grève, les travailleurs taisaient la queue pour aller prendre leur carte syndicale qui les engage pour deux ans) ;
- renforcer encore un peu plus la division entre les ouvriers de l'Est et ceux de l'Ouest, les premiers ne comprenant pas que les seconds revendiquent des augmentations alors qu'à l'Ouest, les salaires sont nettement supérieurs et le chômage plus faible, les seconds n'ayant pas envie de payer pour les «ossies» qu'on se plaît à présenter comme des «paresseux» et des «incapables».
Dans les autres pays, l'image de l’«Allemagne modèle» a été quelque peu ternie par ces grèves. Mais la bourgeoisie s'est empressée d'enfoncer deux clous contre la conscience de la classe ouvrière :
- le mensonge que la grève des ouvriers allemands «privilégiés» vient encore aggraver la situation financière et économique de l'occident ;
- le message qu'il est illusoire de tenter de mener des luttes contre la dégradation des conditions d'existence, puisque, malgré toute leur force (et notamment celle des syndicats) et la prospérité de leur pays, les ouvriers d'Allemagne n’ont pas pu obtenir grand-chose,
Ainsi, la bourgeoisie la plus puissante d'Europe a donné le ton de l'offensive politique contre la classe ouvrière qui doit nécessairement accompagner des attaques économiques d'une brutalité sans précédent. Pour le moment, la manoeuvre a réussi mais l'ampleur qu'elle a prise est à l'image de la crainte que le prolétariat inspire à la bourgeoisie. Les événements de ces trois dernières années, et toutes les campagnes qui les ont accompagnés, ont affaibli de façon significative la combativité et la conscience au sein de la classe ouvrière. Mais celle-ci n'a pas dit son dernier mot. Avant même qu'elle n'ait renoué avec des luttes de grande envergure, sur son terrain de classe, tous les préparatifs de la classe dominante démontrent l'importance de ces combats à venir.
[1] [679] Comme le signale la résolution, l'Allemagne et la France n'attendent pas exactement la même chose de leur alliance. En particulier, ce dernier pays compte sur ses avantages militaires pour compenser son infériorité économique par rapport au premier afin de ne pas se retrouver en situation de vassal et de pouvoir revendiquer une sorte de «co-direction» d'une alliance des principaux Etats européens (à l'exception de la Grande-Bretagne, évidemment). C'est pour cela que la France n'est nullement intéressée à une présence allemande en Méditerranée qui dévaloriserait de façon très sensible l'importance de sa propre flotte dans cette mer ce qui la priverait a'un atout majeur dans les marchandages avec son «amie».
[2] [680] Il n'est pas exclu non plus que le soutien des Etats-Unis aux populations croates de Bosnie-Herzégovine actuellement victimes de la Serbie parvienne un jour à « démontrer ». La Croatie qu'elle a tout intérêt à troquer la «protection» allemande, qui s'est révélée d'une efficacité très limitée, contre une protection américaine beaucoup mieux pourvue en moyens de se faire respecter. De telles visées ne sauraient évidemment être absentes de la diplomatie américaine.
[3] [681] Voir notamment les articles dans la Revue Internationale n° 57 et 62.
Récent et en cours:
- Luttes de classe [143]
Questions théoriques:
- Guerre [129]
Crise économique mondiale : une récession pas comme les autres
- 6495 reads
Sur le plan économique, le monde entier semble suspendu à une seule question : y aura-t-il une reprise aux Etats-Unis ? La locomotive qui a tiré l'économie mondiale depuis deux décennies aura-t-elle la force de redémarrer une fois encore ?
La réponse des économistes est évidemment: oui. Leur métier de gérants et porte-paroles idéologiques du système leur interdit, quoiqu il en soit, de penser autrement. La seule chose dont ils sont sûrs c'est que le capitalisme est éternel. Au-delà du royaume des marchands et de l'exploitation salariale, il ne peut y avoir que le néant. Même pour les plus cyniquement lucides d'entre eux, les pires difficultés de l'économie capitaliste mondiale ne peuvent jamais être que des contrariétés passagères, des secousses dues aux «nécessités du progrès», surmontables pour peu qu'on se donne les moyens des «changements structurels nécessaires». L'actuelle récession ouverte qui, depuis plus d'une année, a commencé a frapper les principales puissances économiques du monde, ne serait ainsi qu'un «ralentissement cyclique»; un naturel et salutaire mouvement de repli après une trop longue période d'expansion.
«Toute l'économie mondiale est en train de s'assainir après des années d'excès», déclarait Raymond Barre([1] [682]) en février 1992, au cours du Forum de l'économie mondiale de Davos.
Georges Bush et l'équipe chargée d'organiser son actuelle campagne électorale aux Etats-Unis vont plus loin : la récession toucherait, dés à présent, à sa in et une nouvelle reprise serait en cours. «Le vieil adage se vérifie : "Quand le bâtiment va, tout va "», déclarait Bush, à la mi-mai, citant des statistiques qui faisaient état d'une augmentation de la construction de logements aux Etats-Unis dans les premiers mois de 1992.
Mais la réalité historique se moque des rêves et souhaits des «responsables» de l'ordre établi. Quelques jours après cette déclaration optimiste de Bush, les statistiques officielles faisaient état d'une chute de 17 % de l'indice de construction de nouvelles maisons, la plus forte chute depuis 8 ans !
Les difficultés que connaît la bourgeoisie mondiale pour faire face a l'actuelle récession ouverte de son économie sont qualitativement nouvelles. Cette récession n'est pas comme les autres.
Des récessions de plus en plus destructrices
Il est vrai que depuis deux décennies l'économie mondiale, suivant à des degrés divers les mouvements de l'économie américaine, a connu une succession de récessions et de «reprises». Mais les récessions, depuis la fin des années 60, c'est-à-dire depuis la fin de la période de «prospérité » due à la reconstruction consécutive à la 2e guerre mondiale, ne suivent pas un mouvement cyclique analogue à la respiration d'un corps sain ; encore moins épousent-elles le rythme des crises cycliques du capitalisme dans la deuxième moitié du 19e siècle, en pleine phase ascendante du capitalisme, dont l'intensité allait en s'atténuant chaque dix ans. Les fluctuations de l'économie mondiale depuis 20 ans ne traduisent pas le mouvement cyclique d'une vie en expansion, mais les convulsions d un corps de plus en plus malade. Depuis la récession de 1967, les plongeons ont été chaque fois de plus en plus profonds et prolongés dans le temps. Le mouvement de la croissance de la production aux Etats-Unis, coeur du capitalisme mondial, est éloquent à cet égard (Voir Graphique 1 ci-contre).
Cet «électrocardiogramme» du centre du capitalisme ne traduit que partiellement la réalité. Dans les faits, après la récession de 1980-1982, il n'y a pas eu de véritable reprise de la croissance économique mondiale. Les pays du «tiers-monde» ne sont pas réellement parvenus à se relever. Les années 1980 sont, pour la plupart des pays sous-développés, synonyme du plus grand marasme économique de leur existence. Le continent africain, une grande partie de l'Asie et de l'Amérique Latine ont été économiquement dévastés au cours de cette période ; l'ex-URSS et les pays de son glacis connaissent depuis le milieu de cette décennie une plongée dans le chaos qui se concrétise par un des plus violents reculs économiques connus dans l'histoire. Ce n'est que dans la petite partie du monde, constituée par les pays les plus industrialisés de l'ancien bloc occidental, que l'économie connaît un certain développement au cours des années 1980. Et encore, ce développement ne se fait que dans certaines zones de ces pays : une véritable désertification industrielle a ravagé pendant ces années des régions qui comptaient parmi les plus anciennement industrialisées de la planète, en Grande-Bretagne, en France, en Belgique ou aux Etats-Unis par exemple.
La récession qui frappe aujourd'hui les pays les plus industrialisés n'a donc rien à voir avec un répit salutaire dans un cours de croissance mondiale. Elle marque, au contraire, l'effondrement de la seule partie au monde qui avait relativement échappé au marasme général.
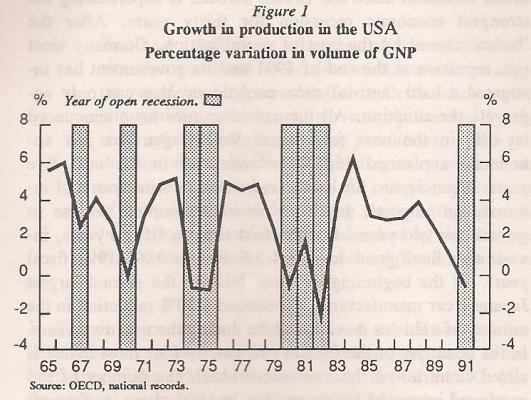
La machine à «relancer» l'économie ne répond plus
Mais, même malade, l'économie des pays les plus industrialisés peut-elle retrouver un minimum de croissance, comme ce fut le cas après les récessions précédentes ? Les gouvernements des grandes puissances peuvent-ils, encore une fois, faire redémarrer la machine en baissant les taux d'intérêt et en faisant tourner la planche à billets ? Le recours au crédit, au «produisons aujourd'hui ; on verra demain pour le paiement », peut-il encore permettre de s'en sortir en trichant, en repoussant les échéances ?
La bureaucratie de l'OCDE, grand chantre des vertus éternelles du système capitaliste et de la victoire du «libéralisme», annonçait fin 1991 l'imminence d'une «reprise modérée» ([2] [683]) Mais elle accompagnait cette «prévision» d'une réserve importante :
«Dans la plupart des grands pays, la croissance monétaire léthargique est à la fois involontaire et inhabituelle (,..)La contraction persistante de l'offre de crédits bancaires, qui paraît être à l'origine de ce ralentissement, pourrait constituer une menace pour la croissance (...) Les incertitudes dues au ralentissement actuel de la croissance monétaire posent un problème très difficile aux responsables.»
Ce qui est appelé ici «la croissance monétaire léthargique» n'est autre que la contraction du crédit bancaire, le «crédit crunch» pour employer le terme anglo-saxon devenu à la mode. La masse monétaire dont il est question est essentiellement celle constituée par les multiples formes de crédits bancaires. Sa contraction traduit essentiellement le refus, l'incapacité des banques d'ouvrir de nouveau le robinet de l'endettement pour faire redémarrer la machine productive, comme lors des récessions des deux dernières décennies.
Le recours sans limites au crédit par le passé, en particulier pendant les «années Reagan» se paie aujourd'hui en termes de banqueroutes. L'insolvabilité croissante des entreprises, et d'une grande partie des banques, interdit le remboursement d'un nombre toujours plus élevé de crédits, poussant chaque jour plus de banques au bord de la faillite. L'effondrement des caisses d'épargne américaines, à la fin des années 1980, n'était que le début de ce marasme. ([3] [684]) Dans ces conditions, les actuelles nouvelles facilités de crédit créées par l'Etat (baisse des taux d'intérêt, création monétaire) sont utilisées par les banques, non pas pour octroyer de nouveaux crédits mais pour tenter de renflouer leurs caisses et de réduire le déséquilibre de leurs bilans.
Lowell L. Bryan, un «éminent expert» américain du système bancaire et financier, affirmait en 1991, dans un livre au titre évocateur de Bankrupt (banqueroute) ([4] [685]) :
«C'est peut être 25 % du système bancaire [américain], représentant plus de 750 milliards de dollars en placements([5] [686]) qui a commencé à connaître des pertes tellement massives qu'il n'a d'autre choix que de se consacrer à se faire rembourser des crédits plutôt qu'à étendre le crédit. Qui plus est, les banques qui ne connaissent pas de problèmes de crédit deviennent évidemment à leur tour beaucoup plus prudentes »
Le Graphique 2 (voir page suivante) montre clairement la réalité de l'effondrement sans précédent de la croissance de la masse de crédits bancaires (en particulier à partir de 1990). Il met aussi en évidence la nouvelle impuissance du Gouvernement pour relancer la machine a crédit. Contrairement à ce qui se produit lors des récessions de 1967, 1970, 1974-75, 1980-82, l'augmentation de la masse monétaire créée directement par l'Etat (billets de la banque centrale et pièces de monnaie) ne provoque plus une augmentation de la masse des crédits bancaires. Le gouvernement américain a beau appuyer sur l'accélérateur, la machine bancaire ne répond plus.
«Nous avons créé un marché qui est efficace pour la destruction de notre économie. Notre système financier est sur le point de s'effondrer. La réglementation de notre système financier, et le contrat social qui le sous-tend, est en faillite», constate amèrement l'auteur de Bankrupt. Et ce constat résume bien la nouveauté qui fait que cette récession ouverte n'est pas comme les autres.
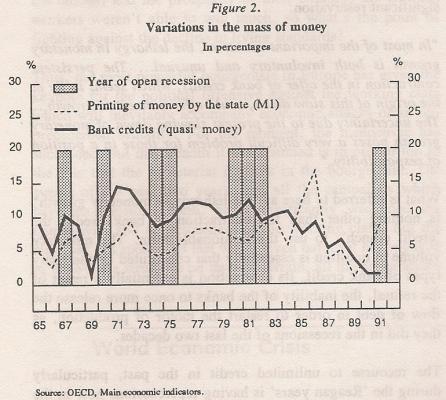
L'économie mondiale ne connaît pas un processus d' «assainissement» financier, mais le contrecoup destructeur de la plus grande période de spéculation de l'histoire du capitalisme. La machine qui a permis pendant des années de repousser les problèmes dans 'avenir est en morceaux, sans que pour autant le problème de fond, l'incapacité du capitalisme de créer ses propres débouches, soit résolu. Au contraire. Jamais le décalage entre ce que la société peut produire et ce qu'elle peut acheter n'a été aussi grand. ([6] [687])
Encore plus de chômage et de misère
Au niveau superficiel, les doses massives d'interventionnisme monétaire de l'actuelle administration Bush - perspective d'élections présidentielles oblige -peuvent provoquer des ralentissements de la chute dans des secteurs particuliers. La récente cascade de réductions du taux d'intérêt par la Fédéral Reserve (plus d'une vingtaine en quelques mois), a, par exemple, fini par enrayer momentanément la chute de la construction de logements. Mais tout cela demeure d'une fragilité extrême.
Les efforts désespérés du gouvernement américain pour limiter les dégâts, à la veille des élections, parviendront, dans le meilleur des cas, à ralentir la chute momentanément. Mais cela ne provoquera pas une véritable reprise ni un dépassement de la récession. Tout au plus cela entraînera un infléchissement momentané de la courbe descendante, une récession en «double dip», en double plongeon, comme ce fut le cas lors de la récession de 1980-1982, qui fut entrecoupée par la fausse reprise de 1981.
(Voir Graphique 1 ).
Les principales entreprises américaines, comme General Motors, IBM ou Boeing, continuent de licencier. Leurs plans de «restructuration», prévoient des dizaines de milliers de suppressions d'emplois (74 000 pour la seule General Motors) et sont prévus pour s'étaler pendant les trois ou cinq ans à venir. Cela en dit long sur la confiance qu'ont les gérants des plus grandes entreprises mondiales (et de pointe) dans es perspectives de reprise.
L'évolution de l'économie dans les autres grands pays industrialisés confirme la dynamique de recul. Le Royaume-Uni continue de s'enfoncer dans ce qui constitue déjà sa plus violente récession depuis les années 1930. La Suède connaît le plus puissant recul économique depuis 30 ans. L'Allemagne, après le «boom» provoqué par les dépenses dues à la réunification, est entrée en récession à la fin de l'année 1991 et son gouvernement met en place un puissant plan de «refroidissement anti-inflation» qui ne pourra qu'aggraver la situation. Tous les constructeurs automobiles y annoncent des suppressions d'emplois pour les années à venir : Volkswagen vient d'annoncer un plan de 15 000 licenciements pour les cinq prochaines années. Le Japon lui-même, victime du ralentissement des importations américaines et mondiales, ne cesse de voir sa croissance diminuer depuis deux ans. Pour la première fois en 15 ans, les investissements y diminuent (- 4,5 % pour l'année fiscale 1991-1992). Nissan, le deuxième constructeur automobile japonais, a annoncé début juin une réduction de 30 % du nombre de véhicules qui seront produits au cours des deux prochaines années. Dans l'ensemble de la zone de l'OCDE (les 24 pays les plus industrialisés de l'ex-bloc occidental) il y a eu 6 millions de chômeurs en plus au cours de la seule année 1991 et aucune prévision officielle ne se risque à prédire un véritable arrêt de l'hémorragie.
Pour la classe ouvrière mondiale, pour les exploités de la planète, cette récession n'est pas, non plus, comme les autres. La nouvelle aggravation du chômage et de la misère, qui frappe et frappera dans les années à venir, s'annonce elle aussi sans précédent. Elle s'abat, en outre, sur une classe qui vient de subir, au cours des années 1980, la plus violente attaque économique depuis la dernière guerre mondiale. Aujourd'hui, c'est la partie centrale du prolétariat mondial, celle des pays les plus industrialisés, celle qui avait été relativement la moins frappée, qui se trouve en première ligne. La nouvelle recrudescence des difficultés du système met ainsi, une fois encore, la classe révolutionnaire devant ses responsabilités historiques.
RV, 10/6/92
[1] [688] « Le premier économiste de France » disait Giscard d'Estaing de cet ancien chef du gouvernement français.
[2] [689] Perspectives économiques n° 50, décembre 1991.
[3] [690] Voir en particulier l'article « Crise du crédit, relance impossible, une récession toujours plus profonde », dans la Revue Internationale n°68.
[4] [691] Bankrupt – Restoring the health and profitability of our banking svstem, HarperCollins Publishers.
[5] [692] Soit l'équivalent de la production totale de l'Espagne et de la Suisse en 1991.
[6] [693] Au mois de mai 1992, la presse mondiale publiait simultanément deux nouvelles : l'annonce par les Nations Unies que 60 millions d'êtres humains risquent de mourir de faim en Afrique cette année, et la notification par la CEE de sa décision de faire stériliser 15 % des terres cultivables en céréales en Europe, par manque d'acheteurs !
Récent et en cours:
- Crise économique [28]
Résolution sur la situation internationale : Le développement des conditions d'un resurgissement de la lutte de classe
- 2880 reads
Deux ans et demi après l'effondrement du bloc de l'Est et des régimes staliniens d'Europe, la situation mondiale continue d'être déterminée pour une grande part par cet événement historique considérable. En particulier, celui-ci a constitué un facteur d'aggravation sans précédent de la décomposition du capitalisme, notamment sur le plan des antagonismes impérialistes de plus en plus marqués par le chaos résultant de celle-ci. Cependant, la crise économique du mode de production capitaliste, en connaissant une très forte aggravation à l'heure actuelle, et en premier lieu dans les métropoles du capital, tend à revenir au centre de cette situation. En détruisant les illusions sur la « supériorité du capitalisme » déversées à profusion lors de la chute du stalinisme, mettant en évidence de façon croissante l'impasse dans laquelle se trouve ce système, obligeant la classe ouvrière à se mobiliser pour la défense de ses intérêts économiques face aux attaques de plus en plus brutales que la bourgeoisie est conduite à déchaîner, elle constitue un puissant facteur de dépassement des difficultés rencontrées par la classe ouvrière depuis l'effondrement du bloc de l'Est.
1) L'envahissement de l'ensemble de la vie du capitalisme par le phénomène de décomposition est un processus qui remonte au début des années 1980 et même à la fin des années 1970 (par exemple les convulsions en Iran débouchant sur la constitution d'une République «islamique» et la perte de contrôle de ce pays par son bloc de tutelle). L'agonie et la mort des régimes staliniens et l'effondrement du bloc impérialiste dominé par l'URSS sont une manifestation de ce processus. Mais, en même temps, ces faits historiques considérables ont provoqué une accélération énorme de celui-ci. C'est pour cela qu'on peut considérer qu'ils révèlent et marquent l'entrée u capitalisme dans une nouvelle phase de sa période de décadence, celle de la décomposition, de la même façon que la première guerre mondiale constituait la première convulsion de grande envergure résultant de l'entrée de ce système dans sa décadence et qui allait en amplifier de façon majeure les différentes manifestations.
Ainsi, l'effondrement des régimes staliniens d'Europe marque l'ouverture d'une période de convulsions catastrophiques dans les pays sur lesquels régnaient ces régimes. Mais c'est encore plus sur le plan des antagonismes impérialistes à l'échelle mondiale que s'expriment les caractéristiques de la nouvelle période, et notamment, au premier rang d'entre elles, le chaos. En effet, c'est bien le chaos qui permet le mieux de qualifier la situation présente des rapports impérialistes entre Etats.
2) La guerre du Golfe du début 1991 a constitué la première manifestation de grande ampleur de ce nouvel «état du monde» :
- elle résultait de la disparition du bloc de l'Est et des premières manifestations de son inéluctable conséquence, la disparition du bloc occidental lui-même ;
- elle constituait, de la part de la première puissance mondiale, une action de grande envergure afin de limiter ce dernier phénomène en contraignant les anciens alliés (en premier lieu, l'Allemagne, le Japon et la France) à manifester, sous la direction de cette puissance, leur «solidarité» face à la déstabilisation générale du monde ;
- par la barbarie sanglante qu'elle a engendrée, elle donnait un exemple de ce qui attend dorénavant l'ensemble de l'humanité ;
- malgré l'ampleur des moyens mis en oeuvre, elle n'a pu que ralentir, mais sûrement pas inverser les grandes tendances qui s'affirmaient dès la disparition du bloc russe : la dislocation du bloc occidental, les premiers pas vers la constitution d'un nouveau bloc impérialiste dirigé par l'Allemagne, l'aggravation du chaos dans les relations impérialistes.
3) La barbarie guerrière qui s'est déchaînée en Yougoslavie quelques mois à peine après la fin de la guerre du Golfe constitue une illustration particulièrement irréfutable de ce dernier point. En particulier, les événements qui se trouvent à l'origine de cette barbarie, la proclamation de l'indépendance de la Slovénie et de la Croatie, s'ils sont eux-mêmes une manifestation du chaos et de l'exacerbation des nationalismes qui caractérisent l'ensemble des zones dirigées auparavant par des régimes staliniens, n'ont pu avoir lieu que parce que ces nations étaient assurées du soutien de la première puissance européenne, l'Allemagne. Bien plus encore que son indiscipline lors de la crise du Golfe (voyage de Brandt à Bagdad avec la bénédiction de Kohl, l'action diplomatique de la bourgeoisie allemande dans les Balkans, qui visait à lui ouvrir un débouché stratégique sur la Méditerranée via une Croatie «indépendante» sous sa coupe, constitue le premier acte décisif de sa candidature à la direction d'un nouveau bloc impérialiste.
4) L'énorme supériorité militaire des Etats-Unis a l'heure actuelle, dont justement la guerre du Golfe a permis un étalage spectaculaire et meurtrier, contraint évidemment la bourgeoisie allemande à limiter considérablement ses ambitions pour le moment. Encore bridée sur le plan diplomatique et militaire (traités lui interdisant d'intervenir à l'extérieur de ses frontières, présence des troupes américaines sur son territoire), dépourvue notamment de l'arme atomique et d'une industrie d'armement de pointe, l'Allemagne ne se trouve qu'au tout début du chemin qui pourrait la conduire à constituer autour d'elle un nouveau bloc impérialiste. Par ailleurs, comme on l'a vu en Yougoslavie, la mise en avant par ce pays de ses nouvelles ambitions ne peut conduire qu'à accentuer la déstabilisation de la situation en Europe et donc à aggraver le chaos dans cette partie du monde ce qui, compte tenu de sa position géographique constitue, pour eux, plus encore que pour les principaux pays occidentaux, une menace de première importance (notamment sous la forme d'une immigration massive). C'est notamment pour cette raison que l'Allemagne continue de tenir sa place au sein de la structure de 'OTAN. Cette dernière, comme elle l'a annoncé elle-même à son sommet de Rome en automne 1991, n'a plus pour objectif de faire face à une puissance russe en pleine déconfiture mais de constituer un parapluie contre les convulsions en Europe de l'Est. La nécessaire fidélité de l'Allemagne envers l'OTAN ne peut que réduire de façon importante la marge de manoeuvre de ce pays à l'égard de la puissance américaine qui dirige cette structure.
5) Enfin, la nécessité pour l'Allemagne de se doter d'alliés de premier plan en Europe occidentale, et qui est une condition de son accession au rang de puissance mondiale, se heurte, pour le moment, à des difficultés importantes. Ainsi, au sein de la CEE, elle ne peut compter en aucune façon sur a Grande-Bretagne (oui est le meilleur allié des Etats-Unis) ni sur les Pays-Bas (que l'étroitesse des liens économiques avec leur grand voisin incitent justement à se tourner vers les Etats-Unis et la Grande-Bretagne pour ne pas devenir une simple province allemande et qui constituent, de ce fait, la tête de pont de ces puissances dans le Nord du continent européen). De tous les grands d'Europe, la France est le plus intéressé à des liens étroits avec l'Allemagne dans la mesure où elle ne peut prendre la place de lieutenant des Etats-Unis dans la sphère européenne que l'histoire, la communauté de langue et surtout la proposition géographique ont attribue de façon définitive à la Grande-Bretagne. Cependant, l'alliance franco-allemande ne saurait avoir la même solidité et stabilité que celle entre les deux puissances anglo-saxonnes dans la mesure où :
- les deux partenaires ne placent pas les mêmes espoirs dans leur alliance (l'Allemagne aspirant à une position dominante alors que la France voudrait conserver un statut d'alter ego, sa détention de l'arme atomique et de positions impérialistes en Afrique devant compenser son infériorité économique) ce qui peut aboutir à des positions diplomatiques divergentes, comme on l'a vu à propos de la Yougoslavie ;
- la puissance américaine a d'ores et déjà entrepris de faire payer très cher le manque de fidélité de la France (éviction du Liban, appui à l'entreprise de Hissen Habré au Tchad, soutien du FIS en Algérie, affaire Habache, etc.), afin de faire revenir ce pays à de «meilleurs sentiments».
6) Cependant, tant son énorme retard militaire actuel, que les embûches que la puissance américaine ne manquera pas de lui opposer, que le risque de provoquer une exacerbation du chaos, ne sauraient détourner l'Allemagne du chemin dans lequel elle s'est, dès à présent, engagée. L'inéluctable aggravation, avec la crise capitaliste elle-même, des antagonismes impérialistes, la tendance de ces antagonismes à déboucher sur le partage du monde en deux blocs impérialistes, la puissance économique et la place en Europe de ce pays, ne peuvent que le pousser toujours plus à poursuivre sa progression sur ce chemin, ce qui constitue un facteur d'instabilité supplémentaire dans le monde d'aujourd'hui.
Plus généralement, même si la menace du chaos constitue un facteur pouvant à certains moments refréner l'affirmation par les grandes puissances de leurs intérêts impérialistes propres, la tendance historique dominante du monde actuel est celle d'une exacerbation de leurs antagonismes, aussi catastrophique que puisse être cette exacerbation. En particulier, la détermination des Etats-Unis, affichée avec la guerre du Golfe, de jouer pleinement leur rôle de «gendarme du monde» ne pourra s'exprimer, en fin de compte, que par l'emploi croissant de la force militaire et le chantage au chaos, ce qui contribuera à aggraver encore ce dernier (comme l'illustre, notamment avec le problème Kurde, la situation du Moyen-Orient après cette guerre). Ainsi, quelles que soient les tentatives des grandes puissances pour y remédier, c'est bien le chaos qui dominera de plus en plus l'ensemble des rapports entre Etats dans le monde d'aujourd'hui, un chaos qui se trouve aussi bien à l'origine qu'à l'aboutissement des conflits militaires, un chaos qui ne pourra que se trouver amplifié par l'aggravation inéluctable de la crise du mode de production capitaliste.
7) La récession ouverte dans laquelle a plongé depuis deux ans la première puissance mondiale est venue sonner le glas de bien des illusions que s'était faites et avait propagées la bourgeoisie durant la majeure partie des années 1980. Les fameuses «reaganomics», qui avaient permis la plus longue période depuis les années 1960 de croissance continue des chiffres censés exprimer la richesse des pays (tel le PNB), se révèlent maintenant comme un échec cinglant qui a fait des Etats-Unis le pays le plus endetté de la terre et qui éprouve des difficultés croissantes à financer ses dettes. L'état de santé de l'économie américaine avec sa dette totale de 10 000 milliards de dollars, sa chute de 4,7 % des investissements en 1991 malgré une baisse historique des taux d'intérêt, son déficit budgétaire de 348 milliards de dollars pour 1992, constitue un indice significatif de la situation catastrophique dans laquelle se trouve 1’économie mondiale. Celle-ci, depuis la fin des années 1960, n'a réussi à faire face à la contraction inéluctable des marchés solvables que par une fuite en avant dans l'endettement généralisé. C'est ainsi que la forte récession mondiale de 1974-75 n'avait pu être surmontée que par l'injection massive de crédits dans les pays sous-développés et du bloc de l'Est, leur permettant pour une courte période, de relancer par leurs achats la production des pays industrialisés mais les conduisant rapidement à la cessation de paiements. La récession de 1981-82, qui constituait la conséquence inéluctable de cette situation, n'a pu à son tour être surmontée que par une nouvelle relance de l'endettement, non plus des pays périphériques, mais du premier d'entre eux. Le déficit commercial des Etats-Unis a servi de nouvelle «locomotive» à la production mondiale et la «croissance» interne de ce pays a été stimulée par des déficits budgétaires de plus en plus colossaux. C'est notamment pour cela que l'impasse économique dans laquelle se débat la bourgeoisie américaine revêt un tel caractère de gravité pour l'ensemble de l'économie mondiale. Désormais, le capitalisme ne peut plus compter sur la moindre «locomotive». Asphyxié par l'endettement, il pourra de moins en moins échapper, globalement et au niveau de chacun des pays, à la conséquence inéluctable de la crise de surproduction : une chute croissante de la production, la mise au rebut de secteurs de plus en plus vastes de l'appareil productif, une réduction drastique de la force de travail, des faillites en série, notamment dans le secteur financier, à côté desquelles celles de ces dernières années apparaîtront comme de petites péripéties.
8) Une telle perspective ne saurait être remise en cause par les bouleversements que vient de connaître l'économie clés pays anciennement autoproclamés «socialistes». Pour ces pays, les mesures de «libéralisation» et de privatisation n'ont fait qu'ajouter la désorganisation la plus complète et des chutes massives de la production au délabrement et à l'absence de productivité qui se trouvaient à 'origine de l'effondrement des régimes staliniens. Dès à présent, ou dans un très court terme, c'est la famine qui menace les populations d'un certain nombre d'entre eux. Ce qui attend la plupart de ces pays, et particulièrement ceux issus de la défunte URSS où les affrontements ethniques et nationalistes ne pourront encore qu'aggraver les choses, c'est une plongée dans le tiers-monde. Ainsi, il n’a pas fallu deux ans pour que se dissipent les illusions sur les «marchés» miraculeux qui étaient censés s'ouvrir à l'Est. Ces pays, déjà endettés jusqu'au cou, ne pourront pas acheter grand chose aux pays les plus développés et ces derniers, déjà confrontés à une crise des liquidités sans précédent, ne dispenseront qu'avec la plus extrême parcimonie leurs crédits à des économies qui apparaissent de plus en {dus comme des gouffres sans fond. Il n'y aura pas de « plan Marshall » pour les pays de l'Est, pas de réelle reconstruction de leur économie leur permettant de relancer un tant soit peu la production des pays les plus industrialisés.
9) L'aggravation considérable de la situation de l'ensemble de l'économie mondiale va se traduire par la poursuite et l'intensification a un niveau sans précédent des attaques capitalistes contre la classe ouvrière de tous les pays. Avec le déchaînement de la guerre commerciale, de la compétition pour des marchés de plus en plus restreints, les baisses des salaires réels et l'aggravation des conditions de travail (augmentation des cadences, économies sur la sécurité, etc.) vont côtoyer la réduction massive des prestations sociales (éducation, santé, pensions, etc.) et des effectifs au travail. Le chômage, dont la courbe a repris brutalement en 1991 un cours ascendant dans les principaux pays avancés (28 millions de chômeurs dans l'OCDE contre 24,6 millions en 1990) est destiné à dépasser de loin ses niveaux les plus élevés du début des années 1980. C'est une misère sordide, intenable, qui attend la classe ouvrière, non seule ment dans les pays moins développés mais aussi dans les plus riches d'entre eux. Le sort qui aujourd'hui accable les ouvriers des ex-pays «socialistes» indique aux ouvriers des métropoles d Occident la di rection vers où s'acheminent leurs conditions d'existence. Cependant, il serait totalement faux « de ne voir dans la misère que la misère», comme Marx le reprochait déjà à Proudhon. Malgré la somme tragique de souffrances qu'elle représente pour la classe ouvrière, et en bonne partie à cause d'elle, l'aggravation présente et à venir de la crise capitaliste porte avec elle la reprise des combats de classe et de la progression de la conscience dans les rangs ouvriers.
10) De façon paradoxale mais parfaitement explicable et prévue par le CCI depuis l'automne 1989, l'effondrement du stalinisme, c'est-à-dire du fer de lance de la contre-révolution qui a suivi la vague révolutionnaire du premier après-guerre, a provoque un recul très sensible de la conscience dans la classe ouvrière. Cet effondrement a permis un déchaînement sans précédent des campagnes sur le thème de la «mort du communisme», de la «victoire du capitalisme» et de la «démocratie» qui n'a pu qu'accentuer la désorientation de la grande majorité des ouvriers sur la perspective de leurs combats. Cependant, cet événement n'a eu qu’un impact limité, en durée et en profondeur, sur la combativité ouvrière, comme les luttes du printemps 1990 dans différents pays l'ont attesté. En revanche, à partir de l'été 1990, la crise et la guerre du Golfe, en développant un fort sentiment d'impuissance dans les rangs du prolétariat des pays les plus avancés (qui étaient tous impliqués, directement ou indirectement, dans l'action de la «coalition») ont constitué un facteur très important de paralysie de sa combativité. En même temps, ces derniers événements, en mettant à nu les mensonges sur le «nouvel ordre mondial», en dévoilant le comportement criminel des «grandes démocraties» et de tous les défenseurs patentés des «droits de l'homme», ont contribué à saper une partie de l'impact sur les consciences ouvrières des campagnes de la période précédente. C'est bien pour cette raison que les principaux secteurs de la bourgeoisie ont pris soin d'accompagner leurs «exploits» au Moyen-Orient d'un tel écran de mensonges, de campagnes médiatiques et de nouvelles opérations «humanitaires», notamment en faveur des Kurdes qu'ils avaient eux-mêmes livrés à la répression par le régime de Saddam Hussein.
11) Le dernier acte de cet ensemble d'événements affectant les conditions de développement de la conscience et de la combativité dans la classe ouvrière s'est joué à partir de l'été 1991 avec :
- le putsch manqué en URSS, la disparition de son parti dirigeant et la dislocation de ce pays ;
- la guerre civile en Yougoslavie.
Ces deux événements ont provoqué un nouveau recul de la classe ouvrière, tant au plan de sa combativité que de la conscience en son sein. S'il n'a pas eu un impact comparable à celui des faits de la seconde partie de 1989, l'effondrement du régime prétendument «communiste» en URSS et la dislocation du pays qui avait connu la première révolution prolétarienne victorieuse a attaqué plus en profondeur encore la perspective du communisme dans la conscience des masses ouvrières. En même temps, les nouvelles menaces d'affrontements militaires catastrophiques (y compris avec l'arme nucléaire) surgies de cette dislocation ont participé à accentuer le sentiment d'inquiétude impuissante en leur sein. Ce même sentiment a été amplifié par la guerre civile en Yougoslavie, à quelques centaines de kilomètres es grandes concentrations ouvrières d'Europe occidentale, dans la mesure où le prolétariat de celles-ci ne pouvait qu'assister en spectateur a des massacres absurdes et qu'il était obligé de s'en remettre au bon vouloir des gouvernements et des institutions internationales (CEE, ONU) pour qu'ils prennent fin. De plus, la conclusion (provisoire) de ce conflit, où les grandes puissances ont envoyé leurs troupes avec une «mission de paix» sous l'égide de l'ONU, n'a pu que redorer le blason, terni par la guerre du Golfe, des unes et de l'autre.
12) Les événements de Yougoslavie sont venus mettre en évidence la complexité du lien qui existe entre la guerre et la prise de conscience du prolétariat. Historiquement, la guerre a constitué un puissant facteur tant de la mobilisation que de la prise de conscience de la classe ouvrière. Ainsi, la Commune de Paris, la révolution de 1905 en Russie, celle de 1917 dans ce même pays, celle de 1918 en Allemagne étaient des résultats de la guerre. Mais en même temps, comme le CCI l'a mis en avant, la guerre ne crée pas les conditions les plus favorables à l'extension de la révolution à l'échelle mondiale. De même, la seconde guerre mondiale a démontré que, désormais, il était illusoire de miser sur un surgisse- ment du prolétariat au cours d'un conflit impérialiste généralisé et que celui-ci constituait. Au contraire, un facteur d'enfoncement de la classe dans la contre-révolution. Cependant, la guerre impérialiste n'a pas perdu pour autant sa capacité de mettre en relief aux yeux des prolétaires la nature profondément barbare du capitalisme décadent et des menaces qu'il fait courir à la survie de l'humanité, le comportement de gangsters des «hommes de bonne volonté» qui gouvernent le monde bourgeois et le fait que la classe ouvrière constitue la principale victime de ce type d'agissements. C'est pour cela que la guerre du Golfe a pu agir, partiellement, comme antidote au poison idéologique déversé au cours de l'année 989. Mais, aujourd'hui, pour que la guerre puisse avoir un tel impact positif sur la conscience des masses ouvrières, il est nécessaire que ces différents enjeux apparaissent clairement aux yeux des prolétaires, ce qui suppose :
- que ces derniers ne soient pas massivement embrigadés derrière les drapeaux nationaux (et c'est pour cette raison que les différents conflits qui déchirent les régions où régnait le stalinisme ne font qu'accentuer le désarroi des ouvriers qui s'y trouvent) ;
- que la responsabilité, dans la barbarie et les massacres, des Etats des pays avancés soit évidente et non masquée par les circonstances locales (conflits ethniques, haines ancestrales) ou des opérations «humanitaires» (comme les «missions de paix» de l'ONU).
Dans la période qui vient, ce n'est pas des affrontements comme ceux de la Yougoslavie ou du Caucase qu'il faut attendre une impulsion e la prise de conscience clans les masses ouvrières. En revanche, la nécessité pour les grandes puissances de s'impliquer de plus en plus de manière directe dans les conflits militaires va constituer un facteur important de prise de conscience dans les rangs ouvriers, particulièrement dans les secteurs décisifs du prolétariat mondial qui justement vivent dans ces pays.
13) Plus généralement, les différentes conséquences de l'impasse historique dans laquelle se trouve le mode de production capitaliste n'agissent pas dans la même direction du point de vue du processus de prise de conscience dans l'ensemble de la classe ouvrière. Ainsi, les caractéristiques spécifiques de la phase de décomposition, notamment le pourrissement sur pieds de la société et le chaos, constituent pour l'heure un facteur d'accroissement de la confusion dans la classe ouvrière. Il en est ainsi, par exemple, des convulsions dramatiques qui affectent l'appareil politique de la bourgeoisie dans les pays sortant du prétendu «socialisme réel» ou dans certain pays musulmans (montée de l’intégrisme). Dans les pays avancés également, les différents soubresauts qui secouent cet appareil politique, à une échelle bien moindre évidemment, et sans échapper au contrôle des forces bourgeoises dominantes (montée des mouvements xénophobes en France, en Belgique, dans l'Est de l'Allemagne, succès électoraux des partis régionalistes en Italie, des écologistes en France ou en Belgique), sont efficacement utilisés pour attaquer la conscience des ouvriers. En réalité, les seuls éléments qui agissent favorablement à la prise de conscience du prolétariat sont ceux qui appartiennent à la décadence dans son ensemble, et non spécifiquement à la phase de décomposition : la guerre impérialiste avec une participation directe des métropoles du capitalisme et la crise de l'économie capitaliste.
14) De même qu'il importe de sa voir distinguer la contribution des différents aspects de l'impasse tragique dans laquelle se trouve la société à la prise de conscience de l'ensemble de la classe ouvrière, il est nécessaire de discerner les diverses façons dont cette situation affecte chacun de ses secteurs. En particulier, il doit être clair, comme le CCI l'a mis en évidence depuis le début des années 1980, que le prolétariat des ex-pays «socialistes» est confronte à d'énormes difficultés dans sa prise de conscience. Malgré les terribles attaques qu'il a déjà subies et qu'il subira encore plus, malgré les combats, même de grande ampleur, qu'il va encore mener contre ces attaques, ce secteur de la classe ouvrière mondiale se distingue par sa faiblesse politique qui en fait une proie relativement facile pour les manoeuvres démagogiques des politiciens bourgeois. Ce n’est que 'expérience et l’exemple des combats des secteurs les plus avancés de la classe, notamment ceux d'Europe occidentale, contre les pièges les plus sophistiqués tendus par la bourgeoisie qui permettra aux ouvriers d'Europe de l'Est d'accomplir des pas décisifs dans le processus de prise de conscience.
15) De même, au sein de l'ensemble de la classe ouvrière mondiale, il importe d'établir également une claire distinction, pour ce qui concerne la façon dont les bouleversements depuis 1989 ont été perçus, entre les minorités d'avant-garde et les grandes masses du prolétariat. Ainsi, autant ces dernières ont subi de plein fouet la succession des différentes campagnes de la bourgeoisie, et ont été conduites de façon très sensible à se détourner de toute perspective de renversement du capitalisme, autant les mêmes événements et les mêmes campagnes ont provoqué un regain d'intérêt, une mobilisation à l'égard des positions révolutionnaires de la part des petites minorités qui ont refusé de se laisser entraîner et assourdir par les discours sur la «mort du communisme». C'est une nouvelle illustration du fait que contre le scepticisme, le désarroi et le désespoir que les différents aspects de la décomposition font peser sur l'ensemble de la société, et notamment sur la classe ouvrière, le seul antidote est constitué par l'affirmation de la perspective communiste. Cet accroissement récent de l'audience des positions révolutionnaires est également la confirmation de la nature du cours historique tel qu'il s'est développé à partir de la fin des années 1960, un cours aux affrontements de classe et non à la contre-révolution, un cours que les événements des dernières années, aussi néfastes qu'ils aient pu être en majorité pour la conscience du prolétariat, n'ont nullement pu renverser.
16) Et c'est bien parce que le cours historique n'a pas été renversé, parce que la bourgeoisie n'a pas réussi avec ses multiples campagnes et manoeuvres à infliger une défaite décisive au prolétariat des pays avancés et à l'embrigader derrière ses drapeaux, que le recul subi par ce dernier, tant au niveau de sa conscience que de sa combativité, sera nécessairement surmonté. Déjà, l'aggravation considérable de la crise capitaliste, et particulièrement dans les pays les plus développés, constitue un facteur de premier ordre de démenti de tous les mensonges sur le «triomphe» du capitalisme, même en l'absence de luttes ouvertes. De même, l'accumulation du mécontentement provoqué par la multiplication et l'intensification des attaques résultant de cette aggravation de la crise ouvrira, à terme, le chemin à des mouvements de grande ampleur qui redonneront confiance à la classe ouvrière, lui rappelleront qu'elle constitue, dès à présent, une force considérable dans la société et permettront à une masse croissante d'ouvriers de se tourner de nouveau vers la perspective du renversement du capitalisme. Il est évidemment encore trop tôt pour prévoir à quel moment prendront place de tels mouvements. Dans l'immédiat, les luttes ouvrières se situent à un des niveaux les plus bas depuis la dernière guerre mondiale. Mais ce dont il faut être certain c'est que, dès à présent, se développent en profondeur les conditions de leur surgissement ce qui doit inciter les révolutionnaires à une vigilance croissante afin qu'ils ne soient pas surpris par un tel surgissement et qu'ils soient préparés à intervenir en son sein pour y mettre en avant la perspective communiste.
CCI, 29/3/1992.
Vie du CCI:
- Résolutions de Congrès [131]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [143]
1492 : « découverte de l'Amérique » : la bourgeoisie fête 500 ans de capitalisme
- 16011 reads
Avec un faste grandiose la classe dominante célèbre le 500éme anniversaire de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. L'Exposition universelle de Séville, ville d'où est partie l'expédition qui allait atteindre pour la première fois les îles des Caraïbes, est le point d'orgue de ces réjouissances hyper médiatisées. Mais le spectacle ne s'arrête pas là. La plus grande flotte de voiliers qui ait jamais traversé l'Atlantique, s'est élancée sur les traces de l'auguste découvreur ; plusieurs films ont été produits qui retracent l'épopée de Colomb ; des dizaines de livres, romans historiques et études universitaires ont été publiés pour raconter l'histoire de la découverte de l'Amérique, analyser la signification de l'événement ; sur les écrans de télévision du monde entier, des émissions sont consacrées à ce fait historique, la presse n'est pas en reste avec des centaines d'articles publiés. Rarement, un événement historique, que tous les écoliers étudient dans leurs livres d'histoire, aura polarisé autant de moyens dans sa célébration. Ce n'est pas un hasard.
L'arrivée de Christophe Colomb sur les côtes du Nouveau Monde ouvre les portes d'une période que les historiens de la classe dominante vont parer de toutes les vertus, qualifiant cette période historique, qui débute au milieu du 15éme siècle, de période des découvertes, de la Renaissance, car c'est celle qui voit le capitalisme s'imposer en Europe et commencer sa conquête du monde. Ce que fête la classe dominante, ce n'est pas seulement le 500éme anniversaire d'un fait historique particulièrement important, c'est, symboliquement, un demi millénaire de domination du capitalisme.
Une découverte rendue possible par le développement du capitalisme
Au 15e siècle, le vent qui gonfle les voiles des caravelles et les propulse vers de nouveaux horizons est celui du capitalisme mercantile à la recherche de nouvelles routes commerciales vers PInde et l'Asie, pour l'échange des épices et des soieries qui valent «plus que de l'or». Cela est tellement vrai que Colomb, jusqu'à sa mort en 1506, restera toujours persuadé que les rivages où ses navires ont accosté, sont ceux de l'Asie, de l'Inde qu'il cherchait obstinément à joindre en ouvrant une nouvelle route occidentale. Le nouveau continent dont il fit la découverte sans le savoir, ne portera jamais son nom, mais s'appellera Amérique, tiré du prénom du navigateur Amerigo Vespucci qui, le premier, établira, dans le compte-rendu de ses voyages publié en 1507, que les terres découvertes constituent un nouveau continent.
Il est aujourd'hui avéré que plusieurs siècles auparavant, les vikings ont déjà abordé les côtes de l'Amérique au nord, et il est même probable qu'à d'autres moments de l'histoire humaine, de hardis navigateurs ont déjà effectué la traversée de l'Atlantique d'Est en Ouest. Mais, ces «découvertes», parce qu'elles ne correspondaient pas, à ce moment-là, aux besoins du développement économique, sont restées méconnues, ont sombré dans l'oubli. Il n'en a pas été de même pour l'expédition de Colomb. La découverte de l'Amérique {par Christophe Colomb n'est pas le fruit du hasard, d'une simple aventure individuelle extraordinaire. Colomb n'est pas un aventurier isolé, il est un navigateur parmi bien d'autres qui s'élancent à l'assaut des océans. Elle est le produit des besoins du capitalisme qui se développe en Europe, elle s'insère dans un mouvement d'ensemble qui pousse les navigateurs à la recherche de nouvelles routes commerciales.
Ce mouvement d'ensemble trouve son origine dans les bouleversements économiques, culturels et sociaux qui secouent l'Europe avec la décadence de la féodalité et l'essor du capitalisme mercantile.
Depuis le 13e siècle, les activités de commerce, de banque et de finance se sont épanouies dans les républiques italiennes, qui ont le monopole du commerce avec l'Orient. «Dès le 15e siècle, les bourgeois des villes étaient devenus plus indispensables à la société que la noblesse féodale. (...) Les besoins de la noblesse elle-même avaient grandi et s'étaient transformés au point que, même pour que, les villes étaient devenues indispensables ; ne tirait-elle pas des villes le seul instrument de sa production, sa cuirasse et ses armes ? Les tissus, les meubles et les bijoux indigènes, les soieries d Italie, les dentelles du Brabant, les fourrures du Nord, les parfums d'Arabie, les fruits du Levant, les épices des Inaes, elle achetait tout aux citadins. Un certain commerce mondial s'était développé; les Italiens sillonnaient la Méditerranée et, au-delà, les côtes de l'Atlantique jusqu 'en Flandre ; malgré l'apparition de la concurrence hollandaise et anglaise, les marchands de la Hanse dominaient encore la mer du Nord et la Baltique. (...) Tandis que la noblesse devenait de plus en plus superflue et gênait toujours plus l'évolution, les bourgeois des villes, eux, devenaient la classe qui personnifiait la progression de la production et du commerce, de la culture et des institutions politiques et sociales »([1] [694])
Le 15e siècle est marqué par l'essor des connaissances qui signe le début de la Renaissance, caractérisée non seulement par la redécouverte des textes antiques, mais aussi par les merveilles d'Orient, comme la poudre, qu'introduisent en Europe les commerçants, et les nouvelles découvertes, comme l'imprimerie et le progrès des techniques de la métallurgie, ou du tissage, permises par le développement de l'économie. Un des secteurs qui sera le plus bouleversé par le développement des connaissances est celui de la navigation, secteur central pour le commerce dans la mesure où il en est le principal vecteur, avec l'invention de nouveaux types de navires, plus solides, plus grands, plus adaptés à la navigation océanique hauturière, et avec le développement d'une meilleure connaissance de la géographie et des techniques de navigation, «De plus, la navigation était une industrie nettement bourgeoise, qui a imprimé son caractère antiféodal même à toutes les flottes modernes.»([2] [695])
Dans le même temps, se sont créés et renforcés les grands Etats féodaux. Cependant, ce mouvement ne traduit pas le renforcement du féodalisme, mais sa régression, sa crise, sa décadence. «Il est évident que (...) la royauté était l'élément de progrès. Elle représentait l’ordre dans le désordre, la nation en formation en face de l’émiettement en Etats vassaux rivaux. Tous les éléments révolutionnaires, qui se constituaient sous la surface de la féodalité en étaient tout aussi réduits à s'appuyer sur la royauté que celle-ci en était réduite à s'appuyer sur eux.» ([3] [696])
L'extension de la domination ottomane sur le Moyen-Orient et l'est de l'Europe, concrétisée par là prise de Constantinople en 1453, débouche sur la guerre avec la République de Venise à partir de 463, et coupe aux commerçants italiens, qui en avaient le quasi-monopole, les routes du commerce fort rémunérateur avec l'Asie. La nécessité économique d'ouvrir de nouvelles routes de commerce vers les trésors des mythiques Indes, Cathay (Chine) et Cipango (Japon), et la perspective de mettre la main sur la source des richesses de Gênes et de Venise, vont constituer le stimulant qui va pousser les royaumes du Portugal et d'Espagne à financer des expéditions maritimes.
Ainsi, durant le 15e siècle, se sont réunies en Europe les conditions et les moyens qui vont permettre le développement de l'exploration maritime du monde :
- développement d'une classe mercantile et industrieuse, la bourgeoisie ;
- développement des connaissances et des techniques, concrétisées notamment sur le plan de la navigation ;
- formation des Etats qui vont soutenir les expéditions maritimes ;
- situation de blocage du commerce traditionnel avec l'Asie, qui va pousser à la recherche de nouvelles routes.
Depuis le début du 15e siècle, Henri le Navigateur, roi du Portugal, finance des expéditions le long des côtes de l'Afrique et y établit les premiers comptoirs (Ceuta en 1415). Dans la foulée, les îles au large de l'Afrique sont colonisées : Madère en 1419, les Açores en 1431, les îles du Cap-Vert en 1457. Ensuite, sous le règne de Jean II, le Congo est atteint en 1482, et le «cap des Tempêtes», futur cap de Bonne Espérance, franchi par Bartolomeo Diaz, ouvre la route des Indes et des épices que Vasco de Gama va suivre en 1498. L'expédition de Colomb est donc une parmi beaucoup d'autres. Dans un premier temps, il avait offert ses services aux Portugais, pour explorer une route occidentale d'accès aux Indes, mais ceux-ci, qui avaient vraisemblablement atteint Terre-Neuve en 1474, les avaient refusés, car ils privilégiaient la recherche d'une route qui contourne l'Afrique par le sud. De même que Colomb a profité de l'expérience des navigateurs portugais, sa propre expérience va bénéficier à John Cabot qui, au service de l'Angleterre, atteint le Labrador en 1496. Pinzon et Lope, pour le compte de l'Espagne, découvrent, en 1499, l'embouchure de l’Orénoque. Cabrai, en tentant de contourner l'Afrique, atteint, en 1500, les côtes du Brésil. En 1513, Balboa peut admirer les vagues de ce qui s'appellera l'océan Pacifique. Et, en 1519, s'élancera l'expédition de Magellan, qui réalisera le premier tour du monde.
«Mais ce besoin de partir au loin à l'aventure, malgré les formes féodales ou à demi féodales dans lesquelles il se réalise au début, était, a sa racine déjà, incompatible avec la féodalité dont la base était l'agriculture et dont les guerres de conquête avaient essentiellement pour but /'acquisition de la terre.»([4] [697])
Ce ne sont donc pas les grandes découvertes qui provoquent le développement du capitalisme, mais au contraire, le développement du capitalisme en Europe qui permet ces découvertes, que ce soit sur le plan géographique ou sur le plan des techniques. Colomb, comme Gutenberg, est le produit du développement historique du capital. Cependant, ces découvertes seront un puissant facteur accélérateur du développement du capitalisme, et de la classe qu'il porte avec lui, la bourgeoisie.
«La découverte de l'Amérique, la circumnavigation de l'Afrique offrirent à la Bourgeoisie naissante un nouveau champ d'action. Les marchés des Indes orientales et de la Chine, la colonisation de l'Amérique, les échanges avec les colonies, l'accroissement des moyens d'échange et des marchandises en général donnèrent au commerce, à la navigation, à l'industrie un essor inconnu jusqu'alors ; du même coup, ils hâtèrent le développement de l'élément révolutionnaire au sein d'une société féodale en décomposition.»([5] [698])
«Les grandes découvertes géographiques ont provoqué, aux 16e et 17 siècles, de profonds bouleversements dans le commerce et accéléré le développement du capital marchand. Il est certain que le passage du mode féodal au mode capitaliste de production en fut lui aussi accéléré, et c'est précisément ce fait qui est à l'origine de certaines conceptions foncièrement erronées. La soudaine extension du marché mondial, la multiplication des marchandises en circulation, la rivalité entre les nations européennes pour s'emparer des produits d'Asie et des trésors d'Amérique, le système colonial enfin, contribuèrent largement à libérer la production de ses entraves féodales. Cependant, dans sa période manufacturière, le mode de production moderne apparaît seulement là où les conditions appropriées se sont formées pendant le moyen Age, que l'on compare la Hollande avec le Portugal, par exemple. Si, au 16e siècle, voire, en partie du moins, au 17e siècle, l'extension soudaine du commerce et la création d'un nouveau marché mondial ont joué un rôle prépondérant dans le déclin de l'ancien mode de production et dans l'essor de la production capitaliste, c'est parce que, inversement, cela s'est produit sur la base du mode de production capitaliste déjà existant. D'une part, le marché mondial constitue la base du capitalisme; de l'autre, c'est la nécessité pour celui-ci de produire à une échelle constamment élargie qui l'incite à étendre continuellement le marché mondial : ici, ce n'est pas le commerce qui révolutionne l'industrie, mais l'industrie qui révolutionne constamment le commerce »([6] [699])
«L'extension du commerce, par suite de la découverte de l'Amérique et de la route maritime des Indes orientales, donna un essor prodigieux à la manufacture et, d'une façon générale, au mouvement de la production. Les nouveaux produits importés de ces régions et, en particulier, les masses d'or et d'argent jetées dans la circulation, modifièrent radicalement la position mutuelle des classes et portèrent un rude coup à la propriété foncière féodale et aux travailleurs ; les expéditions d'aventuriers, la colonisation et, avant tout, la possibilité donnée aux marchés de s'étendre chaque jour, jusqu'à s'amplifier en marché mondial, suscitèrent une nouvelle phase de l'évolution historique.»([7] [700])
De fait, en 1492, avec la découverte de l'Amérique, symboliquement une page se tourne dans 1’histoire de l'humanité. Une nouvelle époque s'ouvre, celle où le capitalisme entame sa marche triomphale vers la domination du monde. «Le commerce mondial et le marché mondial inaugurent au 16e siècle la biographie moderne du capitalisme.» «L'histoire moderne du capital date de la création du commerce et du marché des deux mondes au 16e siècle. » « Bien que les premières ébauches de la production capitaliste aient été faites de bonne heure dans quelques villes de la Méditerranée, l'ère capitaliste ne date que du 16e siècle. » ([8] [701]) C'est l'ouverture de cette ère nouvelle, celle de sa domination, celle du début de la construction du marché mondial capitaliste, que la bourgeoisie fête avec tant de faste aujourd'hui. «La grande industrie a fait naître le marché mondial que la découverte de l'Amérique avait préparé. Le marché mondial a donné une impulsion énorme au commerce, à la navigation, aux voies de communication. En retour, ce développement a entraîné l'essor de l'industrie. A mesure que l'industrie, le commerce, la navigation, les chemins de fer prirent de l'extension, la bourgeoisie s'épanouissait, multipliant ses capitaux et refoulant à l'arrière-plan toutes les classes léguées par le Moyen Age.»([9] [702])
Avant les grandes découvertes du 15e et 16e siècle, évidemment les Incas ou les Aztèques ne sont pas connus, mais les civilisations des Indes, de la Chine, ou du Japon le sont à peine plus, le plus souvent de manière purement mythique, où l'affabulation l'emporte sur la connaissance réelle. La découverte de l'Amérique signe la fin d'une période de l'histoire marquée par le développement multipolaire de civilisations qui s'ignorent, ou communiquent à peine par un commerce relativement restreint. Ce ne sont pas seulement de nouvelles routes maritimes qui sont explorées, ce sont des voies de commerce qui s'ouvrent aux marchandises européennes. Le développement du commerce porte la fin des civilisations séculaires qui se sont développées en dehors de l'Europe, «Par suite du perfectionnement rapide des instruments de production et grâce à l'amélioration incessante des communications, la bourgeoisie précipite dans la civilisation jusqu'aux nations les plus barbares. Le bas prix de ses marchandises est la grosse artillerie avec laquelle elle démolit toutes les murailles de Chine et obtient la capitulation des barbares le plus opiniâtrement xénophobes».([10] [703]) «En exploitant le marché mondial, la bourgeoisie a donné une forme cosmopolite à la production et à la consommation de tous les pays. (...) Les produits industriels sont consommés non seulement dans le pays même, mais dans toutes les parties du monde. Les anciens besoins, satisfaits par les produits indigènes, font place à de nouveaux lui réclament pour leur satisfaction es produits des pays et des climats les plus lointains. L'ancien isolement et l'autarcie locale et nationale font place à un trafic universel, une interdépendance universelle des nations. Et ce qui est vrai de la production matérielle ne l'est pas moins des productions de l'esprit. Les oeuvres spirituelles des diverses nations deviennent un bien commun. Les limitations et les particularismes nationaux deviennent de plus en plus impossibles, et les nombreuses littératures nationales et locales donnent naissance à une littérature universelle.» ([11] [704]) Voilà le rôle éminemment révolutionnaire qu'a joué la bourgeoisie : elle a unifié le monde. En saluant comme elle le fait aujourd'hui la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, premier pas significatif de cette unification par la création du marché mondial, elle célèbre en fait sa propre gloire.
La bourgeoisie aime à honorer ce 16e siècle qui voit son affirmation en Europe et qui annonce sa domination mondiale à venir, celui de la Renaissance, des grandes découvertes, de la floraison des Arts et des connaissances. La classe dominante aime à se reconnaître dans ces hommes de la Renaissance qui symbolisent et annoncent l'élan prodigieux de la technique qui va se concrétiser dans le développement tumultueux des forces productives que va permettre le capitalisme. Elle salue en eux la quête d'universalité qui est sa propre caractéristique qu'elle va imposer au monde en le façonnant à sa propre image. Et c'est une des plus belles images qu'elle puisse donner d'elle-même. Une de celles qui caractérise le mieux le progrès qu'elle a incarné pour l'humanité.
Mais toute médaille a son revers, et au revers de la belle aventure de Colomb qui découvre le Nouveau Monde, il y a la colonisation brutale, l'asservissement impitoyable des indiens, la réalité du capitalisme comme système d'exploitation et d'oppression. Les trésors issus des colonies qui refluent vers la mère patrie pour y fonctionner comme capital sont extorqués «par le travail forcé des indigènes réduits à l'esclavage, par la concussion, le pillage et le meurtre.» ([12] [705])
Colonisation de l'Amérique : la barbarie capitaliste à l'oeuvre
Le capitalisme n'a pas seulement créé les moyens techniques et accumulé les connaissances qui ont rendu possible le voyage de Colomb et la découverte de l'Amérique. Il a aussi fourni le nouveau Dieu, l'idéologie qui va pousser de l'avant les aventuriers qui s'élancent à la conquête des mers.
Ce n'est pas le goût de la découverte qui pousse Colomb de l'avant, c'est l'appât du gain : «L'or est la meilleure chose au monde, il peut même envoyer les âmes au paradis » déclare-t-il, tandis que Cortez surenchérit : «Nous, Espagnols, nous souffrons d'une maladie de coeur dont l'or est le seul remède »
«C'est l'or que les Portugais cherchaient sur la côte d'Afrique, aux Indes, dans tout l'Extrême-Orient ; c'est l'or le mot magique qui poussa les Espagnols à franchir l'océan Atlantique pour aller vers l'Amérique; l’or était la première chose que demandait le blanc, dès qu'il foulait un rivage nouvellement découvert. »([13] [706])
«D'après le rapport de Colomb, le Conseil de Castille résolut de prendre possession d'un pays dont les habitants étaient hors d état de se défendre. Le pieux dessein de le convertir au christianisme sanctifia l'injustice du projet. Mais l'espoir d'y puiser des trésors fut le vrai motif qui décida l'entreprise. (...) Toutes les autres entreprises des Espagnols dans le Nouveau Monde postérieures à celles de Colomb paraissent avoir eu le même motif. Ce fut la soif sacrilège de l'or (...) » ([14] [707]) La grande oeuvre civilisatrice du capitalisme européen prend d'abord la forme a'un génocide. Au nom de cette «soif sacrilège de l'or», les populations indiennes vont être soumises au pillage, au travail forcé, à l'esclavage dans les mines, décimées par les maladies importées par les Conquistadores : syphilis, tuberculose, etc. Las Casas estimait qu'entre 1495 et 1503, plus de trois millions d'hommes avaient disparu sur les îles, massacrés dans la guerre, envoyés comme esclaves en Castille ou épuisés dans les mines ou par d autres travaux : « Qui parmi les générations futures croira cela? Soi-même qui écrit ces lignes, qui j’ai vu de mes yeux et qui n’en ignore rien, je peux difficilement croire qu'une telle chose ait été possible. » En un peu plus d'un siècle, la population indienne va être réduite de 90 % au Mexique, chutant de 25 millions à 1 million et demi, et de 95 % au Pérou. Le trafic d'esclaves, à partir de l'Afrique, va se développer pour compenser le manque de main-d'oeuvre qui découle du massacre. Tout au long du 16e siècle, des centaines de milliers de nègres vont être déportés pour repeupler l'Amérique. Ce mouvement va encore s'intensifier aux siècles suivants. A cela, il faut ajouter l'envoi de milliers d'européens condamnés aux travaux forcés dans les mines et les plantations d'Amérique. «La découverte des contrées aurifères et argentifères de l'Amérique, la réduction des indigènes en esclavage, leur enfouissement dans les mines ou leur extermination, les commencements de conquête et de pillage aux Indes orientales, la transformation de l'Afrique en une sorte de garenne commerciale pour la chasse aux peaux noires, voilà les procédés idylliques d'accumulation primitive qui signalent l'ère capitaliste à son aurore.»([15] [708])
Les milliers de tonnes d'or et d'argent qui se déversent en Europe, en provenance des colonies américaines, et qui vont servir à financer le gigantesque essor du capitalisme européen, sont souillés du sang de millions d'esclaves. Mais cette violence qui caractérise l'entreprise coloniale capitaliste n'est pas réservée en propre à la conquête des terres lointaines, elle caractérise le capitalisme dans tous les aspects de son développement, y compris dans sa terre d'élection l'Europe.
En Europe, le capitalisme s'impose avec la même violence
Les mêmes méthodes utilisées sans retenue pour l'exploitation forcenée des indigènes dans les colonies d'Amérique, d'Afrique et d'Asie sont employées en Europe, pour arracher les paysans à la terre, et les transformer en esclaves salariés dont l'industrie manufacturière en plein essor a besoin. La période de a Renaissance, que la bourgeoisie se plaît à nous présenter sous le jour aimable de la multiplication des découvertes et de l'épanouissement artistique, est, pour des millions de paysans et de travailleurs, celle de la terreur et de la misère.
Le développement du capitalisme se caractérise en Europe par le mouvement d'expropriation des terres ; des millions de paysans vont être jetés sur les routes. «L'expropriation des producteurs immédiats s'exécute avec un vandalisme impitoyable qu'aiguillonnent les mobiles les plus infâmes, les passions les plus sordides et les plus haïssables dans leur petitesse. »([16] [709]) «Les actes de rapine, les atrocités, les souffrances...depuis le dernier tiers du 15e siècle jusqu'à la fin du 18e, forment le cortège de l'expropriation violente des cultivateurs. »([17] [710]) «La spoliation des biens d'église, l'aliénation frauduleuse des domaines de l'Etat, le pillage des terrains communaux, la transformation usurpatrice et terroriste de la propriété féodale ou même patriarcale en propriété moderne privée, la guerre aux chaumières, voilà les procédés idylliques de l'accumulation primitive. Ils ont conquis la terre à l'agriculture capitaliste, incorporé le sol au capital et livré à l'industrie des villes les bras dociles d'un prolétariat sans feu ni lieu. »([18] [711])
« Ainsi il arrive qu'un glouton avide et insatiable, un vrai fléau pour son pays natal, peut s'emparer de milliers d'arpents de terre en les entourant de pieux ou de haies, ou en tourmentant leurs propriétaires par des injustices qui les contraignent à vendre. De façon ou d'autre, de gré ou de force, il faut qu'ils déguerpissent, tous, pauvres gens, coeurs simples, hommes, femmes, époux, orphelins, veuves, mères avec leurs nourrissons et tout leur avoir ; peu de ressources, mais beaucoup de têtes, car l'agriculture a besoin de beaucoup de bras. Il faut qu'ils traînent leurs pas loin de leurs anciens foyers, sans trouver un lieu de repos. Dans d'autres circonstances, la vente de leur mobilier et de leurs ustensiles domestiques eût pu les aider, si peu qu'ils valent ; mais, jetés subitement dans le vide, ils sont forcés de les donner pour une bagatelle. Et, quand ils ont erré çà et là et mangé jusqu'au dernier liard, que peuvent-ils faire autre chose que de voler, et alors, mon Dieu ! d'être pendu avec toutes les formes légales, ou d'aller mendier ? Et alors encore on les jette en prison comme des vagabonds, parce qu'ils mènent une vie errante et ne travaillent pas, eux auxquels personne au monde ne veut donner du travail, si empressés qu'ils soient à s'offrir pour tout genre de besogne. »([19] [712])
«La création d'un prolétariat sans feu ni lieu - licenciés des grands seigneurs féodaux et cultivateurs victimes d'expropriations violentes et répétées - allait nécessairement plus vite que son absorption par les manufactures naissantes. (...) Il en sortit donc une masse de mendiants de voleurs, de vagabonds. De là vers la fin du 15e siècle et pendant tout le 16e, dans l'ouest de l'Europe, une législation sanguinaire contre le vagabondage. Les pères de la classe ouvrière actuelle furent châtiés d'avoir été réduits à l'état de vagabonds et de pauvres.»([20] [713]) Châtiés et de quelle manière ! En Angleterre, sous le règne de Henri VIII (1509-1547), les vagabonds robustes sont condamnés au fouet et à l'emprisonnement. A la première récidive, en plus du fouet de nouveau appliqué, le vagabond a la moitié de l'oreille coupée ; à la seconde récidive, il sera considéré comme félon et exécuté, comme ennemi de l'Etat. Sous le règne de ce roi, 72 000 pauvres hères furent exécutés. Sous son successeur Edouard VII, en 1547, un statut ordonne que tout individu réfractaire au travail sera adjugé comme esclave à la personne qui l'aura dénoncé comme truand. En cas d'une première «absence» de plus de quinze jours, il sera marqué d'un « S » au fer rouge sur la joue et le front, et condamné à l'esclavage à perpétuité ; la récidive, c'est la mort. «Sous le règne aussi maternel que virginal de queen Bess" (la reine Elisabeth, 1572), on pendit les vagabonds par fournées, rangés en longues files. Il ne se passait pas d'année qu'il n'y en eût 300 ou 400 d'accrochés à la potence dans un endroit ou dans un autre. » ([21] [714]) En France, à la même époque, «tout homme sain et bien constitué, âgé de 16 à 60 ans, et trouvé sans moyens d'existence et sans profession, devait être envoyé aux galères ». « Il en est de même du statut de Charles Quint pour les Pays-Bas (1537).»
«C'est ainsi que la population des campagnes, violemment expropriée et réduite au vagabondage, a été rompue à la discipline qu'exige le système du salariat par des lois d'un terrorisme grotesque, par le fouet, la marque au fer rouge, la torture et l'esclavage. »([22] [715])
«Dans tous les pays développés, jamais le nombre de vagabonds n'avait été aussi considérable que dans la première moitié du 16e siècle. De ces vagabonds, les uns s'engageaient pendant les périodes de guerre, dans les armées; d'autres parcouraient le pays en mendiant ; d'autres enfin s efforçaient, dans les villes, de gagner misérablement leur vie par des travaux à la journée ou d’autres occupations non accaparées par les corporations.»([23] [716]) Les paysans spoliés de leurs terres, jetés sur les routes ne vont donc pas seulement être réduits à la mendicité ou obligés de se soumettre à l'esclavage salarié. Ils vont aussi être abondamment employés comme chair à canon. Ces canons et escopettes infiniment plus destructeurs que les piques, épées, masses, arcs et arbalètes des guerres féodales antérieures, réclament une masse toujours plus importante de soldats à sacrifier à l’appétit sanglant du capitalisme naissant ; les progrès scientifiques et technologiques de la Renaissance vont être amplement utilisés dans le perfectionnement des armes et leur production de plus en plus massive. Le 16e siècle est un siècle de guerre : « les guerres et les dévastations étaient des phénomènes quotidiens à l'époque. »([24] [717]) Guerres de conquêtes coloniales, mais aussi et surtout guerres en Europe même : guerres « italiennes » du roi de France, François 1er; guerre des Habsbourg contre les Turcs qui font le siège de Vienne en 1529 et seront défaits par la marine espagnole à la bataille de Lépante en 1571 ; guerre d'indépendance des Pays-Bas contre la domination espagnole à partir de 1568 ; guerre entre 'Espagne et l'Angleterre qui aboutit en 1588 à l'anéantissement par la marine anglaise de la grande Armada espagnole, la plus grande flotte de guerre réunie jusque là; guerres multiples entre les princes allemands ; guerres de religion, etc. Ces guerres sont le produit des bouleversements qui secouent l'Europe avec le développement du capitalisme.
«Même dans ce que l’on appelle les guerres de religion du 16e siècle, il s'agissait avant tout de très positifs intérêts matériels de classe, et ces guerres étaient des luttes de classes, tout autant que les collisions intérieures qui se produisirent plus tard en Angleterre et en France. » ([25] [718]) L'acharnement que vont mettre les Etats nationaux, tout juste sortis du Moyen Age, les princes féodaux et les nouvelles cliques bourgeoises à s'affronter derrière l'étendard des religions, ils vont cependant savoir l'oublier lorsqu'il s agit de réprimer avec la plus extrême férocité les révoltes paysannes que la misère soulève. Face à la guerre des paysans en Allemagne, « Bourgeois et princes, noblesse et clergé, Luther et le Pape s'unirent "contre les bandes paysannes, pillardes et tueuses "([26] [719]). "Il faut les mettre en pièces, les étrangler, les égorger, en secret et publiquement, comme on abat des chiens enragés !" s'écria Luther. » «"C'est pourquoi, mes chers seigneurs, égorgez-les, abattez-les, étranglez-les, libérez ici, sauvez là ! Si vous tombez dans la lutte, vous n'aurez jamais de mort plus sainte !" »([27] [720])
Le 16e siècle n'est pas le siècle d'une liberté naissante comme aime à le faire croire la bourgeoisie. Il est celui d'une nouvelle oppression qui s'installe sur les décombres du féodalisme en déliquescence, celui des persécutions religieuses et de la répression sanglante des révoltes plébéiennes. Ce n'est certainement pas un hasard si la même année où le nouveau monde est découvert, 1492, l'Inquisition est fondée en Espagne. Dans ce pays, des millions de juifs et de musulmans seront christianisés de force et poussés vers l'exode pour fuir la mort qui menace ceux qui résistent. Mais cela n'est pas propre à une Espagne encore profondément marquée par les stigmates du féodalisme représenté par un christianisme catholique intransigeant qui constitue son pendant idéologique ; dans toute l'Europe, les massacres religieux, les pogroms sont monnaie courante, la persécution des minorités religieuses ou raciales une constante, et l'oppression des masses la règle. A l'horreur de l'Inquisition répond en écho la rage de Luther contre les paysans insurgés d'Allemagne : «Les paysans ont de la paille d'avoine dans la tête; ils n'entendent point les paroles de Dieu, ils sont stupides ; c'est pourquoi il faut leur faire entendre le fouet, l arquebuse et c'est bien fait pour eux. Prions pour eux qu'ils obéissent. Sinon, pas de pitié!». Voila comment parlait le père de la Réforme, la nouvelle idéologie religieuse derrière laquelle s'avançait la bourgeoisie dans sa lutte contre le catholicisme féodal.
C'est à ce prix, par ces moyens, que le capitalisme impose sa loi qui permet, en sapant les bases de 'ordre féodal, de libérer les forces productives, de produire des richesses comme jamais l'humanité n'en avait rêvé. Mais si le 16e est une période d'enrichissement gigantesque pour les bourgeois commerçants et les Etats, il n'en est pas de même pour les ouvriers. «Au 16e siècle, la situation des travailleurs s'était, on le sait, fort empirée. Le salaire nominal s'était élevé, mais point en proportion de la dépréciation de l'argent et de la hausse correspondante du prix des marchandises. En réalité, il avait donc baissé. »([28] [721]) En Espagne, les prix sont multipliés par trois ou quatre entre 1500 et 1600 ; en Italie le prix du blé est multiplié par 3,3 entre 1520 et 1599 ; entre le premier et le dernier quart du 16e siècle, les prix sont multipliés par 2,6 en Angleterre et par 2,2 en France. La baisse du salaire réel qui en découle durant cette période est estimée à 50 % ! La bourgeoisie mercantile et les princes régnants s'étaient vite chargés de concrétiser l'idée de Machiavel selon laquelle « Dans un gouvernement bien organisé, l'Etat doit être riche et le citoyen pauvre. » ([29] [722])
« Tantae molis erat ! (Qu'il a fallu de peines) Voilà de quel prix nous avons payé nos conquêtes ; voilà ce qu'il en a coûté pour dégager les « lois éternelles et naturelles » de la production capitaliste (...) chef-d'oeuvre de l'art, création sublime de l'histoire moderne. Si, d'après Augier, c'est "avec des taches naturelles de sang sur une de ses faces" que "l'argent est venu au monde", le capital y arrive suant le sang et la boue par tous les pores. » ([30] [723])
«Les différentes méthodes d'accumulation primitive que l'ère capitaliste fait éclore, se partagent d'abord, par ordre plus ou moins chronologique, entre le Portugal, l'Espagne, la Hollande, la France et l Angleterre, jusqu'à ce que celle-ci les combine toutes, au dernier tiers du 17é siècle, dans un ensemble systématique, embrassant à la fois le régime colonial, le crédit public, la finance moderne et le système protectionniste. Quelques unes de ces méthodes reposent sur l'emploi de la force brutale, mais toutes sans exception exploitent le pouvoir de l'Etat, la force concentrée et organisée de la société, afin de précipiter violemment le passage de l’ordre économique féodal à l’ordre économique capitaliste et d'abréger les phases de transition. Et, en effet, la force est l'accoucheuse de toute vieille société en travail. La force est un agent économique.»([31] [724]) Rosa Luxemburg, à propos des relations entre le capital et les modes de production non capitalistes qui ont «le monde entier pour théâtre », constate :
«Les méthodes employées sont la politique coloniale, le système des emprunts internationaux, la politique des sphères d'intérêts, la guerre. La violence, l'escroquerie, oppression, le pillage se déploient ouvertement, sans masque, et il est difficile de reconnaître les lois rigoureuses du processus économique dans l'enchevêtrement des violences et des brutalités politiques. La théorie libérale bourgeoise n'envisage que l'aspect unique de la "concurrence pacifique", des merveilles de la technique et de l'échange pur de marchandises ; elle sépare le domaine économique du capital de l'autre aspect, celui des coups de force considérés comme des incidents plus ou moins fortuits de la politique extérieure. En réalité, la violence politique est, elle aussi, l'instrument et le véhicule du processus économique; la dualité des aspects de l'accumulation recouvre un même phénomène organique, issu des conditions de la reproduction capitaliste. La carrière historique du capital ne peut être appréciée qu'en fonction de ces deux aspects. Le capital n 'est pas qu 'à sa naissance "dégouttant de sang et de boue par tous les pores", mais pendant toute sa marche à travers le monde; c'est ainsi qu'il prépare, dans des convulsions toujours plus violentes, son propre effondrement. »([32] [725])
Les humanistes bourgeois d'aujourd'hui qui célèbrent avec ferveur et enthousiasme la découverte de l'Amérique voudraient faire croire que la brutalité extrême de la colonisation qui a suivi ne serait qu'un excès du capitalisme naissant, marqué par sa forme mercantile et empêtré dans les rets du féodalisme brutal de l'Espagne, un péché de jeunesse en quelque sorte. Mais cette violence est loin d'avoir été seulement l'apanage des espagnols et des portugais. Ce que les conquistadores ont commencé, les hollandais, les français, les anglais, et la jeune démocratie nord- américaine qui naît de la guerre d'indépendance contre le colonialisme anglais à la fin du 18e siècle, vont le poursuivre : l'esclavagisme durera jusqu'au milieu du 19e siècle, et le massacre des indiens jusqu'à la fin de ce même siècle en Amérique du nord. Et cette violence, comme on l'a vu, n'a pas été réservée au domaine colonial, elle a été générale et marque de son empreinte indélébile toute la vie du capital. Elle s'est perpétuée au-delà de la phase mercantile du capitalisme dans le développement brutal de la grande industrie. Les méthodes expérimentées dans les colonies vont servir à intensifier l'exploitation dans les métropoles. «Dans le même temps que l'industrie cotonnière introduisait en Angleterre l'esclavage des enfants, aux Etats-Unis eue transformait le traitement plus ou moins patriarcal des noirs en un système d'exploitation mercantile. En somme, il fallait pour piédestal à l'esclavage dissimulé des salariés en Europe l esclavage sans phrase dans le Nouveau Monde. »([33] [726])
Mais ce n'est évidemment pas ces hauts faits d'armes, ce massacre impitoyable, cette rapacité criminelle que la bourgeoisie veut fêter avec le 500e anniversaire de la découverte de l'Amérique. Cette réalité barbare du capitalisme, cette empreinte de « boue et de sang » qui marque le capitalisme depuis son origine, elle préfère la rejeter dans les oubliettes de l'histoire, la gommer pour présenter l'image plus convenable des grands progrès, des découvertes géographiques, technologiques et scientifiques, de l'explosion artistique et des douces poésies de la Renaissance.
Un demi millénaire après Colomb : le capitalisme dans sa crise de décadence
Aujourd'hui, la classe dominante, en fêtant la découverte de l'Amérique, entonne donc un hymne à sa propre gloire, utilise ce fait historique pour sa propagande idéologique afin de justifier sa propre existence. Mais depuis la découverte de l'Amérique, depuis l'époque de la Renaissance, les choses ont bien changé.
La bourgeoisie n'est plus la classe révolutionnaire qui postule au remplacement du féodalisme déliquescent et décadent. Depuis longtemps elle a imposé son pouvoir au moindre recoin de la planète. Ce que la découverte de l'Amérique par Colomb annonçait, la création du marché mondial capitaliste, est achevé depuis la fin du 19e siècle. La dynamique de colonisation inaugurée dans le Nouveau Monde s'est étendue à la terre entière, les civilisations pré-capitalistes d'Asie se sont effondrées comme les civilisations précolombiennes d'Amérique sous les coups de boutoir du développement de l'échange capitaliste. Au début du 20e siècle, il n'existe plus de marché pré-capitaliste qui ne soit contrôle ou pris dans les mailles d'une puissance capitaliste ou d'une autre. La dynamique de colonisation qui a permis, par le pillage et 'exploitation forcenée des indigènes, l'enrichissement de l'Europe mercantile et qui a ouvert de nouveaux débouchés à l'industrie capitaliste, permettant ainsi son développement tumultueux, bute sur les limites mêmes de la géographie mondiale. «Du point de vue géographique, le marché est limité : le marché intérieur est restreint par rapport à un marché intérieur et extérieur, qui l'est par rapport au marché mondial, lequel - bien que susceptible d'extension- est lui-même limité dans le temps. »([34] [727]) Confronté à cette limite objective du marché depuis près d'un siècle, le capitalisme ne parvient plus à trouver des débouchés solvables à la mesure de ses capacités de production, et s'enfonce dans une crise inexorable de surproduction. «La surproduction est une conséquence particulière de la loi de la production générale du capital : produire en proportion des forces productives (c'est-à-dire selon la possibilité d'exploiter, avec une masse de capital donnée, la masse maximum de travail) sans tenir compte des limites réelles du marché ni des besoins solvables. .. » ([35] [728])
«A un certain degré de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en collision avec les rapports de production existants, ou avec les rapports de propriété au sein desquels elles s'étaient mues jusqu'alors, et qui n'en sont que l'expression juridique. Hier encore formes de développement des forces productives, ces conditions se changent en de lourdes entraves. »([36] [729]) Cette réalité, qui a déterminé naguère la fin dû système féodal et nécessité le développement du capitalisme comme facteur progressiste de libération des forces productives, s'impose aujourd'hui au système capitaliste lui-même. Il n'est plus source de progrès, il est devenu une entrave au développement des forces productives, il est entré, à son tour, en décadence.
Les conséquences de cet état de fait sont dramatiques pour l'ensemble de l'humanité. A l’époque de Colomb, à l'époque de la Renaissance, et par la suite jusqu'à l'achèvement de la construction du marché mondial, malgré la barbarie, la violence qui caractérisent constamment son développement, le capitalisme est synonyme de progrès car il s'identifie avec la croissance des forces productives, avec l'incroyable explosion de découvertes qui en découlent. Aujourd'hui, tout cela est terminé, le capitalisme est devenu une entrave, un frein au développement des forces productives. Il n'est plus porteur de progrès, et il ne peut plus offrir que son visage barbare.
Le 20e siècle montre amplement cette sinistre réalité : des conflits impérialistes constants, ponctués par deux guerres mondiales, des répressions massives, des famines comme jamais l'humanité n'en avait connues, ont provoqué plus de morts en 80 ans que plusieurs siècles de développement brutal. La crise permanente qui se développe a plongé la majorité des habitants de la planète dans la pénurie alimentaire. Partout dans le monde la population subit un processus de paupérisation accéléré, une dégradation tragique de ses conditions dévie.
De manière caractéristique, alors que le 19e siècle est marqué par le développement de la médecine, le reflux des grandes épidémies, l'accroissement de l'espérance de vie, le dernier quart du 20e siècle voit les grandes épidémies faire un retour en force : choléra, paludisme et, évidemment, le SIDA. Le développement du cancer est le symbole de l'impuissance présente du capitalisme. Comme les grandes épidémies de peste du Moyen Age qui manifestaient le symptôme de la décadence du féodalisme, de la crise de ce système, ces épidémies traduisent aujourd'hui, dramatiquement, la décadence du capitalisme, son incapacité à faire face aux calamités qui plongent l'humanité dans la souffrance. Quant à l'espérance de vie, sa croissance a été freinée, elle stagne maintenant dans les pays développés et régresse depuis des années dans les pays sous-développés.
Les capacités de découvertes, d'innovation, qu'il serait nécessaire de mobiliser pour faire face à ces maux, sont de plus en plus freinées par les contradictions d'un système en crise, avec des crédits de recherche qui se réduisent comme peau de chagrin sous les coupes des budgets d austérité qui partout sont mis en place, l'essentiel du potentiel d'invention est mis au service de la recherche militaire, sacrifié sur l'autel de la course aux armements, consacré à la fabrication d'armes de destruction toujours plus perfectionnées, toujours plus barbares. Les forces de la vie sont détournées au profit de celles de la mort.
Cette réalité du capitalisme devenu décadent, devenu un frein au progrès, s'illustre sur tous les plans de la vie sociale. Cela, la classe dominante doit absolument le masquer, le dissimuler. Pendant des siècles, la démonstration spectaculaire et concrète par la bourgeoisie des progrès, clés inventions, des réalisations merveilleuses dont son système était capable était le support de sa domination idéologique sur la masse des exploités qu elle sou mettait à la loi bestiale du profit. Aujourd'hui, elle ne parvient plus à réaliser de tels exploits. Ainsi, pour ne prendre qu'un exemple significatif, la conquête de la Lune, présentée il y a 20 ans comme la répétition moderne de l'aventure de Colomb, est restée sans lendemain, et la conquête de l'espace, la nouvelle frontière qui devait faire rêver les générations présentes et leur faire croire dans les possibilités toujours renouvelées de l'expansion capitaliste, s'est étiolée sous le poids de la crise économique et des échecs technologiques. Elle apparaît maintenant comme une utopie impossible. L'espérance de voyage vers d'autres planètes et vers les étoiles lointaines, le grand projet, est aujourd'hui réduit à une laborieuse et routinière utilisation mercantile et militaire de la haute atmosphère terrestre. Ce bond de l'humanité hors de son jardin terrestre, le capitalisme est incapable de le réaliser car il n'y a, dans l'espace proche qui nous environne, aucun marché à conquérir, aucun indigène à réduire en esclavage. Il n'y a plus d'Amérique, plus de Christophe Colomb.
Le Nouveau Monde est devenu vieux. L'Amérique du nord qui durant des siècles a représente pour les opprimés du monde entier le monde nouveau, l'échappatoire à la misère et aux persécutions où tout paraissait possible, même si cela relevait pour une grande part de l'illusion, est devenue maintenant le symbole de la décomposition putride du monde capitaliste, de ses contradictions aberrantes. Amérique, symbole par excellence du capitalisme, aujourd'hui, le rêve est terminé, il ne reste que l'horreur.
La bourgeoisie maintenant n'a plus, nulle part dans le monde, de réalisation à présenter pour justifier sa domination scélérate. Elle ne peut, pour justifier sa barbarie présente, que communier dans la messe au temps passé. Voilà le sens de tout ce vacarme autour du voyage de Colomb il y a cinq siècles. Pour redorer son blason terni, la classe dominante n'a plus que le souvenir de sa gloire passée à offrir, et, comme ce passé n'est, malgré tout, pas si magnifique, elle ne peut que l’enjoliver, le parer de toutes les vertus. Comme un vieillard sénile qui radote, la classe dominante est tournée vers ses souvenirs, pour oublier elle-même et, faire oublier du même coup, que le présent lui fait peur car elle n'a plus d'avenir.
JJ, 1/06/1992
[1] [730] Engels, La décadence de la féodalité et l'essor de la bourgeoisie, in La guerre des paysans, Ed. Sociales.
[2] [731] Ibid.
[3] [732] Ibid
[4] [733] Ibid
[5] [734] Marx-Engels, Le Manifeste communiste.
[6] [735] Marx, Le Capital, IV-13, Ed. Sociales.
[7] [736] Marx-Engels, L'idéologie allemande, Ed. Sociales.
[8] [737] Marx, Le Capital VIII-26.
[9] [738] Marx-Engels, Le Manifeste communiste.
[10] [739] Ibid.
[11] [740] Ibid.
[12] [741] Marx, Le Capital, VIII-31.
[13] [742] Engels, La décadence de la féodalité et l'essor de la bourgeoisie.
[14] [743] Adam Smith, cité par Engels, Ibid.
[15] [744] Marx, Le Capital, VIII-31.
[16] [745] Ibid., VIII-32.
[17] [746] Ibid.,VIII-27.
[18] [747] Ibid.
[19] [748] Thomas More : L'Utopie, 1516, cité par Marx dans Le Capital VIII-28.
[20] [749] Marx, Le Capital VIII-28.
[21] [750] Ibid.
[22] [751] Ibid.
[23] [752] Engels, La guerre des paysans, I.
[24] [753] Idib., VII.
[25] [754] Ibid., II.
[26] [755] Titre d'un pamphlet de Luther publié en 1525 en pleine guerre des paysans, note d'Engels.
[27] [756] Engels, La
guerre des paysans, I.
[28] [757] Marx, Le Capital, VIII-28.
[29] [758] Machiavel, Le Prince, 1514.
[30] [759] Marx, Le Capital, VIII-31.
[31] [760] Ibid., VIII-31.
[32] [761] Rosa Luxemburg, L'accumulation du capital, Ed. Maspéro.
[33] [762] Marx, Le Capital VIII-31.
[34] [763] Marx, Matériaux pour l’« économie » "Limites du marché et accroissement de la consommation", Ed. La Pléiade, Economie Tome II.
[35] [764] Ibid.
[36] [765] Marx, Avant-propos à la critique de l'économie politique, Ed. Sociales.
Géographique:
- Etats-Unis [766]
- Amérique Centrale et du Sud [767]
Le communisme n'est pas un bel idéal mais une nécessite matérielle [3e partie]
- 5593 reads
L'aliénation du travail constitue la prémisse de son émancipation
Dans les deux premiers articles de cette série (Revue Internationale n°68 et 69), nous avons commencé par réfuter l'idée que le communisme n'était qu'une invention de quelques « réformateurs du monde », en examinant le développement des idées communistes dans l'histoire, en les montrant comme le produit des forces matérielles qui travaillent en profondeur la société, et surtout comme celui de la rebellion des classes opprimées et exploitées contre les conditions de la domination de classe. Dans le second article en particulier, nous avons montré que la conception marxiste du communisme, loin d'être un schéma sorti du cerveau de Marx, est devenue possible seulement lorsque le prolétariat a gagné des hommes tels que Marx et Engels à la lutte pour son émancipation.
Les deux articles suivants traitent des premières définitions par Marx de la société communiste, et en particulier de sa vision du communisme comme le dépassement de l'aliénation de l'homme. L'article qui suit est donc consacré particulièrement au concept d'aliénation. A première vue, ceci peut paraître s'éloigner du principal argument de cette série d'articles, à savoir que le communisme est une nécessité matérielle imposée par les contradictions inhérentes au mode de production capitaliste. Superficiellement, la question de l'aliénation peut sembler être un facteur purement subjectif, quelque chose qui concerne les idées et les sentiments plus que les bases matérielles solides de la société. Mais, comme nous le développons dans cet article, ce fut le mérite et la force de la conception de Marx de l'aliénation que de faire sortir celle-ci des nuages de la spéculation brumeuse pour en situer les racines dans les rapports sociaux fondamentaux entre les êtres humains. Et, par là-même, Marx fit parfaitement la clarté sur le fait que la société communiste qui peut permettre à l'homme de surmonter son aliénation ne peut venir que d'une transformation totale de ces rapports sociaux, c'est-à-dire de la lutte révolutionnaire de la classe ouvrière.
Sur les buts supérieurs du communisme
On a souvent dit que Marx ne s'est jamais intéressé à dresser des plans pour la société communiste future. C'est vrai dans la mesure où, à la différence des socialistes utopiques qui voyaient le communisme comme une pure invention d'esprits éclairés, Marx avait conscience qu'il serait infructueux de dresser des plans détaillés de la structure et du fonctionnement de la société communiste, puisque cette dernière ne pouvait être que l'oeuvre d'un mouvement social de masse qui devrait trouver les solutions pratiques à la tâche sans précédent de construire un ordre social qualitativement supérieur à tout ce qui avait existé jusqu'alors.
Mais cette opposition parfaitement valable à toute tentative de faire rentrer le mouvement réel de l'histoire dans la camisole de schémas préétablis, ne signifie pas du tout que Marx, ni la tradition marxiste en général, ne trouve aucun intérêt à définir les buts ultimes du mouvement. Au contraire : c'est l'une des fonctions distinctives de la minorité communiste d'avoir « sur le reste de la masse des prolétaires l'avantage de comprendre clairement les conditions, la marche, et les résultats généraux du mouvement prolétarien » (Le Manifeste Communiste). Ce qui distingue le communisme de toutes les sortes d'utopie, ce n'est pas l'absence de vision des « résultats généraux » ultimes, mais le fait qu'il établit les connexions réelles entre ces buts et les « conditions » et la « marche » qui y mènent. En d'autres termes, il base sa vision de la société future sur une analyse complète des conditions de la société existante ; de sorte que, par exemple, la revendication de l'abolition de l'économie de marché ne découle pas d'une objection purement morale à l'achat et à la vente, mais de la reconnaissance qu'une société fondée sur une production généralisée de marchandises est condamnée à s'écrouler sous le poids de ses contradictions internes, posant de ce fait la nécessité d'une forme d'organisation sociale supérieure, basée sur la production pour l'usage. En même temps, le marxisme fonde sa conception du chemin, de la ligne de marche vers cette forme supérieure, sur les expériences réelles de la lutte du prolétariat contre le capitalisme. Ainsi, alors que le mot d'ordre de dictature du prolétariat est apparu au tout début du mouvement marxiste, la forme que cette dictature devait prendre, a été précisée par les grands événements révolutionnaires de l'histoire de la classe ouvrière, en particulier la Commune de Paris et la Révolution d'Octobre 1917.
Sans une vision générale du type de société à laquelle il vise, le mouvement communiste serait aveugle. Au lieu d'être l'incarnation la plus haute de cette capacité humaine, unique, de prévoir, d'« ériger sa structure en imagination avant de l'ériger dans la réalité »,[1] [768] il ne serait rien de plus qu'une réaction instinctive à la misère capitaliste. Dans sa bataille permanente contre la domination de l'idéologie bourgeoise, il n'aurait aucun pouvoir de convaincre les ouvriers et toutes les autres couches opprimées de la société que leur seul espoir réside dans la révolution communiste, que les problèmes apparemment insolubles posés par la société capitaliste peuvent trouver des solutions pratiques dans une société communiste. Et une fois la transformation révolutionnaire véritablement commencée, il n'aurait aucun moyen de mesurer le progrès fait vers son but final.
Cependant, nous ne devons pas oublier qu'il y a une distinction à faire entre ces buts finaux, les « résultats généraux » ultimes, et la « marche » qui y mène. Comme on l'a déjà dit, cette dernière est sujette a une clarification constante par l'expérience pratique du mouvement de la classe : la Commune de Paris a clarifié pour Marx et Engels le fait que le prolétariat devait détruire l'ancien appareil d'Etat avant d'ériger son propre appareil de pouvoir ; le surgissement des soviets en 1905 et 917 a convaincu Lénine et Trotsky qu'ils étaient « la forme enfin trouvée de la dictature du prolétariat », et ainsi de suite. D'un autre côté, si l'on considère les buts suprêmes du communisme, on ne peut que s'en tenir à des conclusions très générales basées sur la critique de la société capitaliste, jusqu'au moment où le mouvement réel aura commencé à les mettre à l'ordre du jour en pratique. C'est d'autant plus vrai que la révolution prolétarienne est, par définition, d'abord une révolution politique, et ensuite une transformation économique et sociale. Comme les exemples authentiques de révolution de la classe ouvrière ne sont pas allés, jusqu'ici, au-delà de la conquête du pouvoir politique dans un pays donné, les leçons qu'ils nous ont apportées, sont fondamentalement liées aux problèmes politiques des formes et des méthodes de la dictature du prolétariat (rapports entre parti, classe et Etat, etc.) ; ce n'est que de façon limitée qu'ils nous ont donné des orientations précises sur les mesures sociales et économiques qui doivent être prises pour établir les fondements de la production et de la distribution communistes, et cela, en grande partie de façon négative (par exemple que l'étatisation n'est pas la socialisation). En ce qui concerne la société communiste pleinement développée qui n'émergera qu'après une période de transition plus ou moins longue, l'expérience historique de la classe ouvrière n'a pu et ne pouvait apporter d'éclaircissement qualitatif pour la description par les communistes d'une telle société.
Ce n'est donc pas par hasard si les descriptions les plus inspirées et les plus inspirantes des buts suprêmes du communisme apparaissent au début de la vie politique de Marx, coïncidant avec son adhésion à la cause du prolétariat, avec son identification explicite comme communiste, en 1844.([2] [769]) Ces premières descriptions de ce que pourrait être l'humanité une fois que les entraves du capitalisme et des sociétés de classe précédentes seront détruites, ont été rarement améliorées dans les écrits ultérieurs de Marx. Nous répondrons brièvement à l'argument selon lequel Marx a abandonné ces premières définitions comme de simples folies de jeunesse. Mais pour le moment nous voulons simplement dire que l'approche que Marx a eue de ce problème, est entièrement cohérente avec l'ensemble de sa méthode : sur la base d'une critique profonde de l'appauvrissement et de la déformation de l'activité humaine dans les conditions sociales existantes, il a déduit ce qui était nécessaire pour nier et dépasser cet appauvrissement. Mais une fois qu'il eût établi les buts ultimes du communisme, ce qui était essentiel était de se plonger dans le mouvement prolétarien naissant, dans la dureté et le vacarme de ses luttes économiques et politiques, qui seules avaient la capacité de transformer ces buts lointains en réalité.
Les Manuscrits économiques et philosophiques et la continuité de la pensée de Marx
Pendant l'été 1844, Marx vivait à Paris, entouré des nombreux groupes communistes qui avaient constitué un élément si important pour le gagner à la cause communiste. C'est là qu'il écrivit les Manuscrits économiques et philosophiques aujourd'hui célèbres, auxquels il s'est référé ultérieurement comme un travail de base pour les Grundrisse et Le Capital lui-même. C'est là qu'il a tenté de maîtriser l'économie politique du point de vue de la classe exploitée, faisant ses premières incursions dans des questions telles que le salaire, le profit, la rente foncière et l'accumulation du capital, questions qui devaient occuper une place si importante dans ses travaux ultérieurs ; même si, dans ses remarques introductives aux Manuscrits, il annonce le plan d'une série monumentale de brochures dont la partie économique ne constituait que le début. Dans ces mêmes carnets de notes, on trouve aussi la tentative la plus globale de Marx d'en finir avec la philosophie idéaliste hégélienne qui avait à présent perdu son utilité, ayant été « remise sur ses pieds » par l'émergence d'une théorie matérialiste de l'évolution historique. Mais les Manuscrits sont certainement mieux connus pour la façon dont ils ont traité l'aliénation du travail et quoique dans une moindre mesure pour l'effort de définir le type d'activité humaine qui le remplacerait dans la future société communiste.
Les Manuscrits économiques et philosophiques n'ont pas été publiés avant 1927: cela signifie qu'ils n'étaient pas connus pendant la période révolutionnaire la plus cruciale de l'histoire du mouvement ouvrier ; leur publication a coïncidé avec les derniers souffles de la vague révolutionnaire qui a ébranlé le monde capitaliste durant la décennie qui a suivi 1917. 1927 est l'année qui a vu à la fois la défaite de la révolution en Chine et celle de l'opposition de Gauche dans les Partis Communistes ; un an plus tard, l'Internationale Communiste signait sa propre fin en adoptant l'infamante théorie du « socialisme en un seul pays ». Le résultat de cette ironie de l'histoire est que c'est la bourgeoisie et non le mouvement prolétarien qui a eu le plus à dire sur les Manuscrits et leur signification. Il y eut en particulier une grande controverse, dans les antichambres stériles de la « théorie » académique bourgeoise de gauche, sur la rupture supposée du « jeune Marx » avec le « vieux Marx ». Comme Marx n'a jamais publié lui-même les Manuscrits et qu'il y a traité de questions qui semblaient peu développées dans ses écrits ultérieurs, certains ont supposé que les Manuscrits représentaient un Marx immature, feuerbachien, hégélien même, rejeté de façon décisive par le Marx ultérieur, plus mûr et plus scientifique. Les principaux tenants de ce point de vue sont... les staliniens, et surtout Althusser, cet obscurantiste achevé. Selon eux, ce que Marx a surtout abandonné, c'est la conception de la nature humaine qu'on trouve dans les Manuscrits, et en particulier la notion d'aliénation.
Il est évident qu'un tel point de vue ne peut être considéré séparément de la nature de classe du stalinisme. La critique du travail aliéné dans les Manuscrits est liée de façon intime à la critique du « communisme de caserne », un communisme dans lequel la communauté devient un capitaliste abstrait payant des salaires, vision du communisme qui fut défendue par d'authentiques courants prolétariens immatures comme les Blanquistes à l'époque.([3] [770]) Marx condamne franchement de telles visions du communisme dans les Manuscrits parce que, pour lui, le communisme n'avait de sens que s'il en finissait avec la suppression des capacités créatrices de l'homme et transformait la corvée du travail en activité libre et joyeuse. Pour leur part, les staliniens se définissent par la notion selon laquelle le socialisme va de pair avec un régime de dénuement et d'exploitation forcenée, personnifié par les conditions dans les usines et les camps de travail des soi-disant pays « socialistes ». Il ne s'agit plus là d'une expression immature du mouvement prolétarien, mais de la pleine apologie de la contre-révolution capitaliste. C'est clairement du travail aliéné qui existait dans le « socialisme réel » de l'Est : il n'est donc pas surprenant que les staliniens ne soient pas très à l'aise avec l'ensemble de cette notion. Dans le même sens, la vision que défend Marx, dans les Manuscrits, des rapports entre l'homme et la nature ne concorde pas du tout avec la catastrophe écologique qu'a entrainée1' « interprétation » stalinienne de cette question. Sur ces deux aspects du travail aliéné et des rapports de l'homme à la nature, la vision du communisme élaborée dans les Manuscrits sape l'imposture du « socialisme » stalinien.
A l'opposé de la gamme bourgeoise, plusieurs variétés d'humanisme libéral, y compris les théologiens protestants et la crème des sociologues, ont aussi tenté de séparer les « deux Marx ». Seulement cette fois, ils ont nettement préféré le jeune Marx romantique, idéaliste et généreux, à l'auteur froid et matérialiste du Capital. Mais au moins de telles interprétations ne se réclament pas du marxisme.
Les écrits de Bordiga dans les années 1950 sont parmi les rares tentatives du mouvement prolétarien de faire quelques commentaires sur les Manuscrits, et ils rejettent clairement cette division artificielle : « Un autre lieu commun très vulgaire est que Marx est hégélien dans les écrits de jeunesse, que c'est seulement après qu'il fut le théoricien du matérialisme historique, et que, plus vieux, il fut un vulgaire opportuniste. »[4] [771] Contre de tels clichés, Bordiga a défendu de façon juste la continuité de la pensée de Marx à partir du moment où il a clairement rejoint la cause du prolétariat. Mais ce faisant, et en réaction aux diverses théories du moment qui soit proclamaient l'obsolescence du marxisme, soit tentaient de l'épicer de divers ajouts tels que l'existentialisme, Bordiga s'est trompé sur cette continuité et l'a prise pour « le monolithisme de tout le système depuis sa naissance jusqu'à la mort de Marx et même après lui (concept fondamental de l'invariance, refus fondamental de l'évolution enrichissante de la doctrine du parti). »[5] [772] Cette conception réduit le marxisme à un dogme statique comme l'Islam ; pour le vrai musulman, le Coran est le verbe de. Dieu de façon précise, parce que pas un point, pas une virgule n'a été changé depuis qu'il fut pour la première fois « dicté ». C'est une notion dangereuse qui a fait oublier aux bordiguistes les enrichissements réels apportés par le courant même dont ils proviennent, la Fraction de Gauche italienne, et les a faits retourner aux positions rendues obsolètes par l'ouverture de l'époque du déclin capitaliste. Par rapport au sujet en cause, les Manuscrits, cela n'a pas de sens. Si l'on compare les Manuscrits aux Grundrisse, qui constituaient si on veut le second brouillon du même grand travail, la continuité est absolument claire : à l'encontre de l'idée selon laquelle Marx a abandonné le concept d'aliénation, le mot et le concept apparaissent encore et encore dans ces travaux de Marx « mûr », tout comme ils le font dans Le Capital lui-même. Mais les Grundrisse représentent sans aucun doute un enrichissement par rapport aux Manuscrits. Ils clarifient par exemple certaines questions fondamentales telles que la distinction entre le travail et la force de travail, et sont donc capables de découvrir le secret de la plus-value. Dans son analyse du phénomène de l'aliénation, Marx est capable de poser le problème de façon plus historique que dans ses travaux précédents, parce qu'il se base sur une étude approfondie des modes de production qui ont précédé le capitalisme. Pour nous, poser correctement le problème, c'est affirmer à la fois la continuité et l'enrichissement progressif de la « doctrine du parti », parce que le marxisme est tout à la fois une tradition profondément historique et une méthode vivante.
Le concept d'aliénation : du mythe à la science
L'idée que l'homme est devenu étranger ou aliéné par rapport à ses propres pouvoirs véritables, est très ancienne. Mais dans toutes les sociétés qui ont précédé le capitalisme, le concept prenait forcément des formes mythiques ou religieuses, surtout dans le mythe de la chute de l'homme d'un paradis originel, dans lequel il jouissait de pouvoirs divins.
Le mythe précède la société de classes et constitue un élément central des croyances et des pratiques des sociétés communistes primitives. Les Aborigènes australiens, par exemple, croyaient que leurs ancêtres étaient les êtres créateurs prodigieux de « l'âge d'or », et que depuis la fin de l'époque mythique les êtres humains avaient considérablement perdu de leur puissance et de leur connaissance.
Tout comme la religion qui en descend, le mythe est à la fois une protestation contre l'aliénation et une expression de celle-ci ; dans le mythe comme dans la religion, l'homme projette des pouvoirs qui sont réellement les siens sur des êtres surnaturels en dehors de lui. Mais le mythe est l'idéologie caractéristique d'avant l'émergence des divisions de classes. Au cours de cette époque historique immensément longue, l'aliénation n'existe qu'à l'état embryonnaire : les conditions brutales de la lutte pour la survie imposent la domination brutale de la tribu sur l'individu, au travers de traditions et coutumes immuables, léguées par les ancêtres mythiques. Mais ce n'est pas encore un rapport d'exploitation de classe. Ceci se reflète sur le plan idéologique dans un deuxième aspect des croyances en l'âge d'or mythique : L’âge d'or peut être périodiquement restauré par les fêtes collectives, et chaque membre de la tribu conserve une identité secrète avec les ancêtres de l'époque. Bref, l'homme ne se sent pas encore totalement étranger à ses propres pouvoirs créateurs.
Avec la dissolution de la communauté primitive par le développement de la société de classes, l'apparition de l'aliénation à proprement parler se reflète dans l'émergence d'une conception strictement religieuse. Dans des sociétés antiques telles que l'Egypte et la Mésopotamie, la forme des vieilles fêtes périodiques du renouveau est maintenue ; mais désormais les masses sont plutôt les spectateurs d'un rituel élaboré et joué par les prêtres avec pour but de glorifier un despote divinisé. Un gouffre s'est ouvert entre l'homme et les dieux, reflétant la séparation croissante de l'homme avec l'homme.
Dans les religions judéo-chrétiennes, les conceptions cycliques profondément conservatrices de la société asiatique sont remplacées par la notion révolutionnaire que le drame de la chute de l'homme et de sa rédemption est une progression historique à travers le temps. Mais avec ce développement, c'est un fossé quasiment infranchissable entre l'homme et Dieu qui s'est ouvert : Dieu ordonne à Adam de quitter l'Eden, précisément à cause du pêché d'avoir tenté de s'élever au niveau de Dieu.
Cependant, dans les traditions religieuses occidentales ont émergé beaucoup de courants ésotériques et mystiques qui virent la Chute non comme la punition de l'homme pour avoir désobéi à la figure lointaine de Dieu, mais comme un processus cosmique dynamique dans lequel l'Esprit originel s'est « oublié » lui-même et a plongé dans le monde de la division et de la réalité apparente. Dans cette conception, la séparation entre le monde créé et le fondement ultime de l'être n'était pas absolue : il restait la possibilité pour le véritable initié de recouvrer son unité sous-jacente avec l'Esprit suprême. De telles visions étaient le fait des Kabbalistes juifs par exemple et de leurs nombreuses ramifications chrétiennes, alchimistes et hermétistes. Il est significatif que de tels courants, qui sont très souvent tombés dans les hérésies du panthéisme et de l'athéisme, devinrent de plus en plus influents avec l'effondrement de l'orthodoxie catholique-féodale, et furent, comme le montre Engels dans La guerre des paysans en Allemagne, souvent associés aux mouvements sociaux subversifs dans la période du capitalisme naissant.
Il existe un lien précis, bien que rarement exploré, entre la pensée de Hegel et certaines de ces traditions ésotériques, en particulier dans les travaux du Protestant radical, artisan visionnaire auquel Marx se réfère lui-même une fois comme à « l'inspiré Jakob Boehme. »[6] [773] Mais Hegel était également le théoricien le plus avancé de la bourgeoisie révolutionnaire, et par conséquent l'héritier de la philosophie rationaliste des Grecs Anciens. Comme tel, il fit une tentative grandiose de détacher l'ensemble du problème de l'aliénation du terrain du mythe et du mysticisme, et de le poser de façon scientifique. Pour Hegel, cela signifiait que ce qui avait été ésotérique autrefois, enfermé dans les recoins mentaux secrets de quelques privilégiés, devait être appréhendé consciemment, clairement et collectivement : « Seulement ce qui est parfaitement déterminé dans sa forme, est en même temps exotérique, compréhensible et capable d'être appris et possédé par tous. L'intelligibilité est la forme sous laquelle la science s'offre à chacun et est la route qui lui est ouverte pour être évidente pour tous. »[7] [774] Avec Hegel donc, il y a une tentative de saisir la séparation de l'homme d'un point de vue historique et consciemment dialectique, et Marx reconnaît même qu'il a apporté des éclaircissements sur le rôle-clé du travail dans l'auto-génèse de l'homme. Et cependant, Marx, à la suite de Feuerbach, a souligné que le système hégélien n'a fait que quelques pas dans le sens de la science avant de retomber dans le mysticisme. On peut voir aisément que la notion hégélienne de l'histoire comme « aliénation de l'Idée Absolue » est une nouvelle forme de la version kabbalistique de la chute cosmique originelle. Pour Marx au contraire, la question n'était pas l'histoire de Dieu, mais l'histoire « du devenir de la nature pour l'homme »[8] [775] ; elle n'était pas la chute d'une conscience originelle dans le royaume vulgaire de la matière, mais l'ascension matérielle de l'être inconscient vers l'être conscient.
Pour autant que Hegel ait traité l'aliénation comme un aspect de l'expérience concrète humaine, celle-ci est là encore devenue a-temporelle et a-historique, du fait qu'elle était posée comme une catégorie absolue du rapport de l'homme au monde extérieur : selon les termes de Marx, Hegel a mélangé l'objectivation, la capacité humaine de séparer le sujet de l'objet, avec l'aliénation. En conséquence, si cette séparation entre l'homme et le monde avait une chance de pouvoir être un jour surmontée, elle ne pouvait l’être qu'à partir du monde abstrait de la pensée, le royaume propre du philosophe qui, pour Marx, n'était lui-même qu'un reflet de l'aliénation.
Mais Marx n'a pas abandonné le concept d'aliénation des Hégéliens. Au contraire, il a tenté de le restaurer dans ses fondements matériels en situant ses origines dans la société humaine. Feuerbach avait expliqué que l'Idée Absolue, comme toutes les manifestations précédentes de Dieu, était en fait la projection de l'homme incapable de réaliser sa propre puissance, de l'homme étranger a lui-même. Mais Marx est allé plus loin, en reconnaissant le fait que « si l'assise profane se détache d’elle-même et se fixe dans les nues, tel un royaume indépendant, cela ne peut s'expliquer que par le déchirement de soi et par la contradiction à soi-même de cette assise profane. »[9] [776] Le concept d'aliénation reste vital pour Marx parce qu'il est devenu une arme de son assaut contre la « base séculaire », c'est-à-dire la société bourgeoise et, par-dessus tout, l'économie politique bourgeoise.
Confronté à la marche triomphante de la société bourgeoise, à tous les « miracles du progrès » qu'elle a apportés, Marx a utilisé le concept d'aliénation pour montrer ce que tout ce progrès signifiait pour les véritables producteurs de richesse, les prolétaires. Il a montré que la richesse croissante de la société capitaliste signifiait l'appauvrissement croissant de l'ouvrier. Pas seulement son appauvrissement physique, mais aussi l'appauvrissement de sa vie intérieure : « (...) Plus l'ouvrier se dépense dans son travail, plus le monde étranger, le monde des objets qu'il crée en face de lui devient puissant, et (...) plus il s'appauvrit lui-même, plus son monde intérieur devient pauvre, moins il possède en propre. C'est exactement comme dans la religion. Plus l'homme place en Dieu, moins il conserve en lui-même. L'ouvrier met sa vie dans l'objet, et voilà qu'elle ne lui appartient plus, elle est à l'objet. Plus cette activité est grande, plus l'ouvrier est sans objet. Il n'est pas ce qu'est le produit de son travail. Plus son produit est important, moins il est lui-même. La dépossession de l'ouvrier au profit de son produit signifie non seulement que son travail devient un objet, une existence extérieure, mais que son travail existe en dehors de lui, indépendamment de lui, étranger à lui, et qu'il devient une puissance autonome face à lui. La vie qu'il a prêtée à l'objet s'oppose à lui, hostile et étrangère. »[10] [777]
Là l'approche de Marx est évidente : contre les abstractions de Hegel (qui ont pris une forme caricaturale dans le travail des Jeunes Hégéliens autour de Bruno Bauer), Marx a enraciné le concept d'aliénation dans les « faits économiques présents. »[11] [778] Il montre que l'aliénation est un élément irréductible du système de travail salarié qui n'a d'autre sens que ,plus 1’ouvrier produit, plus il enrichit non lui-même, mais le capital, cette puissance étrangère qui se dresse au-dessus de lui.
Aussi l'aliénation cesse-t-elle d'être un simple état d'esprit, un aspect inhérent du rapport de l'homme au monde (auquel cas elle ne pourrait jamais être surmontée) et devient un produit particulier de l'évolution historique de l'homme. Elle n'a pas commencé avec le capitalisme : le travail salarié, comme Marx le souligne dans les Grundrisse, est simplement la forme finale et la plus haute de l'aliénation. Mais parce qu'elle est sa forme la plus avancée, elle fournit la clé de la compréhension de l'histoire de l'aliénation en général, tout comme l'apparition de l'économie politique bourgeoise rend possible l'examen des fondements des modes de production précédents. Sous les conditions bourgeoises de production, les racines de l'aliénation sont mises à nu : elles ne résident pas dans les nuages, dans la seule tête de l'homme, mais dans le processus du travail, dans les rapports pratiques et concrets entre 1’homme et l'homme, et l'homme et la nature. Ayant fait cette percée théorique, il devient alors possible de montrer comment l'aliénation de l'homme dans l'acte de travail s'étend à toutes ses autres activités ; de même, cela ouvre la possibilité d'investigation des origines de l'aliénation et de son évolution à travers les précédentes sociétés humaines, bien qu'il faille dire que Marx et le mouvement marxiste n'ont pas fait plus qu'établir les prémisses d'une telle investigation, puisque d'autres tâches ont nécessairement eu priorité sur celle-ci.
Les quatre facettes de l'aliénation
Bien que la théorie de Marx de l'aliénation soit loin d'être complète, sa façon de la traiter dans les Manuscrits montre à quel point il était préoccupé qu'elle ne reste pas dans le vague et l'incertain. Dans le chapitre sur « le travail aliéné », il examine donc le problème de façon très précise, identifiant quatre aspects distincts mais interconnectés de l'aliénation.
Le premier aspect est celui qui est traité dans la citation précédente des Manuscrits et résumé brièvement dans un autre passage : « Le rapport de l'ouvrier au produit du travail comme à un objet étranger exerçant son pouvoir sur lui. Ce rapport est en même temps le rapport au monde extérieur des sens, aux objets de la nature, en tant que monde étranger opposé à lui de façon hostile. »[12] [779] Dans les conditions d'aliénation, les produits des mains mêmes des hommes se retournent contre eux, et bien que cela s'applique aux précédents modes d'exploitation de classe, cela atteint un sommet sous le capitalisme qui est une puissance complètement impersonnelle et inhumaine, créée par le travail des hommes mais échappant complètement à leur contrôle, et plongeant périodiquement l'ensemble de la société dans des crises catastrophiques. Cette définition s'applique évidemment à l'acte immédiat de production : le capital, sous la forme des machines et de la technologie, domine l'ouvrier, et au lieu d'augmenter ses loisirs, intensifie son épuisement. De plus, la critique du travail salarié comme étant, par définition, du travail aliéné défie toutes les tentatives de la bourgeoisie de séparer les deux : par exemple, les thèmes frauduleux, populaires dans les années 1960, qui avaient pour but de créer « la satisfaction dans le travail » en réduisant l'extrême spécialisation caractéristique du travail à l'usine, en instituant des équipes de travail, la « participation des ouvriers » et tout le reste. Du point de vue marxiste, rien de tout cela n'altère le fait que les ouvriers créent des objets sur lesquels ils n'ont aucun contrôle et qui ne servent qu'à enrichir d'autres à leurs dépens, et cela reste vrai, même si les ouvriers s'estiment « bien payés ». Mais on peut aussi faire une application bien plus large de toute cette problématique au processus immédiat de production. Il est de plus en plus clair, par exemple, en particulier dans la période de décadence du capitalisme, que tout l'appareil politique, bureaucratique et militaire du capital a développé une vie propre hypertrophiée, qu'il écrase les êtres humains comme un énorme monstre. La bombe atomique est l'exemple-type de cette tendance : dans une société réglée par des forces inhumaines, les forces du marché et de la concurrence capitaliste, ce que
l'homme produit a tellement échappé à son contrôle qu'il en est menacé d'extinction. On peut dire la même chose du rapport de l'homme et de la nature dans le capitalisme : ce dernier n'a pas en lui-même produit l'aliénation entre l'homme et la nature, qui a une histoire bien plus ancienne, mais il la porte à son point ultime. En « perfectionnant » l'hostilité entre l'homme et la nature, en réduisant l'ensemble du monde naturel au statut de marchandise, le développement de la production capitaliste menace aujourd'hui de détruire la matrice même de la vie planétaire.[13] [780]
La seconde dimension de l'aliénation décrite par Marx est le rapport de l'ouvrier à « l'acte de production, à l'intérieur de l'activité productrice elle-même. Comment l'ouvrier ne serait-il pas étranger au produit de son activité si, dans l'acte même de la production, il ne devenait étranger à lui-même ? ». Dans ce processus, « le travail n'appartient pas à l'être (de l'ouvrier) ; dans son travail, l'ouvrier ne s'affirme pas, mais se nie ; il ne s'y sent pas satisfait mais malheureux ; il n'y déploie pas une libre énergie physique et intellectuelle, mais mortifie son corps et ruine son esprit. C'est pourquoi l'ouvrier n'a le sentiment d'être à soi qu'en dehors du travail ; dans le travail, il se sent extérieur à soi-même. Il est lui quand il ne travaille pas et, quand il travaille, il n'est pas lui. Son travail n'est pas volontaire, mais contraint. Travail forcé, il n'est pas la satisfaction d'un besoin, mais seulement un moyen de satisfaire des besoins en dehors du travail. La nature aliénée du travail apparaît nettement dans le fait que, dès qu'il n'existe pas de contrainte physique ou autre, on fuit le travail comme la peste »[14] [781].
N'importe qui ayant un emploi « normal » dans la vie quotidienne capitaliste, mais surtout n'importe qui ayant déjà travaillé dans une usine, peut se reconnaître et reconnaître ses sentiments dans ces mots. Dans une société capitaliste qui a depuis longtemps établi sa domination sur le monde, le fait que le travail doive être une expérience détestable pour la vaste majorité de l'humanité, est présenté quasiment comme une loi de la nature. Mais pour Marx et le marxisme, il n'y avait et il n'y a rien de naturel là-dedans. Les précédentes formes de production (par exemple le travail communal primitif, le travail artisanal) n'avaient pas réalisé ce divorce entre l'acte de production et la jouissance des sens ; ceci en soi est la preuve que la séparation totale réalisée par le capital est un produit historique et non naturel. Armé de cette connaissance, Marx a été capable de dénoncer la qualité véritablement scandaleuse de la situation apportée par le travail salarié. Et cela l'a amené à l'autre aspect de l'aliénation : l'aliénation par rapport à la vie de l'espèce.
Ce troisième aspect de la théorie de l'aliénation de Marx est certainement le plus complexe, le plus profond et le moins compris. Dans cette partie du même chapitre, Marx affirme que l'homme est devenu étranger à sa nature humaine. Pour Althusser et d'autres critiques du « jeune Marx », de telles idées sont la preuve que les Manuscrits de 1844 ne représentent pas une rupture décisive avec Feuerbach et la philosophie radicale en général. C'est faux. Ce que Marx rejetait chez Feuerbach, c'était la notion d'une nature humaine fixe et immuable. Puisque la nature elle-même n'est pas fixe et immuable, c'est clairement une impasse théorique, en fait une forme d'idolâtrie. La conception de Marx de la nature humaine n'est pas celle-là. Elle est dialectique : l'homme est toujours une partie de la nature, la nature est « le corps inorganique de l'homme » comme il le dit dans un passage des Manuscrits ; l'homme est toujours une créature d'instinct, comme il le dit ailleurs dans le même ouvrage.[15] [782] Mais l'homme se distingue de toutes les autres créatures naturelles par sa capacité à transformer son corps à travers l'activité créatrice consciente, la nature la plus essentielle de l'Homme, son être générique, comme le dit Marx, qui est celle de créer, de transformer la nature.
Les critiques vulgaires du marxisme proclament parfois que Marx a réduit l'homme à 1' « homo faber », une simple bête de somme, une catégorie économique. Mais ces critiques sont aveuglés par la proximité du travail salarié, par les conditions de la production capitaliste. En définissant l'homme comme producteur conscient, Marx l'élevait en fait aux portes du paradis : car qui est Dieu sinon l'image étrangère de l'homme vraiment homme, de l'homme créateur ? Pour Marx, l'homme n'est vraiment l'homme que lorsqu'il produit dans un état de liberté. L'animal « ne produit que sous l'empire d'un besoin physique immédiat, (...) l'homme produit tandis qu'il est libéré de tout besoin physique et ne produit vraiment que lorsqu'il en est libéré. »[16] [783]
C'est certainement l'une des prises de position les plus radicales que Marx ait jamais prise. Alors que l'idéologie capitaliste voit le fait que le travail se présente sous une forme de torture mentale ou physique comme un fait éternel de la nature, Marx dit que l'homme est un homme, non seulement quand il produit, mais quand il produit pour la pure joie de produire, quand il est libre du fouet du besoin physique immédiat. Autrement, l'homme vit une existence purement animale. Engels a écrit la même chose bien des années plus tard, dans la conclusion de Socialisme utopique ou socialisme scientifique, lorsqu'il dit que l'homme ne se distinguera pas vraiment du reste du genre animal tant qu'il ne sera pas entré dans le royaume de la liberté, aux stades les plus avancés de la société communiste.
On pourrait même dire que le travail aliéné réduit l'homme à un niveau inférieur à celui des animaux : « En arrachant à l'homme l'objet de sa production, le travail aliéné lui arrache sa vie générique, sa véritable objectivité générique, et en lui dérobant son corps non organique, sa nature, il transforme en désavantage son avantage sur l'animal. De même, en dégradant au rang de moyen la libre activité créatrice de l'homme, le travail aliéné fait de sa vie générique un instrument de son existence physique »[17] [784]
En d'autres termes, la capacité de l'homme au travail conscient est ce qui le rend humain, ce qui le sépare de toutes les autres créatures. Mais sous les conditions d'aliénation, cette avance devient un recul : la capacité de l'homme de séparer le sujet de 1’objet, qui est un élément fondamental de la conscience spécifiquement humaine, est pervertie en un rapport d'hostilité à la nature, au monde « objectif » des sens. En même temps, le travail aliéné, par dessus tout le travail salarié capitaliste, a transformé la caractéristique la plus essentielle et la plus élevée de l'homme, son activité vitale consciente, libre, spontanée, en de simples moyens de subsistance, l'a transformée en fait en quelque chose qui s'achète et se vend sur le marché. En bref, la « normalité » de travailler sous le capitalisme est l'insulte la plus raffinée à 1' « être générique » de l'homme.
La quatrième facette de l'aliénation découle directement des trois précédentes :
« Par conséquent, (...) rendu étranger au produit de son travail, à son activité vitale, à son être générique, l'homme devient étranger à l'homme. Lorsqu'il se trouve face à lui-même, c'est l'autre qui est présent devant lui »[18] [785].
L'aliénation du
travail dans sa forme entière implique un rapport d'exploitation : 1
appropriation du surplus par la classe dominante. Dans les premières sociétés
de classe (dans ce chapitre, Marx mentionne l'Egypte, l'Inde, le Pérou,
exemples qu'il classa ultérieurement comme mode de production asiatique), bien que ce surplus soit
normalement consacré aux dieux, la puissance
étrangère réelle régnant sur le
travail des exploités, n'etait pas les dieux mais d'autres hommes :
« L'être "étranger"
à qui appartient le travail et le produit
du travail, qui dispose du travail et jouit du produit du travail, ne peut être
autre que l'homme lui-même. »[19] [786]Cette division profonde au coeur de la vie sociale
crée inévitablement une séparation fondamentale entre les êtres humains. Du point de vue de la classe dominante dans n'importe quelle société de classe, les
producteurs de richesses, les exploités sont autant d'objets, simples biens
qui n'existent qu'à leur bénéfice (bien qu'à nouveau il faille dire ici que ce n'est que sous le capitalisme que cette aliénation prend une forme achevée, puisque dans son mode de production les rapports d'exploitation perdent
tout caractère personnel et deviennent complètement inhumains et mécaniques).
Du point de vue de la classe
exploitée, les dirigeants de la
société sont également cachés derrière un brouillard de mystification, apparaissant
à un moment comme des dieux, à un autre comme des démons selon les circonstances ;
ce n'est que lorsque a émergé la conscience
de classe prolétarienne qui est la
négation de toutes les formes
idéologiques de perception, qu'il est
devenu possible pour une classe exploitée de voir ses exploiteurs à la lumière
du jour en tant que simples produits de rapports sociaux et historiques.[20] [787]
Mais cette division ne se réduit pas au rapport direct entre exploiteur et exploité. Pour Marx, l'être générique de l'homme ne constitue pas une essence isolée enfermée dans chaque individu ; c'est la « Gemeinwesen », un terme-clé qui implique que la nature de l'homme est sociale, que l'existence communautaire est la seule réelle forme humaine de l'existence. L'homme n'est pas isolé, producteur individuel. Il est par définition le travailleur social, le producteur collectif. Cependant, et cet élément est développé dans les pages des Grundrisse en particulier, l'histoire de l'homme depuis les temps tribaux peut être vue comme la dissolution continue des frontières communautaires originelles qui maintenaient la cohésion des premières sociétés humaines. Ce processus est intimement lié au développement des rapports marchands, puisque ceux-ci sont, avant tout, l'agent dissolvant de l'existence communautaire. On peut déjà voir cela dans la société classique où la croissance sans précédent des rapports mercantiles avait profondément miné les anciens liens « gentils » et tendait déjà à créer une société de « guerre de chacun contre tous », un fait noté par Marx dès sa Thèse de doctorat sur la philosophie grecque. Mais la domination des rapports marchands a évidemment atteint son apogée sous le capitalisme, la première société qui a généralisé les rapports marchands au coeur même de l'organisme social, le processus de production lui-même.
Cet aspect de la société capitaliste en tant que société de l'égoïsme universel, dans laquelle la concurrence et la séparation mettent tous les hommes en guerre avec les autres, a été particulièrement souligné dans son article La Question juive, dans lequel Marx fait sa première critique de la conception bourgeoise d'une émancipation purement politique : « Aucun des prétendus droits de l'homme ne dépasse donc l'homme égoïste, l'homme en tant que membre de la société bourgeoise, c'est-à-dire un individu séparé de la communauté, replié sur lui-même, uniquement préoccupé de son intérêt personnel et obéissant à son arbitraire privé. L'homme est loin d'y être considéré comme un être générique ; tout au contraire, la vie génerique elle-même, la société, apparaît comme un cadre extérieur à l'individu, comme une limitation de son indépendance originelle. »[21] [788]
Cette atomisation de l'homme dans la société civile, c'est-à-dire bourgeoise, est une clé indispensable pour analyser toutes les questions sociales qui existent en dehors du processus immédiat de production : les rapports entre les sexes et l'institution de la famille ; le phénomène de « solitude de masse » qui a tant intrigué les sociologues et qui semble caractéristique de la civilisation du 20e siècle ; et, en général, toute la sphère des relations interpersonnelles. Mais cela a également une signification plus directe pour la lutte du prolétariat, puisque cela se rapporte à la façon dont le capitalisme divise le prolétariat lui-même et fait de chaque ouvrier un concurrent de son camarade ouvrier, inhibant ainsi la tendance inhérente du prolétariat à s'unir en défense de ses intérêts communs contre l'exploitation capitaliste.
Le phénomène d'atomisation est particulièrement aigu aujourd'hui, dans la phase finale de la décadence capitaliste, la phase de l'effondrement généralisé et de la décomposition des rapports sociaux. Comme on l'a dit dans de nombreux textes[22] [789], cette phase est avant tout caractérisée par le développement de l'individualisme, du « chacun pour soi », par le désespoir, le suicide, la drogue et la maladie mentale à une échelle inconnue jusqu'ici dans l'histoire. C'est la phase dont le mot d'ordre pourrait être la phrase de Thatcher : « Il n'existe pas quelque chose qui serait la société, mais seulement des individus et leur famille » ; c'est une phase, comme les événements sanglants qui se déroulent dans l'ex-URSS le confirment, de cannibalisme individuel dans laquelle des masses d'êtres humains sont emportées dans les conflits les plus irrationnels et les plus meurtriers, des pogroms, des luttes fratricides et des guerres qui menacent de façon sinistre le futur même de la race humaine. Cela va sans dire que les racines d'une telle irrationalité résident dans les aliénations fondamentales au centre de la société bourgeoise et que leur solution ne peut être apportée qu'à partir de ce centre, par le changement radical des rapports sociaux de production.
L'aliénation du travail est la prémisse de son émancipation
Car il ne faut pas oublier que Marx n'a pas élaboré sa théorie de l'aliénation pour déplorer la misère qu'il voyait autour de lui, ni pour présenter, comme l'ont fait divers courants de socialisme « vrai » et féodal, l'histoire humaine comme rien d'autre qu'une chute regrettable depuis un état originel de plénitude. Pour Marx, l'aliénation de l'homme était le produit nécessaire de l'évolution humaine, et comme telle contenait les germes de son propre dépassement : « L'être humain devait être réduit à cette pauvreté absolue, afin de donner jour à sa richesse intérieure. »[23] [790] Mais la création de cette vaste richesse extérieure, cette richesse étrangère à ceux qui la créent, rend également possible que les êtres humains passent de 1’aliénation à la liberté. Comme Marx le dit dans les Grundrisse : « Il sera démontré (...) que la forme la plus extrême de l'aliénation, celle où le travail est en rapport avec le capital et le travail salarié, et le travail, l'activité productive est en rapport à ses propres contradictions et à son propre produit, est un moment de transition nécessaire - et donc contient en elle-même, sous une forme seulement encore inversée, mise sur la tête, la dissolution de tous les présupposés limités de la production et de plus crée et produit les présupposés inconditionnels de la production, et avec cela, les pleines conditions matérielles pour le développement total, universel des forces productives des individus »[24] [791].
Il y a deux aspects là dedans : d'abord, à cause de la productivité sans précédent du travail réalisée sous le mode de production capitaliste, le vieux rêve d'une société d'abondance où tous les êtres humains, et pas simplement quelques privilégiés, ont le loisir de se dédier au « développement total, universel » de leur puissance créatrice, peut cesser d'être un rêve pour devenir une réalité. Mais la possibilité du communisme n'est pas seulement une question de possibilité technologique. Elle est par-dessus tout liée à l'existence d'une classe qui a un intérêt matériel à la mettre au monde. Et là encore la théorie de l'aliénation de Marx montre comment en dépit et à cause de l'aliénation qu'il subit dans la société bourgeoise, le prolétariat sera amené à se dresser contre ses conditions d'existence : « La classe possédante et la classe du prolétariat représentent la même aliénation humaine. Mais la première se complaît et se sent confirmée dans cette aliénation de soi, elle éprouve l'aliénation comme sa propre puissance et trouve en elle l'apparence d'une existence humaine ; la seconde se sent anéantie dans l'aliénation, elle voit en elle sa propre impuissance et la réalité d'une existence inhumaine. Pour employer une expression de Hegel, elle est dans l'abjection, la révolte contre cette abjection, révolte à laquelle elle est poussée nécessairement par le conflit de sa nature humaine avec sa situation dans la vie, qui est la négation évidente, radicale et intégrale de cette nature ».[25] [792]
La théorie de l'aliénation n'est donc rien si elle n'est pas une théorie de révolte de classe, une théorie de révolution, une théorie de la lutte historique pour le communisme. Dans le prochain chapitre, nous étudierons les premières ébauches de la société communiste que Marx a « déduites » de sa critique de l'aliénation capitaliste.
CDW.
[1] [793] Le Capital. Dans ce passage de Marx « mûr », il développe une question fondamentale traitée dans les Manuscrits : la distinction entre le travail humain et « l’activité vitale » des autres animaux.
[2] [794] Voir l'article précédent de cette série : « Comment le prolétariat a gagné Marx au communisme », Revue internationale n 69.
[3] [795] Sur les critiques par Marx du « communisme vulgaire », voir le premier article de cette série, Revue internationale n° 68
[4] [796] Bordiga, « Commentaires sur les Manuscrits de 1844 », dans Bordiga et la passion du communisme, réunis par J.Camatte, Editions Spartacus, 1974.
[5] [797] Ibid.
[6] [798] Marx, dans l'article éditorial du n° 179 de la Kolnische Zeitung, publié dans la Reinische Zeitung, 1842.
[7] [799] Hegel, La phénoménologie de l'esprit, 1807, Préface.
[8] [800] Manuscrits économiques et philosophiques, Ed. La Pléiade, Tome II.
[9] [801] Thèses sur Feuerbach, Ed. La Pléiade, T.III
[10] [802] Manuscrits, Ed. La Pléiade, T. II
[11] [803] Manuscrits, Ed. La Pléiade, T. II.
[12] [804] Ibid.
[13] [805] Voir l'article « C'est le capitalisme qui empoisonne la terre », dans la Revue internationale n° 63
[14] [806] Manuscrits, Ed. La Pléiade, T.II
[15] [807] Ibid
[16] [808] Manuscrits, Ed 10-18
[17] [809] Manuscrits, Ed. La Pléiade, T.II
[18] [810] Ibid
[19] [811] Ibid
[20] [812] Sur les spécificités de la conscience prolétarienne, voir en particulier Lukacs, Histoire et Conscience de classe ; et la brochure du CCI Conscience de classe et organisations communistes.
[21] [813] La question Juive, Ed. 10-18.
[22] [814] Voir en particulier « La décomposition, phase finale de la décadence du capitalisme », dans la Revue internationale n° 62.
[23] [815] Manuscrits, Ed. La Pléiade, T.II.
[24] [816] Grundrisse (traduit de l'anglais par nous).
[25] [817] Marx et Engels, La Sainte Famille, Ed. La Pléiade, T. III.
Approfondir:
Questions théoriques:
- Communisme [492]
Heritage de la Gauche Communiste:
A quoi sert la « fraction externe du CCI » ? De l'irresponsabilité politique au vide théorique
- 4194 reads
Le milieu politique prolétarien est constitué d'un certain nombre d'organisations qui, malgré des confusions et des erreurs d'analyse, quelques fois graves pour certaines, représentent un réel effort historique de la classe ouvrière dans sa prise de conscience. Cependant, en marge de ce milieu, on peut trouver toute une série de petits groupes qui ne s'inscrivent pas en véritable continuité avec l'effort des courants historiques de la classe, dont l'existence est essentiellement basée sur l'esprit de chapelle, voire sur des « questions personnelles » et autres mesquineries. De tels groupes se présentent comme des parasites des véritables organisations révolutionnaires. Non seulement leur existence est sans fondement du point de vue des intérêts de la classe ouvrière, mais ils vivent aux dépends des organisations sérieuses et ils contribuent à discréditer aux yeux des prolétaires les positions et l'activité de celles-ci. La Fraction externe du CCI (fecci) constitue un exemple particulièrement significatif de groupe parasite. C'est ce qu'a illustré, sous une forme caricaturale, la façon dont ce groupe a affronté les événements historiques considérables qui ont bouleversé le monde au cours des deux dernières années. Dans les n° 44 et 45 de la Revue Internationale (RInt), nous avons évoqué les circonstances dans lesquelles s'est constituée la fecci. Nous ne reviendrons que très brièvement ici sur ces circonstances.
La FECCI a été formée par un certain nombre d'anciens militants de notre organisation qui ont volontairement quitté celle-ci en novembre 1985 lors de son 6e congrès. Ces camarades s'étaient constitués en tendance quelques mois auparavant autour d'un document qui tentait de faire une synthèse de différents points de vue contradictoires qui avaient été développés dans l'organisation contre les orientations de celle-ci. Mais au-delà de leur absence d'homogénéité et de leur incohérence, les positions exprimées à cette époque par ces camarades se distinguaient par un manque de fermeté, par des concessions à l'égard des positions conseillistes, en bref par une démarche centriste envers le conseillisme. Bien que de telles positions auraient pu avoir des conséquences néfastes si elles avaient gagné l'ensemble du CCI, elles ne motivaient en aucune façon une séparation organisationnelle. Aussi, nous avions considéré cette scission comme une véritable désertion marquée du sceau de l'irresponsabilité et du sectarisme. D'ailleurs, les scissionnistes eux-mêmes étaient bien conscients du caractère injustifiable de leur démarche puisqu'ils ont, depuis leur départ et jusqu'à aujourd'hui, colporté la fable qu'ils avaient été exclus du CCI. Nous n'avons pas la place, dans le cadre de cet article, de revenir sur ce mensonge (que nous avons déjà amplement réfuté dans la RInt n°45). Au même titre que les communautés primitives, les sectes ont en général besoin de se donner un mythe fondateur justifiant leur existence. L'exclusion du CCI constitue un des mythes fondateurs de cette secte qui a pour nom fecci.
Cependant, le mensonge n'est pas la seule caractéristique de la fecci. Il faut y ajouter également la stupidité. C'est ainsi qu'elle donne elle-même le bâton pour se faire battre en confirmant qu'elle n'a nullement été exclue du CCI mais qu'elle a quitté celui-ci de son propres chef.
« Rester dans une organisation dégénérescente comme le CCI revient à se priver de la possibilité de faire face et éventuellement de surmonter la crise du marxisme... Et tout ceci est recouvert d'un fin vernis de respectabilité par un nouveau dogme que le CCI a inventé commodément il y a six ou sept ans, à savoir que les militants sont censés rester dans une organisation jusqu'à ce que celle-ci ait franchi la frontière de classe vers la classe capitaliste ennemie. Prisonniers pour la vie. Comme des femmes battues qui proclament pathétiquement qu "il m'aime", les militants du CCI ont découvert le caractère sacré du mariage. » (Perspective Internationaliste - PI -n° 20, « Pour une pratique vivante de la théorie marxiste »). Le lecteur pourra apprécier à sa juste valeur a comparaison entre le CCI et un mari brutal. La fecci nous a habitués depuis ses origines à ce genre de qualificatifs. Ce qu'on peut constater, toutefois, c'est que la FECCI (se considère-t-elle comme une femme battue ?) revendique avec véhémence son divorce avec le CCI alors qu'elle confirme clairement que ce dernier y était opposé.
Encore une fois, la place nous manque ici pour revenir sur l'ensemble des accusations stupides et mensongères, et elles sont nombreuses, portées par la fecci contre notre organisation. En particulier, nous reviendrons dans un autre article, si c'est encore nécessaire, sur un des chevaux de bataille de la fecci : le prétendu abandon par le CCI de ses principes programmatiques. Cependant, il est une accusation dont les événements de ces dernières années ont révélé la débilité : c'est l'accusation de régression théorique.
La FECCI et l'approfondissement théorique
Outre l’accusation d'abandon des principes, la FECCI a décrété que «... le CCI, non seulement avait cessé d'être un laboratoire pour le développement de la théorie/praxis marxiste (la condition sine qua non d'une organisation révolutionnaire) mais il était même incapable de maintenir les acquis théoriques sur lesquels il s'était fondé. » ([1] [818]) . Pour sa part, la fecci s'est donnée comme objectif de sauvegarder ces acquis et de les enrichir : « pour qu'une organisation vive et se développe, il ne suffît pas qu'elle garde une plateforme dans ses archives... L'histoire avance, pose de nouveaux problèmes, pose d'anciens problèmes sous une forme nouvelle, et tous ceux qui ne parviennent pas à se placer à la hauteur de l'histoire sont condamnés à être piétines dans sa progression » ([2] [819]). De toute évidence, elle ne connaît pas l'histoire de l'arroseur arrosé. C'est ce que les bouleversements intervenus depuis l'automne 1989 ont démontré à l'évidence.
Comme l'écrivait la fecci en décembre 1989, « Les événements qui secouent l'Europe de l'Est depuis plusieurs mois requièrent l'élaboration, de la part des révolutionnaires, d'une analyse marxiste claire qui en cerne les causes et conséquences réelles sur le plan du rapport de forces inter impérialistes et de la lutte de classe...»([3] [820]) Et effectivement, la fecci a constaté que «La Russie n'a désormais plus de bloc. Pour le moment, elle a cessé d'être un protagoniste essentiel sur la scène mondiale, un concurrent de l'impérialisme US. (...) La division du monde en deux blocs rivaux, qui n'est pas seulement la caractéristique de la dernière moitié de ce siècle mais aussi une condition nécessaire pour un conflit mondial, n'existe plus aujourd'hui. ». Bravo ! C’est presque exactement ce que nous avons écrit à partir de la fin de l'été 1989, c'est-à-dire près de deux mois avant la disparition du mur de Berlin. ([4] [821]) Le petit ennui, c'est que cette analyse de la fecci ne date pas de la même période, mais qu'elle est apparue pour la première fois dans PI n° 21 («L'avenir de l'impérialisme ») daté de l'hiver 1991-92, c'est-à-dire plus de deux ans après que nous ayons adopté notre propre analyse.
Depuis Marx, nous savons que « c’est dans la pratique que l'homme doit prouver la vérité, c’est-à-dire la réalité et la puissance... de sa pensée» (Thèses sur Feuerbach). Lorsque la capacité théorique des organisations révolutionnaires a été mise à l'épreuve dans la pratique, on a pu voir à l'oeuvre la fecci qui s'était justement proposée de reprendre le flambeau de l'élaboration théorique qu'à ses dires le CCI avait laissé tomber. Voici ce qu'elle écrivait le 16 décembre 1989 (plus d'un mois après la disparition du mur de Berlin : «Les événements actuels en Europe de l'Est s'inscrivent dans le cadre de la politique de la "perestroïka" entamée en Russie il y a quatre ans lors de l'arrivée au pouvoir de Gorbatchev. (...) Les buts de la perestroïka sont (...) sur le plan militaire et impérialiste, arrêter l'offensive [du bloc] occidental par une contre-offensive idéologique visant à l’amener à réduire ses dépenses d'armement et le diviser, tout en cherchant à se doter du potentiel économique et technologique nécessaire pour le concurrencer militairement à moyen terme. (...) sur le plan impérialiste, la Russie n'a plus guère le choix que de déstabiliser la scène européenne en escomptant en tirer profit. L'Europe a toujours été le théâtre ultime des conflits impérialistes mondiaux, et l'est plus que jamais pour la Russie aujourd'hui... En accélérant les réformes dans les pays est-européens, la Russie entend modifier les données du problème européen, ouvrir la Communauté Européenne à l'Est pour la diviser et la neutraliser. La destruction du mur de Berlin, loin d'être un gage de paix, est une bombe à retardement placée au coeur de l'Europe. (...) Si la dissolution du stalinisme comme mode de domination du capital dans les pays d'Europe de l'Est est à terme une possibilité qui ne peut être exclue ([5] [822]) à cause de leur passé historique et de la possibilité de leur attraction dans l'orbite occidentale, il n'en va pas de même de la Russie elle-même. » ([6] [823])
Heureusement que le ridicule ne tue pas, sinon les membres de la FECCI seraient aujourd'hui enterrés. Nous pouvons toutefois leur accorder une qualité : le cran. Il faut effectivement avoir bien du cran pour continuer aujourd'hui à se réclamer d'une organisation qui a pu adopter des positions aussi ineptes, qui a pu se tromper à ce point dans la compréhension d'une situation historique. Dans l'ensemble, le milieu politique prolétarien a éprouvé bien des difficultés à produire une analyse correcte et lucide des événements de la seconde moitié de 1989.([7] [824]) Mais il faut bien reconnaître que la fecci détient de très loin le pompon. C'est vrai aussi qu'on ne peut pas réellement la placer dans le milieu politique prolétarien à proprement parler.
En fait, une cécité comme celle de la FECCI a peu d'équivalents dans l'histoire de ce milieu politique ([8] [825]) : le seul exemple comparable est celui du Ferment Ouvrier Révolutionnaire (FOR) qui, pendant plus de vingt ans, a nié l'existence de la crise économique du capitalisme. Car même lorsqu'elle a admis (par la force des évidences) son erreur d'analyse initiale, la fecci a continué de ne rien comprendre à ce qui se passait. Ainsi, lors de sa 4e conférence, en été 1991, la FECCI n'avait pas encore reconnu la disparition du bloc de l'Est. La façon dont elle traite de cette question dans PI n°20 est d'ailleurs typique de son centrisme congénital : d'un côté, on constate « l’effondrement du Pacte de Varsovie et du COMECON » (ce qui est la moindre des choses après leur disparition formelle qui ne faisait qu’entériner un effondrement qui avait eu lieu bien auparavant), on découvre que « les événements de ces deux dernières années ont représenté une véritable révocation des accords de Yalta, » ([9] [826]) on met en évidence la perte par l'impérialisme russe de toutes les positions et de l'influence qu'il conservait (Europe centrale, Moyen-Orient, Asie du Sud-Est, Afrique, Amérique centrale et Cuba, etc.), mais, d'un autre côté, on se refuse de parler explicitement de la «disparition» ou même de «l'effondrement du bloc de l'Est». Dans ce document, on oppose au « bloc américain » «l'impérialisme russe » ou son « adversaire potentiel russe » sans, à aucun moment, dire clairement ce qui est advenu du bloc russe.([10] [827]) Pour le centrisme, il est des mots qu'il ne faut pas prononcer, comme cela, on s’évite de devoir affirmer une position claire et tranchée. Et comme le propre d'une position centriste, c est d'être intenable, il faut bien, un jour ou l'autre, sous la pression des réalités, parce que « les faits sont têtus» (comme disait Lénine), qu'on se jette à l'eau : c'est ce qu'a fait, avec deux ans de retard, PI n° 21. Bel effort, bravo camarades !
« LA PAILLE ET LA POUTRE »
Evidemment, les exploits de la FECCI, concernant la compréhension des événements qui ont secoué le monde dans la dernière période, ne pouvaient en rester à «l'élaboration» d'une «analyse» tellement erronée qu'il fallait la remettre en cause mois après mois. Il fallait encore qu'elle fasse preuve de sa stupidité et de sa cécité dans la critique des organisations révolutionnaires, et particulièrement du CCI. Ainsi, dans PI n° 16, on trouve un article au titre explicite «Le CCI et l'Europe de l'Est, le virage à 180° d'une organisation dégénérescente » qui se propose de procéder à une «dénonciation» de a vision du CCI puisque : « Il faut bien parler de dénonciation et non de polémique devant la profondeur de la confusion que représente cette organisation face à notre classe et devant la lâcheté avec laquelle elle change de position, avec cette tactique bien connue des organisations staliniennes : sans débat ouvert et de façon monolithique. » Rien que cela, excusez du peu !
L'article se scandalise que « La vision développée par le CCI [soit] donc celle de la disparition du bloc de l'Est par ''implosion" sous l'effet de la crise économique». C'est effectivement bien (à grands traits) la conception défendue par le CCI depuis le début et que nous n'avons remise en cause à aucun moment. Mais pour la FECCI : « Il s'agit là... d'une analyse qui abandonne le cadre marxiste de la décadence. », c'est « une régression théorique fondamentale. .. car il s'agit bien de la compréhension d'un des mécanismes profonds du capitalisme et de sa crise », c'est « renier purement et simplement le cadre de l'impérialisme et la nature même de la bourgeoisie», c'est «certes accréditer le battage idéologique bourgeois mais certainement plus comprendre la réalité avec un cadre d'analyse marxiste», c'est «nier le caractère guerrier des Etats impérialistes», etc. On ne peut évidemment reproduire toutes les accusations de ce style, ce serait vraiment lassant pour le lecteur. Mais ce que témoigne l'article, fondamentalement, c'est que pour la FECCI, son « cadre d'analyse » (lequel, au fait ?) est plus important que la réalité elle-même. Et si cette dernière ne se plie pas à ses schémas, et bien, elle n'existe pas ! Et tout cela au nom du «marxisme» s'il vous plaît.
En fait, il ne suffit pas de produire des citations de Marx et de Rosa Luxemburg, comme le fait l'article, pour développer une pensée marxiste (les staliniens nous l'ont prouvé depuis des décennies). Encore faut-il comprendre ce qu'elles veulent dire et ne pas afficher une nullité théorique affligeante en confondant, par exemple, impérialisme et blocs impérialistes. C'est pourtant bien ce que fait l'article. Celui-ci rappelle l'affirmation parfaitement juste de Rosa Luxembourg : « La politique impérialiste n'est pas l'oeuvre d un pays ou d'un groupe de pays. Elle est le produit de l'évolution mondiale à un moment donné de sa maturation. C'est un phénomène international par nature... auquel aucun Etat ne saurait se soustraire. ». Et, à cette citation, la FECCI fait dire que la division du monde en deux blocs impérialistes est une donnée permanente du capitalisme depuis le début du siècle. Camarades de la fecci, il faut retourner à l'école primaire, c'est là qu'on apprend à lire. ([11] [828])
Si la rigueur théorique n'est vraiment pas le fort de la fecci, ce n'est pas finalement pour elle un problème. Le but principal de l'article, comme l'annonce son titre et son introduction, est bien le dénigrement de notre organisation.
Il faut à tout prix illustrer la thèse de la « dégénérescence du CCI » qui est un des autres mythes fondateurs de la FECCI. C'est avec insistance que la conclusion y revient : « Entraîné et balayé par l'idéologie dominante, incapable désormais d'appréhender les événements quotidiens au travers de principes de classe et d'une méthodologie marxiste, le CCI se fait le véhicule de l'idéologie de classe. (...) Nous espérons que ces articles [ceux de Pi] alimenteront le débat au sein du milieu révolutionnaire, et, qui sait, provoqueront un choc salutaire auprès des éléments restés sains dans le CCI». Les «éléments sains du CCI» disent un grand merci à la FECCI pour sa sollicitude... et pour la démonstration qu'elle a faite, tout au long de la dernière période, de l'absurdité de ses accusations contre le CCI.
Sérieusement, si on ne peut demander à la FECCI de réaliser son ambition d’ «approfondissement théorique» (de toute évidence, ses «analyses» depuis deux ans ont établi que cela dépasse de loin ses capacités), il serait temps, pour la dignité des rapports entre révolutionnaires, qu’elle arrête avec ses insultes ridicules mais répugnantes à propos des prétendues « tactiques staliniennes » du CCI. Dans la RInt n°45, nous avons déjà fait justice de ce type d'accusations concernant la façon dont le CCI avait affronté l'apparition en son sein de la minorité qui allait former la FECCI. Aujourd'hui, vouloir étayer une telle légende en relevant que le CCI n'a pas fait part dans sa presse des positions de ses membres en désaccord avec son analyse sur l'Est est une absurdité. Que les prises de position successives de la FECCI sur ce sujet aient provoqué dans ses rangs le surgissement et le maintien de nombreux désaccords, ([12] [829]) cela se comprend aisément : lorsque des positions sont tellement éloignées de la réalité, il est difficile qu elles rencontrent l'unanimité ou même qu'elles permettent un minimum l'homogénéité dans l'organisation. La FECCI sait pertinemment qu'il y a eu des débats dans le CCI tout au cours des événements de la dernière période. Mais elle sait également, parce que ses membres étaient d'accord avec un tel principe lorsqu'ils étaient militants du CCI, que ces débats, afin de permettre une réelle clarification dans la classe, ne sont répercutés vers l'extérieur que lorsqu'ils ont atteint un certain niveau de développement. Or, si l'analyse adoptée par le CCI au début octobre 1989 (et mise en discussion à la mi-septembre) sur les événements de l'Est a provoqué sur le moment des désaccords, ces derniers se sont assez rapidement résorbés du fait que, jour après jour, la réalité ne faisait que confirmer la validité de cette analyse. Est-ce une preuve de la «dégénérescence du CCI» que son cadre d'analyse et sa compréhension du marxisme lui aient permis, beaucoup plus rapidement que les autres groupes du milieu politique, d'appréhender la signification et les implications des événements de l'Est ?
Avant d'en finir avec les accusations de la fecci contre le CCI à {propos des événements de l'Est, il faut encore relever deux perles (parmi beaucoup d'autres que nous ne pouvons évoquer faute de place) : notre prétendu « virage à 180°» et la question du «super impérialisme».
Incapable de reconnaître les changements qui étaient intervenus sur a scène internationale (malgré tous les discours sur la «sclérose» du CCI), changements qui constituaient effectivement un « virage à 180° », la fecci n'a su (ou voulu) voir dans la compréhension qu'en avait le CCI qu'un reniement de son propre cadre d'analyse fondamental. Encore une fois, la critique (la « dénonciation » suivant les termes de la fecci) est imbécile et de mauvaise foi. Et cela d'autant plus que, dans notre prise de position sur les événements de l'Est publiée dans la RInt n° 60, nous nous appuyons amplement sur l'analyse des régimes staliniens et du bloc de l'Est que le CCI avait développée au début des années 1980 (et qui se basait sur les avancées de la Gauche communiste de France sur la question) à la suite de l'instauration de l'état de guerre en Pologne (cf. RInt n°34). En revanche, on ne trouve dans les «analyses» multiples et à géométrie variable (minoritaires; majoritaires; majoritaires/minoritaires ou minoritaires/majoritaires) que nous a proposées la fecci aucune référence à ce cadre (ne serait-ce que pour le remettre en cause) que pourtant les membres de la FECCI avaient fait leur à cette époque puisqu'ils étaient encore militants du CCI.([13] [830]) La prochaine fois que la FECCI aura envie d'écrire que le CCI « est incapable de maintenir ses acquis théoriques », nous lui conseillons de commencer par se regarder dans une glace.
C'est le même conseil que nous lui donnons au cas où elle serait tentée de nous attribuer encore une fois (comme elle le fait par exemple dans l'article de PI n° 19 « Un même appel contre la guerre impérialiste ») une position typiquement bourgeoise comme celle du « super impérialisme». Cette thèse élaborée par Kautsky et les réformistes à la veille et au cours de la première guerre mondiale visait à établir que les secteurs dominants du capital mondial seraient en mesure de s'unifier pour imposer leur loi sur la planète et garantir de ce fait la stabilité et la paix de celle-ci. La fecci savait pertinemment, lorsqu'elle nous a attribué une telle conception, que depuis le tout début des événements de l'Est nous l'avions clairement rejetée : « Cette disparition du bloc de l'Est signifie-t-elle que, désormais, le monde sera dominé par un seul bloc impérialiste ou que le capitalisme ne connaîtra plus d'affrontements impérialistes ? De telles hypothèses seraient tout à fait étrangères au marxisme. (...) Aujourd'hui, l'effondrement de ce bloc ne saurait remettre en selle ce genre d'analyses [celles du "super impérialisme"] : cet effondrement porte avec lui, à terme, celui du bloc occidental. (...) l'aggravation des convulsions de l'économie mondiale ne pourra qu'attiser les déchirements entre /TOUS les] Etats, y compris, et de plus en plus, sur te plan militaire. (... ) La disparition des deux constellations impérialistes qui étaient sorties de la seconde guerre mondiale porte, avec elle, la tendance à la recomposition de deux nouveaux blocs.([14] [831]) » En revanche, c'est bien une telle conception du « super-impérialisme » qui transparaît dans PI n°21 («L'avenir de l'impérialisme ») : « Un seul bloc a survécu à la crise. Il n'a pas de concurrent en ce moment. Et pourtant, contrairement aux prédictions faites par le CCI et par d'autres, pour le moment il ne montre aucun signe de désintégration. Son existence ne repose plus sur la rivalité impérialiste avec la Russie, mais sur la domination du monde selon les besoins des capitaux les plus puissants. » L'éditorial de ce numéro de notre Revue, comme celui du précédent, fait justice (après beaucoup d'autres articles) de la prétendue cohésion du bloc de l'Ouest : encore une fois, la FECCI refuse de voir la réalité. Mais ce qui est plus grave encore, c'est qu'elle remet en cause, ce faisant, un des acquis essentiels du marxisme au cours de ce siècle. Ainsi, pour étayer l'idée que des puissances comme l'Allemagne et le Japon ne peuvent faire autre chose que se maintenir fermement dans le « bloc américain »> la fecci nous affirme que : « Les Etats du bloc américain ou occidental sont devenus économiquement dépendants du fonctionnement de ces institutions [Banque mondiale, FMI, GATT, etc.] et du réseau de liens commerciaux et financiers qu’ils ont tissés. »([15] [832]) C'est là une version moderne de la conception des réformistes du début du siècle (dénoncée vigoureusement par les révolutionnaires de l'époque) qui prétendaient que le développement des liens économiques, financiers, commerciaux entre pays constituait un frein à leurs antagonismes impérialistes et devait écarter la menace de guerre entre eux. La fecci est vraiment bien placée pour parler des «reniements du marxisme» par le CCI et de sa « capitulation » devant l'idéologie bourgeoise. Quand on veut se mêler de moucher les autres, il vaut mieux vérifier d'abord si on n'est pas morveux soi-même. En fait, c'est là une des pratiques courantes de la FECCI qui, afin de masquer ses propres défauts, les attribue généreusement au CCI. C’est un procédé vieux comme la politique mais qui n'a jamais grandi ceux qui l'ont utilisé, particulièrement s'il s'agit de révolutionnaires.
A QUOI SERT LA FECCI ?
Si on considère, comme elle le dit fort justement elle-même, que « Les événements qui secouent l’Europe de l'Est... requièrent l'élaboration, de la part des révolutionnaires, d'une analyse marxiste claire qui en cerne les causes et conséquences réelles... » ce n'est pas faire preuve de la moindre volonté de dénigrement que de constater que la fecci a complètement failli a sa tâche. Elle-même le reconnaît d'ailleurs : «Cette réalité nouvelle nous a conduits à reconnaître l'insuffisance de notre ancienne analyse qui, par certains côtés, restait prisonnière de poncifs sans valeur, » ([16] [833]) même si c'est pour ajouter un peu plus loin (il faut bien crâner un peu et soutenir le moral des adhérents) : «Estimant positive notre capacité d'analyse de la situation... nous avons décidé de poursuivre dans la même voie que précédemment. »
Plus généralement, on peut constater que la FECCI a fait complètement faillite dans son objectif de préserver et développer les acquis théoriques du CCI, tâche que ce dernier aurait abandonnée à ses dires. Lorsque ses prétentions ont été confrontées à l'épreuve des faits, elles ont éclaté comme des bulles de savon. Elle voulait nous donner une leçon de clairvoyance théorique, elle a fustigé pendant deux ans, dans les termes les plus infamants nos analyses, mais, pour finir, elle a été obligée d'accepter, pour l'essentiel, sans évidemment e reconnaître, le point de vue que nous avions défendu depuis le début ([17] [834]) et qu'elle présentait comme la preuve irréfutable de la « dégénérescence » de notre organisation. La seule différence qu'elle maintient avec notre compréhension élaborée il y a déjà deux ans et demi, c'est qu'elle reprend maintenant à son compte la position bourgeoise du super-impérialisme qu'elle nous avait attribuée de façon mensongère. Ainsi, toute sa « démonstration » de la « régression du CCI » s'est retournée contre elle : ce n'est pas le CCI qui régressait, c'est la fecci qui ne comprenait rien à la situation, toute armée qu'elle fut de sa supériorité théorique auto-proclamée. Et si l'incapacité d'appréhender les enjeux des événements de l'Est était une manifestation de régression, comme elle l'a affirmé, avec raison, pendant deux ans, ce n'est certainement pas notre organisation qui a régressé mais bien la FECCI elle-même.
A la question «A quoi sert la FECCI ? », on pourrait donc être tenté de répondre : « A rien ». Mais ce n'est malheureusement pas le cas. Même si l'influence de la FECCI est insignifiante, sa capacité de nuisance n’est pas nulle. Et c'est pour cette raison que nous lui consacrons cet article. En effet, dans la mesure où sa revue a un certain nombre de lecteurs, où quelques personnes assistent à ses réunions publiques, où elle intervient dans le milieu politique prolétarien, alors qu'elle se réclame de la plateforme de l'organisation aujourd'hui la plus importante de celui-ci, le CCI, elle constitue un élément de confusion supplémentaire au sein de la classe ouvrière. En particulier, ses tendances conseillistes et son manque de rigueur théorique ne peuvent que rencontrer un écho dans une partie du monde comme les Etats-Unis qui se distingue par la faiblesse de son milieu politique, par l'ignorance que manifestent beaucoup de ses membres et par la forte imprégnation des visions conseillistes et libertaires. Ce faisant, un groupe comme la fecci contribue incontestablement à maintenir et enfoncer dans son sous-développement le milieu prolétarien d'un tel pays.
Mais plus fondamentalement encore, la fecci a pour fonction de discréditer un travail révolutionnaire sérieux et, en premier lieu, le marxisme lui-même. Ainsi, que ce soit au nom du «marxisme» que, pendant deux ans, ce groupe ait proféré une telle quantité d'inepties, qu'il ait fait preuve d'une telle cécité ne peut aboutir qu'à déconsidérer le marxisme lui-même. Ce faisant, la fecci apporte sa petite contribution à la campagne actuelle sur la «mort du marxisme ». C'est vrai que PI n° 17 a publié un texte, « Le marxisme est-il mort ? » qui dénonce ces mensonges et réaffirme, à sa façon, la pleine validité du marxisme. Mais encore faut-il que les révolutionnaires fassent la preuve, dans la pratique, par la vérification de leurs analyses, de la validité du marxisme. Et cela, la fecci est vraiment mal placée pour le faire. Mais, malheureusement, la contribution de la fecci aux campagnes répugnantes contre le marxisme ne s'arrête pas à sa défense inconséquente de cette théorie. C'est de façon délibérée qu'elle y participe dans PI n°20. La première page elle-même est déjà ambiguë : « Le "communisme" doit mourir pour que vive le communisme ». Comme s'il n'y avait pas assez de confusions entre communisme et stalinisme, comme si l'agonie actuelle de ce dernier se présentait comme une «victoire» pour la classe ouvrière, alors qu'elle a été retournée contre elle par toute la bourgeoisie «démocratique ». De plus, l'éditorial se réjouit « Que tombent les statues » de Lénine. Si la classe ouvrière n'a évidemment pas besoin des statues des révolutionnaires (que la bourgeoisie a édifiées justement pour en faire des «icônes inoffensives », comme disait Lénine lui-même), il ne faut pas se méprendre sur la signification des actions des foules dans la période passée : elles correspondent à un rejet, promu et encouragé par les forces bourgeoises, de l'idée même d'une révolution du prolétariat. Ce même éditorial nous affirme que [les révolutionnaires] «doivent se débarrasser de la tendance à considérer la révolution bolchevique comme un modèle». Dans les circonstances présentes, le terme «révolution Bolchevique» est déjà pernicieux puisqu'il laisse entendre, comme le répète aujourd'hui la bourgeoisie de façon obsédante, que la révolution d'Octobre était l'affaire des seuls bolcheviks, ce qui ne peut que conforter la thèse que cette révolution n'était pas autre chose qu'un coup d'Etat de Lénine et des siens « contre la volonté de la population » ou même de la classe ouvrière. Et pour bien ancrer ce type de confusions, l'éditorial est chapeauté par un dessin représentant Lénine versant des larmes qui ont la tête de Staline : en d'autres termes, Staline est bien, d'une certaine façon l'héritier de Lénine. Encore une fois, la Gauche communiste, et le CCI en particulier, n'a jamais craint de mettre en lumière les erreurs des révolutionnaires qui ont facilité le travail de la contre-révolution. Mais elle a toujours su où étaient les priorités du moment : aujourd'hui, cette priorité n'est certainement pas de « hurler avec les loups » mais bien de revendiquer, à contre-courant des campagnes bourgeoises, l'expérience fondamentalement valable de la vague révolutionnaire du premier après guerre. Tout le reste n'est qu'opportunisme.
Enfin, ce même numéro de PI contient un article (« Pour une pratique vivante de la théorie marxiste») qui glose longuement sur la «crise du marxisme». On comprend que la fecci commence à se sentir mal dans ses souliers après la mise en évidence de son incapacité à comprendre les enjeux des événements de l'Est. Ce n'est pas une raison pour affirmer péremptoirement que «personne dans ce milieu [révolutionnaire] «n’a prédit ces événements». Une telle prévision n'a sûrement pas été le fait de la fecci, on le sait, mais elle n'est pas seule au monde et notre propre organisation ne peut se sentir concernée par ce genre d'affirmations. En ce sens, ce n'est pas le marxisme tel qu'il a été développé par la Gauche communiste et, à sa suite, par le CCI, qui porte la responsabilité de la faillite des analyses de la fecci. Il ne faut pas se tromper de cible : ce n'est pas le marxisme qui est en crise, c'est la FECCI. Ceci dit, ce genre d'article où TOUT le milieu politique est mis dans le même sac, où on attribue généreusement à tous les autres groupes sa propre nullité, ne peut encore une fois qu'apporter de l'eau au moulin de ceux qui prétendent que c'est le marxisme «en général » qui a fait faillite.
Mais la contribution de la fecci à la confusion dans les rangs de la classe ouvrière et de son milieu politique ne s'arrête pas à ces divagations sur la «crise du marxisme». On la retrouve dans son rapprochement actuel avec le Communist Bulletin Group (cbg) qui sévit en Ecosse. Ce groupe est issu de la scission, fin 1981, de la tendance secrète qui s'était formée autour de l'élément trouble Chénier (lequel, quelques mois après son exclusion, portait les banderoles du syndicat CFDT et qui est aujourd'hui un cadre du parti socialiste, dirigeant le gouvernement français). Au moment de leur départ, les membres de cette « tendance » y compris ceux qui allaient former le CBG, avaient dérobé à notre organisation du matériel et des fonds. Voici ce que le CCI écrivait à propos de ce groupe en 1983, avec le plein accord clés camarades qui, plus tard, allaient constituer la fecci:
« Dans les premiers numéros de The Bulletin, il [le CBG] se revendiquait de ce comportement en se vautrant dans le colportage de racontars aussi vils que stupides contre le CCI.([18] [835]) Maintenant, (sans doute en voyant que l'attitude précédente n'a pas mené au résultat escompté) il essaye de se blanchir les mains en défendant hypocritement "la nécessité de polémiques saines". (...) Comment oser parler de "solidarité", de "reconnaissance du milieu politique du prolétariat" quand le fondement n'existe pas? CBG a la toupet d’oser nous écrire : "L’existence de ce milieu engendre une communauté d’obligations et de responsabilité". Mais cela se traduira en vol le jour où vous serez en désaccord avec le CBG et il justifiera le vol comme "anti-petit-bourgeois". Peut-être pourrions-nous le formuler ainsi: quand on scissionne, on peut voler ce qu'on veut, mais quand on a enfin un groupe à soi... l'accession à la propriété assagit les petits voyous. Quelles sont les positions du CBG? Celles (plus ou moins) du CCI! Voila un autre groupe dont l'existence est parasitaire. Que représente-t-il face au prolétariat ? Une version provinciale de la plateforme du CCI avec la cohérence en moins et le vol en plus. (...) La plupart des petits cercles qui scissionnent sans avoir préalablement clarifié les positions commencent par suivre le chemin de la facilité en adoptant la même plate-forme que le groupe d'origine. Mais bientôt, pour Justifier une existence séparée, on découvre maintes questions secondaires divergentes et à la fin on change les principes... le CBG prend déjà le même chemin en rejetant la cohérence sur la question de l'organisation. »([19] [836])
Voici également en quels termes la fecci évoquait le CBG en 1986 : « ... les scissionnistes de 81 usèrent de la tromperie pour s'approprier du Matériel du CCI. Certains de ceux qui formèrent ultérieurement le cbg aggravèrent encore les choses en menaçant d'appeler la police contre les membres du CCI qui voulaient récupérer le matériel volé. (...) Dans les pages du Communist Bulletin n° 5, le CBG a condamné de telles menaces comme "un comportement totalement étranger à la pratique révolutionnaire". Il affirme également que "les scissionnistes devraient rendre le matériel appartenant au groupe et les fonds de l'organisation". Cette autocritique est toutefois, au mieux, timide. Pour autant que nous sachions, le CBG détient toujours des fonds dont il avait la responsabilité quand il faisait partie du CCI... )ans la pratique, le CBG en tant que groupe n'a pas répudié sans équivoque le comportement gangstériste dans le milieu.»([20] [837])
Ainsi, à ses débuts, la FECCI était plus que réticente face aux propositions d'ouverture que le cbg avait faites à son égard. Mais depuis, l'eau a coulé sous les ponts de la Tamise, et le même CBG était l'invité d'honneur de la 4e conférence de la FECCI puisqu'entre elle et lui «s’'était dégagé, au cours de précédentes discussions et rencontres, une réelle identité principielle. »([21] [838]) C'est vrai, qu'entre temps, le CBG, après presque neuf ans, avait restitue au CCI le matériel et les fonds dérobés au CCI. La FECCI en avait fait une sorte de préalable : «Sur notre insistance et comme pré condition à la tenue de la rencontre, le cbg marqua son accord sur la restitution au CCI du matériel en sa possession.»([22] [839]) Comme on peut donc le voir, ce n'est pas parce qu'il serait devenu d'un seul coup honnête que le cbg nous a restitue ce qu'il avait volé. Il a tout simplement acheté, au sens propre et en Livres Sterling, sa respectabilité aux yeux de la fecci qui était prête, dès lors à les fermer sur son « comportement gangstériste » (comme elle l'écrivait elle-même) du passé. Ainsi, la fecci s'est comportée comme une fille de bonne famille qui, craignant de rester célibataire après plusieurs échecs sentimentaux,([23] [840]) est prête à accepter les avances d'un ancien voyou. Mais comme elle « a de l'honneur», elle exige, avant de se fiancer, que son prétendant restitue à ses victimes le produit de ses larcins. Décidément, même si la fecci estime que l'opportunisme ne peut plus exister dans la période de décadence, elle est un vivant exemple du contraire. Et cela d'autant plus que la FECCI elle-même affirmait que ce qu'elle reprochait (évidemment à tort) au CCI était la marque de la tendance de 1981 : «Beaucoup d'aspects de la dégénérescence programmatique du CCI en 1985 (la recherche d'une influence immédiate, la tendance au substitutionnisme, le flou sur la nature de classe du syndicalisme de base, etc.) sont précisément des points qui étaient défendus par Chénier et d'autres scissionnistes en 1981. »([24] [841])
En fin de compte, ce n'est évidemment pas un hasard si, aujourd'hui, la FECCI opère un regroupement parfaitement opportuniste avec un groupe que tout le CCI (y compris les camarades de la future fecci) reconnaissait comme «parasitaire». C'est que la FECCI, ne se distingue fondamentalement pas du cbg (sinon qu'elle savait qu'on ne doit pas voler le matériel des organisations révolutionnaires). Tous les deux sont fondamentalement des groupes parasites, qui ne correspondent nullement à un effort historique, aussi imparfait soit-il, du prolétariat et de ses organisations politiques vers sa prise de conscience, et dont la seule raison d'existence est justement de «parasiter» (au sens propre de tirer sa substance en prélevant celle des autres et en les affaiblissant) les véritables organisations du prolétariat.
Une des preuves que la fecci n'a pas d'existence autonome, en tant que groupe politique, vis-à-vis du CCI, c'est que sa publication est constituée pour plus d'un tiers en moyenne (et quelques fois dans sa presque totalité) d'articles attaquant et dénigrant notre organisation.([25] [842]) Cette démarche parasitaire permet également de comprendre es énormes difficultés rencontrées par la fecci pour comprendre les véritables enjeux des événements de l'Est : comme il lui fallait à tout prix se distinguer du CCI pour justifier son existence (et «démontrer » la dégénérescence du CCI), elle n'a pu raconter que des âneries dans la mesure où le CCI a été la première organisation du milieu politique à appréhender correctement ces enjeux. La seule chance (et encore) pour la fecci de dire quelque chose de sensé aurait été que nous fassions fausse route. C'était quand même trop nous demander. En fait, c'est le propre des groupes parasites que de sombrer dans l'incohérence et les analyses aberrantes et cela d'autant plus que l'organisation de référence à des positions correctes et cohérentes, l'opposition systématique contre la cohérence ne peut que donner n'importe quoi.([26] [843])
D'ailleurs, le caractère parasitaire de la fecci apparaît dans son nom même. Pour l’ouvrier qui est peu informé des arcanes du milieu politique, rencontrer une publication ou un tract signé d'une organisation qui se réfère au CCI sans être le CCI ne peut que semer le trouble. Les absurdités écrites par la fecci risquent d'être imputées à tort à notre organisation et même si la FECCI écrit des choses correctes (cela lui arrive quelquefois puisque sa plate-forme est celle du CCI), il ne peut qu'aboutir à la conclusion que les révolutionnaires sont des gens peu sérieux qui prennent un malin plaisir à semer la confusion.
Fondamentalement, la fonction de tels groupes est d'amoindrir l'action des organisations révolutionnaires dans la classe, de discréditer les idées révolutionnaires elles-mêmes. C'est pour cela que nous estimons aujourd'hui encore, comme en 1986 que : «Comme à l'égard du CBG, nous pouvons écrire à propos de la FECCI : " Voila un autre groupe dont l'existence est parasitaire. La meilleure chose que nous puissions souhaiter pour la classe ouvrière de même que pour les camarades qui la composent, c'est la disparition la plus rapide possible de la FECCI. " »([27] [844])
Et si, décidément, la fecci n'est pas résolue à rendre ce service à la classe ouvrière nous pouvons lui demander au moins de nous lâcher les basques et de cesser de faire référence à notre organisation dans son propre nom : cela éviterait au CCI de continuer d'endosser le discrédit qu'apportent à son nom les stupidités et l'opportunisme de la FECCI.
FM, mars 92.
[1] [845] « Pourquoi la Fraction », PI n° 3.
[2] [846] « Les tâches de la fraction », PI n° 1.
[3] [847] « Les bouleversements en Europe de l'Est », supplément à PI n° 15.
[4] [848] « ..quelle que soit l’évolution future de la situation dans les pays de l'Est, les événements qui les agitent actuellement signent la crise historique, l’effondrement définitif du stalinisme, cette monstruosité symbole de la plus terrible contre-révolution qu'ait subie le prolétariat. Dans ces pays s'est ouverte une période d'instabilité, de secousses, de convulsions, de chaos sans précédent dont les implications dépasseront très largement leurs frontières. En particulier, l'effondrement qui va encore s'accentuer du bloc. russe ouvre les portes à une déstabilisation du système de relations internationales, des constellations impérialistes, qui étaient sortis de la seconde guerre mondiale avec les accords de Yalta. ...) Les événements qui agitent à l'heure actuelle les pays dits "socialistes", la disparition défait au bloc russe, (...) constituent le fait historique le plus important depuis la seconde guerre mondiale avec le resurgissement international du prolétariat à la fin des années 60. » (Thèses sur la crise économique et politique en URSS et dans les pays de l'Est, RInt n° 60)
«La configuration géopolitique sur laquelle a vécu le monde depuis la seconde guerre mondiale est désormais complètement remise en cause par les événements qui se sont déroulés au cours de la seconde moitié de l’année 1989. Il n'existe plus aujourd'hui deux blocs impérialistes se partageant la mainmise sur la planète. (...) à l'heure actuelle, un cours vers la guerre mondiale est exclu du fait de l'inexistence de deux blocs impérialistes. » (« Après l'effondrement du bloc de l'Est, déstabilisation et chaos », RInt n° 61)
[5] [849] Pour mémoire, ce texte est écrit alors que les seuls régimes staliniens d’Europe à conserver leur pouvoir passé sont ceux d’Albanie te de Hongrie.
[6] [850] Résolution de la fecci sur les bouleversements en Europe de l'Est, supplément à PIn°15.
[7] [851] Voir « Face aux bouleversements à l'Est, une avant-garde en retard », RInt n° 62.
[8] [852] Cependant, on peut dire que, d'une certaine façon, les événements de l'Est ont quand même donné raison à la fecci sur certains points : comme nous l'avions prévu depuis le début dans notre analyse, ces événements ont effectivement provoqué la division du bloc occidental et de la CEE. Mais il est fort peu probable que ce fut de cette façon-là que l'ait planifié Gorbatchev; à moins de considérer qu'il ait adopté l'attitude du mari trompé qui se suicide pour plonger sa femme dans la culpabilité et le désespoir... La fecci pourrait réfléchir à cette hypothèse dans le cadre de sa problématique de la femme battue, partie prenante de son effort pour « approfondir le marxisme».
[9] [853] «Antagonismes inter impérialistes : une orientation pour les années 90». Comme souvent, la fecci fait dans l'humour involontaire. Compte tenu du fait qu'elle avait été obligée de modifier son analyse tout au long des deux ans qui s'étaient écoulés (pratiquement à chacune de ses publications de PI, mais sans que cela lui permette de dégager une analyse correcte), proposer une orientation pour toute une décennie faisait figure d'acte de démence. Si la présomption de la fecci n'était pas aussi hypertrophiée qu'est rachitique sa capacité d'analyse, en d'autres mots, si elle avait un tout petit peu le sens du ridicule, elle aurait dû proposer «une orientation pour le prochain trimestre», c'est-à-dire jusqu'à la parution suivante de sa revue. Elle se serait évitée ainsi le désagrément de devoir invalider dès PI n°21 (sans toutefois le reconnaître) les prévisions à long terme de PI n°20.
[10] [854] Pour ne pas mentir, il faut bien dire que la fecci, dans la présentation de sa conférence, évoque tout de même le bloc de l'Est : «le COMECON a disparu en tant que système de rapport impérialiste entre la tête de bloc, l'URSS, et ses satellites qui ont cessé d'être de simples vassaux ». C'est clair, ça au moins ! C'est clair que la fecci veut noyer le poisson. Le COMECON a disparu, certes (c'est bien de constater ce que celui-ci a lui- même annoncé officiellement), mais subsiste-t-il un autre «système de rapport impérialiste entre... l'URSS et ses satellites»'} Mystère. De quel «bloc» s'agit-il? De celui qui a disparu, ou de celui qui subsisterait encore sous d'autres formes ? Au lecteur de deviner. Et que sont devenus les satellites ? Des vassaux quand même mais «pas simples» ? Quand la fecci cessera-t-elle de prendre les lecteurs de sa revue pour des simples d'esprit ?
[11] [855] Il n'y a pas de limites à la nullité et à l'ignorance théoriques de la fecci (surtout quand elle se propose d'épingler le cci). Ainsi, dans PIn° 1 / («Saisir la signification des événements en Europe de l'Est») on peut lire que : « la théorie du capitalisme d'Etat est basée sur l'existence de blocs militaires». C'est une idiotie. Les deux phénomènes ont bien une origine commune : l'impérialisme et, plus globalement, la décadence capitaliste, mais cela ne signifie pas qu'ils soient liés entre eux par un lien de cause à effet. Si la rougeole provoque à la fois des boutons et de la fièvre, faut-il en conclure que ce sont les boutons qui sont responsables de la fièvre ? Dans ce même article, la fecci ironise finement: «Il est étrange de conjecturer la fin d'un bloc impérialiste tout entier sans qu’un seul coup de feu ait été tiré. Chaque bloc serait sans aucun doute transporté de joie si l'autre devait venir à disparaître en raison des seuls effets de la crise, sans avoir à tirer un missile. Pensez au temps et à l'énergie qui pourraient ainsi être épargnés ! » Et oui, c est «étrange» ! Surtout pour ceux qui écrivent que : «L'histoire avance, pose de nouveaux problèmes, pose d'anciens problèmes sous une forme nouvelle». Mais c'est arrivé, même s'il a fallu deux ans aux auteurs de ces bonnes paroles pour s'en rendre compte. Pensons au temps et à l'énergie qui pourraient être épargnés aux organisations révolutionnaires (et à la classe ouvrière) si elles n'étaient pas encombrées de parasites stupides et prétentieux comme la fecci ! Et comme l'ironie mal à propos semble être le fort de la fecci, et particulièrement de l'auteur des lignes qui précèdent (JA), nous avons encore droit dans PI n° 20, du même auteur, a une pique du même calibre : «Certains nous chantent même que la rivalité impérialiste entre le bloc U. S. et le bloc russe est une affaire du passé. On n'arrête pas le progrès !» (« Pour une pratique vivante du marxisme») Trois mois après, c'est la fecci elle-même qui chante (mieux vaut tard que jamais !) la même chanson. Mais en comprend-elle les paroles ?
[12] [856] Voir PI n° 16, où il semble qu'il y ait autant de positions que de membres de la fecci (ce qui confirme que cette dernière reproduit la même hétérogénéité qui existait déjà dans l'ancienne "tendance").
[13] [857] Il faut noter que, dans les deux textes (celui de la fecci et celui de la minorité d'alors) de décembre 89 prenant position sur les événement de l'Est (supplément à PI n° 15), il n'est fait AUCUNE référence au document « Thèses sur Gorbatchev » publié dans PI n° 14 et qui était censé représenter le cadre de compréhension de la «perestroïka » En particulier, il n'est nullement évoqué la question du passage de la « domination formelle à la domination réelle du capital» qui constitue un nouveau dada de la fecci (voir dans la Revue n° 60 notre article de réfutation des élucubrations de la fecci et d'autres groupes sur cette question) et qui est présentée par elle comme un de ses grands « apports théoriques ». De toute évidence les « découvertes » de la fecci ne lui étaient pas d'un grand usage pour comprendre le monde d'aujourd’hui. Ce n'est qu'ultérieurement, qu'elle a essayé de recoller les morceaux en y faisant, sans trop de conviction, de nouveau référence.
[14] [858] RInt 61, « Après l'effondrement du bloc de l'Est, déstabilisation et chaos », janvier 1990.
[15] [859] «Antagonismes inter-impérialistes : une orientation pour les années 90 », PI n° 20.
[16] [860] PI n°20, Présentation de la IV^ conférence de PI.
[17] [861] Il existe évidemment une différence fondamentale entre la façon dont la fecci est parvenue à comprendre les enjeux et les implications des événements de l'Est et la façon dont le CCI l'avait fait il y a deux ans et demi. C'est de manière totalement empirique, sous la poussée massive de réalités irréfutables, que la fecci a fini par reconnaître une réalité. En revanche, si le CCI a réussi à identifier cette nouvelle réalité historique alors même que les manifestations en passaient encore pratiquement inaperçues pour la totalité des observateurs (qu'ils appartiennent au camp capitaliste ou même au camp prolétarien), ce n’est pas en faisant appel a un médium ou aux prédictions de Nostradamus. C'est en se basant sur son cadre d'analyse antérieur et en s'appuyant fermement sur la démarche marxiste lorsqu'il a fallu reconsidérer certains aspects de ce cadre. Empirisme (dans le meilleur des cas) contre méthode marxiste, voilà la véritable distinction entre la fecci et le CCI sur le plan de la réflexion théorique.
[18] [862] Pour avoir une petite idée du niveau de la kpolémique» tel que l'entendait le cbg, voici un tout petit extrait de sa prose de l'époque : «un processus de manoeuvres dans lequel X et sa compagne de lit d'alors,Y, jouèrent un rôle proéminent » [a process of manoeuvring in which X and his then bed-fellow Y played a proéminent part] (« Lettre ouverte au milieu prolétarien sur l'affaire Chénier », The Bulletin n° 1).
[19] [863] RInt n°36, "Adresse du 5e congrès du CCI aux groupes politiques prolétariens : réponse aux réponses [864]".
De façon quelque peu ironique, cet article a été écrit par JÀ, aujourd'hui membre de la fecci et principal procureur de notre organisation dans les colonnes de PI, lorsqu'elle défendait les principes du CCI. Nous lui souhaitons bien du plaisir, ainsi qu'aux « voyous » du cbg, dans les relations étroites qui se développent à l'heure actuelle entre la fecci et le cbg.
[20] [865] PI n° 3, « Les incompréhensions face à notre existence ».
[21] [866] PI n° 20.
[22] [867] PI n°15, «Compte-rendu d'une rencontre avec le cbg ».
[23] [868] Voir dans PI n° 13 (« Revue Internationale du Mouvement communiste : Les Limites d'une initiative») ses déboires dans ses tentatives de participation, en 87, à un rapprochement entre différents reliquats de groupes politiques confus et parasitaires. 4. PI n6 3, « Les incompréhensions face à notre existence».
[24] [869] PI n6 3, « Les incompréhensions face à notre existence».
[25] [870] C'est pour cela qu'on a du mal à la croire lorsqu'elle écrit : « Nous avons donc accentué notre critique de la manière dépenser et d'agir du CCI, ... non par plaisir d'assouvir des rancoeurs obsessionnelles "anti-CCI " mais par soucis révolutionnaire » (PI n° 10, « Quelle lutte pour les comités ouvriers »)
[26] [871] C'est faute de place que cet article, rédigé en mars 92, n est pas paru dans le précédent numéro de notre Revue. Depuis, la fecci a publié un nouveau numéro de PI que nous ne pouvions pas évoquer sans allonger encore notre article. Cependant, il vaut la peine de citer un texte de PI n° 22, rédigé par un ancien membre de la fecci, et qui connaît bien l'état d'esprit qui la domine : «La Fraction ne veut pas utiliser la notion de décomposition, sans doute parce que ce serait aller dans le sens du CCI (souligné par nous). On comprend mal pourquoi ta Fraction critique l'emploi du terme décomposition " et accuse le CCI de sortir du cadre au marxisme quand cette organisation utilise et développe cette notion. Tout se passe comme s'il y avait une orthodoxie de la décadence, une invariance de la décadence sur laquelle il serait malséant de revenir. De critique, la pensée devient immobilisme, passe-partout essayant péniblement d'ouvrir les énigmes... De la sorte, on prépare et on se dirige tout droit vers une situation analogue à celle causée par nos insuffisances d'analyse des événements à l'Est. On s'est rendu compte de la disparition du bloc de l'Est avec deux années de retard; on se rendra compte de la réalité de la décomposition sociale avec un retard tout aussi accablant. » (« Décadence du capitalisme, décomposition sociale et révolution»). Nous ne saurions mieux dire !
[27] [872] RInt n°45, «La Fraction externe du CCI».
Conscience et organisation:
Courants politiques:
Revue internationale no 71 - 4e trimestre 1992
- 3044 reads
Documents de la Gauche communiste - Bilan, 1935
- 37 reads
L'actualité de la méthode de Bilan
A l'occasion des forts résultats électoraux des partis de l'extrême-droite en France, en Belgique, en Allemagne, en Autriche, ou lors de violentes ratonnades pogromistes de bandes d'extrême-droite plus ou moins manipulées, contre les immigrés et réfugiés dans l'ex-RDA, la propagande de la bourgeoisie « démocratique », partis de gauche et gauchistes en tête, a de nouveau brandi le spectre d'un « danger fasciste ».
Comme à chaque fois que la racaille raciste et xénophobe de l'extrême-droite sévit, c'est le choeur unanime de la réprobation des « forces démocratiques » qui s'élève, toutes tendances politiques confondues. Avec force publicité, tout le monde stigmatise les succès « populaires » de l'extrême-droite aux élections, et déplore la passivité de la population, complaisamment présentée comme de la sympathie, envers les agissements répugnants des sbires de cette mouvance. L'Etat « démocratique » peut alors faire apparaître sa répression comme garante des « libertés », la seule force capable d'enrayer le fléau du racisme, de conjurer le retour de l'horreur du fascisme de sinistre mémoire. Tout cela fait partie de la propagande de la classe dominante, qui multiplie les appels à la « défense de la démocratie » capitaliste, dans la continuité des campagnes idéologiques qui chantent le « le triomphe du capitalisme et la fin du communisme ».
Ces campagnes « anti-fascistes » reposent en fait en grande partie, sur deux mensonges : le premier qui prétend que les institutions de la démocratie bourgeoise et les forces politiques qui s'en réclament, constitueraient un rempart contre les « dictatures totalitaires » ; le deuxième qui fait croire que des régimes de type fasciste pourraient surgir aujourd'hui dans les pays d'Europe occidentale.
Face à ces mensonges, la lucidité des révolutionnaires des années 1930 permet de mieux comprendre ce qu'il en est dans le cours historique actuel, comme le montre l'article de Bilan, dont nous reproduisons ci-dessous des extraits.
Cet article fut écrit il y a près de 60 ans, en pleine période de victoire du fascisme en Allemagne et un an avant l'instauration du Front populaire en France. Les développements qu'il contient sur l'attitude des « forces démocratiques » face à la montée du fascisme en Allemagne, ainsi que sur les conditions historiques du triomphe de tels régimes, demeurent pleinement d'actualité dans le combat contre les porte-parole de l' « anti-fascisme. »
La Fraction de gauche du Parti Communiste d'Italie, contrainte à l'exil (en particulier en France) par le régime fasciste de Mussolini, défendait, à contre-courant de tout le « mouvement ouvrier » de l'époque, la lutte indépendante du prolétariat pour la défense de ses intérêts et de sa perspective révolutionnaire : le combat contre le capitalisme dans son ensemble.
Contre ceux qui prétendaient que les prolétaires devaient soutenir les forces bourgeoisies démocratiques pour empêcher l'arrivée du fascisme, Bilan démontrait dans les faits, comment les institutions et les forces politiques « démocratiques », loin de s'être dressées en Allemagne en rempart contre la montée du fascisme, firent le lit de celui : « ... de la Constitution de Weimar à Hitler se déroule un processus d'une continuité parfaite et organique. » Bilan établissait que ce régime n'était pas une aberration, mais une des formes du capitalisme, une forme rendue possible et nécessaire par les conditions historiques : « ... le fascisme s'est donc édifié sur la double base des défaites prolétariennes et des nécessités impérieuses d'une économie acculée par une crise économique profonde. »
Le fascisme en Allemagne, tout comme « la démocratie des pleins pouvoirs » en France, traduisaient l'accélération de l'étatisation (de la « disciplinisation », dit Bilan) de la vie économique et sociale du capitalisme des années 1930, capitalisme confronté à une crise économique sans précédent qui exacerbait les antagonisme inter-impérialistes. Mais ce qui déterminait que cette tendance se concrétisait sous la forme du « fascisme », et non sous celle d'une « démocratie des pleins pouvoirs », se situait au niveau du rapport de forces entre les deux principales forces de la société : la bourgeoisie et la classe ouvrière. Pour Bilan, l'établissement du fascisme reposait sur une défaite préalable, physique et idéologique, du prolétariat. Le fascisme en Allemagne et en Italie avait pour tâche l'achèvement de l'écrasement du prolétariat entrepris par la « social-démocratie. »
Ceux qui aujourd'hui prêchent la menace imminente du fascisme, outre qu'ils reproduisent la politique anti-prolétarienne des « antifascistes » de l'époque, « oublient » cette condition historique mise en lumière par Bilan. Les actuelles générations de prolétaires, en particulier en Europe occidentale, n'ont été ni défaites physiquement ni embrigadées idéologiquement. Dans ces conditions, la bourgeoisie ne peut se passer des armes de « l'ordre démocratique ». La propagande officielle ne brandit l'épouvantail du monstre fasciste que pour mieux enchaîner les exploités à l'ordre établi de la dictature capitaliste de la « démocratie. »
Dans ses formulations, Bilan parle encore de l'URSS comme d'un « Etat ouvrier » et des Partis Communistes comme des partis « centristes. » Il faudra en effet attendre la seconde guerre mondiale pour que la Gauche italienne assume entièrement l'analyse de la nature capitaliste de l'URSS et des partis staliniens. Cependant, cela n'empêcha pas ces révolutionnaires, dès les années 1930, de dénoncer vigoureusement et sans hésitation les staliniens comme des forces « travaillant à la consolidation du monde capitaliste dans son ensemble. », « un élément de la victoire fasciste ». Le travail de Bilan se situait en pleine débâcle de la lutte révolutionnaire du prolétariat, au tout début de la gigantesque tâche théorique que représentait l'analyse critique de la plus grande expérience révolutionnaire de l'histoire : la révolution Russe. Il était encore imprégné de confusions liées à l'énorme attachement des révolutionnaires à cette expérience unique, mais il constitua un moment précieux et irremplaçable de la clarification politique révolutionnaire. Il fut une étape cruciale dont reste entièrement vivante aujourd'hui la méthode, celle qui consiste à analyser sans concessions la réalité en se situant toujours du point de vue historique et mondial de la lutte prolétarienne.
CCI.
- Allemagne - L'écrasement du prolétariat allemand et l'avènement du fascisme (BILAN n°16, mars 1935) [873]
- Sous le signe du 14 juillet
« C'est sous le signe d'imposantes manifestations de masses que le prolétariat français se dissout au sein du régime capitaliste. Malgré les milliers d'ouvriers défilant dans les rues de paris, on peut affirmer que pas plus en France qu'en Allemagne ne subsiste une classe prolétarienne luttant pour ses objectifs historiques propres. A ce sujet le 14 juillet marque un moment décisif dans le processus de désagrégation du prolétariat et dans la reconstitution de l'unité sacro-sainte de la Nation capitaliste. Ce fut vraiment une fête nationale, une réconciliation officielle des classes antagonistes, des exploiteurs et des exploités ; ce fut le triomphe du républicanisme intégral que la bourgeoisie loin d'entraver par des services d'ordre vexatoires, laissa se dérouler en apothéose. Les ouvriers ont donc toléré le drapeau tricolore de leur impérialisme, chanté la Marseillaise, et même applaudi les Daladier, Cot, et autres ministres capitalistes qui avec Blum, Cachin ont solennellement juré de "donner du pain aux travailleurs, du travail à la jeunesse et la paix au monde" ou, en d'autres termes, du plomb, des casernes et la guerre impérialiste pour tous. »
Bilan n° 21, juillet-août 1935
Géographique:
- Allemagne [98]
Questions théoriques:
- Guerre [129]
Situation internationale : derrière les opérations « humanitaires », les grandes puissances font la guerre.
- 3025 reads
A travers les reportages « live » des télévisions, la barbarie du monde actuel s'est installée de façon quotidienne dans des centaines de millions de foyers. Camps de « purification ethnique » et massacres sans fin dans /'ex-Yougoslavie, au coeur de l'Europe « civilisée », famines meurtrières en Somalie, nouvelle incursion des grandes puissances occidentales au dessus de l'Irak : la guerre, la mort, la terreur, voilà comment se présente « l'ordre mondial » du capital en cette fin de millénaire. Si les médias nous renvoient une image aussi insoutenable de la société capitaliste, ce n'est certainement pas, évidemment, pour inciter la seule classe qui puisse la renverser, le prolétariat, à prendre conscience de sa responsabilité historique et à engager les combats décisifs dans cette direction. C'est au contraire, avec les campagnes « humanitaires » qui entourent ces tragédies, pour tenter de le paralyser, pour lui faire croire que les puissants de ce monde se préoccupent sérieusement de la situation catastrophique dans laquelle se trouve ce dernier, qu'ils font tout ce qui est nécessaire, ou tout au moins possible, pour guérir ses plaies. C'est aussi pour masquer les sordides intérêts impérialistes qui animent leur action et pour lesquels elles se déchirent. C'est donc pour couvrir d'un écran de fumée leur propre responsabilité dans la barbarie actuelle et justifier de nouvelles escalades dans celle-ci.
Depuis plus d'un an, ce qui avant s'appelait la Yougoslavie est à feu et à sang. La liste des villes martyres s'allonge mois après mois : Vukovar, Osijek, Dubrovnik, Gorazde et, maintenant, Sarajevo. De nouveaux charniers sont ouverts alors que les anciens ne sont pas encore refermés. On compte déjà- plus de deux millions de réfugiés sur les routes. Au nom de la « purification ethnique », on a vu se multiplier des camps de concentration pour les soldats prisonniers mais aussi pour les civils, des camps où Ton affame, torture, pratique les exécutions sommaires. A Quelques centaines de kilomètres es grandes concentrations industrielles d'Europe occidentale, le « nouvel ordre mondial », annoncé par Bush et autres grands « démocrates » lors de l'effondrement des régimes staliniens d'Europe, nous dévoile une nouvelle fois son vrai visage : celui des massacres, de la terreur, des persécutions ethniques.
La barbarie impérialiste en Yougoslavie
Les gouvernements des pays avancés et leurs médias aux ordres n'ont eu de cesse de présenter la barbarie qui se déchaîne dans l'ex-Yougoslavie comme le résultat des haines ancestrales qui opposent les différentes populations de ce territoire. Et c'est vrai que, à l'image des autres pays anciennement dominés par des régimes staliniens, notamment l'ex-URSS, le corset de fer qui étreignait ces populations n'a nullement aboli les vieux antagonismes perpétués par l'histoire. Bien au contraire, alors qu'un développement tardif du capitalisme dans ces régions ne leur avait pas permis de connaître un réel dépassement des anciennes divisions léguées par la société féodale, les soi-disant régimes « socialistes » n'ont fait que maintenir et exacerber ces divisions. Le dépassement de celles-ci ne pouvait être réalisé que par un capitalisme avancé, par une industrialisation poussée, par le développement d'une bourgeoisie forte économiquement et politiquement, capable de s'unifier autour de l'Etat national. Or, les régimes staliniens n'ont présenté aucune de ces caractéristiques.
Comme les révolutionnaires l'avaient souligné depuis longtemps, ([1] [874]) et comme il s'est confirmé de façon éclatante ces dernières années, ces régimes étaient à la tête de pays capitalistes peu développés, avec une bourgeoisie particulièrement faible et qui portait, jusqu'à la caricature, tous les stigmates de la décadence capitaliste ayant présidé à sa constitution ([2] [875]). Née de la contre-révolution et de la guerre impérialiste, cette forme de bourgeoisie avait pour piliers pratiquement uniques de son pouvoir la terreur et la force des armes. De tels instruments lui ont donné pendant un certain nombre de décennies l'apparence de la puissance et ont pu laisser croire qu'elle était venue à bout des vieux clivages nationalistes et ethniques existant auparavant. Mais en réalité, le monolithisme qu'elle affichait était loin de recouvrir une réelle unité dans ses rangs. C'était au contraire la marque de la permanence des divisions entre les différentes cliques qui la composaient, des divisions que seule la poigne de fer du parti-Etat était en mesure d'empêcher qu'elles ne conduisent à un éclatement. L'explosion immédiate de l'URSS en autant de républiques dès lors que s'était effondré son régime stalinien, le déchaînement au sein de ces républiques d'une multitude de conflits ethniques (arméniens contre azéris, ossètes contre géorgiens, tchétchènes-ingouches contre russes, etc.) sont venus exprimer que la mise sous l'étouffoir de ces divisions n'avait permis que leur exacerbation. Et c'est par le même moyen qu'elles avaient été contenues, la force des armes, qu'elles tendent aujourd'hui à s'exprimer.
Cela dit, l'effondrement du régime stalinien dans l'ex-Yougoslavie ne suffit pas, à lui seul, à expliquer la situation actuelle dans cette partie du monde. Comme nous l'avons mis en évidence, cet effondrement était lui-même, comme celui de l'ensemble des régimes du même type, une manifestation de la phase ultime de la décadence du mode de production capitaliste, la phase de décomposition ([3] [876]). On ne peut comprendre la barbarie et le chaos qui se déchaînent aujourd'hui de par le monde, et en ce moment même dans les Balkans, qu'en faisant intervenir cet élément historique inédit que constitue la décomposition : le « nouvel ordre mondial » ne peut être qu'une chimère, c'est de façon irréversible que le capitalisme a plongé la société humaine dans le plus grand chaos de l'histoire, un chaos qui ne peut déboucher que sur la destruction de l'humanité ou sur le renversement du capitalisme.
Cependant, les grandes puissances impérialistes ne restent pas les bras croisés devant l'avancée de la décomposition. La guerre du Golfe, préparée, provoquée et menée par les Etats-Unis, constituait une tentative de la part de la première puissance mondiale de limiter ce chaos et la tendance au « chacun pour soi » sur lequel débouchait nécessairement l'effondrement du bloc de l'Est. En partie, les Etats-Unis sont parvenus à leurs fins, notamment en renforçant encore leur emprise sur une zone aussi importante que le Moyen-Orient et en obligeant les autres grandes puissance à les suivre, et même à les seconder dans la guerre du Golfe. Mais cette opération de « maintien de l'ordre » a très vite montré ses limites. Au Moyen-Orient même, elle a contribué à raviver le soulèvement des nationalistes Kurdes contre l'Etat irakien (et, sur cette lancée, contre l'Etat turc) de même qu'elle a favorisé une insurrection es populations chiites du sud de l'Irak. Sur le reste de la planète, « l'ordre mondial » s'est révélé très rapidement n'être qu'un miroir aux alouettes, notamment avec le début des affrontements en Yougoslavie au cours de l'été 1991. Et ce que révèlent justement ces derniers, c'est que la contribution des grandes puissances à un quelconque « ordre mondial » non seulement n'est en rien positive mais, qu'au contraire, elle n'a d'autre résultat que d'aggraver le chaos et les antagonismes.
Un tel constat est particulièrement évident en ce qui concerne l'ex-Yougoslavie où le chaos actuel découle directement de l'action des grandes puissances. A l'origine du processus qui a conduit cette région dans les affrontements d'aujourd'hui, il y a la proclamation d'indépendance de la Slovénie et de la Croatie en juin 1991. Or, il est clair que ces deux républiques n'auraient pas pris un tel risque si elles n'avaient reçu un ferme soutien (diplomatique mais aussi en armes) de la part de l'Autriche et de son chef de file, l'Allemagne. En fait, on peut dire que, dans le but de s'ouvrir un débouché en Méditerranée, la bourgeoisie de cette dernière puissance a pris la responsabilité initiale de provoquer l'explosion de l'ex-Yougoslavie avec toutes les conséquences qu'on voit aujourd'hui. Mais les bourgeoisies des autres grands pays n'ont pas été en reste. Ainsi, la riposte violente de la Serbie face à l'indépendance de la Slovénie et surtout face à celle de la Croatie, où vivait une importante minorité serbe, a reçu, dès le début, un ferme soutien de la part des Etats-Unis et de ses alliés européens les glus proches tels que la Grande-Bretagne. On a même vu la France, qui, par ailleurs, s'est alliée à 1 Allemagne pour essayer d'établir avec elle une sorte de condominium sur l'Europe, se retrouver à côté des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne pour apporter son soutien a « l'intégrité de la Yougoslavie », c'est-à-dire, en fait, à la Serbie et à sa politique d'occupation des régions croates peuplées par des serbes. Là aussi, il est clair que sans ce soutien initial, la Serbie se serait montrée beaucoup moins entreprenante dans sa politique militaire, tant face à la Croatie l'an dernier, qu'aujourd'hui face à la Bosnie-Herzégovine. C'est pour cela que la soudaine préoccupation « humanitaire » des Etats-Unis et d'autres grandes puissances face aux exactions commises par les autorités serbes a bien du mal à masquer l'immense hypocrisie qui préside à leurs agissements. La palme revient, d'une certaine façon, à la bourgeoisie française qui, alors qu'elle a continue à entretenir des relations étroites avec la Serbie (ce qui correspondait à une vieille tradition d'alliance avec ce pays), s'est permise d'apparaître comme le champion de l'action « humanitaire » avec le voyage de Mitterrand à Sarajevo en juin 1992 à la veille de la levée du blocus serbe sur l'aéroport de cette ville. Il est évident que ce « geste » de la Serbie avait été négocié en sous-main avec la France pour permettre aux deux pays de tirer le maximum d'avantages de la situation : il permettait au premier d'obtempérer à l'ultimatum de l'ONU tout en sauvant la face et il donnait un bon coup de pouce à la diplomatie du second dans cette partie du monde, une diplomatie qui essaye de jongler entre celles des Etats-Unis et de l'Allemagne.
En fait, l'échec de la récente conférence de Londres sur l'ex-Yougoslavie, un échec avéré par la poursuite des affrontements sur le terrain, ne fait qu'exprimer l'incapacité des grandes puissances à se mettre d'accord du fait de l'antagonisme de leurs intérêts. Si toutes se sont entendues pour faire de grandes déclarations sur les besoins « humanitaires » (il faut bien sauver la face) et sur une condamnation du « mouton noir » serbe, il est clair que chacune a sa propre approche de la « solution » des affrontements dans les Balkans.
D'un côté, la politique des Etats-Unis vise à faire contrepoids à celle de l'Allemagne. Il s'agit, pour la première puissance mondiale, de tenter de limiter l'extension de la Croatie pro-allemande et, en particulier, de préserver, autant que possible, l'intégrité de la Bosnie-Herzégovine. Une telle politique, qui explique le soudain revirement de la diplomatie US contre la Serbie, au printemps 92, a pour objet de priver les ports croates de Dalmatie de leur arrière-pays lequel appartient à la Bosnie-Herzégovine. En outre, le soutien à ce dernier pays, où les musulmans sont majoritaires, ne peut que faciliter la politique américaine en direction des Etats musulmans. En particulier, il vise à ramener dans le giron américain une Turquie qui se tourne de plus en plus en direction de l’Allemagne.
D'un autre côté, la bourgeoisie allemande n'est nullement intéressée au maintien de l'intégrité territoriale de la Bosnie-Herzégovine. Au contraire, elle est intéressée à une partition de celle-ci, avec une mainmise croate sur le sud du pays, comme c'est déjà le fait aujourd'hui, afin que les ports dalmates disposent d'un arrière pays plus large que l'étroite bande de terrain appartenant officiellement à la Croatie. C'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'il existe à l'heure actuelle une complicité de fait entre les deux ennemis d'hier, la Croatie et la Serbie, en faveur du démembrement de la Bosnie-Herzégovine. Cela ne veut pas dire, évidemment, que l'Allemagne soit prête à se ranger du côté de la Serbie qui demeure « l'ennemie héréditaire » de son alliée croate. Mais, en même temps, elle ne peut que voir d'un mauvais oeil toutes les gesticulations « humanitaires » dont il clair qu'elles visent, en premier lieu, les intérêts du capital allemand dans la région.
Pour sa part, la bourgeoisie française essaye de jouer sa propre carte, à la fois contre la perspective d'un renforcement de l'influence américaine dans les Balkans et contre la politique de l'impérialisme allemand d'ouverture d'un débouché sur la Méditerranée. Son opposition à cette dernière politique ne signifie pas que soit remise en cause l'alliance entre l'Allemagne et la France. Elle signifie seulement que ce dernier pays tient à conserver un certain nombre d'atouts qui lui soient propres (comme la présence d'une flotte en Méditerranée dont est privée pour le moment la puissance germanique) afin que son association avec son puissant voisin ne débouche pas sur une simple soumission à celui-ci. En fait, au delà des contorsions autour des thèmes humanitaires et des discours dénonçant la Serbie, la bourgeoisie française reste le meilleur allié occidental de ce dernier pays dans l'espoir de disposer de sa propre zone d'influence dans les Balkans.
Dans un tel contexte de rivalités entre les grandes puissances, il ne peut y avoir de solution «pacifique» dans l'ex-Yougoslavie. La concurrence à laquelle se livrent ces puissances dans le domaine de l'action « humanitaire » n'est jamais que la prolongation et la feuille de vigne de leur concurrence impérialiste. Dans ce déchaînement des antagonismes entre Etats capitalistes, la première puissance mondiale a tenté d'imposer sa « pax americana» en prenant la tête des menaces et de l'embargo contre la Serbie. En fait, c'est la seule puissance qui soit en mesure de porter des coups décisifs au potentiel militaire de ce pays et à ses milices grâce à son aviation de guerre basée sur les porte-avions de la 6e flotte. Mais, en même temps, les Etats-Unis ne sont pas disposés à engager leurs troupes terrestres afin de mener une guerre conventionnelle contre la Serbie. Sur le terrain, la situation est loin de ressembler à celle de l'Irak qui avait permis la chevauchée triomphale des GI's il y a un an et demi. Cette situation est devenue, grâce à la contribution de tous les requins impérialistes, tellement inextricable qu'elle risque de constituer un véritable bourbier dans lequel même la première armée du monde risquerait de s'enliser, à moins de procéder à des massacres de grande envergure sans commune mesure avec ceux d'aujourd'hui. C'est pour cela que, pour le moment, même si une intervention aérienne « ciblée » n'est pas à exclure, les menaces répétées des Etats-Unis contre la Serbie n'ont pas été suivies de mise en pratique. Elles ont essentiellement servi, jusqu'à présent, à « forcer la main », dans le cadre de l'ONU, aux «alliés» récalcitrants de cette puissance (notamment la France) afin de leur faire voter les sanctions contre la Serbie. Elles ont eu également pour «mérite», du point de vue américain, de mettre en relief la totale impuissance de « l'Union européenne » face à un conflit se déroulant dans sa zone de compétence et donc de dissuader les Etats qui pourraient rêver d'utiliser cette structure pour s'acheminer vers la constitution d'un nouveau bloc impérialiste rival des Etats-Unis de renoncer à une telle démarche. En particulier, cette attitude américaine a eu pour effet de raviver les plaies au sein de l'alliance franco-allemande. Enfin, cette attitude menaçante de la puissance américaine constitue également un rappel à l'ordre à deux pays importants de la région, l'Italie et la Turquie, ([4] [877]) qui sont aujourd'hui tentés par un rapprochement avec le pôle impérialiste allemand au détriment de l'alliance avec les Etats-Unis.
Cependant, si la politique de l'impérialisme américain à l'égard de la question yougoslave a réussi à atteindre certains de ses objectifs, c'est surtout en attisant les difficultés de ses rivaux mais non par une affirmation massive et incontestable de la suprématie des Etats-Unis sur ces derniers. Et c'est justement une telle affirmation que cette puissance est allée chercher dans le ciel d'Irak.
En Irak comme ailleurs, les Etats-Unis réaffirment leur vocation de gendarme du monde
Il faut être particulièrement naïf ou bien soumis corps et âme aux campagnes idéologiques pour croire à la vocation « humanitaire » de la présente intervention « alliée » contre l'Irak. Si vraiment la bourgeoisie américaine et ses complices s'étaient le moins du monde préoccupées du sort des populations de l'Irak, elles auraient commencé par ne pas apporter un ferme soutien au régime irakien lorsque celui-ci faisait la guerre à l'Iran et qu'en même temps il gazait sans retenue les kurdes. Elles n'auraient pas, en particulier, déchaîné, en janvier 1991, une guerre sanguinaire dont la population civile et les soldats appelés ont été les principales victimes, une guerre que l'administration Bush avait délibérément voulue et préparée, notamment en encourageant, avant le 2 août 1990, Saddam Hussein à faire main basse sur le Koweït et en ne lui laissant, par la suite, aucune porte de sortie ([5] [878]). De même, il faut vraiment se forcer pour déceler une vocation humanitaire dans la façon dont les Etats-Unis ont mis fin a la guerre du Golfe, lorsqu'ils ont laissée intacte la Garde républicaine, c'est-à-dire les troupes d'élite de Saddam Hussein, qui s'est empressée de noyer dans le sang les Kurdes et les Chiites que la propagande US avait appelés à se soulever contre Saddam tout au long de la guerre. Le cynisme d'une telle politique a d'ailleurs été relevé par les plus éminents spécialistes bourgeois des questions militaires :
« Ce fut bien une décision délibérée du président Bush de laisser Saddam Hussein procéder à l'écrasement de rébellions qui, aux yeux de l'administration américaine, comportaient le risque d'une libanisation de l'Irak, un coup d'Etat contre Saddam Hussein était souhaité, mais pas le morcellement du pays. » ([6] [879]).
En réalité, la dimension humanitaire de « l'exclusion aérienne » du sud de l'Irak est du même ordre que celle de l'opération menée par les « coalisés » au printemps 1991 dans le nord de ce pays, rendant plusieurs mois, après la fin de la guerre, on avait laissé les Kurdes se faire massacrer par la Garde républicaine ; puis, quand le massacre était bien avancé, on avait créé, au nom de « l'ingérence humanitaire », une « zone d'exclusion aérienne » en même temps qu'on lançait une campagne caritative internationale en faveur des populations kurdes. Il s'agissait alors d'apporter, après coup, une justification idéologique à la guerre du Golfe en mettant en relief combien Saddam était ignoble. Le message qu'on voulait faire passer auprès de ceux qui réprouvaient la guerre et ses massacres était le suivant : « il n'y a pas eu "trop" de guerre mais encore "pas assez" ; il aurait fallu poursuivre l'offensive jusqu'à chasser Saddam au pouvoir». Quelques mois après cette opération ultra-médiatisée, les « humanitaires » de service ont laissé les kurdes à leur sort pour aller passer l'hiver dans leurs foyers. Quant aux chiites, ils n'avaient pas a cette époque bénéficié de la sollicitude des pleureuses professionnelles et encore moins d'une protection armée. De toute évidence, ils avaient été gardés en réserve (c'est-à-dire qu'on avait laissé Saddam continuer à les massacrer et les réprimer) pour qu'on puisse s'intéresser à leur triste sort au moment le plus opportun, lorsque cela servirait les intérêts du gendarme du monde. Et ce moment est justement arrivé.
Il est arrivé avec la perspective des élections présidentielles aux Etats-Unis. Bien que certaines fractions de la bourgeoisie américaine soient en faveur d'une alternance permettant de redonner un peu de tonus à la mystification démocratique, ([7] [880]) Bush et son équipe conservent la confiance de la majorité des secteurs de la classe dominante. Ils ont fait leurs preuves, notamment avec la guerre du Golfe, comme défenseurs avisés du capital national et des intérêts impérialistes des Etats-Unis. Cependant, les sondages indiquent que Bush n'est pas assuré de sa réélection. Aussi, une bonne action d'éclat faisant vibrer la fibre patriotique et rassemblant autour du président de larges couches de la population américaine, comme lors de la guerre du Golfe, est aujourd'hui la bienvenue. Cependant, le contexte électoral ne suffit pas à expliquer une telle action de la bourgeoisie américaine au Moyen-Orient. Si le moment précis choisi pour cette action est déterminé par ce contexte, les raisons profondes de celle-ci dépassent de très loin les contingences domestiques du candidat Bush.
En fait, le nouvel engagement militaire des Etats-Unis en Irak fait partie d'une offensive générale de cette puissance afin de réaffirmer sa suprématie dans l'arène impérialiste mondiale. La guerre du Golfe correspondait déjà à cet objectif et elle a contribué à freiner la tendance au « chacun pour soi » parmi les anciens partenaires des Etats-Unis au sein de feu le bloc occidental. Alors que la disparition, avec celle du bloc russe, de la menace majeure venue de l'Est avait fait pousser des ailes à des pays comme le Japon, l'Allemagne ou la France, « tempête du désert » avait contraint ces mêmes pays à faire acte d'allégeance au gendarme américain. Les deux premiers avaient dû verser des contributions financières importantes et le troisième avait été « invité », en compagnie de toute une série d'autres pays aussi peu enthousiastes que lui (tels l'Italie, l'Espagne ou la Belgique), à participer aux opérations militaires. Cependant, les événements de cette dernière année, et particulièrement l'affirmation par la bourgeoisie allemande de ses intérêts impérialistes en Yougoslavie, ont fait apparaître les limites de l'impact de la guerre du Golfe. D'autres événements sont venus confirmer l'incapacité pour les Etats-Unis d'imposer de façon définitive, ou même durable, la prééminence de leurs intérêts impérialistes. Ainsi, au Moyen-Orient même, un pays comme la France, oui avait été éjecté de la région lors de la guerre du Golfe (perte de son client irakien et élimination de ses positions au Liban avec la prise de contrôle, accordée par les Etats-Unis, de ce pays par la Syrie) tente un certain retour au Liban (entrevue récente entre Mitterrand et le premier ministre libanais, retour au pays de l'ancien président pro-français, Aminé Gemayel). En fait, il ne manque pas au Moyen-Orient de fractions bourgeoises (comme l'OLP par exemple) qui seraient intéressées à un certain allégement du poids d'une suprématie US encore renforcée par la guerre du Golfe. C'est pour cela que, de façon régulière et répétée, les Etats-Unis sont contraints de réaffirmer leur leadership par le moyen dont celui-ci s'exprime le plus clairement, la force des armes.
Aujourd'hui, avec la création d'une « zone d'exclusion aérienne » dans le sud-Irak, les Etats-Unis se permettent de rappeler bien clairement aux Etats de la région, mais aussi et surtout aux autres grandes puissances, que ce sont eux les maîtres. Ce faisant, ils soumettent à leur politique et « mouillent » un pays comme la France (dont la participation à la guerre du Golfe était déjà loin d'être enthousiaste) qui, de son côté, témoigne de son peu d'engouement pour cette action en n'envoyant sur place que quelques avions de reconnaissance. Et au delà de la France, c'est aussi à son principal allié, l'Allemagne, c'est-à-dire le principal rival potentiel des Etats-Unis, que s'adresse le rappel à l'ordre américain.
L'offensive menée à l'heure actuelle par la première puissance mondiale pour remettre au pas ses « alliés » ne s'arrête pas aux Balkans et à l'Irak. Elle s'exprime également dans d'autres « points chauds » du globe comme l'Afghanistan où la Somalie.
Dans ce premier pays, l'offensive sanglante du « Hezb » de Hekmatyar pour s'assurer le contrôle de Kaboul reçoit un soutien résolu de la part du Pakistan et de l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire de deux proches alliés des Etats-Unis. Autant dire que c'est la bourgeoisie américaine qui se trouve, en dernier ressort, derrière l'entreprise d'élimination de l'actuel homme fort de Kaboul, le « modéré » Massoud. Et cela se comprend aisément lorsqu'on sait que ce dernier est le chef d'une coalition comprenant des tadjiks persophones (soutenus par l'Iran dont les relations avec la France sont en train de se réchauffer) et des ouzbeks turcophones (soutenus par la Turquie proche de l'Allemagne). ([8] [881])
De même, le soudain engouement « humanitaire » pour la Somalie recouvre en réalité des antagonismes impérialistes de même type. La corne de l'Afrique est une région stratégique de première importance. Pour les États-Unis, il est prioritaire de contrôler parfaitement cette région et d'en chasser tout rival potentiel. En l'occurrence, un des empêcheurs de dominer en rond est l'impérialisme français qui dispose avec Djibouti d'une base militaire d'importance non négligeable. Aussi, c'est une véritable course de vitesse « humanitaire » qui s'est engagée entre le France et les Etats-Unis pour « porter secours » aux populations somalies (en fait, pour essayer de prendre position dans un pays aujourd'hui à feu et à sang). La France a marqué un point en faisant parvenir la première la fameuse « aide humanitaire » (envoyée justement à partir de Djibouti), mais, depuis, les Etats-Unis, avec tous les moyens dont ils disposent, ont fait parvenir leur propre « aide » dans des proportions sans commune mesure avec celle de leur rivale. En Somalie, pour l'instant, ce n'est pas en tonnage de bombes que se mesure le rapport de forces impérialiste mais en tonnage de céréales et de médicaments ; même si, demain, lorsque la situation aura évolué, on laissera de nouveau les somaliens crever comme des mouches dans l'indifférence générale.
Ainsi, c'est au nom des sentiments « humanitaires », au nom de la vertu que, sur trois continents, le « gendarme du monde » affirme sa conception de «l'ordre mondial». Cela ne l'empêche pas, évidemment, de se conduire en gangster, comme d'ailleurs tous les autres secteurs de la bourgeoisie. Cependant, il est des formes d'action de la bourgeoisie américaine, dont il va de soi qu'elle ne se vante pas spécialement, et qui utilisent directement la pègre, ce que la classe bourgeoise appelle le « crime organisé » (en realité, le principal « crime organisé » est constitué par l'ensemble des Etats capitalistes dont les crimes sont autrement plus monstrueux et « organisés » que ceux de tous les bandits du monde). C'est ce que nous voyons à l'heure actuelle en Italie avec la série d'attentats qui, en deux mois, a coûté la vie de deux juges anti- mafia de Palerme et du chef de la police de Catane. Le « professionnalisme » de ces attentats démontre, et c'est clair pour tout le monde en Italie, qu'un appareil d'Etat, ou des secteurs d'un tel appareil, se trouve derrière. En particulier, la complicité des services secrets chargés d'assurer la sécurité des juges semble avérée. Ces assassinats sont bruyamment utilisés par l'actuelle équipe gouvernementale, par les médias et par les syndicats pour faire accepter aux ouvriers les attaques sans précédent destinées à « assainir » l'économie italienne. Les campagnes bourgeoises associent cet « assainissement » à celui de la vie politique et de l'Etat («pour avoir un Etat sain, il faut se serrer la ceinture») en même temps qu'éclate toute une série de scandales autour de la corruption. Cela dit, dans la mesure où ces attentats contribuent à mettre en relief son impuissance, le gouvernement actuel ne saurait être à leur origine directe, même si certains secteurs de l'Etat sont impliqués. En réalité, ces attentats révèlent des règlements de compte brutaux entre différentes fractions de la bourgeoisie et de son appareil politique. Et derrière ces règlements de comptes, il est clair que les questions de politique extérieure sont présentes. En tait, la clique oui vient d'être écartée (celle d'Andreotti et compagnie) du nouveau gouvernement était à la fois la plus liée à la Mafia (c'est de notoriété publique) mais aussi celle qui était la plus impliquée dans l'alliance avec les Etats-Unis. Aujourd'hui, il n'est pas surprenant que ce pays utilise, pour dissuader la bourgeoise italienne de se ranger derrière l'axe franco-allemand, une des organisations qui lui a déjà rendu de nombreux services par le passé : la Mafia. En effet, dès 1943, les « mafiosi » de Sicile avaient reçu consigne du fameux gangster italo-américain, Lucky Luciano, alors emprisonné, de favoriser le débarquement des troupes américaines ans cette île. En échange, Luciano fut libéré (alors qu'il avait écopé de 50 ans de prison) et retourna en Italie pour diriger le trafic de cigarettes et de drogue. Par la suite, la Mafia a été régulièrement associée aux activités du réseau Gladio (mis en place au moment de la « guerre froide », avec la complicité des services secrets italiens, par la CIA et l'OTAN) et de la loge P2 (liée à la franc-maçonnerie américaine) destinées à combattre la « subversion communiste » (les activités favorables au bloc russe). Les déclarations des mafiosi « repentis » lors des « maxi-procès » anti-mafia de 1987, organises par le juge Falcone, ont clairement mis en évidence les connivences entre « Cosa Nostra » et la loge P2. C'est pour cela que les attentats actuels ne sauraient être réduits à des problèmes de politique intérieure mais doivent être compris dans le cadre de l'offensive présente des Etats-Unis qui tentent de faire pression, par ce moyen aussi, pour qu'un Etat aussi important du point de vue stratégique que l'Italie ne se dégage de leur tutelle.
Ainsi, au delà des grandes phrases sur les «droits de l'homme», sur l'action « humanitaire », sur la paix, sur la morale, c'est une bararie sans nom, une putréfaction avancée de toute la vie sociale que la bourgeoisie nous demande de préserver. Et plus son verbe est vertueux, plus ses actes sont répugnants. C'est le mode de vie d'une classe et d'un système condamnés par l'histoire, qui se débattent dans les affres de l'agonie mais qui menacent d'entraîner dans leur propre mort toute l'humanité si le prolétariat ne trouve pas la force de les renverser, s'il se laisse détourner de son terrain de classe par tous les discours vertueux de la classe qui l'exploite. Et ce terrain de classe, c'est à partir d'une lutte déterminée de résistance contre les attaques de plus en plus brutales que lui assène un capital confronté à une crise économique insoluble qu'il pourra le retrouver. Parce que le prolétariat n'a pas subi de défaite décisive, malgré les difficultés que les boule versements de ces trois dernières années ont provoquées dans sa conscience et sa combativité, l'avenir reste ouvert à des affrontements de classe gigantesques. Des affrontements où la classe révolutionnaire devra puiser la force, la solidarité et la conscience pour accomplir la tâche que l'histoire lui assigne l'abolition de l'exploitation capitaliste et de toutes les formes d exploitation.
FM, 13/09/1992.
[1] [882] Voir en particulier l'article «Europe de l'Est : les armes de la bourgeoisie contre la prolétariat » dans la Revue Internationale n°34, 3 trimestre 1983.
[2] [883] Un facteur important dans le dépassement des vieux clivages ethniques est évidemment le développement a'un prolétariat moderne, concentré, instruit pour les besoins mêmes de la production capitaliste ; un prolétariat ayant une expérience des luttes et de la solidarité de classe et dégagé des vieux préjugés légués par la société féodale, notamment les préjugés religieux qui constituent souvent le terreau où s'épanouissent les haines ethniques. Il est clair que dans les pays économiquement arriérés, qui étaient la majorité dans l'ancien bloc de l’Est, un tel prolétariat avait peu de chances de pouvoir se développer. Cependant, dans cette partie du monde, la faiblesse du développement économique n'est pas le facteur principal de la faiblesse politique de la classe ouvrière et de sa vulnérabilité face aux thèmes nationalistes. Par exemple, le prolétariat de Tchécoslovaquie est beaucoup plus proche, du point de vue de son développement économique et social, de celui des pays d'Europe occidentale que de celui de l'ex-Yougoslavie. Cela ne l'a pas empêché d'accepter, quand ce n'était pas de soutenir, le nationalisme qui a conduit à la partition de ce pays en deux républiques (il est vrai que c'était en Slovaquie, la partie du pays la moins développée, que le nationalisme était le plus fort). En fait, l'énorme arriération politique de la classe ouvrière dans les pays dirigés par des régimes staliniens pendant plusieurs décennies provient essentiellement du rejet presque viscéral par les ouvriers des thèmes centraux du combat de leur classe suite à l'utilisation abjecte qu'en ont fait ces régimes. Si la « révolution socialiste » veut dire la tyrannie féroce des bureaucrates du parti-Etat : a bas la révolution socialiste ! Si la « solidarité de classe » signifie se plier au pouvoir de ces bureaucrates et accepter leurs privilèges : feu sur elle et chacun pour soi ! Si « internationalisme prolétarien » est synonyme d'intervention des chars russes : mort a l'internationalisme et vive le nationalisme !
[3] [884] Sur notre analyse de la phase de décomposition, voir en particulier, dans la Revue Internationale n° 62, «La décomposition, phase ultime de la décadence du capitalisme ».
[4] [885] L'importance stratégique de ces deux pays pour les Etats-Unis est évidente : la Turquie, avec le Bosphore, contrôle la communication entre la Mer Noire et la Méditerranée ; l'Italie, pour sa part, commande grâce à la Sicile, le passage entre l'Est et l'Ouest de cette mer. De plus, la 6e Flotte US est basée à Naples.
[5] [886] Voir à ce sujet les articles et résolutions dans la Revue Internationale n° 63 à 67.
[6] [887] F. Heisbourg, directeur de l'Institut international d'études stratégiques, dans une interview au journal Le Monde du 17/1/1992.
[7] [888] Comme nous l'avions mis en évidence à l'époque dans notre presse, l'arrivée des républicains à la tête de l'Etat, en 1981, correspondait à une stratégie globale des bourgeoisies les plus puissantes (particulièrement en Grande-Bretagne et en Allemagne, mais dans beaucoup d'autres pays également) visant à placer ses partis de gauche dans l'opposition. Cette stratégie devait permettre à ces derniers de mieux encadrer la classe ouvrière à un moment où celle-ci était en train de développer des combats significatifs contre les attaques économiques croissantes menées par la bourgeoisie pour faire face à la crise. Le recul subi par la classe ouvrière mondiale suite à l'effondrement du bloc de l'Est et aux campagnes qui l'ont accompagné a momentanément fait passer au second plan la nécessité de maintenir les partis de gauche dans l'opposition. C'est pour cela qu'une période de quatre ans de présidence démocrate, avant que la classe ouvrière n'ait pleinement retrouvé le chemin de ses combats, à acquis les faveurs de certains secteurs bourgeois. En ce sens, une éventuelle victoire du candidat démocrate en novembre 1992 ne devrait pas être considérée comme une perte de contrôle par la bourgeoisie de son jeu politique comme ce fut, par contre, le cas avec l'élection de Mitterrand en France, en 1981.
[8] [889] La présente offensive de la Russie visant à maintenir son contrôle sur le Tadjikistan n'est évidemment pas étrangère à cette situation : depuis de nombreux mois, la fidélité de la Russie d'Eltsine vis-à-vis des Etats-Unis ne s'est pas démentie.
Questions théoriques:
- Décomposition [3]
- Guerre [129]
Crise économique mondiale : catastrophe au coeur du monde industrialise
- 5853 reads
Avec l’été 1992, un flot d'annonces et d'événements inquiétants sont venus peindre un tableau particulièrement sombre de la situation économique mondiale. La bourgeoisie a beau répéter sur tous les tons que la reprise de la croissance se profile à l'horizon, s'accrocher au moindre indice apparemment positif pour justifier son optimisme, les faits sont têtus et se chargent rapidement de la détromper. La reprise joue l’Arlésienne. Elle a manqué tous les rendez-vous qui lui ont été fixés. Déjà, à l'été 1991, Bush et son équipe avaient cru pouvoir annoncer la fin de la récession; l'automne 1991 avec la rechute de la production américaine avait balayé ce mirage. Une nouvelle fois, campagne électorale oblige, le même scénario a été mis en avant au printemps 1992 et de nouveau la réalité se charge vite de sonner le glas de cette espérance. Depuis deux ans que le même dis cours répétitif sur la reprise est tenu, il commence singulièrement à s'user devant la situation économique mondiale qui ne cesse de s'aggraver.
Un été meurtrier pour les illusions sur la reprise économique
Non seulement la croissance ne repart pas, mais c'est un nouvel affaissement de la production qui a commencé. Aux USA, après une année 1991 calamiteuse, la bourgeoisie a crié victoire trop tôt à la suite d'un 1er trimestre 1992 où la croissance s'est rehaussée à 2,7 % en rythme annuel. Elle a du déchanter rapidement en affichant pour le 2e trimestre un piteux 1,4 % de croissance qui annonce des chiffres négatifs pour la fin de l'année. Et, ce ne sont pas seulement les USA, la première puissance économique mondiale, qui ne parviennent pas à relancer. Les deux puissances économiques qui jusqu'à présent étaient présentées comme les exemples mêmes de la réussite capitaliste, l'Allemagne et le Japon, sont à leur tour en train de s'embourber dans l'ornière de la récession. En Allemagne occidentale le PIB a baissé de 0,5 % au 2e trimestre 1992; de juin 1991 à juin 1992, la production industrielle a diminué de 5,7 %. Au Japon, de juillet 1991 à juillet 1992, la production d'acier a chuté de 11,5% et celle de véhicules motorisés de 7,2%. La situation est identique dans tous les pays industrialisés, ainsi la Grande-Bretagne connaît depuis la mi-1990 sa plus longue récession depuis la guerre. Il n'y a plus sur la carte de la géographie capitaliste un seul havre de prospérité, un seul « modèle » de capitalisme national en bonne santé. En n'ayant plus d'exemple de bonne gestion à présenter, la classe dominante montre en fait qu'elle n'a plus de solution.
Avec la plongée du coeur de l'économie mondiale dans la récession, tout le système est fragilisé, et le tissu de l'organisation économique capitaliste mondiale est soumis à des tensions de plus en plus fortes. L'instabilité gagne les systèmes financier et monétaire. Les symboles classiques du capitalisme que sont les bourses, les banques et le dollar se sont retrouvés cet été au coeur de la tempête. Le Kabuto-Cho, la bourse de Tokyo, qui en 1989, à son plus haut niveau, avait dépassé en importance Wall Street, a atteint le tond en août avec une décote de 69 % de son principal indice des valeurs, le Nikkeï, par rapport à cette période faste, rejoignant son niveau de 1986. Des années de spéculation ont été effacées et des centaines de milliards de dollars évaporés. Les places boursières de Londres, Francfort, Paris ont, dans la foulée, perdu de 10 % à 20 % depuis le début de l'année. Les banques et assurances qui ont alimenté la spéculation dans les années 1980, payent les pots cassés: les bénéfices sont en chute libre, les pertes s'accumulent et les faillites se multiplient partout dans le monde. Les célèbres Lloyds qui gèrent les assurances de toute la navigation mondiale, sont au bord de la banqueroute. Le roi-dollar a accélère sa dégringolade durant l'été, atteignant son niveau le plus bas vis-à-vis du deutschemark: depuis que celui-ci a été créé en 1945, ébranlant l'équilibre du marché monétaire international. Le roi-dollar, la spéculation boursière qui paraissaient être, selon la propagande euphorique des années 1980, les symboles de la vigueur et du triomphe du capitalisme, sont devenus celui de sa faillite.
Les attaques les plus importantes depuis la seconde guerre mondiale
Mais plus que les indices économiques abstraits et les épisodes mouvementés de la vie des institutions capitalistes qui alimentent les pages des journaux, la réalité de la crise, de son aggravation est vécue au quotidien par les exploités qui, sous les coups répétés des programmes d'austérité, subissent une paupérisation croissante.
Le développement des licenciements, et en conséquence du chômage, a connu, ces derniers mois, une accélération brutale au cœur du monde industrialisé. Dans l'ensemble de l'OCDE, le chômage, après avoir progressé de 7,6% en 1991 pour atteindre 28 millions, doit, selon les prévisions dépasser 30 millions en 1992. Dans tous les pays il progresse : en Allemagne, en juillet 1992, il atteint 6% à l'Ouest et 14,6% à l'Est, contre, respectivement, 5,6 % et 13,8 % le mois précédent ; en France, les entreprises ont licencié 262 000 travailleurs au 1er semestre, 43 000 en juillet 1992 ; en Grande-Bretagne 300 000 suppressions d'emploi sont annoncées d'ici la fin de l’année dans le seul secteur du bâtiment ; en Italie, 100 000 emplois doivent disparaître dans l'industrie dans les mois qui viennent. Dans la CEE officiellement, 53 millions de personnes vivent en dessous du « seuil de pauvreté » : en Espagne près du quart de la population, en Italie, 9 millions de personnes, soit 13,5% de la population. Aux USA, 14,2 % de la population est dans ce cas, 35,7 millions de personnes. Le revenu moyen des familles américaines a chuté de 5 % en trois ans !
Traditionnellement, dans les pays développés, la bourgeoisie met à profit l'été, période classique de démobilisation de la classe ouvrière, pour mettre en place ses programmes d'austérité. Non seulement l'été 1992 n'a pas fait exception à la règle, mais il a été l'occasion d'une vague d'attaques sans précédent contre les conditions de vie des exploités. En Italie l'échelle mobile des salaires a été abandonnée avec l'accord des syndicats. Les salaires ont été gelés dans le secteur privé et les impôts fortement augmentés alors que l'inflation atteint 5,7%. En Espagne, les impôts ont été augmentés de 2 % par mois, avec effet rétroactif à partir de janvier. En conséquence les salaires de septembre seront amputés de 20 % ! En France, les allocations-chômage ont été réduites tandis que les cotisations chômage pour les travailleurs qui ont encore un emploi ont été augmentées. En Grande-Bretagne, en Belgique aussi des budgets d'austérité ont été mis en place qui signifient : diminution des prestations sociales, renchérissement du coût des soins médicaux, etc. La liste n'est évidemment pas exhaustive.
Sur tous les plans de ses conditions de vie la classe ouvrière des pays développés est en train de connaître les attaques les plus importantes depuis la fin de la deuxième guerre mondiale.
Une relance impossible
Alors que depuis près de trois ans la classe dominante attend la reprise sans rien voir venir, le doute s'installe et l'inquiétude grandit face à la dégradation économique qui se poursuit et la crise sociale qui inévitablement doit en découler. Cette peur qui la tenaille, la bourgeoisie croit l'exorciser en clamant sans cesse que la reprise est pour bientôt, que la récession est comme la nuit qui succède au jour et que finalement, inéluctablement, le soleil de la croissance repointera à l'horizon, bref, qu'il n'y a rien là que de très normal et qu'il faut savoir être patient et accepter les sacrifices nécessaires.
Ce n'est pas la première fois, depuis la fin des années 1960 qui a vu l'ouverture de la crise, que l'économie mondiale connaît des phases de récession ouverte. En 1967, en 1970-71, en 1974-75, en 1981-82, l'économie mondiale avait confronté les affres d'une chute de la production. Chaque fois, les politiques de relance avaient eu pour effet de retrouver la croissance, chaque fois l'économie avait paru sortir de l'ornière. Pourtant, ce constat optimiste sur lequel la bourgeoisie s'appuie pour nous faire croire qu'inéluctablement la croissance reviendra, comme un cycle normal de l'économie, est illusoire. Le retour de la croissance dans les années 1980 n'a pas concerné l'ensemble de l'économie mondiale. Les économies du «tiers-monde» ne se sont jamais remises de la chute de la production qu'elles ont subie au début des années 1980, elles ne sont pas sorties de la récession, tandis que les pays du « second monde », ceux de l'ex-bloc de l'Est ont poursuivi pour leur part un lent affaissement qui a mené à l'effondrement économique et politique de la fin des années 1980. a fameuse relance reaganienne des années 1980 a donc été partielle, limitée, essentiellement réservée aux pays du « premier monde », les pays les plus industrialisés. Et il faut surtout constater que ces relances successives ont été menées grâce à des politiques économiques artificielles qui ont constitué autant de tricheries, de distorsions par rapport a la sacro-sainte « loi du marché » que les économistes « libéraux » ont institué en dogme idéologique.
La classe dominante est confrontée à une crise de surproduction et le marché solvable est trop étroit pour absorber le trop plein des marchandises produites. Pour faire face à cette contradiction, pour écouler ses produits, pour élargir les limites du marché, la classe dominante a eu essentiellement recours à un artifice qui consiste en une fuite en avant dans le crédit. Durant les années 1970, les pays sous-développés de la périphérie se sont vus accorder plus de 1000 milliards de dollars de crédits, qui ont été utilisés en grande partie pour acheter des marchandises produites dans les pays industrialisés permettant à ces derniers de poursuivre leur croissance. Cependant avec la fin des années 1970, l'incapacité où se sont retrouvés les pays les plus endettés de la périphérie à rembourser leurs dettes a signé le glas de cette politique. La périphérie du monde capitaliste s'est définitivement enfoncée dans le marasme. Qu'à cela ne tienne la bourgeoisie a trouvé une autre solution. Ce sont les USA, sous la houlette du président Reagan, qui sont devenus le déversoir du trop plein de la production mondiale et ce au travers d'un endettement qui a renvoyé celui des pays sous-développés au niveau d'une aimable broutille. La dette des USA atteint, fin 1991, le chiffre astronomique de 10 481 milliards de dollars sur le plan intérieur, et de 650 milliards de dollars vis-à-vis des autres pays. Evidemment, une telle politique n'a été rendue possible que parce que les USA, première puissance impérialiste mondiale, leader à l'époque d'un bloc constitué des principales puissances économiques, ont pu profiter de ces atouts pour tricher avec les lois du marché, les plier à leurs besoins en imposant une discipline de fer à leurs alliés. Mais cette politique a ses limites. A l'heure des échéances, les USA, comme les pays sous-développés il y a une douzaine d'année, sont confrontés à un problème de solvabilité.
Le recours à la potion du crédit pour soigner l'économie capitaliste malade rencontre donc ses limites objectives. C'est pour cette raison que la récession ouverte qui se développe depuis plus de deux ans au coeur du capitalisme le plus industrialisé est qualitativement différente des phases de récession précédentes. Les artifices économiques qui ont permis les relances précédentes se révèlent maintenant inefficaces.
Pour la 22e fois consécutive la Banque fédérale de l'Etat américain a baissé cet été le taux de base auquel elle prête aux autres banques, Celui-ci a ainsi été ramené de 10 % à 3 % depuis le printemps 1989. Ce taux est aujourd'hui inférieur à celui de l'inflation, c'est-à-dire que le taux d'intérêt réel est nul ou même négatif, que l'Etat prête à perte ! Cette politique de crédit facile n'a pourtant donné aucun résultat, pas plus aux USA qu'au Japon où là aussi les taux de la banque centrale approchent aujourd'hui les 3 %.
Les banques qui ont prêté à tour de bras durant des années sont confrontées à des impayés de plus en plus massifs, les faillites d'entreprises s'accumulent laissant des ardoises qui se chiffrent parfois en milliards de dollars. L'effondrement de la spéculation boursière et immobilière aggrave encore plus les bilans qui virent au rouge, les pertes s'accumulent, les faillites bancaires se multiplient et les trésoreries sont exsangues. Bref, les banques ne peuvent plus prêter. La relance par le crédit n'est plus possible, ce qui revient à dire tout simplement que la relance tout court est impossible.
Un seul espoir pour la classe dominante : freiner la chute, limiter les dégâts
La baisse du taux d'escompte sur le dollar ou le yen a d'abord servi à restaurer les marges de profit des banques américaines et japonaises qui ont emprunté moins cher à l'Etat mais n'ont pas entièrement répercuté cette baisse sur les taux des crédits qu'elles proposaient aux particuliers et aux entreprises, évitant ainsi une multiplication trop dramatique des faillites bancaires et une implosion catastrophique du système bancaire international. Mais cette politique a aussi ses limites. Les taux ne peuvent plus guère baisser. L'Etat est obligé de plus en plus d'intervenir directement pour venir au secours des banques qui, apparemment indépendantes, avaient constitué le paravent « libéral » du capitalisme d'Etat, lequel contrôle en fait étroitement les vannes du crédit. Aux USA, le budget fédéral doit financer des centaines de milliards de dollars pour soutenir les banques menacées de faillite, et au Japon, l'Etat vient de racheter le parc immobilier des banques les plus menacées pour renflouer leur trésorerie. Des nationalisations en quelque sorte. On est bien loin du credo pseudo-libéral du « moins-d'Etat » dont on nous a rebattu les oreilles pendant des années. De plus en plus, l'Etat est obligé d'intervenir ouvertement pour sauver les meubles. Un exemple récent vient d'en être fourni par le programme de relance mis en place au Japon où le gouvernement a décidé d'écorner fortement son bas de laine en décidant de débloquer 85,4 milliards de dollars pour soutenir le secteur privé qui bat de l'aile. Mais cette politique de relance de la consommation intérieure est destinée a avoir un effet aussi provisoire que les dépenses de l'Allemagne pour sa réunification qui n'ont permis que de freiner très provisoirement la récession en Europe.
Limiter les dégâts, freiner la plongée dans la catastrophe, c'est ce que tente la classe dominante. Dans une situation où les marchés se restreignent comme peau de chagrin, Faute de crédit, la recherche de la compétitivité à coup de programmes d'austérité de plus en plus draconiens pour développer les exportations, est devenu le leitmotiv de tous les Etats. Le marché mondial est déchiré par la guerre commerciale où tous les coups sont permis, où chaque Etat utilise tous les moyens pour s'assurer des débouchés. La politique des USA illustre particulièrement cette tendance : coups de poing sur la table de négociation du GATT, création d'un marché privilégié et protégé avec le Mexique et le Canada associés autant de force que de gré, baisse artificielle du cours du dollar pour doper les exportations. Cependant cette guerre commerciale à outrance ne peut qu'aggraver encore la situation, déstabiliser toujours plus le marché mondial. Et cette dynamique de déstabilisation est encore renforcée par le fait qu'avec la disparition du bloc de l'Est la discipline que les USA pouvaient imposer à ses ex-partenaires impérialistes, mais également principaux concurrents économiques, a volé en éclats. La tendance est au chacun pour soi. Les dernières aventures du dollar sont parfaitement illustratives de cette réalité. La politique américaine de baisse du dollar s'est heurtée à la limite constituée par la politique allemande de taux élevés, car l'Allemagne, confrontée au risque d'une flambée inflationniste à la suite de sa réunification, joue sa propre carte. Résultat, la spéculation mondiale s'est portée massivement sur le Mark, contre la monnaie américaine, et les banques centrales dans l'affolement général ont eu toutes les peines du monde à stabiliser la dégringolade incontrôlée du dollar. L'ensemble du système monétaire international s'en est trouvé ébranlé. Le mark finlandais a dû décrocher du système monétaire européen, tandis que la lire italienne et la livre anglaise sont elles-mêmes dans la tourmente et ont toutes les peines du monde à s'y maintenir. Ce coup de semonce annonce clairement les séismes à venir. Les événements économiques de l'été 1992 montrent que la perspective, loin d'être à une reprise de la croissance mondiale est à une accélération de la chute dans la récession, à un ébranlement brutal de tout l'appareil économique et financier du capital mondial.
La catastrophe au coeur du monde industrialisé
Il est significatif de la gravité de la crise, que ce soient aujourd'hui les métropoles orgueilleuses du cœur industrialisé du capitalisme qui su bissent de plein fouet la récession ouverte. L'effondrement économique des pays de l'Est a déterminé la mort du bloc impérialiste russe. A l'inverse de la propagande qui s'est déchaînée à l'occasion de cet événement, celui-ci n'a pas signifié l'inanité du communisme, ce que le système stalinien n'était pas, mais les convulsions mortelles d'une fraction sous-développée du capitalisme mondial. Cette faillite du capitalisme à l'Est a été la démonstration des contradictions in surmontables qui minent l'économie capitaliste sous quelque forme que ce soit. Dix ans après l'effondrement économique des pays sous-développés de la périphérie, la banqueroute économique des pays de l'Est annonçait l'aggravation des effets de la crise au coeur du monde industriel le plus développé, là où se concentre l'essentiel de la production mondiale (plus de 80 % pour les pays de l'OCDE), là où se cristallisent de la manière la plus aiguë les contradictions insurmontables de l'économie capitaliste. La progression de puis plus de vingt ans des effets de a crise de la périphérie vers le centre manifeste l'incapacité grandissante des pays les plus développés à reporter ces effets sur les nations plus faibles économique ment. Comme un boomerang, la crise revient exercer ses ravages sur l'épicentre qui est à son origine. Cette dynamique de la crise montre où est le futur du capital.
De la même façon que les pays de l'ex-bloc de l'Est voient se concrétiser le spectre d'une catastrophe économique de l'ampleur de celle que connaissent l'Afrique ou 1 Amérique Latine, à terme c'est ce futur terrible qui menace les riches pays industrialisés.
Cette dynamique catastrophique, qui est celle du développement de la crise, la classe dominante ne peut évidemment l'admettre. Elle a besoin elle-même de croire en la pérennité de son système. Mais cet auto-aveuglement se conjugue avec la nécessité absolue où elle se trouve de masquer le plus possible la réalité de la crise aux yeux des exploités du monde entier. La classe exploiteuse doit se cacher à elle-même, et cacher aux exploités, son impuissance sous peine de montrer au monde entier que sa tâche historique est depuis longtemps terminée et que le maintien de son pouvoir ne peut mener l'ensemble de l'humanité que dans une barbarie toujours plus effroyable.
Pour tous les travailleurs, la réalité douloureuse des effets de la crise, qu'ils subissent dans leur chair, est un puissant facteur de clarification et de réflexion. L'aiguillon de la misère qui se fait chaque jour plus douloureux ne peut que pousser le prolétariat à manifester plus ouvertement son mécontentement, à exprimer sa combativité dans des luttes pour la défense de son niveau de vie. C'est pour cela que, depuis plus de vingt ans que la crise s'approfondit, masquer le fait que celle-ci est insurmontable dans le cadre de l'économie capitaliste est un thème permanent de la propagande bourgeoise.
Mais la réalité balaie les illusions, et érode les mensonges. L'histoire fait un pied de nez à ceux qui avaient cru, grâce à la potion reaganienne, avoir terrassé définitivement la crise, et avaient mis à profit abusivement l'effondrement du bloc impérialiste russe pour clamer l'inanité de la critique marxiste du capitalisme et prétendre que celui-ci était le seul système viable, le seul avenir de l'humanité. La faillite de plus en plus catastrophique du capitalisme pose et va poser de plus en plus la nécessité pour la classe ouvrière de mettre en avant sa solution : la révolution communiste.
JJ, 4/9/1992
Questions théoriques:
- L'économie [86]
Heritage de la Gauche Communiste:
Supplément : La crise monétaire sanctionne l'effondrement du capitalisme.
- 5289 reads
La classe ouvrière paye la note, en Italie elle commence à répondre.
La Livre anglaise et la Lire italienne obligées de décrocher su Serpent Monétaire Européen et de dévaluer en catastrophe, l'Espagne dans la foulée qui doit dévaluer la Peseta et rétablir, ainsi que l'Irlande, le contrôle des changes, l'Escudo portugais qui flotte, le Franc français qui a son tour présente des signes de faiblesse et ne doit son salut qu'à l'intervention massive de la Bundesbank qui vole au secours de la Banque de France laquelle a du, dans l'affaire, débourser plus de la moitié de ses avoirs. L'onde de choc qui a secoué les monnaies européennes durant le mois de septembre a fait voler en éclat un pilier essentiel du système monétaire international : le SME.
Au moment où la bourgeoisie européenne communiait, avec le processus engagé de ratification des accords de Maastricht, dans l'avenir radieux de l'unification européenne, les yeux fixés sur le résultat, impatiemment attendu, du référendum sur ce sujet en France, la crise est venue apporter sa contribution brutale aux débats et porter un coup terrible aux illusions sur la perspective européenne. De fait, c'est un pilier essentiel de la construction européenne qui s'est disloqué. La moitié des monnaies européennes ont dû décrocher dans la tourmente, et malgré la réaffirmation renouvelée par tous les pays de l'Union européenne lors d'une réunion des ministres des finances, fin septembre, de leur foi à l'égard du SME, elles ne sont pas prêtes, pour la plupart, de s'y réintégrer.
La crise qui s'accélère pousse chaque pays dans la défense prioritaire de ses propres intérêts, dans une concurrence acharnée, dans une dynamique de chacun pour soi qui menace de dislocation l'unification de l'Europe sur le plan où ses acquis étaient les plus importants, le plan économique. Il suffit de constater la polémique venimeuse qui, à la suite de ces événements, s'est développée entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne, se reprochant réciproquement leur manque de solidarité et de responsabilité pour mesurer à quel point la perspective future d'une unification économique et politique des douze pays qui ont signé le Traité de Maastricht relève du mythe.
La crise monétaire est le produit de la crise mondiale
La crise économique actuelle, produit insurmontable des contradictions du capitalisme, est un révélateur profondément significatif de la vérité de ce système, de sa faillite, et donc de tous les mensonges de la classe dominante destinés à masquer la banqueroute de son mode de production. Comme la Livre ou le Franc, les autres monnaies phares du marché mondial ne sont pas à la fête : les accès de faiblesse à répétition de la devise reine de l'économie planétaire, le Dollar, montrent l'asphyxie dont l'économie américaine ne parvient pas à sortir, quant au Yen, sa stabilité elle aussi est menacée par le marasme dans lequel le Japon s'enfonce, et si le Mark parait solide c'est uniquement parce que l'Etat allemand maintien des taux d'intérêts élevés attractifs par peur d'une inflation galopante consécutive au coût prohibitif de la réunification. La tempête monétaire à l'échelle mondiale montre que ce n'est pas seulement l'Europe qui est gravement malade mais l'économie mondiale dans son ensemble.
La spéculation : une fausse explication
Jamais avare de mensonges, la bourgeoisie en trouve toujours de nouveaux pour masquer son impuissance. Ainsi, pour elle, la cause de la crise monétaire ce n'est pas la crise mondiale de surproduction généralisée qui s'exprime par la récession, ce sont les méchants spéculateurs internationaux. Il est vrai que c'est sous la pression de la spéculation que les gouvernements ont dû plier et que la Grande-Bretagne ainsi que l'Italie, par exemple, ont dû abandonner le
SME. L'équivalent de 1 000 milliards de dollars sont échangés chaque jour entre les banques et les entreprises capitalistes. Une fraction notable de ce montant se porte sur une monnaie ou une autre selon les fluctuations du marché, bref alimente la spéculation au jour le jour sur le cours des monnaies. Aucune banque centrale ne peut résister à la pression si une proportion importante d'une telle masse de capitaux spécule durablement à la baisse de sa monnaie.
Le développement de la spéculation est le reflet du fait que les investissements industriels, dans la production, ne sont plus rentables, cela était déjà clair durant les années 1980 quand la spéculation boursière et immobilière faisait rage. Aujourd'hui, alors que les valeurs boursières et l'immobilier s'effondrent, les capitaux fuient ces secteurs et en cherchent désespérément où s'investir avec profit, et il y en a de moins en moins. En fait, si la masse de capitaux qui spéculent sur le cours des monnaies s'est ainsi gonflée, c'est parce que la crise mondiale sévit : jouer sur le cours des monnaies devient le seul moyen de préserver la valeur du capital investi. C'est pourquoi, aujourd'hui, tous les capitalistes spéculent, sans exception : des riches particuliers aux banques pour protéger leurs avoirs, des entreprises privées aux Etats pour gérer leur trésoreries. Ceci dit, il serait erroné de croire que la spéculation est aveugle. Lorsque la spéculation mondiale joue à la baisse une monnaie c'est parce que le marché juge que celle-ci est surévaluée, c'est-à-dire que l'économie dont elle est la représentante ne correspond plus à la valeur de sa devise. De fait, la spéculation internationale sur le marché des devises traduit la sanction de la sacro-sainte loi du marché, tant louée par les économistes libéraux, sur les diverses économies nationales en compétition dans l'arène mondiale. En imposant la dévaluation de la Livre et de la Lire, la spéculation internationale a ainsi montré qu'elle considérait les actions "Grande-Bretagne" et "Italie" comme des valeurs à risques. Avec l'enfoncement dans la récession, la masse croissante de capitaux spéculatifs en circulation dans le monde va devenir un facteur de plus en plus fort d'instabilité du marché mondial : d'autres "valeurs" symboles du capitalisme mondial vont se trouver éprouvées comme l'a été le SME. La dynamique d'effondrement de l'économie capitaliste est à l'oeuvre et, sur le plan monétaire, la dislocation du SME n'est que le signe avant-coureur d'autres catastrophes à venir.
Italie : les ouvriers commencent à répondre.
Cette crise du capitalisme, le prolétariat la subit dans sa chair. Les attaques contre son niveau de vie sont de plus en plus fortes. Les derniers événements monétaires ont été le prétexte tout trouvé pour justifier de nouvelles atteintes au niveau de vie des exploités et imposer de nouveaux plans d'austérité au nom de la défense de l'économie nationale. Face à ces attaques, qui sont les plus fortes depuis la seconde guerre mondiale, la classe ouvrière se doit de réagir, de sortir de la passivité qui règne depuis 1989. A cet égard les luttes du prolétariat en Italie montrent le chemin.
Depuis la fin septembre 1992, l'Italie est secouée par des manifestations ouvrières, « les plus importantes depuis 20 ans » reconnaît Bruno Trentin, secrétaire du principal syndicat italien, la CGIL. Dès l'annonce des mesures d'austérité, des débrayages spontanés ont lieu dans différents secteurs. La série de manifestations que les syndicats avaient programmées pour désamorcer d'éventuelles réponses à ces attaques du gouvernement Amato ont été l'occasion d'une expression massive (100 000 personnes à Milan, 50 000 à Bologne, 40 000 à Gênes, 80 000 à Naples, 60 000 à Turin, etc.) et surtout déterminée de la colère ouvrière contre le gouvernement et... contre les syndicats qui ont soutenu ces mesures. Point commun de cette explosion de colère : en même temps qu'ils s'en prennent au gouvernement (« Amato, les ouvriers ont les mains propres et les poches vides ! »), les ouvriers s'attaquent à leurs soi-disant « représentants », les syndicats, en bombardant leurs orateurs de pièces de monnaie, oeufs, tomates, pommes de terre, parfois même des boulons, les insultant, les traitant de « vendus ». Même les travailleurs qui hésitent devant la violence s'expriment ainsi : « Ceux qui jettent des boulons se trompent. Mais moi, je les comprends un peu : il est vraiment difficile de subir et de rester toujours gentils et silencieux ». ([1] [890]) L'ancien maire socialiste de Gênes devant la tournure que prend la manifestation à laquelle il assiste se désole : "Avant de mourir, je devais aussi voir cela : les carabiniers en train de protéger les syndicalistes dans un meeting. ".
Partout, les manifestations que les syndicats voulaient paisibles bien contrôlées, se transforment en un cauchemar pour eux : « Ce qui devait être une journée contre le gouvernement est devenue une journée contre les syndicats » (« Corriere délia Sera » du 24 septembre).
Les syndicats apportent leur soutien aux attaques du capital.
Les ouvriers italiens savent bien à quel point les syndicats ont trempé dans les mesures draconiennes qui les assomment aujourd'hui : gel des salaires dans la fonction publique et annulation des départs à la retraite anticipée pendant un an, augmentation des impôts et création d'une kyrielle de nouveaux prélèvements ; l'âge de départ à la retraite est repoussé : les ouvriers devront consacrer 5 ans de plus de leur vie au travail salarié. Pour ceux qui sont malades, mais dont le revenu dépasse le salaire moyen, les médicaments ne seront quasiment plus remboursés. Bien que prônant quelques aménagements au dernier plan de rigueur, les syndicats affichent, par la voix de B. Trentin, leur plein soutien au gouvernement « Les mesures décidées sont injustes mais dans cette situation grave, nous voûtons montrer que nous avons le sens des responsabilités ». Quant aux ouvriers, ils ont commencé à prendre leurs responsabilités en mettant ces racailles à leur vraie place : dans le camp du capital.
Certes les ouvriers italiens, une fois dépassé l'obstacle des grandes centrales syndicales officielles devront, entre autre, se confronter - et ils se confrontent déjà-, aux annexes « radicales » de celles-ci : les « COBAS » et autres syndicalisme « de base » qui ne les grandes centrales, y compris en prenant la tête des actions "violentes" contre leurs dirigeants, que pour mieux prendre leur place. La polarisation sur cette forme "violente" de la contestation des syndicats a été orchestrée par le syndicalisme de base pour mieux détourner la combativité et affaiblir la riposte ouvrière. Il ne suffit pas de rejeter les formes les plus grossières du syndicalisme, encore faut-il apprendre à développer et à devenir maître de sa force par soi-même.
La signification internationale des combats ouvriers en Italie.
D'ores et déjà ces événements signent la fin d'une période où la bourgeoisie pouvait compter sur la passivité des ouvriers pour asséner ses attaques.
Ce n'est pas un hasard s'il revient aux ouvriers d'Italie d'avoir les premiers surmontés la paralysie imposée au prolétariat mondial par le carcan des campagnes déchaînées par la bourgeoisie depuis 1989. Depuis plusieurs décennies, le prolétariat d'Italie a fait la preuve qu'il était un des secteurs de la classe ouvrière mondiale les plus combatifs et expérimentés. En particulier, les ouvriers de ce pays ont déjà une longue tradition d'affrontements aux syndicats. De plus, le niveau des attaques subies aujourd'hui par ces ouvriers est le plus important de tous les pays industrialisés.
Cependant, les luttes qui se déroulent aujourd'hui en Italie ne sont pas un feu de paille et ne sont pas destinés à rester une « spécialité » des ouvriers de ce pays. Même si ce n'est pas dans l'immédiat, ni dans les mêmes formes, notamment l'affrontement ouvert aux syndicats dés le début de la lutte, les autres secteurs du prolétariat mondial seront nécessairement conduits à prendre le même chemin. Elles doivent être comprises comme un exemple et un appel au combat des ouvriers du monde entier, et en particulier à ses bataillons les plus décisifs et expérimentés, ceux du reste d'Europe occidentale.
CCI / 8.10.92
L'effondrement du SME renvoie l'Europe a son mytheQuestions théoriques:
- L'économie [86]
Heritage de la Gauche Communiste:
Le communisme n'est pas un bel idéal mais une nécessite matérielle [4°partie]
- 4680 reads
Le communisme : véritable commencement de la société humaine
Dans le précédent article de cette série, nous avons vu comment, dans ses premiers travaux, Marx a examiné le problème du travail aliéné en vue de définir les buts ultimes de la transformation sociale communiste. Nous avons notamment conclu que pour Marx, le travail salarié capitaliste constituait à la fois l'expression la plus élevée de l'aliénation de l'homme par rapport à ses capacités réelles, et la prémisse du dépassement de cette aliénation vers le surgissement d'une société véritablement humaine. Dans ce chapitre, nous voulons étudier les véritables contours d'une société communiste pleinement développée telle que Marx les a tracés dans ses premiers écrits, un tableau qu'il a approfondi et auquel il n'a jamais renoncé dans ses travaux ultérieurs.
Dans Les Manuscrits économiques et philosophiques, après avoir examiné les diverses facettes de l'aliénation humaine, Marx s'est ensuite attaché à critiquer les conceptions du communisme, rudimentaires et inadéquates, qui prédominaient dans le mouvement prolétarien de l'époque. Comme nous l'avons vu dans le premier article de cette série, Marx a rejeté les conceptions héritées de Babeuf que les adeptes de Blanqui ont continué à défendre, car elles tendaient à présenter le communisme comme un nivellement général par le bas, une négation de la culture dans laquelle « la condition de travailleur n'est pas abolie, elle est étendue à tous les hommes. »([1] [892]) Dans cette conception, tout le monde devait devenir travailleur salarié sous la domination d'un capital collectif, de la « communauté en tant que capitaliste universel. »([2] [893]). En rejetant ces conceptions, Marx anticipait déjà sur les arguments que les révolutionnaires venus après ont dû développer pour démontrer la nature capitaliste des régimes soi-disant « communistes » de l'ex-bloc de l'Est (même si ces derniers étaient le produit monstrueux d'une contre-révolution bourgeoise et non l'expression d'un mouvement ouvrier immature).
Marx a également critiqué les versions plus « démocratiques » et plus sophistiquées de communisme telles que Considérant et d'autres les ont développées, car elles étaient « de nature encore politique », c'est-à-dire qu'elles ne proposaient pas de changement radical des rapports sociaux et restaient donc « encore imparfaites, encore affligées de la propriété privée. »([3] [894])
Marx avait à cœur de montrer, à l'encontre de ces définitions restrictives et déformées, que le communisme ne signifiait pas la réduction générale des hommes à un philistinisme inculte, mais l'élévation de l'humanité à ses plus hautes capacités créatrices. Ce communisme, comme Marx l'annonce dans un passage souvent cité mais rarement analysé, se donnait les buts les plus élevés :
« Le communisme en tant que dépassement positif de la propriété privée, donc de l'auto aliénation humaine, et par conséquent en tant qu'appropriation réelle de l'essence humaine par et pour l'homme, c'est le retour total de l'homme à soi en tant qu'homme social, c'est-à-dire humain, retour conscient accompli dans toute la richesse du développement antérieur. Ce communisme est un naturalisme achevé, et comme tel un humanisme ; en tant qu'humanisme achevé, il est un naturalisme ; il est la vraie solution de la lutte entre l'existence et l'essence, entre l'objectification et l'affirmation de soi, entre la liberté et la nécessité, entre l'individu et l'espèce. Il est l'énigme de l'histoire résolue et il sait qu'il est cette solution. »([4] [895]).
Le communisme vulgaire avait compris assez correctement que les réalisations culturelles des sociétés antérieures étaient basées sur l'exploitation de l'homme par l'homme. Mais ce faisant, il les rejetait de façon erronée alors que le communisme de Marx, au contraire, cherchait à s'approprier et à rendre vraiment fructueux tous les efforts culturels et, si l'on peut utiliser ce terme, spirituels antérieurs de l'humanité en les libérant des distorsions dont la société de classe les avait inévitablement marqués. En faisant de ces réalisations le bien commun de toute l'humanité, le communisme les fusionnerait en une synthèse supérieure et plus universelle. C'était une vision profondément dialectique qui, même avant que Marx ait exprimé une claire compréhension des formes communautaires de société ayant précédé la formation des divisions de classe, reconnaissait que l'évolution historique, en particulier dans sa phase finale capitaliste, avait spolié l'homme et l'avait privé de ses rapports sociaux « naturels » originels. Mais le but de Marx n'était pas un simple retour à une simplicité primitive perdue mais l'instauration consciente de l'être social de l'homme, une accession à un niveau supérieur qui intègre toutes les avancées contenues dans le mouvement de l'histoire.
De la même
façon, loin d'être simplement la généralisation de l'aliénation imposée au
prolétariat par les rapports sociaux capitalistes, ce communisme se considérait
comme le « dépassement positif» des multiples contradictions et aliénations
qui avaient tourmenté le genre humain jusqu'à présent.
La production communiste en tant que réalisation de la nature sociale de l'homme
Comme nous l'avons vu dans le précédent chapitre, la critique par Marx du travail aliéné présentait plusieurs aspects :
- le travail aliéné séparait le producteur de son propre produit : ce que l'homme créait de ses propres mains devenait une force hostile écrasant son créateur ; il séparait le producteur de l'acte de production : le travail aliéné était une forme de torture ([5] [896]), une activité totalement extérieure au travailleur. Et comme la caractéristique humaine la plus fondamentale, l'« être générique de l'homme » comme dit Marx, était la production créatrice consciente, transformer celle-ci en source de tourment, c'était séparer l'homme de son véritable être générique ;
- il séparait l'homme de l'homme : il y avait une profonde séparation non seulement entre l'exploiteur et l'exploité, mais aussi entre les exploités eux-mêmes, atomisés en des individus rivaux par les lois de la concurrence capitaliste.
Dans ses premières définitions du communisme, Marx traitait ces aspects de l'aliénation sous différents angles, mais toujours avec la même préoccupation de montrer que le communisme fournissait une solution concrète et positive à ces maux. Dans la conclusion des Extraits des éléments d'économie politique de James Mill, commentaire qu'il a écrit à la même époque que les Manuscrits, Marx explique pourquoi le remplacement du travail salarié capitaliste qui ne produit que pour le profit, par le travail associé produisant pour les besoins humains, constitue la base du dépassement des aliénations énumérées plus haut :
« En supposant la propriété privée, le travail est aliénation de la vie, car je travaille pour vivre, pour me procurer un moyen de vivre. Mon travail n'est pas ma vie. (...) En supposant la propriété privée, mon individualité est aliénée à un degré tel que cette activité m'est un objet de haine, de tourment : c'est un simulacre d'activité, une activité purement forcée, qui m'est imposée par une nécessité extérieure, contingente, et non par un besoin et une nécessité intérieurs. »([6] [897]).
En opposition à cela, Marx nous demande de supposer « que nous produisions comme des êtres humains : chacun de nous s'affirmerait doublement dans sa production, soi-même et l'autre. 1° Dans ma production, je réaliserais mon identité, ma particularité ; j'éprouverais, en travaillant, la jouissance d'une manifestation individuelle de ma vie, et, dans la contemplation de l'objet, j'aurais la joie individuelle de reconnaître ma personnalité comme une puissance réelle, concrètement saisissable et échappant à tout doute. 2° Dans ta jouissance ou ton emploi de mon produit, j'aurais la joie spirituelle immédiate de satisfaire par mon travail un besoin humain, de réaliser la nature humaine et de fournir au besoin d'un autre l'objet de sa nécessité. 3° J'aurais conscience de servir de médiateur entre toi et le genre humain, d'être reconnu et ressenti par toi comme un complément à ton propre être et comme une partie nécessaire de toi-même; d'être accepté dans ton esprit comme dans ton amour. 4° J'aurais, dans mes manifestations individuelles, la joie de créer la manifestation de ta vie, c'est-à-dire de réaliser et d'affirmer dans mon activité individuelle ma vraie nature, ma sociabilité humaine. Nos productions seraient autant de miroirs où nos êtres rayonneraient l'un vers l'autre. (... ) Mon travail serait une manifestation libre de la vie, une jouissance de la vie. »([7] [898]).
Ainsi, pour Marx, les être humains ne produiraient de façon humaine que lorsque chaque individu serait capable de se réaliser pleinement dans son travail : accomplissement qui vient de la jouissance active de l'acte productif ; de la production d'objets qui non seulement aient une utilité réelle pour d'autres êtres humains mais qui méritent également d'être contemplés en eux‑mêmes, parce qu'ils ont été produits, pour utiliser une expression des Manuscrits, « selon les lois de la beauté » ; du travail en commun avec d'autres êtres humains, et dans un but commun.
Ici, il apparaît clairement que, pour Marx, la production pour les besoins qui est l'une des caractéristiques du communisme, est bien plus que la simple négation de la production capitaliste de marchandises, de la production pour le profit. Dès le début, l'accumulation de richesses comme capital a signifié l'accumulation de la pauvreté pour les exploités ; à l'époque du capitalisme moribond, c'est doublement vrai, et aujourd'hui, il est plus évident que jamais que l'abolition de la production de marchandises est une pré condition pour la survie même de l'humanité. Mais pour Marx, la production pour les besoins n'a jamais constitué un simple minimum, une satisfaction purement quantitative des besoins élémentaires de se nourrir, de se loger, etc. La production pour les besoins était également le reflet de la nécessité pour l'homme de produire - pour l'acte de production en tant qu'activité sensuelle et agréable, en tant que célébration de l'essence communautaire du genre humain. C'est une position que Marx n'a jamais modifiée. Comme l'écrit, par exemple, le Marx « mûr» dans la Critique du Programme de Gotha (1874), quand il parle d'une «phase supérieure de la société communiste, quand auront disparu l'asservissante subordination des individus à la division du travail, et, avec elle, l'antagonisme entre le travail intellectuel et le travail manuel, quand le travail sera devenu non seulement un moyen de vivre, mais même le premier besoin de l'existence ; quand avec le développement en tous sens des individus, les forces productives iront s'accroissant, et que toutes les sources de la richesse collective jailliront avec abondance... »([8] [899]).
« ...Quand
le travail sera devenu non seulement un moyen de vivre, mais même le premier
besoin de l'existence»... De telles affirmations sont cruciales si l'on
veut répondre à l'argument typique de l'idéologie bourgeoise selon lequel si
l'appât du gain est supprimé, il ne reste plus de motivation pour que
l'individu ou la société dans son ensemble produise quoi que ce soit. Une fois
encore, un élément fondamental de réponse, c'est de montrer que, sans
l'abolition du travail salarié, la simple survie du prolétariat, de l'humanité
elle-même, n'est pas possible. Mais cela reste un argument purement négatif si
les communistes ne mettent pas en évidence que dans la société future, la
principale motivation pour travailler sera que travailler devient « le
premier besoin de l'existence », la jouissance de la vie - cœur de
l'activité humaine et accomplissement des désirs les plus essentiels de
l'homme.
Dépasser la division du travail
Il faut noter comment Marx, dans cette dernière citation, commence sa description de la phase supérieure du communisme en envisageant l'abolition de « l'asservissante subordination des individus à la division du travail, et, avec elle, l'antagonisme entre le travail intellectuel et le travail manuel». C'est un thème constant de la dénonciation par Marx du travail salarié capitaliste. Dans le premier volume du Capital, il passe des pages et des pages à fulminer contre la façon dont le travail à l'usine réduit l'ouvrier à un simple fragment de lui-même ; contre la façon dont il transforme les hommes en corps sans tête, dont la spécialisation a réduit le travail à la répétition des actions les plus mécaniques engourdissant l'esprit. Mais cette polémique contre la division du travail se trouve déjà dans ses premiers travaux, et il est clair dans ce qu'il dit que, pour Marx, il ne peut être question de dépasser l'aliénation implicite dans le système salarié sans qu'il y ait une profonde transformation de la division du travail existante. Un passage fameux de l'Idéologie Allemande traite cette question :
« Enfin, et la division du travail nous en fournit d'emblée le premier exemple, aussi longtemps que les hommes se trouvent dans la société primitive, donc aussi longtemps que subsiste la division entre intérêt particulier et intérêt général, et que l'activité n'est pas divisée volontairement mais naturellement, le propre acte de l'homme se dresse devant lui comme une puissance étrangère qui l'asservit, au lieu que ce soit lui qui la maîtrise. En effet, du moment où le travail commence à être réparti, chacun entre dans un cercle d'activités déterminé et exclusif, qui lui est imposé et dont il ne peut s'évader ; il est chasseur, pêcheur, berger ou "critique", et il doit le rester sous peine de perdre les moyens qui lui permettent de vivre. Dans la société communiste, c'est le contraire : personne n'est enfermé dans un cercle exclusif d'activités et chacun peut se former dans n'importe quelle branche de son choix ; c'est la société qui règle la production générale et qui me permet ainsi de faire aujourd'hui telle chose, demain telle autre, de chasser le matin, de pêcher l'après-midi, de m'occuper d'élevage le soir et de m'adonner à la critique après le repas, selon que j'en ai envie, sans jamais devenir chasseur, pêcheur, berger ou critique. »([9] [900]).
Cette merveilleuse image de la vie quotidienne dans une société communiste pleinement développée utilise évidemment une certaine licence poétique, mais elle traite le point essentiel : étant donné le développement des forces productives que le capitalisme a apporté, il n'y a absolument pas besoin que les êtres humains passent la plus grande partie de leur vie dans la prison d'un genre unique d'activité - par-dessus tout dans le genre d'activité qui ne permet l'expression que d'une minuscule part des capacités réelles de l'individu. De la même façon, nous parlons de l'abolition de l'ancienne division entre la petite minorité d'individus qui ont le privilège de vivre d'un travail réellement créatif et gratifiant, et la vaste majorité condamnée à l'expérience du travail comme aliénation de la vie :
« Le fait que le talent artistique soit concentré exclusivement dans quelques individus, et qu'il soit, pour cette raison, étouffé dans la grande masse des gens, est une conséquence de la division du travail. (...) dans une organisation communiste de la société, l'assujettissement de l'artiste à l'esprit borné du lieu et de la nation aura disparu. Cette étroitesse d'esprit est un pur résultat de la division du travail. Disparaîtra également l'assujettissement de l'individu à tel art déterminé qui le réduit au rôle exclusif de peintre, de sculpteur, etc., de sorte que, à elle seule, l'appellation reflète parfaitement l'étroitesse de son développement professionnel et sa dépendance de la division du travail. Dans une société communiste, il n'y a pas de peintres, mais tout au plus des êtres humains qui, entre autres choses, font de la peinture. »([10] [901]).
L'image
héroïque de la société bourgeoise dans son aurore naissante est celle de 1' «
Homme de la Renaissance
» - d'individus tels que Léonard De Vinci qui a combiné les talents d'artiste,
de scientifique et de philosophe. Mais de tels hommes ne sont que des exemples
exceptionnels, des génies extraordinaires, dans une société où l'art et la
science s'appuyaient sur le labeur éreintant de l'immense majorité. La vision
du communisme de Marx est celle d'une société composée tout entière d'« Hommes
de la Renaissance
»([11] [902])
L'émancipation des sens
Pour le genre
de « socialistes » dont la fonction est de réduire le socialisme à un léger
maquillage du système existant d'exploitation, de telles visions ne peuvent
constituer une anticipation du futur de l'humanité. Pour le partisan du socialisme
« réel » (c'est-à-dire le capitalisme d'Etat pour la social-démocratie, le
stalinisme ou le trotskisme), il ne s'agit vraiment que de visions, de rêves
utopiques irréalisables. Mais pour ceux qui sont convaincus que le communisme
est à la fois une nécessité et une possibilité, l'extrême audace de la
conception du communisme de Marx, son refus inflexible de s'en tenir au
médiocre et au second ordre ne peuvent que constituer une inspiration et un
stimulant pour poursuivre une lutte sans relâche contre la société
capitaliste. Et le fait est que les descriptions par Marx des buts ultimes du communisme
sont extrêmement hardies, bien plus que ne le soupçonnent habituellement les
« réalistes », car elles ne considèrent pas seulement les profonds changements
qu'implique la transformation communiste (production pour l'usage, abolition de
la division du travail, etc.) ; elles fouillent aussi dans les changements subjectifs
que le communisme apportera, permettant une transformation spectaculaire de la
perception et de l'expérience sensitive mêmes de l'homme.
Là encore la méthode de Marx est de partir du problème réel, concret posé par le capitalisme et de chercher la solution contenue dans les contradictions présentes de la société. Dans ce cas, il décrit la façon dont le règne de la propriété privée réduit les capacités de l'homme de jouir véritablement de ses sens. D'abord, cette restriction est une conséquence de la simple pauvreté matérielle qui émousse les sens, réduit toutes les fonctions fondamentales de la vie à leur niveau animal, et empêche les êtres humains de réaliser leur puissance créatrice :
« Prisonnier du besoin élémentaire, le sens n'a qu'un sens borné. Pour l'homme affamé, la nourriture n'a pas de qualité humaine ; il n'en perçoit que l'existence abstraite : elle pourrait tout aussi bien se présenter sous sa forme la plus primitive sans que l'on puisse dire en quoi son activité nourricière se distingue du pâturage. Le souci et le besoin rendent l'homme insensible au plus beau des spectacles. »([12] [903])
Au contraire, « les sens de l'homme social sont autres que ceux de l'homme non social. C'est seulement grâce à l'épanouissement de la richesse de l'être humain que se forme et se développe la richesse de la sensibilité subjective de l'homme : une oreille musicienne, un oeil pour la beauté des formes, bref des sens capables de jouissance humaine, des sens s'affirmant comme maîtrise propre à l'être humain... une fois accomplie (sa gestation), la société produit comme sa réalité durable l'homme pourvu de toutes les richesses de son être, l'homme riche, l'homme doué de tous ses sens, l'homme profond. »([13] [904])
Mais ce n'est pas seulement la privation matérielle quantifiable qui restreint le libre jeu des sens. C'est quelque chose de plus profondément incrusté par la société de propriété privée, la société d'aliénation. C'est la « stupidité » induite par cette société qui nous convainc que rien « n'est vraiment vrai » tant qu'on ne le possède pas :
« La propriété privée nous a rendus si sots et si bornés qu'un objet est nôtre uniquement quand nous l'avons, quand il existe pour nous comme capital, ou quand ils est immédiatement possédé, mangé, bu, porté sur notre corps, habité par nous, etc., bref quand il est utilisé par nous. Il est vrai que la propriété privée ne conçoit toutes ces réalisations directes de la possession elle-même que comme des moyens de vivre, et la vie, à laquelle elles servent de moyens, comme la vie de la propriété privée : le travail et le profit du capital. A la place de tous les sens physiques et intellectuels est apparue l'aliénation pure et simple des sens, le sens de l'avoir. »([14] [905])
Et de nouveau, en opposition à cela :
« ...l'abolition positive de la propriété privée - c'est-à-dire l'appropriation sensible par l'homme et pour l'homme de la vie et de l'être humains, de l'homme objectif, des oeuvres humaines - ne doit pas être comprise dans le seul sens de la jouissance immédiate, partiale, dans le sens de la possession, de l'avoir. L'homme s'approprie sa nature universelle d'une manière universelle, donc en tant qu'homme total. Chacun de ses rapports humains avec le monde, voir, entendre, sentir, goûter, toucher, penser, contempler, vouloir, agir, aimer, bref, tous les actes de son individualité, aussi bien que, sous leur forme directe, ses organes génériques sont, dans leur comportement envers l'objet, l'appropriation de celui-ci (...) L'abolition de la propriété privée est l'émancipation de tous les sens et de toutes les qualités humaines ; mais elle est cette émancipation précisément parce que ces sens et ces qualités deviennent humains, tant subjectivement qu'objectivement. L’œil devient l’œil humain, tout comme son objet devient un objet social, humain, venant de l'homme et aboutissant à l'homme. Ainsi les sens sont devenus "théoriciens" dans leur action immédiate. Ils se rapportent à l'objet pour l'amour de l'objet et inversement, l'objet se rapporte humainement à lui-même et à l'homme. C'est pourquoi le besoin et la jouissance perdent leur nature égoïste, tandis que la nature perd sa simple utilité pour devenir utilité humaine. »([15] [906])
Interpréter ces passages dans toute leur profondeur et leur complexité pourrait prendre un livre entier. Mais à partir de là, ce qui est clair, c'est que, pour Marx, le remplacement du travail aliéné par une forme réellement humaine de production mènerait à une modification fondamentale de l'état de conscience de l'homme. La libération de l'espèce du tribut paralysant payé à la lutte contre la pénurie, le dépassement de l'association de l'anxiété et du désir imposée par la domination de la propriété privée libèrent les sens de l'homme de leur prison et lui permettent de voir, d'entendre et de sentir d'une nouvelle façon. Il est difficile de discuter de telles formes de conscience parce qu'elles ne sont pas « simplement » rationnelles. Cela ne veut pas dire qu'elles ont régressé à un niveau antérieur au développement de la raison. – cela veut dire qu'elles sont allées au-delà de la pensée rationnelle telle qu'elle a été conçue jusqu'à présent en tant qu'activité séparée et isolée, atteignant une condition dans laquelle « non seulement dans le penser, mais avec tous ses sens, l'homme s'affirme dans le monde des objets. »([16] [907])
Une première approche pour comprendre de telles transformations internes, c'est de se référer à l'état d'inspiration qui existe dans toute grande oeuvre d'art ([17] [908]). Dans cet état d'inspiration, le peintre ou le poète, le danseur ou le chanteur entrevoit un monde transfiguré, un monde resplendissant de couleur et de musique, un monde d'une signification élevée qui fait que notre état « normal » de perception apparaît partiel, limité et même irréel - ce qui est juste quand on se rappelle que la « normalité » est précisément la normalité de l'aliénation. De tous les poètes, William Blake a peut-être le mieux réussi à faire connaître la distinction entre l'état « normal » dans lequel « l'homme s'est enfermé jusqu'à voir toutes choses à travers les étroites fissures de sa caverne » et l'état d'inspiration qui, dans la perspective messianique mais par beaucoup d'aspects, très matérialiste de Blake, «passera par une amélioration de la jouissance sensuelle» et par l'ouverture des «portes de la perception ». Si l'humanité ne pouvait accomplir que cela, « tout apparaîtrait à l'homme tel que c'est, infini. »([18] [909])
L'analogie avec l'artiste n'est pas du tout fortuite. Lorsqu'il écrivait les Manuscrits, l'ami le plus estimé de Marx était le poète Heine et toute sa vie durant, Marx fut passionné par les oeuvres d'Homère, Shakespeare, Balzac et autres grands écrivains. Pour lui, de tels personnages et leur créativité débridée, constituaient des modèles durables du véritable potentiel de l'humanité. Comme nous l'avons vu, le but de Marx était une société où de tels niveaux de créativité deviendraient un attribut « normal » de l'homme ; il s'ensuit donc que l'état élevé de perception sensitive décrite dans les Manuscrits deviendrait de plus en plus l'état « normal » de conscience de l'humanité sociale.
Plus tard, l'approche de Marx développera plus l'analogie avec l'activité créatrice du scientifique qu'avec celle de l'artiste, tout en conservant l'essentiel : la libération de la corvée du travail, le dépassement de la séparation entre travail et temps libre, produisent un nouveau sujet humain :
«Au demeurant, il tombe sous le sens que le temps de travail immédiat ne pourra pas toujours être opposé de manière abstraite au temps libre, comme c'est le cas dans le système économique bourgeois. (...) Le temps libre - qui est à la fois loisir et activité supérieure - aura naturellement transformé son possesseur en un sujet différent, et c'est en tant que sujet nouveau qu'il entrera dans le processus de la production immédiate. Par rapport à l'homme en formation, ce processus est d'abord discipline ; par rapport à l'homme formé, dont le cerveau est le réceptacle des connaissances socialement accumulées, il est exercice, science expérimentale, science matériellement créatrice et réalisatrice. Pour l'un et l'autre, il est en même temps effort, dans la mesure où, comme en agriculture, le travail exige la manipulation pratique et le libre mouvement. »([19] [910])
Au-delà du moi atomisé
L'éveil des sens par la libre activité humaine implique aussi la transformation du rapport de l'individu avec le monde social et naturel qui l'entoure. C'est à ce problème que Marx se réfère quand il dit que le communisme résoudra les contradictions « entre l'existence et l'essence... entre l'objectification et l'affirmation de soi... entre l'individu et l'espèce». Comme nous l'avons vu dans le chapitre sur l'aliénation, Hegel dans son examen du rapport entre le sujet et l'objet dans la conscience humaine, a reconnu que la capacité unique de l'homme de se concevoir en tant que sujet séparé était vécue comme une aliénation : l'« autre », le monde objectif, à la fois humain et naturel, lui apparaissait comme hostile et étranger. Mais l'erreur de Hegel était de voir cela dans l'absolu au lieu de le considérer comme un produit historique ; de ce fait, il n'y voyait pas d'issue sinon dans les sphères raréfiées de la spéculation philosophique. Pour Marx, d'un autre côté, c'est le travail de l'homme qui avait créé la distinction sujet objet, la séparation entre l'homme et la nature, l'individu et l'espèce. Mais jusqu'ici le travail avait été « le devenir pour soi de l'homme à l'intérieur de l'aliénation. »([20] [911]) Et c'est pourquoi, jusqu'à présent, la distinction entre le sujet et l'objet avait aussi été vécue comme aliénation. Ce processus, comme on l'a vu, avait atteint son point le plus avancé dans le moi isolé, profondément atomisé de la société capitaliste ; mais le capitalisme avait également jeté la base de la résolution pratique de cette aliénation. Dans la libre activité créatrice du communisme, Marx voyait la base d'un état de l'être dans lequel l'homme considère la nature comme humaine et lui-même comme naturel ; un état dans lequel le sujet a réalisé une unité consciente avec l'objet :
« ...dans la société, la réalité objective devient pour l'homme la réalité de sa maîtrise en tant qu'être humain ; réalité humaine, cette maîtrise est par conséquent la réalité de son être propre, grâce à laquelle tous les objets deviennent pour lui l'objectification de lui-même, les objets qui confirment et réalisent son individualité, ses objets : il devient lui-même objet. »([21] [912])
Dans ses commentaires sur les Manuscrits, Bordiga a particulièrement insisté sur ce point : la résolution des énigmes de l'histoire ne devenait possible que «parce qu'on est sorti de la tromperie millénaire de l'individu seul face au monde naturel stupidement appelé externe par les philosophes. Externe à quoi ? Externe au moi, ce déficient suprême ; externe à l'espèce humaine, on ne peut plus l'affirmer, parce que l'homme espèce est interne à la nature, il fait partie du monde physique ». Et il continue en disant que « dans ce texte puissant, l'objet et le sujet deviennent, comme l'homme et la nature, une seule et même chose. Et même tout est objet : l'homme sujet "contre nature" disparaît avec l'illusion d'un moi singulier. »([22] [913])
Jusqu'ici, le fait de cultiver volontairement des états (ou plutôt des étapes, puisque nous ne parlons ici de rien de définitif) de conscience qui aillent au-delà de la perception du moi isolé, s'est limité en grande partie à des traditions mystiques. Par exemple, dans le bouddhisme Zen, les comptes-rendus d'expérience de Satori dans lesquels s'exprime une tentative de dépasser la rupture entre le sujet et l'objet dans une unité plus vaste, comportent une certaine ressemblance avec le mode d'être que Bordiga, à la suite de Marx, a tenté de décrire. Mais tandis que la société communiste trouvera peut-être à se réapproprier de ces traditions, il ne faut pas déduire de ces passages de Marx ou de Bordiga que le communisme pourrait se définir comme une « société mystique » ou qu'il y a un « mysticisme communiste », comme on le trouve dans certains textes sur la question de la nature qui ont été publiés récemment par le groupe bordiguiste Il Partito Comunista([23] [914]). Inévitablement, 1' enseignement de toutes les traditions mystiques était plus ou moins lié aux diverses conceptions religieuses et idéologiques erronées résultant de l'immaturité des conditions historiques, tandis que le communisme sera capable de s'emparer du « noyau rationnel » de ces traditions et de les intégrer dans une véritable science de l'homme. De façon également inévitable, les vues et les techniques des traditions mystiques étaient, presque par définition, limitées à une élite d'individus privilégiés, alors que dans le communisme, il n'y aura pas de « secrets » à cacher aux masses vulgaires. En conséquence, l'extension de la conscience que réalisera l'humanité collective du futur, sera incomparablement supérieure aux éclairs d'illumination atteints par des individus dans les limites de la société de classe.
Les branches d'un arbre de la terre
Telles sont les recherches les plus lointaines dans la vision du communisme de Marx, une vision qui s'étend même au-delà du communisme, puisque Marx dit à un moment que « le communisme est la forme nécessaire et le principe dynamique du proche avenir sans être en tant que tel le but du développement humain.»([24] [915]) Le communisme, même sous sa forme pleinement développée, n'est que le début de la société humaine.
Mais ayant atteint ces hauteurs de l'Olympe, il est nécessaire de revenir sur terrain ferme ; ou plutôt de rappeler que cet arbre dont les branches s'élèvent vers le ciel, est fermement enraciné dans le sol de la Terre.
Nous avons déjà présenté plusieurs arguments contre l'accusation selon laquelle les divers tableaux présentés par Marx de la société communiste seraient des schémas purement spéculatifs et utopiques : d'abord en montrant que même ses premiers écrits en tant que communiste se basent sur un diagnostic très complet et scientifique de l'aliénation de l'homme, et plus particulièrement sous le règne du capital. Le remède découle donc logiquement du diagnostic : le communisme doit fournir le « dépassement positif» de toutes les manifestations de l'aliénation humaine.
Deuxièmement, nous avons vu comment les descriptions d'une humanité qui a retrouvé sa santé, étaient toujours basées sur de réels aperçus d'un monde transformé, d'authentiques moments d'inspiration et d'illumination qui peuvent avoir lieu et ont lieu dans la chair et le sang d'êtres humains même dans les limites de l'aliénation.
Mais ce qui était encore peu développé dans les Manuscrits, c'est la conception du matérialisme historique : l'examen des transformations économiques et sociales successives qui ont jeté les bases de la société communiste future. Dans son travail ultérieur, donc, Marx a dû dépenser une grande partie de son énergie à étudier le mode d'action sous-jacent du système capitaliste, et l'opposer aux modes de production qui avaient précédé l'époque bourgeoise. En particulier, une fois qu'il eût mis à nu les contradictions inhérentes à l'extraction et à la réalisation de la plus-value, Marx fut capable d'expliquer comment toutes les sociétés de classe précédentes avaient péri parce qu'elles ne pouvaient produire suffisamment, tandis que le capitalisme était le premier à être menacé de destruction parce qu'il « surproduisait ».
Mais c'est précisément cette tendance inhérente à la surproduction qui a signifié que le capitalisme établissait les bases d'une société d'abondance matérielle ; une société capable de libérer les immenses forces productives développées puis entravées par le capital, une fois celui-ci parvenu dans sa période de déclin historique ; une société capable de les développer pour les besoins humains et concrets de l'homme et non pour les besoins inhumains et abstraits du capital.
Dans les Grundrisse, Marx a examiné ce problème en se référant spécifiquement à la question du temps de surtravail, observant que : « Ainsi, réduisant à son minimum le temps du travail, le capital contribue malgré lui à créer du temps social disponible au service de tous, pour l'épanouissement de chacun. Mais, tout en créant du temps disponible, il tend à le transformer en surtravail. Plus il réussit dans cette tâche, plus il souffre de surproduction ; et sitôt qu'il n'est pas en mesure d'exploiter du surtravail, le capital arrête le travail nécessaire. Plus cette contradiction s'aggrave, plus on s'aperçoit que l'accroissement des forces productives doit dépendre non pas de l'appropriation du sur-travail par autrui, mais par la masse ouvrière elle-même. Quand elle y sera parvenue - et le temps disponible perdra du coup son caractère contradictoire - le temps de travail nécessaire s'alignera d'une part sur les besoins de l'individu social, tandis qu'on assistera d'autre part à un tel accroissement de forces productives que les loisirs augmenteront pour chacun, alors que la production sera calculée en vue de la richesse de tous. La vraie richesse étant la pleine puissance productive de tous les individus, l'étalon de mesure en sera non pas le temps de travail, mais le temps disponible. »([25] [916])
Nous reviendrons sur cette question du temps de travail dans d'autres articles, en particulier quand nous examinerons les problèmes économiques de la période de transition. Ce sur quoi nous voulons insister ici, c'est que, quelles que soient la radicalité et la profondeur de vue des tableaux présentés par Marx du futur communiste de l'humanité, ils étaient basés sur une sobre affirmation des possibilités réelles contenues dans le système de production existant. Mais plus que cela : l'émergence d'un monde qui mesure la richesse en termes de « temps disponible » plutôt qu'en temps de travail, un monde qui dédie consciemment ses ressources productives au plein développement du potentiel humain, n'est pas une simple possibilité : c'est une nécessité brûlante si l'humanité veut trouver une issue face aux contradictions dévastatrices du capitalisme. Ces derniers développements théoriques montrent donc par eux-mêmes qu'ils sont en totale continuité avec les premières descriptions audacieuses de la société communiste : ils démontrent de façon évidente que « le dépassement positif» de l'aliénation décrit avec une telle profondeur et une telle passion dans les premiers travaux de Marx n'était pas un choix parmi beaucoup d'autres pour le futur de l'humanité, mais son seul futur.
Dans le prochain article, nous suivrons les pas de Marx et Engels, après leurs premiers textes soulignant les buts ultimes du mouvement communiste : la montée de la lutte politique qui constituait la pré-condition indispensable aux transformations économiques et sociales qu'ils envisageaient. Nous examinerons donc comment le communisme est devenu un programme politique explicite avant, pendant et après les grands soulèvements sociaux de 1848.
CDW.
[1] [917] Manuscrits économiques et philosophiques, « Communisme et propriété », p. 77, Ed. La Pléiade, T.11.
[2] [918] Ibid, page 78.
[3] [919] Ibid, page 79.
[4] [920] Ibid.
[5] [921] D'ailleurs en français, travail vient du bas-latin trepalium, un instrument de torture...
[6] [922] « Notes de lecture », p. 34, Ed. La Pléiade, T.II.
[7] [923] Ibid. , p. 33.
[8] [924] Critique du Programme de Gotha, p. 24, Ed. Spartacus
[9] [925] L'idéologie Allemande, « I. Feuerbach », « Division du travail et aliénation », p. 1065, Ed. La Pléiade, T.III.
[10] [926] Ibid. , « III Saint Max », « Organisation du travail », p. 1289
[11] [927] La terminologie utilisée ici est inévitablement marquée de préjugé sexuel, parce que l'histoire de la division du travail est également l'histoire de l'oppression des femmes et de leur exclusion effective de bien des sphères d'activité sociale et politique. Dans ses premiers travaux, Marx a souligné que le rapport naturel des sexes « permet de juger de tout le degré du développement humain » et que « du caractère de ce rapport, on peul conclure jusqu'à quel point l'homme est devenu pour lui-même un être générique, humain, et conscient de l'être devenu.... » (Manuscrits, « Communisme et propriété », p. 78, Ed. La Pléiade, T.II)).
Ainsi, il était évident pour Marx que l'abolition communiste de la division du travail était également l'abolition de tous les rôles restrictifs imposés aux hommes et aux femmes. Le marxisme ne s'est donc jamais réclamé du soi-disant « mouvement de libération des femmes » dont la renommée se base sur le fait qu'il serait le seul à voir que les visions « traditionnelles » (c'est-à-dire staliniennes et gauchistes) de la révolution seraient trop limitées à d'étroits buts politiques et économiques et « rateraient » de ce fait la nécessité d'une transformation radicale des rapports entre les sexes. Pour Marx, il était évident dès le début qu'une révolution communiste signifiait précisément une transformation profonde de tous les aspects des rapports humains.
[12] [928] Manuscrits, « Communisme et propriété », p. 85, Ed. La Pléiade, T.II.
[13] [929] Ibid. , p. 84-85
[14] [930] Ibid., p. 83
[15] [931] Ibid., p. 82-83
[16] [932] Ibid. , p. 84
[17] [933] Dans son autobiographie, Trotsky, rappelant les premiers jours de la révolution d'octobre, souligne que le processus révolutionnaire lui-même s'exprime comme une explosion massive d'inspiration collective :
« Le marxisme est à considérer comme l'expression consciente d'un processus historique inconscient. Mais le processus "inconscient", au sens historico-philosophique du terme et non psychologique, ne coïncide avec son expression consciente qu'en ses plus hauts sommets, lorsque la masse, par la poussée de ses forces élémentaires, force les portes de la routine sociale et donne une expression victorieuse aux plus profonds besoins de l'évolution historique. La conscience théorique la plus élevée que l'on a de l'époque fusionne, en de tels moments, avec l'action directe des couches les plus profondes, des masses opprimées les plus éloignées de toute théorie. La fusion créatrice du conscient avec l'inconscient est ce qu'on appelle d'ordinaire, l'inspiration. La révolution est un moment d'inspiration exaltée de l'histoire.
Tout véritable écrivain connaît des moments de création où quelqu'un de plus fort que lui guide sa main. Tout véritable orateur a connu des minutes où quelque chose de plus fort que lui ne l'était à ses heures ordinaires s'exprimait par ses lèvres. C'est cela "l'inspiration". Elle naît d'une suprême tension créatrice de toutes les forces. L'inconscient remonte de sa profonde tanière et se subordonne le travail conscient de la pensée, se l'assimile dans une sorte d'unité supérieure.
Les heures où la tension des forces spirituelles est poussée à son plus haut degré s'emparent quelques fois de l'activité individuelle sous tous ses aspects, car elle est liée au mouvement des masses. Telles furent les journées d'Octobre pour les "leaders". Les forces latentes de l'organisme, ses instincts profonds, tout le flair hérité de fauves ancêtres, tout cela se souleva, rompit les guichets de la routine psychique et - à côté des généralisations historico-philosophiques les plus élevées - se mit au service de la révolution.
Ces deux processus, celui des individus et celui des masses, étaient basés sur une combinaison du conscient avec l'inconscient, de l'instinct, qui donne du ressort à la volonté, avec les plus hautes généralisations de l'esprit.
Extérieurement, cela n'avait pas du tout l'air pathétique : des hommes circulaient, las, affamés, non lavés, les yeux enflammés, les joues hérissées de poils parce qu'ils ne s'étaient pas rasés. Et chacun d'eux ne fut en mesure, plus tard, de raconter que très peu de chose sur les jours et les heures les plus critiques. » (Trotsky, Ma Vie, chap.19, ed.Gallimard).
Ce passage à propos de l'émancipation des sens est également remarquable parce que, dans la continuité des écrits de Marx, il soulève la question du lien entre le marxisme et la théorie psychanalytique. Selon l'auteur de cet article, les conceptions de Marx de l'aliénation et sa notion d'émancipation des sens ont été confirmées, à partir d'un point de vue différent, par les découvertes de Freud. Tout comme Marx voyait l'aliénation de l'homme comme un processus accumulatif atteignant son point culminant dans le capitalisme, Freud a décrit le processus de la répression atteignant son paroxysme dans la civilisation actuelle. Et pour Freud, ce qui est réprimé est précisément la capacité de l'être humain de jouir de ses sens - le lien érotique avec le monde que nous savourons dans la prime enfance mais qui est progressivement « réprimé » à la fois dans l'histoire de l'espèce et dans celle de l'individu. Freud a également compris que la source ultime de cette répression résidait dans la lutte contre la pénurie matérielle. Mais alors que Freud, en tant que penseur bourgeois honnête, l'un des derniers à avoir apporté une réelle contribution à la science humaine, était incapable d’envisager une société ayant dépassé la pénurie et donc la nécessité de la répression, la vision de l’émancipation des sens de Marx considère la restauration du monde d’être érotique « infantile » à un niveau supérieur. Comme Marx lui-même le souligne, « Un homme ne peut redevenir un enfant sans être puéril. Mais ne se réjouit-il pas de la naïveté de l’enfant, et ne doit-il pas lui-même s’efforcer, à un niveau plus élevé, de reproduire sa vérité ? ». (Introduction générale à la critique de l’économie politique, p 266, Ed. La Pléiade, T.I.).
[18] [934] in « The Marriage of Heaven and Hell U.
[19] [935] Principes d'une critique de l'économie politique, « Le Capital », p. 311, Ed. La Pléiade, T.11.
[20] [936] Manuscrits, « Critique de la philosophie hégélienne », p. 126, Ed. La Pléiade, T.II.
[21] [937] Manuscrits, « Communisme et propriété «, p. 84, Ibid.
[22] [938] Bordiga et la passion du communisme, «Tables immuables de la théorie communiste de parti », J. Camatte, 1972
[23] [939] Voir en particulier le Rapport de la réunion des 3/4 février 1990 à Florence, Communist Left n°3 et l'article « Nature et révolution communiste » dans Communist Left n°5. Nous ne sommes pas surpris que les bordiguistes tombent ici dans le mysticisme : toute leur notion d'un programme communiste invariant en est déjà fortement imprégnée. Nous devons savoir également que dans certaines de ses formulations sur le dépassement du moi atomisé, c'est-à-dire de l'aliénation entre soi et les autres, Bordiga s'égare dans la négation pure et simple de l'individu ; que le point de vue de Bordiga sur le communisme et également sur le parti qu'il voyait, dans un certain sens, comme une préfiguration de celui-là, glisse souvent vers une suppression totalitaire de l'individu par le collectif. Au contraire, Marx a toujours rejeté de telles conceptions comme l'expression de déformations grossières et primitives du communisme. Il parlait du communisme qui résolvait la contradiction entre l'individu et l'espèce - pas de l'abolition de l'individu, mais de sa réalisation dans la collectivité, et de la réalisation de celle-ci dans chaque individu.
[24] [940] Manuscrits, « Propriété privée et communisme », p. 90, Ed. La Pléiade, T.II.
[25] [941] Principes d'une critique de l'économie politique, « Le Capital «, p. 307-308, Ed. La pléiade, T.II.
Approfondir:
Questions théoriques:
- Communisme [492]
Heritage de la Gauche Communiste:
Revue Int. 1993 - 72 à 75
- 4285 reads
Revue Internationale no 72 - 1e trimestre 1993
- 3122 reads
Situation internationale : un tournant
- 3067 reads
De la Somalie à l'Angola, du Venezuela à la Yougoslavie, de famines en massacres, de coups d'Etats en guerres « civiles », le tourbillon de la décomposition accélérée de tous les rouages de la société capitaliste n'engendre que des ravages. Partout, non seulement la prospérité et la liberté promises ne sont pas au rendez-vous, mais de plus, le capitalisme porte partout le fer et le feu, déchaîne le militarisme, réduit les masses de l'immense majorité de la population mondiale à la déchéance, la misère et la mort, et porte des attaques massives aux conditions d'existence du prolétariat dans les grands centres urbains et industrialisés.
Chaos, mensonges et guerre impérialiste
Que le « nouvel ordre mondial » se révèle n'être qu'un chaos généralisé, même les plus ardents défenseurs de l'ordre existant sont de plus en plus forcés de le reconnaître. Mieux, ne pouvant plus cacher la détérioration, dans tous les pays, de tous les aspects de la vie politique, économique et sociale, les journaux, les radios, les télés, porte-voix des classes dominantes, rivalisent désormais pour «dévoiler» la réalité. Scandales politiques, génocides ethniques, déportations, répressions et ratonnades, pogroms et catastrophes en tous genres, épidémies et famines, tout y est. Mais les événements, bien réels, au lieu d'être expliqués pour ce qu'ils sont, au fond, c'est-à-dire la conséquence de la crise mondiale du capitalisme ([1]), sont chaque fois présentés comme une sorte de fatalité.
En montrant la famine en Somalie, les massacres de la « purification ethnique » en Yougoslavie, les déportations et martyrs des populations dans les républiques du sud de l'ex-URSS, les magouilles politiciennes, la propagande rend compte du pourrissement actuel. Mais elle le fait en présentant les phénomènes sans aucun lien entre eux, distillant ainsi un sentiment d'impuissance, entravant la prise de conscience que c'est le mode de production capitaliste dans son ensemble qui est responsable de la situation, dans tous ses aspects les plus corrompus, et que, au premier rang, se trouvent les bourgeoisies des grands pays capitalistes.
La décomposition est le résultat du blocage de tous les rouages de la société : une crise générale de l'économie mondiale, ouverte depuis plus de vingt-cinq ans, et l'absence d'une perspective de sortie de cette crise. Et les grandes puissances, qui, avec la fin du stalinisme, prétendaient ouvrir une « ère de paix et de prospérité » pour le capitalisme, sont entraînées dans un chacun pour soi débridé, qui entretient et amplifie cette désagrégation sociale, sur les plans intérieur et international.
Sur le plan de la situation intérieure des pays industrialisés, les bourgeoisies nationales s'efforcent de contenir les manifestations de la décomposition, tout en les utilisant pour renforcer l'autorité de l'Etat ([2]). C'est ce qu'a fait la bourgeoisie américaine lors des émeutes de Los Angeles au printemps 1992, dont elle a même pu se permettre d'en contrôler le moment et l'extension ([3]). C'est ce que fait la bourgeoisie allemande qui, depuis l'automne, développe un énorme battage sur la « chasse aux étrangers». Elle contrôle, et provoque parfois en sous-main, les événements, pour faire passer des mesures de renforcement du « contrôle de l'immigration », c'est-à-dire en fait sa propre « chasse aux étrangers». Elle essaie d'embrigader dans la politique de l'Etat la population en général, et la classe ouvrière en particulier, par l'orchestration de manifestations en défense de la « démocratie».
Sur le plan international, depuis l'éclatement de la discipline du bloc de l'Ouest, qui leur avait été imposée face au bloc impérialiste russe, avec l'accélération de la crise qui frappe en leur sein, au coeur de l'économie mondiale, les pays industrialisés sont de moins en moins des « alliés ». Ils sont entraînés dans une confrontation acharnée entre leurs intérêts capitalistes et impérialistes opposés. Ils ne vont pas vers la « paix » mais aiguisent les tensions militaires.
Somalie : un prélude à des interventions plus difficiles
Depuis plus d'un an et demi, l'Allemagne a mis de l'huile sur le feu en Yougoslavie, rompant le statu quo qui assurait la domination américaine en Méditerranée, par un soutien à la constitution d'une Slovénie et d'une Croatie «indépendantes». Les Etats-Unis cherchent, depuis le début du conflit, à résister à l'extension d'une zone d'influence dominée par l'Allemagne. Après leur appui voilé à la Serbie, avec le sabotage des « initiatives européennes » qui auraient consacré l'affaiblissement relatif de leur hégémonie, les Etats-Unis passent la vitesse supérieure. L'intervention militaire américaine n'apportera pas la «paix» en Somalie, pas plus qu'elle ne permettra d'enrayer la famine qui ravage ce pays entre autres, parmi les régions du monde les plus déshéritées. La Somalie n'est que le terrain d'entraînement d'opérations militaires de plus grande envergure que préparent les Etats-Unis et qui sont dirigées en premier lieu contre les grandes puissances susceptibles de lui disputer sa suprématie sur la scène mondiale, au premier rang desquelles l'Allemagne.
L' « action humanitaire » des grandes puissances n'est encore une fois qu'un prétexte servant à «masquer les sordides intérêts impérialistes qui animent leur action et pour lesquels elles se déchirent, (...) pour couvrir d'un écran de fumée leur propre responsabilité dans la barbarie actuelle et justifier de nouvelles escalades dans celle-ci. » ([4]). Le raid de forces armées des Etats-Unis en Somalie n'a que faire de la misère, de la famine et des massacres qui sévissent dans ce pays, tout comme la guerre du Golfe il y a deux ans n'avait rien à voir avec le sort des populations locales, dont la situation n'a fait qu'empirer depuis cette première « victoire » du « nouvel ordre mondial».
La mise au pas qui avait été imposée à tous, par la « coalition » sous la férule américaine dans la guerre du Golfe, s'est effritée depuis deux ans, et les Etats-Unis ont du mal à maintenir leur « ordre mondial », qui tourne de plus en plus à la cacophonie. Pressée par l'essoufflement et la faillite de pans entiers de son économie, la bourgeoisie américaine a besoin d'une nouvelle offensive d'ampleur, réitérant sa supériorité militaire, afin de pouvoir continuer à imposer ses diktats à ses anciens « alliés ».
La première phase de cette offensive consiste à porter un coup aux prétentions de l'impérialisme français, en imposant sans partage le contrôle américain dans les opérations en Somalie, en cantonnant dans le rôle de petit comparse in efficace les forces militaires françaises de Djibouti sans aucun rôle réel à Mogadiscio. Mais cette première phase n'est qu'un round de préparation à côté des besoins d'une intervention dans l'ex-Yougoslavie, en Bosnie, qui doit être massive pour pouvoir être efficace comme l'ont déclaré depuis l'été 1992 les chefs d'Etat-major de l'armée américaine, notamment Colin Powell, un des patrons de la guerre du Golfe ([5]). Car si la corne de l'Afrique constitue par sa position géographique une zone stratégique d'un intérêt non négligeable, l'ampleur de l'opération US ([6]), et sa médiatisation à outrance, servent surtout à justifier et préparer des opérations plus importantes, dans les Balkans, en Europe au coeur de tous les enjeux de l'affrontement impérialiste, comme l'ont montré les deux guerres mondiales.
Les USA n'ont pas pour objectif de noyer la Somalie sous un tapis de bombes comme ce fut le cas en Irak ([7]), mais ils ne feront rien pour autant pour arrêter les massacres et endiguer la famine dans la région. L'objectif est d'abord de tenter d'établir une image de « guerre propre», nécessaire pour obtenir suffisamment d'adhésion de la population à des interventions difficiles, coûteuses et durables. Elle vise ensuite à lancer un avertissement à la bourgeoisie française, et derrière elle à la bourgeoisie allemande et japonaise, quant à la détermination des Etats-Unis à maintenir leur leadership. Prévue de longue date, elle sert enfin, comme toute action de « maintien de l'ordre », à renforcer les préparatifs de guerre, en l'occurrence le déploiement de l'action militaire américaine en Europe.
L'alliance franco-allemande ne s'y trompe pas qui réclame, par la voix de Delors notamment, un accroissement de la participation de troupes des pays d'Europe à l'intervention en Yougoslavie, ceci non pour rétablir la paix comme il le prétend, mais pour être présent militairement sur le terrain face à l'initiative des Etats-Unis. Quant à l'Allemagne, pour la première fois depuis la seconde guerre mondiale, elle envoie 1 500 militaires hors de ses frontières. C'est en fait, sous couvert de 1'« acheminement des vivres » en Somalie, un premier pas vers une participation directe dans les conflits. Et c'est un message aux Etats-Unis sur la volonté de l'Allemagne d'être bientôt présente militairement sur le champ de bataille de l'ex-Yougoslavie. C'est une nouvelle étape que va franchir cette confrontation, notamment sur le plan militaire, mais également sur l'ensemble des aspects de la politique capitaliste. Et l'élection de Clinton aux Etats-Unis, si elle ne modifie pas les principaux choix de la stratégie de la bourgeoisie américaine, est une manifestation du tournant qui s'opère dans la situation mondiale.
Clinton : une politique plus musclée
En 1991, quelques mois après la « victoire » de la « tempête du désert », malgré une chute de popularité liée à l'aggravation de la crise aux USA, Bush était promis à une réélection sans problème. Clinton a finalement gagné parce qu'il a reçu petit à petit l'appui de fractions significatives de la bourgeoisie américaine, qui s'est manifesté, entre autres, par le soutien d'organes de presse influents, puis par le sabotage délibéré de la campagne de Bush par la candidature Perot. Cette dernière a été relancée dans un deuxième temps pour s'exercer directement contre Bush. Avec la révélation du scandale de l’« Irakgate » ([8]) et Bush accusé, devant des dizaines de millions de téléspectateurs, d'avoir encouragé l'Irak à envahir le Koweït, la bourgeoisie américaine signifiait son choix au vainqueur de la « tempête du désert » : la porte. Le score relativement confortable que Clinton a obtenu face à Bush, a montré la volonté de changement largement majoritaire au sein de la bourgeoisie américaine.
C'est en premier lieu face à l'ampleur de la catastrophe économique, que la bourgeoisie américaine dans sa majorité s'est résolue, après quelques tergiversations, à remiser son discours idéologique sur un libéralisme impuissant à enrayer le déclin économique, et pire, perçu comme responsable de celui-ci. Avec la récession ouverte depuis 1991, la bourgeoisie a été obligée de prononcer la faillite de cet ultralibéralisme inadéquat pour justifier l'intervention croissante de l'Etat rendue nécessaire pour sauvegarder les restes d'un appareil productif et financier prenant l'eau de toutes parts. Elle s'est ralliée dans sa grande majorité au discours sur la nécessité de « plus d'Etat» promu par Clinton, s'accordant mieux à la réalité de la situation que celui de Bush, resté dans la continuité des « reaganomics»([9]).
En deuxième lieu, l'administration Bush n'est pas parvenue à maintenir l'initiative des USA sur l'arène mondiale. Elle a pu, au moment de la guerre du Golfe, faire l'unanimité de la bourgeoisie américaine autour du rôle incontesté de super-puissance militaire mondiale joué dans le montage et l'exécution de cette guerre, mais elle s'est essoufflée depuis, et n'a plus pu trouver les moyens d'une intervention aussi spectaculaire et efficace pour s'imposer face aux rivaux potentiels des Etats-Unis.
En Yougoslavie, alors que, dès l'été 1992, les Etats-Unis avaient envisagé une intervention de l'aviation en Bosnie, les européens leur ont mis des bâtons dans les roues. Le voyage-« surprise » de Mitterrand à Sarajevo permit notamment de couper court au battage « humanitaire » américain préparant les bombardements à ce moment-là. De plus, l'imbroglio des fractions armées et la géographie des lieux, rendent beaucoup plus dangereuse toute opération militaire, en diminuant notamment l'efficacité de l'aviation, pièce maîtresse de l'armée américaine. L'administration Bush n'a pas pu déployer les moyens nécessaires. Et si une nouvelle action en Irak a eu lieu, avec la neutralisation d'une partie de l'espace aérien de ce pays, elle n'a pas pu fournir l'occasion d'une nouvelle démonstration de force, Saddam Hussein n'ayant cette fois-ci pas cédé à la provocation.
Bush, en perdant les élections, peut ainsi servir de bouc émissaire pour les revers de la politique des Etats-Unis, aussi bien sur le bilan économique alarmant que sur le bilan mitigé du leadership militaire mondial. En étant désigné comme le responsable, il rend un dernier service en permettant de cacher qu'il ne pouvait en fait pas exister d'autre politique et que c'est le système lui-même qui est définitive ment gangrené. Qui plus est, pour la bourgeoisie confrontée à une « opinion publique » désenchantée par les résultats économiques et sociaux désastreux des années 1980, et plus que sceptique sur le « nouvel ordre mondial », l'alternance avec Clinton après douze années de Parti républicain donne un ballon d'oxygène à la crédibilité de la « démocratie » américaine.
Et pour ce qui est d'assumer l'accélération des interventions militaires, la bourgeoisie peut faire pleine confiance au Parti démocrate qui en a une expérience plus éprouvée encore que le Parti républicain, puisque c'est lui qui a gouverné le pays avant et pendant la seconde guerre mondiale, qui a déclenché et mené la guerre du Vietnam, et qui a relancé la politique d'armement sous Carter à la fin des années 1970.
Avec Clinton, la bourgeoisie américaine essaie de négocier un tournant, d'abord face à la crise économique, et pour tenter de garder son leadership mondial, sur le terrain impérialiste, face à la tendance à la constitution d'un bloc rival emmené par l'Allemagne.
L' « Europe de 1993 » avortée
Avant l'effondrement du bloc de l'Est, les divers accords et institutions garantissant un certain degré d'unité entre les différents pays d'Europe étaient cimentés, sous le « parapluie » américain, par un intérêt commun de ces pays contre la menace du bloc impérialiste russe. Avec la disparition de cette menace, P « unité européenne » a perdu ce ciment et la fameuse « Europe de 1993 » est en train d'avorter.
A la place de l’« union économique et monétaire », dont le « traité de Maastricht » devait constituer une étape décisive, regroupant tous les pays de la « Communauté économique européenne » d'abord, pour en intégrer d'autres ensuite, on voit se dessiner une « Europe à deux vitesses». D'un côté c'est l'alliance de l'Allemagne avec la France, vers laquelle penchent l'Espagne, la Belgique, en partie l'Italie, qui pousse à prendre des mesures pour affronter la concurrence américaine et japonaise et essaye de s'affranchir sur le plan militaire de la tutelle américaine ([10]). De l'autre, ce sont les autres pays, Grande-Bretagne en tête, Hollande également, qui résistent à cette montée en puissance de l'Allemagne en Europe, et jouent l'alliance avec les Etats-Unis, qui sont déterminés pour leur part à s'opposer par tous les moyens à l'émergence d'un bloc rival.
De conférences en sommets européens, de ratifications parlementaires en référendums, ce n'est pas une plus grande unité et une plus grande harmonie entre les bourgeoisies nationales des différents pays d'Europe qui se dessine. C'est une empoignade de plus en plus aiguë qu'engendre la nécessité de choisir entre l'alliance avec les Etats-Unis qui restent la première puissance mondiale, et son challenger, l'Allemagne, le tout sur fond d'une crise économique sans précédent et d'une décomposition sociale qui commence à faire sentir ses conséquences désastreuses au coeur même des pays développés. Et si cette empoignade garde l'apparence d'une joute entre « démocraties » soucieuses de « dialogue » pour « trouver une terrain d'entente», la guerre meurtrière dans l’ex-Yougoslavie, alimentée par l'affrontement entre grandes puissances derrière les rivalités entre les nouveaux Etats « indépendants» ([11]), fournit une première mesure du mensonge de l’« unité » des « grandes démocraties » et de la barbarie dont elles sont capables pour défendre leurs intérêts impérialistes ([12]). Non seulement, la guerre se poursuit en Bosnie, mais elle risque de gagner le Kosovo et la Macédoine où les populations là aussi se trouveront emportées dans le tourbillon de cette barbarie.
L'Europe, confluent des rivalités entre principales puissances, tient évidemment une place centrale dans la tendance à la formation d'un bloc allemand, et l’ex-Yougoslavie en est le « laboratoire » militaire européen. Mais c'est la planète entière qui est le théâtre des tensions entre les nouveaux pôles impérialistes, tensions qui contribuent à attiser les conflits armés dans le « tiers-monde » et dans l'ex-bloc « soviétique ».
La multiplication des « conflits locaux »
Avec l'effondrement de l'ancien « ordre mondial », non seulement les anciens conflits locaux n'ont pas cessé, comme en témoigne la situation en Afghanistan ou au Kurdistan par exemple, mais encore de nouveaux conflits, de nouvelles « guerres civiles », surgissent entre fractions locales de la bourgeoisie auparavant obligées de collaborer pour un même intérêt national. Mais l'éclatement de nouveaux foyers de tensions ne se limite jamais à la situation strictement locale. Tout conflit attire immédiatement la convoitise de fractions de la bourgeoisie de pays voisins et, au nom d'oppositions ethniques, de contentieux frontaliers, de querelles religieuses, du « danger du désordre », ou tout autre prétexte, du plus petit potentat local aux grandes puissances, tous sont poussés à s'engouffrer dans la spirale de l'affrontement armé. N'importe quelle guerre « civile » ou « locale » débouche inévitablement sur un affrontement entre grandes puissances impérialistes.
Les tensions ne sont pas toutes au départ nécessairement liées aux intérêts de ces grandes puissances (capitalistes. Mais celles-ci, par l'enchaînement de cette « logique » de la guerre capitaliste, finissent toujours par s'en mêler, ne serait-ce que pour essayer d'empêcher leurs concurrents de le faire et de marquer ainsi des points pouvant peser sur le rapport de forces général.
Ainsi, les Etats-Unis interviennent ou suivent de près des situations « locales » qui peuvent servir leurs intérêts face à leurs rivaux potentiels. En Afrique, au Libéria, la guerre, entre bandes rivales au dé part, est devenue aujourd'hui un fer de lance de l'offensive américaine pour évincer la présence française de ses « chasses gardées » que sont la Mauritanie, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. En Amérique du Sud, les Etats-Unis ont observé une neutralité bienveillante lors du coup d'Etat au Venezuela, visant à renverser Carlos Andres Perez, ami de Mitterrand et du défunt Willy Brandt, membre de l'Internationale Socialiste, et favorable au maintien d'une influence de la France et de l'Espagne, ainsi que de l'Allemagne. En Asie, les Etats-Unis s'intéressent de près à la politique prochinoise des Khmers rouges, escomptant garder la Chine dans leur orbite, plutôt que de la voir jouer le jeu du Japon.
Les grandes puissances sont également amenées à s'immiscer dans les confrontations entre des sous-impérialismes régionaux qui, par leur situation géographique, leur dimension et l'armement nucléaire qu'ils possèdent, pèsent dangereusement sur le rapport de forces impérialiste mondial. C'est le cas du sous-continent indien, où règne une situation catastrophique, provoquant toutes sortes de rivalités au sein de chaque pays entre fractions de la bourgeoisie, comme en témoignent les récents massacres des «musulmans» en Inde. Ces rivalités sont exacerbées par la confrontation entre Inde et Pakistan, le Pakistan soutenant les « musulmans » en Inde, l'Inde fomentant la révolte contre le gouvernement pakistanais au Cachemire. La remise en question des anciennes alliances internationales ; de l'Inde avec l'URSS et du Pakistan avec la Chine et les USA, conduit ces derniers, non à calmer les conflits mais à risquer de les embraser.
Les grandes puissances sont aussi aspirées par les conflits nouveaux, qu'ils n'ont, au départ, ni souhaités, ni fomentés. Dans les pays de l'Est, sur le territoire de l'ex-URSS en particulier, les tensions entre républiques ne cessent de s'aggraver. Chaque république est confrontée à des minorités nationales qui se proclament « indépendantes » et forment des milices, en recevant l'appui ouvert ou déguisé d'autres républiques : les arméniens d'Azerbaïdjan, les tchétchènes de Russie, les russes de Moldavie et d'Ukraine, les factions da la « guerre civile » en Géorgie, etc. Les grandes puissances répugnent à s'immiscer dans le bourbier de ces situations locales, mais le fait que des puissances secondaires, comme la Turquie, l'Iran, le Pakistan lorgnent sur ces parties de l'ancienne URSS, ou le fait qu'aujourd'hui, c'est la Russie même qui se déchire de plus en plus dans la lutte farouche entre « conservateurs » et « réformateurs », ouvrent la voie à l'élargissement des conflits.
A la décomposition qui aiguise les contradictions, engendre rivalités et conflits, les fractions de la bourgeoisie, des plus petites aux plus puissantes, ne peuvent répondre que par le militarisme et les guerres.
Guerre et crise
Les régimes capitalistes de type j stalinien, issus de la contre-révolution des années 1920-30 en Russie, qui avaient instauré une forme rigide et totalement militarisée du capitalisme, se sont effondrés. Les bureaucrates d'hier repeignent leur nationalisme de toujours de la phraséologie de « indépendance » et de la « démocratie », mais ils n'ont, pas plus aujourd'hui qu'auparavant, autre chose à offrir que la corruption, le gangstérisme et la guerre.
C'est au tour des régimes capitalistes de type occidental, qui pré tendaient avoir fait la preuve, par leur suprématie économique, de la «victoire du capitalisme», de se trouver entraînés dans l'effondrement du système : ralentissement sans précédent de leurs économies, purge drastique de leurs profits, avec le chômage pour des dizaines de millions d'ouvriers et d'employés, une dégradation sans cesse grandissante des conditions de travail, de logement, d'éducation, de santé, et de sécurité.
Mais dans ces pays, à la différence de ceux du « tiers-monde » ou de l'ex-« bloc de l'Est », le prolétariat n'est pas prêt à subir sans réagir les conséquences dramatiques de cet effondrement pour ses conditions de vie, comme l'a montré le formidable coup de colère de la classe ouvrière en Italie à l'automne 1992.
Vers une reprise des luttes de la classe ouvrière.
Après trois années de passivité, les manifestations, les débrayages et les grèves de centaines de milliers d'ouvriers et employés en Italie, à l'automne 1992, ont constitué les premiers signes d'un changement d'une importance considérable. Face aux attaques les plus brutales depuis la seconde guerre mondiale, la classe ouvrière a réagi. Tous secteurs et toutes régions confondues, pendant quelques semaines, elle est venu rappeler que, non seulement la crise économique loge à la même enseigne tous les travailleurs en attaquant partout les conditions d'existence, mais surtout que, tous ensemble, au-delà des divisions qu'impose le capitalisme, ceux-ci constituent une force sociale qui peut s'opposer aux conséquences de cette crise.
Les initiatives ouvrières dans les grèves, la participation massive aux manifestations de protestation contre le plan d'austérité du gouvernement, et la bronca contre les syndicats officiels qui appuient ce plan, ont montré une potentialité de riposte intacte de la part du prolétariat. Même si la bourgeoisie a gardé l'initiative et si le mouvement massif de départ s'est ensuite émietté, il reste un acquis de ces premières luttes importantes du prolétariat depuis 1989 dans les pays industrialisés : un retour de la combativité ouvrière.
Les événements en Italie marquent ainsi une étape pour que la classe ouvrière, en reprenant la lutte, sur le terrain commun à tous de résistance à la crise, prenne confiance dans sa capacité à répondre aux attaques du capitalisme, et à ouvrir une perspective.
Le black-out de l'information entretenu sur les événements en Italie, au contraire de la publicité qu'ont eu la « grève des sidérurgistes », la « grève des transports », la « grève du secteur public », lors des grandes manoeuvres syndicales en Allemagne du printemps 1992([13]), est significatif d'une véritable poussée ouvrière dans le mouvement en Italie. Lorsque la bourgeoisie allemande parvenait l'an dernier à étouffer toute initiative ouvrière, son opération avait la faveur des médias de la bourgeoisie internationale. A l'automne 1992, la bourgeoisie italienne a eu, par le black-out de cette même propagande, le soutien de la bourgeoisie internationale, car cette dernière s'attendait et craignait la réaction des ouvriers aux mesures d'austérité, que ne pouvait plus se permettre de reporter l'Etat italien.
Cependant, ce mouvement n'est qu'un premier pas vers une reprise de la lutte de classe internationale. L'Italie est le pays du monde où le prolétariat a la plus grande expérience des luttes ouvrières et la plus grande méfiance envers les syndicats, ce qui est loin d'être le cas dans les autres pays européens. Sur ce plan, des réactions ouvrières ailleurs en Europe, ou aux Etats-Unis, ne prendront pas immédiatement un caractère aussi radical et massif qu'en Italie.
Par ailleurs, en Italie même, le mouvement a trouvé ses limites. D'un côté, le rejet massif des grands syndicats par la majorité des ouvriers dans ce mouvement, a montré que, malgré la rupture des trois dernières années, l'expérience de longue date de la classe ouvrière de la confrontation au syndicalisme n'était pas perdue. Mais de l'autre, la bourgeoisie aussi s'attendait à ce rejet. Elle en a joué pour focaliser la colère ouvrière dans des actions spectaculaires, contre les dirigeants syndicaux, au détriment d'une riposte plus large contre les mesures et l'ensemble de l'appareil d'Etat et de tous ses appendices syndicaux.
Au lieu de la prise en mains de la lutte dans les assemblées générales où, collectivement, les ouvriers peuvent décider des objectifs et des moyens de leurs actions, les organismes « radicaux», de type syndicaliste de base, ont organisé un défoulement du mécontentement. En lançant boulons et pierres à la tête des dirigeants syndicaux, ils ont entretenu le piège de la fausse opposition entre le syndicalisme de base et les syndicats officiels, semé le désarroi et cassé la mobilisation massive et l'unité, qui seules permettent de développer une efficacité face aux attaques de l'Etat.
Les luttes ouvrières en Italie marquent ainsi une reprise de la combativité avec les difficultés qui partout attendent la classe ouvrière, au premier rang desquelles le syndicalisme, officiel et de base, et le corporatisme.
L'atmosphère de déboussolement et de confusion répandu dans la classe ouvrière par les campagnes idéologiques sur la « faillite du communisme », la fin du marxisme et la fin de la lutte de classe, pèse encore, et la combativité n'est qu'une première condition pour sortir de cette atmosphère. La classe ouvrière doit aussi prendre conscience que sa lutte passe par une remise en question générale, que c'est au capitalisme comme système mondial qui domine la planète, qu'elle doit s'affronter, un système en crise, porteur de misère, de guerre et de destruction.
Aujourd'hui, la passivité face aux promesses de « paix » du capitalisme triomphant commence à s'effriter. La « tempête du désert » a contribué à dévoiler le mensonge de cette « paix».
La participation des armées des grands pays « démocratiques » aux guerres, comme en Somalie et dans l'ex-Yougoslavie, est moins évidente à dévoiler. Elle prétend intervenir pour « protéger les populations » et « acheminer de la nourriture ». Mais la pluie d'attaques sur les conditions de vie de la classe ouvrière crée une ambiance où le prétexte « humanitaire » pour l'envoi de troupes, bardées d'armes les plus coûteuses, sophistiquées et meurtrières, va contribuer à faire comprendre ce mensonge « humanitaire », et le vrai « sale boulot » des armées « démocratiques », au même titre que celui de tous les gangs, milices et armées de toutes sortes et de tous horizons, qu'elles prétendent combattre.
Quant à la promesse de « prospérité », partout la catastrophe et l'accélération sans précédent de la crise économique sont en train de faire voler en éclats les derniers exemples-refuges où les conditions de vie étaient relativement épargnées, dans les pays comme l'Allemagne, la Suède ou la Suisse par exemple. Le chômage massif se répand maintenant dans des secteurs à main d'oeuvre hautement qualifiée, les moins touchés jusqu'à présent, qui viennent rejoindre par dizaines de milliers la cohorte des dizaines de millions de chômeurs dans les régions du monde où le prolétariat est le plus nombreux et groupé.
Le réveil de la lutte de classe en Italie à l'automne 1992 a marqué une reprise de la combativité ouvrière. Le développement de la crise, avec le militarisme de plus en plus omniprésent dans le climat social des pays industrialisés, vont contribuer à ce que les prochaines luttes d'importance, qui ne vont pas manquer de surgir, débouchent sur un développement de la conscience dans la classe ouvrière de la nécessité de renforcer son unité, et, avec les organisations révolutionnaires, de reforger ainsi sa perspective vers un véritable communisme.
OF
[1] Voir l'article sur la crise économique dans ce numéro.
[2] La bourgeoisie essaie de s'opposer à la décomposition qui perturbe son ordre social. Mais elle est une classe totalement incapable d'en éradiquer la cause profonde, puisque c'est son propre système d'exploitation et de profit qui est à la racine de celle-ci. Elle ne peut pas scier la branche sur laquelle elle est assise.
[3] Voir Revue Internationale n° 71.
[4] Voir Revue Internationale n°71. Et comme le mentionne Libération du 9/12/92: «C'est ainsi que sous couvert d'anonymat, un très haut responsable de la mission des Nations-Unies en Somalie (Onusom) a livré hier le fond de sa pensée : "L'intervention américaine pue l'arrogance. Ils n'ont consulté personne. Ce débarquement a été préparé de longue main, l'humanitaire ne sert que de prétexte. En fait ils testent ici, comme d'autres un vaccin sur une bête, leur doctrine pour là résolution de futurs conflits locaux. Or cette opération coûtera de leur propre aveu, entre 400 et 600 millions de dollars dans sa première phase. Avec la moitié de cette somme, sans un seul soldat, je rendrais sa stabilité prospère à la Somalie''.
[5] Colin Powell s'est prononcé contre l'intervention en Yougoslavie en septembre 1992.
[6] Selon des sources proches de Boutros Ghali, secrétaire de l'ONU, les besoins de l'intervention pour acheminer la nourriture s'élèveraient à 5000 hommes. Les USA en envoient 30 000...
[7] Près de 500 000 blessés et morts sous les bombardements.
[8] Ce scandale, ainsi nommé par analogie avec celui du « Watergate » qui fit tomber Nixon, puis celui de l’« Irangate » qui déstabilisa Reagan, dévoile, parmi d'autres révélations, l'importance de l'aide financière consentie par les USA à l'Irak, par l'intermédiaire d'une banque italienne, au cours de l'année précédant la guerre du Golfe, aide utilisée par ce pays pour développer ses recherches et infrastructures en vue de se doter de l'arme atomique...
[9] Voir dans ce numéro l'article sur la crise.
[10] Voir la constitution d'un corps d'armée franco-allemand ainsi que le projet de formation d'une force aéronavale italo-franco-espagnole.
[11] Sur la guerre en Yougoslavie et la responsabilité des grandes puissances, voir les n° 70 et 71 de la Revue Internationale.
[12] Quant aux accords économiques, ils ne sont en rien une manifestation d'une coopération véritable, ou d'une d'entente entre bourgeoisies nationales, tout comme la concurrence économique n'engendre pas mécaniquement des divergences politiques et militaires. Avant l'effondrement du bloc de l'Est, Etats-Unis et Allemagne étaient de très sérieux concurrents sur le terrain économique, cela ne les empêchait pas d'être totalement alliés sur le terrain politique et militaire. L'URSS n'a jamais été un concurrent sérieux des Etats-Unis sur le plan économique et leur rivalité militaire a pourtant fait peser pendant quarante ans la menace de la destruction de la planète. Aujourd'hui, l'Allemagne peut très bien passer des accords avec la Grande-Bretagne sur le plan économique, dans le cadre de l'Europe, y compris parfois au détriment des intérêts de la France, cela n'empêche pas que la Grande-Bretagne et l'Allemagne se trouvent en complète opposition sur le plan politique et militaire, alors que la France et l'Allemagne jouent la même politique.
[13] Voir Revue Internationale n° 70.
Questions théoriques:
- Décomposition [3]
- Guerre [129]
Crise économique mondiale : Un peu plus d’Etat ?
- 4872 reads
Au lieu de connaître la « reprise » tant annoncée, l'économie mondiale continue de s'enfoncer dans le marasme. Au coeur du monde industrialisé, les ravages du capitalisme en crise se traduisent par des millions de nouveaux chômeurs et par la dégradation accélérée des conditions d'existence des prolétaires qui ont encore du travail.
On nous annonce pourtant du « nouveau ». Devant l'impuissance des anciennes recettes pour relancer l'activité productive, les gouvernements des grands pays industrialisés (Clinton en tête), proclament une « nouvelle » doctrine : le retour au fameux « plus d'Etat ». De « grands travaux », financés par les Etats nationaux, telle serait la nouvelle potion magique qui devrait redonner vie à la machine d'exploitation capitaliste décrépite.
Qu'y a-t-il derrière ce changement de langage des gouvernements occidentaux ? Quelles chances de réussite ont ces « nouvelles » politiques ?
Nous devrions être eh pleine reprise de l’économie mondiale. Depuis deux ans, les «experts» nous avaient régulièrement promis celle-ci pour «dans six mois» ([1] [942]). L'année 1992 s'achève cependant dans une situation catastrophique. Au centre du système, dans cette partie de la planète qui avait été jusqu'ici relativement épargnée, l'économie des premiers pays frappés par la récession depuis 1990 (Etats-Unis, Grande-Bretagne et Canada) ne parvient toujours pas à se relever réellement ([2] [943]) , alors que celle des autres puissances (Japon et pays Européens) s'effondre.
Depuis 1990, le nombre de chômeurs a augmenté de trois millions et demi aux Etats-Unis, d'un million et demi en Grande-Bretagne. Dans ce dernier pays, qui connaît sa récession la plus profonde et la plus longue depuis les années 1930, le nombre de faillites, au cours de Tannée 1992, a augmenté de 40 %. Le Japon vient d'entrer « officiellement » en récession, pour la première fois depuis 18 ans ([3] [944]). Il en est de même pour l'Allemagne, où Kohl vient de reconnaître, lui aussi « officiellement », la récession. Les prévisions gouvernementales y annoncent un demi-million de chômeurs de plus pour 1993, alors qu'on estime que dans l'ex-Allemagne de l'Est 40 % de la population active ne dispose pas d'un emploi stable.
Mais, indépendamment des prévisions officielles, les perspectives pour les années qui viennent sont clairement tracées par les suppressions d'emplois massives, annoncées dans des secteurs aussi importants que la sidérurgie et l'automobile, ou dans des domaines aussi avancés que l'informatique et la construction aéronautique. Eurofer, l'organisme responsable de la sidérurgie dans la CEE, annonce la suppression de 50 000 emplois dans ce secteur au cours des trois prochaines années. General Motors, la première entreprise industrielle du monde, qui avait déjà annoncé la fermeture de 21 de ses usines dans le monde vient de faire savoir qu'elle portait ce chiffre à 25. IBM, le géant de l'informatique mondiale, qui a déjà supprimé 20 000 emplois en 1991 et avait annoncé la suppression de 20 000 autres au début de 1992, vient d'informer qu'il s'agira en fait de 60 000. Tous les grands constructeurs d'avions civils annoncent des licenciements (Boeing, un des moins touchés par la crise, prévoit la suppression de 9 000 emplois au cours de la seule année 1992).
C'est dans tous les pays ([4] [945]) et dans tous les secteurs, classiques ou de pointe, industriels ou de services, que la réalité de la crise s'impose de façon impitoyable. Le capitalisme mondial connaît bien une récession sans précédent par sa profondeur, son étendue géographique et sa durée. Une récession qui, comme nous l'avons développé à plusieurs reprises dans ces colonnes, est qualitativement différente des quatre autres qui l'ont précédée depuis la fin des années 1960. Une récession qui traduit, bien sûr, l'incapacité chronique du capitalisme à dépasser ses contradictions historiques fondamentales (son impuissance à créer des débouchés suffisants pour permettre l'écoulement de sa production), mais aussi les difficultés nouvelles, engendrées par les « remèdes » utilisés au cours de deux décennies de fuite en avant dans le crédit et l'endettement massif ([5] [946]).
Le gouvernement américain s’est efforcé depuis deux ans de refaire partir la machine économique en appliquant la vieille politique consistant à faciliter le crédit par la baisses des taux d'intérêt. Ainsi, aux Etats-Unis, les taux d'intérêt de la Banque fédérale ont été diminués à plus de 20 reprises, au point d'arriver à une situation où, compte tenu de l'inflation, une banque privée peut emprunter de l'argent sans quasiment payer d'intérêts en termes réels. Malgré tous ces efforts, l'électro-encéphalogramme de la croissance reste désespérément plat. L'état d'endettement de l'économie américaine est tel que les prêts « gratuits » ont été utilisés par les banques privées et les entreprises, non pas pour investir, mais pour rembourser un peu de leurs dettes antérieures ([6] [947]).
Jamais les perspectives économiques ne sont apparues aussi sombres pour le capitalisme. Jamais le constat d'impuissance n'avait été aussi flagrant. Le miracle des « reagannomics », le miracle du retour au capitalisme « pur », triomphant sur les ruines du « communisme » s'achève dans un fiasco total.
Plus d'Etat ?
Mais voilà que le nouveau président, Clinton, se présente avec une solution pour les Etats-Unis et pour le monde :
« La seule solution pour le président (Clinton) est celle qu'il a évoquée dans ses grandes lignes, tout au long de sa campagne. A savoir, relancer l’économie en augmentant les dépenses publiques dans les infrastructures (réseau routier, ports, ponts), dans la recherche et la formation. Ainsi des emplois seront créés. Tout aussi important, ces dépenses contribueront à accélérer la croissance de la productivité à long terme et les salaires réels. » (Lester Thurow, un des conseillers économiques les plus écoutés dans le parti démocrate américain) ([7] [948]). Clinton promet ainsi de faire injecter par l'Etat entre 30 et 40 milliards de dollars dans l'économie.
En Grande-Bretagne, le très conservateur Major, aux prises avec les premières manifestations d'un retour de la combativité ouvrière, confronté lui aussi à la banqueroute économique, abandonne soudain son credo libéral, « antiétatique » et entonne le même hymne keynésien en annonçant une « stratégie pour la croissance» et l'injection de 1,5 milliards de dollars. Puis, c'est le tour de Delors, représentant de la CEE, qui insiste en outre sur la nécessité d'accompagner cette nouvelle politique d'une forte dose de « coopération entre Etats » : « Cette initiative de croissance n'est pas une relance keynésienne classique. Il ne s'agit pas seulement d'injecter de l'argent dans le circuit. Nous voulons surtout envoyer un signal que la coopération entre Etats est à l'ordre du jour. » ([8] [949])
Au même moment, le gouvernement japonais décide de fournir une aide massive au* principaux secteurs de l'économie (90 milliards de dollars, soit l'équivalent de 2,5% du PIB).
De quoi s'agit-il exactement ?
La propagande démocrate aux Etats-Unis, tout comme celle de certains partis de gauche en Europe, présente cela comme un changement par rapport aux politiques trop « libérales » du temps des «reagannomics». Après le « moins d'Etat », ce serait un retour à plus de justice par un recours accru à l'action de cette institution qui est supposée représenter «r les intérêts communs de toute la nation».
En fait il ne s'agit que de la poursuite de cette tendance, caractéristique du capitalisme décadent, à recourir à la force étatique pour faire fonctionner une machine économique qui spontanément, laissée à elle-même, est de plus en plus condamnée à la paralysie du fait du développement de ses contradictions internes.
En réalité, depuis la première guerre mondiale, depuis que la survie de chaque nation dépend de sa capacité à se faire une place par la force dans un marché mondial devenu définitivement trop étroit, l'économie capitaliste n'a cessé de s'étatiser en permanence. Dans le capitalisme décadent, la tendance au capitalisme d'Etat est une tendance universelle. Suivant les pays, suivant les périodes historiques, cette tendance s'est concrétisée à des rythmes et sous des formes plus ou moins accentués. Mais elle n'a cessé de progresser, au point de faire de la machine étatique le coeur même de la vie économique et sociale de toutes les nations.
Le militarisme allemand du début du siècle, le stalinisme, le fascisme des années 1930, les grands travaux du New Deal aux Etats-Unis au lendemain de la dépression économique de 1929, ou ceux du Front populaire en France à la même époque, ne sont que des manifestations d'un même mouvement d'étatisation de la vie sociale. Cette évolution ne s'arrête pas après la seconde guerre mondiale. Au contraire. Et les «reagannomics», supposées constituer un retour à un capitalisme « libéral », moins étatisé, n'ont pas interrompu cette tendance. Le «miracle» de la reprise américaine au cours des années 1980 n'a pas eu d'autre fondement qu'un doublement du déficit de l'Etat et une augmentation spectaculaire des dépenses d'armement. Ainsi, au début des années 1990, après trois mandats républicains, la dette publique brute représente près de 60 % du PIB américain (alors que ce chiffre était de 40 % au début des années 80). Et le seul financement de cette dette absorbe la moitié de l'épargne nationale ([9] [950]).
Les politiques de « dérégulation » et « privatisations », appliquées au cours des années 1980 dans l'ensemble des pays industrialisés, ne traduisaient pas un recul du poids de l'Etat dans la gestion économique ([10] [951]). Ces politiques ont surtout servi de justificatif à une réorientation des aides de l’Etat vers des secteurs plus compétitifs, à l'élimination d'entreprises moins rentables par la réduction de certaines subventions publiques, à une incroyable concentration de capitaux (ce qui a entraîné inévitablement une fusion croissante, au niveau de la gestion, entre Etat et grand capital « privé »).
Sur le plan social, elles ont facilité le recours aux licenciements, la précarisation de l'emploi en général, ainsi que la réduction des dépenses dites «sociales». Au bout d'une décennie de « libéralisme anti-étatique», l'emprise de l'Etat sur la vie économique de la société ne s'est pas amoindrie. Au contraire, elle s'est renforcée en devenant plus effective.
A ce niveau, le « plus d'Etat » annoncé aujourd'hui ne constitue donc pas un retournement, mais un renforcement de tendance.
En quoi consiste alors le changement proposé ?
L'économie capitaliste vient de vivre, au cours des années 1980, la plus grande orgie spéculative de son histoire. Au moment du dégonflement de « la bulle » que celle-ci a engendrée, un renforcement du corset bureaucratique est nécessaire pour tenter de limiter les effets de la gueule de bois dévastatrice ([11] [952]).
Mais il s'agit aussi d'un recours accru aux planches à billets des Etats. Puisque le système financier « privé » ne peut plus assurer une expansion du crédit, du fait de son état d'endettement outrancier et du dégonflement de toutes les valeurs spéculatives dont il s'était porté acquéreur, l'Etat se propose de relancer la machine en injectant de l'argent, en créant un marché artificiel. L'Etat achèterait des « infrastructures (réseau routier, ports, ponts) », etc. Ce qui orienterait l'activité économique vers des secteurs plus productifs que la spéculation. Et il paierait avec... du papier, avec de la monnaie émise par les banques centrales, sans aucune couverture.
En fait, la politique de « grands tra vaux» proposée aujourd'hui, est dans une grande mesure celle appliquée par l'Allemagne depuis deux ans dans son effort de « reconstruction » de l’ex-RDA. Et l'on peut avoir une certaine idée des effets de cette politique en regardant ce qui s'y est produit. Ces effets sont particulièrement significatifs dans deux domaines : celui de l'inflation et celui du commerce extérieur. En 1989, l'Allemagne fédérale connaissait un des taux d'inflation les plus bas du monde, en tête des pays industrialisés. Aujourd'hui, l'inflation y est la plus élevée des sept grands ([12] [953]), exception faite de l'Italie. Il y a deux ans, la RFA jouissait du plus important excédent commercial de la planète, dépassant même le Japon. Aujourd'hui, celui-ci a fondu sous le poids d'un accroissement de plus de 50 % de ses importations.
Mais le cas de l'Allemagne est celui d'une des économies les plus puissantes et « saines » financièrement du monde ([13] [954]). Dans le cas de pays tels que les Etats-Unis, en particulier, une même politique aura, à court ou moyen terme, des effets beaucoup plus dévastateurs ([14] [955]). Le déficit de l'Etat et le déficit commercial, ces deux maladies chroniques de l'économie américaine depuis deux décennies, y atteignent des niveaux beaucoup plus élevés qu'en Allemagne. Même si ces déficits sont actuellement relativement inférieurs à ceux du début des politiques « reaganiennes », les accroître aura des répercussions dramatiques, non seulement pour les Etats-Unis, mais aussi pour l'économie mondiale, en particulier au niveau de l'inflation et de l'anarchie des taux de change des monnaies. Par ailleurs, la fragilité de l'appareil financier américain est telle qu'un accroissement des déficits étatiques risque de le faire s'effondrer définitivement. En effet, c'est l'Etat qui depuis des années a pris systématiquement en charge les faillites de plus en plus importantes et nombreuses des banques et caisses d'épargne, incapables de rembourser leurs dettes. En relançant une politique de déficits d'Etat, le gouvernement affaiblit le dernier et faible garant d'un ordre financier que tout le monde sait lézardé de toutes parts.
Plus de coopération entre Etats ?
Ce n'est pas par hasard si Delors insiste sur la nécessité que ces politiques de grands travaux s'accompagnent d'une plus grande « coopération entre Etats ». Comme le démontre l'expérience allemande, de nouvelles dépenses de l'Etat entraînent inévitablement une relance des importations et donc une aggravation des déséquilibres commerciaux. Au cours des années 1930, les politiques de grands travaux s'étaient accompagnées d'un violent renforcement du protectionnisme, jusqu'à l'autarcie de l'Allemagne hitlérienne. Ces mêmes tendances se font jour aujourd'hui. Aucun pays ne veut accroître ses déficits pour relancer l'économie de ses voisins et concurrents. Le langage de Clinton et de ses conseillers, réclamant un puissant renforcement du protectionnisme américain, est particulièrement clair dans ce domaine.
L'appel de Delors est un vœu pieux. Devant l'aggravation de la crise économique mondiale, ce qui est à l'ordre du jour ce n'est pas la tendance à plus de « coopération entre Etats » mais, au contraire, la guerre de tous contre tous. Toutes les politiques de coopération, destinées pourtant à faire des alliances partielles pour être mieux en me sure d'affronter d'autres concurrents, se heurtent en permanence au renforcement de ces forces centrifuges internes. Les convulsions croissantes qui déchirent la CEE, et dont le récent éclatement du SME constitue une des manifestations les plus spectaculaires, en attestent. Il en est de même des tensions au sein du Traité de libre-échange des Etats-Unis avec le Canada et le Mexique ou des tentatives mort-nées de marché commun entre les pays du cône sud de l'Amérique latine ou des pays du « Pacte andin ».
Le protectionnisme n'a cessé de se développer au cours des années 1980. Malgré tous les discours sur « la libre circulation des marchandises », ce principe que le capitalisme occidental a tellement claironné comme concrétisation des « droits de l'homme » (bourgeois), les entraves au commerce mondial n'ont cessé de se multiplier ([15] [956]).
La guerre impitoyable qui oppose les grandes puissances commerciales, et dont les « négociations » du GATT ne sont qu'une toute petite partie, n'a pas tendance à s'atténuer mais à s'exacerber. Le renforcement des tendances au capitalisme d'Etat, stimulé par les politiques de « grands travaux », ne pourra que l'aiguiser.
Les gouvernements ne peuvent évidemment jamais rester inactifs devant la situation catastrophique de leur économie. Tant que le prolétariat ne parviendra pas à détruire définitivement le pouvoir politique de la bourgeoisie mondiale, celle-ci gérera d'une façon ou d'une autre la machine d'exploitation capitaliste, aussi décadente et décomposée soit-elle.
Les classes exploiteuses ne se suicident pas. Mais les «solutions» qu'elles peuvent trouver ont inévitablement deux caractéristiques majeures. La première c'est qu'elles ont de plus en plus recours à l'action de l'Etat, force organisée du pouvoir de la classe dominante, seule capable d'imposer par la violence la survie de mécanismes qui, spontanément, tendent à la paralysie et l'autodestruction. C'est le «plus d'Etat» d'aujourd'hui. La deuxième c'est que ces « solutions » comportent toujours une part croissante d'absurdités et d'aberrations. C'est ainsi que l'on peut voir aujourd'hui les différentes fractions du capital mondial s'affronter dans les négociations du GATT, regroupées autour de leurs Etats respectifs, pour savoir combien de millions d'hectares de terres cultivables devront être stérilisés en Europe (« solution » au problème de la « surproduction » agricole), alors qu'au même moment on étale sur tous les écrans du monde, pour les besoins de la propagande guerrière, une des nombreuses famines d'Afrique, en Somalie.
Pendant des décennies, les idéologies staliniennes et « socialistes » ont inculqué, parmi les travailleurs, le mensonge d'après lequel l'étatisation de l'économie était synonyme d'amélioration de la condition ouvrière. Mais l'Etat, dans une société capitaliste, ne peut être que l'Etat du capital, l'Etat des capitalistes (qu'il s'agisse de riches propriétaires ou de grands bureaucrates). L'inéluctable renforcement de l'Etat qu'on nous annonce, n'apportera rien aux prolétaires, sinon plus de misère, plus de répression, plus de guerres.
RV.
[1] [957] En décembre 1991, on pouvait lire dans le n° 50 des Perspectives économiques de l'OCDE : « Chaque pays devrait voir sa demande progresser d'autant plus qu'une expansion comparable interviendra de façon plus ou moins simultanée dans les autres pays : une reprise du commerce mondial est en vue (...). L'accélération de l'activité devrait se confirmer au printemps de l'année 1992 (...). Cette évolution entraînera progressivement un accroissement de l'emploi et une reprise des investissements des entreprises... ». Il faut noter que, déjà à cette date, les mêmes « experts » avaient dû constater que «La croissance de l'activité dans la zone de l'OCDE au second semestre de 1991 apparaît plus faible que ne le prévoyaient les Perspectives économiques de juillet... »
[2] [958] Les quelques signes de reprise qui se sont manifestés jusqu'à présent aux Etats-Unis sont très fragiles, et apparaissent plus comme un ralentissement momentané de la chute, effet des efforts désespérés de Bush pendant la campagne électorale, que comme l'annonce d'un véritable retournement de tendance.
[3] [959] La définition technique d'entrée en récession (suivant les critères américains) est de deux trimestres consécutifs de croissance négative pour le PIB (produit intérieur brut, c'est-à-dire l'ensemble de la production, y compris le salaire de la bureaucratie étatique, supposée produire l'équivalent de son salaire). Au 2e et 3e trimestres de 1992, le PIB japonais a baissé de 0,2 et 0,4 %. Mais au cours de la même période, la chute de la production industrielle par rapport à l'année précédente était de plus de 6 %.
[4] [960] Nous ne reviendrons pas ici sur l'évolution de la situation dans les pays du « tiers-monde » dont les économies ne cessent de s'enfoncer depuis le début des années 80. Il est intéressant cependant de donner quelques éléments sur ce qu'a été l'évolution des pays anciennement dits « communistes », ces pays que l'accès à « l'économie de marché » devait rendre prospères et transformer en riches marchés pour les économies occidentales. La dislocation de l'ancienne URSS s'est accompagnée d'une catastrophe économique sans pareil dans l'histoire. A la fin 1992, le nombre de chômeurs y atteint déjà 10 millions et l'inflation y avance à un rythme annuel de 14 000%, un chiffre qui se passe de tout commentaire. Quant aux pays de l'Europe de l'Est, leurs économies sont toutes en récession et le plus avancé d'entre eux, la Hongrie, celui qui avait commencé le premier des « réformes capitalistes » et qui devait le plus facilement jouir des vertus du libéralisme, est balayé par une vague dévastatrice de faillites. Le taux de chômage y atteint déjà officiellement 11 % et il est prévu qu'il double au cours de l'année prochaine. Quant au dernier bastion du soi-disant « socialisme réel », Cuba, la production annuelle en 1992 y est tombée à la moitié de celle de 1989 ! Seule la Chine fait encore figure d'exception : partant d'un niveau particulièrement bas, (la production industrielle de la Chine populaire est à peine supérieure à celle de la Belgique), elle connaît actuellement des taux de croissance relativement élevés, traduisant l'expansion des zones « ouvertes à l'économie capitaliste » où l'on brûle la masse de crédits qu'y déverse le Japon.
Quant aux quatre petits dragons de l'Asie « capitaliste » (Corée du Sud, Taiwan, Hongkong et Singapour), leurs croissances exceptionnelles commencent à décliner à leur tour.
[5] [961] Voir, en particulier, « Une récession pas comme les autres » et « Catastrophe au coeur du monde industrialisé » dans Revue Internationale, n° 70 et 71.
[6] [962] L'endettement total de l'économie américaine (Gouvernement plus entreprises, plus particuliers) équivaut à près de deux années de production nationale.
[7] [963] Le Monde, 17 novembre 1992.
[8] [964] Libération, 24 novembre 1992.
[9] [965] En termes concrets, le développement de la dette publique, phénomène qui a particulièrement marqué cette décennie, veut dire que l'Etat prend en charge la responsabilité de fournir un revenu régulier, une part de la plus-value sociale, sous forme d'intérêts au nombre croissant de capitaux qui s'investit sous forme de « Bons du trésor». Cela veut dire que, de plus en plus, les capitalistes tirent leurs revenus, non plus du résultat de l'exploitation d'entreprises leur appartenant, mais des impôts prélevés par l'Etat. Il faut noter que, pour la CEE, le montant de la dette publique, en pourcentage du PIB, est supérieur à celui des Etats-Unis (62%).
Revue Internationale n° 72
[10] [966] Même en se situant du point de vue purement quantitatif, si l'on mesure le poids de l'Etat dans l'économie par le pourcentage que représentent les dépenses des administrations publiques dans le produit intérieur brut, ce taux est plus élevé aujourd'hui qu'au début des années 80. Lorsque Reagan est élu, ce chiffre est de l'ordre de 32 %, lorsque Bush quitte la présidence, il dépasse les 37 %.
[11] [967] Les faillites des caisses d'épargne et de banques américaines, les difficultés des banques japonaises, l'effondrement de la bourse de Tokyo (équivalent déjà au krach de 1929), la faillite d'un nombre croissant de compagnies chargées de la gestion de capitaux en bourse, etc., sont les premières conséquences directes de ces lendemains de folie spéculative. Seuls les Etats peuvent faire face aux désastres financiers qui en découlent
[12] [968] Etats-Unis, Japon, Allemagne, France, Italie, Grande-Bretagne, Canada.
[13] [969] En outre, le gouvernement s'y est appliqué à financer le déficit de l'Etat par le recours aux emprunts internationaux tout en s'efforçant de maintenir sous contrôle l'inflation par la limitation (certes, de moins en moins effective) de l'expansion des masses monétaires et le maintien de taux d'intérêts très élevés.
[14] [970] Dans le cas de pays comme l'Italie, l'Espagne ou la Belgique, l'endettement de l'Etat a atteint de tels niveaux (plus de 100 % du PIB pour l'Italie, 120 % pour la Belgique) que de telles politiques sont tout simplement impensables.
[15] [971] Ces entraves au commerce ne prennent pas tant la forme de tarifs douaniers que de restrictions pures et simples : quota d'importations, accords d'auto-restriction, législations « anti-dumping », réglementations sur les qualités des produits, etc., <r... la part des échanges donnant lieu à des mesures non-tarifaires s’ est fortement accrue tant aux Etats-Unis que dans la Communauté européenne, qui représentent ensemble près de 75 % des importations de la zone OCDE (hors combustibles). » OCDE, Progrès de la réforme structurelle : une vue d'ensemble, 1992.
Récent et en cours:
- Crise économique [28]
Heritage de la Gauche Communiste:
- Capitalisme d'Etat [40]
Le communisme n'est pas un bel idéal mais une nécessite matérielle [5°partie]
- 4721 reads
Le communisme comme programme politique
Les deux précédents
articles de cette série ([1] [972]) ont
été en grande partie centrés sur les Manuscrits Economiques et Philosophiques
de 1844 car ceux-ci constituent un filon très riche sur le problème du travail
aliéné et des buts ultimes du communisme, tel que Marx l'envisageait quand il
a commencé à adhérer au mouvement prolétarien. Mais bien que, dès 1843, Marx
eût déjà reconnu le prolétariat moderne comme l'agent de la transformation
communiste, les Manuscrits ne sont pas encore précis sur le mouvement social
pratique qui mènera de la société d'aliénation à la communauté humaine
authentique. Ce développement fondamental dans la pensée de Marx devait se
faire jour à travers la convergence de deux éléments vitaux : l'élaboration de
la méthode matérialiste historique, et la politisation ouverte du projet communiste.
Le mouvement réel de
l'histoire
Les Manuscrits contiennent diverses réflexions sur les différences entre le féodalisme et le capitalisme, mais dans certaines parties, ils présentent de la société capitaliste une image quelque peu statique. Parfois dans le texte, le capital et les aliénations qui s'y rattachent, apparaissent simplement comme un état de fait, sans explication réelle de leur genèse. Aussi le processus réel de la faillite du capitalisme reste-t-il également plutôt nébuleux. Mais, un an plus tard, dans L'Idéologie Allemande, Marx et Engels ont développé une vision cohérente des bases pratiques et objectives du mouvement de l'histoire (et donc des différentes étapes de l'aliénation humaine). L'histoire se présentait maintenant clairement comme une succession de modes de production, depuis la communauté tribale, en passant par la société antique jusqu'au féodalisme et au capitalisme ; et ce qui constituait l'élément dynamique de ce mouvement n'était pas les idées ou les sentiments humains, mais la production matérielle des besoins vitaux :
« (...) force nous est de constater d'emblée que la première condition de toute existence humaine, donc de toute histoire, c'est que les hommes doivent être en mesure de vivre pour être capables de "faire l'histoire". Or, pour vivre, il faut avant tout manger et boire, se loger, se vêtir et maintes autres choses encore. Le premier acte historique, c'est donc la création des moyens pour satisfaire ces besoins, la production de la vie matérielle elle-même. » ([2] [973])
Cette vérité toute simple était la base pour comprendre le passage d'un type de société à un autre, pour comprendre « qu'un mode de production ou un stade industriel déterminé est toujours lié à un mode de coopération ou à un stade social bien défini, et ce mode de coopération est lui-même une "force productive" ; que la quantité de forces productives accessibles aux hommes détermine l'état social, de sorte que "l'histoire de l'humanité" doit être étudiée et traitée en liaison avec l'histoire de l'industrie et du commerce. » ([3] [974])
Avec ce point de vue, les idées et la lutte entre les idées, la politique, la morale et la religion cessent d'être les facteurs déterminants du développement historique :
« (...) on ne part pas de ce que les hommes disent, s'imaginent, se représentent, ni non plus de ce que l'on dit, pense, s'imagine et se représente à leur sujet, pour en arriver à l'homme en chair et en os; c'est à partir des hommes réellement actifs et de leur processus de vie réel que l'on expose le développement des reflets et des échos idéologiques de ce processus... Ce n'est pas la conscience qui détermine la vie, c'est la vie qui détermine la conscience. »([4] [975])
L'Idéologie allemande souligne qu'au bout de ce vaste mouvement historique, à l'instar des modes de production précédents, le capitalisme, est condamné à disparaître, non pas à cause de sa faillite morale, mais parce que ses contradictions internes le contraignent à s'autodétruire, et parce qu'il a fait surgir une classe capable de le remplacer par une forme supérieure d'organisation sociale :
« A un certain stade de l'évolution des forces productives, on voit surgir des forces de production et des moyens de commerce qui, dans les conditions existantes, ne font que causer des malheurs. Ce ne sont plus des forces de production, mais des forces de destruction (machinisme et argent). Autre conséquence, une classe fait son apparition, qui doit supporter toutes les charges de la société sans jouir de ses avantages, une classe qui, jetée hors de la société, est reléguée de force dans l'opposition la plus résolue à toutes les autres classes ; une classe qui constitue la majorité de tous les membres de la société et d'où émane la conscience de la nécessité d'une révolution en profondeur, la conscience communiste (...) ». ([5] [976])
Le résultat, en contradiction complète avec toutes les visions utopistes qui voyaient le communisme comme un idéal statique sans aucun rapport avec le processus réel de l'évolution historique, c'était que « le communisme n'est pas un état de choses qu'il convient d'établir, un idéal auquel la réalité devra se conformer. Nous appelons communisme le mouvement réel qui abolit l'état actuel des choses. » ([6] [977])
Ayant établi cette méthode et ce cadre général, Marx et Engels purent procéder alors à un examen plus détaillé des contradictions spécifiques de la société capitaliste. De nouveau, la critique de l'économie bourgeoise contenue dans les Manuscrits, a fourni beaucoup de matière pour le faire, et Marx devait y revenir sans cesse. Mais une étape décisive fut marquée par le développement du concept de plus-value, puisqu'il permettait d'enraciner la dénonciation de l'aliénation capitaliste dans les faits économiques les plus tangibles, dans les mathématiques mêmes de l'exploitation quotidienne. Ce concept devait évidemment préoccuper Marx dans la plupart de ses travaux ultérieurs (les Grundrisse, Le Capital, les Théories de la Plus-Value) qui contiennent d'importantes clarifications sur ce sujet - en particulier la distinction entre le travail et la force de travail. Néanmoins, l'essentiel du concept est déjà élaboré dans Misère de la Philosophie et dans Travail Salarié et Capital, rédigés en 1847.
Les écrits ultérieurs devaient également se pencher de plus près sur le rapport entre l'extraction et la réalisation de la plus-value, et sur les crises périodiques de surproduction qui ébranlaient, tous les dix ans ou à peu près, la société capitaliste jusqu'en ses fondements. Mais Engels avait déjà saisi la signification des « crises commerciales » dans sa Critique de l'Economie Politique en 1844, et avait rapidement convaincu Marx de la nécessité de les comprendre comme les signes avant-coureurs de l'effondrement du capitalisme - manifestations concrètes des contradictions insolubles de celui-ci.
L'élaboration du programme : la
formation de la Ligue
des communistes
Puisque désormais, le communisme avait été appréhendé comme mouvement et non simplement comme but - de façon spécifique comme le mouvement de la lutte de classe du prolétariat - il ne pouvait maintenant que se développer comme programme pratique pour l'émancipation du travail - comme programme politique révolutionnaire. Même avant qu'il eût formellement adopté une position communiste, Marx avait rejeté tous les « nobles critiques » qui refusaient de se salir les mains dans les sordides réalités de la lutte politique. Comme il le déclarait dans sa lettre à Ruge en septembre 1843 : « Rien ne nous empêche de rattacher notre critique à la critique de la politique, et de prendre parti dans la politique, donc de participer à des luttes réelles et de nous identifier à elles. » ([7] [978]) En fait, la nécessité de s'engager dans les luttes politiques, afin de réaliser une transformation sociale plus totale, faisait partie intégrante de la nature même de la révolution prolétarienne : « Ne dites pas que le mouvement social exclut le mouvement politique » ([8] [979]), écrivait Marx dans sa polémique contre l'« anti-politique » Proudhon : «Il n'y a jamais de mouvement politique qui ne soit social en même temps. Ce n'est que dans un ordre de choses où il n'y aura plus de classes et d'antagonismes de classes, que les évolutions sociales cesseront d'être des révolutions politiques. » ([9] [980])
Autrement dit, le prolétariat se différenciait de la bourgeoisie en ce qu'il ne pouvait, en tant que classe exploitée et sans propriété, édifier la base économique d'une nouvelle société dans la coquille de l'ancienne. La révolution qui mettrait fin à toutes les formes de domination de classe ne pouvait donc commencer que comme assaut politique contre le vieil ordre ; son premier acte serait la prise du pouvoir politique par une classe sans propriété qui, sur cette base, procéderait aux transformations économiques et sociales menant à une société sans classe.
Mais le programme politique précisément défini de la révolution communiste ne pouvait naître spontanément : il devait être élaboré par les éléments les plus avancés du prolétariat, ceux qui s'étaient organisés dans des groupes communistes distincts. Aussi, dans les années 1845-48, Marx et Engels furent-ils de plus en plus impliqués dans la construction d'une telle organisation. Là encore, leur démarche était dictée par la reconnaissance de la nécessité de s'insérer dans un « mouvement réel » déjà existant. C'est pourquoi, au lieu de construire une organisation « ex nihilo », ils cherchaient à se relier aux courants prolétariens les plus avancés, dans le but de les gagner à une conception plus scientifique du projet communiste. Cela les a menés, concrètement, à un groupe principalement composé d'ouvriers allemands exilés, la Ligue des Justes. Pour Marx et Engels, l'importance de ce groupe résidait dans le fait qu'à la différence de diverses branches de « socialisme » des couches moyennes, la Ligue était une réelle expression du prolétariat combattant. Formée à Paris en 1836, elle avait des liens étroits avec la Société des Saisons de Blanqui et avait participé, avec cette dernière, au soulèvement défait de 1839. Elle était donc une organisation qui reconnaissait la réalité de la guerre de classe et la nécessité d'une bataille révolutionnaire violente pour le pouvoir. Il est vrai que, tout comme Blanqui, elle tendait à voir la révolution en termes de conspiration, comme l'action d'une minorité déterminée, et sa nature même de société secrète était le reflet de cette conception. Elle fut également influencée, au début des années 1840, par les conceptions à demi-messianiques de Wilhelm Weitling.
Mais la Ligue avait aussi fait la preuve de ses capacités de développement théorique. L'un des effets de son caractère « émigré » devait la confirmer, selon les termes d'Engels, comme « le premier mouvement ouvrier international de tous les temps ». Ceci signifiait qu'elle était ouverte aux plus importants développements internationaux de la lutte de classe. Dans les années 1840, le principal centre de la Ligue s'était déplacé à Londres et, à travers ses contacts avec le mouvement Chartiste, ses chefs avaient commencé à s'éloigner des anciennes conceptions conspiratrices pour adopter une vision de la lutte prolétarienne comme mouvement massif, auto conscient et organisé, dans lequel le rôle clé serait joué par le prolétariat industriel.
Les conceptions de Marx et Engels tombèrent donc sur un sol fertile, non sans qu'un dur combat ait dû être mené contre les influences de Blanqui et Weitling. Mais en 1847, la Ligue des Justes était devenue la Ligue des Communistes. Elle avait changé sa structure organisationnelle, caractéristique d'une secte conspiratrice, en une organisation centralisée aux statuts clairement définis et dirigée par des comités élus. Et elle avait délégué à Marx la tâche de rédiger la prise de position des principes politiques de l'organisation - le document connu comme Manifeste du Parti Communiste ([10] [981]), d'abord publié en allemand, à Londres en 1848, juste avant l'explosion de la révolution de Février en France.
Le Manifeste communiste
L'ascension et le déclin de la bourgeoisie
Le Manifeste du Parti Communiste - ainsi que son premier brouillon les Principes du communisme - représente la première prise de position détaillée du communisme scientifique. Bien que rédigé pour les grandes masses, dans un style enthousiasmant et passionné, il n'est jamais grossier ou superficiel. Au contraire, il mérite un réexamen continuel parce qu'il condense, en relativement peu de pages, les lignes générales de la pensée marxiste sur toute une série de questions reliées entre elles.
La première partie du texte souligne la nouvelle théorie de l'histoire, annoncée dès le début par la fameuse phrase « l'histoire de toute société jusqu'à nos jours, c'est l'histoire de la lutte des classes. » ([11] [982]) Elle traite brièvement des différents changements dans les rapports de classes, de l'évolution depuis la société antique jusqu'au féodalisme et au capitalisme, afin de montrer que « la bourgeoisie moderne est elle-même le produit d'un long processus de développement, de toute une série de révolutions survenues dans les modes de production et d'échange. » ([12] [983]) S'abstenant de toute condamnation morale abstraite du surgissement de l'exploitation capitaliste, le texte souligne le rôle éminemment révolutionnaire de la bourgeoisie qui a balayé toutes les vieilles formes « paroissiales », bornées de société, et les a remplacées par le mode de production le plus dynamique et expansif jamais connu ; un mode de production qui, en conquérant et unifiant la planète si rapidement, et en mettant en mouvement des forces productives si énormes, jetait les bases d'une forme supérieure de société qui soit finalement capable de se débarrasser des antagonismes de classes. Tout aussi exempte de subjectivisme est, dans le texte, l'identification des contradictions internes qui mèneront à la chute du capitalisme.
D'un côté la crise économique : « Les conditions bourgeoises de production et de commerce, les rapports de propriété bourgeois, la société bourgeoise moderne, qui a fait éclore de si puissants moyens de production et de communication, ressemble à ce magicien, désormais incapable d'exorciser les puissances infernales qu'il a évoquées. Depuis plusieurs décennies, l'histoire de l'industrie et du commerce n'est que l'histoire de la révolte des forces productives modernes contre les rapports de production modernes, contre le système de propriété qui est la condition d'existence de la bourgeoisie et de son régime. Il suffit de rappeler les crises commerciales qui, par leur retour périodique, menacent de plus en plus l'existence de la société bourgeoise. Dans ces crises, une grande partie, non seulement des produits déjà créés, mais encore des forces productives existantes, est livrée à la destruction. Une épidémie sociale éclate qui, à toute autre époque, eût semblé absurde : l'épidémie de la surproduction. Brusquement, la société se voit rejetée dans un état de barbarie momentané ; on dirait qu'une famine, une guerre de destruction universelle lui ont coupé les vivres ; l'industrie, le commerce semblent anéantis. Et pourquoi ? Parce que la société a trop de civilisation, trop de vivres, trop d'industrie, trop de commerce. » ([13] [984])
Les Principes du communisme soulignent que la tendance inhérente du capitalisme aux crises de surproduction, non seulement indique le chemin de sa destruction, mais explique également pourquoi celui-ci crée les conditions du communisme dans lequel «Au lieu de créer la misère, la production au-delà des besoins actuels de la société assurera la satisfaction des besoins de tous. » ([14] [985])
Pour le Manifeste, les crises de surproduction sont, bien sûr, les crises cycliques qui ont ponctué toute la période ascendante du capitalisme. Mais, bien que le texte reconnaisse que ces crises peuvent encore être surmontées « en s'emparant de marchés nouveaux et en exploitant mieux les anciens » ([15] [986]), il tend aussi à tirer la conclusion que les rapports bourgeois sont déjà devenus une entrave permanente au développement des forces productives - en d'autres termes, que la société capitaliste a déjà achevé sa mission historique et est entrée dans sa période de déclin. Immédiatement après le passage où sont décrites les crises périodiques, le texte continue : « Les forces productives dont (la société) dispose ne jouent plus en faveur de la propriété bourgeoise ; elles sont, au contraire, devenues trop puissantes pour les institutions bourgeoises qui ne font plus que les entraver (...). Les institutions bourgeoises sont devenues trop étroites pour contenir la richesse qu'elles ont créée. » ([16] [987])
Cette appréciation de l'état atteint par la société bourgeoise n'est pas complètement cohérente avec d'autres formulations du Manifeste, en particulier sur les notions tactiques qui apparaissent à la fin du texte. Mais elles devaient avoir une très grande influence sur les attentes et les interventions de la minorité communiste lors des grands soulèvements de 1848, qui furent considérés comme les précurseurs d'une révolution prolétarienne imminente. Ce n'est que plus tard, en tirant les leçons de ces soulèvements, que Marx et Engels devaient revoir l'idée que le capitalisme avait déjà atteint les limites de sa courbe ascendante.
Les fossoyeurs du capitalisme
« Mais la bourgeoisie n'a pas seulement forgé les armes qui lui donneront la mort ; elle a en outre produit les hommes qui manieront ces armes - les travailleurs modernes, les prolétaires. » ([17] [988])
Ceci résume la seconde contradiction fondamentale menant au renversement de la société capitaliste : la contradiction entre le capital et le travail. Et, en continuité avec l'analyse matérialiste de la dynamique de la société bourgeoise, le Manifeste poursuit en soulignant l'évolution historique de la lutte de classe du prolétariat, depuis ses tout débuts rudimentaires jusqu'au présent et au futur.
Il rend compte de toutes les étapes principales de ce processus : la première réponse des « Luddistes » à la montée de l'industrie moderne, quand les ouvriers sont encore en grande partie dispersés dans de petits ateliers et fréquemment « dirigent leurs attaques, non seulement contre le système bourgeois de production, mais contre les instruments de production eux-mêmes» ([18] [989]) ; le développement d'une organisation de classe pour la défense des intérêts immédiats des ouvriers (les syndicats) comme condition de l'homogénéisation et de l'unification de la classe ; la participation des ouvriers aux luttes de la bourgeoisie contre l'absolutisme qui a fourni au prolétariat une éducation politique et donc « met dans leurs mains des armes contre elle-même » ([19] [990]) ; le développement d'une lutte politique prolétarienne distincte, menée, au début, pour la mise en oeuvre de réformes - telles que la Loi des 10 heures - mais assumant peu à peu la forme d'un défi politique aux fondements mêmes de la société bourgeoise.
Le Manifeste défend l'idée que la situation révolutionnaire naîtra des contradictions économiques du capitalisme ayant atteint leur paroxysme, un point où la bourgeoisie ne pourra même plus « assurer l'existence de l'esclave à l'intérieur même de son esclavage : elle est forcée de le laisser déchoir si bas qu'elle doit le nourrir au lieu d'être nourrie par lui. » ([20] [991])
En même temps, le texte envisage une polarisation croissante de la société entre une petite minorité d'exploiteurs et une majorité prolétarienne appauvrie, toujours croissante : « de plus en plus, la société se divise en deux grands camps ennemis, en deux grandes classes qui s'affrontent directement » ([21] [992]), puisque le développement du capitalisme projette toujours plus la petite-bourgeoisie, la paysannerie, et même des parties de la bourgeoisie elle-même, dans les rangs du prolétariat. La révolution est donc le résultat de cette combinaison de misère économique et de polarisation sociale.
De nouveau, il semble parfois, dans le Manifeste, que cette grande simplification de la société a déjà été accomplie ; que le prolétariat constitue déjà la majorité écrasante de la population. En fait, ce n'était le cas que dans un seul pays à l'époque où le texte a été écrit (la Grande-Bretagne). Et puisque, comme nous l'avons vu, le texte laisse la place à l'idée que le capitalisme a déjà atteint son apogée, il tend à donner l'idée que la confrontation finale entre les « deux grandes classes » est vraiment pour bientôt. Par rapport à l'évolution réelle du capitalisme, c'était loin d'être le cas. Mais malgré ça, le Manifeste est un travail extraordinairement prophétique. A peine quelques mois après sa publication, le développement de la crise économique globale avait engendré une série de soulèvements révolutionnaires dans toute l'Europe. Et, bien que la plupart de ces mouvements aient plus constitué les derniers souffles du combat de la bourgeoisie contre l'absolutisme féodal que les premières échauffourées de la révolution prolétarienne, le prolétariat de Paris, en menant son propre soulèvement indépendant contre la bourgeoisie, démontrait en pratique tous les arguments du Manifeste sur la nature révolutionnaire de la classe ouvrière comme négation vivante de la société capitaliste. Le caractère « prophétique » du Manifeste est le témoignage de la justesse fondamentale, pas tant des pronostics immédiats de Marx et Engels, que de la méthode historique générale avec laquelle ils ont analysé la réalité sociale. Et c'est pourquoi, dans son essence et contrairement à toutes les affirmations arrogantes de la bourgeoisie sur la façon dont l'histoire aurait prouvé l'erreur de Marx, le Manifeste Communiste ne date pas.
De la dictature du prolétariat au dépérissement de l'Etat
Le Manifeste prévoit donc que l'être du prolétariat sera poussé à la révolution sous le fouet de la misère économique croissante. Comme on l'a noté, le premier acte de cette révolution est la prise du pouvoir politique par le prolétariat. Celui-ci devait se constituer en classe dominante pour accomplir son programme économique et social.
Le Manifeste envisage explicitement cette révolution comme « le renversement violent de la bourgeoisie », la culmination d'une «guerre civile plus ou moins occulte » ([22] [993]). Inévitablement cependant, les détails de la manière dont le prolétariat renverserait la bourgeoisie, restent vagues puisque le texte a été écrit avant la première apparition ouverte de la classe comme force indépendante. Le texte parle en fait du prolétariat qui fait « la conquête de la démocratie » ([23] [994]) ; les Principes disent que la révolution « établira un régime démocratique et, par là même, directement ou indirectement, la domination politique du prolétariat » ([24] [995]). Si nous regardons certains écrits de Marx sur le mouvement Chartiste ou sur la République bourgeoise, nous pouvons voir que, même après l'expérience des révolutions de 1848, il envisageait toujours la possibilité que le prolétariat arrive au pouvoir à travers le suffrage universel et le processus parlementaire (par exemple dans son article sur les Chartistes dans The New York Daily Tribune du 25 août 1852, dans lequel Marx défend l'idée qu'accorder le suffrage universel en Angleterre signifierait « la suprématie politique de la classe ouvrière »). Ceci a, à son tour, ouvert la porte à des spéculations sur une conquête totalement pacifique du pouvoir, dans certains pays du moins. Comme nous le verrons, ces spéculations furent ensuite saisies par les pacifistes et les réformistes dans le mouvement ouvrier, dans la dernière partie du siècle, pour prendre et justifier toutes sortes de libertés idéologiques. Néanmoins, les principales lignes de la pensée de Marx vont dans un sens tout à fait différent, et surtout l'expérience de la Commune de Paris de 1871 qui a démontré la nécessité, pour le prolétariat, de créer ses propres organes de pouvoir politique et de détruire l'Etat bourgeois, et non de s'en emparer, que ce soit de façon violente ou « démocratique ». En fait, d'après les préfaces au Manifeste écrites plus tard par Engels, ce fut le changement le plus important que l'expérience historique ait apporté au programme communiste : « (...) en face des expériences pratiques, d'abord de la révolution de Février, ensuite et surtout de la Commune de Paris, où, pour la première fois, le prolétariat a pu tenir entre ses mains le pouvoir politique pendant deux mois, ce programme a perdu, par endroits, son actualité. La Commune notamment a démontré que la classe ouvrière ne peut pas simplement prendre possession de la machine d'Etat telle quelle et l'utiliser pour ses propres fins. » ([25] [996])
Mais ce qui reste valable dans le Manifeste, c'est l'affirmation de la nature violente de la prise du pouvoir et la nécessité que la classe ouvrière établisse sa propre domination politique - la « dictature du prolétariat », telle qu'elle est présentée dans d'autres écrits de la même époque.
Tout aussi valable jusqu'aujourd'hui est le projet de dépérissement de l’Etat. Depuis ses premiers écrits en tant que communiste, Marx a souligné que l'émancipation véritable de l'humanité ne pouvait se restreindre à la sphère politique. « L'émancipation politique » avait constitué la réalisation la plus haute de la révolution bourgeoise, mais pour le prolétariat, cette
«émancipation» ne signifiait qu'une nouvelle forme d'oppression. Pour la classe exploitée, la politique n'était qu'un moyen pour arriver à une fin, à sa voir une émancipation sociale totale. Le pouvoir politique et l'Etat n'étaient nécessaires que dans une société divisée en classes ; puisque le prolétariat n'avait aucun intérêt à se constituer en nouvelle classe exploiteuse, mais était contraint de lutter pour l'abolition de toutes les divisions de classe, il s'ensuivait que l'avènement du communisme signifiait la fin de la politique en tant que sphère particulière, et la fin de l'Etat. Comme le dit le Manifeste :
« Lorsque, dans le cours du développement, les antagonismes de classes auront disparu et que toute la production sera concentrée entre les mains des individus associés, le pouvoir public perdra son caractère politique. Le pouvoir politique au sens strict du terme, est le pouvoir organisé d'une classe pour l'oppression d'une autre. Si, dans sa lutte contre la bourgeoisie, le prolétariat est forcé de s'unir en une classe ; si, par une révolution, il se constitue en classe dominante et, comme telle, abolit violemment les anciens rapports de production - c'est alors qu'il abolit en même temps que ce système de production les conditions d'existence de l'antagonisme des classes ; c'est alors qu'il abolit les classes en général, et, par là même, sa propre domination en tant que classe. » ([26] [997])
Le caractère international de la révolution prolétarienne
Le Manifeste concevait-il la possibilité d'une révolution ou même du communisme, dans un seul pays ? Il est certainement vrai qu'il y a des phrases ambiguës ici et là dans le texte ; par exemple quand il dit que « le prolétariat doit tout d'abord s'emparer du pouvoir politique, s'ériger en classe nationale, se constituer lui-même en tant que nation. Par cet acte, il est, sans doute, encore national mais nullement au sens de la bourgeoisie. » ([27] [998]) En fait, l'amère expérience historique a montré que le terme national n'a qu'un sens bourgeois et que, pour sa part, le prolétariat est la négation de toutes les nations. Mais ceci est avant tout l'expérience de l'époque décadente du capitalisme, quand le nationalisme et les luttes de nationalités auront perdu le caractère progressiste qu'ils pouvaient avoir à l'époque de Marx où le prolétariat soutenait encore certains mouvements nationaux comme moment de la lutte contre l'absolutisme féodal et d'autres vestiges réactionnaires du passé. En général, Marx et Engels étaient clairs sur le fait que de tels mouvements étaient de caractère bourgeois, mais des ambiguïtés se glissaient inévitablement dans leur langage et leur pensée car c'était une époque où la totale incompatibilité entre les intérêts nationaux et les intérêts de classe n'avait pas encore été portée à son terme.
Ceci dit, l'essence du Manifeste n'est pas contenue dans la phrase ci-dessus, mais dans une autre juste avant : « Les prolétaires n'ont pas de patrie. On ne peut leur dérober ce qu'ils ne possèdent pas » ([28] [999]) et dans la conclusion finale du texte : « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! » ([29] [1000]) De même, le Manifeste insiste sur le fait que : « Une des premières conditions de son émancipation, c'est l'action unifiée, tout au moins des travailleurs des pays civilisés. » ([30] [1001])
Les Principes sont même plus explicites là-dessus :
« Question : cette révolution se fera-t-elle dans un seul pays ?
Réponse : Non. La grande industrie, en créant le marché mondial, a déjà rapproché si étroitement les uns des autres les peuples de la terre, et notamment les plus civilisés, que chaque peuple dépend de ce qui se passe chez les autres. Elle a, en outre, uniformisé dans tous les pays civilisés le développement social à tel point que, dans tous ces pays, la bourgeoisie et le prolétariat sont devenus les deux classes décisives de la société, et que la lutte entre ces deux classes est devenue la principale lutte de notre époque. La révolution communiste, par conséquent, ne sera pas une révolution purement nationale ; elle se produira en même temps dans tous les pays civilisés, c'est-à-dire tout au moins en Angleterre, en Amérique, en France et en Allemagne (...). Elle est une révolution universelle ; elle aura, par conséquent, un terrain universel. » ([31] [1002])
Donc, dès le
départ, la révolution prolétarienne était considérée comme une révolution
internationale. L'idée que le communisme, ou même la prise du pouvoir
révolutionnaire, puisse avoir lieu dans les limites d'un seul pays, était aussi
éloignée des idées de Marx et Engels qu'elle l'était de l'esprit des Bolcheviks
qui ont dirigé la révolution d'Octobre 1917, et de celui des fractions
internationalistes qui ont mené la résistance à la contre-révolution
stalinienne qui justement s'identifiait à la théorie monstrueuse du «
socialisme en un seul pays»
Le communisme et le chemin pour y parvenir
Comme nous l'avons vu dans l'article précédent, le courant marxiste était, dès ses débuts, tout à fait clair sur les caractéristiques d'une société communiste pleinement développée pour laquelle il luttait. Le Manifeste la définit brièvement, mais de façon significative, dans le paragraphe qui suit celui sur le dépérissement de l'Etat :
« L'ancienne société bourgeoise, avec ses classes et ses conflits de classes, fait place à une association où le libre épanouissement de chacun est la condition du libre épanouissement de tous. » ([32] [1003])
Le communisme n'est donc pas seulement une société sans classes et sans Etat : il est aussi une société qui a dépassé (et c'est sans précédent dans toute l'histoire de l'humanité jusqu'à nos jours) le conflit entre les besoins sociaux et les besoins individuels et qui dédie, de façon consciente, ses ressources au développement illimité de tous ses membres - tout ceci faisant clairement écho aux réflexions sur la nature d'une activité authentiquement libre parues dans les écrits de 1844 et 1845. Les passages dans le Manifeste qui traitent des objections de la bourgeoisie au communisme, montrent aussi à l'évidence que le communisme signifie non seulement la fin du travail salarié, mais de toutes les formes d'achat et de vente. La même partie insiste sur le fait que la famille bourgeoise, qui est caractérisée comme une forme de prostitution légalisée, est aussi condamnée à disparaître.
Les Principes du communisme traitent, plus longuement que le Manifeste, d'autres aspects de la nouvelle société. Par exemple, ils soulignent que le communisme remplacera l'anarchie du marché par l'organisation des forces productives de l'humanité « d'après un plan établi en fonction des ressources disponibles et des besoins de toute la collectivité ». ([33] [1004]) En même temps, le texte développe le thème selon lequel l'abolition des classes sera possible dans le futur parce que le communisme sera une société d'abondance :
« Le développement de l'industrie mettra à la disposition de la société une masse de produits suffisante pour satisfaire les besoins de tous. De même l'agriculture » en utilisant les x perfectionnements et les progrès scientifiques déjà réalisés connaîtra un essor tout nouveau et mettra à la disposition de la société une quantité tout à fait suffisante de produits. Ainsi la société fabriquera suffisamment de produits pour pouvoir organiser la répartition de façon à satisfaire les besoins de tous ses membres. La division de la société en classes différentes, mutuellement hostiles, sera rendue ainsi superflue. » ([34] [1005])
De nouveau, si le communisme est consacré au « libre développement de tous », ce doit alors être une société qui s'est débarrassée de la division du travail telle que nous la connaissons : « La gestion commune de la production ne peut être assurée par des hommes tels qu'ils sont aujourd'hui, alors que chaque individu est subordonné à une seule branche de la production, enchaîné à elle, exploité par elle, n'ayant développé qu'une de ses facultés aux dépens des autres... L'industrie exercée en commun, et suivant un plan, par l'ensemble de la société suppose des hommes dont les facultés sont développées dans tous les sens et qui sont en état de dominer tout le système de production. » ([35] [1006])
Une autre division qui doit être supprimée, c'est celle entre la ville et la campagne :
« La dispersion dans les campagnes de la population agricole, à côté de la concentration de la population industrielle dans les grandes villes, est un phénomène qui correspond à une étape de développement encore inférieure de l'agriculture et de l'industrie, un obstacle à tout progrès ultérieur qui se fait fortement sentir dès maintenant. » ([36] [1007])
Ce point était considéré comme si important que la tâche de mettre fin à la division entre ville et campagne a été incluse comme l'une des mesures de « transition » vers le communisme, à la fois dans les Principes et dans le Manifeste. Et il reste une question brûlante dans le monde d'aujourd'hui avec ses mégapoles en croissance constante et la pollution grandissante. (Nous reviendrons sur cette question plus en détail dans un autre article, quand nous devrons considérer comment la révolution communiste traitera la « crise écologique »).
Ces descriptions générales de la société communiste future sont en continuité avec celles contenues dans les premiers écrits de Marx, et ne requièrent pas beaucoup, sinon pas du tout, de modifications aujourd'hui. Par contre, les mesures sociales et économiques spécifiques défendues dans le Manifeste en tant que moyens d'atteindre ces buts sont - comme Marx et Engels l'ont reconnu eux-mêmes à leur propre époque - bien plus marquées par la période, pour deux raisons fondamentales et intimement liées :
- le fait que le capitalisme, à l'époque où le Manifeste a été écrit, était encore dans sa phase ascendante et n'avait pas encore jeté les bases des conditions objectives de la révolution communiste ;
- le fait que la classe ouvrière n'avait pas eu d'expérience concrète d'une situation révolutionnaire, ni de ce fait des moyens par lesquels elle pourrait assumer le pouvoir politique, ni des premières mesures économiques et sociales qu'elle devrait prendre une fois au pouvoir.
Voici les mesures que le Manifeste envisage comme pouvant « assez généralement être mises en application » une fois que le prolétariat aura pris le pouvoir :
«1° Expropriation de la propriété foncière et affectation de la rente foncière aux dépenses de l'Etat.
2° Impôt sur le revenu fortement progressif.
3° Abolition du droit d'héritage.
4° Confiscation des biens de tous les émigrés et rebelles.
5° Centralisation du crédit entre les mains de l'Etat, au moyen d'une banque nationale à capital d'Etat et à monopole exclusif
6° Centralisation entre les mains de l'Etat de tous les moyens de transport et de communication.
7° Multiplication des manufactures nationales et des instruments de production ; défrichement des terrains incultes conformément à un plan d'ensemble.
8° Travail obligatoire pour tous, constitution d'armées industrielles, particulièrement dans l'agriculture.
9° Combinaison de l'exploitation agricole et industrielle ; mesures tendant à faire disparaître graduellement la différence entre la ville et la campagne.
10° Education publique gratuite de tous les enfants. Abolition du travail des enfants dans les fabriques, tel qu'il existe aujourd'hui ; éducation combinée avec la production matérielle, etc. » ([37] [1008])
Dès le début, il est évident que la majorité de ces mesures se sont avérées, dans sa phase de décadence, tout à fait compatibles avec la survie du capitalisme - en fait beaucoup d'entre elles ont été adaptées par le capital précisément pour survivre dans cette dernière période. L'époque de décadence est celle du capitalisme d'Etat universel : la centralisation du crédit entre les mains de l'Etat, la formation des armées industrielles, la nationalisation des transports et de la communication, l'éducation libre dans des écoles d'Etat ... A un degré plus ou moins grand, et à différents moments, chaque Etat capitaliste a adopté de telles mesures depuis 1914, et les régimes staliniens, ceux qui proclament mettre en oeuvre le programme du Manifeste Communiste, les ont pratiquement toutes adoptées.
Les staliniens basaient leurs références « marxistes » en partie sur le fait qu'ils avaient mis en pratique la plupart des mesures défendues dans le Manifeste. Les anarchistes, pour leur part, ont également souligné cette continuité, bien qu'évidemment, dans un sens totalement négatif, et ils peuvent se réclamer de certaines diatribes « prophétiques » de Bakounine pour « prouver » que Staline était l'héritier logique de Marx.
En fait, cette
façon de voir les choses est complètement superficielle, et ne sert qu'à
justifier des attitudes politiques bourgeoises particulières. Mais avant
d'expliquer pourquoi les mesures économiques et sociales défendues dans le Manifeste ne sont, en général, plus
applicables, nous voulons souligner la validité de la méthode qui les
sous-tend.
La nécessité d'une période
de transition
Des éléments aussi profondément enracinés dans la société capitaliste que le travail salarié, les divisions de classes ou l'Etat, ne pouvaient pas être abolis en une nuit, comme les anarchistes du temps de Marx le prétendaient et comme leurs descendants ultérieurs (les diverses branches de conseillisme et de modernisme) le prétendent encore. Le capitalisme a créé le potentiel pour l'abondance, mais cela ne signifie pas que l'abondance apparaisse, de façon magique, le lendemain de la révolution. Au contraire, la révolution est une réponse à une profonde désorganisation de la société et, dans sa phase initiale tout au moins, tendra encore à intensifier cette désorganisation. Un immense travail de reconstruction, d'éducation et de réorganisation attend le prolétariat victorieux. Des siècles, des millénaires d'habitudes enracinées, tous les vieux débris idéologiques du vieux monde, devront être supprimés. La tâche est vaste et sans précédent, et les colporteurs de solutions instantanées sont des marchands d'illusions. C'est pourquoi le Manifeste a raison de parler du besoin, pour le prolétariat victorieux, d'« accroître le plus rapidement possible la masse des forces productives » ([38] [1009]) et, pour ce faire, au début, « (en attentant) despotiquement au droit de propriété et aux rapports de production bourgeois, donc (en prenant) des mesures apparemment insuffisantes et inconsistantes du point de vue économique. Mais au cours du mouvement, ces mesures se dépassent elles-mêmes et sont indispensables comme moyens de bouleverser le mode de production tout entier. » ([39] [1010])
Cette vision générale du prolétariat mettant en mouvement une dynamique vers le communisme, plutôt que d'introduire ce dernier par décret, reste parfaitement correcte, même si nous pouvons, rétrospectivement, reconnaître que cette dynamique ne découle pas du fait de placer l'accumulation du capital entre les mains de l'Etat, mais dans le prolétariat auto-organisé qui renverse les principes mêmes de l'accumulation (c'est-à-dire en soumettant la production à la consommation ; en « attentant de façon despotique » à l'économie de marché et à la forme du travail salarié ; à travers le contrôle direct par le prolétariat de l'appareil productif, etc.)
Le principe de centralisation
De nouveau, et
contrairement aux anarchistes qui, en épousant la cause de la « fédération »,
reflètent le localisme et l'individualisme petit-bourgeois de ce courant, le
marxisme a toujours insisté sur le fait que le chaos et la concurrence
capitaliste ne peuvent être dépassés qu'à travers la centralisation la plus
stricte à l'échelle globale - centralisation des forces productives par le
prolétariat, centralisation des organes économiques et politiques propres du
prolétariat. L'expérience a certainement montré que cette centralisation est
très différente de la centralisation bureaucratique de l'Etat capitaliste ;
plus encore, le prolétariat doit se méfier du centralisme de l'Etat
post-révolutionnaire. Mais l'Etat capitaliste ne peut être renversé, et les
tendances contre-révolutionnaires de l'Etat de « transition » contrecarrées,
sans la centralisation des forces du prolétariat. A ce niveau encore une fois,
la démarche générale contenue dans le Manifeste
reste valable aujourd'hui.
Les limites posées par l'histoire
Néanmoins, comme Engels le dit dans son introduction à l'édition de 1872, si « les principes généraux énoncés dans le Manifeste gardent aujourd'hui encore, dans leurs grandes lignes, toute leur validité... Ainsi que le déclare le Manifeste lui-même, l'application pratique de ces principes dépend partout et toujours des conditions historiques du moment ; il ne faut donc pas attribuer trop d'importance aux mesures révolutionnaires proposées à la fin du chapitre II. A bien des égards, il faudrait aujourd'hui remanier ces passages ». ([40] [1011]) Il mentionne ensuite les « immenses progrès de la grande industrie au cours de ces vingt-cinq dernières années » et, comme nous l'avons déjà vu, l'expérience révolutionnaire de la classe ouvrière en 1848 et 1871.
La référence au développement de l'industrie moderne est particulièrement valable ici, puisqu'elle indique que, en ce qui concerne Marx et Engels, le but premier des mesures économiques proposées dans le Manifeste était de développer le capitalisme à une époque où nombre de pays n'avaient pas achevé leur révolution bourgeoise. On peut le vérifier en regardant les Revendications du Parti communiste d'Allemagne que la Ligue des communistes a distribuées sous forme de tract durant les soulèvements de 1848 en Allemagne. Nous savons que Marx était tout à fait explicite à l'époque sur la nécessité que la bourgeoisie prenne le pouvoir en Allemagne comme pré condition de la révolution prolétarienne. Les mesures proposées dans ce tract avaient donc pour but de pousser l'Allemagne hors de son arriération féodale et d'étendre les rapports bourgeois de production aussi vite que possible : mais beaucoup de ces mesures - lourd impôt progressif sur le revenu, banque d'Etat, nationalisation de la terre et des transports, libre éducation - sont exactement les mêmes que celles du Manifeste. Nous examinerons dans un autre article jusqu'à quel point les perspectives de Marx sur la révolution en Allemagne ont été confirmées ou infirmées par les événements ; mais le fait reste que, si Marx et Engels voyaient les mesures proposées dans le Manifeste comme étant déjà dépassées à leur époque, elles sont encore moins valables dans la période de décadence, quand le capitalisme a, depuis longtemps, établi sa domination mondiale et, depuis longtemps, ne s'est plus manifesté comme force de progrès où que ce soit dans le monde.
Ce n'est pas pour dire qu'à l'époque de Marx et Engels, ou dans le mouvement révolutionnaire qui s'est développé après eux, il y ait eu une véritable clarté sur le genre de mesures que le prolétariat victorieux devrait prendre afin d'enclencher une dynamique vers le communisme. Au contraire, les confusions sur la possibilité, pour la classe ouvrière, d'utiliser les nationalisations, le crédit d'Etat et autres mesures capitalistes d'Etat comme pas en avant vers le communisme, ont persisté durant le 19e siècle et joué un rôle très négatif durant la révolution en Russie. Il a fallu la défaite de cette révolution, la transformation du bastion prolétarien en une effrayante tyrannie capitaliste d'Etat et beaucoup d'autres réflexions et débats parmi les révolutionnaires avant que de telles ambiguïtés soient finalement rejetées. Mais nous traiterons aussi de cette question dans d'autres articles.
Le jugement de la pratique
La partie finale du Manifeste concerne les tactiques à suivre par les communistes dans les différents pays, en particulier ceux où ce qui était à l'ordre du jour, ou ce qui semblait l'être, était la lutte contre l'absolutisme féodal. Dans le prochain article, nous examinerons comment l'intervention pratique des communistes dans les soulèvements européens de 1848 a clarifié les perspectives de la révolution prolétarienne et confirmé ou infirmé les considérations tactiques contenues dans le Manifeste.
CDW
[1] [1012] Voir « l’aliénation du travail constitue la prémisse de son émancipation » dans la Revue Internationale n°70 et « Le communisme, véritable commencement de la société humaine » dans la Revue internationale n°71.
[2] [1013] L'Idéologie allemande, Ed. La Pléiade, T.III, p. 1058
[3] [1014] Ibid. p. 1060
[4] [1015] Ibid. p. 1056
[5] [1016] Ibid. p. 1122
[6] [1017] Ibid. p. 1067
[7] [1018] Ecrits de Jeunesse, Ed. Spartacus, p. 46
[8] [1019] Misère de la philosophie, Ed. La Pléiade, Tome I, p. 136
[9] [1020] Ibid.
[10] [1021] Ici, le terme « parti » ne se réfère pas à la Ligue des Communistes elle-même : bien que le Manifeste fût le travail collectif de cette organisation, son nom n'apparaissait pas dans la première édition de ce texte, essentiellement pour des raisons de sécurité. Le terme « parti », à ce stade, ne se référait pas à une organisation spécifique mais à une tendance ou un mouvement général.
[11] [1022] Le Manifeste, Ed. La Pléiade, Tome I, p. 161. Dans les dernières éditions de ce texte, Engels a précisé que cette prise de position s'appliquait à toute « l'histoire écrite » mais pas aux formes communautaires de société qui ont précédé l'apparition des divisions en classes.
[12] [1023] Ibid., p. 163
[13] [1024] Ibid., p. 167
[14] [1025] Principes du communisme, Ed. Beijing, p. 19
[15] [1026] Le Manifeste, ibid.
[16] [1027] Ibid.
[17] [1028] Ibid. p. 168
[18] [1029] Ibid. p. 169
[19] [1030] Ibid. p. 171
[20] [1031] Ibid. p. 173
[21] [1032] Ibid. p. 162
[22] [1033] Ibid. p. 173
[23] [1034] Ibid. p. 181
[24] [1035] Principes du communisme, Ed. Beijing, p. 15
[25] [1036] Préface du Manifeste Communiste à la réédition allemande, 1872, Ed.
Histoire du mouvement ouvrier:
- 1848 [1037]
Approfondir:
Questions théoriques:
- Communisme [492]
Heritage de la Gauche Communiste:
Comprendre le développement du chaos et des conflits impérialistes
- 3124 reads
Jusqu'à l'effondrement du bloc de l'Est, en 1989, l'alternative posée par le mouvement ouvrier au début du siècle – Guerre ou Révolution – résumait clairement les enjeux de la situation : dans une course aux armements vertigineuse, les deux blocs rivaux se préparaient pour une nouvelle guerre mondiale, seule réponse que le capitalisme puisse apporter à sa crise économique. Aujourd'hui, l'humanité est confrontée, non à un “nouvel ordre mondial”, comme annoncé en 1989, mais à un désordre mondial où le chaos et la barbarie se développent jusque dans les régions qui avaient vu la première révolution prolétarienne de l'histoire, en 1917. Les militaires des grandes puissances “démocratiques”, préparés pour la guerre avec le bloc de l'Est, seraient maintenant sur le terrain au nom de “1'aide humanitaire” dans les pays ravagés par les guerres civiles. Face à ce bouleversement de la situation mondiale et à toutes les campagnes mensongères qui l'accompagnent, la responsabilité des communistes est de dégager une analyse claire, une compréhension en profondeur des nouveaux enjeux des conflits impérialistes. Malheureusement, comme on va le voir dans cet article, la plupart des organisations du milieu politique prolétarien sont bien loin d'être à la hauteur de cette responsabilité.
Il est évident que, dans la confusion que la bourgeoisie s'emploie à entretenir, les révolutionnaires ont pour tâche de réaffirmer que la seule force capable de changer la société, c'est la classe ouvrière, que le capitalisme ne saurait être porteur de paix et se soucie fort peu du bien-être des populations, que le seul “nouvel ordre mondial” sans guerre, sans famine, sans misère, c'est celui que peut instaurer le prolétariat en détruisant le capitalisme : le communisme. Cependant, le prolétariat attend de ses organisations politiques, si petites soient-elles, plus que de simples déclarations de principe. Il doit pouvoir compter sur elles pour opposer à toute l'hypocrisie, toute la propagande de la bourgeoisie, leur capacité d'analyse de la situation et des indications claires sur ses véritables enjeux.
Nous avons montré dans notre revue (n°61) que les groupes politiques sérieux, qui publient une presse régulière comme Battaglia Comunista, Workers Voice, Programma Comunista, Il Partito Comunista, Le Prolétaire, avaient réagi avec vigueur à toute la campagne sur la “fin du communisme” en réaffirmant la nécessité de celui-ci et la nature capitaliste de l'ex-URSS stalinienne (<!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]--> [1038]). De même, ces groupes ont répondu au déchaînement de la guerre du Golfe en prenant position clairement pour dénoncer tout soutien à un camp ou à l'autre et appeler les ouvriers à engager le combat contre le capitalisme sous toutes ses formes et dans tous les pays (voir Revue Internationale n°64). Cependant, au delà de ces positions de principe, de ce minimum que l'on peut attendre de groupes prolétariens, on chercherait en vain un cadre de compréhension de la situation aujourd'hui. Alors que, depuis la fin de l'année 1989, notre organisation a fait l'effort, comme c'était sa responsabilité élémentaire (et il n'y a pas lieu de nous en glorifier comme s'il s'agissait d'un exploit exceptionnel pour des révolutionnaires), d'élaborer un tel cadre, et de s'y tenir (<!--[if !supportFootnotes]-->[2]<!--[endif]--> [1039]), un des traits des “analyses” de ces groupes c'est leur tendance à zigzaguer de façon inconsidérée, à se contredire d'un mois à l'autre.
Les zigzags du milieu politique prolétarien
Pour se rendre compte de cette inconstance des groupes du milieu politique prolétarien, il suffit, par exemple, de suivre leur presse régulière dans la période de la guerre du Golfe.
Ainsi, le lecteur attentif de Battaglia Comunista a pu lire en novembre 90, en pleins préparatifs de l'intervention militaire que « celle ci [la guerre] n'est certainement pas provoquée par la folie de Saddam Hussein mais qu'elle est le produit d'un affrontement entre cette partie de la bourgeoisie arabe qui revendique plus de pouvoir pour les pays producteurs de pétrole et la bourgeoisie occidentale, en particulier la bourgeoisie américaine, qui prétend dicter sa loi en matière de prix du pétrole comme il est advenu jusqu'à présent ». Il faut noter que, au même moment, défilait à Bagdad une multitude de personnalités politiques occidentales (notamment Willy Brandt et toute une brochette d'anciens premiers ministres japonais) venues ouvertement négocier, au grand dam des États-Unis, la libération d'otages. Dès cette époque, il était clair que cette puissance et ses “alliés” occidentaux étaient très loin de partager les mêmes objectifs, mais ce qui était déjà un évidence, le fait que, depuis l'effondrement du bloc de l'Est, il n'existait plus les mêmes convergences d'intérêts au sein de la “bourgeoisie occidentale”, qu'au contraire, les antagonismes impérialistes partageaient de façon croissante celle-ci dès ce moment, échappe complètement à l'analyse “marxiste” de BC.
Par ailleurs, dans ce même numéro, il est affirmé, à juste titre, et c'est bien le moins à deux mois de l'éclatement d'une guerre annoncée, que « le futur, même le plus immédiat, sera caractérisé par un nouvel embrasement des conflits ». Toutefois, cette perspective n'est pas le moins du monde évoquée dans le journal de décembre.
Avec le numéro de janvier 1991, quelle n'est pas la surprise du lecteur de découvrir, en première page, que « la troisième guerre mondiale a commencé le 17 janvier » ! Cependant, le journal ne consacre qu'un article à un tel événement : on peut se demander si les camarades de BC eux-mêmes sont vraiment convaincus de ce qu'ils écrivent dans leur presse.
En février, une grande partie de BC est dédiée à la question de la guerre : il y est réaffirmé que le capitalisme c'est la guerre et que toutes les conditions sont réunies pour que la bourgeoisie en arrive à sa “solution”, la troisième guerre mondiale. « En ce sens, affirmer que la guerre qui a commencé le 17 janvier dernier marque le début du troisième conflit mondial n'est pas un accès de fantaisie, mais prendre acte que s'est ouverte la phase dans laquelle les conflits commerciaux, qui se sont accentués à partir du début des années 70, n'ont plus guère de possibilités de s'arranger si ce n'est en prévoyant la guerre généralisée ». Dans un autre article, l'auteur est beaucoup moins affirmatif et dans un troisième, qui montre “la fragilité du front anti-Saddam”, on s'interroge sur les protagonistes des futurs conflits : « avec ou sans Gorbatchev, la Russie ne pourrait tolérer la présence militaire américaine à la porte de sa maison, chose qui se vérifierait dans le cas d'une occupation militaire de l'Irak. Elle ne pourrait pas plus tolérer... un bouleversement des équilibres actuels en faveur de la traditionnelle coalition arabe pro-américaine ». Ainsi, ce qui était déjà évident dès les derniers mois de 1989, la fin de l'antagonisme entre les États-Unis et l'URSS par KO de cette dernière puissance, l'incapacité définitive de celle-ci de contester la supériorité écrasante de son ex-rivale, et particulièrement au Moyen-Orient, n'apparaît pas encore dans le champ de vision de BC. Avec le recul, alors que le successeur de Gorbatchev est devenu un des meilleurs alliés des États-Unis, on peut constater l'absurdité de l'analyse et des “prévisions” de BC. A la décharge de BC, il faut signaler que, dans ce même numéro, elle déclare que la fidélité aux USA de l'Allemagne devient absolument douteuse. Cependant, les raisons qu'elle donne pour étayer cette affirmation sont pour le moins insuffisantes : il en serait ainsi parce cette dernière puissance serait « engagée dans la construction d'une nouvelle zone d'influence à l'Est et dans l'établissement de nouveaux rapports économiques avec la Russie (grand producteur de pétrole) ». Si le premier argument est tout à fait valable, le second, en revanche, est plutôt faible : franchement, les antagonismes entre l'Allemagne et les États-Unis vont bien au delà de la question de savoir qui pourra bénéficier des réserves de pétrole de la Russie.
En mars, et on a envie de dire “enfin” (le mur de Berlin s'est écroulé depuis un an et demi...), BC annonce qu'avec « l'écroulement de l'empire russe, le monde entier sera entraîné dans une situation d'incertitude sans précédent ». La guerre du Golfe a engendré de nouvelles tensions, l'instabilité devient la règle. Dans l'immédiat, la guerre se poursuit dans le Golfe avec le maintien des USA dans la zone. Mais ce qui est considéré comme une source de conflits, ce sont les rivalités autour de la gigantesque “affaire” que serait la reconstruction du Koweït. C'est ce qui s'appelle regarder le monde par le petit bout de la lorgnette : les enjeux de la guerre du Golfe étaient d'une autre dimension que le petit émirat, ou que les marchés de sa reconstruction.
Dans le numéro de Prometeo (revue théorique de BC) de novembre 91, un article est consacré à l'analyse de la situation mondiale après la “fin de la guerre froide”. Cet article montre que le bloc de l'Est ne peut plus jouer le même rôle qu'auparavant et que le bloc de l'ouest, lui-même, vacille. L'article fait le point sur la guerre du Golfe et réaffirme que c'était une guerre pour le pétrole et le contrôle de la “rente pétrolière”. Cependant, il poursuit : « Mais cela en tant que tel, ne suffit pas à expliquer le déploiement colossal de forces et le cynisme criminel avec lesquels les USA ont pilonné l'Irak. Aux raisons économiques fondamentales, et à cause de celles ci, on doit ajouter des motifs politiques. En substance, il s'agissait pour les USA d'affirmer leur rôle hégémonique grâce à l'instrument de base de la politique impérialiste (l'exhibition de la force et de la capacité de destruction) aussi face aux alliés occidentaux, appelés tout simplement à coopérer dans la coalition de tous contre Saddam ». Ainsi, même si elle s'accroche encore à “l'analyse du pétrole”, BC commence à percevoir, avec un an de retard cependant, les véritables enjeux de la guerre du Golfe. Il n'est jamais trop tard pour bien faire !
Dans ce même article, la troisième guerre mondiale paraît toujours inévitable, mais, d'une part, « la reconstruction de nouveaux fronts est en cours selon des axes encore confus » et d'autre part, il manque encore « la grande farce qui devra justifier aux yeux des peuples la conduite de nouveaux massacres entre les États centraux, aujourd'hui si unis et solidaires en apparence ».
L'émotion de la guerre du Golfe passée, la troisième guerre mondiale commencée le 17 janvier devient seulement la perspective qui est devant nous. Après s'être mouillée imprudemment au début de 1991, BC a décidé, sans le dire, d'ouvrir un grand parapluie. Cela lui évite d'avoir à examiner, de façon précise, dans quelle mesure cette perspective est en train de se concrétiser dans l'évolution mondiale et notamment dans les conflits qui embrasent le monde et l'Europe même. En particulier, le lien entre le chaos qui se développe dans le monde et les affrontements impérialistes est loin d'être analysé comme le CCI a essayé de le faire, pour sa part. (<!--[if !supportFootnotes]-->[3]<!--[endif]--> [1040])
En général les groupes du milieu prolétarien ne pouvaient pas ne pas voir le chaos grandissant et ils en font même des descriptions très justes, mais on chercherait en vain dans leurs analyses quelles sont les tendances à l'oeuvre, soit dans le sens d'une aggravation du chaos, indépendamment même des conflits impérialistes, soit dans le sens de l'organisation de la société en vue de la guerre.
Ainsi, en novembre 91, Programma Comunista (PC) n° 6, dans un long article, affirme que les vrais “responsables” de ce qui arrive en Yougoslavie « ne doivent pas être cherchés à Ljubljana ou à Belgrade, mais, le cas échéant, dans les capitales des nations plus développées. En Yougoslavie s'affrontent en réalité par personnes interposées, les exigences, les nécessités, les perspectives du marché européen. Ce n'est que si on voit dans la guerre intestine un aspect de la lutte pour la conquête des marchés, en tant que contrôle financier de vastes régions, qu'exploitation de zones économiques, que nécessité des pays plus avancés du point de vue capitaliste, de trouver toujours de nouveaux débouchés économiques et militaires, ce n'est qu'ainsi qu'aux yeux des travailleurs n'apparaîtra plus "justifiée" une lutte pour se libérer du "bolchevik Milosevic" ou de l'''oustachi Tudjman" ».
En mai 92, dans PC n° 3, l'article “Dans le marais du nouvel ordre social capitaliste” fait un constat lucide des tendances au “chacun pour soi” et du fait que le « Nouvel ordre mondial n'est que l'arène d'une explosion de conflits à jet continu », que « l'émiettement de la Yougoslavie a été autant un effet qu'un facteur de la grande poussée expansionniste de l'Allemagne ». Dans le numéro suivant, PC reconnaît que « une fois de plus, on assiste à la tentative américaine de faire valoir l'ancien droit de préemption sur les possibilités de défense (ou d'autodéfense) européenne, conféré à Washington à la fin de la deuxième guerre mondiale, et d'une tentative analogue (en sens inverse) de l'Europe, ou au moins de l'Europe "qui compte", d'affirmer son propre droit à agir par elle même, ou – si vraiment elle ne peut pas faire plus – à ne pas dépendre totalement dans chaque mouvement de la volonté des USA ». On trouve donc, dans cet article, les éléments essentiels de compréhension des affrontements en Yougoslavie: le chaos résultant de l'effondrement des régimes staliniens d'Europe et du bloc de l'Est, l'aggravation des antagonismes impérialistes divisant les grandes puissances occidentales.
Malheureusement, PC ne sait pas se maintenir sur cette analyse correcte. Dans le numéro d'après (septembre 92), alors qu'une partie de la flotte américaine basée en Méditerranée croise au large des côtes yougoslaves, on a une nouvelle version : « Il y a deux ans que la guerre fait rage en Yougoslavie : les USA manifestent à l'égard de celle-ci la plus souveraine des indifférences; la CEE se donne bonne conscience avec l'envoi d'aides humanitaires et de quelques contingents armés pour les protéger et avec la convocation de rencontres périodiques, ou plutôt de conférences de paix, qui laissent chaque fois les choses dans l'état où elles les trouvent. (...) Faut-il s'en étonner? Il suffit de penser à la course frénétique, après l'écroulement de l'empire soviétique, des marchands occidentaux, en particulier austro-allemands, pour accaparer la souveraineté économique, et donc aussi politique, sur la Slovénie et, si possible, sur la Croatie ». Ainsi, après avoir fait un pas en direction d'une clarification, PC en revient au thème du “business”, cher au milieu politique prolétarien, pour expliquer les grands enjeux impérialistes de la période actuelle.
C'est sur ce même thème que BC intervient à propos de la guerre en Yougoslavie, pour nous expliquer à longueur de pages les raisons économiques qui ont poussé les différentes fractions de la bourgeoisie yougoslave à vouloir s'assurer par les armes « ces quotas de plus-value qui allaient auparavant à la Fédération ». « Le morcellement de la Yougoslavie faisait le jeu surtout de la bourgeoisie allemande d'une part et italienne de l'autre. Et même les destructions d'une guerre peuvent rendre service quand il s'agit ensuite de reconstruire : adjudications lucratives, commandes juteuses qui, ma foi, commencent à se faire rare en Italie ou en Allemagne ». « C'est pourquoi, en contradiction avec les principes de la maison commune européenne, les États de la CEE ont reconnu le "droit des peuples". En même temps, ils ont mis en route leurs opérations économiques : l'Allemagne en Croatie et, en partie, en Slovénie, l'Italie en Slovénie. Parmi les opérations, la vente d'armes et l'approvisionnement en munitions consommées pendant la guerre ». Bien sûr, souligne BC, çà ne plaît pas trop aux USA qui ne voient pas d'un bon oeil les pays européens se renforcer. (BC n° 7/8, juillet-août 92).
On ne peut manquer de s'interroger sur les “fabuleuses affaires” que le capitalisme pourrait réaliser en Yougoslavie, dans un pays qui s'est écroulé en même temps que l'empire russe et qui est, de plus, ravagé par la guerre. On avait déjà eu les “grandes affaires” de la reconstruction du Koweït, à l'horizon se profilent celles de la “reconstruction de la Yougoslavie”, avec, en prime, une flèche décochée aux ignobles marchands de canon, fauteurs de guerre.
On ne peut pas continuer l'énumération chronologique des prises de position et des méandres du milieu politique prolétarien, ces exemples étant suffisamment parlants et affligeants en eux-mêmes. Le prolétariat ne peut se contenter pour mener son combat quotidien d'actes de foi du style : « A travers des secousses continues, et nous ne savons pas quand, nous arriverons à l'aboutissement que la théorie marxiste et l'exemple de la révolution russe nous indiquent » (Programma). On ne peut même pas saluer le fait que la plupart des organisations du milieu identifient les nouveaux “fronts” potentiels d'une troisième guerre mondiale autour de l'Allemagne d'une part et des USA de l'autre. Comme une montre arrêtée, cela fait des décennies qu'elles voient comme seul possible la situation qui prévalait à l'éclatement des deux premières guerres mondiales. Il se trouve qu'après l'effondrement du bloc de l'est, la situation tend à se présenter comme cela, mais c'est, en quelque sorte, par hasard que ces organisations donnent “l'heure juste” aujourd'hui : une montre arrêtée en fait de même deux fois par jour, mais elle ne sert à rien ! Les raisons de ce bouleversement de l'histoire, la perspective ouverte – ou non – de la troisième guerre mondiale sont floues ou totalement ignorées. Qui plus est, les tentatives d'explication données au déchaînement des guerres, quand elles ne sont pas carrément incohérentes et variables d'un mois à l'autre, sont quasiment surréalistes et dénuées de toute vraisemblance. Comme le dit Programma, c'est bien la théorie marxiste qui doit nous guider, qui doit nous servir de boussole pour comprendre comment évolue le monde que nous devons changer et, notamment, quels sont les enjeux de la période. Malheureusement, pour la plupart des organisations du milieu politique, le marxisme, tell qu'elles l'entendent, ressemble à une boussole rendue folle par la proximité d'un aimant.
En réalité, à l'origine de la désorientation qui afflige ces groupes on trouve, pour une bonne part, une incompréhension de la question du cours historique, c'est-à-dire du rapport de forces entre les classes qui détermine le sens d'évolution de la société plongée dans la crise insoluble de son économie : ou bien l'aboutissement bourgeois, la guerre mondiale, ou bien la réponse prolétarienne, l'intensification des combats de classe devant déboucher sur une période révolutionnaire. L'histoire des fractions révolutionnaires à la veille de la deuxième guerre mondiale nous a montré que l'affirmation des principes de base ne suffit pas, que la difficulté à comprendre autant la question du cours que celle de la nature de la guerre impérialiste a profondément secoué et plus ou moins paralysé celles-ci (<!--[if !supportFootnotes]-->[4]<!--[endif]--> [1041]). Pour aller à la racine des incompréhensions du milieu politique, il nous faut donc revenir, une fois de plus, sur la question du cours historique et des guerres en période de décadence.
Le cours historique
Il est pour le moins surprenant que BC qui se refusait à voir la possibilité d'une troisième guerre mondiale tant qu'il y avait des blocs militaires constitués, annonce celle-ci comme imminente dès qu'un des deux blocs s'est effondré. Les incompréhensions de BC sont à la base de cette volte-face. Le CCI avait déjà, à plusieurs reprises (Revue Internationale n°50 et 59), démontré la faiblesse des analyses de cette organisation et insisté sur le risque d'en arriver à éliminer toute perspective historique.
Depuis la fin des années 60, l'écroulement de l'économie capitaliste ne pouvait que pousser la bourgeoisie vers une nouvelle guerre mondiale et ceci d’autant plus que les blocs impérialistes étaient déjà constitués. Depuis plus de deux décennies, le CCI défend le fait que la vague de luttes ouvrières qui a débuté en 1968 marque une nouvelle période dans le rapport de forces entre les classes, l'ouverture d'un cours historique de développement des luttes prolétariennes. Pour envoyer le prolétariat à la guerre, le capitalisme a besoin d'une situation caractérisée par « l'adhésion croissante des ouvriers aux valeurs capitalistes et une combativité qui tend soit à disparaître, soit apparaît au sein d'une perspective contrôlée par la bourgeoisie » (Revue Internationale n°30, “Le cours historique”).
Face à la question : « Pourquoi la troisième guerre mondiale ne s'est-elle pas déclenchée alors que toutes ses conditions objectives sont présentes ? », le CCI a mis en avant, depuis le début de la crise ouverte du capitalisme, le rapport de forces entre les classes, l'incapacité pour la bourgeoisie de mobiliser le prolétariat des pays avancés derrière les torchons nationalistes. Quelle réponse apportait BC qui, par ailleurs, reconnaissait que « au niveau objectif, sont présentes toutes les raisons pour le déclenchement d'une nouvelle guerre généralisée » ? Se refusant à prendre en considération la question du cours historique, cette organisation nous servait toutes sortes “d'analyses” : La crise économique n'aurait pas été suffisamment développée (ce qui contredisait son affirmation sur la présence de toutes les “raisons objectives”), le cadre des alliances encore « assez fluide et plein d'inconnues » et enfin, les armements auraient été... trop développés, trop destructeurs. Le désarmement nucléaire aurait constitué une des conditions nécessaires pour que la guerre mondiale puisse éclater. Nous avons répondu en leur temps à ces arguments.
La réalité d'aujourd'hui confirme-t-elle l'analyse de BC pour qu'elle nous annonce qu'on va, cette fois, vers la guerre mondiale ?
La crise n'était pas assez développée ? À cette époque, nous mettions en garde BC contre la sous-estimation de la gravité de la crise mondiale. Or, si BC a reconnu que les difficultés de l'ex-bloc de l'Est étaient dues à la crise du système, pendant tout un temps, et contre toute vraisemblance, elle s'est illusionnée sur les opportunités ouvertes à l'Est, la “bouffée d'oxygène” qu'elles étaient sensées représenter pour le capitalisme international... ce qui ne l'empêchait pas, en même temps, de voir l'éclatement de la troisième guerre mondiale comme perspective de l'heure. Pour BC, lorsque la crise capitaliste s'atténue, la guerre mondiale devient plus proche : comme les voies du Seigneur, les méandres de la logique de BC sont impénétrables.
En ce qui concerne les armements, nous avions déjà montré en quoi cette affirmation manquait de sérieux, mais aujourd'hui que les armements nucléaires sont toujours présents et, qu'en outre, ils sont entre les mains d'un nombre supérieur d’États, la guerre mondiale deviendrait possible.
Lorsque le monde était entièrement divisé en deux blocs, le cadre des alliances, pour BC, était “fluide”. Aujourd'hui que ce partage a pris fin et que nous sommes encore loin d'un nouveau partage (même si la tendance à la reconstitution de nouvelles constellations impérialistes s'affirme de façon croissante) les conditions pour une nouvelle guerre mondiale seraient déjà mûres. Un peu de rigueur, camarades de BC !
Notre souci n'est pas de prétendre que BC dit en permanence n'importe quoi (bien que cela lui arrive aussi), mais bien de montrer que, malgré l'héritage du mouvement ouvrier (dont se revendique cette organisation), en l'absence de méthode, de prise en compte de l'évolution du capitalisme et du rapport de forces entre les classes, on en arrive à être incapable de fournir des orientations à la classe ouvrière. N'ayant pas compris la raison essentielle pour laquelle la guerre généralisée n'avait pas eu lieu dans la période précédente : la sortie de la contre-révolution, le cours historique aux affrontements de classe, n'étant pas capable, en conséquence, de constater que ce cours n'avait pas été remis en cause, puisque la classe ouvrière n'a pas subi de défaite décisive, BC nous annonce l'imminence d'une troisième guerre mondiale alors que les bouleversements de ces dernières années en ont justement éloigné la perspective.
C'est, en particulier, cette incapacité à prendre en compte le resurgissement de la classe ouvrière, à la fin des années 60, dans l'examen des conditions de l'éclatement de la guerre mondiale qui interdit de voir les réels enjeux de la période actuelle, le blocage de la société et son pourrissement sur pied. « Si le prolétariat avait la force d'empêcher le déchaînement d'une nouvelle boucherie généralisée, il n'avait pas encore celle de mettre en avant sa propre perspective : le renversement du capitalisme et l'édification de la société communiste. Ce faisant, il n'a pu empêcher la décadence capitaliste de faire sentir toujours plus ses effets sur l'ensemble de la société. Dans ce blocage momentané, l'histoire ne s'est pas arrêtée pour autant. Privée du moindre projet historique capable de mobiliser ses forces, même le plus suicidaire comme la guerre mondiale, la société capitaliste ne pouvait que s'enfoncer dans le pourrissement sur pied, la décomposition sociale avancée, le désespoir généralisé... Si on laisse le capitalisme en place, il finira, même en l'absence d'une guerre mondiale, par détruire définitivement l'humanité : à travers l'accumulation des guerres locales, des épidémies, des dégradations de l'environnement, des famines et autres catastrophes qu'on prétend “naturelles”. » (Manifeste du IXe Congrès du CCI).
BC n'a malheureusement pas l'apanage de cette méconnaissance complète des enjeux de la période qui s'est ouverte avec l'effondrement du bloc de l'Est. Le Prolétaire l'écrit clairement : « En dépit de ce qu'écrivent, non sans une certaine touche d'hypocrisie, certains courants politiques, sur l'effondrement du capitalisme, le "chaos", "la décomposition", etc., nous n'en sommes pas là. » En effet, « même s'il faut attendre des années pour détruire sa domination (du capitalisme), sa destinée reste tracée ». Que Le prolétaire ait besoin de se rassurer, c'est triste pour lui, mais qu'il masque au prolétariat la gravité des enjeux, c'est beaucoup plus grave.
En effet, si la guerre mondiale n'est pas à l'ordre du jour à l'heure actuelle, cela ne retire rien à la gravité de la situation. La décomposition de la société, son pourrissement sur pieds constitue une menace mortelle pour le prolétariat comme nous l'avons mis en évidence dans cette même revue (<!--[if !supportFootnotes]-->[5]<!--[endif]--> [1042]). Il est de la responsabilité des révolutionnaires de mettre leur classe en garde contre cette menace, de lui dire clairement que le temps est compté et que, si elle attend trop avant d'engager les combats en vue du renversement du capitalisme, elle risque d'être emportée par la putréfaction de ce système. Le prolétariat attend autre chose qu'une totale incompréhension de ces enjeux, voire une ironie stupide à leur propos, de la part des organisations qui se veulent constituer son avant-garde.
Décadence et nature des guerres
A la racine des incompréhensions des enjeux de la période actuelle par la plupart des groupes du milieu politique, il n'y a pas seulement l'ignorance de la question du cours historique. On trouve également une incapacité à comprendre toutes les implications de la décadence du capitalisme sur la question de la guerre. En particulier, on continue de penser que, à l'image du siècle dernier, la guerre continue d'avoir une rationalité économique. Même si, évidemment, c'est en dernière instance la situation économique du capitalisme décadent qui engendre les guerres, toute l'histoire de cette période nous montre à quel point, pour l'économie capitaliste elle-même (et pas seulement pour les exploités transformés en chair à canon) la guerre est devenue une véritable catastrophe, et pas seulement pour les pays vaincus. De ce fait, les antagonismes impérialistes et militaires ne sauraient recouvrir les rivalités commerciales existant entre les différents États.
Ce n'est pas par hasard si BC tendait à considérer le partage du monde entre le bloc de l'Est et celui de l'Ouest comme “fluide”, non achevé en vue de la guerre puisque les rivalités commerciales les plus importantes n'opposaient pas les pays de ces deux blocs mais les principales puissances occidentales. Ce n'est sans doute pas par hasard non plus si, aujourd'hui, les rivalités commerciales, éclatant au grand jour entre les États-Unis et les grandes puissances ex-alliées comme l'Allemagne ou le Japon, BC voit la guerre beaucoup plus proche. Comme les groupes qui ne reconnaissent pas la décadence du capitalisme, BC – qui n'en a pas vu toutes les implications – identifie guerres commerciales et guerres militaires.
La question n'est pas nouvelle et l'histoire s'est déjà chargée de donner raison à Trotsky lorsque, au début des années 20, il combattait la thèse majoritaire dans l'IC selon laquelle la deuxième guerre mondiale aurait pour têtes de blocs les États-Unis et la Grande-Bretagne, les grandes puissances commerciales concurrentes. Plus tard, la Gauche communiste de France devait, à la fin de la deuxième guerre mondiale, réaffirmer que « il existe une différence entre les deux phases ascendante et décadente de la société capitaliste et, partant, une différence de fonction de la guerre dans les deux phases respectives. (...) La décadence de la société capitaliste trouve son expression éclatante dans le fait que des guerres en vue du développement économique (période ascendante), l'activité économique se restreint essentiellement en vue de la guerre (période décadente)... La guerre prenant un caractère de permanence est devenue le mode de vie du capitalisme » (« Rapport sur la situation internationale », 1945, republié dans la Revue Internationale n° 59). Au fur et à mesure que le capitalisme s'enfonce dans sa crise, la logique du militarisme s'impose à lui de façon croissante, irréversible et incontrôlable, même si celui-ci n'est pas plus capable que les autres politiques de proposer la moindre solution aux contradictions économiques du système (<!--[if !supportFootnotes]-->[6]<!--[endif]--> [1043]).
En se refusant à admettre qu'entre le siècle dernier et le nôtre, les guerres ont changé de signification, en ne voyant pas le caractère de plus en plus irrationnel, suicidaire de la guerre, en voulant à tout prix voir dans la logique des guerres celle des guerres commerciales, les groupes du milieu politique prolétarien se privent de tout moyen de comprendre ce qui est réellement à l'oeuvre derrière les conflits où sont impliqués, ouvertement ou non, les grandes puissances et, plus généralement, dans l'évolution de la situation internationale. Au contraire, ils sont amenés à développer des positions à la limite de l'absurde sur la “course aux profits”, aux “gigantesques affaires” qu'offriraient aux pays développés des régions aussi ruinées, ravagées par la guerre que la Yougoslavie, la Somalie, etc. Alors que la guerre est une des questions les plus décisives qu'ait à affronter le prolétariat parce qu'il en est la principale victime, comme chair à canon et force de travail soumise à une exploitation sans précédent, mais aussi parce qu'elle est un des éléments essentiels de la prise de conscience de la faillite du capitalisme, de la barbarie dans laquelle il entraîne l'humanité, il est de la plus haute importance que les révolutionnaires fassent preuve du maximum de clarté. La guerre constitue « la seule conséquence objective de la crise, de la décadence et de la décomposition que le prolétariat puisse dès à présent limiter (à l'opposé des autres manifestations de la décomposition) dans la mesure où, dans les pays centraux, il n'est pas à l'heure actuelle embrigadé derrière les drapeaux nationalistes. » (« Militarisme et décomposition », Revue Internationale, n°64).
Le cours historique n'a pas changé (mais encore faut-il, pour s'en rendre compte, admettre qu'il existe des cours historiques différents suivant les périodes), la classe ouvrière, même si elle a été paralysée, déboussolée par les énormes bouleversements de ces dernières années, est de plus en plus contrainte de repartir à l'assaut, comme le démontrent les luttes de septembre-octobre en Italie. Le chemin va être long et difficile et ne pourra se faire sans que toutes les forces de la classe ouvrière ne soient mobilisées dans un combat dont les enjeux sont décisifs. La tâche des révolutionnaires est primordiale, sinon ils seront non seulement balayés par l'histoire mais porteront leur part de responsabilité dans l'anéantissement de toute perspective révolutionnaire.
Me.
<!--[endif]-->
<!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]--> [1044] Pour une analyse plus détaillée, on peut se reporter à l'article « Le vent d'Est et la réponse des révolutionnaires » dans la Revue Internationale n°61.
<!--[if !supportFootnotes]-->[2]<!--[endif]--> [1045] Pour le CCI, « il faut affirmer clairement que l'effondrement du bloc de l'est et les convulsions économiques des pays qui le constituaient n'augurent nullement une quelconque amélioration de la situation économique de la société capitaliste. La faillite économique des régimes staliniens, conséquence de la crise générale de l'économie mondiale, ne fait qu'annoncer et précéder l'effondrement des secteurs les plus développés de cette économie. (...) L'aggravation des convulsions de l'économie mondiale ne pourra qu'attiser les déchirements entre les différents États, y compris et de plus en plus sur le plan militaire. La différence avec la période qui vient de se terminer, c'est que ces déchirements et antagonismes, qui auparavant étaient contenus et utilisés par les deux grands blocs impérialistes, vont maintenant passer au premier plan. Ces rivalités et affrontements ne peuvent, à l'heure actuelle, dégénérer en un conflit mondial (même en supposant que le prolétariat ne soit plus en mesure de s'y opposer). En revanche, du fait de la disparition de la discipline imposée par la présence des blocs, ces conflits risquent d'être plus violents et plus nombreux, en particulier, évidemment, dans les zones où le prolétariat est le plus faible. » (« Après l'effondrement du bloc de l'est, déstabilisation et chaos », Revue Internationale n°60, février 1990). La réalité est venue amplement confirmer ces analyses.
<!--[if !supportFootnotes]-->[3]<!--[endif]--> [1046] Pour le CCI, la guerre du Golfe, « malgré l'ampleur des moyens mis en oeuvre, n'a pu que ralentir, mais sûrement pas inverser les grandes tendances qui s'affirmaient dès la disparition du bloc russe : la dislocation du bloc occidental, les premiers pas vers la constitution d'un nouveau bloc impérialiste dirigé par l'Allemagne, l'aggravation du chaos dans les relations impérialistes. La barbarie guerrière qui s'est déchaînée en Yougoslavie quelques mois après la fin de la guerre du Golfe constitue une illustration particulièrement irréfutable de ce dernier point. En particulier, les événements qui se trouvent à l'origine de cette barbarie, la proclamation de l'indépendance de la Slovénie et de la Croatie, s'ils sont eux-mêmes une manifestation du chaos et de l'exacerbation des nationalismes qui caractérisent l'ensemble des zones dirigées auparavant par les régimes staliniens, n'ont pu avoir lieu que parce que ces nations étaient assurées du soutien de la première puissance européenne, l'Allemagne). (...) L'action diplomatique de la bourgeoisie allemande dans les Balkans qui visait à lui ouvrir un débouché stratégique sur la Méditerranée via une Croatie "indépendante" sous sa coupe, constitue' le premier acte décisif de sa candidature à la direction d'un nouveau bloc impérialiste. » (« Résolution sur la situation internationale », Revue internationale n°70). « Consciente de la gravité de l'enjeu, la bourgeoisie américaine a tout fait, au delà de son apparente discrétion. pour contrer et briser, avec l'aide de l'Angleterre et des Pays-Bas, cette tentative de percée de l'impérialisme allemand. » (Revue Internationale n°68). On se reportera à la presse du CCI pour une analyse plus détaillée.
<!--[if !supportFootnotes]-->[4]<!--[endif]--> [1047] Le lecteur peut se référer à notre brochure Histoire de la Gauche Communiste d'Italie et au bilan tiré par la Gauche Communiste de France en 1945, publié dans la Revue Internationale n°59.
<!--[if !supportFootnotes]-->[5]<!--[endif]--> [1048] Voir en particulier « La décomposition du capitalisme » et « La décomposition, phase ultime de la décadence du capitalisme », respectivement dans les n°57 et 62 de la Revue Internationale.
<!--[if !supportFootnotes]-->[6]<!--[endif]--> [1049] Le lecteur pourra se reporter aux nombreux articles consacrés à ce sujet dans cette même revue (n°19, n°52, n°59).
Courants politiques:
- Gauche Communiste [49]
Approfondir:
Questions théoriques:
- Le cours historique [17]
Heritage de la Gauche Communiste:
Mémoires d'un révolutionnaire (A. Stinas, Grèce) : nationalisme et antifascisme
- 3690 reads
Les extraits du livre de A. Stinas, révolutionnaire communiste de Grèce ([1] [1050]), que nous publions ici, s'attaquent à la résistance antifasciste de la seconde guerre mondiale. Ils contiennent ainsi une impitoyable dénonciation de ce qui reste l'incarnation de la fusion de trois mystifications particulièrement meurtrières pour le prolétariat : la « défense de l'URSS », le nationalisme et « l'antifascisme démocratique ».
L'explosion des nationalismes dans ce qui fut l'URSS et son empire d'Europe de l'est, tout comme le développement de gigantesques campagnes idéologiques « antifascistes » dans les pays d'Europe Occidentale, en particulier, donnent à ces lignes, écrites à la fin des années 40, toute leur actualité ([2] [1051]).
Il est aujourd'hui de plus en plus difficile, pour l'ordre établi, de justifier idéologiquement sa domination. Le désastre que ses lois engendre le lui interdit. Mais face à la seule force capable de l'abattre et d'instaurer un autre type de société, face au prolétariat, la classe dominante dispose encore d'armes idéologiques capables de diviser son ennemi et de le maintenir soumis à des fractions nationales du capital. Le nationalisme et « l'antifascisme » sont, actuellement, en première ligne de cet arsenal contre-révolutionnaire de la bourgeoisie.
A. Stinas reprend ici l'analyse marxiste de Rosa Luxembourg sur la question nationale, en rappelant que dans le capitalisme, arrivé à sa phase l'impérialiste, «... la nation s'est acquittée de sa mission historique. Les guerres de libération nationale et les révolutions bourgeoises-démocratiques sont désormais vides de sens ». A partir de cette base il dénonce et détruit l'argumentation de tous ceux qui ont appelé à participer à la « résistance antifasciste » pendant la seconde guerre mondiale, sous prétexte que sa dynamique propre, « populaire » et « antifasciste » pouvait conduire à la révolution.
Stinas et l'UCI (Union Communiste Internationaliste) font partie de cette poignée de révolutionnaires qui, pendant la deuxième guerre mondiale, surent aller à contre-courant de tous les nationalismes, refusèrent de soutenir « la démocratie » contre le fascisme et d'abandonner l'internationalisme prolétarien au nom de « la défense de l'URSS. » ([3] [1052])
Peu connus, même dans le milieu révolutionnaire, en partie du fait que leurs travaux n'existaient qu'en langue grecque, il est utile de donner ici quelques éléments sur leur histoire.
Stinas appartenait à la génération des communistes qui connurent la grande période de la vague révolutionnaire internationale qui mit fin à la première guerre mondiale. Il resta fidèle toute sa vie aux espoirs soulevés par l'Octobre rouge de 1917 et par la révolution allemande de 1919. Membre du Parti communiste grec (dans une période où les Partis communistes n'étaient pas encore passés dans le camp bourgeois) jusqu'à son exclusion en 1931, il fut ensuite membre de l'Opposition léniniste, qui publiait l'hebdomadaire Drapeau du Communisme et qui se réclamait de Trotsky, symbole international de la résistance au stalinisme.
En 1933, Hindenburg donne le pouvoir à Hitler en Allemagne. Le fascisme y devient le régime officiel. Stinas soutient que la victoire du fascisme sonne le glas de l'Internationale communiste, tout comme le 4 août 1914 avait signé la mort de la 2e Internationale, que ses sections sont définitivement, et sans retour possible, perdues pour la classe ouvrière, que d'organes de lutte à l'origine, elles se sont muées en ennemies du prolétariat. Le devoir des révolutionnaires dans le monde entier est donc de constituer de nouveaux partis révolutionnaires, hors de l'Internationale et contre elle.
Un débat aigu provoque une crise dans l'organisation trotskiste, et Stinas la quitte, après avoir été en minorité. En 1935, il rejoignit une organisation, Le Bolchevik, qui s’était détachée de l’archéo-marxisme et devait constituer, à partir de celle-ci, une nouvelle organisation qui prit le nom d'Union communiste internationaliste. L'UCI était à l'époque la seule section reconnue en Grèce de la Ligue communiste internationaliste (LCI) - la 4e Internationale ne sera créée qu'en 1938.
L'UCI avait, dès 1937, rejeté le mot d'ordre, fondamental pour la 4e Internationale, de la « défense de l'URSS ». Stinas et ses camarades n'étaient pas arrivés à cette position à l'issue d'un débat sur la nature sociale de l'URSS, mais après l'examen critique des mots d'ordre et de la politique devant l'imminence de la guerre. L'UCI voulait supprimer tous les aspects de son programme par lesquels le social-patriotisme pouvait s'infiltrer, sous le couvert de la défense de l'URSS.
Durant la deuxième guerre impérialiste, Stinas, en internationaliste intransigeant, resta fidèle aux principes du marxisme révolutionnaire, tels que Lénine et Rosa Luxemburg les avaient formulés et appliqués pratiquement dans la première guerre mondiale.
L'UCI était, depuis 1934, la seule section du courant trotskyste en Grèce. Pendant toutes les années de la guerre et de l'occupation, isolé des autres pays, ce groupe était convaincu que tous les trotskistes luttaient comme lui, sur les mêmes idées et à contre-courant.
Les premières informations sur la position de l'Internationale trotskiste laissèrent Stinas et ses compagnons bouche bée. La lecture de la brochure française Les trotskystes dans la lutte contre les nazis leur apportait les preuves que les trotskistes avaient combattu les Allemands, comme tous les bons patriotes. Puis ils apprirent l'attitude honteuse de Cannon et du Socialist Workers Party aux USA.
La 4e Internationale dans la guerre, c'est-à-dire dans ces conditions qui mettent à l'épreuve les organisations de la classe ouvrière, était tombée en poussière. Ses sections, les unes ouvertement avec la « défense de la patrie », les autres sous couvert de la « défense de l'URSS », étaient passées au service de leurs bourgeoisies respectives et avaient contribué, à leur niveau, aux massacres.
L'UCI rompit, à l'automne 1947, tout lien politique et organisationnel avec la 4e Internationale. Dans les années qui suivirent, la pire période contre-révolutionnaire sur le plan politique, alors que les groupes révolutionnaires étaient réduits à de minuscules minorités et que beaucoup de ceux qui restaient fidèles aux principes de base de l'internationalisme prolétarien et de la révolution d'octobre étaient complètement isolés, Stinas deviendra le principal représentant en Grèce du courant Socialisme ou Barbarie. Ce courant, qui ne parvint jamais à clarifier la nature sociale pleinement capitaliste des rapports sociaux en URSS, développant la théorie d'une sorte de troisième système d'exploitation fondé sur une nouvelle division, entre « dirigeants » et « dirigés », s'écarta de plus en plus du marxisme et finit par se disloquer dans les années 1960. A la fin de sa vie, Stinas n'eut plus de véritable activité politique organisée. Il se rapprocha des anarchistes et mourut en 1987.
CR.
Marxisme et nation
La nation est le produit de l'histoire, comme la tribu, la famille, la cité. Elle a un rôle historique nécessaire et devra disparaître une fois celui-ci rempli.
La classe porteuse de cette organisation sociale est la bourgeoisie. L'Etat national se confond avec l'Etat de la bourgeoisie et, historiquement, l'oeuvre progressiste de la nation et du capitalisme se rejoignent : créer, avec le développement des forces productives, les conditions matérielles du socialisme.
Cette oeuvre progressiste prend fin à l'époque de l'impérialisme, des grandes puissances impérialistes, avec leurs antagonismes et leurs guerres.
La nation s'est acquittée de sa mission historique. Les guerres de libération nationale et les révolutions bourgeoises-démocratiques sont désormais vides de sens.
La révolution prolétarienne est maintenant à l’ordre du jour. Elle n'engendre ni ne maintient mais abolit les nations et les frontières et unit tous les peuples de la terre dans une communauté mondiale. La défense de la nation et de la patrie n’est à notre époque rien d’autre que la défense de l’impérialisme, du système social qui provoque les guerres, qui ne peut vivre sans guerre et qui mène l'humanité au chaos et à la barbarie. C'est vrai aussi bien pour les grandes puissances impérialistes que pour les petites nations, dont les classes dirigeantes sont et ne peuvent être que les complices et les associés des grandes puissances.
« Le socialisme est à cette heure le seul espoir de l'humanité. Au-dessus des remparts du monde capitaliste qui s'écroulent enfin, brillent en lettres de feu ces mots du Manifeste communiste : socialisme ou chute dans la barbarie. » (R. Luxemburg, 1918)
Le socialisme est l'affaire des ouvriers du monde entier, et le terrain de son édification, toute l'étendue du globe terrestre. La lutte pour le renversement du capitalisme et pour l'édification du socialisme unit tous les ouvriers du monde. La géographie y fixe une répartition des tâches : l'ennemi immédiat des ouvriers de chaque pays est leur propre classe dirigeante. C'est leur secteur du front international de lutte des ouvriers pour renverser le capitalisme mondial.
Si les masses travailleuses de chaque pays n'ont pas pris conscience qu'elles ne forment que la section d'une classe mondiale, jamais elles ne pourront s'engager sur le chemin de leur émancipation sociale.
Ce n'est pas le sentimentalisme qui fait de la lutte pour le socialisme, dans un pays donné, la partie intégrante de la lutte pour la société socialiste mondiale, mais l'impossibilité du socialisme dans un seul pays. Le seul « socialisme» aux couleurs nationales et à l'idéologie nationale que nous a donné l'histoire est celui de Hitler, et le seul « communisme » national, celui de Staline.
La lutte à l'intérieur du pays contre la classe dirigeante et la solidarité avec les masses travailleuses du monde entier, tels sont à notre époque les deux principes fondamentaux du mouvement des masses populaires pour leur libération économique, politique et sociale. Cela vaut pour la « paix » comme pour la guerre.
La guerre entre les peuples est fratricide. La seule guerre juste est celle des peuples qui fraternisent par-delà les nations et les frontières contre leurs exploiteurs. La tâche des révolutionnaires, en temps de « paix » comme en temps de guerre, est d'aider les masses à prendre conscience des fins et des moyens de leur mouvement, à se débarrasser de la tutelle des bureaucraties politiques et syndicales, à prendre leurs propres affaires en mains, à ne faire confiance à d'autre «direction» que celle des organes exécutifs qu'elles ont elles-mêmes élus et qu'elles peuvent révoquer à tout moment, à acquérir la conscience de leur propre responsabilité politique et, d'abord et surtout, à s'émanciper intellectuellement de la mythologie nationale et patriotique.
Ce sont les principes du marxisme révolutionnaire tels que Rosa Luxemburg les a formulés et appliqués pratiquement et qui ont guidé sa politique et son action dans la Première Guerre mondiale. Ces principes ont guidé notre politique et notre action dans la Seconde Guerre mondiale.(...)
La résistance anti-fasciste : un appendice de l'impérialisme
Le « mouvement de résistance », c'est-à-dire la lutte contre les Allemands sous toutes ses formes, du sabotage à la guerre de partisans, dans les pays occupés, ne peut s'envisager hors du contexte de la guerre impérialiste, dont elle est partie intégrante. Son caractère progressiste ou réactionnaire ne peut être déterminé ni par la participation des masses, ni par ses objectifs antifascistes ni par l'oppression par l'impérialisme allemand, mais en fonction du caractère soit réactionnaire soit progressiste de la guerre.
L'ELAS comme l'EDES ([4] [1053]) étaient des armées qui continuèrent, à l'intérieur du pays, la guerre contre les Allemands et les Italiens. Cela seul détermine strictement notre position à leur égard. Participer au mouvement de résistance, quels que soient les mots d'ordre et les justifications, signifie participer à la guerre.
Indépendamment des dispositions des masses et des intentions de leur direction, ce mouvement, en raison de la guerre qu'il a conduite dans les conditions du second massacre impérialiste, est l'organe et l'appendice du camp impérialiste allié. (...)
Le patriotisme des masses et leur attitude à l'égard de la guerre, si contraire à leurs intérêts historiques, sont des phénomènes très connus depuis la guerre précédente, et Trotsky, dans une foule de textes, avait inlassablement prévenu du danger que les révolutionnaires soient surpris et qu'ils se laissent entraîner par le courant. Le devoir des révolutionnaires internationalistes est de se tenir au-dessus du courant, et de défendre contre le courant, les intérêts historiques du prolétariat. Ce phénomène ne s'explique pas seulement par les moyens techniques utilisés, la propagande, la radio, la presse, les défilés, l'atmosphère d'exaltation créée au début de la guerre, mais aussi par l'état d'esprit des masses, qui résulte de l'évolution politique antérieure, des défaites de la classe ouvrière, de son découragement, de la ruine de sa confiance en sa propre force et dans les moyens d'action de la lutte des classes, de la dispersion du mouvement international et de la politique opportuniste de sape menée par ses partis. Il n'existe aucune loi historique fixant le délai au bout duquel les masses, d'abord entraînées dans la guerre, finiraient par se ressaisir. Ce sont les conditions politiques concrètes qui éveillent la conscience de classe. Les conséquences horribles de la guerre pour les masses font disparaître l'enthousiasme patriotique. Avec la montée du mécontentement, leur opposition aux impérialistes et à leurs propres dirigeants, qui en sont les agents, s'approfondit sans cesse et réveille leur conscience de classe. Les difficultés de la classe dirigeante augmentent, la situation évolue vers la rupture de l'unité intérieure, l'écroulement du front intérieur et la révolution. Les révolutionnaires internationalistes contribuent à l'accélération des rythmes de ce processus objectif par la lutte intransigeante contre toutes les organisations patriotiques et social-patriotiques, ouvertes ou cachées, par l'application conséquente de la politique du défaitisme révolutionnaire.
Les suites de la guerre, dans les conditions de l'Occupation, ont eu une influence entièrement différente sur la psychologie des masses et leurs relations avec leur bourgeoisie. Leur conscience de classe a sombré dans la haine nationaliste, constamment renforcée par le comportement barbare des Allemands, la confusion s'est aggravée, l'idée de la nation et de son destin a été placées au-dessus des différences sociales, l'union nationale s'est renforcée, et les masses se sont davantage soumises à leur bourgeoisie, représentée par les organisations de résistance nationale. Le prolétariat industriel, brisé par les défaites précédentes, son poids spécifique exceptionnellement diminué, s'est trouvé prisonnier de cette situation effrayante pendant toute la durée de la guerre.
Si la colère et le soulèvement des masses contre l'impérialisme allemand dans les pays occupés étaient «justes», ceux des masses allemandes contre l'impérialisme allié, contre les bombardements barbares des quartiers ouvriers l'étaient tout autant. Mais cette colère justifiée, qui est renforcée par tous les moyens par les partis de la bourgeoisie de toute nuance, seuls les impérialistes peuvent l'exploiter et l'utiliser pour leurs propres intérêts. La tâche des révolutionnaires restés au-dessus du courant est de diriger cette colère contre «leur» bourgeoisie. Seul ce mécontentement contre notre « propre » bourgeoisie peut devenir une force historique, le moyen de débarrasser une fois pour toute l'humanité des guerres et des destructions.
Du moment que le révolutionnaire, dans la guerre, fait simplement allusion à l'oppression par l'impérialisme « ennemi » dans son propre pays, il devient victime de la mentalité nationaliste étroite et de la logique social-patriotique, et coupe les liens qui unissent la poignée des ouvriers révolutionnaires qui sont restés fidèles à leur drapeau dans les différents pays, dans l'enfer où le capitalisme en décomposition a plongé l'humanité. (...)
La lutte contre les nazis dans les pays occupés par l'Allemagne était une tromperie et un des moyens qu'utilisa l'impérialisme allié pour tenir les masses enchaînées à son char de guerre. La lutte contre les nazis était la tâche du prolétariat allemand. Mais elle n'était possible que si les ouvriers de tous les pays combattaient contre leur propre bourgeoisie. L'ouvrier des pays occupés qui combattait les nazis combattait pour le compte de ses exploiteurs, pas pour le sien, et ceux qui l'ont entraîné et poussé dans cette guerre étaient, quels que soient leurs intentions et leurs justifications, des agents des impérialistes. L'appel aux soldats allemands à fraterniser avec les ouvriers des pays occupés dans la lutte commune contre les nazis était, pour le soldat allemand, un artifice trompeur de l'impérialisme allié. Seul l'exemple de la lutte du prolétariat grec contre sa « propre » bourgeoisie qui, dans les conditions de l'Occupation, signifiait lutter contre les organisations nationalistes, aurait pu réveiller la conscience de classe des ouvriers allemands enrégimentés et rendre possible la fraternisation, et la lutte du prolétariat allemand contre Hitler.
L'hypocrisie et la tromperie sont des moyens aussi indispensables à la conduite de la guerre que les tanks, les avions ou les canons. La guerre n'est pas possible sans la conquête des masses. Mais pour les conquérir, il faut qu'elles croient combattre pour la défense de leurs biens. Tous les mots d'ordre, toutes les promesses de « libertés, prospérité, écrasement du fascisme, réformes socialistes, république populaire, défense de l'URSS etc. », visent ce but. Ce travail est surtout réservé aux partis « ouvriers », qui utilisent leur autorité, leur influence, leurs liens avec les masses travailleuses, les traditions du mouvement ouvrier pour qu'elles se laissent mieux tromper et égorger. Les illusions des masses sur la guerre, sans lesquelles elle est impossible, ne la rendent pas pour autant progressiste, et seuls les plus hypocrites social-patriotes peuvent s'en servir pour la justifier. Toutes les promesses, toutes les proclamations, tous les mots d'ordre des PS et des PC dans cette guerre n'ont été que des leurres. (...)
La transformation d'un mouvement en combat politique contre le régime capitaliste ne dépend pas de nous et de la force de conviction de nos idées mais de la nature même de ce mouvement. «Accélérer et faciliter la transformation du mouvement de résistance en mouvement de lutte contre le capitalisme» aurait été possible si ce mouvement, dans son développement, avait pu de lui-même créer en permanence, à la fois dans les rapports des classes, les consciences et dans la psychologie des masses des conditions plus favorables à sa transformation en lutte politique générale contre la bourgeoisie, donc en révolution prolétarienne.
La lutte de la classe ouvrière pour ses revendications économiques et politiques immédiates peut se transformer, au cours de sa croissance, en lutte politique d'ensemble pour renverser la bourgeoisie. Mais elle est rendue possible par la forme même de cette lutte : les masses, par leur opposition à leur bourgeoisie et son Etat et par la nature de classe de leurs revendications, se débarrassent de leurs illusions nationalistes, réformistes et démocratiques, se libèrent de l'influence des classes ennemies, développent leur conscience, leur initiative, leur esprit critique, leur confiance en elles-mêmes. Avec l'extension du champ de la lutte, les masses sont toujours plus nombreuses à y participer, et plus profondément est creusé le sol social, plus les fronts de classe se distinguent strictement et plus le prolétariat révolutionnaire devient l'axe principal des masses en lutte. L'importance du parti révolutionnaire est énorme à la fois pour accélérer les rythmes, pour la prise de conscience, pour l'assimilation de l'expérience, la compréhension de la nécessité de la prise révolutionnaire du pouvoir par les masses, pour organiser le soulèvement et en assurer la victoire. Mais c'est le mouvement lui-même, de par sa nature et sa logique interne, qui donne sa force au parti. C'est un processus objectif dont la politique du mouvement révolutionnaire est l'expression consciente. La croissance du « mouvement de résistance » eut, également par sa nature même, le résultat exactement inverse : il ruina la conscience de classe, renforça les illusions et la haine nationalistes, dispersa et atomisa encore plus le prolétariat dans la masse anonyme de la nation, le soumit encore plus à sa bourgeoisie nationale, porta à la surface et à la direction les éléments les plus farouchement nationalistes.
Aujourd'hui, ce qui reste du mouvement de résistance (la haine et les préjugés nationalistes, les souvenirs et les traditions de ce mouvement qui fut si habilement utilisé par les staliniens et les socialistes) est le plus sérieux obstacle à une orientation de classe des masses. S'il avait existé des possibilités objectives qu'il se transforme en lutte politique contre le capitalisme, celles-ci auraient dû se manifester sans notre participation. Mais nulle part nous n'avons vu une tendance prolétarienne surgir de ses rangs, même la plus confuse. (...)
Le déplacement des fronts et l'occupation militaire du pays, comme de presque toute l'Europe, par les armées de l'Axe, ne changent pas le caractère de la guerre, ne créent pas de question nationale et ne modifient pas nos objectifs stratégiques ni nos tâches fondamentales. La tâche du parti prolétarien dans ces conditions est d'aiguiser sa lutte contre les organisations nationalistes et de protéger la classe ouvrière de la haine antiallemande et du poison nationaliste.
Les révolutionnaires internationalistes participent aux luttes des masses pour leurs revendications économiques et politiques immédiates, tentent de leur donner une claire orientation de classe et s'opposent de toutes leurs forces à l'exploitation nationaliste de ces luttes. Au lieu de s'en prendre aux Italiens et aux Allemands, ils expliquent pourquoi la guerre a éclaté, guerre dont la barbarie dans laquelle nous vivons est la conséquence inévitable, dénoncent avec courage les crimes de leur « propre » camp impérialiste et de la bourgeoisie, représentée par les différentes organisations nationalistes, appellent les masses à la fraternisation avec les soldats italiens et allemands pour la lutte commune pour le socialisme. Le parti prolétarien condamne toutes les luttes patriotiques, si massives qu'elles soient et quelle que soit leur forme, et appelle ouvertement les ouvriers à s'en abstenir.
Le défaitisme révolutionnaire, dans les conditions de l'Occupation, rencontra des obstacles effrayants et jamais vus auparavant. Mais les difficultés ne peuvent changer nos tâches. Au contraire, plus le courant est fort, plus l'attachement du mouvement révolutionnaire à ses principes doit être rigoureux, plus il doit s'opposer au courant avec intransigeance. Seule cette politique le rendra capable d'exprimer les sentiments des masses révolutionnaires demain et de se trouver à leur tête. La politique de la soumission au courant, c'est-à-dire la politique du renforcement du mouvement de résistance, aurait ajouté un obstacle supplémentaire aux tentatives d'orientation de classe des ouvriers et aurait détruit le parti.
Le défaitisme révolutionnaire, la politique internationaliste juste contre la guerre et contre le mouvement de résistance, montre aujourd'hui, et montrera toujours plus , dans les événements révolutionnaires à venir, toute sa force et toute sa valeur.
A. Stinas
[1] [1054] Tirés de ses Mémoires d'un révolutionnaire. Cet ouvrage, qu'il écrivit dans la dernière période de sa vie, couvre essentiellement les événements des années 1912 à 1950 en Grèce, placées sous le signe de la guerre : des guerres balkaniques qui annoncent la première guerre impérialiste de 1914-18 à la guerre civile, prolongement du deuxième holocauste de 1939-45.
L'ironie de l'histoire veut que ce soit les éditions « La Brèche », liées à la IVe Internationale de Mandel, qui ont édité en français ces mémoires. Leur publication est certainement due à celui qui fut le « pape de la IVe Internationale» de 1943 à 1961, Pablo, et à son nationalisme, lui même étant grec. Car le livre dénonce sans ambiguïtés les agissements des trotskistes pendant la deuxième guerre mondiale et après.
[2] [1055] La Grèce, le pays de Stinas, est secoué, au moment où nous publions ce texte, par une vague de nationalisme orchestrée par le gouvernement et tous les grands partis «démocratiques». Ceux-ci ont, en décembre 1992, fait défiler un million de personnes dans les rues d'Athènes pour défendre le nom de Macédoine pour la province grecque contre la « reconnaissance » de la Macédoine dans l'ex-Yougoslavie en décomposition !
[3] [1056] Stinas ignora que d'autres groupes que le sien
défendirent la même attitude dans d'autres pays : les courants de la Gauche communiste : italienne (en France
et en Belgique en particulier), germano-hollandaise (le Communistenbond
Spartacus, en Hollande) ; des groupes en rupture avec le trotskisme, comme
celui de Munis, exilé au Mexique, ou les RKD, composé de militants autrichiens
et français.
[4] [1057] Noms des années de résistance, contrôlées essentiellement par les partis staliniens et socialistes.
Courants politiques:
- Gauche Communiste [49]
Approfondir:
- La question nationale [320]
Questions théoriques:
- Internationalisme [1058]
Heritage de la Gauche Communiste:
Revue Internationale no 73 - 2e trimestre 1993
- 3059 reads
Situation internationale : le nouveau désordre mondial du capitalisme
- 3906 reads
« The new world (dis)order », le nouveau (dés)ordre mondial, voilà comment la presse anglo-saxonne qualifie maintenant le « nouvel ordre mondial » que lègue l'ex-président Bush à son successeur. Le panorama est effrayant et catastrophique. La liste des malheurs qui frappent l'humanité, est longue. La presse bourgeoise et la télévision en rendent compte. Voudraient-elles cacher les faits, qu'elles ne le pourraient pas et se déconsidéreraient complètement. Mais, au service de l'idéologie bourgeoise, elles séparent les événements tragiques qui se multiplient, refusent de voir le lien, la racine commune, c'est-à-dire l'impasse historique du capitalisme et sa putréfaction, qui unit la multiplication des guerres impérialistes, l'aggravation brutale de la crise économique mondiale et les ravages qu'elle provoque. Reconnaître l'unité entre toutes ces caractéristiques du capitalisme d'aujourd'hui, reconnaître la concomitance de leur aggravation respective, met à nu la barbarie sans fin dans laquelle le capitalisme nous entraîne, le gouffre sans fond dans lequel il plonge l'espèce humaine.
La reconnaissance du lien, de la cause, et de l'unité entre ces différents éléments de la réalité du capital facilite aussi la prise de conscience des enjeux historiques qui se présentent à l'humanité. Il existe une alternative à la catastrophe irréversible, et une seule. Détruire la société capitaliste et en instaurer une autre, radicalement différente. Il existe une force sociale, et une seule, capable d'assumer une telle tâche. Le prolétariat qui est à la fois classe exploitée et classe révolutionnaire, est cette force. Lui seul peut mettre à bas le capital, en terminer avec toutes ces catastrophes, et faire naître le communisme où les hommes ne seront plus conduits à s'entretuer sauvagement et où ils pourront vivre en harmonie.
Les mots et les phrases sont de peu de poids pour dénoncer la barbarie et la multitude de conflits locaux meurtriers qui ensanglantent la planète. Pas un seul continent n'est épargné. Ces conflits ne sont pas le résultat de haines ancestrales qui les rendraient fatals, inévitables, ni d'une loi naturelle selon laquelle l'homme serait foncièrement mauvais, toujours en quête d'affrontements et de guerres. Cette dynamique barbare de chute dans la guerre impérialiste n’est pas une fatalité naturelle. Elle est produite par l’impasse historique dans laquelle se trouve le capitalisme. La décomposition qui frappe la société capitaliste, l'absence de perspective et d'espoir autres que celui de la survie individuelle, ou comme bandes armées, contre tous les autres, est responsable de l'explosion des guerres locales entre populations qui vivaient, pour la plupart, en bonne harmonie, ou cohabitaient, depuis des décennies ou des siècles.
La putréfaction du capitalisme est responsable des milliers de morts, des tueries, des viols et des tortures, des famines et des privations qui touchent les populations, les hommes, les femmes, les vieillards. Elle est responsable des millions de réfugiés terrorisés, obligés de quitter leur maison, leur village, leur région, sans doute pour toujours. Elle est responsable de la séparation des familles endeuillées, des enfants qu'on envoie ailleurs en espérant qu'ils échapperont à l'horreur, au massacre, à la mort, ou à l'enrôlement forcé, et qu'on ne reverra plus. Elle est responsable aussi du fossé de sang et de vengeances qui va séparer pour longtemps des peuples, des ethnies, des régions, des villages, des voisins, des parents. Elle est responsable du cauchemar quotidien dans lequel vivent des milliards d'êtres humains.
La décomposition du capitalisme est responsable aussi du rejet hors de la production capitaliste, et de toute production, de centaines de millions d'hommes et de femmes dans le monde, réduits à s'entasser dans les immenses bidonvilles des mégalopoles, les plus chanceux trouvant de temps en temps un travail surexploité qui parvient à peine à les nourrir (et encore) ; et les autres, poussés par la faim, obligés de mendier, de voler, de trafiquer, de fouiller dans les décharges publiques pour trouver leur pitance, inexorablement amenés à la délinquance, à la drogue et à l'alcool, poussés à abandonner ou vendre leurs enfants encore bébés qui sont achetés comme esclaves pour travailler dans les mines, dans les innombrables petits ateliers, ou bien contraints de se prostituer dès leur plus jeune âge. Le pire n'est-il pas la multiplication des enlèvements de gamins à qui l'on prélève des organes, qui un rein, qui un oeil, ou les deux, pour les revendre ? Comment s'étonner après, que cette déchéance matérielle et morale, qui touche des millions d'être humains, fournisse en quantité, des hommes, des adolescents, des mômes qui n'ont pas 10 ans, prêts à toutes les horreurs et infamies, « libres » de toute morale, de toute valeur, de tout respect, pour qui la vie des autres n'est rien puisque la leur n'est rien depuis leur plus jeune âge, prêts à devenir mercenaires de n'importe quelle armée, guérilla ou bande, dirigée par n'importe quel caïd, général, colonel, sergent, chef mafieux, s'abaissant à la torture, aux tueries, aux viols systématiques, au service du «nettoyage ethnique » et autres horreurs ?
Il y a une cause et un responsable à cette folie croissante : l'impasse historique du capitalisme.
La décomposition du capitalisme pousse aux guerres et aux conflits locaux
La décomposition du capitalisme est responsable des guerres effroyables qui se propagent dans le territoire de l'ex-URSS, au Tadjikistan, en Arménie, en Géorgie... Elle est responsable de la poursuite sans fin des affrontements entre milices, hier alliées, en Afghanistan, qui balancent à tour de rôle leurs missiles et leur obus à l'aveuglette sur Kaboul. Elle est responsable de la continuation de la guerre au Cambodge qui met le pays à feu et à sang. Elle est responsable de la propagation dramatique des guerres et des affrontements inter-ethniques sur tout le continent africain. Elle est responsable du renouveau des petites guerres, si l’on peut dire, entre armées, guérillas et mafias au Pérou, en Colombie, en Amérique centrale. Si les populations manquent de tout, ces bandes armées, étatiques ou non, ont des stocks considérables d'armes, provenant bien souvent de l'argent du trafic de drogue, en pleine expansion mondiale, qu'elles contrôlent et pratiquent elles-mêmes.
La décomposition du capitalisme est responsable de l'éclatement de la Yougoslavie et du chaos qui s'y est développé. Les ouvriers qui travaillaient dans les mêmes usines, qui luttaient et faisaient grève ensemble, au coude à coude, contre l'Etat capitaliste yougoslave, les paysans qui cultivaient les terres voisines, les enfants qui allaient à la même école, les nombreuses familles, fruits de mariages a mixtes »y sont aujourd'hui séparés par un abîme de sang, de tueries, de tortures, de viols, de vols.
« Les combats entre Serbes et Croates ont fait quelques 10 000 morts. Ceux qui se sont déroulés en Bosnie-Herzégovine plusieurs dizaine de milliers (le président bosniaque parle de 200 000), dont plus de 8 000 à Sarajevo. (...) Sur le territoire de l’ex-Yougoslavie, on estime à 2 millions le nombre de réfugiés et des victimes du "nettoyage ethnique". »([1] [1060])
Des millions d'hommes et de femmes, de familles, voient leur vie et leurs espoirs ruinés, sans retour en arrière possible. Sans aucune perspective sinon le désespoir, voire, pire, la vengeance aveugle.
Les antagonismes impérialistes exacerbent les conflits locaux
Il faut dénoncer avec force les mensonges de la bourgeoisie qui affirme que cette période de chaos est passagère. Elle serait le prix à payer pour la mort du stalinisme dans les pays de l'Est. Nous, communistes, disons que le chaos et les guerres vont encore se développer et se multiplier. La phase de décomposition du capitalisme ne meut offrir ni paix, ni prospérité, bien au contraire, elle exacerbe, encore plus que par le passé les appétits impérialistes de tous les Etats capitalistes qu'ils soient puissants ou faibles. Le « chacun pour soi » et le « tous contre tous » s'imposent à tous, petits ou grands. Il n'est pas un conflit dans lequel des intérêts impérialistes ne soient absents. La nature a horreur du vide, dit-on. Ainsi en va-t-il de l'impérialisme. Chacun, quelle que soit sa force, ne peut laisser une région, un pays « à sa portée» à l'abandon, sous peine de voir un rival s'en emparer. La logique infernale du capitalisme pousse inévitablement à l'intervention des différents impérialismes.
Aucun Etat, quel qu'il soit, grand ou petit, puissant ou faible, n'échappe à la logique implacable des rivalités et des affrontements impérialistes. Simplement, les pays les plus faibles, en essayant de défendre leurs intérêts particuliers au mieux, s'alignent comme ils peuvent, de gré ou de force, en fonction de l'évolution des grands antagonismes impérialistes mondiaux. Ils participent ainsi tous au développement ravageur des guerres locales.
Cette période de chaos n'est pas passagère. L'évolution des alignements impérialistes globaux autour des principales puissances impérialistes mondiales, telles les USA bien sûr, mais aussi l'Allemagne, le Japon, et, à des degrés moindres, la France, la Grande-Bretagne, la Russie ([2] [1061]), la Chine, met de l'huile sur le feu des guerres locales. En fait, c'est le coeur même du capitalisme mondial, particulièrement es vieilles puissances impérialistes occidentales, qui alimente le feu des affrontements et des guerres locales. C'est le cas en Afghanistan, dans les républiques asiatiques de l’ex-URSS, au Moyen-Orient, en Afrique tel en Angola, au Rwanda, en Somalie, et bien sûr en Yougoslavie.
En Yougoslavie, les difficultés croissantes de l'impérialisme américain pour imposer son leadership sur les autres puissances
L'ex-Yougoslavie est devenue le point central des rivalités impérialistes globales, le lieu où, à travers l'effroyable guerre qui s'y déroule, se cristallisent les principaux enjeux impérialistes de la période actuelle. Si l’impasse historique du capitalisme décadent, sa phase de décomposition, est responsable de l'éclatement de la Yougoslavie (tout comme de celui de l'URSS) et de l'aggravation des tensions entre les peuples qui en faisaient partie, ce sont les intérêts impérialistes des grandes puissances qui sont responsables de l'éclatement et de l'aggravation dramatique de la guerre. La reconnaissance de la Slovénie et de la Croatie par l'Allemagne a provoqué la guerre, comme le dit et le répète, non sans arrière-pensées, la presse anglo-saxonne. Les USA bien sûr, mais aussi la France et la Grande-Bretagne, ont sciemment poussé la Serbie, qui n'attendait que ça, à corriger militairement la Croatie. Et à partir de là, les intérêts impérialistes divergents des grandes puissances déjà citées, ont déterminé la chute dans la barbarie guerrière.
Les atrocités commises par les uns et les autres, et particulièrement l'horrible « nettoyage ethnique » dont les milices serbes se sont rendues coupables en Bosnie, sont cyniquement utilisées par la propagande médiatique des puissances occidentales pour justifier leurs interventions politiques, diplomatiques et militaires, et pour masquer leurs intérêts impérialistes divergents. En fait, derrière les discours humanitaires, les grandes puissances s'affrontent et entretiennent l'incendie tout en se faisant passer pour les pompiers.
Depuis la fin de la guerre froide et la disparition des blocs impérialistes qui l'a accompagnée, l'allégeance à l'impérialisme américain de la part de puissances comme l'Allemagne, la France et le Japon, pour ne citer que les plus hardies, a disparu inévitablement, un pays comme l'Allemagne est destiné à se poser en pôle, exerçant une attraction impérialiste alternative au pôle américain. Depuis la fin de la guerre du Golfe, ces puissances ont de plus en plus défendu leurs intérêts propres, remettant en cause le leadership US.
L'éclatement de la Yougoslavie et l'influence croissante de l'Allemagne dans la région, en Croatie particulièrement, donc sur la Méditerranée, représente un revers pour la bourgeoisie américaine, en termes stratégiques,([3] [1062]) et un mauvais exemple de ses capacités d'intervention politique, diplomatique et militaire. Tout le contraire de la leçon qu'elle avait administrée, à dessein, lors de la guerre du Golfe.
« Nous avons échoué » a affirmé Eagleburger, l'ex-secrétaire d'Etat (le ministre des Affaires étrangères) de Bush. «Depuis le début jusqu'à maintenant, je vous dis que je ne connais aucun moyen de stopper (la guerre), sinon au moyen d'un usage massif de la force militaire. » ([4] [1063]) Comment se fait-il que l'impérialisme américain, si prompt à utiliser une incroyable armada contre l'Irak il y a deux ans, n'ait pas eu recours jusqu'à maintenant à l'usage massif de la force militaire ?
Depuis l'été dernier, à chaque fois que les américains étaient sur le point d'intervenir militairement en Yougoslavie, quand ils voulaient bombarder les positions et les aéroports serbes, à chaque fois un grain de sable déposé à propos par les rivaux impérialistes européens, est venu enrayer la machine de guerre américaine. En juin dernier, le voyage de Mitterrand à Sarajevo, au nom de « l’ingérence humanitaire », a permis aux Serbes de débloquer l'aéroport tout en sauvant la face devant les menaces d'intervention US ; l'envoi de forces françaises et britanniques parmi les soldats de l'ONU, puis leur renforcement, puis les négociations du Plan Owen-Vance entre toutes les parties en conflit, ont enlevé les justifications et, surtout, affaibli considérablement les garanties de succès d'une intervention militaire US. Par contre, elles ont aggravé les combats et les massacres. Comme on l'a vu lors des négociations de Genève du Plan Owen-Vance mises à profit par les Croates pour relancer la guerre contre la Serbie en Krajina.
Les hésitations de la nouvelle administration Clinton pour appuyer le Plan Owen-Vance au nom de la CEE et de l'ONU, révèlent les difficultés américaines. Lee H. Hamilton, Président démocrate du Comité des affaires étrangères pour la Chambre des représentants résume bien le problème auquel se trouve confrontée la politique impérialiste US : «Le fait saillant ici est qu'aucun leader n'est prêt à intervenir massivement dans l’ex-Yougoslavie avec le genre de moyens que nous avons utilisé dans le Golfe pour repousser l'agression, et si vous n'êtes pas prêts à intervenir de cette façon, alors vous devez vous arranger avec des moyens plus faibles et travailler dans ce cadre. » ([5] [1064])
Suivant les conseils réalistes d'Hamilton, le gouvernement Clinton s'est rendu à la raison et a décidé finalement de soutenir le Plan Owen-Vance. Comme dans une partie de poker, il a aussitôt décidé de relancer la mise sur le terrain des convois humanitaires et d'envoyer son aviation parachuter des vivres aux populations affamées de Bosnie. ([6] [1065]) A l'heure où nous écrivons, les containers de nourritures largués dans la nature, n'ont toujours pas été retrouvés ! Apparemment, les parachutages «humanitaires» sont aussi précis que les bombes de la guerre «chirurgicale» en Irak. En revanche, ils ont eu comme résultat de relancer la guerre autour des villes assiégées. Le nombre de victimes augmente dramatiquement, les exactions se multiplient encore plus, et des milliers de vieillards, d'hommes, de femmes et d'enfants sont contraints à la fuite désespérée dans la neige et le froid, sous les bombardements, les tirs des « snippers » isolés. Mais, pour la bourgeoisie américaine, l'important est de pouvoir commencer à imposer sa présence militaire sur le terrain. D'ailleurs les rivaux ne s'y trompent pas. « Devant la recrudescence des combats et à titre humanitaire», bien sûr, les bourgeoisies allemande et russe parlent ouvertement d'intervenir à leur tour en participant au parachutage de vivres, et même à l'envoi de troupes sur le terrain. La population peut être inquiète, elle n'est pas au bout de son calvaire.
L'impérialisme mène aux affrontements militaires
Tous les propos des dirigeants américains le confirment : les Etats-Unis sont amenés de plus en plus à faire usage de la force militaire. Et donc à attiser les conflits et les guerres. Les campagnes humanitaires ont été la justification des démonstrations de force que les USA ont réalisées en Somalie et en Irak dernièrement. Ces démonstrations « humanitaires » avaient pour but de réaffirmer la puissance militaire US aux yeux du monde, et conséquemment l'impuissance européenne en Yougoslavie. Elles avaient aussi pour but de préparer l'intervention militaire en Yougoslavie vis-à-vis des autres impérialismes rivaux (ainsi qu'aux yeux de la population américaine). Comme on vient de le voir, le résultat n'a pas été à la hauteur de leurs espérances, jusqu'à présent. Par contre, la famine et les affrontements militaires entre fractions rivales se poursuivent en Somalie. Par contre, les tensions impérialistes régionales s'exacerbent au Moyen-Orient, et les populations kurdes et chiites continuent de subir la terreur des Etats de la région.
L'utilisation croissante de la carte militaire par l'impérialisme US a pour conséquence de pousser ses rivaux à développer leur propre force militaire. C'est le cas du Japon et de l'Allemagne qui veulent changer leurs Constitutions respectives, héritées de la défaite de 1945, qui limitent leur capacité d'intervention armée. Elle a pour conséquence aussi la montée de la rivalité entre les USA et l'Europe sur le plan militaire. Bien sûr la constitution du corps d'armée franco-allemand en a été une manifestation. En Yougoslavie, une véritable bataille politique est engagée pour savoir si «l'ingérence humanitaire » doit être réalisée sous commandement de l'ONU ou de l'OTAN. De manière plus générale, « une situation critique se développe entre le gouvernement de Bonn et l'OTAN » ([7] [1066]) ce qu'affirme aussi l'ancien Président français Giscard d'Estaing : « Quant à la défense, c'est le point de blocage des relations euro-américaines.» ([8] [1067])
L'hypocrisie répugnante de la bourgeoisie n'a pas de borne. Toutes les interventions militaires américaines, ou sous couvert de l'ONU, Somalie, Irak, Cambodge, Yougoslavie, se sont faites au nom de l'aide et de l'ingérence humanitaire. Elles ont toutes relancé et aggravé l'horreur, les guerres, les massacres, les réfugiés fuyant les combats, la misère et la famine. Elles ont aussi manifesté, et porté à un point plus élevé, les rivalités impérialistes entre petites, moyennes, et surtout grandes puissances. Toutes sont poussées à développer leurs dépenses d'armement, à réorganiser leurs forces militaires en fonction des nouveaux antagonismes. Telle est la signification réelle du «devoir d'ingérence humanitaire» que s'attribue la bourgeoisie, tels sont les résultats des campagnes sur l'humanitaire et la défense des droits de l'homme.
La décomposition et les rivalités impérialistes accrues sont le produit de l'impasse économique du capitalisme
A l'origine de l'impasse historique du capitalisme qui provoque la multiplication et l'horrible aggravation des tueries impérialistes, se trouve son incapacité à dépasser et à résoudre les contradictions insurmontables que rencontre son économie. La bourgeoisie est impuissante à résoudre la crise économique. S'inquiétant de l'avenir des habitants du Bangladesh, et du capital voilà comment un économiste bourgeois présente cette contradiction :
« Même si, par quelque miracle de la science (sic), on pouvait produire assez de nourriture pour qu'ils puissent manger, comment trouveraient-ils l'emploi rémunéré nécessaire pour l'acheter ? » ([9] [1068])
D'abord, quel culot ce type ! Affirmer aujourd'hui qu'il est impossible, sauf miracle dit-il, de nourrir la population du Bangladesh, (et nous, nous disons du monde entier) est scandaleuse. Et c'est le capital lui-même qui le prouve, en incitant et en payant les paysans des pays industrialisés pour qu'ils limitent leur production et mettent en jachère chaque fois plus de terres. Il n'y a pas sous-production, mais surproduction de biens. Ce n'est évidemment pas une surproduction de biens, de nourriture en particulier, par rapport aux besoins des hommes, mais, comme le souligne notre éminent professeur d'université, impuissant (car il ne peut résoudre la contradiction) et hypocrite (car il fait comme si elle n'existait pas en éliminant les capacités immenses de production), c'est une surproduction parce que la plus grande partie de la population mondiale ne peut acheter. Parce que les marchés sont saturés.
Aujourd'hui, le capitalisme mondial, c'est des millions d'être humains qui meurent faute de pouvoir se procurer de la nourriture, des milliards qui ont à peine de quoi manger alors que les principales puissances industrialisées, les mêmes qui dépensent des milliards de dollars pour leurs interventions militaires impérialistes, imposent à leurs paysans de diminuer leur production. Non seulement le capitalisme est barbare et meurtrier, mais en plus il est totalement absurde et irrationnel. D'un côté, surproduction qui oblige à fermer les usines, à laisser les terres cultivables à l'abandon, et des millions d'ouvriers sans travail, de l'autre des milliards d'individus sans ressources et torturés par la faim.
Le capitalisme ne peut plus surmonter cette contradiction comme il le faisait au siècle dernier en conquérant de nouveaux marchés. Il n'en reste plus sur la planète. Il ne peut pas non plus, pour le moment, s'engager dans la seule perspective qu'il puisse offrir à la société, une 3e guerre mondiale, comme il a pu le faire déjà à deux reprises depuis 1914, lors des deux guerres mondiales, au prix de plusieurs dizaines de millions de morts. D'une part, il n'y a plus de blocs impérialistes constitués nécessaires pour un tel holocauste depuis la disparition de l'URSS et du Pacte de Varsovie ; d'autre part la population, et tout spécialement le prolétariat, des principales puissances impérialistes d'Occident, n'est pas prête pour un tel sacrifice. Alors le capitalisme s'enfonce dans une situation sans issue dans laquelle il pourrit sur pied.
Dans ces conditions d'impasse historique, les rivalités économiques s'exacerbent autant que les rivalités impérialistes. La guerre commerciale s'aggrave tout comme les guerres impérialistes. Et la décomposition de l'URSS, qui a marqué une étape importante dans le développement dramatique du chaos généralisé au plan impérialiste, marque aussi une étape importante dans l'accélération de la concurrence entre toutes les nations capitalistes, et tout spécialement entre les grandes puissances: «Avec la chute de la menace soviétique, les inégalités et les conflits économiques entre les pays riches sont plus difficiles à maîtriser. »([10] [1069]) D'où l'impossibilité, jusqu'à maintenant, de clore les négociations du GATT, d'où les disputes et les menaces de protectionnisme entre les USA, l'Europe et le Japon.
Le capitalisme fait faillite et la guerre commerciale se déchaîne. La récession ravage jusqu'aux économies les plus fortes, les USA, l'Allemagne, le Japon, tous les Etats européens. Aucun pays n'est à l'abri. Elle oblige chacun à défendre avec acharnement ses intérêts. C'est un facteur supplémentaire de tensions entre les grandes puissances.
A partir de la décomposition du capitalisme, du chaos qui l'accompagne et, en particulier, à partir de l'explosion de l'URSS, les guerres impérialistes sont devenues plus sauvages, plus barbares et en même temps plus nombreuses. Aucun continent n'est épargné. De même, aujourd'hui, la crise économique prend un caractère plus profond, plus irréversible que jamais, plus dramatique, et elle touche tous les pays du globe. L'un et l'autre viennent aggraver dramatiquement la catastrophe généralisée que représente la survie du capitalisme. Chaque jour qui passe est une tragédie de plus pour des milliards d'êtres humains. Chaque jour qui passe est aussi un pas de plus vers la chute irréversible du capitalisme dans la destruction de l'humanité. Les enjeux sont terribles : chute définitive dans la barbarie, sans retour, ou bien révolution prolétarienne et ouverture de la perspective d'un monde dans lequel les hommes vivront en une communauté harmonieuse.
Ouvriers de tous pays, au combat contre le capitalisme !
RL, 4mars 1993.
Le réveil de la combativité ouvrière.
La crise économique pousse le prolétariat à lutter
La faillite économique du capitalisme a des conséquences terribles pour le prolétariat mondial. Les fermetures d'entreprises, les licenciements, se multiplient partout dans le monde. Et particulière ment, dans les principales puissances économiques et impérialistes, aux USA, en Europe occidentale, et même au Japon ; dans les secteurs centraux tels l'automobile, la construction d'avions, la sidérurgie, l'informatique, les banques et les assurances, les secteurs publics, etc. Juste pour donner une maigre illustration de ce qui est officiellement prévu : 30 000 licenciements à Volkswagen, 28 000 à Boeing, 40 000 dans la sidérurgie allemande, 25 000 à IBM alors qu'il y en a déjà eu 42 900 en 1992... Ces coupes massives dans les rangs des ouvriers actifs, s'accompagnent d'une baisse des salaires, de réductions drastiques du «salaire social », de la Sécurité sociale, des aides, allocations diverses, des retraites, etc. Les conditions de travail pour ceux qui ont encore «la chance» de travailler se détériorent gravement. Les allocations chômage pour les autres se réduisent considérablement, quand elles existent encore. Le nombre de sans-abri, de familles ouvrières réduites aux soupes populaires, de mendiants, explose dans tous les pays industrialisés. Les ouvriers d'Amérique du Nord et d'Europe occidentale souffrent de la paupérisation absolue comme, avant eux, leurs frères de classe des pays dits du «tiers-monde» et d'Europe de l'Est.
Tout comme les conflits impérialistes éclatent sur tous les continents en même temps, avec une incroyable sauvagerie, les attaques contre les ouvriers tombent avec une dureté inimaginable il y a peu encore, dans tous les secteurs et dans tous les pays, en même temps.
Mais à la différence des conflits guerriers produits par la décomposition du capitalisme, la catastrophe économique du capitalisme et ses conséquences pour la classe ouvrière, peuvent permettre le réveil de l'espoir et de la perspective de l'alternative communiste à ce monde de misères effroyables et d'atrocités inouïes.
Déjà, depuis l'automne 1992 et la réaction ouvrière massive en Italie, le prolétariat recommence à lutter. Malgré leurs faiblesses, les manifestations des mineurs en Grande-Bretagne, les signes de colères en France, en Espagne, et les manifestations de rue des ouvriers de la sidérurgie en Allemagne, expriment le retour de la combativité ouvrière. Inévitablement, le prolétariat international doit répondre aux attaques dont il fait l'objet. Inévitablement, il reprend le chemin du combat de classe. Mais la voie est encore longue avant qu'il puisse présenter clairement à l'humanité souffrante, la perspective de la révolution prolétarienne et du communisme. Non seulement il doit lutter bien sûr, mais il doit aussi apprendre comment se battre. Dans la défense de ses conditions d'existence, dans ses luttes économiques, dans la recherche de son unité chaque fois plus large, il va devoir s'affronter aux manoeuvres et aux obstacles des syndicats, il va devoir déjouer les pièges corporatistes et de division des syndicalistes radicaux, «de base», et rejeter les impasses politiques faussement radicales des gauchistes. Il va devoir développer ses capacités d'organisation, se regrouper, tenir des assemblées générales ouvertes à tous, travailleurs actifs ou chômeurs, constituer des comités de lutte, manifester dans la rue en appelant à la solidarité active. Bref, il va devoir mener un combat politique, difficile et acharné, pour le développement de ses luttes et l'affirmation de sa perspective révolutionnaire. Pour les ouvriers, il n'y a pas de choix, sinon la lutte et le combat politique. Il en va de leurs conditions générales d'existence. Il en va de leur futur. Il en va du futur de l'humanité toute entière.
RL, 5 mars 1993.
[1] [1070] Le Monde des débats, février 1993.
[2] [1071] Après la fin de l'URSS, allons-nous voir l'éclatement de la Fédération de Russie ? En tout cas, la situation se détériore rapidement tant sur le plan économique que politique. Le chaos se développe, l'anarchie, les violences et les mafias règnent, la gabegie et la récession brutale frappent, la misère et le désespoir s'étendent, Eltsine semble ne plus gouverner grand chose et son pouvoir est de plus en plus affaibli et remis en cause. L'aggravation de la situation en Russie ne manquera pas, par ailleurs, d'avoir de graves conséquences au niveau international.
[3] [1072] L'intérêt directement économique, le gain d'un marché particulier, est de plus en plus secondaire dans le développement des rivalités impérialistes. Par exemple, le contrôle du Moyen-Orient, et donc du pétrole, par les USA, correspond plus à un intérêt stratégique vis-à-vis des autres puissances rivales, l'Allemagne et le Japon tout particulièrement, qui sont dépendantes pour leur approvisionnement de cette région, plutôt que par les bénéfices financiers A qu'ils pourraient en tirer.
[4] [1073] International Herald Tribune, 9/2/93.
[5] [1074] International Herald Tribune, 5/2/93.
[6] [1075] Au moment où nous écrivons, l'attentat du World Trade Center de New-York, n'est toujours pas élucidé. Il est fort probable qu'il s'inscrive dans l'exacerbation des rivalités impérialistes. Soit qu'il soit le fait d'un Etat qui essaie de faire pression sur la bourgeoisie US (comme c'était le cas lors des attentats terroristes de septembre 1986 à Paris), soit une provocation, ce qui est tout à fait possible aussi. En tout cas, le crime est utilisé par la bourgeoisie américaine pour créer un sentiment de peur dans la population, pour amener celle-ci à resserrer les liens autour de l'Etat, et pour justifier les interventions militaires à venir.
[7] [1076] Die Welt, 8 février 1993.
[8] [1077] Le Monde, 13 février 1993.
[9] [1078] M.F. Perutz de l'Université de Cambridge cité par Y International Herald Tribune, 20 février 1993.
[10] [1079] Washington Post cité par l’International Herald Tribune, 15 février 1993.
Questions théoriques:
- Décomposition [3]
- Impérialisme [321]
Crise économique mondiale : le capital allemand a bout de souffle.
- 5625 reads
Le texte ci-dessous est extrait d'un Rapport sur la situation en Allemagne, réalisé par Welt-révolution, section du CCI dans ce pays. Même si cet article traite de la situation dans un seul pays, il n'en traduit pas moins la situation généralisée de crise du capitalisme que traversent tous les pays du monde. Naguère exemple vertueux de la bonne santé du capitalisme, constamment exhibé par la propagande bourgeoise, l'économie allemande est devenue un symbole de la gravité de l'effondrement du système.
Avec sa plongée dans la pire crise qu'elle ait connue depuis les années 1930, c'est un pôle essentiel du capitalisme mondial qui vacille, celui qui, il y a quelques années, paraissait le plus solide. Cette situation est non seulement significative de la gravité présente de la crise économique mondiale, mais est aussi le signe annonciateur des tempêtes futures qui promettent d'ébranler l'ensemble de l'édifice économique du capitalisme.
La bourgeoisie n'a plus de modèle d'un capitalisme en bonne santé à offrir pour accréditer l'illusion selon laquelle, pour sortir de la crise, il suffit de mettre en place une gestion rigoureuse. La situation en Allemagne montre aujourd'hui que même les pays qui se distinguaient par une gestion économique « vertueuse », et dont les ouvriers étaient salués pour leur discipline, n'échappent pas à la crise. Cela montre l'inanité des appels constants de la classe dominante à la rigueur. Aucune politique de la bourgeoisie n'est capable d'apporter une solution à la faillite généralisée du système capitaliste. Les sacrifices imposés partout au prolétariat n'annoncent pas des lendemains meilleurs, mais au contraire, un accroissement de la misère sans que se profile une quelconque solution à l'horizon, y compris dans les pays les plus industrialisés.
La brutale accélération de la crise
La récession aux USA à la fin des années 80, bien qu'éclipsée par l'effondrement de l'Est et la célébration par les médias de « la victoire de l’économie de marché», n'était pas simplement conjoncturelle mais avait une importance historique. Après l'effondrement final et définitif du « Tiers-monde » et de l'Est, elle signifiait la chute de l'un des trois principaux moteurs de l'économie mondiale, paralysé par une montagne de dettes. A ce ni veau, 1992 fut une année véritablement historique : l'affaissement économique officiel et spectaculaire des deux géants restants, le Japon et l'Allemagne.
Au lendemain de l'unification, qui avait engendré un boom ponctuel, l'endettement de l'Allemagne n'a pas permis d'éviter la récession. Cela signifie que, comme pour les USA, cette récession est, pour l'Allemagne, d'une importance sans précédent. L'augmentation de la dette publique empêche l'Allemagne de financer sa sortie du marasme actuel. Non seulement elle est entrée en récession de façon officielle et spectaculaire, mais elle a échoué en tant que pôle de croissance de l'économie mondiale et de pilier de la stabilité économique en Europe.
La bourgeoisie allemande est la dernière et la plus spectaculaire victime de l'explosion du chaos économique et de la crise incontrôlable.
La récession en Allemagne
Par rapport au boom de ces trois dernières années, l'économie s'est littéralement effondrée durant le troisième trimestre de 1992. La croissance annuelle du PNB, qui à la fin de 1990 atteignait presque 5 %, a soudain chuté aux environs de 1 % machines-outils a chuté de 20 % en ; 1991 et de 25% en 1992. La production industrielle totale a baissé de 1 % l'année dernière et on s'attend à une baisse de 2% cette année. La production textile est tombée de 12%. L'exportation, moteur traditionnel de l'économie allemande, capable d'ordinaire de la faire sortir de chaque effondrement, n'est plus capable d'engendrer le moindre effet positif face à l'énorme récession mondiale, alors que les importations s'accroissent pour les besoins de l'unification. La balance des paiements, encore excèdentaire de 57,4 milliards de dollars en 1989, a atteint, en 1992, un déficit record de plus de 25 milliards de dollars. La dévaluation des devises britannique, italienne, espagnole, portugaise, suédoise et norvégienne à l'automne a rendu les marchandises allemandes plus chères d'environ 15 % en quelques jours. Le nombre de compagnies ayant fait faillite l'année dernière a augmenté de presque 30 %. L'industrie automobile a déjà planifié des réductions de la production d'au moins 7 % pour cette année. Les autres piliers industriels tels que l'acier, les produits chimiques, l'électronique et la mécanique ont planifié des réductions semblables. L'un des plus grands producteurs d'acier et de machines, Klôckner, est au bord de la banqueroute.
La conséquence de tout cela est une explosion des suppressions d'emplois. Volkswagen, s'attendant à une réduction des ventes de 20 % cette année, projette de licencier un employé sur dix : 12 500. Daimler Benz (Mercedes, AEG, DASA Aérospatial) licenciera 11 800 personnes cette année et supprimera 40 000 postes d'ici à 1996. D'autres réductions d'emplois importantes sont prévues : Poste télécommunication: 13 500; Veba : 7 000 ; MAN : 4 500 ; Lufthansa : 6 000 ; Siemens : 4 000, etc.
Le chiffre officiel du chômage était I à la fin 1992 de 3 126 000 chômeurs, 1 soit 6,6 % en Allemagne de l'Ouest et 13,5% (1,1 million) en Allemagne de l'Est. Le travail à temps partiel touche 649 000 personnes à l'Ouest, 233 000 à l'Est. A l'Est 4 millions de postes ont été éliminés ces trois dernières années et près d'un demi million de travailleurs sont en stages de reclassement par l'Etat. Et ce n'est que le début. Même les prédictions officielles s'attendent à 3,5 millions de chômeurs à la fin de cette année pour l'Allemagne dans son ensemble. Dans l'ex-RDA, la production de biens et de services devrait augmenter de 100 % pour maintenir l'emploi au niveau actuel. Officiellement, trois millions de logements manquent dans les grandes villes, tandis que 4,2 millions de personnes vivent en dessous du revenu minimum (460 % de plus qu'en 1970). Même les organisations semi-officielles admettent que le nombre réel de chômeurs atteindra les 5,5 millions cette année. Et ceci n'inclue pas les 1,7 millions de personnes en apprentissage dans les nouvelles provinces de l'Est, en création de travail, en travail à temps partiel et en retraite anticipée une opération qui a coûté à elle seule 50 milliards de DM.
L'explosion des dettes
Lorsque Kohl devint chancelier en 1982, la dette publique s'élevait à 615 milliards de DM, 39% du PNB, soit 10 000 DM par habitant. Depuis lors, elle a atteint le chiffre de 21 000 DM par tête, plus de 42 % du PNB. Et on s'attend à ce qu'elle dépasse rapidement 50% du PNB. Pour la rembourser, chaque allemand devrait travailler six mois sans salaire. La dette publique a désormais atteint 1 700 milliards, et il est prévu qu'elle dépasse les 2 500 milliards à la fin du siècle. Cela a pris 40 ans, jusqu'en 1990, pour que l'Etat allemand atteigne le premier millier de milliards de dette. Le second millier est prévu pour la fin de 1994 ou, au plus tard, 1995. A chaque minute l'Etat prélève 1,4 millions de DM de taxes et engage 217 000 DM de nouvelles dettes. Plus de 100 milliards de DM ont été prêtés par les banques et les caisses contrôlées par l'Etat (Kreditanstalt fur Wiederaufbau, Deutsche Aus-gleichsbank, Berliner Industrie-bank) aux entreprises d'Allemagne de l'Est entre 1989 et 1991. La majeure partie de cet argent est perdue à jamais. 41 milliards ont été donnés à l'ex-URSS dans la même période et subiront certainement le même sort. Ainsi, en peu de temps, les énormes ressources financières accumulées sur des décennies, et qui ont non seulement fait de l'Allemagne la puissance la plus insolvable mais aussi le principal prêteur de capitaux sur les marchés mondiaux, ont fondu comme neige au soleil. Des outils essentiels de contrôle de l'économie ont été définitivement gaspillés. Et la récession rend tout cela encore pire. Chaque point de pourcentage de croissance perdu coûte à Bonn 10 milliards de DM, aux provinces et aux communes 20 milliards de DM de revenus en moins au travers de la diminution des entrées d'impôts. En même temps, les taxes et les prélèvements sociaux ont atteint un niveau record. Sur 2 DM gagnés de revenu, 1 va à l'Etat ou au fonds social. De nouvelles taxes sont planifiées : une augmentation drastique du prix de l'essence ; une taxe spéciale pour financer la reconstruction de l'Est. La part du paiement des intérêts dans le budget fédéral, qui atteignait 18 % en 1970 et 42 % en 1990, est prévue à plus de 50 % en 1995.
L'effondrement de l'économie allemande, le rétrécissement de ses marchés, sa fin en tant que financier international, sont une catastrophe réelle non seulement pour l'Allemagne mais pour le monde entier et plus particulièrement pour l'économie européenne.
Le chaos économique, le capitalisme d'Etat et la politique économique
Nous pouvons difficilement trouver de meilleur exemple de l’in contrôlabilité croissante de la crise économique mondiale que la manière avec laquelle la bourgeoisie la plus puissante d'Europe est contrainte d'agir. Elle aggrave la crise et se trouve contrainte d'ignorer les principes auxquels elle était le plus attachée. Un exemple : la politique inflationniste de l'endettement public, pour financer une consommation improductive, et qui va de pair avec un accroissement constant de la monnaie en circulation une politique qui a pris une dimension spectaculaire lors de l'union économique et monétaire avec la RDA et qui continue depuis. La croissance de l'indice annuel des prix, traditionnellement l'un des plus bas des principaux pays industrialisés, tend actuellement à être l'un des plus élevés. Tournant autour de 4 % à 5 %, ce niveau n'a pu être maintenu jusqu'à présent que grâce à une politique anti-inflationniste impitoyable des taux d'intérêts de la Bundesbank. La plongée dans une dette toujours plus grande constitue en elle-même une grave rupture avec la politique précédente qui maintenait cet endettement dans certaines proportions. La politique allemande anti inflationniste classique des quarante dernières années (la stabilité des prix et une relative autonomie de la Bundesbank sont inscrits dans la constitution) reflétait non seulement les intérêts économiques immédiats mais toute une « philosophie » politique issue, à la fois des expériences de la grande inflation de 1923, du désastre économique de 1929, et des traditionnels penchants du « caractère national» allemand vers l'ordre, la stabilité et la sécurité. Alors que dans les pays anglo-saxons, les hauts taux d'intérêts sont habituellement considérés comme la principale barrière à l'expansion économique, « l'école allemande » affirme que les entreprises rentables ne seront jamais mises en difficulté par les taux d'intérêts, mais plutôt par l'inflation. De même, la croyance profondément enracinée en une politique de « Deutschemark fort» est sous-tendue théoriquement par l'idée selon laquelle les avantages de la dévaluation (pour l'exportation) sont toujours effacés par l'inflation qui en résulte (à travers des importations plus chères). Le fait que ce soit l’Allemagne qui, parmi tous les pays mène une telle politique inflationniste est donc autant plus significatif d'une perte de contrôle.
Il en va de même pour les convulsions du SME qui constituent une véritable catastrophe pour les intérêts allemands. Des rapports stables entre les devises sont cruciaux pour l'industrie allemande, puisque les grandes, mais aussi-la plupart des petites entreprises, non seulement exportent principalement vers les pays de la Communauté européenne mais y réalisent également une partie de leur production. Sans cette stabilité, aucun calcul des prix ne devient possible, et la vie économique devient encore plus hasardeuse qu'auparavant. A ce niveau, le SME avait réellement constitué un succès, en rendant l'Allemagne largement indépendante des fluctuations et des manipulations du dollar. Mais même la Bundesbank, avec ses gigantesques réserves de devises, fut impuissante face au mouvement de spéculation qui a atteint 500 à 1000 milliards de dollars par jour sur le marché des devises. En tant que puissance économique opérant à l'échelle mondiale, l'Allemagne est la plus vulnérable face la fragilisation des marchés, y compris les marchés financier et monétaire. Et pourtant, elle se voit contrainte de mener une politique économique nationale qui quotidiennement sape les fondations de ces marchés.
L'unification et le rôle de l'Etat
Que ce soit aux USA avec Clinton, au Japon, ou dans la Communauté européenne avec les propositions de Delors, des politiques d'intervention de l'Etat plus brutales et plus ouvertes au travers du financement de travaux publics et de programmes d'infrastructure (qui dans une certaine mesure ignorent les besoins réels du marché) reviennent au premier plan dans tous les pays industrialisés. Cela va de pair avec un changement idéologique. Les mystifications sur le « laisser faire » des années 1980, particulièrement développées dans les pays anglo-saxons sous Reagan et Thatcher, sont abandonnées. Ces politiques ne sont pas une solution ou même un palliatif à moyen terme. Elles sont simplement le signe que la bourgeoisie n'est pas en train de se suicider et se prépare à différer une catastrophe plus grande, même si cela implique que la catastrophe n'en sera que plus dramatique. Le niveau à la fois des dettes et de la surproduction empêche toute stimulation réelle de l'économie capitaliste.
L'aboutissement de ces politiques est parfaitement illustré par le pays qui, pour des raisons particulières, fut obligé d'initier la reprise de telles politiques : l'Allemagne. Avec son programme de reconstruction de l'Est, celle-ci a transféré chaque année des centaines de milliards de DM dans ses provinces de l'Est. Le résultat aujourd'hui est éloquent : explosion de la dette, reprise de l'inflation, gaspillage des réserves, déficit de la balance des paiements et, finalement, la récession.
Mais bien qu'étant le précurseur, les buts et les motivations de cette politique ne sont pas identiques à ceux des USA ou du Japon dont la principale préoccupation est d'arrêter l'effondrement de l'activité économique. Nous ne devons pas perdre de vue le fait que le but principal de cette orientation a été d'ordre politique (unification, stabilisation, élargissement du pouvoir de l'Etat allemand, etc.). De ce fait elle possède une dynamique différente de celle annoncée pour les USA sous Clinton. D'un côté cela implique que des investissements peuvent être politiquement « profitables », même s'ils engendrent des pertes économiques immédiates. Mais, d'un autre côté, cela signifie aussi que la bourgeoisie allemande ne peut pas simplement arrêter et renverser ses politiques si ces opérations se montrent trop chères, ce qui est précisément lie cas. C'est une opération où il n'y a pas de retour en arrière possible, même face au danger de la banqueroute. Au niveau économique la bourgeoisie a mal calculé le prix de la réunification. Elle a sous-estimé, à la fois, le coût général et le degré de dégradation de l'industrie d'Allemagne de l'Est. Elle ne prévoyait pas un effondrement aussi rapide des marchés d'exportation de l'ex-RDA vers l'Est. La stratégie a, de ce fait, été changée. Le territoire de l'ex-RDA doit être transformé en tremplin pour conquérir les marchés de l'Ouest. Ceci n'est bien sûr possible que si elle acquiert des avantages compétitifs sur ses rivaux, en particulier dans la Communauté européenne. Les trois piliers de cette stratégie sont les suivants :
Le programme de développement des infrastructures de l’Etat : à une époque où les méthodes de production et les technologies de viennent de plus en plus uni formes, l'infrastructure (transport, communications etc.) constitue potentiellement un avantage compétitif décisif. Il n'y a pas de doute au sujet de la détermination de la bourgeoisie allemande à équiper les provinces de l'Est de l'infrastructure la plus moderne d'Europe, à faire avancer ce programme à pas de géant et à l'achever avant la fin du siècle... si le capital allemand ne fait pas faillite avant.
Les bas salaires : selon les accords signés, les salaires de l'Est devraient normalement rattraper bientôt ceux de l'Ouest. Cependant les syndicats ont passé un accord non officiel selon lequel des salaires plus bas pourraient être payés dans les entreprises luttant pour leur survie (c'est le cas de 80 % d'entre elles).
Les investissements pour des raisons politiques : la précédente politique économique vis-à-vis de l'Est impliquait que l'Etat crée les infrastructures et le cadre économique, tandis que les employeurs privés s'occupent des investissements. Cependant, les employeurs ne l'ont pas fait, car ils se sont tenus à ce qu'on appelle « l'économie de marché ». Le résultat : personne ne voulait acheter l'industrie de la RDA, qui, pour l'essentiel, a complètement disparu dans ce qui fut la plus rapide et la plus spectaculaire désindustrialisation de l'histoire. Finalement, l'Etat devra réaliser directement les investissements à long terme que les investisseurs privés ont eu peur d'engager.
Les attaques contre la classe ouvrière
Toute la politique du gouvernement de Kohl consistait à mener à bien l'unification sans attaquer trop brutalement la population, de façon à ne pas décourager l'enthousiasme national. Mais cela s'est traduit par un accroissement massif de l'endettement au lieu d'une attaque massive contre les ouvriers. Même les taxes spéciales de «solidarité avec l'Est», prélevées sur les salaires, furent annulées. Au début, l'unification s'est accompagnée d'impôts et de prélèvements spéciaux à l'Ouest, mais cela dans le contexte d'un boom économique et d'une relative baisse du chômage.
Maintenant nous sommes à un tournant dramatique de la situation. Le boom de l'unification a été rattrapé par la récession mondiale. Et les dettes sont devenues si gigantesques qu'elles menacent non seulement la stabilité allemande mais celle du monde entier. Via les faux d'intérêts élevés, le système monétaire, mais aussi d'autres systèmes de stabilisation en Europe, dont l'Allemagne est si dépendante, sont menacés. Ainsi alors qu de toute évidence la poussée de l'endettement ne va pas s'arrêter, le temps est venu où toute la population, particulièrement la classe ouvrière, doit payer de façon directe et brutale au travers d'attaques massives, frontales et généralisées. Ceci a déjà commencé sur le plan des salaires en 1992, quand de façon générale des accords salariaux inférieurs à l'inflation ont été négociés grâce à la manoeuvre de la grève dans le secteur public. Cette attaque contre les salaires va continuer à s'intensifier, puisque les syndicats ne cessent d'étaler leur volonté de modération et leur sens des responsabilités sur ce plan. Le second aspect est bien sûr l'explosion du chômage, du travail à temps partiel, et des licenciements massifs, plus particulièrement dans les secteurs clés de l'industrie. Ceci a été le cas, depuis trois ans, à l'Est, mais cela prend un développement nouveau et dramatique à l'Ouest. Des suppressions d'emplois et des «sacrifices particuliers » se préparent, y compris dans le secteur public. Last but not least, le gouvernement a concocté un gigantesque programme de coupes claires dans les services sociaux. Nous ne connaissons pas encore les détails de ce plan. Des rumeurs parlent d'une réduction de 3 % pour commencer dans tous les services tels que les allocations de chômage, les allocations de logement, les allocations familiales, etc.
Sans connaître encore tous les détails, nous pouvons être sûrs que 1993 apportera un changement qualitatif dans les conditions de vie du prolétariat, une avalanche d'attaques sans précédent depuis la guerre, à une échelle au moins comparable à celle endurée dans d'autres pays d'Europe occidentale.
Les conditions des ouvriers à l'Est
Au niveau des licenciements et du chômage, les ouvriers de l'ancienne Allemagne de l'Est ont été plus brutalement touchés que toute autre fraction du prolétariat d'Europe occidentale ces trois dernières années. En fait, l'éjection de plus de 4 millions de personnes hors du processus de production en un temps très court, et pour une population totale de 17 millions, dépasse même la dimension de la crise économique mondiale après 1929. Ceci s’est accompagné d'un processus de paupérisation absolue particulièrement pour les personnes âgées et les malades, de lumpénisation, surtout parmi les jeunes, et, de façon générale, d'un développement de l'insécurité.
Pour ceux qui gardent encore un emploi ou ceux qui font des stages de formation, le niveau des revenus a relativement augmenté, suivant la politique d'unification qui prévoit à terme un alignement des salaires de l'Est sur ceux de l'Ouest. Mais ces augmentations qui touchent une partie restreinte des travailleurs (surtout des hommes, à condition de n'être ni jeunes, ni vieux, ni malades) sont encore loin de l'égalisation. Quant à l'objectif de l'égalisation des niveaux de salaires il est loin d'être atteint : en termes réels on estime que le niveau des salaires des ouvriers à l'Est reste inférieur de près de la moitié par rapport à celui des ouvriers à l'Ouest. En outre, le patronat vient d'annoncer qu'il ne pourra respecter les augmentations qui étaient prévues dans les contrats signés avec les syndicats l'année dernière, étant donné le marasme économique général. Quatre ans après l'effondrement du mur de Berlin, les ouvriers de l’ex-RDA restent des étrangers sous-payés dans « leur patrie».
Comme souvent dans l'histoire du capitalisme décadent, l'Allemagne constitue un lieu privilégié d'explosion des contradictions qui déchirent le capitalisme mondial. L'économie la plus « saine » de la planète subit aujourd'hui de plein fouet les vents dévastateurs de la récession mondiale, de l'endettement à outrance, de la perte de contrôle sur la machine économique, de l'anarchie financière et monétaire internationale. Et, comme dans tous les pays, la classe dominante répond par le renforcement du rôle de sa machine étatique et par des attaques sans précédent sur la classe ouvrière.
Au-delà des spécificités dues à la réunification, le problème en Allemagne n'est pas une question allemande mais celle la faillite du capitalisme mondial.
« Le pouvoir de consommation des travailleurs est limité en partie par les lois du salaire, en partie par le fait qu'ils ne sont employés qu'aussi longtemps que leur emploi est profitable pour la classe capitaliste. La raison ultime de toutes les crises réelles, c'est toujours la pauvreté et la consommation restreinte des masses, face à la tendance de l'économie capitaliste à développer les forces productives comme si elles n'avaient pour limite que le pouvoir de consommation absolue de la société. »
Marx, Le capital.
Géographique:
- Allemagne [98]
Récent et en cours:
- Crise économique [28]
Questions théoriques:
- Décadence [32]
Décadence du capitalisme : l'impossible « unité de l'Europe »
- 3637 reads
La bourgeoisie est-elle capable de donner un début de solution à la question de la division du monde en nations, source de dizaines de millions de morts dans les guerres mondiales et locales qui ont ensanglanté la planète depuis le début du siècle ? C'est en tout cas ce qu'ont largement suggéré, à différents niveaux, diverses tendances politiques pro européennes.
La réalité démontre aujourd'hui, dans les faits, qu'une Europe unie, regroupant en son sein les anciens pays de la CEE, et même au-delà, n'était qu'une utopie, comme l'attestent en particulier les dissensions qui traversent ces pays et leur incapacité à influencer le règlement d'événements internationaux aussi tragiques que ceux de Yougoslavie se déroulant à proximité des principaux pays industrialisés d'Europe. Cependant, il n'en demeure pas moins que la bourgeoisie pourra de nouveau à l'avenir, en d'autres circonstances et en particulier pour les besoins des alliances impérialistes, être amenée à mettre au goût du jour l'idée d'une unité européenne, avec d'autres contours. La bourgeoisie tentera alors de nouveau, comme elle l'a toujours fait dans le passé, d'utiliser les campagnes sur l'Europe pour polariser les préoccupations de la classe ouvrière sur un problème tout à fait étranger à ses intérêts de classe, et surtout pour la diviser en lui faisant prendre parti dans ce faux débat.
C'est pourquoi, il est nécessaire de démontrer en quoi tout projet de construction de l'unité européenne ne fait en réalité que .participer de la mise en place des ententes dans la guerre |économique que se livrent sans merci tous les pays du monde, ou de la constitution des alliances impérialistes en vue de la guerre des armes à laquelle les pousse l'impasse de la crise économique.
Les différentes tentatives de construction européenne ont parfois été présentées comme des étapes vers la création d'une « nouvelle nation Europe » ayant un poids économique et politique considérable dans le monde. Chacune de ces étapes, et la dernière en particulier, devant, selon leurs partisans, constituer des facteurs de paix et de justice dans le monde. Une telle idée a pu avoir un impact d'autant plus grand qu'elle a illusionné des secteurs entiers de la bourgeoisie qui s'en sont ainsi fait des porte-parole convaincus. Ces derniers ont souvent donné à leur projet la forme d'« Etats-Unis d'Europe », à l'image, par exemple, de ce que sont le Etats-Unis d'Amérique.
L'impossibilité d'une nouvelle nation viable dans la décadence du capitalisme
En fait, un tel projet est utopique parce qu'il escamote deux facteurs indispensables de sa réalisation.
Le premier facteur concerne le fait que la constitution d'une nouvelle nation digne de ce nom, est un processus qui n'est réalisable que dans certaines circonstances historiques données. Or la période actuelle, par opposition à certaines autres antérieures, est sur ce plan totalement défavorable.
Le second facteur est celui de la violence auquel ne peuvent se substituer la « volonté politique des gouvernements » et 1'« aspiration des peuples » , contrairement à ce que présente la propagande de la bourgeoisie. L'existence de la bourgeoise étant indissolublement liée à celle de la propriété privée, individuelle ou étatique, un tel projet passe nécessairement par l'expropriation ou la soumission violente de fractions nationales de la bourgeoisie par d'autres.
L'histoire de la formation des nations depuis le Moyen Age jusqu'à nos jours illustre cette situation.
Au Moyen Age, la situation sociale, économique et politique peut être résumée par cette caractérisation qu'en fait Rosa Luxemburg : «r Au Moyen Age, alors que le féodalisme était dominant, les liens entre les parties et régions d'un même Etat étaient extrêmement lâches. Ainsi, chaque ville importante et ses environs produisait, pour satisfaire ses besoins, la majorité des objets d'usage quotidien; elle avait également sa propre législation, son propre gouvernement, son armée ; les villes les plus grosses et plus prospères, à l'Ouest, parfois menaient elles mêmes des guerres et concluaient des traités avec des puissances étrangères. De la même manière, les communautés les plus importantes avaient leur propre vie isolée, et chaque parcelle du domaine d'un seigneur féodal ou même chacune des propriétés des chevaliers constituaient en elles mêmes un petit Etat quasi indépendant. » ([1] [1080])
Bien qu'à un rythme et à une échelle très inférieurs à ce qu'ils seront par la suite, lors de la domination du mode de production capitaliste, déjà à cette époque le processus de transformation de la société est à l'oeuvre : « La révolution dans la production et dans les relations commerciales à la fin du Moyen Age, l'augmentation des moyens de production et le développement de l'économie basée sur l'argent, avec également le développement du commerce international et, simultanément à la révolution dans le système militaire, le déclin de la royauté et le développement des armées permanentes, tout cela constitua des facteurs qui, dans les relations politiques, favorisèrent le développement du pouvoir du monarque et la montée de l'absolutisme. La tendance principale de l'absolutisme fut de créer un appareil d'Etat centralisé. Les 16e et 17° siècles sont une période de luttes incessantes entre la tendance centralisatrice de l'absolutisme contre les restes des particularismes féodaux. »([2] [1081])
C'est évidemment à la bourgeoisie qu'il revient de donner l'impulsion décisive à ce processus de constitution des Etats modernes et de le mener à son terme: «L'abolition des douanes et de l'autonomie, en matière d'impôts dans différentes municipalités et propriétés de la petite noblesse, et dans l'administration des cours de justice, furent les premières réalisations de la bourgeoisie moderne. Avec cela vint la création d'une grosse machine étatique qui combinait toutes les fonctions : l'administration aux mains d'un gouvernement central ; la législation entre celles d'un organe législatif le parlement; les forces armées regroupées au sein d'une armée cen tralisée sous les ordres d'un gouvernement central; les droits de douane uniformisés face à l'extérieur; une monnaie unique dans l'ensemble de l'Etat, etc. Dans le même sens, l'Etat moderne a introduit dans le domaine de la culture,le plus possible, l'homogénéisation dans l'éducation et les écoles, dans le domaine ecclésiastique, etc., à organisé selon les mêmes principes l'Etat dans son en semble. En un mot, la centralisation la plus étendue possible est la tendance dominante du capitalisme. »([3] [1082])
Au sein de ce processus de formation des nations modernes la guerre a toujours joué un rôle de premier ordre, pour éliminer les résistances intérieures émanant des secteurs réactionnaires de la société, et face aux autres pays pour délimiter ses propres frontières en faisant prévaloir par les armes son droit à l'existence. C'est pour cette raison que, parmi les Etats qui sont légués par le Moyen Age, ne sont viables que ceux présentant les conditions d'un développement économique suffisant leur permettant d'assumer leur indépendance.
Ainsi, l'exemple de l'Allemagne illustre-t-il, parmi d'autres, le rôle de la violence dans la constitution d'un Etat fort : Après avoir battu l'Autriche et soumis les princes allemands, c'est la victoire contre la France en 1871 qui permet à la Prusse d'imposer de façon stable l'unité allemande.
De même, la constitution des Etats-Unis d'Amérique en 1776, bien que ses prémisses ne se développent pas au sein de la société féodale -cette colonie ayant conquis son indépendance par les armes face à la Grande-Bretagne - fournit également une telle illustration : « Le premier noyau de l'Union des colonies Anglaises en Amérique du Nord, qui jusque là avaient été indépendantes les unes des autres, qui différaient largement les unes des autres socialement et politiquement, et qui sur beaucoup de plans avaient des intérêts divergents, fut créé par la révolution. » ([4] [1083]) Mais il faut attendre la victoire du Nord sur le Sud lors de la guerre de sécession de 1861 pour que soit parachevé, à travers une constitution lui permettant la cohésion qu'il a aujourd'hui, l'Etat moderne que sont les Etats-Unis : « C'est en tant qu'avocats du centralisme que les Etats du Nord agirent, représentant ainsi le développement du grand capital moderne, le machinisme industriel, la liberté individuelle et la liberté devant la loi, c'est-à-dire les corollaires véritables du travail salarié, de la démocratie et du progrès bourgeois. »([5] [1084])
Le 19e siècle a pour caractéristique la constitution de nouvelles nations (Allemagne, Italie) ou bien la lutte acharnée pour celles-ci (Pologne, Hongrie). Cela «n'est nullement un fait fortuit, mais correspond à la poussée exercée par l'économie capitaliste en plein essor qui trouve dans la nation le cadre le plus approprié à son développement. »([6] [1085])
L'entrée du capitalisme dans sa phase de décadence, au début du siècle, interdit désormais l'émergence de nouvelles nations capables de s'insérer dans le peloton de tête des nations les plus industrialisées et de rivaliser avec elles. ([7] [1086]) Ainsi les six plus grandes puissances industrielles dans les années 1980 (USA, Japon, Russie, Allemagne, France, Angleterre) l'étaient déjà, bien que dans un ordre différent, à la veille de la première guerre mondiale. La saturation des marchés solvables, qui est à la base de la décadence du capitalisme, engendre la guerre commerciale entre nations, et le développement de l'impérialisme qui n'est autre que la fuite en avant dans le militarisme face à l'impasse de la crise économique. Dans un tel contexte, les nations arrivées avec retard sur l'arène mondiale ne peuvent surmonter celui-ci, tout au contraire, l'écart tend à se creuser. Marx soulignait déjà au siècle précédent l'antagonisme permanent qui existe entre toutes les fractions nationales de la bourgeoisie : « La bourgeoise vit dans un état de guerre perpétuel ; d'abord contre l'aristocratie, plus tard contre ces fractions de la bourgeoise même dont les intérêts entrent en contra diction avec les progrès de l'industrie, et toujours contre la bourgeoisie de tous les pays étrangers.» ([8] [1087]) Si la contradiction qui l'opposait aux restes féodaux a été dépassée par le capitalisme, par contre, celle concernant l'antagonisme entre les nations n'a fait que s'exacerber dans la décadence. Cela souligne à quel point est utopique ou hypocrite et mensongère cette idée de l'union pacifique de différents pays, fussent ils européens.
Toutes Les nations qui naîtront dans cette période résulteront, comme par exemple la Yougoslavie (le 28 octobre 1918), de la modification des frontières, du dépeçage des pays vaincus ou de leurs empires dans les guerres mondiales. Dans ces conditions elles se trouvent d'emblée privées des attributs d'une grande nation.
La phase actuelle et ultime de la décadence, celle de la décomposition de la société, non seulement est elle aussi défavorable au surgissement de nouvelles nations, mais encore exerce une pression à l'éclatement de celles d'entre elles présentant le moins de cohésion. L'éclatement de l'URSS a résulté en partie de ce phénomène, et depuis il agit à son tour comme facteur de déstabilisation et particulièrement sur les républiques issues de cet éclatement, mais également à l'échelle du continent européen. La Yougoslavie, entre autre, n'y a pas résisté.
L'Europe ne s'étant pas constituée en entité nationale avant le début de ce siècle, à une époque pourtant favorable au surgissement de nouvelles nations, parce qu'elle n'en présentait pas les conditions, il était impossible qu'elle le fît ensuite. Cependant, vu l'importance de cette région -la plus forte densité industrielle du monde- constituant de ce fait un enjeux impérialiste de premier ordre, il était inévitable qu'elle soit le théâtre où se sont nouées et dénouées les alliances impérialistes déterminantes dans le rapport de force international entre les nations. Ainsi, depuis la fin de la seconde guerre mondiale jusqu'à l'effondrement du bloc de l'Est, elle a constitué face à celui-ci un avant-poste du bloc occidental, doté d'une cohésion politique et militaire à la mesure de la menace adverse. Ainsi également, depuis l'effondrement du bloc de l'Est et la dissolution du bloc de l'Ouest, elle est le théâtre de la lutte d'influence entre essentiellement l'Allemagne et les Etats-Unis, qui seront à la tête des deux futurs blocs impérialistes si ces derniers voient jamais le jour.
A ces alliances et rivalités impérialistes, et pas toujours en correspondance avec elles, voir antagoniques à elles, se sont superposées des ententes économiques des pays européens pour faire face à la concurrence internationale.
L'Europe : un instrument de l'impérialisme américain
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, déstabilisée par la crise économique et la désorganisation sociale, l'Europe constitue alors une proie facile pour l'impérialisme Russe. De ce fait, il y a nécessité pour la tête du bloc adverse de mettre tout en oeuvre pour remettre sur pied, dans cette partie du monde, une organisation économique et sociale, afin de la rendre moins vulnérable aux visées russes : « L'Europe occidentale, sans avoir subi les immenses ravages qui avaient affecté la partie orientale du continent, souffrait, près de deux ans après la conclusion du conflit, d'un marasme dont elle ne paraissait pas capable de sortir ... prise dans son ensemble, elle se trouve, en ce début de 1947, au bord du gouffre... tous ces éléments risquent d'entraîner, à bref délai, un effondrement général des économies, tandis que s'accentuent les tensions sociales qui menacent de faire basculer l'Europe occidentale dans le camp de l'URSS en voie de constitution rapide. » ([9] [1088])
Le plan Marshall, voté en 1948, qui prévoit pour la période de 1948-1952 une aide de 17 milliards de dollars, est tout entier au service de cet objectif impérialiste des USA. ([10] [1089]) Il s'inscrit ainsi dans la dynamique de renforcement des deux blocs et de développement des tensions entre eux, auxquels participent également d'autres événements marquants. En faveur du bloc de l'Ouest il y a la même année : la rupture de la Yougoslavie avec Moscou, empêchant ainsi la formation, avec la Bulgarie et l'Albanie, d'une fédération Balkanique sous influence soviétique ; la création du Pacte d'Assistance de Bruxelles (liant sur un plan militaire les Etats du Benelux, la France, la Grande-Bretagne), suivi l'année suivante par le Pacte Atlantique qui débouche lui-même sur la création de l'OTAN en 1950. Ce faisant, le Bloc de l'Est ne reste pas passif: il initie la «guerre froide » marquée en particulier par le blocus de Berlin et le coup d'Etat prosoviétique en Tchécoslovaquie de 1948 ; Il met en place en 1949 le Comecon (Conseil d'entraide économique) entre les pays de ce bloc. L'antagonisme entre les deux blocs ne se limite d'ailleurs pas à l'Europe mais déjà polarise les tensions impérialistes dans le monde. Ainsi, de 1946 à 1954, se déroule une première phase de la guerre d'Indochine qui se terminera avec la capitulation des troupes françaises à Dien Bien Phu.
La mise en oeuvre du plan Marshall est un puissant facteur du resserrement des liens entre les pays bénéficiaires, et la structure qui en a la charge, l’ « Organisation Européenne de Coopération Economique», est le précurseur des « ententes » qui, par la suite, verront le jour. Cependant ce sont encore les nécessités impérialistes qui constituent le moteur et l'aiguillon de telles ententes et de la suivante en particulier, la « Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier» . Le parti européen qu'il [Robert Schumann] anime s'affermit vers 1949, 1950, au moment où l'on craint le plus une offensive de l'URSS, et où Von désire consolider la résistance économique de l'Europe, tandis que, dans le domaine politique, s'édifient le Conseil de l'Europe et l'OTAN. Ainsi se précise le désir de renoncer aux particularismes et de procéder à la mise en commun des grandes ressources européennes, c'est à dire les bases de la puissance que sont, à l'époque, le charbon et l'acier. » ([11] [1090]). Ainsi, en 1952, voit le jour la CECA, marché commun pour le charbon et l'acier entre la France, l'Allemagne, l'Italie, le Benelux. Bien que formellement plus autonome des Etats-Unis que ne l'était l'OECE, cette nouvelle communauté va cependant encore dans le sens de leurs intérêts par un renforcement économique, et donc politique, de cette partie du bloc occidental qui fait directement face au bloc russe. Pour des raisons qui lui sont propres, liées au souci de son « indépendance » vis à vis des autres pays européens, et de l'intégrité de la « zone sterling » la Livre étant à l'époque la seconde monnaie mondiale, la Grande Bretagne n'entre pas dans la CECA. Une telle exception est cependant tout à fait tolérable pour le bloc occidental car elle n'affaiblit pas sa cohésion, vu la situation géographique de la Grande Bretagne et la force de ses liens avec les USA.
La création de la CEE en 1957 visant à « la suppression graduelle des droits de douane, l'harmonisation des politiques économiques, monétaires, financières et sociales, la libre circulation de la main d'oeuvre, le libre jeu de la concurrence » ([12] [1091]) constitue une étape supplémentaire dans le renforcement de la cohésion européenne, et donc du bloc occidental. Bien que, sur le plan économique, elle constitue un concurrent potentiel des USA, pendant un premier temps, la CEE est au contraire un facteur de leur propre développement : «L'ensemble géographique le plus favorisé par les investissements directs américains depuis 1950 est l'Europe : il y ont été multipliés par 15 environ. Le mouvement est demeure relativement modeste jusqu'en 1957, pour s'accélérer ensuite.
L'unification du marché continental européen amena les Américains à repenser leur stratégie en fonction de plusieurs impératifs : La création d'un tarif économique commun risquait de les exclure, s'ils n'étaient pas représentés sur place. Les anciennes implantations étaient remises en question, car, à l'intérieur d'un marché unifié, les avantages en matière de main d'oeuvre, d'impôts ou de subventions pouvaient l'emporter en Belgique ou en Italie, par exemple. En outre des duplications devenaient sans objet entre deux pays. Enfin et surtout le nouveau marché européen représentait un ensemble comparable, en population, en puissance industrielle et, à moyen terme, en niveau de vie, à celui des Etats-Unis et comportait donc des potentialités non négligeables. » ([13] [1092])
En fait le développement de l'Europe fut tel -au cours des années 1960 elle devient la première puissance commerciale de la planète- que ses produits vinrent directement concurrencer les USA. Cependant, et malgré ses succès économiques, elle ne pouvait pas transcender les divisions en son sein, relevant d'intérêts économiques opposés et d'options politiques différentes qui, sans remettre aucunement en question l'appartenance au bloc occidental, néanmoins divergeaient sur les modalités de cette appartenance. L'opposition d'intérêts économiques s'exprime par exemple entre d'une part l'Allemagne qui, pour écouler ses exportations, souhaitait un élargissement de la CEE et le développement de relations plus étroites avec les Etats-Unis, et d'autre part la France qui, au contraire, souhaitait la CEE plus fermée sur elle même, afin de protéger son industrie de la concurrence internationale. L'opposition politique se cristallise entre la France et les autres pays membres à propos des demandes réitérées de candidature de la Grande Bretagne qui, jusque là, n'avait pas voulu entrer dans la CEE. Le gouvernement De Gaulle, soucieux d'alléger le poids de la tutelle américaine, alléguait alors l'incompatibilité d'une participation à la Communauté et de relations « privilégiées » avec les Etats-Unis.
Ainsi « la CEE ne réussit que très partiellement et n'arriva pas à imposer une stratégie commune. L'échec de l’EURATOM, en 1969-1970, le demi-succès de l'avion Concorde, en portent témoignage.»([14] [1093]) Cela n'a pas lieu de nous surprendre dans la mesure où une stratégie commune et autonome de l'Europe sur le plan politique et partant, en bonne partie sur le plan économique, se heurtait nécessairement aux limites imposées par la discipline du bloc à la tête duquel se trouvaient les USA.
Cette discipline de bloc disparaît avec l'effondrement du bloc de l'Est et la dissolution, dans les faits, de celui de l'Ouest, car disparaît aussi le ciment principal de l'unité européenne qui relevait, on l'a vu, de considérations impérialistes.
Le seul facteur de cohésion de l'Europe telle qu'elle se présente avec a disparition du bloc de l'Ouest se situe au niveau économique, dans une entente destinée à affronter dans les conditions les moins défavorables possibles la concurrence américaine et japonaise. Or ce facteur de cohésion est bien faible à lui seul, au regard des tensions impérialistes croissantes qui traversent et déchirent 1'Europe.
Le terrain de la lutte d'influence des grands impérialismes
Les accords qui définissent, sur le plan économique, l'actuelle Communauté européenne concernent essentiellement le libre échange entre les pays adhérents pour une majorité de marchandises, avec cependant des clauses de sauvegarde permettant à certains pays, moyennant l'accord des autres membres, de protéger pendant un certain temps et sous certaines conditions une production nationale. De tels accords vont de pair avec des mesures protectionnistes ouvertes ou dissimulées vis à vis d'autres pays qui n'appartiennent pas à la Communauté. Même si ces accords n'éliminent évidemment pas la concurrence entre les pays signataires, et ce n'est d'ailleurs pas leur but, ils sont cependant d'une certaine efficacité face, par exemple, à la concurrence américaine et japonaise. En témoignent les entraves hypocrites imposées à l'importation de véhicules japonais dans certains pays de la CEE, pour protéger l'industrie automobile européenne /En témoigne également, à contrario cette fois, l'acharnement dont ont fait preuve les USA, dans les négociations du GATT, pour battre en brèche l'unité européenne, et y parvenir, entre autres, sur la question de la production agricole. Les mesures de libre échange sont complétées, sur le plan économique, par l'adoption de certaines normes communes, relatives par exemple à l'établissement des taxes, ayant pour but de faciliter les échanges et la coopération économique entre les pays concernés.
Au delà de ces mesures strictement économiques, il en existe d'autres, en projet ou déjà en vigueur, dont le but évident est un resserrement des liens entre les différents pays concernés.
Ainsi, pour se «protéger contre l'immigration massive », et par la même occasion contre les «facteur intérieurs de déstabilisation », furent adoptés les accords de Schengen signés par la France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, le Luxembourg, les Pays Bas auxquels doivent se joindre ultérieurement l'Espagne et le Portugal.
De même, les accords de Maastricht, malgré leur flou, constituent une tentative d'aller de l'avant dans le resserrement de ces liens.
La portée de tels accords va au-delà de la seule défense en commun de certains intérêts autres qu'économiques, puisque avec l'accroissement de l'interdépendance qu'ils impliquent entre les pays signataires, ils ouvrent la voie à la possibilité d'une plus grande autonomie politique vis à vis des Etats-Unis. Une telle perspective prend toute son importance quand, parmi les pays européens concernés, le plus puissant d'entre eux, l'Allemagne, se trouve justement être le pays susceptible de prendre la tête d'un futur bloc impérialiste opposé aux USA. C'est la raison pour laquelle on assiste, en particulier de la part de la Grande-Bretagne et de la Hollande, qui demeurent en Europe des fidèles alliés des USA, à des tentatives évidentes de sabotage de la construction d'une Europe plus « politique ».
La question impérialiste s'affirme encore plus nettement lorsque sont noués des accords de coopération militaire, impliquant un nombre restreint de pays européens qui constituent le « noyau dur » du projet visant à vouloir s'affirmer de plus en plus nettement face à l'hégémonie des USA. Ainsi l'Allemagne et la France ont-elles constitué un corps d'armée commun. A un niveau moindre, mais cependant significatif, la France, l'Italie et l'Espagne ont conclu un accord pour un projet de force aéronaval commune. ([15] [1094])
La réprobation de la Grande-Bretagne à la création du corps d'armée franco-allemand, la réaction Hollandaise à ce propos, « l'Europe ne doit pas être soumise au consensus franco-allemand», sont tout à fait significatives des camps en présence et de leur antagonisme.
De même les USA, malgré quelques déclarations favorables discrètes et purement « diplomatiques » sont réticents à la conclusion des accords de Maastricht, même si, en usant de leur droit de veto, leurs alliés anglais ou hollandais peuvent paralyser l'institution européenne. ([16] [1095])
La tendance est évidemment à ce que la France et l'Allemagne tentent toujours d'utiliser davantage la structure communautaire pour rendre l'Europe plus autonome vis à vis des USA. Inversement, la Grande Bretagne et la Hollande seront contraintes de répondre à de telles poussées en paralysant les initiatives européennes.
Cependant, une telle action de la part de la Hollande ou de la Grande Bretagne connaît des limites dont le franchissement participera de « marginaliser » ces deux pays vis-à-vis de la structure communautaire.
Si une telle perspective, qui constituerait l'amorce d'une rupture de la Communauté européenne, n'est évidemment pas sans inconvénients, au niveau des relations économiques, pour tous les pays qui la composent. Elle stimulerait par ailleurs une accélération, en Europe même, du renforcement des bases pour la construction d'un bloc opposé aux USA.
Un terrain propice aux campagnes idéologiques contre la classe ouvrière
Le «projet européen » n'étant autre qu'un mythe qui, de plus, est le paravent à l'intégration dans un bloc impérialiste, la classe ouvrière n'a évidemment pas à prendre parti dans la querelle qui oppose des fractions de la bourgeoise sur les différentes options impérialistes en présence. Elle doit rejeter à la fois les appels des nationalistes « chauvins » qui se présentent comme les «garants de l'intégrité nationale »y ou encore comme les «défenseurs des intérêts des ouvriers menacés par l'Europe du capital » et celui des non moins nationalistes partisans de la «construction européenne». Elle a tout à perdre à se laisser embarquer sur ce terrain qui ne peut la conduire qu'à la division en son sein et aux pires illusions. Parmi les mensonges employés par la bourgeoisie pour tromper les ouvriers, on en trouve un certain nombre de «classiques» que les ouvriers doivent savoir démasquer.
«L'union d'une majorité de pays d'Europe est un facteur de paix dans le monde, ou pour le moins en Europe». Une telle idée s'appuie souvent sur l'idée que si la France et l'Allemagne se trouvent alliées dans une telle structure, on évitera la répétition du scénario des deux guerres mondiales. Il est possible que ce soit là un moyen d'éviter un conflit entre ces deux pays, si toutefois la France ne change pas de camp au dernier moment pour rejoindre celui des USA. Cependant, cela ne règle strictement en rien le problème crucial de la guerre. En effet, si les liens politiques entre certains pays européens venaient à se développer au delà de ce qui existe actuellement, cela serait nécessairement le produit d'une dynamique à la formation d'un nouveau bloc impérialiste autour de l'Allemagne, et opposé aux USA. Or, si la classe ouvrière laisse les mains libres à la bourgeoisie, l'aboutissement d'une telle dynamique n'est autre qu'une nouvelle guerre mondiale.
« Une telle union permettrait à ses habitants d'éviter les calamités, telles que la misère, les guerres ethniques, les famines, (...) qui ravagent une majorité des autres parties du monde». Cette idée est complémentaire de la précédente. Outre le mensonge consistant à faire croire qu'une partie de la planète pourrait échapper à la crise mondiale du système, cette idée fait partie d'une propagande ayant comme objectif d'amener la classe ouvrière en Europe à s'en remettre à ses bourgeoisies pour le règlement du problème fondamental de sa survie, indépendamment et, ce qui n'est pas dit ouvertement, au détriment de la classe ouvrière du reste du monde. Elle vise ainsi à terme à l'enchaîner à la bourgeoisie dans la défense de ses intérêts nationaux. Elle n'est en fait que l'équivalent, à l'échelle d'un bloc impérialiste en formation, de toutes les campagnes nationalistes et chauvines que déploie la bourgeoisie dans tous les pays. En ce sens, elle peut être comparée, par exemple, aux campagnes que déployait le bloc occidental contre le bloc adverse qu'il appelait, pour la circonstance, « l'empire du mal ».
« La classe ouvrière est en fait, en bonne partie, assimilable aux fractions les plus nationalistes de la bourgeoisie, puisque, comme elles, elle se positionne majoritairement contre l'union européenne». C'est vrai que, face au battage de la bourgeoisie, des ouvriers ont été amenés, en certaines circonstances, notamment lors du référendum de 1992 en France portant sur la ratification des accords de Maastricht, à prendre part massivement au «débat sur l'Europe». Cela relève évidemment d'une faiblesse de la classe ouvrière. C'est également vrai que, dans ce contexte, des ouvriers ont été sensibles aux arguments mêlant, à différents niveaux, la soi-disant défense de ses intérêts au nationalisme, au chauvinisme, à la xénophobie. Une telle situation est le produit du fait que la classe ouvrière subit globalement le poids de l'idéologie dominante, dont le nationalisme, sous toutes ses formes. Mais, de plus, cette situation est exploitée par la bourgeoisie pour rendre la classe ouvrière coupable de générer en son sein de telles « monstruosités », pour la diviser entre fractions soi-disant «réactionnaires» et d'autres soi-disant « progressistes ».
Face au mensonge du « dépassement des frontières par la construction européenne », où à celui de «l'Europe sociale», tout comme face aux appels au repli nationaliste pour soi-disant « se protéger des méfaits sociaux de l'Union européenne », les ouvriers n'ont pas à choisir. Leur seule voie, c'est celle de la lutte intransigeante contre toutes les fractions de la bourgeoisie, pour la défense de leurs conditions d'existence et le développement de la perspective révolutionnaire, à travers le développement de leur solidarité et unité internationales de classe. Leur seul salut, c'est la mise en pratique du vieux et toujours actuel mot d'ordre du mouvement ouvrier «Les ouvriers n'ont pas de patrie. Prolétaires de tous les pays unissez-vous ! ».
M, 20 février 1993
[1] [1096] Rosa Luxemburg in The nation state and the prolétariat. Publié dans La question nationale, sélection de textes de Rosa Luxemburg, Editeur Horace B. Davis, p. 187.
[2] [1097] Idem.
[3] [1098] Idem p. 189.
[4] [1099] Idem p. 195.
[5] [1100] Idem p. 196.
[6] [1101] « La lutte du prolétariat dans la décadence du Capitalisme. Le développement de nouvelles unités capitalistes », Revue Internationale n°23.
[7] [1102] Lire l'article: «Des nations mort-nées», Revue internationale n° 69.
[8] [1103] Le manifeste communiste.
[9] [1104] Le Second XXe siècle, T. 6, p 241, Pierre Léon, Histoire économique et sociale du monde.
[10] [1105] Ce n'est évidemment pas un hasard si ce plan fut initié par Marshall, le chef d'état-major de l'armée américaine durant la seconde guerre mondiale.
[11] [1106] Idem p.255
[12] [1107] Idem p.258
[13] [1108] Idem p. 508.
[14] [1109] Idem.
[15] [1110] Une telle initiative est également significative du besoin de la France, mais également de l'Espagne et de l'Italie, de ne pas se trouver démunies face au puissant voisin et allié allemand.
[16] [1111] Les Etats-Unis, de leur côté font tout leur possible non seulement pour faire échec aux tentatives de l'Allemagne et de la France de jouer leur propre carte, mais encore pour créer leur «propre marché commun» afin de se préparer à une situation mondiale plus difficile. L'ALENA (Association de libre-échange nord-américaine), marché commun avec le Mexique et le Canada, n'est pas simplement une entente économique, mais une tentative de renforcer la stabilité et la cohésion de leur zone immédiate d'influence, tant face à la décomposition que face aux <r incursions » de l'influence d'autres puissance européennes ou du Japon.
Géographique:
- Europe [95]
Heritage de la Gauche Communiste:
Qui peut changer le monde ? (1ere partie) : Le prolétariat est bien la classe révolutionnaire
- 3954 reads
« Le communisme est mort ! Le capitalisme l'a vaincu parce qu'il est le seul système qui puisse fonctionner ! Il est inutile, et même dangereux, de vouloir rêver à une autre société ! » C'est une campagne sans précédent que la bourgeoisie a déchaînée avec l'effondrement du bloc de l'Est et des régimes prétendument « communistes ». En même temps, et pour enfoncer le clou, la propagande bourgeoise s'est appliquée, une nouvelle fois, à démoraliser la classe ouvrière en essayant de la persuader que, désormais, elle n'est plus une force dans la société, qu'elle ne compte plus, voire qu'elle n'existe plus. Et, pour ce faire, elle s'est empressée de monter en épingle la baisse générale de la combativité résultant du désarroi que les bouleversements de ces dernières années ont provoqué dans les rangs ouvriers. La reprise des combats de classe, qui déjà s'annonce, viendra démentir dans la pratique de tels mensonges, mais la bourgeoisie n'aura de cesse, même au cours des grandes luttes ouvrières, de marteler l'idée que ces luttes ne peuvent en aucune façon se donner comme objectif un renversement du capitalisme, l'instauration d'une société débarrassée des plaies que ce système impose à l'humanité. Ainsi, contre tous les mensonges bourgeois, mais aussi contre le scepticisme de certains qui se veulent des combattants de la révolution, l'affirmation du caractère révolutionnaire du prolétariat reste une responsabilité des communistes. C'est l'objectif de cet article.
Dans les campagnes que nous avons subies ces dernières années, un des thèmes majeurs est la «réfutation» du marxisme. Ce dernier, au dire des idéologues appointés par la bourgeoisie, aurait fait faillite. Sa mise en pratique et son échec dans les pays de l'Est constitueraient une illustration de cette faillite. Dans notre Revue, nous avons mis en évidence à quel point le stalinisme n'avait rien à voir avec le communisme tel que Marx et l'ensemble du mouvement ouvrier l'ont envisagé.([1] [1112]) Concernant la capacité révolutionnaire de la classe ouvrière, la tâche des communistes est de réaffirmer la position marxiste sur cette question, et en premier lieu, de rappeler ce que le marxisme entend par classe révolutionnaire.
Qu'est-ce qu'une classe révolutionnaire pour le marxisme ?
«L'histoire de toutes les sociétés jusqu'à nos jours est l'histoire des luttes de classe. »([2] [1113]) C'est ainsi que débute un des textes les plus importants du marxisme et du mouvement ouvrier : le Manifeste communiste. Cette thèse n'est pas propre au marxisme ([3] [1114]) mais un des apports fondamentaux de la théorie communiste est d'avoir établi que l'affrontement des classes dans la société capitaliste a comme perspective ultime le renversement de la bourgeoisie par le prolétariat et l'instauration du pouvoir de ce dernier sur l'ensemble de la société, thèse qui a toujours été rejetée, évidemment, par les défenseurs du système capitaliste. Cependant, si des bourgeois de la période ascendante de ce système avaient pu découvrir (de façon incomplète et mystifiée, évidemment) un certain nombre de lois de la société,([4] [1115]) cela ne risque pas de se reproduire aujourd'hui : la bourgeoisie de la décadence capitaliste est devenue totalement incapable d'engendrer de tels penseurs. Pour les idéologues de la classe dominante, la priorité fondamentale de tous leurs efforts de «pensée» est de démontrer que la théorie marxiste est erronée (même si certains se réclament de tel ou tel apport de Marx). Et la pierre angulaire de leurs « théories » est F affirmation que la lutte de classe ne joue aucun rôle dans l'histoire, quand ce n'est pas de nier, purement et simplement, l'existence d'une telle lutte ou, pire encore, l'existence des classes sociales.
Il ne revient pas aux seuls défenseurs avoués de la société bourgeoise d'avancer de telles affirmations. Certains «penseurs radicaux», qui font carrière dans la contestation de l'ordre établi, les ont rejoints depuis un certain nombre de décennies. Le gourou du groupe Socialisme ou Barbarie (et inspirateur du groupe Solidarity en Grande-Bretagne), Cornélius Castoriadis, en même temps qu'il prévoyait le remplacement du capitalisme par un « troisième système », la «société bureaucratique », avait annoncé, il y a près de 40 ans, que l'antagonisme entre bourgeoisie et prolétariat, entre exploiteurs et exploités, était destiné à céder la place à un antagonisme entre « dirigeants et dirigés. »([5] [1116]) Plus près d'aujourd'hui, d'autres «penseurs» qui ont connu leur heure de gloire, tel le professeur Marcuse, ont affirmé que la classe ouvrière avait été « intégrée » dans la société capitaliste et que les seules forces de contestation de celle-ci se trouvaient, désormais, parmi des catégories sociales marginalisées tels les noirs aux Etats-Unis, les étudiants ou encore les paysans des pays sous-développés. Ainsi, les théories sur la «fin de la classe ouvrière » qui recommencent à fleurir aujourd'hui, n'ont même pas l'intérêt de la nouveauté : une des caractéristiques de la « pensée » de la bourgeoisie décadente, et qui exprime bien la sénilité de cette classe, est l'incapacité de produire la moindre idée nouvelle. La seule chose qu'elle soit capable de réaliser est de fouiller dans les poubelles de l'histoire pour en ressortir de vieux poncifs qu'on repeint au goût du jour et qu'on présente comme la « découverte du siècle ».
Un des moyens favoris utilisés aujourd'hui par la bourgeoisie pour escamoter la réalité des antagonismes de classe, et même la réalité des classes sociales, est constitué par les «études» sociologiques. A grand renfort de statistiques, on «démontre» que les véritables clivages sociaux n'ont rien à voir avec des différences de classes mais avec des critères comme le niveau d'instruction, le lieu d'habitation, la tranche d'âge, l'origine ethnique, voire la pratique religieuse. ([6] [1117]) A l'appui de ce type d'affirmations on s'empresse d'exhiber le fait, par exemple, que le vote d'un « citoyen » en faveur de la droite ou de la gauche dépend moins de sa situation économique que d'autres critères. Aux Etats-Unis, la Nouvelle-Angleterre, les noirs et les juifs votent traditionnellement démocrate, en France, les catholiques pratiquants, les Alsaciens et les habitants de Lyon votent traditionnellement à droite. On s'évite cependant de souligner que la majorité des ouvriers américains ne votent jamais et que, dans les grèves, les ouvriers français qui vont à l'église ne sont pas nécessairement les moins combatifs. De façon plus générale, la « science » sociologique «oublie» toujours de donner une dimension historique à ses affirmations. Ainsi, on refuse de se souvenir que les mêmes ouvriers russes qui allaient se lancer dans la première révolution prolétarienne du 20e siècle, celle de 1905, avaient débuté, le 9janvier (le «dimanche rouge») par une manifestation conduite par un pope et réclamant la bienveillance au Tzar pour qu'il soulage leur misère. ([7] [1118])
Lorsque les « experts » en sociologie font référence à l'histoire, c'est pour affirmer que les choses ont radicalement changé depuis le siècle dernier. A cette époque, selon eux, le marxisme et la théorie de la lutte de classe pouvaient avoir un sens car les conditions de travail et de vie des salariés de l'industrie étaient effectivement épouvantables. Mais, depuis, les ouvriers se sont « embourgeoisés » et ont accédé à la « société de consommation » au point de «perdre leur identité ». De même, les bourgeois en haut de forme et à gros ventre ont cédé la place à des «managers» salariés. Ce que toutes ces considérations veulent occulter c'est que, fondamentalement, les structures profondes de la société n'ont pas changé. En réalité, les conditions qui, au siècle dernier, donnaient à la classe ouvrière sa nature révolutionnaire sont toujours présentes. Le fait que le niveau de vie des ouvriers d'aujourd'hui soit supérieur à celui de leurs frères de classe des générations passées ne modifie en aucune façon leur place dans les rapports de production qui dominent la société capitaliste. Les classes sociales continuent d'exister et les luttes entre celles-ci constituent toujours le moteur fondamental du développement historique.
C'est vraiment une ironie de l'histoire que les idéologies officielles de la bourgeoisie prétendent, d'un côté, que les classes ne jouent plus aucun rôle spécifique (voire n'existent plus) et reconnaissent, de l'autre, que la situation économique du monde constitue la question essentielle, cruciale, à laquelle est confrontée cette même bourgeoisie.
En réalité, l'importance fondamentale des classes dans la société découle justement de la place prépondérante qu'y occupe l'activité économique des hommes. Une des affirmations de base du matérialisme historique c'est que, en dernière instance, l'économie détermine les autres sphères de la société : les rapports juridiques, les formes de gouvernement, les modes de pensée. Cette vision matérialiste de l'histoire vient battre en brèche, évidemment, les philosophies qui voient dans les événements historiques, soit le pur fruit du hasard, soit l'expression de la volonté divine, soit le simple résultat des passions ou des pensées des hommes. Mais, comme le disait Marx déjà en son temps, « la crise se charge de faire entrer la dialectique dans la tête des bourgeois ». Le fait, aujourd'hui évident, de cette prépondérance de l'économie dans la vie de la société se trouve à la base de l'importance des classes sociales, justement parce que celles-ci sont déterminées, contrairement aux autres catégories sociologiques, par la place occupée vis-à-vis des rapports économiques. Cela a toujours été vrai depuis qu'il existe des sociétés de classe, mais c'est dans le capitalisme que cette réalité s'exprime avec le plus de clarté.
Dans la société féodale, par exemple, la différenciation sociale était consignée dans les lois. Il existait une différence juridique fondamentale entre les exploiteurs et les exploités : les nobles avaient, par la loi, un statut officiel de privilégiés (dispense de payer des impôts, perception d'un tribut versé par leurs serfs, par exemple) alors que les paysans exploités étaient attachés à leur terre et étaient tenus de céder une part de leur revenu au seigneur (ou bien de travailler gratuitement les terres de celui-ci). Dans une telle société, l'exploitation, si elle était facilement mesurable (par exemple sous la forme du tribut payé par le serf), semblait découler du statut juridique. En revanche, dans la société capitaliste, l'abolition des privilèges, l'introduction du suffrage universel, l'Egalité et la Liberté proclamées par ses constitutions, ne permettent plus à l'exploitation et à la différenciation en classes de s'abriter derrière des différences de statut juridique. C'est la possession, ou la non-possession, des moyens de production,([8] [1119]) ainsi que leur mode de mise en oeuvre, qui détermine, pour l'essentiel, la place dans la société des membres de celle-ci et leur accession à ses richesses, c'est-à-dire l'appartenance à une classe sociale et l'existence d'intérêts communs avec les autres membres de la même classe. A grands traits, le fait de posséder des moyens de production et de les mettre en oeuvre individuellement détermine l'appartenance à la petite-bourgeoisie (artisans, exploitants agricoles, professions libérales, etc.).([9] [1120]) Le fait d'être privé de moyens de production et d'être contraint, pour vivre, de vendre sa force de travail à ceux qui les détiennent et qui mettent à profit cet échange pour s'accaparer une plus-value, détermine l'appartenance à la classe ouvrière. Enfin, font partie de la bourgeoisie, ceux qui détiennent (au sens strictement juridique ou au sens global de leur contrôle, de manière individuelle ou collective) des moyens de production dont la mise en oeuvre fait appel au travail salarié et qui vivent de l'exploitation de ce dernier sous forme d'une appropriation de la plus-value qu'il produit. Pour l'essentiel, cette différenciation en classes est aujourd'hui aussi présente qu'elle l'était au siècle dernier. De même, ont subsisté les intérêts de chacune de ces différentes classes et les conflits entre ces intérêts. C'est pour cela que les antagonismes entre les principales composantes de la société, déterminées par ce qui constitue le squelette de celle-ci, l'économie, continuent de se trouver au centre de la vie sociale.
Cela dit, même si l'antagonisme entre exploiteurs et exploités constitue un des moteurs principaux de l'histoire des sociétés, ce n'est pas de façon identique pour chacune d'entre elles. Dans la société féodale, les luttes, souvent féroces et de très grande envergure, entre les serfs et les seigneurs n'ont jamais abouti à un bouleversement radical de celle-ci. L'antagonisme de classe qui a conduit au renversement de l'ancien régime, aboli les privilèges de la noblesse, n'était pas celui qui opposait celle-ci et la classe qu'elle exploitait, la paysannerie asservie, mais l'affrontement entre cette même noblesse et une autre classe exploiteuse, la bourgeoisie (révolution anglaise du milieu du 17e siècle, révolution française de la fin du 18e). De même, la société esclavagiste de l'antiquité romaine n'a pas été abolie par la classe des esclaves (malgré les combats quelques fois formidables que celle-ci a menés, comme la révolte de Spartacus et des siens en 73 avant Jésus-Christ), mais bien par la noblesse qui allait dominer l'Occident chrétien pendant plus d'un millénaire.
En réalité, dans les sociétés du passé, les classes révolutionnaires n'ont jamais été des classes exploitées mais de nouvelles classes exploiteuses. Un tel fait ne devait rien au hasard, évidemment. Le marxisme distingue les classes révolutionnaires (qu'il appelle également classes «historiques») des autres classes de la société par le fait que, contrairement à ces dernières, elles ont la capacité de prendre la direction de la société. Et tant que le développement des forces productives était insuffisant pour assurer une abondance de biens à l'ensemble de la société, infligeant à celle-ci le maintien des inégalités économiques et donc des rapports d'exploitation, seule une classe exploiteuse était en mesure de s'imposer à la tête du corps social. Son rôle historique était de favoriser l'éclosion et le développement des rapports de production dont elle était porteuse et qui avaient comme vocation, en supplantant les anciens rapports de production devenus caducs, de résoudre les contradictions, désormais, insurmontables engendrées par le maintien de ces derniers.
Ainsi, la société esclavagiste romaine en décadence était travaillée à la fois par le fait que « l'approvisionnement » en esclaves, basé sur la conquête de nouveaux territoires, se heurtait à la difficulté pour Rome de contrôler des frontières de plus en plus éloignées et par l'incapacité d'obtenir de la part des esclaves le soin qu'exigeait la mise en oeuvre des nouvelles techniques agricoles. Dans une telle situation, les rapports féodaux, où les exploités n'avaient plus un statut identique à celui du bétail (comme c'était le cas des esclaves),([10] [1121]) où ils étaient étroitement intéressés à une plus grande productivité du sol qu'ils travaillaient puisqu'ils devaient en vivre, se sont imposés comme les plus aptes à sortir la société de son marasme. C'est pour cela que ces rapports se sont développés, notamment par un affranchissement croissant des esclaves (ce qui fut accéléré, en certains lieux, par l'arrivée des «barbares» dont certains, d'ailleurs, vivaient déjà dans une forme de société féodale).
De même, le marxisme (à commencer par le Manifeste communiste) insiste sur le rôle éminemment révolutionnaire joué par la bourgeoisie au cours de l'histoire. Cette classe, qui est apparue et s'est développée au sein de la société féodale, a vu son pouvoir s'accroître vis-à-vis d'une noblesse et d'une monarchie qui dépendaient de plus en plus d'elle, tant pour leurs fournitures en biens de toutes sortes (étoffes, mobilier, épices, armes), que pour le financement de leurs dépenses. Alors qu'avec l'épuisement des possibilités de défrichement et d'extension des terres cultivées se tarissait une des sources de la dynamique des rapports de production féodaux, qu'avec la constitution de grands royaumes, le rôle de protecteur des populations, qui était initialement la vocation principale de la noblesse, perdait sa raison d'être, le contrôle, par cette classe, de la société tendait à devenir une entrave pour le développement de cette dernière. Et cela était amplifié par le fait que ce développement était de plus en plus tributaire de la croissance du commerce, de la banque et de l'artisanat dans les villes qui faisaient connaître un progrès considérable au niveau des forces productives
Ainsi, en prenant la tête du corps social, d'abord dans la sphère économique, puis dans la sphère politique, la bourgeoisie libérait la société des entraves qui l'avaient plongée dans le marasme, elle créait les conditions du plus formidable accroissement de richesses que l'histoire humaine ait connu. Ce faisant, elle substituait une forme d'exploitation, le servage, par une autre forme d'exploitation, le salariat. Pour y parvenir, elle a été conduite, lors de la période que Marx appelle l'accumulation primitive, à prendre des mesures d'une barbarie, qui valait bien celle imposée aux esclaves, afin que les paysans soient contraints de venir vendre leur force de travail dans les villes (voir, à ce sujet, les pages admirables dans le livre I du Capital). Et cette barbarie elle-même ne faisait qu'annoncer celle avec laquelle le capital allait exploiter le prolétariat (travail des enfants en bas âge, travail de nuit des femmes et des enfants, journées de travail allant jusqu'à 18 heures, parcage des ouvriers dans les « work-houses », etc.) avant que les luttes de celui-ci ne parviennent à contraindre les capitalistes à atténuer la brutalité de leurs méthodes.
La classe ouvrière a mené, dès son apparition, des révoltes contre l'exploitation. De même, ces révoltes se sont accompagnées de la mise en avant d'un projet de bouleversement de la société, d'abolition des inégalités, de mise en commun des biens sociaux. En cela, elle ne se distinguait pas fondamentalement des précédentes classes exploitées, notamment des serfs qui, eux aussi, dans certaines de leurs révoltes, pouvaient se rallier à un projet de transformation sociale. I Ce fut le cas notamment lors de la Guerre des paysans au 16e siècle, en Allemagne, où les exploités c’étaient donnés comme porte parole Thomas Munzer qui préconisait une forme de communisme ([11] [1122]). Cependant, contrairement au projet de transformation sociale des autres classes exploitées, celui du prolétariat n'est pas une simple utopie irréalisable. Le rêve d'une société égalitaire, sans maîtres et sans exploitation, que pouvaient faire les esclaves ou les serfs, n'était qu'une simple chimère car le degré de développement économique atteint par la société de leur temps ne permettait pas l'abolition de l'exploitation. En revanche, le projet communiste du prolétariat est parfaitement réaliste, non seulement parce que le capitalisme a créé les prémisses d'une telle société, mais aussi parce qu'il est le seul projet qui puisse sortir l'humanité du marasme dans lequel elle s'enfonce.
Pourquoi le prolétariat est la classe révolutionnaire de notre temps
Dès que le prolétariat a commencé à mettre en avant son propre projet, la bourgeoisie n'a eu que mépris pour ce qu'elle considérait comme des élucubrations de prophètes en mal de public. Lorsqu'elle se donnait la peine de dépasser ce simple mépris, la seule chose qu'elle pouvait imaginer c'est qu'il en serait des ouvriers comme il en avait été des autres exploités aux époques antérieures : ils ne pourraient que rêver des utopies impossibles. Evidemment, l'histoire semblait donner raison à la bourgeoisie et celle-ci résumait sa philosophie dans les termes : «Toujours il y a eu des pauvres et des riches, il y en aura toujours. Les pauvres ne gagnent rien à se révolter: ce qu'il convient défaire, c'est que les riches n'abusent pas de leur richesse et se préoccupent de soulager la misère des plus pauvres». Les curés et les dames patronnesses se sont faits les porte-parole et les praticiens de cette «philosophie». Ce que la bourgeoisie se refusait à voir, c'est que son système économique et social, pas plus que les précédents, ne pouvait être éternel, et que, au même titre que l'esclavagisme ou la féodalité, il était condamné à laisser la place à un autre type de société. Et de même que les caractéristiques du capitalisme avaient permis de résoudre les contradictions qui avaient terrassé la société féodale (comme il en avait été déjà le cas de cette dernière vis-à-vis de la société antique), les caractéristiques de la société appelée à résoudre les contradictions mortelles qui assaillent le capitalisme découlent du même type de nécessité. C'est donc en partant de ces contradictions qu'il est possible de définir les caractéristiques de la future société.
On ne peut, évidemment, dans le cadre de cet article, revenir en détail sur ces contradictions. Depuis plus d'un siècle, le marxisme s'y est employé de façon systématique et notre propre organisation y a consacré de nombreux textes.([12] [1123]) Cependant, on peut résumer à grands traits les origines de ces contradictions. Elles résident dans les caractéristiques essentielles du système capitaliste : c'est un mode de production qui a généralisé l'échange marchand à tous les biens produits alors que, dans les sociétés du passé, seule une partie, souvent très minime, de ces biens était transformée en marchandise! Cette colonisation de l'économie! Par la marchandise a même affecté, dans le capitalisme, la force de travail mise en oeuvre par les hommes dans leur activité productive. Privé de moyens de production, le producteur n'a d'autre possibilité, pour survivre, que de vendre sa force de travail à ceux qui détiennent ces moyens de production : la classe capitaliste, alors que dans la société féodale par exemple, où existait déjà une économie marchande, c'est le fruit de son travail que l'artisan ou le paysan vendait. Et c'est bien cette généralisation de la marchandise qui est à la base des contradictions du capitalisme : la (prise de surproduction trouve ses racines dans le fait que le but de ce système n'est pas de produire des valeurs d'usage, mais des valeurs d'échange qui doivent trouver des acheteurs. C'est dans l'incapacité de la société à acheter la totalité des marchandises produites (bien que les besoins soient très loin d'être satisfaits) que réside cette calamité qui apparaît comme une véritable absurdité : le capitalisme s'effondre non parce qu'il produirait trop peu, mais parce qu'il produit trop. ([13] [1124])
La première caractéristique du communisme sera donc l'abolition de la marchandise, le développement de la production de valeurs d'usage et non de valeurs d'échange.
En outre, le marxisme, et particulièrement Rosa Luxembourg, a mis en évidence qu'à l'origine de la surproduction réside la nécessité pour le capital, considéré comme un tout, de réaliser, par la vente en dehors de sa propre sphère, la part des valeurs produites correspondant à la plus-value extirpée aux prolétaires et destinée à son accumulation. A mesure que cette sphère extra-capitaliste se réduit, les convulsions de l'économie ne peuvent prendre que des formes de plus en plus catastrophiques.
Ainsi, le seul moyen de surmonter les contradictions du capitalisme réside dans l'abolition de toutes les formes de marchandise, et en particulier de la marchandise force de travail, c'est-à-dire du salariat.
L'abolition de l'échange marchand suppose que soit aboli également ce qui en constitue la base : la propriété privée. Ce n'est que si les richesses de la société sont appropriées par celle-ci de façon collective que pourra disparaître l'achat et la vente de ces richesses (ce qui existait déjà, sous une forme embryonnaire, dans la communauté primitive). Une telle appropriation collective par la société des richesses qu'elle produit, et en premier lieu, des moyens de production, signifie qu'il n'est plus possible à une partie d'elle-même, à une classe sociale (y compris sous la forme d'une bureaucratie d'Etat), de disposer des moyens d'en exploiter une autre partie. Ainsi, l'abolition du salariat ne peut être réalisée sur la base de l'introduction d'une autre forme (l'exploitation, mais uniquement par l'abolition de l'exploitation sous toutes ses formes. Et, contrairement au passé, non seulement le type de transformation qui puisse aujourd'hui sauver la société ne peut désormais aboutir sur de nouveaux rapports d'exploitation, mais le capitalisme a réellement créé les prémisses matérielles d'une abondance permettant le dépassement de l'exploitation. Ces conditions d'une abondance, elles aussi, se révèlent dans l'existence des crises de surproduction (comme le relève le Manifeste communiste).
La question qui est posée est donc : quelle force dans la société est en mesure d'opérer cette transformation, d'abolir la propriété privée, de mettre fin à toute forme d'exploitation ?
La première caractéristique de cette classe est d'être exploitée car seule une telle classe peut être intéressée à l'abolition de l'exploitation. Si, dans les révolutions du passé, la classe révolutionnaire ne pouvait, en aucune façon, être une classe exploitée, dans la mesure où les nouveaux rapports de production étaient nécessairement des rapports d'exploitation, c'est exactement le contraire qui est vrai aujourd'hui. En leur temps, les socialistes utopistes (tels Fourier, Saint-Simon, Owen) ([14] [1125]) avaient caressé l'illusion que la révolution pourrait être prise en charge par des éléments de la bourgeoisie elle-même. Ils espéraient qu'il se trouverait, au sein de la classe dominante, des philanthropes éclairés et fortunés qui, comprenant la supériorité du communisme sur le capitalisme, seraient disposés à financer des projets de communautés idéales dont l'exemple ferait ensuite tâche d'huile. Comme l'histoire n'est pas faite par des individus mais par des classes, ces espérances furent déçues en quelques décennies. Même s'il s'est trouvé quelques rares membres de la bourgeoisie pour adhérer aux idées généreuses des utopistes, ([15] [1126]) l'ensemble de la classe dominante, comme telle, s'est évidemment détournée, quand elle n'a pas combattu, de telles tentatives qui avaient pour projet sa propre disparition.
Cela dit, le fait d'être une classe exploitée ne suffit nullement, comme on l'a vu, pour être une classe révolutionnaire. Par exemple, il existe encore aujourd'hui, dans le y\monde, et particulièrement dans les pays sous-développés, une multitude de paysans pauvres subissant l'exploitation sous forme d'un prélèvement sur le fruit de leur travail qui vient enrichir une partie de la classe dominante, soit directement, soit à travers les impôts, soit par les intérêts qu'ils versent aux banques ou aux usuriers auprès desquels ils sont endettés. C'est sur le constat de la misère, souvent insupportable, de ces couches paysannes que reposaient toutes les mystifications tiers-mondistes, maoïstes, guévaristes, etc. Lorsque ces paysans ont été conduits à prendre les armes, c'était comme fantassins de telle ou telle clique de la bourgeoisie qui s'est empressée, une fois au pouvoir, de renforcer encore l'exploitation, souvent sous des formes particulièrement atroces (voir, par exemple, l'aventure des Khmers rouges au Cambodge, dans la seconde moitié des années 70). Le recul de ces mystifications (que diffusaient tant les staliniens que les trotskistes et même certains «penseurs radicaux» comme Marcuse) n'est que la sanction de l'échec patent de la prétendue « perspective révolutionnaire » qu'aurait porté la paysannerie pauvre. En réalité, les paysans, bien qu'ils soient exploités de multiples façons et qu'ils puissent mener des luttes parfois très violentes pour limiter leur exploitation, ne peuvent jamais donner pour objectif à ces luttes l'abolition de la propriété privée puisqu'ils sont eux-mêmes de petits propriétaires ou que, vivant aux côtés de ces derniers, ils aspirent à le devenir.([16] [1127])
Et, même lorsque les paysans se dotent de structures collectives pour augmenter leur revenu à travers une amélioration de leur productivité ou de la commercialisation de leurs produits, c'est, en règle générale, sous la forme de coopératives, lesquelles ne remettent en cause ni la propriété privée, ni l'échange marchand ([17] [1128]) . En résumé, les classes et couches sociales qui apparaissent comme des vestiges du passé (exploitants agricoles, artisans, professions libérales, etc.), ([18] [1129]) qui ne subsistent que parce que le capitalisme, même s'il domine totalement l'économie mondiale, est incapable de transformer tous les producteurs en salariés, ne peuvent porter de projet révolutionnaire. Bien au contraire, la seule perspective dont elles puissent éventuellement rêver est celle d'un retour à un mythique «âge d'or» du passé : la dynamique de leurs luttes spécifiques ne peut être que réactionnaire.
En réalité, dans la mesure où l'abolition de l'exploitation se confond, pour l'essentiel, avec l'abolition du salariat, seule la classe qui subit cette forme spécifique d'exploitation, c'est-à-dire le prolétariat, est en mesure de porter un projet révolutionnaire. Seule la classe exploitée au sein des rapports de production capitalistes, produit du développement de ces rapports de production, est capable de se doter d'une perspective de dépassement de ces derniers.
Produit du développement de la grande industrie, d'une socialisation comme jamais l'humanité n'en a connue du processus productif, le prolétariat moderne ne peut rêver d'aucun retour en arrière.([19] [1130]) Par exemple, alors que la redistribution ou le partage des terres peut être une revendication «réaliste» des paysans pauvres, il serait absurde que les ouvriers, qui fabriquent de façon associée des produits incorporant des pièces, des matières premières et une technologie qui proviennent du monde entier, se proposent de découper leur entreprise en morceaux pour se la partager. Même les illusions sur l'autogestion, c'est-à-dire une propriété commune de l'entreprise par ceux qui y travaillent (ce qui constitue une version moderne de la coopérative ouvrière) commencent à avoir fait leur temps. Après de multiples expériences, y compris récentes (comme l'usine LIP en France, au début des années 1970) qui, en général, se sont soldées par un affrontement entre l'ensemble des travailleurs et ceux qu'ils avaient nommés comme gérants, la majorité des ouvriers est bien consciente que, face à la nécessité de maintenir la compétitivité de l'entreprise dans le marché capitaliste, autogestion veut dire auto-exploitation. C'est uniquement vers l'avant que peut regarder le prolétariat lorsque se développe sa lutte historique : non pas vers un morcellement de la propriété et de la production capitalistes, mais vers l'achèvement du processus de leur socialisation que le capitalisme a fait avancer de façon considérable mais qu'il ne peut, par nature, achever, même lorsqu'elles sont concentrées entre les mains d'un Etat national (comme c'était le cas dans les régimes staliniens).
Pour accomplir cette tâche, la force potentielle du prolétariat est considérable.
D'une part, dans la société capitaliste développée, l'essentiel de la richesse sociale est produite par le travail de la classe ouvrière même si, encore aujourd'hui, celle-ci est minoritaire dans la population mondiale. Dans les pays industrialisés, la part du produit national qu'on peut attribuer à des travailleurs indépendants (paysans, artisans, etc.) est négligeable. C'est même le cas dans les pays arriérés ou, pourtant, la majorité de la population vit (ou survit) du travail de la terre.
D'autre part, par nécessité, le capital a concentré la classe ouvrière dans des unités de production géantes, qui n'ont rien à voir avec ce qui pouvait exister du temps de Marx. En outre, ces unités de production sont elles-mêmes, en général, concentrées au coeur ou à proximité de villes de plus en plus peuplées. Ce regroupement de la classe ouvrière, tant dans ses lieux d'habitation que de travail, constitue une force sans pareil dès lors qu'elle sait le mettre à profit, en particulier par le développement de sa lutte collective et de sa solidarité.
Enfin, une des forces essentielles du prolétariat est sa capacité de prise de conscience. Toutes les classes, et particulièrement les classes révolutionnaires, se sont données une forme de conscience. Mais celle-ci ne pouvait être que mystifiée, soit que le projet mis en avant ne puisse aboutir (cas de la guerre des paysans en Allemagne, par exemple), soit que la classe révolutionnaire se trouve obligée de mentir, de masquer la réalité à ceux qu'elle voulait entraîner dans son action mais qu'elle allait continuer à exploiter (cas de la révolution bourgeoise avec ses slogans «Liberté, Egalité, Fraternité »). N'ayant, comme classe exploitée et porteuse d'un projet révolutionnaire qui abolira toute exploitation, à masquer ni aux autres classes, ni à lui-même, les objectifs et les buts ultimes de son action, le prolétariat peut développer, au cours de son combat historique, une conscience libre de toute mystification. De ce fait, celle-ci peut s'élever à un niveau de très loin supérieur à celui qu'a jamais pu atteindre la classe ennemie, la bourgeoisie. Et c'est bien cette capacité de prise de conscience qui constitue, avec son organisation en classe, la force déterminante du prolétariat.
Dans la seconde partie de cet article nous verrons comment le prolétariat d'aujourd'hui conserve, malgré toutes les campagnes qui évoquent sa «r disparition » ou son «r intégration », toutes les caractéristiques qui en font la classe révolutionnaire de notre temps.
FM.
« Autre conséquence, une classe fait son apparition, qui doit supporter toutes les charges de la société sans jouir de ses avantages ; une classe qui, jetée hors de la société, est reléguée de force dans l'opposition la plus résolue à toutes les autres classes ; une classe qui constitue la majorité de tous les membres de la société et d'où émane la conscience de la nécessité d'une révolution en profondeur, la conscience communiste, celle-ci pouvant, naturellement, se former aussi parmi les autres classes grâce à l'appréhension du rôle de cette classe. »
MARX, L'Idéologie Allemande.
[1] [1131] Voir notamment l'article « L'expérience russe, propriété privée et propriété collective » dans la Revue internationale n°61, 2e trimestre 1990, ainsi que notre série d'articles « Le communisme n'est pas un bel idéal, mais une nécessité matérielle ».
[2] [1132] Marx et Engels sont revenus par la suite sur cette affirmation en précisant qu'elle n'était valable qu'à partir de la dissolution de la communauté primitive dont l'existence fut confirmée par des travaux d'ethnologie de la seconde partie du 19è siècle, comme ceux de Morgan sur les indiens d'Amérique.
[3] [1133] Certains « penseurs » de la bourgeoisie (tel le politicien français du 19e siècle Guizot, qui fut chef du gouvernement sous le règne de Louis-Philippe) sont aussi parvenus à une telle idée.
[4] [1134] C'est valable également pour les économistes «classiques», tels Smith ou Ricardo, dont les travaux ont été particulièrement utiles pour le développement de la théorie marxiste.
[5] [1135] Il faut rendre à César ce qui est à César, et a Cornélius ce qui lui revient : avec une grande persévérance, les prévisions de ce dernier ont été démenties par les faits : n'avait-il pas «prévu» que, désormais, le capitalisme avait surmonté ses crises économiques (voir notamment ses articles sur «La dynamique du capitalisme» au début des années 1960 dans Socialisme ou Barbarie) ? N'avait-il pas annoncé à la face du monde, en 1981 (voir son livre Devant la guerre dont on attend toujours la seconde partie annoncée pour l'automne 1981), que l'URSS avait remporté de façon définitive la « guerre froide » (« déséquilibre massif en faveur de la Russie », « situation pratiquement impossible à redresser pour les Américains » ? De telles formules étaient vraiment les bienvenues à une époque où Reagan et la CIA essayaient de nous faire peur à propos de « L'empire du mal. ») Cela n'a pas empêché les médias de continuer à lui demander son avis d’expert face aux grands événements de notre époque : malgré sa collection de gaffes, il conserve la gratitude de la bourgeoisie pour ses convictions et ses discours péremptoires contre le marxisme, convictions qui sont justement à l'origine de ses échecs chroniques.
[6] [1136] Il est vrai que, dans beaucoup de pays, ces caractéristiques recouvrent partielle ment l'appartenance à des classes. Ainsi, dans beaucoup de pays du tiers-monde, notamment en Afrique, la classe dominante recrute la plupart de ses membres dans telle ou telle ethnie : cela ne signifie pas, cependant, que tous les membres de cette ethnie soient des exploiteurs, loin de là. De même, aux Etats-Unis, les WASP (White Anglo-Saxon Protestants) sont proportionnellement les plus représentés dans la bourgeoisie : cela n'empêche pas l'existence d'une bourgeoisie noire (Colin Powel, chef d'Etat-major, est noir) ni d'une multitude de « petits blanc » qui se débattent contre la misère.
[7] [1137] « Souverain,... nous sommes venus vers toi pour demander justice et protection. (...) Ordonne et jure de les [nos principaux besoins] satisfaire, et tu rendras la Russie puissante et glorieuse, tu imprimeras ton nom dans nos coeurs, dans les coeurs de nos enfants et petits enfants, à tout jamais. » Voici en quels termes la pétition ouvrière s'adressait au Tzar de toutes les Russies. Il faut préciser tout de même que cette pétition affirmait aussi : « La limite de la patience est atteinte; pour nous, voici venu le terrible moment où la mort vaut mieux que le prolongement d'insupportables tourments. (...) Si tu refuses d'entendre notre supplication, nous mourrons ici, sur cette place, devant ton palais. »
[8] [1138] Cette possession ne prend pas nécessairement, comme on l’a vu avec le développement du capitalisme d'Etat, et notamment sous sa version stalinienne, la forme d'une propriété individuelle, personnelle (et par exemple transmissible par héritage). C'est de plus en plus collectivement que la classe capitaliste « possède » (au sens où elle en dispose, les contrôle, en bénéficie) les moyens de production, y compris lorsque ces derniers sont étatisés.
[9] [1139] La petite bourgeoisie n'est pas une classe homogène. Il en existe de multiples variantes qui ne possèdent pas toutes des moyens matériels de production. Ainsi, les acteurs de cinéma, les écrivains, les avocats, par exemple, appartiennent à cette catégorie sociale sans pour autant disposer d'outils spécifiques. Leurs «moyens de production» résident dans un savoir ou un « talent » qu'ils mettent en oeuvre dans leur travail.
[10] [1140] Le serf n'était pas la simple « chose» du seigneur. Attaché à sa terre, il était vendu avec elle (ce qui est un point commun avec l'esclave). Cependant, il existait à l'origine un « contrat » entre le serf et le seigneur : ce dernier, qui possédait des armes, lui assurait protection en contrepartie du travail, par le serf, des terres seigneuriales (les corvées) ou du versement d'une partie de ses récoltes.
[11] [1141] Voir « Le communisme n'est pas un idéal..., I, Du communisme primitif au socialisme de l'utopie », Revue Internationale n°68, 1er trimestre 1992.
[12] [1142] Voir notamment notre brochure sur La décadence du capitalisme.
[13] [1143] A ce sujet, voir dans l'article « Le communisme n'est pas un bel idéal... » dans la Revue internationale n° 72, la façon dont la crise de surproduction exprime la faillite du capitalisme.
[14] [1144] Voir à ce sujet, « Le communisme n'est pas un bel idéal... » dans la Revue internationale n°68.
[15] [1145] Owen en faisait partie qui, initialement grand industriel du textile, fit plusieurs tentatives, tant en Grande-Bretagne qu'aux Etats-Unis, pour créer des communautés qui finirent par se briser devant les lois capitalistes. Il contribua néanmoins à l'apparition des Trade-unions, les syndicats britanniques. Les utopistes français eurent encore moins de succès dans leurs entreprises. Pendant des années, Fourier attendit tous les jours à son bureau, en vain, que se présente le mécène qui allait financer sa cité idéale, et les tentatives de construction de « phalanstères » de ses disciples (notamment aux Etats-Unis) aboutirent à des faillites économiques désastreuses. Quant aux doctrines de Saint-Simon, si elles eurent plus de succès, c'est en tant que credo de toute une série d'hommes de la bourgeoisie tels les frères Pereire, fondateurs d'une banque, ou Ferdinand de Lesseps, le constructeur du canal de Suez.
[16] [1146] Il existe un prolétariat agricole dont le seul moyen d'existence est de vendre contre salaire sa force de travail aux propriétaires des terres. Cette partie de la paysannerie appartient à la classe ouvrière et constituera, au moment de la révolution, sa tête de pont dans les campagnes. Cependant, vivant son exploitation comme conséquence d'une <r malchance » qui l'a privé de l'héritage d'une terre, ou qui lui a attribué une parcelle trop petite, le salarié agricole, qui souvent est saisonnier ou commis dans une exploitation familiale, tend, la plupart du temps, à se rallier au rêve d'une accession à la propriété et d'un meilleur partage des terres. Seule la lutte, à un stade avancé, du prolétariat urbain lui permettra de se détourner de ces chimères en lui proposant comme perspective la socialisation de la terre au même titre que des autres moyens de production.
[17] [1147] Cela n'empêche pas que, au cours de la période de transition du capitalisme au communisme, le regroupement des petits propriétaires terriens dans des coopératives pourra constituer une étape vers la socialisation des terres, notamment en leur permettant de surmonter l'individualisme résultant de leur cadre de travail.
[18] Ce qui est vrai pour les paysans Test encore plus pour les artisans dont la place dans la société s'est réduite de façon bien plus radicale encore que pour les premiers. Pour ce qui concerne les professions libérales (médecins privés, avocats, etc.), leur statut social et leurs revenus (qui les font regarder avec envie du côté de la bourgeoisie) ne les incitent en aucune manière à remettre en cause Tordre existant. Quant aux étudiants, dont la définition même indique qu'ils n'ont encore aucune place dans l'économie, leur destin est de se scinder entre les différentes classes dont ils proviennent par leurs origines familiales ou auxquelles ils se destinent.
[19] [1148] A l'aube du développement de la classe ouvrière, certains secteurs de celle-ci, mis au chômage à cause de l'introduction de nouvelles machines, avaient dirigé leur révolte contre ces machines en les détruisant. Cette tentative de retour en arrière n'était qu'une forme embryonnaire de la lutte ouvrière qui fut vite dépassée par le développement économique et politique du prolétariat.
Géographique:
- Europe [95]
Questions théoriques:
- Le cours historique [17]
Heritage de la Gauche Communiste:
Le communisme n'est pas un bel idéal mais une nécessite matérielle [6°partie]
- 3682 reads
Les révolutions de 1848 : la perspective
communiste se clarifie.
Comme on l'a vu dans l'article précédent ([1] [1150]), le Manifeste communiste prévoyait une explosion révolutionnaire imminente. Il n'était pas seul à l'attendre :
« ... il était assez significatif que la conscience d'une révolution sociale imminente... ne se limitât pas aux révolutionnaires qui l'exprimaient de la façon la plus élaborée, ni aux classes dominantes dont la peur des masses appauvries n'est jamais bien loin sous la surface aux époques de changement social. Les pauvres eux-mêmes la sentaient. Les couches instruites l'exprimaient. "Tous les gens bien informés", écrivait d'Amsterdam le consul américain durant la famine de 1847, rapportant les sentiments des émigrants allemands qui traversaient la Hollande, "pensent que la crise est si inextricablement mêlée aux évènements de l'époque actuelle qu"elle' n'est que le commencement de cette grande Révolution qu'ils considèrent être appelée, tôt ou tard, à dissoudre l'état de choses existant". »([2] [1151])
Confiant dans le fait que d'énormes soulèvements sociaux étaient sur le point d'éclater, mais conscient du fait que les nations d'Europe n'étaient pas toutes à la même étape de développement historique, le Manifeste communiste, dans sa dernière partie, met en avant certaines considérations tactiques pour l'intervention de la minorité communiste.
La démarche générale reste la même dans tous les cas : « Les communistes combattent pour les intérêts et les buts immédiats de la classe ouvrière ; mais dans ce mouvement du présent, ils représentent en même temps l'avenir. (...) les communistes appuient partout les mouvements révolutionnaires contre les institutions sociales et politiques existantes. Dans tous ces mouvements, ils mettent en avant la question de la propriété, quel que soit le degré de développement qu'elle ait pu atteindre : c'est la question fondamentale. »([3] [1152])
Plus concrètement, reconnaissant que la majorité des pays d'Europe n'avait même pas encore atteint l'étape de la démocratie bourgeoise, que l'indépendance nationale et l'unification constituaient encore la question centrale dans des pays comme l'Italie, la Suisse et la Pologne, les communistes s'engageaient dans la lutte aux côtés des partis démocrates bourgeois et des partis de la petite-bourgeoise radicale, contre les vestiges de la stagnation féodale et de l'absolutisme.
La tactique est expliquée particulièrement en détail en ce qui concerne l'Allemagne : « C'est sur l'Allemagne que les communistes concentrent surtout leur attention. Ce pays se trouve à la veille d'une révolution bourgeoise. Cette révolution, l'Allemagne l'accomplit donc dans des conditions plus avancées de civilisation européenne, et avec un prolétariat plus développé que l'Angleterre et la France n'en possédaient au XVII° et au XVIII° siècles. Par conséquent, en Allemagne, la révolution bourgeoise sera forcément le prélude immédiat d'une révolution prolétarienne. »([4] [1153])
Donc, la tactique consistait à soutenir la bourgeoisie dans la mesure où elle menait la révolution antiféodale, mais de toujours défendre l'autonomie du prolétariat, par dessus tout dans l'attente d'une révolution prolétarienne qui suivrait immédiatement. Dans quelle mesure les événements de 1848 ont-ils donné raison à ces pronostics ? Et quelles leçons Marx et son « parti » ont-ils tiré, au lendemain de ces évènements ?
La révolution bourgeoise et le spectre du prolétariat
Comme on l'a dit, les pays d'Europe se trouvait, en 1848, à des niveaux sociaux et politiques différents. C'est seulement en Grande-Bretagne que le capitalisme était pleinement développé et que la classe ouvrière constituait la majorité de la population. En France, la classe ouvrière avait acquis une expérience de base considérable, à travers la participation à une série de soulèvements révolutionnaires depuis 1789. Mais sa maturité politique relative se restreignait quasiment totalement au prolétariat de Paris, et, même à Paris, la production industrielle à grande échelle n'en était encore qu'à ses débuts, ce qui signifiait que les fractions politiques de la classe ouvrière (Blanquistes, Proudhoniens, etc.) tendaient à refléter le poids des préjugés et des conceptions obsolètes de l'artisanat. Quant au reste de l'Europe - l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, les régions centrales et orientales - les conditions politiques et sociales y étaient extrêmement arriérées. Ces régions étaient, pour leur plus grande partie, divisées en une mosaïque de petits royaumes et n'existaient pas comme Etats nationaux centralisés. Des vestiges féodaux de toutes sortes pesaient lourdement sur la société et la structure de l'Etat.
Aussi, dans la majorité de ces pays, l'achèvement de la révolution bourgeoise était-il la première chose à l'ordre du jour : se débarrasser des vieux restes de féodalité, établir des Etats nationaux unifiés, instaurer le régime politique de la démocratie bourgeoise. Et cependant, bien des choses avaient changé depuis l'époque de la révolution bourgeoise « classique » de 1789, introduisant toute une série de complications et de contradictions dans la situation. Au départ, les soulèvements révolutionnaires de 1848 ne furent pas tant provoqués par une crise de la « féodalité »que par l'une des grandes crises cycliques du capitalisme juvénile : la grande dépression de 1847 qui, arrivant dans le sillage d'une série de moissons désastreuses, avait réduit le niveau de vie des masses à un niveau intolérable. Deuxièmement, ce sont, avant tout, les masses urbaines de prolétaires ou de semi-prolétaires de Paris, Berlin, Vienne et d'autres villes qui ont mené les soulèvements contre le vieil ordre. Et comme le Manifeste l'avait montré, le prolétariat était déjà devenu une force distincte, bien plus qu'il ne l'avait été en 1789 ; non seulement au niveau social mais également sur le plan politique. La montée du mouvement Chartiste en Grande-Bretagne l'avait confirmé. Mais c'est, d'abord et avant tout, le grand soulèvement de juin 1848 à Paris qui a vérifié la réalité du prolétariat tel qu'il est défini dans le Manifeste : une force politique indépendante irrévocablement opposée à la domination du capital.
En février 1848, la classe ouvrière parisienne avait constitué la force principale derrière les barricades, dans le soulèvement qui avait renversé la monarchie de Louis-Philippe et instauré la République. Mais au cours des mois suivants, l'antagonisme entre le prolétariat et la bourgeoisie « démocratique » était devenu ouvert et aigu, au fur et à mesure que cette dernière montrait clairement qu'elle était incapable, pratiquement, de faire quoi que ce soit pour soulager la détresse économique du premier. La résistance du prolétariat fut formulée dans la revendication confuse du « droit au travail », lorsque le gouvernement ferma les Ateliers nationaux qui avaient apporté aux ouvriers un minimum de secours face au chômage. Néanmoins, comme le défend Marx dans Les luttes de classe en France, écrit en 1850, derrière ce slogan dérisoire s'expriment les débuts d'un mouvement pour la suppression de la propriété privée. Il est certain que la bourgeoisie elle-même était consciente de ce danger ; lorsque les ouvriers parisiens firent des barricades pour défendre les Ateliers nationaux, le soulèvement fut réprimé avec la plus grande férocité : « On sait que les ouvriers, avec un courage et un génie sans exemple, sans chefs, sans plan commun, sans ressources, pour la plupart manquant d'armes, tinrent en échec cinq jours durant l'armée, la garde nationale de Paris ainsi que la garde nationale qui afflua de la province. On sait que la bourgeoisie se dédommagea de ses transes mortelles par une brutalité inouïe et massacra plus de 3 000 prisonniers.»([5] [1154])
En fait, ce soulèvement confirma les pires craintes de la bourgeoisie dans toute l'Europe, et son issue devait avoir de profondes conséquences sur le développement ultérieur du mouvement révolutionnaire. Traumatisée par le spectre du prolétariat, l'assurance de la bourgeoisie s'affaiblit et elle se trouva incapable de poursuivre sa propre révolution contre l'ordre établi. Ceci fut bien sûr amplifié par des facteurs matériels : dans les pays dominés par l'absolutisme, l'appréhension de la bourgeoisie était aussi le produit de son développement économique et politique tardif. De toutes façons le résultat fut que, plutôt que de faire appel à l'énergie des masses pour mener sa bataille contre le pouvoir féodal, comme elle l'avait fait en 1789, la bourgeoisie se compromit de plus en plus avec la réaction afin de contenir le danger qui venait « d'en bas » . Ce compromis prit des formes diverses. En France, il produisit l'étrange anomalie d'un second Bonaparte qui s'infiltra dans la brèche du pouvoir parce que les mécanismes « démocratiques » de la bourgeoisie semblaient uniquement ouvrir la porte aux vents froids de l'agitation sociale et de l'instabilité politique. En Allemagne, il fut incarné par la timidité et la mollesse particulières de la bourgeoisie dont le manque de résistance face à la réaction absolutiste fut si souvent stigmatisé par Marx, en particulier dans l'article « La bourgeoisie et la contre-révolution » publié dans la Neue Reinische Zeitung du 15 décembre 1848: « La bourgeoisie allemande avait évolué avec tant d'indolence, de lâcheté, de lenteur qu'au moment où elle se dressa menaçante en face du féodalisme et de l'absolutisme, elle aperçut en face d'elle le prolétariat menaçant ainsi que toutes les fractions de la bourgeoisie dont les idées et les intérêts sont apparentés à ceux du prolétariat. » Cela la rendait « indécise face à chacun de ses adversaires pris séparément parce qu'elle les voyait toujours tous les deux devant ou derrière elle ; encline dès l'abord à trahir le peuple et à tenter des compromis avec le représentant couronné de l'ancienne société... sans foi en elle-même, sans foi dans le peuple, montrant les dents à ceux d'en haut, tremblant devant ceux d'en bas... telle un vieillard maudit, affaibli par l'âge, elle se voyait condamnée à diriger et à détourner, dans son propre intérêt, les premières manifestations de jeunesse d'un peuple robuste - sans yeux ! Sans oreilles ! Sans dents ! Sans rien - c'est ainsi que la bourgeoisie prussienne se trouva après la révolution de mars à la barre de l'Etat prussien. »([6] [1155])
Mais bien que la bourgeoisie fût « mortellement terrorisée » par le prolétariat, ce dernier n'était pas assez mûr, historiquement parlant, pour assumer la direction politique des révolutions. Déjà la puissante classe ouvrière britannique se trouvait quelque peu isolée des événements qui se déroulaient sur le continent européen ; et le Chartisme, en dépit de l'existence d'une tendance consistante sur son aile gauche, cherchait avant tout à faire une place à la classe ouvrière à l'intérieur de la société « démocratique », c'est-à-dire bourgeoise. Il est certain que la bourgeoisie britannique fut assez intelligente pour trouver un moyen d'intégrer graduellement la revendication du suffrage universel de telle sorte que, loin de menacer le règne politique du capital, comme Marx lui-même l'avait pensé, elle en devint l'un des piliers. A côté de cela, au moment même où l'Europe continentale était traversée par tous ces soulèvements, le capitalisme britannique se trouvait à la veille d'une nouvelle phase d'expansion. En France, bien que la classe ouvrière y ait fait les plus grands progrès politiques, elle n'avait pas été capable d'échapper aux pièges de la bourgeoisie, et encore moins de se poser comme porteuse d'un nouveau projet social. Le soulèvement de juin 1848 avait, en fait, été pratiquement provoqué par la bourgeoisie, et les aspirations communistes qu'il contenait, étaient restées plus implicites qu'explicites. Comme le dit Marx dans Les luttes de classe en France : « Ce fut la bourgeoisie qui contraignit le prolétariat de Paris à l'insurrection de Juin. De là son arrêt de condamnation. Ni ses besoins immédiats avoués ne le poussaient à vouloir obtenir par la violence le renversement de la bourgeoisie, il n'était pas encore de taille à accomplir cette tâche. Force fut au Moniteur de lui apprendre officiellement que le temps n'était plus où la République jugeait à propos de rendre les honneurs à ses illusions, et seule la défaite le convainquit de cette vérité que la plus infime amélioration de sa situation reste une utopie au sein de la République bourgeoise, utopie qui se change en crime dès qu'elle veut se réaliser. »([7] [1156])
Aussi, loin d'arriver rapidement à une révolution prolétarienne comme le Manifeste l'avait espéré, les mouvements de 1848 aboutirent-ils à peine à l'achèvement par la bourgeoisie de sa propre révolution.
L'intervention de la
Ligue des Communistes
Les révolutions de 1848 soumirent ainsi très tôt la Ligue des Communistes à l'épreuve du feu. Rarement a été accordée à une organisation communiste, si rapidement après sa naissance, la récompense parfois incertaine d'être plongée dans le grand bain d'un gigantesque mouvement révolutionnaire. Marx et Engels, ayant opté pour l'exil politique loin du régime débilitant des Junkers, retournèrent en Allemagne pour prendre part aux événements vers lesquels les guidaient nécessairement leurs convictions. Etant donnée l'absence totale d'expérience directe de la Ligue des Communistes dans des événements d'une telle échelle, il aurait été surprenant que le travail mené par cette organisation durant cette période - y compris celui des ses éléments les plus avancés théoriquement - fût exempt d'erreurs ; il y en eut parfois de très sérieuses. Mais la question de fond, ce n'est pas de savoir si la Ligue des Communistes a commis des erreurs, mais si l'ensemble de son intervention était cohérent avec les tâches fondamentales qu'elle s'était donnée dans sa prise de position sur les principes politiques et la tactique, dans le Manifeste Communiste.
L'une des caractéristiques les plus frappantes de l'intervention de la Ligue des Communistes dans la révolution allemande de 1848, c'est son opposition à l'extrémisme révolutionnaire facile. Aux yeux de la bourgeoisie - ou tout au moins dans ses organes de propagande - les communistes constituaient le nec plus ultra du fanatisme et du terrorisme, de féroces facteurs de destruction et de nivellement social forcé. Durant cette période, on parlait de Marx lui-même comme du « Docteur Terreur Rouge » et il fut constamment accusé de préparer de sournois complots pour assassiner les têtes couronnées de l'Europe. En réalité, l'activité du « parti de Marx » dans cette période fut remarquable pour sa sobriété.
D'abord, durant les premiers jours grisants de la révolution, Marx s'opposa publiquement au romantisme révolutionnaire des « légions » créées en France par des révolutionnaires expatriés et , qui avaient pour but de ramener la révolution en Allemagne à la pointe de la baïonnette. A l'encontre de cela, Marx souligna que la révolution n'était pas en premier lieu une question militaire, mais surtout une question sociale et politique ; il mit sèchement en évidence que la bourgeoisie française K démocratique» ne serait que trop heureuse de voir ces troublions révolutionnaires allemands partir combattre les tyrans féodaux d'Allemagne - et qu'elle n'avait pas négligé d'avertir comme il convient les autorités allemandes de leur arrivée. Dans le même ordre d'idées, Marx prit position contre un soulèvement isolé et intempestif à Cologne dans la phase déclinante de la révolution, puisqu'il aurait encore une fois mené les masses dans les bras tendus de la réaction qui avait pris des mesures explicites pour provoquer ce soulèvement.
Au niveau politique plus global, Marx a dû également combattre les communistes qui croyaient que la révolution des ouvriers et l'avènement du communisme étaient à l'ordre du jour à court terme ; ceux qui dédaignaient la lutte pour la démocratie politique bourgeoise et considéraient que les communistes ne devaient parler que des conditions de la classe ouvrière et de la nécessité du communisme. A Cologne où Marx passa la plus grande partie de la période révolutionnaire comme éditeur du journal démocrate radical, la Neue Reinische Zeitung, le principal défenseur de ce point de vue était le bon Dr Gotteschalk qui se considérait comme un véritable homme du peuple et critiquait sévèrement Marx de n'être rien d'autre qu'un terroriste de salon, puisque celui-ci défendait de façon si opiniâtre que l'Allemagne n'était pas mûre pour le communisme, que la bourgeoisie devait d'abord venir au pouvoir et faire sortir l'Allemagne de son arriération féodale, et que, par conséquent, la tâche des communistes était de soutenir la bourgeoisie « sur la gauche », de participer au mouvement populaire pour faire en sorte qu'il pousse sans cesse la bourgeoisie à aller jusqu'aux limites extrêmes de son opposition à l'ordre féodal.
En termes d'organisation pratique, cela signifiait la participation aux Unions démocratiques qui surgirent, comme leur nom l'indique, en vue de rassembler tous ceux qui luttaient de façon décidée et sincère contre l'absolutisme féodal et pour l'instauration de structures politiques démocratiques bourgeoises. Mais l'on peut dire qu'en réagissant contre les excès volontaristes de ceux qui voulaient sauter d'un seul coup par dessus la phase démocratique bourgeoise, Marx est allé trop loin dans l'autre direction et a oublié certains des principes établis dans le Manifeste. A Cologne, la tendance de Gotteschalk constituait la majorité de la Ligue, et pour contrer son influence, à un moment donné, Marx a dissous complètement la Ligue Politiquement la Neue Reinische Zeitung continua pendant toute une période sans rien dire sur les conditions de la classe ouvrière, et en particulier sur la nécessité que les ouvriers gardent leur autonomie politique face à toutes les fractions de la bourgeoisie et de la petite-bourgeoisie. C'était à peine compatible avec les notions d'indépendance du prolétariat mises en avant dans le Manifeste et, comme nous le verrons, Marx fit son autocritique sur cette question, en particulier dans ses premières tentatives de dresser un bilan de l'activité de la Ligue des communistes dans le mouvement. Mais la question fondamentale reste : ce qui a guidé Marx durant cette période, comme pendant toute sa vie, c'était la reconnaissance que le communisme était plus qu'une nécessité en termes de besoin humain fondamental : il devait aussi être une possibilité réelle étant données les conditions objectives atteintes par le développement social et historique. Ce débat devait aussi ressurgir dans la Ligue au lendemain de la révolution.
Leçons de la défaite : la nécessité de l'autonomie du prolétariat
Par bien des aspects, les contributions politiques les plus importantes de la Ligue des Communistes, à part évidemment le Manifeste lui-même, sont les documents élaborés au lendemain des mouvements de 1848 ; le « bilan » que l'organisation tira concernant sa propre participation aux révoltes. Cela est vrai, même si les débats que ces documents expriment ou provoquent ont amené à une scission fondamentale et à la dissolution, dans les faits, de l'organisation.
Dans la circulaire du Comité central de la Ligue des Communistes, publiée en mars 1850, il y a une critique - en fait une autocritique puisque c'est Marx lui-même qui l'a rédigée - des activités de la Ligue durant les événements révolutionnaires. Le document, tout en reconnaissant sans hésitation que les pronostics politiques généraux de la Ligue avaient été amplement confirmés par les événements révolutionnaires, et que ses membres avaient été les combattants les plus déterminés de la cause révolutionnaire, montre que l'affaiblissement organisationnel de la Ligue - en fait sa dissolution dans les premières étapes de la révolution en Allemagne - avait gravement exposé la classe ouvrière à la domination politique des démocrates petit-bourgeois : « ...l'ancienne et solide organisation de la Ligue s'est considérablement relâchée. Beaucoup de membres, directement engagés dans le mouvement révolutionnaire, se sont imaginé que le temps des sociétés secrètes était passé et que l'action publique pouvait suffire seule. Un certain nombre de cercles et de communes (les unités de base de l'organisation de la Ligue) ont laissé leurs relations avec le conseil central se relâcher et s'assoupir peu à peu. Tandis que le parti démocratique, le parti de la petite-bourgeoisie, s'organisait donc de plus en plus en Allemagne, le parti ouvrier perdait son seul lien solide ; c'est tout au plus s'il conservait dans quelques localités, son organisation en vue de buts locaux ; et c'est pour cela que, dans le mouvement général, il est tombé complètement sous la domination et la direction des démocrates petits-bourgeois. Il faut mettre fin à cet état de choses et rétablir l'autonomie des ouvriers. » ([8] [1157]). Il n'y a aucun doute sur le fait que, dans ce texte, l'élément le plus important est la claire défense de la nécessité de lutter pour l'indépendance organisationnelle et politique la plus totale de la classe ouvrière, même durant les révolutions menées par d'autres classes.
C'était une nécessité pour deux raisons.
D'abord, si comme en Allemagne, la bourgeoisie se montrait incapable d'accomplir ses propres tâches révolutionnaires, le prolétariat devait agir et s'organiser de façon indépendante pour accélérer la révolution malgré les réticences et le conservatisme de la bourgeoisie : ici, le modèle est constitué, dans une certaine mesure, par la première Commune de Paris, celle de 1793 où les masses « populaires» s'étaient organisées en assemblées et en sections locales, centralisées au niveau de la ville dans la Commune, afin de pousser la bourgeoisie jacobine à poursuivre l'élan de la révolution.
En même temps, même si les éléments démocrates les plus radicaux venaient au pouvoir, ils seraient contraints, par la logique de leur position, de se retourner contre les ouvriers et de les soumettre à l'ordre et à la discipline bourgeoise, dès qu'ils seraient devenus les nouveaux timoniers de l'Etat. Cela s'était avéré en 1793 et après, quand la bourgeoisie s'était mise à découvrir de plus en plus d' « ennemis à gauche » ; ça avait été démontré dans le sang par les journées de juin 1848 à Paris ; et selon Marx, cela aurait encore lieu lors de la prochaine reprise révolutionnaire en Allemagne. Marx prévoyait qu'à la suite de l'échec de la bourgeoisie libérale, de son incapacité à s'affronter au pouvoir absolutiste, les démocrates petit-bourgeois seraient portés à la direction du prochain gouvernement révolutionnaire mais qu'ils tenteraient aussi sur le champ de désarmer et d'attaquer la classe ouvrière. Et pour cette raison même, le prolétariat ne pouvait se défendre de telles attaques qu'en maintenant son indépendance de classe. Cette indépendance comportait trois dimensions :
- L'existence et l'action d'une organisation communiste en tant que fraction politique la plus avancée de la classe :
« En ce moment, où les petits-bourgeois démocratiques sont partout opprimés, ils prêchent en général au prolétariat l'union et la réconciliation ; ils lui tendent la main et s'efforcent de constituer un grand parti d'opposition, qui embrasse toutes les nuances du parti démocratique ; en d'autres termes, ils s'efforcent d'enrôler les ouvriers dans une organisation de parti où prédominent les lieux communs généraux de la social-démocratie servant de paravent à leurs intérêts particuliers, et où défense est faite, pour ne pas troubler la bonne entente, de mettre en avant les revendications précises du prolétariat. Une telle union tournerait uniquement à l'avantage des petits-bourgeois démocratiques et tout à fait au désavantage du prolétariat. Le prolétariat perdrait en totalité sa situation indépendante, achetée par tant de peines, et retomberait au rang de simple annexe de la démocratie bourgeoise officielle. Cette union doit donc être repoussée de la façon la plus catégorique. Au lieu de se ravaler une fois encore à servir de claque aux démocrates bourgeois, les ouvriers, et surtout la Ligue, doivent travailler à constituer, à côté des démocrates officiels, une organisation autonome, secrète et publique, du parti ouvrier, et à faire de chaque commune le centre et le noyau de groupements ouvriers où la position et les intérêts du prolétariat seront discutés indépendamment d'influences bourgeoises. »([9] [1158]).
- Le maintien des revendications autonomes de classe, soutenues par des organisations unitaires de la classe, c'est-à-dire des organes regroupant tous les ouvriers en tant qu'ouvriers :
« Pendant la lutte et après la lutte, les ouvriers doivent en toute occasion formuler leurs propres revendications à côté des revendications des démocrates bourgeois. Il faut qu'ils exigent des garanties pour les ouvriers, dès que les bourgeois démocratiques se disposent à prendre le gouvernement en mains. Il faut, au besoin, qu'ils obtiennent ces garanties de haute lutte et s'arrangent en somme pour obliger les nouveaux gouvernants à toutes les concessions et à toutes les promesses possibles ; c'est le plus sûr moyen de les compromettre. L'ivresse du triomphe et l'engouement pour le nouvel état de choses, conséquence de toute victoire remportée dans la rue, il faut qu'ils s'ingénient à les amortir le plus possible, en jugeant avec calme et sang-froid la situation et en affectant à l'égard du nouveau gouvernement une méfiance non déguisée. Il faut qu'à côté des nouveaux gouvernements officiels, ils établissent en même temps leurs propres gouvernements ouvriers révolutionnaires, soit sous forme de municipalités ou de conseils municipaux, soit par des clubs ou des comités ouvriers, de telle façon que les gouvernements démocratiques bourgeois non seulement perdent aussitôt l'appui des ouvriers, mais se sentent, de prime abord, surveillés et menacés par des autorités ayant derrière elles toute la masse des ouvriers. En un mot : aussitôt la victoire acquise, la méfiance du prolétariat ne doit plus se tourner contre le parti réactionnaire vaincu, mais contre ses anciens alliés, contre le parti qui veut exploiter seul la victoire commune. »([10] [1159]).
- Ces organes doivent être armés ; à aucun moment le prolétariat ne doit se faire piéger en rendant ses armes au gouvernement officiel :
« Mais pour pouvoir prendre une attitude énergique et menaçante à l'égard de ce parti, dont la trahison envers les ouvriers commencera dès la première heure de la victoire, il faut que les ouvriers soient armés et organisés. Il faut faire immédiatement le nécessaire pour que tout le prolétariat soit armé de fusils, de carabines, de canons et qu'il ait des munitions ; et il faut, par contre, s'opposer au rétablissement de l'ancienne garde nationale dirigée contre les ouvriers. Là où ce rétablissement ne peut être empêché, les ouvriers doivent essayer de s'organiser en garde prolétarienne autonome, avec des chefs élus par eux-mêmes et son propre état-major également élu par eux, et sous les ordres, non pas du pouvoir public, mais des conseils municipaux révolutionnaires formés par les ouvriers. Là où les ouvriers sont occupés au compte de l'Etat, il faut qu'ils fassent en sorte d'être armés et organisés en un corps spécial avec des chefs de leur choix ou un détachement de la garde prolétarienne. Il ne faut, sous aucun prétexte, se dessaisir des armes et des munitions, et il faut empêcher, au besoin par la force, toute tentative de désarmement. »([11] [1160]).
Ces conclusions, ces définitions de ce qu'entraîne pratiquement l'indépendance de classe dans une situation révolutionnaire, ne revêtent pas tant une importance comme prescription pour un type de révolution qui n'était plus véritablement à l'ordre du jour, mais en tant qu'anticipation historique d'un futur facilement reconnaissable - celui des grands conflits révolutionnaires de 1871, 1905 et 1917, où la classe ouvrière a dû créer ses propres organes de combat politique et se présenter comme candidat possible au pouvoir. Dans la circulaire de la Ligue, on trouve toute la notion de la dualité de pouvoir, dans une situation sociale dans laquelle la classe ouvrière commence à atteindre un degré d'autonomie politique et organisationnelle tel qu'elle constitue une menace directe envers la direction bourgeoise de la société ; et au-delà de l'instabilité inhérente à toute situation de dualité de pouvoir, la notion de dictature du prolétariat, de prise et d'exercice du pouvoir politique par la classe ouvrière organisée. Dans le texte de la Ligue, apparaît l'idée que les formes embryonnaires de ce pouvoir prolétarien surgissent en dehors et contre les organes officiels de l'Etat bourgeois. Elles sont (Marx se réfère ici spécifiquement aux clubs ouvriers) une « coalition de toute la classe ouvrière contre toute la classe bourgeoise - la formation d'un Etat ouvrier contre l'Etat bourgeois. »([12] [1161]) Ces lignes contiennent par conséquent les germes de la position selon laquelle la prise du pouvoir par la classe ouvrière n'implique pas la prise de l'appareil d'Etat existant, mais sa destruction violente par les propres organes ouvriers de pouvoir. Les germes seulement car cette position n'avait été aucunement clarifiée par une expérience historique décisive : bien que Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte fasse, en passant, explicitement référence à la nécessité de détruire l'Etat plutôt que de le contrôler - « Toutes les révolutions politiques n'ont fait que perfectionner cette machine, au lieu de la briser, »([13] [1162]) -, à la même époque Marx était encore convaincu que les ouvriers pourraient parvenir au pouvoir dans certains pays (comme en Grande-Bretagne) à travers le suffrage universel. La question était traitée en fonction des conditions nationales particulières et non comme un problème de principe général.
Cette question ne fut pas pleinement clarifiée tant que le mouvement historique réel n'est pas intervenu de façon décisive dans la discussion : c'est la Commune de Paris qui la tranchera. Mais nous pouvons déjà voir la continuité entre les conclusions tirées à partir de la Commune, selon lesquelles le pouvoir politique du prolétariat requiert l'apparition d'un nouveau réseau d'organes de classe, un «État» révolutionnaire centralisé qui ne peut vivre à côté de l'appareil d'Etat existant. On voit ici la profondeur de vue « prophétique » de Marx ; mais ces prévisions ne sont pas de simples spéculations. Elles sont solidement enracinées dans l'expérience passée ; l'expérience de la première Commune de Paris, des clubs et des sections révolutionnaires de 1789-95 et surtout des journées de juin 1848 en France où le prolétariat a surgi et s'est armé comme force sociale distincte, mais fut écrasé, dans une grande mesure, parce qu'il était insuffisamment armé politiquement. Si l'on ne tient pas compte des limites historiques au sein desquelles ces textes de la Ligue furent rédigés, les leçons qu'ils contiennent sur la nécessité d'une action et d'une organisation indépendantes de la classe ouvrière restent toujours aussi essentielles ; sans cela, la classe ouvrière ne prendra jamais le pouvoir et le communisme ne sera vraiment rien de plus qu'un rêve.
La révolution permanente : de façon permanente non réalisée.
Néanmoins, nous ne pouvons ignorer le fait que ces appels à l'autonomie prolétarienne furent lancés dans une perspective historique particulière : celle de la « révolution permanente ».
Le Manifeste avait envisagé une transition rapide de la révolution bourgeoise en révolution prolétarienne en Allemagne. Comme nous l'avons dit, l'expérience réelle de 1848 avait convaincu Marx et sa tendance du fait que la bourgeoisie allemande était congénitalement incapable de mener sa propre révolution ; que lors de la prochaine explosion révolutionnaire, que la Circulaire de mars 1850 voyait encore comme une perspective à court terme, les démocrates petit-bourgeois, les «social-démocrates » comme on les appelait parfois à l'époque, viendraient au pouvoir. Mais cette couche sociale se montrerait également incapable de mener la destruction complète des rapports féodaux et allait être, de toutes façons, forcée d'attaquer et de désarmer le prolétariat dès qu'elle assumerait une fonction gouvernementale. La tâche d'achever véritablement la révolution bourgeoise reviendrait donc au prolétariat, mais ce faisant, ce dernier serait contraint d'aller de l'avant, vers sa propre révolution communiste.
Le fait que ce schéma était inapplicable aux conditions très arriérées de l'Allemagne, fut ensuite, comme nous le verrons, rapidement reconnu par Marx, lorsqu'il prit conscience que le capitalisme européen se trouvait encore dans sa phase pleinement ascendante. Ceci est également reconnu par les commentateurs et les historiens gauchistes. Mais selon ces derniers, « la tactique de la révolution permanente, bien qu'inapplicable dans l'Allemagne de 1850, a constitué un legs politique valable pour le mouvement ouvrier. Elle fut proposée par Trotski dans la Russie de 1905, bien que Lénine ait encore considéré comme prématurée la tentative de transformer la révolution bourgeoise en révolution prolétarienne. En 1917 cependant, dans le contexte de la crise européenne apportée par la guerre mondiale, Lénine et le parti bolchevik furent capables d'appliquer victorieusement la tactique de la révolution permanente, menant la révolution russe cette année là, du renversement du tsarisme au renversement du capitalisme lui-même. »([14] [1163]).
En réalité, c'est l'idée même de la révolution permanente qui était basée sur une insoluble énigme : l'idée qu'en même temps que la révolution prolétarienne serait possible dans certains pays, d'autres parties du monde auraient (ou ont) encore des tâches bourgeoises à achever ou des étapes à franchir. C'était un problème authentique pour Marx, mais il fut dépassé par l'évolution historique elle-même qui démontra que le capitalisme ne pouvait poser les conditions de la révolution prolétarienne qu'à l'échelle mondiale. C'est en tant que système international unique que le capitalisme, avec l'éclatement de la première guerre mondiale, est entré dans sa phase de décadence, dans l' « époque de guerres et de révolutions ». La tâche qui se présentait au prolétariat en Russie n'était pas l'achèvement de quelque étape bourgeoise, mais la prise du pouvoir politique comme premier pas vers la révolution prolétarienne mondiale. Contrairement aux apparences, Février 17 ne fut pas une « révolution bourgeoise», et ne représenta pas l'accession au pouvoir d'une couche sociale intermédiaire. Février 1917 fut une révolte prolétarienne face à laquelle toutes les forces de la bourgeoise firent tout ce qui était en leur pouvoir pour la dévoyer et la défaire ; ce qui fut très rapidement prouvé c'est que toutes les fractions de la bourgeoisie, loin d'être « révolutionnaires », se consacrèrent corps et âme à la guerre impérialiste et à la contre-révolution, et que la petite-bourgeoisie et d'autres couches intermédiaires ne disposaient d'aucun programme politique ou social propre, mais étaient condamnées à tomber d'un côté ou de l'autre des deux classes historiques de la société.
Quand Lénine écrivit les Thèses d'Avril en 1917, il liquida toutes les notions dépassées d'une étape à mi-chemin entre la révolution prolétarienne et la révolution bourgeoise, tous les vestiges de conceptions purement nationales du changement révolutionnaire. En effet, les Thèses rendaient superflu le concept ambigu de la révolution permanente et affirmaient que la révolution de la classe ouvrière est communiste et internationale, ou qu'elle n'est rien.
Clarification de la perspective communiste : le concept de décadence
Les clarifications les plus importantes sur la perspective du communisme provinrent du débat qui surgit dans la Ligue peu de temps après la publication de sa première Circulaire post-révolutionnaire. Il devint rapidement clair pour Marx et ceux qui lui étaient politiquement proches, que la contre-révolution avait triomphé dans toute l'Europe, et qu'en fait, il n'existait pas de perspective de lutte révolutionnaire imminente. Plus que toute autre chose, ce qui l'en a convaincu, ce n'était pas simplement les victoires politiques et militaires de la réaction, mais la reconnaissance, basée sur un travail assidu de recherche économique dans sa nouvelle condition d'exilé en Grande-Bretagne, du fait que le capitalisme était entré dans une nouvelle phase de croissance. Comme il l'a écrit dans Les luttes de classe en France :
«Etant donné cette prospérité générale dans
laquelle les forces productives de la société bourgeoise se développent aussi
abondamment que le permettent les conditions bourgeoises, on ne saurait parler
de véritable révolution. Une telle révolution n'est possible que dans les périodes
où ces deux facteurs, les forces productives modernes et les formes de
production bourgeoises entrent en conflit les unes avec les autres. Les
différentes querelles auxquelles s'adonnent aujourd'hui les représentants des
diverses fractions du parti de l'ordre continental et où elles se
compromettent réciproquement, bien loin de fournir l'occasion de nouvelles
révolutions, ne sont, au contraire, possibles que parce que la base des
rapports est momentanément si sûre, et, ce que la réaction ne sait pas, si bourgeoise.
Toutes les tentatives de réaction pour arrêter le développement bourgeois s'y
briseront aussi fortement que toute l'indignation morale et toutes les
proclamations enthousiastes des démocrates. Une nouvelle révolution ne sera
possible qu'à la suite d'une nouvelle crise, mais l'une est aussi certaine que l'autre. » ([15] [1164]).
l'une est aussi certaine que l'autre. » ([15] [1164]).
Par conséquent, la tâche à laquelle les communistes devaient faire face, n'était plus constituée par la préparation immédiate de la révolution, mais, avant tout, par la compréhension théorique de la situation historique objective, la destinée réelle du capital et donc les véritables bases d'une révolution communiste.
Cette perspective rencontra une opposition virulente chez les éléments les plus immédiatistes dans le parti, la tendance Willich-Schapper qui, lors de la réunion fatidique du Comité central de la Ligue des communistes en septembre 1850, déclara que la polémique avait lieu entre ceux « qui organisent le prolétariat » (c'est-à-dire eux-mêmes, les véritables ouvriers communistes) et « ceux qui agissent avec la plume »([16] [1165]) (c'est-à-dire Marx et ses théoriciens de salon). Marx pose la véritable question dans sa réponse ; il signale que : « Pendant notre dernier débat en particulier, sur la question de "La position du prolétariat allemand dans la prochaine révolution", des membres de la minorité du Comité central ont exprimé des points de vue en contradiction directe avec notre avant-dernière Circulaire, et même avec le Manifeste. »([17] [1166]) « A la place de la conception critique, la minorité met une conception dogmatique, et à la place de la conception matérialiste, une conception idéaliste. Au lieu des conditions réelles, c'est la simple volonté qui devient la force motrice de la révolution. Nous, nous disons aux ouvriers : "Vous avez à traverser quinze, vingt, cinquante ans de guerres civiles et de luttes entre les peuples, non seulement pour changer les conditions existantes, mais pour vous changer vous-mêmes et vous rendre aptes à la direction politique". Vous, au contraire, vous dites : "Il nous faut immédiatement arriver au pouvoir, ou bien nous n'avons plus qu'à aller nous coucher". Nous, nous attirons tout spécialement l'attention des ouvriers allemands sur le faible développement du prolétariat allemand. Vous, vous flattez de la façon la plus grossière le sentiment national et les préjugés corporatifs des artisans allemands, ce qui est évidemment plus populaire. »([18] [1167]).
L'issue de ce débat fut la dissolution effective de la Ligue. Marx proposa que son quartier général (HG) se déplace à Cologne et que les deux tendances travaillent dans des sections locales séparées. L'organisation continua d'exister jusqu'au célèbre Procès des communistes de Cologne en 1852, mais son existence était de plus en plus formelle. Les adeptes de Willich-Schapper se trouvèrent de plus en plus impliqués dans des complots loufoques et des conspirations ayant pour but de déchaîner 1; tempête prolétarienne. Marx, Engels et quelques autres se retirèrent de plus en plus des activités de l'organisation (sauf quand Marx alla défendre les camarades emprisonnés à Cologne) et se dédièrent à la principale tâche de l'heure - l'élaboration d'une compréhension plus approfondie des mécanismes et des faiblesses du mode de production capitaliste.
Ce fut la première démonstration claire du fait que le parti du prolétariat ne pouvait exister comme tel dans une période de réaction et de défaite ; que, dans de telles périodes, les révolutionnaires ne peuvent travailler que comme une fraction. Mais le fait qu'il n'ait pas existé de fraction organisée autour de Marx et d'Engels dans la période qui suivit, n'exprime pas une force ; cela exprimait l'immaturité du mouvement politique du prolétariat, du concept même de parti.([19] [1168])
Néanmoins, le débat avec la tendance Willich-Schapper nous a légué une leçon durable : la claire affirmation par la « tendance de Marx » selon laquelle la révolution ne pourrait avoir lieu que lorsque les « forces de production modernes » entreraient en conflit avec « les formes de production bourgeoises » ; quand le capitalisme serait devenu une entrave au développement des forces productives, un système social décadent. C'était une réponse essentielle à tous ceux qui, se séparant des conditions historiques objectives, réduisaient la révolution communiste à une simple question de volonté. Et c'est une réponse qui dut être répétée maintes fois dans le mouvement ouvrier : contre les bakouninistes dans la Première internationale qui montrèrent la même absence d'intérêt pour la question des conditions matérielles, et faisaient dépendre la révolution de la perspicacité et de l'enthousiasme des masses (et de leur avant-garde secrète autoproclamée) ; ou contre les descendants ultérieurs de Bakounine dans le milieu politique prolétarien d'aujourd'hui - comme le Groupe communiste internationaliste et Wildcat, qui, en commençant par rejeter la conception marxiste de la décadence du capitalisme, ont fini par rejeter toute notion de progrès historique et proclament que le communisme était possible depuis l'avènement du capitalisme, et même depuis l'aube de la société de classe.
Il est vrai que le débat de 1850 n'a pas clarifié cette question de la décadence ; on peut trouver dans les formulations de Marx sur « la prochaine révolution émergeant de la prochaine crise » de quoi conclure que celui-ci envisageait la possibilité d'une révolution surgissant dans une période où les rapports bourgeois ne sont pas devenus une entrave permanente aux forces productives, mais d'une des crises cycliques et temporaires qui ont ponctué la vie du capitalisme durant le XIX° siècle. Certains courants du mouvement prolétarien - les bordiguistes en particulier - ont cherché à rester en cohérence avec la critique par Marx du volontarisme tout en rejetant la notion de crise permanente du mode de production capitaliste, la notion de décadence. Mais bien que le concept de décadence n'ait pu être pleinement clarifié tant que le capitalisme n'était pas vraiment entré dans sa phase de décadence, nous soutenons que les véritables héritiers de la méthode de Marx sont ceux qui défendent un tel concept. C'est l'un des éléments que nous examinerons dans le prochain article, lorsque nous étudierons, du point de vue le plus approprié à cette série d'articles, les travaux théoriques de Marx durant la décennie qui a suivi la dissolution de la Ligue : comme clé de la compréhension de la nécessité et de la possibilité du communisme.
CDW.
[1] [1169] « 1848: Le communisme comme programme politique », Revue internationale, n°72
[2] [1170] E.J. Hobsbawn, L'âge de la Révolution, 1789-1848
[3] [1171] Le manifeste communiste, Ed La Pleiade, Œuvres 1, pages 193-194.
[4] [1172] Ibid.
[5] [1173] Les luttes de classe en France. J.J. Pauvert, page 88.
[6] [1174] La Nouvelle Gazette Rhénane. Tome II, Editions sociales, pages 230, 231
[7] [1175] Les luttes de classe en France. J.J. Pauvert, page 90.
[8] [1176] . « Adresse du Conseil Central à la Ligue », Londres, mars 1850, in Textes sur l'organisation, Ed. Spartacus, page 35
[9] [1177] Ibid, page 40.
[10] [1178] Ibid, page 42.
[11] [1179] Ibid, page 42.
[12] [1180] Les luttes de classe en France, Ibid., page 123
[13] [1181] Editions sociales, page 125
[14] [1182] David Fernbach, introduction à The revolutions of 1848, Penguin Marx library, 1973.
[15] [1183] J.J. Pauvert, page 193.
[16] [1184] « Réunion du Comité Central », 17 septembre 1850, cité dans Le parti de classe, T.II, Petite Collection Maspero, p. 14 et 15.
[17] [1185] Traduit de l'anglais.
[18] [1186] « Réunion du Comité Central », 15 septembre 1850, idem, p. 8.
[19] [1187] Lire la série d'articles « Le rapport Fraction-Parti dans la tradition marxiste », dans la Revue Internationale n° 59, 61, 64, 65, en particulier « De Marx à la Seconde Internationale », dans le n° 64.
Histoire du mouvement ouvrier:
- 1848 [1037]
Approfondir:
Questions théoriques:
- Communisme [492]
Heritage de la Gauche Communiste:
Revue Internationale no 74 - 3e trimestre 1993
- 2746 reads
Editorial : bas les masques !
- 2450 reads
Impitoyablement, les faits viennent démentir la propagande de la classe dominante. Jamais peut-être, la réalité ne s'est chargée aussi rapidement de mettre à nu les mensonges qu'assènent à dose massive les médias hypertrophiés de la bourgeoisie. La « nouvelle ère de paix et de prospérité » annoncée avec l'effondrement du bloc de l'Est et chantée sur tous les tons par les responsables politiques de tous les pays s'est révélée être un songe creux à peine quelques mois plus tard. Cette nouvelle période s'est avé rée être celle du développement d'un chaos grandissant, d'un en foncement dans la crise économique la plus grave que le capitalisme ait jamais connu, de l'explosion de conflits, de la guerre du Golfe à l'ex-Yougoslavie, où la barbarie militaire atteint des sommets rarement égalés.
L'aggravation brutale des tensions sur la scène internationale est l'ex pression de l'impasse dans laquelle s'enfonce le capitalisme, de la crise catastrophique et explosive qui l'ébranle sur tous les plans de son existence. Cette réalité, la classe dominante ne peut la reconnaître, ce serait admettre sa propre impuissance et donc accepter la faillite du système dont elle est la représentante. Toutes les affirmations rassurantes, toutes les prétentions volontaristes à contrôler la situation, se voient inéluctablement apporter un démenti cinglant par le déroulement des événements eux- mêmes. De plus en plus, les dis cours de la classe dominante apparaissent pour ce qu'ils sont : des mensonges. Qu'ils soient volontaires ou le produit de ses propres illusions ne change rien à l'affaire, jamais la contradiction entre la propagande bourgeoise et la vérité des faits n'a été aussi criante.
La bourgeoisie occidentale il y a encore quelques années se réjouissait du discrédit quasi-total dont pâtissait la bourgeoisie stalinienne dans les pays de l'Est. Ce discrédit lui servait de faire-valoir. Aujourd'hui, à son tour, elle est entrée dans la même dynamique de perte de crédibilité, et de plus en plus il devient visible qu'elle emploie finalement les mêmes armes : le mensonge d'abord, et lorsque cela ne suffît plus, la répression.
Bosnie : le mensonge d'un capitalisme pacifiste et humanitaire
La guerre en Bosnie a été pour les puissances occidentales l'occasion de se vautrer dans une orgie médiatique où tous ont communié dans la défense de la petite Bosnie contre l'ogre serbe. Les hommes politiques de tous horizons ne trouvaient pas de mots assez durs, d'images suffisamment marquantes pour dénoncer la barbarie de l'expansionnisme serbe : les camps de prisonniers assimilés aux camps d'extermination nazis, la purification ethnique, le viol des femmes musulmanes, les souffrances indicibles des populations civiles prises en otages. Une belle unanimité de façade où les surenchères humanitaires se sont conjuguées avec des appels répétés et menaçant à une intervention militaire.
Mais derrière ce choeur unanime, c'est en réalité la désunion qui s'est affirmée. Les intérêts contradictoires des grandes puissances n'ont pas tant déterminé une impuissance des grandes nations à mettre fin au conflit, chacun rejetant sur les autres cette responsabilité, mais ils ont surtout été le facteur essentiel qui a déterminé le conflit. Par Serbie, Croatie et Bosnie interposées, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, les Etats-Unis, ont avancé leurs cartes impérialistes sur l'échiquier des Balkans, et leurs larmes de crocodiles n'ont servi qu'à cacher leur rôle actif dans la poursuite de la guerre.
Les récents accords de Washington, signés par les Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Espagne et la Russie consacrent l'hypocrisie des campagnes idéologiques qui ont rythmé deux années de guerre et de massacres. Ils reconnaissent dans les faits les gains territoriaux serbes. Adieu le dogme de l’intangibilité des frontières internationalement reconnues». Et la presse de disserter à n'en plus finir sur l'impuissance de l'Europe maastrichtienne, des USA de Clinton, après ceux de Bush, à faire plier les serbes, à imposer leur volonté « pacifique » au nouvel Hitler : Milosevic, qui a remplacé Saddam Hussein dans le bestiaire de la propagande. Encore un mensonge de plus destiné à perpétuer l'idée que les grandes puissances sont pacifiques, qu'elles désirent réellement mettre fin aux conflits sanglants qui ravagent la planète, que les principaux fauteurs de guerre, ne sont que les petits despotes de puissances locales de troisième ordre.
Le capitalisme c'est la guerre. Cette vérité s'est inscrite en lettres de sang durant toute son histoire. Depuis la seconde guerre mondiale, pas une année, pas un mois, pas une journée ne s'est écoulée sans qu'en un lieu ou l'autre de la planète un conflit n'apporte son lot de massacres et de misère atroces, sans que les grandes puissances ne soient présentes, à un degré ou à un autre, pour attiser le feu au nom de la défense de leurs intérêts stratégiques globaux : guerres de décolonisation en Indochine, guerre de Corée, guerre d'Algérie, guerre du Vietnam, guerres israélo-arabes, guerre « civile » du Cambodge, guerre Iran-Irak, guerre en Afghanistan, etc. Pas un instant où la propagande bourgeoise ne se soit apitoyée sur les populations martyres, sur les atrocités commises, sur la barbarie de l'un ou l'autre camp pour mieux justifier un soutien à l'un de ces camps. Pas une guerre qui n'ait pu se faire sans la fourniture abondante d'armes par les grandes puissances qui les produisent. Pas un conflit qui ne se soit terminé par l'affirmation hypocrite d'un retour à la paix éternelle, alors que dans le secret des ministères et des états-majors se préparaient les plans pour de nouvelles guerres.
Avec l'effondrement du bloc de l'Est, la propagande occidentale s'est déchaînée pour prétendre qu'avec la disparition de l'antagonisme Est-Ouest, la principale source de conflit avait disparu, et que s'ouvrait donc, une «nouvelle ère de paix ». Ce mensonge là avait déjà été utilisé après la défaite de l'Allemagne à la fin de la deuxième guerre mondiale jusqu'à ce que, très rapidement, les alliés d'alors : l'URSS stalinienne et les démocraties occidentales soient prêtes à s'étriper pour un nouveau partage du monde. La situation présente, sur ce plan, n'est pas fondamentalement différente. Même si l'URSS n'a pas été vaincue militairement, son effondrement laisse le champ libre au déchaînement des rivalités entre les alliés d'hier pour un nouveau repartage du monde. La guerre du Golfe est venue montrer comment les grandes puissances entendaient maintenir la paix : par la guerre. Le massacre de centaines de milliers d'irakiens, soldats et civils, n'avait pas pour but de mettre au pas le tyran local, Saddam Hussein, ([1] [1188]) Ce conflit était la conséquence de la volonté de la première puissance mondiale, les USA, dans le contexte où la disparition du bloc de l'Est et de la menace russe faisait perdre au bloc occidental son principal ciment, d'avertir ses anciens alliés des risques qu'ils courraient dans le futur à vouloir jouer leur propre carte.
L'éclatement de la Yougoslavie est le produit de la volonté de l'Allemagne de mettre à profit la crise yougoslave pour récupérer une de ses anciennes zones d'influence et, par Croatie interposée, prendre pied sur les bords de la Méditerranée. La guerre entre la Serbie et la Croatie est le résultat de la volonté des « bons amis » de l'Allemagne de ne pas laisser celle-ci profiter des ports croates, et dans ce but la Serbie a été encouragée à en découdre avec la Croatie. Par la suite, les USA ont encouragé la Bosnie à proclamer son indépendance, espérant ainsi bénéficier d'un allié à leur dévotion dans la région, ce que les puissances européennes pour des raisons d'ailleurs multiples et contradictoires, ne désiraient absolument pas, ce qui va se traduire de leur part par un double langage qui, à cette occasion, atteint des sommets. Alors que tous proclament de manière véhémente vouloir protéger la Bosnie, en sous main, ils vont s'employer à favoriser les avancées serbes et croates, et à saboter les perspectives d'intervention militaire américaine. L'expression de cette réalité complexe s'est traduite sur le plan de la propagande. Alors que tous communiaient hypocritement dans la défense de la petite Bosnie agressée et pratiquaient la surenchère « pacifiste » et « humanitaire», dès qu'il s'agissait de proposer des mesures concrètes, la plus grande cacophonie régnait. D'une part les USA poussaient dans le sens d'une intervention musclée, tandis que d'autre part, la France et la Grande-Bretagne, notamment, employaient toutes les mesures dilatoires et ruses diplomatiques possibles pour prévenir une telle issue.
Demain, les alliances peuvent très bien se modifier, et la Serbie être présentée comme un allié fréquentable par les uns et les autres. Finalement, tous les ardents discours humanitaires apparaissent pour ce qu'ils sont, de la pure propagande destinée à masquer la réalité des tensions impérialistes qui s'exacerbent entre les grandes puissances occidentales auparavant alliées face à l'URSS, mais qui, depuis que celle-ci s'est effondrée et a implosé, sont engagées dans un jeu complexe de réorganisation de leurs alliances. L'Allemagne aspire à jouer de nouveau le rôle de grande puissance chef de bloc que sa défaite lors de la seconde guerre mondiale lui avait ôté. Et, en l'absence de discipline imposée par des blocs qui n'existent plus, ou pas encore, la dynamique du chacun pour soi se trouve renforcée et pousse chaque pays à mettre prioritairement en avant sa propre carte impérialiste.
En Bosnie, ce n'est donc pas de l'impuissance des grandes puissances à rétablir la paix dont il s'agit, mais bien de l'inverse, de la dynamique présente qui pousse les alliés d'hier à s'affronter, même si c'est encore indirectement et de manière masquée, sur le terrain impérialiste.
Il est cependant une puissance pour laquelle le conflit en Bosnie apparaît plus particulièrement comme un échec, un aveu d'impuissance, ce sont les USA. Après le cessez-le-feu entre la Croatie et la Serbie, conflit que les USA avaient mis à profit pour stigmatiser l'impuissance de l'Europe de Maastricht et ses divisions, les USA ont misé sur la Bosnie. Leur incapacité à assurer la survie de celle-ci ramène leurs prétentions à de simples rodomontades d'un matamore de théâtre. Plus que tout autre, les USA ont pratiqué la surenchère médiatique, critiquant la timidité des accords Vance-Owen, la part trop belle qu'ils faisaient aux serbes, menaçant continuellement ces derniers d'une intervention massive. Mais cette intervention, ils n'ont pas pu la mener à bien. Cette incapacité des USA à mettre leurs actes en accord avec leurs paroles est un très rude coup porté à leur crédibilité internationale. Les bénéfices engrangés par les USA avec l'intervention dans le Golfe sont, en grande partie, effacés par le revers qu'ils ont subi en Bosnie. En conséquence, les tendances centrifuges de leurs ex-alliés à échapper à la tutelle américaine, à jouer leur propre carte sur la scène impérialiste, se trouvent renforcées et accélérées. Quant aux fractions de la bourgeoisie qui comptaient sur la puissance américaine pour les protéger, elles y regarderont à deux fois avant de s'engager, le sort de la Bosnie est là pour les faire méditer.
Face à une telle situation, les USA ne vont certainement pas rester les bras croisés. Ils se doivent de réagir. Les récents bombardements en Somalie et l'envoi de troupes américaines en Macédoine annoncent un nouvel aiguisement des tensions impérialistes.
Les alliés d'hier communient encore dans l'idéologie qui les rassemblait face à l'URSS, mais derrière cette unité des thèmes, c'est une foire d'empoigne annonçant, au-delà de la Bosnie, de futures guerres, de futurs massacres. Toutes les belles paroles et les larmes de crocodiles abondamment versées n'ont qu'un but : masquer la réalité impérialiste du conflit qui ravage l’ex-Yougoslavie et justifier la guerre.
Crise économique : le mensonge de la reprise
Si la guerre n'est pas l'expression de l'impuissance de la bourgeoisie mais celle de la réalité intrinsèquement belliciste du capitalisme, la crise économique par contre est une claire expression de l'impuissance de la classe dominante à surmonter les contradictions indépassables de l'économie capitaliste. Les proclamations pacifistes de la classe dominante sont un pur mensonge : pacifique, elle ne l'a jamais été, la guerre a toujours été un moyen pour une fraction de la bourgeoisie de défendre ses intérêts contre d'autres, moyen devant lequel elle n'a jamais reculé. Par contre, toutes les fractions de la bourgeoisie rêvent sincèrement d'un capitalisme sans crise, sans récession, à la prospérité éternelle, qui permette de dégager des profits toujours plus juteux. La classe dominante ne peut pas envisager que la crise est insurmontable, qu'elle n'a pas de solution, car un tel point de vue, une telle conscience signifierait la reconnaissance de ses limites historiques, sa propre négation, ce qu'elle ne peut, précisément par sa position de classe exploiteuse dominante, ni envisager, ni accepter.
Entre le rêve d'un capitalisme sans crise et la réalité présente d'une économie mondiale qui ne parvient pas à sortir de la récession, il y a un abîme que la bourgeoisie voit, chaque jour, se creuser un peu plus avec une angoisse croissante. Pourtant, il n'est pas loin le temps où, avec l'effondrement économique de l'URSS, le capitalisme « libéral » à l'occidentale croyait discerner la preuve de sa propre santé inébranlable, de sa capacité à surmonter tous les obstacles. Que n'a-t-on entendu dans ces moments d'euphorie de la classe dominante ? Une débauche médiatique d'autosatisfaction où le capitalisme était promis à un avenir éternel. Las, l'Histoire a pris une revanche cinglante sur ces illusions et n'a pas attendu pour opposer un démenti brutal à ces mensonges.
L'URSS n'avait pas fini de s'effondrer que la récession faisait un retour remarqué au coeur de la première puissance économique mondiale : les USA. Depuis, cette récession s'est étendue comme une épidémie à l'ensemble de l'économie mondiale. Le Japon et l'Allemagne, ont, à leur tour, été terrassés par le même mal. A peine signé, le traité de Maastricht, qui promettait le renouveau de l’Europe et la prospérité économique, patatras, le bel assemblage s'effondre avec la crise du Système Monétaire Européen d'abord, et la récession ensuite.
Face a la brutale accélération de la crise mondiale qui prend à revers toute la propagande menée depuis des années dans tous les pays sur le thème de la reprise, la bourgeoisie n'en continue pas moins de répéter la même antienne : « nous avons des solutions ! », et de proposer de nouveaux plans économiques qui doivent sortir le capitalisme du marasme. Mais toutes les mesures mises en place ne sont d'aucun effet. La classe dominante n'a pas le temps de chanter victoire devant le frémissement de quelques indices économiques, que les faits se chargent de démentir ces illusions. Dernier exemple significatif en date, la croissance américaine : à peine arrivée à la Maison-Blanche, l'équipe Clinton est fière d'annoncer un taux de croissance inespéré de l'économie américaine au 4e trimestre 1992, + 4,7 %, et de prédire sur tous les tons la fin de la récession. Mais l'espoir aura été de courte durée. Après avoir prévu une croissance de +2,4% pour le 1er trimestre 1993, c'est finalement une petite croissance de +0,9 % qui est annoncée. La récession mondiale est là et bien là, et jusqu'à présent aucune des mesures employées par la classe dominante n'est parvenue à changer cet état de fait. Dans les milieux dirigeants, la panique s'amplifie et nul ne sait que faire.
Dans la mesure où toutes les mesures classiques de relance s'avèrent inefficaces, il ne reste plus qu'un argument à employer pour la bourgeoisie : «r il faut accepter les sacrifices pour que ça aille mieux demain.» Cet argument est constamment utilisé pour justifier les programmes d'austérité contre la classe ouvrière. Depuis le retour de la crise historique à la fin des années 1960, ce type d'argument s'est évidemment heurté au mécontentement des travailleurs qui payent la note, mais il n'en avait pas moins conservé, durant toutes ces années, une certaine crédibilité dans la mesure où l'alternance entre les périodes de récession et de relance semblait la valider. Mais la réalité de la misère qui n'a cessé de se développer partout, de plan de rigueur en plan d'austérité, avec pour seul résultat la situation catastrophique présente, montre que tous les sacrifices passés n'ont servi à rien.
Malgré tous les plans « contre le chômage », mis en place depuis des années, à grand renfort de publicité, par tous les gouvernements des métropoles industrialisées, celui-ci n'a cessé de croître. Il atteint aujourd'hui des sommets. Chaque jour de nouveaux plans de licenciements sont annoncés. Devant l'évidence des impôts de plus en plus lourds, des salaires qui diminuent ou de toute façon augmentent moins vite que l'inflation, nul n'a plus l'outrecuidance de prétendre que le niveau de vie progresse. Dans les grandes villes du monde développé, les miséreux, sans domicile faute d'argent pour payer un loyer, réduits à la mendicité, sont de plus en plus nombreux et témoignent dramatiquement du délabrement social qui gagne au coeur du capitalisme le plus riche.
Mettant à profit la faillite politique, économique et sociale du « modèle » stalinien de capitalisme d'Etat mensongèrement identifié au communisme, la bourgeoisie a répété à satiété que seul le capitalisme « libéral » pouvait apporter la prospérité. Elle doit maintenant déchanter devant la crise qui remet les pendules à l'heure.
La vérité de la lutte de classe face aux mensonges de la bourgeoisie
Avec l'aggravation brutale de la crise, la bourgeoisie voit se profiler, avec frayeur, le spectre d'une crise sociale. Pourtant, il y a peu, les idéologues de la bourgeoisie croyaient pouvoir affirmer que la faillite du stalinisme démontrait l'inanité du marxisme et l'absurdité de l'idée même de lutte de classe. Dans la foulée, l'existence même de la classe ouvrière était niée, et la perspective historique du socialisme présentée comme un idéal généreux, mais impossible à réaliser. Toute cette propagande a déterminé un doute profond au sein de la classe ouvrière sur la nécessité et la possibilité d'un autre système, d'un autre mode de relations des hommes entre eux, pour mettre fin à la barbarie capitaliste.
Mais si la classe ouvrière reste encore profondément déboussolée par la succession rapide des événements et le martelage idéologique intense des campagnes médiatiques, elle est, sous la pression des événements poussée à retrouver le chemin de la lutte face aux attaques incessantes et de plus en plus dures menées contre ses conditions de vie.
Depuis l'automne 1992, et les manifestations massives des travailleurs italiens en colère face au nouveau plan d'austérité mis en place par le gouvernement, les signes d'une lente reprise de la combativité du prolétariat se précisent dans de nombreux pays : Allemagne, Grande-Bretagne, Belgique, Espagne, etc. Dans une situation où l'aggravation incessante de la crise implique des plans d'austérité de plus en plus draconiens, cette dynamique ne peut aller qu'en s'accélérant et en s'amplifiant. La classe dominante voit s'avancer avec une inquiétude croissante cette perspective inéluctable du développement de la lutte de classe. Sa marge de manoeuvre se réduit de plus en plus. Non seulement, elle ne peut plus retarder tactiquement ses attaques contre la classe ouvrière, mais tout son arsenal idéologique pour faire face à la lutte de classe subit une érosion accélérée.
L'impuissance de tous les partis de la bourgeoisie à juguler la crise, à apparaître comme des bons gestionnaires renforce leur discrédit. Aucun parti de gouvernement ne peut dans les conditions présentes espérer bénéficier d'une grande popularité, il n'est que de voir comment en quelques mois d'accélération de la crise, Mitterrand en France, Major en Grande-Bretagne et même le nouvel élu Clinton aux USA, ont vu leur côte dans les sondages chuter vertigineusement. Partout la situation est la même : qu'ils soient de droite ou de gauche, les gestionnaires du capital en montrant leur impuissance mettent aussi involontairement à nu tous les mensonges qu'ils ont colportés pendant des années. L'implication des partis socialistes dans la gestion étatique en France, en Espagne, en Italie, etc., montre, internationalement, qu'ils ne sont pas différents des partis de droite dont ils voudraient tant se différencier. Les partis staliniens subissent de plein fouet le contrecoup de la faillite de leur modèle russe, les partis socialistes en pâtissent aussi. Avec le développement des « affaires » qui mettent en évidence la corruption généralisée régnant au sein de la classe dominante et de son appareil politique, le rejet confine au dégoût. C'est l'ensemble du modèle « démocratique » de gestion du capital et de la société qui est ébranlé. Le déphasage entre les discours de la bourgeoisie et la réalité devient chaque jour plus grand. En conséquence, le divorce entre l'Etat et la société civile ne peut aller qu'en s'accroissant. Résultat, aujourd'hui, c'est un truisme que d'affirmer que les hommes politiques mentent, tous les exploités en sont profondément convaincus.
Mais le fait de constater un mensonge ne signifie pas que l'on soit automatiquement immunisé contre des mystifications nouvelles, ni que l'on connaisse la vérité. Le prolétariat est dans cette situation aujourd'hui. Le constat que rien ne va plus, que le monde est en train de plonger dans la catastrophe, et que tous les discours rassurants sont pure propagande, cela, la grande masse des ouvriers s'en rend de plus en plus compte. Mais ce constat, s'il ne s'accompagne pas d'une réflexion vers la recherche d'une alternative, d'une réappropriation par le prolétariat de ses traditions révolutionnaires, de la réaffirmation dans ses luttes de son rôle central dans la société et de son affirmation comme classe révolutionnaire porteuse d'un avenir pour l'humanité, la perspective communiste, peut aussi mener au déboussolement et à la résignation. La dynamique présente, avec la crise économique qui agit comme révélateur, pousse la classe ouvrière vers la réflexion, la recherche d'une solution qui, pour elle, conformément à son être, ne peut être que la nouvelle société dont elle est porteuse : le communisme. De plus en plus, face à la catastrophe que la classe dominante ne peut plus cacher, se pose comme une question de vie ou de mort, la nécessité de la mise en avant de la perspective révolutionnaire.
Dans cette situation, la classe dominante ne reste pas passive. Même si son système se délite et sombre dans le chaos, elle ne va pas pour autant mettre la clé sous la porte. De toutes ses forces elle s'accroche à son pouvoir sur la société, par tous les moyens elle essaye d'entraver le processus de prise de conscience du prolétariat dont elle sait qu'il signifie sa propre perte. Face à l'usure des mystifications qu'elle utilise depuis des années, elle en forge de nouvelles et répète les anciennes avec encore plus de force. Elle utilise même la décomposition qui gangrène son système comme un nouvel instrument de confusion contre le prolétariat. La misère dans le «tiers-monde » et les atrocités des guerres servent de repoussoir pour renforcer l'idée que, là où la catastrophe n'atteint pas une telle ampleur, il n'y a finalement pas lieu de se plaindre et de protester. La mise à jour des scandales, de la corruption des politiciens, comme en Italie, est utilisée pour détourner l'attention des attaques économiques, justifier un renouvellement de l'appareil politique et crédibiliser l'idée d'un «Etat propre». Même la misère des travailleurs est utilisée pour les abuser. La peur du chômage sert à justifier des baisses de salaires au nom de la « solidarité». La «protection des emplois» dans chaque pays est le prétexte de campagnes chauvines, les travailleurs « immigrés » sont des victimes expiatoires toutes trouvées pour alimenter les divisions au sein de la classe ouvrière. Dans une situation où la bourgeoisie n'est plus porteuse d'aucun avenir historique, elle ne peut survivre que par le mensonge, elle est la classe du mensonge. Et quand celui-ci ne peut plus suffire, il lui reste l'arme de la répression, qui elle ne mystifie pas, mais dévoile ouvertement le visage barbare du capitalisme.
Socialisme ou barbarie. Cette alternative posée par les révolutionnaires au début du siècle est plus que jamais à l'ordre du jour. Ou la classe ouvrière se laisse embourber dans les mystifications de la bourgeoisie et l'ensemble de l'humanité est condamné à sombrer avec le capitalisme dans son processus de décomposition qui à terme signifie sa fin. Ou le prolétariat développe sa capacité de lutter, de mettre à nu les mensonges de la bourgeoisie, s'avance vers la mise en avant de sa perspective révolutionnaire. Tels sont les enjeux contenus dans la période présente. Les vents de l'histoire poussent le prolétariat vers l'affirmation de son être révolutionnaire, mais le futur n'est jamais acquis d'avance. Même si les masques de la bourgeoisie tombent de plus en plus, elle en forge constamment de nouveaux pour cacher le visage hideux du capitalisme, il appartient au prolétariat de les lui arracher définitivement.
JJ.
[1] [1189] Il est d'ailleurs toujours en place et, durant des années, l'Occident n'avait pas hésité à l'armer abondamment et à le soutenir face à l'Iran.
Récent et en cours:
- Crise économique [28]
- Luttes de classe [143]
10e congrès du CCI
- 2844 reads
Le CCI vient de tenir son 10e Congrès. Notre organisation a fait un bilan de ses activités, de ses prises de position et analyses durant les deux dernières années, et a tracé les perspectives pour les prochaines années. L'élément central a été la reconnaissance par l'organisation du tournant entamé au niveau de la lutte des classes. Les luttes massives du prolétariat italien de l'automne 1992 ont montré que la période de reflux qui avait débuté en 1989 avec la chute du bloc russe et du stalinisme, a commencé à prendre fin. Ce reflux a affecté non seulement la combativité qu'avait manifestée le prolétariat jusqu'à cette date dans sa résistance aux mesures d'austérité imposées par la bourgeoisie, mais aussi, de manière significative, le développement de sa conscience de classe révolutionnaire. Avec la perspective d'une reprise des combats de classe, le congrès s'est donné l'orientation de l'intervention dans les luttes ouvrières qui commencent, pour que le CCI, comme organisation politique du prolétariat, soit préparé au mieux pour jouer son rôle dans cette période décisive pour le prolétariat et l'humanité dans son ensemble.
Il ne fait pas de doute que pour tracer ces perspectives, il est fondamental de savoir si les analyses et les positions défendues par l'organisation dans la période passée, ont correspondu au développement des événements qui ont dominé la scène internationale. Le congrès a rempli cette tâche en évaluant les avancées du chaos et des conflits guerriers, la crise, les tensions impérialistes, et bien sûr, la lutte des classes. De même, ont été évaluées les activités réalisées dans cette période pour les adapter à la nouvelle période.
L'accentuation du chaos
Le 9e congrès du CCI de l'été 1991 avait analysé comment la phase de décomposition du capitalisme, commencée avec la décennie des années 1980, était à la base de la chute du bloc impérialiste de l'Est, de l'éclatement de l'URSS et de la mort du stalinisme.
Présentation
Le 10e congrès a constaté que ces analyses sur la phase de décomposition et ses conséquences avaient été entièrement correctes. Non seulement, l'explosion de l’ex-bloc de l'Est a continué, mais aussi l’ex-bloc occidental est entré dans un processus similaire en rompant «l'harmonie» existant entre les pays qui le constituaient, y inclus entre les pays les plus industrialisés. Cette rupture du système des blocs existant depuis 1945, a déclenché une situation de chaos qui, au lieu de s'amoindrir, s'étend comme une gangrène à toute la planète.
Un élément accélérateur du chaos a été l'accentuation des antagonismes impérialistes entre les grandes puissances. Ces dernières profitent de chaque conflit entre fractions de la bourgeoisie de différents pays ou d'un même pays pour essayer de gagner des positions stratégiques face aux puissances opposées, ravageant les économies rachitiques des pays en conflit, ce qui met en évidence une fois de plus l'irrationalité des guerres dans la période de décadence. Dans ce sens, il n'y a pas de conflit, petit ou grand, armé ou non, où ne soit présente la lutte des puissants gangsters impérialistes.
L'autre élément accélérateur du chaos est la tendance à la formation d'un nouveau système de blocs, et la lutte des USA qui veulent être l'unique «gendarme du monde ». Les avancées stratégiques de l'Allemagne, liées à sa force économique, dans le conflit des Balkans, au travers d'un appui ouvert à l'indépendance de la Slovénie et de la Croatie, placent le capital allemand comme la puissance capable de prendre la tête d'un bloc rival des Etats-Unis. Cependant, la voie qui mène à la conformation de ce nouveau bloc se resserre chaque fois davantage : d'une part, on trouve l'opposition que mènent la Grande-Bretagne et les Pays-Bas comme principaux alliés des Etats-Unis en Europe, à la stratégie allemande ; d'autre part, les appétits impérialistes propres de l'Allemagne et de la France limitent le renforcement de l'alliance dans laquelle la France viendrait pallier les limites militaires de l'Allemagne.
Les USA n'ont plus autant les mains libres pour leurs actions militaires. Les déploiements militaires et diplomatiques des puissances rivales en Yougoslavie, ont montré les limites de l'efficacité de l'opération « Tempête du désert » de 1991 qui était destinée à réaffirmer le leadership des Etats-Unis sur le monde. Pour cette raison, et à cause de l'opposition interne au déclenchement d'un autre Vietnam, les Etats-Unis n'ont pas eu la même capacité, ni la même liberté, de mobilisation en Yougoslavie ; mais il ne fait pas de doute qu'ils ne sont pas restés comme simples spectateurs : au travers de l'aide « humanitaire » à la Somalie et aux populations musulmanes traquées par les milices serbes en Bosnie-Herzégovine, ils ont commencé une offensive qui a pris un caractère de plus grande ampleur avec les mobilisations aériennes sur ces territoires.
Tout ce contexte ne fait que confirmer une tendance chaque fois plus grande au développement de conflits armés.
La crise frappe les pays centraux
Au plan économique, le congrès a pu constater que la crise qui s'exprime au travers de la récession économique, est devenue une des préoccupations principales de la bourgeoisie des pays centraux. A l'aube des années 1990, l'usure des remèdes traditionnels utilisés par la bourgeoisie pour essayer de pallier à la crise devient évidente : non seulement les Etats-Unis se trouvent en récession ouverte (laquelle en est à sa troisième année consécutive), mais de plus « la récession ouverte s'est généralisée pour atteindre des pays qu'elle avait épargné dans un premier temps, tel la France, et parmi les plus solides comme l'Allemagne et même le Japon. » ([1] [1190]). Le capital mondial souffre d'une crise qui atteint un degré qualitativement plus grand que toutes celles vécues jusqu'à présent.
Face à l'impossibilité d'obtenir une quelconque solution avec les politiques «néolibérales» appliquées dans la décennie 1980, la bourgeoisie des pays centraux entame un tournant stratégique vers une intervention encore plus grande de l'Etat dans l'économie, intervention qui a été une constante dans le capitalisme décadent, y inclus dans l'époque de Reagan, comme seule forme possible de survie par une tricherie constante avec ses propres lois économiques. Avec l'élection de Clinton, la première puissance mondiale concrétise cette stratégie. Cependant, « quelles que soient les mesures appliquées, la bourgeoisie américaine se trouve confrontée à une impasse : en lieu et place d'une relance de l’économie et d'une réduction de son endettement (et particulièrement celui de l'Etat), elle est condamnée, à une échéance qui ne saurait être reportée bien longtemps, à un nouveau ralentissement de l'économie et à une aggravation irréversible de l'endettement. » ([2] [1191])
Mais ce n'est pas seulement la récession qui exprime l'accentuation de la crise. La disparition des anciens blocs impérialistes vient accentuer aussi la crise et le chaos économique.
Les conséquences de l'accentuation de la crise dans les pays les plus développés se manifestent de manière immédiate dans une détérioration des conditions de vie du prolétariat. Mais le prolétariat de ces pays n'est pas disposé à rester passif face à la chute dans la misère et le chômage. Le prolétariat en Italie nous l'a rappelé à l'automne 1992 : la crise continue d'être la meilleure alliée du prolétariat.
La reprise de la combativité ouvrière
La reprise des luttes ouvrières a été un élément central, un axe du 10e Congrès. Après trois ans de reflux, les luttes massives du prolétariat italien de l'automne 1992 ([3] [1192]), ainsi que les manifestations massives des mineurs britanniques face à l'annonce de la fermeture de la majorité des mines, les mobilisations des ouvriers allemands durant l'hiver, ainsi que d'autres manifestations de combativité ouvrière dans d'autres pays d'Europe et du reste du monde, viennent confirmer la position défendue par le CCI selon laquelle le cours historique est bien aux confrontations massives entre le prolétariat et la bourgeoisie.
Le fait le plus significatif de cette reprise des luttes est qu'elles marquent le début d'un processus de dépassement du reflux dans la conscience ouvert en 1989. Mais nous serions naïfs si nous pensions que cette reprise des luttes va s'effectuer sans difficultés et de manière linéaire : les effets négatifs, les confusions, les doutes sur ses capacités comme classe révolutionnaire, conséquences du reflux de 1989, sont encore loin d'être totalement dépassés.
A ces facteurs, s'ajoutent les effets néfastes de la décomposition du capitalisme sur la classe ouvrière : l'atomisation, le «chacun pour soi», qui sapent la solidarité entre les prolétaires ; la perte de perspective face au chaos régnant ; le chômage massif et de longue durée, qui tend à séparer les prolétaires sans emploi du reste de la classe et, pour beaucoup d'autres, dans leur majorité les jeunes, à les plonger dans la délinquance ; les campagnes xénophobes et anti-racistes qui tendent à diviser les ouvriers ; le pourrissement de la classe dominante et de son appareil politique qui favorise les campagnes mystificatrices de « lutte contre la corruption » ; les campagnes « humanitaires » déchaînées par la bourgeoisie, face à la barbarie à laquelle est soumis le « tiers-monde »> qui tendent à culpabiliser les ouvriers pour justifier ainsi la dégradation de ses conditions de vie. Tous ces facteurs, tout comme les guerres comme celle de l'ex-Yougoslavie, où la participation des grandes puissance et leur confrontation sont masquées, rendent difficile le processus de prise de conscience du prolétariat et de reprise de sa combativité.
Cependant, la gravité de la crise et la brutalité des attaques de la bourgeoisie, ainsi que le développement inévitable de guerres dans lesquelles vont s'impliquer de manière ouverte les grandes puissances, montreront la faillite du mode de production capitaliste aux yeux des ouvriers. La perspective est donc au développement massif de luttes ouvrières. Cette reprise de la combativité du prolétariat exige l'intervention des révolutionnaires, qu'ils soient partie prenante de ces combats afin d'en impulser toutes les potentialités et d'y défendre avec détermination la perspective communiste.
Les activités
Pour être capable d'affronter les enjeux que présente la reprise des luttes ouvrières, le 10e congrès devait faire un bilan objectif des activités depuis le congrès passé, vérifier la réalisation de leur orientation, relever les difficultés qui s'étaient présentées, pour être préparé le mieux possible pour la période future. Le congrès a tiré un bilan positif des activités menées par l'organisation :
« L'organisation a été capable de résister au regain de désorientation entraîné par la relance de la campagne idéologique de la bourgeoisie sur la "fin du marxisme et de la lutte de classe", de tracer des perspectives chaque fois confirmées sur l'accélération des tensions inter impérialistes et de la crise, sur la reprise de combativité que devait nécessairement entraîner l'avalanche d'attaques contre la classe ouvrière, ceci en tenant compte des spécificités de la phase historique actuelle de décomposition, développant son activité en fonction des conditions de la situation et de l'état de ses forces militantes. »([4] [1193])
Le renforcement théorico-politique
Un des aspects positifs des activités a été le processus d'approfondissement théorico-politique qu'a réalisé l'organisation face à la nécessité d'affronter les (campagnes de la bourgeoisie qui affirmaient la «mort du communisme». Cela impliquait l'expression de la manière la plus claire et la plus élaborée, du caractère contre-révolutionnaire du stalinisme ; cependant, un des facteurs (l'autre étant l'accélération de l'histoire à laquelle il nous fallait, et il nous faut, répondre rapidement) qui a accentué l'importance de cette tâche, a été le développement des éléments révolutionnaires avec qui le CCI était en contact.
Ces contacts, à contre-courant de l'ambiance générale, sont l'expression de la maturation souterraine de la conscience de la classe qui s'exprime au travers de cette minorité.
D'autre part, les nouveaux événements ont montré que la maîtrise du cadre général d'analyse n'est pas suffisante. Il faut aussi «parler le marxisme» à propos, pour l'appliquer à l'analyse des événements et des situations particulières, ce qui ne peut se produire que s'il existe un approfondissement théorico-politique.
« La poursuite des efforts d'approfondissement théorique-politique, avec la vigilance dans le suivi de la situation internationale et des situations nationales, vont être déterminants pour la capacité de l’organisation à s'inscrire comme facteur actif au sein de la classe ouvrière, sur le plan de sa contribution au dégagement d'une perspective générale de lutte et, à terme, de la perspective communiste ».
La centralisation
«Depuis ses débuts, des groupes à l’origine du CCI au CCI lui-même, l'organisation s'est toujours conçue comme une organisation internationale. Mais la capacité à faire vivre cette conception internationaliste, qui a dynamisé la formation du CCI, s'est affaiblie. Aujourd'hui, la décomposition vient aggraver considérablement la pression à l'individualisme, au chacun pour soi, au localisme, au fonctionnarisme, plus encore que ne le faisait le poids de l'idéologie petite-bourgeoise post-soixante-huitarde dans les premières années d'existence de l'organisation. » C'est donc avec la volonté de faire face et de dépasser ces nouvelles difficultés que le 10e congrès a débattu de la nécessité de renforcer la vie politique et organisationnelle internationale du CCI :
« Dans chaque aspect de nos activités, à chaque moment, dans le fonctionnement et dans l'approfondissement politique, dans l'intervention, au quotidien, dans chaque tâche des sections locales, les tâches sont des tâches "internationales", les discussions sont des "discussions internationales", les contacts sont des "contacts internationaux". Le renforcement du cadre international est la condition première du renforcement de toute activité locale. »
La centralisation internationale du CCI est une condition fondamentale pour pouvoir jouer de manière effective notre rôle d'avant-garde politique du prolétariat :
«Nous n'avons pas la conception d'une organisation dont l'organe central dicte les orientations qu'il suffit d'appliquer, mais celle d'un tissu vivant où toutes les composantes agissent constamment comme parties d'un tout. (...) La substitution d'un organe central à la vie de l'organisation est totalement étrangère à notre fonctionnement. La discipline de l'organisation est fondamentalement basée sur une conviction d'un mode de fonctionnement international vivant permanent et implique une responsabilité à tous les niveaux dans l'élaboration des prises de position et dans l'activité vis-à-vis de l'organisation dans son ensemble. »
L'intervention
« Le tournant actuel de la situation internationale ouvre des perspectives d'intervention dans les luttes comme nous n'en avions plus connues au cours de ces dernières années».
C'est au travers de la presse, notre principal outil d'intervention, que nous devons marquer notre adaptation à la dynamique de la nouvelle période. Nous allons devoir intervenir simultanément sur tous les plans : décomposition crise économique, impérialisme, lutte de classe.
« Dans un tel contexte, les réflexes et la rapidité, la rigueur dans le suivi des événements, la profondeur dans l'assimilation des orientations, vont plus encore que par le passé être décisifs. (...) La presse doit intervenir de façon décidée face aux premières manifestations de la reprise ouvrière, et en même temps toujours traiter de l'exacerbation des tensions impérialistes, des questions de la guerre et de la décomposition, répondre en permanence et de façon adéquate à ce qui se déroule sous nos yeux dans toute la complexité de la situation, en dénonçant sans relâche les manoeuvres et mensonges de la bourgeoisie, en montrant les perspectives au prolétariat, (...) et participer au développement dans la classe ouvrière de la conscience qu'elle est une classe historique porteuse de la seule alternative au capitalisme en décomposition, dimension de sa conscience qui a été la plus durement et durablement affectée par les campagnes idéologiques accompagnant la faillite historique du stalinisme. »
L'intervention vers les sympathisants
Le CCI a connu un afflux important de contacts dans ses différentes sections qui sont le produit d'un rapprochement des positions révolutionnaires par une minorité de la classe ouvrière. Un des aspects que nous avons pu reconnaître, est que le développement et le nombre de contacts va augmenter avec l'intervention dans les luttes. L'organisation doit être très décidée dans son intervention face à eux, pour permettre leur incorporation réelle au mouvement révolutionnaire du prolétariat. Pour sa part, le CCI, au travers de l'intervention vers les contacts doit se réaffirmer comme le principal pôle de regroupement des forces révolutionnaires à l'heure actuelle.
L'intervention dans les luttes
« Le changement le plus important pour notre intervention dans la période qui vient, est la perspective de la reprise des luttes ouvrières. » L'intervention dans les luttes a été un élément central de discussion dans-le congrès. Après trois années de reflux de la lutte des classes, nous avons insisté sur la nécessité que le CCI réagisse rapidement et qu'il se trouve préparé pour intervenir, sans hésitation, dans la nouvelle situation. Les lignes fondamentales que doit suivre l'intervention, se sont exprimées de la manière suivante :
« C'est d'abord dans notre capacité à être partie prenante de la lutte, dans notre préoccupation de chercher, lorsque c'est possible, à influer sur le cours des luttes et à faire des propositions de marche concrètes, que nous assumons notre fonction d'organisation révolutionnaire».
Un des aspects principaux dans l'intervention dans les luttes ouvrières, est de ne pas laisser le terrain libre à l'action de la gauche, des gauchistes et des syndicats, principalement le syndicalisme de base, qui comme nous l'ont montré les luttes récentes en Italie, vont jouer un rôle de premier ordre pour essayer de dévier et de contrôler les luttes, en empêchant qu'elles se développent sur le terrain de classe et en essayant de semer la confusion et de démoraliser les travailleurs. Notre intervention doit viser au renforcement de la plus grande unité possible au sein de la classe :
« C'est ensuite en mettant en avant dans toute expérience de lutte de la classe ouvrière, ce qui défend réellement les intérêts immédiats de la classe, les intérêts communs à toute la classe, ce qui permet l'extension, l'unité, la prise en main des luttes que l'organisation doit toujours mener son intervention ».
De même, « dans le contexte de faiblesse de la classe ouvrière sur le plan de sa conscience, plus encore que par le passé, la mise en avant de la faillite historique du système capitaliste, de sa crise internationale et définitive, de l'enfoncement inéluctable dans la misère, la barbarie et les guerres où la domination de la bourgeoisie entraîne l'humanité, doit, avec la perspective du communisme, faire partie de l'intervention que nous menons dans les luttes ouvrières. »
L'intervention vers le milieu politique prolétarien
La tendance au réveil des luttes à des niveaux jamais atteints encore depuis la reprise historique à la fin des années 1960, nécessite non seulement un renforcement du CCI mais aussi de tout le milieu politique prolétarien. Pour cette raison, le 10e congrès s'est attaché particulièrement à l'évaluation de l'intervention en son sein. S'il faut constater le faible niveau des réponses du milieu politique prolétarien à notre appel du 9e congrès, le CCI ne doit pas se décourager pour autant. Il convient que nous développions encore plus notre suivi, notre mobilisation, et notre intervention à son égard.
Un élément central pour renforcer notre intervention dans le milieu politique prolétarien, duquel nous faisons partie, est de réaffirmer qu'il est lui-même une expression de la vie de la classe, de son processus de prise de conscience. Le renforcement de notre intervention vers le milieu politique prolétarien requiert que le débat se développe de manière plus ouverte, plus rigoureuse et fraternelle entre les groupes qui le composent, qu'ils rompent avec le sectarisme et avec la vision tordue exprimée par certains groupes, qui considèrent que « tout questionnement, tout débat, toute divergence ne sont pas une manifestation d'un processus de réflexion au sein de la classe mais une "trahison des principes invariants". »([5] [1194])
Ces débats permettront à leur tour, d'avoir une meilleure clarté sur les nouveaux événements, tant pour le CCI que pour le reste du milieu, qui a exprimé certaines confusions pour les comprendre.
« Cela s'est particulièrement confirmé lors des événements de l'Est et de la guerre du Golfe face auxquels ces groupes ont manifesté des confusions majeures et ont accusé un retard considérable par rapport au CCI lorsqu'ils sont parvenus à un minimum de clarté. Un tel constat ne doit pas être fait pour nous rassurer ou nous permettre de nous endormir sur nos lauriers mais bien pour que nous prenions la juste mesure de nos responsabilités vis-à-vis de l'ensemble du milieu. Il doit nous inciter à un surcroît d'attention, de mobilisation et de rigueur dans l'accomplissement de nos tâches de suivi du milieu politique prolétarien et d'intervention en son sein. » ([6] [1195])
La question de la défense du milieu politique prolétarien comme un tout, a posé au congrès la nécessité d'avoir la plus grande clarté politique par rapport aux groupes du milieu parasitaire qui gravitent autour du milieu politique prolétarien et y répandent leur venin.
« Quelle que soit leur plate-forme (qui peut-être formellement très valable), les groupes de ce milieu parasitaire n'expriment nullement un effort de prise de conscience de la classe. En ce sens, ils ne font pas partie du milieu politique prolétarien, même si on ne doit pas considérer qu'ils appartiennent au camp bourgeois (appartenance qui est fondamentalement déterminée par un programme bourgeois : défense de l'URSS, de la démocratie, etc.). Ce qu'ils expriment fondamentalement, ce qui les anime et détermine leur évolution (que cela soit conscient ou inconscient de la part de leurs membres), ce n'est pas la défense des principes révolutionnaires au sein de la classe, la clarification des positions politiques, mais l'esprit de chapelle ou de "cercle d'amis", l'affirmation de leur individualité vis-à-vis des organisations qu'ils parasitent, tout cela basé sur des griefs personnels, des ressentiments, des frustrations et autres préoccupations mesquines relevant de l'idéologie petite-bourgeoise. » ([7] [1196])
Nous ne pouvons pas faire la moindre concession à ce milieu parasitaire qui est un facteur de confusion et surtout de destruction du milieu politique prolétarien. Encore moins aujourd'hui, où pour répondre aux enjeux de la nouvelle période, la défense et le renforcement du milieu politique prolétarien sont indispensables face à toutes les attaques qu'il peut subir.
Le CCI a tenu son 10e congrès à un moment crucial de l'histoire : le prolétariat reprend le chemin de sa lutte contre le capital. Déjà la monstrueuse campagne idéologique déclenchée par la bourgeoisie sur « la mort du communisme », commence à céder face à la réalité brutale de la barbarie des guerres et à l'attaque impitoyable contre les conditions de vie du prolétariat des pays les plus développés, comme résultat d'une accélération plus grande de la crise de surproduction.
Le 10e congrès a fourni les orientations politiques pour permettre au CCI d'affronter les enjeux de la nouvelle période : une homogénéité existe par rapport au tournant de la situation internationale avec la reprise de la lutte de classe.
Ce Congrès a consolidé l'analyse du CCI sur les tensions impérialistes et la crise, qui, par leur accélération, élèvent à des niveaux plus hauts la situation de chaos produit par la décomposition du capitalisme. Il a aussi constaté que la reprise des luttes ne sera pas facile, que le poids dans le développement de la conscience qu'ont apporté la chute du bloc de l'Est et la mort du stalinisme, ne sera pas dépassé facilement. En outre, la bourgeoisie utilisera tout ce qui est en son pouvoir, pour essayer d'éviter que le prolétariat porte ses luttes à des niveaux plus grands de combativité et de conscience. C'est pour cela que le congrès a élaboré des perspectives pour renforcer le CCI, fondamentalement la centralisation internationale, ainsi que les moyens pour être mieux armés politiquement pour l'intervention, non seulement au niveau de la lutte des classes, mais aussi dans les autres manifestations du développement de la conscience de classe comme le sont les contacts qui émergent, et le milieu politique prolétarien.
Avec ce 10e congrès, le CCI s'efforce de se situer au niveau des exigences du moment historique et d'assumer son rôle d'avant-garde du prolétariat, pour contribuer à dépasser le reflux dans le développement de la conscience de classe dans la classe ouvrière afin que celle-ci se réaffirme et qu'elle puisse défendre la seule alternative à la barbarie capitaliste : le communisme.
CCI.
[1] [1197] Voir la « Résolution sur la situation internationale » dans ce numéro.
[2] [1198] Idem.
[3] [1199] Voir Revue Internationale n° 72, 1er trimestre 1993.
[4] [1200] « Résolution sur les activités ». Toutes les citations qui suivent sont tirées de cette même résolution.
[5] [1201] « Résolution sur le milieu politique prolétarien».
[6] [1202] Idem.
[7] [1203] Idem.
Vie du CCI:
- Résolutions de Congrès [131]
Conscience et organisation:
Résolution sur la situation internationale 1993
- 2356 reads
Depuis près de dix ans, la décomposition étend son emprise sur toute la société. De façon croissante, l'ensemble des phénomènes et des événements mondiaux ne peut se comprendre que dans ce cadre. Cependant, la phase de décomposition appartient à la période de décadence du capitalisme et les tendances propres à l'ensemble de cette période ne disparaissent pas, loin de là. Ainsi, dans l'examen de la situation mondiale, il importe de distinguer les phénomènes qui relèvent de la période de décadence en général de ceux qui appartiennent spécifiquement à sa phase ultime, la décomposition, dans la mesure, notamment, où leurs impacts respectifs sur la classe ouvrière ne sont pas identiques et peuvent même agir en sens opposé. Et il en ainsi tant sur le plan des conflits impérialistes que de la crise économique qui constituent les éléments essentiels déterminant le développement des luttes de la classe ouvrière et de sa conscience.
L'évolution des conflits impérialistes
1) Rarement, depuis la fin de la seconde guerre mondiale, le monde a connu une multiplication et une intensification des conflits guerriers comme celles auxquelles on assiste aujourd'hui. La guerre du Golfe, au début de 1991, était sensée instaurer un « nouvel ordre mondial » basé sur le «Droit». Depuis, la foire d'empoigne qui devait succéder à la fin du partage du monde entre deux mastodontes impérialistes n'a cessé de s'étendre et de s'exacerber. L'Afrique et l'Asie du Sud-Est, traditionnels terrains des affrontements impérialistes, ont continué à plonger dans les convulsions et la guerre. Libéria, Rwanda, Angola, Somalie, Afghanistan, Cambodge : ces pays sont aujourd'hui synonymes d'affrontements armés et de désolation malgré tous les « accords de paix » et les interventions de la « communauté internationale » patronnées directement ou indirectement par l’ONU. A ces «zones des tempêtes » sont venues s'ajouter le Caucase et l'Asie centrale qui payent au prix fort des massacres interethniques la disparition de l'URSS. Enfin, le havre de stabilité qu'avait constitué l'Europe depuis la fin de la seconde guerre mondiale est maintenant plongé dans un des conflits les plus meurtriers et barbares qui soient. Ces affrontements expriment de façon tragique les caractéristiques du monde capitaliste en décomposition. Ils résultent, pour une bonne part, de la situation nouvelle créée par ce qui constitue, à ce jour, la manifestation la plus importante de cette nouvelle phase de la décadence capitaliste : l'effondrement des régimes staliniens et du bloc de l'Est. Mais, en même temps, ces conflits sont encore aggravés par une des caractéristiques générales et fondamentales de cette décadence : l'antagonisme entre les différentes puissances impérialistes. Ainsi, la prétendue « aide humanitaire » en Somalie n'est qu'un prétexte et un instrument de l'affrontement des deux principales puissances qui s'opposent aujourd'hui en Afrique : les Etats-Unis et la France. Derrière, les différentes cliques qui se disputent le pouvoir à Kaboul, se profilent les intérêts des puissances régionales comme le Pakistan, l'Inde, l'Iran, la Turquie, l'Arabie Saoudite, puissances qui, elles-mêmes, inscrivent leurs intérêts et leurs antagonismes à l'intérieur de ceux qui partagent les « Grands » comme les Etats-Unis ou l'Allemagne. Enfin, les convulsions qui ont mis à feu et à sang l’ex-Yougoslavie, à quelques centaines de kilomètres de l'Europe «avancée», traduisent, elles aussi, les principaux antagonismes qui aujourd'hui divisent la planète.
2) L'ex-Yougoslavie est devenue un enjeu primordial dans les rivalités entre les principales puissances du monde. Si les affrontements et les massacres qui s'y déroulent depuis deux ans ont trouvé un terrain favorable avec des antagonismes ethniques ancestraux mis sous l'éteignoir par le régime stalinien, et que l'effondrement de celui-ci a fait ressurgir, les calculs sordides des grandes puissances ont constitué un facteur de premier ordre d'exacerbation de ces antagonismes. C'est bien parce que l'Allemagne à encouragé la sécession des Républiques du Nord, Slovénie et Croatie, afin de se constituer un débouché vers la Méditerranée, que s'est ouverte la boîte de Pandore yougoslave. C'est bien parce que les autres Etats européens, ainsi que les Etats-Unis, étaient opposés à cette offensive allemande qu'ils ont directement, ou indirectement par leur immobilisme, encouragé la Serbie et ses milices à déchaîner la « purification ethnique » au nom de la «défense des minorités». En fait, l'ex-Yougoslavie constitue une sorte de résumé, une illustration parlante et tragique de l'ensemble de la situation mondiale dans le domaine des conflits impérialistes.
3) En premier lieu, les affrontements qui ravagent aujourd'hui cette partie du monde sont une nouvelle confirmation de la totale irrationalité économique de la guerre impérialiste. Depuis longtemps, et à la suite de la « Gauche communiste de France », le CCI a relevé la différence fondamentale opposant les guerres de la période ascendante du capitalisme, qui avaient une réelle rationalité pour le développement de ce système, et celles de la période de décadence qui ne font qu'exprimer la totale absurdité économique d'un mode de production à l'agonie. Si l'aggravation des antagonismes impérialistes a comme cause ultime la fuite en avant de toutes les bourgeoisies nationales placées devant l'impasse totale de l'économie capitaliste, les conflits guerriers ne sauraient apporter la moindre « solution » à la crise, aussi bien pour l'ensemble de l'économie mondiale que pour celle d'un quelconque pays en particulier. Comme le notait déjà Internationalisme en 1945, ce n'est plus la guerre qui est au service de l'économie, mais bien l'économie qui s'est mise au service de la guerre et de sa préparation. Et ce phénomène n'a fait que s'amplifier depuis. Dans le cas de l'ex-Yougoslavie, aucun des protagonistes ne peut espérer le moindre profit économique de son implication dans le conflit. C'est évident pour la totalité des Républiques qui se font la guerre à l'heure actuelle : les destructions massives des moyens de production et de la force de travail, la paralysie des transports et de l'activité productive, l'énorme ponction que représentent les armements au détriment de l'économie locale ne vont bénéficier à aucun des nouveaux Etats en présence. De même, contrairement à l'idée qui a eu cours même au sein du milieu politique prolétarien, cette économie totalement ravagée ne pourra en aucune façon constituer un quelconque marché solvable pour la production excédentaire des pays industrialisés. Ce ne sont pas des marchés que les grandes puissances se disputent sur le territoire de l'ex-Yougoslavie mais des positions stratégiques destinées à préparer ce qui est devenu la principale activité du capitalisme décadent : la guerre impérialiste à une échelle toujours plus vaste.
4) La situation dans l'ex-Yougoslavie vient également confirmer un point que le CCI avait souligné depuis longtemps :la fragilité de l'édifice européen. Celui-ci, avec ses différentes institutions (l'Organisation Européenne de Coopération Economique chargée d'administrer le plan Marshall et qui se transformera ultérieurement en l'OCDE, l'Union de l'Europe Occidentale fondée en 1949, la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier entrée en activité en 1952 et qui deviendra, cinq ans plus tard, la Communauté Economique Européenne) s'était constitué essentiellement comme instrument du bloc américain face à la menace du bloc russe. L'intérêt commun des différents Etats d'Europe occidentale face à cette menace (qui n'excluait pas la tentative de certains d'entre eux, comme la France de De Gaulle, de limiter l'hégémonie américaine) avait constitué un facteur puissant de stimulation de la coopération, notamment économique, entre ces Etats. Une telle coopération n'avait pas été en mesure de sur monter les rivalités économiques entre eux, résultat qui ne peut être atteint dans le capitalisme, mais avait permis l'instauration d'une certaine « solidarité » face à la concurrence commerciale du Japon et des Etats-Unis. Avec l'effondrement du bloc de l'Est, les bases de l'édifice européen se sont trouvées bouleversées. Désormais, l'Union Européenne, que le traité de Maastricht de la fin 1991 a fait succéder à la CEE, ne saurait plus être considérée comme un instrument d'un bloc occidental qui a lui même cessé d'exister. Au contraire, cette structure est devenue le champ clos des antagonismes impérialistes que la disparition de l'ancienne configuration du monde a mis au premier plan ou fait surgir. C'est bien ce que les affrontements en Yougoslavie ont mis en évidence lorsqu'on a vu s'étaler la profonde division des Etats européens incapables de mettre en oeuvre la moindre poli tique commune face à un conflit qui se développait à leur porte. Aujourd'hui, même si « l'Union européenne » peut encore être mise à profit par l'ensemble de ses participants comme rempart contre la concurrence commerciale du Japon et des Etats-Unis ou comme instrument contre l'immigration et contre les combats de la classe ouvrière, sa composante diplomatique et militaire fait l'objet d'une dispute qui ne pourra aller qu'en s'exacerbant entre ceux (particulièrement la France et l'Allemagne) qui veulent lui faire jouer un rôle comme structure capable de rivaliser avec la puissance américaine (préparant la constitution d'un futur bloc impérialiste) et les alliés des Etats-Unis (essentiellement la Grande-Bretagne et les Pays-Bas) qui conçoivent leur présence dans les instances de décision comme moyen de réfréner une telle tendance. ([1])
5) L'évolution du conflit dans les Balkans est venue également illustrer une des autres caractéristiques de la situation mondiale : les entraves sur le chemin de la reconstitution d'un nouveau système de blocs impérialistes. Comme le CCI l'a souligné dès la fin de 1989, la tendance vers un tel système a été mise à l'ordre du jour dès que l'ancien a disparu avec l'effondrement du bloc de l'Est. L'émergence d'un candidat à la direction d'un nouveau bloc impérialiste, rivalisant avec celui qui serait dirigé par les Etats-Unis, s'est rapidement confirmée avec l'avancée des positions de l'Allemagne en Europe centrale et dans les Balkans alors que la liberté de manoeuvre militaire et diplomatique de ce pays était encore limitée par les contraintes héritées de sa défaite dans la seconde guerre mondiale. L'ascension de l'Allemagne s'est largement appuyée sur sa puissance économique et financière, mais elle a pu aussi bénéficier du soutien de son vieux complice au sein de la CEE, la France (action concertée par rapport à l'Union européenne, création d'un corps d'armé commun, etc.). Cependant, la Yougoslavie a mis en relief toutes les contradictions qui divisent ce tandem : alors que l'Allemagne apportait un sou tien sans faille à la Slovénie et à la Croatie, la France a maintenu pendant une longue période une politique pro-serbe la faisant s'aligner, dans un premier temps, sur la position de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis, ce qui a permis à cette puissance d'enfoncer un coin au sein de l'alliance privilégiée entre les deux principaux pays européens. Même si ces deux pays ont consacré des efforts particuliers à ce que le sanglant imbroglio yougoslave ne vienne pas compromettre leur coopération (par exemple, le soutien de la Buba au Franc français à chacune des attaques de la spéculation contre ce dernier), il est de plus en plus clair qu'ils ne mettent pas les mêmes espoirs dans leur alliance. L'Allemagne, du fait de sa puissance économique et de sa position géographique, aspire au leadership d'une « Grande Europe » qui ne serait elle-même que l'axe central d'un nouveau bloc impérialiste. Si elle est d'accord pour faire jouer un tel rôle à la structure européenne, la bourgeoisie française, qui depuis 1870 a pu constater la puissance de sa voisine de l'Est, ne veut pas se contenter de la place de second plan que celle-ci se propose de lui accorder dans leur alliance. C'est pour cela que la France n'est pas intéressée à un développement trop important de la puissance militaire de l'Allemagne (accès à la Méditerranée, acquisition de l'arme nucléaire, notamment) qui viendrait dévaloriser les atouts dont elle dis pose encore pour tenter de maintenir une certaine parité avec sa voisine dans la direction de l'Europe et à la tête de la contestation de l'hégémonie américaine. La réunion de Paris du 11 mars entre Vance, Owen et Milosevic sous la présidence de Mitterrand, est venue, une nouvelle fois, illustrer cette réalité. Ainsi, une des conditions pour que se reconstitue un nouveau partage du monde entre deux blocs impérialistes, l'accroissement très significatif des capacités militaires de l'Allemagne, porte avec elle la menace de difficultés sérieuses entre les deux pays européens qui sont candidats au leadership d'un nouveau bloc. Le conflit dans l'ex-Yougoslavie est donc venu confirmer que la tendance vers la reconstitution d'un tel nouveau bloc, mise à l'ordre du jour par la disparition de celui de l'Est en 1989, n'était nullement assurée de parvenir à son terme : la situation géopolitique spécifique des deux bourgeoisies qui s'en font les principaux protagonistes vient encore s'ajouter aux difficultés générales propres à la période de décomposition exacerbant le « chacun pour soi » entre tous les Etats.
6) Le conflit dans l’ex-Yougoslavie, enfin, vient confirmer une des autres caractéristiques majeures de la situation mondiale : les limites de l'efficacité de l'opération « Tempête du Désert » de 1991 destinée à affirmer le leadership des Etats-Unis sur le monde. Comme le CCI l'a affirmé à l'époque, cette opération de grande envergure n'avait pas comme principale cible le régime de Saddam Hussein ni même les autres pays de la périphérie qui auraient pu être tentés d'imiter l'Irak. Pour les Etats- Unis, ce qu'il s'agissait avant tout d'affirmer et de rappeler, c'était son rôle de « gendarme du monde » face aux convulsions découlant de l'effondrement du bloc russe et particulièrement d'obtenir l'obéissance de la part des autres puissances occidentales qui, avec la fin de la menace venue de l'Est, se sentaient pousser des ailes. Quelques mois à peine après la guerre du Golfe, le début des affrontements en Yougoslavie est venu illustrer le fait que ces mêmes puissances, et particulièrement l'Allemagne, étaient bien déterminées à faire prévaloir leurs intérêts impérialistes au détriment de ceux des Etats-Unis. Depuis, ce pays, s'il a réussi à mettre en évidence l'impuissance de l'Union européenne par rapport à une situation qui est de son ressort et le manque d'harmonie qui règne dans les rangs de cette dernière, y compris entre les meilleurs alliés que sont la France et l'Allemagne, n'est pas parvenu à contenir réellement l'avancée des autres impérialismes, particulièrement celui de ce dernier pays qui est, dans l'ensemble, parvenu à ses fins dans l'ex-Yougoslavie. Un tel échec est évidemment grave pour la première puissance mondiale puisqu'il ne peut que conforter la tendance de nombreux pays, sur tous les continents, à mettre à profit la nouvelle donne mondiale pour desserrer l'étreinte que leur a imposée l'Oncle Sam pendant des décennies. C'est pour cette raison que ne cesse de se développer l'activisme des Etats-Unis autour de la Bosnie après qu'ils aient fait étalage de leur force militaire avec leur massif et spectaculaire déploiement « humanitaire » en Somalie et l'interdiction de l'espace aérien du sud de l'Irak.
7) Cette dernière opération militaire, elle aussi, a confirmé un certain nombre des réalités mises en évidence par le CCI auparavant. Elle a illustré le fait que la véritable cible visée par les Etats-Unis dans cette partie du monde n'est pas l'Irak, puisqu'elle a renforcé le régime de Saddam Hussein tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais bien leurs « alliés » qu'elle a essayé, avec moins de succès qu'en 1991, d'entraîner une nouvelle fois (le troisième larron de « la coalition », la France, s'est contenté cette fois-ci d'envoyer des avions de reconnaissance). En particulier, elle a constitué un message en direction de l'Iran dont la puissance militaire montante s'accompagne du resserrement de ses liens avec certains pays européens, notamment la France. Cette opération est venue confirmer également, puisque le Koweït n'était plus concerné, que la guerre du Golfe n'avait pas eu pour cause la question du prix du pétrole ou de la préservation par les Etats-Unis de leur « rente pétrolière » comme l'avaient affirmé les gauchistes et même, à un moment donné, certains groupes du milieu prolétarien. Si cette puissance est intéressée à conserver et renforcer son emprise sur le Moyen-Orient et ses champs pétroliers, ce n'est pas fondamentalement pour des raisons commerciales où strictement économiques. C'est avant tout pour être en mesure, si le besoin s'en fait sentir, de priver ses rivaux japonais et européens de leur approvisionnement d'une matière première essentielle pour une économie développée et plus encore pour toute entreprise militaire (matière première dont dispose d'ailleurs abondamment le principal allié des Etats-Unis, la Grande-Bretagne).
8) Ainsi, les événements récents ont confirmé que, face à une exacerbation du chaos mondial et du « chacun pour soi » et à la montée en force de ses nouveaux rivaux impérialistes, la première puissance mondiale devra, de façon croissance, faire usage de la force militaire pour préserver sa suprématie. Les terrains potentiels d'affrontement ne manquent pas et ne font que se multiplier. Dès à présent, le sous-continent indien, dominé par l'antagonisme entre le Pakistan et l'Inde, se trouve de plus en plus concerné, comme en témoignent par exemple les affrontements dans ce dernier pays entre communautés religieuses qui, s'il sont bien un témoignage de la décomposition, sont attisés par cet antagonisme. De même, l'Extrême-Orient est aujourd'hui le théâtre de manoeuvres impérialistes de grande envergure comme, en particulier, le rapprochement entre la Chine et le Japon (scellé par la visite à Pékin, pour la première fois de l'histoire, de l'Empereur de ce dernier pays). Il est plus que probable que cette configuration des lignes de forces impérialistes ne fera que se confirmer dans la mesure où :
- il ne subsiste plus de contentieux entre la Chine et le Japon ;
- chacun de ces deux pays conserve un contentieux avec la Russie (tracé de la frontière russo-chinoise, question des Kouriles) ;
- s'accroît la rivalité entre les Etats-Unis et le Japon autour de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique ;
- la Russie est «condamnée», même si cela attise la résistance des « conservateurs » contre Eltsine, à l'alliance américaine du fait même de l'importance de ses armements atomiques (dont les Etats-Unis ne peuvent tolérer qu'ils puissent passer au service d'une autre alliance).
Les antagonismes mettant aux prises la première puissance mondiale et ses ex-alliés n'épargnent même pas le continent américain où les tentatives répétées de coup d'Etat contre Carlos Andres Perez au Venezuela aussi bien que la constitution de la NAFTA, au delà de leurs causes ou implications économiques et sociales, ont pour objet de faire pièce aux visées et à l'accroissement de l'influence de certains Etats européens. Ainsi, la perspective mondiale sur le plan des tensions impérialistes se caractérise par une montée inéluctable de celles-ci avec une utilisation croissante de la force militaire par le Etats-Unis, et ce n'est pas la récente élection du démocrate Clinton à la tête de ce pays qui saurait inverser une telle tendance, bien au contraire. Jusqu'à présent, ces tensions se sont développées essentiellement comme retombées de l'effondrement de l'ancien bloc de l'Est. Mais, de plus en plus, elles seront encore aggravées par la plongée catastrophique dans sa crise mortelle de l'économie capitaliste.
L'évolution de la crise économique
9) L'année 1992 s'est caractérisée par une aggravation considérable de la situation de l'économie mondiale. En particulier, la récession ouverte s'est généralisée pour at teindre des pays qu'elle avait épargné dans un premier temps, tel la France, et parmi les plus solides comme l'Allemagne et même le Japon. Si l'élection de Clinton représente la poursuite, et même le renforcement, de la politique de la première puissance mondiale sur l'arène impérialiste, elle symbolise la fin de toute une période dans l'évolution de la crise et des poli tiques bourgeoises pour y faire face. Elle prend acte de la faillite définitive des « reaganomics » qui avaient suscité les espoirs les plus fous dans les rangs de la classe dominante et de nombreuses illusions parmi les prolétaires. Aujourd'hui, dans les discours bourgeois, il ne subsiste plus la moindre référence aux mythiques vertus de la « dérégulation » et du « moins d'Etat». Même des hommes poli tiques appartenant aux forces poli tiques qui s'étaient faites les apôtres des « reaganomics », tel Major en Grande-Bretagne, ad mettent, face à l'accumulation des difficultés de l'économie, la nécessité de « plus d'Etat » dans celle-ci.
10) Les « années Reagan », prolongées par les « années Bush », n'ont nullement représenté une inversion de la tendance historique, propre à la décadence capitaliste, de renforcement du capitalisme d'Etat. Pendant cette période, des mesures comme l'augmentation massive des dépenses militaires, le sauvetage du système de caisses d'épargne par l'Etat fédéral (qui représente un prélèvement de 1000 milliards de dollars dans son budget) ou la baisse volontariste des taux d'intérêt en dessous du niveau de l'inflation ont représenté un accroissement significatif de l'intervention de l'Etat dans l'économie de la première puissance mondiale. En fait, quels que soient les thèmes idéologiques employés, quelles que soient les modalités, la bourgeoisie ne peut jamais, dans la période de décadence, renoncer à faire appel à l'Etat pour rassembler les morceaux d'une économie qui tend à l'éclatement, pour tenter de tricher avec les lois capitalistes (et c'est la seule instance qui puisse le faire, notamment par l'usage de la à planche à billets). Cependant, avec :
- la nouvelle aggravation de la crise économique mondiale ;
- le niveau critique atteint par le délabrement de certains secteurs cruciaux de l'économie américaine (systèmes de santé et d'éducation, infrastructures et équipements, recherche,...) favorisé par la politique « libérale » forcenée de Reagan et compagnie ;
- l'explosion surréaliste de la spéculation au détriment des investissements productifs également encouragée par les « reaganomics » ;
L'Etat fédéral ne pouvait échapper à une intervention beaucoup plus ouverte, à visage découvert, dans cette économie. En ce sens, la signification de l'arrivée du démocrate Clinton à la tête de l'exécutif américain ne saurait être réduite à de seuls impératifs idéologiques. Ces impératifs ne sont pas négligeables, notamment en vue de favoriser une plus grande adhésion de l'ensemble de la population des Etats-Unis à la politique impérialiste de la bourgeoisie de ce pays. Mais, beaucoup plus fondamentalement, le « New Deal » de Clinton signale la nécessité d'une réorientation significative de la politique de cette bourgeoisie, une réorientation que Bush, trop lié à la politique précédente, était mal placé pour mettre en oeuvre.
11) Cette réorientation politique, contrairement aux promesses du candidat Clinton, ne saurait remettre en cause la dégradation des conditions de vie de la classe ouvrière, qu'on qualifie de « classe moyenne » pour les besoins de la propagande. Les centaines de milliards de dollars d'économies annoncées par Clinton fin février 1993, représentent un accroissement considérable de l'austérité destinée à soulager l'énorme déficit fédéral et à améliorer la compétitivité de la production US sur le marché mondial. Cependant, cette politique se confronte à des limites infranchissables. La réduction du déficit budgétaire, si elle est effectivement réalisée, ne pourra qu'accentuer les tendances au ralentissement de l'économie qui avait été dopée par ce même déficit pendant près d'une décennie. Un tel ralentissement, en réduisant les recettes fiscales (malgré l'augmentation prévue des impôts) conduira à aggraver encore ce déficit. Ainsi, quelles que soient les mesures appliquées, la bourgeoisie américaine se trouve confrontée à une impasse : en lieu et place d'une relance de l'économie et d'une réduction de son endettement (et particulièrement celui de l'Etat), elle est condamnée, à une échéance qui ne saurait être reportée bien longtemps, à un nouveau ralentissement de l'économie et à une aggravation irréversible de l'endettement.
12) L'impasse dans laquelle est placée l'économie américaine ne fait qu'exprimer celle de l'ensemble de l'économie mondiale. Tous les pays sont enserrés de façon croissante dans un étau dont les mâchoires ont pour nom chute de la production et explosion de l'endettement (et particulièrement celui de l'Etat). C'est la manifestation éclatante de la crise de surproduction irréversible dans laquelle s'enfonce le mode de production capitaliste depuis plus de deux décennies. Successivement, l'explosion de l'endettement du « tiers-monde », après la récession mondiale de 1973-74, puis l'explosion de la dette américaine (tant interne qu'externe), après celle de 1981-82, avaient permis à l'économie mondiale de limiter les manifestations directes, et surtout de masquer l'évidence, de cette surproduction. Aujourd'hui, les mesures draconiennes que se propose d'appliquer la bourgeoisie US signent la mise au rebut définitive de la « locomotive » américaine qui avait tiré l'économie mondiale dans les années 1980. Le marché interne des Etats-Unis se ferme de plus en plus, et de façon irréversible. Et si ce n'est pas grâce à une meilleure compétitivité des marchandises made in US, ce sera à travers une montée sans précédent du protectionnisme dont Clinton, dès son arrivée, a donné un avant goût (augmentation des droits sur les produits agricoles, l'acier, les avions, fermeture des marchés publics,...). Ainsi, la seule perspective qui puisse attendre le marché mondial est celle d'un rétrécissement croissant et irrémédiable. Et cela d'autant plus qu'il est confronté à une crise catastrophique du crédit symbolisée par les faillites bancaires de plus en plus nombreuses : à force d'abuser d'une façon délirante de l'endettement, le système financier international se trouve au bord de l'explosion, explosion qui conduirait à précipiter de façon apocalyptique l'effondrement des marchés et de la production.
13) Un autre facteur venant aggraver l'état de l'économie mondiale est le chaos grandissant qui se développe dans les relations internationales. Lorsque le monde vivait sous la coupe des deux géants impérialistes, la nécessaire discipline que devaient respecter les alliés au sein de chacun des blocs ne s'exprimait pas seulement sur le plan militaire et diplomatique, mais aussi sur le plan économique. Dans le cas du bloc occidental, c'est à travers des structures comme l'OCDE, le FMI, le G7 que les alliés, qui étaient en même temps les principaux pays avancés, avaient établi, sous l'égide du chef de file américain, une coordination de leurs politiques économiques et un modus vivendi pour contenir leurs rivalités commerciales. Aujourd'hui, la disparition du bloc occidental, faisant suite à l'effondrement de celui de l'Est, a porté un coup décisif à cette coordination (même si se sont maintenues les anciennes structures) et laisse le champ libre à l'exacerbation du « chacun pour soi » dans les relations économiques. Concrètement, la guerre commerciale ne peut que se déchaîner encore plus, venant aggraver les difficultés et l'instabilité de l'économie mondiale qui se trouvent à son origine. C'est bien ce que manifeste la paralysie actuelle dans les négociations du GATT. Celles-ci avaient officiellement pour objet de limiter le protectionnisme entre les « partenaires » afin de favoriser les échanges mondiaux et donc la production des différentes économies nationales. Le fait que ces négociations soient devenues une foire d'empoigne, où les antagonismes impérialistes se superposent aux simples rivalités commerciales, ne peut que provoquer l'effet inverse : une plus grande désorganisation encore de ces échanges, des difficultés accrues pour les économies nationales.
14) Ainsi, la gravité de la crise a atteint, avec l'entrée dans la dernière décennie du siècle, un degré qualitativement supérieur à tout ce que le capitalisme avait connu jusqu'à présent. Le système financier mondial marche au bord du précipice au risque permanent et croissant d'y sombrer. La guerre commerciale va se déchaîner à une échelle jamais vue. Le capitalisme ne pourra trouver de nouvelle « locomotive » pour remplacer la locomotive américaine désormais hors d'usage. En particulier, les marchés pharamineux qu'étaient sensés représenter les pays anciennement dirigés par des régimes staliniens n'auront jamais existé que dans l'imagination de quelques secteurs de la classe dominante (et aussi dans celle de certains groupes du milieu prolétarien). Le délabrement sans espoir de ces économies, le gouffre sans fond qu'elles représentent pour toute tentative d'investissement se proposant de les redresser, les convulsions politiques qui agitent la classe dominante et qui viennent encore amplifier la catastrophe économique, tous ces éléments indiquent qu'elles sont en train de plonger dans une situation semblable à celle du Tiers-monde, que loin de pouvoir constituer un ballon d'oxygène pour les économies les plus développées, elles deviendront un fardeau croissant pour elles. Enfin, si, dans ces dernières, l'inflation a quelque chance d'être contenue, comme c'est la cas jusqu'à présent, cela ne traduit aucunement un quelconque dépassement des difficultés économiques qui se trouvaient à son origine. C'est au contraire l'expression de la réduction dramatique des marchés qui exerce une puissante pression à la baisse sur le prix des marchandises. La perspective de l'économie mondiale est donc à une chute croissante de la production avec la mise au rebut d'une part toujours plus importante du capital investi (faillites en chaîne, désertification industrielle, etc.) et une réduction drastique du capital variable, ce qui signifie, pour la classe ouvrière, outre des attaques accrues contre tous les aspects du salaire, des licenciements massifs, une montée sans précédent du chômage.
Les perspectives du combat de classe
15) Les attaques capitalistes de tous ordres qui se déchaînent aujourd'hui, et qui ne peuvent que s'amplifier, frappent un prolétariat qui a été sensiblement affaibli au cours des trois dernières années, un affaiblissement qui a affecté aussi tien sa conscience que sa combativité.
C’est l'effondrement des régimes staliniens d'Europe et la dislocation de l'ensemble du bloc de l'Est à la fin de 1989, qui a constitué le facteur essentiel de recul de la conscience dans le prolétariat. L'identification, par tous les secteurs bourgeois, pendant un demi-siècle, de ces régimes au « socialisme », le fait que ces régimes ne soient pas tombés sous les coups de la lutte de classe ouvrière mais à la suite d'une implosion de leur économie, a permis le déchaînement de campagnes massives sur la « mort du communisme », sur la «victoire définitive de l'économie libérale» et de la «démocratie», sur la perspective d'un « nouvel ordre mondial » fait de paix, de prospérité et de respect du Droit. Si la très grande majorité des prolétaires des grandes concentrations industrielles avait cessé, depuis longtemps, de se faire des illusions sur les prétendus « paradis socialistes», la disparition sans gloire des régimes staliniens a toutefois porté un coup décisif à l'idée qu'il pouvait exister autre chose sur la terre que le système capitaliste, que l'action du prolétariat pouvait conduire à une alternative à ce système. Et une telle atteinte à la conscience dans la classe s'est trouvée encore aggravée par l'explosion de l'URSS, à la suite du putsch manqué d'août 1991, une explosion qui touchait le pays qui avait été le théâtre de la révolution prolétarienne au début du siècle.
D'autre part, la crise du Golfe à partir de l'été 1990, l'opération « Tempête du désert » au début 1991, ont engendré un profond sentiment d'impuissance parmi les prolétaires qui se sentaient totalement incapables d'agir ou de peser par rapport à des événements dont ils étaient conscients de la gravité, mais qui restaient du ressort exclusif de « ceux d'en haut ». Ce sentiment a puissamment contribué à affaiblir la combativité ouvrière dans un contexte où cette combativité avait déjà été altérée, bien que de façon moindre, par les événements de l'Est, l'année précédente. Et cet affaiblissement de la combativité a été encore aggravé par l'explosion de l'URSS, deux ans après l'effondrement de son bloc, de même que par le développement au même moment des affrontements dans l’ex-Yougoslavie.
16) Les événements qui se sont précipités après l'effondrement du bloc de l'Est, en apportant sur toute une série de questions un démenti aux campagnes bourgeoises de 1989, ont contribué à saper une partie des mystifications dans lesquelles avait été plongée la classe ouvrière. Ainsi, la crise et la guerre du Golfe ont commencé à porter des coups décisifs aux illusions sur l'instauration d'une « ère de paix » que Bush avait annoncée lors de l'effondrement du rival impérialiste de l'Est. En même temps, le comportement barbare de la « grande démocratie » américaine et de ses acolytes, les massacres perpétrés contre les soldats irakiens et les populations civiles ont participé à démasquer les mensonges sur la « supériorité » de la démocratie, sur la victoire du « droit des nations » et des « droits de l'homme ». Enfin, l'aggravation catastrophique de la crise, la récession ouverte, les faillites, les pertes enregistrées par les entreprises considérées comme les plus prospères, les licenciements massifs dans tous les secteurs et particulièrement dans ces entreprises, la montée inexorable du chômage, toutes ces manifestations des contradictions insurmontables que rencontre l'économie capitaliste sont en train de régler leur compte aux mensonges sur la « prospérité » du système capitaliste, sur sa capacité à surmonter les difficultés qui avaient englouti son prétendu rival « socialiste ». La classe ouvrière n'a pas encore digéré l'ensemble des coups qui avaient été portés à sa conscience dans la période précédente. En particulier, l'idée qu'il peut exister une alternative au capitalisme ne découle pas automatiquement du constat croissant de la faillite de ce système et peut très bien déboucher sur le désespoir. Mais, au sein de la classe, les conditions d'un rejet des mensonges bourgeois, d'un questionnement en profondeur sont en train de se développer.
17) Cette réflexion dans la classe ouvrière prend place à un moment où l'accumulation des attaques capitalistes et leur brutalité croissante l'obligent à secouer la torpeur qui l'avait envahie pendant plusieurs années. Tour à tour :
- l'explosion de combativité ouvrière en Italie durant l'automne 1992 (une combativité qui, depuis, ne s'est jamais complètement éteinte) ;
- à un degré moindre mais significatif, les manifestations massives des ouvriers anglais durant la même période, à l'annonce de la fermeture de la plupart des mines ;
- la combativité exprimée par les prolétaires d'Allemagne à la fin de l'hiver suite à des licenciements massifs, notamment dans ce qui constitue un des symboles de l'industrie capitaliste, la Ruhr;
- d'autres manifestations de combativité ouvrière, de moindre envergure mais qui se sont multipliées dans plusieurs pays d'Europe, notamment en Espagne, face à des plans d'austérité de plus en plus draconiens ; sont venues mettre en évidence que le prolétariat était en train de des serrer l'étau qui l'étreignait depuis le début des années 1990, qu'il se libérait de la paralysie qui l'avait contraint de subir sans réaction les attaques portées dès ce moment-là par la bourgeoisie. Ainsi, la situation présente se distingue fondamentalement de celle qui avait été mise en évidence au précédent congrès du CCI lorsqu'il avait constaté que : «... les appareils de gauche de la bourgeoisie ont tenté déjà depuis plusieurs mois de lancer des mouvements de lutte prématurés afin d'entraver cette réflexion [au sein du prolétariat] et de semer un surcroît de confusion dans les rangs ouvriers. ». En particulier, l'ambiance d'impuissance qui prédominait alors parmi la majorité des prolétaires, et qui favorisait les manoeuvres bourgeoises visant à provoquer des luttes minoritaires destinées à s'enliser dans l'isolement, tend de plus en plus à laisser la place à la volonté d'en découdre avec la bourgeoisie, de répliquer avec détermination à ses attaques.
18) Ainsi, dès à présent, le prolétariat des principaux pays industrialisés est en train de redresser la tête confirmant ce que le CCI n'a cessé d'affirmer : « le fait que la classe ouvrière détient toujours entre ses mains les clés de l’avenir» (Résolution du 9e Congrès du CCI) et qu'il avait annoncé avec confiance : « ... c'est bien parce que le cours historique n'a pas été renversé, parce que la bourgeoisie n'a pas réussi avec ses multiples campagnes et manoeuvres à infliger une défaite décisive au prolétariat des pays avancés et à l'embrigader derrière ses drapeaux, que le recul subi par ce dernier, tant au niveau de sa conscience que de sa combativité, sera nécessairement surmonté. » ((Résolution du 29 mars 1992, Revue Internationale n°70). Cependant, cette reprise du combat de classe s'annonce difficile. Les premières tentatives faites par le prolétariat depuis l'automne 1992 mettent en évidence qu'il subit encore le poids du recul. En bonne partie, 'expérience, les leçons acquises au cours des luttes du milieu des années 1980, n'ont pas encore été réappropriés par la grande majorité des ouvriers. En revanche, la bourgeoisie a, dès maintenant, fait la preuve qu'elle avait tiré les enseignements des combats précédents :
- en organisant, depuis un long moment, toute une série de campagnes destinées à faire perdre aux ouvriers leur identité de classe, particulièrement des campagnes anti-fascistes et anti-racistes de même que des campagnes visant à leur bourrer le crâne avec le nationalisme ;
- en prenant rapidement, grâce aux syndicats, les devants des expressions de combativité ;
- en radicalisant le langage de ces organes d'encadrement de la classe ouvrière ;
- en donnant d'emblée, là où c'était nécessaire comme en Italie, un rôle de premier plan au syndicalisme de base ;
- en organisant ou en préparant, dans un certain nombre de pays, le départ du gouvernement des partis « socialistes » afin de pouvoir mieux jouer la carte de la gauche dans l'opposition ;
- en veillant à éviter, grâce à une planification internationale de ses attaques, un développement simultané des luttes ouvrières dans les différents pays ;
- en organisant un black-out systématique sur celles-ci.
De plus, la bourgeoisie s'est montrée capable d'utiliser le recul de la conscience dans la classe pour introduire de faux objectifs et revendications dans les luttes ouvrières (partage du travail, « droits syndicaux», défense de l'entreprise, etc.).
19) Plus généralement, c'est encore un long chemin qui attend le prolétariat avant qu'il ne soit capable d'affirmer sa perspective révolutionnaire. Il devra déjouer les pièges classiques que toutes les forces de la bourgeoisie disposeront systématiquement sous ses pas. En même temps, il sera confronté à tout le poison que la décomposition du capitalisme fait pénétrer dans les rangs ouvriers, et que la classe dominante (dont les difficultés politiques liées à la décomposition n'affectent pas sa capacité de manoeuvre contre son ennemi mortel) utilisera de façon cynique :
- l'atomisation, la « débrouille » individuelle, le « chacun pour soi », qui tend à saper la solidarité et l'identité de classe et qui, même dans les moments de combativité, favorisera le corporatisme ;
- le désespoir, le manque de perspective qui continuera de peser, même si la bourgeoisie ne pourra pas utiliser une nouvelle fois une occasion comme l'effondrement du stalinisme ;
- le processus de lumpénisation résultant d'une ambiance dans laquelle le chômage massif et de longue duré tend à couper une partie significative des chômeurs, et particulièrement les plus jeunes, du reste de leur classe;
- la montée de la xénophobie, y compris parmi des secteurs ouvriers importants, facilitant grandement, en retour, les campagnes anti-racistes et anti-fascistes destinées non seulement à diviser la classe ouvrière, mais également à la ramener derrière la défense de l'Etat démocratique ;
- les émeutes urbaines, qu'elles soient spontanées ou provoquées par la bourgeoisie (comme celles de Los Angeles au printemps 1992), qui seront utilisées par cette dernière pour tenter de dévoyer le prolétariat de son terrain de classe ;
- les différentes manifestations de la pourriture de la classe dominante, la corruption et la gangstérisation de son appareil politique, qui, s'ils sapent sa crédibilité aux yeux des ouvriers, favorisent en même temps les campagnes de diversion en faveur d'un Etat « propre » (ou « vert ») ;
- l'étalage de toute la barbarie dans laquelle plonge non seulement le « tiers-monde » mais également une partie de l'Europe, comme l’ex-Yougoslavie, ce qui est terrain béni pour toutes les campagnes « humanitaires » visant à culpabiliser les ouvriers, à leur faire accepter la dégradation de leurs propres conditions de vie, mais également à recouvrir d'un voile pudique et justifier les menées impérialistes des grandes puissances.
20) Ce dernier aspect de la situation présente met en relief la complexité de la question de la guerre comme facteur dans la prise 3e conscience du prolétariat. Cette complexité a déjà été amplement analysée par les organisations communistes, et notamment par le CCI, dans le passé. Pour l'essentiel, elle consiste dans le fait que, si la guerre impérialiste constitue une des manifestations majeures de la décadence du capitalisme, symbolisant en particulier l'absurdité d'un système à l'agonie et indiquant la nécessité de le renverser, son impact sur la conscience dans la classe ouvrière dépend étroitement des circonstances dans lesquelles elle se déchaîne. Ainsi, la guerre du Golfe, il y a deux ans, a apporté auprès des ouvriers des pays avancés (pays qui étaient pratiquement tous impliqués dans cette guerre, directement ou indirectement) une contribution sérieuse au dépassement des illusions semées par la bourgeoisie l'année précédente participant ainsi à la clarification de la conscience du prolétariat. En revanche, la guerre dans l'ex-Yougoslavie n'a aucunement contribué à éclaircir la conscience dans le prolétariat, ce qui est confirmé par le fait que la bourgeoisie n'a pas éprouvé le besoin d'organiser des manifestations pacifistes alors que plusieurs pays avancés (comme la France et la Grande-Bretagne) ont, dès à présent, envoyé des milliers d'hommes sur le terrain. Et il en est de même de l'intervention massive du gendarme US en Somalie. Il apparaît ainsi que, lorsque le jeu sordide de l'impérialisme peut se dissimuler derrière les paravents « humanitaires », c'est-à-dire tant qu'il lui est permis de présenter ses interventions guerrières comme destinées à soulager l'humanité des calamités résultant de la décomposition capitaliste, il ne peut pas, dans la période actuelle, être mis à profit par les grandes masses ouvrières pour renforcer leur conscience et leur détermination de classe. Cependant, la bourgeoisie ne pourra pas en toutes circonstances dissimuler le visage hideux de sa guerre impérialiste derrière le masque des «bons sentiments». L'inéluctable aggravation des antagonismes entre les grandes puissances, en contraignant celles-ci, même en l'absence de prétexte « humanitaire » (comme on l'a déjà vu avec la guerre du Golfe), à des interventions de plus en plus directes, massives et meurtrières (ce qui constitue, en fin de compte, une des caractéristiques majeures de toute la période de décadence du capitalisme), tendra à ouvrir les yeux des ouvriers sur les véritables enjeux de notre époque. Il en est de la guerre comme des autres manifestations de l'impasse historique du système capitaliste : lorsqu'elles relèvent spécifiquement de la dé composition de ce système, elles se présentent aujourd'hui comme un obstacle à la prise de conscience dans la classe ; ce n'est que comme manifestation générale de l'ensemble de la décadence qu'elles peuvent constituer un élément positif dans cette prise de conscience. Et cette potentialité tendra à devenir de plus en plus réalité à mesure que la gravité de la crise et des attaques bourgeoises, ainsi que le développement des luttes ouvrières, permettront aux masses prolétariennes d'identifier le lien qui unit l'impasse économique du capitalisme et sa plongée dans la barbarie guerrière.
21) Ainsi, l'évidence de la crise mortelle du mode de production capitaliste, manifestation première de sa décadence, les terribles conséquences qu'elle aura pour tous les secteurs de la classe ouvrière, la nécessité pour celle-ci de développer, contre ces conséquences, les luttes dans lesquelles elle recommence à s'engager, vont constituer un puissant facteur dans sa prise de conscience. L'aggravation de la crise fera de plus en plus l'évidence qu'elle ne découle pas d'une « mauvaise gestion», que les bourgeois « vertueux » et les Etats « propres » sont aussi incapables que les autres de la surmonter, qu'elle exprime l'impasse mortelle de tout le capitalisme. Le déploiement massif des combats ouvriers constituera un puissant antidote contre les effets délétères de la décomposition, permettant de surmonter progressivement, par la solidarité de classe que ces combats impliquent, l'atomisation, le « chacun pour soi » et toutes les divisions qui pèsent sur le prolétariat : entre catégories, branches d'industrie, entre immigrés et nationaux, entre chômeurs et ouvriers au travail. En particulier, si, du fait du poids de la décomposition, les chômeurs n'ont pu, au cours de la décennie passée, et contrairement aux années 1930, entrer dans la lutte (sinon de façon très ponctuelle), s'ils ne pourront jouer un rôle d'avant garde comparable à celui des soldats dans la Russie de 1917 comme on aurait pu le prévoir, le développement massif des luttes prolétariennes leur permettra, notamment dans les manifestations de rue, de rejoindre le combat général de leur classe, et cela d'autant plus que, parmi eux, la proportion de ceux qui ont déjà une expérience du travail associé et de la lutte sur le lieu de travail ne pourra aller qu'en croissant. Plus généralement, si le chômage n'est pas un problème spécifique des sans travail mais bien une question affectant et concernant toute la classe ouvrière, notamment en ce qu'il constitue une manifestation tragique et évidente de la faillite historique du capitalisme, c'est bien ces mêmes combats à venir qui permettront à l'ensemble du prolétariat d'en prendre pleinement conscience.
22) C'est aussi, et fondamentalement, à travers ces combats face aux attaques incessantes contre ses conditions de vie que le prolétariat devra surmonter les séquelles de l'effondrement du stalinisme qui a porté un coup d'une telle violence à son appréhension de sa perspective, à sa conscience qu'il existe une alternative révolutionnaire à la société capitaliste moribonde. Ces combats « redonneront confiance à la classe ouvrière, lui rappelleront qu'elle constitue, dès à présent, une force considérable dans la société et permettront à une masse croissante d'ouvriers de se tourner de nouveau vers la perspective du renversement du capitalisme » (Résolution du 29 mars 1992). Et plus cette perspective sera présente dans la conscience ouvrière, plus la classe disposera d'atouts pour déjouer les pièges bourgeois, pour développer pleinement ses luttes, pour les prendre efficacement en mains, les étendre et les généraliser. Pour développer cette perspective, la classe n'a pas seulement pour tâche de se remettre de la désorientation subie dans la dernière période et de se réapproprier les leçons de ses combats des années 1980 ; elle devra aussi renouer le fil historique de ses traditions communistes. L'importance centrale de ce développement de la conscience ne peut que souligner l'immense responsabilité qui repose sur la minorité révolutionnaire dans la présente période. Les communistes doivent prendre une part active à tous les combats de classe afin d'en impulser les potentialités, de favoriser au mieux la récupération de la conscience du prolétariat érodée !par l'effondrement du stalinisme, de contribuer à lui redonner confiance en lui-même et de mettre en évidence la perspective révolutionnaire que ces combats contiennent implicitement. Cela va de pair avec la dénonciation de la barbarie militaire du capitalisme décadent et, plus globalement, la mise en garde contre la menace que ce système en décomposition fait peser sur la survie même de l'humanité. L'intervention déterminée de l'avant garde communiste est une condition indispensable du succès définitif du combat de classe prolétarien.CCI, avril 1993.
[1] Il apparaît ainsi une nouvelle fois que les antagonismes impérialistes ne recouvrent pas automatiquement les rivalités commerciales, même si, avec l'effondrement du bloc de l'Est, la carte impérialiste mondiale d'aujourd'hui est plus proche que la précédente de la carte de ces rivalités, ce qui permet à un pays comme les Etats-Unis d'utiliser, notamment dans les négociations du GATT, sa puissance économique et commerciale comme instrument de chantage auprès de ses ex-alliés. De même que la CEE pouvait être à la fois un instrument du bloc impérialiste dominé par la puissance américaine tout en favorisant la concurrence commerciale de ses membres contre cette dernière, des pays comme la Grande-Bretagne et les Pays-Bas peuvent très bien s'appuyer aujourd'hui sur l'Union européenne pour faire valoir leurs intérêts commerciaux face à cette puissance tout en se faisant les représentants de ses intérêts impérialistes en Europe.
Vie du CCI:
- Résolutions de Congrès [131]
Récent et en cours:
- Crise économique [28]
- Luttes de classe [143]
Qui peut changer le monde ? (2e partie) le prolétariat est toujours la classe révolutionnaire
- 3849 reads
Dans la première partie de cet article nous avons dégagé les raisons pour lesquelles le prolétariat est la classe révolutionnaire au sein de la société capitaliste. Nous avons vu pourquoi c'est la seule force capable, en instaurant une nouvelle société débarrassée de l'exploitation et en mesure de satisfaire pleinement les besoins humains, de résoudre les contradictions insolubles qui minent le monde actuel. Cette capacité du prolétariat, mise en évidence depuis le siècle dernier, en particulier par la théorie marxiste, ne découle pas du simple degré de misère et d'oppression qu'il subit quotidiennement. Elle repose encore moins, comme voudraient le faire dire au marxisme certains idéologues de la bourgeoisie, sur une quelconque « inspiration divine » faisant du prolétariat le « messie des temps modernes ». Elle se base sur des conditions bien concrètes et matérielles : la place spécifique qu'occupe cette classe au sein des rapports de production capitalistes, son statut de producteur collectif de l'essentiel de la richesse sociale et de classe exploitée par ces mêmes rapports de production. Cette place au sein du capitalisme ne lui permet pas, contrairement aux autres classes et couches exploitées qui subsistent dans la société (tels les petits paysans, par exemple), d'aspirer à un retour en arrière. Elle l'oblige, au contraire, à se tourner vers l'avenir, vers l'abolition du salariat et l'édification de la société communiste.
Tous ces éléments ne sont pas nouveaux, ils font partie du patrimoine classique du marxisme. Cependant, un des moyens les plus perfides par lesquels l'idéologie bourgeoise essaye de détourner le prolétariat de son projet communiste, est de le convaincre qu'il est en voie de disparition, voire qu'il a déjà disparu. La perspective révolutionnaire aurait eu un sens tant que les ouvriers industriels constituaient l'immense majorité des salariés, mais avec la réduction actuelle de cette catégorie, une telle perspective s'éteindrait d'elle-même. Il faut d'ailleurs reconnaître que ce type de discours n'a pas seulement un impact sur les ouvriers les moins conscients, mais aussi sur certains groupes qui se réclament du communisme. C'est une raison supplémentaire pour combattre fermement de tels bavardages.
La prétendue « disparition » de la classe ouvrière
Les « théories » bourgeoises sur la « disparition du prolétariat » ont déjà une longue histoire. Pendant plusieurs décennies, elles se sont basées sur le fait que le niveau de vie des ouvriers connaissait une certaine amélioration. La possibilité pour ces derniers d'acquérir des biens de consommation qui, auparavant étaient réservés à la bourgeoisie ou à la petite bourgeoisie, était sensée illustrer la disparition de la condition ouvrière. Déjà, à l'époque, ces "théories" ne tenaient pas debout : lorsque l'automobile, la télévision ou le réfrigérateur deviennent, grâce à l'accroissement de la productivité du travail humain, des marchandises relativement bon marché, lorsque, en outre, ces objets se font indispensables de par l'évolution du cadre de vie qui est celui des ouvriers ([1] [1204]), le fait de les posséder ne signifie nullement qu'on se soit dégagé de la condition ouvrière ou même qu'on soit moins exploité. En réalité, le degré d'exploitation de la classe ouvrière n'a jamais été déterminé par la quantité ou la nature des biens de consommation dont elle peut disposer à un moment donné. Depuis longtemps, Marx et le marxisme ont apporté une réponse à cette question : le pouvoir de consommation des salariés correspond au prix de leur force de travail, c'est-à-dire à la quantité de biens nécessaire à la reconstitution de cette dernière. Ce que vise le capitaliste, en versant un salaire à l'ouvrier, c'est de faire en sorte que celui-ci poursuive sa participation au processus productif dans les meilleures conditions de rentabilité pour le capital. Cela suppose que le travailleur, non seulement puisse se nourrir, se vêtir, se loger, mais aussi se reposer et acquérir la qualification nécessaire à la mise en oeuvre de moyens de production en constante évolution.
C'est pour cela que l'instauration de congés payés et l'augmentation de leur durée, qu'on a pu constater au cours du 20e siècle dans les pays développés, ne correspondent nullement à une quelconque « philantropie » de la bourgeoisie. Elles sont rendues nécessaires par la formidable augmentation de la productivité du travail, et donc des cadences de celui-ci, comme de l'ensemble de la vie urbaine, qui caractérise cette même période. De même, ce qu'on nous présente comme une autre manifestation de sollicitude de la classe dominante, la disparition (relative) du travail des enfants et l'allongement de la scolarité, relève essentiellement (avant que ce dernier ne soit devenu aussi un moyen de masquer le chômage) de la nécessité, pour le capital, de disposer d'une main d'oeuvre adaptée aux exigences de la production dont la technicité ne cesse de croître. D'ailleurs, dans «l'augmentation» du salaire tant vantée par la bourgeoisie, notamment depuis la seconde guerre mondiale, il faut prendre en considération le fait que les ouvriers doivent entretenir leurs enfants pendant une durée beaucoup plus longue que par le passé. Lorsque les enfants allaient travailler à 12 ans ou moins, ils rapportaient pendant plus d'une dizaine d'années, avant qu'ils ne fondent un nouveau foyer, un revenu d'appoint dans la famille ouvrière. Avec une scolarité portée à 18 ans, un tel appoint disparaît pour l'essentiel. En d'autres termes, les « augmentations » salariales sont aussi, et en très grande partie, un des moyens par lesquels le capitalisme prépare la relève de la force de travail aux conditions nouvelles de la technologie.
En réalité, même si, pendant un certain temps, le capitalisme des pays les plus développés a pu donner l'illusion d'une réduction du niveau d'exploitation de ses salariés, ce n'était qu'une apparence. Dans les faits, le taux d'exploitation, c'est-à-dire le rapport entre la plus-value produite par l'ouvrier et le salaire qu'il reçoit ([2] [1205]), n'a cessé de s'accroître. C'est pour cela que Marx parlait déjà d'une paupérisation « relative » de la classe ouvrière comme tendance permanente au sein du capitalisme. Durant ce que la bourgeoisie a baptisé « les trente glorieuses» (les années de relative prospérité du capitalisme correspondant à la reconstruction du second après-guerre), l'exploitation des ouvriers a augmenté de façon continue, même si cela ne se traduisait pas par une baisse de leur niveau de vie. Ceci dit, ce n'est plus de paupérisation simplement relative qu'il est question aujourd'hui. Les « améliorations » du revenu des ouvriers ne sont plus de mises par les temps qui courent et la paupérisation absolue, dont les chantres de l'économie bourgeoise avaient annoncé la disparition définitive, a fait un retour en force dans les pays les plus « riches ». Alors que la politique de tous les secteurs nationaux de la bourgeoisie, face à la crise, est de porter des coups brutaux au niveau de vie absolu des prolétaires, par le chômage, la réduction drastique des prestations «sociales » et même les baisses du salaire nominal, les bavardages sur la « société de consommation » et sur « l’embourgeoisement » de la classe ouvrière se sont éteints d'eux-mêmes. C'est pour cela que, maintenant, le discours sur « l’extinction du prolétariat» a changé d'arguments et que, de plus en plus, il porte principalement sur les modifications qui affectent les différentes parties de la classe ouvrière et notamment sur la réduction des effectifs industriels, de la proportion des ouvriers « manuels » dans la masse totale des travailleurs salariés.
De tels discours reposent sur une grossière falsification du marxisme. Celui-ci n'a jamais identifié le prolétariat avec le seul prolétariat industriel ou « manuel » (les « cols bleus »). C'est vrai que, du temps de Marx, les plus gros bataillons de la classe ouvrière étaient constitués par les ouvriers dits «manuels». Mais, de tous temps, il a existé au sein du prolétariat des secteurs qui faisaient appel à une technologie sophistiquée ou à des connaissances intellectuelles importantes. Par exemple certains métiers traditionnels, tels que les pratiquaient les « compagnons », nécessitaient un long apprentissage. De même, des métiers comme correcteur d'imprimerie, faisaient appel à des études non négligeables assimilant ceux qui le pratiquaient à des «travailleurs intellectuels». Cela n'a pas empêché ce secteur du prolétariat de se trouver souvent à l'avant-garde des luttes ouvrières. En fait, l'opposition entre « cols bleus » et « cols blancs » correspond à un découpage comme les affectionnent les sociologues et leurs employeurs bourgeois et qui est destiné à diviser les rangs ouvriers. C'est d'ailleurs pour cela que cette opposition n'est pas nouvelle, la classe dominante ayant compris depuis longtemps l'intérêt qu'il pouvait y avoir pour elle de faire croire à beaucoup d'employés qu'ils n'appartiennent pas à la classe ouvrière. En réalité, l'appartenance à la classe ouvrière ne relève pas de critères sociologiques, et encore moins idéologiques : l'idée que se fait de sa condition tel ou tel prolétaire, ou même l'ensemble d'une catégorie de prolétaires. Ce sont fondamentalement des critères économiques qui déterminent cette appartenance.
Les critères d'appartenance à la classe ouvrière
Fondamentalement, le prolétariat est la classe exploitée spécifique des rapports de production capitalistes. Il en découle, comme nous l'avons vu dans la première partie de cet article, les critères suivants : « A grands traits... le fait d'être privé de moyens de production et d'être contraint, pour vivre, de vendre sa force de travail à ceux qui les détiennent et qui mettent à profit cet échange pour s'accaparer une plus-value, détermine l'appartenance à la classe ouvrière». Cependant, face à toutes les falsifications qui, de façon intéressée, ont été introduites sur cette question, il est nécessaire de préciser ces critères.
En premier lieu, il faut remarquer que, s'il est nécessaire d'être salarié pour appartenir à la classe ouvrière, ce n'est pas suffisant : sinon, les flics, les curés, certains PDG de grandes entreprises (en particulier ceux des entreprises publiques) et même les ministres seraient des exploités et, potentiellement, des camarades de combat de ceux qu'ils répriment, abrutissent, font trimer ou qui ont un revenu dix ou cent fois moindre ([3] [1206]). C'est pour cela qu'il est indispensable de signaler qu'une des caractéristiques du prolétariat est de produire de la plus-value. Cela signifie notamment deux choses : le revenu d'un prolétaire n'excède pas un certain niveau ([4] [1207]) au delà duquel il ne peut provenir que de la plus-value extorquée à d'autres travailleurs ; un prolétaire est un producteur réel de plus-value et non pas un agent salarié du capital ayant pour fonction de faire régner l'ordre capitaliste parmi ces producteurs.
Ainsi, au sein du personnel d'une entreprise, certains cadres techniques (et même des ingénieurs d'études) dont le salaire n'est pas éloigné de celui d'un ouvrier qualifié, appartiennent à la même classe que ce dernier, alors que ceux dont le revenu s'apparente plutôt à celui du patron (même s'ils n'ont pas de rôle dans l'encadrement de la main-d'oeuvre) n'en font pas partie. De même, dans cette entreprise, tel ou tel «petit chef» ou « agent de sécurité», dont le salaire peut être moindre que celui d'un technicien ou même d'un ouvrier qualifié mais dont le rôle est celui d'un « kapo » du bagne industriel, ne peut pas être considéré comme appartenant au prolétariat.
D'un autre côté, l'appartenance à la classe ouvrière n'implique pas une participation directe et immédiate à la production de plus value. L'enseignant qui éduque le futur producteur, l'infirmière -ou même le médecin salarié (dont il arrive maintenant que le revenu soit moindre que celui d'un ouvrier qualifié)- qui « répare » la force de travail des ouvriers (même si, en même temps, elle soigne aussi des flics, des curés ou des responsables syndicaux, voire des ministres) appartient incontestablement à la classe ouvrière au même titre qu'un cuisinier dans une cantine d'entreprise. Evidemment, cela ne veut pas dire que ce soit aussi le cas pour le mandarin de l'université ou pour l'infirmière qui s'est mise à son compte. Il est cependant nécessaire de préciser que le fait que les membres du corps enseignant, y compris les instituteurs (dont la situation économique n'est vraiment pas reluisante, en général), soient consciemment ou inconsciemment, volontairement ou non, des véhicules des valeurs idéologiques bourgeoises, ne les exclut pas de la classe exploitée et révolutionnaire, pas plus, non plus, que les ouvriers métallurgistes qui produisent des armes ([5] [1208]). D'ailleurs on peut constater que, tout au long de l'histoire du mouvement ouvrier, les enseignants (particulièrement les instituteurs) ont fourni une quantité importante de militants révolutionnaires. De même, les ouvriers des arsenaux de Kronstadt faisaient partie de l'avant-garde de la classe ouvrière lors de la révolution russe de 1917.
Il faut également réaffirmer que la grande majorité des employés appartient aussi à la classe ouvrière. Si on prend le cas d'une administration comme la poste, personne ne s'aviserait de prétendre que les mécaniciens qui entretiennent les camions postaux et ceux qui les conduisent, de même que ceux qui transbordent des sacs de courrier n'appartiennent pas au prolétariat. Partant de là, il n'est pas difficile de comprendre que leurs camarades qui distribuent les lettres ou qui travaillent derrière les guichets pour affranchir des colis ou payer des mandats se trouvent dans la même situation. C'est pour cela que les employés de banque, les agents des compagnies d'assurance, les petits fonctionnaires des caisses de sécurité sociale ou des impôts, dont le statut est tout à fait équivalent à celui des précédents, appartiennent également à la classe ouvrière. Et on ne peut même pas arguer que ces derniers auraient des conditions de travail meilleures que celles des ouvriers de l'industrie, un ajusteur ou un fraiseur, par exemple. Travailler toute une journée derrière un guichet ou devant un écran d'ordinateur n'est pas moins pénible que d'actionner une machine-outil, même si on ne s'y salit pas les mains. En outre, ce qui constitue un des facteurs objectifs de la capacité du prolétariat, tant de mener sa lutte de classe, que de renverser le capitalisme, le caractère associé de son travail, n'est nullement remis en cause par les conditions modernes de la production. Au contraire, il ne cesse de s'accentuer.
De même, avec l'élévation du niveau technologique de la production, cette dernière fait appel à un nombre croissant de ce que la sociologie et les statistiques nomment les « cadres » (techniciens ou même ingénieurs) dont la plupart, comme on l'a signalé plus haut, voient ainsi leur statut social, et même leur revenu, se rapprocher de celui des ouvriers qualifiés. Il ne s'agit nullement, dans ce cas, d'un phénomène de disparition de la classe ouvrière au détriment des « couches moyennes» mais bien d'un phénomène de prolétarisation de celles-ci ([6] [1209]). C'est pour cela que les discours sur la « disparition du prolétariat », qui résulterait du nombre croissant d'employés ou de « cadres » par rapport au nombre d'ouvriers «manuels» de l'industrie, n'ont d'autre fondement que de tenter de mystifier ou démoraliser les uns et les autres. Que les auteurs de ces discours y croient ou non ne change rien à l'affaire : ils peuvent servir efficacement la bourgeoisie tout en étant des crétins incapables de se demander qui a fabriqué le stylo avec lequel ils écrivent leurs âneries.
La prétendue « crise » de la classe ouvrière
Pour démoraliser les ouvriers, la bourgeoisie ne met pas tous ses oeufs dans le même panier. C'est pour cela qu'à l'adresse de ceux qui ne marchent pas dans ses campagnes sur la « disparition de la classe ouvrière » elle serine que cette dernière est «en crise». Et un des arguments qui se veut décisif pour faire la preuve de cette crise c'est la perte d'audience qu'ont subi les syndicats au cours des deux dernières décennies. Dans le cadre de cet article, nous ne reviendrons pas sur notre analyse démontrant la nature bourgeoisie du syndicalisme sous toutes ses formes. En fait, c'est l'expérience quotidienne de la classe ouvrière, le sabotage systématique de ses luttes par les organisations qui prétendent la « défendre», qui se charge, jour après jour, de faire cette démonstration ([7] [1210]). Et c'est justement cette expérience des ouvriers qui est la première responsable de leur rejet des syndicats. En ce sens, ce rejet n'est pas une «preuve» d'une quelconque crise de la classe ouvrière, mais au contraire, et avant tout, une manifestation d'une prise de conscience en son sein. Une illustration de ce fait, parmi des milliers, nous est donnée par l'attitude des ouvriers lors de deux mouvements de grande ampleur qui ont affecté le même pays, la France, à trois décennies d'intervalle. A la fin des grèves de mai-juin 1936, alors que nous nous trouvons au creux de la contre-révolution qui a suivi la vague révolutionnaire mondiale du premier après-guerre, les syndicats bénéficient d'un mouvement d'adhésion sans précédent. En revanche, la fin de la grève généralisée de mai 1968, qui signe la reprise historique des combats de classe et la fin de cette période de contre-révolution, est marquée par de nombreuses démissions des syndicats, par des monceaux de cartes déchirées.
L'argument de la désyndicalisation comme preuve des difficultés que peut rencontrer le prolétariat est un des plus sûrs indices de l'appartenance au camp bourgeois de celui qui l'utilise. Il en est exactement de même que pour la prétendue nature «socialiste» des régimes staliniens. L'histoire a montré, notamment avec la seconde guerre mondiale, l'ampleur des ravages sur les consciences ouvrières de ce mensonge promu par tous les secteurs de la bourgeoisie, de droite, de gauche et d'extrême gauche (staliniens et trotskistes). Ces dernières années, on a pu voir comment l'effondrement du stalinisme a été utilisé comme «preuve » de la faillite définitive de toute perspective communiste. Le mode d'emploi du mensonge sur la « nature ouvrière des syndicats » est en bonne partie similaire : dans un premier temps, il sert à embrigader les ouvriers derrière l'Etat capitaliste ; dans un deuxième temps, on tente d'en faire un instrument pour les démoraliser et les désorienter. Il existe cependant une différence dans l'impact de ces deux mensonges : parce qu'elle ne résultait pas des luttes ouvrières, la faillite des régimes staliniens a pu être utilisée avec efficacité contre le prolétariat ; en revanche, le discrédit des syndicats résulte, pour l'essentiel, de ces mêmes luttes ouvrières, ce qui en limite grandement l'impact comme facteur de démoralisation. C'est bien pour cette raison, d'ailleurs, que la bourgeoisie a fait surgir un syndicalisme « de base » chargé de prendre la relève du syndicalisme traditionnel. C'est pour cette raison, également, qu'elle fait la promotion d'idéologues, aux allures plus «radicales», chargés de délivrer le même type de message.
C'est ainsi qu'on a pu voir fleurir, et promues dans la presse ([8] [1211]), des analyses comme celles du sieur Alain Bihr, docteur en sociologie et auteur, entre autres, d'un livre intitulé : «Du grand soir à l'alternative : la crise du mouvement ouvrier européen». En soi, les thèses de ce personnage ne présentent pas un grand intérêt. Cependant, le fait que celui-ci grenouille, depuis quelques temps, dans des milieux qui se réclament de la gauche communiste, lesquels, pour certains, n'ont pas peur de reprendre à leur compte (de façon « critique », évidemment) ses « analyses » ([9] [1212]), nous incite à relever le danger que représentent ces dernières.
Monsieur Bihr se présente comme un « vrai » défenseur des intérêts ouvriers. C'est pour cela qu'il ne prétend pas que la classe ouvrière serait en voie de disparition. Au contraire, il commence par affirmer que : « ... les frontières du prolétariat s'étendent aujourd'hui bien au-delà du traditionnel "monde ouvrier" ». Cependant, c'est pour mieux faire passer son message central : « Or, au cours d'une quinzaine d'années de crise, en France comme dans la plupart des pays occidentaux, on a assisté à une fragmentation croissante du prolétariat, qui, en mettant en cause son unité, a tendu à le paralyser en tant que force sociale. »([10] [1213])
Ainsi, le propos principal de notre auteur est de démontrer que le prolétariat « est en crise » et que le responsable de cette situation est la crise du capitalisme lui-même, cause à laquelle il faut ajouter, évidemment, les modifications sociologiques qui ont affecté la composition de la classe ouvrière : « En fait, les transformations en cours du rapport salarial, avec leurs effets globaux de fragmentation et de "démassification" du prolétariat, [...] tendent à dissoudre les deux figures prolétariennes qui lui ont fourni ses gros bataillons durant la période for dis te : d'une part, celle de l'ouvrier professionnel, que les transformations actuelles remanient profondément, les anciennes catégories d'OP liées au fordisme tendant à disparaître tandis que de nouvelles catégories de "professionnels" apparaissent en liaison avec les nouveaux procès de travail automatisés ; d'autre part, celle de l'ouvrier spécialisé, fer de lance de l'offensive prolétarienne des années 60 et 70, les OS se trouvant progressivement éliminés et remplacés par des travailleurs précaires à l'intérieur de ces mêmes procès de travail automatisés. »([11] [1214]) Au delà du langage pédant (qui transporte de plaisir les petits bourgeois qui se prennent pour des « marxistes »), Bihr nous ressort les mêmes poncifs que nous ont déjà infligés des générations de sociologues : l'automatisation de la production serait responsable de l'affaiblissement du prolétariat (comme il se veut « marxiste », il ne dit pas la « disparition »), etc. Et il leur emboîte également le pas en prétendant que la désyndicalisation serait elle aussi un signe de la « crise de la classe ouvrière » puisque : « Toutes les études effectuées sur le développement du chômage et de la précarité montrent que ceux-ci tendent à réactiver et à renforcer les anciennes divisions et inégalités au sein du prolétariat (...). Cet éclatement en des statuts aussi hétérogènes a eu des effets désastreux sur les conditions d'organisation et de lutte. En témoigne d'abord l'échec des différentes tentatives menées, notamment par le mouvement syndical, pour organiser précaires et chômeurs, ...;»([12] [1215]) Ainsi, derrière ses phrases plus radicales, derrière son prétendu «marxisme», Bihr nous ressort la même camelote frelatée que celle qui nous est servie par tous les secteurs de la bourgeoisie : les syndicats seraient encore aujourd'hui des « organisations du mouvement ouvrier. »([13] [1216])
Voilà chez quel type de « spécialistes » des gens comme GS et des publications comme Perspective Internationaliste (PI), qui accueille avec sympathie ses écrits, tirent leur inspiration. Il est vrai que Bihr, qui malgré tout est malin, prend soin, pour faire passer en contrebande sa marchandise, de prétendre que le prolétariat sera capable de surmonter, malgré tout, ses difficultés actuelles en parvenant à se « recomposer ». Mais la façon dont il le dit tend plutôt à convaincre du contraire : « Les transformations du rapport salarial lancent ainsi un double défi au mouvement ouvrier : elles le contraignent simultanément à s'adapter à une nouvelle base sociale (à une nouvelle composition "technique" et "politique" de la classe) et à faire la synthèse entre des catégories aussi hétérogènes a priori que celles des "nouveaux professionnels" et des "précaires", synthèse beaucoup plus difficile à réaliser que celle entre OS et OP pendant la période fordiste » ([14] [1217]) «L'affaiblissement pratique du prolétariat et du sentiment d'appartenance de classe peut ainsi ouvrir la voie à la recomposition d'une identité collective imaginaire sur d'autres bases. »([15] [1218])
Ainsi, après des tonnes d'arguments, pour la plupart spécieux, destinés à convaincre le lecteur que tout va mal pour la classe ouvrière, après avoir «démontré» que les causes de cette « crise » sont à rechercher dans l'automatisation du travail ainsi que dans l'effondrement de l'économie capitaliste et la montée du chômage, tous phénomènes qui ne pourront que s'aggraver, on finit par affirmer, de façon lapidaire et sans le moindre argument : « Cela ira mieux... peut-être! Mais c'est un défi très difficile à relever. » Si après avoir gobé les sornettes de Bihr on continue de penser qu'il existe encore un futur pour le prolétariat et pour sa lutte de classe, c'est qu'on est un optimiste béat et indécrotable. Bien joué, Docteur Bihr : vos grosses ficelles ont attrapé les niais qui publient PI et qui se présentent comme les véritables défenseurs des principes communistes que le CCI aurait jetés aux orties.
C'est vrai que la classe ouvrière a rencontré au cours de ses dernières années un certain nombre de difficultés pour développer ses luttes et sa conscience. Pour notre part, et contrairement aux reproches que nous font les sceptiques de service (qu'ils s'appellent la FECCI -ce qui est bien dans son rôle de semeur de confusion - mais aussi Battaglia Comunista - ce qui l'est moins, puisqu'il s'agit d'une organisation du milieu politique prolétarien -) nous n'avons jamais hésité à signaler ces difficultés. Mais en même temps, et c'est la moindre des choses qu'on puisse attendre des révolutionnaires, nous avons, sur la base d'une analyse de l'origine des difficultés que rencontre le prolétariat, mis en évidence les conditions permettant leur dépassement. Et lorsqu'on examine un tant soit peu sérieusement l'évolution des luttes ouvrières au cours de la dernière décennie, il saute aux yeux que leur affaiblissement actuel ne saurait s'expliquer par la diminution des effectifs des ouvriers « traditionnels », des « cols bleus ». Ainsi, dans la plupart des pays, les travailleurs des postes et télécommunications sont parmi les plus combatifs. Il en est de même des travailleurs de la santé. En 1987, en Italie, ce sont les travailleurs de l'école qui ont mené les luttes les plus importantes. Et nous pourrions ainsi multiplier les exemples qui viennent illustrer le fait que, non seulement le prolétariat ne se limite pas aux «cols bleus », aux ouvriers « traditionnels » de l'industrie, mais que la combativité ouvrière non plus. C'est pour cela que nos analyses ne se sont pas focalisées sur des considérations sociologiques bonnes pour universitaires ou petits-bourgeois en mal d'interprétation non pas du « malaise » de la classe ouvrière, mais de leur propre malaise.
Les difficultés réelles de la classe ouvrière et les conditions de leur dépassement
Nous ne pouvons pas revenir, dans le cadre de cet article, sur l'ensemble des analyses de la situation internationale que nous avons faites tout au long des dernières années. Le lecteur pourra les retrouver dans pratiquement tous les numéros de notre Revue au cours de cette période et particulièrement dans les thèses et résolutions adoptées par notre organisation depuis 1989 ([16] [1219]). Les difficultés que traverse aujourd'hui le prolétariat, le recul de sa combativité et de la conscience en son sein, difficultés sur lesquelles s'appuient certains pour diagnostiquer une « crise » de la classe ouvrière, n'ont pas échappé au CCI. En particulier, nous avons mis en évidence que, tout au long des années 1980, celle-ci à été confrontée au poids croissant de la décomposition généralisée de la société capitaliste qui, en favorisant le désespoir, l'atomisation, le « chacun pour soi», a porté des coups importants à la perspective générale de la lutte prolétarienne et à la solidarité de classe, ce qui a facilité, en particulier, les manoeuvres syndicales visant à enfermer les luttes ouvrières dans le corporatisme. Cependant, et c'était une manifestation de la vitalité du combat de classe, ce poids permanent de la décomposition n'a pas réussi, jusqu'en 1989, à venir à bout de la vague de combats ouvriers qui avait débuté en 1983 avec les grèves du secteur public en Belgique. Bien au contraire, durant cette période, nous avions assisté à un débordement croissant des syndicats qui avaient dû, pour le travail de sabotage des luttes, laisser le devant de la scène de plus en plus souvent à un syndicalisme « de base », plus radical. ([17] [1220])
Cette vague de luttes prolétariennes allait cependant être engloutie par les bouleversements planétaires qui se sont succédés à partir de la seconde moitié de 1989. Alors que certains, en général les mêmes qui n'avaient rien vu des luttes ouvrières du milieu des années 1980, estimaient que l'effondrement, en 1989, des régimes staliniens d'Europe (qui constitue, à ce jour, la manifestation la plus importante de la décomposition du système capitaliste) allait favoriser la prise de conscience de la classe ouvrière, nous n'avons pas attendu pour annoncer le contraire ([18] [1221]). Par la suite, notamment en 1990-91, lors de la crise et de la guerre du Golfe puis du putsch de Moscou suivi de l'effondrement de l'URSS, nous avons relevé que ces événements allaient affecter également la lutte de classe, la capacité du prolétariat à faire face aux attaques croissantes que le capitalisme en crise allait lui asséner.
C'est pour cela que les difficultés traversées par la classe au cours de la dernière période n'ont pas échappé, ni surpris, notre organisation. Cependant, en analysant leurs causes véritables (qui ont peu de chose à voir avec un mythique besoin de « recomposition de la classe ouvrière ») nous avons, en même temps, mis en évidence les raisons pour lesquelles la classe ouvrière avait aujourd'hui les moyens de dépasser ces difficultés.
A ce sujet, il est important de revenir sur un des arguments du sieur Bihr pour accréditer l'idée d'une crise de la classe ouvrière : la crise et le chômage ont «fragmenté le prolétariat» en «renforçant les anciennes divisions et inégalités» en son sein. Pour illustrer son propos, et « charger la barque », Bihr nous fait le catalogue de tous ces «fragments» : «les travailleurs stables et garantis », « les exclus du travail, voire du marché du travail », « la masse flottante des travailleurs précaires». Et, dans cette dernière, il se délecte à distinguer des sous-catégories : « les travailleurs des entreprises travaillant en sous-traitance et en régie », « les travailleurs à temps partiel », «les travailleurs temporaires », «les stagiaires » et « les travailleurs de l'économie souterraine. »([19] [1222]) en fait, ce que le docteur Bihr nous présente comme un argument n'est pas autre chose qu'un constat photographique, ce qui cadre tout à fait avec sa vision réformiste ([20] [1223]). C'est vrai que, dans un premier temps, la bourgeoisie a mené ses attaques contre la classe ouvrière de façon sélective de façon à limiter l'ampleur des ripostes de cette dernière. C'est vrai également que le chômage, et particulièrement celui des jeunes, a constitué un facteur de chantage sur certains secteurs du prolétariat et, partant, de passivité tout en accentuant l'action délétère de l'ambiance de décomposition sociale et de «chacun pour soi». Cependant, la crise elle-même, et son aggravation inexorable, se chargeront de plus en plus d'égaliser par le bas la condition des différents secteurs de la classe ouvrière. En particulier, les secteurs «de pointe» (informatique, télécommunications, etc.) qui avaient paru échapper à la crise, sont aujourd'hui frappés de plein fouet, jetant leurs travailleurs dans la même situation que ceux de la sidérurgie ou de l'automobile. Et ce sont maintenant les plus grandes entreprises (telles IBM) qui licencient en masse. En même temps, contrairement à la tendance de la décennie passée, le chômage des travailleurs d'âge mûr, qui ont déjà une expérience collective de travail et de lutte, augmente aujourd'hui plus vite que celui des jeunes, ce qui tend à limiter le facteur d'atomisation qu'il avait représenté par le passé.
Ainsi, même si la décomposition constitue un handicap pour le développement des luttes et de la conscience dans la classe, la faillite de plus en plus évidente et brutale de l'économie capitaliste, avec le cortège d'attaques qu'elle implique contre les conditions d'existence du prolétariat, constitue l'élément déterminant de la situation actuelle pour la reprise des luttes et de la marche de celui-ci vers sa prise de conscience. Evidemment, on ne peut comprendre cela si l'on pense, comme l'affirme l'idéologie réformiste qui se refuse à envisager la moindre perspective révolutionnaire, que la crise capitaliste provoque une « crise de la classe ouvrière». Mais, encore une fois, les événements eux-mêmes se sont chargés de souligner la validité du marxisme et l'inanité des élucubrations des sociologues. Les luttes formidables du prolétariat d'Italie, à l'automne 1992, face à des attaques économiques d'une violence sans précédent, ont, une fois de plus, démontré que le prolétariat n'était pas mort, qu'il n'avait pas disparu et qu'il n'avait pas renoncé à la lutte, même si, comme on pouvait s'y attendre, il n'avait pas encore fini de digérer les coups qu'il avait reçus dans les années précédentes. Et ces luttes ne sont pas destinées à rester des feux de paille. Elles ne font qu'annoncer (comme l'avaient fait les luttes ouvrières de mai 1968, il y a juste un quart de siècle, en France) un renouveau général de la combativité ouvrière, une reprise de la marche en avant du prolétariat vers la prise de conscience des conditions et des buts de son combat historique pour l'abolition du capitalisme. N'en déplaise à tous ceux qui se lamentent, sincèrement ou hypocritement, sur la « crise de la classe ouvrière » et sa « nécessaire recomposition».
FM.
[1] [1224] L'automobile est indispensable pour aller à son travail ou pour faire des achats lorsque les transports en commun sont insuffisants et que les distances à parcourir deviennent de plus en plus considérables. On ne peut se passer d'un réfrigérateur lorsque le seul moyen d'acquérir de la nourriture bon marché est de l'acheter dans des grandes surfaces, ce qu'on ne peut faire tous les jours. Quant à la télévision, qui fut présentée comme le symbole de l'accession à la «société de consommation », outre l'intérêt qu'elle présente comme instrument de propagande et d'abrutissement entre les mains de la bourgeoisie (comme «opium du peuple», elle a remplacé avantageusement la religion), on la trouve aujourd'hui dans beaucoup de logis des bidonvilles du tiers-monde, ce qui en dit long sur la dévalorisation d'un tel article
[2] [1225] Marx appelait taux de plus-value ou taux d'exploitation le rapport P1/V où PI représente la plus-value en valeur-travail (le nombre d'heures de la journée de travail que le capitaliste s'approprie) et le capital variable, c'est-à-dire le salaire (le nombre d'heures pendant lesquelles l'ouvrier produit l'équivalent en valeur de ce qu'il reçoit). C'est un indice qui permet de déterminer en termes économiques objectifs, et non subjectifs, l'intensité réelle de l'exploitation.
[3] [1226] Evidemment, cette affirmation va à rencontre des mensonges proférés par tous les prétendus « défenseurs de la classe ouvrière », comme les socio-démocrates ou les staliniens, qui ont une longue expérience tant de la répression et de la mystification des ouvriers que des cabinets ministériels. Lorsqu'un ouvrier « sorti du rang » accède au poste de cadre syndical, de conseiller municipal, voire de maire, de député ou de ministre, il n'a plus rien à voir avec sa classe d'origine.
[4] [1227] Il est évidemment très difficile (sinon impossible) de déterminer ce niveau, lequel peut être variable dans le temps ou d'un pays à l'autre. L'important est de savoir que, dans chaque pays (ou ensemble de pays similaires du point de vue du développement économique et de la productivité du travail), il existe un tel seuil qui se situe entre le salaire de l'ouvrier qualifié et celui du cadre supérieur.
[5] [1228] Pour une analyse plus développée sur travail productif et travail improductif, on pourra se reporter à notre brochure <r La décadence du capitalisme » (pages 78-84 dans la version en français).
[6] [1229] Il faut cependant noter qu'en même temps, une certaine proportion des cadres voit ses revenus augmenter ce qui débouche sur son intégration dans la classe dominante.
[7] [1230] Pour une analyse développée de la nature bourgeoise des syndicats, voir notre brochure «Les syndicats contre la classe ouvrière».
[8] [1231] Par exemple Le Monde Diplomatique, un mensuel humaniste français, spécialisé dans la promotion d'un capitalisme <r à visage humain», publie fréquemment des articles d'Alain Bihr. Ainsi, dans sa livraison de mars 91, on peut y trouver un texte de cet auteur intitulé « Régression des droits sociaux, affaiblissement des syndicats, le prolétariat dans tous ses éclats ».
[9] [1232] C'est ainsi que dans le n°22 de Perspective Internationaliste, organe de la <r Fraction ex terne (sic!) du CCI», on peut lire une contribution de GS (qui, sans que son auteur ne soit membre de la FECCI, rencontre, pour l'essentiel, l'assentiment de celle-ci) intitulée «La nécessaire recomposition du prolétariat» et qui cite longuement le livre phare de Bihr pour étayer ses assertions.
[10] [1233] Le Monde Diplomatique, mars 1991.
[11] [1234] « Du Grand Soir... »
[12] [1235] Le Monde Diplomatique, mars 1991.
[13] [1236] Le Monde Diplomatique, mars 1991.
[14] [1237] « Du grand soir...»
[15] [1238] Le Monde Diplomatique, mars 1991.
[16] [1239] Voir la Revue Internationale n° 60, 63, 67, 70, et ce numéro.
[17] [1240] Evidemment, si l'on considère, comme le Docteur Bihr, que les syndicats sont des organes de la classe ouvrière et non de la bourgeoisie, les progrès accomplis par la lutte de classe se convertissent en une régression. Il est toutefois curieux que des gens, tels les membres de la FECCI, qui officiellement reconnaissent la nature bourgeoise des syndicats, lui emboîtent le pas dans cette appréciation.
[18] [1241] Voir « Des difficultés accrues pour le prolétariat » dans la Revue Internationale n° 60.
[19] [1242] Le Monde Diplomatique, mars 1991.
[20] [1243] D'ailleurs, une des phrases favorites d'Alain Bihr est que « le réformisme est une chose trop sérieuse pour la laisser aux réformistes». Si par hasard il se prenait pour un révolutionnaire, nous tenons ici à le détromper.
Questions théoriques:
- Le cours historique [17]
Heritage de la Gauche Communiste:
Vingt-cinq ans après mai 1968 : que reste-t-il de mai 1968 ?
- 8943 reads
Les grandes luttes ouvrières laissent peu de traces visibles, quand elles sont terminées. Lorsque «l'ordre» revient, lorsque « la paix sociale » répand à nouveau son impitoyable chape de plomb quotidienne, il ne reste bientôt d'elles qu'un souvenir. Un «souvenir», cela semble bien, mais peu. En fait c'est une force redoutable dans la tête de la classe révolutionnaire.
L'idéologie dominante tente en permanence de détruire ces images des moments où les exploités ont relevé la tête. Elle le fait en falsifiant l'histoire. Elle manipule les mémoires en vidant de leur force révolutionnaire les souvenirs de lutte. Elle génère des clichés mutilés, vidés de tout ce que ces luttes avaient d'exemplaire, d'instructif et d'encourageant pour les luttes à venir.
A l'occasion de l'effondrement de l'URSS, les prêtres de l'ordre établi s'étaient adonnés à coeur joie à cet exercice, pataugeant comme jamais dans la boue du mensonge qui identifie la révolution d'octobre 1917 au stalinisme. A l'occasion du 25e anniversaire des événements de Mai 1968, ils recommencent, même si c'est à une moindre échelle.
Ce qui fut, par le nombre des participants et la durée, la plus grande grève ouvrière de l'histoire est présenté aujourd'hui comme une agitation estudiantine produit d'infantiles rêveries utopiques d'une intelligentsia universitaire imbue des Rolling Stones et des héros staliniens du « tiers-monde ». Qu'en resterait-t-il aujourd'hui ? Rien, sinon une preuve de plus que toute idée de dépassement du capitalisme est une rêvasserie creuse. Et les médias de se régaler à nous montrer les images des anciens leaders étudiants «révolutionnaires», apprentis-bureaucrates devenus, un quart de siècle après, de consciencieux et respectables gérants de ce capitalisme qu'ils avaient tant contesté Cohn Bendit, « Dany le rouge », député du Parlement de Francfort ; les autres, conseillers particuliers du président de la république, ministres, hauts fonctionnaires, cadres d'entreprise, etc. Quant à la grève ouvrière, on n'en parle que pour dire qu'elle n'est jamais allée au-delà de revendications immédiates. Qu'elle a abouti à une augmentation de salaires qui fut annulée en six mois par l'inflation. Bref, tout cela n'était que du vent et il ne peut en rester que du vent.
Que subsiste-t-il en réalité de mai 1968 dans la mémoire de la classe ouvrière qui l'a fait ?
Il y a bien sûr les images des barricades en flammes où s'affrontaient la nuit, dans le brouillard des bombes lacrymogènes, étudiants et jeunes ouvriers contre les forces de police ; celles des rues dépavées du Quartier latin de Paris, le matin, jonchées de débris et de voitures les roues en l'air. Les médias les ont suffisamment montrées.
Mais la puissance des manipulations médiatiques a des limites. La classe ouvrière possède une mémoire collective, même si celle-ci vit un peu sous forme «souterraine », ne s'exprimant ouvertement que lorsque la classe parvient à nouveau à s'unifier massivement dans la lutte. Au-delà de ce côté spectaculaire, il reste dans les mémoires ouvrières un sentiment diffus et profond à la fois : celui de la force que représente le prolétariat lorsqu'il sait s'unifier.
Il y a bien eu au début des événements de 68 en France une agitation estudiantine, comme il y en avait dans tous les pays industrialisés occidentaux, nourrie en grande partie par l'opposition à la guerre du Vietnam et par une inquiétude nouvelle sur l'avenir. Mais cette agitation restait cantonnée à une toute petite partie de la société. Elle se résumait souvent à des défilés d'étudiants qui sautillaient dans la rue scandant les syllabes du nom d'un des staliniens les plus meurtriers : « Ho-Ho, Ho-Chi-Minh ! ». A l'origine des premiers troubles en milieu étudiant en 68 en France, on trouve, entre autres, la revendication des étudiants d'avoir accès aux chambres des filles dans les cités universitaires... Avant 1968, dans les campus, « la révolte » s'affirmait souvent sous la bannière des théories de Marcuse, dont une des thèses essentielles était que la classe ouvrière n'était plus une force sociale révolutionnaire car elle s'était définitivement embourgeoisée.
En France, la bêtise du gouvernement du militaire De Gaulle, qui répondit à l'effervescence estudiantine par une répression disproportionnée et aveugle, avait conduit l'agitation au paroxysme des premières barricades. Mais cela demeurait encore pour l'essentiel circonscrit dans le ghetto de la jeunesse scolarisée. Ce qui vint tout bouleverser, ce qui transforma « les événements de Mai» en une explosion sociale majeure ce fut l'entrée en scène du prolétariat. C'est lorsque, au milieu du mois de Mai, la classe ouvrière s'est jetée presque toute entière dans la bataille, paralysant la quasi-totalité des mécanismes essentiels de la machine économique, que les choses sérieuses ont commencé. Balayant la résistance des appareils syndicaux, brisant les barrières corporatistes, près de 10 millions de travailleurs avaient arrêté le travail tous ensemble. Et par ce seul geste ils avaient fait basculer l'histoire.
Les ouvriers, qui quelques jours auparavant étaient une masse d'individus épars, s'ignorant les uns les autres et subissant aussi bien le poids de l'exploitation que celui de la police stalinienne dans les lieux de travail, ceux-là mêmes qu'on avait dit définitivement embourgeoisés, se retrouvaient soudain réunis, avec, entre leurs mains, une force gigantesque. Une force dont ils étaient les premiers surpris et dont ils ne savaient pas toujours quoi faire.
L'arrêt des usines et des bureaux, l'absence de transports publics, la paralysie des rouages productifs démontraient chaque jour comment, dans le capitalisme, tout dépend, en fin de compte, de la volonté et de la conscience de la classe exploitée. Le mot de « révolution » revint dans toutes bouches et les questions de savoir ce qui était possible, où on allait, comment cela s'était passé dans les grandes luttes ouvrières du passé devinrent les sujets centraux de discussion. « Tout le monde parlait et tout le monde s'écoutait». C'est une des caractéristiques dont on se souvient le plus. Pendant un mois, le silence qui isole les individus en une masse atomisée, cette muraille invisible qui semble d'ordinaire si épaisse, si inévitable, si désespérante, avait disparu. On discutait partout : dans les rues, dans les usines occupées, dans les universités et les lycées, dans les «Maisons de jeunes» des quartiers ouvriers, transformées en lieu de réunion politique par les « comités d'action » locaux. Le langage du mouvement ouvrier qui appelle les choses par leur nom : bourgeoisie, prolétariat, exploitation, lutte de classes, révolution, etc. se développait parce qu'il était tout naturellement le seul capable de cerner la réalité.
La paralysie du pouvoir politique bourgeois, ses hésitations face à une situation qui lui échappait, confirmaient la puissance de l'impact de la lutte ouvrière. Une anecdote illustre bien ce qui était ressenti dans les antres du pouvoir. Michel Jobert, chef de cabinet du premier ministre Pompidou pendant les événements, racontait en 1978, dans une émission de télévision consacrée au dixième anniversaire de 68, comment un jour, par la fenêtre de son bureau, il avait aperçu un drapeau rouge qui flottait sur le toit d'un des bâtiments ministériels. Il s'était empressé de téléphoner pour faire enlever cet objet qui par sa présence ridiculisait l'autorité des institutions. Mais, après plusieurs appels, il n'était pas parvenu à trouver quelqu'un disposé ou ayant les moyens d'exécuter cette tâche. C'est alors qu'il avait compris que quelque chose de vraiment nouveau était en train de se produire.
La véritable victoire des luttes ouvrières de Mai 68 ne fut pas dans les augmentations de salaires obtenues, mais dans le ressurgissent même de la force de la classe ouvrière. C'était le retour du prolétariat sur la scène de l'histoire après plusieurs décennies de contre-révolution stalinienne triomphante.
Aujourd'hui, alors que les ouvriers du monde entier subissent les effets des campagnes idéologiques sur « la fin du communisme et de la lutte de classe », le souvenir de ce que fut véritablement la grève de masses en 1968 en France constitue un rappel vivant de la force que porte en elle la classe ouvrière. Alors que toute la machine idéologique s'efforce d'enfoncer la classe révolutionnaire dans une océan de doutes sur elle même, de convaincre chaque ouvrier qu'il est désespérément seul et n'a rien à attendre du reste de sa classe, ce rappel constitue un indispensable antidote.
Mais, nous dira-t-on, qu'importe le souvenir s'il s'agit seulement de quelque chose qui ne se reproduira plus. Qu'est-ce qui prouve que dans l'avenir nous pourrons assister a de nouvelles affirmations massives, puissantes de l'unité combative de la classe ouvrière ?
Sous une forme un peu différente, cette même question se trouva posée au lendemain des luttes du printemps 68 : venait-on d'assister à un simple feu de paille spécifiquement français ou bien ces événements ouvraient-ils, à l'échelle internationale, une nouvelle période historique de combativité prolétarienne ?
L'article ci-après, publié en 1969 dans le n°2 de Révolution Internationale, se donnait pour tâche de répondre à cette question. A travers la critique des analyses de l'Internationale Situationniste ([1] [1244]), il affirme la nécessité de comprendre les causes profondes de cette explosion et de les chercher non pas, comme le faisait l’IS, dans « les manifestations les plus apparentes des aliénations sociales » mais dans « les sources qui leur donnent naissance et les nourrissent». «C'est dans ces racines (économiques) que la critique théorique radicale doit déceler les possibilités de son dépassement révolutionnaire... Mai 1968 apparaît dans toute sa signification pour avoir été une des premières et une des plus importantes réactions de la masse des travailleurs contre une situation économique mondiale allant se détériorant. »
A partir de là il était possible de prévoir. En comprenant le lien qui existait entre l'explosion de Mai 68 et la dégradation de la situation économique mondiale, en comprenant que cette dégradation traduisait un changement historique dans l'économie mondiale, en comprenant que la classe ouvrière avait commencé à se dégager de l'emprise de la contre-révolution stalinienne, il était aisé de prévoir que de nouvelles explosions ouvrières suivraient rapidement celle de Mai 68, avec ou sans étudiants radicalisés.
Cette analyse fut rapidement confirmée. Dès l'automne 1969 l'Italie connaissait sa plus importante vague de grèves depuis la guerre ; la même situation se reproduisit en Pologne en 1970, en Es pagne en 1971, en Grande Bretagne en 1972, au Portugal et en Espagne en 1974-75. Puis à la fin des années 1970, une nouvelle vague internationale de luttes ouvrières se développa avec en particulier le mouvement de masse en Pologne en 1980-81, la lutte la plus importante depuis la vague révolutionnaire de 1917-1923. Enfin, de 1983 à 1989, c'est encore une série de mouvements de la classe qui, dans les principaux pays industrialisés, montrera à plusieurs reprises des tendances à la remise en cause de l'encadrement syndical, à l'extension et la prise en mains des luttes.
Le Mai 68 français n'avait été « qu'un début », le début d'une nouvelle ère historique. Il n'était plus «minuit dans le siècle». La classe ouvrière s'arrachait de ces « années de plomb» qui duraient depuis le triomphe de la contre-révolution social-démocrate et stalinienne dans les années 1920. En réaffirmant sa force par des mouvements massifs capables de s'opposer aux machines syndicales et aux « partis ouvriers», la classe ouvrière avait ouvert un cours à des affrontements de classes barrant la route au déclenchement d'une troisième guerre mondiale, ouvrant la voie au développement de la lutte de classe internationale du prolétariat.
La période que nous vivons est celle ouverte par 1968. Vingt cinq ans après, les contradictions de la société capitaliste qui avaient conduit à l'explosion de Mai ne se sont pas estompées, au contraire. Au regard de la dégradation que connaît aujourd'hui l'économie mondiale, les difficultés de la fin des années 1960 paraissent insignifiantes : un demi-million de chômeurs en France en 1968, plus de trois millions aujourd'hui, pour ne prendre qu'un exemple qui est loin de rendre compte du véritable désastre économique qui a dévasté l'ensemble de la planète pendant ce quart de siècle. Quant au prolétariat, à travers des avancées et des reculs de sa combativité et de sa conscience, il n'a jamais signé un armistice avec le capital. Les luttes de l'automne 1992 en Italie, en réponse au plan d'austérité imposé par une bourgeoisie confrontée à la plus violente crise économique depuis la guerre, et où les appareils syndicaux ont subi une contestation ouvrière sans précédent, viennent encore récemment de le confirmer.
Que reste-t-il de Mai 68 ? L'ouverture d'une nouvelle phase de l'histoire. Une période au cours de laquelle ont mûri les conditions de nouvelles explosions ouvrières qui iront beaucoup plus loin que les balbutiements d'il y a 25 ans.
RV, juin 93.
Vingt-cinq ans après mai 1968 : COMPRENDRE MAI - Révolution Internationale n° 2 (ancienne série), 1969
Les événements de mai 1968 ont eu comme conséquence de susciter une activité littéraire exceptionnellement abondante. Livres, brochures, recueils de toutes sortes se sont succédés à une cadence accélérée et à des tirages forts élevés. Les maisons d'éditions - toujours à l'affût de « gadgets » à la mode - se sont bousculées pour exploiter à fond l'immense intérêt soulevé dans les masses par tout ce qui touche à ces événements. Pour cela, ils ont trouvé, sans difficultés, journalistes, publicistes, professeurs, intellectuels, artistes, hommes de lettres, photographes de toutes sortes, qui, comme chacun sait, abondent dans ce pays et qui sont toujours à la recherche d'un bon sujet bien commercial.
On ne peut pas ne pas avoir un haut-le-coeur devant cette récupération effrénée.
Cependant dans la masse des combattants de Mai, l'intérêt éveillé au cours de la lutte même, loin de cesser avec les combats de rue, n'a fait que s'amplifier et s'approfondir. La recherche, la discussion, la confrontation se poursuivent. Pour n'avoir pas été des spectateurs ni des contestataires d'occasion, pour s'être trouvées brusquement engagées dans des combats d'une portée historique, ces masses, revenues de leur propre surprise, ne peuvent pas ne pas s'interroger sur les racines profondes de cette explosion sociale qui était leur propre ouvrage, sur sa signification, sur les perspectives que cette explosion a ouvertes dans un futur à la fois immédiat et lointain. Les masses essaient de comprendre, de prendre conscience de leur propre action.
De ce fait, nous croyons pouvoir dire que c'est rarement dans les livres publiés à profusion que nous pouvons trouver le reflet de cette inquiétude et des interrogations de la part des gens. Elles apparaissent plutôt dans de petites publications, les revues souvent éphémères, les papiers ronéotés de toutes sortes de groupes, de comités d'action de quartier et d'usines qui ont survécu depuis Mai, dans leurs réunions, au travers de discussions souvent et inévitablement confuses. Au travers et en dépit de cette confusion, se poursuit néanmoins un travail sérieux de clarification des problème soulevés par Mai.
Après plusieurs mois d'éclipsé, et de silence, probablement consacrés à l'élaboration de ses travaux, vient d'intervenir dans ce débat le groupe de « L'Internationale Situationniste », en publiant un livre chez Gallimard : « Enragés et Situationnistes dans le mouvement des occupations ».
On était en droit d'attendre de la part d'un groupe qui a effectivement pris une part active dans les combats, une contribution approfondie à l'analyse de la signification de Mai, et cela d'autant plus que le temps de recul de plusieurs mois offrait des possibilités meilleures. On était en droit d'émettre des exigences et on doit constater que le livre ne répond pas à ses promesses.
Mis à part le vocabulaire qui leur est propre : « spectacle », « société de consommation », « critique de la vie quotidienne », etc., on peut déplorer que pour leur livre, les situationnistes aient allègrement cédé au goût du jour, se complaisant à le farcir de photos, d'images et de bandes de comics.
On peut penser ce que l'on veut des comics comme moyen pour la propagande et l'agitation révolutionnaire. On sait que les situationnistes sont particulièrement friands de cette forme d'expression que sont les comics et les bulles. Ils prétendent même avoir découvert dans le « détournement », l'arme moderne (?) de la propagande subversive, et voient en cela le signe distinctif de leur supériorité par rapport aux autres groupes qui en sont restés aux méthodes « surannées » de la presse révolutionnaire « traditionnelle », aux articles « fastidieux » et aux tracts ronéotés.
Il y a assurément du vrai dans la constatation que les articles de la presse des groupuscules sont souvent rébarbatifs, longs et ennuyeux. Cependant, cette constatation ne saurait devenir un argument pour une activité de divertissement. Le capitalisme se charge amplement de cette besogne qui consiste sans cesse à découvrir toutes sortes d'activités culturelles (sic) pour les jeunes, les loisirs organisés et surtout les sports. Ce n'est pas seulement une question de contenu mais aussi de méthode appropriée qui correspond à un but bien précis : le détournement de la réflexion.
La classe ouvrière n'a pas besoin d'être divertie. Elle a surtout besoin de comprendre et de penser. Les comics, les mots d'esprit et les jeux de mots leur sont d'un piètre usage. On adopte d'une part pour soi un langage philosophique, une terminologie particulièrement recherchée, obscure et ésotérique, réservée aux « penseurs intellectuels », d'autre part, pour la grande masse infantile des ouvriers, quelques images accompagnées de phrases simples, cela suffit amplement.
Il faut se garder, quand on dénonce partout le spectacle, de ne pas tomber soi-même dans le spectaculaire. Malheureusement, c'est un peu par là que pêche le livre sur Mai en question. Un autre trait caractéristique du livre est son aspect descriptif des événements au jour le jour, alors qu'une analyse les situant dans un contexte historique et dégageant leur profonde signification eût été nécessaire. Remarquons encore que c'est surtout l'action des enragés et des situationnistes qui est décrite plutôt que les événements eux-mêmes comme d'ailleurs l'annonce le titre. En rehaussant hors mesure le rôle joué par telle personnalité des enragés, en faisant un véritable panégyrique de soi, on a l'impression que ce n'est pas eux qui étaient dans le mouvement des occupations, mais que c'est le mouvement de Mai qui était là pour mettre en relief la haute valeur révolutionnaire des enragés et des situationnistes. Une personne n'ayant pas vécu, ignorant tout de Mai et se documentant au travers de ce livre, se ferait une curieuse idée de ce que ce fut. A les en croire, les situationnistes auraient occupé une place prépondérante, et cela dès le début, dans les événements, ce qui révèle une bonne dose d'imagination et est vraiment « prendre ses désirs pour la réalité ». Ramenée à ses justes proportions, la place occupée par les situationnistes a été sûrement inférieure à celle de nombreux autres groupuscules, et en tout cas pas supérieure. Au lieu de soumettre à la critique le comportement, les idées, les positions des autres groupes - ce qui aurait été intéressant, mais qu'ils ne font pas - minimiser (voir dans les pages 179 à 181 avec quel dédain et combien superficiellement, ils font la « critique » des autres groupes « conseillistes ») ou encore passer sous silence l'activité et le rôle des autres est un procédé douteux pour faire ressortir sa propre grandeur, et ne mène pas à grand chose.
Le livre (ou ce qu'il en reste, déduction faite des bandes dessinées, photos, chansons, inscriptions murales et autres reproductions) débute par une constatation généralement juste : Mai avait surpris un peu tout le monde et en particulier les groupes révolutionnaires ou prétendus tels. Tous les groupes et courants, sauf évidemment les situationnistes qui, eux, « savaient et montraient la possibilité et l’imminence d'un nouveau départ de la révolution». Pour le groupe de situationnistes, grâce à « la critique révolutionnaire qui ramène au mouvement pratique sa propre théorie, déduite de lui et portée à la cohérence qu'il poursuit, certainement rien n'était plus prévisible, rien n'était plus prévu, que la nouvelle époque de la lutte de classe... »
On sait depuis longtemps qu'il n'existe aucun code contre la présomption et la prétention, manie fort répandue dans le mouvement révolutionnaire -surtout depuis le « triomphe » du léninisme - et dont le bordiguisme est une manifestation exemplaire : aussi ne disputerons-nous pas cette prétention aux situationnistes et nous contenterons-nous simplement d'en prendre acte en haussant les épaules pour seulement chercher à savoir : où et quand, et sur la base de quelles données, les situationnistes ont-ils prévu les événements de Mai ? Quand ils affirment qu'ils avaient « depuis des années très exactement prévu l'explosion actuelle et ses suites », ils confondent visiblement une affirmation générale avec une analyse précise du moment. De puis plus de cent cinquante ans, depuis qu'existe un mouvement révolutionnaire du prolétariat, existe la « prévision » qu'un jour, inévitablement surviendra l'explosion révolutionnaire. Pour un groupe qui prétend non seulement avoir une théorie cohérente, mais encore « ramener sa critique révolutionnaire au mouvement pratique », une prévision de ce genre est largement insuffisante. Pour ne pas rester une simple phrase rhétorique, « ramener sa critique au mouvement pratique » doit signifier l'analyse de la situation concrète, de ses limites et de ses possibilités réelles. Cette analyse, les situationnistes ne l'ont pas faite avant et, si nous jugeons d'après leur livre, ne la font pas encore maintenant ; car quand ils parlent d'une nouvelle période de reprise des luttes révolutionnaires, leur démonstration se réfère toujours à des généralités abstraites. Et même quand ils se réfèrent aux luttes de ces dernières années, ils ne font rien d'autre que de constater un fait empirique. Par elle seule, cette constatation ne va pas au-delà du témoignage de la continuité de la lutte des classes et n'indique pas le sens de son évolution, ni de la possibilité de déboucher et d'inaugurer une période historique de luttes révolutionnaires surtout à l'échelle internationale, comme peut et doit l'être une révolution socialiste. Même une explosion d'une signification révolutionnaire aussi formidable que la Commune de Paris ne signifiait pas l'ouverture d'une ère révolutionnaire dans l'histoire, puisqu'au contraire elle sera suivie d'une longue période de stabilisation et d'épanouissement du capitalisme, entraînant comme conséquence, le mouvement ouvrier vers le réformisme.
A moins de considérer comme les anarchistes, que tout est toujours possible et qu'il suffit de vouloir pour pouvoir, nous sommes appelés à comprendre que le mouvement ouvrier ne suit pas une courbe continuellement ascendante mais est fait de périodes de montées et de périodes dé reculs, et est déterminé objectivement et en premier lieu par l'état de développement du capitalisme et des contradictions inhérentes à ce système.
L'I.S. définit l'actualité comme « le retour présent de la révolution ». Sur quoi fonde-t-elle cette définition ? Voici son explication :
1. « La théorie critique élaborée et répandue par l’I S. constatait aisément (...) que le prolétariat n'était pas aboli » (curieux vraiment que l'I.S. constate «aisément» ce que tous les ouvriers et tous les révolutionnaires savaient, sans recours nécessaire à l'I.S.)
2. « ... que le capitalisme continuait à développer ses aliénations » (qui s'en serait douté ?).
3. « ... que partout où existe cet antagonisme (comme si cet antagonisme ne pouvait dans le capitalisme ne pas exister partout) la question sociale posée depuis plus d'un siècle demeure » (en voilà une découverte !)
4. « ... que cet antagonisme existe sur toute la surface de la planète » (encore une découverte !)
5. « L'I.S.explique l'approfondissement et la concentration des aliénations par le retard de la révolution» (évidence...).
6. «Ce retard découle manifestement de la défaite internationale du prolétariat depuis la contre-révolution russe » (voilà encore une vérité proclamée par les révolutionnaires depuis 40 ans au moins).
7. En outre « l'I.S. savait bien (...) que l'émancipation des travailleurs se heurtait partout et toujours aux organisations bureaucratiques ».
8. Les situationnistes constatent que la falsification permanente nécessaire à la survie de ces appareils bureaucratiques, était une pièce maîtresse de la falsification généralisée dans la société moderne.
9. Enfin « ils avaient aussi reconnu et s'étaient employés à rejoindre les nouvelles formes (?) de subversion dont les premiers signes s'accumulaient».
10. Et voilà pourquoi « ainsi les situationnistes savaient et montraient la possibilité et l'imminence d'un nouveau départ de la révolution, »
Nous avons reproduit ces longs extraits afin de montrer le plus exactement possible ce que les situationnistes d'après leur propre dire «savaient».
Comme on peut le voir, ce savoir se réduit à des généralités que connaissent depuis longtemps des milliers et des milliers de révolutionnaires, et ces généralités si elles suffisent pour l'affirmation du projet révolutionnaire, ne contiennent rien qui puisse être considéré comme une démonstration de « l’imminence d'un nouveau départ de la révolution ». La « théorie élaborée » des situationnistes se réduit donc à une simple profession de foi et rien de plus.
C'est que la Révolution Socialiste et son imminence ne sauraient se déduire de quelques « découvertes » verbales comme la société de consommation, le spectacle, la vie quotidienne, qui désignent avec de nouveaux mots les notions connues de la société capitaliste d'exploitation des masses travailleuses, avec tout ce que cela comporte, dans tous les domaines de la vie sociale, de déformations et d'aliénations humaines.
En admettant que nous nous trouvions devant un nouveau départ de la révolution, comment expliquer d'après l'I.S. qu'il ait fallu attendre juste LE TEMPS qui nous sépare de la victoire de la contre-révolution russe, disons : 50 ans. Pourquoi pas 30 ou 70 ? De deux choses l'une : ou la reprise du cours révolutionnaire est déterminée fondamentalement par les conditions objectives, et alors il faut les expliciter - ce que l'I.S. ne fait pas - ou bien cette reprise est uniquement le fait d'une volonté subjective s'accumulant et s'affirmant un beau jour et elle ne pourrait alors être que constatable mais non prévisible puisque aucun critère ne saurait d'avance fixer son degré de maturation.
Dans ces conditions, la prévision dont se targue l'I.S. tiendrait davantage d'un don de devin que d'un savoir. Quand Trotsky écrivait en 1936 « La révolution a commencé en France», il se trompait assurément, néanmoins son affirmation reposait sur une analyse autrement sérieuse que celle de l'I.S. puisqu'elle se référait à des données telles que la crise économique qui secouait le monde entier. Par contre la « prévision » juste de l'I.S. s'apparenterait plutôt aux affirmations de Molotov inaugurant la fameuse troisième période de l'I.C. (Internationale Communiste) au début de 1929, annonçant la grande nouvelle que le monde est entré des deux pieds dans la période révolutionnaire. La parenté entre les deux consiste dans la gratuité de leurs affirmations respectives, dont l'étude est effectivement indispensable comme point de départ de toute analyse sur une période donnée, suffisent à déterminer le caractère révolutionnaire ou non des luttes de cette période : et c'est ainsi que, s'appuyant sur la crise économique mondiale de 1929, il croit pouvoir annoncer l'imminence de la révolution. L'I.S. par contre croit suffisant d'ignorer et de vouloir ignorer tout ce qui se rapporte à l'idée même d'une condition objective et nécessaire, d'où son aversion profonde pour ce qui concerne les analyses économiques de la société capitaliste moderne.
Toute l'attention se trouve ainsi dirigée vers les manifestations les plus apparentes des aliénations sociales, et on néglige de voir les sources qui leur donnent naissance et les nourrissent. Nous devons réaffirmer qu'une telle critique qui porte essentiellement sur les manifestations superficielles, aussi radicale soit-elle, restera forcément circonscrite, limitée, tant en théorie qu'en pratique.
Le capitalisme produit nécessairement les aliénations qui lui sont propres dans son existence et pour sa survie, et ce n'est pas dans leur manifestation que se rencontre le moteur de son dépérissement. Tant que le capitalisme dans ses racines, c'est-à-dire comme système économique, reste viable, aucune volonté ne saurait le détruire.
«Jamais une société n'expire avant que soient developpees toutes les forces productives qu'elle est assez large pour contenir » (Marx, « Avant propos à la Critique de l'Economie Politique »).
C'est donc dans ces racines que la critique théorique radicale doit déceler les possibilités de son dépassement révolutionnaire.
«A un certain degré de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en collision avec les rapports de production... Alors commence une ère de révolution sociale» (Marx, idem).
Cette collision dont parle Marx, se manifeste par des bouleversements économiques, comme les crises, les guerres impérialistes et les convulsions sociales. Tous les penseurs marxistes ont insisté sur le fait que pour qu'on puisse parler d'une période révolutionnaire, « il ne suffit pas que les ouvriers ne veuillent plus, il faut encore que les capitalistes ne puissent plus continuer comme auparavant ». Et voilà l'I.S. qui se prétend être quasiment l'unique expression théorique organisée de la pratique révolutionnaire d'aujourd'hui, qui bataille exactement dans le sens contraire. Les rares fois où, surmontant son aversion, elle aborde dans le livre les sujets économiques, c'est pour démontrer que le nouveau départ de la révolution s'opère non seulement indépendamment des fondations économiques de la société mais encore dans un capitalisme économiquement florissant. « On ne pouvait observer aucune tendance à la crise économique (p. 25) (...) L'éruption révolutionnaire n'est pas venue d'une crise économique (...) ce qui a été attaqué de front en Mai, c'est l'économie capitaliste fonctionnant BIEN. » (Souligné dans le texte p. 209)
Ce qu'on s'acharne à démontrer évidemment ici, est que la crise révolutionnaire et la situation économique de la société sont deux choses complètement séparées, pouvant évoluer et évoluant de fait chacune dans un sens qui lui est propre, sans relation entre elles. On croit pouvoir appuyer cette « grande découverte » théorique dans les faits, et on s'écrie triomphalement : « ON NE POUVAIT OBSERVER AUCUNE TENDANCE A LA "CRISE ECONOMIQUE" » !
Aucune tendance ? Vraiment ?
Fin 1967, la situation économique en France commence à donner des signes de détérioration. Le chômage menaçant commence à préoccuper chaque jour davantage. Au début de 1968, le nombre de chômeurs complets dépasse les 500 000. Ce n'est plus un phénomène local, il atteint toutes les régions. A Paris, le nombre des chômeurs croît lentement mais constamment. La presse se remplit d'article traitant gravement de la hantise du désemploi dans divers milieux. Le chômage partiel s'installe dans beaucoup d'usines et provoque des réactions parmi les ouvriers. Plusieurs grèves sporadiques ont la question du maintien de l'emploi et du plein emploi pour cause directe. Ce sont surtout les jeunes qui sont touchés en premier lieu et qui ne parviennent pas à s'intégrer dans la production. La récession dans l'emploi tombe d'autant plus mal que se présente sur le marché du travail cette génération de l'explosion démographique qui a suivi immédiatement la fin de la 2e Guerre Mondiale. Un sentiment d'insécurité du lendemain se développe parmi les ouvriers et surtout parmi les jeunes. Ce sentiment est d'autant plus vif qu'il était pratiquement inconnu des ouvriers en France depuis la guerre.
Concurremment, avec le désemploi et sous sa pression directe, les salaires tendent à baisser et le niveau de vie des masses se détériore. Le gouvernement et le patronat profitent naturellement de cette situation pour attaquer et aggraver les conditions de vie et de travail des ouvriers (voir par exemple les décrets sur la Sécurité Sociale).
De plus en plus, les masses sentent que c'en est fini de la belle prospérité. L'indifférence et le je-m'en-foutisme, si caractéristiques et tant décriés des ouvriers, au long des derniers 10-15 ans, cèdent la place à une inquiétude sourde et grandissante.
Il est assurément moins aisé d'observer cette lente montée de l'inquiétude et du mécontentement chez les ouvriers, que des actions spectaculaires dans une faculté. Cependant, on ne peut continuer à l'ignorer après l'explosion de Mai, à moins de croire que 10 millions d'ouvriers aient été touchés un beau jour par l'Esprit-Saint de l’Anti-spectacle. Il faut bien admettre qu'une telle explosion massive repose sur une longue accumulation d'un mécontentement réel de leur situation économique et de travail, directement sensible dans les masses, même si un observateur superficiel n'en a rien aperçu. On ne doit pas non plus, attribuer exclusivement à la politique canaille des syndicats et autres staliniens le fait des revendications économiques.
Il est évident que les syndicats, le P.C., venant à la rescousse du gouvernement, ont joué à fond la carte revendicative comme un barrage contre un possible débordement révolutionnaire de la grève sur un plan social global. Mais ce n'est pas le rôle des organismes de l'Etat capitaliste que nous discutons ici. C'est là leur rôle et on ne saurait leur reprocher de le jouer à fond. Mais le fait qu'ils ont facilement réussi à contrôler la grande masse des ouvriers en grève sur un terrain uniquement revendicatif, prouve que les masses sont entrées dans la lutte essentiellement dominées et préoccupées par une situation chaque jour plus menaçante pour eux. Si la tâche des révolutionnaires est de déceler les possibilités radicales contenues dans la lutte même des masses et de participer activement à leur éclosion, il est avant tout nécessaire de ne pas ignorer les préoccupations immédiates qui font entrer les masses dans la lutte.
Malgré les fanfaronnades des milieux officiels, la situation économique préoccupe de plus en plus le monde des affaires, comme le témoigne la presse économique du début de l'année. Ce qui inquiète n'est pas tant la situation en France, qui occupe alors une place privilégiée, mais le fait que cette situation d'alourdissement s'inscrit dans un contexte d'essoufflement économique à l'échelle mondiale, qui ne manquerait pas d'avoir des répercussions en France. Dans tous les pays industriels, en Europe et aux USA, le chômage se développe et les perspectives économiques s'assombrissent. L'Angleterre, malgré une multiplication des mesures pour sauvegarder l'équilibre, est finalement réduite fin 1967 à une dévaluation de la Livre Sterling, entraînant derrière elle des dévaluations dans toute une série de pays. Le gouvernement Wilson proclame un pro gramme d'austérité exceptionnel : réduction massive des dépenses publiques, y compris l'armement - retrait des troupes britanniques de l'Asie -, blocage des salaires, réduction de la consommation interne et des importations, effort pour augmenter les exportations. Le 1er janvier 1968, c'est au tour de Johnson de pousser un cri d'alarme et d'annoncer des mesures sévères indispensables pour sauvegarder l'équilibre économique. En mars, éclate la crise financière du dollar. La presse économique chaque jour plus pessimiste, évoque de plus en plus le spectre de la crise de 1929, et beaucoup craignent des conséquences encore plus graves. Le taux de crédit monte dans tous les pays, partout la bourse des valeurs accuse des bouleversements, et dans tous les pays, un seul cri : réduction des dépenses et de la consommation, augmentation des exportations à tout prix et réduction au strict nécessaire des importations. Parallèlement, la même détérioration se manifeste à l'Est dans le bloc russe, ce qui explique la tendance des pays comme la Tchécoslovaquie et la Roumanie à se détacher de l'emprise soviétique et à chercher des marchés à l'extérieur.
Tel est le fond de la situation économique d'avant mai.
Bien sûr, ce n'est pas la crise économique ouverte, d'abord parce que ce n'est que le début, et ensuite parce que dans le capitalisme actuel, l'Etat dispose de tout un arsenal de moyens lui permettant d'intervenir afin de pallier et partiellement, d'atténuer momentanément les manifestations les plus frappantes de la crise. Il est nécessaire toutefois de mettre en évidence les points suivants :
a) Dans les 20 années qui ont suivi la 2e Guerre, l'économie capitaliste a vécu sur la base de la reconstruction des ruines résultant de la guerre, d'une spoliation éhontée des pays sous-développés, qui au travers de la fumisterie de guerres de libération et d'aides à leur reconstruction en Etats indépendants, ont été exploités au point d'être réduits à la misère et à la famine ; d'une production croissante d'armements : l'économie de guerre.
b) Ces trois sources de la prospérité et du plein-emploi de ces 20 dernières années, tendent vers leur point d'épuisement. L'appareil de production se trouve devant un marché d'autant plus saturé et l'économie capitaliste se retrouve exactement dans la même situation et devant les mêmes problèmes insolubles qu'en 1929, encore aggravés.
c) L'interrelation entre les économies de l'ensemble des pays est plus accentuée qu'en 1929. De là : une répercussion plus grande et plus immédiate de toute perturbation d'une économie nationale sur l'économie des autres pays et sa généralisation.
d) La crise de 1929 a éclaté après de lourdes défaites du prolétariat international, la victoire de la contre-révolution russe s'imposant complètement par sa mystification du « socialisme » en Russie, et le mythe de la lutte anti-fasciste. C'est grâce à ces circonstances historiques particulières que la crise de 1929 qui n'était pas conjoncturelle mais bien une manifestation violente de la crise chronique du capitalisme en déclin, pouvait se développer et se prolonger de longues années, pour déboucher finalement dans la guerre et la destruction généralisée. Tel n'est plus le cas aujourd'hui.
Le capitalisme dispose de moins en moins de thèmes de mystification capables de mobiliser les masses et de les jeter dans le massacre. Le mythe russe s'écroule, le faux dilemme démocratie bourgeoisie contre totalitarisme est bien usé. Dans ces conditions, la crise apparaît dès ses premières manifestations pour ce qu'elle est. Dès ses premiers symptômes, elle verra surgir dans tous les pays, des réactions de plus en plus violentes des masses. Aussi, c'est parce qu'aujourd'hui la crise économique ne saurait se développer pleinement, mais se transforme dès ses premiers indices en crise sociale, que cette dernière peut apparaître à certains comme indépendante, suspendue en quelque sorte en l'air, sans relation avec la situation économique qui cependant la conditionne.
Pour bien saisir cette réalité, il ne faut évidemment pas l'observer avec des yeux d'enfant, et surtout ne pas rechercher la relation de cause à effet d'une façon étroite, immédiate et limitée à un plan local de pays et de secteurs isolés. C'est globalement, à l'échelle mondiale, qu'apparaissent clairement les fondements de la réalité et des déterminations ultimes de son évolution. Vu ainsi, le mouvement des étudiants qui luttent dans toutes les villes du monde, apparaît dans sa signification profonde et sa limite. Si les combats des étudiants, en mai, pouvaient servir comme détonateur du vaste mouvement des occupations des usines, c'est parce que, avec toute leur spécificité propre, ils n'étaient que les signes avant-coureurs d'une situation s'aggravant au coeur de la société, c'est-à-dire dans la production et les rapports de production.
Mai 1968 apparaît dans toute sa signification pour avoir été une des premières et une des plus importantes réactions de la masse des travailleurs contre une situation économique mondiale allant en se détériorant.
C'est par conséquent une erreur de dire comme l'auteur du livre que : « L'éruption révolutionnaire n'est pas venue d'une crise économique, mais elle a tout au contraire CONTRIBUE A CREER UNE SITUATION DE CRISE DANS L'ECONOMIE» et « cette économie une fois perturbée par les forces négatives de son dépassement historique doit FONCTIONNER MOINS BIEN » (p. 209).
Ici décidément, les choses marchent sur la tête : les crises économiques ne sont pas le produit nécessaire des contradictions inhérentes au système capitaliste de production, comme nous l'enseigne Marx, mais au contraire, ce sont seulement les ouvriers par leurs luttes qui produisent ces crises dans une économie qui « FONCTIONNE BIEN ». C'est ce que ne cessent de nous répéter de tous temps, le patronat et les apologistes du capitalisme ; c'est ce que De Gaulle reprendra en novembre, expliquant la crise du franc par la faute des enragés de mai. ([2] [1245])
C'est en somme la substitution de l'économie politique de la bourgeoisie à la théorie économique du marxisme. Il n'est pas surprenant qu'avec une telle vision, l'auteur explique tout cet immense mouvement qu'était Mai comme l'oeuvre d'une minorité bien décidée et en l'exaltant : «L'agitation déclenchée en Janvier 1968 à Nanterre par quatre ou cinq révolutionnaires qui allaient constituer le groupe des enragés, devait entraîner, sous cinq mois, une quasi liquidation de l'Etat». Et plus loin «jamais une agitation entreprise par un si petit nombre n'a entraîné en si peu de temps de telles conséquences ».
Là où pour les situationnistes le problème de la révolution se pose en termes « d'entraîner», ne serait-ce que par des actions exemplaires, il se pose pour nous en termes d'un mouvement spontané des masses du prolétariat, amenées forcément à se soulever contre un système économique en désarroi et en déclin, qui ne leur offre plus désormais que la misère croissante et la destruction, en plus de l'exploitation.
C'est sur cette base de granit que nous fondons la perspective révolutionnaire de classe et notre conviction de sa réalisation.
MC[1] [1246] L'IS était un groupe qui eut une influence certaine en Mai 68, en particulier dans les secteurs les plus radicaux du milieu étudiant. Il trouvait ses sources d'une part dans le mouvement « lettriste » qui, dans la continuité de la tradition des surréalistes, voulait faire une critique révolutionnaire de l'art, et d'autre part dans la mouvance de la Revue Socialisme ou Barbarie fondée par l'ex-trotskiste grec Castoriadis au début des années 50 en France. L'IS se réclamait ainsi de Marx mais pas du marxisme. Elle reprenait certaines des positions les plus avancées du mouvement ouvrier révolutionnaire, en particulier de la Gauche communiste germano-hollandaise, (nature capitaliste de l'URSS, rejet des formes syndicales et parlementaires, nécessité de la dictature du prolétariat par la voie des conseils ouvriers) mais les présentait comme ses propres découvertes, enrobées dans son analyse du phénomène du totalitarisme : la théorie de «la société du spectacle». L'IS incarnait certainement un des points les plus élevés que pouvaient atteindre des secteurs de la petite bourgeoisie estudiantine radicalisée : le rejet de leur condition («Fin de l’université ») pour tenter de s'intégrer dans le mouvement révolutionnaire du prolétariat. Mais leur adhésion restait imbibée des caractéristiques de leur milieu d'origine, en particulier par leur vision idéologique de l'histoire, incapables de comprendre l'importance de l'économie et donc la réalité de la lutte de classes. La revue de l'IS disparut peu de temps après 1968 et le groupe finit dans les convulsion d'une série d'exclusions réciproques.
[2] [1247] Pour ceux qui voudraient voir dans la crise du franc en novembre, un simple fait de spéculation de « mauvais français », nous soumettons ces lignes de Marx extraites de « Revue de Mai à Octobre 1850 » : « La crise elle-même éclate d'abord dans le domaine de la spéculation, et ce n'est que plus tard qu'elle s'installe dans la production. A l'observation superficielle, ce n'est pas la surproduction, mais la sur spéculation - pourtant simple symptôme de la surproduction - qui paraît être la cause de la crise. La désorganisation ultérieure de la production n'apparaît pas comme un résultat nécessaire de sa propre exubérance antérieure, mais comme une simple réaction de la spéculation en train de s'effondrer » (Publié par M.Rubel dans Etudes de Marxologie, n° 7, août 1963).
Géographique:
- France [1248]
Histoire du mouvement ouvrier:
- Mai 1968 [1249]
Approfondir:
- Mai 1968 [1250]
Revue Internationale no 75 - 4e trimestre 1993
- 3581 reads
Editorial : contre le chômage massif, ripostons par des luttes massives
- 2624 reads
A l'automne 1992, les manifestations massives de la classe ouvrière en Italie avaient marqué le réveil des luttes ouvrières ([1] [1251]). A l'automne 1993, les manifestations ouvrières en Allemagne ont confirmé la reprise des combats de classe face aux attaques qui s'abattent sur le prolétariat des pays les plus industrialisés.
Dans la Ruhr, au coeur de l'Allemagne, plus de 80 000 travailleurs ont envahi les rues et barré des routes pour protester contre les annonces de licenciements dans les mines. Les 21 et 22 septembre, sans consigne syndicale (ce qui est significatif dans un pays réputé pour la « discipline » des « partenaires sociaux »), les mineurs de la région de Dortmund ont débrayé spontanément, entraînant avec eux, leurs familles, leurs enfants, des chômeurs et des travailleurs d'autres secteurs, appelés à manifester leur solidarité.
Quel que soit le résultat des manifestations encore en cours ([2] [1252]) au moment de boucler cette Revue Internationale, ce mouvement représente, sur un aspect important, un bon exemple de comment la classe ouvrière peut engager la lutte : à l'agression massive des conditions de travail, il faut riposter massivement et unis.
La reprise de la lutte de classe
Aujourd'hui, plus que jamais, la seule force qui peut intervenir contre la catastrophe économique, est la classe ouvrière. Elle est la seule classe sociale capable de briser les barrières nationales, sectorielles et catégorielles de « l'ordre capitaliste ». C'est la division du prolétariat, renforcée par le pourrissement actuel de la société, qu'entretiennent ces barrières, qui laisse le champ libre aux mesures « sociales » tous azimuts prises dans tous les pays.
L'intérêt de la classe ouvrière, de tous ceux qui subissent partout la même exploitation et les mêmes attaques de la part de l'Etat capitaliste, du gouvernement, des patrons, des partis et des syndicats, c'est l'unité la plus large possible du plus grand nombre, dans l'action et la réflexion, pour trouver les moyens de s'organiser et dégager une direction au combat contre le capitalisme.
Le fait qu'en Allemagne, après avoir été baladés l'an dernier pendant des mois dans des manoeuvres syndicales stériles, les ouvriers réagissent par eux-mêmes au matraquage qu'ils subissent, est un signe du réveil de la combativité du prolétariat international. Cet événement, le plus significatif du moment, n'est pas isolé. En même temps ont eu lieu d'autres manifestations en Allemagne, entre autres : 70 000 ouvriers contre le plan de chômage chez Mercedes, plusieurs dizaines de milliers à Duisburg contre 10 000 licenciements dans la métallurgie. Dans plusieurs pays, le nombre des grèves augmente, mouvements que les syndicats et leurs alliés canalisent, mais qui montrent que l'heure n'est plus à la passivité. Il faut s'attendre à une lente et longue série de manifestations ouvrières, d'accrochages entre le prolétariat et bourgeoisie, internationalement.
La reprise internationale de la lutte de classe dans les conditions d'aujourd'hui n'est pas facile. De nombreux facteurs contribuent à freiner et entraver le déploiement de la combativité et de la conscience du prolétariat :
-La décomposition sociale, qui corrompt les relations entre les membres de la société et sape les réflexes de solidarité, qui pousse au « chacun pour soi » et au désespoir, engendre un sentiment d'impuissance à constituer un être collectif, à s'assumer comme une classe aux intérêts communs face au capitalisme.
-L'avalanche du chômage massif, qui frappe à la cadence de 10 000 licenciements par jour, pour la seule Europe de l'ouest, et qui va s'amplifier, est, dans un premier temps, ressentie comme un coup de massue paralysant les travailleurs.
- Les manoeuvres multiples et systématiques des syndicats, du syndicalisme officiel et du syndicalisme « de base », qui enferment la classe ouvrière dans le corporatisme et les divisions, permettent de contenir et d'encadrer le mécontentement dans des impasses. Les thèmes de propagande de la bourgeoisie, celui, classique, de ses fractions de gauche qui prétendent défendre les « intérêts ouvriers », celui des campagnes idéologiques répétées depuis la chute du « mur de Berlin » sur la « mort du communisme » et la « fin de la lutte de classe », entretiennent la confusion sur les possibilités réelles de lutter, en tant que classe ouvrière. Ils renforcent parmi les travailleurs, les doutes sur l'existence d'une perspective de leur émancipation par la destruction du capitalisme.
Ces obstacles, c'est dans le développement même des luttes que le prolétariat va les affronter. Le capitalisme va dévoiler de plus en plus la faillite générale et irréversible de son système. La brutale accélération de la crise, en décuplant soudain ses conséquences désastreuses contre la classe ouvrière, fait certes en partie l'effet d'un « k.o », mais elle constitue aussi un terrain favorable à une mobilisation sur le terrain de classe, autour de la défense des intérêts fondamentaux du prolétariat. Et cela, avec l'intervention active des organisations révolutionnaires partie prenante de la lutte de classe qui défendent la perspective communiste, va contribuer à ce que la classe ouvrière trouve les moyens d'organiser et d'orienter cet affrontement dans le sens de ses intérêts, et partant, dans les sens des intérêts de toute l'humanité.
La fin des « miracles »
Depuis longtemps, personne n'ose plus parler de « miracle économique » dans le « tiers-monde ». La misère s'y généralise irrémédiablement. Le continent africain est désormais pratiquement laissé à l'abandon dans sa quasi-totalité. La vie humaine vaut moins que celle d'un animal dans la plupart des régions d'Asie. D'année en année, les famines s'amplifient, touchant des dizaines de millions de personnes. En Amérique latine, les épidémies font des ravages là où elles avaient complètement disparu.
Dans les pays de l'ex-bloc de l'Est, la prospérité et le bien-être, promis au lendemain de l'effondrement du bloc, ne sont pas au rendez-vous. La perfusion de « capitalisme libéral » injectée au stalinisme agonisant ne fait qu'ajouter à la faillite économique de cette forme extrême d'étatisation purement capitaliste, qui s'est cachée pendant soixante ans derrière le mensonge du « socialisme » ou du «communisme». Là aussi, la pauvreté augmente de façon vertigineuse et les conditions de vie sont de plus en plus catastrophiques pour l'immense majorité de la population.
Dans les pays «développés», c'en est également fini des « miracles économiques ». La déferlante du chômage et des attaques des conditions d'existence de la classe ouvrière sur tous les fronts ramène brutalement au premier plan la crise économique. La propagande du «capitalisme triomphant» sur la « faillite du communisme » ne cesse de marteler qu'il n'y a « rien de mieux que le capitalisme». La crise économique montre surtout de plus en plus à tous que le pire est devant nous dans le capitalisme.
Les attaques massives contre la classe ouvrière
La crise met à nu les contradictions fondamentales d'un capitalisme non seulement incapable d'assurer la survie de la société, mais encore qui détruit les forces productives, au premier rang desquelles, le prolétariat.
Il restait encore aux défenseurs du mode de production capitaliste, qui domine la planète et porte la responsabilité de la sauvagerie infligée aux milliards d'êtres humains plongés dans le plus total dénuement, l'entretien de l'illusion d'un fonctionnement « normal » dans les pays les plus développés. La classe dominante, dans les pays capitalistes du «premier monde», dans les Etats «démocratiques», voulait donner l'impression d'un système permettant d'assurer à chacun des moyens de subsistance, un travail et des conditions de vie décentes. Et, même si l'augmentation, depuis plusieurs années d'une « nouvelle pauvreté» commençait sérieusement à faire pâlir ce rutilant tableau, la propagande pouvait encore s'en sortir, en présentant le phénomène comme le « prix à payer » pour la « modernisation ».
Mais aujourd'hui la crise redouble d'intensité et les Etats « démocratiques », pris à la gorge, doivent tomber le masque. Loin d'offrir une perspective, même lointaine, de prospérité et de paix comme il le prétend, le capitalisme lamine les conditions d'existence de la classe ouvrière et fomente la guerre ([3] [1253]). Si les travailleurs des grandes concentrations industrielles d'Europe de l'ouest, d'Amérique du nord et du Japon, ont encore des illusions sur les « privilèges » qu'on leur agite à la face pour les faire tenir tranquille, ils vont tomber de haut avec ce qui s'abat sur eux.
Le mensonge de la « restructuration » de l'économie, qui a servi de justification aux précédentes vagues de licenciements dans les secteurs «traditionnels» de l'industrie et dès services, est en train d'en prendre un coup. C'est dans les secteurs de l'industrie déjà « modernisés », comme l'automobile ou l'aéronautique, dans les secteurs « de pointe » comme l'électronique et l'informatique, dans les services les plus « profitables » de la banque et de l'assurance, dans le secteur public déjà largement « dégraissé » au cours des années 1980, dans la poste, la santé et l'éducation, que tombent de multiples plans de réduction des effectifs, de mise en chômage partiel ou total, qui touchent des centaines de milliers de travailleurs.
Quelques annonces de licenciements en Europe, au cours de trois semaines de septembre 1993 ([4] [1254])
Allemagne Dalmler/Benz 43900
................. ................. Basf/Hoechst/Bayer 25000
................................... Ruhrkohle 12000
................................... Veba.. 10000
France........................ Bull...... ......... 6500
................................... Thomson-CSF 4174
................................... Peugeot ... 4023
................................... Air France 4000
................................... GIAT.. ..... 2300
................................... Aérospatiale 2250
................................... Snecma. 775
Royaume-Uni.... ......... British Gas 20000
................................... Inland Revenue 5000
................................... Rolls Royce 3100
................................... Prudential 2000
................................... T&N..... 500
Espagne...................... SEAT... 4000
Europe........................ GM/Opel/Vauxhall 7830
................................... Du Pont.......... 3000
Au total, plus de .................... 150000
Sources : Financial Times, Courrier international.
Aucun secteur n'échappe aux «exigences» de la crise économique générale de l'économie mondiale. L'obligation pour chaque unité capitaliste encore en activité, de « réduire les coûts » pour se maintenir dans la concurrence, se manifeste à tous les niveaux, de la plus petite entreprise à la plus grande, jusqu'à l'Etat en charge de la défense de la « compétitivité » du capital national. Dans les pays les plus « riches », eux aussi entraînés dans la récession, le chômage augmente aujourd'hui de façon vertigineuse. Il n'existe plus aucun îlot de santé économique dans le monde capitaliste. C'est la fin du « modèle allemand », ce sont partout des «plans» et autres « pactes » sociaux, des « thérapies de choc ». Et le « choc », il est d'abord pour les travailleurs.
En moyenne, pratiquement un travailleur sur cinq est déjà au chômage dans les pays industrialisés. Et un chômeur sur cinq l'est depuis plus d'un an, avec de moins en moins de possibilités de retrouver un emploi. L'exclusion totale de tout moyen normal de subsistance devient un phénomène de masse : c'est en millions qu'on compte désormais ceux qu'on appelle les « nouveaux pauvres » et « sans domicile fixe », réduits aux pires privations dans les grandes villes.
Le chômage massif qui se développe aujourd'hui ne constitue pas un réservoir de main d'oeuvre pour une future reprise de l'économie. Il n'y aura pas de reprise permettant au capitalisme d'intégrer ou de réintégrer à la production la masse grandissante de dizaines de millions de sans-travail dans les pays « développés ». C'est même le minimum vital nécessaire à leur subsistance qui va être remis en cause. La masse des chômeurs aujourd'hui n'est plus 1'« armée de réserve» du capitalisme, comme c'était le cas lorsque Marx l'avait définie au 19e siècle. Elle vient grossir la masse de tous ceux qui sont déjà complètement exclus de tout accès à des conditions d'existence normales, comme dans les pays du « tiers-monde » ou de l'ex-bloc de l'Est. Elle est concrètement la manifestation de la tendance à la paupérisation absolue que provoque la faillite définitive du mode de production capitaliste.
Pour ceux qui ont encore du travail, les augmentations de salaires sont ridicules et rognées par l'inflation, quand elles ne sont pas complètement bloquées. Pire, les diminutions brutes sont de plus en plus fréquentes. A cette attaque directe du montant des salaires s'ajoutent les augmentations des cotisations, taxes et impôts, celles des frais de logement, de transport, de santé et d'éducation. Qui plus est, une partie croissante du revenu des familles doit, de plus en plus souvent, être consacrée à l'entretien d'enfants ou de parents sans travail. Quant aux diverses allocations, de retraite, de maladie, de chômage, de formation, elles sont aussi révisées en baisse partout, quand ce n'est pas purement et simplement leur suppression qui est envisagée.
Tout cela, la classe ouvrière doit le combattre énergiquement. Les sacrifices réclamés aux ouvriers aujourd'hui, par chaque Etat, au nom de la solidarité « nationale », ne feront qu'amener d'autres sacrifices demain, car il n'existe pas de « sortie de la crise » dans le cadre du capitalisme.
La crise est irréversible, la lutte déclasse indispensable
Même ceux qui font profession de défendre le mensonge de la santé économique du capitalisme font grise mine. Lorsque les statistiques de la croissance montrent de tout petits signes positifs, ils n'osent même plus parler de « reprise de l'économie ». Tout au plus parlent-ils d'une « pause » dans la récession, prenant bien soin de préciser que « si une reprise doit intervenir, elle risque d'être très faible et très lente... » ([5] [1255]). Ce langage prudent montre combien la classe dominante est encore plus démunie aujourd'hui, que face aux précédentes récessions depuis vingt-cinq ans.
Personne n'ose plus prévoir le « bout du tunnel ». Ceux qui ne voient pas le caractère irréversible de la crise et croient en l'immortalité du mode de production capitaliste ne peuvent que répéter à la manière d'une incantation : « il y aura nécessairement une reprise économique, puisqu'il y a toujours eu reprise après la crise ». Cette formule, qui s'apparente à l'adage du paysan qui attend « après la pluie, le beau temps », en dit long sur l'absence totale de maîtrise de la classe capitaliste des propres lois de son économie.
Dernier exemple en date : l'effritement du Système monétaire européen tout au long de l'année 1993 puis son effondrement au cours de l'été ([6] [1256]). Avec l'impossibilité pour les Etats d'Europe de l'ouest de se doter d'une monnaie unique, c'est un brutal coup d'arrêt qui est donné à la construction d'une «unité européenne » qui devait, selon les dires de ses défenseurs, être un exemple de la capacité du capitalisme à instaurer une coopération économique, politique et sociale. Derrière les turbulences monétaires de l'été, ce sont tout simplement les lois incontournables de l'exploitation et de la concurrence capitalistes qui sont venues une fois encore remettre les pendules à l'heure :
- il est impossible pour le système capitaliste de constituer un ensemble harmonieux et prospère, à quelque niveau que ce soit ;
- la classe qui tire son profit de l'exploitation de la force de travail, est condamnée à être divisée par la concurrence.
En même temps qu'à l'intérieur de chaque nation les bourgeoisies fourbissent leurs armes contre la classe ouvrière, au plan international, les querelles et les heurts se multiplient. « L'entente entre les peuples », dont le modèle devait être celle entre grands pays capitalistes, cède le pas à une guerre économique sans merci, aveu d'un « chacun pour soi » débridé, qui est la tendance de fond du capitalisme actuel. Le marché mondial est depuis longtemps saturé. Il est devenu trop étroit pour permettre le fonctionnement normal de l'accumulation du capital, l'élargissement de la production et de la consommation nécessaire à la réalisation du profit, moteur de ce système.
Mais à la différence des dirigeants d'une simple entreprise capitaliste qui, lorsqu'il y a faillite, mettent la clé sous la porte, procèdent à une liquidation et vont chercher ailleurs la manne qui leur a fait défaut, la classe capitaliste dans son ensemble ne peut pas prononcer sa propre faillite et procéder à la liquidation du mode de production capitaliste. Ce serait prononcer sa propre disparition, ce qu'aucune classe exploiteuse n'est en mesure de faire. La classe dominante ne va pas se retirer de la scène sociale sur la pointe des pieds en disant «j'ai fait mon temps». Elle défendra bec et ongles et jusqu'au bout ses intérêts et ses privilèges.
C'est à la classe ouvrière que revient la tâche de détruire le capitalisme. De par sa place dans les rapports de production capitaliste, elle seule est capable d'enrayer la machine infernale du capitalisme décadent. Ne disposant d'aucun pouvoir économique dans la société, sans intérêt particulier à défendre, classe qui, collectivement, n'a que sa force de travail à vendre au capitalisme, la classe ouvrière est la seule force porteuse d'une perspective de nouveaux rapports sociaux débarrassés de la division en classes, de la pénurie, de la misère, des guerres et des frontières.
Cette perspective, qui est celle d'une révolution communiste internationale, doit commencer par une réponse massive aux attaques massives du capitalisme, premiers pas d'un combat historique contre la destruction systématique des forces productives, aujourd'hui à l'oeuvre à l'échelle de la planète, et qui vient de s'accélérer brutalement dans les pays développés.
OF, 23/9/93.
[1] [1257] Voir les Revue Internationale n° 72, « Un tour nant », et n° 73, « Le réveil de la combativité ouvrière », 1er et 2e trimestre 1993.
[2] [1258] Le gain immédiat que vont pouvoir en tirer les travailleurs risque d'être mince avec la rapide reprise en mains par les syndicats, et des ouvriers ne sa chant pas trop comment poursuivre leur initiative de départ.
[3] [1259] Voir « Derrière les accords de paix, toujours la guerre impérialiste » dans ce numéro.
[4] [1260] Repris de « Annonces de suppressions d'emplois en Europe au cours des trois dernières semaines », Courrier International, 23-29 septembre 1993.
[5] [1261] Libération du 18 septembre 1993
[6] [1262] Voir « Une économie rongée par la décomposition » dans ce numéro.
Récent et en cours:
- Crise économique [28]
- Luttes de classe [143]
Balkans, Moyen-Orient : derrière les accords de paix, toujours la guerre impérialiste
- 2648 reads
Poignée de main historique, et généreusement médiatisée, entre Yasser Arafat, président de l'OLP, et Yitzhak Rabin, premier ministre israélien. Après 45 ans de guerres entre Israël et ses voisins arabes, et notamment palestiniens, c'est un événement considérable auquel Clinton, l'organisateur de la cérémonie, a voulu donner valeur de symbole : la seule paix possible est la « Pax americana ». Il faut dire que le président américain avait bien besoin d'un tel succès après toutes les déconvenues enregistrées depuis son arrivée. Et la kermesse qu'il a organisée dans sa propre maison (blanche) ne visait pas seulement à redresser une popularité en chute libre aux Etats-Unis mômes. Le message délivré le 13 septembre par les fastes de Washington s'adressait au monde entier. Il s'agissait d'affirmer bien fort à tous les pays que les Etats-Unis restent bien le « gendarme du monde » seul capable de garantir la stabilité de la planète. Une telle action d'éclat était d'autant plus nécessaire que depuis l'annonce par Bush, en 1989, de l'ouverture d'un « nouvel ordre mondial » sous l'égide de l'impérialisme américain, la situation n'a fait que s'aggraver partout et dans tous les domaines. A la place des bienfaits auxquels la fin de « l'Empire du Mal » devait ouvrir la porte : prospérité, paix, ordre, droit des peuples et des personnes, nous avons eu toujours plus de convulsions économiques, de famines, de guerres, de chaos, de massacres, de tortures, de barbarie. Au lieu d'une affirmation accrue de l'autorité de la «première démocratie du monde» comme garant de l'ordre planétaire, nous avons assisté à une perte accélérée de cette autorité, à une contestation croissante de celle-ci de la part de pays de plus en plus nombreux, y compris parmi les alliés les plus proche. Avec l'image des effusions entre les vieux ennemis «r héréditaires » du Moyen-Orient sous la bénédiction paternelle du président américain (qu'il puisse être leur fils ne fait que renforcer l'impact du tableau), ce dernier prétend inaugurer un nouveau « nouvel ordre mondial » (puisque celui de Bush est parti aux poubelles de l'histoire). Mais rien n'y fera, pas plus les gestes symboliques que les discours ampoulés, pas plus les cérémonies fastueuses que les caméras de télévision : comme toujours dans le capitalisme décadent, les discours et les accords de paix ne font que préparer de nouvelles guerres et encore plus de barbarie.
Les accords de Washington du 13 septembre 1993 ont éclipsé de leur éclat un autre « processus de paix » qui s'est ouvert durant l'été : les négociations de Genève sur l'avenir de la Bosnie. En réalité, ces négociations, leur contexte diplomatique, de même que les gesticulations militaires qui les ont entourées, constituent une des clés des enjeu En même temps qu'à l'intérieur de chaque nation les bourgeoisies fourbissent leurs armes contre la classe ouvrière, au plan international, les querelles et les heurts se multiplient. «L'entente entre les peuples », dont le modèle devait être celle entre grands pays capitalistes, cède le pas à une guerre économique sans merci, aveu d'un « chacun pour soi » débridé, qui est la tendance de fond du capitalisme actuel. Le marché mondial est depuis longtemps saturé. Il est devenu trop étroit pour permettre le fonctionnement normal de l'accumulation du capital, l'élargissement de la production et de la consommation nécessaire à la réalisation du profit, moteur de ce système.
Mais à la différence des dirigeants d'une simple entreprise capitaliste qui, lorsqu'il y a faillite, mettent la clé sous la porte, procèdent à une liquidation et vont chercher ailleurs la manne qui leur a fait défaut, la classe capitaliste dans son ensemble ne peut pas prononcer sa propre faillite et procéder à la liquidation du mode de production capitaliste. Ce serait prononcer sa propre disparition, ce qu'aucune classe exploiteuse n'est en mesure de faire. La classe dominante ne va pas se retirer de la scène sociale sur la pointe des pieds en disant « j'ai fait mon temps ». Elle défend bec et ongles et jusqu'à la dernière énergie ses intérêts et ses privilèges.
C'est à la classe ouvrière que revient la tâche de détruire le capitalisme. De par sa place dans les rapports de production capitaliste, elle est la seule force capable d'enrayer la machine infernale du capitalisme décadent. Ne disposant d'aucun pouvoir économique dans la société, sans intérêt particulier à défendre, classe qui, collectivement, n'a que sa force de travail à vendre au capitalisme.
Ex-Yougoslavie : l'échec de la puissance américaine
A l'heure où ces lignes sont écrites, il n'y a pas eu d'accord définitif entre les trois parties (Serbes, Croates et Musulmans) qui s'affrontent autour des dépouilles de feu la République de Bosnie-Herzégovine. Le plan de partage de ce pays remis le 20 août aux participants est encore en discussion sur les détails du tracé des nouvelles frontières. Cependant, les véritables enjeux de ces négociations, de même que de la guerre qui continue de ravager une partie de l'ex-Yougoslavie, apparaissent clairement aux yeux de ceux qui refusent de se laisser manipuler par les campagnes d'intoxication des différents camps et des différentes puissances.
En premier lieu, il est évident que la guerre dans l'ex-Yougoslavie n'est pas seulement une affaire interne avec pour cause unique les déchirements entre différentes ethnies. Depuis longtemps, les Balkans sont devenus un terrain d'affrontements privilégié entre puissances impérialistes. Et le nom de Sarajevo lui-même n'a pas attendu les années 1992-93 pour devenir tristement célèbre : ce nom est associé, depuis près de 80 ans aux origines de la première guerre mondiale. Cette fois encore, dès le début de l'éclatement de la Yougoslavie, en 1991, les grandes puissances sont apparues comme des acteurs de premier plan de la tragédie endurée par les populations de cette région. D'entrée de jeu, le ferme soutien de l'Allemagne à l'indépendance de la Slovénie et de la Croatie a contribué à mettre de l'huile sur le feu des affrontements, de même d'ailleurs que le soutien à la Serbie des autres puissances telles la France, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et la Russie. Sans revenir sur les analyses amplement développées dans cette même Revue, il importe de mettre en relief l'antagonisme entre les intérêts de la première puissance européenne, qui voyait dans une Slovénie et une Croatie indépendantes et alliées le moyen de s'ouvrir une porte vers la Méditerranée, et les intérêts des autres puissances, qui sont totalement opposées à un tel déploiement de l'impérialisme allemand.
Par la suite, lorsque la Bosnie elle-même a revendiqué son indépendance, la puissance américaine s'est empressée de lui apporter son soutien : ce changement d'attitude par rapport à celle adoptée envers la Slovénie et la Croatie était significatif de la stratégie de l'impérialisme US : ne pouvant faire de la Serbie un allié fiable dans la zone des Balkans, dans la mesure où ce pays avait déjà des attaches anciennes et solides avec des pays comme la Russie ([1] [1263]) et la France, cet impérialisme visait à faire de la Bosnie son point d'appui dans la région, notamment sur les arrières d'une Croatie pro-allemande. Le ferme soutien à la Bosnie a été un des thèmes de la campagne du candidat Clinton. Le même, devenu président, a commencé avec la même politique : « Tout le poids de la diplomatie américaine doit être engagé » derrière cet objectif avait-il déclaré en février 1993. En mai, Warren Christopher, secrétaire d'Etat, propose aux européens deux mesures pour stopper l'avance serbe en Bosnie-Herzégovine : levée de l'embargo sur les armes pour ce dernier pays et utilisation de frappes aériennes contre les positions serbes. Les Etats-Unis proposent comme « solution » du conflit des Balkans le moyen par lequel ils avaient « résolu » la crise du Golfe : le gros bâton, et notamment l'utilisation de la puissance de feu aérienne qui a le grand avantage de mettre en évidence leur énorme supériorité militaire. La France et la Grande-Bretagne, c'est-à-dire les deux pays les plus engagés sur le terrain dans le cadre de la FORPRONU, refusent catégoriquement. A la fin du même mois, l'accord de Washington entre les Etats-Unis et les pays européens, avalise, malgré les déclarations triomphalistes de Clinton, la position de ces derniers sur la Bosnie : ne pas riposter à l'offensive serbe visant à démembrer ce pays, limiter l'intervention des forces de l'ONU ou, éventuellement, de l'OTAN à des objectifs uniquement « humanitaires ».
Ainsi, il devenait clair que la première puissance mondiale changeait son fusil d'épaule et abandonnait la carte jouée depuis l'année précédente avec force campagnes médiatiques sur la défense des « droits de l'homme » et la dénonciation de la « purification ethnique ». C'était la reconnaissance d'un échec dont les Etats-Unis faisaient porter (non sans raison) la responsabilité aux pays européens. Ce constat d'impuissance était encore réitéré le 21 juillet par W. Christopher qui déclarait : « Les Etats-Unis font tout ce qu'ils peuvent, compte tenu de leurs intérêts nationaux. » après avoir qualifié de « tragique, tragique » la situation à Sarajevo.
Cependant, dix jours plus tard, alors qu'avait débuté la conférence de Genève sur la Bosnie, la diplomatie américaine reprend brusquement son gros bâton ; ses différents responsables martèlent à nouveau, et avec encore plus de force qu'en mai, le thème des frappes aériennes contre les Serbes : « Nous pensons que la moment de l'action est venu (...) le seul espoir réaliste de parvenir à un règlement politique raisonnable est de mettre la puissance aérienne [celle de l'OTAN] au service de la diplomatie » (Christopher dans une lettre à Boutros-Ghali du 1er août). «Les Etats-Unis n'allaient pas rester à regarder sans rien faire alors que Sarajevo est mise à genoux » (le même au Caire, le jour suivant). En même temps, les 2 et 9 août, sont convoquées à l'initiative des Etats-Unis deux réunions du Conseil de l'OTAN. Cette puissance demande à ses «alliés» d'autoriser et de mettre en oeuvre ces frappes aériennes. Après de nombreuses heures de résistance, menée principalement par la France (avec l'accord de la Grande-Bretagne), le principe de telles frappes est accepté à la condition (dont ne voulaient pas au départ les américains)... que la demande en soit faite par le Secrétaire général de l'ONU, lequel s'est toujours opposé au principe des frappes aériennes. La nouvelle offensive américaine a tourné court.
Sur le terrain, les forces serbes desserrent leur pression sur Sarajevo et cèdent à la FORPRONU les hauteurs stratégiques surplombant la ville qu'ils avaient prises aux Musulmans quelques jours auparavant. Mais si les Etats-Unis attribuent ce recul serbe à la décision de l'OTAN, le général Belge commandant la FORPRONU en Bosnie y voit « un exemple de ce qu'on peut accomplir par la négociation » alors que son adjoint, le général britannique Hayes, déclare : « A quoi le président Clinton veut-il en venir ? [...] la force aérienne ne mettra pas en échec les Serbes ». C'est un véritable affront à la puissance américaine et un sabotage en règle de sa diplomatie. Et le pire pour les Etats-Unis c'est que ce sabotage est cautionné, sinon encouragé, par la Grande-Bretagne, c'est-à-dire par leur plus fidèle allié.
Cela dit, il est fort peu probable que les Etats-Unis aient sérieusement envisagé, en dépit de leurs discours tonitruants, de faire donner la force aérienne contre les Serbes au cours de l'été. De toutes façons, les jeux étaient faits : la perspective d'une Bosnie unitaire et pluriethnique, telle qu'elle avait été défendue tant par la diplomatie américaine que par les Musulmans, était définitivement passée à la trappe dès lors que le territoire de la république bosniaque était pour la plus grande partie entre les mains des milices serbes et croates, les musulmans n'en conservant qu'un cinquième alors qu'ils représentaient près de la moitié de la population avant la guerre.
En réalité, l'objectif des gesticulations des Etats-Unis au cours de l'été était déjà bien loin de celui que s'était donné la diplomatie de ce pays à l'origine du conflit. Il s'agissait uniquement pour elle de s'éviter l'humiliation suprême, la chute de Sarajevo, et surtout de s'inviter dans une pièce dont le scénario lui avait échappé depuis longtemps. Alors que le dernier acte de la tragédie bosniaque est en train de se jouer à Genève, il importait que la puissance américaine y fasse une apparition comme « guest star », même à titre de mouche du coche, puisque le premier rôle lui avait été interdit depuis longtemps. Et finalement, sa contribution à l'épilogue aura consisté à « convaincre » ses protégés Musulmans, moyennant quelques menaces contre les Serbes, d'accepter leur capitulation le plus vite possible car plus la guerre se prolonge en Bosnie, plus elle met en évidence l'impuissance de la première puissance mondiale.
Le caractère piteux et velléitaire de la prestation du géant américain face au conflit en Bosnie apparaît encore plus crûment si on la compare à sa « gestion » de la crise et de la guerre du Golfe en 1990-91. Lors de cette dernière, il avait tenu intégralement ses promesses auprès de ses protégés, l'Arabie Saoudite et le Koweït. Cette fois-ci, il n'a rien pu faire pour son protégé bosniaque : sa contribution à la « solution » du conflit s'est résumée à lui forcer la main pour lui faire accepter l'inacceptable. Dans le contexte de la crise du Golfe, cela aurait consisté, après plusieurs mois de gesticulations, à faire pression sur les autorités du Koweït pour qu'elles consentent à céder à Saddam Hussein la plus grande partie de leur territoire ! Mais il est un élément peut être encore plus grave : alors qu'en 1990-91, les Etats-Unis avaient réussi à entraîner dans leur aventure la totalité des pays occidentaux (même si certains, comme la France ou l'Allemagne, traînaient leurs guêtres), ils se sont heurtés, en Bosnie, à l'hostilité de ces mêmes pays, y compris à celle de la fidèle Albion.
La faillite patente de la diplomatie américaine dans le conflit en Bosnie constitue un coup sévère à l'autorité d'une puissance qui prétend jouer le rôle de « gendarme du monde ». Quel confiance pourront avoir à l'égard d'une telle puissance les pays qu'elle est sensée « protéger » ? Quelle crainte peut-elle inspirer à ceux qui songent à la narguer ? C'est justement en tant que moyen de restaurer cette autorité que l'accord de Washington du 13 septembre prend toute sa signification.
Moyen-Orient : l'accord de paix ne met pas fin à la guerre
S'il fallait une seule preuve du cynisme dont est capable la bourgeoisie, l'évolution récente de la situation au Moyen-Orient suffirait amplement. Aujourd'hui, les médias nous invitent à verser une larme d'émotion devant la poignée de main historique de la Maison Blanche. Elles se gardent bien de nous rappeler comment elle a été préparée, il y a moins de deux mois.
Fin juillet 1993 : l'Etat d'Israël déchaîne un enfer de feu et de fer sur des dizaines de villages du Liban. C'est l'action militaire la plus importante et meurtrière depuis l'opération « Paix en Galilée » de 1982. Des centaines de morts, surtout des civils, sinon des milliers Près d'un demi million de réfugiés sur les routes. Et c'est très officiellement que cette belle « Démocratie », dirigée de surcroît par un gouvernement « socialiste », a justifié en ces termes son action : terroriser les populations civiles du Liban afin qu'elles fassent pression auprès du gouvernement pour que ce dernier brise le Hezbollah. Une nouvelle fois, les populations civiles sont les otages des menées impérialistes. Mais le cynisme bourgeois ne s'arrête pas là. En réalité, au delà de la question du Hezbollah, lequel, dès la fin des hostilités, a repris ses actions militaires contre les troupes israéliennes occupant le Sud Liban, l'offensive militaire israélienne n'était pas autre chose que la préparation de la touchante cérémonie de Washington, une préparation mise en oeuvre autant par l'Etat d'Israël que par son grand proxénète, les Etats-Unis.
Du côté d'Israël, il importait que les négociations de paix et les propositions que cet Etat s'apprêtait à faire à l'OLP n'apparaissent pas comme un signe de faiblesse de sa part. Les bombes et les obus qui ont détruit les villages du Liban étaient porteurs d'un message destiné aux différents Etats arabes : « inutile de compter sur notre faiblesse, nous ne céderons que ce qui nous arrangera». Le message s'adressait notamment à la Syrie (dont l'autorisation est nécessaire aux activités du Hezbollah) et qui, depuis des décennies, rêve de récupérer le Golan annexé par Israël à la suite de la guerre de 1967.
Du côté des Etats-Unis, il s'agissait, à travers les exploits militaires de son affidé, de signifier que cette puissance restait bien la patronne du Moyen-Orient malgré les difficultés qu'elle pouvait connaître par ailleurs. Le message s'adressait aux Etats arabes qui pourraient être tentés de jouer une autre partition que celle qu'ils ont reçue de Washington. Par exemple, il était bon d'avertir la Jordanie qu'il ne faudrait pas qu'elle recommence à faire des infidélités comme au moment de la guerre du Golfe. Et surtout, il fallait rappeler à la Syrie qu'elle devait sa mainmise sur le Liban à la « bonté » américaine, suite à la guerre du Golfe, et à ce dernier Etat que ses attaches historiques avec la France étaient bien de l'histoire ancienne. Le message s'adressait aussi à l'Iran, parrain du Hezbollah, et qui tente aujourd'hui une ouverture diplomatique en direction de la France et de l'Allemagne. En conséquence, la mise en garde des Etats-Unis s'adressait à toutes les puissances qui pourraient songer à braconner dans sa chasse gardée du Moyen-Orient.
Enfin, il fallait montrer au monde entier que la première puissance mondiale avait encore les moyens de dispenser à sa guise autant la foudre que les colombes et qu'il fallait, en conséquence, la respecter. C'était bien le sens du message de W. Christopher lors de sa tournée au Moyen-Orient, début août, juste après l'offensive israélienne : « les affrontements présents illustrent la nécessité et l'urgence de la conclusion d'un accord de paix entre les différents Etats concernés ». C'est la méthode classique des racketteurs qui viennent proposer une « protection » au boutiquier dont ils ont cassé la vitrine.
Ainsi, comme toujours dans le capitalisme décadent, il n'existe pas de différence de fond entre la guerre et la paix : c'est par la guerre, par les massacres et la barbarie que les brigands impérialistes préparent leurs accords de paix. Et ces derniers ne sont jamais qu'un moyen, qu'une étape dans la préparation de nouvelles guerres encore plus meurtrières et barbares.
Vers toujours plus de guerres
Les négociations et les accords qui sont intervenus au cours de l'été, tant à Genève qu'à Washington, ne doivent pas laisser la moindre place au doute : il n'y aura pas plus « d'ordre mondial » avec Clinton qu'avec Bush.
Dans l'ex-Yougoslavie, même si les négociations de Genève sur la Bosnie aboutissent (pour le moment la guerre se poursuit, notamment entre les Musulmans et les Croates), cela ne signifiera pas pour autant la fin des affrontements. On connaît déjà les nouveaux champs de bataille : la Macédoine revendiquée presque ouvertement par la Grèce, le Kosovo peuplé principalement d'Albanais qui sont tentés par un rattachement à une « Grande Albanie », la Krajina, cette province située sur le territoire de l'ancienne république fédérée de Croatie, aujourd'hui entre les mains des Serbes et qui coupe en deux le littoral croate de Dalmatie. Et l'on sait également que dans ces conflits qui couvent, les grandes puissances ne joueront nullement le rôle de modérateurs ; au contraire, comme elles l'ont fait jusqu'à présent, elles s'appliqueront à jeter de l'huile sur le feu.
Au Moyen-Orient, si la mode est aujourd'hui à la paix, cela ne saurait durer : les modes passent vite et les sources de conflits ne manquent pas. L'OLP, nouveau flic des territoires auxquels Israël a «consenti» l'autonomie, doit faire face à la concurrence du mouvement intégriste Hamas. L'organisation de Yasser Arafat est elle-même divisée : ses différentes factions, qui sont entre tenues par les différents Etats arabes, ne pourront que s'entre-déchirer en même temps que s'aiguiseront les conflits entre ces mêmes Etats du fait de la disparition de ce qui limitait les affrontements entre eux, le soutien à la « cause palestinienne » contre Israël. Par ailleurs, les bonnes dispositions affichées, avec un sourire un peu forcé, par la Syrie à l'égard de l'accord de Washington n'ont pas résolu la question du Golan. L'Irak reste encore au ban des nations. Les nationalistes Kurdes n'ont pas renoncé à | leurs revendications en Irak et en Turquie... Et tous ces foyers ne font qu'attiser les ardeurs de pyromane des grandes puissances toujours prêtes à se découvrir une cause « humanitaire » qui, comme par hasard, correspond à leurs intérêts impérialistes.
Mais les sources de conflits ne se localisent pas aux seules régions des Balkans et du Moyen-Orient.
Dans le Caucase, en Asie centrale, la Russie, en faisant valoir ses appétits impérialistes (évidemment beaucoup plus restreints que par le passé) ne fait qu'ajouter au chaos des anciennes ré publiques qui constituaient l'URSS et aiguiser les déchirements ethniques (Abkhazes contre Géorgiens, Arméniens contre Azéris, etc.). Et cela ne permet en aucune façon d'atténuer le chaos politique qui règne aussi à l'intérieur de ses frontières, comme on peut le voir avec les affrontements actuels entre Eltsine et le Parlement russe.
En Afrique, la guerre est déclarée entre les anciens alliés de l'ex-bloc occidental : « Si nous voulons prendre la tête de l'évolution mondiale (...) nous devons être prêts à investir autant en Afrique que dans d'autres régions du monde » (Clinton, cité par « Jeune Afrique ») ; « Depuis la fin de la guerre froide, nous n'avons plus à nous aligner sur la France en Afrique » (un diplomate américain dans le même magazine). En d'autres termes : « Si la France nous taille des croupières dans les Balkans, nous ne nous gênerons pas pour aller chasser sur ses terres africaines ». Au Libéria, au Rwanda, au Togo, au Cameroun, au Congo, en Angola, les Etats-Unis et la France s'affrontent déjà par politiciens ou par guérillas interposés. En Somalie, c'est l'Italie qui se retrouve aujourd'hui en première ligne du front anti-américain (mais la France n'est pas loin), et cela dans le cadre d'une opération « humanitaire » sous le drapeau de l'ONU, symbole de la paix.
Et cette liste est loin d'être exhaustive ou définitive. S'ils éloignaient la menace d'une troisième guerre mondiale, l'effondrement du bloc de l'Est en 1989 et la disparition du bloc occidental qui devait en résulter nécessairement, ont ouvert une véritable boîte de pandore. Désormais, la loi du « chacun pour soi » tend à régner de plus en plus même si de nouvelles alliances se dessinent dans la perspective, encore lointaine sinon inaccessible, d'un futur partage du monde entre deux nouveaux blocs. Mais ces alliances elles-mêmes sont en permanence ébranlées dans la mesure où, avec la disparition de la menace de «l'Empire du Mal», aucun pays ne trouve son intérêt dans l'accroissement de la puissance de ses alliés plus forts. Lorsqu'un ami a des bras trop musclés, il risque de m'étouffer en m'embrassant. Ainsi, la France n'était nullement intéressée à voir sa comparse germanique devenir, en mettant la main sur la Slovénie et le Croatie, une puissance méditerranéenne. Plus significatif encore, la Grande-Bretagne, pourtant l'allié historique des Etats-Unis, n'avait aucune envie de favoriser le jeu de cette puissance dans les Balkans et en Méditerranée qu'elle considère un peu, grâce à ses positions à Gibraltar, Malte et Chypre, comme une « Mare nostrum ».
En fait, nous assistons à un véritable renversement de la dynamique des tensions impérialistes. Dans le passé, avec le partage du monde en deux blocs, tout ce qui pouvait renforcer la tête de bloc face à l'adversaire était bon pour ses seconds couteaux. Aujourd'hui, ce qui renforce la puissance la plus forte risque de se révéler mauvais pour ses alliés plus faibles.
C'est pour cela que l'échec des Etats-Unis dans les Balkans, qui doit beaucoup à la trahison de leur « ami » britannique, ne saurait être compris comme le simple résultat d'une politique erronée de l'équipe Clinton. C'est à une sorte de quadrature du cercle qu'est confrontée celle-ci : plus les Etats-Unis voudront faire preuve d'autorité afin de resserrer les boulons, plus leurs « alliés » seront tentés de se dégager de leur tutelle étouffante. En particulier, si l'étalage et l'utilisation de sa supériorité militaire massive constitue la carte maîtresse de l'impérialisme américain, c'est aussi une carte qui tend à se retourner contre ses propres intérêts, notamment en favorisant une indiscipline encore plus grande de ses « alliés ». Cependant, même si la force brute n'est plus capable de faire régner « l'ordre mondial », il n'existe pas, dans un système qui s'enfonce dans une crise irrémédiable, d'autre moyen non plus et, de ce fait, elle sera de plus en plus utilisée.
Cette absurdité est un symbole tragique de ce qu'est devenu le monde capitaliste : un monde en putréfaction qui sombre dans une barbarie croissante avec toujours plus de chaos, de guerres et de massacres.
FM, 27 septembre 1993[1] [1264] Le fait que la Russie soit devenue aujourd'hui un des meilleurs alliés des Etats-Unis n'élimine pas les divergences d'intérêts qui peuvent exister entre les deux pays. En particulier, la Russie n'est nullement intéressée à une alliance directe entre les Etats-Unis f et la Serbie, alliance qui ne pourrait se faire que par dessus sa propre tête. Les Etats-Unis, en faisant la promotion de leur ressortissant d'origine Serbe, Panic, ont bien essayé de s'attacher directement la Serbie. Mais l'échec de Panic aux élections pour la présidence de ce pays a marqué un coup d'arrêt à cette entreprise américaine.
Géographique:
- Europe [95]
Questions théoriques:
- Guerre [129]
Où en est la crise économique ? : Une économie rongée par la décomposition
- 4218 reads
La crise du système monétaire européen au cours de l'été 1993, a mis en évidence l'accélération de quelques unes des tendances les plus profondes et significatives qui traversent actuellement l'économie mondiale. En montrant l'importance acquise par les pratiques artificielles et destructrices telles que la spéculation massive, en mettant à nu la puissance des tendances au « chacun pour soi » qui opposent les nations entre elles, ces événements tracent l'avenir immédiat du capitalisme : un avenir marqué du sceau de la dégénérescence, de la décomposition, de l'autodestruction.
Ces secousses monétaires ne sont que des manifestations superficielles d'une réalité beaucoup plus dramatique : l'incapacité croissante du capitalisme, comme système, à surmonter ses propres contradictions. Pour la classe ouvrière, pour les classes exploitées sur toute la planète, sous la forme du chômage massif, de la réduction des salaires réels, de la diminution des «prestations sociales » etc., c'est la plus violente attaque économique depuis la seconde guerre mondiale.
« Les spéculateurs enterrent l'Europe... L'Occident est au bord du désastre. » C'est en ces termes qu'un prix Nobel d'économie, Maurice Allais ([1] [1265]), commentait les événements qui ont vu, fin juillet 1993, quasiment éclater le SME. Un aussi éminent défenseur de l'ordre établi ne pouvait envisager les difficultés économiques de son système que comme résultat de l'action d'éléments « extérieurs » à la machine capitaliste. En l'occurrence, « les spéculateurs ». Mais la catastrophe économique actuelle est telle qu'elle contraint même les plus obtus des bourgeois à un minimum de lucidité, du moins pour constater l'ampleur des dégâts.
Les trois quarts de la planète, (« tiers-monde», ancien bloc soviétique), ne sont plus « au bord du désastre », mais en plein dedans. Le dernier réduit, sinon de prospérité du moins de non-effondrement, « l'Occident », plonge à son tour. Depuis trois ans, des puissances comme les Etats-Unis, le Canada et le Royaume-Uni s'embourbent dans la plus longue et profonde récession depuis la guerre. La « reprise » économique aux Etats-Unis, que les « experts » avaient saluée, se fondant sur les taux de croissance positifs du PIB dans ce pays (3,2 % au deuxième semestre 92), s'est dégonflée au début de 1993 faisant 0,7 % au premier trimestre et 1,6 au deuxième, c'est-à-dire la quasi stagnation. (Les « experts » s'attendaient à au moins 2,3 % pour le deuxième trimestre). La « locomotive américaine », celle qui avait entraîné la relance en Occident après les récessions de 1974-75 et 1980-82, s'essouffle avant même d'avoir commencé à entraîner le train. Quant aux deux autres grands pôles de « l'Occident », l'Allemagne et le Japon ils s'enfoncent à leur tour dans la récession. Au mois de mai 1993 la production industrielle avait chuté, sur douze mois, de 3,6 % au Japon, de 8,3 % en Allemagne.
C'est dans ce contexte qu'éclate la crise du Système Monétaire Européen (SME), la deuxième en moins d'un an ([2] [1266]). Sous la pression d'une vague mondiale de spéculation, les gouvernements du SME sont contraints de renoncer à leur engagement de maintenir leurs monnaies liées entre elles par des taux de change stables. En portant les marges de fluctuation de ces taux de 5 % à 30 %, ils ont pratiquement réduit ces accords à du bavardage.
Même si ces événements se situent dans la sphère particulière du monde financier du capital, ils sont un produit de la crise réelle du capital. Ils sont significatifs, au moins sous trois aspects importants, des tendances profondes qui tracent la dynamique de l'économie mondiale.
1. Le développement sans précédent de la spéculation, des trafics et de la corruption
L'ampleur des forces spéculatives qui ont ébranlé le SME est une des caractéristiques majeures de la période actuelle. Après avoir spéculé sur tout au cours des années 1980 (actions en bourse, immobilier, objets d'art, etc.), après avoir vu nombre de valeurs spéculatives commencer à s'effondrer avec l'arrivée des années 1990, les capitaux ont trouvé dans la spéculation sur le marché des changes un des derniers refuges. A la veille de la crise du SME on estimait que les flux financiers internationaux consacrés, chaque jour, à la spéculation monétaire atteignaient 1 000 milliards de dollars (soit l'équivalent de la production annuelle du Royaume-Uni), quarante fois le montant des flux financiers correspondant à des règlements commerciaux ! Il ne s'agit plus de quelques hommes d'affaires peu scrupuleux à la recherche de profits rapides et risqués. C'est toute la classe dominante, avec en tête ses banques et ses Etats, qui se livre à cette activité artificielle et totalement stérile du point de vue de la richesse réelle. Elle le fait non pas parce que ce serait un moyen plus simple de faire du profit, mais parce que dans le monde réel de la production et du commerce elle a de moins en moins les moyens de faire fructifier autrement son capital. Le recours au profit spéculatif est tout d'abord la manifestation de la difficulté à réaliser des profits réels.
C'est pour les mêmes raisons que la vie économique du capital se voit de plus en plus infectée par les formes les plus dégénérées de toute sorte de trafics et par la corruption politique généralisée. Le chiffre d'affaires du trafic de drogues au niveau mondial, est devenu aussi important que celui du commerce du pétrole. Les convulsions de la classe politique italienne révèlent l'ampleur atteinte par les profits produits par la corruption et toute sorte d'opérations frauduleuses.
Certains moralistes radicaux de la bourgeoisie déplorent ce visage de plus en plus hideux que prend leur démocratie capitaliste en vieillissant. Ils voudraient débarrasser le capitalisme des « spéculateurs rapaces », des trafiquants de drogue, des hommes politiques corrompus. Ainsi, Claude Julien, du très sérieux Monde diplomatique ([3] [1267]) propose, sans rire, aux gouvernements démocratiques de : « Stériliser les énormes profits financiers qu'engendre le trafic, rendre impossible le blanchiment de l'argent sale, et pour cela lever le secret bancaire, éliminer les paradis fiscaux. »
Parce qu'ils ne parviennent pas à envisager un seul instant qu'il puisse exister une autre forme d'organisation sociale que le capitalisme, les défenseurs du système croient que les pires aspects de la société actuelle pourraient être éliminés moyennant quelques lois énergiques. Ils croient qu'ils ont à faire à des maladies guérissables, alors qu'il s'agit d'un cancer généralisé. Un cancer comme celui qui décomposa la société antique romaine en décadence. Une dégénérescence qui ne disparaîtra qu'avec la destruction du système lui-même.
2. L'obligation de tricher avec ses propres lois
L'incapacité des pays du SME à maintenir une véritable stabilité dans le domaine monétaire, traduit l'incapacité croissante du système à vivre en conformité avec ses propres règles les plus élémentaires. Pour mieux comprendre l'importance et la signification de cet échec, il est utile de rappeler pourquoi fut créé le SME, à quelles nécessités était-il supposé répondre.
La monnaie est un des instruments les plus importants de la circulation capitaliste. Elle constitue un moyen de mesurer ce qui s'échange, de conserver et accumuler la valeur des ventes passées pour pouvoir faire les achats du futur, elle permet l'échange entre les marchandises les plus diverses, quelles que soient leur nature et leur origine, en constituant un équivalent universel. Le commerce international nécessite des monnaies internationales : la livre sterling joua ce rôle jusqu'à la première guerre mondiale, supplantée depuis par le dollar. Mais cela ne suffit pas. Pour acheter et vendre, pour pouvoir avoir recours au crédit, il faut aussi que les différentes monnaies nationales s'échangent entre elles de façon « fiable », avec suffisamment de constance pour ne pas fausser entièrement le mécanisme de l'échange.
S'il n'y a pas un minimum de règles respectées dans ce domaine, les conséquences se font sentir dans toute la vie économique. Comment faire du commerce lorsqu'on ne peut plus prévoir si le prix payé par une marchandise sera celui accordé au moment de la commande ? En quelques mois, par le jeu des fluctuations monétaires le profit escompté par la vente d'une marchandise peut ainsi se voir transformé en perte sèche.
Aujourd'hui, l'insécurité monétaire au niveau international est devenue telle qu'on voit de plus en plus ressurgir cette forme archaïque de l'échange que constitue le troc, c'est-à-dire l'échange de marchandises directement sans recours à l'intermédiaire de l'argent.
Parmi les tricheries monétaires qui permettent d'échapper, au moins momentanément, aux contraintes des règles capitalistes, il en est une qui prend aujourd'hui une importance de premier ordre. Les « économistes » l'appellent pudiquement « dévaluation compétitive ». Il s'agit d'une « tricherie » avec les lois les plus élémentaires de la concurrence capitaliste : au lieu de se servir de l'arme de la productivité pour gagner des places sur le marché, les capitalistes d'une nation dévaluent le cours international de leur monnaie. De ce fait ils voient le prix de leurs marchandises diminuer d'autant sur le marché international. Au lieu de procéder à des réorganisations difficiles et complexes de l'appareil de production, au lieu d'investir dans des machines de plus en plus coûteuses pour assurer une exploitation plus efficace de la force de travail, il suffit de laisser s'effondrer le cours de sa monnaie. La manipulation financière prend le pas sur la productivité réelle. Une dévaluation réussie peut même permettre à un capital national de faire pénétrer ses marchandises dans le marché d'autres capitalistes pourtant plus productifs.
Le SME constitue une tentative de limiter ce genre de pratique qui transforme toute « entente » commerciale en un jeu de dupes. Son échec traduit l'incapacité du capitalisme d'assurer un minimum de rigueur dans un domaine crucial.
Mais, ce manque de rigueur, cette incapacité à respecter ses propres règles n'est ni un fait momentané, ni une spécificité du marché monétaire international. C'est dans tous les domaines que, depuis 25 ans, le capitalisme tente de « se libérer » de ses propres contraintes, de ses propres lois qui l'étouffent, se servant souvent pour cela de l'action de son appareil responsable de la légalité (capitalisme d'Etat). Dés la première récession de l'après-reconstruction, en 1967, il invente les «droits de tirage spéciaux » qui ne font que consacrer la possibilité pour les grandes puissances de créer de l'argent sur le plan international sans autre couverture que les promesses des gouvernements. En 1972 les Etats-Unis se débarrassent de la contrainte de la convertibilité-or du dollar et du système monétaire, dit de Bretton Woods. Au cours des années 1970, les rigueurs monétaires cèdent le pas aux politiques inflationnistes, les rigueurs budgétaires aux déficits chroniques des Etats, les rigueurs de crédit aux prêts sans limites ni couverture. Les années 1980, ont poursuivi ces tendances voyant avec les politiques dites reaganniennes, l'explosion du crédit et des déficits d'Etat. Ainsi entre 1974 et 1992 la dette publique brute des Etats de l'OCDE est passée, en moyenne, de 35 % du PIB à 65 %. Dans certains pays comme l'Italie ou la Belgique la dette publique dépasse les 100 % du PIB. En Italie, la somme des intérêts de cette dette équivaut à la masse salariale de tout le secteur industriel.
Le capitalisme a survécu à sa crise depuis 25 ans en trompant ses propres mécanismes. Mais ce faisant il n'a rien résolu des raisons fondamentales de sa crise. Il n'a fait que saper les bases mêmes de son fonctionnement, cumulant de nouvelles difficultés, de nouvelles sources de chaos et de paralysie.
3. La tendance croissante au « chacun pour soi »
Mais une des tendances du capitalisme actuel que la crise du SME a le plus mises en évidence est l'intensification des tendances centrifuges, les tendances au « chacun pour soi » et « tous contre tous ». La crise économique exacerbe sans fin les antagonismes entre toutes les fractions du capital, au niveau national et international. Les alliances économiques entre capitalistes ne peuvent être que des ententes momentanées entre requins pour mieux en affronter d'autres. A chaque instant, elles menacent de disparaître sous les tendances des alliés à se dévorer entre eux. Derrière la crise du SME, c'est le développement de la guerre commerciale à outrance qui se dessine. Une guerre impitoyable autodestructrice, mais à laquelle aucun capitaliste ne peut échapper.
Les gémissements de ceux qui, inconsciemment ou cyniquement, sèment des illusions sur la possibilité d'un capitalisme harmonieux, n'y peuvent rien : « Il faut désarmer l'économie. Il est urgent de demander aux entrepreneurs d'abandonner leurs uniformes de généraux et de colonels... Le G7 s'honorerait de mettre en place, dés sa prochaine réunion à Naples, un "Comité pour le désarmement économique mondial" » ([4] [1268]) Autant demander que le sommet des sept principales nations capitalistes occidentales constitue un comité pour l'abolition du capitalisme.
La concurrence fait partie de l'âme même du capitalisme, depuis toujours. Aujourd'hui elle est simplement portée à un degré d'exacerbation extrême.
Cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de contre-tendance. La guerre de tous contre tous pousse aussi à la recherche d'indispensables alliances, de gré ou de force, pour survivre. Les efforts des douze pays de la CEE pour assurer un minimum de coopération économique face aux concurrents américain et japonais ne sont pas que du bluff. Mais sous la pression de la crise économique et de la guerre commerciale qu'elle exacerbe, ces efforts se heurtent et se heurteront à des contradictions internes de plus en plus insurmontables.
Les entrepreneurs comme les gouvernements capitalistes ne peuvent pas plus « abandonner leurs uniformes de généraux et de colonels » que le capitalisme ne peut se transformer en un système d'harmonie et de coopération économique. Seul le dépassement révolutionnaire de ce système en décomposition pourra débarrasser l'humanité de l'absurde anarchie auto-destructrice qu'elle subit.
Un avenir de destruction, de chômage, de misère
La guerre militaire détruit des forces productives matérielles par le feu et l'acier. La crise économique détruit ces forces productives en les paralysant, en les immobilisant sur place. En vingt-cinq ans de crise, des régions entières, parmi les plus industrielles de la planète, telles le nord de la Grande-Bretagne, le nord de la France, Hambourg en Allemagne, sont devenues des lieux de désolation, jonchés d'usines et de chantiers navals fermés, dévorés par la rouille et l'abandon. Depuis deux ans les gouvernements de la CEE procèdent à la stérilisation d'un quart des terres cultivables européennes, pour cause de « crise de surproduction ».
La guerre détruit physiquement les hommes, soldats et population civile, pour l'essentiel des exploités, ouvriers ou paysans. La crise capitaliste répand le fléau du chômage massif. Elle les réduit à la misère, par le chômage ou par la menace du chômage. Elle répand le désespoir pour les générations présentes et condamne l'avenir des générations futures. Dans les pays sous-développés elle se traduit par de véritables génocides par la faim et la maladie : le continent Africain dans sa très grande partie est abandonné à la mort, rongé par les famines, les épidémies, la désertification au sens propre du terme.
Depuis un quart de siècle, depuis la fin des années 1960 qui marquaient la fin de la période de prospérité due à la reconstruction d'après-guerre, le chômage n'a cessé de se développer dans le monde. Ce développement s'est fait de façon inégale suivant les pays et lès régions. Il a connu des périodes d'intense développement (récessions ouvertes) et des périodes de répit. Mais le mouvement général ne s'est jamais démenti. Avec la nouvelle récession commencée à la fin des années 1980 il connaît un nouveau déploiement aux proportions inconnues jusqu'à présent.
Dans les pays qui ont été les premiers frappés par cette nouvelle récession, Etats-Unis, Royaume-Uni, Canada, la reprise de l'emploi, annoncée depuis maintenant trois ans, se fait toujours attendre. Dans la Communauté européenne le chômage se répand au rythme de 4 millions de chômeurs de plus par an (on prévoit 20 millions de chômeurs à la fin 1993, 24 millions pour la fin 1994). C'est comme si, en un an, on supprimait tous les emplois d'un pays comme l'Autriche. De janvier à mai 1993 il y a eu, chaque jour, 1 200 chômeurs de plus en France, 1 400 en Allemagne (en ne tenant compte que des statistiques officielles qui sous-estiment systématiquement la réalité du chômage).
Dans des secteurs qu'on croyait « assainis », pour reprendre la cynique terminologie de la classe dominante, on annonce de nouvelles saignées : dans la sidérurgie de la CEE où il ne reste que 400 000 emplois, on prévoit 70 000 nouvelles mises à la rue. IBM, l'entreprise modèle des 30 dernières années n'en finit pas de « s'assainir » et annonce 80 000 nouvelles suppressions d'emploi. Le secteur automobile allemand en annonce 100 000.
La violence et l'ampleur de l'attaque subie par la classe ouvrière des pays les plus industrialisés, en particulier en Europe actuellement, sont sans précédent.
Les gouvernements européens ne cachent pas leur conscience du danger. Delors, traduisant le sentiment des gouvernements de la CEE ne cesse de mettre en garde contre le risque d'une prochaine explosion sociale. Bruno Trentin, un des responsables de la CGIL, principal syndicat italien, qui dut affronter à l'automne dernier les sifflets des manifestations ouvrières en colère contre les mesures d'austérité imposées par le gouvernement avec l'appui des centrales syndicales, résume simplement les craintes de la bourgeoisie de son pays : « La crise économique est telle, la situation financière des grands groupes industriels si dégradée, que l'on ne peut que redouter le prochain automne social. » ([5] [1269])
La classe dominante a raison de redouter les luttes ouvrières que provoquera l'aggravation de la crise économique. Rarement dans l'histoire la réalité objective n'avait aussi clairement mis en évidence que l'on ne peut plus combattre les effets de la crise capitaliste sans détruire le capitalisme lui-même. Le degré de décomposition atteint par le système, la gravité des conséquences de son existence sont tels que la question de son dépassement par un bouleversement révolutionnaire apparaît et apparaîtra de plus en plus comme la seule issue « réaliste » pour les exploités.
RV
[1] [1270] Libération, 2 août 1993.
[2] [1271] En septembre 1992 la Grande-Bretagne avait dû quitter le SME, « humiliée par l'Allemagne », et les monnaies les plus faibles avaient été autorisées à dévaluer. Leurs marges de fluctuation avaient dû être élargies.
[3] [1272] Août 1993.
[4] [1273] Ricardo Petrella, de l'université catholique de Louvain, dans Le monde diplomatique d'août 1993.
[5] [1274] Interview à La tribune, 28 juillet 1993.
Récent et en cours:
- Crise économique [28]
Questions théoriques:
- Décomposition [3]
La lutte de classe contre la guerre impérialiste : Les luttes ouvrières en Italie 1943
- 3258 reads
Dans l'histoire du mouvement ouvrier et de la lutte de classe, la guerre impérialiste a toujours constitué une question fondamentale. Et ce n’est pas par hasard. La guerre concentre toute la barbarie de cette société ; avec la décadence historique du capitalisme en particulier, la guerre démontre l'impossibilité pour ce système d'offrir à l'humanité une quelconque possibilité de développement, en arrive à mettre en question jusqu'à sa survie même. En tant que manifestation majeure de la barbarie dont est capable le système capitaliste, la guerre constitue un puissant facteur de prise de conscience et de mobilisation de la classe ouvrière, ce dont nous avons eu la démonstration au cours de ce siècle, au moment des deux conflits mondiaux.
Si la riposte du prolétariat à la première guerre mondiale est assez connue, on connaît moins les épisodes de la lutte de classe dont les manifestations n'ont pas manqué pendant la seconde guerre mondiale également, en particulier en Italie. Quand les historiens et les propagandistes en parlent, c'est pour chercher à démontrer que les grèves de 1943 en Italie représentaient le début de la résistance « antifasciste » et, cette année, pour le cinquantenaire de ces événements, les syndicats italiens n'ont pas manqué de remettre à l'ordre du jour cette mystification, avec leurs « commémorations » nationalistes et patriotiques.
C'est à la réfutation de ces mensonges et à la réaffirmation de la capacité de la classe de répondre à la guerre impérialiste sur son propre terrain que cet article est dédié.
1943 : le prolétariat italien s'oppose aux sacrifices de la guerre
Dans la deuxième moitié de l'année 1942, quand l'issue de la guerre était encore largement ouverte et que le fascisme semblait solidement au pouvoir, il y eut des grèves sporadiques contre le rationnement et pour les augmentations de salaire dans les grandes usines du nord de l'Italie. Ce n'étaient que les premières escarmouches, dues au mécontentement que la guerre avait engendré dans les rangs du prolétariat, du fait des sacrifices qu'elle imposait.
Le 5 mars 1943, la grève commence à l'usine Mirafiori de Turin et s'élargit en l'espace de quelques jours aux autres usines, rassemblant des dizaines de milliers d'ouvriers. Les revendications sont très claires et très simples : augmentation des rations de vivres, augmentations de salaire et... fin de la guerre. Au cours du même mois, l'agitation gagne les grandes usines de Milan, la Lombardie toute entière, la Ligurie et d'autres parties de l'Italie.
La réponse du pouvoir fasciste est celle du bâton et de la carotte : arrestation des ouvriers les plus en vue, mais aussi concessions par rapport aux revendications les plus immédiates. Bien que Mussolini soupçonne l'action des forces antifascistes derrière ces grèves, il ne peut se permettre le luxe de faire grandir la colère ouvrière. En réalité, ses soupçons ne sont guère fondés, les grèves sont totalement spontanées, partent de la base ouvrière et du mécontentement de celle-ci contre les sacrifices de la guerre. C'est tellement vrai que les ouvriers « fascistes » participent aussi aux grèves.
« L'élément typique de cette action a été son caractère de classe qui, sur le plan historique, confère aux grèves de 1943-44 une physionomie propre, unitaire, typique, même par rapport à l'action générale menée unitairement par les comités de libération nationale. » ([1] [1275])
« En ne me prévalant que de mon prestige de vieil organisateur syndical, j'ai affronté des milliers d'ouvriers qui reprirent aussitôt le travail, bien que les fascistes se soient avérés complètement passifs dans les établissements et malheureusement, dans quelques cas, aient fomenté les grèves. C'est ce phénomène qui m'a énormément impressionné. » ([2] [1276])
Le comportement des ouvriers n'impressionnait pas seulement les hiérarques fascistes, mais la bourgeoisie italienne toute entière, qui voyait dans les grèves de mars la renaissance du spectre prolétarien, un ennemi bien plus dangereux que les adversaires sur les champs de bataille. A travers ces grèves, la bourgeoisie comprend que le régime fasciste n'est plus adapté pour contenir la colère ouvrière et prépare le remplacement de celui-ci et la réorganisation de ses forces « démocratiques ».
Le 25 juillet, le Roi destitue Mussolini, le fait arrêter et charge le maréchal Badoglio de former un nouveau gouvernement. Un des premiers soucis de ce gouvernement va être la refondation de syndicats « démocratiques » pour créer de nouvelles digues derrière lesquelles faire confluer les revendications des ouvriers lesquels, pendant ce temps, s'étaient donnés leurs propres organes pour mener le mouvement et étaient donc hors de tout contrôle. Le ministre des Corporations (cela s'appelait encore ainsi !), Leopoldo Piccardi, fait libérer le vieux dirigeant syndical socialiste, Bruno Buozzi, et lui propose la charge de commissaire aux organisations syndicales. Buozzi demande, et obtient, comme vice-commissaires le communiste Roveda et le chrétien-démocrate Quadrello. Le choix de la bourgeoisie est bien étudié, Buozzi est bien connu pour avoir participé aux grèves de 1922 (le mouvement d'occupation des usines, notamment dans le nord), dans lesquelles il avait démontré sa fidélité à la bourgeoisie en oeuvrant pour limiter toute possible avancée du mouvement.
Mais les ouvriers n'avaient que faire de la démocratie bourgeoise et de ses promesses. S'ils se méfiaient du régime fasciste, c'était avant tout parce qu'ils n'en pouvaient plus de faire les sacrifices que leur imposait la guerre ; or, le gouvernement Badoglio leur demandait de continuer à la supporter.
Ainsi, à la mi-août 1943, les ouvriers de Turin et de Milan se mettent de nouveau en grève en demandant, avec encore plus de force qu'auparavant, la fin de la guerre. Les autorités locales répondent encore une fois par la répression, mais ce qui a été bien plus efficace que celle-ci, c'est le voyage de Piccardi, Buozzi et Roveda dans le nord, pour rencontrer les représentants des ouvriers et les convaincre de reprendre le travail. Avant même d'avoir reconstruit leurs organisations, les syndicalistes du régime « démocratique » commençaient leur sale travail contre les ouvriers.
Pris entre répression, concessions et promesses, les ouvriers reprennent le travail, en attendant les événements. Ceux-ci se précipitent. Déjà en juillet, les alliés avaient débarqué en Sicile ; le 8 septembre, Badoglio signe l'armistice avec eux, s'enfuit dans le Sud avec le Roi et demande à la population de continuer la guerre contre les fascistes et nazis. Après quelques manifestations d'enthousiasme, la réaction est celle d'une démobilisation dans le désordre. De nombreux soldats jettent leurs uniformes et retournent à la maison, ou se cachent.
Les ouvriers qui ne sont pas capables de s'insurger sur leur propre terrain de classe, n'acceptent pas de prendre les armes contre les allemands et reprennent le travail en se préparant à avancer leurs revendications immédiates contre les nouveaux patrons de l'Italie du nord. En effet, l'Italie est divisée en deux : au Sud il y a les troupes alliées et une apparence de gouvernement légal ; au Nord par contre, les fascistes sont de nouveau aux commandes, ou plus exactement les troupes allemandes.
Même sans participation populaire, la guerre continue dans les faits. Les bombardements alliés sur le nord de l'Italie se font plus durs et les conditions de vie des ouvriers se détériorent encore plus. En novembre-décembre, les ouvriers reprennent donc le chemin de la lutte, s'affrontant cette fois à une répression encore plus brutale. A côté des arrestations, il y a désormais une nouvelle menace : la déportation en Allemagne. Les ouvriers défendent courageusement leurs revendications. En novembre, les ouvriers de Turin font grève et leurs revendications sont en grande partie satisfaites. Au début de décembre, ce sont les ouvriers de Milan qui rentrent en grève : là aussi promesses et menaces de la part des autorités allemandes. L'épisode suivant est significatif: « à 11H30 arrive le général Zimmerman qui donne l'ordre suivant : ceux qui ne reprennent pas le travail doivent sortir des entreprises ; ceux qui sortiront seront considérés comme des ennemis de l'Allemagne. Tous les ouvriers ont quitté les usines ». (D'après un journal clandestin du PC cité par Turone). A Gènes, le 16 décembre, les ouvriers descendent dans la rue. Les autorités allemandes utilisent la manière forte : il y a des affrontements qui font des blessés et des morts, affrontements qui se poursuivent, toujours avec la même dureté, pendant le mois de décembre dans toute la Ligurie.
C'est le signal du tournant : le mouvement s'affaiblit du fait, entre autre, de la division de l'Italie en deux. Les autorités allemandes, en difficulté sur le front, ne peuvent plus tolérer les interruptions de la production et affrontent résolument la question ouvrière (celle-ci commence aussi à se manifester, avec des grèves, au sein même de l'Allemagne). Le mouvement commence à se dénaturer, à perdre son caractère spontané et classiste. Les forces «antifascistes» cherchent à donner aux revendications ouvrières le caractère de lutte « de libération ». Ce phénomène est favorisé par le fait que de nombreuses avant-gardes ouvrières, pour échapper à la répression, se cachent dans les montagnes où elles sont enrôlées dans les bandes de partisans. En fait, il y a encore des grèves au printemps 1944 et en 1945 mais, désormais, la classe ouvrière a perdu l'initiative.
Les grèves de 1943 : une lutte de classe, pas une guerre antifasciste
La propagande bourgeoise cherche à présenter tout le mouvement de grèves de 1943 à 1945 comme une lutte antifasciste. Les quelques éléments que nous avons rappelés montrent qu'il n'en était pas ainsi. Les ouvriers luttent contre la guerre et les sacrifices qu'elle leur impose. Pour le faire, ils s'affrontent aux fascistes quand ceux-ci sont officiellement au pouvoir (en mars), contre le gouvernement, qui n'est plus fasciste, de Badoglio (en août), contre les Nazis, quand ce sont eux les vrais patrons du nord de l'Italie (en décembre).
Ce qui est vrai, par contre, c'est que les forces « démocratiques » et de la gauche bourgeoise, PCI en tête, cherchent depuis le début à dénaturer le caractère de classe de la lutte ouvrière pour dévoyer celle-ci vers le terrain bourgeois de la lutte patriotique et antifasciste. C'est à ce travail qu'ils consacrent tous leurs efforts : surprises par le caractère spontané du mouvement, les forces « antifascistes » sont contraintes de le suivre, en cherchant au cours même des grèves à introduire leurs mots d'ordre « antifascistes » au milieu de ceux des grévistes. Les militants locaux se montrent souvent incapables de le faire, s'attirant par là les foudres des dirigeants de leurs partis. Tout englués dans leur logique bourgeoise, les dirigeants de ces partis ne réussissent pas, ou ont du mal, à comprendre que, pour les ouvriers, l'affrontement est toujours contre le capital, quelle que soit la forme sous laquelle il se présente. «Rappelons-nous combien nous nous sommes fatigués dans les premiers temps de la lutte de libération pour faire comprendre aux ouvriers et aux paysans qui n'avaient pas de formation communiste (sic !), qui comprenaient qu'il fallait lutter contre les allemands, bien sûr, mais qui disaient : 'pour nous, que les patrons soient des italiens ou des allemands, çà ne fait vraiment pas beaucoup de différence. » E. Sereni, dirigeant à l'époque du PCI, dans Le Gouvernement du CL. ([3] [1277]).
Et bien non, M. Sereni ! Les ouvriers comprenaient très bien que leur ennemi, c'était le capitalisme, que c'était contre lui qu'il fallait se battre, quel que soit le masque sous lequel il se cache ; tout comme vous, les bourgeois, compreniez que c'était justement contre ce danger que vous, vous deviez vous battre ! Comme le comprenaient aussi les fascistes contre qui vous luttiez.
Nous ne sommes sûrement pas de ceux qui nient la nécessité de la lutte politique pour une véritable émancipation du prolétariat. Le problème, c'est quelle politique, quel terrain, dans quelle perspective ? La politique de la lutte « antifasciste » était une politique complètement patriotique et nationale-bourgeoise, qui ne mettait pas en question le pouvoir du capital au contraire. Même si ce n'est qu'en germe, la revendication la plus simple « du pain et la paix », si on la mène jusqu'au bout, et c'est cela que les ouvriers italiens n'ont pas été capables de faire, contenait en elle-même la perspective de la lutte contre le capitalisme, qui n'est capable de concéder ni ce pain ni cette paix. .
En 1943, la classe ouvrière a de nouveau démontré sa nature antagonique au capital...
« Du pain et la paix », un mot d'ordre simple et immédiat, qui a fait trembler de peur la bourgeoisie en mettant en péril ses visées impérialistes. Le pain et la paix, c'était le mot d'ordre qui avait fait bouger le prolétariat russe en 1917, et à partir duquel il avait pris le chemin de la révolution qui l'avait conduit au pouvoir, en Octobre. Effectivement, en 1943 aussi, il ne manquait pas de groupes ouvriers qui, dans les grèves, mettaient en avant le mot d'ordre de formation de soviets. C'est bien connu et, quelques fois, reconnu même à travers la reconstruction des partis « antifascistes », que pour une bonne partie des ouvriers, la participation à la Résistance était vue comme ayant une fonction anticapitaliste et non pas patriotique.
Enfin, la peur de la bourgeoisie était justifiée par le fait qu'il y avait égale ment des mouvements de grève en Allemagne dans la même année 1943. Mouvements qui ont ensuite touché la Grèce, la Belgique, la France et la Grande-Bretagne. ([4] [1278])
Avec ces mouvements, la classe ouvrière revenait sur le devant de la scène sociale, menaçant le pouvoir de la bourgeoisie. Elle l'avait déjà fait, victorieusement, en 1917, quand la révolution russe avait obligé les belligérants à mettre prématurément fin à la guerre mondiale, pour faire face, tous unis, au danger prolétarien qui, de la Russie, s'étendait à l'Europe entière.
Comme nous l'avons vu, les grèves en Italie ont accéléré la chute du fascisme ainsi que la sortie de l'Italie de la guerre. Par son action, la classe ouvrière a aussi confirmé dans la seconde guerre mondiale qu'elle était l'unique force sociale capable de s'opposer à la guerre. Contrairement au pacifisme petit-bourgeois, qui manifeste pour « demander » au capitalisme d'être moins belliqueux, la classe ouvrière, quand elle agit sur son propre terrain de classe, met en question le pouvoir même du capitalisme et, par là, la possibilité pour ce dernier de poursuivre ses entreprises guerrières. Potentiellement, les grèves de 1943 renfermaient la même menace qu'en 1917 : la perspective d'un processus révolutionnaire du prolétariat.
Les fractions révolutionnaires de l'époque ont saisi, en la surestimant, cette possibilité et ont tout fait pour la favoriser. En août 1943, à Marseille, la Fraction Italienne de la Gauche communiste (qui publiait avant-guerre la revue Bilan), surmontant les difficultés qu'elle avait connues au début de la guerre, a tenu, avec le Noyau français de la Gauche communiste qui venait de se former, une conférence sur la base de l'analyse selon laquelle les événements en Italie avaient ouvert une phase pré-révolutionnaire. Pour elle, c'était donc le moment de la « transformation de la fraction en parti » et du retour en Italie pour contrecarrer les tentatives des faux partis ouvriers de « bâillonner la conscience révolutionnaire » du prolétariat. Ainsi commençait tout un travail de propagande pour le défaitisme révolutionnaire qui a amené la Fraction à diffuser, en juin 1944, un tract aux ouvriers d'Europe embrigadés dans les différentes armées belligérantes pour qu'ils fraternisent et tournent leur lutte contre le capitalisme, qu'il soit démocratique ou fasciste.
Les camarades qui étaient en Italie se réorganisaient aussi et, sur la base d'une analyse semblable à celle de Bilan, fondaient le Parti communiste internationaliste. Cette organisation commençait elle aussi un travail de défense du défaitisme révolutionnaire, en combattant le patriotisme des formations partisanes et en faisant de la propagande pour la révolution prolétarienne. ([5] [1279])
Cinquante ans après, si nous ne pouvons que nous rappeler avec fierté le travail et l'enthousiasme de ces camarades (dont certains ont perdu la vie pour cela), nous devons cependant reconnaître que l'analyse sur laquelle ils s'appuyaient était erronée.
... mais la guerre n'est pas la situation la plus favorable pour le développement d'un processus révolutionnaire
Les mouvements de lutte que nous avons rappelés, et en particulier ceux de 1943 en Italie, sont la preuve indiscutable du retour du prolétariat sur son terrain de classe et du début d'un processus révolutionnaire potentiel. Cependant, le dénouement n'a pas été le même que pour le mouvement né contre la guerre en 1917 : le mouvement de 1943 en Italie ne réussit pas à mettre fin à la guerre comme celui en Russie, puis en Allemagne, au début du siècle. Pas plus qu'il ne réussit à déboucher sur une issue révolutionnaire qui seule aurait permis la fin de la guerre.
Les causes de cette défaite sont multiples. Certaines sont d'ordre général d'autres spécifiques à la situation dans laquelle se déroulaient ces événements,.
En premier lieu, s'il est vrai que la guerre pousse le prolétariat à agir de façon révolutionnaire, cela est surtout vrai dans les pays vaincus. Le prolétariat des pays vainqueurs reste en général plus soumis idéologiquement à la classe dominante, ce qui va à rencontre de l'indispensable extension mondiale dont a besoin le pouvoir prolétarien pour survivre. De plus, si la lutte arrive à imposer la paix à la bourgeoisie, elle se prive par là même des conditions extraordinaires qui ont fait naître cette lutte. En Allemagne, par exemple, le mouvement révolutionnaire qui a conduit à l'armistice de 1918 a souffert fortement, après celui-ci, de la pression exercée par toute une partie des soldats qui, revenus du front, n'avaient qu'un désir : rentrer dans leur famille, profiter de cette paix tant désirée et conquise à un prix aussi élevé. En réalité, la bourgeoisie allemande avait retenu la leçon de la révolution en Russie où la poursuite de la guerre par le gouvernement provisoire, successeur du régime tsariste après février 1917, avait constitué le meilleur aliment de la montée révolutionnaire dans laquelle les soldats avaient justement joué un rôle de premier plan. C'est pour cela que le gouvernement allemand avait signé l'armistice avec l'Entente dès le 11 novembre 1918, deux jours après le début de mutineries dans la marine de guerre à Kiel.
En deuxième lieu, ces enseignements du passé sont mis à profit par la bourgeoisie dans la période qui précède la seconde guerre mondiale. La classe dominante ne s'est lancée dans la guerre qu'après s'être assurée que le prolétariat était complètement embrigadé. La défaite du mouvement révolutionnaire des années 1920 avait plongé le prolétariat dans un profond désarroi. A la démoralisation s'étaient ajoutées les mystifications sur le « socialisme en un seul pays » et sur la « défense de la patrie socialiste ». Ce désarroi a permis à la bourgeoisie de procéder à une répétition générale de la guerre mondiale avec la guerre d'Espagne. Là, la combativité exceptionnelle du prolétariat espagnol a été dévoyée sur le terrain de la lutte anti-fasciste, alors que le stalinisme réussissait à entraîner également sur ce terrain bourgeois des bataillons importants du reste du prolétariat européen.
Enfin, dans le cours de la guerre elle-même quand, malgré toutes les difficultés qu'il connaissait depuis le début, le prolétariat a commencé à agir sur son terrain de classe, la bourgeoisie a pris immédiatement ses propres mesures.
En Italie, là où le danger était le plus grand, la bourgeoisie, comme nous l'avons vu, s'est empressée de changer de régime et ensuite, d'alliances. A l'automne 1943, l'Italie est divisée en deux, le sud aux mains des Alliés, le reste occupé par les nazis. Sur les conseils de Churchill (« il faut laisser l'Italie mijoter dans son jus »), les Alliés ont retardé leur avance vers le nord, obtenant ainsi un double résultat : d'un côté, on a laissé à l'armée allemande le soin de réprimer le mouvement prolétarien ; de l'autre, on a donné aux forces « antifascistes » la tâche de dévoyer ce même mouvement du terrain de la lutte anticapitaliste vers celui de la lutte antifasciste. Cette opération a réussi au terme de presque une année, et à partir de ce moment, l'activité du prolétariat n'a plus été autonome, même si celui-ci continuait à revendiquer des améliorations immédiates. Par ailleurs, aux yeux des prolétaires, la poursuite de la guerre était due à l'occupation nazie, ce qui faisait la partie belle à la propagande des forces antifascistes.
Que la guerre des partisans ait été une lutte populaire relève en grande partie de l'affabulation. Ce fut une véritable guerre, organisée par les forces alliées et antifascistes dans laquelle la population était enrôlée de force (ou sous la pression idéologique) comme dans n'importe quelle guerre. Cependant, il est vrai que le fait d'avoir laissé aux nazis la tâche de réprimer le mouvement prolétarien et de les avoir rendus responsables de la poursuite de la guerre, a favorisé une haine croissante du fascisme et, par là même, la propagande des forces partisanes.
En Allemagne, forte de son expérience du premier après-guerre, la bourgeoisie mondiale mène une action systématique en vue d'éviter le retour d'événements semblables à ceux de 1918-19. En premier lieu, peu avant la fin de la guerre, les Alliés procèdent à une extermination massive des populations des quartiers ouvriers au moyen de bombardements sans précédent de grandes villes comme Hambourg ou Dresde où, le 13 février 1945, 135 000 personnes (le double d'Hiroshima) périssent sous les bombes. Ces objectifs n'ont aucune valeur militaire (d'ailleurs, les armées allemandes sont déjà en pleine déroute) : il s'agit en réalité de terroriser et d'empêcher toute organisation du prolétariat. En deuxième lieu, les Alliés rejettent toute idée d'armistice tant qu'ils n'ont pas occupé la totalité du territoire allemand : ils tiennent à administrer directement ce territoire, sachant que la bourgeoisie allemande vaincue risque de ne pas être en mesure de contrôler seule la situation. Enfin, après la capitulation de cette dernière, et en étroite collaboration avec elle, les Alliés retiennent pendant de longs mois les prisonniers de guerre allemands afin d'éviter le mélange explosif qu'aurait pu provoquer leur rencontre avec les populations civiles.
En Pologne, au cours de la deuxième moitié de 1944, c'est l'Armée rouge qui laisse aux forces nazies le sale boulot de massacrer les ouvriers insurgés de Varsovie : l'Armée rouge a attendu pendant des mois à quelques kilomètres de la ville que les troupes allemandes étouffent la révolte. La même chose s'est produite à Budapest au début de 1945.
Ainsi dans toute l'Europe, la bourgeoisie, forte de l'expérience de 1917 et alertée par les premières grèves ouvrières, n'a pas attendu que le mouvement grandisse et se renforce : avec l'extermination systématique, avec le travail de détournement des luttes par les forces staliniennes et antifascistes, elle a réussi à bloquer la menace prolétarienne et à l'empêcher de grandir.
Le prolétariat n'a pas réussi à arrêter la deuxième guerre mondiale, pas plus qu'il n'a réussi à développer un mouvement révolutionnaire au cours de celle-ci. Mais, comme pour toutes les batailles du prolétariat, les défaites peuvent être transformées en armes pour les combats de demain, si le prolétariat sait en tirer les leçons. Et ces leçons, il appartient aux révolutionnaires d'être les premiers à les mettre en évidence, à les identifier clairement. Un tel travail suppose notamment, sur base d'une profonde assimilation de l'expérience du mouvement ouvrier, qu'ils ne restent pas prisonniers des schémas du passé, comme cela arrive encore aujourd'hui pour la plupart des groupes du milieu prolétarien tel le PCInt (Battaglia Comunista) et les diverses chapelles de la mouvance bordiguiste.
De façon très résumée, voici les principales leçons qu'il importe de tirer de l'expérience du prolétariat depuis un demi-siècle.
Contrairement à ce que pensaient les révolutionnaires du passé, la guerre généralisée ne crée pas les meilleures conditions pour la révolution prolétarienne. C'est d'autant plus vrai aujourd'hui, alors que les moyens de destruction existants rendent un éventuel conflit mondial tellement dévastateur que cela empêcherait toute réaction prolétarienne, et pourrait même avoir pour conséquence la destruction de l'humanité. S'il est une leçon que les prolétaires doivent tirer de leur expérience passée, c'est que, pour lutter contre la guerre aujourd'hui, ils doivent agir avant celle-ci. Pendant, il sera trop tard.
Aujourd'hui, les conditions pour un nouveau conflit mondial n'existent pas encore. D'un côté, le prolétariat n'est pas embrigadé au point que la bourgeoisie puisse déchaîner un tel conflit, seul aboutissement qu'elle connaisse à sa crise économique. D'autre part si, comme le CCI l'a mis en évidence, l'effondrement du bloc de l'Est a induit une tendance à la formation de deux nouveaux blocs impérialistes, on est encore très loin de la constitution effective de tels blocs et, sans eux, il ne peut y avoir de guerre mondiale.
Cela ne veut pas dire que la tendance à la guerre et que de vraies guerres n'existent pas. La guerre du Golfe en 1991, celle de Yougoslavie aujourd'hui, en passant par tant de conflits répartis dans le monde entier, prouvent bien que l'effondrement du bloc de l'Est n'a pas ouvert une période de « nouvel ordre mondial » mais au contraire une période d'instabilité croissante qui ne pourra mener qu'à un nouveau conflit mondial (à moins que la société ne soit engloutie et détruite avant par sa propre décomposition), si le prolétariat ne prend pas les devants grâce à son action révolutionnaire. La conscience de cette tendance à la guerre est un facteur important pour le renforcement de cette possibilité révolutionnaire.
Aujourd'hui le facteur le plus puissant de prise de conscience de la faillite du capitalisme est la crise économique. Une crise économique catastrophique qui ne peut trouver de solution dans le capitalisme. Ce sont ces deux facteurs qui créent les meilleures conditions pour la croissance révolutionnaire de la lutte prolétarienne. Mais cela ne sera possible que si les révolutionnaires eux-mêmes savent abandonner les vieilles idées du passé et adapter leur intervention aux nouvelles conditions historiques.
Helios
[1] [1280] Sergio Turone, Storia del sindacato in Italia. Editori Laterza, p. 14.
[2] [1281] Déclaration du Sous-secrétaire Tullio Cianetti, citée dans le livre de Turone, p. 17.
[3] [1282] Cité par Romolo Gobbi dans Opérai e Resis-tenza, Mussolini editore. Ce livre, bien qu'il soit empreint des positions conseillisto-apolitiques de l'auteur, montre bien le caractère anticapitaliste et spontané du mouvement de 43 ; comme il montre bien à travers de larges citations tirées des archives du PCI (Parti communiste italien), le caractère nationaliste et patriotique du PCI dans ce mouvement
[4] [1283] Pour d'autres détails sur cette période, voir : Da-nilo Montaldi, Saggio sulla politica comunista in Italia, edizioni Quaderni piacentini.
[5] [1284] Sur l'activité de la gauche communiste pendant la guerre, voir notre livre La gauche communiste d'Italie, 1927-1952.
Géographique:
- Italie [1285]
Evènements historiques:
- Deuxième guerre mondiale [1286]
Courants politiques:
- Bordiguisme [1287]
Le communisme n'est pas un bel idéal mais une nécessite matérielle [7e partie] I
- 4939 reads
L'étude du Capital et des fondements du communisme
1. L'histoire en toile de fond
Dans le précédent article de cette série, ([1] [1288]) nous avons vu que Marx et sa tendance, ayant atteint leurs limites avec la défaite des révolutions de 1848 et l'ouverture d'une nouvelle période de croissance capitaliste, ont mis en oeuvre le projet de mener une recherche théorique approfondie, dans le but de découvrir la dynamique concrète du mode de production capitaliste et, par conséquent, la base concrète pour pouvoir le remplacer par un ordre social communiste.
Dès 1844, Marx dans les Manuscrits économiques et philosophiques, et Engels dans l’Esquisse d'une critique de l'économie politique, avaient commencé à étudier et à critiquer, d'un point de vue prolétarien, les fondements économiques de la société capitaliste ainsi que les théories économiques de la classe capitaliste, généralement connues sous le nom d' « économie politique ». La compréhension du fait que la théorie communiste devait être solidement établie sur le terrain d'une analyse économique de la société bourgeoise, constituait déjà une rupture décisive avec les conceptions utopiques du communisme qui prévalaient jusqu'alors dans le mouvement ouvrier. Cela signifiait, en effet, que la dénonciation des souffrances et de l'aliénation engendrées par le système de production capitaliste ne se réduisait plus à une objection purement morale envers ses injustices. Au contraire, les horreurs du capitalisme étaient analysées comme des expressions inévitables de sa structure économique et sociale, et ne pouvaient donc être supprimées que par la lutte révolutionnaire d'une classe sociale ayant un intérêt matériel à réorganiser la société.
Entre 1844 et 1848, la fraction « marxiste » développa une compréhension plus claire des mécanismes profonds du système capitaliste, une vision historique plus dynamique qui conçoit le capitalisme comme la dernière de la longue série des sociétés divisées en classes, et comme un système dont les contradictions fondamentales l'amèneraient finalement à s'effondrer, posant ainsi la nécessité et la possibilité de la nouvelle société communiste ([2] [1289]). Cependant, la tâche primordiale des révolutionnaires, durant cette phase, était de construire une organisation politique communiste et d'intervenir dans les énormes soulèvements sociaux qui ont secoué l'Europe durant l'année 1848. Bref, la nécessité de mener activement un combat politique était prioritaire par rapport au travail d'élaboration théorique. Au contraire, avec la défaite des révolutions de 1848 et la bataille qui s'ensuivit contre les illusions activistes et immédiatistes qui menèrent à la mort de la Ligue Communiste, il était devenu essentiel de prendre du recul par rapport à l'activité purement immédiate et de développer une vision plus profonde, à plus long terme, de l'avenir de la société capitaliste.
L'économie politique et au-delà
Durant plus d'une décennie, Marx s'est donc à nouveau lancé dans le vaste projet théorique qu'il s'était fixé au début des années 1840. Ce fut la période durant laquelle il travailla de longues heures au British Museum, étudiant non seulement les économistes politiques classiques mais aussi une grande masse d'informations sur le fonctionnement contemporain de la société capitaliste le système de la manufacture, la monnaie, le crédit, le commerce international ; non seulement l'histoire des débuts du capitalisme, mais aussi celle des civilisations et des sociétés pré-capitalistes. L'objectif initial de ces recherches était celui qu'il s'était fixé une décennie auparavant : produire un travail monumental sur « l'Économie » qui ne constituerait lui-même qu'une partie d'un travail plus global traitant, entre autres choses, de questions plus directement politiques et de l'histoire de la pensée socialiste. Mais comme Marx l'écrivait dans une lettre à Wedemeyer, « le travail sur lequel je suis, a tellement de ramifications » que l'échéance finale du travail sur l'Économie était constamment repoussée, d'abord pour des semaines, puis pour des années. En fait, il n'a jamais été achevé : seul le premier volume du Capital a été réellement terminé par Marx. La masse de matériel provenant de cette période a dû soit être complétée par Engels et n'a été publiée qu'après la mort de Marx (les deux volumes suivants du Capital), soit, comme dans le cas des Grundrisse (les Fondements de la Critique de l'Économie Politique, ébauche de brouillon), n'a jamais dépassé le stade de collection de notes élaborées qui n'ont été disponibles à l'Ouest qu'à partir des années 1950, et n'ont été complètement traduites en anglais qu'en 1973.
Toutefois, bien que ce fût une période de grande pauvreté et de souffrances personnelles pour Marx et sa famille, ce fut aussi la période la plus féconde de sa vie pour ce qui est de l'aspect le plus théorique de son travail. Et ce n'est pas par hasard si la plus grande partie de la gigantesque production de ces années fut dédiée à l'étude de l'économie politique, car c'était la clé pour parvenir à une compréhension réellement scientifique de la structure et du mouvement du mode capitaliste de production.
Dans sa forme classique, l'économie politique était une des expressions les plus avancées de la bourgeoisie révolutionnaire.
« Historiquement, elle fit son apparition comme partie intégrante de la nouvelle science de la société civile, créée par la bourgeoisie au cours de sa lutte révolutionnaire pour instaurer cette formation socio-économique nouvelle. L'économie politique fut donc le complément réaliste de la grande commotion philosophique, morale, esthétique, psychologique, juridique et politique, de l'époque dite des "lumières", à l'occasion de laquelle les porte-parole de la classe ascendante exprimèrent pour la première fois la nouvelle conscience bourgeoise, qui correspondait au changement intervenu dans les conditions réelles de l'existence. » ([3] [1290])
Comme telle, l'économie politique a été capable, jusqu'à un certain point, d'analyser le mouvement réel de la société bourgeoise, de la voir comme une totalité plutôt que comme une somme de fragments, et de saisir ses rapports fondamentaux au lieu d'être abusée par les phénomènes superficiels. En particulier, les travaux d'Adam Smith et de David Ricardo sont presque arrivés à dévoiler le secret résidant au coeur même du système : l'origine et la signification de la valeur, la valeur des marchandises. Champions de la défense des « classes productives » contre la noblesse oisive et toujours plus parasitaire, ces économistes de l'école anglaise ont été capables de voir que la valeur de la marchandise est essentiellement déterminée par la quantité de travail humain que celle-ci contient. Mais, encore une fois, seulement jusqu'à un certain point. Puisqu'elle exprimait le point de vue de la nouvelle classe exploiteuse, inévitablement l'économie politique bourgeoise devait mystifier la réalité pour dissimuler la nature exploiteuse du nouveau mode de production. Et cette tendance à justifier le nouvel ordre devenait plus évidente, au fur et à mesure que la société bourgeoise révélait ses contradictions internes, avant tout la contradiction sociale entre Capital et travail, mais aussi les contradictions économiques qui plongeaient périodiquement le système dans la crise. Déjà, durant les années 1820 et 1830, la lutte de classe des ouvriers et la crise de surproduction avaient fait une apparition manifeste sur la scène historique. Entre Adam Smith et Ricardo, il y a déjà une « réduction de la vision théorique et les débuts d'une sclérose formelle » ([4] [1291]), car ce dernier manifeste moins d'intérêt à examiner le système comme une totalité. Mais les « théoriciens » économistes de la bourgeoisie qui leur succèdent, sont de moins en moins capables de contribuer utilement à la compréhension de leur propre économie. Comme dans tous les aspects de la pensée bourgeoise, ce processus de dégénérescence atteint son apogée dans la période de décadence du capitalisme. Pour la plupart des écoles d'économistes aujourd'hui, l'idée que le travail humain a quelque chose à voir avec la valeur, est rejetée comme un anachronisme ridicule. Cependant, il va sans dire que ces mêmes économistes sont complètement déconcertés par l'effondrement toujours plus évident de l'économie mondiale moderne.
Marx adopta la même approche pour l'économie politique classique que celle qu'il avait utilisée pour la philosophie de Hegel : en l'abordant du point de vue prolétarien et révolutionnaire, il fut capable d'assimiler ses contributions les plus importantes tout en dépassant ses limites. Ainsi, il démontra que :
- Bien que ce fait primordial soit dissimulé dans le procès de production capitaliste, contrairement aux sociétés de classes antérieures, le capitalisme est néanmoins un système d'exploitation de classe et ne peut être rien d'autre. Ce fut le message essentiel de sa conception de la plus-value.
- Malgré son incroyable caractère expansif, la dynamique de soumission de la planète entière à ses lois, le capitalisme n'est qu'un mode de production historiquement transitoire comme l'esclavagisme romain ou le féodalisme médiéval. Une société basée sur la production universelle de marchandises est inévitablement condamnée, par la logique de son fonctionnement interne, au déclin et à l'effondrement ultime.
- Le communisme est donc une possibilité matérielle ouverte par le développement sans précédent des forces productives par le capitalisme lui-même. Il est aussi une nécessité, si l'humanité veut échapper aux conséquences dévastatrices des contradictions économiques du capitalisme.
Mais si l'étude des lois du Capital, parfois dans les détails les plus étonnants, se trouve au coeur du travail de Marx durant cette période, il ne se limita pas à cela. Marx avait hérité d'Hegel la compréhension que le particulier et le concret, dans ce cas, le capitalisme, ne pouvaient être compris que dans leur totalité historique, c'est-à-dire, avec la vaste toile de fond de toutes les formes de sociétés humaines depuis les premiers jours de l'espèce. Dans les Manuscrits de 1844, Marx a dit que le communisme était la « solution à l'énigme de l'histoire ». Le communisme est l'héritier immédiat du capitalisme ; mais tout comme l'enfant est également le produit de toutes les générations qui l'ont précédé, on peut dire que « le mouvement entier de l'histoire est l'acte de genèse » de la société communiste. C'est pourquoi une bonne partie des écrits de Marx sur le Capital contient aussi de longues digressions sur des questions « anthropologiques », basées sur les caractéristiques de l'homme en général, et sur les modes de production qui ont précédé la société bourgeoise. C'est particulièrement vrai des Grundrisse. D'un côté, ils sont une « ébauche de brouillon » du Capital ; de l'autre ils sont un prologue à une investigation de plus grande ampleur dans laquelle Marx traite dans les détails non seulement de la critique de l'économie politique comme telle, mais aussi de quelques questions anthropologiques ou «philosophiques» soulevées dans les Manuscrits de 1844, plus particulièrement le rapport entre l'homme et la nature, et le problème de l'aliénation. Ils contiennent aussi la présentation la plus élaborée par Marx des différents modes de production pré-capitalistes. Mais toutes ces questions sont aussi traitées dans Le Capital, particulièrement dans le premier volume, même si c'est sous une forme plus réduite et plus concentrée.
Donc, avant d'aborder l'analyse par Marx de la société capitaliste en particulier, nous allons essayer de voir les thèmes plus historiques et généraux qu'il traite dans les Grundrisse et dans Le Capital, car ils n'en sont pas moins essentiels dans la compréhension de Marx de la perspective et de la physionomie du communisme.
L'homme, la nature et l'aliénation
Nous avons déjà mentionné ([5] [1292]) qu'il existe une école de pensée, incluant parfois de véritables disciples de Marx, selon laquelle le travail de ce dernier arrivé à maturité démontrerait sa perte d'intérêt, ou serait même un reniement, de certains axes de l'investigation qu'il avait menée dans ses travaux de jeunesse, particulièrement dans les Manuscrits de 1844 : la question de l'« être générique » de l'homme, le rapport entre l'homme et la nature, et le problème de l'aliénation. L'argument consiste en ceci que de telles conceptions sont liées à une vision « Feuerbachienne », humaniste, et même utopique du communisme que Marx avait, avant qu'il ne développe définitivement la théorie du matérialisme historique. Bien que nous ne niions pas qu'il y ait certaines influences philosophiques dans sa période parisienne, nous avons déjà défendu ([6] [1293]) que l'adhésion de Marx au mouvement communiste était conditionnée par l'adoption d'une position qui l'amenait au-delà des Utopistes, à un point de vue prolétarien et matérialiste. Le concept de l'homme, de son « être générique » dans les Manuscrits n'est pas assimilable à celui de « l'essence humaine » de Feuerbach, critiqué dans les Thèses sur Feuerbach. Ce n'est pas une religion abstraite, individualisée de l'humanité, mais déjà une conception de l'homme social, de l'homme comme être qui se crée lui-même par le travail collectif Et quand nous nous tournons vers les Grundrisse et Le Capital, nous constatons que cette définition est approfondie et clarifiée, plutôt que rejetée. Certainement, dans les Thèses sur Feuerbach, Marx rejette catégoriquement toute idée d'une essence humaine statique. Et il insiste : « l'essence de l'homme n'est pas une abstraction inhérente à l'individu isolé. Dans sa réalité, elle est l'ensemble des rapports sociaux. » Mais cela ne signifie pas que l'homme « comme tel » soit une non réalité ou une page vide qui serait entièrement et absolument modelée par chaque forme particulière de l'organisation sociale. Une telle vue rendrait impossible pour le matérialisme historique l'approche de l'histoire humaine comme une totalité : on se retrouverait avec une série fragmentée de photos de chaque type de société, sans que rien ne les relie dans une vision globale. L'approche de cette question, dans les Grundrisse et dans Le Capital, est très loin de ce réductionnisme sociologique ; au lieu de cela, elle est fondée sur une vision de l'homme en tant qu'espèce dont l'unique caractéristique est sa capacité à se transformer lui-même et son environnement, au travers du procès du travail et au travers de l'histoire.
La question « anthropologique », la question de l'homme générique, de ce qui distingue l'homme des autres espèces animales, est traitée dans le premier volume du Capital. Il commence par une définition du travail car c'est par le travail que l'homme se produit lui-même. Le procès du travail est : « la condition générale des échanges matériels entre l'homme et la nature, une nécessité physique de la vie humaine, indépendante par cela même de toutes ses formes sociales, ou plutôt également commune à toutes » (...) « Le travail est de prime abord un acte qui se passe entre l'homme et la nature. L'homme y joue lui-même vis-à-vis de la nature le rôle d'une puissance naturelle. Les forces dont son corps est doué, bras et jambes, têtes et mains, il les met en mouvement, afin de s'assimiler des matières en leur donnant une forme utile à sa vie. En même temps qu'il agit par ce mouvement sur la nature et la modifie, il modifie sa propre nature, et développe les facultés qui y sommeillent. Nous ne nous arrêterons pas à cet état primordial du travail où il n'a pas encore dépouillé son mode purement instinctif Notre point de départ c'est le travail sous une forme qui appartient exclusivement à l'homme. Une araignée fait des opérations qui ressemblent à celles du tisserand, et l'abeille confond par la structure de ses cellules de cire l'habileté de plus d'un architecte. Mais ce qui distingue dès l'abord le plus mauvais architecte de l'abeille la plus experte, c'est qu'il a construit la cellule dans sa tête avant de la construire dans la ruche. » ([7] [1294]).
Dans les Grundrisse, le caractère social de cette forme d'activité « exclusivement humaine » est aussi souligné : « Que ce besoin de l'un puisse être satisfait par le produit de l'autre et vice versa, que l'un soit capable de produire l'objet du besoin de l'autre et que chacun se présente à l'autre comme le propriétaire de l'objet de son besoin, cela prouve que chacun dépasse, en tant qu'homme, son propre besoin particulier, etc., et qu'ils se comportent l'un par rapport à l'autre comme des hommes ; qu'ils sont tous conscients de leur communauté d'espèce. Il n'arrive d'ailleurs pas que des éléphants produisent pour des tigres, ou des animaux pour d'autres animaux. » ([8] [1295]) Ces définitions de l'homme comme animal qui seul possède une conscience de lui-même et une activité vitale capable de se fixer des objectifs, qui produit universellement plutôt qu'unilatéralement, sont remarquablement similaires aux formulations contenues dans les Manuscrits. ([9] [1296])
De nouveau, comme dans les Manuscrits, ces définitions supposent que l'homme fait partie de la nature : dans le passage précédent du Capital il est dit : l'homme est « une des propres forces de la nature », et dans les Grundrisse est utilisée exactement la même terminologie que dans le texte de Paris : la nature est le « corps réel » de l'homme ([10] [1297]). C'est surtout au niveau d'une compréhension plus profonde de l'évolution historique des relations entre l'homme et le reste de la nature que les derniers ouvrages représentent une avancée par rapport aux Manuscrits.
« Ce n'est pas l'unité des hommes vivants et actifs avec les conditions naturelles, inorganiques de leur échange de substance avec la nature ni, par conséquent, leur appropriation de la nature, qui demande à être expliquée ou qui est le résultat d'un procès historique, mais la séparation entre ces conditions inorganiques de l'existence humaine et cette existence active, séparation qui n'a été posée comme séparation totale que dans le rapport du travail salarié et du Capital. » ([11] [1298])
Ce processus de séparation entre l'homme et la nature est vu par Marx d'une manière profondément dialectique.
D'un côté, c'est le réveil des « pouvoirs endormis » de l'homme, le pouvoir de se transformer lui-même et le monde autour de lui. C'est une caractéristique générale du procès de travail : l'histoire comme développement graduel, quoique irrégulier, des capacités productives de l'humanité. Mais ce développement a toujours été freiné par les formations sociales qui ont précédé le Capital, dans lesquelles les limites de l'économie naturelle maintenaient aussi l'homme dans les limites des cycles de la nature. Le capitalisme, au contraire, crée de nouvelles possibilités pour dépasser cette subordination.
« D'où la grande influence civilisatrice du Capital. Le fait qu'il produise un niveau de société par rapport auquel tous les autres niveaux antérieurs n'apparaissent que comme des développements locaux de l'humanité et comme une idolâtrie naturelle. C'est seulement avec lui que la nature devient un pur objet pour l'homme, une pure affaire d'utilité ; qu'elle cesse d'être reconnue comme une puissance pour soi ; et même la connaissance théorique de ses lois autonomes n'apparaît elle-même que comme une ruse visant à la soumettre aux besoins humains, soit comme objet de consommation, soit comme moyen de production. Le Capital, selon cette tendance, entraîne aussi bien au-delà des barrières et des préjugés nationaux que de la divinisation de la nature et de la satisfaction traditionnelle des besoins, modestement circonscrite à l'intérieur de limites déterminées et de la reproduction de l'ancien mode de vie. Il détruit et révolutionne constamment tout cela, renversant tous les obstacles qui freinent le développement des forces productives, l'extension des besoins, la diversité de la production et l'exploitation et l'échange des forces naturelles et intellectuelles. » ([12] [1299])
D'un autre côté, la conquête de la nature par le Capital, sa réduction de la nature à un simple objet, a les conséquences les plus contradictoires. Comme poursuit le passage.
« Mais, si le Capital pose chaque limite de ce type comme un obstacle qu'il surmonte ainsi de manière idéale, il ne le surmonte pas réellement pour autant ; et, comme chacun de ces obstacles est en contradiction avec sa détermination et sa destination, sa production se meut dans des contradictions qui sont constamment surmontées, mais tout aussi constamment posées. Il y a plus. L'universalité à laquelle le Capital aspire irrésistiblement se heurte à des obstacles qu'il rencontre dans sa nature propre et qui le font reconnaître lui-même à une certaine phase de son développement comme obstacle majeur à cette même tendance à l'universalité, le poussant donc à sa propre abolition. » (Ibid.).
Après avoir vécu 80 ans de décadence capitaliste, dans une époque où le Capital est définitivement devenu la plus grande barrière à sa propre expansion, nous pouvons apprécier là, la complète validité du pronostic de Marx. Plus grand est le développement des forces productives du capitalisme, plus universel son règne sur la planète, et plus grandes et destructives sont les crises et les catastrophes qu'il entraîne dans son sillage : non seulement par les crises directement économiques, sociales et politiques, mais aussi par les crises « écologiques » qui signifient la menace d'une rupture complète de « l'échange métabolique de l'homme avec la nature ».
Nous pouvons voir clairement que, contrairement aux prétendus critiques radicaux du marxisme, la reconnaissance par Marx de « l'influence civilisatrice » du Capital, n'a jamais été une apologie du Capital. Le processus historique, dans lequel l'homme s'est séparé lui-même du reste de la nature, est aussi la chronique du processus qui rend l'homme étranger à lui-même, un mouvement qui a atteint son apogée, ou son abîme, dans la société bourgeoise, dans le rapport du travail salarié que les Grundrisse définissent comme « la forme extrême de l'aliénation ». ([13] [1300]) C'est cela qui peut effectivement souvent faire croire que le « progrès » capitaliste, qui subordonne impitoyablement tous les besoins humains à l'expansion incessante de la production, est plutôt une régression par rapport aux époques précédentes.
« C'est ainsi que l'opinion ancienne selon laquelle l'homme apparaît toujours comme la finalité de la production, quel que soit le caractère borné de ses déterminations nationales, religieuses, politiques, semble d'une grande élévation en regard du monde moderne, où c'est la production qui apparaît comme la finalité de l'homme, et la richesse comme finalité de la production. (...) Dans l'économie bourgeoise - et à l'époque de production à laquelle elle correspond - cette complète élaboration de l'intériorité humaine apparaît au contraire comme un complet évidage, cette objectivation universelle, comme totale aliénation, et le renversement de toutes les fins déterminées et unilatérales, comme le sacrifice de la fin en soi à une fin tout à fait extérieure. » ([14] [1301]).
Mais ce triomphe final de l'aliénation signifie aussi l'avènement des conditions pour la pleine réalisation des pouvoirs créatifs de l'humanité, libérés à la fois de l'inhumanité du Capital et des limites restrictives des rapports sociaux pré-capitalistes.
« Mais, en fait, une fois que la forme bourgeoise bornée a disparu, qu'est-ce que la richesse, sinon l'universalité des besoins, des capacités, des jouissances, des forces productives des individus, universalité engendrée dans l'échange universel ? Sinon le plein développement de la domination humaine sur les forces de la nature, tant sur celles de ce qu'on appelle la nature que sur celles de sa propre nature ? Sinon l'élaboration absolue de ses aptitudes créatrices, sans autre présupposé que le développement historique antérieur qui fait une fin en soi de cette totalité du développement, du développement de toutes les forces humaines en tant que telles, sans qu'elles soient mesurées à une échelle préalablement fixée ? Sinon un état de choses où l'homme ne se reproduit pas selon une déterminité particulière, mais où il produit sa totalité, où il ne cherche pas à rester quelques chose ayant son devenir derrière soi, mais où il est pris dans le mouvement absolu du devenir ? »
La vision dialectique de l'histoire reste une énigme et un scandale pour tous les défenseurs du point de vue bourgeois, qui est à jamais bloqué par un dilemme « ou bien - ou bien » entre l'apologie générale du « progrès » et la nostalgie d'un passé idéalisé.
« A des stades antérieurs de développement, l'individu singulier apparaît plus complet, parce qu'il n'a justement pas encore élaboré la plénitude de ses relations et n'a pas encore fait face à celles-ci en tant que pouvoirs et rapports sociaux indépendants de lui. Il est aussi ridicule d'avoir la nostalgie de cette plénitude originelle que de croire qu'il faille en rester à cette vacuité. Le point de vue bourgeois n'a jamais dépassé l'opposition à cette vue romantique, et c'est pourquoi c'est cette dernière qui constitue légitimement le contraire des vues bourgeoises et les accompagnera jusqu'à leur dernier souffle ». ([15] [1302])
Dans tous ces passages, nous pouvons voir que ce qui s'applique à la problématique de « l'homme générique » et son rapport à la nature, s'applique aussi au concept d'aliénation : loin d'abandonner les concepts de base formulés dans ses travaux de jeunesse, le Marx mûr les enrichit en les situant dans toute leur dynamique historique. Et dans la seconde partie de cet article, nous verrons comment, dans les descriptions de la société future contenues ici et là tout au long des Grundrisse et du Capital, Marx considère encore que le dépassement de l'aliénation et la conquête d'une activité vitale réellement humaine reste au cœur de tout le projet communiste.
De la vieille communauté à la nouvelle
Le « déclin » contradictoire de l'individu apparemment plus développé des premiers temps jusqu'à l'ego séparé de la société bourgeoise, exprime une autre facette de la dialectique historique de Marx : la dissolution des formes communales primordiales par l'évolution des rapports marchands. C'est un sujet qui parcourt tout les Grundrisse, mais qui est aussi résumé dans le Capital. Il s'agit d'un élément crucial dans la réponse de Marx à la vision du genre humain contenue dans l'économie politique bourgeoise, et donc dans son esquisse de la perspective communiste.
En effet, une des critiques que fait constamment Marx à l'économie politique bourgeoise dans les Grundrisse, est la manière avec laquelle « elle s'identifie mythologiquement avec le passé », présentant ses propres catégories particulières comme des absolus de l'existence humaine. C'est ce qui est appelé parfois la vision de l'histoire à la Robinson Crusoé : l'individu isolé, et non l'homme social, comme point de départ ; la propriété privée comme la forme originelle et essentielle de la propriété ; le commerce, plutôt que le travail collectif, comme clé de la compréhension de la création de la richesse. Ainsi, dès la première page des Grundrisse, Marx ouvre le feu contre de telles « Robinsonnades », et souligne : « plus on remonte dans le cours de l'histoire, plus l'individu, et par suite l'individu producteur lui aussi, apparaît dans un état de dépendance, membre d'un ensemble plus grand : cet état se manifeste d'abord de façon tout à fait naturelle dans la famille, et dans la famille élargie à la tribu ; puis dans les différentes formes de la communauté issue de l'opposition et de la fusion des tribus. Ce n'est qu'au 18e siècle, dans la "société civile-bourgeoise", que les différentes formes de l'interdépendance sociale se présentent à l'individu comme un simple moyen de réaliser ses buts particuliers, comme un nécessité extérieure. » ([16] [1303])
Ainsi, l'individu isolé est avant tout un produit historique, et en particulier un produit du mode bourgeois de production. Les formes communautaires de propriété et de production n'étaient pas seulement les formes sociales originelles dans les époques primitives ; elles persistent aussi dans tous les modes de production basés sur la division des classes qui ont succédé à la dissolution de la société primitive sans classe. Ceci est plus clair dans le mode « asiatique » de production dans lequel l'appareil de l'Etat central s'approprie le surplus des communes villageoises qui continuaient de vivre, en grande partie, suivant les traditions immémoriales de la vie tribale, un fait que Marx considérait comme « la clef de l'immutabilité des sociétés asiatiques, immutabilité qui contraste d'une manière si étrange avec la dissolution et la reconstruction incessantes des Etats asiatiques, les changements violents de leurs dynasties. » ([17] [1304])
Dans les Grundrisse, Marx insiste sur comment la forme asiatique « se maintient le plus longuement et le plus opiniâtrement » ([18] [1305]), un point repris par Rosa Luxemburg dans L'accumulation du Capital où elle montre la difficulté pour le Capital et les rapports marchands d'arracher les unités de base de ces sociétés à la sécurité de leurs rapports communautaires.
Dans les sociétés esclavagistes et féodales, les anciennes communautés sont davantage émiettées par le développement des rapports marchands et de la propriété privée, un fait important pour comprendre pourquoi l'esclavagisme et le féodalisme contenaient, au sein de leur propre dynamique, des éléments permettant l'émergence du capitalisme, alors que celui-ci dut être imposé « de l'extérieur » à la société asiatique. Néanmoins, des vestiges importants de la forme communautaire peuvent être trouvés à l'origine de ces formations par exemple, la cité romaine surgit comme communauté de groupes de parents ; le féodalisme ne surgit pas seulement de l'effondrement de la société esclavagiste romaine, mais aussi des caractéristiques spécifiques de la communauté tribale « germanique » ; et la tradition des terres communautaires a été maintenue par les classes paysannes, très souvent comme question motivant leurs révoltes et leurs insurrections, tout au long de la période médiévale. La caractéristique principale de toutes ces formes sociales est qu'elles étaient dominées par l'économie naturelle : la production de valeur d'usage avait le dessus sur la production de valeur d'échange. Et c'est justement le développement de cette dernière qui est l'agent dissolvant de la vieille communauté.
« L'avidité d'argent ou frénésie d'enrichissement signifie nécessairement le déclin des anciennes communautés. D'où l'opposition que l'argent suscite. L'argent lui-même est la communauté et ne peut en tolérer aucune autre qui lui soit supérieure. Mais cela présuppose le complet développement des valeurs d'échange et donc d'une organisation de la société qui corresponde à ce développement. » ([19] [1306]).
Dans toutes les sociétés antérieures, « la valeur d'échange n'était pas le nexus rerum » mais existait dans des « interstices » ; ce n'est que dans la société capitaliste que la valeur d'échange se saisit finalement du coeur même du procès de production, que l'ancienne Gemeinwesen est finalement détruite complètement, au point que la vie communautaire est peinte comme l'exact opposé de la nature humaine ! Il est facile de voir comment cette analyse reprend et renforce la théorie de Marx sur l'aliénation.
L'importance de cette question de la communauté originelle dans l'oeuvre de Marx, se reflète dans le temps que les fondateurs du matérialisme historique lui ont consacrée. Elle apparaît déjà dans L'Idéologie Allemande dans les années 1840 ; Engels, s'appuyant sur les études ethnographiques de Morgan, abordent la même question dans les années 1870, dans L'Origine de la famille, de la propriété privée et de l'État. A la fin de sa vie, Marx approfondissait de nouveau cette même question. Les peu connus Cahiers ethnographiques proviennent de cette période. C'est un aspect essentiel de la réponse marxiste aux hypothèses de l'économie politique sur la nature humaine. Loin de constituer des traits essentiels et invariables de l'existence humaine, il y est démontré que les catégories telles que la propriété privée et la valeur d'échange, ne sont que des expressions transitoires d'époques historiques particulières. Et alors que la bourgeoisie essaye de présenter la cupidité pour la richesse en monnaie comme quelque chose d'inné dans les fondements de l'être de l'homme, les recherches historiques de Marx ont découvert le caractère essentiellement social de l'espèce humaine.
Toutes ces découvertes sont de puissants arguments en faveur de la possibilité du communisme.
L'approche de Marx sur cette question ne glisse jamais dans une nostalgie romantique du passé. La même dialectique est appliquée ici comme dans la question du rapport de l'homme avec la nature, puisque les deux questions n'en sont réellement qu'une : l'individu est intégré dans la tribu comme la tribu est intégrée dans la nature. Ces organismes sociaux « ont pour base l'immaturité de l'homme individuel - dont l'histoire n'a pas encore coupé, pour ainsi dire, le cordon ombilical qui l'unit à la communauté naturelle d'une tribu primitive - ou des conditions de despotisme et d'esclavage. Le degré inférieur de développement des forces productives du travail qui les caractérise, et qui par suite imprègne tout le cercle de la vie matérielle, l'étroitesse des rapports des hommes, soit entre eux, soit avec la nature, se reflète idéalement dans les vieilles religions nationales. » ([20] [1307])
La société capitaliste, avec sa masse d'individus atomisés, séparés et aliénés les uns aux autres par la domination de la marchandise, est donc l'exact opposé du communisme primitif, le résultat d'un processus historique long et contradictoire menant de l'un à l'autre. Mais cette rupture du cordon ombilical qui liait l'homme à la tribu et à la nature, est une nécessité douloureuse pour que l'humanité finisse par vivre dans une société qui soit à la fois vraiment communautaire et vraiment individuelle, une société où le conflit entre le social et les besoins de l'individu doit être dépassé.
L'ascendance et la décadence des formations sociales
L'étude des formations sociales précédentes n'est rendue possible que par l'émergence du capitalisme.
« La société bourgeoise est l'organisation historique de la production la plus développée et la plus variée qui soit. De ce fait, les catégories qui expriment les rapports de cette société, la compréhension de son articulation, permettent en même temps de se rendre compte de l'articulation et des rapports de production de toutes les formes de société disparues avec les débris et les éléments desquelles elle s'est édifiée, dont certains vestiges non encore dépassés pour une part subsistent en elle. » ([21] [1308]). En même temps, cette compréhension des formations sociales devient, dans les mains du prolétariat, une arme contre le Capital. Comme Marx l'écrit dans Le Capital, « Les catégories de l'économie bourgeoise sont des formes de l'intellect qui ont une vérité objective, en tant qu'elles reflètent des rapports sociaux réels, mais ces rapports n'appartiennent qu'à cette époque historique déterminée, où la production marchande est le mode de production social. Si donc nous envisageons d'autres formes de production, nous verrons disparaître aussitôt tout ce mysticisme qui obscurcit les produits du travail dans la période actuelle. » ([22] [1309]). En résumé, le capitalisme n'est qu'un des éléments de la série de formations sociales qui se sont développées et ont décliné, du fait de contradictions économiques et sociales que l'analyse permet de discerner. Vu dans ce cadre historique, le capitalisme, la société de la production universelle de marchandises, n'est pas le produit de la nature mais « un mode de production défini, historiquement déterminé », destiné à disparaître tout autant que l'esclavagisme romain ou le féodalisme médiéval.
La présentation la plus succincte et la plus connue de cette vision globale de l'histoire apparaît dans l'Avant-propos de la Contribution à la critique de l'économie politique, publiée en 1858. Ce court texte n'est pas seulement un résumé des travaux contenus dans les Grundrisse, mais aussi des fondements de toute la théorie du matérialisme historique de Marx. Le passage commence par les prémisses de base de cette théorie.
« Dans la production sociale de leur existence, les hommes entrent en des rapports déterminés, nécessaires, indépendants de leur volonté, rapports de production qui correspondent à un degré de développement déterminé de leurs forces productives matérielles. L'ensemble de ces rapports de production constitue la structure économique de la société, la base concrète sur laquelle s'élève une superstructure juridique et politique et à laquelle correspondent des formes de conscience sociale déterminées. Le mode de production de la vie matérielle conditionne le processus de vie social, politique et intellectuel en général. Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être ; c'est inversement leur être social qui détermine leur conscience. » ([23] [1310])
Il s'agit là d'un des plus remarquables résumés de la conception matérialiste de l'histoire : le mouvement de l'histoire ne peut pas être compris, comme il l'avait été jusqu'alors, au travers des idées que les hommes se font d'eux-mêmes, mais en étudiant ce qui sous-tend ces idées, les processus et les rapports sociaux au travers desquels les hommes produisent et reproduisent leur vie matérielle. Ayant résumé ce point essentiel, Marx continue alors :
« A un certain stade de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en contradiction avec les rapports de production existants, ou, ce qui n'en est que l'expression juridique, avec les rapports de propriété au sein desquels elles s'étaient mues jusqu'alors. De formes de développement des forces productives qu'ils étaient ces rapports en deviennent des entraves. Alors s'ouvre une époque de révolution sociale. Le changement dans la base économique bouleverse plus ou moins rapidement toute l'énorme superstructure. »
C'est donc un axiome de base du matérialisme historique que les formations économiques (dans le même texte Marx mentionne « les modes de production asiatique, antique, féodal et bourgeois » comme « des époques progressives de l'ordre socio-économique ») passent nécessairement par des périodes d'ascendance, quand les rapports sociaux sont « des formes de développement », et par des périodes de déclin, ou de décadence, « l'ère de la révolution sociale », quand ces mêmes rapports se transforment en « entraves ». Ré exposer ce point ici peut sembler banal, mais il est nécessaire de le faire car il y a beaucoup d'éléments, dans le mouvement révolutionnaire, qui se réclament de la méthode du matérialisme historique et argumentent encore de manière véhémente contre la notion de décadence capitaliste telle qu'elle est défendue par le CCI et d'autres organisations prolétariennes: De telles attitudes peuvent se retrouver à la fois parmi les groupes bordiguistes et les héritiers de la tradition conseilliste. Les bordiguistes, en particulier, peuvent concéder que le capitalisme passe par des crises d'une magnitude et d'une destruction croissantes, mais ils rejettent notre insistance sur l'entrée définitive du capitalisme dans sa propre époque de révolutions sociales depuis 1914. Il s'agit là pour eux d'une innovation non-prévue par « l'invariance » du marxisme.
Jusqu'à un certain point, ces arguments contre la décadence sont des arguties sémantiques. En général, Marx n'a pas utilisé la formulation « décadence du capitalisme », car il ne considérait pas que cette période avait déjà commencé. Il est vrai que, durant sa vie politique, il est arrivé qu'Engels et lui aient succombé à un optimisme excessif sur la possibilité imminente de la révolution : ce fut particulièrement vrai en 1848 ([24] [1311]). Et, même après avoir révisé leur pronostic, après la défaite des révolutions de 1848, les fondateurs du marxisme n'ont jamais vraiment abandonné l'espoir de voir poindre la nouvelle ère de leur vivant. Mais leur pratique politique tout au long de leur vie, s'est basée fondamentalement sur la reconnaissance que la classe ouvrière continuait à développer ses forces, son identité, son programme politique au sein d'une société bourgeoise qui n'avait pas encore rempli sa mission historique.
Néanmoins, Marx parle bien des périodes de déclin, de dépérissement ou de dissolution des modes de production qui ont précédé le capitalisme, particulièrement dans les Grundrisse ([25] [1312]). Et il n'y a rien dans son oeuvre qui suggère que le capitalisme serait fondamentalement différent, ce qui lui éviterait d'une façon ou d'une autre sa propre période de déclin. Au contraire, les révolutionnaires de la gauche de la Seconde Internationale se basaient entièrement sur la méthode et les prévisions de Marx quand ils proclamaient que la première guerre mondiale avait finalement et incontestablement ouvert « une nouvelle époque, (..) époque de désagrégation du capitalisme, de son effondrement intérieur » comme l'affirma le premier congrès de l'Internationale Communiste en 1919. Comme nous le défendons dans notre introduction à notre brochure La décadence du capitalisme, tous les groupes de la gauche communiste qui ont adopté la notion de décadence du capitalisme, du KAPD à Bilan et Internationalisme, ont simplement continué cette tradition « classique ». Comme marxistes conséquents, ils ne pouvaient pas faire plus, ni moins : le matérialisme historique leur imposait de se prononcer sur la question de savoir à quel moment le capitalisme était devenu une entrave au développement des forces productives de l'humanité. L'engloutissement du travail accumulé par des générations, dans l'holocauste de la guerre impérialiste, a tranché cette question une fois pour toutes.
Certains des arguments contre le concept de décadence vont un peu au-delà de la sémantique. Ils peuvent même se baser sur un autre passage de l'Avant propos dans lequel Marx dit qu' « a une formation sociale ne disparaît jamais avant que soient développées toutes les forces productives qu'elle est assez large pour contenir, jamais des rapports de production nouveaux et supérieurs ne s’y substituent avant que les conditions d'existence matérielles de ces rapports soient écloses dans le sein même de la vieille société ». Selon les anti-décadentistes (en particulier dans les années 1960 et 1970, quand l'incapacité totale du capitalisme à développer le soi-disant tiers-monde, n'était pas aussi claire qu'aujourd'hui), on ne pouvait pas dire que le capitalisme était décadent tant qu'il n'avait pas développé ses capacités jusqu'à la dernière goutte de sueur des ouvriers, et qu'il existait encore des zones du monde avec des perspectives de croissance. D'où les « capitalismes juvéniles » des bordiguistes et les nombreuses « révolutions bourgeoises » imminentes des conseillistes.
Du fait que les pays du « tiers-monde » se présentent aujourd'hui sous les traits de la guerre, de la famine, de la maladie et des désastres, de telles théories sont maintenant en grande partie un souvenir embarrassant. Mais derrière, il y a une incompréhension de base, une erreur de méthode. Dire qu'une société est en déclin ne veut pas dire que les forces productives ont simplement cessé de croître, qu'elles ont fini par s'arrêter complètement. Et Marx ne voulait certainement pas dire qu'un système social ne peut laisser la place à un autre que lorsque toute possibilité de développement a été épuisée. Comme nous pouvons le voir dans le passage suivant des Grundrisse, il montre que même en déclin, le mouvement d'une société ne s'arrête pas.
« D'un point de vue idéal, la dissolution d'une forme de conscience donnée suffirait à tuer une époque entière. D'un point de vue réel, cette limite de la conscience correspond à un degré déterminé de développement des forces productives matérielles et donc de la richesse. A vrai dire, le développement ne s'est pas produit sur l'ancienne base, mais il y a eu développement de cette base elle-même. Le développement maximum de cette base elle-même (la floraison en laquelle elle se transforme ; mais c'est toujours cette base, cette même plante en tant que floraison ; c'est pourquoi elle fane après la floraison, et à la suite de la floraison) est le point où elle a elle-même été élaborée jusqu'à prendre la forme dans laquelle elle est compatible avec le développement maximum des forces productives, et donc aussi avec le développement le plus riche des individus. Dès que ce point est atteint, la suite du développement apparaît comme un déclin, et le nouveau développement commence sur une nouvelle base. » ([26] [1313])
Les termes sont compliqués, lourds : c'est souvent le problème en lisant les Grundrisse. Mais la conclusion semble suffisamment limpide : le dépérissement d'une société n'est pas la fin de toute évolution. La décadence est un mouvement, mais il se caractérise par un glissement vers la catastrophe et l'autodestruction. Peut-on sérieusement douter que la société capitaliste du 20e siècle, qui consacre plus de forces productives à la guerre et à la destruction que n'importe quelle formation sociale antérieure, et dont la reproduction continue est une menace pour la perpétuation de la vie sur la terre, n'ait atteint ce stade où son « développement apparaît comme dépérissement » ?
Dans la seconde partie de cet article, nous verrons de plus près comment le Marx «mûr » a analysé les rapports sociaux capitalistes, les contradictions inhérentes qu'ils contiennent, et la solution à ces contradictions : la société communiste.
CDW
[1] [1314] Voir la Revue Internationale n° 73.
[2] [1315] Voir la Revue Internationale n° 72.
[3] [1316] Karl Marx, K. Korsch, Ed. Champ libre, p. 103.
[4] [1317] Ibid.
[5] [1318] Voir la Revue Internationale n° 70
[6] [1319] Voir la Revue Internationale n° 69.
[7] [1320] K. Marx, Le Capital, 3e section, chap. VII.
[8] [1321] K. Marx, Grundrisse, « Le chapitre du Capital », p.183, Editions Sociales.
[9] [1322] Comparons les passages suivants avec ceux cités plus haut : « L'animal s'identifie directement avec son activité vitale. Il ne se distingue pas d'elle. Il est cette activité. L'homme fait de son activité vitale elle-même l'objet de sa volonté et de sa conscience. Il a une activité vitale consciente. Ce n'est pas une détermination avec laquelle il se confond directement. L'activité vitale consciente distingue directement l'homme de l'activité vitale de l'animal ». Et encore :
« Certes, l'animal aussi produit. Il se construit un nid, des habitations, comme l'abeille, le castor, la fourmi, etc. Mais il produit seulement ce dont il a immédiatement besoin pour lui ou son petit ; il produit d'une façon unilatérale, tandis que l'homme produit d'une façon universelle ; il ne produit que sous l'empire du besoin physique immédiat, tandis que l'homme produit même libéré du besoin physique et ne produit vraiment que lorsqu'il en est libéré ; l'animal ne se produit que lui-même, tandis que l'homme reproduit toute la nature ; le produit de l'animal fait directement partie de son corps physique, tandis que l'homme affronte librement son produit. L'animal ne façonne qu'à la mesure et selon les besoins de l'espèce à laquelle il appartient, tandis que l'homme sait produire à la mesure de toute espèce et sait appliquer partout à l'objet sa nature inhérente ; l'homme façonne donc aussi d'après les lois de la beauté H( Manuscrits de 1844, chapitre sur « Le travail aliéné », Editions Sociales, p. 63).
Nous pouvons ajouter que, si ces distinctions entre l’homme et le reste de la nature animale ne sont plus pertinentes pour une compréhension marxiste de 1’histoire ; si le concept « d'espèce humaine » doit être abandonné, nous devons aussi jeter entièrement la psychanalyse freudienne par la fenêtre, car elle peut être résumée comme une tentative de comprendre les ramifications de la contradiction qui a, jusqu'ici, caractérisé l'ensemble de 1’histoire humaine : la contradiction, le conflit profond, entre la vie instinctive de l’homme et son activité consciente
[10] [1323] Grundrisse, tome 2, p. 34, Editions sociales.
[11] [1324] Ibid., p. 426.
[12] [1325] Ibid., p. 349.
[13] [1326] Ibid., p. 8.
[14] [1327] Ibid., p.424, 425.
[15] [1328] Grundrisse, p. 99.
[16] [1329] Ibid., p. 18.
[17] [1330] Le Capital, 1, chap. XIV, section 4.
[18] [1331] Grundrisse, tome 1, p. 423.
[19] [1332] Ibid., p. 161.
[20] [1333] Le Capital, Vol 1, chap. I, section 4.
[21] [1334] Grundrisse, tome 1, p. 39
[22] [1335] Vol 1, Chap. I, section 4.
[23] [1336] Editions Sociales, p. 4.
[24] [1337] Voir la Revue Internationale n° 72 et 73
[25] [1338] Par exemple : dans les Grundrisse (Editions Sociales, tome 1, p.438), Marx dit « que les rapports de domination et de servitude (..) constituent un ferment nécessaire du développement et du déclin de tous les rapports de propriété et de production originels, tout comme ils expriment leur caractère borné. Au demeurant, ils sont reproduits dans le Capital - sous une forme médiatisée - et ils constituent ainsi également un ferment de sa dissolution et sont l'emblème de son propre caractère borné ». En bref, la dynamique interne et les contradictions de base de toute société de classe doivent être situées en leur cœur mêmes : les rapports d'exploitation. Dans la seconde partie de cet article nous examinerons comment c'est aussi le cas pour le rapport de travail salarié. Ailleurs, Marx souligne le rôle joué par le développement des rapports marchands dans l'accélération du déclin des formations sociales précédentes : « Il est évident - et cela se voit quand on analyse de plus près la période historique dont il est question ici - que l'époque de la dissolution des modes de production antérieurs et des façons dont le travailleur se rapporte aux conditions de travail est en même temps une époque où, d'autre part, elle croît rapidement et prend de l'extension grâce aux mêmes circonstances qui accélèrent cette dissolution ». (Ibid., p.444).
[26] [1339] Grundrisse, tome 2, p.33
Approfondir:
Questions théoriques:
- Communisme [492]
Heritage de la Gauche Communiste:
Revue Int. 1994 - 76 à 79
- 4276 reads
Revue Internationale no 76 - 1e trimestre 1994
- 2850 reads
Editorial : La difficile reprise de la lutte de classe
- 2618 reads
Au Moyen-Orient la <r paix » Israel-OLP se révèle pour ce qu'elle est : un nouveau prolongement de la guerre qui n'a jamais cessé dans cette région du monde. Champ de bataille des grands intérêts impérialistes depuis la première guerre mondiale, le Moyen-Orient le restera tant que le capitalisme mondial vivra, tout comme toutes les autres régions où n'ont jamais cessés les guerres ouvertes ou larvées.
En Yougoslavie, la guerre se poursuit. Des combats se mènent désormais au sein même de chacun des camps, entre Serbes, entre Croates, et entre Musulmans. L'alibi « ethnique » fourni pour justifier cette guerre est tragiquement dénoncé par les nouveaux combats autour desquels les médias font désormais taire leur publicité ! C'est sous couvert du « droit à l'indépendance » des « peuples » que la Yougoslavie est devenue le sinistre champ d'expérience des nouveaux affrontements entre grandes puissances provoqués par la disparition des anciens blocs impérialistes. Là aussi, il n'y aura pas de retour en arrière possible tant que le capitalisme aura les mains libres pour mener sa politique diplomatico-guerrière au nom de l'aide « humanitaire ».
En Russie, la situation ne fait qu'empirer. Le naufrage économique est décuplé, et l'instabilité politique qui a déjà entraîné des pans entiers de l'ex-URSS dans des guerres sanglantes, touche de plus en plus au coeur même de la Russie. Le risque de l'extension d'un chaos « à la yougoslave » y est bien réel. Là encore, le capitalisme n'a d'autre perspective que les guerres.
Guerres et crise, décomposition sociale, tel est /'« avenir » que le capitalisme offre à l'humanité en cette dernière décennie du millénaire
Dans les pays « développés », qui constituent le centre névralgique de ce système de terreur, de mort et de misère qu'est le capitalisme mondial, les luttes ouvrières ont resurgi depuis plusieurs mois après quatre ans de recul et de passivité. Début de mobilisation ouvrière contre des plans d'austérité d'une brutalité inconnue depuis la deuxième guerre mondiale, ces luttes contiennent aussi en germe la seule possibilité de réponse à la décadence et la décomposition du mode de production capitaliste. Avec toutes leurs limites, elles constituent déjà un pas dans le sens d'un combat de classe, une lutte massive et internationale du prolétariat, seule perspective pour enrayer les attaques contre les conditions d'existence, la misère et les guerres qui ravagent aujourd'hui la planète.
Le développement de la lutte de classe
Depuis plusieurs mois maintenant, mouvements de grèves et manifestations se sont multipliés dans les principaux pays d'Europe de l'ouest. Le calme social qui régnait depuis près de quatre ans est définitivement rompu.
La brutalité des licenciements et des baisses de salaires, et toutes les autres mesures d'austérité qui les accompagnent, ont partout provoqué la montée d'un mécontentement qui, à plusieurs reprises, a débouché sur une combativité retrouvée, une volonté manifeste de se battre, de ne pas se résigner face aux menaces que font peser les attaques contre toutes les conditions de vie de la classe ouvrière.
Et si partout les mouvements restent bien encadrés par les syndicats, ils n'en signifient pas moins un développement important de la lutte de classe. Le fait que, dans tous les pays, les syndicats appellent à des journées de manifestation et à des grèves, est symptomatique de la montée de la combativité dans les rangs ouvriers. C'est bien parce que les syndicats, par la place qu'ils occupent dans l'Etat capitaliste comme gardiens de l'ordre social pour le compte du capital national, perçoivent clairement que la classe ouvrière n'est pas prête à accepter passivement ces attaques contre ses conditions d'existence, qu'ils prennent les devants. En enfermant et en canalisant les revendications dans le corporatisme et le nationalisme, en dévoyant la volonté de lutter dans des impasses, les syndicats déploient une stratégie visant à empêcher le développement de la lutte de classe. Et cette stratégie est, a contrario, le signe qu'une véritable reprise de la lutte de classe est désormais en cours, à l'échelle internationale.
La reprise de la combativité ouvrière
La fin de l'année 1993 a ainsi été marquée par des grèves et manifestations en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Grande-Bretagne, en France, en Espagne.
Ce sont les grèves et manifestations en Allemagne ([1] [1340]) au début de l'automne qui ont donné le « la ». Tous les secteurs ont été touchés par une forte vague de mécontentement, obligeant les syndicats à orchestrer des manoeuvres de grande envergure, dans les principaux secteurs industriels, avec notamment une manifestation de 120 000 ouvriers du bâtiment le 28 octobre à Bonn, et avec également, dans l'industrie automobile, la « négociation » sur la semaine de 4 jours de travail avec diminution des salaires chez Volkswagen.
En Italie, où les premiers signes de la reprise de la lutte de classe internationale s'étaient manifestés dès septembre 1992, avec une importante mobilisation contre le plan du gouvernement Amato et contre les syndicats officiels signataires du plan, se sont multipliées grèves et manifestations depuis septembre 1993. Les grandes centrales syndicales étant fortement discréditées auprès des ouvriers, ce sont des organismes du syndicalisme de base qui prennent le relais. Le 25 septembre, 200 000 personnes manifestent à l'appel des « coordinations des conseils de fabrique ». Le 28 octobre, 700 000 personnes participent aux manifestations organisées dans le pays, et la grève de 4 heures est suivie ce jour-là par 14 millions de salariés. Le 16 novembre, c'est une manifestation de 500 000 salariés du secteur du bâtiment. Le 10 décembre, des manifestations de métallos de Fiat se déroulent à Turin, Milan et Rome.
En Belgique, le 29 octobre, 60 000 manifestants défilent à Bruxelles à l'appel de la FGTB, syndicat socialiste. Le 15 novembre sont organisées des grèves tournantes dans les transports publics. Le 26 novembre, qualifié de « Vendredi rouge » par la presse bourgeoise, la grève générale contre le « plan global » du premier ministre, la plus importante depuis 1936, appelée par les deux grands syndicats, la FGTB et le syndicat chrétien, la CSC, paralyse tout le pays.
En France, en octobre, c'est la grève des personnels au sol de la compagnie Air France, puis toute une série de manifestations et grèves localisées, notamment dans les transports publics, le 26 novembre. En Grande-Bretagne, 250 000 fonctionnaires sont en grève le 5 novembre. En Espagne, le 17 novembre, c'est le rassemblement de 30 000 métallos à Barcelone, contre le plan de licenciements de l'usine d'automobiles SEAT. Le 25 novembre est organisée une grande journée de manifestations syndicales dans tout le pays, contre le « pacte social » du gouvernement, la baisse des salaires, retraites, allocation chômage à laquelle participent plusieurs dizaines de milliers de personnes à Madrid, Barcelone et dans tout le pays.
Le blackout
Dans chaque pays, la propagande médiatique de la presse, de la radio et de la télévision, s'efforce autant que possible de taire les événements qui touchent à la classe ouvrière. C'est particulièrement le cas des mouvements dans les autres pays qui ne sont pratiquement jamais « couverts ». Et lorsque certains journaux mentionnent parfois très brièvement grèves et manifestations, dans la presse « populaire » et à la télévision, c'est quasiment partout le black out. Par exemple, pratiquement rien n'a filtré des grèves et manifestations en Allemagne dans les médias des autres pays. Et quand la réalité de « l'agitation sociale » ne peut pas être cachée, lorsqu'il s'agit d'événements nationaux, lorsqu'il s'agit des manoeuvres de la bourgeoisie qui servent sa propagande, ou lorsque l'importance de ce qui se passe s'impose à 1' « information », cette dernière présente systématiquement les aspects particuliers de chaque situation : c'est le problème de telle ou telle entreprise, c'est le problème de tel ou tel secteur, c'est le problème de tel ou tel pays. Ce sont toujours les revendications les plus corporatistes et nationalistes des syndicats qui sont présentées. Ou encore, ce sont les aspects spectaculaires stériles, comme les affrontements minoritaires avec les forces de l'ordre (en France lors du conflit d'Air France, en Belgique lors du « Vendredi rouge »), qui sont mis en avant.
Mais derrière le black out et la déformation de la réalité, c'est fondamentalement la même situation dans tous les pays développés, en Europe de l'ouest en particulier, qui est à la base de la reprise de la lutte de classe. La multiplication des grèves et manifestations est en elle-même déjà la marque de la reprise de la combativité ouvrière, d'une montée du mécontentement contre la baisse du « niveau de vie » qui s'élargit de jour en jour à toutes les couches de la population au travail, et contre le chômage massif.
Ce développement de la lutte de classe n'est qu'un début. Il se heurte aux difficultés créées par les conditions de la période historique actuelle.
Les difficultés de la classe ouvrière face à la stratégie syndicale et politique
C'est après toute une période d'un important reflux des combats ouvriers, qui a duré près de quatre ans, que la classe ouvrière commence à retrouver le chemin de la lutte.
Le mensonge stalinisme=communisme pèse toujours
Le prolétariat a d'abord été déboussolé par les campagnes idéologiques sur la « fin du communisme » et la « fin de la lutte de classe » qui ont été martelées à profusion depuis la chute du mur de Berlin en 1989. Ces campagnes, en présentant la mort du stalinisme comme la « fin du communisme », ont attaqué directement la conscience latente dans la classe ouvrière de la nécessité et de la possibilité de se battre pour une autre société. En usant et abusant du plus grand mensonge de ce siècle, l'assimilation de la forme stalinienne de capitalisme d'Etat au « communisme », la propagande de la bourgeoisie a largement déboussolé la classe ouvrière. Dans sa grande majorité, celle-ci a perçu l'effondrement du stalinisme comme la manifestation de l'impossibilité de l'instauration d'un autre système que le capitalisme. Au lieu d'une clarification dans la conscience de la classe sur la nature capitaliste du stalinisme, la fin de ce dernier a en quelque sorte permis de renforcer la crédibilité du mensonge de la nature « socialiste » de l’URSS et des pays de l'Est. Un reflux profond dans la conscience de la classe ouvrière, qui se dégageait lentement de l'emprise de ce mensonge, dans ses luttes depuis la fin des années 1960, s'est ouvert à partir de là, expliquant en grande partie le plus bas niveau de grèves et manifestations ouvrières jamais enregistré en Europe de l'ouest depuis la seconde guerre mondiale.
La confusion, qui depuis plusieurs décennies a régné dans la classe ouvrière sur sa propre perspective, celle du communisme, mensongèrement assimilée à la contre-révolution capitaliste sanglante du stalinisme, perdure. Elle continue d'être entretenue par la propagande, aussi bien celle des fractions de la bourgeoisie qui dénoncent le « communisme » pour vanter les mérites de la « démocratie » libérale ou socialiste, que par celle des fractions qui en défendent les «acquis socialistes» comme les Partis communistes et les organisations trotskistes. ([2] [1341])
Toutes les occasions sont bonnes pour entretenir cette confusion. Lors des affrontements à Moscou en octobre 1993 entre le gouvernement d'Eltsine et les « insurgés du Parlement », la propagande n'a cessé de présenter les députés « conservateurs » comme les « vrais communistes » (en insistant qu'ils ne peuvent bien sûr s'entendre qu'avec les « fascistes »), renforçant à nouveau le rideau de fumée idéologique sur le « communisme », utilisant une fois encore le cadavre du stalinisme pour marteler son message contre la classe ouvrière. Quant aux Partis communistes et aux organisations trotskistes, avec la désillusion qu'entraînent les ravages de la crise en URSS et dans les ex-pays « socialistes », ils retrouvent de la voix de plus en plus souvent pour défendre combien finalement les « acquis socialistes » ([3] [1342]) avaient du bon... avant le «retour du capitalisme ».
Le mensonge de l'assimilation du stalinisme au communisme, qui occulte la véritable perspective du communisme, va continuer à être entretenu par la bourgeoisie. La classe ouvrière ne pourra véritablement se débarrasser de cet obstacle à sa prise de conscience qu'avec la mise à nu, dans la pratique de ses luttes, du rôle contre-révolutionnaire des organisations de la gauche du capital social-démocratie, stalinisme et ses variantes « déstalinisées » et du syndicalisme.
Le poids du syndicalisme
Les promesses d'un « nouvel ordre mondial » qui devait ouvrir une « nouvelle ère de paix et de prospérité » sous l'égide du capitalisme « démocratique » ont également contribué à un reflux de la lutte de classe, de la capacité de la classe ouvrière à riposter aux remises en cause de ses conditions d'existence.
La guerre du Golfe en 1991 avait mis à mal les promesses de « paix », et constitué un facteur de clarification dans la conscience sur la nature de cette « paix » selon le capitalisme « triomphant », mais elle avait en même temps généré un sentiment d'impuissance annihilant la combativité.
Aujourd'hui, la crise économique et la généralisation des attaques des conditions de vie qu'elle entraîne, pousse le prolétariat à émerger lentement de la passivité qui dominait dans ses rangs. Le regain de combativité est un signe que les promesses de « prospérité » ne font plus recette. Les faits sont là. Le capitalisme ne peut offrir que la misère. Les sacrifices consentis appellent d'autres sacrifices. L'économie capitaliste est malade et ce sont les travailleurs qui en font les frais.
La reprise actuelle de la lutte de classe est donc marquée à la fois par une confusion qui persiste dans la classe ouvrière sur la perspective générale de ses luttes, à l'échelle historique, la perspective du communisme, le vrai, dont elle est porteuse, et à la fois par un réveil de la conscience de la nécessité de se battre contre le capitalisme.
C'est pourquoi, la caractéristique principale de cette reprise est l'emprise des syndicats sur les luttes actuelles, la quasi absence d'initiatives autonomes de la part des ouvriers, le faible niveau de rejet du syndicalisme. En effet, en l'absence de développement d'une conscience, même diffuse, de la possibilité d'un renversement du capitalisme, la combativité est piégée. Cantonnée à poser des revendications dans le cadre du capitalisme, elle se retrouve sur le terrain privilégié du syndicalisme. C'est pourquoi, actuellement, les syndicats parviennent à entraîner les ouvriers hors de leur terrain de classe:
- en formulant les revendications dans un cadre corporatiste, dans celui de la défense de l'économie nationale, au détriment de revendications communes à tous les ouvriers ;
- en « organisant » des « actions » qui servent à défouler le mécontentement, à faire croire à la classe ouvrière qu'elle lutte ainsi pour ses revendications, alors qu'en réalité elle est entraînée dans des impasses, fourvoyée dans des actions isolées, quand elle n'est pas simplement baladée dans des processions inoffensives pour l'Etat.
Une bourgeoisie qui se prépare à l'affrontement...
A quelques rares exceptions près, comme lors du début du mouvement des mineurs dans la Ruhr en Allemagne en septembre, tous les mouvements qui se sont développés ont été encadrés et «organisés» par les syndicats. Y compris certaines actions de syndicalisme de base, plus radicales, se sont déroulées sous l'oeil bienveillant des grandes centrales, quand ces dernières ne les ont pas directement suscitées ([4] [1343]). Cette capacité de manoeuvre est rendue possible à la fois par le faible niveau de conscience dans la classe ouvrière du rôle véritable que jouent les syndicats dans le sabotage de leurs luttes et à la fois par la préparation de la stratégie de la bourgeoisie sur les « conséquences sociales de l'austérité », en clair le danger de la lutte de classe.
Car si le prolétariat a des difficultés à se reconnaître comme classe, à prendre conscience de son être, la bourgeoisie n'a aucune difficulté à voir le danger que représentent des luttes ouvrières, les grèves, les manifestations. Par expérience, la classe dominante connaît le danger de la lutte de classe pour le capitalisme, tout au long de son histoire en général et avec les vagues de luttes qu'elle a dû contenir, encadrer et affronter au cours des dernières vingt-cinq années ([5] [1344]). Avec les mesures particulièrement brutales qu'elle est amenée à prendre dans la tourmente économique actuelle, elle s'efforce de planifier ses attaques, y compris les réactions de colère, de mécontentement, et la combativité que celles-ci ne manquent pas de susciter.
Il n'est donc pas étonnant que, tout comme le moment du déclenchement des luttes ouvrières en Italie, en septembre 1992, avait été choisi par la bourgeoisie pour défouler prématurément le prolétariat dans ce pays, et éviter ainsi la contagion dans d'autres pays européens ([6] [1345]), la plupart des mouvements aujourd'hui dépendent peu ou prou d'un calendrier syndical. D'un côté les «journées d'action », de l'autre le battage sur quelques « exemples », comme Air France ou le « Vendredi rouge » en Belgique, tout cela est en grande partie programmé par l'appareil politique et syndical de la classe dominante, pour « lâcher la vapeur » dans la classe ouvrière. Et ceci en concertation avec les « partenaires » des autres pays.
Avec le coup de massue des mesures anti ouvrières, dans un contexte de déboussolement politique et idéologique, le poids des illusions syndicalistes et le soin apporté par la bourgeoisie dans sa stratégie expliquent pourquoi la combativité n'a nulle part réellement fait échec aux attaques anti-ouvrières. Qui plus est, le prolétariat subit aussi la pression de la décomposition sociale. Le « chacun pour soi » ambiant pèse sur le besoin de développer la lutte collective et la solidarité, et favorise les manoeuvre de division du syndicalisme. De plus, la bourgeoisie utilise sa propre décomposition pour en retourner les effets contre la prise de conscience du prolétariat.
...et utilise la décomposition
La décomposition qui gangrène la société bourgeoise où règnent en maître les mensonges et les magouilles pour les profits d'un gâteau qui se rétrécit à vue d'oeil, pousse effectivement la classe bourgeoise au chacun pour soi.
Les scandales et les diverses affaires du monde politique, financier, industriel, sportif, princier, suivant les pays, ne sont pas seulement une mascarade. Ils correspondent à l'aiguisement des rivalités au sein de la classe dominante. Néanmoins, il y a une chose qui met d'accord tout ce beau monde autour des « affaires », c'est la publicité maximum qui en est faite pour occuper le terrain de 1'« information ».
En Italie par exemple, c'est l'« opération mains propres». Publiquement il s'agit de moraliser et d'assainir les comportements des hommes politiques. En fait, c'est le règlement de comptes entre les différentes fractions de la bourgeoisie, les divers clans dans l'appareil politique, essentiellement entre les tendances pro-Etats-Unis, dont le Parti démocrate-chrétien a été le zélé serviteur pendant quarante ans, et les tendances pro-alliance franco-allemande ([7] [1346]). De même en France, le scandale Tapie et autres feuilletons politico-médiatiques, sont les sujets systématiquement traités au premier plan de 1' « actualité ». A vrai dire, tout le monde s'en fout. Mais c'est précisément un des buts recherché : le moins d'information possible, et le message en filigrane, « surtout, pas de politique, c'est sale », est bien utile pour le cas où les ouvriers s'aviseraient précisément de s'occuper de politique. En Grande-Bretagne, c'est le feuilleton permanent autour de la famille royale qui remplit le même rôle d'occupation du terrain de 1'« information ».
Les campagnes «humanitaires» pour « héberger un étranger» en Allemagne ou « recueillir un enfant de Sarajevo » en Grande-Bretagne, tout comme le matraquage autour d'assassinats commis par des enfants en Grande-Bretagne ou en France, constituent également de claires illustrations de l'utilisation de la décomposition par l'idéologie bourgeoise pour entretenir un sentiment d'impuissance et de peur, et détourner l'attention des véritables problèmes économiques, politiques et sociaux.
Il en va de même de l'utilisation systématiques des images de guerre, comme au Moyen-Orient ou en Yougoslavie, dans lesquelles les intérêts impérialistes sont masqués, qui servent à créer un sentiment de culpabilité, et justifier ainsi l'acceptation des conditions d'exploitation dans les pays en « paix ».
Les perspectives de la lutte de classe
Toutes les difficultés de la lutte de classe ne signifient pas que les combats soient perdus d'avance et que les ouvriers n'ont rien à en attendre. Au contraire. Le déploiement actuel de la stratégie concertée de la bourgeoisie internationale contre la classe ouvrière, s'il constitue un obstacle de taille au déploiement des luttes, est aussi la marque d'une réelle tendance à la mobilisation et à la combativité, ainsi que d'une tendance à la réflexion sur les enjeux d'aujourd'hui.
C'est plus « par défaut » que par adhésion profonde que les ouvriers s'en remettent aux syndicats, contrairement à ce qui se passait dans les années 1930 où c'est par dizaines de millions que les ouvriers entraient dans ces organisations, signe de défaite historique de la classe ouvrière. C'est également plus « par défaut » que par adhésion à la politique de la bourgeoisie que le prolétariat tend encore à suivre les partis de la gauche du capital qui se prétendent « ouvriers », contrairement aux années 1930 où c'était l'enthousiasme pour les « fronts populaires » (avec son pendant dans la soumission au « national-socialisme » et au « stalinisme »).
Si la décomposition et son utilisation par la bourgeoisie se conjuguent avec les manoeuvres sur le terrain social des syndicats et de leurs prolongements « à la base » pour empoisonner la combativité et brouiller la prise de conscience de la classe ouvrière, la crise économique et les attaques des conditions d'existence en constituent un puissant antidote. C'est sur ce terrain que le prolétariat a commencé à riposter. Ce n'est qu'un début d'une longue période de luttes. La répétition de défaites sur les revendications économiques, si elle est douloureuse, est aussi porteuse d'une réflexion en profondeur sur les buts et les moyens de la lutte. La mobilisation ouvrière porte déjà en elle cette réflexion. La bourgeoisie ne s'y trompe pas : une « critique du capitalisme », de la part... du pape, est publiée à grand renfort de publicité ; des intellectuels publient soudain des articles en « défense du marxisme ». C'est au danger du début de réflexion qui s'opère dans la classe que s'attaque ce genre d'entreprise.
Malgré les difficultés, les conditions historiques actuelles tracent un chemin vers des affrontements de classe entre le prolétariat et la bourgeoisie, dont la reprise de la combativité aujourd'hui ne constitue qu'un premier pas.
Il revient aux organisations révolutionnaires de participer activement à cette réflexion et au développement de l'action de la classe ouvrière. Dans les luttes, ils doivent mettre en avant la dénonciation sans relâche de la stratégie de la bourgeoisie de division et de dispersion, rejeter les revendications corporatistes, catégorielles, sectorielles et nationalistes, s'opposer aux méthodes de « lutte » des syndicats qui ne sont que des manoeuvres destinées à « mouiller la poudre ». Ils doivent défendre la perspective d'une lutte générale de la classe ouvrière, la perspective du communisme. Ils doivent rappeler les expériences des luttes passées, l'apprentissage de la prise en mains de son combat par la classe ouvrière, dans ses assemblées générales, avec des délégués élus et révocables par ces mêmes assemblées. Ils doivent défendre, lorsque c'est possible, l'extension des luttes au-delà des barrières catégorielles. Ils doivent impulser et animer des cercles de discussion et comités de lutte où tous les travailleurs peuvent discuter des enjeux, des objectifs et des moyens de la lutte de classe, développer leur compréhension du rapport de forces entre prolétariat et bourgeoisie, de la nature de ce combat qui ouvre la perspective du développement d'affrontements de classe de grande ampleur dans les années qui viennent.
OF, 12 décembre 1993.
[1] [1347] Voir Revue Internationale n° 75.
[2] [1348] Quant à l'anarchisme, qui fait du stalinisme le résultat du « marxisme », il est condamné, en dépit de son « radicalisme » à se rallier à la bourgeoisie. Dans sa variante anarcho-syndicaliste, il se rattache directement à l'Etat bourgeois, en tant que syndicalisme. Dans sa variante politique, il est l'expression de la petite-bourgeoisie, et se range dans un camp de la bourgeoisie, comme en 1936 en Espagne, au même titre que les couches sociales qu'il représente.
[3] [1349] En France, le groupe trotskiste Lutte Ouvrière a mené une énorme campagne d'affichage dans toute la France pour dénoncer le « retour au capitalisme » en URSS et appeler à défendre ces fameux « acquis ouvriers.»
[4] [1350] Aussi bien la manifestation en Italie à l'appel des « coordinations... » que les bagarres sur les pistes des aéroports de Paris lors de la grève d'Air France.
[5] [1351] Qui plus est aujourd'hui, c'est la génération d'hommes qui avaient vingt ans en 1968 qui est aux commandes de l'Etat capitaliste. C'est une génération particulièrement expérimentée dans le domaine « social » : faut-il rappeler qu'un Mitterrand en France est entouré d'anciens gauchistes de Mai 68, et que le premier grand service rendu par Chirac à sa classe a été l'organisation, en plein mai 68, des réunions secrètes du gouvernement Pompidou (dont faisait partie Balladur...) avec le syndicat stalinien CGT, pour préparer les accords qui devaient enterrer le mouvement.
[6] [1352] Sur les luttes en Italie en 1992, voir Revue Internationale n° 72 et 71 (supplément).
[7] [1353] Sur l'Italie, voir la Revue Internationale n° 73.
Géographique:
- Europe [95]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [143]
« Reprise » économique, accords du GATT : Les mystifications d'une solution capitaliste a la crise
- 3002 reads
Depuis le début de la décennie, l'économie mondiale a plongé dans la récession. La multiplication des licenciements, la croissance brutale du chômage qui atteint des niveaux inconnus depuis les années 1930, une précarisation grandissante de l'emploi pour ceux qui ont la chance d'en conserver un, une baisse généralisée du niveau de vie amputé par les plans d'austérité à répétition, une paupérisation grandissante qui se concrétise brutalement par la marginalisation d'une fraction de plus en plus importante de la population qui se retrouve sans revenu et même sans domicile. Autant de phénomènes que la classe ouvrière au coeur des grandes métropoles développées subit de plein fouet. Aujourd'hui, les exploités sont confrontés à la plus importante attaque jamais menée contre leurs conditions de vie. Au-delà de tous les indices abscons, de tous les chiffres abstraits, cette réalité montre de manière terriblement concrète la vérité de la crise économique du système capitaliste dans son ensemble. C'est une évidence tellement criante qu'aujourd'hui, plus aucun économiste ne songe à la nier. Et pourtant, inlassablement, les thuriféraires du capitalisme ne cessent de nous annoncer que la reprise est là... pour l'année prochaine. Jusqu'à présent, ces espoirs ont été chaque fois déçus. Cela n'empêche pas qu'en cette fin d'année 1993, une fois de plus, et peut-être plus fort que jamais, les médias nous chantent sur tous les tons le refrain de la « reprise » annoncée.
Sur quoi se base ce regain d'optimisme? Essentiellement sur le fait qu'on assiste aux USA, après plusieurs années de récession, à un retour à des taux de croissance positifs du PNB. Ces chiffres sont-ils pour autant significatifs et annoncent-ils le retour à des lendemains capitalistes qui chantent? Croire cela serait la pire des illusions pour la classe ouvrière.
Le niveau assourdissant qu'atteint aujourd'hui le tapage médiatique sur la question de la fin de la récession exprime au contraire le besoin pour la classe dominante de contrecarrer le sentiment de plus en plus aigu qui se développe au sein du prolétariat, confronté à la réalité de ses difficultés quotidiennes qui vont en s'aggravant depuis de nombreuses années, que, face à la crise de leur système, les gestionnaires du capital n'ont pas de réponse adéquate, pas de solution. Depuis des années, les thèmes et les discours idéologiques mis en avant par la classe dominante ont pu varier, du « moins d'Etat » de Reagan et Thatcher à la revalorisation du rôle social et régulateur de l'Etat par Clinton, les gouvernements de « gauche » et de « droite » se sont succédés, mais la réalité a continué d'avancer toujours dans le même sens : celui de l'approfondissement de la crise mondiale et de la dégradation généralisée des conditions de vie des exploités. Constamment de nouvelles recettes au goût de potion amère ont été essayées. Continuellement de nouveaux espoirs ont été soulevés. En vain.
Ces derniers mois, la propagande capitaliste a trouvé un nouveau thème mystificateur: les négociations du GATT. Ce serait le protectionnisme qui entraverait le développement de la reprise économique. Par conséquent, l'ouverture des marchés, le respect des règles de la libre concurrence serait la panacée qui permettrait de sortir l'économie mondiale de l'ornière dans laquelle elle s'est embourbée. Les USA se font le porte-drapeau d'une telle vision. Mais tout cela n'est que baratin idéologique, un écran de fumée qui parvient de plus en plus mal à cacher la férocité de la foire d'empoigne qui oppose les principales puissances économiques du monde pour la conservation de leur part d'un marché mondial qui va en se rétrécissant. Sous prétexte des négociations du GATT, chaque fraction de la bourgeoisie essaye de mobiliser le prolétariat derrière l'étendard de la défense de l'économie nationale. Les accords du GATT ne sont qu'un moment de la guerre commerciale qui s'exacerbe sur le marché mondial et la classe ouvrière n'a fondamentalement rien à en attendre. L'issue de ces négociations ne change rien à la dynamique de concurrence effrénée qui se développe depuis des années et qui se traduit par des licenciements massifs et des plans sociaux draconiens pour restaurer la compétitivité des entreprises et redresser les bilans en imposant des économies drastiques dont la classe ouvrière va continuer à faire les frais. Dans le futur, les responsables capitalistes auront tout au plus un nouvel argument à faire valoir pour licencier, pour amputer les salaires, pour imposer plus de misère : « c'est la faute du GATT », comme on entend déjà « c'est à cause de la CEE » ou de la « NAFTA » ([1] [1354]). Tous ces faux arguments n'ont qu'une raison d'être : masquer la réalité que toute cette misère qui se développe est le produit d'un système économique qui s'empêtre dans ses contradictions insolubles, le capitalisme.
Une récession sans fin
Au moindre petit frémissement des indices de croissance, les dirigeants du capitalisme sont prompts à s'enthousiasmer pour y voir le signe de la reprise et donc la validation de la politique économique d'austérité qu'ils ont menée. Tel a notamment été le cas en France et en Allemagne récemment. Pourtant, les chiffres de la croissance de ces derniers mois pour les principales puissances économiques montrent qu'il n'y a vraiment pas de quoi pavoiser.
Ainsi pour l'ensemble de l’Union Européenne (suivant la nouvelle dénomination de l'ex-CEE), la « croissance » était encore d'un petit + 1 % en 1992 avant qu'elle ne chute à -0,6% en 1993. Elle passe ainsi, pour ces deux années, de + 1,6% à -2,2% pour l'Allemagne (hors Allemagne orientale), de + 1,4 % à - 0,9 % pour la France, de + 0,9 % à - 0,3 % pour l'Italie. Tous les pays de l’Union Européenne voient uniformément leur PIB plonger à une seule exception près : la Grande-Bretagne dont le PIB grimpe durant la même période de - 0,5 % à + 1,9 % (nous y reviendrons) ([2] [1355]).
Par-delà le nécessaire optimisme de façade dont font preuve les hommes politiques lorsqu'ils annoncent la reprise pour 1994, les divers instituts spécialisés de conjoncture, à l'audience plus discrète, réservés à l'usage des «décideurs» économiques, sont autrement plus prudents. Ainsi le Nomura Research Institute (Institut de recherche Nomura), après avoir estimé le recul du PIB du Japon pour l'année fiscale qui va d'avril 1993 à avril 1994 à -1,1 %, envisage un nouveau recul de -0,4 % pour la période suivante, c'est-à-dire jusqu'en avril 1995. Dans son rapport, il précise même : «L'actuelle récession risque d'être la pire depuis les années 1930 », et ajoute : « Il est important de noter que le Japon est en train de passer d'une vraie récession à une déflation (...) en bonne et due forme ». Après une baisse du PIB estimée à -0,5 % en 1993 ([3] [1356]), la seconde puissance économique de la planète ne voit guère la reprise se profiler à l'horizon.
Le climat est apparemment bien différent aux USA. Avec une croissance du PIB estimée à 2,8 % en 1993 ([4] [1357]), les Etats-Unis (avec la Grande-Bretagne et le Canada) font, aujourd'hui, figure d'exception parmi les grandes puissances. Eux qui ont toujours prétendu symboliser le capitalisme libéral, qui s'en sont faits les champions sur le plan idéologique trouvent, là encore, une occasion de hisser haut le drapeau arrogant du capitalisme triomphant. Dans la situation de pessimisme ambiant, les USA se veulent les fers de lance de la foi dans les vertus du capitalisme et dans sa capacité à surmonter toutes les crises qu'il peut traverser, incarnation du modèle achevé de la « Démocratie », idéal indépassable, point le plus achevé auquel peut prétendre l'humanité. Malheureusement pour nos chantres d'un capitalisme éternel, ce verbiage idéologique inlassablement répété n'a pas grand chose à voir avec la sinistre réalité qui se développe sur la scène mondiale, y compris aux USA. Ce discours est surtout destiné à entraver la prise de conscience de la classe ouvrière en suscitant de vains espoirs et à servir de vecteur idéologique des intérêts impérialistes américains face aux rivaux européens et japonais. La farce médiatisée du GATT en témoigne clairement.
Le mythe de la baisse du chômage aux Etats-Unis
Pour asseoir leur propagande sur la « reprise », les USA s'appuient aussi sur un indice qui a un écho autrement plus important pour la classe ouvrière que celui, abstrait, de la croissance du PIB : le taux de chômage. Là encore, les USA et le Canada, font figure d'exception. Parmi les pays développés, ils sont les seuls à pouvoir prétendre à une diminution du nombre de chômeurs, alors que partout ailleurs celui-ci progresse de manière accélérée.
Progression du chômage
Taux de chômage (pourcentage) ([5] [1358])
|
|
|
USA |
7,4 |
6,8 |
|
Canada |
11,3 |
11,2 |
|
Japon |
2,2 |
2,5 |
|
Allemagne |
7,7 |
8,9 |
|
France |
10,4 |
11,7 |
|
Italie |
10,4 |
11,7 |
|
GB |
10,0 |
10,3 |
|
Union européenne |
10,3 |
11,3 |
|
Total OCDE |
7,8 |
8,2 |
Aux USA, la situation des travailleurs est-elle à ce point différente de celle des autres pays développés ? Pas un jour ne passe sans qu'une des grandes entreprises qui occupe le devant de la scène économique mondiale n'annonce une nouvelle charrette de licenciement. Nous ne reprendrons pas ici la lugubre litanie des licenciements annoncés ces derniers mois, il y faudrait des pages et des pages. Partout dans le monde la situation est la même et les USA ne font pas exception. Ainsi, 550 000 emplois ont été supprimés en 1991, 400 000 en 1992 et 600 000 en 1993. De 1987 à 1992, les entreprises de plus de 500 employés ont « dégraissé » leurs effectifs de 2,3 millions de travailleurs. Ce ne sont pas les grandes entreprises qui ont créé des emplois aux USA, mais les petites. Ainsi durant la période considérée, les entreprises de moins de 20 salariés ont vu leurs effectifs croître de 12 %, celles de 20 à 100 salariés de 4,6 % ([6] [1359]). Qu'est-ce que cela signifie pour la classe ouvrière ? Tout simplement que des millions d'emplois stables et bien rémunérés ont été détruits et que les nouveaux emplois sont précaires, instables et le plus souvent très mal payés. Derrière les chiffres triomphalistes de l'administration américaine sur l'emploi, se cache toute la sauvagerie de l'attaque brutale contre les conditions de vie de la classe ouvrière. Une telle situation a été rendue possible par le simple fait qu'aux USA, au nom du « libéralisme » et de la sacro-sainte loi du marché, les règles régissant le marché du travail sont quasiment inexistantes, contrairement à la situation qui prévaut en Europe.
C'est vers ce « modèle » que lorgnent avec envie les dirigeants européens et japonais, pressés de démanteler ce qu'ils appellent les « rigidités » du marché de l'emploi, c'est-à-dire tout le système de « protection sociale » mis en place depuis des décennies et qui, suivant les pays, est concrétisé par un salaire minimum, l'assurance de ne pas être licencié dans certains secteurs (fonction publique en Europe, grandes entreprises au Japon), des réglementations précises concernant les licenciements, des systèmes d'allocation chômage, etc. En fait, derrière le mot d'ordre, généralisé aujourd'hui dans tous les pays industrialisés, de la recherche d'une plus grande «mobilité» des travailleurs, d'un «assouplissement» du marché de l'emploi se profile une des plus importantes attaques jamais menées contre les conditions de vie de la classe ouvrière. Voila le « modèle » proposé par les USA. Au-delà de l'apparence des chiffres, la diminution du chômage aux Etats-Unis n'est pas en soi une bonne nouvelle. Il correspond à une énorme dégradation des conditions de vie du prolétariat.
Ce qui est vrai pour les chiffres du chômage l'est aussi pour ceux de la croissance. Ils n'ont en fait qu'un lointain rapport avec la réalité. Le retour de la prospérité est un rêve définitivement révolu pour une économie capitaliste en crise ouverte depuis 25 ans. Un seul exemple qui permet de relativiser grandement les proclamations euphoriques du capitalisme américain : durant les années 1980, sous la présidence Reagan, nous avons déjà connu, de manière intensive, les affirmations mille fois répétées sur la « reprise » qui renvoyaient définitivement le spectre de la crise du capitalisme aux oubliettes de l'histoire. Finalement, l'histoire a pris sa revanche, et la récession ouverte qui a suivi a fait oublier ces rodomontades. Les années 1980 ont été, en fait, des années de crise et la « reprise », pas autre chose qu'une récession larvée durant laquelle, loin des discours idéologiques, les conditions de vie de la classe ouvrière se sont continuellement dégradées. La situation présente est encore pire. Le moins que l'on puisse dire est que la «reprise» américaine est particulièrement poussive et guère significative. Elle relève pour l'instant plus d'une propagande qui se veut rassurante que de la réalité.
Une fuite en avant dans le crédit
Dans réchauffement des débats du GATT, un chiffre a été publié dans la presse : les USA, l'Union européenne, le Japon et le Canada à eux quatre représentent 80 % des exportations mondiales. Cela donne une idée du poids prépondérant de ces pays sur le marché mondial. Mais cela montre aussi que l'économie de la planète repose sur trois pôles : l'Amérique du Nord, l'Europe occidentale et le Japon en Asie. Et deux de ces pôles, qui représentent près de 60 % de la production totale de ces pays, sont toujours plongés dans la récession. Malgré les rodomontades de l'équipe Clinton qui, sur ce plan, est dans la continuité de ses prédécesseurs, Reagan et Bush, la reprise de l'économie mondiale n'est pas au coin de la rue, loin de là. Dans ces conditions, quelle est donc la signification de la « reprise » américaine ? Les USA, le Canada et la GB qui ont les premiers plongés officiellement dans la récession vont-ils être les premiers à en sortir et les indices en progression qu'ils annoncent aujourd'hui sont-ils le signe annonciateur d'une reprise générale de l'économie mondiale?
Regardons d'un peu plus près cette fameuse «reprise» américaine. Que se passe-t-il ? D'un coup de baguette magique, Clinton a-t-il fait disparaître tous les maux qui minaient l'économie américaine? A-t-il enrayé le manque de compétitivité à l'exportation et en conséquence un déficit commercial abyssal, des déficits budgétaires colossaux se traduisant par un endettement écrasant de l'Etat américain, un endettement généralisé qui a atteint un tel niveau que le problème de son remboursement et de la solvabilité de l'économie américaine menace l'édifice financier international ? Rien de tout cela n'a disparu, c'est plutôt le contraire qui s'est passé. Sur tous ces plans la situation s'est aggravée.
La déficit annuel de la balance commerciale des USA qui avait atteint en 1987 le niveau record de 159 milliards de dollars s'était quelque peu résorbé par la suite pour atteindre « seulement » 73,8 milliards de dollars en 1991. Mais depuis, il ne cesse de s'approfondir et, pour 1993, il est estimé à 131 milliards de dollars ([7] [1360]). Quant au déficit budgétaire, il est estimé, pour 1993, entre 260 et 280 milliards de dollars. Bref, Clinton n'innove pas, il continue sur la même lancée que ses prédécesseurs, celle de la fuite en avant dans l'endettement. Les problèmes sont repoussés à demain et leur aggravation réelle est masquée dans le présent. La baisse des taux qui a abouti à ce qu'aujourd'hui la Banque fédérale prête à un taux de 3 %, c'est-à-dire un taux équivalent à l'inflation officielle (et donc inférieur à l'inflation réelle) n'avait pas d'autre but que de permettre aux entreprises, aux particuliers et à l'Etat d'alléger le poids de la dette et de fournir à une économie défaillante un débouché intérieur artificiellement entretenu par le crédit « gratuit ». Un exemple : après deux ans de quasi-stagnation, la consommation des ménages a recommencé à croître depuis quelque mois, elle a fait un bond de 4,4 % au troisième trimestre 1993. La raison essentielle en est que les particuliers ont pu renégocier tous leurs prêts hypothécaires à un taux de 6,5 % au lieu de 9,5 %, 10 % ou plus, ce qui augmente d'autant le revenu disponible et leur redonne le goût pour la vie à crédit. Ainsi, les crédits à la consommation ont fait un bond en rythme annuel de 8 % en août, de 9,7 % en septembre, de 12,7% en octobre ([8] [1361]). La confiance retrouvée de l'économie américaine c'est avant tout une nouvelle fuite en avant dans le crédit.
Les USA ne sont certainement pas les seuls à recourir massivement au crédit, à fuir dans l'endettement. C'est une situation généralisée.
Evolution de la dette publique nette
En pourcentage du PIB nominal ([9] [1362])
|
|
1991 |
1992 |
1993 |
|
USA |
34,7 |
38,0 |
39,9 |
|
Allemagne |
23,2 |
24,4 |
27,8 |
|
France |
27,1 |
30,1 |
35,2 |
|
Italie |
101,2 |
105,3 |
111,6 |
|
GB |
30,2 |
35,8 |
42,6 |
|
Canada |
49,2 |
54,7 |
57,8 |
A l'exception du Japon, qui utilise son bas de laine pour maintenir son économie à flot et en est déjà à son cinquième plan de relance sans grands résultats, tous les pays ont eu recours à la drogue du crédit pour éviter une récession plus dramatique. Cependant, bien que l'endettement de l'Etat américain ne soit pas le plus excessif selon l'OCDE, les USA n'en demeurent pas moins le pays qui y a recouru le plus massivement sur tous les plans de son activité économique, Etat, entreprises et particuliers. Ainsi selon d'autres sources, l'endettement brut de l'Etat représente 130 % du PNB, celui des entreprises et des particuliers 170%. L'importance de l'endettement global des USA - plus de 12 000 milliards de dollars, mais l'estimation pourrait être bien supérieure selon certaines sources -, pèse lourdement sur la situation économique mondiale. Cette situation signifie qu'à terme, la dynamique de reprise annoncée peut faire illusion quelque temps et trouver provisoirement une confirmation ailleurs qu'aux USA, mais surtout qu'elle est destinée à faire long feu.
La contre-offensive américaine
Ce qui pour n'importe quel autre pays serait considéré comme une situation catastrophique et susciterait la colère du FMI est pourtant, dans le cas des USA, constamment minimisé par les dirigeants du monde entier. La « reprise » présente, comme celle de la deuxième moitié des années 1980, sous Reagan, activée de façon totalement artificielle par la drogue du crédit, est présentée comme la preuve du dynamisme du capitalisme américain et par extension du capitalisme en général. La raison de cette situation paradoxale : non seulement toutes les économies du monde sont étroitement dépendante du marché américain où elles exportent et sont donc intéressées au maintien de celui-ci, mais la crédibilité des USA ne se résume pas à la puissance de leur économie. Les Etats-Unis ont d'autres atouts à faire valoir. En particulier, leur statut de première puissance impérialiste mondiale durant des décennies, leur maintien à la tête du bloc occidental de la fin de la deuxième guerre mondiale à la chute du bloc de l'Est, leur ont permis d'organiser le marché mondial suivant leurs besoins. Un exemple de cette situation parmi d'autres : le dollar est la monnaie-reine du marché mondial, avec laquelle sont effectués les trois-quarts des échanges internationaux. Même si le bloc occidental s'est aujourd'hui délité avec la perte du ciment que constituait la menace de l'«ogre» russe et, qu'en conséquence, les principaux concurrents économiques des USA - l'Europe et le Japon, qui auparavant se soumettaient à la discipline du bloc, y compris sur le plan économique - tentent maintenant de voler de leurs propres ailes - , il n'en demeure pas moins que toute l'organisation actuelle du marché mondial est héritée de la période passée. En conséquence, les USA vont tenter de toutes leurs forces, d'en tirer le bénéfice dans la situation présente de concurrence et de guerre commerciale exacerbée. La foire d'empoigne à propos des négociations du GATT est une illustration frappante de cette situation.
Les USA ont annoncé la couleur. Leur président affiche dans son programme la perspective de faire passer de 638 à 1000 milliards de dollars les exportations annuelles américaines. Ce qui signifie en clair que les Etats-Unis comptent redresser leur situation économique en restaurant une balance commerciale bénéficiaire. Ambitieux objectif qui mobilise aujourd'hui l'Amérique et qui ne peut être atteint qu’aux dépens des autres puissances économiques. Premier volet de cette politique, la relance des investissements, Clinton prônant un rôle accru de l'Etat sur ce plan. Il est tout à fait significatif de constater qu'aux USA la formation brute de capital fixe (l'investissement) a progressé de + 6,2 % en 1992 et de + 9,8 % en 1993, alors qu'elle a baissé en 1993 de 2,3 % au Japon, de 3,3 % en Allemagne, de 5,5 % en France, de 7,7 % en Italie et n'a progressé que de + 1,8 % en GB. Les USA sont en train de muscler leur économie pour restaurer leur compétitivité et repartir à l'assaut du marché mondial. Mais dans les conditions de concurrence exacerbée qui prédominent actuellement, cette seule politique économique ne saurait suffire. Un deuxième volet y a été adjoint qui consiste à utiliser toutes les ressources de la puissance américaine pour ouvrir aux exportations US les marchés protégés par des barrières protectionnistes.
C'est dans ce cadre qu'il faut comprendre aussi bien les accords NAFTA, la récente conférence qui vient de réunir les pays riverains du Pacifique à Seattle, comme les disputes qui ont dominé les négociations des accords du GATT. Les arrières pensées impérialistes ne sont évidemment pas absentes de ces négociations économiques. Après la disparition de leur bloc, les Etats-Unis se doivent de reconstituer et de restructurer leur zone d'influence. De la même manière qu'ils font bénéficier leur économie des atouts que constitue leur puissance impérialiste, ils utilisent aussi leur puissance économique au profit de leurs objectifs impérialistes. Cela n'est pas nouveau, mais auparavant, tenus par la nécessaire discipline du bloc, les principaux compétiteurs économiques des USA faisaient contre mauvaise fortune bon coeur, et avalaient les couleuvres. En fait ils payaient la note au nom de la solidarité occidentale. Ce n'est plus le cas aujourd'hui.
L'attitude en flèche de la France face a l'Amérique n'a pas été aussi isolée que la propagande médiatique a pu le faire croire. Elle a pu compter sur le soutien de la majeure partie des pays européens, notamment de l'Allemagne, tandis que le Japon, visiblement, n'en pensait pas moins en comptant les points. Les négociations ont été aussi dures et ont pris une telle allure de psychodrame parce que, face aux exigences américaines, l'Europe et le Japon ont, bien sûr, défendu leurs propres intérêts économiques avec une détermination qu'ils n'avaient jamais montrée auparavant. Mais cela n'est pas la seule raison. Toutes les grandes puissances, qui sont aussi les principaux pays exportateurs, ont intérêt à un accord qui limite le développement du protectionnisme. Même si la France est le 2e exportateur agricole mondial, l'argument français à propos du préaccord de Blair House qui n'affectait qu'une très petite part de ses exportations a été essentiellement un prétexte médiatisé, tandis que se négociaient, difficilement et discrètement, d'autres aspects autrement plus importants sur le plan économique. La dramatisation de ces négociations avait aussi pour fondement la rivalité impérialiste qui se développe de manière de plus en plus intense entre, d'une part, les USA et d'autre part l'alliance franco-allemande au coeur de l'Europe, et le Japon. La France et la plupart des pays d'Europe devaient marquer leur différence parce que derrière ces négociations économiques se joue aussi la mise en place des thèmes idéologiques qui serviront aux alignements impérialistes futurs. Il est ainsi particulièrement significatif qu'aucun accord n'ait pu se faire sur le volet des produits audio-visuels. La fameuse « exception culturelle », mise en avant notamment par la France, masque en fait la nécessité pour les challengers de la domination américaine de ne pas laisser les USA contrôler un secteur, celui des médias, indispensable à toute politique impérialiste indépendante.
L'argument selon lequel le GATT va favoriser la relance de l'économie mondiale a été abondamment utilisé. Cette affirmation s'est essentiellement appuyée sur une étude produite par une équipe de chercheurs de l'OCDE qui a prédit que le GATT permettrait un accroissement de 213 milliards de dollars du revenu annuel mondial, sans insister exagérément sur le fait que cette perspective était définie pour le siècle prochain ! D'ici là, quand on sait combien les spécialistes de la conjoncture ont pu se tromper par le passé, ces prévisions opportunes seront bien oubliées. Car la véritable signification de ces accords est d'abord l'exacerbation de la guerre commerciale, une concurrence qui va aller en s'aggravant et donc, à court terme, une dégradation de l'économie mondiale. Ils ne changent rien à la dynamique de la crise. Ils en sont au contraire un moment aigu où se sont manifestés les tensions et griefs entre les principales puissances du monde.
Par delà les illusions que tente aujourd'hui de véhiculer la classe dominante, les nuages annonciateurs de tempête continuent de s'accumuler sur l'économie mondiale. Crise financière, plongée plus profonde dans la récession, retour de l'inflation sont autant de spectres qui se profilent à l'horizon. Autant de menaces qui signifient pour la classe ouvrière une dégradation toujours plus tragique de ses conditions d'existence. Mais elles annoncent aussi une difficulté toujours plus grande pour la classe dominante à crédibiliser son système. La crise détermine le prolétariat à lutter pour la défense de ses conditions de vie, en même temps qu'elle lui ouvre les yeux sur la réalité du mensonge capitaliste. Malgré les souffrances qu'elle lui inflige, la crise reste le principal allié de la classe révolutionnaire.
JJ, 16/12/1993
[1] [1363] NAFTA (North american free trade agreement) ou ALENA : Association de libre-échange nord-américaine englobant les pays d'Amérique du Nord (Canada, Mexique, USA).
[2] [1364] Source : Commission Européenne
[3] [1365] Déflation : référence à la crise de 1929 durant laquelle la chute de la production et de l'emploi s'est conjuguée avec une baisse des prix.
[4] [1366] Source : OCDE
[5] [1367] Source : OCDE (sauf Italie qui entre temps a modifié son mode de calcul et pour laquelle la référence est la Commission européenne).
[8] [1370] Source : Réserve fédérale
[9] [1371] Source : OCDE
Questions théoriques:
- L'économie [86]
Heritage de la Gauche Communiste:
- Capitalisme d'Etat [40]
Comment est organisée la bourgeoisie ? : Le mensonge de l'Etat « démocratique »
- 3182 reads
Le bloc de l'Est s'est effondré et, du coup, les thèmes de la propagande idéologique déchaînée par son vieux rival occidental s'en sont trouvés automatiquement revalorisés. Durant des décennies, le monde a vécu sous le poids d'un double mensonge : celui de l'existence du communisme à l'Est, identifié à la dictature impitoyable du stalinisme, opposé à celui du règne de la liberté démocratique à l'Ouest. De ce combat idéologique, traduction, sur le plan de la propagande, des rivalités impérialistes, l'illusion en la « démocratie » est sortie gagnante. Ce n'est pas sa première victoire. Déjà, lors des deux guerres mondiales qui ont ravagé la planète depuis le début du siècle, le camp des « démocraties libérales » a gagné, et à chaque fois, en conséquence, l'idéologie démocratique s'en est trouvée renforcée.
Ce n'est pas là un phénomène du hasard. Les pays qui ont pu le mieux prétendre incarner l'idéal démocratique sont ceux qui, les premiers, sont parvenus à réaliser la révolution démocratique bourgeoise et à instaurer le règne d'Etats purement capitalistes : le Royaume-Uni, la France, les Etats-Unis notamment. Par conséquent, parce qu'ils sont arrivés les premiers, ils ont été les mieux lotis sur le plan économique. Cette supériorité économique s'est concrétisée sur le plan militaire et sur le plan de la guerre idéologique. Durant les conflits impérialistes qui ont ravagé la planète depuis le début du siècle, la force des « démocraties libérales » a constamment été de faire croire aux prolétaires qui servaient de chair à canon, qu'en se battant pour la «c démocratie », ce n'était pas les intérêts d'une fraction capitaliste qu'ils défendaient, mais un idéal de liberté face à la barbarie de systèmes dictatoriaux. Ainsi, durant la 1e guerre mondiale, les prolétaires français, anglais et américains sont envoyés à la boucherie au nom de la lutte contre le militarisme prussien. Durant la seconde, les dictatures nazies et fascistes servent, par leur brutalité, de justification au militarisme démocratique. Par la suite, le combat idéologique entre les deux blocs a été assimilé à la lutte de la « démocratie » contre la dictature « communiste ». Chaque fois, les démocraties occidentales ont prétendu mener le combat contre un système fondamentalement différent du leur, contre des « dictatures ». Il n'en est rien.
Aujourd'hui, le modèle démocratique occidental est présenté comme un idéal de progrès qui transcende les systèmes économiques et les classes. Tous les citoyens sont « égaux » et « libres » de choisir par le vote les représentants politiques, et donc le système économique qu'ils désirent. Chacun est «libre» en «démocratie» d'exprimer ses opinions. Si les électeurs veulent le socialisme, ou même le communisme, ils n'ont qu'à voter pour les représentants des partis qui prétendent défendre ces objectifs. Le parlement est le reflet de la « volonté populaire ». Chaque citoyen a un recours devant l'Etat. Les « Droits de l'homme sont respectés », etc.
Cette vision idyllique et naïve de la «démocratie» est un mythe. La «démocratie» est le paravent idéologique qui sert à masquer la dictature du capital dans ses pôles les plus développés. Il n'y a pas de différence fondamentale de nature entre les divers modèles que la propagande capitaliste oppose les uns aux autres pour les besoins de ses campagnes idéologiques de mystification. Tous les systèmes soi-disant différents par leur nature, qui ont servi de faire-valoir à la propagande démocratique depuis le début du siècle, sont des expressions de la dictature de la bourgeoisie, du capitalisme. La forme, l'apparence peuvent varier, pas le fond. Le totalitarisme sans fard du nazisme ou du stalinisme n’est pas l'expression de systèmes économiques différents, mais le résultat du développement du totalitarisme étatique, caractéristique du capitalisme décadent, et du développement universel de la tendance au capitalisme d'Etat qui marque le 20e siècle. En fait, la supériorité des vieilles démocraties occidentales qui, elles aussi, ont été marquées tout au long de ce siècle par les stigmates du totalitarisme étatique, a été d'avoir su bien mieux masquer ce phénomène.
Les mythes ont la vie dure. Mais la crise économique ; qui s'approfondit chaque jour de façon plus dramatique; met à nu la réalité du capitalisme décadent, dévoile ses mensonges. Ainsi l'illusion de la prospérité à l'Ouest, présentée comme éternelle au lendemain de l'effondrement économique de l'ex-bloc de l'Est, a fait long feu. Le mensonge démocratique est d'un autre acabit, car il repose sur d'autres prémisses moins sujettes aux fluctuations immédiates. Cependant, des dizaines d'années de crise ont imposé à la classe dominante un niveau croissant de tensions tant sur le plan international que sur le plan intérieur pour chacune de ses fractions nationales. En conséquence, elle a dû développer des manoeuvres sur tous les plans de son activité comme jamais elle n'en avait connu auparavant la nécessité. Les occasions où elle a montré, en gros et en détail, le peu de cas qu'elle pouvait faire de l'idéal démocratique qu'elle prétend incarner, se sont multipliées. Dans le monde entier, les partis politiques «responsables», de droite comme de gauche, qui tous ont suivi la même politique d'austérité contre la classe ouvrière lorsqu'ils se sont approchés des responsabilités gouvernementales, souffrent aujourd'hui d'un discrédit général. Ce discrédit qui touche l'ensemble du fonctionnement de l'appareil d'Etat est le produit du divorce croissant entre l'Etat qui impose la misère et la société civile qui la subit. Mais cet état de fait a encore été renforcé, ces dernières années, par le processus de décomposition qui affecte l'ensemble du monde capitaliste.
Dans tous les pays, les rivalités sourdes qui s'exacerbent entre les divers clans qui grenouillent au sein de l'appareil d'Etat, se traduisent par des scandales à répétition qui mettent en évidence la pourriture de la classe dominante, la corruption, la prévarication qui gangrènent l'ensemble de l'appareil politique et qui lèvent le voile sur le fonctionnement réel de l'Etat où les politiciens cohabitent étroitement avec des barbouzes de tout acabit et des représentants de toutes sortes de maffias gangstéristes et affairistes, au sein d'officines de pouvoir occulte, inconnues du grand public. Peu à peu cette réalité sordide de l'Etat totalitaire du capitalisme décadent commence à percer l'écran des apparences démocratiques. Cela ne signifie pas pour autant que le poids de la mystification s'est évanoui. La classe dominante sait utiliser sa propre pourriture pour renforcer sa propagande en utilisant les exemples édifiants de ses scandales comme justification de sa lutte pour la pureté démocratique. Même si la crise sape continuellement les bases de la domination bourgeoise et mine son emprise idéologique sur les exploités, met à nu les mensonges continuellement martelés, la classe dominante n'en devient que plus déterminée, plus acharnée à utiliser tous les moyens à sa disposition pour conserver son pouvoir. Le mensonge démocratique s'est installé avec le capitalisme, il ne pourra disparaître qu'avec lui.
Au 19e siècle : une démocratie bourgeoise à l'usage exclusif des bourgeois
Si les fractions dominantes de la bourgeoisie mondiale peuvent se réclamer de la « démocratie », c'est parce que cela correspond à leur propre histoire. La bourgeoisie a fait sa révolution et mis à bas le féodalisme au nom de la démocratie, des libertés. La bourgeoisie organise son système politique en correspondance avec ses besoins économiques. Il lui faut abolir le servage au nom de la liberté individuelle, pour permettre la création d'un prolétariat massif composé de salariés prêts à vendre individuellement leur force de travail. Le parlement est l'arène où les différents partis, représentants des intérêts multiples qui existent au sein de la bourgeoisie, les différents secteurs du capital, s'affrontent pour décider de la composition et des orientations du gouvernement en charge de l'exécutif. Le parlement est alors, pour la classe dominante, un véritable lieu de débat et de décision. Voilà le modèle historique duquel se réclament nos « démocrates » d'aujourd'hui, la forme d'organisation politique que prend la dictature du capital dans sa période juvénile, la forme qu'a prise la révolution bourgeoise en Angleterre, en France, aux Etats-Unis.
Mais il faut noter que déjà, ce modèle classique n'était pas absolument universel. Souvent ces règles démocratiques ont dû subir d'importantes entorses pour permettre à la bourgeoisie de faire sa révolution et d'accélérer le bouleversement social nécessaire à l'affermissement de son système. Il suffit, pour constater cela, de considérer, entre autres, la Révolution française, la terreur jacobine et l'épopée napoléonienne ensuite, et voir le peu de cas que la bourgeoisie pouvait déjà faire de son idéal démocratique lorsque les circonstances l'imposaient. La démocratie bourgeoise était, d'une certaine manière, comme la démocratie athénienne, au sein de laquelle seuls les citoyens pouvaient participer aux décisions, c'est-à-dire ni les femmes, ni les métèques (étrangers), ni les esclaves qui constituaient évidemment la grande majorité de la population.
Dans le système démocratique parlementaire mis en place par la bourgeoisie, seuls les notables sont électeurs : les prolétaires n'ont pas le droit à la parole, ni le droit de s'organiser. Il faudra des années de luttes acharnées de la classe ouvrière, pour arracher le droit d'association, le droit de s'organiser en syndicat, pour imposer le suffrage universel. Que les ouvriers veuillent participer activement à la démocratie bourgeoise pour arracher des réformes ou soutenir les fractions les plus progressistes de la classe dominante, cela n'était pas prévu au programme de la révolution bourgeoise. D'ailleurs, chaque fois que la classe ouvrière est parvenue, par ses luttes, à gagner de nouveaux droits démocratiques, la bourgeoisie s'est employée à en limiter les effets. Ainsi, en Italie, en 1882, lorsqu'une nouvelle loi électorale est promulguée, un des amis du chef du gouvernement d'alors, Depretis, décrivait ainsi l'attitude de ce dernier : « Il craignait que la participation de nouvelles couches sociales à la vie publique n'eut comme conséquence logique des bouleversements profonds dans les institutions de l'Etat. Dès lors, il employa tous les moyens pour se mettre à l'abri, pour opposer des digues solides aux inondations redoutées. » ([1] [1372]). Voilà qui résume parfaitement l'attitude de la classe dominante, la conception de celle-ci de la démocratie et du parlement au 19e siècle. Fondamentalement, les travailleurs en sont exclus. Elle n'est pas faite pour eux, mais pour les besoins de la bonne gestion du capitalisme. Lorsque des fractions plus éclairées de la bourgeoisie soutiennent certaines réformes et se proclament favorables à une plus grande participation des travailleurs au fonctionnement de la « démocratie », par le suffrage universel ou le droit d'organisation syndical, ce sera toujours en vue de permettre un meilleur contrôle de la classe ouvrière, et d'éviter des remous sociaux préjudiciables à la production. Ce n'est pas par hasard si les premiers patrons qui s'organisent et se regroupent en comité, face à la pression des luttes ouvrières, sont ceux de la grande industrie qui sont, en même temps, les plus favorables à des réformes. Dans la grande industrie, les capitalistes, confrontés à la force massive des nombreux prolétaires qu'ils emploient, prennent plus pleinement conscience d'une part de la nécessité de contrôler le potentiel explosif de la classe ouvrière, en lui permettant une expression parlementaire et syndicale et, d'autre part, de la nécessité de réformes (limitation de la journée de travail, interdiction du travail des enfants) qui permettent d'entretenir une force de travail en meilleure santé, et donc plus productive.
Cependant, malgré le fait que les exploités en soient fondamentalement exclus, la démocratie parlementaire au 19e siècle constitue la réalité du fonctionnement de la bourgeoisie. Le législatif domine l'exécutif, le système parlementaire et la démocratie représentative sont une réalité.
Au 20e siècle : un fonctionnement « démocratique » vidé de son contenu
Avec l'entrée dans le 20e siècle, le capitalisme a conquis le monde et, en se heurtant aux limites de son expansion géographique, il rencontre aussi la limitation objective des marchés et donc des débouchés à sa production. Les rapports de production capitalistes se transforment en entraves au développement des forces productives. Le capitalisme comme un tout est entré dans une période de crises et de guerres de dimension mondiale.
Ce bouleversement, déterminant dans la vie du capital a eu pour conséquence une modification profonde du mode d'existence politique de la bourgeoisie et du fonctionnement de son appareil d'Etat.
L'Etat bourgeois est, par essence, le représentant des intérêts globaux du capital national. Tout ce qui concerne les difficultés économiques globales, les menaces de crise et les moyens de s'en dégager, l'organisation de la guerre impérialiste, est affaire d'Etat. Avec l'entrée du capitalisme dans sa période de décadence, le rôle de l'Etat devient donc prépondérant car il est le seul à même de maintenir un minimum d'« ordre » dans une société capitaliste déchirée par ses contradictions et qui tend à l'éclatement. « L'Etat est l'aveu que la société s'empêtre dans une insoluble contradiction avec elle-même » disait Engels. Le développement d'un Etat tentaculaire qui contrôle tous les aspects de la vie économique, politique et sociale est la caractéristique fondamentale du mode d'organisation du capital dans sa phase de décadence, il est la réponse totalitaire de la société capitaliste à sa crise. « Le capitalisme d'Etat est la forme que tend à prendre le capitalisme dans sa phase de déclin » ([2] [1373]).
En conséquence, dans la société bourgeoise, le pouvoir se concentre dans les mains de l'exécutif au détriment du pouvoir législatif. Ce phénomène est particulièrement évident durant la première guerre mondiale où les impératifs de la guerre et l'intérêt national n'autorisent pas le débat démocratique au parlement et imposent une discipline absolue à toutes les fractions de la bourgeoisie nationale. Mais, par la suite, cet état de fait va se maintenir et se renforcer. Le parlement bourgeois devient une coquille vide qui ne possède plus aucun rôle décisionnel.
Cette réalité, la 3e internationale la constate à son deuxième congrès. Elle proclame que « le centre de gravité de la vie politique actuelle est complètement et définitivement sorti du parlement », que « le parlement ne peut être en aucun cas, à l'heure actuelle, le théâtre d'une lutte pour des réformes et pour l'amélioration de la situation de la classe ouvrière, comme il arriva à certains moments à l'époque antérieure ». En effet, non seulement, le capitalisme en crise ne peut plus accorder de réformes durables, mais la classe bourgeoise a définitivement perdu son rôle historique de classe du progrès économique et social, toutes ses fractions deviennent également réactionnaires.
De fait, dans ce processus, les partis politiques de la bourgeoisie perdent leur fonction première, celle de représenter, au sein de la vie « démocratique » bourgeoise qui s'exprimait au parlement, les divers groupes d'intérêts, les différents secteurs économiques du capital. Ils deviennent des instruments de l'Etat chargés de faire accepter la politique de celui-ci aux divers secteurs de la société auxquels ils s'adressent. De représentants de la société civile dans l'Etat, les partis deviennent des instruments de l'Etat pour contrôler la société civile. L'unité de l'intérêt global du capital national que représente l'Etat tend à se traduire par le fait qu'en un certain sens, les partis politiques de la bourgeoisie sont devenus des fractions du parti totalitaire étatique. Cette tendance au parti unique va s'exprimer clairement dans les régimes fascistes, nazis ou staliniens. Mais, même là où la fiction du pluralisme se maintient, dans des situations de crise aiguë telle que la guerre impérialiste, la réalité d'un parti hégémonique ou la domination d'un parti unique s'imposent de fait. Ainsi, à la fin des années 1930 et durant la guerre qui suivit, Roosevelt et le parti démocrate aux Etats-Unis, ou en Grande-Bretagne, pendant la deuxième guerre mondiale avec l'« état d'exception », Churchill et la création du Cabinet de guerre. « Dans le contexte du capitalisme d'Etat, les différences qui séparent les partis bourgeois ne sont rien en comparaison de ce qu'ils ont en commun. Tous partent d'une prémisse générale selon laquelle les intérêts du capital national sont supérieurs à tous les autres. Cette prémisse fait que les différentes fractions du capital national sont capables de travailler très étroitement ensemble, surtout derrière les portes fermées des commissions parlementaires et aux plus hauts échelons de l'appareil d'Etat ». ([3] [1374]) Les dirigeants des partis et les membres du parlement sont en réalité devenus des fonctionnaires d'Etat.
Ainsi, toute l'activité parlementaire, le jeu des partis perdent leur sens du point de vue des décisions que prend l'Etat au nom de l'intérêt supérieur de la nation, c'est-à-dire du capital national. Ils ne sont plus qu'un paravent destiné à masquer le développement de l'emprise totalitaire de l'Etat sur l'ensemble de la société. Le fonctionnement «démocratique» de la classe dominante, même avec les limites qu'il connaissait au 19e siècle, a cessé d'exister, il est devenu une pure mystification, un mensonge.
Le totalitarisme « démocratique » contre la classe ouvrière
Dans ce cas pourquoi maintenir un tel appareil «démocratique» coûteux et délicat à faire fonctionner, s'il ne correspond plus aux besoins du capital? En fait, toute cette organisation conserve une fonction essentielle à un moment où la crise permanente pousse la classe ouvrière vers des luttes pour la défense de ses conditions de vie et vers une prise de conscience révolutionnaire. Celle de dévoyer le prolétariat de son terrain de classe, de le piéger et de l'empêtrer sur le terrain « démocratique ». Dans cette tâche, l'Etat va bénéficier de l'apport des partis dits « socialistes » après 1914, et «communistes» à partir des années 1930. Partis qui, en trahissant la classe qui les a fait naître, en s'intégrant dans l'appareil de contrôle et de mystification de la bourgeoisie, vont crédibiliser le mensonge «démocratique» aux yeux de la classe ouvrière. Alors qu'au 19e siècle le prolétariat doit lutter pour arracher le droit de voter, au 20e siècle dans les métropoles développées, c'est au contraire une propagande intensive qui est menée par l'Etat «démocratique» pour ramener le prolétariat sur le terrain électoral. Il est même des pays, par exemple la Belgique et l'Italie, où le vote devient obligatoire.
De même, sur le plan des syndicats, alors que la lutte pour des réformes a perdu son sens, les syndicats, qui correspondaient au besoin du prolétariat pour améliorer sa situation dans le cadre de la société capitaliste, perdent leur utilité pour la lutte ouvrière. Mais ils ne vont pas disparaître pour autant. L'Etat va s'en emparer et s'en servir pour mieux contrôler la classe exploitée. Ils vont compléter l'appareil de coercition « démocratique » de la classe dominante.
Mais alors, on peut légitimement se poser la question suivante : si l'appareil de mystification démocratique est si utile à la classe dominante, à son Etat, comment se fait-il que ce mode de contrôle de la société ne se soit pas imposé partout, dans tous les pays ? Il est intéressant de noter à cet égard que les deux régimes qui ont symbolisé le plus clairement le totalitarisme étatique au cours du 20e siècle, ceux de l'Allemagne nazie et de l'URSS stalinienne sont ceux qui se sont bâtis sur l'écrasement le plus profond du prolétariat à la suite de l'échec des tentatives révolutionnaires qui ont marqué l'entrée du capitalisme dans sa décadence. Face à un prolétariat profondément affaibli par la défaite, décimé dans ses forces vives par la répression, la question de son encadrement se pose différemment pour la bourgeoisie. La mystification « démocratique » dans ces conditions n'est guère utile et le capitalisme d'Etat totalitaire peut apparaître sans fard, sans masque. De plus, précisément parce que du strict point de vue du fonctionnement de la machine d'Etat, au début du siècle, l'appareil « démocratique » hérité du 19e siècle est devenu superflu, certains secteurs de la bourgeoisie, reconnaissant cet état de fait, théorisent son inutilité. Le fascisme est une expression de cette tendance. Il faut aussi noter que l'entretien d'une lourde machinerie «démocratique» est non seulement dispendieux, mais réclame aussi un fonctionnement économique adéquat pour le crédibiliser et une classe dominante suffisamment expérimentée pour le manier subtilement. Dans les pays sous-développés, la plupart du temps, ces facteurs ne sont pas réunis et la faiblesse du prolétariat local n'encourage pas la bourgeoisie à mettre en place un tel système ; de fait, les dictatures militaires y abondent. Ceci est la traduction du fait que dans ces pays, la faiblesse de l'économie trouve son expression dans la faiblesse de la bourgeoisie locale et que, dans ce cas, l'armée constitue la structure de l'Etat bourgeois la plus à même de représenter l'intérêt global du capital national et va donc constituer l'ossature de l'appareil d'Etat. Ce rôle a aussi pu être joué par des partis uniques militarisés qui s'inspiraient du modèle stalinien comme en Chine par exemple.
Loin d'être l'expression d'une sorte de perversion face à la pureté « démocratique » du capitalisme, les différentes dictatures et Etats ouvertement totalitaires dont l'existence marque toute l'histoire du 20e siècle sont au contraire la manifestation de la tendance générale à l'emprise totalitaire sur tous les aspects de la vie économique, sociale et politique par le capitalisme d'Etat. En fait, ils montrent la réalité du totalitarisme de l'Etat du capitalisme décadent et permettent de comprendre ce qui se cache derrière le vernis démocratique qui recouvre les agissements de la classe dominante dans les pays développés. Il n'y a pas de différence de nature, ni même une bien grande différence dans le fonctionnement de l'Etat qui se prétend « démocratique » ; simplement cette réalité est bien mieux cachée, occultée.
Lorsqu'en France, dans les années 1930, la même assemblée parlementaire qui a été élue avec le Front populaire, vote les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, il ne s'agit pas d'une aberration mais, au contraire, de l'expression limpide de la réalité de l'inanité des prétentions «démocratiques» du jeu parlementaire dans le capitalisme décadent. De même, une fois la guerre finie, l'Etat qui se met en place à la « Libération » est fondamentalement dans la continuité de celui de la collaboration avec l'Allemagne nazie. La police, la magistrature, les oligarchies économiques et même politiques qui s'étaient distinguées par leur zèle collaborationniste, à part quelques rares exceptions utilisées comme victimes expiatoires, restent en place. Il en a été de même en Italie où, comme en France, on estime à 90 % le nombre de responsables de l'Etat qui conservent leur fonction après la chute du régime fasciste.
D'ailleurs, il est aisé de constater que nos « démocraties » ne se sont jamais gênées pour soutenir ou utiliser telle ou telle «dictature» lorsque cela correspondait à leurs besoins stratégiques, ni même d'ailleurs à mettre en place de telles «dictatures». Les exemples ne manquent pas : ainsi les USA en Amérique latine ou bien la France dans la plupart de ses ex-colonies africaines.
L'habileté des vieilles « démocraties » occidentales consiste à utiliser la barbarie et la brutalité des formes les plus caricaturales du capitalisme d'Etat pour masquer le fait qu'elles-mêmes ne font pas exception à cette règle absolue du capitalisme décadent qui est celle du développement du totalitarisme étatique. En fait, seuls les pays capitalistes les plus développés ont les moyens d'entretenir la crédibilité et de manoeuvrer un appareil « démocratique » sophistiqué de mystification et d'encadrement de la classe ouvrière. Dans le monde capitaliste sous-développé, les régimes à apparence « démocratique » sont l'exception et, en général, sont plus le produit d'un soutien efficace d'une puissance impérialiste « démocratique » que l'expression de la bourgeoisie locale. De plus, leur existence est le plus souvent provisoire, soumise aux aléas des fluctuations de la situation internationale. Il faut toute la puissance et l'expérience des fractions les plus anciennes et les plus développées de la bourgeoisie mondiale pour entretenir le grand mensonge du fonctionnement démocratique de l'Etat bourgeois.
Dans sa forme la plus sophistiquée de la dictature du capital qu'est la « démocratie », le capitalisme d'Etat doit parvenir à la gageure de faire croire que règne la plus grande liberté. Pour cela, à la coercition brutale, à la répression féroce doit le plus souvent, lorsque c'est possible, se substituer la manipulation en douceur qui permet d'aboutir au même résultat sans que la victime ne s'en aperçoive. Ce n'est pas là une tâche facile et seules les fractions les plus expérimentées de la bourgeoisie mondiale y parviennent efficacement. Mais pour y parvenir, l'Etat a dû soumettre étroitement à son contrôle l'ensemble des institutions de la société civile. Il a dû développer tout un système tentaculaire, totalitaire.
L'Etat «démocratique» a non seulement organisé tout un système visible et officiel de contrôle et de surveillance de la société, mais il a dédoublé son fonctionnement en tissant une toile de fils occultes qui lui permettent de contrôler et de surveiller les espaces de la société qu'il prétend en dehors de sa compétence. Cela est vrai pour tous les secteurs de la société. Un exemple caricatural est celui de l'information. Un des grands principes dont se vante l'Etat « démocratique » est la liberté de la presse. Il se pose même en garant de la pluralité de l'information. Il est vrai que dans les pays «démocratiques», il existe une presse abondante et le plus souvent une multitude de chaînes de télévision. Mais, à y regarder de plus près, les choses ne sont pas si idylliques. Tout un système administrativo-juridique permet à l'Etat de borner cette « liberté » et de fait, les grands médias sont complètement dépendants de la bonne volonté de l'Etat qui a parfaitement les moyens juridiques et économiques d'étrangler et de faire disparaître un titre de presse. Quant aux grandes chaînes de télévision, leur autorisation d'émettre est directement subordonnée à l'accord de l'Etat. On peut aussi noter que presque partout, l'essentiel des moyens d'« information » sont aux mains de quelques magnats qui, le plus souvent, ont leur fauteuil réservé dans l'antichambre des ministères. On peut même supposer que s'ils bénéficient de cette situation enviable, c'est parce qu'ils ont été mandatés par l'Etat, comme agents d'influence, pour jouer ce rôle. Les grandes agences de presse sont le plus souvent des émanations directes de l'Etat au service de sa politique. Il est parfaitement significatif de constater comment, durant la guerre du Golfe, l'ensemble de la presse «libre» occidentale s'est mise au garde-à-vous pour raconter les gros mensonges de la propagande guerrière, filtrer les nouvelles et manoeuvrer l'opinion au mieux des besoins de « son » impérialisme. A ce moment-là, il n'y avait guère de différence entre la conception « démocratique » de l'information et celle tant vilipendée de la « dictature » stalinienne, ou de celle que, de son côté, imposait Saddam Hussein. Elle ne faisait qu'un avec la plus vile propagande, et les fiers journalistes occidentaux, ces remparts des «libertés», étaient servilement aux ordres, le doigt sur la couture du pantalon, faisant docilement vérifier leurs informations par l'armée avant de les publier. Par souci d'objectivité, sans doute !
Ce gigantesque appareil étatique «démocratique» trouve sa justification, dans les pays développés, dans le besoin vital pour la classe dominante de contrôler les plus grandes concentrations prolétariennes de la planète. Même si la mystification démocratique est un aspect essentiel de la propagande impérialiste des grandes puissances occidentales, il n'en reste pas moins que c'est sur le plan social, du contrôle du prolétariat et de la population en général, qu'elle trouve sa principale justification. C'est d'ailleurs dans ce but d'encadrement social que sont menées les grandes manoeuvres pour lesquelles l'Etat « démocratique » utilise toutes ses ressources de propagande et de manipulation. Une des occasions où l'Etat fait manoeuvrer le plus pleinement son lourd appareil « démocratique » est la grand messe électorale dans laquelle, périodiquement, les «citoyens» sont invités à communier. Les élections, alors qu'elles ont perdu tout sens du point de vue du fonctionnement de l'Etat totalitaire, restent une arme de choix pour atomiser la classe ouvrière dans le vote individualisé, pour dévoyer son mécontentement sur un terrain stérile et crédibiliser l'existence de la « démocratie ». Ce n'est pas par hasard si les Etats « démocratiques » mènent aujourd'hui une lutte acharnée contre l'abstentionnisme et la désaffection des partis, car la participation des ouvriers aux élections est essentielle à la perpétuation de l'illusion démocratique. Cependant, même si la représentation parlementaire n'est plus d'aucune importance pour le fonctionnement de l'Etat, il n'en reste pas moins essentiel que le résultat des élections soit conforme aux besoins de la classe dominante afin d'utiliser au mieux le jeu trompeur des partis et d'éviter leur usure prématurée. Notamment, les partis dits « de gauche » ont un rôle spécifique d'encadrement de la classe ouvrière et leur place vis-à-vis des responsabilités gouvernementales est déterminante dans leur capacité à jouer leur rôle mystificateur et donc à encadrer efficacement la classe ouvrière. Par exemple, il est évident qu'à un moment où ce qui est à l'ordre du jour, quand la crise s'accélère, c'est l'austérité, la gauche au pouvoir perd énormément de sa crédibilité pour prétendre défendre les intérêts de la classe ouvrière et est fort mal placée pour encadrer le prolétariat sur le terrain des luttes. Manipuler les élections pour obtenir le résultat souhaité est donc extrêmement important pour l'Etat. Pour réussir cela, l'Etat a mis en place tout un système de sélection des candidatures, au travers de règles, de lois qui permettent d'éviter des candidats surprises. Mais là, ce n'est pas dans cet aspect officiel qu'est l'essentiel. La presse aux ordres oriente les choix par un martelage idéologique intense. Le jeu subtil des alliances entre partis, les candidatures manipulées pour les besoins de la cause permettent, le plus souvent, d'obtenir finalement le résultat souhaité et la majorité gouvernementale désirée. C'est un constat banal aujourd'hui que, quels que soient les résultats électoraux, c'est finalement toujours la même politique anti-ouvrière qui est menée. L'Etat « démocratique » parvient à conduire sa politique indépendamment des élections qui sont organisées à cadence accélérée. Les élections sont une pure mascarade.
En dehors des élections qui sont la pierre de touche de l'auto-justification «démocratique» de l'Etat, il est beaucoup d'occasions où celui-ci manoeuvre son appareil pour assurer son emprise. Face aux grèves par exemple : dans chaque lutte qu'elle mène sur son terrain, la classe ouvrière voit se dresser face à elle l'ensemble des forces de l'Etat : presse, syndicats, partis politiques, forces de répression, parfois provocations du fait de la police ou d'autres organismes moins officiels, etc.
Ce qui distingue fondamentalement l'Etat « démocratique » des « dictatures », ce ne sont donc pas finalement les moyens employés qui tous sont basés sur l'emprise totalitaire de l'Etat sur la société civile, mais la subtilité et l'efficacité avec lesquels ils sont employés. Cela est particulièrement net sur le plan électoral. Souvent, les « dictatures », elles aussi, cherchent dans des élections ou des référendum une légitimité, mais la pauvreté de leurs moyens fait qu'elles ne sont qu'une caricature de ce que sont capables d'organiser les riches pays industrialisés. Mais il n'y a pas de différence de fond. La caricature ne fait que montrer, à traits forcés, la vérité du modèle. La « démocratie » bourgeoise n'est que la dictature « démocratique » du capital.
L'envers du décor de l'Etat « démocratique »
Alors que la bourgeoisie durant la période ascendante du capitalisme pouvait appuyer sa domination de classe sur la réalité du progrès dont son système était porteur pour l'humanité, dans la période de décadence, cette base non seulement a disparu, mais le capitalisme ne peut plus apporter que la misère d'une crise économique permanente et la barbarie meurtrière du déchaînement de conflits impérialistes à répétition. La classe dominante ne peut plus assurer sa domination de classe et la perpétuation de son système obsolète que par la terreur et le mensonge. Cette réalité va déterminer une évolution en profondeur de la vie interne de la classe dominante et se concrétiser dans l'activité de l'appareil d'Etat.
La capacité de l'Etat, d'une part, à imposer sa force militaire et répressive, et d'autre part, à rendre ses mensonges crédibles, et corollairement à conserver ses secrets, devient l'un des facteurs déterminants de sa capacité à gérer la situation.
Dans cette situation, les secteurs de la bourgeoisie qui vont se hisser dans la hiérarchie de l'Etat sont naturellement ceux qui sont spécialisés dans l'emploi de la force, de la propagande mensongère, de l'activité secrète et dans les manoeuvres tordues de toutes sortes. En clair cela donne l'armée, la police, les services secrets, les clans et sociétés secrètes et les maffias gangsteristes.
Les deux premiers secteurs ont, de tout temps, joué un rôle important dans l'Etat dont ils étaient des piliers indispensables. Nombre de généraux ont ainsi marqué la vie politique de la bourgeoisie au 19e siècle Mais à cette époque, il faut déjà noter que leur arrivée près du centre ou au centre même du pouvoir d'Etat, était le plus souvent le produit de situations d'exception, de difficultés particulières dans la vie du capital national, comme avec la guerre de Sécession aux USA. Cette tendance militariste n'exprimait pas le moins du monde la tendance démocratique de la vie politique bourgeoise, comme sous Napoléon ni en France. Aujourd'hui, il est tout à fait caractéristique qu'une très grande proportion des chefs d'Etat des pays sous-développés soit des militaires et même dans les «démocraties» occidentales, il y ait eu des Eisenhower et des Haig aux USA, ou un De Gaulle en France.
L'accession de responsables de services secrets au pouvoir est par contre un phénomène typique de la période de décadence qui traduit bien les préoccupations présentes de la bourgeoisie et le fonctionnement interne des plus hautes sphères de l'Etat. Ce fait est particulièrement visible, encore une fois, à la périphérie du capitalisme, dans le monde sous-développé. Le plus souvent les généraux qui s'y emparent des présidences, sont les chefs des services secrets de l'armée et, très fréquemment, lorsqu'une personnalité civile accède à la tête de l'Etat, il est intéressant de constater, qu'auparavant, elle a fait sa carrière à la direction des services secrets « civils » ou de la police politique.
Mais cet état de fait n'est pas l'exclusivité des pays sous-développés d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique latine. En URSS, Andropov était le patron du KGB, Gorbatchev en avait été un responsable et l'actuel président de Géorgie, Chevardnadze en est un ancien général. Particulièrement significatif est l'exemple de Bush aux USA, « le pays le plus "démocratique" du monde ». Il était un ancien directeur de la CIA. Et ce ne sont là que les exemples les plus connus. Il n'est pas de notre ressort, ni de nos moyens -d'ailleurs tel n'est pas notre but - de dresser une liste exhaustive, mais il serait cependant intéressant de noter la quantité impressionnante de responsables politiques, de ministres, de parlementaires qui, avant d'occuper ces «honorables» fonctions, ont fait leurs classes dans un service secret d'une sorte ou d'une autre.
La multiplication de polices parallèles, de services tous plus secrets les uns que les autres, d'officines occultes de toutes sortes est un aspect particulièrement saillant de la vie sociale dans les pseudo-démocraties d'aujourd'hui. Cela trahit les besoins et la nature des activités de l'Etat. Sur le plan impérialiste bien sur : espionnage, provocation, chantage, assassinats, manipulations de toutes sortes sur le plan international, pour la défense des intérêts impérialistes nationaux, sont devenus monnaie courante. Mais cela n'est que l'aspect « patriotique » le plus «avouable» de l'activité des services secrets. C'est sur le plan intérieur que cette activité occulte de l'Etat s'est certainement le plus développée. Fichage systématique de la population, surveillance des individus, développement des écoutes téléphoniques «officielles» et clandestines, provocations de toutes sortes destinées à manoeuvrer l'opinion publique, infiltration de tous les secteurs de la société civile, financements occultes, etc., la liste est longue des activités pour lesquelles l'Etat a recruté une main-d'oeuvre abondante et qui sont menées dans le secret afin de ne pas entacher le mythe de la « démocratie » Pour exécuter ces tâches délicates l'Etat a recruté le ban et l'arrière-ban de la société, les services des diverses maffias ont été appréciés et la distinction entre gangster et agent secret s'est faite de plus en plus floue car ces spécialistes du crime ont su, à l'occasion, vendre au mieux leurs compétences et rendre d'appréciables services. Depuis de nombreuses années, l'Etat a investi les divers réseaux d'influence qui existaient dans la société, sociétés secrètes, maffia, sectes, pour les mettre au service de sa politique internationale et nationale, permettant du même coup leur ascension au sein des sphères dirigeantes. De fait l'Etat «démocratique» fait exactement la même chose que les « dictatures » qu'il dénonce, mais plus discrètement. Les services secrets sont non seulement au coeur de l'Etat, mais ils sont aussi ses antennes au sein de la société civile.
Parallèlement à ce processus qui a permis la progression, au sein de l'Etat, de fractions de la bourgeoisie dont le mode d'existence était basé sur le secret, l'ensemble du fonctionnement de l'Etat s'est occulté. Derrière l'apparence gouvernementale, les centres de décisions sont devenus invisibles. Nombre de ministres n'ont pas de pouvoir réel et sont là pour amuser la galerie. Cette tendance a trouvé une expression cynique avec le président Reagan dont les piètres talents d'acteur lui ont permis de parader sur la scène médiatique, mais dont le rôle n'était certainement pas de définir des orientations politiques. Pour cela d'autres centres de décision existent qui sont, la plupart du temps, ignorés du grand public. Dans un monde où les médias de propagande idéologique ont pris une importance grandissante, la qualité qui est devenue de plus en plus essentielle pour un homme politique est de bien savoir parler, de bien « passer » à la télévision. Parfois cela seul suffit pour faire carrière. Mais derrière les «bêtes de scène» politiques chargées de donner figure humaine à l'Etat, se cachent une multitude de comités, officines, lobbies animés par des éminences grises couleur muraille, le plus souvent inconnus du public et qui, par-delà les fluctuations gouvernementales, assurent la continuité de la politique étatique et donc la réalité du pouvoir.
Ce fonctionnement de plus en plus dissimulé de l'Etat ne signifie pas pour autant que les divergences, les antagonismes d'intérêts ont disparu au sein de la classe dominante. Au contraire, avec la crise mondiale qui s'approfondit, les divisions s'exacerbent au sein même de chaque bourgeoisie nationale. De manière évidente, des fractions se cristallisent sur le choix des alliances impérialistes. Mais là n'est pas le seul facteur de division au sein de la classe bourgeoise. Les choix économiques, l'attitude à adopter face à la classe ouvrière sont autant de motifs qui cristallisent des débats et des désaccords, et aussi, bien sûr, le sordide intérêt pour la puissance et le pouvoir, source de richesse, au-delà de réelles divergences d'orientation, est une source permanente de conflits entre les différents clans de la classe dominante. Ces divergences au sein de celle- ci ne trouvent plus tant leur expression sur le plan de la division en partis politiques, c'est-à-dire à un niveau visible, qu'au travers de la formation de cliques qui cohabitent à tous les échelons de l'Etat et dont l'existence est cachée au commun des mortels. La guerre que se mènent ces clans pour gagner une influence au sein de l'appareil d'Etat est sévère et pourtant, le plus souvent, elle n'apparaît pas au grand jour. De ce point de vue, là encore, rien ne distingue les « dictatures » des « démocraties ». Fondamentalement, la guerre pour le pouvoir se mène en dehors de la connaissance du plus grand nombre.
La situation actuelle de crise économique exacerbée, de bouleversement des alliances à la suite de l'effondrement du bloc de l'Est pousse à l'exacerbation des rivalités et de la guerre que se mènent les clans capitalistes au sein de l'Etat. Les divers scandales, les « suicides » à répétition d'hommes politiques et d'hommes d'affaires qui émaillent de plus en plus l'actualité depuis quelques années sont la manifestation visible de cette guerre de l'ombre qui s'exacerbe entre les divers clans de la bourgeoisie. La multiplication des « affaires » est une occasion qui permet d'avoir un aperçu de la réalité du fonctionnement réel de l'Etat par-delà l'écran de fumée « démocratique ». La situation en Italie est à cet égard particulièrement révélatrice. L'affaire de la Loge P2, l'affaire Gladio, les scandales maffieux et les scandales de la corruption des hommes politiques illustrent de manière exemplaire la réalité du cadre de compréhension de la réalité totalitaire du fonctionnement de l'Etat «démocratique» que nous avons abordé dans cet article. L'exemple concret de l'Italie constituera l'ossature de la seconde partie de cet article.
JJ.
Articles de référence : Brochure : « La décadence du capitalisme », Revue Internationale n° 31 : « Machiavélisme, conscience, unité de la bourgeoisie », Revue Internationale n° 66 : « Les massacres et les crimes des 'Grandes Démocraties' ».
Questions théoriques:
- Décomposition [3]
Polémique avec le BIPR : tirer les leçons des expériences négatives
- 3705 reads
Quelle méthode ? Quelles perspectives pour le rapprochement des organisations révolutionnaires ?
Au moment où une nouvelle reprise de la combativité prolétarienne se développe internationalement, posant avec encore plus d'acuité la question d'une plus grande unité au sein du milieu révolutionnaire, il est important que les organisation révolutionnaires sachent tirer un bilan de ce qui a été fait dans ce domaine au cours des dernières années, et qu'elles en tirent des leçons pour le futur.
L'objet de cet article est de contribuer à cet effort. Il s'attache plus particulièrement à la critique de l'expérience du BIPR. Nous le faisons non pas dans un esprit de « concurrence » mais de sincère et fraternelle confrontation. Notre objectif n'est pas de critiquer des pratiques et habitudes du BIPR en soi, mais d'illustrer, à travers les difficultés de cette organisation, les erreurs à ne pas commettre.
Au cours des deux dernières années, quelque chose a commencé à bouger au sein du milieu politique prolétarien : une certaine conscience a commencé à émerger - même si c'est de façon très sporadique et hésitante - du fait que les révolutionnaires doivent se rassembler s'ils veulent être à la hauteur de leurs responsabilités.
L'Appel du CCI
En 1991, le 9e congrès du CCI publiait un Appel au milieu politique prolétarien. Il s'agissait d'un appel au combat contre le sectarisme qui pèse au sein de ce milieu et un encouragement à voir dans ce combat une question vitale pour la classe ouvrière.
Il traduisait lui même les frémissements d'un premier changement d'ambiance dans le milieu politique prolétarien.
«A la place du total isolement sectaire, nous trouvons aujourd'hui dans les différents groupes une plus grande disposition à exposer leurs critiques réciproques dans la presse ou dans les réunions publiques. Il existe en plus un appel explicite des camarades de Battaglia Comunista à surmonter la dispersion actuelle, appel dont nous partageons en grande partie les arguments et les buts. Il existe enfin - et ce doit être encouragé au maximum - une poussée contre l'isolement sectaire, qui vient d'une nouvelle génération d'éléments que le tremblement de terre de ces deux dernières années pousse vers les positions de la gauche communiste et qui restent pantois devant l'extrême dispersion dont ils n'arrivent pas à comprendre les raisons politiques. »
(...)
«Aujourd'hui, l'hypothèque que le capitalisme en décomposition fait peser sur la classe ouvrière est la perte de son unité de classe, à travers mille affrontements fratricides, des sables du Golfe aux frontières de la Yougoslavie. C'est pour cela que la défense de cette unité est une question de vie ou de mort pour notre classe. Mais quelle espérance pourrait désormais avoir le prolétariat de maintenir cette unité, si son avant-garde consciente elle-même, renonçait à combattre pour son unification ? Qu'on ne vienne pas nous dire que c'est un 'embrassons-nous tous', un 'escamotage opportuniste des divergences', un appel à une 'unité indifférenciée au mépris des principes'. Rappelons-nous que ce fut justement la participation aux discussions de Zimmerwald qui permit aux bolcheviks de réunir la Gauche de Zimmerwald, embryon de la future Internationale communiste et de la séparation définitive avec les sociaux-démocrates. »
L'appel poursuivait :
« Il ne s'agit pas de cacher les divergences pour rendre possible un 'mariage' entre groupes, mais de commencer à exposer et à discuter ouvertement des divergences qui sont à l'origine de l'existence des différents groupes.
Le point de départ, c'est de systématiser la critique réciproque des positions dans la presse. Cela peut paraître une banalité, mais il y a encore des groupes révolutionnaires qui, dans leur presse, font semblant d'être seuls au monde.
Un autre pas qui peut être fait immédiatement, c'est de systématiser la présence et l'intervention aux réunions publiques des autres groupes.
Un pas plus important est la confrontation des positions dans des réunions publiques, convoquées conjointement par plusieurs groupes, face à des événements d'une importance particulière, comme la guerre du Golfe. »
Des petits pas
Notre appel n'a rencontré aucune réponse explicitement favorable de la part des autres organisations prolétariennes. Et pourtant, quelques petits pas ont été réalisés ici et là :
- le groupe bordiguiste, qui publie Il comunista et Le prolétaire, a publié des polémiques ouvertes avec d'autres organisations bordiguistes et avec BC ;
- la Communist Workers Organisation (CWO) de Grande-Bretagne, à ouvert les pages de sa presse à d'autres groupes, a participé avec d'autres groupes à un cercle de discussion dans le nord de l'Angleterre, et a pris récemment l'initiative, peu fréquente, d'inviter le CCI à une réunion de lecteurs à Londres ;
- au cours des deux dernières années, le BIPR (Bureau international pour le parti révolutionnaire), formé par BC et la CWO, en 1984, a ouvert ses stands aux publications du CCI au cours de la fête annuelle du groupe Lutte ouvrière à Paris ([1] [1378]) ;
- BC a publié BC Inform une publication restreinte destinée à l'information des groupes prolétariens internationalement ;
- plusieurs groupes prolétariens à Milan (y compris BC, Programma et le CCI) ont participé ensemble dans une action de dénonciation à l'occasion de la visite de Ligatchev (ancien membre du Polit-Bureau de 1’URSS) invité par des staliniens locaux. Même si de fortes critiques peuvent être faites à cette action, elle n'en traduisit pas moins une volonté de rompre l'isolement. Une volonté qui se concrétisa à nouveau peu de temps après par la participation des mêmes groupes à une journée d'exposition débat de la presse internationaliste.
Ces initiatives constituent sans aucun doute des pas dans la bonne direction. Mais ces derniers sont-ils suffisants pour nous permettre de penser que le milieu politique prolétarien est véritablement en train de se donner les moyens d'assumer ses responsabilités au niveau qu'exige la gravité de la situation ? Nous ne pensons pas que ce soit le cas.
En réalité, même si nous considérons bienvenue la nouvelle « ouverture » des groupes prolétariens, nous sommes forcés de constater qu'il s'agit plutôt d'une réponse empirique à la nouvelle situation mondiale que d'une véritable réévaluation fondée sur une analyse en profondeur.
La nécessité d'une méthode
Le regroupement des révolutionnaires ne peut se faire au hasard. Il exige une méthode consistante, fondée sur l'ouverture au débat, combinée avec une rigoureuse défense des principes.
Une telle méthode doit éviter deux dangers :
- d'une part, tomber dans le « débat pour le débat », dans des bavardages académiques où chacun dit ce qu'il veut sans se soucier de créer une dynamique vers des actions communes ;
- d'autre part, croire qu'il serait possible d'entreprendre un « travail commun » sur une base purement « technique », sans clarté préalable sur les principes, clarté qui ne peut être atteinte que par le débat ouvert.
Un manque de méthode peut être excusé chez de jeunes groupes qui manquent d'expérience du travail révolutionnaire. Ce n'est pas le cas pour des organisations qui se réclament de l'héritage de la Gauche italienne et de l'Internationale communiste. Or, lorsqu'on se penche sur l'histoire du BIPR on ne peut que constater, premièrement, qu'il n'y a aucune méthode solide de regroupement des révolutionnaires, deuxièmement, que le manque de méthode a stérilisé les efforts réalisés.
Si nous critiquons le BIPR, nous n'en tirons pour autant aucune satisfaction. Nous avons et avons eu nos propres difficultés, en particulier au cours des années 1980. Nous ne sommes que trop conscients de la terrible fragilité de l'ensemble du milieu révolutionnaire aujourd'hui, surtout si l'on compare cette faiblesse avec les énormes responsabilités qui sont aujourd'hui celles de la classe ouvrière et de ses organisations politiques. Si nous nous penchons sur les défauts du mouvement, par le passé et actuellement, c'est pour les dépasser et ainsi mieux nous préparer à affronter l'avenir. Les révolutionnaires n'étudient pas l'histoire de leur classe à la recherche de « recettes » ou de « formules magiques », mais pour tirer profit de cette expérience historique en vue d'affronter les problèmes du présent. Quelques fois ils peuvent oublier qu'ils font eux-mêmes partie de cette histoire. Après tout, Battaglia Comunista existe depuis au moins 1952, et le CCI constitue déjà l'organisation politique prolétarienne qui a vécu le plus longtemps en tant que corps internationalement organisé et centralisé, dans l'histoire de la classe ouvrière. Les Conférences internationales tenues à la fin des années 70 ont leur place dans l'histoire du prolétariat, tout comme celles de Zimmerwald ou de Kienthal. L'histoire du milieu prolétarien depuis ces Conférences n'est pas une question « d'intérêt archéologique » comme l'a affirmé BC (Workers'Voice, n° 62). Cette période a constitué en réalité un terrain d'expérimentation pratique des différentes conceptions de l'intervention et du regroupement qui se sont exprimées au cours de ces Conférences.
Le prolétariat a une tâche historique à accomplir : le renversement du capitalisme et la construction de la société communiste. Pour mener à bien cette tâche, il ne dispose que de deux armes : sa conscience et son unité. Il en découle pour les révolutionnaires une double responsabilité : intervenir dans la classe ouvrière pour défendre le programme communiste, et travailler en vue du regroupement des révolutionnaires comme une expression de l'unité de la classe.
Nous n'avons pas à hésiter sur l'objectif d'un tel regroupement : la formation du parti mondial communiste, la dernière internationale, sans laquelle la victoire d'une révolution communiste est impossible.
Le travail de regroupement a plusieurs facettes, liées entre elles mais distinctes :
- l'intégration d'individus militants au sein des organisations communistes, le principe de l'action prolétarienne étant celui de l'action collective et organisée sur la base d'un engagement commun à la cause communiste ;
- les organisations des pays au centre du capitalisme, où l'expérience historique du prolétariat est la plus importante, ont une responsabilité particulière vis-à-vis des groupes qui surgissent dans les pays de la périphérie dans les pires conditions de précarité et d'isolement politique ; ces groupes ne peuvent survivre et contribuer à l'unification mondiale de la classe ouvrière qu'en brisant leur isolement et en s'intégrant dans un mouvement plus large ;
-enfin, toutes les organisations communistes, et surtout celles qui ont une filiation historique avec les organisations de la classe ouvrière dans le passé, ont la responsabilité de montrer à leur classe qu'il y a une différence fondamentale, une frontière de classe, entre les groupes et organisations qui défendent fermement les principes internationalistes, d'une part, et les partis « socialistes » ou « communistes » dont la seule fonction est de renforcer l'emprise de la bourgeoisie sur les exploités, d'autre part. En d'autres termes, les communistes doivent clairement définir et défendre le milieu politique prolétarien.
Si nous voulons que les efforts encore hésitants faits aujourd'hui aboutissent à quelque chose, cela ne pourra être fait que sur la base d'un abandon du manque de méthode, des attitudes opportunistes et du sectarisme dont le BIPR a fait preuve depuis sa formation en 1984.
Les Conférences internationales de la Gauche communiste
On ne peut dans cet article reprendre l’histoire détaillée des Conférences internationales ([2] [1379]). Mais nous devons en rappeler quelques éléments.
La première Conférence appelée par BC ([3] [1380]) se tint à Milan, en mai 1977 ; la deuxième à Paris, en novembre 1978 ; la troisième également.à Paris, en mai 1980. Outre BC, la CWO et le CCI, y participèrent plusieurs groupes se situant sur le terrain de la Gauche communiste ([4] [1381]).
Les critères pour participer aux Conférences, tels qu'ils furent définis, puis précisés, lors des deux premières Conférences, étaient les suivants :
«-Reconnaissance de la révolution d'Octobre comme révolution prolétarienne ;
-Reconnaissance de la rupture avec la social-démocratie effectuée par le premier et le deuxième congrès de l'IC ;
- Rejet sans réserve du capitalisme d'Etat et de l'autogestion ;
- Rejet de tous les partis communistes et socialistes en tant que partis bourgeois ;
- Orientation vers une organisation de révolutionnaires qui se réfère à la doctrine et à la méthodologie marxiste comme science du prolétariat ;
- Reconnaissance du refus de l'encadrement du prolétariat derrière, et sous une forme quelconque, les bannières de la bourgeoisie. » ([5] [1382])
Le CCI soutenait l'idée des Conférences telles qu'elles avaient été proposées par la lettre initiale de BC:
« Dans une situation telle que celle que nous vivons, où la dynamique des choses progresse beaucoup plus vite que la dynamique du monde des hommes, la tâche des forces révolutionnaires est d'intervenir dans les événements par un retour à la volonté réalisatrice sur le terrain où elle a pris naissance et qui est propre aujourd'hui à l'accueillir. Mais la Gauche communiste faillirait à sa tâche si elle ne se donnait pas des armes efficaces du point de vue de la théorie et de la pratique politique, c'est-à-dire :
a) avant tout, sortir de l'état d'infériorité et d'impuissance où l'ont menée le provincialisme de querelles culturelles empreintes de dilettantisme, l'infatuation incohérente qui ont pris la place de la modestie révolutionnaire, et surtout l'affaiblissement du concept de militantisme compris comme sacrifice dur et désintéressé ;
b) établir une base programmatique historiquement valable, laquelle est, pour notre parti, l'expérience théorico-pratique qui s'est incarnée dans la révolution d'Octobre et, sur le plan international, l'acceptation critique des thèses du 2e congrès de l'IC ;
c) reconnaître que l'on ne parvient ni à une politique de classe, ni à la création du parti mondial de la révolution, ni d'autant moins à une stratégie révolutionnaire si l'on ne décide pas d'abord de faire fonctionner, dès à présent, un Centre international de liaison et d'information qui soit une anticipation et une synthèse de ce que sera la future Internationale, comme Zimmerwald, et plus encore Kienthal, furent l'ébauche de la 3e Internationale. » ([6] [1383])
« La Conférence devra indiquer aussi comment et quand ouvrir un débat sur des problèmes par exemple tels que le syndicat, le parti et tant d'autres qui divisent actuellement la Gauche communiste internationale, ceci, si nous voulons qu'elle se conclue positivement et représente un premier pas vers des objectifs plus vastes et vers la formation d'un front international des groupes de la Gauche communiste qui soit le plus homogène possible, si nous voulons enfin sortir de la tour de Babel idéologique et politique et d'un ultérieur démembrement des groupes existants. » ([7] [1384])
BC donnait à la Conférence des objectifs qui allaient encore plus loin : «... nous retenons que la gravité de la situation générale... impose des prises de position précises, responsables et surtout en accord avec une vision unitaire des différents courants au sein desquels se manifeste internationalement la Gauche communiste... » ([8] [1385])
Cependant, au cours des Conférences, le moins qu'on puisse dire c'est que BC n'a pas brillé par sa cohérence. Loin de défendre la nécessité de «prises de position précises, responsables » BC a systématiquement refuse la moindre prise de position commune : « Nous sommes opposés, par principe, à des déclarations communes, car il n'y a pas d'accord politique. » (Intervention de BC à la 2e Conférence) ([9] [1386]); «Ce n'est pas le plus ou moins grand nombre de groupes signant la résolution (sur la situation internationale, proposée par le CCI) qui donnera à celle-ci un plus ou moins grand poids dans la classe » (Intervention de BC à la 3e Conférence).
Il vaut la peine de rappeler que la 3e Conférence se tint peu de temps après l'invasion de l'Afghanistan par l’URSS, et que tous les groupes participants étaient d'accord sur la nature impérialiste de ce pays, l'inévitabilité de la guerre sous le capitalisme, et sur la responsabilité du prolétariat comme seule force capable de faire reculer la marche vers la guerre. Tous ces points d'accord étaient certainement suffisants pour marquer clairement la séparation entre la Gauche communiste et les trotskistes, les staliniens, les socialistes et les divers «démocrates» qui demandaient aux travailleurs d'appuyer un des deux camps dans la confrontation entre les blocs impérialistes des USA et de l'URSS en Afghanistan. ([10] [1387])
Suite à l'échec des Conférences, BC pouvait écrire en 1983: «Les Conférences ont rempli leur tâche essentielle qui était de créer un climat de confrontation et de débat au niveau international au sein du camp prolétarien (...) nous les considérons comme des instruments de classification et de sélection politique au sein du camp révolutionnaire ». ([11] [1388])
Mais qu'est-il advenu du «Centre international de liaison et d'information » ? Où est le «front international des groupes de la Gauche communiste » ?
Le Bureau international pour le parti révolutionnaire
Evidemment, tout le monde peut changer d'avis, même une «force de direction sérieuse », comme aime à se qualifier BC. Après avoir défini un « camp révolutionnaire » de groupes sérieux (en fait réduit à eux-mêmes), situé au sein d'un « camp prolétarien » (qui, entre autres, inclut le CCI, merci), BC et la CWO avaient décidé de convoquer une 4e Conférence internationale et de fonder le BIPR.
Au cours d'une de ses dernières interventions dans la 3e Conférence BC déclara :
« Nous voulons aller à une quatrième Conférence qui soit un lieu de travail et non de simple discussion... Travailler ensemble c'est reconnaître un terrain commun. Par exemple, un travail commun ne peut être entrepris qu'avec des groupes qui reconnaissent la nécessité de créer des groupes ouvriers d'avant-garde, s'organisant sur une plate-forme révolutionnaire. »
Dans Revolutionary Perspectives n° 18, la CWO a aussi annoncé son intention de «développer des discussions et un travail commun en vue du regroupement de la CWO avec le PCInt (BC). Ceci ne veut pas dire que nous soyons proches de la fin d'un tel processus, ni non plus que des questions seront mises de côté ou oubliées, mais notre récente coopération à la 3e Conférence nous rend optimistes quant à la réalisation d'une conclusion positive. » On proclama donc la nécessité d'une 4e Conférence internationale qui « ne reproduise pas les limitations de ses précédentes mais qui constitue la condition préliminaire pour rendre possible un travail politique commun à une échelle internationale. »
Peu de temps après fut constitué le BIPR. La quatrième Conférence s'était tenue et avait abouti a un fiasco total. ([12] [1389]) Depuis lors l'expérience n'a pas été recommencée. Cependant, le premier numéro de la revue du BIPR, Communist Review, constatait que : « Dans les Conférences, les groupes et organisations appartenant au camp politique prolétarien se rencontrent, convergent et se confrontent ». La plat-forme du Bureau devait représenter « un moment dans la synthèse des plates-formes des groupes au niveau national ».
Quelle est la situation neuf ans plus tard ? Les Conférences internationales sont restées lettre morte. Il n'y pas eu de regroupement entre BC et la CWO. Qui plus est, et d'après ce qui ressort de leur presse, il n' y a même pas eu de discussion entre eux pour résoudre leurs divergences, par exemple sur la question syndicale ou parlementaire. Les camarades français du BIPR, qui en 1984 avaient « l'intention de jeter les bases d'une reconstruction organisationnelle du mouvement révolutionnaire sur les positions organiques mises en avant par le BIPR », ont disparu sans laisser de trace. Le seul autre groupe qui a rejoint le BIPR, Lai Pataka, en Inde, a sombré dans un fatras de diatribes anti-BIPR, et a, lui aussi, disparu.
Les treize années depuis la 3e Conférence ont violemment mis à l'épreuve le milieu prolétarien : beaucoup de forces militantes, dont la classe ouvrière a tant besoin, se sont évaporées. Il suffit de regarder ce que sont devenus la plupart des groupes participant aux Conférences (y compris ceux qui ne le firent qu'épistolairement) : Forbundet Arbetarmakt (Suède), l'Eveil internationaliste (France), l'Organisation communiste révolutionnaire internationaliste d'Algérie ont disparu. Le Groupe communiste internationaliste (GCI) s'est rapproché du gauchisme avec ses ambiguïtés sur l'appui à « Sentier lumineux ». Les Nuclei Comunisti Internazionalisti (NCI), à travers les diverses mutations qui les ont amenés à la constitution de l'OCI, se sont jetés dans le camp de la bourgeoisie pendant la guerre du Golfe en appuyant l'Irak. Le FOR, Ferment ouvrier révolutionnaire, se délite.
La disparition de certains de ces groupes traduisait certainement la nécessité d'une inévitable décantation. Et il ne saurait être question de refaire l'histoire avec des « si », il n'en demeure pas moins que l'échec des Conférences signait la disparition d'un lieu où la Gauche communiste pouvait se définir elle-même et affirmer sa nature révolutionnaire face aux multiples variétés de gauchisme. Pour les nouveaux groupes à la recherche d'une cohérence, ce fut la disparition d'un solide point de repère qui aurait été utile dans la tempête idéologique de la décomposition du capitalisme. Aujourd'hui, les groupes qui surgissent sans pouvoir s'identifier complètement avec les positions politiques des organisations existantes au sein de la Gauche communiste, sont condamnés à un isolement quasi-total, avec tout ce que cela entraîne, en termes de stagnation politique, de démoralisation et d'ouverture à l'infiltration de l'idéologie bourgeoise et petite-bourgeoise.
Le BIPR a été
incapable de fournir une alternative aux Conférences. Celles-ci sont restées
au niveau de projets. Il n'en est toujours rien du regroupement annoncé entre
la CWO et BC.
Le BIPR en Inde
Si l'on veut comprendre pourquoi le BIPR n'est pas parvenu à mener à bien un seul regroupement solide, il est utile de jeter un coup d'oeil à la tentative d'intégration du groupe indien Lai Pataka dans le BIPR.
Le BIPR s'est toujours fait des illusions sur la possibilité de regroupement avec des organisations ayant leurs origines dans le camp ennemi, et plus particulièrement dans le gauchisme. Ces illusions sont elles-mêmes liées à une attitude ambiguë, dont BC n'est jamais parvenue à se défaire, envers les mouvements de masses sur un terrain non-prolétarien. Au cours de la 2e Conférence, BC avait pu dire que la tâche des communistes est « d'être en tête des mouvements de libération nationale » et « de travailler dans le sens d'un clivage de classe au sein du mouvement, et non de le juger de l'extérieur ». Ces positions ont été reprises dans les thèses sur Les tâches des communistes dans la périphérie du capitalisme. La conclusion en est la suivante :
« Dans ces pays (de la périphérie), la domination du capital ne s'étend pas encore à toute la société, le capital n'a pas soumis l'ensemble de la collectivité aux lois de l'idéologie du capital comme il l'a fait dans les pays centraux. Dans les pays de la périphérie, l'intégration politique et idéologique des individus dans la société capitaliste ne constitue pas un phénomène de masse comme dans les pays centraux, parce que l'individu exploité, frappé par la misère et l'oppression, n'est pas encore l'individu citoyen des formations capitalistes d'origine. Cette différence avec les pays centraux rend possible l'existence d'organisations communistes de masse dans la périphérie. (...) Ces 'meilleures' conditions impliquent la possibilité d'organiser des masses de prolétaires autour du parti prolétarien. » ([13] [1390])
Nous avons toujours dit que c'est une erreur fatale de croire que les communistes peuvent, d'une façon ou d'une autre, «prendre la tête » de mouvements de libération nationale, de luttes nationalistes révolutionnaires, ou quel que soit le nom que l'on donne à ces luttes de « nations ». De telles luttes sont, en fait, une attaque directe contre la conscience du prolétariat, parce qu'elles noient la seule classe révolutionnaire dans la masse du « peuple », un danger particulièrement important dans les pays périphériques, où le prolétariat est largement dépassé en nombre par la paysannerie et par les masses de pauvres sans terre et sans travail.
Nous savons cela, non seulement par la théorie, mais aussi par la pratique. La plus vieille section du CCI, au Venezuela, se forma en opposition directe aux idéologies guévaristes de « libération nationale » en vogue dans les années 1960 dans toute la gauche. Plus récemment, notre expérience de formation d'une section au Mexique a confirmé, si c'était encore nécessaire, qu'une solide présence communiste ne peut être établie que sur la base d'une confrontation directe avec toutes les variétés de gauchisme et par l'établissement d'une rigoureuse frontière de classe entre le gauchisme, aussi « radical » soit-il, et les positions prolétariennes.
De la «Quatrième Conférence internationale», tenue avec des défenseurs du PC iranien, jusqu'à la correspondance fraternelle avec le groupe « marxiste-léniniste » Revolutionnary Proletarian Platform (RPP) en Inde, le BIPR n'a jamais réussi à établir cette claire séparation. Aussi n'y a-t-il rien de surprenant à ce que des gauchistes soient eux-mêmes plus conscients des divisions qui les opposent aux communistes. Ainsi le RPP pouvait écrire au BIPR :
« ... sur la question de la participation dans des syndicats réactionnaires et dans les parlements bourgeois, il nous est difficile d'être d'accord avec vous ou avec tout courant qui rejette totalement une telle participation. Même si nous reconnaissons que votre position sur les syndicats (...) est beaucoup plus saine que celle du CCI (qui considère que les syndicats ont été intégrés dans l'Etat bourgeois et doivent comme tels être détruits), il nous semble que sur le fond, elle demeure une critique de l'approche bolchevique-léniniste, à partir d'un point de vue d'extrême gauche, car elle part des mêmes prémisses théoriques que le CCI et les courants similaires. » ([14] [1391])
L'ironie veut que la CWO semble être parvenue maintenant à notre position sur l'impossibilité que des groupes (contrairement aux individus) puissent passer du camp bourgeois au camp prolétarien : « La politique de ces groupes (trotskistes) se situe sans aucun doute dans l'aile gauche du capital et ce serait une énorme erreur de s'imaginer que de telles organisations puissent revenir dans le camp du communisme internationaliste. »([15] [1392])
Mais ni la CWO, ni BC, ni le BIPR n'ont été capables de comprendre cela dans leur attitude envers les partisans du PC Iranien en exil (SUCM) ou envers l'organisation maoïste indienne RPP (et il n'est pas inutile de rappeler que le maoïsme, contrairement au trotskisme, n'a jamais appartenu au camp prolétarien). Au contraire. Après l'exclusion du CCI de la 3e Conférence internationale, au lendemain du fiasco de la 4e, tenue avec comme seul « invité » le SUCM, le BIPR se réjouissait de mener avec le RPP en Inde « une bataille politique contre les partisans (du CCI) » ([16] [1393]) et d'accepter que la section bengali du RPP et son journal se dirigent comme un tout vers « le camp du communisme internationaliste ».
Dans le n° 11 de la Communist Review, une « Prise de position sur Lai Pataka » fait remarquer que : « Quelques esprits cyniques peuvent penser que nous avons accepté ce camarade trop rapidement dans le BIPR ». Nous ne faisons pas partie de ces « esprits cyniques ». Le problème ne réside pas dans la « précipitation » du BIPR à « accepter » Lai Pataka, mais dans une faiblesse congénitale du BIPR lui-même. Comment le BIPR pourrait-il aider les autres à surmonter leurs confusions et à rompre avec l'idéologie bourgeoise, alors que lui-même entretient des ambiguïtés sur des questions telles que le syndicalisme, et s'avère incapable de tracer une nette démarcation entre communistes et gauchistes. Vue l'incapacité de BC et de la CWO à conduire leurs propres discussions jusqu'au regroupement, comment le BIPR pourrait-il fournir un solide point de référence pour ceux qui évoluent vers des positions communistes ?
Les flirts
opportunistes avec le gauchisme de la part du BIPR s'accompagnent logiquement
d'une attitude sectaire vis-à-vis de groupes qui ne sont pas dans sa «sphère d'influence ». Ainsi, le numéro
3 de la Communist Review qui traite
assez longuement des groupes en Inde, ne fait aucune mention du groupe qui
publiait Communist Internationaliste ni du groupe qui publiera plus tard
Kamunist Kranti, bien que ces deux groupes fussent connus, au moins de la CWO.
Puis vers 1991, Lai Pataka disparaît des pages de Workers Voice et se voit remplacé
par Kamunist Kranti : « Nous espérons
que, dans l'avenir, de fécondes relations pourront être établies entre le
Bureau international et Kamunist Kranti ». Deux ans plus tard, tout porte
à croire que ces rapports sont restés stériles, puisque le n° 11 de Communist Review dit : « c'est une tragédie que, malgré l'existence
d'éléments prometteurs, il n’existe pas encore un noyau solide de communistes
indiens ». Il n'y aurait que « des
étincelles de conscience au milieu du désordre ». Entre temps, le noyau de Communist Internationalist est devenu
partie intégrante du CCI. Le BIPR pourrait mieux contribuer au processus de
regroupement des révolutionnaires s'il commençait par reconnaître l'existence
d'autres groupes dans le mouvement.
Le BIPR dans l'ex-bloc de l'est
Après les échecs avec les iraniens du SUCM et les indiens du RPP, on aurait pu s'attendre à ce que le BIPR ait appris quelque chose à propos des frontières séparant les organisations bourgeoises et la classe ouvrière. Mais, le compte-rendu de l'intervention du BIPR avec le groupe autrichien Gruppe Internazionalistische Kommunisten (GDC), dans les pays de l'Est, nous en fait douter.
Nous ne pouvons que saluer l'effort du BIPR pour défendre des positions communistes dans la tourmente de l'ex-bloc de l'est (et n'était-ce pas là une situation exigeant un «front international de la Gauche communiste », pour employer les termes de BC ?). Mais comment ne pas être troublé par les illusions que semble développer BC sur la possibilité qu'il surgisse quelque chose de positif du sein des anciens PC ? « Nos camarades ont donc décidé d'aller voir les restes du parti 'communiste' tchécoslovaque. Il aurait pu être dangereux d'aller dire aux staliniens toute notre haine de leur régime de capitalisme d'Etat, exploiteur de notre classe, mais cela valait la peine si on devait y trouver quelque résidu de leur base de classe, désorienté et en présence des derniers souffles du parti. » Et, parlant d'une autre réunion : « les discussions n'ont pas manqué (y compris un échange d'idées avec des représentants étrangers de la IVe Internationale) » ([17] [1394])
Comment peut-il y avoir un « échange d'idées » entre ceux qui se proposent de faire revivre le corps putride du stalinisme et la Gauche communiste, décidée à l'enterrer pour toujours ? Le rapport du GDC, dans Workers Voice n° 55, se fait l'écho de l'idée qu'il peut exister un «mélange» de marxisme prolétarien et d'idéologie bourgeoise à l’Est : «Il y existe une plus large connaissance des idées marxistes au sein de la population, certains éléments de l'analyse matérialiste marxiste ne sont pas inconnus, même s'ils subissent des distorsions bourgeoises et sont mêlés d'un contenu bourgeois ». Mais, du point de vue de la conscience de la classe ouvrière, quel sens a de choisir entre un travailleur de l'Europe de l'Ouest qui n'a jamais entendu parler de « l'internationalisme prolétarien », et un travailleur de l'Est pour qui ce terme veut dire invasion de la Tchécoslovaquie ou de l'Afghanistan par la Russie ? Le pire, c'est que le GIK semble préférer la pêche dans les eaux troubles des staliniens défroqués que l'intervention au sein de la classe elle même :
« Plus importante que notre intervention dans la rue fut notre intervention au sein du nouveau KPD (Kommunistische Partei Deutschlands) qui s'est reformé en janvier 1990. Il n'y a pas de véritable homogénéité dans celui-ci et le point commun à tous ses fondateurs c'est qu'ils veulent maintenir des 'idéaux communistes' (...) Beaucoup, au sein du KPD (...) défendent la RDA caractérisée comme un 'système socialiste avec des erreurs'. D'autres sont divisés entre le stalinisme pur et ceux qui appuient les oppositions anti-staliniennes de gauche (trotskistes et Gauche communiste). » ([18] [1395]) Une fois encore la distinction entre trotskisme et Gauche communiste est estompée, comme si les deux pouvaient appartenir à une sorte de front commun « anti-stalinien ». Ce n'est certainement pas avec ce genre d'intervention que l'on pourra contribuer à une rupture nette avec le stalinisme et ses défenseurs trotskistes.
Un nouveau début...ou encore un peu plus du même acabit ?
Pour autant que nous le sachions, au cours de ses neuf années d'existence, le BIPR n'est pas réellement parvenu à étendre sa présence ou à faire avancer le regroupement avec la CWO, annoncé en 1980. La «première sélection de forces » dont parlait BC au lendemain de la fin des Conférences internationales, s'est avérée... très sélective. A l'automne 1991, la CWO annonce: «L'alternative historique de notre époque est entre l'actuelle barbarie capitaliste qui aboutira à la destruction de toute vie humaine, et l'instauration du socialisme par le prolétariat (...) Participer à ce processus exige une plus grande concentration de forces que les nôtres (ou de celles que peut posséder tout autre groupe du camp politique prolétarien). C'est pourquoi nous nous attachons à trouver de nouveaux moyens, fondés sur des principes, pour entretenir un dialogue politique avec tous ceux qui considèrent qu'ils combattent pour les mêmes objectifs que nous. » Treize ans après que BC et CWO eurent assumé « la responsabilité qu'on est en droit d'attendre de la part d'une force dirigeante sérieuse », en interrompant les Conférences internationales, la boucle est bouclée. Mais, pour paraphraser Marx, si l'histoire se répète deux fois, la première c'est sous la forme d'une tragédie, la seconde sous forme de farce. Le « nouveau début » de la CWO n'a conduit pour le moment qu'à un demi-regroupement avec le Communist Bulletin Group (CBG). Mais le CBG n'est-il pas l'exemple même de groupe dont BC pouvait écrire, en avril 1992 : «L'importance politique d'une division, qui est parfois nécessaire pour être capable d'interprétations politiques précises et pour définir des stratégies, a ouvert la porte, dans un certain milieu politique et parmi certaines personnalités, à une exaspérante pratique de scissionner pour scissionner, à un rejet individuel de toute centralisation, de toute discipline organisationnelle, ou de toute responsabilité 'encombrante' dans le travail collectif départi. » ?
Comment la CWO, qui ne manque jamais une occasion de dénoncer « le spontanéisme » et « l'idéalisme » du CCI, peut-elle proposer une fusion avec le CBG qui, pour autant qu'il lui reste quelques principes, est supposé défendre la plate-forme du CCI? Avec un tel fatras sans principes, ce nouvel effort du BIPR ne peut aboutir qu'à un échec, comme les précédents. ([19] [1396])
Quel chemin pour l'avenir ?
Vingt ans d'expérience, avec leurs succès et leurs échecs, dans la construction d'une organisation internationale présente sur trois continents et dans douze pays, nous ont appris au moins une chose : il n'y a pas de raccourcis dans le chemin du regroupement. Le manque de compréhension mutuelle, l'ignorance des positions des autres, la méfiance qui sont le legs des années écoulées depuis la fin des Conférences internationales, rien de cela ne disparaîtra du jour au lendemain. Pour reconstruire un tant soit peu d'unité dans le camp prolétarien, il nous faut avant tout revenir à un peu de « modestie révolutionnaire », pour reprendre un terme de BC, et entreprendre les pas, très limités, que le CCI propose dans son Appel : polémiques régulières, présence aux réunions publiques des autres groupes, organisation de réunions publiques en commun, etc. Et, lorsqu'un retour à l'esprit des Conférences internationales sera redevenu possible, il faudra avoir tiré les leçons du passé :
« Il y aura d'autres conférences. Nous y serons et nous espérons y retrouver, si le sectarisme ne les a pas tués d'ici là, les groupes qui, jusqu'à présent, n'ont pas compris l'importance de ces Conférences que nous venons de vivre, elles profiteront de l'acquis de celles-ci :
- importance de ces Conférences pour le milieu révolutionnaire et pour l'ensemble de la classe ;
- nécessité d'avoir des critères ;
- nécessité de se prononcer ;
- rejet de toute précipitation ;
- nécessité de la discussion la plus approfondie sur les questions cruciales affrontées par le prolétariat.
Pour construire un corps sain, le futur parti mondial, il faut une méthode saine. Ces Conférences, à travers leurs points forts comme à travers leurs faiblesses, auront appris aux révolutionnaires qui "n'ont pas désappris d'apprendre", comme disait Rosa Luxembourg, en quoi consiste une telle méthode ».([20] [1397])
Sven.
[1] [1398] Lutte ouvrière, la principale organisation trotskiste en France, tient une kermesse annuelle près de Paris, quelque chose qui tient plus de la foire de campagne que d'un événement politique. Pour donner une image de tolérance politique, il y est autorisé à toute une série d'organisations «de gauche » d'y tenir des stands pour la vente de leur presse et d'organiser de courtes réunions publiques pour défendre leurs positions. Le CCI a toujours participé à ces «fêtes» afin de défendre des positions internationalistes et dénoncer la nature anti-ouvrière des trotskistes. Il y a trois ans il s'est produit un incident plus important que d'habitude : un camarade du CCI, au cours d'un forum de discussion, a démasqué les tentatives de LO de nier qu'elle avait appuyé la campagne électorale de Mitterrand en 1981 - de sorte que la duplicité de LO apparaissait sans équivoque. Depuis lors, le CCI a été interdit d'y tenir des stands ou des forums.
[2] [1399] Les textes et les procès-verbaux de ces conférences peuvent être obtenus à nos adresses. Nous avons aussi traité à plusieurs reprises des principales questions soulevées par les Conférences dans différents numéros de la Revue internationale.
[3] [1400] Ces conférences ont été formellement tenues à l'initiative de BC. Mais BC n'était pas seule à partager un souci de regroupement. Révolution internationale, qui allait devenir plus tard la section en France du CCI, avait déjà lancé un appel à BC pour que, en tant qu'un des groupes historiques au sein du prolétariat, elle engage un travail de regroupement des forces prolétariennes dispersées. En 1972, à l'initiative d'Internationalism (plus tard la section du CCI aux Etats-Unis) débuta un effort de conférences et de correspondance qui aboutit d'un côté à la formation de la CWO et de l'autre du CCI en 1975.
[4] [1401] Si l'on inclut les groupes qui ont participé ne fut-ce que par correspondance et au moins à une conférence, on peut citer : le FOR, Ferment ouvrier révolutionnaire; Fôr Komunismen et Forbundet Arbetarmakt, de Suède; Nuclei Leninisti Internazionalisti et Il Leninista d'Italie; Organisation communiste révolutionnaire internationaliste d'Algérie; le Groupe communiste internationaliste et le Groupe communiste l'Eveil internationaliste, de France.
[5] [1402] Bulletin préparatoire n° 1 de la 3e Conférence des groupes de la Gauche communiste (novembre 1979).
[6] [1403] Aux groupes internationalistes de la Gauche communiste, Milan, avril 1976; in Textes et compte rendu de la Conférence internationale organisée par le PCInt (BC) à Milan les 30-4 et 1-5 1977.
[7] [1404] Deuxième lettre circulaire du PCInt. (BC) aux groupes communistes au sujet d'une éventuelle rencontre internationales Milan, 15 juin 1976; in Textes et compte rendu de la Conférence internationale...
[8] [1405] Première lettre-circulaire du PCInt, in Textes et compte rendu de la Conférence internationale...
[9] [1406] Deuxième Conférence des groupes de la Gauche communiste : textes préparatoires, compte rendu, correspondance. Paris, novembre 1978.
[10] [1407] Au lendemain de notre «exclusion» des conférences, dans une article intitulé : « Le sectarisme, un héritage de la contre-révolution à dépasser », nous écrivions à ce propos :
« Se taire, c'est pour des révolutionnaires, nier leur existence. Les communistes n'ont rien à cacher à leur classe. Face à elle, dont ils se veulent l’avant-garde, ils assument de façon responsable leurs actes et leurs convictions. Pour cela, les prochaines conférences devront rompre avec les habitudes "silencieuses" des trois conférences précédentes.
Elles devront savoir affirmer et assumer CLAIREMENT, explicitement, dans des textes et des résolutions courtes et précises, et non dans des centaines de pages de procès-verbaux, les résultats de leurs travaux, qu'il s'agisse de l'éclaircissement de DIVERGENCES, ou qu'il s'agisse de positions COMMUNES, partagées par l'ensemble des groupes.
L'incapacité des conférences passées à mettre noir sur blanc le contenu réel des divergences a été une manifestation de leur faiblesse. Le silence jaloux de la 3e Conférence sur la question de la guerre est une honte. Les prochaines conférences devront savoir assumer leurs responsabilités, si elles veulent être viables. » (...)
« "Mais, attention", nous disent les groupes partisans du silence. "C'est que nous, on ne signe pas avec n'importe qui ! Nous ne sommes pas des opportunistes !" Et nous leur répondons : l'opportunisme c'est trahir des principes à la première opportunité. Ce que nous proposions ce n'était pas de trahir un principe (l'internationalisme), mais de l'affirmer avec le maximum de nos forces. » Revue internationale, n° 22, 3e trimestre 1980.
[11] [1408] Réponse de BC à l’Adresse aux groupes politiques prolétariens du CCI (1983).
[12] [1409] Nous ne pouvons traiter ici de la triste histoire de la 4e Conférence. Nous renvoyons le lecteur aux n° 40 et 41 de la Revue internationale.
[13] [1410] Communist Review, n° 3, (1985).
[14] [1411] Workers Voice, n° 65.
[15] [1412] Workers Voice, n° 65.
[16] [1413] Communist Review, n° 3.
[17] [1414] Workers Voice, n° 53, septembre 1990.
[18] [1415] Workers Voice, n° 55; c'est nous qui soulignons.
[19] [1416] Peut-être est-ce déjà le cas. Les derniers numéros de Workers Voice ne portent pas trace des « contributions régulières » du CBG annoncées.
[20] [1417] Lettre du CCI au CE du PCInt, après la 3e Conférence; in 3e Conférence des groupes de la gauche communiste, mai 1980 -Procès verbal (janvier 1981).
Courants politiques:
- Gauche Communiste [49]
- TCI / BIPR [137]
Approfondir:
Heritage de la Gauche Communiste:
Le communisme n'est pas un bel idéal mais une nécessite matérielle [7e partie] II
- 4170 reads
L'étude du capital et les fondements du communisme
2. Le renversement du fétichisme de la marchandise
Dans la première partie de ce chapitre ([1] [1419]), nous avons commencé par examiner le contexte historique dans le cadre duquel Marx a traité de la société capitaliste comme étant la dernière de toute une série de systèmes d'exploitation et d'aliénation, en tant que forme d'organisation sociale non moins transitoire que ne le furent l'esclavage romain ou le féodalisme médiéval. Nous avons noté que, dans ce contexte, il fallait considérer le drame de l’histoire de 1’humanité à la lumière de la relation dialectique entre les liens sociaux originels de 1’humanité et la croissance des rapports marchands qui avaient à la fois dissous ces liens et préparé le terrain pour une forme plus avancée de communauté humaine. Dans la partie qui suit, nous nous centrerons sur l'analyse qu'a développée Marx dans sa maturité, du capital lui-même - de sa nature interne, de ses contradictions insolubles et de la société communiste destinée à le supplanter.
Démystifier la marchandise
Il est certainement impossible d'étudier Le capital de Marx, ses différents brouillons et annexes, depuis les Grundrisse jusqu'aux Théories de la Plus-Value, sans ressentir une vive agitation. Ce gigantesque travail intellectuel auquel «j'ai sacrifié ma santé, mon bonheur et ma famille » ([2] [1420]) fouille, jusque dans les détails les plus extraordinaires, les origines historiques de la société bourgeoise, examine très concrètement le mode d'opération quotidien du capital, depuis le terrain de l'usine jusqu'au système du crédit, « descend » jusqu'aux questions les plus générales et les plus abstraites de I’histoire de 1’humanité et des caractéristiques de l'espèce humaine, pour « s'élever » ensuite vers le concret, à la réalité dure et nue de l'exploitation capitaliste. Mais tout en étant un travail qui requiert une concentration et un effort mental considérables de la part de ses lecteurs, ce n'est jamais un travail académique, ni une simple description, ni un exercice d'apprentissage scolaire constituant une fin en soi. Comme Marx l'a souvent répété, c'est à la fois une description et une critique de l'économie politique bourgeoise. Son but n'était pas de classer, d'établir des catégories ni de définir les caractéristiques du capital, mais de montrer le chemin de sa destruction révolutionnaire.
Comme le dit Marx dans son langage coloré, Le capital est « assurément la bombe la plus effrayante qui ait jamais été lancée à la tête de la bourgeoisie ». ([3] [1421]).
Dans cet article, notre objectif n'est pas, et ne pourrait être, l'examen détaillé du Capital et des autres travaux sur l'économie politique. Il est simplement de faire ressortir ce qui nous semble constituer ses thèmes centraux afin de souligner leur contenu révolutionnaire et donc communiste. Nous commencerons, comme l'a fait Marx, par la marchandise.
Dans la première partie de cet article, nous avons rappelé que, du point de vue de Marx, I’histoire n'est pas simplement la chronique du développement de ses capacités productives, mais est aussi celle de son aliénation croissante, une aliénation qui atteint son apogée dans le capitalisme et le système du travail salarié. Dans Le capital, cette aliénation est traitée sous différents angles, mais son application la plus significative est sans doute contenue dans le concept du fétichisme de la marchandise ; et dans une large mesure, Le capital lui-même constitue une tentative de percer, dévoiler et renverser ce caractère fétiche.
Selon Marx dans le premier chapitre du Capital, la marchandise apparaît à 1’humanité comme « énigmatique » dès qu'on la considère comme quelque chose de plus qu'un simple article de consommation - c'est-à-dire quand on la considère non du point de vue de sa simple valeur d'usage, mais de celui de sa valeur d'échange. Plus la production d'objets matériels est subordonnée aux besoins du marché, de l'achat et de la vente, plus 1’humanité perd de vue les buts et les motifs réels de la production. La marchandise a jeté un sort aux producteurs, et jamais ce sort n'a été aussi puissant, jamais cet « univers ensorcelé et perverti » ([4] [1422]) ne s'est autant développé que dans la production universelle de marchandises, dans le capitalisme - première société dans I’histoire où les rapports marchands ont pénétré jusqu'au cœur même du système productif, au point que la force de travail elle-même est devenue une marchandise. Voici comment Marx décrit le processus dans lequel les rapports marchands en sont arrivés à ensorceler l'esprit des producteurs « ... dans l'acte de vision, la lumière est réellement projetée d'un objet extérieur sur un autre objet, l’œil; c'est un rapport physique entre des choses physiques. Mais la forme valeur et le rapport de la valeur des produits du travail n'ont absolument rien à faire avec leur nature physique. C'est seulement un rapport social déterminé des hommes entre eux qui revêt ici pour eux la forme fantastique d'un rapport des choses entre elles. Pour trouver une analogie de ce phénomène, il faut la chercher dans la région nuageuse du monde religieux. Là les produits du cerveau humain ont l'aspect d'êtres indépendants, doués de corps particuliers, en communication avec les hommes et entre eux. Il en est de même des produits de la main de l'homme dans le monde marchand. C'est ce qu'on peut nommer le fétichisme attaché aux produits du travail, dès qu'ils se présentent comme des marchandises, fétichisme inséparable de ce mode de production. » ([5] [1423])
Pour Marx, découvrir et renverser le fétichisme de la marchandise était crucial à deux niveaux. D'abord, parce que la confusion que les rapports marchands semaient dans l'esprit humain, rendait le fonctionnement véritable de la société bourgeoise extrêmement difficile à saisir, même par les théoriciens les plus éduqués et les plus intelligents de la classe dominante. Et deuxièmement, parce qu'une société dominée par la marchandise était nécessairement condamnée à échapper au contrôle de ses producteurs ; pas seulement dans un sens abstrait et statique, mais également au sens où un tel ordre social allait en définitive mener l'ensemble de l'humanité à la catastrophe s'il n'était pas remplacé par une société qui ait banni la valeur d'échange en faveur de la production pour l'usage.
Le secret de la plus-value
Les économistes bourgeois avaient évidemment vu que le capitalisme était une société basée sur la production pour le profit ; certains d'entre eux avaient même reconnu l'existence d'antagonismes de classe et d'injustices sociales au sein de la société.
Mais aucun d'entre eux n'avait été capable de discerner les origines réelles du profit capitaliste dans l'exploitation du prolétariat. On retrouve à nouveau le fétichisme de la marchandise : contrairement au despotisme oriental, à l'esclavage classique, ou au féodalisme, il n'existe pas d'exploitation institutionnalisée dans le capitalisme, pas de corvée, pas de propriété légale d'un être humain par un autre, pas de jours fixes pour travailler la terre du seigneur. Dans la vision du simple bon sens de la pensée bourgeoise, le capitaliste achète le « travail » de l'ouvrier et lui donne, en échange, un « salaire équitable ». Si un profit surgit de cet échange, ou de la production capitaliste en général, il a simplement pour fonction de couvrir le coût et l'effort dépensés par le capitaliste, ce qui semble également équitable. Ce profit peut provenir du fait que le capitaliste achète « à bas prix » et vend « cher » - c'est-à-dire qu'il vient du marché - ou bien qu'il est le produit de l'« abstinence » du capitalisme lui-même, ou encore, comme dans la théorie de Senior, « de la dernière heure de travail ».
Mais ce que Marx a démontré à travers son analyse de la marchandise, c'est que l'origine du profit capitaliste réside dans une véritable forme d'esclavage, dans un temps de travail non payé à l'ouvrier. C'est pourquoi Marx commence Le Capital par l'analyse de l'origine de la valeur, en expliquant que la valeur d'une marchandise est déterminée par la quantité de temps de travail contenu dans sa production. Jusque là Marx était en continuité avec l'économie politique bourgeoise classique (même si des « experts » économiques modernes nous diraient aujourd'hui que la théorie de la valeur du travail n'est rien d'autre qu'une charmante vieillerie - ce qui exprime la dégénérescence ultérieure de la « science » économique bourgeoise). Mais il a été capable d'aller plus loin dans l'exploration de la marchandise particulière qu'est la force de travail (pas le travail dans l'abstrait comme l'a toujours vu la bourgeoisie, mais la capacité de travail de l'ouvrier, qui est ce que le capitaliste achète vraiment). Cette marchandise, comme toute autre, « vaut » la quantité de temps de travail nécessaire pour la reproduire - c'est-à-dire dans ce cas, répondre aux besoins fondamentaux de l'ouvrier comme la nourriture, l'habillement, le toit, etc. Mais la force de travail vivant, contrairement aux machines qu'elle fait tourner, comporte la caractéristique unique d'être capable de créer plus de valeur en un jour de travail que ce qu'il est nécessaire pour la reproduire. L'ouvrier, qui travaille 8 heures par jour, peut donc ne pas passer plus de 4 heures à travailler pour lui-même - le reste étant donné « gratuitement » au capitaliste. Cette plus-value, une fois qu'elle est réalisée sur le marché, constitue la véritable source du profit capitaliste. Le fait que la production capitaliste soit précisément l'extraction, la réalisation et l'accumulation de ce surtravail volé, en fait, par définition, par nature, un système d'exploitation de classe en totale continuité avec l'esclavage et le féodalisme. Il ne s'agit pas de parler de combien de temps travaille un ouvrier, 8, 10 ou 18 heures par jour, ni de savoir si son environnement est agréable ou infernal, ou son salaire haut ou bas. Ces facteurs influencent le taux d'exploitation, non le fait de l'exploitation. L'exploitation n'est pas un sous-produit accidentel de la société capitaliste, ni le produit de patrons particulièrement avides. C'est le mécanisme fondamental de la production capitaliste, et celle-ci ne peut se concevoir sans cette exploitation.
Les implications de cela sont immédiatement révolutionnaires. Dans le cadre marxiste, toutes les souffrances, matérielles et spirituelles, imposées à la classe ouvrière sont le produit logique et inévitable de ce système d'exploitation. Le capital est sans aucun doute un puissant acte d'accusation morale contre la misère et la dégradation que la société bourgeoise fait peser sur la grande majorité de ses membres. Le volume I, en particulier, montre dans le détail comment le capitalisme est né « suant le sang et la boue par tous les pores » ([6] [1424]) ; comment dans sa phase d'accumulation primitive, le capital naissant a violemment exproprié les paysans et puni à coups de fouet et de hache les vagabonds qu'il avait lui-même créés ; comment - et dans la première période de la manufacture, la phase de la « domination formelle » du capital, et dans le système industriel proprement dit, la phase de la « domination réelle »- la soif de plus-value des « loups-garous » capitalistes avait mené, avec toute la puissance objective d'une machine en marche, à 1’horreur du travail des enfants, des journées de travail de 18 heures et tout le reste. Dans ce même travail, Marx dénonce l'appauvrissement interne, l'aliénation de l'ouvrier réduit à n'être qu'un simple rouage d'un vaste engrenage, à n'être qu'un simple fragment, du fait du caractère pénible et répétitif de son travail, de son réel potentiel humain. Mais il ne le fait pas dans le but d'en appeler à une forme plus humaine de capitalisme, mais en démontrant scientifiquement que le système lui-même du travail salarié doit mener à de tels excès » ; que le prolétariat ne peut atténuer ses souffrances en comptant sur la bonne volonté ou les pulsions charitables de ses exploiteurs, mais seulement en menant une résistance opiniâtre et organisée contre les effets quotidiens de l'exploitation ; que « la misère, l'oppression, l'esclavage, la dégradation, l'exploitation » inévitablement croissants ne peuvent être balayés que par « la résistance de la classe ouvrière, sans cesse grossissante et de plus en plus disciplinée, unie et organisée par le mécanisme même de la production capitaliste. » ([7] [1425]) Bref, la théorie de la plus-value prouve la nécessité, l'inévitabilité absolue de la lutte entre le capital et le travail, de classes aux intérêts objectivement irréconciliables. Tel est le fondement de granit de toute analyse de l'économie, la politique et la vie sociale capitalistes qui ne peuvent être compris clairement et lucidement que du point de vue de la classe exploitée, puisque seule cette dernière a un intérêt matériel à percer le voile de la mystification dont le capitalisme se recouvre.
Les contradictions insolubles du capital
Comme nous l'avons montré dans la première partie de cet article, le matérialisme historique, l'analyse marxiste de 1’histoire est synonyme de la vision selon laquelle toute société de classe a traversé des époques d'ascendance durant lesquelles ses rapports sociaux fournissent un cadre pour le développement progressif des forces productives, et des époques de décadence durant lesquelles ces mêmes rapports sont devenus une entrave croissante à un développement ultérieur, nécessitant l'émergence de nouveaux rapports de production. Dans la vision de Marx, le capitalisme ne fait pas exception à ces lois - au contraire, Le Capital, et toute l’œuvre de Marx, en fait, ne peuvent être conçus que comme la nécrologie du capital, l'étude des processus qui mènent à sa chute et à sa disparition. C'est pourquoi le crescendo du volume I est constitué par le passage dans lequel Marx prédit une époque où « le monopole du capital devient une entrave pour le mode de production qui a grandi et prospéré avec lui et sous ses auspices. La socialisation du travail et la centralisation de ses ressorts matériels arrivent à un point où elles ne peuvent plus tenir dans leur enveloppe capitaliste. Cette enveloppe se brise en éclats. L'heure de la propriété capitaliste a sonné. Les expropriateurs sont à leur tour expropriés ». ([8] [1426])
Le premier volume du Capital est cependant principalement une étude critique du « procès de production capitaliste ». Son but principal est de mettre à nu la nature de l'exploitation capitaliste et se limite donc largement à l'analyse des rapports directs entre le prolétariat et la classe capitaliste, ayant recours à un modèle abstrait dans lequel les autres classes et formes de production n'ont pas d'importance. C'est dans les volumes suivants, en particulier dans le volume III et dans les Théories sur la plus-value (2e partie) ainsi que dans les Grundrisse que Marx lance la phase suivante de son attaque contre la société bourgeoise : la démonstration que la chute du capital sera le résultat des contradictions enracinées au cœur même du système, dans la production de la plus-value elle-même.
Déjà dans les années 1840, et en particulier dans le Manifeste communiste, Marx et Engels avaient identifié les crises périodiques de surproduction comme étant les signes avant-coureurs de la faillite définitive du capitalisme. Dans Le Capital et les Grundrisse, Marx consacre beaucoup de pages à la polémique contre les économistes politiques bourgeois qui tentent de montrer que le capitalisme est fondamentalement un système économique harmonieux dans lequel tout produit peut, si tout va bien, trouver un acheteur - c'est-à-dire que le marché capitaliste peut absorber toutes les marchandises fabriquées dans le processus de production capitaliste. Si des crises de surproduction ont bien lieu, selon les arguments de Say, Mill et Ricardo, elles sont le résultat d'un déséquilibre purement contingent entre l'offre et la demande, d'une « disproportion » malencontreuse entre un secteur et l'autre ; ou peut-être sont-elles tout simplement le résultat de salaires trop bas. Une surproduction partielle est possible, mais pas une surproduction généralisée. Et toute idée selon laquelle les crises de surproduction auraient trouvé leur source dans les contradictions insolubles inhérentes au système lui-même, ne pouvait être admise, parce que c'était admettre la nature limitée et transitoire du mode de production capitaliste :
« La phraséologie apologétique, utilisée pour nier l'existence de la crise, est importante en ce qu'elle prouve toujours le contraire de ce qu'elle veut prouver. Pour nier l'existence de la crise, elle affirme qu'il y a unité, là où existent opposition et contradiction. Elle est donc importante en ce qu'on peut dire: elle prouve que si, en fait, les contradictions qu'elle nie imaginairement n'existaient pas, les crises, elles non plus, n'existeraient pas. Mais, en fait, la crise existe, parce que ces contradictions existent. Chaque raison qu'elle avance contre la crise est une contradiction niée par l'imagination, donc une contradiction réelle, donc une raison de la crise. La volonté de nier par l'imagination les contradictions qui, selon un vœu pieux, ne doivent pas exister ». ([9] [1427])
Et dans les paragraphes suivants, Marx montre que c'est dans son existence même que le système du travail salarié et de la plus-value contient les crises de surproduction:
« Ce que les ouvriers produisent en fait, c'est la plus-value. Aussi longtemps qu'ils en produisent, ils ont de quoi consommer. Mais dès que cela cesse, leur consommation cesse, parce que cesse leur production. Ce n'est nullement parce qu'ils produisent un équivalent pour leur consommation qu'ils ont de quoi consommer... Quand on réduit donc ce rapport à celui de consommateurs et de producteurs, on oublie que le travailleur salarié qui produit et le capitaliste qui produit sont des producteurs d'un genre tout à fait différent (abstraction faite des consommateurs qui ne produisent rien du tout). A nouveau on nie l'existence de cette opposition, en faisant abstraction d'une opposition qui existe réellement dans la production. Le simple rapport entre travailleur salarié et capitaliste implique :
1. Que la majeure partie des producteurs (les ouvriers) ne sont pas consommateurs (pas acheteurs) d'une très grande portion de leur produit: les moyens et la matière de travail ;
2. Que la majeure partie des producteurs, les ouvriers, ne peuvent consommer un équivalent pour leur produit, qu'aussi longtemps qu'ils produisent plus que cet équivalent - qu'ils produisent la plus-value ou le surproduit. Il leur faut constamment être des surproducteurs, produire au-delà de leurs besoins pour pouvoir être consommateurs ou acheteurs, à l'intérieur des limites de leurs besoins ». ([10] [1428])
Bref, puisque le capitaliste extrait la plus-value de l'ouvrier, l'ouvrier produit toujours plus qu'il ne peut acheter. Evidemment, pour le capitaliste individuel, cela ne pose pas de problème puisqu'il peut toujours trouver un marché chez les ouvriers d'un autre capitaliste ; de même pour l'économiste politique bourgeois : ses oeillères de classe l'empêchent de voir les problèmes du point de vue du capital social dans son ensemble. Mais dès qu'on l'appréhende de ce point de vue (ce que seul peut faire un théoricien du prolétariat), alors apparaît l'aspect fondamental du problème. Marx l'explique dans les Grundrisse :
« En fait, nous n'avons pas encore à analyser ici le rapport d'un capitaliste vis-à-vis des ouvriers des autres capitalistes. Ce rapport nous révèle les illusions de tout capitaliste, mais ne change absolument rien au rapport entre le capital et le travail. Chacun des capitalistes sait que ses ouvriers ne lui font pas face comme consommateurs dans la production, et s'efforce de restreindre autant que possible leur consommation, c'est-à-dire leur capacité d'échange, leur salaire. Cela ne l'empêche pas, bien sûr, de souhaiter que les ouvriers des autres capitalistes fassent la plus grande consommation possible de ses marchandises. Quoiqu'il en soit, le rapport général fondamental entre le capital et le travail est celui de chacun des capitalistes avec ses ouvriers.
Mais l'illusion propre à chacun des capitalistes privés, en opposition à tous les autres, à savoir qu'en dehors de ses propres ouvriers, toute la classe ouvrière n'est faite que de consommateurs et d'échangistes, de dispensateurs d'argent, et non d'ouvriers, provient de ce que le capitaliste oublie ce qu'énonce Malthus : "L'existence même d'un profit réalisé sur une marchandise quelconque implique une demande autre que celle émanant du travailleur qui l'a produite", et par conséquent "la demande émanant du travailleur productif lui-même ne peut jamais suffire à toute la demande". Etant donné qu'une branche de production en active une autre et gagne ainsi des consommateurs parmi les ouvriers du capital étranger, chaque capitaliste croit à tort que la classe ouvrière, créée par la production elle-même, suffit à tout. Cette demande créée par la production elle-même incite à négliger la juste proportion de ce qu'il faut produire par rapport aux ouvriers: elle tend à dépasser largement leur demande, tandis que, par ailleurs, la demande des classes non ouvrières disparaît ou se réduit fortement, - c'est ainsi que se prépare l'effondrement ». ([11] [1429])
Pas plus que la classe ouvrière, prise dans son ensemble, ne peut constituer un marché adéquat pour la production capitaliste, le problème ne peut être non plus résolu par la vente des produits entre capitalistes :
« Si l'on dit que les capitalistes n'ont qu'à échanger et consommer leurs marchandises entre eux, on perd de vue la nature foncière du système capitaliste et l'on oublie qu'il s ‘agit de faire fructifier le capital, et non de le consommer ». ([12] [1430])
Puisque le but du capital est l'accroissement de la valeur, la reproduction de la valeur sur une échelle toujours plus vaste, il a besoin d'un marché toujours plus grand, « l'extension du champ extérieur de la production » ([13] [1431]) ; c'est pourquoi, dans sa phase ascendante, le capitalisme a été poussé à conquérir le globe et à soumettre des parties de plus en plus importantes de celui-ci à ses lois. Mais Marx était tout à fait conscient du fait que ce processus d'expansion ne pourrait se poursuivre à l'infini : la production capitaliste allait se heurter aux limites du marché, dans un sens à la fois géographique et social ; alors, ce que Ricardo et d'autres refusaient d'admettre, deviendrait évident : « ...le mode de production bourgeois constitue une limite pour le libre développement des forces productives, limite qui se manifeste dans les crises et, entre autres, dans la surproduction - phénomène de base des crises ». ([14] [1432])
Tout en étant contraints de nier la réalité de la surproduction, les économistes bourgeois n'en étaient pas moins troublés par une autre contradiction fondamentale contenue dans la production capitaliste : la tendance du taux de profit à chuter. Marx situait les origines de cette tendance dans la nécessité impérieuse pour les capitaux de se faire concurrence, de révolutionner constamment les moyens de production, c'est-à-dire d'accroître la composition organique du capital, le rapport entre le travail mort - incarné par les machines et qui ne produit pas de nouvelle valeur - et le travail vivant du prolétariat.
Les conséquences contradictoires d'un tel « progrès » sont ainsi résumées :
« ...il est de la nature du mode de production capitaliste que, au cours de son évolution, le taux moyen général de la plus-value se traduise nécessairement par une baisse du taux de profit général. La masse de travail vivant utilisé diminue continuellement par rapport à la masse de travail matérialisé qu'elle met en mouvement, c'est-à-dire par rapport aux moyens de production consommés de façon productive; il s'ensuit que la fraction non payée de ce travail vivant, matérialisée dans la plus-value, doit décroître sans cesse par rapport à la valeur du capital total investi. Or, ce rapport entre la masse de la plus-value et la valeur du capital total investi constitue le taux de profit; celui-ci doit donc baisser continuellement ». ([15] [1433])
Ce qui, dans ce phénomène, inquiétait les économistes bourgeois les plus sérieux, tels que Ricardo, c'était sa nature inéluctable, le fait que « ...le taux de profit est le moteur de la production capitaliste » et que « sa baisse ... apparaît ainsi comme une menace pour le développement du processus de production capitaliste », parce que de nouveau ceci implique que « le mode de production capitaliste » n'est pas un absolu, mais qu'il « se crée lui-même une barrière ». « Et cette limite particulière démontre le caractère étroit, simplement historique et transitoire, du mode de production capitaliste ». ([16] [1434])
Le travail inachevé de Marx
Le capital est nécessairement un travail inachevé. Non seulement parce que Marx n'a pas vécu assez longtemps pour le terminer, mais aussi parce qu'il a été écrit dans une période historique durant laquelle les rapports sociaux capitalistes n'étaient pas encore devenus une entrave définitive au développement des forces productives. Et ce n'est sûrement pas sans rapport avec le fait que lorsqu'il définit l'élément fondamental de la crise capitaliste, Marx insiste tantôt sur le problème de la surproduction, tantôt sur la baisse tendancielle du taux de profit, tout en n'établissant jamais de séparation mécanique et rigide entre les deux : par exemple, le chapitre du 3e volume, dédié aux conséquences de la baisse du taux de profit, contient également certains des passages les plus clairs sur le problème du marché. Néanmoins, cette brèche, ou cette contradiction apparente, dans la théorie de la crise de Marx, a amené, dans la période de déclin du capitalisme, à l'émergence, au sein du mouvement révolutionnaire, de théories différentes sur les origines de ce déclin. Il n'est pas surprenant de les retrouver sous deux rubriques principales : celle qui se base sur le travail de Rosa
Luxemburg, et insiste sur le problème de la réalisation de la plus-value, et celle qui découle des travaux de Grossman et Mattick, et met en évidence la baisse du taux de profit.
Ce n'est pas le lieu d'examiner ces théories de façon détaillée ; nous avons commencé à le faire ailleurs ([17] [1435]). Nous nous contenterons ici de répéter pourquoi, selon nous, l'approche de Luxemburg est la plus cohérente.
D'un point de vue « négatif », c'est parce que la théorie de Grossman-Mattick, qui nie le caractère fondamental du problème de la réalisation, semble régresser vers les idées des économistes politiques bourgeois que Marx avait dénoncées parce qu'elles soutenaient que la production capitaliste créait un marché suffisant pour elle-même. En même temps, ceux qui adhèrent à la théorie de Grossman-Mattick ont souvent recours aux arguments d'économistes révisionnistes comme Otto Bauer que Luxemburg ridiculise dans son Anti-critique. Selon eux, les schémas mathématiques abstraits de Marx sur la reproduction élargie dans le 2e volume du Capital « résoudraient » le problème de la réalisation et toute l'approche de Rosa Luxemburg se résumerait à une simple incompréhension, à un non-problème.
D'un point de vue plus positif, l'approche de Luxemburg fournit une explication des conditions historiques concrètes qui déterminent l'ouverture de la crise permanente du système : plus le capitalisme intègre à lui-même les aires d'économie non-capitaliste restantes, plus il crée un monde à sa propre image, moins il peut étendre son marché de façon permanente et trouver de nouveaux débouchés pour la réalisation de cette partie de la plus-value qui ne peut être réalisée ni par les capitalistes, ni par le prolétariat. L'incapacité du système à continuer de s'étendre comme auparavant a ouvert la nouvelle époque de l'impérialisme et des guerres impérialistes qui ont constitué le signal de la fin de la mission historique progressiste du capitalisme, menaçant l'humanité de retourner dans la barbarie. Tout cela, comme nous l'avons vu, s'intègre pleinement au «problème » du marché tel que Marx le pose dans sa critique de l'économie politique.
En même temps, alors que l'approche de Grossman-Mattick, du moins sous sa forme pure, nie carrément cette question, la méthode de Luxemburg nous permet de voir comment le problème de la baisse du taux de profit devient de plus en plus aigu une fois que le marché mondial ne trouve plus de champ d'expansion : si le marché est saturé, il n'y a plus de possibilité de compenser la chute du taux de profit, c'est-à-dire la quantité décroissante de valeur contenue dans chaque marchandise, par une augmentation de la masse de profit, c'est-à-dire en produisant et en vendant plus de marchandises; au contraire, une telle tentative ne fait qu'exacerber le problème de la surproduction. Il devient ici évident que les deux contradictions essentielles mises à nu par Marx agissent l'une sur l'autre et s'aggravent l'une l'autre, approfondissant la crise et la rendant toujours plus explosive.
« Les crises du marché mondial doivent être comprises comme regroupant réellement et égalisant violemment toutes les contradictions de l'économie bourgeoise ». ([18] [1436]) C'est certainement vrai du désastre économique qui a ravagé l'ordre capitaliste ces vingt-cinq dernières années. Malgré tous les mécanismes que le capitalisme a mis en place en vue de repousser la crise, pour tricher en fait avec les conséquences de ses propres lois (les montagnes de dettes, l'intervention de 1’Etat, la mise en place d'organismes de commerce et de taxations à l'échelle mondiale, etc), cette crise porte toutes les marques de la crise de surproduction, révélant comme jamais auparavant l'absurdité et l'irrationalité véritables du système économique de la bourgeoisie.
Dans cette crise, nous sommes confrontés, à un degré bien plus élevé que par le passé, au contraste insensé entre l'immense potentiel de richesses et de jouissance promis par le développement des forces productives, et la misère et les souffrances réelles induites par les rapports sociaux de production. Techniquement parlant, assez de nourriture et un logement adéquat pourraient être fournis au monde entier : au lieu de cela, des millions d'êtres humains meurent de faim pendant qu'on jette la nourriture dans les océans, que les fermiers sont payés pour ne pas produire et que d'inimaginables ressources financières et scientifiques sont dépensées dans les abîmes de la production militaire et de guerre ; des millions sont sans logis tandis que les ouvriers de la construction sont jetés au chômage ; des millions sont forcés de travailler de plus en plus dur, durant des journées de plus en plus longues, afin de répondre aux besoins de la concurrence capitaliste, alors que des millions supplémentaires sont rejetés du travail dans l'inactivité et la pauvreté du chômage. Et tout cela parce qu'il y a une folle épidémie de surproduction. Non pas, comme le souligne Marx, de surproduction par rapport aux besoins, mais de surproduction par rapport à la capacité de payer.
« Ce n'est pas qu'on produise trop de moyens de subsistance par rapport à la population existante ; bien au contraire, la production est insuffisante pour satisfaire de façon normale et humaine les besoins de la masse de la population... En revanche, trop de moyens de travail et de subsistance sont produits périodiquement pour qu'on puisse les faire fonctionner comme moyens d'exploitation des ouvriers à un certain taux de profit. Il est produit trop de marchandises pour qu'on puisse réaliser et reconvertir en capital nouveau la valeur et la plus-value qui s y trouvent contenues... dans les conditions de répartition et de consommation de la production capitaliste... Il n'est pas produit trop de richesse. Mais périodiquement, il est produit trop de richesse dans les formes antagonistes du capital ». ([19] [1437])
Bref, la crise de surproduction qui ne peut plus être atténuée par une nouvelle expansion du marché, met à nu le fait que les forces productives ne sont plus compatibles avec leur « enveloppe » capitaliste et que cette enveloppe doit être «mise en pièces ». Le fétichisme de la marchandise, la tyrannie du marché doivent être dépassés par la classe ouvrière révolutionnaire, seule force sociale capable de prendre la direction des forces productives existantes et de les orienter vers la satisfaction des besoins humains.
Le communisme : une société sans échange
Les définitions du communisme dans les travaux théoriques de Marx « mûr » sont posées à deux niveaux qui sont en lien l'un avec l'autre. Le premier découle logiquement de la critique du fétichisme de la marchandise, d'une société dominée par des forces mystérieuses, non humaines et prise dans les terribles conséquences de ses contradictions internes. C'est en fait la tentative de Marx de concrétiser un projet qu'il avait déjà annoncé dans La question juive en 1843 : le fait que l'émancipation de 1’humanité nécessite que l'homme reconnaisse et organise ses propres pouvoirs sociaux au lieu d'être dominé par eux. Il expose donc à grands traits la solution aux insolubles contradictions de la société marchande : une forme fondamentalement simple d'organisation sociale où les divisions basées sur la propriété privée ont été dépassées, où la production est faite en fonction des besoins et non du profit et où le calcul du temps de travail à réaliser, au lieu d'être conçu comme une torture à chaque ouvrier individuel et à la classe ouvrière dans son ensemble, est seulement déterminé en fonction de la quantité de travail social qui doit être dépensé à la production de tel ou tel ordre de besoins :
« La vie sociale, dont la production matérielle et les rapports qu'elle implique forment la base, ne sera dégagée du nuage mystique qui en voile l'aspect, que le jour où s'y manifestera l’œuvre d'hommes librement associés, agissant consciemment et maîtres de leur propre mouvement social »
« Représentons-nous enfin une réunion d'hommes libres travaillant avec des moyens de production communs, et dépensant, d'après un plan concerté, leurs nombreuses forces individuelles comme une seule et même force de travail social. Tout ce que nous avons dit du travail de Robinson se reproduit ici, mais socialement et non individuellement. Tous les produits de Robinson étaient son produit personnel et exclusif et conséquemment objets d'utilité immédiate pour lui. Le produit total des travailleurs unis est un produit social. Une partie sert de nouveau comme moyen de production et reste sociale ; mais l'autre partie est consommée, et, par conséquent, doit se répartir entre tous. Le mode de répartition variera suivant l'organisme producteur de la société et le degré de développement historique des travailleurs. Supposons, pour mettre cet état de choses en parallèle avec la production marchande, que la part accordée à chaque travailleur soit en raison de son temps de travail. Le temps de travail jouerait ainsi un double rôle. D'un côté sa distribution dans la société règle le rapport exact des diverses fonctions aux divers besoins ; de l'autre, il mesure la part individuelle de chaque producteur dans le travail commun, et en même temps la portion qui lui revient dans la partie du produit commun réservée à la consommation. Les rapports sociaux des hommes dans leurs travaux et avec les objets utiles qui en proviennent restent ici simples et transparents dans la production aussi bien que dans la distribution ». ([20] [1438])
Bien que toutes ces caractéristiques paraissent simples et transparentes, évidentes même, il a été à maintes reprises nécessaire que les marxistes insistent sur cette définition minimale d'une société communiste, contre tous les faux « socialismes » qui ont hanté si longtemps le mouvement ouvrier. Dans les Grundrisse, par exemple, il y a une longue polémique contre les fantaisies proudhoniennes sur un socialisme basé sur un échange égalitaire, un système où l'ouvrier serait payé totalement pour la valeur de son produit, et où la monnaie serait remplacée par une sorte de non-monnaie pour mesurer cet échange. Contre cela, Marx dit à la fois qu'il est impossible d'abolir la monnaie tant que la valeur d'échange demeure la forme sociale prise par les produits, et que, dans une véritable société communiste, « d'emblée le travail de l'individu y est posé comme travail social. Quelle que soit donc la forme matérielle et particulière du produit qu'il crée ou contribue à créer, ce qu'il achète avec son travail, ce n'est pas tel ou tel produit, mais une participation déterminée à la production collective. Il n'a donc pas à échanger ici de produit particulier : son produit n'est pas une valeur d'échange ». ([21] [1439])
Quand Marx à son époque écrivait « qu'il est absolument faux de penser, comme le font certains socialistes, que nous avons besoin du capital et non des capitalistes » ([22] [1440]), il se référait à des éléments confus du mouvement ouvrier. Mais dans la période de décadence du capitalisme, de telles idées ne sont pas simplement fausses ; elles sont devenues une partie de l'arsenal de la contre-révolution. L'une des caractéristiques distinctives de l'ensemble de la gauche .du capital, depuis les partis « socialistes » en passant par les staliniens jusqu'aux trostskystes les plus radicaux, c'est que tous identifient le socialisme à une société capitaliste sans capitalistes privés, un système où le capital a été nationalisé, le travail salarié étatisé et où la production de marchandises continue de régner, et si ce n'est au niveau de chaque unité nationale, alors au niveau mondial, en tant que rapport entre les différentes « nations socialistes ». Naturellement, comme nous l'avons vu avec le système stalinien du défunt bloc de 1`Est, un tel système n'évite en aucune façon les contradictions fondamentales du capital et est condamné à s'effondrer, au même titre que les variantes plus classiques de la société bourgeoise.
Le règne de la liberté
Jusqu'ici, Marx a décrit les soubassements matériels de la liberté communiste, ce qui lui est fondamentalement pré-requis :
« Dans ce domaine, la liberté ne peut consister qu'en ceci : les producteurs associés - l'homme socialisé - règlent de manière rationnelle leurs échanges organiques avec la nature et les soumettent à leur contrôle commun au lieu d'être dominés par la puissance aveugle de ces échanges; et ils les accomplissent en dépensant le moins d'énergie possible, dans les conditions les plus dignes, les plus conformes à leur nature humaine. Mais l'empire de la nécessité n'en subsiste pas moins. C'est au-delà que commence l'épanouissement de la puissance humaine qui est sa propre fin, le véritable règne de la liberté qui, cependant, ne peut fleurir qu'en se fondant sur ce règne de la nécessité. » ([23] [1441])
Le vrai but du communisme n'est donc pas une liberté négative par rapport à la domination de lois économiques arbitraires, mais la liberté positive de développer les potentialités humaines au maximum et pour elles-mêmes. Comme on l'a noté auparavant, ce projet d’une portée considérable était annoncé par Marx dès ses premiers écrits, en particulier dans les Manuscrits économiques et philosophiques, et il n'en a dévié à aucun moment de son travail ultérieur.
Le passage qu'on vient de citer, est précédé d'une prise de position qui dit que « le règne de la liberté commence seulement à partir du moment où cesse le travail dicté par la nécessité et les fins extérieures ; il se situe donc, par sa nature même, au-delà de la sphère de la production matérielle proprement dite » ([24] [1442]). C'est vrai dans la mesure où l'énorme développement de la productivité du travail sous le capitalisme, l'automatisation de la production (que Marx entrevoit clairement dans de nombreux passages des Grundrisse) rendent possible de réduire au minimum la quantité de temps et d'énergie consacrée à des tâches répétitives et sans intérêt. Mais lorsque Marx commence vraiment à examiner le contenu de l'activité humaine caractéristique de l'humanité communiste, il reconnaît qu'une telle activité dépassera toute séparation rigide entre le temps libre et le temps de travail :
« Au demeurant, il tombe sous le sens que le temps de travail immédiat ne pourra pas toujours être opposé de manière abstraite au temps libre, comme c'est le cas dans le système économique bourgeois. Le travail ne peut pas devenir un jeu comme le veut Fourier, qui eut le grand mérite d'avoir proclamé comme fin ultime le dépassement, dans une forme supérieure, non point du mode de distribution mais de production. Le temps libre - qui est à la fois loisir et activité supérieure - aura naturellement transformé son possesseur en un sujet différent, et c'est en tant que sujet nouveau qu'il entrera dans le processus de la production immédiate. Par rapport à l'homme en formation, ce processus est d'abord discipline ; par rapport à l'homme formé, dont le cerveau est le réceptacle des connaissances socialement accumulées, il est exercice, science expérimentale, science matériellement créatrice et réalisatrice. Pour l'un et l'autre, il est en même temps effort, dans la mesure où, comme en agriculture, le travail exige la manipulation pratique et le libre mouvement ». ([25] [1443])
Aussi, si Marx critique Fourier lorsque ce dernier pense que le travail peut devenir « une simple joie, un simple jeu » (une incompréhension reprise par les successeurs de Fourier, comme les situationnistes, qui abondent à la marge du mouvement révolutionnaire), il offre au contraire un but non pas plus gris ou plus banal, mais bien plus passionnant par sa portée, mettant en évidence que « le renversement de ces obstacles constitue en soi une affirmation de liberté (..) les fins extérieures perdent leur apparence de nécessité naturelle, posées et imposées comme elles sont par l'individu lui-même : (…c’est) la réalisation de soi, l’objectivisation du sujet, donc sa liberté concrète, qui s’actualise précisément dans le travail ». ([26] [1444])
Et de nouveau : « Les travaux vraiment libres, la composition musicale par exemple, c'est diablement sérieux, cela exige même l'effort le plus intense ». ([27] [1445])
Vision mondiale de la première classe travailleuse à être révolutionnaire et reconnaissant le travail comme la forme d'activité spécifiquement humaine, le marxisme ne peut envisager que les êtres humains trouvent une satisfaction réelle dans un simple « loisir » conçu dans une opposition abstraite vis-à-vis du travail ; il affirme donc que l'humanité se réalisera véritablement sous la forme de la création active, dans une fusion inspirée de travail, de science et d'art.
Dans la prochaine partie de cette série, nous suivrons le « retour » de Marx du monde abstrait des études économiques au monde pratique de la politique, dans la période qui a culminé dans la première révolution prolétarienne de l'histoire, la Commune de Paris. Ce faisant, nous retracerons le développement de la compréhension marxiste du problème politique par excellence : le problème de l'Etat et comment s'en débarrasser.
CDW.
[1] [1446] Voir la Revue Internationale n°75.
[2] [1447] Lettre à Meyer, 30 avril 1867
[3] [1448] Lettre à Becker, 17 avril 1867.
[4] [1449] Livre III du Capital, Ed. La Pléiade, Tome II, 7e section, « La formule trinitaire».
[5] [1450] Livre I du Capital, chapitre I, Edition Garnier Flammarion.
[6] [1451] Ibid., chapitre XXXII.
[7] [1452] Ibid.
[8] [1453] Ibid.
[9] [1454] Théories sur la Plus-Value, chapitre XVII, Editions sociales, Tome II.
[10] [1455] Ibid.
[11] [1456] Grundrisse, «Chapitre du Capital », Edition 1018.
[12] [1457] Livre III du Capital, Ed. La Pléiade, Tome II, 3e section, « Conclusions ».
[13] [1458] Ibid.
[14] [1459] Théories sur la Plus-Value, Chapitre XVII, Ed. sociales, Tome II.
[15] [1460] Livre III du Capital, Ed. La Pléiade, Tome II, 3e section, « Définition de la loi».
[16] [1461] Livre III du Capital, Ed. La Pléiade, Tome 11, 3e section, «Conclusions ».
[17] [1462] Voir en particulier l'article « Marxisme et théorie des crises» dans la Revue Internationale n°13
[18] [1463] Théories sur la Plus- Value, Chapitre XVII, Ed. sociales, Tome II.
[19] [1464] Livre III du Capital, Ed. La Pléiade, Tome II, 3e section, « Les contradictions internes ».
[20] [1465] Livre I du Capital, chapitre I, Ed. Garnier Flammarion. Nous reviendrons dans un autre article sur la question du temps de travail comme moyen de mesure de la consommation individuelle. Mais notons qu'ici, ce n'est plus le temps de travail qui domine le travailleur et la société ; la société l'utilise de façon consciente comme moyen de planifier la production et la distribution rationnelles des valeurs d'usage. Et, comme Marx le montre dans les Grundrisse, ce n'est certainement plus en termes de temps de travail qu'elle mesure sa richesse réelle, mais en termes de temps libre.
[21] [1466] Grundrisse, « Chapitre de l'Argent », Ed. 10-18.
[22] [1467] Principes d'une critique de l'économie politique, Ed. La Pléiade, Tome II, Chapitre III, « Manufacture et capital ».
[23] [1468] Livre III du Capital, Ed. La Pléiade, Tome II, Fragments, « En manière de conclusion».
[24] [1469] Ibid.
[25] [1470] Principes d'une critique de l'économie politique, Ed. La Pléiade, Tome II, chapitre II, «Machinisme, science et loisir créateur »,.
[26] [1471] Principes d'une critique de l'économie politique, Ed. La Pléiade, Tome II, Chapitre II, « Le travail comme sacrifice et le travail libre ».
[27] [1472] Ibid.
Approfondir:
Questions théoriques:
- Communisme [492]
Heritage de la Gauche Communiste:
Revue Internationale no 77 - 2e trimestre 1994
- 2731 reads
Situation internationale : Les grandes puissances impérialistes sont les fauteurs de guerre
- 3244 reads
Les grandes puissances impérialistes sont les fauteurs de guerre dans l'ex-Yougoslavie, tout comme dans le reste du monde
L'hiver, et particulièrement le mois de février 1994, a vu la guerre impérialiste en Yougoslavie passer à un stade supérieur, plus dramatique, aux enjeux plus élevés encore pour le monde capitaliste, avec le massacre du marché de Sarajevo et l'intervention militaire directe des Etats-Unis et de la Russie. Mais la folie guerrière et les conflits régionaux gagnent aussi toute la planète : les anciennes Républiques méridionales et orientales de l'ex-URSS, le Moyen-Orient, l'Afghanistan, le Cambodge, l'Afrique.
En même temps, la crise économique étend et aggrave ses ravages sur des milliards d'êtres humains. Là aussi, l'impasse, la catastrophe et la perspective d'une chute dramatique dans la misère gagnent toute la planète, ce qui ne pourra qu'alimenter encore plus les conflits et les guerres.
Le capitalisme mène le monde à la désolation et à la destruction. La guerre dans l'ex-Yougoslavie n'est pas une guerre d'un autre temps, du passé, ni d'une période transitoire, le prix à payer pour la fin du stalinisme, mais bel et bien une guerre impérialiste d'aujourd'hui, de la situation qui fait suite à la disparition du bloc de l'Est et de l'URSS. Une guerre de la phase de décomposition du capitalisme décadent. Une guerre qui est l'annonce du seul devenir que peut offrir le capitalisme à l'ensemble de l'humanité.
Au bas mot 200 000morts -combien de blessés, d'invalides ? - tel est le tribut payé par la population en Bosnie et dans l'ex-Yougoslavie aux nationalismes et aux intérêts impérialistes. Les vies déchirées, « la purification ethnique » massive, les familles chassées de chez elles et déportées dont les membres sont séparés - se reverront-ils un jour ? - voilà la réalité du capitalisme. Il faut dénoncer la terreur exercée par chaque camp, par des milices et une soldatesque ivres de sang, de viols, de tortures. Il faut dénoncer la terreur qu'exercent les Etats bosniaque, serbe et croate, sur les réfugiés dont on exige la mobilisation forcée dans les différentes armées, sous peine de mort en cas de désertion. Et bien sûr, dénoncer la misère et la faim, crier son horreur devant les vieillards réduits à la mendicité, assassinés par un « snipper » parce qu'ils ne courent pas assez vite, devant ces parents partis chercher du ravitaillement et déchiquetés par les obus qui tombent aveuglement, devant les enfants traumatisés à vie dans leur chair et dans leur coeur. Il faut dénoncer la barbarie du capitalisme. Il est responsable de ces tragédies.
Il faut dénoncer aussi, dans cette folie guerrière, dans cette barbarie dont la population ne voit pas la fin, les nouvelles « valeurs », les nouveaux « principes », qui émergent du « nouvel ordre mondial » que la bourgeoisie nous avait promis après la chute du mur de Berlin : le chaos et le chacun pour soi. Les retournements d'alliance, la trahison, sont la règle : à peine signés, les accords de cessez-le-feu sont systématiquement bafoués ; les Bosniaques, les Croates, et les Serbes, se sont tour à tour alliés avec l'un contre l'autre, pour ensuite se retourner contre l'allié de la veille. Les Croates et les Bosniaques se sont entre massacrés à Mostar sous l'oeil bienveillant des miliciens serbes alors qu'ils s'opposaient ensemble aux Serbes à Sarajevo. Jusqu'aux « Musulmans » de l'enclave de Bihac qui se sont entre-tués alors qu'ils étaient encerclés !
Une fois terminé le conflit actuel, s'il doit se terminer un jour, jamais la situation d'avant-guerre ne pourra revenir. Les Etats qui subsisteront seront dévastés et ne pourront se relever dans une situation de crise économique mondiale. Même si les bourgeoisies locales ne pouvaient y échapper, et n'y ont pas échappé, aveuglées par leur propre nationalisme, par les différents intérêts particuliers, par le « chacun pour soi », la guerre en Yougoslavie ne débouchera pas sur des Etats renforcés et viables. Tout au plus certains seigneurs de la guerre, certains roitelets locaux, vont pouvoir jouir de leur pouvoir et de leur racket, jusqu'à ce qu'un rival vienne les supplanter. C'est ce qui s'est passé au Liban, en Afghanistan, au Cambodge. C'est ce qui se passe en Géorgie, en Palestine, au Tadjikistan, et ailleurs. La Yougoslavie s'est « libanisée » à son tour.
L'INTERVENTION IMPERIALISTE DES GRANDES PUISSANCES EST RESPONSABLE DU DEVELOPPEMENT DE LA GUERRE ET DE SON AGGRAVATION
Si l'explosion de la Yougoslavie tenait directement des effets de la décomposition, l'impérialisme a trouvé dans cette même décomposition généralisée, et en Yougoslavie même, un terrain fertile à son action funeste. A l'origine, c'est l'Allemagne qui a poussé les Slovènes et les Croates à l'indépendance. Et ce sont les Etats-Unis et la France, entres autres, qui ont appuyé, à l'époque, les Serbes pour qu'il réagissent et donnent une leçon à la Croatie, et à l'Allemagne.
« Il n'y pas de soutien désintéressé, dès que le problème de la Bosnie est devenu le problème des Balkans, il s'est transformé en un problème de rapport de forces politiques, et les intérêts des grandes puissances ont pris le pas sur la réalité du conflit. » ([1] [1473])
Aujourd'hui, deux ans d'interventions directes, militaires et diplomatiques, des grandes puissances dans le conflit, sous couvert de l'ONU et de l'OTAN, et si besoin était encore, les derniers événements de février, la menace de frappes aériennes, l'envoi de casques bleus russes, les chasseurs F16 de l'OTAN abattant des avions serbes, révèlent clairement, sans ambiguïté, le caractère impérialiste du conflit où les grandes puissances défendent leurs intérêts les unes contre les autres : « Une politique internationale effective continue d'être contrecarrée par les intérêts rivaux des principales puissances européennes. Avec la Grande-Bretagne, la France et la Russie protégeant effectivement les Serbes, et les Etats-Unis faisant ce qu'ils peuvent en faveur du gouvernement musulman, ceux-ci mettent maintenant la pression sur la troisième partie en lutte, les Croates, dont le protecteur traditionnel, l'Allemagne, trouve peu politique de se dresser contre les autres puissances. » ([2] [1474])
Il y a longtemps que le masque de « l'humanitaire » est tombé. La presse bourgeoise internationale, on vient de le voir, ne l'évoque plus. Du coup apparaît au grand jour la nature et l'objectif des grandes proclamations des pacifistes et autres « humanistes » du monde bourgeois qui appelaient à sauver la Bosnie, à arrêter le massacre. Ils ont servi durant deux ans à essayer de mobiliser les populations, et particulièrement la classe ouvrière des grandes puissances industrialisées, derrière les interventions militaires, derrière l'impérialisme de leur propre bourgeoisie nationale. Une fois de plus, les grands pacifistes, qu'ils soient « philosophes », écrivains, artistes, curés, ou (h écologistes, se sont révélés, avec leur double langage, comme de dangereux va-t-en-guerre au service de l'impérialisme.
Les Etats-Unis a la contre-offensive
Depuis la guerre du Golfe où les Etats-Unis avaient fait la démonstration éclatante de leur leadership mondial, la bourgeoisie américaine a vécu de sérieuses déconvenues, un échec même, en Yougoslavie. D'abord incapables de s'opposer au démembrement de cette dernière, et donc à l'indépendance de la Croatie qui manifestait une ouverture et une avancée pour l'Allemagne, les Etats-Unis se sont appuyés sur la Bosnie pour avoir un point d'ancrage dans la région. Mais là, ils se sont révélés incapables de garantir l'intégrité et l'unité de ce nouvel Etat malgré leur puissance. Résultat : une Slovénie et une Croatie indépendantes sous influence allemande, une Serbie sous influence française d'abord, et aujourd'hui surtout russe, une Bosnie démantelée, un Etat-croupion sur lequel il était difficile de s'appuyer. Le bilan était négatif pour la première puissance impérialiste mondiale. Les Etats-Unis ne pouvaient rester sur un échec qui mettait en cause leur « crédibilité » et leur leadership et les affaiblissait aux yeux du monde. Les Etats-Unis ne pouvaient rester sur un échec qui allait encourager encore plus les grands rivaux impérialistes, européens et japonais, et les petits impérialismes des pays « secondaires », à s'affirmer et à remettre en cause le « nouvel ordre mondial » américain.
Impuissants dans les Balkans, leur contre-offensive s'est développée autour de deux axes au niveau mondial : leur intervention en Somalie et au Moyen-Orient avec l'ouverture - au prix de l'action militaire meurtrière d'Israël au Liban en juillet 1993 - des négociations de paix entre l'Etat Hébreu et l'OLP ([3] [1475]). Ils faisaient la preuve de leur capacité militaire et diplomatique, de leur capacité à « régler des conflits » ce qui, parallèlement, mettait en évidence... l'incapacité des Européens à régler la guerre en Bosnie. D'autant que les Etats-Unis faisaient tout pour saboter les différents plans de partition au profit des Serbes, que mettaient en avant les Européens : en poussant le gouvernement bosniaque à l'intransigeance et en réarmant son armée. Ce qui a permis à celle-ci de reprendre l'offensive contre les Serbes et les Croates durant l'hiver.
Cependant, cela ne pouvait suffire à faire regagner le terrain perdu à la première puissance mondiale, à effacer l'impression d'affaiblissement. Certes, elle réussissait à bloquer l'action des Européens, les négociations de paix en particulier, mais sans pouvoir reprendre l'initiative. A force, la poursuite sanglante du conflit commençait à atteindre, par ricochet, encore plus la «crédibilité» des Etats-Unis eux-mêmes. Le massacre du marché de Sarajevo est venu à point pour relancer la donne du jeu impérialiste.
Alors que Clinton justifiait l'absence d'intervention militaire aérienne américaine par le refus des Français et des Britanniques, des voix de plus en plus nombreuses de l'appareil d'Etat américain poussaient à l'action : « Nous continuerons à avoir un problème de crédibilité si nous n'agissons pas » lui a répondu Tom Foley ([4] [1476]), « Speaker » à la Chambre des Représentants. On le voit, Tom Foley est plus soucieux de la crédibilité militaire des Etats-Unis que des considérations « humanitaires » qui sont avancées au « prime time » des télévisions à l'usage des populations et de la classe ouvrière.
L'ultimatum de l'OTAN redonne l'initiative aux Etats-Unis
L'ultimatum de l'OTAN qui a fait suite au carnage du marché de Sarajevo, a sanctionné l'impuissance européenne, de la France et de la Grande-Bretagne en particulier, obligées d'approuver les frappes aériennes qu'elles avaient toujours refusées et sabotées depuis le début du conflit. Il manifestait la prépondérance de l'OTAN, dont les Etats-Unis sont les maîtres, sur l'ONU et les casques bleus sur place, où le poids de la France et de la Grande-Bretagne était plus grand. Le retrait des canons serbes, obtenu par la menace aérienne de l'OTAN a été un succès pour les Etats-Unis. L'ultimatum leur a permis de reprendre l'initiative, d'avoir un pied dans la place, tant au plan militaire que diplomatique. Néanmoins, ce succès restait encore limité. Il n'était qu'un premier pas. Il ne gommait pas le recul des mois précédents, en particulier la partition de la Bosnie.
« Les gouvernements européens ont joué un rôle cynique. (...) Les Européens voulaient utiliser le bombardement de Sarajevo et d'autres villes, pour faire pression sur le gouvernement bosniaque afin qu'il accepte un mauvais plan de partition qui leur dénie tout territoire vital et toutes routes de commerce. S'ils acceptent maintenant de souscrire aux frappes aériennes de l'OTAN contre les canons des assiégeants, ils attendent au moins en retour que Washington se joigne à leur manoeuvre diplomatique au moment même où le gouvernement bosniaque a commencé à retrouver une force militaire et à récupérer certaines de ses pertes initiales. » ([5] [1477])
Par ailleurs, la démonstration de force américaine était amoindrie par un retrait des Serbes en traînant les pieds et la protection que leur a fournie l'arrivée de casques bleus russes. «L'alliance (l'OTAN) n'a pas fait ses preuves. Et l'on continuera à douter de sa volonté et de sa capacité. » ([6] [1478]). L'aviation américaine allait essayer de corriger quelque peu cette mauvaise impression, en abattant quatre avions serbes qui survolaient le territoire bosniaque malgré l'interdiction qui leur en était faite, et alors que près de mille infractions avaient été relevées auparavant, sans provoquer de réaction de l'OTAN. La « crédibilité » des Etats-Unis leur imposait de saisir la bonne occasion au bon moment pour eux. Ils l'ont saisie.
Après l'ultimatum, les Etats-Unis mettent les Européens sur la touche
Le retour en force des Etats-Unis s'est concrétisé par la signature de l'accord croato-musulman. Dès le début du mois de février, la pression des Etats-Unis s'est faite sentir sur la Croatie: « Il est temps maintenant de faire payer la Croatie, économiquement et politiquement. » ([7] [1479]), la menace avant le chantage. Ce que les Croates ont compris tout de suite, comme en témoigne le limogeage du chef croate de Bosnie ultra-nationaliste, Mate Boban, et son remplacement par quelqu'un de plus « raisonnable » et de plus contrôlable. Après la menace est venue le « deal », le marché, et la proposition : « Le seul moyen pour que la Croatie puisse obtenir un soutien international pour réclamer la Krajina est de reformer son alliance avec la Bosnie. » ([8] [1480])
Est-il besoin de souligner que cette nouvelle alliance sous l'égide américaine qui promet à la Croatie la récupération de la Krajina occupée par les Serbes, est directement dirigée contre ceux-ci ? Un pas vers la « paix » qui est porteur d'une aggravation encore plus terrible de la guerre, tant au plan « quantitatif» - l'embrasement de toute l'ex-Yougoslavie-, qu'au plan «qualitatif» si l'on ose dire - une guerre « totale » entre les armées régulières de Serbie et de Croatie.
A l'heure où nous écrivons, l'accord entre Croates et Bosniaques n'a pas éteint les affrontements autour de Mostar en particulier. Mais pour sûr, c'est un succès pour les Etats-Unis dans la mesure où les pays européens, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, qui sont obligées de « saluer » l'initiative, la voient d'un très mauvais oeil. Exit les négociations de Genève sous l'égide de l'Union Européenne. L'accord vient confirmer et leur impuissance et leur mise sur la touche, au moins pour le moment. La signature de l'accord à Washington même, la photo de Warren Cristopher, le Secrétaire d'Etat américain, debout derrière les signataires, est une douce revanche pour la bourgeoisie américaine après plus de deux ans de pieds de nez européens: «L'Europe en tant que principal arbitre de la crise yougoslave a fait son temps. » ([9] [1481])
l'agressivite imperialiste de la Russie
Le retour en force de la Russie « dans le concert des nations », sa ferme opposition à l'ultimatum de l'OTAN, puis le succès de sa diplomatie qui sauve la face des Serbes « en obtenant» le recul de leur artillerie des hauteurs de Sarajevo, l'envoi de casques bleus russes, sont une autre expression de la redistribution des cartes impérialistes depuis le massacre du marché de Sarajevo. Elle marque un réveil de « l'arrogance » impérialiste de la Russie. Cette aspiration à rejouer un rôle de premier plan sur la scène internationale s'était déjà clairement affirmée ces derniers mois.
Jusqu'à présent, l'attitude des Etats-Unis à l'égard de la Russie, était un soutien sans faille à Eltsine, tant sur le plan intérieur contre les fractions staliniennes conservatrices, que sur le plan extérieur. L'intervention russe dans son ancien empire s'est faite avec l'assentiment américain.
Que, dans les ex-républiques soviétiques, la Russie fasse pièce aux aspirations impérialistes de l'Iran « islamiste » et de la Turquie qui penche toujours plus vers l'Allemagne, que la Russie impose à une Ukraine, toujours troisième puissance nucléaire du monde, mais dont l'économie est en pleine déconfiture, ses conditions et donc l'abandon de son flirt avec l'Allemagne, qu'une Russie s alliée s'arroge une zone d'influence sur le territoire de l'ancienne URSS, voilà qui ne pouvait que convenir à la bourgeoisie nord-américaine.
Mais que la Russie ait des visées plus précises sur les pays de l'ex-Pacte de Varsovie, quand elle s'oppose à leur intégration à l'OTAN, voilà qui inquiète les bourgeoisies européennes, l'Allemagne au premier chef, et qui provoque des interrogations au sein même de la bourgeoisie américaine, même si Clinton cède à sa demande en repoussant l'adhésion. Que la Russie enfin accède militairement pour la première fois de toute son histoire dans les Balkans, même sous la forme symbolique - mais quel symbole ! - de quelques centaines de casques bleus, c'est-à-dire qu'elle ait franchi un pas important vers la réalisation de cet objectif historique vieux de plusieurs siècles, et jamais atteint, d'une ouverture sur la Méditerranée, voilà qui alerte la bourgeoisie américaine. Car point trop n'en faut. Cette vieille aspiration à la Méditerranée de la part de la Russie, tout comme la même aspiration de la part de l'Allemagne, ne peut être acceptée par les impérialismes américain, britannique et français qui, eux, y sont déjà présents, même avec un Eltsine et des « réformateurs » au pouvoir. « Nous n'avons pas affaire à du noir et du blanc, mais du gris. Il y aura forcément des choses que nous n'aimerons pas » a dit Clinton à propos de la Russie. ([10] [1482])
Mais de plus, dans la situation incontrôlable et incontrôlée qui se développe chaque jour un peu plus en Russie, le chaos et l'anarchie qui s'approfondissent, les départs du gouvernement Eltsine des « réformateurs » proaméricains comme Gaïdar, au profit des fractions « conservatrices » de la bourgeoisie russe dont l'esprit ultra-nationaliste et revanchard s'incarne jusque dans les outrances de Jirinowski, ne peuvent qu'alarmer les puissances occidentales. Le risque est réel de voir une Russie incontrôlable, aux mains de néo-staliniens revanchards ou d'un Jirinowski.
Soyons clair, quelle que soit la fraction au pouvoir, ce retour de la Russie au premier plan dans les antagonismes impérialistes, ne signifie pas un retour à la situation de « stabilité » internationale qui avait prévalu de Yalta à la chute du mur de Berlin, et qui avait alimenté tous les conflits impérialistes de l'époque. Il ne signifie pas la réapparition de deux grandes puissances capables d'imposer à leurs protégés respectifs les limites à ne pas dépasser. Il n'y aura pas de retour à la reconstitution d'un bloc impérialiste de l'Est mené par la Russie opposé à un bloc de l'Ouest. Le retour de la Russie, alimenté et dangereusement exacerbé par la situation de chaos dans le pays et la fuite en avant de la bourgeoisie russe, est porteur d'aggravation terrible des tensions et des antagonismes impérialistes, porteur de chaos et de guerres encore plus accentués au plan international.
L'utilisation de l'OTAN (qui avait été créée en 1949 pour faire face à l'URSS) pour imposer aujourd'hui l'ultimatum à la Serbie, a constitué « une gifle magistrale ». Elle a signifié un avertissement à la Russie, à Eltsine bien sûr, mais aussi aux autres fractions de l'appareil d'Etat russe, aux revanchards et aux nostalgiques de la grandeur de l'URSS. «L'ultimatum de l'OTAN, en soi, était déjà suffisamment mortifiant » pour la Russie. ([11] [1483]) Les Etats-Unis ont voulu adresser un message clair à leur «partenaire» russe (la presse américaine ne parle plus d'« allié ») : attention, il y a des limites à ne pas dépasser. Au cas où le message n'aurait pas été bien entendu, l'attaque par l'aviation américaine des avions serbes est venue mettre les points sur les « i ». N’est-ce pas la première fois de son histoire que l'OTAN tire une seule balle en 45 ans d'existence ?
Tout comme cette intervention militaire directe des Etats-Unis en ex-Yougoslavie, l'intervention militaire russe, tout aussi directe, est un nouvel élément d'extrême importance dans la situation internationale. Les deux marquent un pas de plus dans la guerre, un pas de plus dans l'exacerbation ^des tensions impérialistes, un pas de plus dans le chaos et le « tous contre tous », tant dans les Balkans - pauvres populations qui ne sont pas au bout de leurs souffrances -que sur le reste de la scène internationale.
L’EUROPE IMPUISSANTE
Si la nouvelle donne de la situation internationale au plan des rivalités impérialistes s'illustre par le retour en force des impérialismes des Etats-Unis et de la Russie en exYougoslavie, elle est caractérisée aussi par son corollaire : l'impuissance et l'affaiblissement des puissances européennes, tout particulièrement de la France et de la Grande-Bretagne. Celles-ci, qui avaient réussi durant deux ans, à saboter les intentions d'intervention militaire américaine, à narguer ouvertement les Etats-Unis, et à occuper un rôle de premier plan sur les terrains militaire et diplomatique, ont dû ravaler leurs prétentions et se ranger finalement derrière ce qu'elles avaient systématiquement refusé : les frappes aériennes de l'OTAN sur les Serbes. De son côté, l'Allemagne n'a pu qu'assister impuissante à la contre-offensive américaine, qui signifiait certes une pression sur les Serbes dont elle ne pouvait qu'être satisfaite, mais aussi une pression sur la Croatie, son allié, ce dont au contraire, elle ne pouvait se réjouir.
L'avancée allemande est bloquée
En fait, avec les derniers événements, l'Allemagne voit se multiplier les obstacles à son affirmation comme puissance impérialiste « leader », comme pôle impérialiste alternatif aux Etats-Unis. La Russie, avec l'aval américain, tend à lui disputer l'Europe centrale et l'Ukraine. En Yougoslavie, où « l'Autriche, la Croatie et la Slovénie ne peuvent plus compter sur un "leadership" allemand clair» ([12] [1484]), l'Allemagne voit les Etats-Unis lui disputer, chose impensable il y a encore deux mois, la Croatie. Incapable qu'elle est de lui offrir ce que les Etats-Unis lui promettent : la Krajina. Elle voit même l'impérialisme américain lui interdire tout rôle réel dans les négociations et dans l'alliance entre les Croates et les Musulmans. Absente sur le terrain, puisqu'elle n'a pas de troupes parmi les soldats de l'ONU, seule grande puissance avec le Japon à ne pas avoir de siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies sur lequel elle ne peut donc peser, et encore moins poser son veto, elle ne peut que jouer en sous-main -elle ne s'en prive pas bien sûr - et assister impuissante, pour l'instant, à la contre-offensive américaine.
Par ailleurs, la nouvelle « arrogance » fusse inquiète l'Allemagne. Car même si celle-ci peut essayer parfois de « flirter » avec la Russie, les deux ayant en commun l'objectif d'accéder à la Méditerranée, sur le long terme, au plan historique, les deux ont aussi des intérêts impérialistes opposés et contradictoires, particulièrement en Europe de l'Est et dans les Balkans. L'Allemagne est donc prise entre son aspiration à devenir une des premières puissances impérialistes, donc à s'affirmer contre les Etats-Unis tout particulièrement, et l'inquiétude d'une Russie chaotique, dont seuls les Etats-Unis peuvent la protéger militairement.
Incapable de suivre la mise américaine, l'impérialisme français est mis hors-jeu
La France, pour qui « le maintien de la coopération politique franco-allemande comme noyau de la Communauté Européenne continue d'être la priorité de la diplomatie française » ([13] [1485]) au niveau général et historique, s'est opposée localement à l'avancée allemande en Croatie et vers la Méditerranée. En même temps, elle s'est opposée à toute ingérence américaine. Elle a donc essayé de jouer seule, avec la Grande-Bretagne, ce qui s'est révélé être au-dessus de ses forces.
Ayant perdu l'écoute de la partie Serbe, menacées par l'offensive militaire bosniaque, les négociations de paix sous leur égide paralysées, la France et la Grande-Bretagne étaient dans l'impasse. Situation inconfortable. La bourgeoisie française ayant épuisé ses atouts, en a tiré les conséquences en priant les Etats-Unis et l'OTAN d'intervenir. Incapable de relancer à hauteur de la mise américaine, elle a du se coucher pour pouvoir rester à la table du jeu impérialiste.
Comme lors de la guerre du Golfe. C'est ce que le Président Mitterrand appelle : « tenir son rang ». C'était ça ou être exclue de la table avec perte et fracas.
La Grande-Bretagne sous la pression américaine
Pour la Grande-Bretagne, la contradiction et l'échec ont été à peu près les mêmes. Lieutenant historique des Etats-Unis, leur plus fidèle allié dans les rivalités impérialistes, et hostile, elle aussi, à toute avancée de l'Allemagne dans les Balkans, la bourgeoisie britannique n'en a pas moins, signe des temps, signe du règne croissant du chaos et du chacun pour soi, voulu défendre ses intérêts spécifiques en Yougoslavie, et en particulier ne pas « partager » sa présence politique et militaire dans la région avec la bourgeoisie américaine. La redistribution des cartes qu’a occasionnée le bombardement du marché de Sarajevo et l'ultimatum de l'OTAN, auquel le gouvernement Major s'est déclaré hostile, se sont accompagnés d'une forte pression sur la Grande-Bretagne avant le voyage de son premier ministre à Washington. ([14] [1486])
« L'approche à court terme dans le désastre bosniaque orchestré par la Grande-Bretagne, menace de déstabiliser une bonne partie de l'Europe. (...) John Major devrait repartir de Washington sans aucun doute sur le fait que sa politique bosniaque sera étudiée minutieusement et que tout opportunisme supplémentaire qui exacerberait la crise des Balkans, ne sera pas facilement oublié, ni pardonné. » ([15] [1487])
Cette pression américaine et la situation difficile dans laquelle la Grande-Bretagne s'est retrouvée en Bosnie, ont imposé à la bourgeoisie britannique de rentrer dans le rang et d'approuver l'ultimatum de l'OTAN (d'autant qu'elle se retrouvait seule depuis l'approbation de la France). Comme le disait The Guardian, «Dans un discours aux Communes, le ministre des Affaires étrangères Douglas Hurd a trahi les motivations cachées de ce revirement. Il a souligné par trois fois la nécessité de rétablir la crédibilité et la solidarité au sein de l'OTAN, et en particulier le soutien des Etats-Unis à cette organisation. » ([16] [1488])
Avec l'OTAN, les Etats-Unis imposent aux européens de rentrer dans le rang
Les Etats-Unis viennent avec éclat de réaffirmer à la face du monde leur leadership mondial. Ils ont finalement réussi à refaire le coup de la Guerre du Golfe : faire rentrer dans le giron américain -pour le moins en Yougoslavie et pour le moment en tout cas -les puissances européennes qui voulaient s’en dégager. Et particulièrement, l'Allemagne, la France surtout et des pays (l'Italie, l'Espagne, la Belgique par exemple) qui, bien qu'assumant un rôle secondaire, n'oublient pas de défendre leurs intérêts impérialistes et de jouer la carte européenne, et donc anti-américaine, derrière la France et l'Allemagne. De même, cette impuissance de l'Europe, obligée d'en appeler aux Etats-Unis, prend une signification pour l'ensemble des impérialismes de la planète qui sont poussés d'une manière ou d'une autre à s'élever contre les intérêts américains. C'est une victoire pour la bourgeoisie américaine, une victoire qui porte en elle l'exacerbation des antagonismes impérialistes et des guerres.
VERS L'AGGRAVATION DES TENSIONS IMPERIALISTES ET DU CHAOS
Le succès remporté par les Etats-Unis en ex-Yougoslavie n'est pas encore complet. Ils ne peuvent s'en contenter. L'alliance croato-musulmane qu'ils patronnent, si elle va jusqu'à son terme, va porter l'affrontement avec la Serbie à un niveau supérieur. Les puissances européennes qui viennent de prendre une gifle, ne vont pas manquer de jeter de l'huile sur le feu. Eltsine, poussé par les fractions les plus conservatrices et nationalistes, ne peut qu'accentuer la politique impérialiste de la Russie. Mais pire encore, tous les Etats étant impérialistes, la chaîne des conflits impérialistes entraîne tous les pays dans un processus irréversible et inextricable d'affrontements et d'antagonismes : dans les Balkans, la Grèce, la Macédoine, l'Albanie, la Bulgarie, la Hongrie, la Roumanie, et la Turquie ; en Asie ex-soviétique, la Turquie, la Russie et l'Iran ; en Afghanistan, la Turquie, l'Iran et le Pakistan ; au Cachemire, le Pakistan doté de l'arme atomique contre l’Inde, elle aussi, puissance nucléaire ; l’Inde contre la Chine au Tibet ; la Chine et le Japon contre la Russie pour des querelles de frontières et les îles Kouriles, etc. La guerre de tous contre tous. Et la liste est loin, très loin, d'être exhaustive.
La chaîne des conflits en cascade, les uns entraînant les autres, dans le désordre et le chaos, le chacun pour soi le plus complet, se tend de plus en plus. Elle entraîne le monde capitaliste dans la barbarie guerrière la plus noire. Se vérifie ainsi la position marxiste selon laquelle le capitalisme, c'est la guerre impérialiste, la « paix » ne faisant que préparer la guerre impérialiste. Se vérifie ainsi la thèse marxiste selon laquelle dans la période de décadence, tout Etat, petit ou grand, faible ou fort, est impérialiste. Se vérifie aussi la thèse marxiste selon laquelle la classe ouvrière, le prolétariat international, où qu'il se trouve, ne peut apporter son soutien au nationalisme, à sa bourgeoisie, une telle capitulation politique ne menant qu'à l'abandon de ses intérêts de classe, de ses luttes, ne menant qu'aux sacrifices matériels et physiques sur l'autel du nationalisme. Se vérifie l'affirmation marxiste que le capitalisme en décadence n'a plus rien de positif à apporter à l'humanité, que sa décomposition entraîne celle-ci vers le néant, vers sa perte. Se vérifie l'alternative que mettaient en avant les communistes du début du siècle : socialisme ou barbarie.
Au prix d'innombrables et incommensurables souffrances, de larmes et de sang, l'échéance historique décisive se rapproche. Détruire le capitalisme avant qu'il ne détruise l'humanité entière, tel est l'enjeu, dramatique et gigantesque, telle est la mission historique du prolétariat !
[1] [1489] Libération, 22/2/94.
[2] [1490] The New York Times repris par l'International Herald Tribune, 3/3/94.
[3] [1491] Le massacre d'Hébron par un colon fanatique religieux juif que les soldats israéliens présents ont laissé faire de toute évidence, exprime la réalité de la «paix» que les Etats-Unis imposent au Moyen-Orient. Si le crime profite à l'Etat hébreu qui trouve ainsi une justification pour essayer de museler et de désarmer ses propres extrémistes, il aggrave encore plus la situation de chaos dans laquelle les territoires occupés et le territoire israélien lui-même sont en train de s'enfoncer. Si les négociations de paix et la constitution d'un Etat palestinien, en continuité avec la guerre du Golfe, sont, et seront, un succès des Etats-Unis, qui ont éliminé ainsi tout rival impérialiste de la région, la situation de désordre et d'anarchie, de décomposition, des deux Etats, et de la région, continuera à s'aggraver.
[4] [1492] Le Monde, 8/2/94.
[5] [1493] The New York Times, 9/2/94.
[6] [1494] The Guardian, repris dans Courrier International du 24/2/94.
[7] [1495] The New York Times repris par Y International Herald Tribune du 8/2/94.
[8] [1496] The New York Times repris dans Y International Herald Tribune du 26/2/94.
[9] [1497] The Guardian repris dans Courrier International du 24/2/94.
[10] [1498] Le Monde, 27/2/94.
[11] [1499] La Repubblica, repris dans Courrier International du 24/2/94.
[12] [1500] International Herald Tribune, 14/2/94.
[13] [1501] 1bid.
[14] [1502] Le visa accordé par le gouvernement américain au leader de TIRA, Gerry Adams, et la publicité faite autour de sa visite aux Etats-Unis, son interview par Larry King, célèbre journaliste de CNN à une heure de grande écoute, ont été aussi une expression de la pression américaine sur le gouvernement Major.
[15] [1503] International Herald Tribune, 26/2/94.
[16] [1504] Repris dans Courrier International, 17/2/94.
Géographique:
- Europe [95]
Questions théoriques:
- Guerre [129]
- Impérialisme [321]
Crise économique mondiale : l'explosion du chômage
- 2971 reads
L'année 1994 a commencé marquée par une réalité majeure : l'explosion du chômage
L'année 1994 a commencé marquée par une réalité majeure : l'explosion du chômage dans le monde. Les gouvernements des 7 premières puissances économiques occidentales ont pour l'occasion organisé, à grands renforts de propagande médiatique, une réunion exclusivement consacrée à cette question, qualifiée de « problème numéro un ». Le président américain devait solennellement y présenter «c un plan mondial contre le chômage », fondé sur la « réussite » des méthodes américaines. Au coeur de l'Europe, dans la première puissance du continent, le chômage bat des records inconnus depuis les années 1930. Le ministre allemand de l'économie, Gunter Rexold reconnaît : « Le fait que plus de quatre millions de citoyens n'aient pas trouvé de travail constitue pour l'Etat et la société l'un des plus grands défis depuis la fondation de la République Fédérale. » Un rapport de l'Organisation internationale du travail affirme qu'il y a aujourd'hui 30 % des travailleurs dans le monde qui sont chômeurs ou sous-employés. Cela fait 820 millions de personnes : 120 millions sont des chômeurs officiellement « enregistrés », 700 millions sont des « sous-employés ». Quelle est la signification de cette nouvelle aggravation du chômage ? Les méthodes du gouvernement américain sont elles un remède efficace contre la maladie ? Quelles perspectives pour la lutte de classe ?
Une situation sans précédent
Plus l'idéologie dominante, dans la foulée des campagnes sur « l'effondrement du communisme », présente le capitalisme comme la seule forme d'organisation sociale possible pour l'humanité moderne, plus les ravages occasionnés par la subsistance de ce système s'avèrent dévastateurs. Le chômage, source de misère, d'exclusion, de désespoir, ce fléau qui incarne au plus haut point l'impitoyable et absurde dictature du profit capitaliste sur les conditions d'existence de l'immense majorité de la société, constitue sans aucun doute la plus significative de ces calamités.
L'actuelle augmentation du chômage, expression de la nouvelle récession ouverte dans laquelle le capitalisme s'enfonce depuis maintenant quatre ans, ne s'abat pas sur une monde jouissant du « plein emploi ». Loin s'en faut. Cela fait maintenant plus d'un quart de siècle, depuis la récession de 1967, qui marqua la fin de la prospérité consécutive à la reconstruction d'après-guerre, que la lèpre du chômage se répand systématiquement sur la planète. La maladie s'est aggravée et répandue suivant le rythme des ralentissements de la « croissance » économique, avec des moments d'accélération et des périodes de piétinement relatif. Mais les périodes de soulagement ne sont jamais parvenues à annuler les effets de l'aggravation précédente, et à travers des fluctuations diverses, dans tous les pays, le nombre de chômeurs n'a cessé d'augmenter. ([1] [1505]) Depuis le début des années 1970, le terme même de « plein emploi » a quasiment disparu du vocabulaire. Les adolescents de deux dernières décennies se sont toujours vu appeler « la génération du chômage ».
L'explosion du chômage qui marque le début des années 1990 ne crée donc pas un nouveau problème. Elle ne vient qu'empirer une situation déjà dramatique. Et elle le fait avec force.
L'Allemagne, première puissance économique européenne, a connu depuis 1991 une très forte augmentation du chômage. En janvier 1994, le chiffre officiel de demandeurs d'emploi a dépassé le cap des quatre millions. Si l'on ajoute à ce chiffre celui des chômeurs « en traitement social », on atteint les six millions. Il s'agit du niveau le plus élevé connu dans ce pays depuis la dépression des années 1930. Le taux de chômage officiel atteint 17 % dans l'ex-RDA, 8,8 % à l'ouest. Les perspectives pour l'avenir immédiat sont tout aussi catastrophiques : 450 000 chômeurs de plus annoncés par les « experts » d'ici la fm de l'année. Des licenciements massifs sont prévus dans les secteurs les plus compétitifs et puissants de l'économie allemande : 51 000 suppressions d'emplois chez Daimler-Benz, 30 000 dans la chimie, 16 000 dans l'aéronautique, 20 000 chez Volkswagen...
Les dépenses du capital allemand pour l'unification avaient momentanément constitué un marché qui a permis à l'Europe de retarder un tant soit peu son entrée dans la récession ouverte par rapport aux Etats-Unis ou la Grande Bretagne. La plongée de l'économie allemande en récession s'est accompagnée d'une explosion du chômage dans l'ensemble de l'Europe occidentale. Ainsi en un peu moins de trois ans les taux de chômage (officiels) sont passés de 9 à plus de 12 % en France, de 1,5 à plus de 9 % en Suède, de 6,5 à près de 10 % aux Pays-Bas et en Belgique, de 16 à 23,5 % en Espagne.
On estime qu'il faudrait en Europe une croissance d'au minimum 2,5 % par an pour simplement empêcher la poursuite de l'accroissement du chômage. On en est loin. Même les plus optimistes conjoncturistes ne prévoient pas de diminution du chômage en Europe avant l'année 1995, voire 1996. Pour la seule année 1994, l'OCDE prévoit un million de chômeurs en plus sur le vieux continent.
A cet accroissement quantitatif, il faut ajouter une rapide détérioration qualitative, marquée par le développement du chômage dit « de longue durée » et du chômage des jeunes ([2] [1506]), accompagnés de la diminution généralisée des allocations de chômage en temps et en valeur.
Le Japon, qui connaît sa plus forte récession depuis la 2e Guerre, voit aussi le chômage se développer. Même si le niveau absolu y reste encore bas en comparaison avec les autres puissances, le nombre de chômeurs « officiels » y est passé en trois ans de 1,3 millions à près de 2 millions. Ces chiffres ne donnent cependant qu'une idée très partielle de la réalité, le gouvernement japonais ayant suivi une politique qui consiste à préférer garder les chômeurs dans les usines, quitte à les payer moins et réduire le temps de travail, plutôt que de les mettre à la rue. Mais cette politique, qui accompagnait celle des « emplois à vie » dans les grands conglomérats industriels, cède le pas à la multiplication des licenciements et suppressions de postes. Toyota a clairement annoncé l'avenir en proclamant la fin de sa politique d'emploi garanti. ([3] [1507])
Face à cette situation, le gouvernement des Etats-Unis et, à sa suite, ceux du Canada et du Royaume-Uni, se vantent d'avoir réussi depuis deux ans à créer de nouveaux emplois et à arrêter la croissance du chômage. Il est vrai que dans les puissances « anglo-saxonnes » les statistiques officielles constatent une réduction du chômage. Mais cette affirmation cache deux réalités majeures : la faiblesse quantitative de cette « reprise » de l'emploi et la mauvaise qualité des emplois créés.
Sur le plan purement quantitatif, l'actuelle « reprise » de l'emploi paraît insignifiante par rapport à celle qui suivit la récession de 1979-1982.
Ainsi, dans le secteur manufacturier aux Etats-Unis, le nombre d'emplois n'a fait, au mieux, que se maintenir globalement depuis 3 ans, certains secteurs connaissant même des baisses importants. Les grandes entreprises industrielles continuent d'annoncer des licenciements massifs : dans le seul mois de novembre 1993, Boeing, ATT, NCR et Philip Morris ont annoncé 30 000 suppressions d'emplois pour les années à venir. Au cours de la reprise reagannienne des années 1980, l'emploi industriel avait augmenté de 9 %, alors qu'aujourd'hui cette augmentation ne dépasse pas 0,3 %. Dans le secteur tertiaire, l'administration Clinton se vante d'avoir augmenté de 3,8 % le nombre d'emplois, mais ce chiffre était de 8 % après 1982. Le budget présenté par Clinton pour 1995 est un des plus rigoureux depuis des années : « Il faut distinguer le luxe et la nécessité ». Il prévoit la suppression de 118 000 emplois dans les administrations publiques, une étape vers les 250 000 suppressions annoncées pour les cinq années à venir.
Pour ce qui est du Royaume-Uni et du Canada, la reprise de l'emploi s'y résume pour le moment à des mouvements marginaux, quasiment insignifiants.
Les faits sont simples : il y a aujourd'hui dans l'ensemble de ces trois pays 4 millions de chômeurs de plus qu'il y a 3 ans. ([4] [1508])
Quant à la qualité des emplois, la réalité des Etats-Unis illustre dans toute sa profondeur l'ampleur du désastre économique. Les travailleurs y sont de plus en plus plongés dans une situation d'instabilité et d'insécurité permanente. On est chômeur pendant six mois, on travaille pendant trois. La fameuse « mobilité » de l'emploi se traduit dans les faits par une sorte de répartition du chômage. On est chômeur moins longtemps qu'en Europe, mais plus souvent. D'après un récent sondage, parmi les personnes qui ont un travail aux Etats-Unis, 40 % ont déclaré craindre le perdre dans l'année qui vient. Les emplois créés le sont, pour l'essentiel, dans le secteur tertiaire. Une grande partie est constituée par des « services » tels que garer des voitures dans les grands restaurants, promener des chiens, garder des enfants, emballer des paquets aux caisses des supermarchés, etc. A coup de « petits boulots », on transforme les chômeurs en valets à (très) bon marché... 30 millions de personnes, soit 25 % de la population active américaine, sont en-dehors du circuit normal de l'emploi, c'est-à-dire vivent directement sous la pression du chômage.
Quelles que soient les formes que prend la maladie, aux Etats-Unis ou en Europe, dans les pays industrialisés ou dans les pays sous-développés, le chômage est devenu effectivement « le problème numéro un » de notre époque.
Quelle est la portée de cette réalité ?
La signification du développement chronique et massif du chômage
Pour la classe ouvrière la signification négative du chômage est une évidence qu'elle vit quotidiennement. Pour le prolétaire qui ne trouve pas de travail, c'est l'expulsion de ce qui constitue la base des relations sociales : le processus de production. C'est, pendant quelque temps, lorsqu'il a la chance de recevoir des allocations, l'impression de vivre en « parasite » de la société, puis c'est l'exclusion, la misère totale. Pour celui qui travaille c'est l'obligation de supporter toujours plus les «abus» de la classe dominante, au nom du chantage : « si tu n'est pas content, il y a des milliers de chômeurs qui sont prêts à prendre ta place ». Pour les prolétaires, le chômage, en tant que réalité et en tant que menace, constitue une des plus efficaces formes de répression, une des pires aggravations de tout ce qui fait de la machine capitaliste un instrument d'exploitation et d'oppression.
La signification négative du chômage peut apparaître cependant moins évidente pour la classe capitaliste. D'une part, celle-ci subit le classique aveuglement des classes exploiteuses, incapables de percevoir véritablement les méfaits sociaux de leur domination ; d'autre part, elle a besoin de croire et de faire croire que l'irrésistible montée du chômage depuis plus d'un quart de siècle constitue, non pas une maladie propre à la sénilité historique de son système, mais un phénomène presque « naturel », une sorte de fatalité due au progrès technique et aux nécessités d'adaptation du système. « Il faut s'y faire, mes amis, les emplois d'hier ne reviendront pas, » déclarait le secrétaire américain au Travail, Robert Reich, pendant la réunion du G7 sur le chômage.
En fait, la propagande sur « la nouvelle reprise » essaie de théoriser la situation qui se développe dans certains pays (Etats-Unis, Royaume-Uni, Canada), où la production a recommencé de croître, sans que pour autant le chômage se soit significativement réduit.
Mais il n'y a rien de « naturel » ni de « sain » dans le développement massif du chômage. Même du point de vue de la santé du capitalisme lui-même, le développement chronique et massif du chômage est une manifestation in équivoque de décrépitude.
Pour la classe capitaliste, le chômage constitue une réalité qui, dans un premier temps du moins, par le chantage qu'il permet de pratiquer, renforce son pouvoir sur les exploités et lui permet de mieux les saigner, ne fut-ce que par la pression qu'il exerce à la baisse sur les salaires. C'est une des raisons pour lesquelles la classe dominante a toujours besoin d'un volant de chômage permanent.
Mais ce n'est là qu'un aspect des choses. Du point de vue du capital, au-delà d'un minimum, le développement du chômage constitue un facteur négatif, destructeur de capital, il est la manifestation d'une maladie. Le capital ne se nourrit que de chair prolétarienne. La substance du profit, c'est du travail vivant. Ce ne sont ni les machines, ni les matières premières qui lui fournissent le profit, mais le « sur-travail » des exploités. Lorsque le capital licencie de la force de travail, il se prive de la source véritable de son gain. S'il le fait, ce n'est pas parce qu'il aime ça, mais parce que les conditions du marché et les impératifs de rentabilité le lui imposent.
L'enfoncement chronique dans le chômage massif traduit dans la réalité deux contradictions fondamentales, mises en évidence par Marx, qui condamnent historiquement le capitalisme :
- l'incapacité de ce dernier à créer, par ses propres mécanismes, un marché solvable suffisant pour écouler toute la production qu'il est en mesure de réaliser ;
- la nécessité de « remplacer des homme par des machines» pour assurer sa compétitivité, ce qui se traduit par une tendance permanente à la baisse du taux de profit.
L'actuelle explosion du chômage, qui vient s'ajouter à la masse de chômeurs qui s'est accumulée pendant plus de vingt-cinq ans de 1967 à aujourd'hui, n'a rien à voir avec une « salutaire restructuration » due au « progrès ». Elle représente au contraire la preuve pratique de l'impuissance définitive du système capitaliste.
Les « solutions » capitalistes
La réunion du G7 consacrée au problème du chômage a été un événement typique de la manipulation spectaculaire avec laquelle gouverne la classe dominante. Le message médiatique de l'opération se résumait à ceci : « Vous qui vous demandez si vous allez perdre votre emploi ou si vous allez en trouver un ; vous qui vous inquiétez de voir vos enfants devenir chômeurs, sachez que les gouvernements des 7 principales puissances économiques occidentales s'en préoccupent et s'en occupent. »
Evidemment, il n'en est sorti aucune décision concrète, à part demander au secrétariat de l'OCDE de mieux comptabiliser les chômeurs ou l'engagement à tenir une nouvelle réunion du G7 en juillet, à Naples, pour parler à nouveau sur le problème.
Le « plan mondial contre le chômage » annoncé par Clinton s'est en fait résumé à l'affirmation de la part des Etats-Unis de leur ferme volonté d'intensifier leur agressivité dans la guerre commerciale qui les oppose au reste du monde. En demandant au capital japonais de mieux ouvrir son marché intérieur, en exigeant des européens qu'ils abaissent leurs taux d'intérêts pour relancer leur production (et donc leurs importations en provenance des Etats-Unis), le discours de Clinton ne faisait que confirmer l'avertissement lancé par son représentant au commerce, M. Kantor : « Personne ne doit avoir de doutes sur notre engagement à aller de l'avant, à ouvrir des marchés et à développer le commerce, comme nous l'avons fait depuis que le président Clinton a pris en charge ses fonctions. »
Le spectacle du G7 a au moins mis en évidence que les différents capitaux nationaux sont incapables effectivement de trouver une solution mondiale au chômage, que la seule chose qu'ils savent et peuvent faire, c'est le chacun pour soi et tous contre tous, l'exacerbation de la guerre commerciale.
Les grands principes qui ont été affirmés ne sont autres que les exigences de la compétitivité pour chaque capital national. Et, de ce point de vue, il est certain que le capital américain pouvait offrir sa récente politique économique comme modèle. Celle-ci a en effet mis en pratique toutes les recettes pour tenter de rentabiliser une économie défaillante en l'armant contre la concurrence :
Licencier la main d'oeuvre « excédentaire »
«Si nous sommes honnêtes envers nous-mêmes, la restauration de la compétitivité industrielle est hostile à l'emploi. » C'est ainsi que s'exprimait lors du G7 un haut fonctionnaire de l'Union européenne, un des rédacteurs du Livre blanc présenté par Delors. Nous avons vu comment le capital américain a mis en pratique ce principe en développent la « mobilité de l'emploi. »
Augmenter la rentabilité et la productivité de la main d'oeuvre employée
Pour cela l'administration Clinton n'a fait qu'infliger avec vigueur la vieille méthode capitaliste : payer moins les exploités tout en les faisant travailler plus. Clinton l'a formulé en termes très concrets : « Une plus longue semaine de travail qu'il y a 20 ans, pour un salaire équivalent. » Et c'est la réalité : le temps de travail hebdomadaire dans les industries manufacturières aux Etats-Unis est aujourd'hui effectivement le plus élevé depuis 20 ans. Quant aux salaires, Clinton avait promis pendant sa campagne électorale de revaloriser le salaire minimum, et même de l'indexer sur l'inflation. Il n'en a rien été. Et, comme ce minimum est quasiment gelé depuis le début des années 1980, cela fait plus de dix ans que le salaire minimum réel ne cesse de baisser aux Etats-Unis. Pour ce qui est de la dite « protection sociale », c'est-à-dire cette partie du salaire que le capital verse sous forme de certains services et allocations publiques, l'administration démocrate présente son fameux plan pour établir un système de santé national comme un progrès. En réalité, il ne s'agit pas d'une dépense supplémentaire du capital américain en faveur des exploités, mais au contraire, d'une tentative pour rationaliser une réalité anarchique et absurde qui, en fin de compte, aboutit à ce que les frais de santé par travailleur soient, dans ce pays, parmi les plus élevés du monde.
Intensifier l'exploitation de la force de travail par la modernisation de l'appareil de production
Depuis deux ans les investissements pour l'équipement des entreprises a fortement augmenté aux Etats-Unis (+15% en 1993, un taux analogue est prévu pour 1994). Ces investissements, pour importants qu'ils soient dans certains secteurs, ne s'accompagnent pas pour autant d'une augmentation significative de l'emploi. Ainsi, par exemple, ATT, qui se prépare à investir d'énormes sommes pour la mise en place des « autoroutes de la communication », projet de grands travaux annoncés pour la décennie, vient en même temps d'annoncer 14 000 licenciements.
Les méthodes américaines ne sont en fait que les vieilles recettes de guerre économique du capital contre les concurrents et contre les exploités. Les autres capitaux nationaux n'en ont pas de différentes sur le fond. Les gouvernements de la vieille Europe, qui se vantent tant d'avoir un système exemplaire de protection sociale, mènent depuis des années un travail systématique de réduction des « dépenses sociales ». « Certaines mesures, telles que le volet social (annexé au traité de Maastricht) sont à ranger au musée auquel elles appartiennent », déclarait récemment Kenneth Clarke, Chancelier de l'échiquier du Royaume-Uni. C'est le même discours et la même pratique qui ont été développés par tous les gouvernements, même si ce n'est pas partout présenté de façon aussi provocante.
Dans le meilleur des cas, ces politiques peuvent permettre de reporter les effets de la crise sur des capitaux concurrents ([5] [1509]). En aucun cas, elles ne fournissent une solution générale.
L'accroissement de la rentabilité et de la productivité de la force de travail peut favoriser, dans un premier temps, le capital d'un pays aux dépens des autres, mais, du point de vue global, avec la généralisation de cet accroissement de productivité, cela ne fait que reposer de façon encore plus aigus le problème de l'insuffisance des marchés pour absorber la production réalisable. Moins de travailleurs employés avec des salaires moindres c'est autant de débouchés en moins. Plus de productivité c'est autant de marchés supplémentaires à trouver.
Chaque capital national ne peut combattre le problème à son échelle spécifique qu'en l'aggravant à l'échelle générale.
Enfin, last but not least, la reprise des investissements aux Etats-Unis a été financée, une fois de plus, par le crédit. La seule dette publique nette est passée en quatre ans de 30% à 39% du PIB. Un mouvement analogue s'est développé d'ailleurs dans les autres pays pour faire face à la récession. Cela ne fait que venir aggraver la situation financière mondiale, fragile et explosive, rongée par deux décennies de crédits et de spéculations en tous genres.
Pour encourager le recours au crédit, le gouvernement américain à imposé, depuis trois ans, des taux d'intérêt à court terme extrêmement bas. L'augmentation de ces taux est tout aussi inévitable que dangereuse pour l'équilibre financier mondial. Le faible coût de l'argent à court terme a permis la constitution d'énormes capitaux spéculatifs. La bourse de Wall Street, en particulier, en a été inondée ([6] [1510]). Le relèvement du coût des crédits risque d'entraîner un véritable krach financier qui ruinerait rapidement les efforts réalisés pour tenter d'endiguer la montée du chômage.
Les « solutions » qu'offrent aujourd'hui les gouvernements pour affronter le problème du chômage, outre qu'elles constituent des attaques directes contre les conditions d'existence des exploités, ont cette particularité de reposer sur les sables mouvants de l'endettement à outrance et de la spéculation sans limites.
Quelles perspectives pour la lutte de classe ?
Même s'il venait à connaître un véritable effondrement économique, le capitalisme ne disparaîtra pas de lui-même pour autant. Sans l'action révolutionnaire du prolétariat, ce système continuera de pourrir sur pied entraînant l'humanité dans une barbarie sans fin.
Quel rôle joue et jouera le chômage dans le cours de la lutte de classe ?
La généralisation du chômage, pour la classe exploitée, c'est pratiquement pire que la présence d'un agent de la police dans chaque foyer, dans chaque lieu de travail. Par le chantage ignoble qu'il permet à la classe dominante sur les travailleurs, il rend plus difficile la lutte.
Cependant, à partir d'un certain degré, la révolte contre cette répression elle-même devient un puissant stimulant du combat de classe et de sa généralisation. A partir de quelle quantité, de quel pourcentage de chômeurs, cette transformation peut-elle se produire? La question est en elle-même sans réponse, car ce qui est en question ce n'est pas un rapport mécanique entre économie et lutte de classe, mais un processus global complexe où la conscience des prolétaires joue le premier rôle.
Nous savons cependant qu'il s'agit d'une situation totalement différente de celle de la grande dépression économique des années 1930.
Du point de vue économique la crise des années 1930 fut résolue par le développement de l'économie de guerre et les politiques keynésiennes (en Allemagne, à la veille de la guerre, le chômage avait presque totalement « disparu ») ; aujourd'hui la véritable efficacité de l'économie de guerre, ainsi que de toutes les politiques keynésiennes se trouve derrière nous. Celle-ci s'est usée jusqu'à conduire à la situation présente, laissant comme solde une bombe financière d'endettement.
Du point de vue politique, l'actuelle situation du prolétariat mondial n'a rien à voir avec ce qu'elle était dans les années 1930. Il y a soixante ans, la classe ouvrière subissait tout le poids des défaites sanglantes et dramatiques qu'elle avait essuyées pendant la vague révolutionnaire de 1917-23, en particulier en Allemagne et en Russie. Idéologiquement et physiquement vaincue, elle se laissait embrigader, atomisée derrière les drapeaux des bourgeoisies nationales, pour marcher vers une deuxième boucherie mondiale.
Les générations de prolétaires d'aujourd'hui n'ont pas subi de défaites importantes. A partir des luttes de 1968 - premières réponses à l'ouverture de la crise économique - elles ont, à travers des hauts et des bas, des avancées et des reculs dans leur combativité et leur conscience, ouvert et confirmé un nouveau cours historique.
Les gouvernements ont raison de trembler devant ce qu'ils appellent « les troubles sociaux » que peut produire le développement du chômage.
Ils ont su, et ils savent utiliser les aspects du chômage qui rendent plus difficile la lutte prolétarienne : son aspect répressif, diviseur, atomisant, le fait qu'il rejette toujours plus une fraction de la classe révolutionnaire, en particulier les jeunes, de plus en plus interdits d' « entrer dans la vie active », dans une marginalisation décomposée et destructrice.
Mais, le chômage, par la violence de l'attaque qu'il représente contre les conditions d'existence de la classe révolutionnaire, par le fait même qu'il prend une ampleur universelle, frappant sans distinction tous les secteurs, dans tous les pays, met en évidence que, pour les exploités, l'issue ne dépend pas d'une question de gestion, de réforme ou de restructuration du capitalisme, mais de la destruction du système lui-même.
L'explosion du chômage révèle dans toute son ampleur l'impasse capitaliste et la responsabilité historique de la classe ouvrière mondiale.
RV.
[1] [1511] En 1979, après la «reprise» qui suivit la récession de 1974-75 (dite du «premier choc pétrolier»), il y avait toujours 2 millions de chômeurs en plus qu'en 1973 aux Etats-Unis, 750 000 en Allemagne de l'Ouest. Entre 1973 et 1990, à la veille de l'actuelle récession, le nombre « officiel » de chômeurs dans la zone de l'OCDE (les 24 pays industrialisés d'Occident - y compris le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande) - avait augmenté de 20 millions, passant de 11 à 31 millions. Il ne s'agit là que des pays les plus riches. Dans le « tiers-monde » ou dans l'ancien « bloc socialiste», l'ampleur de la catastrophe est incomparablement plus grave. Après la récession de 1980-82, nombreux sont les pays sous-développés qui ne se sont plus relevés et qui ont entamé un enfoncement sans fin dans la misère et le sous-emploi.
[2] [1512] Début 1994, 50 % des chômeurs en Europe le sont depuis plus d'un an. Les « experts » prévoient que fin 1994 un quart des chômeurs y auront moins de 20 ans. {International Herald Tribune, 14 mars 1994).
[3] [1513] Le Japon doit faire face à une très forte réduction de ses exportations, c'est-à-dire du principal moteur de sa croissance. Cette réalité se fait sentir dans tous les secteurs de son économie. Mais elle est particulièrement significative dans celui des produits électroniques de consommation, domaine où le Japon est très performant. Ainsi les exportations de ce secteur ont-elles chuté de près de 25 % en 1993 et ne représentent aujourd'hui que 50 % de ce qu'elles étaient en 1985. Pour la première fois le Japon a dû, en 1993, importer plus de postes de télévisions couleurs qu'il en a exportés.
Le paradoxe est que ces importations proviennent pour l'essentiel des entreprises japonaises implantées dans le Sud-est asiatique afin de profiter de coûts de main d'oeuvre inférieurs.
Le « boom » économique exceptionnel de certaines économies asiatiques trouve en réalité sa source dans la crise mondiale qui contraint les capitaux des principales puissances, soumis à la plus impitoyable guerre commerciale, à « délocaliser » certaines de leurs productions dans des pays à main d'œuvre bon-marché (...et disciplinée) afin de baisser leurs coûts.
[4] [1514] 2,3 millions de plus aux Etats-Unis, 1,2 million au Royaume-Uni, 600 000 au Canada.
[5] [1515] Ainsi, par exemple, une partie de la « reprise » américaine récente s'est faite directement aux dépens du capital japonais auquel elle a réussi à enlever certaines parts de marché.
[6] [1516] Il en est ainsi des valeurs boursières dites « dérivatives »dont la caractéristique est de reposer non plus sur des critères économiques, liés à la santé desentreprises qu'elles sont supposées représenter, mais sur des équation mathématiques fondées sur des mécanismes purement spéculatifs. (Signe des temps, une grande partie des investissements informatiques des dernières années aux Etats-Unis ont été destinés à moderniser et élargir les capacités des entreprises qui spéculent avec ces systèmes ultramodernes.) Ces valeurs représentent une masse colossale d'argent: le portefeuille de Salomon Brothers en contient pour 600 milliards de dollars, celui de la Chemical Bank 2 500 milliards. A eux deux seuls cela fait 3 100 milliards de dollars, soit l'équivalent du PIB annuel de l'Allemagne, plus la France et le Danemark !
Récent et en cours:
- Crise économique [28]
Questions théoriques:
- Décadence [32]
Comment est organisée la bourgeoisie : Le mensonge de l'Etat « démocratique », II.
- 4074 reads
L'exemple des rouages secrets de l'Etat italien
On pourrait croire, à écouter la propagande de la classe dominante, que celle-ci n'a qu'un souci : le bien de l'humanité. Le discours idéologique sur la « défense des libertés et de la démocratie», sur les «droits de l'homme » ou 1' « aide humanitaire » est en complète contradiction avec la réalité. Le battage qui accompagne ce discours est à la mesure du mensonge qu'il véhicule. Comme le disait déjà Goebbels, le maître de la propagande nazie : «r Plus le mensonge est gros, plus il a de chance d'être cru ». Cette « règle », l'ensemble de la bourgeoisie mondiale l'applique avec assiduité. L'Etat du capitalisme décadent a développé tout un appareil monstrueux de propagande, réécrivant l'histoire, couvrant d'un vacarme assourdissant les événements, pour masquer la nature barbare et criminelle du capitalisme, qui n'est plus porteur d'un quelconque progrès pour l'humanité. Cette propagande pèse lourdement sur la conscience de la classe ouvrière. Elle est d'ailleurs conçue pour cela.
Les deux articles qui suivent, «L'exemple des rouages secrets de l'Etat italien » et « La bourgeoisie mexicaine dans l'histoire de l'impérialisme», montrent tous deux comment, derrière les discours propagandistes de circonstance, la bourgeoisie du capitalisme décadent est une classe de gangsters, dont les multiples fractions sont prêtes à toutes les manoeuvres pour la défense de leurs intérêts dans l'affrontement qui les oppose dans l'arène capitaliste et impérialiste et dans le front qui les unit face au danger prolétarien.
Pour bien combattre l'ennemi, il faut le connaître. Ceci est particulièrement vrai pour le prolétariat dont la conscience, la clarté dont il doit faire preuve dans sa lutte, est l'arme principale. Sa capacité à mettre à nu les mensonges de la classe dominante, à voir derrière le paravent de la propagande, notamment « démocratique », la réalité de la barbarie du capitalisme et de la classe qui l'incarne, est déterminante pour sa capacité future à jouer son rôle historique : mettre fin par la révolution communiste à la période la plus sombre que l'humanité ait jamais connue.
Le mensonge de l'Etat « démocratique », II. L'exemple des rouages secrets de l'Etat italien
La première partie de cet article ([1] [1517]) a abordé le cadre général qui permet de comprendre le développement totalitaire du fonctionnement de l'Etat dans le capitalisme décadent, y compris dans ses variantes démocratiques. Cette deuxième partie traite d'une illustration de ce fonctionnement, au travers du cas concret de l'Italie.
Depuis de nombreuses années, les scandales à répétition qui ont émaillé la vie politique de la classe dominante en Italie, notamment les affaires dites de la Loge P2 ([2] [1518]), du réseau Gladio et des liens avec la Mafia, ont permis de soulever un coin du voile vertueux dont se pare l'Etat démocratique et d'avoir un aperçu de la réalité sordide et criminelle de son fonctionnement. La piste sanglante des multiples attentats terroristes et mafieux, des « suicides » sur fond de faillites financières trouve son origine au coeur même de l'Etat, dans ses manoeuvres tortueuses pour assurer son hégémonie. Une « affaire » chasse l'autre, et la classe dominante sait parfaitement utiliser la nouveauté apparente de chaque scandale pour faire oublier les précédents. Aujourd'hui, les autres grandes « démocraties » occidentales montrent du doigt la bourgeoisie italienne coupable de telles oeuvres, pour mieux faire croire qu'il s'agit là d'une situation particulière et spécifique. Machiavel et la Mafia, tout comme le Chianti et le Parmesan ne sont-ils pas des produits typiquement italiens? Pourtant, toute l'histoire scandaleuse de la bourgeoisie italienne, et les ramifications qu'elle met à jour, montre exactement le contraire. Ce qui est spécifique à l'Italie, c'est que les apparences démocratiques y sont plus fragiles que dans les autres démocraties historiques. Les scandales en Italie, lorsqu'on y regarde d'un peu plus près, mettent pourtant en évidence que ce qu'ils dévoilent n'est pas propre à l’Italie, mais est au contraire l'expression de la tendance générale du capitalisme décadent au totalitarisme étatique et des antagonismes impérialistes mondiaux qui ont marqué le 20e siècle.
L'histoire de l’Italie depuis le début du siècle le démontre amplement.
LA MAFIA : au coeur de l'Etat et de la stratégie impérialiste
Depuis le milieu des années 1920, Mussolini a déclaré la guerre à la Mafia. «Je l'assécherai comme j'ai asséché les marais Pontin » déclare-t-il. Les troupes du préfet Mori sont chargées de cette besogne en Sicile. Mais avec les années qui passent Cosa Nostra résiste et, lorsque se profile la perspective de la 2e guerre mondiale, la Mafia, implantée de manière solide dans le sud de l'Italie et aux Etats-Unis, devient un enjeu stratégique important pour les futurs belligérants. En 1937, Mussolini, intéressé à renforcer son influence parmi les italo-américains afin de tenter d'installer ainsi une « cinquième colonne » en territoire ennemi, accueille à bras ouvert Vito Genovese, l'adjoint de Lucky Luciano, le boss de la Mafia américaine, en délicatesse avec la justice des Etats-Unis. Genovese devient un protégé du régime fasciste, invité plusieurs fois à la table du Duce à partager le spaghetti de l'amitié en compagnie, entre autres, de célébrités telles que le Comte Ciano, gendre de Mussolini et ministre des Affaires étrangères et d’Hermann Goering. Il recevra en 1943 la plus haute distinction du régime fasciste, le Duce en personne lui épinglera l'Ordre de Commandatore sur la poitrine. Genovese rend de menus service au régime fasciste, éliminant des mafieux qui ne comprennent pas les nouvelles règles du jeu, organisant l'assassinat, à New-York, d'un journaliste italo-américain, Carlo Tresca, responsable d'un journal antifasciste influent, Il Martello. Mais surtout, l'adjoint de Lucky Luciano, va mettre à profit sa situation privilégiée pour monter une structure de trafic en tous genres et développer son réseau d'influence : le préfet de Naples, Albini, devient son homme lige, et Genovese réussit à le faire nommer sous-secrétaire d'Etat à l'intérieur en 1943. Ciano, qui s'adonne à la drogue, tombe aussi sous la coupe de Genovese dont il dépend pour son approvisionnement.
Pendant ce temps, aux Etats-Unis, avec l'entrée en guerre en 1941, l'importance stratégique de la Mafia est reconnue. Sur le plan intérieur, il s'agit d'éviter la création d'un front intérieur au sein de l'immigration d'origine italienne, et la Mafia qui contrôle, entre autre, les syndicats des dockers et des camionneurs, secteurs vitaux pour l'acheminement de l'approvisionnement des armées, devient dans ces conditions un interlocuteur incontournable de l'Etat américain. Pour renforcer sa crédibilité, la Mafia organise en février 1942, le sabotage, dans le port de New-York, du paquebot Normandie en cours de réaménagement pour le transport de troupes qui devient la proie des flammes. Peu après, une grève générale des dockers fomentée par le syndicat mafieux paralyse l'activité du port. Finalement, la Marine américaine demande à Washington l'autorisation de négocier avec la Mafia et son chef Luciano, alors en prison ; autorisation que Roosevelt s'empressera d'accorder. Bien que ce fait soit toujours nié par l'Etat américain et les détails de l'Opération Underworld (puisque tel fut son nom) toujours classifiés secrets, bien que Lucky Luciano ait toujours proclamé jusqu'à sa mort que tout cela n'était que «foutaises et galéjades à l'usage des cons » ([3] [1519]), après des décennies de silence, le fait que l'Etat américain ait négocié une alliance avec la Mafia est aujourd'hui généralement reconnu. Conformément à la promesse qui sera faite, Luciano sera libéré au lendemain de la guerre et « exilé » en Italie. Pour justifier cette grâce, Thomas Dewey, celui qui, comme procureur, avait organisé l'arrestation et le jugement de Luciano dix ans plus tôt, et qui, grâce à cette publicité, était entre temps devenu le gouverneur de l'Etat de New-York, déclara dans une interview au New York Post : « Une enquête exhaustive a établi que l'aide apportée par Luciano à la Marine pendant la guerre a été considérable et précieuse. »
Des services, la Mafia en a effectivement rendus de très importants à l'Etat américain durant la guerre. Après avoir placé ses billes dans les deux camps, quand à la mi-1942 le rapport de forces bascule plus nettement en faveur des Alliés, la Mafia met ses forces à la disposition des Etats-Unis. Sur le plan intérieur, elle va engager ses syndicats dans l'effort de guerre, mais c'est surtout en Italie qu'elle va s'illustrer. Les troupes américaines durant le débarquement de 1943 en Sicile vont bénéficier du soutien efficace de la Mafia sur place. Débarqués le 10 juillet, les soldats américains font une véritable promenade de santé, rencontrent très peu d'opposition et sept jours plus tard seulement Palerme est sous leur contrôle. Pendant ce temps, la 8e armée britannique qui, elle, n'a probablement pas bénéficié du même soutien mafieux, dut se battre pendant cinq semaines et subir de nombreuses pertes pour atteindre partiellement ses objectifs. Cette alliance avec la Mafia aurait, selon certains historiens, sauvé la vie à 50 000 soldats américains. Le General Patton appellera, à partir de ce moment, le parrain sicilien Don Calogero Vizzini, l'organisateur de cette déroute italo-allemande, le « General Mafia ». En récompense celui-ci, qui avait passé des années en prison, sera élu maire de sa ville, Villalba, sous l'oeil bienveillant des Alliés. Une semaine après la chute de Palerme, le 25 juillet, Mussolini est éliminé par le Grand conseil fasciste et un mois après l'Italie capitule. Dans ce processus qui suit le débarquement en Sicile, le rôle du réseau d'influence constitué par Genovese sera très important. Ainsi, Ciano participe aux côtés de Badoglio à l'élimination de Mussolini. La structure de marché noir mise en place dans la région de Naples travaillera en complète harmonie avec les forces Alliées pour un profit mutuel. Vito Genovese deviendra l'homme de confiance de Charlie Poletti, gouverneur militaire américain de toute l'Italie occupée. Par la suite Genovese, de retour aux Etats-Unis, deviendra là-bas le principal boss mafieux de l'après-guerre.
L'alliance qui s'est nouée durant la guerre entre l'Etat américain et la Mafia ne va pourtant pas s'achever avec celle-ci, l’Honorata Societa est un partenaire qui s'est révélé trop efficace et trop utile pour risquer qu'elle serve d'autres intérêts, alors qu'avec la fin de la 2e guerre mondiale, l'Etat américain voit se profiler l'émergence d'un nouveau rival impérialiste : l'URSS.
LE RESEAU « GLADIO » : une structure de manipulation pour les intérêts stratégiques du bloc
En octobre 1990, le président du conseil Giulio Andreotti révèle l'existence d'une organisation clandestine, parallèle aux services secrets officiels, financée par la CIA, intégrée à l'OTAN et chargée de faire face à une éventuelle invasion russe et, par extension, à lutter contre l'influence communiste : le réseau Gladio. Ce faisant, il provoque un beau tollé. Pas seulement en Italie, mais internationalement dans la mesure où une telle structure a été constituée dans tous les pays du bloc occidental sous le contrôle des Etats-Unis.
«Officiellement», le réseau Gladio a été constitué en 1956, mais son origine réelle remonte à la fin de la guerre. Avant même que la deuxième guerre mondiale ne soit achevée, alors que le destin des forces de l'Axe est déjà scellé, le nouvel antagonisme qui se développe entre les Etats-Unis et l'URSS polarise l'activité des états-majors et des services secrets. Les crimes de guerre et les responsabilités sont oubliés au nom de la guerre qui commence à se mener contre l'influence du nouvel adversaire russe. Dans toute l'Europe les services Alliés, et notamment américains, opèrent un recrutement tous azimuts d'anciens fascistes et nazis, d'hommes de sac et de corde, d'aventuriers de tous poils, au nom de la sacro-sainte lutte contre le « communisme ». Les « vaincus » trouvent là une occasion de se refaire une virginité à bon compte.
En Italie, la situation est particulièrement délicate pour les intérêts occidentaux. Il y existe le Parti stalinien le plus fort d'Europe occidentale qui sort de la guerre auréolé de gloire pour son rôle déterminant dans la résistance face au fascisme. Alors que se préparent les élections pour 1948, conformément à la nouvelle constitution mise en place à la Libération, l'inquiétude grandit parmi les stratèges occidentaux, car nul ne peut être certain du résultat, et une victoire du PCI serait une catastrophe. En effet, alors que la Grèce est plongée dans la guerre civile et que le PC menace d'y prendre le pouvoir par la force, que la Yougoslavie est encore dans l'orbite russe, la chute de l'Italie sous l'influence de 1’URSS signifierait un désastre stratégique de première grandeur pour les intérêts occidentaux, avec le risque de perdre le contrôle de la Méditerranée et donc l'accès au Moyen-Orient.
Pour faire face à cette menace, les divisions de la guerre sont vite oubliées par la bourgeoisie italienne. En mars 1946, le Haut Commissariat pour les sanctions contre le fascisme, chargé d'épurer l'Etat des éléments qui s'étaient trop impliqués dans le soutien à Mussolini, est dissous. Les partisans sont démobilisés. Les autorités mises en place par les Comités de libération, notamment à la tête de la police, sont remplacées par des responsables naguère nommés par Mussolini. De 1944 à 1948, on estime que 90 % du personnel de l'appareil d'Etat du régime fasciste a réintégré ses fonctions.
La campagne électorale censée sanctifier la nouvelle république démocratique bat son plein. L'establishment financier et industriel, l'armée, la police, qui avaient été les principaux soutiens du régime fasciste, se mobilisent et, face au danger « communiste », embouchent la trompette de la défense de la démocratie occidentale, leur ancien ennemi. Le Vatican, fraction essentielle de la bourgeoisie italienne qui, après avoir soutenu le régime de Mussolini, avait joué double-jeu durant la guerre, comme à son habitude, se lance aussi dans la campagne électorale et le Pape devant 300 000 fidèles réunis sur la place Saint-Pierre déclare que « celui qui offrirait son aide à un parti qui ne reconnaît pas Dieu serait un traître et un déserteur ».
La Mafia dans le sud de l'Italie va s'employer activement dans la campagne électorale, finançant la Démocratie-chrétienne, donnant des consignes de vote à sa clientèle.
Tout cela sous l'oeil bienveillant et avec le soutien actif des Etats-Unis. En effet, l'Etat américain ne ménage pas ses efforts. Aux Etats-Unis, une campagne, « lettere à Italia » est mise en place pour que les italo-américains envoient à leur famille en Italie des lettres recommandant le « bon » vote. La radio Voice of America qui, durant la guerre, vilipendait les méfaits du régime fasciste, dénonce dorénavant à longueur de journée les dangers du «communisme». Deux semaines avant les élections, le Plan Marshall est approuvé, mais les Etats-Unis n'ont pas attendu cette échéance pour inonder le gouvernement italien de dollars. Quelques semaines avant, une aide de 227 millions de dollars avait été votée par le Congrès. Les partis et les organisations hostiles au PCI et au Front démocratique qu'il fédère reçoivent une aide sonnante et trébuchante : la presse américaine évalue alors les sommes dépensées dans ces circonstances à 20 millions de dollars.
Mais pour le cas où tout cela ne suffirait pas à faire échec au Front démocratique du PCI, les Etats-Unis vont mettre en place une stratégie secrète destinée à faire face à un éventuel gouvernement dominé par les staliniens. Les diverses cliques de la bourgeoisie italienne opposés au PCI -responsables de l'appareil d'Etat, armée, police, grands industriels et financiers, Vatican, parrains de la Mafia - sont contactés par les services secrets américains qui coordonnent leur action. Un réseau clandestin de résistance à une éventuelle mainmise «communiste» est structuré. Il recrute parmi les «anciens» fascistes, l'armée, la police, le milieu mafieux et, de manière générale, parmi tous les « anti-communistes » convaincus. La résurgence des groupes fascistes est encouragée au nom de la défense des « libertés ». Des armes sont distribuées clandestinement. L'éventualité d'un coup d'Etat militaire est envisagée et ce n'est pas un hasard si, quelques jours avant l'élection, 20 000 carabiniers sont engagés dans des manoeuvres avec du matériel blindé et si le ministre de l'Intérieur, Mario Scelba, déclare avoir organisé une structure capable de faire face à une insurrection armée. En cas de victoire du PCI la sécession de la Sicile est prévue. Les Etats-Unis peuvent compter pour cela sur la Cosa Nostra qui soutient dans cette intention la lutte « indépendantiste » de Salvatore Giuliano, tandis que l'état-major américain prévoit sérieusement une occupation de la Sicile et de la Sardaigne par ses forces armées.
Finalement, le 16 avril 1948, avec 48 % des voix, la Démocratie-chrétienne l'emporte avec 40 sièges de majorité. Le PCI est renvoyé dans l'opposition. Les intérêts occidentaux sont saufs. Mais les premières élections de la nouvelle république démocratique italienne issue de la Libération n'ont rien eu de démocratique. Elles sont le produit d'une gigantesque manipulation. Et de toute façon, si le résultat en avait été défavorable, les forces « démocratiques » de l'Occident étaient prêtes à organiser un coup d'Etat, à semer le désordre, à susciter une guerre civile pour restaurer leur contrôle de l'Italie. C'est sous ces auspices et dans ces conditions rien moins que « démocratiques » qu'est née la république italienne. Jusqu'à aujourd'hui elle en porte les stigmates.
Pour parvenir à ce résultat électoral, loin du cadre officiel du fonctionnement « démocratique », une structure clandestine, regroupant les secteurs de la bourgeoisie les plus favorables aux intérêts occidentaux et formant ainsi la clique dominante au sein de l'Etat italien, a été mise en place sous la houlette des Etats-Unis. Ce qui sera plus tard dénommé le réseau Gladio regroupe ainsi secrètement un cerveau politique : le sommet ; un corps économique : les différents clans intéressés qui en tirent profit tout en le finançant ; des bras armés : la piétaille aux ordres, recrutée par les services secrets de toutes sortes, et chargée des basses besognes. Cette structure a montré son efficacité et elle sera maintenue. En effet, avec le développement des antagonismes impérialistes de la période dite de la « guerre froide », avec la présence d'un PC très puissant en Italie, ce qui était valable du point de vue des intérêts stratégique occidentaux au lendemain de la guerre reste d'actualité.
Cependant, manipuler les résultats électoraux, au travers d'un contrôle serré des partis politiques, des principaux organes de l'Etat, des médias et du coeur de l'économie, ne suffisait pas. Le danger d'un retournement de situation au profit du PCI subsistait. Depuis la fin de la guerre, pour faire face à la « subversion communiste », l'organisation Gladio (ou son équivalent sous quelque nom que ce soit) a préparé l'éventualité d'un coup d'Etat militaire pour le compte du bloc occidental.
- En 1967, L'Expresso dénonce les préparatifs putschistes organisés trois ans plus tôt par les carabiniers et les services secrets. Par la suite, dans leur enquête, les juges vont se heurter au secret d'Etat, à la dissimulation des preuves par les services secrets, à l'obstruction des ministères et d'hommes politiques influents et à une série de décès mystérieux parmi les protagonistes de l'affaire.
- Dans la nuit du 7-8 décembre 1970, un commando d'extrême-droite occupe le ministère de l’Intérieur à Rome. Ce complot avorte et les quelques centaines d'hommes en armes qui se promènent dans la nuit romaine rentreront chez eux à l'aube. Aventurisme de quelques éléments fascistes ? A voir ! L'instruction, qui va durer sept ans, montrera que ce complot a été organisé par le prince Valerio Borghese, qu'il bénéficiait de complicités militaires au plus haut niveau, de complicités politiques au sein de la Démocratie-chrétienne et du Parti social-démocrate, et que l'attaché militaire de l'ambassade américaine était en liaison étroite avec les initiateurs du coup. Là encore, l'enquête sera peu à peu étouffée, même si l'Amiral Miceli, responsable des services secrets, est destitué en 1974 à la suite d'un mandat d'arrêt qui l'inculpe « d'avoir promu, constitué et organisé en concours avec d'autres personnes une association secrète de militaires et de civils destinée à provoquer une insurrection armée. »
- En 1973, un autre complot visant à fomenter un coup d'Etat est découvert par la police italienne, organisé par l'ancien ambassadeur d'Italie à Rangoon, Edgardo Sogno. Encore une fois, l'instruction est empêchée de mener son enquête au nom du « secret d'Etat ».
Cependant, à bien les considérer, ces complots, plus que de réelles tentatives de coup d'Etat qui auraient échoué, semblent au contraire correspondre à des préparatifs « au cas où » et à des manoeuvres pour entretenir une atmosphère politique. En effet, en 1969, Italie est secouée par une vague de grèves, 1'« automne chaud », qui marque le réveil de la lutte de classe et vient aviver, dans la tête des stratèges de l'OTAN, la peur d'une déstabilisation de la situation sociale en Italie. Au lendemain de 1969, une stratégie va être élaborée, destinée à rétablir l'ordre et à renforcer l'Etat : la « stratégie de la tension. »
LA « STRATEGIE DE LA TENSION » : la provocation comme méthode de gouvernement
En 1974, Roberto Caballero, un fonctionnaire du syndicat fasciste Cisnal, déclare dans une interview à L'Europeo : « Quand des troubles apparaissent dans le pays (désordres, tensions syndicales, violences), l'Organisation se met en action pour créer les conditions d'un rétablissement de l'ordre si les troubles ne se produisent pas, ils sont créés par l'organisation elle-même, par le truchement de tous ces groupes d'extrême-droite (quand il ne s'agit pas de groupes d'extrême-gauche) aujourd'hui impliqués dans les procès sur la subversion noire, » et il précise aussi que le groupe dirigeant de cette organisation « qui comprend des représentants des services secrets italiens et américains ainsi que de puissantes sociétés multinationales, a choisi une stratégie de désordre et de tensions qui justifie le rétablissement de l'ordre. »
En 1969, on dénombre 145 attentats commis. Le point culminant, cette année-là, sera atteint le 12 décembre avec des explosions meurtrières à Rome et Milan faisant 16 morts et une centaine de blessés. L'enquête sur ces attentats va s'égarer durant trois ans sur la piste anarchiste avant qu'elle ne s'oriente, malgré tous les obstacles mis sur son chemin, sur la piste noire, celle de l'extrême-droite et des services secrets. L'année 1974 est marquée par deux explosions meurtrières à Brescia (7 morts, 90 blessés) et dans un train, Italicus (12 morts, 48 blessés). Encore une fois, c'est la piste noire qui est mise en évidence. Cependant, à partir de cette année 1974, le terrorisme « noir » de l'extrême-droite laisse la place au terrorisme des Brigades rouges qui atteint son sommet avec l'enlèvement et l'assassinat du président du Conseil, Aldo Moro. Mais en 1980 l'extrême-droite refait son apparition violente avec le sanglant attentat de la gare de Bologne (90 morts) qui lui est finalement attribué. Une fois de plus, les services secrets sont mouillés par l'instruction et de nouveau des généraux responsables de ces services passeront en procès.
La « stratégie de la tension » a été mise en oeuvre avec cynisme et efficacité pour renforcer un climat de terreur et justifier ainsi le renforcement des moyens de répression et de contrôle de la société par l'Etat. Le lien entre le terrorisme d'extrême-droite et les services secrets a été clairement mis en évidence par les enquêtes qui ont été menées, même si celles-ci ont été globalement étouffées. Par contre, en ce qui concerne le terrorisme d'extrême-gauche, mené par des groupes comme les Brigades rouges et Prima Linea, ces liens n'ont pas été démontrés de manière claire par les enquêtes policières. Pourtant, là aussi, avec le recul du temps, les témoignages et les éléments s'accumulent qui tendent à démontrer que le terrorisme « rouge » a été encouragé, manipulé, utilisé, sinon parfois directement impulsé par l'Etat et ses services parallèles.
Il faut déjà constater que les attentats des Brigades rouges ont finalement le même résultat que celui des néo-fascistes : créer un climat d'insécurité propice aux campagnes idéologiques de l'Etat visant à justifier le renforcement de ses forces répressives. Dans la deuxième moitié des années 1970, ils tombent à point pour faire oublier ce que les enquêtes commençaient à mettre en évidence : à savoir que les attentats de 1969 à 1974 n'étaient pas l'oeuvre d'anarchistes, mais d'éléments fascistes utilisés par les services secrets. Justifiés par une phraséologie révolutionnaire, ces attentats « rouges » sont le meilleur moyen pour semer la confusion dans le processus de clarification de la conscience en train de s'opérer au sein de la classe ouvrière. Ils permettent de faire peser lourdement le poids de la répression sur les éléments les plus avancés du prolétariat et sur le milieu révolutionnaire, assimilés au terrorisme. Bref, du point de vue de l'Etat, il est bien plus utile que le terrorisme « noir ». C'est d'ailleurs pour cela que, dans un premier temps, les médias de la bourgeoisie au service de l'Etat attribuent les premiers attentats réalisés par l'extrême-droite à des anarchistes, tel était d'ailleurs le but de la manoeuvre : une provocation.
« Il peut arriver que face à la subversion communiste les gouvernements de pays Alliés fassent preuve de passivité ou d'indécision. L'espionnage militaire des Etats-Unis doit avoir le moyen de lancer des opérations spéciales capables de convaincre les gouvernements des pays Alliés et l'opinion publique de la réalité du danger d'insurrection. L'espionnage militaire des Etats-Unis devrait chercher à infiltrer les foyers d'insurrection au moyen d'agents en mission spéciale chargés déformer certains groupes d'action au sein des mouvements les plus radicaux. ». Cette citation est extraite du US Intelligence Field Manual, manuel de campagne des espions américains, dont les responsables de Washington prétendent qu'il est un faux. Mais il a été authentifié par le Colonel Oswald Le Winter ([4] [1520]), ancien agent de la CIA et officier de liaison en Europe, dans un documentaire télévisé consacré à Gladio. Il lui donne aussi un contenu concret en déclarant dans cet interview: «Les Brigades rouges avaient été infiltrées de même que Baader-Meinhof et Action Directe. Plusieurs de ces organisations terroristes de gauche étaient infiltrées et sous contrôle », et précise que « des rapports et des documents émis par notre bureau de Rome attestaient que les Brigades rouges avaient été infiltrées et que leur noyau dirigeant recevait ses ordres de Santovito.». Le général Santovito était à l'époque le chef des services secrets italiens (SISMI). Source plus fiable, Federico Umberto d'Amato, ancien chef de la police politique et ministre de l'Intérieur de 1972 à 1974, raconte avec fierté : « Les Brigades rouges ont été infiltrées. Cela a été difficile parce qu'elles étaient dotées d'une structure très fermée et très efficace. Toutefois, elles ont été infiltrées de façon remarquable, avec des résultats optimaux. »
Plus que tout autre attentat commis par les Brigades rouges, l'enlèvement d'Aldo Moro, l'assassinat de son escorte, sa séquestration et son exécution finale en 1978 vont faire soupçonner une manoeuvre d'un clan dans l'Etat et des services secrets. On s'étonne que les Brigades rouges, composées de jeunes éléments révoltés, très motivés et convaincus, mais sans grande expérience de la guerre clandestine, aient pu mener à bien une opération d'une telle envergure. L'enquête met en lumière plusieurs faits troublants : présence d'un membre des services secrets sur le lieu de l'enlèvement, les balles qui ont été tirées ont subi un traitement spécial utilisé dans les services spéciaux, etc. Alors que le scandale suscité par la découverte de la main de l'Etat dans les attentats de 1969 à 1974, faussement attribués aux anarchistes, commençait à être oublié, le doute renaît dans l'opinion publique italienne sur une manipulation étatique derrière les attentats des Brigades rouges. En effet, Aldo Moro est enlevé à la veille de la signature du « Compromis historique » qui devait sceller une alliance de gouvernement entre la Démocratie-chrétienne et le PCI, et dont Moro était le maître d'oeuvre. Sa veuve déclare : « Je savais par mon mari, ou par une autre personne, qu'aux environs de 1975 on l'avait averti que ses tentatives d'amener toutes les forces politiques à gouverner ensemble pour le bien du pays déplaisaient à certains groupes et à certaines personnes. On lui avait dit que s'il persistait à vouloir mener à bien son projet politique, il risquait de payer son obstination très chère. » L'option du «Compromis historique » aurait eu pour résultat d'ouvrir les portes du gouvernement au PCI. Moro qui était au courant, en tant que président du Conseil, de l'existence de Gladio, pensait probablement que le travail d'infiltration mené depuis des années au sein de ce parti, afin de le soustraire à l'influence de l'Est, et que son éloignement grandissant des options politiques russes, le rendaient acceptable au yeux de ses alliés occidentaux. Mais la manière dont l'Etat le lâcha durant son enlèvement montre que ce n'était pas le cas. Finalement, le « Compromis historique » n'a pas été signé. La mort de Moro correspond donc parfaitement à la logique des intérêts défendus par Gladio. Et lorsque D'Amato parle de « résultats optimaux » obtenus dans l'infiltration des Brigades rouges, pense-t-il à l'assassinat de Moro ?
Les diverses enquêtes butaient toujours sur l'obstruction de certains secteurs de l'Etat, les manoeuvres administratives dilatoires et le sacro-saint secret d'Etat. Mais avec le dévoilement de la Loge P2 en 1981, les juges voient leurs soupçons confirmés quant à l'existence d'une structure parallèle, d'un gouvernement occulte qui tirait les ficelles dans l'ombre et organisait la « stratégie de la tension ».
LA LOGE P2 : le véritable pouvoir occulte de l'Etat
En 1981, la Garde des finances découvre la liste de 963 « frères » membres de la Loge P2. Sur cette liste figurent le Gotha de la bourgeoisie italienne : 6 ministres en exercice, 63 hauts fonctionnaires des ministères, 60 politiciens dont Andreotti et Cossiga, 18 juges et procureurs, 83 grands industriels dont Agnelli, Pirelli, Falk, Crespi, des banquiers tels Calvi et Sindona, des membres du Vatican tel le cardinal Casaroli, de grands noms du secteur de la communication comme Rizzoli propriétaire du Corriere de la Sera, ou Berlusconi propriétaire de nombreuses chaînes de télévision, quasiment tous les responsables des services secrets depuis des années dont les généraux Allavena, chef du SIFAR de juin 1965 à juin 1966, Miceli nommé à la tête des services secrets en 1970, l'Amiral Casardi qui lui succède, le Général Santovito alors patron du SISMI, 14 généraux de l'armée, 9 amiraux, 9 généraux des carabiniers, 4 généraux de l'aéronautique et 4 de la garde des finances, pour ne citer que les officiers les plus capes. Mais il faut aussi citer des universitaires, des syndicalistes, des responsables de groupes d'extrême-droite. A l'exclusion des radicaux, des gauchistes et du PCI, tout l'éventail politique italien est représenté. Cette liste n'est pourtant certainement pas complète. De nombreux autres noms au moment du scandale ont été cités sans qu'une preuve puisse être apportée. Des rumeurs invérifiables ont même couru sur la participation de membres influents du PCI à la P2.
Pourtant, on pourrait penser qu'il n'y a là rien que de très habituel. En effet, il est courant de retrouver au sein de la franc-maçonnerie de nombreux notables qui pratiquent ses rites et qui trouvent là un bon moyen de cultiver leurs relations et de remplir leur carnet d'adresses. La personnalité du Grand-Maître, Licio Gelli, est pourtant troublante.
A la tête de cette loge, Gelli est inconnu du grand public, mais le développement de l'enquête et les révélations qui se succèdent va montrer l'influence déterminante qu'il a exercée sur la politique italienne durant des années. Personnage à l'histoire édifiante, Gelli a commencé sa carrière comme membre du parti fasciste. A 18 ans il s'engage chez les Camicie nere, les « chemises noires » qui vont combattre en Espagne. Pendant la guerre il collabore activement avec les nazis auxquels il livre des dizaines de partisans et de déserteurs. A partir de 1943 il semble qu'il commence à faire double jeu en contactant la Résistance et les services secrets américains. Après la guerre il se réfugie en Argentine et revient sans problèmes en Italie en 1948. Au début des années 1960 il s'inscrit à la Franc-maçonnerie, participe à la loge Propaganda due, dont il devient rapidement le Grand Maître et où il est rejoint par les principaux responsables des services secrets. Sa puissance alors est confirmée par de nombreux témoignages. Lors du mariage d'un de ses enfants, d'éminentes personnalités tels le président du Conseil Amintore Fanfani et, semble-t-il, le pape Paul VI, envoient des cadeaux somptueux. Selon les enquêteurs, en signe d'amitié, Agnelli lui aurait offert un téléphone en or massif. Au début des années 1980, Gelli téléphone presque chaque jour au président du Conseil, au ministre du Commerce et de l'Industrie, à celui des Affaires étrangères, aux dirigeants des principaux partis politiques de la Péninsule (démocrate-chrétien, socialiste, social-démocrate, républicain, libéral et néofasciste). A sa résidence près de Florence et dans les salons privés du luxueux hôtel Excelsior où il reçoit, défile le Gotha de l'Establishment italien, notamment Andreotti, qui est en fait son représentant politique officiel, son âme damnée.
La conclusion de la commission d'enquête sur la Loge P2 ne manque pas d'intérêt. Elle estime que Gelli « appartient aux services secrets dont il est le chef; la Loge P2 et Gelli sont l'expression d'une influence exercée par la maçonnerie américaine et la CIA sur le Palazzo Giustiniani depuis sa réouverture après la guerre ; une influence qui témoigne de la dépendance économique à l'égard de la Maçonnerie américaine et de son chef Frank Gigliotti. » Gigliotti est lui-même un agent de la CIA. En 1990, un ex agent de la CIA, Richard Brenneke, dans une interview à la télévision qui fait scandale, déclare : « Le gouvernement des Etats-Unis finançait la P2 jusqu'à 10 millions de dollars par mois. » Voilà qui est clair. La P2 et Gladio ne font qu'un. L'acte d'accusation du 14 juin 1986 fait état de « l'existence en Italie d'une structure secrète composée de militaires et de civils qui, s'étant donnée comme finalité ultime le conditionnement des équilibres politiques existants à travers le contrôle de l'évolution démocratique du pays, a tenté de réaliser cet objectif en se servant des moyens les plus divers, parmi lesquels le recours direct aux attentats commis par des organisations néo-fascistes » et parle d' « une sorte de gouvernement invisible dans lequel la P2, des secteurs déviants des services secrets, le crime organisé et le terrorisme sont étroitement liés. »
Mais pourtant, ce constat lucide des juges ne va pas changer grand chose au fonctionnement de l'Etat italien. Soupçonné d'avoir commandité l'attentat de Bologne, Gelli s'exile à l'étranger. Arrêté dans une banque suisse le 13 septembre 1982, alors qu'il retirait 120 millions de dollars d'un compte numéroté, le vieil homme sera l'auteur d'une invraisemblable évasion de sa prison genevoise le 10 août 1983, et il s'évanouira dans la nature, jusqu'à ce que, quatre ans plus tard, il vienne se livrer aux autorités helvétiques. De Suisse Gelli sera extradé en Italie. Mais alors qu'en son absence il avait, en 1988, été condamné à 10 ans de prison, il sera rejugé en 1990 et finalement acquitté. Le scandale de la P2 est banalisé, oublié. La Loge P2 a disparu mais, n'en doutons pas, une autre structure occulte a du la remplacer, tout aussi efficace. En 1990, Cossiga, président de la République et ex-membre de la P2, pourra déclarer avec satisfaction à propos de Gladio, qu'il est « fier que le secret ait pu être gardé pendant 45 ans. » Oubliés les dizaines de morts victimes des attentats, oubliés les multiples assassinats. De nouveaux scandales viennent à point faire oublier les anciens.
QUELQUES LEÇONS
Tous ces événements, où la grande histoire de l'Italie voisine avec le crime et le fait divers, n'ont finalement eu que peu d'écho en dehors de la péninsule. Tout cela est apparu comme des « affaires italiennes », sans correspondance avec ce qui se passait dans les autres grandes démocraties occidentales. En Italie même, le rôle de la Mafia a été surtout présenté comme un produit régional du sud de l'Italie, la « stratégie de la tension » comme l'oeuvre de secteurs dévoyés des services secrets, et les scandales politiques comme un simple problème de corruption de certains politiciens. Bref, les véritables leçons ont été escamotées et, de scandales en révélations, de procès médiatisés en démissions de responsables étatiques, l'illusion d'une lutte de l'Etat contre ces atteintes à l'ordre démocratique a été maintenue. Pourtant, ce que met clairement en évidence ce bref historique des « affaires » qui ont ébranlé la république italienne depuis les années 1930 est tout autre.
- Les « affaires » ne sont pas un produit spécifiquement italien, mais le résultat de l'activité internationale de la bourgeoisie, dans un contexte de rivalités impérialistes exacerbées. Dans ces conditions, cela signifie que l'Italie, loin d'être une exception, est au contraire un exemple de ce qui existe partout.
- Elles ne sont pas l'expression d'une minorité dévoyée de la classe dominante, mais elles traduisent le fonctionnement totalitaire de l'Etat du capitalisme décadent, même si celui-ci se cache derrière le masque de la démocratie.
Aussi bien l'histoire de l'ascension de Cosa Nostra que les révélations de l'existence des réseaux Gladio et de la Loge P2, montre qu'il ne s'agit pas d'affaires italiennes, mais bien d'affaires internationales.
Cela est particulièrement évident avec l'affaire Gladio. Le réseau Gladio était, par définition, une structure secrète de l'OTAN, donc internationale. Elle était la courroie de transmission clandestine du contrôle des Etats-Unis sur les pays de leur bloc, destinée à s'opposer aux manoeuvres de l'impérialisme adverse et aux risques de déstabilisation sociale par tous les moyens, y compris les moins avouables. C'est pourquoi elle était secrète,. De la même manière qu'elle a existé et agi en Italie, elle a existé et agi dans les autres pays du bloc occidental. Il n'y a aucune raison qu'il en soit autrement : aux mêmes causes, les mêmes effets.
Avec cet éclairage, on peut mieux comprendre les forces qui étaient à l'oeuvre derrière le coup d'Etat des colonels en Grèce en 1967, celui de Pinochet au Chili en 1973, ou encore tous ceux qui se sont succédés en Amérique latine durant les années 1970. De même, ce n'est pas seulement en Italie que, à partir de la fin des années 1960, des vagues d'attentats terroristes se sont développées, qui ont aidé l'Etat à mener des campagnes idéologiques intenses destinées à déboussoler la classe ouvrière qui reprenait le chemin de la lutte et à justifier le renforcement de son arsenal répressif En Allemagne, en France, en Grande-Bretagne, au Japon, en Espagne, en Belgique, aux Etats-Unis, on peut, à la lumière de l'exemple italien, penser avec raison que, derrière les agissements terroristes de groupes d'extrême-droite, d'extrême-gauche, nationalistes, il y a la main de l'Etat et de ses services secrets, et l'expression d'une stratégie internationale organisée sous les auspices du bloc.
De même, l'exemple édifiant en Italie du rôle de la Mafia révèle que ce n'est pas là un fait très récent, ni un produit spécifiquement local. L'intégration de la Mafia au coeur de l'Etat italien n'est pas un phénomène nouveau : elle date de plus de cinquante ans. Elle n'est pas le produit d'une simple et lente gangrène affairiste qui affecterait seulement les politiciens les plus corrompus : elle est le résultat du bouleversement des alliances qui s'est opéré durant la seconde guerre mondiale. La Mafia, pour le compte des Alliés, a joué un rôle déterminant dans la chute du régime mussolinien et, pour paiement de ses services, a gagné une place centrale dans l'Etat. L'alliance qui est scellée avec la guerre ne va d'ailleurs pas cesser avec celle-ci. La Mafia restera, comme clique de la bourgeoisie italienne, le principal point d'appui des Etats-Unis. Le poids et le rôle important de la Mafia au sein de l'Etat italien est donc, avant tout, le résultat de la stratégie impérialiste américaine.
Alliance contre-nature entre le champion américain de la défense de la démocratie et le symbole du crime au nom des impératifs stratégiques mondiaux ? Alliance, oui, contre-nature, certainement pas. La réalité italienne ne fait que mettre en évidence un phénomène mondial du capitalisme décadent : au nom des sacro-saints impératifs de la raison d'Etat et des intérêts impérialistes, les grandes puissances qui, sur le devant de la scène médiatique, claironnent leurs convictions démocratiques, nouent, dans l'arrière-cour, des alliances qui montrent le mensonge de tous leurs discours officiels. C'est une banalité de constater que les multiples dictateurs qui sévissent à la périphérie sous-développée du capitalisme subsistent grâce au parrainage intéressé d'une puissance ou d'une autre. Il en est de même pour les clans mafieux dans le monde : leur activité peut se développer impunément parce qu'ils savent aussi rendre des services précieux aux divers impérialismes dominants qui se partagent la planète.
Ils sont même le plus souvent partie intégrante des fractions dominantes de la bourgeoisie des pays où ils sévissent. C'est évident pour toute une série de pays dont la production et l'exportation de drogue constituent l'activité économique essentielle, favorisant au sein de la classe dominante l'ascension des gangs qui contrôlent ce secteur de l'économie capitaliste qui prend de plus en plus d'importance. Mais cette réalité n'est pas l'apanage des pays sous-développés et l'exemple vient du haut de la hiérarchie du capitalisme mondial. Ainsi, l'alliance entre l'Etat américain et la Mafia italienne, pendant la deuxième guerre mondiale, trouve aussi son pendant au niveau interne aux Etats-Unis où, par la même occasion, la branche américaine de Cosa Nostra est en fait invitée à participer, avec ses moyens, aux affaires de l'Etat. De même, la situation au Japon n'est pas sans rappeler celle de l'Italie et les récents scandales qui y ont éclaté mettent en lumière l'omniprésence des liens entre les politiques et la Mafia locale. L'exemple italien est donc aussi valable pour les deux premières puissances économiques mondiales où ce qu'on appelle la Mafia a conquis une place de choix au sein de l'Etat. Ce n'est cependant pas seulement dû au poids économique considérable lié à la maîtrise de secteurs économiques extrêmement lucratifs -drogue, jeu, prostitution, racket, etc. - , mais aussi aux services « spécialisés » que ces cliques de gangsters peuvent rendre et qui correspondent parfaitement aux besoins de l'Etat du capitalisme décadent.
Il est vrai que la bourgeoisie la plus « respectable » a toujours su, lorsque cela était nécessaire, utiliser les services d'agents spéciaux, ou ceux de ses fractions les moins fréquentables pour des activités « non-officielles », c'est-à-dire illégales selon ses propres lois. Au 19e siècle, les exemples ne manquent pas : l'espionnage bien sûr, mais aussi l'embauche de gros bras du milieu pour casser des grèves ou l'utilisation de Mafias locales pour favoriser la pénétration coloniale. Mais à cette époque cet aspect de la vie du capitalisme était limité et circonstanciel. Depuis son entrée dans sa phase de décadence au début du siècle, le capitalisme est dans une situation de crise permanente. Il ne peut plus, pour assurer sa domination, s'appuyer sur la réalité du progrès qu'il apporte, car tel n'est plus le cas. Pour perpétuer son pouvoir, de plus en plus, il a du recourir au mensonge et à la manipulation. De plus, au cours du 20e siècle, marqué par deux guerres mondiales, l'exacerbation des tensions impérialistes est devenue un facteur prépondérant de la vie du capitalisme. Dans la foire d'empoigne qu'est devenue la planète, tous les coups, même les plus tordus, sont permis pour assurer la survie. Pour répondre à ces nécessités, le fonctionnement de l'Etat a dû s'adapter. Dans la mesure où la manipulation et le mensonge, que ce soit pour les besoins de la défense impérialiste ou ceux du contrôle social, sont devenus des aspects essentiels de sa survie, le secret et sa préservation sont devenus un aspect central de la vie de l'Etat capitaliste, le fonctionnement démocratique classique de la bourgeoisie et de son Etat, tels qu'il existait au 19e siècle, n'est plus possible. Il n'est perpétué que comme illusion destinée à masquer la réalité d'un fonctionnement étatique totalitaire, qui n'a plus rien de démocratique. La réalité du pouvoir et ses agissements, parce qu'ils devenaient inavouables, ont été occultés. Non seulement le pouvoir effectif s'est concentré au sein de l'exécutif, aux dépens du législatif, dont la représentation, le parlement, est devenu un simple paravent destiné à alimenter les campagnes médiatiques, mais de plus, au sein même de cet exécutif, le pouvoir est concentré entre les mains des spécialistes du secret et des manipulations en tous genres. Dans ces conditions, non seulement l'Etat a dû recruter une abondante main d'oeuvre spécialisée, créant une multitude de services spéciaux, tous plus secrets les uns que les autres, mais en son sein, l'ascension des cliques de la bourgeoisie les plus expérimentées dans le secret et l'activité « illégale » a été, comme conséquence, favorisée. Dans ce processus, l'Etat totalitaire a étendu son emprise sur l'ensemble de la société, y compris ses bas-fonds, aboutissant à une symbiose extraordinaire où il devient difficile de distinguer un représentant politique d'un homme d'affaires, d'un agent secret ou d'un gangster, et vice versa.
Telle est la raison de fond du rôle croissant des secteurs mafieux dans la vie du capital. Mais la Mafia n'est pas le seul exemple. L'affaire de la Loge P2 montre que la Maçonnerie est un instrument idéal, par son fonctionnement occulte et ses ramifications internationales, pour être utilisée comme réseau d'influence par les services secrets pour les besoins de la politique impérialiste. Cela fait d'ailleurs longtemps que les diverses obédiences maçonniques dans le monde ont été investies par le pouvoir d'Etat et mises au service des puissances impérialistes occidentales qui les utilisent selon leurs plans. C'est d'ailleurs probablement le cas de la majeure partie des sociétés secrètes d'une quelconque importance.
Mais la Loge P2 n'était pas seulement un outil de la politique impérialiste américaine. Elle était d'abord une partie du capital italien et elle montre, au-delà du verbiage démocratique, la réalité du fonctionnement de l'Etat et de son totalitarisme. Elle regroupait en son sein des clans de la bourgeoisie qui dominent de manière occulte l'Etat depuis des années. Cela ne veut pas dire qu'elle regroupait toute la bourgeoisie italienne. Déjà, à priori le PCI en était exclu, représentant une autre faction à l'orientation en politique étrangère tournée vers l'Est. Il est également probable que d'autres cliques existent au sein du capital italien, ce qui pourrait expliquer que le scandale ait éclaté. En son sein de la Loge P2 cohabitaient d'ailleurs plusieurs clans soudés par les intérêts convergents sous la houlette américaine face au danger commun représenté par l'impérialisme russe et le danger de subversion «communiste». La liste trouvée dans la résidence de Gelli permet d'identifier certains de ces clans : les grands industriels du nord, le Vatican, un secteur très important de l'appareil d'Etat, notamment les états-majors de l'armée et des services secrets, et de manière plus discrète, la Mafia. Le lien de cette dernière avec la Loge P2 apparaît avec la présence des banquiers Sindona et Calvi, le premier mort empoisonné en prison et le deuxième étrangement pendu sous un pont de Londres, qui tous deux ont été impliqués dans des scandales financiers quand ils géraient à la fois les fonds du Vatican et de la Mafia. Etranges alliances parfaitement significatives du capitalisme contemporain. La Loge P2 nous présente un cocktail sulfureux qui montre encore une fois que souvent la réalité dépasse la fiction la plus échevelée : sociétés occultes, services secrets, Vatican, partis politiques, milieux des affaires, de l'industrie et de la finance, Mafia, journalistes, syndicalistes, universitaires, etc.
En fait, avec la Loge P2 est dévoilé le véritable centre de décision occulte qui a présidé aux destinées du capitalisme italien depuis la guerre. Gelli se nommait lui-même, avec un humour cynique, le «grand marionnettiste », celui qui, derrière la scène, tirait les ficelles et dont les « marionnettes » étaient les hommes politiques. Le grand jeu démocratique de l'Etat italien n'était donc qu'une habile mise en scène. Les décisions les plus importantes étaient prises ailleurs que dans les structures officielles (assemblée nationale, ministères, présidence du Conseil, etc.) de l'Etat italien. Cette structure secrète de pouvoir s'est maintenue quel qu'ait été le résultat des multiples consultations électorales qui se sont déroulées durant toutes ces années. D'ailleurs, la Loge P2 avait toutes les cartes dans sa manche pour, comme en 1948, manipuler les élections et maintenir le PCI à l'écart. Quasiment tous les leaders des partis démocrates-chrétiens, républicains, socialistes, étaient à sa dévotion et le jeu « démocratique » de 1'« alternance » n'était qu'un trompe-l'oeil. La réalité du pouvoir, elle, ne changeait pas. En coulisse, Gelli et sa Loge P2 continuaient à contrôler l'Etat.
Là encore, il n'y a aucune raison pour qu'il s'agisse d'une spécificité italienne, même si ailleurs, le centre occulte de décision ne prend pas forcément l'aspect quelque peu folklorique d'une loge maçonnique. Depuis quelques années, l'aggravation brutale de la crise et le bouleversement des alignements impérialistes dû à la disparition du bloc de l'Est provoquent un chamboulement des alliances entre les cliques qui existent au sein de chaque capital national. Loin d'être l'expression d'une soudaine volonté de restaurer un fonctionnement démocratique, les campagnes qui se développent aujourd’hui dans de nombreux pays, au nom du nettoyage de l'Etat de ses éléments les plus pourris, ne sont que l'expression de règlements de compte entre diverses cliques pour le contrôle central de l'Etat. La manipulation des médias, l'usage à bon escient des dossiers compromettants, sont les armes de cette lutte qui peut aussi prendre d'autres formes plus sanglantes.
En fait, tout cela montre, avec le recul, que, loin d'être une exception, l'Italie, qui depuis des années voit se succéder les scandales politiques, était l'exemple édifiant et annonciateur de ce qui s'est aujourd'hui généralisé.
JJ.
Quelques références. Sur la Mafia : « Le syndicat du crime », J.-M. Charlier et J. Marcilly, Presses de la Cité, Paris 1980. Sur Gladio et la Loge P2 : « Intelligences secrètes », F. Calvi et O. Schmidt, Hachette, Paris 1988 ; « Gladio », EPO, Bruxelles 1991 ; ainsi que le documentaire télévisé en trois parties « Gladio », BBC 1992. Sur la « stratégie de la tension » en Italie : « Il partito del golpe », G. Flamini, Ferrara, Boloventa 1981.
Géographique:
- Italie [1285]
Questions théoriques:
- Décadence [32]
- Impérialisme [321]
Comment est organisée la bourgeoisie : La bourgeoisie mexicaine dans l'histoire de l'impérialisme
- 3230 reads
Différents facteurs, que ce soit le fait d'être une réserve de matières premières (minéraux, pétrole) ou surtout sa situation géographique -une longue frontière avec les Etats-Unis -, confèrent au Mexique une importance particulière au sein des relations impérialistes : il constitue une « priorité » pour la sécurité de la première puissance mondiale. Dans un article sur le Traité de libre commerce ([1] [1525]), nous avons souligné que le traité a pour objectif fondamental de préserver la stabilité du Mexique (et au-delà, la stabilité de toute l'Amérique latine), parce que toute situation de conflits sociaux, chaos ou guerre, se répercuterait sur les Etats-Unis. En même temps, il s'agit pour les Etats-Unis, d'éviter qu'une bourgeoisie latino-américaine ne se rapproche d'une autre grande puissance, l'Allemagne ou le Japon par exemple. Mais, par-dessus tout, garantir la stabilité du gouvernement mexicain, sans qu'il y ait trop de désordres, un gouvernement qui soit de plus un allié inconditionnel au sud de sa frontière (et aussi au nord avec le Canada), est une priorité pour la bourgeoisie des Etats-Unis.
Il semble évident que la classe capitaliste du Mexique est alignée sur celle des Etats-Unis. Pourtant, en voyant la situation dans d'autres pays, y compris d'Amérique latine, où les gouvernements remettent en question, à plus ou moins grande échelle, leur fidélité aux Etats-Unis, où les bourgeoisies se tournent de plus en plus vers l'Allemagne (ou le Japon), ou se désintègrent, provoquant des crises politiques qui menacent l'unité de l'Etat capitaliste, nous devons nous poser la question : pourrions-nous voir au Mexique une situation de déstabilisation, ou même de remise en question de la domination américaine semblable à celle qui se produit dans d'autres pays, ou au contraire, le Mexique est-il pour les Etats-Unis, un terrain 100% acquis ?
L'ascension des Etats-Unis dans les dernières décennies du siècle dernier, a signifié une domination économique et politique de plus en plus totale sur les pays d'Amérique latine. Mais cette domination n'a pas été exempte de conflits et de difficultés. De fait, l'application de la dite « Doctrine Monroe », selon laquelle « l'Amérique appartient aux américains » (c'est-à-dire « l'Amérique latine appartient à la bourgeoisie des Etats-Unis »), a signifié, en premier lieu, la liquidation, au début du siècle, de l'influence des vieilles puissances qui avaient dominé l'Amérique latine tout au long du 19e siècle, celle de l'Angleterre en premier lieu. Ensuite, dans la première moitié du 20e siècle, elle a signifié la lutte contre ceux qui tentaient de s'approprier un morceau du gâteau américain, et surtout la lutte contre l'Allemagne. Enfin, après la seconde guerre mondiale, les Etats-Unis ont dû combattre les tentatives de déstabilisation menées par 1’URSS. Tout au long de ce siècle, les crises politiques qui ont secoué les pays d'Amérique latine ont eu pour toile de fond - voire pour cause fondamentale- ces affrontements : changements violents de gouvernements, assassinats de responsables gouvernementaux, coups d'Etat ou guerres. L'attitude des bourgeoisies d'Amérique latine ne peut en aucun cas être qualifiée de passive. C'est plutôt que, cherchant à tirer le meilleur profit, elles ont pris le parti, appuyées plus d'une fois par les autres grandes puissances, de mettre en question plus ou moins sérieusement la suprématie américaine, sans jamais naturellement parvenir à se débarrasser d'elle. Le Mexique est une illustration parfaite de ce que nous avançons.
La soi-disant « Révolution mexicaine» ou d'où vient la «fidélité » de la bourgeoisie mexicaine ?
Une des conséquences les plus importantes -pour ne pas dire la plus importante de la guerre de 1910-1920, la soi-disant « révolution mexicaine », fut l'affaiblissement définitif de la bourgeoisie nationale qui avait grandi à l'ombre des vieilles puissances, et son remplacement par une « nouvelle bourgeoisie », alliée inconditionnelle et soumise des Etats-Unis. En effet, pendant la seconde moitié du 19e siècle, puis surtout pendant les trente années de l'ère Porfirio Diaz, s'était développé un capital national agressif et combatif (dans les mines, les chemins de fer, le pétrole, le textile, etc., ainsi que dans le commerce et les finances), sous la houlette de pays comme la France ou l'Angleterre. La bourgeoisie mexicaine de cette époque voyait comme une menace les avancées et les prétentions des Etats-Unis, une menace contre l'Amérique latine et le Mexique en particulier, et essayait de la contrecarrer en ouvrant ses portes à d'autres puissances, dans l'illusion qu'en multipliant les influences politiques en provenance d'Europe, aucune puissance ne pourrait prédominer.
Cependant, vers la fin du 19e siècle, la dictature féroce de Diaz commença à se lézarder. La forme de la dictature militaire de l'Etat capitaliste devenait trop étroite pour le stade de développement atteint par l'économie, et différents facteurs ont poussé à la modification de cette situation. Ceci s'est exprimé par le fractionnement de la classe capitaliste, par une lutte pour la succession du vieux Diaz ; en particulier, une fraction combative de capitalistes propriétaires-terriens du nord aspirait à occuper une place prédominante, en accord avec sa puissance économique, dans le gouvernement. En même temps, un profond mécontentement se développait dans les classes travailleuses de la campagne (peones des haciendas dans tout le pays, rancheros dans le nord, comuneros dans le sud) et dans le jeune prolétariat industriel, qui ne supportaient plus l'exploitation sans pitié qu'ils subissaient. La conjonction de ces facteurs a produit une commotion sociale qui a mené à 10 ans de guerre interne, sans que - contrairement à ce que dit l'histoire officielle- cela constitue pour autant une véritable révolution sociale.
En premier lieu, la guerre de 1910-1920 au Mexique ne fut pas une révolution prolétarienne. Le prolétariat industriel, jeune et dispersé, ne constituait pas, en ce temps-là, une force décisive. En fait, ses tentatives de rébellion les plus importantes, dans la vague de grèves du début du siècle, avaient été complètement écrasées à la veille des événements de 1910-1920. Si certains secteurs du prolétariat ont participé à la guerre, ils l'ont fait comme wagon de queue d'un train d'une des fractions bourgeoises. Quant au prolétariat agricole, privé du guide de son frère industriel et encore très attaché à la terre, il a été intégré à la guerre paysanne.
A son tour, la guerre paysanne n'a pas constitué non plus une révolution. La guerre du Mexique est venue démontrer pour la nième fois que le mouvement paysan se caractérise par l'absence de projet historique propre, et ne peut être que liquidé ou intégré dans le mouvement d'une des classes historiques (le prolétariat ou la bourgeoisie). Au Mexique, c'est dans le sud que le mouvement paysan a pris sa forme la plus « classique ». Les partisans paysans, qui conservaient encore leurs traditions communautaires, se sont lancés à l'assaut des haciendas « porfiristes » ([2] [1526]), mais après avoir récupéré la terre, ils ont abandonné les armes, et n'ont jamais été capables de former une armée régulière, ni un gouvernement capable de contrôler pour un certain temps les villes qu'ils avaient prises. Ces partisans furent combattus aussi bien par l'ancien régime que par le nouveau (qualifié de «révolutionnaire»), qui avait surgi de la guerre. Finalement, ils furent complètement écrasés. La bataille des rancheros du nord connut le même destin : leur tactique de prise de villes avec des assauts de cavalerie, propre au siècle dernier, fut efficace face à l'armée fédérale « porfiriste », mais échoua avec fracas devant la guerre moderne des tranchées, des barbelés hérissés et des mitrailleuses, qui était celle de l'armée du nouveau régime. La défaite des paysans (comuneros du sud et rancheros du nord) se solda par la restitution des terres aux anciens propriétaires des haciendas, et la formation de nouvelles latifundia dans les premiers temps du nouveau régime.
Enfin, cette guerre ne saurait être considérée comme une révolution bourgeoise. Elle n'a pas donné lieu à la formation d'un Etat capitaliste, puisqu'il existait déjà; elle n'a fait que substituer une forme d'Etat à une autre. Son seul mérite fut d'avoir jeté les bases d'une adéquation des rapports capitalistes à la campagne, avec l'élimination du système des «tiendas de raya» qui attachait les peones aux haciendas et empêchait ainsi la libre circulation de la force de travail (mais en général, les rapports de production capitalistes existaient déjà pleinement; ils s'étaient développés de façon accélérée et étaient prédominants déjà avant la guerre).
La main des grandes puissances dans la guerre du Mexique
Mais la soi-disant « révolution mexicaine » n'a pas eu pour seul contenu le conflit social interne. Elle était inscrite, pleinement, dans les conflits impérialistes qui ont secoué le monde au début de ce siècle, qui ont conduit à la 1° guerre mondiale de 1914-18 et à un changement dans l'hégémonie des grandes puissances, changement qui mettait les Etats-Unis au premier rang des puissances impérialistes. En fait, la succession de gouvernements qui va de la chute de Diaz au gouvernement et à l'assassinat de Madero, puis au gouvernement et à l'expulsion de Huerta, et jusqu'au gouvernement et à l'assassinat de Carranza, que l'histoire officielle explique comme une succession de mésaventures d'hommes « bons » ou « méchants », « traîtres » ou « patriotes », peut s'expliquer beaucoup plus logiquement par les luttes pour la suprématie économique et politique au Mexique, au travers du contrôle de son gouvernement, et par le parti pris par les différents gouvernements, leurs virages - parfois à 180 degrés - vis-à-vis de ces luttes impérialistes. Plus concrètement, au-delà de ces bouleversements, nous pouvons voir les efforts des Etats-Unis pour établir au Mexique un gouvernement soumis à leurs intérêts ([3] [1527]).
Ainsi la décomposition et la chute du gouvernement de Diaz fut activement impulsée par les Etats-Unis, qui appuyèrent les fractions de capitalistes propriétaires d'haciendas du nord (avec à leur tête Madero), dans le but d'obtenir des concessions économiques et politiques, et d'affaiblir l'influence des puissances européennes. Pourtant, Madero ne cherchait ni à détruire en faveur des Etats-Unis l'équilibre des forces entre les différentes puissances qu'avait toujours entretenu Diaz, ni à améliorer réellement la situation des classes exploitées. D'ailleurs Madero, à mesure que s'embrasait l'explosion des révoltes paysannes, devint un obstacle aux yeux des Etats-Unis, qui organisèrent alors la conspiration de Huerta pour l'assassiner et s'emparer du pouvoir.
Plus tard, Huerta essaiera vainement, d'utiliser les affrontements entre grandes puissances à son profit : il finit abandonné de tous. Parallèlement, le mouvement paysan atteignait son apogée et Huerta fût, lui aussi, renversé. Simultanément, la 1° guerre mondiale avait éclaté en Europe, et c'est là qu'ont commencé à influer sur la situation mexicaine d'autres intérêts : ceux de l'Allemagne.
L'Allemagne disputait aux autres puissances sa place dans l'arène impérialiste de la répartition du monde, dans laquelle elle était arrivée avec retard. Elle avait quelques intérêts économiques au Mexique, mais ce n'était pas le principal. L'Allemagne avait compris l'importance stratégique du Mexique et essayait de l'utiliser comme moyen de faire obstacle aux visées américaines. D'abord avec Huerta et ensuite, plus résolument encore, avec Carranza, les services diplomatiques et secrets allemands tentèrent de provoquer un conflit armé entre le Mexique et les États-Unis. L'Allemagne essayait par là de détourner les efforts de guerre des Etats-Unis qui déjà fournissaient en armes les puissances « alliées » et se préparaient à entrer en guerre. A l'extrême, la bourgeoisie allemande rêvait d'une alliance Japon-Mexique-Allemagne qui aurait pu se confronter aux Etats-Unis en Amérique, mais le Japon était plus préoccupé de s'établir en Chine et ne se sentait pas assez fort pour affronter les Etats-Unis. Finalement, les « alliés » parvinrent à renverser les conjurés appuyés par l'Allemagne. Enfin, comprenant l'imminence de la défaite, l'Allemagne amorça un virage dans sa politique, et, grâce à des accords économiques, tenta de se préserver une influence sur le Mexique, en espérant des jours meilleurs.
Au début des années 1920, après la fin de la 1° guerre mondiale et l'étouffement de la guerre interne, une nouvelle bourgeoisie vint au pouvoir, dont les capitaux d'« origine » provenaient directement des butins de la guerre. Malgré le pouvoir croissant des Etats-Unis sur l'ensemble du continent et le net recul des anciennes puissances, Angleterre et France, les conflits ne cessèrent pas totalement. L'Angleterre par exemple, disputa encore aux Etats-Unis pendant deux décennies le contrôle du pétrole. Et les gouvernements « issus de la révolution » postérieurs à celui de Carranza (qui lui aussi finit assassiné) ne remirent plus jamais en question la suprématie du voisin du nord.
Pourtant, l'ancienne bourgeoisie de l'époque « porfiriste », bien que très affaiblie, n'avait pas été complètement détruite. Et avant d'accepter de s'adapter à la nouvelle situation et de reconnaître qu'il n'y avait pas d'autre choix que de coexister et même de fusionner avec la nouvelle bourgeoisie, certains secteurs trouvèrent la force de remettre en question le nouveau gouvernement.
La guerre des « cristeros »
Les règlements de comptes non liquidés entre les deux fractions de la bourgeoisie nationale au lendemain de la guerre de 1910-1920 entraînèrent une nouvelle guerre sanglante de 1926 à 1929, qui dévasta les Etats du centre-ouest de la République (Zacatecas, Guanajuato, Jalisco, Michoacan) dans lesquels, tout récemment, les paysans avaient déjà servi de chair à canon. Quant à l'influence que les grandes puissances exercèrent sur le Mexique, il est hautement intéressant de constater que l’ « ancienne » fraction avait reçu récemment un appui, plus ou moins voilé, de la part de certains secteurs du capital européen (d'Espagne, de France et d'Allemagne) au travers de... l'Eglise catholique romaine. Cette fraction avait pour mot d'ordre la « liberté religieuse » soi-disant menacée par le «régime révolutionnaire» (en réalité, ce dernier ne faisait qu'arracher des parts du pouvoir économique à l'« ancienne» fraction qui incluait l'église catholique). Et derrière ce mot d'ordre, se cachait l'idéologie de la « Synarchie ». Derrière le cri de « Vive le Christ-Roi » (de là leur vient le nom de «cristeros»), poussé par l'armée irrégulière de l'ancienne fraction bourgeoise, se cachait toute la conception d'une recherche d'un nouvel «ordre mondial » qui aurait à sa tête les anciennes puissances (France, Allemagne, Italie, Espagne), prémisse idéologique, comme on pourra le voir par la suite, du fascisme européen des années 1930. Ainsi, de nouveau, nous voyons derrière un conflit interne une tentative de déstabiliser le pays de la part du capital européen (ou tout du moins de certains secteurs) qui, des années plus tard, s'affrontera sur le terrain militaire aux Etats-Unis. Les « cristeros » furent battus, et il ne restait à 1'« ancienne » fraction du capital qu'à imiter la nouvelle, qu'à se fondre en elle et enterrer ses propres aspirations pro-«européennes». Les gouvernements des années 1930-40 se soumirent aux Etats-Unis, transformant le Mexique en fournisseur de matières premières durant la 2e guerre mondiale. Ce fut la position non seulement du gouvernement de Avila Camacho, qui en vint à « déclarer la guerre » aux puissances de l'Axe, mais aussi du gouvernement de son prédécesseur et électeur (au Mexique, la voix du président est décisive pour l'élection de son successeur), Lazaro Cardenas, général qui s'était distingué dans la guerre contre les «cristeros», dont la mythique «expropriation du pétrole», en 1938, conduisit en fait à l'expulsion définitive des compagnies pétrolières anglaises et à la conversion du Mexique en réserve énergétique à l'usage exclusif des Etats-Unis.
La parenthèse du bloc impérialiste stalinien
A la fin de la seconde guerre mondiale, en 1945, s'est ouverte ce que nous pourrions appeler une «parenthèse» historique dans la guerre que se menaient, depuis le début du siècle, les Etats-Unis et l'Allemagne pour le contrôle du monde. Pendant plus de 40 ans, l'impérialisme russe disputa la suprématie mondiale à l'impérialisme américain ([4] [1528]). La formation d'un nouveau jeu de blocs plaça les ennemis d'hier du même côté, l'Allemagne aux côtés des Etats-Unis. Quant à l'Amérique latine, les Etats-Unis y renforcèrent leur domination économique et politique, malgré les tentatives d'intervention de 1’URSS dans la région (à travers quelques guérillas et le flirt avec des gouvernements « socialistes »). Ces tentatives ne furent d'ailleurs, à part à Cuba ([5] [1529]), que des essais de déstabiliser la région, très semblables à ceux du passé, surtout à ceux de l'Allemagne.
Cette parenthèse a été refermée, au début de cette décennie, par l'effondrement du bloc impérialiste de l'Est, la dissolution du bloc de l'Ouest et le démantèlement de l'URSS. Mais au contraire de ce qu'affirme la propagande des médias, cet événement ne signifie pas la fin des affrontements entre les grandes puissances, la « fin de l'histoire », ou autres semblables mensonges.
Les relations impérialistes constituent aujourd'hui une source de déstabilisation, de guerres et de chaos qui affectent le monde tout entier. Aucun pays, grand ou petit, n'échappe au jeu sinistre des luttes impérialistes, et surtout à celles qui opposent les deux grandes puissances rivales tout au long de ce siècle : les Etats-Unis et l'Allemagne. Au milieu du « nouveau désordre mondial », se dessinent les tendances à la formation d'un nouveau partage entre blocs impérialistes, ayant comme axe ces deux puissances, autour desquelles se polarisent tous les autres pays, dans lequel les alliés d'hier deviennent ennemis, dans un tourbillon sans frein où le chaos ne fait qu'alimenter ces tendances, lesquelles à leur tour accroissent le chaos. Et le Mexique n'échappe en aucun cas à cette dynamique des relations capitalistes mondiales.
Le Mexique, « toujours fidèle » ?
Nous allons maintenant essayer de répondre à la question que nous avons posée au début de cet article, au sujet de la « fidélité » aux Etats-Unis de la classe capitaliste mexicaine. La bourgeoisie des Etats-Unis s'est assurée de la fidélité de la bourgeoisie mexicaine pendant six décennies, et elle continuera assurément à le faire, en général.
Il subsiste cependant, non une «fraction» (ce qui impliquerait une fissure profonde dans le capital, et ce n'est pas le cas), mais quelques secteurs du capital mexicain qui, traditionnellement, ont toujours résisté à la domination presque exclusive des Etats-Unis. Ces secteurs, bien que relativement minoritaires, ont été capables d'élever un des leurs au fauteuil présidentiel : ce fut le cas, dans les années 1960, du président Diaz Ordaz Claro, et ce ne fut possible que parce que les rivalités entre « pro-européens » et « pro-américains » étaient secondaires à l'époque, le premier plan étant occupé par « l'ennemi principal », le capitalisme russe, et parce qu'il existait une alliance entre l'Europe occidentale et les Etats-Unis. Ceci n'arrivera plus. Les Etats-Unis vont rechercher la garantie d'une fidélité absolue de la part de l'exécutif mexicain, ils vont chercher à éviter toute « erreur » qui pourrait amener au pouvoir un représentant des secteurs les plus favorables aux puissances du vieux continent.
Malgré cela, nous pouvons nous attendre à ce que ces secteurs minoritaires, illusionnés par l'essor de l'Allemagne, commencent à se manifester bruyamment, à s'agiter, à « protester », à « exiger », créant par là des problèmes supplémentaires au gouvernement pro-américain. Nous pouvons aussi prévoir que les rivaux des Etats-Unis vont soutenir ces secteurs, non pour s'emparer du Mexique, mais pour créer une instabilité sociale dans la « chasse gardée » des Etats-Unis, partant du principe que tout ce qui fait obstacle aux Etats-Unis et les oblige à détourner leurs efforts (économiques, politiques, militaires) est de nature à offrir des avantages. Nous pouvons déjà en observer des signes. Par exemple, dans la réactivation ces derniers mois des héritiers de la « synarchie » (le Parti démocrate mexicain, et d'autres groupements qui lui sont proches). A l'intérieur du Parti d'Action Nationale - le PAN, rien moins que la seconde force du pays -, une partie a décidé de s'allier au gouvernement de Salinas, alors que l'autre, dans laquelle sont restés les « leaders historiques», a décidé de former un autre parti, qui se rapproche idéologiquement des « synarchistes ». Significative elle aussi, la lutte à l'intérieur de l'Eglise catholique oppose ceux qui cherchent à concilier avec le gouvernement et ceux qui l'attaquent constamment du haut de leurs chaires. Et enfin, le ressurgissement de la revendication du « Christ-Roi », et des « cristeros », impulsée par le Vatican (dont certains indices font penser qu'il se rapproche de l'Allemagne), n'est pas le fruit du hasard : manifestation religieuse à Guanajuato, dans le lieu qui symbolise le mouvement des « cristeros », présidée par le gouverneur (membre du PAN); manifestation dans la ville de Mexico pour célébrer la béatification récente d'une trentaine de martyrs de la guerre des «cristeros», béatification prononcée par... le Pape.
Nous insistons : les secteurs minoritaires du capital mexicain, partisans d'une attitude « anti-américaine » et donc « pro-européenne » ne peuvent mettre en question la suprématie des Etats-Unis au Mexique, mais ils peuvent par contre créer des problèmes, de plus ou moins grande "ampleur. L'avenir nous le dira.
Le prolétariat doit-il prendre parti pour une des fractions bourgeoises ?
Il est vital pour la classe ouvrière de comprendre que ses intérêts n'ont rien à voir avec les luttes impérialistes. Elle n'a rien à gagner à appuyer une fraction bourgeoise contre l'autre, et tout à perdre. Deux guerres mondiales pour le partage du monde entre les différents bandits impérialistes n'ont apporté à la classe ouvrière que des dizaines de millions de morts. Au Mexique aussi, les guerres bourgeoises de 1910-1920 et de 1926-29 n'ont apporté aux classes travailleuses que des millions de morts et un renforcement des chaînes de l'oppression.
Le prolétariat doit être conscient qu'à travers les appels à défendre la « patrie » ou la « religion » se cache la volonté d'amener le prolétariat à défendre des intérêts qui ne sont pas les siens, voire à s'entre-tuer au nom des intérêts de ses propres exploiteurs. Ces appels vont sûrement s'amplifier, jusqu'à devenir assourdissants, au fur et à mesure que la bourgeoisie aura besoin de façon plus urgente de la chair à canon pour ses luttes internes et ses guerres. Le prolétariat doit rejeter ces appels, et au contraire s'opposer à la continuation des luttes impérialistes, en développant sa lutte de classe, seule voie qui mène à en terminer définitivement avec le système capitaliste, lequel n'a rien à offrir à l'humanité, sinon le chaos et les guerres.
Leonardo, Juillet 1993. Révolution Mundial n° 16.
[1] [1530] Revolucion Mundial n° 12, « TLC : El gendarme del mundo asegura su traspatio ». Le TLC est en français aussi appelé ALENA, Accord de Libre-Echange Nord-Américain.
[2] [1531] De Porfirio Diaz.
[3] [1532] Le livre de F.Katz, La guerre secrète au Mexique, est une étude très complète et révélatrice du degré d'ingérence des grandes puissances dans la « révolution » mexicaine. C'est de ce livre que nous avons tiré une grande partie de nos informations.
[4] [1533] Nous ne pouvons revenir ici sur notre conception du stalinisme. Nous recommandons à nos lecteurs le Manifeste du 9e Congrès du CCI et notre Revue Internationale
[5] [1534] Sur Cuba, voir Revolucion Mundial n° 9 et 10.
Géographique:
- Mexique [1535]
Questions théoriques:
- Décadence [32]
- Impérialisme [321]
Le rejet de la notion de décadence conduit à la démobilisation du prolétariat face à la guerre (1ère partie)
- 3181 reads
Polémique avec Programme Communiste sur la guerre impérialiste
Dans les numéros 90, 91 et 92 de la revue Programme Communiste publiée par le Parti Communiste International (PCI), qui édite aussi les journaux Il Communista en langue italienne et Le Prolétaire en langue française) [1] [1536], on trouve une longue étude sur « La guerre impérialiste dans le cycle bourgeois et dans l'analyse marxiste », qui fait le point des conceptions de cette organisation sur une question de première importance pour le mouvement ouvrier. Les positions politiques fondamentales qui y sont affirmées constituent une défense claire des principes prolétariens face à tous les mensonges véhiculés par les différents agents de la classe dominante. Cependant, certains des développements théoriques sur lesquels ces principes sont fondés, et les prévisions qui en découlent, ne sont pas toujours à la hauteur des affirmations principielles et risquent d'affaiblir ces dernières plutôt que de les renforcer. Cet article se propose de soumettre à la critique ces conceptions théoriques erronées afin de dégager les bases les plus solides possibles à la défense de l'internationalisme prolétarien.
Le CCI, contrairement à d'autres organisations qui se réclament comme lui de la Gauche communiste (notamment, les différents PCI appartenant au courant « bordiguiste »), a toujours établi une distinction claire entre les formations qui se trouvent dans le camp prolétarien et celles qui se trouvent dans le camp bourgeois (commes les différents représentants du courant trotskyste, par exemple). Avec ces dernières, il ne saurait être question d'un quelconque débat politique : la responsabilité des révolutionnaires est de les dénoncer comme des instruments de la classe dominante destinés, grâce à leur langage «ouvrier» ou « révolutionnaire», à dévoyer le prolétariat de son terrain de classe afin de le soumettre pieds et poings liés aux intérêts du capital. En revanche, entre les organisations du camp prolétarien, le débat politique n'est pas seulement une possibilité, mais un devoir. Ce débat n'a rien à voir avec un échange d'idées tel qu'on peut le rencontrer dans les séminaires universitaires, c'est un combat pour la défense de la clarté des positions communistes. En ce sens, il peut prendre les formes d'une vive polémique, justement parce que les questions concernées sont de la première importance pour le mouvement de la classe et que chaque communiste sait bien qu'une petite erreur théorique ou politique peut avoir des conséquences dramatiques pour le prolétariat. Cependant, même dans les polémiques, il est nécessaire de savoir reconnaître ce qui est correct dans les positions de l'organisation qu'on critique.
Une défense ferme des positions de classe
Le PCI (Il Communista) se revendique de la tradition de la Gauche communiste italienne, c'est-à-dire un des courants internationaux qui a maintenu des positions de classe lors de la dégénérescence de 1’Internationale communiste au cours des années 1920. Dans l'article publié par Programme communiste (PC) on peut constater que, sur toute une série de questions essentielles, cette organisation n'a pas perdu de vue les positions de ce courant. En particulier, cet article contient une réaffirmation claire de ce qui fonde la position des communistes face à la guerre impérialiste. La dénonciation de celle-ci n'a rien à voir avec celle des pacifistes ou des anarchistes :
« Le marxisme est complétement étranger aux formules vides et abstraites qui font de "l'anti-bellicisme" un principe supra-historique et qui voient de façon métaphysique dans les guerres le Mal absolu. Notre attitude se fonde sur une analyse historique et dialectique des crises guerrières en liaison avec la naissance, le développement et la mort des formes sociales.
Nous distinguons donc :
a) les guerres de progrés (ou de développe-ment) bourgeois dans l'aire européenne de 1792 à 1871
b) les guerres impérialistes, caractérisées par le choc réciproque entre nations au capitalisme ultra-développé...
c) les guerres révolutionnaires prolétariennes. » (PC n° 90, p. 19)
« L'orientation fondamentale est de prendre position pour les guerres qui poussent en avant le développement général de la société et contre les guerres qui y font obstacle ou qui le retardent. En conséquence, nous sommes pour le sabotage des guerres impérialistes, non parce qu'elles sont plus cruelles et plus épouvantables que les précédentes, mais parce qu'elles se mettent en travers du devenir historique de l'humanité ; parce que la bourgeoisie impérialiste et le capitalisme mondial ne jouent plus aucun rôle "progressiste", mais sont devenus au contraire un obstacle au développement général de la société... » (PC n° 90, p. 22)
Le CCI pourrait signer des deux mains ces phrases qui rejoignent ce que nous avons écrit à de multiples reprises dans notre presse territoriale et dans cette revue. [2] [1537]
De même, la dénonciation du pacifisme que fait le PCI est particulièrement claire et percutante :
« ... le capitalisme n'est pas "victime" de la guerre provoquée par tel ou tel énerguméne, ou par des "esprits malins" reliquats d'époques barbares contre lesquels il faudrait périodiquement se défendre. (...) le pacifisme bourgeois doit nécessairement déboucher dans le bellicisme. Le rêve idyllique d'un capitalisme pacifique n'est en effet pas innocent. C'est un rêve tâché de sang. Si l'on admet que capitalisme et paix peuvent aller ensemble de façon non contingente et momentanée, mais de façon permanente, on est obligé, quand montent les cris de guerre, de reconnaître que quelque chose d'étranger à la civilisation menace le développement pacifique, humanitaire du capitalisme; et que celui-ci doit donc se défendre, y compris avec les armes si les autres moyens ne suffisent pas en regroupant autour de lui les hommes de bonne volonté et les "amoureux de la paix". Le pacifisme accomplit alors sa pirouette finale et se convertit en bellicisme, en facteur actif et agent direct de la mobilisation guerrière. Il s'agit donc d'un processus obligé, qui dérive de la dynamique interne du pacifisme. Celui-ci tend naturellement à se transformer en bellicisme... » (PC n° 90, p. 22)
De cette analyse du pacifisme, le PCI fait découler une orientation juste par rapport aux prétendus mouvements anti-guerre qu'on voir périodiquement fleurir à 1’heure actuelle. Avec le PCI, nous considérons évidemment qu'il peut exister un anti-militarisme de classe (comme celui qui s'est manifesté au cours de la première guerre mondiale et qui a abouti à la révolution en Russie et en Allemagne). Mais cet anti-militarisme ne peut se développer à partir des mobilisations orchestrées par toutes les bonnes âmes de la bourgeoisie :
« Par rapport aux "mouvements pour la paix" actuels, notre consigne 'positive' est celle d'une intervention de l'extérieur à caractére de propagande et de prosélytisme en direction des éléments prolétariens capturés par le pacifisme et englobés dans les mobilisations petites-bourgeoises afin de les arracher à ce genre d'encadrement et d'action politique. nous disons en particulier à ces éléments que ce n'est pas dans les parades pacifistes d'aujourd'hui que se prépare l'antimilitarisme de demain, mais dans la lutte intransigeante de défense des conditions de vie et de travail des prolétaires en rupture avec les intérêts de l'entreprise et de l'économie nationale. Comme la discipline du travail et la défense de l'économie nationale préparent la discipline des tranchées et la défense de la patrie, le refus aujourd'hui de défendre et respecter les intérêts de l'entreprise et de l'économie nationale préparent l'antimilitarisme et le défaitisme de demain. » (PC n° 92, p. 61) Comme nous le verrons plus loin, le défaitisme n'est plus un mot d'ordre adapté à la situation présente ou à venir. Cependant, nous tenons à souligner toute la validité de cette démarche.
Enfin, l'article de PC est très clair également en ce qui concerne le rôle de la démocratie bourgeoise dans la préparation et la conduite de la guerre impérialiste :
« ... dans "nos" Etats civilisés, le capitalisme règne grâce à la démocratie (..) lorsque le capitalisme pousse sur le devant de la scène canons et généraux, il le fait en s'appuyant sur la démocratie, ses mécanismes et ses rites hypnotiques » (PC n°91, p. 38) « L'existence d'un régime démocratique permet à l'Etat une plus grande efficacité militaire car il permet de potentialiser au maximum tant la préparation de la guerre que la capacité de résistance du pays en guerre. » (Ibid.)
« ... le fascisme ne peut faire appel pratiquement qu'au sentiment national, poussé jusqu'à l'hystérie raciste, pour cimenter "l'Union nationale" alors que la démocratie possède une ressource encore plus puissante pour souder l'ensemble de la population à la guerre impérialiste : le fait que la guerre émane directement de la volonté populaire librement exprimée lors des élections, et qu'elle apparaît ainsi, grâce à la mystification des consultations électorales, comme une guerre de défense des intérêts et des espérances des masses populaires et des classes laborieuses en particulier.» (PC n°91, p. 41)
Nous avons reproduit ces longues citations de Programme Communiste (et nous aurions pu en donner d'autres, notamment concernant les illustrations historiques des thèses présentées) parce qu'elles représentent exactement notre position sur les questions concernées. Plutôt que de réaffirmer avec nos propres mots nos principes concernant la guerre impérialiste, il nous a paru utile de mettre en évidence la profonde unité de vues qui existe sur cette question au sein de la Gauche communiste, unité de vues qui constitue notre patrimoine commun.
Cependant, autant il convient de souligner cette unité principielle, autant il est du devoir des révolutionnaires de mettre en évidence les inconséquences et incohérences théoriques du courant « bordiguiste » qui affaiblissent considérablement sa capacité de donner une boussole efficace au prolétariat. Et la première de ces inconséquences réside dans le refus de ce courant de reconnaître la décadence du mode de production capitaliste.
La « non-décadence » à la manière bordiguiste
La reconnaissance que, depuis le début du siécle, et particulièrement depuis la première guerre mondiale, la société capitaliste est entrée dans sa phase de décadence constitue une des pierres angulaires de la perspective du mouvement communiste. Au cours du premier holocauste impérialiste, des révolutionnaires comme Lénine, pour appuyer la nécessité pour le prolétariat de rejeter toute participation à celui-ci, de « transformer la guerre impérialiste en guerre civile », se basent sur une telle analyse (voir en particulier L'impérialisme, stade suprême du capitalisme). De même, l'entrée du capitalisme dans sa période de décadence est au cceur des positions politiques de 1`Internationale communiste lors de sa fondation en 1919. C'est justement parce que le capitalisme est devenu un système décadent qu'il ne saurait plus être question de lutter en son sein pour obtenir des réformes, comme le préconisaient les partis ouvriers de la 2e Internationale, mais que la seule tâche historique que puisse se donner le prolétariat est de réaliser la révolution mondiale. C'est en particulier sur cette base de granit que, par la suite, la Gauche communiste internationale et, notamment, sa fraction italienne, a pu élaborer l'ensemble de ses positions politiques. [3] [1538]
Cependant, c'est « l'originalité » de Bordiga et du courant dont il a été l'inspirateur que de nier que le capitalisme soit entré dans sa période de décadence [4] [1539]. Et pourtant, le courant bordiguiste, notamment le PCI (Il Comunista) est bien obligé de reconnaître que quelque chose a changé au début de ce siècle, tant dans la nature des crises économiques que dans celle de la guerre.
Sur la nature de la guerre, les citations de PC que nous avons reproduites plus haut parlent d'elles-mêmes: il existe effectivement une différence fondamentale entre les guerres que pouvaient mener les Etats capitalistes au siècle dernier et celles de ce siècle. Par exemple, 6 décennies séparent les guerres napoléoniennes contre la Prusse de la guerre franco-allemande de 1870, alors que cette dernière n'est distante que de 4 décennies de celle de 1914. Cependant, la guerre de 1914 entre la France et l'Allemagne est fondamentalement différente de toutes les précédentes entre ces deux nations: c'est pour cela que Marx pouvait appeler les ouvriers allemands à participer à la guerre de 1870 (voir le premier manifeste du Conseil Général de l’AIT sur la guerre franco-allemande) tout en se situant parfaitement sur un terrain de classe prolétarien, alors que les socio-démocrates allemands qui appelaient ces mêmes ouvriers à la « défense nationale » en 1914 se situaient résolument sur le terrain bourgeois. C'est exactement ce que les révolutionnaires comme Lénine et Rosa Luxemburg ont défendu bec et ongle à cette époque contre les socio-chauvins qui prétendaient s'inspirer de la position de Marx en 1870 : cette position n'avait plus cours parce que la guerre avait changé de nature, et ce changement résultait lui-même d'un changement fondamental dans la vie de l'ensemble du mode de production capitaliste.
Programme Communiste, d'ailleurs, ne dit pas autre chose lorsqu'il affirme (comme on l'a vu plus haut) que les guerres impérialistes « se mettent en travers du devenir historique de l'humanité ; parce que la bourgeoisie impérialiste et le capitalisme mondial ne jouent plus aucun rôle 'progressiste'; mais sont devenus au contraire un obstacle au développement général de la société ». De même, reprenant une citation de Bordiga, il considére que «Les guerres impérialistes mondiales démontrent que la crise de désagrégation du capitalisme est inévitable en raison de l'ouverture de la période oú son expansion n'exalte plus l'augmentation des forces productives, mais en fait dépendre l'accumulation d'une destruction encore plus grande » (PC n°90, p.25). Cependant, enfermé dans les vieux dogmes bordiguistes, le PCI est incapable d'en tirer la conséquence logique du point de vue du matérialisme historique : le fait que le capitalisme mondial soit devenu un obstacle au développement général de la société signifie tout simplement que ce mode de production est entré dans sa période de décadence. Lorsque Lénine ou Rosa Luxemburg faisaient ce constat en 1914, ils ne tiraient pas une telle idée de leur chapeau : ils ne faisaient qu'appliquer scrupuleusement la théorie marxiste à la compréhension des faits historiques de leur époque. Le PCI, comme l'ensemble des autres « PCI » appartenant au courant « bordiguiste », se réclame du marxisme. C'est une très bonne chose : aujourd'hui, seules des organisations basant leurs positions programmatiques sur les enseignements du marxisme peuvent prétendre défendre la perspective révolutionnaire du prolétariat. Malheureusement, le PCI nous administre la preuve qu'il a du mal à comprendre cette méthode. En particulier, il aime employer abondamment le terme « dialectique », mais il nous prouve que, à l'image de l'ignorant qui veut donner le change en employant des mots savants, il ne sait pas de quoi il parle.
Par exemple, concernant la nature des crises, voici ce que l'on peut lire dans PC :
« Les crises décennales du jeune capitalisme n'eurent que des incidences tout à fait mineures ; elles avaient plus le caractére de crises du commerce international que de la machine industrielle. Elles n'entamaient pas les potentialités de la structure industrielle (...). C'était des crises de chômage, c'est-à-dire de fermeture, d'arrêt des industries. Les crises modernes sont des crises de désagrégation de tout le système, qui doit ensuite péniblement reconstruire ses différentes structures » (PC n° 90, p. 28). Suit toute une série de statistiques qui démontrent l'ampleur considérable des crises du 20e siècle, sans commune mesure avec celles du siècle dernier. Ici, en ne percevant pas que cette différence d'ampleur entre ces deux types de crises est révélateur non seulement d'une différence fondamentale entre elles, mais aussi dans le mode de vie du systéme qu'elles affectent, le PCI s'assoie royalement sur un des éléments de base de la dialectique marxiste : la transformation de la quantité en qualité. En effet, pour le PCI, la différence entre les deux types de crises reste du domaine du quantitatif et ne concerne pas les mécanismes fondamentaux. C'est ce qu'il révéle en écrivant : «Au siècle dernier on enregistra huit crises mondiales: 1836, 1848, 1856, 1883, 1886 et 1894. La durée moyenne du cycle selon les travaux de Marx était de 10 ans. A ce rythme 'juvénile" fait suite, dans la période qui va du début du siècle à l'éclatement du second conflit mondial, une succession plus rapide des crises: 1901, 1908, 1914, 1920, 1929. A un capitalisme démesurément accru correspond une augmentation de la composition organique (..) ce qui conduit à une croissance du taux d'accumulation : la durée moyenne du cycle se réduit pour cette raison à 7 ans. » (PC n° 90, p. 27). Cette arithmétique sur la durée des cycles fait la preuve que le PCI met sur le même plan les convulsions économiques du siècle dernier et celles de ce siècle, sans comprendre que la nature même de la notion de cycle a changé fondamentalement. Aveuglé par sa fidélité à la parole divine de Bordiga, le PCI ne voit pas que, suivant les mots de Trotsky, les crises du 19e siècle étaient les battements de coeur du capitalisme alors que celles du 20e siécle sont les râles de son agonie.
C'est le même aveuglement que manifeste le PCI lorsqu'il essaie de mettre en évidence le lien entre crise et guerre. De façon très argumentée et systématique, faute d'être rigoureuse (nous y reviendrons plus loin), PC tente d'établir que, dans la période actuelle, la crise capitaliste débouche nécessairement sur la guerre mondiale. C'est une préoccupation tout à fait louable puisqu'elle a le mérite de vouloir réfuter les discours illusoires et criminels du pacifisme. Cependant, il ne vient pas à l'idée de PC de se demander si le fait que les crises du 19e siècle ne débouchaient pas, pour leur part, sur la guerre mondiale, ou même sur des guerres localisées, ne provient pas d'une différence de fond avec celles du 20e siècle. Là encore, le PCI fait preuve d'un «marxisme» bien pauvre : il ne s'agit même plus d'une incompréhension de ce que veut dire le mot dialectique, il s'agit d'un refus, ou au moins d'une incapacité, d'examiner en profondeur, au-delà d'une fixation sur d'apparentes analogies pouvant exister entre des cycles économiques du passé et d'aujourd'hui, les phénomènes majeurs, déterminants, de la vie du mode de production capitaliste.
Ainsi, le PCI se montre incapable, à propos d'une question aussi essentielle que celle de la guerre impérialiste, d'appliquer de façon satisfaisante la théorie marxiste en comprenant la différence fondamentale qui existe entre la phase ascendante du capitalisme et sa phase de décadence. Et la concrétisation navrante de cette incapacité réside dans le fait que le PCI essaye d'attribuer aux guerres de la période actuelle une rationalité économique similaire à celle que pouvaient avoir les guerres au siècle dernier.
Rationalité et irrationalité de la guerre
Notre Revue internationale a déjà publié de nombreux articles sur la question de l'irrationalité de la guerre dans la période de décadence du capitalisme [5] [1540]. Notre position n'a rien à voir avec une «découverte originale » de notre organisation. Elle est basée sur les acquis fondamentaux du marxisme depuis le début du 20e siècle, notamment exprimés par Lénine et Rosa Luxemburg. Ces acquis ont été formulés avec une très grande clarté en 1945 par la Gauche communiste de France contre la théorie révisionniste développée par Vercesi à la veille de la Seconde Guerre mondiale, théorie qui avait conduit son organisation, la Fraction italienne de la Gauche communiste, à une paralysie totale lors de l'éclatement du conflit impérialiste :
« A l'époque du capitalisme ascendant, les guerres (...) exprimèrent la marche ascendante de fermentation, d'élargissement et de l'expansion du système économique capitaliste. (...) Chaque guerre se justifiait et payait ses frais en ouvrant un nouveau champ d'une plus grande expansion, assurant le développement d'une plus grande production capitaliste. (...) La guerre fut le moyen indispensable au capitalisme lui ouvrant des possibilités de développement ultérieur, à l'époque ou ces possibilités existaient et ne pouvaient être ouvertes que par le moyen de la violence. De même le croulement du monde capitaliste ayant épuisé historiquement toutes les possibilités de développement, trouve dans la guerre moderne, la guerre impérialiste, l'expression de ce croulement, qui, sans ouvrir aucune possibilité de dévelopement ultérieur pour la production, ne fait qu'engouffrer dans l'abîme les forces productives et accumuler à un rythme accéléré ruines sur ruines. » (Rapport sur la situation internationale à la Conférence de juillet 1945 de la GCF; republié par la Revue Internationale n° 59.)
Cette distinction entre les guerres du siècle dernier et celles de ce siècle, PC la fait également, comme on l'a vu. Cependant, il n'en tire pas les conséquences et, après avoir fait un pas dans la bonne direction, il en fait deux en sens inverse en cherchant une rationalité économique aux guerres impérialistes qui dominent le 20e siècle.
Cette rationalité, « la démonstration des raisons économiques fondamentales qui poussent tous les Etats à la guerre » (PC n° 92, p. 54), PC essaye de la trouver dans des citations de Marx : « une destruction périodique de capital est devenue une condition nécessaire à l'existence d'un quelconque taux d'intérêt courant (...) Considéré de ce point de vue, ces horribles calamités que nous sommes habitués à attendre avec tant d'inquiétude et d'appréhension (...) ne sont probablement que le correctif naturel et nécessaire d'une opulence excessive et exagérée, la 'vis medicatrix' grâce à laquelle notre système social tel qu'il est actuellement configuré, a la possibilité de se libérer de temps à autre d'une pléthore toujours renaissante qui en menace l'existence, et de revenir à un état sain et solide » (Grundrisse). En réalité, la destruction de capital que Marx évoque ici est celle provoquée par les crises cycliques de son époque (et non par la guerre) à un moment, justement, où ces crises constituent les battements de coeur du système capitaliste (même si elles posent déjà en perspective les limitations historiques de ce système). En de nombreux endroits de son oeuvre, Marx démontre que la façon dont le capitalisme surmonte ses crises réside non seulement dans une destruction (ou plutôt une dévalorisation) du capital momentanément excédentaire mais aussi, et surtout, dans la conquête de nouveaux marchés, particulièrement à l'extérieur de la sphére des rapports de production capitalistes [6] [1541]. Et puisque le marché mondial n'est pas extensible indéfiniment, puisque les secteurs extra-capitalistes ne peuvent que se rétrécir jusqu'à disparaître complètement à mesure que le capital soumet la planète à ses lois, le capitalisme est condamné à des convulsions de plus en plus catastrophiques.
C'est une idée qui sera développée de façon beaucoup plus systématique par Rosa Luxemburg dans L'accumulation du capital mais qu'elle n'a nullement inventée, comme le prétendent certains ignorants. Une telle idée apparaît d'ailleurs en filligrane dans certains passages du texte de PC mais, lorsque que celui-ci fait référence à Rosa Luxemburg, ce n'est pas pour s'appuyer sur ses remarquables développements théoriques qui expliquent avec la plus grande clarté les mécanismes des crises du capitalisme et particulièrement pourquoi les lois de ce système le condamnent historiquement, c'est pour reprendre à son compte la seule idée vraiment contestable qu'on puisse trouver dans L'accumulation du capital, la thèse suivant laquelle le militarisme pourrait constituer un « champ d'accumulation » soulageant partiellement le capitalisme de ses contradictions économiques (voir PC n° 91 pages 31 à 33). C'est malheureusement dans une telle idée que s'était justement fourvoyé Vercesi, à la fin des années 1930, ce qui l’a conduit à penser que le formidable développement de la production d'armements à partir de 1933, en permettant une relance de la production capitaliste, éloignait d'autant la perspective d'une guerre mondiale. En revanche, lorsque PC veut donner une explication systématique du mécanisme de la crise, afin de mettre en évidence le lien existant entre celle-ci et la guerre impérialiste, il adopte une vision unilatérale basée de façon prépondérante sur la thése de la baisse tendancielle du taux de profit:
« Depuis que le mode de production bourgeois est devenu dominant, la guerre est liée de façon déterministe à la loi établie par Marx de la baisse du taux de profit moyen, qui est la clé de la tendance du capitalisme à la catastrophe finale » (PC n° 90, p. 23). Suit un résumé, que PC emprunte à Bordiga (Dialogue avec Staline), de la thèse de Marx suivant laquelle l'élévation constante, dans la valeur des marchandises (du fait des progrès constants des techniques productives), de ce qui revient aux machines et aux matières premières par rapport à ce qui revient au travail des salariés, conduit à une tendance historique à la baisse du taux de profit, dans la mesure où seul le travail de l'ouvrier est en mesure de produire un profit (de produire plus de valeur qu'il ne coùte).
Il faut signaler que, dans son analyse, PC (et Bordiga qu'il cite abondamment) n'ignore pas la question des marchés et le fait que la guerre impérialiste est la conséquence de la concurrence entre Etats capitalistes :
« La progression géométrique de la production impose à chaque capitalisme national d'exporter, de conquérir sur les marchés extérieurs des débouchés adéquats pour leur production. Et comme chaque pôle national d'accumulation est soumis à la même règle, la guerre entre Etats capitalistes est inévitable. De la guerre économique et commerciale, des conflits financiers, des disputes pour les matières premières, des affrontements politiques et diplomatiques qui en découlent, on en arrive finalement à la guerre ouverte. Le conflit latent entre Etats éclate d'abord sous la forme de conflits militaires limités à certaines zones géographiques, de guerres localisées où les grandes puissances ne s'affrontent pas directement, mais par personnes interposées ; mais il débouche finalement sur une guerre généralisée, caractérisée par le choc direct des grands monstres étatiques de l'impérialisme, lancés les uns contre les autres par la violence de leurs contradictions internes. Et tous les Etats mineurs sont entraînés dans le conflit, dont le théatre s'étend nécessairement à toute la planète. Accumulation-Crises-Guerres locales-Guerre mondiale. » (PC n° 90, p. 24)
On ne peut que souscrire à cette analyse, qui recoupe en fait ce que les marxistes ont mis en avant depuis la première guerre mondiale. Cependant, là où le bât blesse, c'est que la recherche des marchés extérieurs ne soit vue par PC que comme conséquence de la baisse tendancielle du taux de profit, alors que, au-delà même de cet aspect des choses, le capitalisme comme un tout a un besoin permanent de marchés en dehors de sa propre sphére de domination, comme l'a magistralement démontré Rosa Luxemburg, pour pouvoir réaliser la part de plus-value destinée à être réinvestie dans un cycle ultérieur par le capital en vue de son accumulation. A partir de cette vision unilatérale, PC attribue à la guerre impérialiste mondiale une fonction économique précise, lui conférant une véritable rationalité dans le fonctionnement du capitalisme :
« La crise tire son origine de l'impossibilité de poursuivre l'accumulation, impossibilité qui se manifeste quand l'accroissement de la masse de production ne réussit plus à compenser la chute du taux de profit. La masse du surtravail total n'est plus à même d'assurer du profit au capital avancé, de reproduire les conditions de rentabilité des investissements. En détruisant du capital constant (travail mort) à grande échelle, la guerre joue alors un rôle économique fondamental: grâce aux épouvantables destructions de l'appareil productif, elle permet en effet une future expansion gigantesque de la production pour remplacer ce qui a été détruit, donc une expansion parallèle du profit, de la plus-value totale, c'est-à-dire du surtravail dont est friand le capital. Les conditions de reprise du processus d'accumulation sont rétablies. Le cycle économique repart. (...) Le système capitaliste mondial, entre vieux dans la guerre, mais y trouve un bain de jouvence dans le bain de sang qui lui donne une nouvelle jeunesse et il en ressort avec la vitalité d'un robuste nouveau-né. »(PC n' 90, p. 24)
La thèse de PC n'est pas nouvelle. Elle a été mise en avant et systématisée par Grossmann dans les années 1920 et reprise après lui par Mattick, un des théoriciens du mouvement conseilliste. Elle peut se résumer de façon trés simple dans les termes suivants : en détruisant du capital constant, la guerre fait baisser la composition organique du capital et permet, de ce fait, un redressement du taux de profit. Le hic, c'est qu'il n'a jamais été prouvé que lors des reprises qui ont suivi les guerres mondiales, la composition organique du capital ait été inférieure à ce qu'elle était à leur veille. C'est bien du contraire qu'il s'agit. Si l'on prend le cas de la seconde guerre mondiale, par exemple, il est clair que, dans les pays affectés par les destructions de la guerre, la productivité moyenne du travail et donc le rapport entre le capital constant et le capital variable a très rapidement rejoint, dès le début des années 1950, ce qu'ils étaient en 1939. En fait, le potentiel productif qui est reconstitué est considérablement plus moderne que celui qui avait été détruit. C'est d'ailleurs ce que PC constate lui-même pour en faire justement une des causes du boom d'après guerre (!) : «L'économie de guerre transmet en outre au capitalisme tant les progrès technologiques et scientifiques réalisés par les industries militaires que les implantations industrielles créées pour la production d'armements. Celles-ci ne furent en effet pas toutes détruites par les bombardements, ni - dans le cas allemand - par le démantèlement réalisé par les alliés. (...) La destruction à grande échelle d'équipements, d'intallations, de bâtiments, de moyens de transport, etc., et la réallocation des moyens de production à haute composition technologique venus de l'industrie de guerre... tout cela crée le miracle. » (PC n° 92, p. 38).
Quant aux Etats-Unis, en l'absence de destructions sur leur propre sol, la composition organique de leur capital était bien supérieure en 1945 à ce qu'elle était 6 ans auparavant. Pourtant, la période de « prospérité » qui accompagne la reconstruction se prolonge bien au-delà (en fait jusqu'au milieu des années 1960) du moment où le potentiel productif d'avant-guerre a été reconstitué, faisant retrouver à la composition organique sa valeur précédente. [7] [1542]
Ayant déjà consacré de nombreux textes à la critique des conceptions de Grossmaan-Mattick auxquelles PC, à la suite de Bordiga, se rattache, nous ne la reprendrons pas ici. En revanche, il est important de signaler les aberrations théoriques (et aberrations tout court) auxquelles les conceptions de Bordiga, reprises par le PCI, conduisent.
Les aberrations de la vision du PCI
La préoccupation centrale du PCI est tout à fait correcte : démontrer le caractère inéluctable de la guerre. En particulier, il veut rejeter fermement la vision du « super impérialisme » développée notamment par Kautsky lors de la première guerre mondiale et destinée à « démontrer » que les grandes puissances pourraient se mettre d'accord entre elles afin d'établir une domination en commun et pacifique sur le monde. Une telle conception était évidemment un des fers de lance des mensonges pacifistes, voulant faire croire aux ouvriers qu'on pourrait mettre fin aux guerres sans avoir besoin de détruire le capitalisme. Pour répondre à une telle vision, PC donne l'argument suivant :
« Un super-impérialisme est impossible ; si par extraordinaire l'impérialisme réussissait à supprimer les conflits entre Etats, ses contradictions internes le contraindraient à se diviser de nouveau en pôles nationaux d'accumulation concurrents et donc en blocs étatiques en confit. La nécessité de détruire d'énormes masses de travail mort ne peut en effet être satisfaite par les seules catastrophes naturelles. » (PC n'90, p. 26)
En somme, la fonction fondamentale des blocs impérialistes, ou de la tendance vers leur constitution, est de créer les conditions permettant des destructions à grande échelle. Avec une telle vision, on ne voit pas pourquoi les Etats capitalistes ne pourraient pas justement s'entendre entre eux afin de provoquer, lorsque nécessaire, de telles destructions permettant une relance du taux de profit et de la production. Ils disposent de suffisamment de moyens pour opérer de telles destructions tout en gardant un contrôle sur elles afin qu'elles préservent aux mieux leurs intérêts respectifs. Ce que PC se refuse à prendre en considération, c'est que la division en blocs impérialistes est le résultat logique de la concurrence à mort que se livrent les différents secteurs nationaux du capitalisme, une concurrence qui fait partie de l'essence même de ce système et qui s'exacerbe lorsque la crise le frappe avec toute sa violence. En ce sens, la constitution de blocs impérialistes ne résulte nullement d'une sorte de tendance, encore inachevée, vers l'unification des Etats capitalistes mais, bien au contraire, de la nécessité où ils se trouvent de former des alliances militaires dans la mesure où aucun d'entre eux ne pourrait faire la guerre à tous les autres. Le plus important dans l'existence des blocs n'est pas la convergence d'intérêts pouvant exister entre les Etats alliés (convergence qui peut être remise en cause comme le démontrent tous les retournements d'alliance qu'on a vus au cours du 20e siécle), mais bien l'antagonisme fondamental entre les blocs, expression au plus haut niveau des rivalités insurmontables existant entre tous les secteurs nationaux du capital. C'est pour cela que l'idée d'un « super-impérialisme » est un non sens dans les termes.
Par l'utilisation d'arguments faibles ou contestables, le rejet par le PCI de l'idée du « super-impérialisme » perd considérablement de sa force, ce qui n'est pas le meilleur moyen de combattre les mensonges de la bourgeoisie. C'est particulièrement évident lorsque, à la suite du passage cité plus haut, il enchaîne ainsi : «Ce sont des volontés humaines, des masses humaines qui doivent faire les choses, des masses humaines dressées les unes contre les autres, des énergies et des intelligences tendues pour détruire ce que défendent d'autres énergies et d'autres intelligences ». Ici, on constate toute la faiblesse de la thèse du PCI : franchement, avec les moyens dont disposent aujourd'hui les Etats capitalistes, et particulièrement l'arme nucléaire, en quoi les « volontés humaines » et surtout « les masses humaines » sont-elles indispensables pour provoquer un degré suffisant de destruction, si telle est la fonction économique de la guerre impérialiste aux dires du PCI.
En fin de compte, le courant « bordiguiste » ne pouvait que payer par de graves dérives théoriques et politiques la faiblesse des analyses sur lesquelles il fonde sa position sur la guerre et les blocs impérialistes. C'est ainsi que, ayant expulsé par la porte la notion d'un super-impérialisme, il le laisse revenir par la fenêtre avec sa notion d'un « condominium russo-américain » sur le monde :
« La seconde guerre mondiale a donné naissance à un équilibre correctement décrit par la formule du "condominium russo-américain" (..) si la paix a régné jusqu'ici dans les métropoles impérialistes, c'est précisément en raison de cette domination des USA et de l'URSS... » (PC n° 91, p. 47)
« En réalité, la "guerre froide" des années cinquante exprimait l'insolente sûreté des deux vainqueurs du conflit et la stabilité des équilibres mondiaux sanctionnés à Yalta ; elle répondait dans ce cadre à des exigences de mobilisation idéologique et de maîtrise des tensions sociales existant à l'intérieur des blocs. La nouvelle "guerre froide" qui prend la place de la détente dans la deuxième moitié des années 70 répond à une exigence de maîtrise d'antagonismes non plus (ou pas encore) entre les classes, mais entre Etats qui ont de plus en plus de mal à supporter les vieux systèmes d'alliance. La réponse russe et américaine aux pressions grandissantes consiste à chercher à orienter en direction du camp opposé l'aggressivité impérialiste de leurs alliés. » (PC n° 92, p. 47)
En somme, la première « guerre froide» n'avait d'autre motivation qu'idéologique afin de « maîtriser les antagonismes entre les classes ». C'est vraiment le monde à l'envers: si au lendemain de la première guerre mondiale, nous avions assisté à un réel recul des antagonismes impérialistes et à un recul parallèle de l'économie de guerre, c'est que la bourgeoisie avait comme principale préoccupation de faire face à la vague révolutionnaire commencée en 1917 en Russie, d'établir un front commun contre la menace de l'ennemi commun et mortel de tous les secteurs de la bourgeoisie : le prolétariat mondial. Et si la seconde guerre mondiale a immédiatement débouché sur le développement des antagonismes impérialistes entre ses deux principaux vainqueurs, avec le maintien d'un degré très élevé de l'économie de guerre, c'est justement que la menace que pouvait encore représenter un prolétariat, déjà profondément affecté par la contre-révolution, avait été complétement éradiquée au cours même de la guerre et à son lendemain par une bourgeoisie instruite par sa propre expérience historique (cf. notamment « Les luttes ouvrières en Italie 1943 » dans la Revue Internationale n° 75). En fait, avec la vision de PC, la guerre de Corée, la guerre d'Indochine et plus tard celle du Vietnam, sans compter toutes celles du Moyen-Orient opposant un Etat d’Israël soutenu fermement par les Etats-Unis et des pays Arabes recevant une aide massive de l'URSS (et nous ne parlons pas de dizaines d'autres jusqu'à la guerre en Afghanistan qui s'est prolongée jusqu'à la fin des années 1980) n'avaient rien à voir avec un antagonisme fondamental entre les deux grand monstres impérialistes mais à une sorte de « bluff» correspondant, soit à de simples campagnes idéologiques contre le prolétariat, soit à la nécessité, pour chacun des super-grands, de maintenir l'ordre dans son pré-carré.
D'ailleurs, cette dernière idée est contredite par PC lui-même qui attribue à la « détente » entre les deux blocs, entre la fin des années 1950 et le milieu des années 1970, la même fonction que la guerre froide : «En réalité, la détente ne fut que la réponse des deux superpuissances aux lignes de fracture qui apparaissent toujours plus nettement dans leurs sphères d'influence respectives. Ce qu'elle signifiait, c'était une pression accrue de Moscou et de Washington sur leurs alliés pour contenir leurs poussées centrifuges. » (PC n°92, p. 43)
Il est vrai que les communistes ne doivent jamais prendre pour argent comptant ce que disent la bourgeoisie, ses journalistes et ses historiens. Mais prétendre que derrière la plupart des guerres (plus d'une centaine) qui ont ravagé le monde, depuis 1945 jusqu'à la fin des années 1980, il n'y avait pas la main des grandes puissances, c'est tourner le dos à une réalité observable pour quiconque n'avait pas de crotte dans les yeux, c'est aussi remettre en cause ce que PC affirme lui-même avec beaucoup de justesse : « Le conflit latent entre Etats éclate d'abord sous la forme de conflits militaires limités à certaines zones géographiques, de guerres localisées oú les grandes puissances ne s'affrontent pas directement, mais par personnes interposées » (voir plus haut).
En fait, le PCI peut toujours expliquer par la « dialectique » la contradiction entre ce qu'il raconte et la réalité, ou bien entre ses différents arguments : il nous fait surtout la preuve que la rigueur n'est pas son fort et qu'il lui arrive de raconter n'importe quoi, ce qui n'est pas fait pour combattre efficacement les mensonges bourgeois et renforcer la conscience du prolétariat.
C'est bien de cela dont il est question, et jusqu'à la caricature, lorsque, pour combattre les mensonges du pacifisme, il s'appuie sur un article de Bordiga de 1950 qui fait de l'évolution de la production d'acier l'indice majeur, sinon un des facteurs de l'évolution du capitalisme lui-même: « La guerre à l'époque capitaliste, c'est-à-dire le plus féroce type de guerre, c'est la crise produite inévitablement par la nécessité de consommer l'acier produit, et de lutter pour le droit de monopole de la production supplémentaire d'acier » (« Sa majesté l'acier », Battaglia Comunista n° 18/1950)
Toujours préoccupé par sa volonté d'attribuer une « rationalité » à la guerre, PC en est conduit à laisser entendre que la guerre impérialiste n'est pas seulement une bonne chose pour le capitalisme mais aussi pour l'ensemble de l'humanité, et donc pour le prolétariat, lorsqu'il affirme que : « ... la prolongation de la paix bourgeoise au-delà des limites définies par un cycle économique qui réclame la guerre, même si elle était possible, ne pourrait déboucher que sur des situations pires encore que celle de la guerre ». Suit alors une citation de l'article de Bordiga qui vaut son pesant de cacahuètes (ou d'acier, si l'on veut !) :
« Arrêtons-nous à supposer... qu'au lieu des deux guerres [mondiales]... nous ayons eu la paix bourgeoise, la paix industrielle. En à peu près trente cinq années, la production avait augmenté de 20 fois ; elle serait devenue encore 20 fois plus grande que les 70 millions de 1915, arrivant aujourd'hui [1950-NDLR] à 1400 millions. Mais tout cet acier ne se mange pas, ne se consomme pas, ne se détruit pas sinon en massacrant les peuples. Les deux milliards d'hommes pèsent à peu prés 140 millions de tonnes ; ils produiraient en une seule année dix fois leur propre poids d'acier. Les dieux punirent Midas en le transformant en une masse d'or; le capital transformerait les hommes en une masse d'acier, la terre, l'eau et l'air dans lesquels ils vivent en une prison de métal. La paix bourgeoise a donc des perspectives plus bestiales que la guerre. »
Il s'agit là, bel et bien, d'un délire de Bordiga comme en était affecté malheureusement trop souvent ce révolutionnaire. Mais au lieu de prendre ses distances avec ces divagations, le PCI, au contraire surenchérit :
« Surtout si l'on considére que la terre, transformée en cercueil d'acier, ne serait qu'un lieu de putréfaction où marchandises et hommes en excès se décomposeraient pacifiquement. Voilà, Messieurs les pacifistes, quel pourrait être le fruit du "retour à la raison" des gouvernements, leur conversion à une "culture de paix" ! Mais c'est précisément pourquoi c'est non la Folie, mais la Raison - bien sûr la Raison de la société bourgeoise, qui pousse tous les gouvernements vers la guerre, vers la salutaire et hygiénique guerre. » (PC n° 92, p. 54)
Bordiga, en écrivant les lignes dont se revendique le PCI, tournait le dos à une des bases même de l'analyse marxiste: le capitalisme produit des marchandises, et qui dit marchandise dit possibilité de satisfaire un besoin, aussi perverti soit-il, comme le «besoin» d'instruments de mort et de destruction de la part des Etats capitalistes. S'il produit de l'acier en grandes quantités, c'est effectivement, en bonne partie, pour satisfaire la demande des Etats en armements lourds destinés à faire la guerre. Cependant, cette production ne peut aller bien au-delà de la demande de ces Etats : si les industriels de la sidérurgie n'arrivent plus à vendre leur acier aux militaires, parce que ces derniers en ont déjà consommé en quantité suffisante, ils ne vont pas poursuivre bien longtemps, sous peine de faillite de leur entreprise, une production qui n'arrive plus à se placer: ils ne sont pas fous. Par contre, Bordiga l'est quelque peu lorsqu'il imagine que la production d'acier pourrait se poursuivre indéfiniment sans autre limite que celle imposée par les destructions de la guerre impérialiste.
Il est heureux pour le PCI que le ridicule ne tue pas (et pour sa part, Bordiga n'est pas mort de cela non plus) : c'est avec un grand éclat de rire que les ouvriers risquent d'accueillir ses élucubrations et celles de son inspirateur. En revanche, c'est extrêmement regrettable pour la cause que le PCI s'efforce de défendre : en utilisant des arguments stupides et ridicules contre le pacifisme, il est conduit, involontairement, à faire le jeu de cet ennemi du prolétariat.
A quelque chose malheur est bon, toutefois : par ses arguments délirants pour justifier la « rationalité » de la guerre, le PCI démolit une telle idée. Et ce n'est pas une mauvaise chose lorsque cette idée le conduit à mettre en avant une perspective qui risque de démobiliser le prolétariat en lui faisant sous-estimer les dangers que le capitalisme fait peser sur 1’humanité. C'est une telle idée qui se trouve en particulier résumée dans cette affirmation :
« Il en découle aussi [de la guerre comme manifestation d'une rationalité économique] que la lutte inter-impérialiste et l'affrontement entre puissances rivales ne pourra jamais conduire à la destruction de la planéte, parce qu'il s'agit justement, non d'avidités excessives mais de la nécessité d'échapper à la surproduction. Quand l'excédent est détruit, la machine de guerre s'arrête, quel que soit le potentiel destructif des armes mises en jeu, car disparaissent du même coup les causes de la guerre. » (PC n° 92, p. SS)
Dans la seconde partie de cet article, nous reviendrons sur cette question de la sous-estimation dramatique de la menace de la guerre impérialiste à laquelle conduit l'analyse du PCI, et plus concrétement sur le facteur de démobilisation que représentent pour la classe ouvrière les mots d'ordre de cette organisation.
FM.
[1] [1543] Il est nécessaire de faire cette précision car il existe á l’heure actuelle trois organisations qui se nomment « Parti Communiste International » : deux d'entre elles proviennent de l'ancienne organisation du même nom qui a éclaté en 1982 et qui publiait en italien Il Programma Comunista ; aujourd'hui, ces deux scissions publient respectivement ce même titre et Il Comunista. Le troisième PCI, qui s'est formé à la suite d'une scission plus ancienne, publie pour sa part, Il Partito Comunista.
[2] [1544] Voir en particulier les articles publiés dans la Revue Internationale n° 52 et 53 « Guerre et militarisme dans la décadence ».
[3] [1545] Sur cette question, voir plus particulièrement (parmi de nombeux textes consacrés à la défense de la notion de décadence du capitalisme) notre étude : « Comprendre la décadence du capitalisme » dans la Revue internationale n° 48, 49, 50, 52, 54, 55, 56 et 58. La question du lien entre l'analyse de la décadence et les positions politiques est traitée dans le n° 49.
[4] [1546] Voir « Comprendre la décadence du capitalisme ». La critiques des conceptions de Bordiga est abordée en particulier dans les n° 48, 54 et 55 de la Revue Internationale.
[5] [1547] Voir notamment « La guerre dans le capitalisme » (n° 41) ainsi que «Guerre et militarisme dans la décadence » (n° 52 et 53)
[6] [1548] Voir à ce sujet la brochure sur La décadence du capitalisme ainsi que de nombreux articles dans cette même Revue internationale, notamment dans le n°13 : « Marxisme et théorie des crises» et dans le n° 76 : « Le communisme n'est pas un bel idéal mais une nécessité matérielle».
[7] [1549] Sur l'étude des mécanismes économiques de la reconstruction, voir en particulier les parties V et VI de l'étude « Comprendre la décadence du capitalisme » (Revue internationale n° 55 et 56).
Courants politiques:
- Bordiguisme [1287]
Approfondir:
Questions théoriques:
- Décadence [32]
Heritage de la Gauche Communiste:
Le communisme n'est pas un bel idéal mais une nécessite matérielle [8e partie]
- 4116 reads
1871 : la première révolution prolétarienne
Le communisme : une société sans Etat
Selon la conception populaire erronée que tous les porte-parole de la bourgeoisie, de la presse aux professeurs d'université, reprennent et propagent systématiquement, le communisme serait une société où tout est dirigé par l'Etat. Toute l'identification entre le communisme et les régimes staliniens de l'Est est fondée sur cette présomption.
Et cependant, c'est une totale falsification, un renversement de la réalité. Pour Marx, pour Engels, pour tous les révolutionnaires qui ont suivi leur trace, le communisme signifie une société sans Etat, une société où les être humains dirigent leurs affaires sans qu'une puissance coercitive ne les domine, sans gouvernement, sans armée, sans prisons et sans frontières nationales.
Evidemment, la bourgeoisie du monde entier a une réponse à cette version-là du communisme : « oui, oui, mais ce n'est qu'une utopie, ça ne pourra jamais exister ; la société moderne est bien trop vaste, bien trop complexe ; les êtres humains sont trop peu dignes de confiance, trop violents, trop avides de pouvoir et de privilèges. » Les plus sophistiqués des professeurs (comme J.Talmon, par exemple, auteur du livre Les Origines de la Démocratie Totalitaire) nous expliquent même que la simple tentative de créer une société sans Etat ne peut que mener à la sorte d’Etat-Léviathan monstrueux qui a surgi, sous Staline, en Russie.
Mais voyons : si la vision d'un communisme sans Etat n'est rien de plus qu'une utopie, un vain rêve, pourquoi les maîtres de l'Etat actuel passent-ils tant de temps et d'énergie à répéter le mensonge selon lequel le communisme = le contrôle de l'Etat sur la société ? N'est-ce pas parce que la version authentique du communisme constitue véritablement un défi subversif contre l'ordre existant, et parce qu'elle correspond aux nécessités d'un mouvement réel qui est inévitablement contraint de s'affronter à l'Etat et à la société que celui-ci protège ?
Si le marxisme constitue le point de vue théorique et la méthode de ce mouvement, celui du prolétariat international, il est alors facile de voir pourquoi l'idéologie bourgeoise sous toutes ses formes, même celles qui s'accolent l'étiquette de «marxiste», a toujours cherché à enterrer la théorie marxiste de l'Etat sous l'immense dépotoir de poubelles intellectuelles. Quand il a écrit L'Etat et la Révolution en 1917, Lénine parlait d'«exhumer» la véritable position marxiste des décombres du réformisme. Aujourd'hui, dans le sillage de toutes les campagnes bourgeoises identifiant le capitalisme d'Etat stalinien au communisme, il faut continuer à exhumer. D'où cet article qui est centré sur l'événement considérable, la Commune de Paris,j première révolution prolétarienne de l'histoire, qui a légué à la classe ouvrière les leçons les plus précieuses précisément sur cette question.
La Première Internationale : de nouveau, la lutte politique
En 1864, Marx sortait de plus d'une décennie d'immersion dans un profond travail théorique d'investigation pour revenir au monde de la politique pratique. Dans la décennie qui suivit, il allait orienter l'essentiel de ses énergies sur deux questions politiques par excellence : la formation d'un parti international des travailleurs, et la conquête du pouvoir par le prolétariat.
Après le long reflux de la lutte de classe qui avait eu lieu, à la suite de la défaite des grands soulèvements sociaux de 1848, le prolétariat d'Europe commençait à montrer des signes de réveil de sa conscience et de sa combativité. Le développement de mouvements de grève sur des revendications à la fois économiques et politiques, la formation des syndicats et des coopératives ouvrières, la mobilisation des ouvriers sur des questions de politique « étrangère » telles que le soutien à l'indépendance de la Pologne ou aux forces anti-esclavagistes dans la guerre civile américaine, tout cela a convaincu Marx que la période de défaite touchait à sa fin. C'est pourquoi il apporta son soutien actif à l'initiative des syndicalistes anglais et français de former l'Association Internationale des Travailleurs ([1] [1551]) en septembre 1864. Comme le dit Marx dans le Rapport du Conseil Général de l'Internationale au Congrès de Bruxelles en 1868 : cette Association « n'est fille ni d'une secte, ni d'une théorie. Elle est le produit spontané du mouvement prolétaire, engendré lui-même par les tendances naturelles et irrépressibles de la société moderne ». ([2] [1552]) Ainsi, le fait que les raisons de beaucoup d'éléments qui formèrent l'Internationale, n'aient pas eu grand chose à voir avec les vues de Marx (par exemple, la principale préoccupation des syndicalistes anglais était d'utiliser l'Internationale pour empêcher l'importation de briseurs de grève étrangers), n'a pas empêché ce dernier d'y jouer un rôle prépondérant ; il a siégé au Conseil Général la plus grande partie de l'existence de celui-ci et a rédigé beaucoup de ses documents les plus importants. Comme l'Internationale était le produit d'un mouvement du prolétariat à une certaine étape de son développement historique, une étape où il était encore en train de se former en tant que force au sein de la société bourgeoise, il était à la fois possible et nécessaire pour la fraction marxiste de travailler dans l'Internationale à côté d'autres tendances de la classe ouvrière, de participer à leurs activités immédiates dans le combat quotidien des ouvriers, tout en essayant en même temps de libérer l'organisation des préjugés bourgeois et petit-bourgeois, et de l'imprégner autant que possible de la clarté théorique et politique requises pour agir comme avant-garde révolutionnaire d'une classe révolutionnaire.
Ce n'est pas le lieu ici de faire une histoire de toutes les luttes doctrinaires et pratiques qu'a menées la fraction marxiste dans l'Internationale. Il suffit de dire qu'elles étaient basées sur des principes qui avaient déjà été établis dans Le Manifeste Communiste et renforcés par l'expérience des révolutions de 1848, en particulier :
- « L'émancipation des travailleurs doit être l'oeuvre des travailleurs eux-mêmes » ([3] [1553]), d'où la nécessité d'une organisation « établie par les ouvriers eux-mêmes et pour eux-mêmes » ([4] [1554]), et la rupture avec l'influence des libéraux et des réformistes bourgeois ; bref, travailler à une politique et une action de classe indépendantes pour le prolétariat, même dans une période où les alliances avec des fractions progressistes bourgeoises étaient encore à l'ordre du jour. Au sein de l'Internationale elle-même, la défense de ce principe devait mener à la rupture avec Mazzini et ses disciples nationalistes bourgeois.
- En conséquence, « la classe en ouvrière ne peut agir en tant que classe qu'en se constituant en parti politique, distinct et opposé à tous les partis formés par les classes propriétaires » et que « cette constitution de la classe ouvrière en parti politique est indispensable pour assurer le triomphe de la révolution sociale et son but ultime - l'abolition des classes » ([5] [1555]). Cette défense d'un parti de classe, une organisation internationale et centralisée des prolétaires les plus avancés ([6] [1556]), a été menée contre tous les éléments anarchistes, « anti-autoritaires », fédéralistes, en particulier les disciples de Proudhon et de Bakounine qui pensaient que toute forme de centralisation était par essence despotique et que, de toute façon, I l'Internationale n'avait rien à voir avec la politique, que ce soit dans les phases défensive ou révolutionnaire du mouvement prolétarien. L'Adresse Inaugurale de l'Internationale en 1864 insistait déjà sur le fait que « la conquête du pouvoir politique est donc devenue le premier devoir de la classe ouvrière. » ([7] [1557]) La résolution de 1871 a donc constitué une répétition de ce principe fondamental contre tous ceux qui croyaient que les révolutions sociales pourraient réussir, sans que les ouvriers ne prennent la peine de former un parti politique et de se battre en tant que classe pour le pouvoir politique.
Dans la période qui va de 1864 à 1871, le débat sur l'engagement dans la « politique » était en grande partie lié à la question de savoir si la classe ouvrière devait participer à la sphère de la politique bourgeoise (l'appel au suffrage universel, la participation du parti des ouvriers au parlement, la lutte pour les droits démocratiques, etc.), comme moyen d'obtenir des réformes et de renforcer ses positions au sein de la société capitaliste. Les Bakouninistes et les Blanquistes ([8] [1558]), champions de la toute-puissance de la volonté révolutionnaire, refusaient d'analyser les conditions matérielles objectives dans lesquelles agissait le mouvement ouvrier, et rejetaient de telles tactiques comme des diversions vis-à-vis de la révolution sociale. La fraction matérialiste de Marx, d'un autre côté, analysait que le capitalisme en tant que système global n'avait pas encore achevé sa mission historique, n'avait pas encore créé toutes les conditions de la transformation révolutionnaire de la société, et qu'en conséquence, il était encore nécessaire que la classe ouvrière lutte pour des réformes aux niveaux à la fois économique et politique. Ce faisant, non seulement elle améliorerait sa situation matérielle immédiate, mais elle se préparerait et s'organiserait pour l'épreuve y de force révolutionnaire qui se produirait inévitablement dans la trajectoire historique du capitalisme vers la crise et l'effondrement.
Ce débat devait se poursuivre dans le mouvement ouvrier dans les décennies suivantes, bien que dans des contextes différents et avec des protagonistes très différents. Mais en 1871, les événements considérables en Europe continentale devaient ajouter une toute autre dimension au débat sur l'action politique de la classe ouvrière. Car c'était l'année de la première révolution prolétarienne de l'histoire, la conquête réelle du pouvoir politique par la classe ouvrière l'année de la Commune de Paris.
La Commune et la conception matérialiste de l'histoire
« Tout pas du mouvement réel vaut mieux qu'une dizaine de programmes » ([9] [1559]).
Le drame et la tragédie de la Commune de Paris sont brillamment analysés par Marx dans La guerre civile en France, publié durant l'été 1871 en tant qu'Adresse officielle de l'Internationale. Dans cette diatribe passionnée, Marx montre comment une guerre entre des nations, la France et la Prusse, s'est transformée en une guerre entre les classes : à la suite du désastreux effondrement militaire de la France, le gouvernement de Thiers, établi à Versailles, avait conclu une paix impopulaire et cherché à en imposer les termes à Paris ; cela ne pouvait être fait qu'en désarmant les ouvriers regroupés dans la Garde Nationale. Le 18 mars 1871, des troupes envoyées par Versailles cherchèrent à saisir les canons qui se trouvaient sous le contrôle de la Garde nationale ; ce devait être le prélude d’une répression massive contre la classe ouvrière et ses minorités révolutionnaires. Les ouvriers de Paris répondirent en descendant dans la rue et en fraternisant avec les troupes de Versailles. Les jours qui suivirent, ils proclamèrent la Commune.
Le nom de la Commune de 1871 était l'écho de la Commune révolutionnaire de 1793, organe des sans-culotte durant les phases les plus radicales de la révolution bourgeoise. Mais la seconde Commune avait une signification très différente ; elle n'était pas tournée vers le passé, mais vers le futur, celui de la révolution communiste de la classe ouvrière.
Bien que Marx, durant le siège de Paris, ait mis en garde contre un soulèvement dans des conditions de guerre qui serait une « folie désespérée » ([10] [1560]), lorsque eut lieu le soulèvement, Marx et l'Internationale s'engagèrent et exprimèrent la solidarité la plus inébranlable avec les Communards - parmi lesquels les membres de l'Internationale jouèrent un rôle d'avant-garde, même si quasiment aucun n'était d'obédience «marxiste». Il ne pouvait y avoir d'autre réaction face aux viles calomnies que la bourgeoisie mondiale lança contre la Commune, et à l'horrible revanche que la classe dominante prit sur le prolétariat parisien pour avoir osé défier sa « civilisation » : après le massacre de milliers de combattants sur les barricades, d'autres milliers, hommes, femmes, et enfants, furent exécutés massivement, incarcérés dans les conditions les plus abjectes, déportés comme forçats dans les colonies. Jamais depuis les jours de la Rome antique n'avait été orchestrée une telle orgie sanglante par la classe dominante.
Mais au-delà de la question élémentaire de la solidarité prolétarienne, il y a une autre raison pour laquelle Marx a été amené à reconnaître la signification fondamentale de la Commune. Même si elle était historiquement « prématurée », dans le sens où les conditions matérielles d'une révolution prolétarienne mondiale n'étaient pas encore mûres, la Commune constituait néanmoins un événement d'une portée historique mondiale, une étape cruciale sur le chemin de cette révolution ; elle constituait un trésor de leçons pour le futur, pour la clarification du programme communiste. Avant la Commune, la fraction la plus avancée de la classe, les communistes, avait compris que la classe ouvrière devait prendre le pouvoir politique comme premier pas vers la construction d'une communauté humaine sans classe. Mais la façon précise dont le prolétariat établirait sa dictature, n'avait pas encore été clarifiée car une telle avancée théorique ne pouvait que se baser sur l'expérience vivante de la classe. La Commune de Paris a constitué une telle expérience, peut-être la preuve la plus vivace que le programme communiste n'est pas un dogme fixe et statique, mais qu'il évolue et se développe en lien l étroit avec la pratique de la classe ouvrière ; pas une utopie, mais une grande expérience scientifique dont le laboratoire est le mouvement réel de la société. Il est bien connu qu'Engels fit un point spécifique, dans son introduction ultérieure au Manifeste communiste de 1848, établissant que l'expérience de la Commune avait rendu obsolètes les formulations du texte qui exprimaient l'idée de s'emparer de l'appareil d'Etat existant. Les conclusions que Marx et Engels ont tirées de la Commune, sont, en d'autres termes, une démonstration et une justification de la méthode matérialiste historique. Comme le dit Lénine dans L'Etat et la révolution :
« Il n'y a pas un grain d'utopisme chez Marx ; il n'invente pas, il n'imagine pas de toutes pièces une société "nouvelle". Non, il étudie comme un processus d'histoire naturelle, la naissance de la nouvelle société à partir de l'ancienne, les formes de transition de celle-ci à celle-là. Il prend l'expérience concrète du mouvement prolétarien de masse et s'efforce d'en tirer les leçons pratiques. Il 'se met à l'école' de la Commune, de même que tous les grands penseurs révolutionnaires n'hésitèrent pas à se mettre à l'école des grands mouvements de la classe opprimée... » ([11] [1561])
Notre but n'est pas de refaire l'histoire de la Commune, les principaux événements sont déjà décrits dans La guerre civile en France, ainsi que dans beaucoup d'autres travaux, y compris ceux de révolutionnaires comme Lissagaray qui s'est lui-même battu sur les Joarricades. Ce que nous essaierons de faire f ici, c'est d'examiner exactement ce que Marx ^ja appris de la Commune. Dans un autre article, nous étudierons comment il a défendu ces leçons contre toutes les confusions qui prévalaient dans le mouvement ouvrier de cette époque.
Marx contre l'adoration de l'Etat
« Ce ne fut donc pas une révolution contre telle ou telle forme de pouvoir d'Etat, légitimiste, constitutionnelle, républicaine ou impériale. Ce fut une révolution contre l'Etat lui-même, cet avorton surnaturel de la société ; ce fut la reprise par le peuple et pour le peuple de sa propre vie sociale. » ([12] [1562])
Les conclusions qu'a tirées Marx de la Commune de Paris, n'étaient pas par ailleurs un produit automatique de l'expérience directe des ouvriers. Elles étaient une confirmation et un enrichissement d'un élément de la pensée de Marx qui avait été constant depuis qu'il avait rompu d'abord avec l’hégélianisme pour évoluer vers la cause prolétarienne.
Même avant de devenir clairement communiste, Marx avait déjà commencé à critiquer l'idéalisation hégélienne de l'Etat. Pour Hegel, dont la pensée était faite d'un mélange contradictoire de radicalisme dérivé de la poussée de la révolution bourgeoise et de conservatisme hérité de l'atmosphère étouffante de l'absolutisme prussien, l'Etat, et en cela l'Etat prussien existant, se définissait comme l'incarnation de l'Esprit Absolu, la forme parfaite de l'existence sociale. Dans sa critique de Hegel, Marx montre au contraire que loin d'être le produit supérieur et le plus noble de l'être humain, le sujet rationnel de l'existence sociale, l'Etat, et par dessus tout l'Etat prussien bureaucratique, était un aspect de l'aliénation de l'homme, de sa perte de contrôle sur ses propres pouvoirs sociaux. La pensée d'Hegel était sens dessus dessous : « Hegel part de l'Etat et conçoit l'homme comme Etat subjective ; la démocratie part de l'homme et conçoit l'Etat comme l'homme objectivé. » ([13] [1563])
A ce moment-là, le point de vue de Marx était celui de la démocratie bourgeoise radicale (très radicale en fait puisque, comme nous l'avons déjà démontré, la véritable démocratie mènerait à la disparition de l'Etat), un point de vue qui voyait que l'émancipation de l'humanité relevait d'abord et avant tout de la sphère de la politique. Mais très rapidement, comme il commençait à envisager les choses du point de vue de la perspective prolétarienne, il fut capable de voir que si l'Etat devenait étranger à la société, c'est parce qu'il était le produit d'une société fondée sur la propriété privée et les privilèges de classe. Dans ses écrits sur La loi contre les voleurs de bois, par exemple, il avait commencé à adopter le point de vue selon lequel l'Etat est le gardien de l'inégalité sociale, d'étroits intérêts de classe ; dans La question juive, il avait commencé à reconnaître que la réelle émancipation humaine ne pouvait se restreindre à la dimension politique, mais requérait une forme de vie sociale différente. Ainsi, dès les débuts du communisme de Marx, celui-ci était très préoccupé de démystifier l'Etat et il n'en dévia jamais.
Comme on l'a vu dans les articles sur le Manifeste communiste et les révolutions de 1848 ([14] [1564]), au fur et à mesure que le communisme émergeait en tant que courant avec une organisation et un programme politique définis, il poursuivait dans le même esprit. Le Manifeste communiste, rédigé à la veille des grands soulèvements sociaux de 1848, avait en perspective non seulement la prise du pouvoir politique par le prolétariat, mais l'extinction finale de l'Etat une fois que ses racines, une société divisée en classes, auraient été extirpées et supprimées. Et les expériences réelles des mouvements de 1848 permirent à la minorité révolutionnaire organisée dans la Ligue communiste de beaucoup faire la lumière sur le chemin du prolétariat vers le pouvoir, mettant en évidence la nécessité, dans tout soulèvement révolutionnaire, que la classe ouvrière conserve ses propres armes et ses propres organes de classe, et suggérant même (dans Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte) que la tâche du prolétariat révolutionnaire n'était pas de perfectionner l'appareil d'Etat bourgeois, mais de le détruire.
Aussi la fraction marxiste n'interpréta-t-elle pas l'expérience de la Commune sans patrimoine théorique : les leçons de l'histoire ne sont pas »spontanées« dans le sens où l'avant-garde communiste les développe sur la base d'un cadre d'idées déjà existant. Mais ces idées elles-mêmes doivent être constamment réexaminées et testées à la lumière de l'expérience de la classe ouvrière, et c'est à la gloire des ouvriers parisiens d'avoir offert une preuve convaincante que la classe ouvrière ne peut faire la révolution en s'emparant d'un appareil dont la structure et le mode de fonctionnement mêmes sont adaptés à la perpétuation de l'exploitation et de l'oppression. Si le premier pas de la révolution prolétarienne est la conquête du pouvoir politique, il ne peut avoir lieu sans la destruction violente de l'Etat bourgeois existant.
L'armement des ouvriers
Que la Commune ait surgi de la tentative du gouvernement de Versailles de désarmer les ouvriers est hautement symbolique : cela a démontré que la bourgeoisie ne peut tolérer un prolétariat en armes. A l'inverse, le prolétariat ne peut parvenir au pouvoir que les armes à la main. La classe dominante la plus violente et la plus impitoyable de l'histoire ne permettra jamais d'être évincée du pouvoir par un vote, elle ne peut qu'y être forcée, et la classe ouvrière ne peut défendre sa révolution contre toutes les tentatives de la renverser qu'en se dotant de sa propre force armée. En fait, deux des critiques les plus rigoureuses portées par Marx à la Commune, c'est que celle-ci n'avait pas suffisamment utilisé la force, ayant manifesté une « crainte superstitieuse » face à la Banque de France au lieu de l'occuper et de l'utiliser comme objet de marchandage, et qu'elle n'avait pas lancé d'offensive contre Versailles quand cette dernière manquait encore de ressources pour mener l'attaque contre-révolutionnaire du capital.
Mais, malgré les faiblesses sur ces aspects, la Commune fit une avancée historique décisive lorsque, dans l'un de ses premiers décrets, elle prononça la dissolution de l'armée existante et introduisit l'armement général de la population dans la Garde nationale qui fut effectivement transformée en milice populaire. Ce faisant, la Commune fit le premier pas vers le démantèlement de l'ancien appareil d'Etat, qui trouve son expression par excellence dans l'armée, dans une force armée qui surveille la population, n'obéit qu'aux échelons supérieurs de l'appareil d'Etat et n'est soumise à aucun contrôle d'en bas.
Le démantèlement de la bureaucratie par la démocratie ouvrière
A côté de l'armée, et en fait profondément interdépendante de celle-ci, l'institution qui concrétise le plus clairement l'Etat comme une « excroissance parasitaire » devenue étrangère à la société, est la bureaucratie, ce réseau byzantin de fonctionnaires permanents qui voient quasiment l'Etat comme leur propriété privée. Là aussi, la Commune prit des mesures immédiates pour se libérer de ce parasite. Engels résume ces mesures très succinctement dans son Introduction à La Guerre civile en France :
« Pour éviter cette transformation, inévitable dans tous les régimes antérieurs, de l'Etat et des organes de l'Etat, à l'origine serviteurs de la société en maîtres de celle-ci, la Commune employa deux moyens infaillibles. Premièrement, elle soumit toutes les places, de l'administration, de la justice et de l'enseignement au choix des intéressés par élection au suffrage universel, et, bien entendu, à la révocation à tout moment par ces mêmes intéressés. Et, deuxièmement, elle ne rétribua tous les services, des plus bas aux plus élevés, que par le salaire que recevaient les autres ouvriers. Le plus haut traitement qu'elle payât dans l'ensemble était de 6 000 francs. Ainsi on mettait le holà à la chasse aux places et à l'arrivisme, sans en appeler aux mandats impératifs des délégués aux corps représentatifs qui leur étaient encore adjoints par surcroît. » ([15] [1565])
Marx a également souligné qu'en combinant les fonctions exécutives et législatives, la Commune était « un corps agissant », « non pas un organisme parlementaire ». ([16] [1566]) En d'autres termes, elle était une forme supérieure de démocratie vis-à-vis du parlementarisme bourgeois : même dans les beaux jours de celui-ci, la division entre le législatif et l'exécutif faisait que ce dernier tendait à échapper au contrôle du premier et engendrait ainsi une bureaucratie croissante. Cette tendance s'est, bien entendu, pleinement confirmée dans l'époque de la décadence capitaliste au cours de laquelle les organes exécutifs de l'Etat ont fait du législatif une simple apparence, une façade.
Mais sans doute la preuve la plus parlante du fait que la démocratie prolétarienne incarnée par la Commune était plus avancée que tout ce qui pouvait exister sous la démocratie bourgeoise, est le principe des délégués révocables :
« Au lieu de décider une fois tous les trois ou six ans quel membre de la classe dirigeante devait 'représenter' et fouler au pied le peuple au Parlement, le suffrage universel devait servir au peuple constitué en communes... » ([17] [1567])
Les élections bourgeoises sont fondées sur le principe du citoyen atomisé dans l'isoloir électoral, avec un vote qui ne lui donne aucun contrôle réel sur ses « représentants ». La conception prolétarienne des délégués élus et révocables, au contraire, ne peut fonctionner que sur la base d'une mobilisation permanente et collective des ouvriers et des opprimés. Suivant la tradition des sections révolutionnaires d'où a surgi la Commune de 1793 (sans mentionner les « agitateurs » radicaux élus dans les rangs du Nouveau modèle d'armée de Cromwell, dans la révolution anglaise), les délégués au Conseil de la Commune étaient élus par des assemblées publiques tenues dans chaque arrondissement de Paris. Formellement parlant, ces assemblées électorales avaient le pouvoir de formuler les mandats de leurs délégués et de les révoquer si nécessaire. Dans la pratique, il devait apparaître que la plus grande partie du travail de supervision et de pression sur les délégués de la Commune était réalisé par les « Comités de Vigilance » et des clubs révolutionnaires qui surgirent dans les quartiers ouvriers et qui étaient le lieu où se concentrait une intense vie de débat politique, à la fois sur les questions générales et théoriques auxquelles était confronté le prolétariat, et à la fois sur les questions immédiates de survie, d'organisation et de défense. La déclaration de principe du Club communal qui se réunissait dans l'église de St Nicolas des Champs, dans le troisième arrondissement, nous donne un aperçu du niveau de conscience prolétarienne atteint par les prolétaires de Paris durant les deux mois enivrants de l'existence de la Commune :
« Les buts du Club Communal sont les suivants :
Combattre les ennemis de nos droits communs, de nos libertés et de la République. Défendre les droits du peuple, l'éduquer politiquement de sorte qu'il puisse gouverner lui-même.
Rappeler les principes à nos délégués s'ils devaient s'en éloigner, et les soutenir dans tous leurs efforts pour sauver la République. Mais par dessus tout, soutenir la souveraineté du peuple qui ne doit jamais renoncer à ses droits, à superviser les actions de ses délégués.
Peuple, gouverne toi-même directement, à travers des réunions politiques, à travers ta presse ; fais peser la pression sur ceux qui te représentent - ils ne peuvent aller trop loin dans la direction révolutionnaire... Longue vie à la Commune ! »
Du semi-Etat à la suppression de l'Etat
Fondée sur l'auto mobilisation permanente du prolétariat armé, la Commune comme le dit Engels, «n'était plus un Etat au sens propre » ([18] [1568]). Lénine dans L'Etat et la révolution, cite cette phrase et la développe :
« La Commune cessait d'être un Etat dans la mesure où il lui fallait opprimer non plus la majorité de la population, mais une minorité (les exploiteurs) ; elle avait brisé la machine d'Etat bourgeoise ; au lieu d'un pouvoir spécial d'oppression, c'est la population elle-même qui entrait en scène. Autant de dérogations à ce qu'est l'Etat au sens propre du mot. Et si la Commune s'était affermie, les vestiges de l'Etat qui subsistaient en elle se seraient 'éteints' d'eux-mêmes ; elle n'aurait pas eu besoin d"abolir' ses institutions : celles-ci auraient cessé de fonctionner au fur et à mesure qu'elles n'auraient plus rien eu à faire. » ([19] [1569])
Ainsi l'« anti-étatisme » de la classe ouvrière opère à deux niveaux, ou plutôt en deux étapes : d'abord, la destruction violente de l'Etat bourgeois ; ensuite son remplacement par une nouvelle sorte de pouvoir politique qui autant que possible évite les «pires aspects » de tous les Etats antérieurs, et qui, en fin de compte, rend possible que le prolétariat se débarrasse complètement de l'Etat, en le consignant, selon les termes évocateurs d'Engels, « au Musée des Antiquités à côté du rouet et de la hache. » ([20] [1570])
De la Commune au communisme : la question de la transformation sociale
Le dépérissement de l'Etat est basé sur la transformation de l'infrastructure économique et sociale, sur l'élimination des rapports capitalistes de production et sur le mouvement vers une communauté humaine sans classe. Comme nous l'avons déjà noté, les conditions matérielles d'une telle transformation n'existaient pas à l'échelle mondiale en 1871. De plus, la Commune ne fut au pouvoir que deux mois, et seulement dans une seule ville assiégée, même si elle a inspiré d'autres tentatives révolutionnaires dans d'autres villes de France (Marseille, Lyon, Toulouse, Narbonne, etc.).
Quand les historiens bourgeois essaient de ridiculiser les proclamations de Marx sur la nature révolutionnaire de la Commune, ils mettent en évidence le fait que la plupart des mesures économiques et sociales qu'elle a prises, étaient à peine socialistes : la séparation de l'Eglise et de l'Etat, par exemple, est entièrement compatible avec le républicanisme bourgeois radical. Même les mesures ayant plus spécifiquement un impact sur le prolétariat, l'abolition du travail de nuit des boulangers, l'aide à la formation des syndicats, etc., se concevaient comme une défense des ouvriers contre l'exploitation plutôt que comme la suppression de l'exploitation elle-même. Tout cela a amené certains « experts » de la Commune à y voir plus le dernier souffle de la tradition jacobine que la première salve de la révolution prolétarienne. D'autres, comme l'a noté Marx, ont pris la Commune pour « un rappel à la vie des communes médiévales, qui d'abord précédèrent ce pouvoir d'Etat, et ensuite en devinrent le fondement. » ([21] [1571])
Toutes ces interprétations se basent sur une totale incompréhension de la nature de la révolution prolétarienne. Les leçons de la Commune de Paris sont fondamentalement des leçons politiques, des leçons sur les formes et les fonctions du pouvoir prolétarien, pour la simple raison que la révolution prolétarienne ne peut commencer qu'en tant qu'acte politique. Manquant de toute assise économique au sein de l'ancienne société, le prolétariat ne peut s'engager dans un processus de transformation sociale tant qu'il n'a pas pris les rênes du pouvoir politique, et ceci à l'échelle mondiale. La révolution russe de 1917 a eu lieu à une époque historique où le communisme à l'échelle mondiale était une possibilité, et elle fut victorieuse à l'échelle d'un grand pays. Et pourtant là encore, l'héritage fondamental de la révolution russe est lié au problème du pouvoir politique de la classe ouvrière, comme on le verra plus tard dans un autre article. S'attendre à ce que la Commune ait introduit le communisme dans une seule ville, c'était attendre des miracles. Comme Marx le dit : « La classe ouvrière n'espérait pas des miracles de la Commune. Elle n'a pas d'utopie toute faite à introduire par décret du peuple. Elle sait que pour réaliser sa propre émancipation et avec elle cette forme de vie plus haute à laquelle tend irrésistiblement la société actuelle de par sa structure économique même, elle aura à passer par de longues luttes, par toute une série de processus historiques, qui transformeront complètement les circonstances et les hommes. Elle n'a pas à réaliser d'idéal, mais seulement à libérer les éléments de la société nouvelle que porte dans ses flancs la vieille société bourgeoise qui s'effondre. » ([22] [1572])
Contre toutes les fausses interprétations de la Commune, Marx insistait sur le fait qu'elle était « essentiellement un gouvernement de la classe ouvrière, le résultat de la lutte de la classe des producteurs contre la classe des appropriateurs, la forme politique enfin trouvée qui permettait de réaliser l'émancipation économique du travail ». ([23] [1573])
Dans ces passages, Marx reconnaît que la Commune fut d'abord et avant tout une forme politique, et qu'il n'était pas du tout question qu'en une nuit, sous sa domination, soient réalisées des utopies. Et cependant, en même temps, il reconnaît qu'une fois que le prolétariat a pris les choses en main, il doit et peut enclencher, ou plutôt « libérer », une dynamique qui mène à « la transformation économique du travail », malgré toutes les limites objectives placées face à cette dynamique. C'est pourquoi la Commune, tout comme la révolution russe, contient également des leçons valables pour la future transformation sociale.
Comme exemple de cette dynamique, de cette logique vers la transformation sociale, Marx a souligné l'expropriation des usines abandonnées par les capitalistes qui avaient fui la ville, et leur prise en charge par des coopératives ouvrières qui devaient être organisées dans une fédération unique. Pour lui, c'était une expression immédiate du but ultime de la Commune, l'expropriation générale des expropriateurs :
« Elle (la Commune) voulait faire de la propriété individuelle une réalité, en transformant les moyens de production, la terre et le capital, aujourd'hui essentiellement moyens d'asservissement et d'exploitation du travail, en simples instruments d'un travail libre et associé. Mais c'est du communisme, c'est’ l'impossible’ communisme ! Eh quoi, ceux des membres de la classe dominante qui sont assez intelligents pour comprendre l'impossibilité de perpétuer le système actuel, - et ils sont nombreux - sont devenus les apôtres importuns et bruyants de la production coopérative. Mais si la production coopérative ne doit pas rester un leurre et un piège; si elle doit évincer le système capitaliste ; si l'ensemble des associations coopératives doit régler la production nationale selon un plan commun, la prenant ainsi sous leur propre direction et mettant fin à l'anarchie constante et aux convulsions périodiques qui sont le destin inévitable de la production capitaliste, que serait-ce, messieurs, sinon du communisme, du très 'possible' communisme ? » ([24] [1574])
La classe ouvrière en tant qu'avant-garde des opprimés
La Commune nous a aussi laissé d'importants éléments de compréhension des rapports entre la classe ouvrière une fois qu'elle a pris le pouvoir, et les autres couches non-exploiteuses de la société, dans ce cas, la petite-bourgeoisie urbaine et la paysannerie. En agissant comme avant-garde déterminée de l'ensemble de la population exploitée, la classe ouvrière a montré sa capacité à gagner la confiance de ces autres couches, qui sont moins capables d'agir en tant que force unifiée. Et pour maintenir ces couches aux côtés de la révolution, la Commune a introduit une série de mesures économiques qui allègent leurs charges matérielles : l'abolition de toutes les sortes de dettes et d'impôts, la transformation de l'incarnation immédiate de l'oppression paysanne, «ses sangsues actuelles, le notaire, l'avocat, l'huissier, et autres vampires judiciaires, en agents communaux salariés, élus par lui et devant lui responsables. » ([25] [1575]) Dans le cas des paysans, ces mesures restaient largement hypothétiques puisque l'autorité de la Commune ne s'étendait pas aux districts ruraux. Mais les ouvriers de Paris gagnèrent vraiment, dans une large mesure, le soutien de la petite-bourgeoisie urbaine, en particulier à travers l'ajournement des obligations de la dette et l'annulation des intérêts.
L'Etat comme « mal nécessaire »
Les structures électorales de la Commune ont aussi permis aux autres couches non-exploiteuses de participer politiquement au processus révolutionnaire. C'était inévitable et nécessaire, et devait se répéter durant la révolution russe. Mais en même temps, rétrospectivement vu du 20e siècle, nous pouvons voir que l'une des principales indications du fait que la Commune était une expression « immature » de la dictature du prolétariat, qu'elle était une expression de la classe ouvrière n'ayant pas encore atteint son plein développement, réside dans le fait que les ouvriers n'avaient pas d'organisation spécifique indépendante en son sein, ni un poids prépondérant dans les mécanismes électoraux. La Commune était élue exclusivement sur la base d'unités territoriales (les arrondissements) qui, tout en étant dominées par le prolétariat, ne pouvaient permettre à la classe ouvrière de s'imposer comme une force clairement autonome (en particulier si la Commune s'était étendue pour embrasser la majorité paysanne en dehors de Paris). C'est pourquoi les conseils ouvriers de 1905 et de 1917-21, élus par les assemblées sur les lieux de travail et basés dans les principaux centres industriels, constituèrent une avancée comme forme de la dictature du prolétariat par rapport à la Commune. Nous pouvons aller jusqu'à dire que la forme de la Commune correspondait plus à l'Etat composé de tous les Soviets (d'ouvriers, de paysans, de citadins), qui surgit de la révolution russe, qu'à l'organisation des Conseils ouvriers.
L'expérience russe a rendu possible la clarification du rapport entre les organes spécifiques de la classe, les conseils ouvriers, et l'Etat soviétique dans son ensemble. En particulier, elle a montré que la classe ouvrière ne peut s'identifier directement avec ce dernier, mais qu'elle doit exercer une vigilance constante et un contrôle sur celui-ci à travers ses propres organisations de classe qui y participent sans y être englouties. Nous examinerons cette question plus tard, dans d'autres articles de cette série, bien que nous l'ayons déjà largement traitée dans nos publications. Mais ça vaut la peine de dire que Marx a lui-même entrevu le problème. Le premier brouillon de La guerre civile en France contient le passage suivant :
« ...la Commune n'est pas le mouvement social de la classe ouvrière, et, par suite, le mouvement régénérateur de toute l'humanité, mais seulement le moyen organique de son action. La Commune ne supprime pas les luttes de classes, par lesquelles la classe ouvrière s'efforce d'abolir toutes les classes, et par suite toute domination de classe... mais elle crée l'ambiance rationnelle dans laquelle cette lutte de classes peut passer par ses différentes phases de la façon la plus rationnelle et la plus humaine. » ([26] [1576])
Ici, on voit une claire vision du fait que la dynamique réelle de la transformation communiste ne vient pas d'un Etat post-révolutionnaire puisque la fonction de ce dernier, comme pour tous les Etats, est de contenir les antagonismes de classe, de les empêcher de déchirer la société. D'où son aspect conservateur par rapport au mouvement social réel du prolétariat. Même dans la courte vie de la Commune, nous pouvons définir certaines tendances dans cette direction. L'histoire de la Commune de Paris de Lissagaray en particulier contient beaucoup de critiques des hésitations, confusions et, dans certains cas, des positions creuses de certains délégués au Conseil de la Commune dont beaucoup incarnaient, en fait, un radicalisme petit-bourgeois obsolète qui était fréquemment mis en question par les assemblées des quartiers plus prolétariens. Un des clubs révolutionnaires locaux au moins déclara qu'il fallait dissoudre la Commune parce qu'elle n'était pas assez révolutionnaire !
Dans un passage très célèbre, Engels plonge certainement dans le même problème quand il dit que l'Etat, le demi-Etat de la période de transition vers le communisme, « ...est un mal dont hérite le prolétariat vainqueur dans la lutte pour la domination de classe et dont, tout comme la Commune, il ne pourra s'empêcher de rogner aussitôt au maximum les côtés les plus nuisibles, jusqu'à ce qu'une génération grandie dans des conditions sociales nouvelles et libres soit en état de se défaire de tout ce bric-à-brac de l'Etat. » ([27] [1577]) Preuve supplémentaire que, selon le marxisme, la puissance de l'Etat est la mesure de l'asservissement de l'homme.
De la guerre nationale à la guerre de classe
Il y a une autre leçon vitale de la Commune qui n'est pas liée au problème de la dictature du prolétariat, mais à une question qui a été particulièrement épineuse dans l'histoire du mouvement ouvrier : la question nationale.
Comme nous l'avons déjà dit, Marx et sa tendance au sein de la Première Internationale reconnaissaient que le capitalisme n'avait pas encore atteint l'apogée de son développement. En fait, le capitalisme était encore limité par les vestiges de la société féodale et d'autres restes archaïques. Pour cette raison, Marx a soutenu certains mouvements nationaux dans la mesure où ils représentaient la démocratie bourgeoise contre l'absolutisme, qu'ils étaient pour l'unification nationale contre la fragmentation féodale. Le soutien que l'Internationale a apporté à l'indépendance de la Pologne contre le Tsarisme russe, à l'unification italienne et allemande, aux Nordistes en Amérique contre le Sud esclavagiste durant la Guerre Civile, se basait sur cette logique matérialiste. C'étaient aussi les causes qui mobilisaient la sympathie et la solidarité active de la classe ouvrière : en Grande-Bretagne par exemple, il y avait des meetings de soutien à l'indépendance polonaise, de grandes manifestations contre l'intervention britannique aux côtés des Sudistes en Amérique, même si le manque de coton résultant de la guerre apportait de réelles privations pour les ouvriers du textile en Grande-Bretagne.
Dans ce contexte où la bourgeoise n'avait pas encore complètement achevé ses tâches historiques progressistes, le problème des guerres de défense nationale était très réel et les révolutionnaires devaient considérer sérieusement chaque guerre entre Etats ; et le problème se posa avec une grande acuité quand la guerre franco-allemande éclata. La politique de l'Internationale envers cette guerre est résumée dans la Première Adresse du Conseil Général de l'AIT sur la guerre franco-allemande. Dans son essence, c'était une prise de position d'un internationalisme prolétarien fondamental contre les guerres « dynastiques » de la classe dominante. Elle citait un Manifeste produit par la section française de l'Internationale lors de l'éclatement de la guerre :
«Une fois de plus, sous prétexte d'équilibre européen et d'honneur national, des ambitions politiques menacent la paix du monde. Travailleurs français, allemands, espagnols, que nos voix s'unissent dans un cri de réprobation contre la guerre ! (...) La guerre pour une question de prépondérance ou de dynastie ne peut être, aux yeux des travailleurs, qu'une criminelle absurdité. » ([28] [1578])
De tels sentiments ne se limitaient pas à une minorité socialiste : Marx rapporte, dans la première Adresse, comment les ouvriers internationalistes français pourchassaient les chauvins pro-guerre dans les rues de Paris.
En même temps, l'Internationale défendait que « du côté allemand, la guerre est une guerre de défense. » ([29] [1579]) Mais cela ne voulait pas dire empoisonner les ouvriers avec le chauvinisme : en réponse à la prise de position de la section française, les allemands affiliés à l'Internationale, tout en acceptant tristement qu'une guerre défensive était un mal inévitable, déclaraient aussi: «...la guerre actuelle est exclusivement dynastique... Nous sommes heureux de saisir la main fraternelle que nous tendent les ouvriers de France. Attentifs au mot d'ordre de l'Association Internationale des Travailleurs : Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! Nous n'oublierons jamais que les ouvriers de tous les pays sont nos amis et les despotes de tous les pays, nos ennemis ! » ([30] [1580])
La première Adresse mettait aussi en garde les ouvriers allemands contre le danger que la guerre ne se transformât en une guerre d'agression du côté allemand, et elle reconnaissait également la complicité de Bismarck dans la guerre, même si c'était avant les révélations sur le télégramme d’Ems qui a prouvé à quel point Bismarck avait en fait attiré Bonaparte et son « Second Empire » dans la guerre. De toute façon, avec l'effondrement de l'armée française à Sedan, la guerre est véritablement devenue une guerre de conquête pour la Prusse. Paris fut assiégé et la Commune elle-même surgit sur la question de la défense nationale. Le régime de Bonaparte fut remplacé par une République en 1870, parce que l'Empire s'était avéré incapable de défendre Paris ; maintenant la même République prouvait qu'elle préférait livrer la capitale à la Prusse plutôt qu'elle ne tombe dans les mains des ouvriers en armes.
Mais bien que, dans leur action initiale, les ouvriers de Paris aient encore pensé en termes d'une sorte de patriotisme défensif, de préservation de l'honneur national par la bourgeoisie elle-même, le soulèvement de la Commune marqua en fait un moment historique décisif. Face à la perspective d'une révolution ouvrière, les bourgeoisies prussienne et française unirent leurs rangs pour l'écraser : l'armée prussienne relâcha ses prisonniers de guerre pour gonfler les troupes contre-révolutionnaires françaises de Thiers, et permit à ces dernières de traverser ses lignes pour mener leur assaut final contre la Commune. De ces événements, Marx a tiré une conclusion de portée historique :
« Qu'après la plus terrible guerre des temps modernes, le vaincu et le vainqueur fraternisent pour massacrer en commun le prolétariat, cet événement inouï prouve, non pas comme Bismarck le pense, l'écrasement définitif d'une nouvelle société montante, mais la désagrégation complète de l'ancienne société bourgeoise. Le plus haut effort d'héroïsme dont la vieille société soit encore capable est une guerre nationale ; et il est maintenant prouvé qu'elle est une pure mystification des gouvernements, destinée à retarder la lutte des classes, et qui est jetée de côté, aussitôt que cette lutte de classe éclate en guerre civile. La domination de classe ne peut plus se cacher sous un uniforme national, les gouvernements nationaux ne font qu'un contre le prolétariat ! »([31] [1581])
Pour sa part, le prolétariat révolutionnaire de Paris avait déjà commencé à faire un certain nombre de pas au-delà de la phrase patriotique initiale : d'où le décret permettant aux étrangers de servir la Commune, «parce que le drapeau de la Commune est le drapeau de la république Universelle » ; la destruction publique de la colonne Vendôme, symbole de la gloire martiale de la France. La logique historique de la Commune de Paris était d'aller vers une Commune mondiale, même si ce n'était pas possible à cette époque. C'est pourquoi le soulèvement des ouvriers de Paris pendant la guerre franco-allemande, quelles que soient toutes les phrases patriotiques qui l'ont accompagnée, était en réalité le signe avant-coureur des insurrections de 1917-18 explicitement contre la guerre, et de la vague révolutionnaire qui les a suivies.
Les conclusions de Marx ouvrent aussi la perspective du futur. Il pouvait être prématuré de dire en 1871 que la société bourgeoise était réduite en poussière : cette année a pu marquer la fin de la question nationale en Europe, comme Lénine le note dans L'impérialisme, stade suprême du capitalisme. Mais elle continuait à se poser dans les colonies, alors que le capitalisme entrait dans la dernière phase de son expansion. Dans un sens plus profond, la dénonciation par Marx de l'imposture de la guerre nationale anticipait ce qui allait devenir une réalité générale une fois que le capitalisme serait entré dans sa phase de décadence : dorénavant, toutes les guerres seraient des guerres impérialistes, et, en ce qui concernait le prolétariat, il ne pourrait plus être question d'une quelconque défense nationale.
Les soulèvements de 1917-18 ont aussi confirmé ce qu'avait dit Marx de la capacité de la bourgeoisie à s'unifier contre la menace prolétarienne : face à la possibilité d'une révolution mondiale des ouvriers, les bourgeoisies d'Europe, qui s'étaient déchirées les unes les autres pendant quatre ans, découvrirent subitement qu'elles avaient toutes les raisons de faire la paix afin d'étouffer le défi prolétarien contre leur « ordre » dégoulinant de sang. Une fois de plus, les gouvernements du monde furent « un contre le prolétariat. »
Dans le prochain article, nous étudierons la lutte de Marx et de sa tendance contre les éléments du mouvement ouvrier qui n'ont pas compris, ou même ont cherché à minimiser, les leçons de la Commune, en particulier les sociaux-démocrates allemands et les anarchistes de Bakounine.
CDW.
[1] [1582] Le nom Association Internationale des Travailleurs, en anglais en particulier, International Workingmen's Association, et non Workers, était évidemment le reflet de l'immaturité du mouvement de la classe, puisque le prolétariat n'a aucun intérêt à instituer dans ses propres rangs des divisions sexuelles. Comme dans les plus grands soulèvements sociaux, la Commune de Paris a vu une extraordinaire fermentation chez les femmes ouvrières qui non seulement ont bruyamment mis en question leur rôle « traditionnel », mais se sont souvent montrées les défenseuses les plus courageuses et les plus radicales de la Commune, dans les clubs révolutionnaires comme sur les barricades. Cette fermentation a aussi donné naissance à la formation de sections féminines de l'Internationale, ce qui, à l'époque, constituait une avancée, même si de telles formes n'ont plus de fonction dans le mouvement révolutionnaire d'aujourd'hui.
2] [1583] Quatrième Rapport annuel du Conseil Général de l'ATT, « Le Conseil Général de la Première Internationale », 1866-1868, Ed. de Moscou, p. 281.
[3] [1584] Premières lignes des Statuts Provisoires de l'Association, « Le Conseil Général de la Première Internationale », 1864-1866, Ed. de Moscou, p. 243.
[4] [1585] Discours au 7e anniversaire de l'Internationale à Londres, 1871.
[5] [1586] Résolution de la Conférence de Londres de l'Internationale sur l'action politique de la classe ouvrière, septembre 1871, traduit de l'anglais par nous..
[6] [1587] Le terme « constitution du prolétariat en parti » reflète certaines ambiguïtés sur le rôle du parti qui étaient aussi le produit des limites historiques de la période. L'Internationale contenait certaines caractéristiques d'une organisation unitaire, et pas seulement d'une organisation politique, de la classe. Durant tout le 19e siècle, la notion qu'un parti soit représentait la classe, soit était la classe sous sa forme organisée, était profondément enracinée dans le mouvement ouvrier. Ce n'est qu'au 20e siècle que de telles idées furent dépassées, et seulement après jde très douloureuses expériences que la nécessité de /(distinguer organisation unitaire et organisation ^politique devint claire. Néanmoins, il existait déjà une compréhension fondamentale du fait que le parti n'est pas l'organisation de l'ensemble de la classe, mais de ses éléments les plus avancés. Une telle définition est déjà mise en évidence dans Le Manifeste Communiste, et la Première Internationale se considérait elle-même également dans ces termes quand elle disait que le parti des ouvriers était (« la partie de la classe ouvrière qui est devenue consciente de son intérêt commun de classe ») (« La question militaire prussienne » et le Parti ouvrier allemand, écrit par Engels en 1865,).
[7] [1588] « Le Conseil Général de la Première Internationale », 1864-66, Ed. de Moscou, p. 241.
[8] [1589] Les Blanquistes partageaient avec les Bakouninistes le volontarisme et l'impatience, mais ils furent toujours clairs sur le fait que le prolétariat devait établir sa dictature afin de créer une société communiste. C'est pourquoi Marx, à certaines occasions importantes, a pu faire alliance avec les Blanquistes contre les Bakouninistes sur la question de l'action politique de la classe ouvrière.
[9] [1590] Lettre de Marx à Bracke, 1875, traduit de l'anglais par nous.
[10] [1591] Seconde Adresse du Conseil général de VAIT sur la guerre franco-allemande, Londres, 9 septembre 1870, Ed.sociales, p. 289.
[11] [1592] Oeuvres choisies, Editions du Progrès, Moscou 1968, p. 324.
[12] [1593] Marx, La guerre civile en France, Premier essai de rédaction, Ed. sociales, p. 212.
[13] [1594] Critique de la doctrine de l'Etat de Hegel, 1843, traduit de l'anglais par nous.
[14] [1595] Voir les Revue Internationale n° 72 et 73.
[15] [1596] Ed.sociales, p. 301.
[16] [1597] La guerre civile en France, Ed. sociales, p. 41.
[17] [1598] Ibid ,p. 43.
[18] [1599] Lettre à Bebel, 1875.
[19] [1600] Oeuvres choisies, Tome 2, Editions du progrès, Moscou 1968, p. 338.
[20] [1601] Les origines de la famille, de la propriété privée et de l'Etat.
[21] [1602] La guerre civile en France, Ed. sociales, p. 44.
[22] [1603] Ibid, p. 46.
[23] [1604] Ibid, p. 45.
[24] [1605] Ibid, p. 46.
[25] [1606] Ibid., p. 48.
[26] [1607] La guerre civile en France, Premier essai de rédaction, Ed. sociales, p. 217.
[27] [1608] Introduction à La guerre civile en France, Engels 1891, Ed. sociales, p. 301.
[28] [1609] Manifeste « Aux travailleurs de tous les pays », Le Réveil, 12 juillet 1870, cité dans la Première Adresse du Conseil Général sur la guerre franco-allemande, 23 juillet 1870, Ed. sociales, p. 278.
[29] [1610] Première Adresse du Conseil Général sur la guerre franco-allemande, Ed. sociales, p. 279.
[30] [1611] Résolution adoptée à l'unanimité par un meeting de délégués, représentant 50 000 ouvriers saxons à Chemnitz, citée dans la Première Adresse..., ibid, p. 280.
[31] [1612] La guerre civile en France. Ed. sociales, p.62.
Approfondir:
Questions théoriques:
- Communisme [492]
Heritage de la Gauche Communiste:
Revue Internationale no 78 - 3e trimestre 1994
- 2777 reads
Rwanda, Yémen, Bosnie, Corée : derrière les mensonges de « paix », la barbarie capitaliste
- 3013 reads
Sous les auspices de « la paix », de « la civilisation » et de la « démocratie », les plus grandes puissances militaires du monde viennent de célébrer en grandes pompes l'anniversaire du débarquement Allié en Normandie. Les festivités organisées à cette occasion, le répugnant reality show mis en scène sur les lieux mêmes de la boucherie cinquantenaire, les phrases sonores à leur propre gloire que se sont échangés les chefs d'Etat les plus puissants de la planète, n'en finissant pas de se congratuler, ont donné lieu à un déballage médiatique phénoménal à l'échelle mondiale. Le message a été assené sur tous les tons : « Nous autres, grands Etats industrialisés et nos institutions démocratiques, sommes les héritiers des libérateurs qui chassèrent d'Europe l'incarnation du mal qu'était le régime nazi. Aujourd'hui comme hier, nous sommes les garants de la "civilisation", de la "paix" et de l'"humanitaire", contre l'oppression, la terreur, la barbarie et le chaos. »
Ces gens-là veulent nous faire croire, qu'aujourd'hui comme hier, la barbarie, c'est ... les autres. Le vieux mensonge selon lequel la boucherie de 1939-45, ses 50 millions de morts, son cortège d'atrocités et de souffrances, aurait eu pour seul responsable la folie barbare d'un Hitler et non le capitalisme comme un tout, et non les sordides intérêts impérialistes de tous les camps en présence. Cela fait un demi-siècle qu'on nous le rabâche, dans l'espoir qu'un mensonge mille fois répété devienne un vérité. Et s'ils nous le resservent aujourd'hui en mondovision, c'est encore pour disculper le capitalisme, et en particulier les grandes puissances « démocratiques », de la responsabilité des massacres, des guerres, des génocides et du chaos grandissant qui ravagent aujourd'hui la planète.
Un demi-million d'hommes impliqués dans l'opération, la plus gigantesque expédition militaire de tous les temps, une boucherie effroyable qui -en quelques heures - laissa sur le terrain des dizaines de milliers de cadavres. Voilà, ce que, « au nom de la paix », les têtes couronnées, galonnées, suffragées, de la « communauté internationale » célébraient en choeur le 6 juin 1994. En se recueillant hypocritement devant les champs de croix blanches à perte de vue où s'inscrivent l'âge de ces enfants qu'ils appellent des « héros » - 20 ans, 18 ans, 16 ans - la seule émotion vraie que ressentaient cette brochette de canailles, c'était bien le regret du « bon temps », celui d'il y a 50 ans, où la classe ouvrière était défaite et la chair à canon abondante et soumise. ([1] [1613])
La « paix », tous, Clinton, Major, Mitterrand et les autres, n'ont eu que ce mot à la bouche. Ce même mot de "paix", dont ils se gargarisaient il y a 5 ans lors de la chute du mur de Berlin. Ce mot de "paix", au nom duquel cette même "communauté internationale" déchaîna, quelques mois plus tard, la "tempête du désert" en Irak avec ses centaines de milliers de victimes. De cette boucherie sans nom -ils nous l'avaient encore promis- un "nouvel ordre mondial" allait naître. Depuis lors, c'est encore en porte-parole de "la paix" et de la "civilisation" qu'ils se sont tous présentés, en Yougoslavie, en Afrique, dans les Etats de l'ex-URSS, au Moyen et en Extrême-Orient. Plus ces régions du monde étaient ravagées par la guerre, plus les grandes puissances s'y sont présentées en défenseurs de "la paix", et plus en réalité elles étaient présentes et actives sur tous les théâtres des conflits guerriers, pour y défendre la seule "juste cause" que connaissent tous les pays capitalistes : leurs intérêts impérialistes.
Il n'y a pas de paix possible dans le capitalisme. La fin de la seconde boucherie mondiale, si elle avait chassé la guerre d'Europe et des pays les plus développés, n'avait fait que la reporter vers la périphérie du capitalisme. Depuis 50 ans, les puissances impérialistes, grandes et petites, n'ont pas cessé de s'affronter militairement à travers les conflits locaux. Pendant des décennies, les guerres locales incessantes ont été autant de moments de l'affrontement entre les deux grands blocs impérialistes qui se disputaient le partage du monde. L'effondrement du bloc de l'Est et, par suite, l'éclatement de celui qui lui faisait face en Occident, loin de mettre fin à cette réalité guerrière et impérialiste du capitalisme a été le signal de son déchaînement tous azimuts et sans limites.
Dans un monde où le chacun pour soi règne désormais en maître, ce sont les anciens alliés d'hier qui se disputent aujourd'hui leurs zones d'influence impérialiste aux 4 coins de la planète. Les célébrations du « D day », où les plus puissants Etats se félicitaient mutuellement d'avoir ensemble chassé la guerre d'Europe il y a 50 ans, se sont déroulées alors même que la guerre est de retour sur ce continent et qu'elle y est activement nourrie, depuis trois ans en Yougoslavie, par les rivalités qui opposent ces mêmes Etats « civilisés ».
Non, le chaos guerrier qui ravage aujourd'hui la planète ne peut simplement s'expliquer par le soudain retour de "haines ancestrales" entre populations arriérées, comme le prétendent ceux qui veulent nous faire croire, encore une fois, que la barbarie, c'est les autres. Il est partout alimenté, attisé, entretenu, quand ce n'est pas carrément provoqué, par les rivalités et les ambitions impérialistes de ceux-là même qui nous abreuvent de discours sur leurs bonnes intentions "civilisatrices", "humanitaires", et "pacificatrices"
RWANDA : Les rivalités franco-américaines sont responsables de l'horreur
Un bain de sang effroyable. Des populations entières froidement assassinées, à coups de machettes et de gourdins à clous, les enfants égorgés dans leur berceaux, les familles pourchassées par des hordes de tueurs déchaînés jusque dans le moindre lieu où elles croient trouver refuge et mises à mort avec une sauvagerie inouïe. Le pays transformé en un immense charnier et dont l'effroyable évocation du lac Victoria charriant des milliers de cadavres putréfiés donne l'odieuse mesure. Le nombre des victimes ? Un demi-million au moins, sans doute plus encore. L'ampleur du génocide restera inconnu. Jamais dans l'histoire un tel exode de populations fuyant à l'aveugle les massacres ne s'était produit en si peu de temps.
L'évocation d'une telle horreur par les médias de la bourgeoisie « démocratique », qui se sont vautrées dans ces images d'holocauste, nous a renvoyé à l'envi le message : « regardez à quelles horreurs aboutissent les haines raciales ancestrales qui déchirent les populations arriérées de l'Afrique "sauvage" et face auxquelles les Etats civilisés sont impuissants. Et réjouissez vous de vivre dans nos contrées démocratiques à l'abri d'un tel chaos. Le quotidien de misère et de chômage que vous vivez ici est un paradis à côté des massacres que subissent ces populations. »
Le mensonge est cette fois d'autant plus énorme, que le prétendu conflit ethnique ancestral entre Hutus et Tutsis a été créé de toutes pièces par les puissances impérialistes à l'époque de la colonisation. Tutsis et Hutus correspondaient alors beaucoup moins à des critères « ethniques » qu'à des castes sociales. Les Tutsis désignaient la caste féodale au pouvoir sur laquelle se sont d'abord appuyées les puissances coloniales. Héritant de la colonie rwandaise lors du dépeçage de l'empire allemand entre les vainqueurs de la première guerre mondiale, c'est la Belgique qui introduit la mention ethnique sur la carte d'identité des Rwandais, attisant la haine entre les deux castes pour mieux s'appuyer sur la monarchie tutsi.
En 1959, changeant son fusil d'épaule, Bruxelles soutient la majorité hutu qui s'est emparée du pouvoir. La fameuse carte d'identité « ethnique » est maintenue et les discriminations entre tutsis et hutus dans les divers domaines de la vie sociale sont renforcées.
Plusieurs centaines de milliers de Tutsis fuient le pays pour s'installer au Burundi ou en Ouganda. Dans ce dernier pays, ils seront une base de recrutement pour la clique de l'actuel président ougandais Museveni qui prend le pouvoir avec leur soutien à Kampala en 1986. En retour, le nouveau régime ougandais favorise et arme la guérilla tutsie qui va se concrétiser par la création du Front patriotique rwandais (FPR) qui entre au Rwanda en octobre 1990.
Entre temps, le contrôle de l'impérialisme belge sur Kigali a laissé la place à la France qui apporte un soutien militaire et économique sans faille au régime hutu d'Habyarimana, lequel fait régner la terreur dans le pays en renforçant les ressentiments ethniques contre les Tutsis. C'est grâce au soutien de l'impérialisme français qui l'arme activement et qui envoie en renfort des militaires, que le régime repoussera l'avance du FPR, lequel est soutenu discrètement par les Etats-Unis, à travers l'Ouganda qui l'arme et l'entraîne.
A partir de là, la guerre civile s'emballe, les pogroms anti-Tutsis se multiplient en même temps que ceux menés par le FPR contre tous ceux qu'il soupçonne de « collaborer » avec le régime. Au nom de « protéger ses ressortissants », Paris renforce encore son corps expéditionnaire. En réalité l'État français ne fait que défendre sa chasse gardée face à l'offensive des Etats-Unis qui n'a de cesse, depuis l'effondrement du bloc de l'Est, de disputer à Paris ses zones d'influence en Afrique. La guérilla du FPR prend la forme d'une véritable offensive américaine visant à faire tomber le régime pro-français de Kigali.
Pour tenter de sauver le régime, la France finit par mettre sur pied en août 1993 un accord de «paix » qui prévoit une nouvelle constitution plus "démocratique", octroyant une partie du pouvoir à la minorité tutsi ainsi qu'aux diverses cliques d'opposition.
Cet accord va s'avérer irréalisable. Non pas parce que les "haines ancestrales" sont trop fortes, mais tout simplement parce que l'enjeu impérialiste et les calculs stratégiques des grandes puissances ne pouvaient pas s'en accommoder. L'assassinat le 6 avril 94, à la veille de la mise en place de la nouvelle constitution, des présidents rwandais et burundais fait capoter l'accord et met le feu au poudres, déclenchant le bain de sang que l'on sait. Les dernières révélations publiées par la presse belge (qui a des raisons d'en vouloir à son rival français en Afrique) mettant directement en cause des militaires français dans l'attentat du 6 avril suggèrent que Paris a très bien pu commanditer l'attentat dans l'espoir qu'en en faisant porter le chapeau aux rebelles du FPR, il obtiendrait toutes les justifications et la mobilisation nécessaires de la part de l'armée gouvernementale pour en finir avec la rébellion tutsi. Si tel est le cas la réalité a dépassé toutes ses espérances. Mais peu importe laquelle des deux cliques, gouvernementale ou FPR, et derrière elles qui, de la France ou des Etats-Unis, avait le plus intérêt à faire ainsi passer le conflit rwandais de la guérilla larvée à la guerre totale. La logique même du capitalisme le veut ainsi : la "paix" n'est qu'un mythe dans le capitalisme, au mieux une pause préparant les prochains affrontements, et en dernière instance la guerre reste son seul mode de vie, la seule manière de régler ses contradictions.
Aujourd'hui les apprentis sorciers font semblant de s'émouvoir devant l'ampleur prise par le brasier qu'ils ont eux-mêmes attisé. Pourtant, pendant des mois, tout ce beau monde à laissé faire le massacre se contentant de déplorer l'"impuissance de l'ONU". Le principe adopté à la mi-mai par le conseil de sécurité de l'ONU -plus d'un mois après le début de la guerre alors qu'on décomptait déjà 500 000 morts !- d'expédier 5 000 hommes dans le cadre de la MINUAR ne devrait pas voir un début de mise en oeuvre avant le mois de juillet ! Même si certains Etats africains de la région se sont dits prêts à fournir les troupes, du côté des grandes puissances, chargées d'assurer l'équipement et les moyens financiers, c'est la lenteur et l'apathie qui ont présidé, faisant s'indigner le responsable de la MINUAR : "c'est comme si nous étions devenus totalement insensibles, comme si cela nous était devenu indifférent." Ce à quoi rétorquaient les diplomates du conseil de sécurité : "de toutes façons le gros des massacres est passé, il faut attendre la suite." Les autres résolutions de l'ONU, censées mettre fin à l'alimentation de la guerre et aux livraisons d'armes à partir de l'Ouganda et du Zaïre, n'ont eu pas plus d'effet. Et pour cause, cette " impuissance", c'est la même qui règne dans la guerre en Bosnie. Elle ne fait que refléter les divergences d'intérêts impérialistes qui divisent ceux qui se font passer pour des forces de "maintien de la paix".
C'est de la bouche du gouvernement français que le sursaut militaro-humanitaire a refait surface en juin, après l'adoption d'un cessez-le-feu immédiatement violé. "On ne peut plus supporter ça" a clamé le ministre français des Affaires étrangères, et de proposer une intervention, "dans le cadre de l'ONU", mais à condition que l'opération soit menée sous le commandement direct de l'État français. L'initiative a évidemment provoqué une réaction immédiate des représentants du FPR s'indignant que « la France ne peut arrêter le génocide qu'elle a aidé à mettre en action. » Quant aux autres "grands" ils freinent des quatre fers, Etats-Unis en tête. D'une part parce qu'il ne fait pas de doute que si la France veut prendre la direction des opérations, c'est bien pour s'assurer la conservation de son rôle de puissance dominante dans le pays et dans le but de peser de tout son poids pour arrêter la progression du FPR. D'autre part, parce que les USA, de leur côté, non seulement s'appuient justement sur le dit FPR sur le terrain, mais tiennent plus généralement à faire entendre qu'il n'est pas question qu'une autre puissance qu'eux-mêmes prétende s'arroger le rôle du gendarme. Voilà les véritables ressorts de cette nouvelle vague de gesticulations " humanitaires", le sort des populations massacrées n'a rien à y voir.
YEMEN : Les calculs stratégiques des grandes puissances
Née de la réunification des deux Yémen il y a 4 ans - dans l'euphorie de l'effondrement du bloc de l'Est, qui laissa brutalement Aden et son parti unique dirigeant le PSY sans parrain - la toute nouvelle République yéménite unifiée n'aura pas fait long feu. La sécession du Sud et le conflit militaire qui opposent à nouveau les deux parties du pays n'est qu'un révélateur de plus de ce que vaut le « nouvel ordre mondial » promis : un monde d'instabilité et de chaos, des Etats qui se déchirent et éclatent sous la pression de la décomposition sociale. Mais comme au Rwanda, comme en Yougoslavie, ce chaos est nourri, alimenté par les puissances impérialistes de la région et au-delà, qui là encore sont bel et bien derrière dans le but d'essayer de tirer les marrons du feu pour leur propre compte.
Régionalement le conflit yéménite est ainsi nourri d'un côté par l'Arabie Saoudite qui reproche les trop grandes sympathies des factions islamistes du Nord avec son menaçant voisin l'Irak et avec le régime soudanais. C'est elle -et derrière elle son puissant allié américain- qui a ainsi attisé et soutenu la clique sécessionniste d'Aden dans le but d'affaiblir les factions yéménites pro irakiennes De l'autre, c'est aussi sa zone d'influence impérialiste régionale que défend Khartoum, en particulier contre son rival local l'Egypte, autre place-forte américaine, en appuyant l'offensive nordiste. Offensive dont l'enjeu n'est autre que le contrôle de la position éminemment stratégique que constitue le port d'Aden, en face de la place-forte française de Djibouti. Et que trouve-t-on derrière le régime militaro islamiste soudanais ? Comme par hasard l'appui discret de la France qui ne fait là qu'apporter la réponse du berger à la bergère, après que l'offensive des Etats-Unis en Somalie est venue menacer sa chasse gardée de Djibouti.
Le bras de fer qui se joue sur le continent africain et au Moyen-Orient entre les grandes puissances, en particulier entre les Etats-Unis et la France, aboutit à cette sordide réalité qui voit d'un côté l'Etat français dénoncer à cor et à cri l'obscurantisme islamiste, quand il sévit en Algérie et déstabilise ses propres zones d'influence avec la bénédiction des Etats-Unis qui soutiennent désormais sans se cacher le FIS. De l'autre côté, c'est Washington qui s'en va dénoncer ce même islamisme quand il contrarie ses prérogatives dans la péninsule arabique, tandis que la France, oubliant ses laïcs états d'âmes, le trouve plutôt à son goût quand il s'agit de défendre ses intérêts impérialistes à l'entrée de la Mer Rouge. Voilà encore une justification idéologique qui s'effondre devant la sordide réalité de l'impérialisme.
BOSNIE : Les missions « pacificatrices » attisent la guerre
C'est le même cynisme, la même duplicité des grandes puissances « civilisatrices » qui se révèlent dans l'enlisement de la guerre en Bosnie ([2] [1614]). Les dernières évolutions de l'imbroglio diplomatico-militaire des principales puissances, tandis que les massacres continuent de plus belle, n'ont fait que confirmer le mensonge du caractère prétendument « humanitaire » de leurs prétentions et le sourd affrontement entre les « grands » qui se joue par populations serbes, croates et musulmanes interposées.
Le théâtre du conflit bosniaque, longtemps terrain privilégié de l'affirmation impérialiste des diverses puissances européennes est aujourd'hui devenue une des pierres angulaire de la contre-offensive américaine. Avec l'ultimatum de l'OTAN et la menace de frappes aériennes sur les forces serbes, Washington est parvenu à reprendre complètement l'initiative, à rabattre les nouvelles prétentions de la Russie à s'engouffrer dans le conflit et à sanctionner l'impuissance totale de la Grande-Bretagne et de la France, qui durent accepter une ingérence américaine qu'elles avaient jusque là refusée et sabotée par tous les moyens. Et ce sont encore les Etats-Unis qui ont marqué des points en parrainant la création d'une fédération croato-musulmane. Du coup les prétentions de l'Allemagne à s'appuyer sur la Croatie pour prendre pied sur les bords de la Méditerranée sont complètement mises sur la touche. Là encore, toutes ces grandes manoeuvres militaro-diplomatiques n'ont pas grand chose à voir avec le "retour de la paix".
Comme nous le disions dans notre précédent numéro : « l'alliance croato-musulmane qu'ils (les Etats-Unis) patronnent - si elle va jusqu'à son terme -va porter l'affrontement avec la Serbie à un niveau supérieur. Les puissances européennes qui viennent de prendre une gifle ne vont pas manquer de jeter de l'huile sur le feu. » Le vote par le Sénat américain, qui s'est prononcé pour la levée de l'embargo sur les armes en Bosnie - et qui a trouvé un appui inattendu de la part d'une poignée d'intellectuels français va-t-en-guerre de salon-, ne peut qu'encourager l'armée bosniaque, déjà réarmée par les bourgeoisie américaine à reprendre l'offensive militaire. Et ce n'est pas le plan européen de partition de la Bosnie, totalement inacceptable par les Musulmans et auquel la Maison blanche - en apparent désaccord avec son Congrès -fait semblant de se rallier qui risque de permettre l'arrêt des massacres. Son prévisible échec, tandis que l'appui de Washington au nouveau front anti-serbe croato-musulman rend inévitable un élargissement de la guerre, ne fait qu'annoncer de nouvelles tueries.
La boucherie qui ensanglante l'ex-Yougoslavie, depuis maintenant trois ans, n'est pas près de se terminer. Elle n'a fait que démontrer à quel point les conflits guerriers et le chaos nés de la décomposition du capitalisme se trouvent attisés par les menées des grands impérialismes. Et aussi, qu'au bout du compte, au nom du « devoir d'ingérence humanitaire », la seule alternative qu'ils aient, les uns et les autres, à proposer, c'est la suivante : soit bombarder les forces serbes, soit envoyer plus d'armes aux bosniaques. En d'autres termes, face au chaos guerrier que provoque la décomposition du système capitaliste, la seule réponse que celui-ci ait à donner, de la part des pays les plus puissants et les plus industrialisés, c'est d'y ajouter encore plus de guerre.
COREE : Vers de nouveaux déchaînements militaires
Tandis que les foyers de conflits se multiplient, un autre brasier couve avec la Corée du Nord, qui prétend se doter d'un embryon d'arsenal nucléaire. La réaction des Etats-Unis qui ont engagé le bras de fer avec Pyongyang menaçant celle-ci d'une escalade de sanctions, nous est encore une fois présentée comme l'attitude responsable de puissances « civilisées » soucieuses de combattre la course aux armements et de défendre la paix. En fait, cette « crise majeure », n'est pas sans rappeler le bras de fer engagé par ces mêmes Etats-Unis il y a quatre ans face à l'Irak et qui déboucha sur la boucherie de la guerre du Golfe. Et, comme à l'époque, les prétentions d'une Corée du Nord -qui est déjà un des pays les plus militarisés du monde, fort d'une armée d'un million d'hommes - à enrichir son énorme arsenal d'un « plus » nucléaire, ne sont fondamentalement qu'un prétexte.
Derrière la « crise coréenne » et l'intox médiatique sur les risques d'agression de Pyongyang sur son voisin du Sud, il y a fondamentalement la réaction américaine à la menace sur son hégémonie et son statut de gendarme du monde que fait peser l'alliance qui se noue entre les deux géants de la région : la Chine et le Japon. Les premiers visés dans cette affaire, à travers la détermination affichée par Washington à « aller jusqu'au bout s'il le faut », sont bien moins le régime de Pyongyang que ces deux derniers pays. Elle fait partie de la pression appuyée de la Maison blanche sur la Chine qui, tendant d'une main la carotte, avec le maintien de la « clause de la nation la plus favorisée » accordée à Pékin, brandit de l'autre le bâton, en s'attaquant à son petit protégé nord coréen.
L'objectif, en faisant volontairement monter la tension avec la Corée, est de contraindre la Chine et le Japon à se ranger derrière eux, d'obliger Pékin à se désolidariser de Pyongyang, et mettre à mal l'axe sino-japonais et toute velléité de politique indépendante de la part de ces deux pays. Exactement comme lors de la crise du Golfe, où les Etats-Unis avaient eux même provoqué la crise en encourageant les visées de Saddam Hussein sur le Koweït, dans le seul but de contraindre les puissances européennes à se ranger derrière eux et, contre leurs propres intérêts au Moyen Orient, à faire acte d'allégeance devant la toute puissance militaire américaine. L'opération avait parfaitement réussi alors. Les velléités d'affirmations impérialistes de ses rivaux européens avaient été un temps étouffées au prix d'une ignoble boucherie.
Que les Etats-Unis aillent jusqu'au bout cette fois-ci, que, rééditant leur « exploit » sanglant, ils mettent une fois de plus en branle leur énorme machinerie guerrière, dans le seul but de faire plier les puissances d'Asie à leurs diktats, n'est pas encore dit. En tout cas cette nouvelle crise montre l'avenir que prépare le capitalisme.
LE CAPITALISME C'EST LA GUERRE
Les cérémonies commémorant le « D day » avaient elles aussi pour but de rappeler à tous ceux qui seraient tentés de passer outre, que ce sont les Etats-Unis qui entendent faire la loi dans le monde en 1994, comme en 1944. Ainsi la gifle adressée à l'Allemagne, ostensiblement exclue des festivités, est venue sèchement lui rappeler sa position de vaincue de la seconde guerre mondiale et lui faire entendre qu'il serait mal venu de sa part de prétendre obtenir un autre statut dans le rapport de forces impérialiste actuel. L'absence encore plus remarquée de la Russie -qui n'a pas manqué de protester contre un tel oubli de sa participation à la victoire de 1945 et aux millions de prolétaires qu'elle avait sacrifiés sur l'autel de la boucherie mondiale- entendait bien aussi rabattre le caquet aux prétentions de Moscou à retrouver place au premier rang des puissances mondiales. Quant aux risettes hypocrites que se sont mutuellement adressés les invités de la fête, clamant leur volonté commune d'agir « pour la paix » elles cachaient décidément mal la sordide réalité des conflits qui les opposent aux quatre coins de la planète.
Il n'y aura pas de pause dans le rythme des foyers guerriers de par le monde. La guerre est inscrite depuis sa naissance dans l'histoire du capitalisme. Elle devient le mode de vie permanent de ce système à l'heure de sa décomposition. On veut nous faire croire qu'il s'agit d'une fatalité, qu'on est impuissant et que le mieux à faire encore est de s'en remettre à la bonne volonté des grandes puissances et de leurs efforts pour en limiter les effets les plus dévastateurs. Rien n'est plus faux. Comme on vient de le voir, ce sont elles les premiers fauteurs de guerre de part le monde. Et pour une raison bien simple : ce chaos guerrier et ce déchaînement du militarisme trouvent leurs fondements dans la faillite même de l'économie capitaliste.
LA REPONSE EST ENTRE LES MAINS DU PROLETARIAT
La barbarie guerrière, qui se répand dans les zones les plus sous-développées de la planète, a pour pendant la misère et le chômage massif, qui s'étendent désormais à l'autre pôle de la planète, dans les grands pays industrialisées. Guerre permanente et plongée catastrophique dans la crise économique sont, l'une et l'autre, des manifestations de la même faillite totale du système capitaliste. Oui, il est impuissant à résoudre ces fléaux. Tout au contraire, en continuant à pourrir sur pied, le capitalisme n'a d'autre chose à offrir que toujours plus de misère, de chômage et de guerres.
La réponse à l'avenir effroyable que nous promet le capitalisme existe. Elle est entre les mains de la classe ouvrière internationale et d'elle seule. Il appartient en particulier aux prolétaires des pays les plus industrialisés, qui subissent de plein fouet les conséquences dramatiques de la crise de ce système, d'y répondre par la lutte sur leur terrain de classe, de la manière la plus déterminée, la plus unie, la plus consciente.
Au sentiment d'impuissance face à la barbarie que veut lui inoculer la classe dominante, à ses tentatives de l'entraîner derrière elle dans ses aventures guerrières, la classe ouvrière doit répondre par le développement de sa riposte de classe aux attaques capitalistes. Cette riposte, et elle seule, est une réponse à la barbarie de ce système. Parce qu'elle seule porte en elle la possibilité de détruire le capitalisme avant que sa logique meurtrière n'aboutisse à la destruction de l'humanité. L'avenir de l'espèce humaine est entre les mains du prolétariat.
PE, 19/6/1994.
Questions théoriques:
- Décomposition [3]
- Guerre [129]
Crise économique mondiale : L'étude de l'OCDE sur l'emploi
- 3873 reads
LE CYNISME DE LA BOURGEOISIE DECADENTE
La bourgeoisie a conscience qu'elle s'installe dans la crise. La faiblesse momentanée de la classe ouvrière internationale lui permet de tenir le langage cynique d'une classe historiquement moribonde qui sait qu'elle ne peut survivre qu'en intensifiant l'oppression et l'exploitation.
Les médecins ont parlé. Les économistes « experts » du Secrétariat de l'OCDE ([1] [1617]), après deux ans de réflexion intense, déclarent avoir rempli « le mandat que leur ont confié les Ministres en mai 1992. » L'objet de l'examen : le chômage, hypocritement appelé « le problème de l'emploi ». Mais, quel est le diagnostic? Quels sont les remèdes proposés ?
L’Etude commence par tenter de mesurer les symptômes. « Il y a 35 millions des personnes au chômage dans les pays de l'OCDE. Quinze millions d'autres, peut-être, ont soit renoncé à chercher du travail, soit accepté faute de mieux un emploi à temps partiel. » La mesure de la maladie est déjà elle-même problématique : la définition du chômage est souvent différente suivant les pays et, dans tous les cas, elle sous-estime la réalité pour des raisons politiques évidentes. Mais, même avec ces déformations les chiffres sont sans précédent : 50 millions de personnes touchées directement par le problème du chômage, cela équivaut presque à la totalité de la population active de l'Allemagne et de la France ensemble !
Comment expliquent les médecins « experts » qu'on en soit arrivés là, eux pour qui le système capitaliste est éternel et est supposé connaître une nouvelle jeunesse depuis l'effondrement du stalinisme ?
« L'émergence d'un chômage à grande échelle en Europe, au Canada et en Australie et la prolifération d'emplois médiocres alliée à l'apparition du chômage aux Etats-Unis ont donc une seule et même cause profonde : l'incapacité de s'adapter de manière satisfaisante au changement. »
Quel changement ? « (...) Les technologies nouvelles, la globalisation et la concurrence intense qui s'exerce au niveau national et international. Les politiques et les systèmes en place ont rendu les économies rigides et paralysé la capacité, voire la volonté d'adaptation. »
En quoi consiste cette « inadaptation », cette « rigidité » ? Les naïfs qui croient encore que les économistes sont autre chose que des charlatans de mauvaise foi chargés de «justifier» le capitalisme, auraient pu s'attendre à ce qu'on parle de la rigidité de lois qui, par exemple, contraignent à payer les agriculteurs pour qu'ils ne cultivent pas la terre, ou à fermer des milliers d'usines en parfait état de marche alors que la misère ne cesse d'étendre sur la planète. Mais, pas du tout. Les rigidités dont parlent nos médecins sont au contraire celles qui peuvent gêner le libre et impitoyable jeu des lois capitalistes, ces lois qui plongent l'humanité dans un chaos croissant.
L’Etude illustre cyniquement ce point de vue par les remèdes, les « recommandations » qu'elle formule :
« ... Supprimer toute connotation négative, dans l'opinion publique, à l'égard des défaillances d'entreprises... Accroître la flexibilité du temps de travail...
Accroître la flexibilité des salaires, réduire les coûts de main-d'oeuvre non salariaux...
Réévaluer le rôle des salaires minimums légaux... en modulant suffisamment les taux de salaire en fonction de l'âge et des régions... Introduire des "clauses de renégociation " qui permettent de renégocier à un niveau inférieur des conventions collectives conclues à un niveau supérieur... Réduire les coûts de main d'oeuvre non-salariaux... en allégeant les prélèvements au titre du facteur travail (impôts payés par les patrons, NDLR) remplaçant ce type de prélèvements par d'autres impôts, notamment sur la consommation ou le revenu (impôts payés principalement par les travailleurs). Fixer les rémunérations offertes dans le cadre des programmes de création d'emplois à un niveau inférieur à celles que le participant pourrait obtenir sur le marché du travail afin de l'inciter à continuer de chercher un emploi régulier...
Les systèmes (d'assurance chômage) ont fini par constituer une garantie de revenu quasi permanente dans beaucoup de pays, ce qui n'incite pas à travailler...
Limiter la durée de versement des prestations de chômage dans les pays où elle est particulièrement longue... »
Rarement la bourgeoisie s'était permis de tenir un langage aussi brutal à une échelle aussi importante. Les conclusions de l'OCDE ne diffèrent pas sur le fond de celles formulées par les « experts » de l'Union européenne ou par le président américain lors du dernier G7 ([2] [1618]). L’Etude devra servir de base aux travaux de la prochaine réunion du G7, consacrée une fois encore au problème du chômage.
La classe dominante connaît la puissance que lui donne le chantage au chômage sur la classe exploitée, elle connaît la difficulté à laquelle se heurte la classe ouvrière dans tous les pays pour retrouver le chemin de la lutte. Et cela lui permet d'élever le ton. De parler un langage sans fioritures.
En réalité, dans la pratique tous les gouvernements du monde, à des degrés divers, appliquent déjà de telles politiques. Ce qu'annonce ce document c'est simplement une aggravation de cette orientation.
Quelle efficacité peuvent avoir les « remèdes » proposés ?
Il n'y a pas d'adaptation saine du capitalisme aux changements que lui même provoque au niveau de la productivité technique du travail et de l'interdépendance de l'économie mondiale.
L'intensification de la concurrence entre capitalistes, exacerbée par la crise de surproduction et la rareté de marchés solvables, pousse ceux-ci à une modernisation à outrance des processus de production, remplaçant des hommes par des machines, dans une course effrénée à la «baisse des coûts». Cette même course les conduit à déplacer une partie de la production vers des pays où la main d'oeuvre est meilleur marché (Chine et Sud Est asiatique actuellement, par exemple).
Mais, ce faisant, les capitalistes ne résolvent pas le problème chronique du manque de débouchés qui frappe l'ensemble de l'économie mondiale. Tout au plus permet-il à certains de survivre aux dépens des autres, mais du point de vue global le problème ne s'en trouve qu'aggravé.
Là où il y a inadaptation ce n'est pas entre le capitalisme et la politique des gouvernements, qui ont tous depuis ^longtemps entrepris de s'attaquer progressivement au niveau de vie des exploités des pays les plus industrialisés. "L'inadaptation est entre la réalité des capacités techniques de la société : productivité du travail, explosion des communications, internationalisation de la vie économique, d'une part, et la subsistances des lois capitalistes, les lois de l'échange, du salariat, de la propriété privée individuelle ou étatique, d'autre part. C'est le capitalisme lui-même qui est devenu inadapté aux capacités et nécessités de l'humanité.
Comme le disait le Manifeste communiste : « Les institutions bourgeoises sont devenues trop étroites pour contenir la richesse qu'elles ont créée. »
Le seul intérêt du « nouveau » discours de la classe dominante c'est qu'il reconnaît que celle-ci est confrontée à une crise économique destinée à durer. Même si les bourgeois pensent toujours que leur système est éternel, même s'ils reparlent de nouvelle reprise de l'économie mondiale, ils admettent aujourd'hui que celui-ci est condamné, du
moins pour les prochaines années à vivre dans une situation où le chômage massif continuera d'être une constante, que le processus qui a vu le nombre de chômeurs sur la planète augmenter de façon continue depuis un quart de siècle est loin de pouvoir être arrêté.
L'Etude fait encore preuve d'une certaine lucidité lorsqu'elle envisage l'avenir social : « Certaines personnes ne seront pas capables de s'adapter aux impératifs d'une économie qui progresse... (Ils auraient du écrire : d'une économie dont la maladie mortelle progresse). Leur exclusion du grand courant des activités économiques risque de provoquer des tensions sociales qui pourraient être lourdes de conséquences sur les plans humain et économique ».
Ce que ne voient pas et ne peuvent voir ce « experts » c'est que ces « tensions sociales » sont porteuses de la seule issue pour l'humanité et que les « conséquences sur les plans humain et économique » peuvent être la révolution communiste mondiale.
18 juin 1994, RV
VERS UNE NOUVELLE TOURMENTE FINANCIERE
L'énorme effort d'endettement consenti par les Etats des principales puissances pour lutter contre la récession est en train d'ébranler le monstrueux et instable système financier international. L'anémique « reprise » annoncée, qui devait venir soulager l'aggravation des conditions d'existence des prolétaires s'en trouve, une fois encore, compromise.
La récession où s'enfonce le capitalisme mondial depuis le début des années 1990 fait connaître à la classe ouvrière la pire dégradation de ses conditions d'existence depuis la deuxième guerre mondiale. Les gouvernements annoncent cependant « la fin de la récession ». Ils prédisent des sacrifices supplémentaires pour les exploités, comme toujours, mais aussi, un renversement de la tendance dans le bon sens: le retour de la croissance, des emplois, la prospérité.
Est-ce vrai?
Il est vrai que les gouvernements ont fait des efforts pour limiter le désastre, freiner l'hémorragie d'emplois, faire reamarrer certains secteurs. Les résultats nt anémiques, là où ils ont eu le plus efficacité (Etats Unis, Canada, Grande
Bretagne) et à peine perceptibles en Europe ou au Japon.
Mais les remèdes employés par les gouvernements pour redonner un peu de tonus au corps défaillant de leur économie, en particulier l'accroissement de l'endettement public, sont en train de se transformer en un dangereux poison pour le système financier.
Depuis quatre ans, pour financer la lutte contre la récession, pour pallier au manque de débouchés solvables qui paralyse la croissance, les gouvernements des principales puissances ont eu recours à des augmentations massives de la dette publique. (Voir graphiques)
Le phénomène a pris une telle ampleur qu'il est devenu un des principaux facteurs de déstabilisation de l'appareil financier.
Les autorités monétaires ne cessent d'adresser des mises en garde aux Etats et aux organisations gouvernementales... « qui lèvent des fonds en nombre croissant et pour des montants toujours plus élevés. Le risque est grand que les autres candidats à l'emprunt soient évincés. Les gouvernements pourraient bien finir par occuper presque tout le terrain et donc pratiquement interdire l'accès du marché international à la plupart des entreprises industrielles et commerciales. » ([3] [1619])
La demande de crédits à long terme se trouve ainsi violemment augmentée entraînant une hausse du coût de ces crédits, c'est-à-dire des taux d'intérêt à long terme.
Dette publique brute
(pourcentage du PIB)
Au début juin 1994 le journal Le monde pouvait constater: « Depuis la fin 1993 les taux d'intérêt à long terme allemands ont fortement progressé (de 5,54 à près de 7 %).La hausse a encore été plus forte en France (de 5,63 à 7,30 %) ou, pis encore au Royaume-Uni (de 6,18 à 8,30 %) » ([4] [1620]) Aux Etats-Unis le rendement des bons du Trésor sur 30 ans, est passé de 6,4 au début de l'année à 7,3 % mi-juin.
Du coup on commence à parler de début de panique financière. Pourquoi ? A un premier niveau, celui de la spéculation boursière, parce que cela se traduit mécaniquement par une dévaluation correspondante d'une part énorme des placements financiers : les obligations. Cette dévaluation se répercute inévitablement tôt ou tard sur la valeur des actions elles-mêmes, ne fut-ce que parce de nombreux possesseurs d'obligations sont obligés de vendre des actions afin de couvrir leurs pertes. ([5] [1621]) De façon générale, la spéculation se fait à crédit, et M toute hausse des taux d'intérêt, du coût || de l'argent pour spéculer, provoque des //secousses boursières.
Mais c'est au niveau de l'économie réelle que les conséquences de la hausse des taux d'intérêt à long terme sont les plus destructrices. Ces taux commandent aux investissements à long terme, c'est-à-dire aux investissements sur lesquels doit reposer une reprise économique : investissement d'équipement industriel, logements. Alors que les gouvernements s'efforcent d'encourager ce type d'investissements pour assurer la /relance de l'économie, la hausse des taux d'intérêt contrecarre frontalement [cette possibilité. Cet effet de frein est d'autant plus puissant que l'inflation étant généralement faible, les hausses des taux d'intérêt en termes réels sont d'autant plus lourdes.
L'inquiétude croissante des milieux financiers et gouvernementaux n'est pas feinte. La proposition formulée par Jacques Delors de constituer au niveau mondial une sorte de Conseil de sécurité économique, pour faire face à d'éventuelles crises financières mondiales, comme le Conseil de sécurité de l'ONU fait face aux crises militaires internationales, en dit long sur le sujet.
Le monde financier n'est que la surface de la réalité économique. Mais c'est dans cette surface que se manifeste le capital sous sa forme la plus abstraite. C'est là qu'il trouve toute sa spécificité historique. C'est là que le capital s'oriente, s'investit et se ruine.
Les difficultés financières du capitalisme mondial ne sont que la manifestation des contradictions profondes qui déchirent le capitalisme lui-même. C'est ien trichant avec ses propres lois, en (particulier au niveau financier, que le (capitalisme est parvenu à survivre depuis un quart de siècle. Depuis l'effondrement du bloc de l'Est, cette tendance n'a fait que se développer. ([6] [1622]) La spéculation a pris une ampleur sans précédent historique transformant une partie de la machine financière en un inextricable casino électronique que plus personne ne peut contrôler véritablement. La dette des Etats, la dette des agents supposés maintenir « l'ordre » est devenue le principal facteur de désordre.
Non. Le « retournement de tendance » que promettent les gouvernements aux exploités pour justifier les sacrifices imposés, est condamné à faire long feu. La tendance de fond de l'économie capitaliste mondiale vers le marasme et la misère ne fait que se confirmer annonçant de nouvelles convulsions à tous les niveaux.
RV.
[1] [1623] Organisation de coopération et de développement économique. Elle regroupe les 24 pays les plus industrialisés de l'ex-bloc américain (tous les pays d'Europe occidentale, les Etats-Unis et le Canada, le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Le Mexique est en cour d'intégration
[2] [1624] Voir l'article «r L'explosion du chômage » dans le numéro précédent de cette revue.
[3] [1625] Le monde, 29 mai 94.
[4] [1626] Le monde, 12 juin 94.
[5] [1627] La bourse de Paris, qui connaît une sorte de krach étalé dans le temps depuis quelques mois, a été particulièrement victime de ce mécanisme.
[6] [1628] Même si c'est dans les grandes puissances occidentales que se concentre le jeu financier mondial, la situation financière n'est pas pour autant plus saine dans le reste du monde. L'évolution de la situation en Russie est à elle seule une bombe à retardement : « (...) sur l'ensemble de la Russie, les prêts à moins de trois mois représentent 96 % du total des crédits accordés. Les taux d'intérêt sont faramineux : 25 % par mois au minimum. Et les ratios de bilan deviennent fous : 513 milliards de roubles de capitaux propres, pour l'ensemble des banques commerciales... contre 16 000 milliards de crédits distribués. Soit une rapport de 1 à 31. Sur l'ensemble de la Russie les impayés se sont accrus de 559 % de janvier à septembre ; ils représentent aujourd'hui 21 % de l'encours de crédit distribué.
C'est ainsi, bien sûr, que s'annoncent les catastrophes financières. » Libération, 9 décembre 93.
Récent et en cours:
- Crise économique [28]
Questions théoriques:
- Décadence [32]
Les commémorations de 1944 : 50 ans de mensonges impérialistes (1e partie)
- 3574 reads
Jamais la commémoration du débarquement du 6 juin 1944 n'aura connu une telle intensité. Jamais la victoire des impérialistes « Alliés » en Europe n'aura donné lieu à tant de bourrage de crâne médiatique. Un tel battage vise une nouvelle fois à masquer le caractère impérialiste du second holocauste mondial, tout comme le premier. Non contente d'agiter à nouveau l'épouvantail fasciste, la bourgeoisie se sert des miasmes de sa société en décomposition. A commencer par l'Allemagne, peu après l'effondrement du mur de Berlin, une publicité croissante allait mettre en vedette les partisans du retour de la « germanité » derrière les exactions de bandes de voyous au crâne rasé. Le meurtre et les incendies de foyers de la communauté turque ont servi de toile de fond pour diaboliser ces ennemis de la « démocratie » héritiers de la « peste brune », grossissant jusqu'à aujourd'hui ces bagarres de rues de voyous néonazis contre des prolétaires immigrés. Grossi à la loupe des médias cela devient de nouvelles « scènes de chasse aux étrangers » à Magdebourg..., sous-entendu comme les ennemis hitlériens de la démocratie dans les années 1930. Quand, en Italie, le démagogue Berlusconi associe cinq ministres d'extrême-droite et que peu après la municipalité de Vicence autorise un défilé d'une centaine de « néonazis » avec croix gammées, la classe politique bourgeoise crie son émotion devant cette nouvelle « marche sur Rome ». En fait de « marche sur Rome », la gauche de la bourgeoisie a réussi à entraîner, malgré la pluie, 300 000 personnes le 25 avril 1994 derrière le drapeau de l'anti-fascisme ! Les simplismes habituels de l'ordre dominant depuis 1945 se donnent libre cours.
En France les chefs des PS et PC brandissent la menace fasciste après de longues années où la gauche au pouvoir a agité l'épouvantail du politicien d'extrême-droite Le Pen. Pour parfaire le tableau de la menace du resurgissement de la « bête immonde », une visite souvenir d'une dizaine de vétérans de la Waffen SS sur les plages de Normandie vient figurer la montée en puissance des ennemis de la démocratie.
Près de 50 millions de morts tous pays confondus sont invoqués comme victimes exclusives de la « barbarie nazie ». De CNN au moindre journal régional, plus c'est gros mieux çà passe ! Dans la plupart des pays d'Europe, les moindres faits et gestes de ces groupuscules de voyous sont montés en mayonnaise. Hollywood fournit à point nommé un film qui s'appesantit sur le seul massacre des Juifs d'Europe et exalte le dévouement des braves GI's tombés par milliers sur les plages de Normandie au nom de la « liberté ».
Ces festivités militaristes esquivent soigneusement les crimes des grandes « démocraties victorieuses » qui, lorsqu'on les connaît ([1] [1629]), placent incontestablement les chefs démocratiques sur la même stèle de barbarie que Hitler, Mussolini et Hirohito. Mais déjà dire cela est faire une concession au mensonge dominant sur la personnification des « crimes de guerre ». C'est une classe sociale, la bourgeoisie, qui est la principale criminelle de guerre. Les dictateurs ne sont que ses sous-fifres. Quand le sinistre Goebbels assurait qu'un mensonge répété à outrance finit par devenir une vérité, son vis-à-vis le cynique Churchill renchérissait : « En temps de guerre la vérité est si précieuse qu'elle devrait toujours être préservée par un rempart de mensonges ». ([2] [1630])
La victoire d'Hitler
Pourtant la plupart des combattants enrôlés dans les deux camps ne sont pas partis la fleur au fusil, encore tétanisés par la mort de leurs pères à peine 25 ans auparavant. L'exode massif en France, la terreur de l'Etat nazi encadrant la population allemande, les déportations massives de l'Etat capitaliste stalinien, rien de tout cela ne transpire des « actualités » nasillardes de l'époque qu'on nous ressert aujourd'hui. Un seul nom apparaît en lettres géantes dans tous les commentaires et filmographies « objectives » mais abjectes : HITLER. Au Moyen Age il y avait LA PESTE comme explication du fléau de Dieu. En plein milieu de l'ère capitaliste décadente, la bourgeoisie a trouvé l'équivalent pour le Dieu « Démocratie » : LA PESTE BRUNE. Les classes dominantes successives de l'histoire de l'humanité ont toujours eu recours à l'invocation d'un haut mal pour fabriquer un intérêt commun aux classes opprimées et à leurs exploiteurs. Un proverbe chinois résume fort bien la chose : « quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt ». La personnification des événements autour du nom des dictateurs ou des généraux Alliés est au demeurant très utile pour gommer l'idée qu'ils n'étaient que les porte-voix de leur bourgeoisie respective, et pour faire disparaître par la magie des noms, toute idée de classes au moment de la guerre ; tout le monde ne peut être qu'uni derrière la nouvelle croisade contre le MAL.
L'année de l'accession au pouvoir de l'élu bourgeois Hitler, 1933, est une année-clé, comme l'ont souligné les révolutionnaires qui publiaient la revue Bilan, non parce qu'elle signait « l'échec des démocraties », mais parce qu'elle signifiait la victoire décisive de la contre-révolution, en particulier dans le pays où le prolétariat est le plus important traditionnellement dans le mouvement ouvrier. Ce n'est pas simplement l'humiliant traité de Versailles de 1918, dont l'exigence de « réparations » mettait à genoux l'Allemagne, qui expliquait la venue au pouvoir d'Hitler, mais la disparition de la scène sociale du prolétariat comme menace pour la bourgeoisie.
En Russie, les massacres par l'Etat russe, des bolcheviks et ouvriers révolutionnaires, commençaient à prendre de l'ampleur, avec l'approbation muette des démocraties occidentales qui avaient tant fait pour armer les armées blanches. En Allemagne, c'est le régime social-démocrate de la République de Weimar qui avait passé tout naturellement le relais aux hitlériens, vainqueurs des élections républicaines. Les chefs « socialistes », massacreurs des ouvriers révolutionnaires allemands, les Scheidemann, Noske et tutti quanti, abandonnaient démocratiquement leurs postes ministériels ; ils ne furent jamais inquiétés personnellement pendant les cinq années du régime hitlérien.
Les luttes en France et en Espagne aux cours des années 1930 ne furent que des queues de grève face à l'ampleur de la défaite internationale de la classe ouvrière. La victoire électorale du fascisme en Italie et en Allemagne n'était pas la cause, mais le produit de la défaite du prolétariat sur son terrain social. La bourgeoisie en sécrétant le fascisme ne produisait pas un régime original, mais une forme capitaliste d'Etat dans la même lignée que le Welfare State de Roosevelt et du capitalisme stalinien. En période de guerre, les fractions bourgeoises s'unissent naturellement au niveau national puisqu'elles ont éliminé mondialement la menace du prolétariat, et cette unification peut prendre la forme du parti stalinien ou nazi.
En complicité avec la bourgeoisie russe et son Staline, la « montée des périls » est organisée par la plupart des PC inféodés au nouvel impérialisme russe, sous couvert de l'idéologie des Fronts Populaires qui permettent de maintenir les ouvriers désorientés derrière les programmes d'union nationale et de préparation à la guerre impérialiste.
Le PCF avait annoncé la couleur tricolore dès 1935 lors du pacte Laval-Staline, s'engageant à ce que les ouvriers aillent se faire massacrer : « Si Hitler, malgré tout, déclenchait la guerre, qu'il sache bien qu'il trouverait devant lui le peuple de France uni, les communistes au premier rang, pour défendre la sécurité du pays, la liberté et l'indépendance des peuples ». Ce sont les PC qui brisent les dernières grèves et qui confrontent et tirent sur les ouvriers en Espagne avec l'aide de la Guepeou, avant que les franquistes ne parachèvent la sale besogne. Puis les dirigeants staliniens se réfugient en France et en Russie, comme les De Gaulle et Thorez qui ne manqueront pas de suivre cet exemple, l'un à Londres, l'autre à Moscou.
La marche à la guerre imperialiste
De 1918 à 1935, les guerres n'avaient pas cessé dans le monde, mais il s'agissait de guerres limitées, éloignées de l'Europe, ou de guerres de « pacification » du type de celles du colonialisme français (Syrie, Maroc, Indochine). Pour les révolutionnaires qui publient Bilan, la première alerte grave est signifiée par la guerre d'Ethiopie qui met en présence l'impérialisme britannique et l'armée de Mussolini. Elle sert à une partie des alliés occidentaux à confondre fascisme et guerre. Le fascisme devient ainsi le principal fauteur de la prochaine guerre mondiale. L'épouvantail fasciste sera donc confirmé avec la victoire de l'armée franquiste en 1939. Le battage idéologique trouve sa concrétisation sanglante en exhibant les centaines de milliers de victimes du franquisme. Une période de statu quo va suivre, au nom de la recherche de la « paix », quand l'Allemagne annexe la Rhénanie, puis l'Autriche en 1938, puis la Bohème en 1939. Lorsque la Tchécoslovaquie est envahie le 27 septembre 1938 par l'armée allemande, les futurs Alliés ne bougent pas pour renchérir leur mensonge de « paix à tout prix ». Le 1er octobre se tient la conférence de Munich où la Tchécoslovaquie n'est pas invitée... De retour de cette sinistre parodie de conférence de la paix, le premier ministre français Daladier, chaleureusement accueilli par la foule, n'est pas dupe et sait que chaque camp en présence joue la montre. Les historiens officiels se contentent d'invoquer le retard de réarmement des Etats français et anglais alors qu'en fait, en sous-main, le jeu des alliances n'était pas encore véritablement tranché et que la bourgeoisie allemande caressait l'espoir de faire front commun avec la France et l'Angleterre. Pendant ce temps, les foules sont aussi abusées en Allemagne et en Angleterre qu'en France :
« (...) Les Allemands acclament follement Chamberlain en lequel ils voient, eux aussi, l'homme qui va les sauver de la guerre. Il y a plus de monde pour le saluer qu'il n'y en avait pour saluer Mussolini. (...) A Munich pavoisé de drapeaux anglais, c'est le délire. A l'aéroport d'Heston, on accueille également Chamberlain comme le messie. A Paris, on propose une souscription publique pour offrir un cadeau au premier ministre anglais ». ([3] [1631])
En 1937 a commencé la guerre sino-japonaise qui menace l'hégémonie américaine dans le Pacifique. Le 24 août 1939 est le coup de tonnerre qui fait basculer dans l'abîme. Le pacte Hitler-Staline laisse les mains libres à l'Etat allemand pour foncer vers l'Europe de l'ouest. En attendant, la Pologne est envahie le 1er septembre par l'armée allemande, mais aussi pour partie par l'armée russe. Piteux, les Etats anglais et français déclarent la guerre en bonne et due forme à l'Allemagne, deux jours après. L'armée italienne s'est emparée de l'Albanie. Sans déclaration de guerre, l'armée de Staline envahit la Finlande le 30 novembre. Pendant ce temps l'armée allemande débarque en Norvège en avril 1940.
L'armée française commence son offensive dans la Sarre, bientôt bloquée au prix d'un millier de morts de part et d'autre. Ce qui permet à Staline de déclarer, démentant ses partisans chauvins selon lesquels son pacte avec la bourgeoisie allemande était un pacte avec le diable pour lui éviter de s'en prendre à l'Europe :
« Ce n'est pas l'Allemagne qui a attaqué la France et l'Angleterre, mais la France et l'Angleterre qui ont attaqué l'Allemagne (...) Après l'ouverture des hostilités, l'Allemagne a fait des propositions de paix à la France et à l'Angleterre, et l'Union Soviétique a ouvertement soutenu les propositions de paix de l'Allemagne. Les cercles dirigeants de France et d'Angleterre ont brutalement repoussé, tant les propositions de paix de l'Allemagne que les tentatives de l'Union Soviétique de mettre fin rapidement à la guerre ».
Personne ne veut endosser la tunique de fauteur de guerre face au prolétariat. Après la « Libération » il n'existera d'ailleurs plus de ministres « de la guerre » mais uniquement des ministres « de la défense ». Il est aussi frappant de constater ce fait, en Allemagne, que l'Etat nazi tient à apparaître lui aussi comme l'agressé. Le haut dignitaire nazi, Albert Speer, confie dans ses Mémoires une déclaration personnelle d'Hitler : « Nous ne commettrons pas une nouvelle fois l'erreur de 1914. Il s'agit maintenant de rejeter la faute sur l'adversaire ». A la veille de l'affrontement avec le Japon, Roosevelt ne dira pas antre chose : « Les démocraties ne doivent jamais apparaître comme l'agresseur ». Les neuf mois de confrontation l'arme au pied, nommés « drôle de guerre » confirment cette valse-hésitation de tous les belligérants. L'historien Pierre Miquel explique qu'Hitler avait remis l'ordre d'attaque à l'ouest pas moins de quatorze fois en raison de l'impréparation de l'armée allemande et des conditions météorologiques.
Le 22 juin 1941, l'Allemagne se retournera contre la Russie, surprenant totalement le « génial stratège » Staline. Le 8 décembre, après que l'impérialisme américain ait laissé massacrer ses propres soldats à Pearl Harbor (les services secrets savaient l'imminence de l'attaque japonaise), les Etats-Unis, « victimes » de la barbarie nippone, déclareront la guerre au Japon. Enfin l'Allemagne et l'Italie lanceront leur cri guerrier aux Etats-Unis le 11 décembre 1941.
Quelques observations s'imposent, après ce rapide survol de la marche diplomatique à la guerre mondiale dans une situation où le prolétariat mondial est muselé. Deux guerres locales (Ethiopie et Espagne) ont achevé de mettre en accusation le fascisme comme «fauteur de guerre », après des années d'excitation médiatique en Europe contre les exactions et parades hitlériennes et mussoliniennes, qui étaient certes plus ordonnées que les 14 juillet français ou les festivités nationalistes anglaises et américaines, mais non moins ridicules. Deux autres guerres locales au coeur de l'Europe (Tchécoslovaquie et Pologne) ont donné lieu à la défaite extrêmement rapide des deux pays « démocratiques » concernés. La « honteuse » non-intervention pour aider la Tchécoslovaquie (et l'Espagne) a rendu la « défense de la démocratie » et la conception de la liberté bourgeoise incontournables après l'invasion par les deux pays « totalitaires » de la Pologne. Les manoeuvres politico-diplomatiques peuvent traîner pendant des années, le conflit militaire, lui, tranche partiellement en quelques heures sur le terrain au prix d'un massacre inouï. La guerre ne devient mondiale véritablement qu'un an après la conquête de l'Europe par l'armée allemande. Pendant plus de quatre ans les Etats-Unis ne tenteront aucune opération décisive pour contrer les « envahisseurs », laissant la bourgeoisie allemande gendarmer l'Europe. Les Etats-Unis, éloignés du territoire européen, étaient initialement plus préoccupés par la menace japonaise dans le Pacifique. La guerre mondiale connaîtra donc une plus longue durée que les guerres locales, et cette durée ne s'explique pas seulement par la toute-puissance de l'armée allemande ni par les aléas des tractations impérialistes. Elle
est notoire, par exemple, la préférence d'une partie de la bourgeoisie américaine pour s'allier avec la bourgeoisie allemande plutôt qu'avec le «régime communiste » stalinien, tout comme la bourgeoisie allemande avait tenté et attendu en vain de s'allier avec la France et l'Angleterre contre les « Rouges ». En 1940 et en 1941, la bourgeoisie anglaise a été l'objet de propositions de paix par le gouvernement d'Hitler au moment des débuts de l'opération « Barbarossa » contre la Russie, et lors de la défaite de l'armée de Mussolini en Afrique du nord, et elle a hésité d'autant qu'elle pouvait laisser les deux puissances « totalitaires » se détruire mutuellement. En rester là cependant, serait raisonner comme si la principale classe ennemie de toutes les bourgeoisies, le prolétariat, avait disparu des soucis des chefs impérialistes en lice, du fait de la guerre « unificatrice » et... « Simplificatrice » !
De plus, les marxistes ne peuvent raisonner sur la guerre en soi, indépendamment des périodes historiques. La guerre, dans le capitalisme juvénile au 19e siècle fut un moyen indispensable permettant des possibilités de développement ultérieur, ouvrant à coups de canon des marchés. C'est ce que montrait en 1945, la Gauche communiste de France, un des rares groupes ayant maintenu l'étendard de l'internationalisme prolétarien pendant la seconde guerre mondiale, précisant que, par contre : « ...dans sa phase de décadence, le capitalisme ayant épuisé historiquement toutes les possibilités de développement, trouve dans la guerre moderne, la guerre impérialiste, l'expression de cette décadence qui, sans ouvrir aucune possibilité de développement ultérieur pour la production, ne fait qu'engouffrer dans l'abîme les forces productives et accumuler à un rythme accéléré ruines sur ruines. (...) Plus se rétrécit le marché, plus devient âpre la lutte pour la possession des sources de matières premières et la maîtrise du marché mondial. La lutte économique entre divers groupes capitalistes se concentre de plus en plus, prenant la forme la plus achevée des luttes entre Etats. La lutte économique exaspérée entre Etats ne peut finalement se résoudre que par la force militaire. La guerre devient le seul moyen par lequel chaque impérialisme national tend à se dégager des difficultés avec lesquelles il est aux prises, aux dépens des Etats impérialistes rivaux ». ([4] [1632])
L'UNION NATIONALE PENDANT LA GUERRE
Les historiens bourgeois ne s'appesantissent pas sur ce fait : la défaite rapide de l'ancienne grande puissance continentale française. Ce ne sont pas simplement les conditions climatiques qui ont retardé l'attaque de l'armée allemande. L'appareil d'Etat allemand n'a pas choisi Hitler par erreur et n'est pas composé de crétins tout juste bons à marcher au pas de l'oie. La raison principale en est encore une fois le jeu des consultations diplomatiques secrètes. Même en pleine guerre des alliances peuvent être renversées. Au surplus, il existe toujours un souci chez la bourgeoisie allemande, en souvenir de l'insubordination des soldats allemands en 1918, que les soldats n'aient jamais faim... En 1938, la bourgeoisie allemande est l'héritière de la première République de Weimar qui a su écraser dans le sang la tentative de révolution prolétarienne en 1919 ; les bataillons SS sont constitués des anciens « corps francs » démocratiques qui ont massacré les ouvriers insurgés. Ni l'éruption de la Commune de Paris en 1870, ni la révolution d'octobre 1917, ni l'insurrection spartakiste de 1919 n'ont été oubliées. Même défaite politiquement, la classe ouvrière reste la classe dangereuse face à la guerre bourgeoise qui dure.
La rapide victoire de l'impérialisme allemand en Tchécoslovaquie avait été le résultat de la guerre des nerfs, du bluff, de manoeuvres raffinées, et surtout de la spéculation sur la crainte de tous les gouvernements des conséquences d'une guerre trop vite généralisée sans adhésion certaine du prolétariat. Plus avisé que les généraux français demeurés aux vieilles conceptions de la «guerre de position » de 1914, l'Etat-major allemand avait « modernisé » en faveur de la « Blitzkrieg » (guerre-éclair). Avancer lentement sans frapper férocement est, selon cette conception militariste (très prisée de nos jours, voir la guerre du Golfe), gage de défaite. Pire encore, d'autant que les bases d'adhésion des populations sont fragiles, traîner en longueur, laisser le temps aux combattants de s'interpeller par-dessus les tranchées, induit les risques de mutineries et d'explosion sociale. Au 20e siècle, la classe ouvrière devient inévitablement le premier bataillon contre la guerre impérialiste. Hitler, lui-même, confia un jour à son affidé Albert Speer : « l'industrie est un facteur favorable au développement du communisme ». Hitler déclarera même à ce confident, après la mise en vigueur du travail obligatoire en 1943 en France, que l'éventualité de voir surgir des troubles et des grèves qui freineraient la production, est un risque à courir en temps de guerre. La bourgeoisie allemande a donc un réflexe « bismarkien », tout comme Bismark fût confronté à l'insurrection des ouvriers parisiens contre leur propre bourgeoisie, ce qui avait bloqué l'action de l'envahisseur allemand et l'avait inquiété pour les risques de propagation d'une telle révolution parmi les soldats et ouvriers allemands, d'autant que ces mêmes ouvriers allemands avaient réagi de la même manière face à la guerre contre la Russie révolutionnaire, par la guerre civile contre leur propre bourgeoisie.
C'est pourtant une véritable guerre de lassitude qui est menée pendant près d'un an en France, après l'arrêt subit de la première offensive militaire allemande. L'Allemagne veut surtout s'ouvrir un « espace vital » à l'Est et préférerait encore s'allier avec les deux démocraties occidentales plutôt que de gâcher une partie de son potentiel militaire pour les envahir. L'Allemagne apportait son soutien au «parti de la guerre » de Laval et Doriot, anciens pacifistes qui s'étaient réclamés du socialisme. Ces fractions pro-fascistes qui militaient pour l'alliance franco-allemande restaient minoritaires. L'ensemble de la bourgeoisie se méfiait de la non-mobilisation du prolétariat français. Là, le prolétariat n'avait pas été vaincu frontalement à coups de baïonnettes et de lance-flammes en 1918 et 1923 le prolétariat allemand.
La bourgeoisie allemande se doit donc aussi, dans un second temps, d'avancer prudemment face à un pays qu'elle sait fragile pas tant militairement que socialement. En fait elle n'aura qu'à observer la lente décomposition de la bourgeoisie française entre ses lâches militaires et ses pacifistes futurs collaborateurs du régime d'occupation, qui maintiendront dans l'impuissance les ouvriers.
Les fronts populaires avaient contribué à un important effort de réarmement (tout en désarmant politiquement les ouvriers), mais n'avaient pas complètement réussi à réaliser l'union nationale. La police avait certes brisé beaucoup de grèves et interné des centaines de militants peu clairs eux-mêmes sur comment s'opposer à la guerre. La gauche de la bourgeoisie française avait calmé les ouvriers avec les boniments du Front populaire qui avait accordé les « congés payés » aux ouvriers, lesquels avaient été mobilisés pendant ces mêmes vacances. C'est le travail de sape des fractions pacifistes d'extrême-gauche qui permet d'achever toute alternative de classe. Complétant le travail de sabotage des staliniens, les anarchistes encore très influents dans les syndicats, publient le tract « Paix immédiate » en septembre 1939, signé par une brochette d'intellectuels : « (...) Pas de fleurs aux fusils, pas de chants héroïques, pas de bravos au départ des militaires. Et l'on nous assure qu'il en est ainsi chez tous les belligérants. La guerre est donc condamnée dés le premier jour, par la plupart des participants de l'avant et de l'arrière. Alors faisons vite la paix. »
La « paix » ne peut pas être l'alternative à la guerre dans le capitalisme décadent. De telles résolutions ne servent qu'à encourager le sauve-qui-peut, les solutions individuelles de départ à l'étranger pour les plus fortunés. Le désarroi des prolétaires est accru, leur inquiétude et leur impuissance s'articulent sur une débandade généralisée des partis et groupuscules de gauche qui les ont enfermés dans le « bon sens » antifasciste et qui ont prétendu défendre leurs intérêts.
Le délitement de la société française est tel que la « drôle de guerre » d'un côté, « komischer Krieg » de l'autre, n'aura été qu'un intermède permettant à l'armée allemande, peu après le premier grand bombardement meurtrier de Rotterdam (40 000 morts), d'enfoncer le 10 mai 1940 sans résistance la fragile ligne Maginot française. Les officiers de l'armée française fuient les premiers, laissant en plan leurs troupes. Les populations néerlandaise, belge, luxembourgeoise et du nord de la France, y inclus Paris et le Gouvernement, fuient de manière massive, irraisonnée et incontrôlable vers le centre et le sud de la France. Ainsi se produit un des plus gigantesques exodes modernes. Cette absence de « résistance » de la population lui sera d'ailleurs reprochée par les idéologues du « maquis » (dont beaucoup, comme Mitterrand et les chefs « socialistes » belges ou italiens n'ont tourné leur veste qu'à partir de 1942), et après la guerre, pour autoriser tous les chantages pour que la classe ouvrière se sacrifie à la reconstruction.
La Blitzkrieg n'en a pas moins causé 90 000 morts et 120 000 blessés côté français, 27 000 morts côté allemand. La débâcle aura drainé dix millions de personnes dans des conditions épouvantables. Un million et demi de prisonniers sont expédiés en Allemagne. Et c'est peu comparé aux 50 millions de morts de l'holocauste.
En Europe, la population civile subira les pertes les plus importantes que l'humanité ait jamais connue en période de guerre. Jamais autant de femmes et d'enfants n'auront rejoint dans la mort les soldats. Les victimes civiles seront pour la première fois de l'histoire mondiale plus nombreuses que les pertes militaires.
Avec son réflexe « bismarkien », la bourgeoisie allemande prendra soin de diviser en deux la France : une zone occupée, le nord avec la capitale, pour surveiller directement les côtes face à l'Angleterre ; et une zone libre, le sud, légitimée avec le gouvernement du général potiche de Verdun Pétain et l'ancien « socialiste » Laval pour l'honorabilité internationale ; cet Etat collaborateur soulagera un temps l'effort de guerre nazi jusqu'à ce que l'avancée des Alliés amène l'impérialisme allemand à le culbuter.
La crainte permanente d'une levée des ouvriers, même affaiblis, contre la guerre transparaît même chez ceux que la gauche présente comme « anti-sociaux ». Un journal collaborationniste, « L'Oeuvre », parle crûment la nécessité des syndicats - ce soi-disant acquis social du Front populaire- pour l'occupant, et dans les mêmes termes que n'importe quel parti de gauche ou trotskyste : « Les occupants ont le plus vif souci de ne pas dresser contre eux les éléments ouvriers, de ne pas perdre le contact, de les intégrer dans un mouvement social bien organisé (...). Les Allemands souhaitent que tous les ouvriers soient effectivement intégrés au corporatisme et, pour cela, il leur parait que les cadres sont nécessaires, qui aient effectivement la confiance des travailleurs (...) Pour obtenir des hommes qui aient autorité et qui soient effectivement suivis (...) ». ([5] [1633]).
Dès 1941, une partie du gouvernement français collaborateur s'inquiète en effet du caractère provisoire de l'occupation et de la garantie d'ordre qui s'y rattachait. La bourgeoisie avec Pétain, tout autant que sa fraction émigrée, la « France libre » de De Gaulle, plus ou moins en contact discret, auront pour principal souci le maintien de l'ordre politique et social d'une époque à une autre. Sécrétée par sa fraction libérale planquée en Angleterre et par les staliniens français, l'idéologie des bandes armées de résistants -d'un impact très faible- aura tout d'abord de grandes difficultés à attirer les ouvriers dans l'Union nationale en vue de la « Libération ». La bourgeoisie allemande prêtera main-forte, malgré elle, avec « la relève » - l'obligation pour tout ouvrier d'aller travailler en Allemagne en échange du retour d'un prisonnier de guerre -, pour que subitement, en 1943, soient renforcés les rangs de l'action « terroriste » contre « l'occupant ». Mais, fondamentalement, ce sont les partis de gauche et d'extrême-gauche qui réussissent à rameuter les ouvriers en s'appuyant sur « la victoire de Stalingrad ».
Les revirements d'alliances impérialistes et les possibles réactions du prolétariat constituent les lignes d'orientation de la bourgeoisie en pleine guerre. Formellement, le tournant de la guerre contre l'Allemagne a lieu en 1942 avec l'arrêt de l'expansion du Japon et la victoire d'El Alamein qui libère les champs de pétrole. La même année débute la bataille de Stalingrad où l'Etat stalinien ne devra la victoire qu'à l'adjonction des fournitures militaires américaines (tanks et armes plus sophistiquées que la Russie ne pouvait en produire face à la moderne armée allemande). Au cours des négociations secrètes, l'Etat stalinien avait mis dans la balance son accord pour déclarer la guerre au Japon. La guerre aurait pu dès lors s'acheminer rapidement vers sa fin d'autant qu'il existait des velléités non déguisées d'une partie de la bourgeoisie allemande de se débarrasser d'Hitler, dont les tenants tenteront un attentat contre Hitler en juillet 1944, mais seront laissés isolés par les Alliés, et massacrés par l'Etat nazi (le plan Walkyrie avec l'amiral Canaris).
C'était sans compter avec le réveil du prolétariat italien. Il sera donc nécessaire de prolonger deux ans encore la guerre pour massacrer les forces vives du prolétariat et éviter une nouvelle paix précipitée comme en 1918, la révolution aux trousses.
1943 est un tournant dans la guerre, à la suite de l'éruption du prolétariat italien. Au niveau mondial, la bourgeoisie va se servir de l'isolement et de la défaite des ouvriers italiens pour développer la stratégie de la « résistance » dans les pays occupés, afin de faire adhérer les populations « de l'intérieur » à la future paix capitaliste. Alors que jusque là, la plupart des bandes de résistants étaient animées essentiellement par d'infimes minorités d'éléments des couches petites-bourgeoises nationalistes et aux méthodes terroristes, la bourgeoisie anglo-américaine va glorifier l'idéologie de la résistance plus pragmatiquement à la suite de la « victoire de Stalingrad » et des retournements pro-occidentaux des PC. Les ouvriers non prisonniers ne voyaient pas de différence entre l'exploitation par un patron allemand ou un patron français. Ils n'avaient pas eu envie de mourir au nom des alliances impérialistes anglo-françaises pour soutenir la Pologne, ils n'avaient fait aucun effort pour s'impliquer dans la guerre qui leur était restée étrangère. Pour les mobiliser en vue de la défense de la « démocratie » il fallait leur fixer une perspective qui leur parut valable du point de vue de classe. L'exhibition de la victoire de Stalingrad comme le tournant de la guerre, et donc la possibilité de mettre fin tout de même aux exactions militaires de l'occupant, de retrouver « la liberté » même avec les gendarmes autochtones, souleva l'espoir aux côtés du « communisme libérateur » représenté par Staline. Sans l'aide de ce mensonge (et l'opportune relève comme oppression supplémentaire), les ouvriers restaient hostiles aux bandes de résistants armés dont les exactions décuplaient la terreur nazie. Sans le renfort sur le terrain des staliniens et des trotskistes, la bourgeoisie de Londres et Washington n'avait aucune chance de ramener les ouvriers dans la guerre. Contrairement à 1914, il ne s'agit pas d'aligner en rang, au front, les ouvriers pour les envoyer à la boucherie, mais d'obtenir leur adhésion et de les encadrer sur le terrain civil dans les réseaux d'ordre résistant, derrière le culte de la glorieuse bataille de Stalingrad !
En effet, en Italie comme en France, beaucoup d'ouvriers rejoignent le maquis dès cette époque, encouragés dans l'illusion du combat de classe retrouvé, et le parti stalinien et les trotskistes leur resservent même l'exemple frauduleusement travesti de la Commune de Paris (les ouvriers ne se dressent-ils pas contre leur propre bourgeoisie menée par le nouveau Thiers, Pétain, alors que les allemands occupent la France?). Au milieu d'une population terrorisée et impuissante dans le déchaînement de la guerre, beaucoup d'ouvriers français et européens, embrigadés dans les bandes de résistants, vont désormais se faire tuer en croyant se battre pour la « libération socialiste » de la France ou de l'Italie, en somme dans une nouvelle « guerre civile contre sa propre bourgeoisie » ; tout comme on avait envoyé les prolétaires de chaque côté du front en 1914 au nom du fait que la France et l'Allemagne étaient les pays « exportateurs » du socialisme. Les bandes de résistants staliniens et trotskistes concentrent particulièrement leur chantage pour que les ouvriers soient « au premier rang pour la lutte pour l'indépendance des peuples », dans un secteur-clé pour paralyser l'économie, celui des cheminots.
Au même moment, la prééminence des fractions de droite pro-alliés dans les bandes armées, pour la restauration du même ordre capitaliste dans la paix, est l'objet d'un âpre combat, à l'insu des ouvriers. Des équipes d'agents secrets américains de l'AMGOT (Allied Military Government of Occupied Territories) sont envoyées sur le terrain en France et en Italie (c'est l'origine de la loge P2 en totale complicité avec la Mafia), pour veiller à ce que les staliniens n'accaparent pas tout le pouvoir qui leur aurait permis de se rattacher au giron de l'impérialisme russe. De bout en bout les staliniens sauront ainsi à quoi ils devaient s'en tenir, et en particulier dans leur domaine de prédilection, saboter la lutte ouvrière, désarmer les résistants utopistes illuminés, cogner sur les ouvriers hostiles aux exigences de la reconstruction. Dès la « Libération », et comme preuve de l'unité bourgeoise contre le prolétariat, la bourgeoisie occidentale - tout en condamnant pour la galerie une poignée de « criminels de guerre » - recrutera même un certain nombre d'anciens tortionnaires nazis et staliniens pour en faire des agents secrets efficaces dans la plupart des capitales européennes. Ces recrues retournées auront pour tâche en premier lieu évidemment de contrer les séides de l'impérialisme russe, mais surtout de lutter « contre le communisme », c'est-à-dire le but naturel de toute lutte autonome généralisée des ouvriers eux-mêmes, menaçant inévitablement après l'horreur de la guerre et avec la disette aux débuts de la paix capitaliste.
LA DESTRUCTION MASSIVE DU PROLETARIAT
Nous laissons les bourgeois débattre entre eux du nombre respectif de massacres selon les communautés ([6] [1634]), mais il est incontestable qu'il faut commencer par en souligner le principal : les 20 millions de russes tués sur le front européen. Ce sont les grands oubliés des festivités du cinquantenaire du débarquement de juin 1944. Les historiens russes actuels continuent d'ailleurs à accuser les Etats-Unis d'avoir retardé le débarquement en Normandie à la seule fin de saigner davantage l'URSS, en prévision de la guerre froide : « Le débarquement a eu lieu alors que le sort de l'Allemagne était déjà scellé par les contre-offensives soviétiques du front de l'Est». ([7] [1635])
Les bourgeois libéraux, à la fin des fastes de la reconstruction avec leur pape Soljetnitsyne, se sont mis tout à coup à épiloguer sur les millions de morts des Goulags sous Staline, faisant semblant d'oublier que le véritable parachèvement de la contre-révolution a été effectué avec la totale complicité de l'occident... dans la guerre. Nous savons comment la classe bourgeoise est impitoyable après une défaite du prolétariat (des dizaines de milliers de communards et de femmes et enfants ont été massacrés et déportés en 1871). Sa façon de mener la deuxième guerre mondiale lui permit de décupler le massacre de la classe qui lui avait flanqué la trouille en 1917. Les Russes ont supporté seuls le poids de quatre ans de guerre en Europe. Ce n'est qu'au tout début 1945 que les Américains prendront pied en Allemagne, économisant, si on peut dire, les victimes chez eux, et préservant leur paix sociale. Tragique « héroïsme » que celui des millions de victimes russes, puisque sans l'aide militaire américaine, le régime stalinien arriéré eût été défait à plate couture par l'Allemagne industrialisée.
Après un tel massacre et sur la paix des tombes, dans la Russie exsangue, le pouvoir d'Etat n'eut aucunement nécessité des subtilités démocratiques pour faire régner l'ordre. Les Alliés laissèrent de plus la soldatesque russe se venger sur des millions d'allemands, consacrant ainsi la Russie au rang de puissance « victorieuse », statut dont on sait que, comme en 1914, il est générateur de paix sociale et d'admiration de la bourgeoisie. De même qu'il a laissé massacrer le prolétariat de Varsovie, le gouvernement russe et son dictateur ont pour leur part clairement et impunément laissé massacrer et crever sans nourriture à Stalingrad et à Leningrad des centaines de milliers de civils, tout comme les staliniens se sont empressés, ainsi qu'en témoigne Souvarine, de mettre au compte des pertes dues à la guerre les millions de morts des Goulags.
Pour que les impérialismes victorieux soient repus (dépeçage des usines en Europe de l'est pour le régime stalinien et reconstruction à l'ouest au bénéfice des Etats-Unis), encore fallait-il que le prolétariat ne risque pas de voler sa « libération » à la bourgeoisie.
Un intense battage idéologique commun à l'occident et à la Russie « totalitaire » mit en exergue le génocide des Juifs, dont les Alliés étaient au courant depuis le début de la guerre. Comme les historiens les plus sérieux l'ont reconnu, le génocide des Juifs ne trouve pas son explication au... Moyen Age, mais dans le cadre de la guerre mondialisée. Le massacre prend une ampleur incroyable au moment du déclenchement de la guerre contre la Russie, pour « résoudre » plus rapidement le problème des masses énormes de réfugiés et de prisonniers parqués, en particulier en Pologne. Les préoccupations de l'Etat nazi sont encore une fois de nourrir avant tout ses propres soldats quitte à faire crever de façon expéditive une population qui pesait sur l'effort de guerre (il fallait économiser les balles pour le front russe, et simplifier le travail des bourreaux d'autant que la décimation par balles individu par individu s'était avérée démoralisante même pour les tueurs).
A la conférence des Alliés aux Bermudes en 1943, les Alliés avaient même décidé de ne rien faire pour les Juifs, préférant de fait cette extermination à l'immense exode qu'ils auraient eu à charge si les nazis avaient pu choisir l'expulsion. Plusieurs marchandages eurent lieu depuis la Roumanie et la Hongrie. Tous essuyèrent le refus poli de Roosevelt sous prétexte de ne pas fournir des subsides à l'ennemi. La proposition la plus connue, mais masquée aujourd'hui derrière l'action humaniste très limitée du seul Schindler, mit en présence des représentants des Alliés avec Eichmann pour l'échange de 100 000 Juifs contre 10 000 camions, échange que les Alliés refusèrent explicitement par la bouche de l'Etat britannique : « transporter tant de monde risquerait de nuire à l'effort de guerre ». ([8] [1636])
Ce génocide des Juifs, «purification ethnique » des nazis, devait
trop bien excuser la « victoire » des Alliés dans la pire des barbaries.
L'ouverture des camps se fit avec énormément de publicité.
Ce rempart de mensonges diabolisant à outrance le camp vaincu, servit à faire taire les questionnements face aux bombardements de terreur des Alliés pour pacifier avant tout le prolétariat mondial. Les chiffres suffisent à dévoiler l'horreur :
-en juillet 1943, bombardement de Hambourg, 50 000 morts ;
-en 1944, à Darmstadt, Kônigsberg, Heilbronn, 24 000 victimes ;
- à Braunschweig, 23 000 victimes ;
- à Dresde, ville de réfugiés de tous les pays, les 13 et 14 février 1945 le bombardement intensif par les avions démocratiques cause 250 000 victimes, c'est l'un des plus grands crimes de cette guerre ;
- en 18 mois, 45 des 60 principales villes allemandes avaient été quasiment détruites et 650 000 personnes avaient péri;
-en mars 1945, le bombardement de Tokyo fait plus de 80 000 victimes ;
- en France, comme ailleurs, ce sont les quartiers ouvriers qui sont l'objet des bombardements des Alliés : au Havre, à Marseille, faisant apparemment sans distinction de nouveaux milliers de morts ; les populations civiles des lieux de débarquement comme Caen (et jusque dans le Pas-de-Calais) ont vécu avec terreur le massacre (plus de 20 000 victimes de part et d'autre) du débarquement, quand elles n'en ont pas été victimes également ;
- quatre mois après la reddition du Reich, alors que le Japon était pratiquement à genoux, au nom de la volonté de limiter les pertes américaines, l'aviation démocratique bombarde, avec l'arme la plus meurtrière et terrifiante de tous les temps, Hiroshima et Nagasaki ; le prolétariat doit en retenir désormais pour longtemps que la bourgeoisie est une classe toute puissante...
Dans un prochain article, nous reviendrons sur les réactions des ouvriers pendant la guerre, passées sous silence par les livres de l'histoire officielle, et sur l'action et les positions des minorités révolutionnaires de l'époque.
Damien.
[1] [1637] Voir dans la Revue Internationale n° 66 : <r Les massacres et les crimes des "grandes démocraties " », 3e trimestre 1991.
[2] [1638] La guerre secrète, A.C. Brown.
[3] [1639] 34-39,L'avant-guerre,Michel Ragon, Ed. Denoêl, 1968.
[4] [1640] Rapport sur la situation internationale, 14 juillet 1945.
[5] [1641] L’œuvre, 29 août 1940.
[6] [1642] Voir dans la Revue Internationale n° 66 : « Les massacres et les crimes des "grandes démocraties"», 3e trimestre 1991, ainsi que le Manifeste du 9e congrès du CCI : Révolution communiste ou destruction de l'humanité.
[7] [1643] Le Figaro, 6 juin 1994.
[8] [1644] Voir L'histoire de Joël Brand par Alex Weissberg.
Un demi-siècle plus tard le problème des réfugiés fait l'objet des mêmes restrictions capitalistes honteuses : « Pour des raisons économiques et politiques (chaque réfugié représentant une dépense de 7000 dollars), Washington ne veut pas que l'augmentation des réfugiés juifs se fasse au détriment d'autres exilés -d'Amérique Latine, d'Asie ou d'Afrique- qui ne disposent d'aucun soutien et sont peut-être plus persécutés » {Le Monde du 4 octobre 1989, « Les juifs soviétiques seraient les plus affectés par des restrictions à l'immigration »). L'Europe de Masstricht n'est pas en reste : « ...pour l'Europe, la majorité des demandeurs d'asile ne sont pas de "vrais" réfugiés, mais de quelconques migrants économiques. Intolérable sur un marché de l'emploi saturé » {Libération du 9 octobre 1989, « L'Europe veut trier les réfugiés ». Voilà où aboutit le capitalisme dans sa décadence. Comme il ne peut plus permettre le développement des forces productives, il préfère, en temps de guerre comme en temps de paix, laisser crever de mort lente la plus grande partie de l'humanité. L'impuissance hypocrite affichée face à la «r purification ethnique » de milliers d'hommes dans l'ex-Yougoslavie et au massacre de 500 000 êtres humains en quelques jours au Rwanda, du jamais vu, sont les dernières preuves de ce dont le capitalisme est capable AUJOURD'HUI. En laissant faire ces massacres, comme elles avaient laissé faire le génocide des Juifs, les démocraties occidentales prétendent être étrangères à l'horreur alors qu'elles en sont complices, et même plus directement partie-prenante qu'au temps des nazis.
Evènements historiques:
- Deuxième guerre mondiale [1286]
Questions théoriques:
- Impérialisme [321]
Le rejet de la notion de décadence conduit à la démobilisation du prolétariat face à la guerre (2e partie)
- 2924 reads
Polémique avec Programme Communiste sur la guerre impérialiste (2e partie)
Le courant bordiguiste appartient incontestablement au camp du prolétariat. Sur un certain nombre de questions essentielles, il défend fermement les principes de la Gauche Communiste qui a mené le combat contre la dégénérescence de la 3e Internationale dans les années 1920 et qui, aprés son exclusion de celle-ci, a poursuivi la bataille, dans les conditions terribles de la contre-révolution, pour la défense des intérêts historiques de la classe ouvrière. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne la question de la guerre impérialiste. Dans la première partie de cet article, nous avons mis ce fait en évidence pour ce qui concerne une organisation de ce courant : celle qui publie ll Comunista en Italie et la revue Programme Communiste (PC) en France. Nous avons cependant démontré, à travers les écrits de cette organisation, comment l'ignorance, par le courant bordiguiste, de la notion de décadence du capitalisme, pouvait conduire à des aberrations théoriques sur la question de la guerre impérialiste. Mais le plus grave, dans les erreurs théoriques des groupes « bordiguistes », c'est qu'ils conduisent à un désarmement politique de la classe ouvrière. C'est ce que nous allons mettre en évidence dans cette seconde partie.
A la fin de la première partie de cet article nous citions une phrase du PCI dans PC n° 92 particulièrement significative du danger que représente la vision de cette organisation : « Il en découle aussi [de la guerre comme mani-festation d'une rationalité économique] que la lutte inter-impérialiste et l'affrontement entre puissances rivales ne pourra jamais conduire à la destruction de la planéte, parce qu'il s'agit justement, non d'avidités excessives mais de la nécessité d'échapper à la surproduction. Quand l'excédent est détruit, la machine de guerre s'arrête, quel que soit le potentiel destructif des armes mi-=ses en jeu, car disparaissent du même coup les causes de la guerre. » Une telle vision, qui met sur le même plan les guerres du siécle dernier, qui avaient, effectivement, une rationalité économique, et celles de ce siècle qui ont perdu une telle rationalité, découle directement de l'incapacité de la part du courant bordiguiste de comprendre le fait que le capitalisme, conformément à ce que disait déjà l'Internationale com-=muniste, est entré dans sa période de décadence depuis la 1re guerre mondiale. Cependant, il est important de revenir sur une telle vision car, non seulement elle tourne le dos à l'histoire réelle des guerres mondiales, mais elle démobilise complétement la classe ouvrière.
Imagination bordiguiste et histoire réelle
Ce n'est pas vrai que les deux guerres mondiales ont pris fin du fait de la dis-parition des causes économiques qui les avaient engendrées. Il faut déjà s'enten-dre, évidemment, sur les causes éco-nomiques véritables de la guerre. Mais, même en se plaçant du point de vue du PCI : la guerre a pour objectif de dé-truire suffisamment de capital constant pour permettre de retrouver un taux de profit suffisant, on peut constater que l'histoire réelle est en contradiction avec la conception imaginaire qu'en donne cette organisation.
Si nous prenons le cas de la 2e guerre mondiale, affirmer une telle chose est une trahison honteuse du combat mené par Lénine et les internationalistes tout au long de celle-ci (à moins qu'il ne s'agisse que d'une ignorance crasse de ces faits historiques). En effet, conformément à la résolution adoptée au congrés de 1907 de la 2e internationale (Congrés de Stuttgart), qu'un amendement présenté par Lénine et Rosa Luxemburg avait rendue trés claire, et conformément au Manifeste adopté par le Congrés de Bâle, en 1912, Lénine a mené le combat, dés aoùt 1914, pour que les révolutionnaires : « utilisent de toutes leurs forces la crise économique et politique créée par la guerre pour agiter les couches populaires -les plus profondes et précipiter la chute de la domination capitaliste. ». (Résolution du Congrés de Stuttgart) Il n'allait pas dire aux ouvriers : « De toutes façons, la guerre impérialiste prendra fin lorsque les causes économiques qui l'ont engendrée seront épuisées. » Au contraire, il mettait en évidence que le seul moyen de mettre fin à la guerre impérialiste, avant qu'elle ne conduise à une hécatombe catastrophique pour le prolétariat et pour l'ensemble de la civilisation, consistait dans la transformation de la guerre impérialiste en guerre civile. Evidemment, PC reprend à son compte ce mot d'ordre, et il approuve la politique des internationalistes au cours de cette guerre. Mais en même temps, il n'est pas capable de comprendre que justement, le scénario qu'il présente de la fin de la guerre impérialiste généralisée ne s'est pas réalisé en 1917-18. Au contraire, la ler guerre mondiale a pris fin, et trés rapidement, en novembre 1918, parce que le prolétariat le plus puissant du monde, celui d'Allemagne, s'était soulevé contre elle et était en train de prendre le chemin de la révolution comme l'avait fait, un an auparavant, le prolétariat de Russie. Les faits sont éloquents : le 9 novembre 1918, aprés plusieurs mois de grèves ouvrières dans toute l'Allemagne, les marins de Kiel de la « Kriegsmarine » se mutinent contre leurs officiers, en même temps qu'une ambiance insurrectionnelle se développe au sein du prolétariat ; le 11 novembre, les autorités allemandes signent un armistice avec les pays de l'Entente. La bourgeoisie a trés bien compris la leçon de la Russie un an au-paravant oú, la décision du gouvernement provisoire, issu de la révolution de février 1917, de poursuivre la guerre avait constitué le principal facteur de mobilisation du prolétariat vers l'issue révolutionnaire d'Octobre et la prise du pouvoir par les soviets. Ainsi, l'histoire avait donné raison à la vision défendue par Lénine et les bolcheviks : c'est la lutte révolutionnaire du prolétariat qui a mis fin à la guerre impérialiste et non une quelconque destruction de l'excé-dent de marchandises.
La 2° guerre mondiale, contrairement à la première (et à l'attente de beaucoup de révolutionnaires) n'a pas ouvert le chemin d'une nouvelle vague révolutionnaire. Et ce n'est malheureusement pas faction du prolétariat qui y a mis fin. Cependant, cela ne veut pas dire qu'elle ait répondu au schéma abstrait de PC. Si on étudie sérieusement les faits historiques, et autrement qu'avec les lunettes déformantes des dogmes « invariants » du bordiguisme, on constate facilement que la fin de la guerre n'a eu rien a voir avec une quelconque « destruction suffisante de l'excédent ». En réalité, la guerre impéria-liste a pris fin avec la destruction com-pléte du potentiel militaire des vaincus et par l'occupation de leur territoire par les vainqueurs. Le cas le plus explicite a été celui de l'Allemagne, encore une fois. Si les Alliés ont pris la peine d'occuper chaque pouce du territoire allemand, en se le partageant en quatre, ce n'était pas pour des raisons économiques mais pour des raisons sociales : la bourgeoisie avait conservé le souvenir de la l'e guerre mondiale. Elle savait qu'elle ne pouvait compter sur un gouvernement vaincu pour garantir l'ordre social dans les énormes concentrations prolétariennes d'Allemagne. C'est d'ailleurs ce que dit lui-même PC (et encore une fois on peut constater son incohérence) :
« Au cours des 3 années 45-48, une grave crise économique frappe tous les pays européens touchés par la guerre [tiens ! pourtant c'est là qu'il y avait eu le plus de destruction de capital constant, NDLR] (..) On voit donc que le marasme d'aprés-guerre ne fait pas de différence entre vaincus et vainqueurs. Mais forte de l'expérience du premier aprés-guerre, la bourgeoisie mondiale a appris que ce marasme pouvait donner naissance à des flambées classistes et révolutionnaires. C'est la raison pour laquelle la période de dépression économique d'aprés-guerre sera aussi la période de l'occupation militaire massive de l'Europe. Cette occupation ne commencera à s'atténuer, dans le secteur occidental, qu'à partir de 1949, quand le spectre du "désordre social" se sera éloigné. » (PC n° 91, p. 43)
En réalité, au nom du « marxisme » et même de la « dialectique », PC nous donne une vision matérialiste vulgaire et mécaniste du processus de déclenchement et de fin de la guerre impérialiste mondiale.
Une vision schématique du déclenchement de la guerre impérialiste
Le marxisme établit qu'en dernière instance, ce sont les infrastructures économiques de la société qui déterminent ses superstructures. De même, l'ensemble des faits historiques, qu'ils affectent la scéne politique, militaire ou sociale, ont des racines économiques. Cependant, c'est encore une fois « en dernière instance » que s'exerce cette détermination économique, de façon dialectique et non mécanique. Il existe, notamment depuis le début du capitalisme, une origine économique aux guerres. Mais le lien entre les facteurs économiques et la guerre a toujours été médiatisé par une série de facteurs historiques, politiques. diplomatiques qui ont justement permis à la bourgeoisie de masquer aux yeux des prolétaires la véritable nature de la guerre. Cela est déjà valable au siécle dernier, lorsque la guerre présente une certaine rationalité économique pour le capital. Il en est ainsi, par exemple de la guerre franco-prussienne de 1870.
Du côté prussien, cette guerre n'a pas de but économique immédiat (même si, évidemment, le vainqueur se permet le luxe de faire verser au vaincu 6 milliards de francs-or en échange du départ de ses troupes d'occupation). Fondamentalement, la guerre de 1870 permet à la Prusse de réaliser autour d'elle l'unité allemande (aprés qu'elle ait vaincu son concurrent autrichien pour un tel rôle lors de la bataille de Sadowa, eu 1866). L'annexion de l'Alsace-Lorraine n'a pas d'intérêt économique décisif, mais elle constitue la corbeille du mariage entre les différentes entités politiques allemandes. Et c'est justement à partir de cette unité politique que peut se développer de façon impétueuse la nation capitaliste qui deviendra en peu de temps la première puissance économi-que d'Europe et qui l'est restée.
Du côté français, le choix fait par Napoléon III de se lancer dans la guerre est encore plus éloigné d'une détermination économique directe. Fondamentalement, comme le dénonce d'ailleurs Marx, il s'agit pour le monarque de mener une guerre « dynastique » permettant au second Empire, en cas de victoire, de s'enraciner de façon beaucoup plus solide à la tête de la bourgeoisie française (qui, dans sa grande majorité, qu'elle soit royaliste ou républicaine, ne porte pas « Badinguet » dans son cceur) et de permettre au fils de Napoléon de lui succéder. C'est pour cela, d'ailleurs, que Thiers, représentant le plus avisé de la classe capitaliste, était farouchement opposé à cette guerre.
Lorsqu'on examine les causes du déclenchement de la 2e guerre mondiale, on peut constater également à quel point le facteur économique, qui est évidemment fondamental, ne joue que de façon indirecte. Nous ne pouvons pas, dans le cadre de cet article, nous étendre sur l'ensemble des ambitions impérialistes des différents protagonistes de cette guerre (au début du siécle, les révolutionnaires ont consacré à cette question de nombreuses brochures). Il suffit de dire que l'enjeu fondamental pour les deux principaux pays de l'Entente, la Grande-Bretagne et la France, était de conserver leur empire colonial face aux ambitions de l'Allemagne, la puissance montante, dont le potentiel industriel ne disposait pratiquement pas de débouchés coloniaux. C'est pour cela, qu'en dernier ressort, la guerre se présente pour l'Allemagne, qui pousse le plus au conflit, comme une lutte pour un repartage des marchés au moment oú ces derniers sont déjà tous entre les mains des puissances plus anciennes. La crise économique qui commence à se développer à partir de 1913 constitue évidemment un facteur important d'exacerbation des rivalités impérialistes qui débouche sur le 4 aoùt 1914, mais il serait totalement faux de prétendre (et aucun marxiste ne l'a fait à l'époque) que la crise avait déjà pris une telle ampleur que le capital ne pouvait faire autre chose, afin de la surmonter, que de déchaîner la guerre mondiale avec ses immenses destructions.
En réalité, la guerre aurait trés bien pu éclater dés 1912, lors de la crise des Balkans. Mais justement, à ce moment précis, l'Internationale Socialiste avait su se mobiliser et mobiliser les masses ouvrières contre la menace de la guerre, notamment avec le Congrés de Bâle, pour que la bourgeoisie renonce à avancer plus sur le chemin de l'affrontement généralisé. En revanche, en 1914, la raison principale pour laquelle la bourgeoisie peut déclencher la guerre mondiale ne réside pas dans le niveau atteint par la crise de surproduction, qui était bien loin du niveau qu'elle a atteint aujourd'hui par exemple. Elle réside dans le fait que le prolétariat, endormi par l'idée que désormais la guerre ne menaçait plus, et plus généralement par l'idéologie réformiste (propagée par l'aile droite des partis socialistes qui dirigeait la plupart de ces partis), n'a opposé aucune mobilisation sérieuse face à la menace qui se profilait de plus en plus à partir de l'attentat de Sarajevo, le 20 juin 1914. Pendant un mois et demi, la bourgeoisie des principaux pays a eu tout loisir de vérifier qu'elle avait les mains libres pour déclencher les massacres. En particulier, tant en Allemagne qu'en France, les gouvernements ont pu contacter directement les chefs des partis socialistes qui les ont assurés de leur fidélité et de leur capacité à entraîner les ouvriers vers la boucherie. Nous n'inventons pas ces faits : ils ont été mis en évidence et dénoncés par les révolutionnaires de l'époque, comme Rosa Luxemburg et Lénine.
En ce qui concerne la 2° guerre mondiale, on peut évidemment mettre en évidence comment, à partir de la crise économique de 1929, se mettent en place tous les éléments qui vont aboutir au déclenchement de la guerre en septembre 1939 : arrivée de Hitler au pouvoir en 1933, accession au gouvernement en 1936 des «fronts populaires » en France et en Espagne, guerre civile dans ce dernier pays, à partir de juillet de la même année. Le fait que la crise ouverte de l'économie capitaliste débouche finalement sur la guerre impérialiste est d'ailleurs perçu trés clairement par les dirigeants de la bourgeoisie. Ainsi, Cordell Hull, proche collaborateur du président américain Roosevelt, déclare : « Quand les marchandises circulent, les soldats n'avancent pas ». Pour sa part Hitler, à la veille de la guerre dit clairement à propos de l'Allemagne : « Ce pays doit exporter ou mourir ». Cependant, on ne peut rendre compte du moment oú se déclenche la guerre mondiale uniquement dans les termes oú le fait PC: «Aprés 29, on chercha à sur-monter la crise aux USA par une espéce de "nouveau modéle de développement ». L'Etat intervient de façon massive dans l'économie... et lance de gigantesques plans d'investissements pu-blics. On reconnaît aujourd'hui que tout cela n'eut que des effets secondaires sur l'économie qui, en 37-38 plongeait de nouveau vers la crise : seuls les crédits en 38 pour le réarmement purent amorcer une "vigoureuse" reprise et faire atteindre des maximums historiques de production. Mais l'endettement public et la production d'armements ne peuvent que freiner, mais pas éliminer la tendance aux crises. Constatons le fait qu'en 39 la guerre éclate pour éviter la chute dans une crise encore plus ruineuse... La crise d'avant la guerre dura 3 ans et elle fut suivie aprés 33 par une reprise qui conduisit directement à la guerre. » (PC n° 90, p. 29) Déjà il faut rejeter l'idée que la guerre serait moins ruineuse que la crise: quand on a vu dans quel état s'est retrouvée l'Europe aprés la 2° guerre mondiale, une telle affirmation n'est pas sérieuse. Cependant, l'explication donnée par PC des origines de la guerre n'est pas fausse en soi, mais elle le devient si on en fait la seule permettant de comprendre pourquoi la guerre a été déclenchée en 1939 et non pas dés le début des années 1930, lorsque le monde, et particulièrement l'Allemagne et les Etats-Unis, plongent dans la plus profonde récession de l'histoire.
Pour mettre en évidence le schématisme incroyable de l'analyse de PC, il suffit de citer le passage suivant : « C'est le cours de l'économie impérialiste qui, à un certain moment, 'fait" la guerre. Et, s'il est vrai que l'affrontement militaire résout provisoirement les problémes posés par la crise, il faut cependant souligner que l'affrontement militaire ne découle pas de la récession, mais de la reprise artificielle qui le suit. Droguée par l'intervention de l'Etat, financée par la dette publique (de l'industrie mili-taire pour une bonne partie), la production reprend de la hauteur ; mais la conséquence immédiate est l'engorgement d'un marché mondial déjà saturé, la reproduction sous une forme aiguë de l'affrontement inter-impérialiste, et donc la guerre. A ce moment les Etats se jettent les uns contre les autres, ils doivent se faire la guerre, et ils la feraient au besoin à coup de bulldozers, de rnoissonneuses-batteuses ou de toutes les machines pacifiques qu'on peut imaginer... Le pouvoir de déclencher la guerre n'appartient pas aux fusils mais aux masses de marchandises invendues. » (PC n° 91, p. 37)
Une telle vision fait complétement abstraction des conditions concrétes à travers lesquelles la crise économique débouche sur la guerre. Pour PC, les choses se réduisent au mécanisme : récession, reprise "droguée", guerre. Rien d'autre. On peut déjà noter que ce schéma ne s'applique nullement à la 1e guerre mondiale. Mais, concernant la 2e, il faut constater que PC ne se penche pas sur la forme que prend la reprise droguée en Allemagne à partir de 1933 : celle de la mise en ceuvre d'un effort d'armement colossal par le régime nazi, ni sur la signification de la venue au pouvoir de ce régime lui-même. De même, la signification de l'arrivée du Front populaire en France, par exemple, ne fait pas l'objet du moindre examen par PC. Enfin, des événements de la scéne internationale aussi importants que l'expédition italienne de 1935 con-tre l'Ethiopie, la guerre d'Espagne en 1936, la guerre entre le Japon et la Chine un an aprés sont ignorés.
En réalité, aucune guerre n'a jamais été menée avec des moissonneuses-batteuses. Quelle que soit la pression exercée par la crise, la guerre ne peut être déclenchée si ne sont pas mûres, si n'ont pas été préparées ses conditions militaires, diplomatiques, politiques et sociales. Et justement, l'histoire des années 1930 est celle de l'ensemble de ces préparatifs. Sans revenir ici longuement sur ce que nous avons déjà développé dans d'autres numéros de cette revue, on peut dire qu'une des fonctions du régime Nazi a été d'impulser l'effort de reconstitution à grande échelle et à « un rythme qui surprend même les gé-néraux »([1] [1645]) du potentiel militaire de l'Allemagne, un potentiel que les clauses du traité de Versailles de 1919 avaient bridé jusque là. En France également, le Front Populaire a eu la responsabilité de relancer l'effort d'arme-ment à une échelle inconnue depuis la 1e guerre mondiale. De même, les guerres que nous avons évoquées plus haut s'inscrivaient dans les préparatifs militaires et diplomatiques de l'affrontement généralisé. Il faut mentionner particulièrement la guerre d'Espagne : c'est le terrain oú les deux puissances de l'Axe, Italie et Allemagne, non seulement testent de façon directe les armements pour la guerre à venir mais renforcent leur alliance en vue de celle-ci. Mais non seulement cela : la guerre d'Espagne constitue le parachévement de l'écrasement physique et politique du prolétariat mondial aprés la vague révolutionnaire qui avait commencé en 1917 en Russie et qui avait jeté ses derniers feux en Chine en 1927. Entre 1936 et 1939, ce n'est pas seulement le prolétariat d'Espagne qui est défait, d'abord par le Frente Popular, ensuite par Franco. La guerre d'Espagne a été un des moyens essentiels par lesquels la bourgeoisie des pays « démocratiques », particulièrement en Europe, a fait adhérer les ouvriers à l'idéologie anti-fasciste, l'idéologie qui a permis qu'ils soient utilisés une nouvelle fois comme « chair à canon » pour la 2° guerre mondiale. Ainsi, l'acceptation de la guerre impérialiste par les ouvriers que les régimes fasciste et nazi ont imposée par la terreur a été obtenue dans les autres pays au nom de la « défense de la Démocratie », avec la participation active, évidemment, des partis de gauche du capital, « socialistes » et « communistes ».
Le schéma du mécanisme qui conduit au déclenchement de la 2° guerre mondiale, tel que nous le propose PC, coincide avec la réalité. Mais s'il en est ainsi, c'est dans les conditions bien spécifiques de cette période, qu'on ne peut comprendre, loin de là, à partir de ce seul schéma. En particulier, en ce qui concerne l'Allemagne, notamment, mais aussi des pays comme la France et la Grande-Bretagne (avec un certain retard sur les autres pays, cependant) l'effort d'armement constitue un des aliments de la reprise aprés la dépression de 1929. Mais cela n'est possible que par le fait que les principaux Etats capitalistes avaient considérablement réduit leurs moyens militaires au lendemain de la 1e guerre mondiale dans la mesure où, à ce moment-là, la principale préoccupation de la bourgeoisie mondiale était de faire face à la vague révolutionnaire du prolétariat. De même, forte de son expérience de la l°guerre mondiale, la bourgeoisie sait pertinemment qu'elle ne peut se lancer dans la guerre impérialiste sans avoir au préalable soumis totalement le prolétariat afin de s'éviter un surgissement révolutionnaire de celui-ci au cours même de la guerre.
Ainsi, la « méthode » de PC consiste a établir comme loi historique, un schéma qui ne s'est appliqué qu'une seule fois dans l'histoire (puisqu'on a déjà vu qu'il ne s'était pas appliqué au premier avant-guerre non plus). Pour qu'il puisse être valable dans la période actuelle, il faudrait que les conditions historiques d'aujourd'hui soient fondamentalement les mêmes que celles des années 1930, ce qui est loin d'être le cas : jamais les armements n'ont été aussi développés et le prolétariat ne vient pas de subir une profonde défaite comme ce fut le cas dans les années 1920. Au contraire, il est sorti, depuis la fin des années 1960, de la profonde contre-révolution qui pesait sur lui depuis le début des années 1930.
Les conséquences de la vision schématique de Programme Communiste
La vision schématique de PC débouche sur une analyse particulièrement dangereuse de la période actuelle. C'est vrai que de temps en temps, dans son étude, PC semble retrouver une conception un peu plus marxiste du processus qui con-duit à la guerre mondiale. C'est le cas lorsqu'il écrit:
« Pour que de telles masses humaines puissent être efficacement envovées au massacre, il faut que les populations soient préparées à temps à la guerre ; et pour qu'elle puissent résister ait cours d'une guerre à outrance, il faut que ce travail de préparation soit suivi d'un travail de mobilisation constante des énergies et des consciences de la nation, de toute la nation, en faveur de la guerre. (..) Sans la cohésion de tout le corps social, sans la solidarité de toutes les classe envers une guerre pour laquelle on sacrifie ses propres existences et ses propres espoirs, même les troupes les mieux armées sont condamnées à se désagréger sous le coup des privations et des horreurs quotidiennes du conflit. » (PC n° 91, p. 41) Mais de telles affirmations, tout-à-fait justes, entrent en contradiction flagrante avec la démarche adoptée par PC lorsqu'il s'essaie à faire des prévisions sur les années à venir. En s'appuyant sur son schéma récession, reprise "droguée", guerre, PC se livre à de savants calculs (dont nous ferons ici grâce au lecteur) pour aboutir à la conclusion que : « Il nous faut maintenant réfuter la thése de l'imminence de la troisiéme guerre mondiale. » (PC n° 90, p. 27) « Il faudrait alors situer la date présumée de la maturité économique du conflit autour de la moitié de la première décennie du prochain millénaire (ou si l'on préfére, du prochain siécle). » (Ibidem., p. 29) Il faut noter que PC fonde une telle prévision sur le fait que : « Le processus de relance droguée typique de l'économie de guerre, qui suit la crise, ne se dessine pas encore, et ceci dans une situation économique, qui, de récession en récession, est encore loin d'avoir épuisé la tendance à la dépression inaugurée en 74-75. » (Ibidem.) Nous pourrions évidemment démontrer (voir toutes nos analyses sur les caractéristiques de la crise actuelle dans cette même Revue) en quoi, depuis plus d'une décennie déjà, les « reprises » de l'éco-nomie mondiale sont parfaitement « droguées». Mais c'est PC qui le dit lui-même quelques lignes plus haut : « Nous voulons seulement souligner que le systéme capitaliste mondial a utilisé pour prévenir la crise les mêmes moyens dont il s'était servi aprés le krach de 1929 pour s'en sortir. » La cohérence n'est vraiment pas le fort de PC et des bordiguistes : c'est peut-être leur conception de la « dialectique » eux qui se flattent d'être « rompus au maniement de la dialectique. » (PC n° 91, p. 56) ([2] [1646])
Cela-dit, au-delà même des contradictions de PC, il importe de souligner le caractére parfaitement démobilisateur des prévisions qu'il s'amuse à faire sur la date du prochain conflit mondial. Depuis sa fondation, le CCI a mis en évidence que, dés lors que le capitalisme avait épuisé les effets de la reconstruction du second aprés guerre, dés lors que la crise historique du mode de production capitaliste se manifestait une nouvelle fois sous forme de crise ouverte (cela, dés la fin des années 1960, et non en 1974-75, comme le veulent les bordiguistes pour essayer de prouver la confirmation d'une vieille « prévision » de Bordiga) les conditions économiques d'une nouvelle guerre mondiale étaient données. II a également mis en évidence que les conditions militaires et diplomatiques d'une telle guerre étaient totalement mùres avec la constitution depuis plusieurs décennies des deux grands blocs impérialistes regroupés au sein de l'OTAN et du Pacte de Varsovie derrière les deux principales puissances militaires du monde. La raison pour laquelle l'impasse économique oú se trouvait le capitalisme mondial n'a pas dé-bouché sur une nouvelle boucherie généralisée se trouvait fondamentalement dans le fait que la bourgeoisie n'avait pas les mains libres sur le terrain social. En effet, dés les premières morsures de la crise, la classe ouvrière mondiale - en mai 1968 en France, à l'automne 1969 en Italie, et dans tous les pays développés par la suite - a redressé la tête et s'est dégagée de la profonde contre-révolution qu'elle avait subie pendant quatre décennies. En expliquant cela, en basant sa propagande sur cette idée, le CCI a participé (de façon trés modeste évidemment, compte-tenu de ses forces actuelles) à redonner confiance en elle même à la classe ouvrière face aux campagnes bourgeoises visant en permanence à saper cette confiance. Au contraire, en continuant à propager l'idée que le prolétariat était encore totalement absent de la scéne historique (comme lorsqu'il était « minuit dans le siécle »), le courant bordiguiste a apporté (involontairement, certes, mais cela ne change rien), sa petite contribution aux campagnes bourgeoises. Pire encore, en laissant croire que, de toutes façons, les conditions matérielles d'une 3e guerre mondiale n'étaient pas encore réunies, il a participé à démobiliser la classe ouvrière contre sa menace, jouant, à une petite échelle, le rôle qu'avaient tenus les réformistes à la veille de la le guerre mondiale lorsqu'ils avaient convaincu les ouvriers que la guerre n'était plus une menace. Ainsi, ce n'est pas seulement, comme on l'a vu dans la première partie de cet article, en affirmant qu'une 3e guerre mondiale ne risquait pas de détruire l'humanité que PC contribue à masquer les véritables enjeux du combat de classe aujourd'hui, c'est aussi en faisant croire que ce combat de classe n'est pour rien dans le fait que cette guerre mondiale n'ait pas eu lieu depuis le début des années 1970.
L'effondrement du bloc de l'Est, à la fin des années 1980, a momentanément fait disparaître les conditions militaires et diplomatiques d'une nouvelle guerre mondiale. Cependant, la vision erronée de PC continue d'affaiblir les capacités politiques du prolétariat. En effet, la disparition des blocs n'a pas mis fin aux conflits militaires, loin de là, des con-flits dans lesquels les grandes et moyen-nes puissances continuent de s'affronter par petits Etats, ou même par ethnies interposées. La raison pour laquelle ces puissances ne s'engagent pas plus directement sur le terrain, ou pour laquelle, lorsqu'elles le font effectivement (comme lors de la guerre du Golfe en 1991) elles n'envoient sur place que des soldats professionnels ou des volontaires, c'est la crainte que continue d'avoir la bourgeoisie que l'envoi du contingent, c'est à dire des prolétaires en uniforme, ne provoque des réactions et une mobilisation de la classe ouvrière. Ainsi, à l'heure actuelle, le fait que la bourgeoisie ne soit pas capable d'embrigader le prolétariat derrière ses objectifs guerriers constitue un facteur de premier plan limitant la portée des massacres impérialistes. Et plus la classe ouvrière sera capable de développer ses combats, plus la bourgeoisie sera entravée dans ses projets funestes. Voilà ce que les révolutionnaires doivent dire à leur classe pour lui permettre de prendre conscience et de ses réelles capacités et de ses responsabilités. Malheureusement, malgré sa dénonciation tout à fait valable des mensonges bourgeois sur la guerre impérialiste, et notamment du pacifisme, c'est ce que ne fait pas le courant bordiguiste, et notamment PC.
Pour conclure sur cette critique des analyses de PC sur la question de la guerre impérialiste, il nous faut relever les quelques « arguments » employés par cette revue lorsqu'elle tente de stigmatiser les positions du CCI. Pour PC, nous sommes des « sociaux pacifistes d'extrême gauche », au même rang que les trotskistes (PC n° 92, p. 61). Notre position serait « emblématique de l'impuissance du petit bourgeois en colére » (Ibidem., p. 57). Et pourquoi, s'il vous plaît ? Parce que : « si l'éclatement de la guerre exclut définitivement la révolution, alors la paix, cette paix bourgeoise, devient malgré tout un "bien" que le prolétariat, tant qu'il n'a pas la force de faire la révolution, doit protéger comme la prunelle de ses yeux. Et voila que pointe à l'horizon la vieille "lutte pour la paix"... au nom de la révolution. L'axe fondamental de la pro-pagande du CCI lors de la dernière guerre du Golfe n'était-elle pas la dénonciation des "va-t-en guerre" de tout poil, et les lamentations sur le "chaos", le "sang" et les "horreurs" de la guerre ? Certes la guerre est horrible, mais la paix bourgeoise l'est tout autant et les "va-t-en paix" doivent être dénon-cés tout aussi sévérement que les "va-t-en guerre"; quant au "chaos" grandissant du monde bourgeois, il ne peut qu'être accueilli favorablement par les communistes véritables parce qu'il signifie que se rapproche l'heure oú la violence révolutionnaire devra être opposée à la violence bourgeoise. » (Ibidem.)
Sincérement, les « arguments » de PC sont un peu pauvres, et surtout, ils sont mensongers. Lorsque les révolutionnaires du début du siécle, les Luxemburg et les Lénine, à chaque congrés de l'Internationale Socialiste et dans leur propagande quotidienne, mettaient les ouvriers en garde contre la menace de la guerre impérialiste, qu'ils dénonçaient les préparatifs de celle-ci, ils ne faisaient pas la même chose que les pacifistes et il nous semble que PC se réclame encore de ces révolutionnaires. De même, lorsque, au cours de la guerre elle-même, ils stigmatisaient avec la dernière énergie tant la bestialité impérialiste que les « jusqu'au-boutistes » et autres « socio-chauvins », ce n'est pas pour cela qu'ils mêlaient leur voix à celle des pacifistes à la Romain Rolland. Et bien c'est exactement du même combat que celui de ces révolutionnaires dont se revendique le CCI, et sans la moindre concession aux discours pacifistes qu'il dénonce avec la même vigueur que les discours guerriers contrairement à ce que prétend PC (qui ferait bien de lire un peu mieux notre presse). En réalité, le fait que PC soit obligé de mentir sur ce que nous disons réell-ment ne fait que démontrer une seule chose : le manque de consistance de ses propres analyses.
Et pour clore, nous voudrions dire à ces camarades qu'il ne sert à rien de consacrer tant d'énergie à prévoir presque à l'année prés la date de la future guerre mondiale pour aboutir à une « prévision » pour la période qui vient qui ne comporte pas moins de quatre scénarios possibles (voir PC n° 92, p. 57 à 60). Le prolétariat, pour s'armer politiquement, attend des révolutionnaires des perspectives claires. Pour tracer de telles perspectives, il ne suffit pas à ces derniers de se contenter de la « stricte répétition de positions classiques »comme veut le faire le PCI (PC n° 92, p. 31). Si le marxisme ne peut s'appuyer que sur un strict respect des principes prolétariens, notamment par rapport à la guerre impérialiste, comme le considére autant le CCI que le PCI, il n'est pas une théorie morte, incapable de rendre compte des différentes circonstances historiques dans lesquelles la classe ouvrière développe son combat, tant pour la défense de ses intérêts immédiats que pour le communisme (les deux faisant d'ailleurs partie du même tout). II doit permettre, comme le disait Lénine, « l'analyse concréte d'une situation concréte ». Dans le cas contraire, mais ce n'est plus le marxisme, il ne sert à rien, sinon à semer encore plus de confusion dans les rangs de la classe ouvrière. C'est malheureusement ce qui arrive au « marxisme » tel que nous le sert le PCI.
FM.
[1] [1647] « Histoire des relations internationales », Tome 8, page 142, par Pierre Renouvin, (Paris, 1972)
[2] [1648] Dans le domaine des incohérences du PCI, on peut encore donner la citation suivante « si la paix a régné jusqu'ici dans les métropoles impérialistes, c'est précisément en raison de cette domination des USA et de l'URSS, et si la guerre est inévitable c'est pour la simple raison que quarante années de "paix" ont permis la maturation de forces qui tendent à remettre en question cet équilibre issu du dernier conflit mondial. » (PC n° 91, page 47) Il faudrait, une fois pour toutes, que le PCI se mette d'accord avec lui-même. Pourquoi la guerre n'a-elle pas eu lieu encore ? A cause, exclusivement, du fait que ses conditions économiques n'étaient pas encore mùres comme essaie de le démontrer PC à longueur de pages, ou bien du fait que ses préparatifs diplomatiques n'étaient pas encore réalisés. Comprenne qui pourra.
Courants politiques:
- Bordiguisme [1287]
Approfondir:
Questions théoriques:
- Décadence [32]
Heritage de la Gauche Communiste:
Le communisme n'est pas un bel idéal mais une nécessite matérielle [9e partie]
- 3677 reads
Le communisme contre le « socialisme d’Etat »
La conscience de classe est quelque chose de vivant. Le fait qu'une partie du mouvement prolétarien ait atteint un certain niveau de clarté, ne veut pas dire que l'ensemble du mouvement y ait aussi accédé, et même les fractions les plus claires peuvent, dans certaines circonstances, ne pas réussir à tirer toutes les implications de ce qu'elles ont appréhendé, et peuvent même régresser par rapport à un niveau de compréhension atteint auparavant.
Ceci est certainement vrai en ce qui concerne la question de l'Etat et les leçons que Marx et Engels ont tirées de la Commune de Paris, que nous avons analysées dans le précédent article de cette série ([1] [1649]). Durant les décennies qui suivirent la défaite de la Commune, la montée du réformisme et de l'opportunisme dans le mouvement ouvrier a mené, au tournant du siècle, à la situation absurde selon laquelle la position marxiste « orthodoxe », telle qu'elle était défendue par Kautsky et ses acolytes, était que la classe ouvrière pouvait prendre le pouvoir au moyen des élections parlementaires, c'est-à-dire en s'emparant de l'Etat existant. Aussi quand Lénine, dans L'Etat et la révolution qu'il a rédigé pendant les événements révolutionnaires de 17, s'est attaché à « déterrer » le véritable héritage de Marx et Engels sur cette question, les « orthodoxes » l'accusèrent-ils de revenir à un anarchisme à la Bakounine !
En fait, la lutte pour faire connaître les leçons de la Commune de Paris, pour maintenir le mouvement prolétarien sur le chemin de la révolution communiste, avait déjà commencé au lendemain de l'insurrection des ouvriers français. Dans ce combat contre l'influence répugnante de l'idéologie bourgeoise et petite-bourgeoise sur le mouvement ouvrier, le marxisme a mené une bataille sur deux fronts : contre les « socialistes d'Etat » et les réformistes qui étaient particulièrement forts au sein du parti allemand, et contre la tendance anarchiste de Bakounine qui avait un forte présence dans les pays capitalistes moins développés.
Dans ce conflit à trois, beaucoup de questions étaient en débat, ou constituaient les germes de débats futurs. Dans le parti allemand, existait déjà la confusion entre la nécessaire lutte pour les réformes, et l'idéologie du réformisme qui oublie complètement les buts ultimes du mouvement. De l'autre côté, les Bakouninistes posaient aussi la question des réformes, mais dans le sens opposé : ils n'avaient que du mépris pour les luttes défensives immédiates de la classe et voulaient sauter par dessus, pour passer directement à la grande « liquidation sociale ». Avec ces derniers, devait également être posée de façon aiguë la question du rôle et du fonctionnement interne de l'Internationale, ce qui devait accélérer la chute de l'Internationale elle-même.
Dans les deux articles qui suivent, nous traiterons principalement de la façon dont ces conflits étaient reliés à la conception de la révolution et de la société future, bien qu'il y ait inévitablement de nombreux autres liens avec les questions mentionnées ci-dessus.
Le socialisme d'Etat est un capitalisme d'Etat
Au 20e siècle, l'identification entre le socialisme et le capitalisme d'Etat a constitué l'un des obstacles les plus tenaces au développement de la conscience de classe. Les régimes staliniens dans lesquels la brutalité de l'Etat totalitaire a violemment assuré le contrôle de la quasi-totalité de l'appareil économique, s'arrogeaient le nom de « socialistes », ce à quoi le reste de la bourgeoisie mondiale apportait obligeamment son accord. Et tous les cousins du stalinisme, des plus « démocratiques » aux plus « révolutionnaires », de la social-démocratie à sa droite au trotskisme à sa gauche, se sont attachés à répandre ce même mensonge fondamental.
Non moins pernicieuse que la version stalinienne est l'idée social-démocrate selon laquelle la classe ouvrière peut bénéficier de l'activité et de l'intervention de l'Etat, même dans les régimes qui sont explicitement identifiés comme « capitalistes » : selon ce point de vue, les conseils locaux, les gouvernements centraux contrôlés par les partis sociaux-démocrates, les institutions de l'Etat-providence, les industries nationalisées peuvent tous être utilisés pour le compte des ouvriers, et même constituer des étapes vers une société socialiste.
L'une des raisons pour lesquelles ces mystifications sont si profondément enracinées, c'est que les courants qui les défendent, ont appartenu dans le passé au mouvement ouvrier. Et beaucoup de pièges idéologiques qu'ils colportent aujourd'hui, trouvent leurs origines dans les confusions authentiques qui existaient dans une phase antérieure de ce mouvement. La vision marxiste du monde surgit d'un combat réel contre l'idéologie bourgeoise dans les rangs du mouvement prolétarien, et, pour cette raison même, est inévitablement confrontée à une lutte sans fin pour se libérer des subtiles influences de l'idéologie de la classe dominante. Dans le marxisme de la phase ascendante du capitalisme, nous pouvons donc voir une difficulté récurrente à abandonner l'illusion que l'étatisation du capital équivaut à la suppression de ce dernier.
Dans une large mesure, de telles illusions résultaient des conditions de l'époque dans lesquelles le capitalisme était encore perçu à travers la personnalité des capitalistes individuels, et où la concentration et la centralisation du capital était encore dans une phase précoce. Face à l'anarchie évidente créée par la pléthore d'entreprises individuelles concurrentes, il était assez facile d'aboutir à l'idée que la centralisation du capital entre les mains de l'Etat national constituerait un pas en avant. En fait beaucoup de mesures de contrôle par l'Etat mises en avant dans Le Manifeste Communiste (une banque d'Etat, la nationalisation de la terre, etc ([2] [1650]) sont présentées dans le but explicite de développer la production capitaliste dans une période où elle avait encore un rôle progressif à jouer. Malgré cela, la question est restée obscure, même dans les travaux ultérieurs de Marx et Engels. Dans le précédent article de cette série, par exemple, nous avons cité l'un des commentaires de Marx sur les mesures économique de la Commune de Paris dans lequel il semble dire que si les coopératives ouvrières centralisaient et planifiaient la production à l'échelle nationale, ce serait alors du communisme. Ailleurs, Marx semble défendre comme une mesure transitoire vers le communisme, l'administration par l'Etat d'opérations typiquement capitalistes telles que le crédit ([3] [1651]).
En soulignant ces erreurs, nous n'émettons aucun jugement moral sur nos ancêtres politiques. La clarification de ces questions ne pouvait être réalisée que par le mouvement révolutionnaire du 20e siècle, après des décennies d'expérience douloureuse : la contre-révolution stalinienne en Russie en particulier, et plus généralement, le rôle croissant de l'Etat en tant qu'agent organisateur de la vie économique à l'époque de la décadence capitaliste. La clarification qui s'est opérée aujourd'hui, est entièrement fondée sur la méthode d'analyse élaborée par les fondateurs du marxisme, et sur certains aperçus prophétiques sur le rôle que l'Etat aurait ou pourrait avoir dans l'évolution du capital.
Ce qui a permis aux générations ultérieures de marxistes de corriger certaines des erreurs « capitalistes d'Etat » précédentes, a été, par dessus tout, l’instance de Marx selon laquelle le capital est un rapport social, et ne peut défini d'une manière purement juridique. Tout l'objectif du travail de Marx est de définir le capitalisme comme un système d'exploitation fondé sur le travail salarié, l'extraction et la réalisation de la plus-value. De ce point de vue, cela n'a absolument aucun rapport de savoir si celui qui arrache la plus-value des ouvriers, qui réalise cette valeur sur le marché en vue d'accroître un profit et d'étendre son capital, est un bourgeois individuel, une corporation, ou un Etat national. Alors que le rôle l'économique de l'Etat s'accroissait peu à peu et nourrissait par conséquent les attentes illusoires de certaines parties du mouvement ouvrier, c'est cette rigueur théorique qui permit à Engels de formuler un passage souvent cité dans lequel il souligne que « ni la transformation en sociétés par actions, ni la transformation en propriété d'Etat ne supprime la qualité de capital des forces productives. Pour les sociétés par actions, cela est évident Et l'Etat moderne n'est à son tour que l'organisation que la société bourgeoise se donne pour maintenir les conditions extérieures générales du mode de production capitaliste contre des empiétements venant des ouvriers comme des capitalistes isolés. L'Etat moderne, quelle qu'en soit la forme, est une machine essentiellement capitaliste : l'Etat des capitalistes, le capitaliste collectif en idée. Plus il fait passer de forces productives dans sa propriété, et plus il devient capitaliste collectif en fait, plus il exploite de citoyens. Les ouvriers restent des salariés, des prolétaires. Le rapport capitaliste n'est pas supprimé, il est au contraire poussé à son comble ». ([4] [1652])
Parmi les apologues les plus sophistiqués du stalinisme, il y a des courants, habituellement les trotskystes et leur progéniture, qui ont défendu que si on ne pouvait traiter de socialiste le monstrueux cauchemar bureaucratique de l'ancienne URSS et d'autres régimes similaires, on ne pouvait pas non plus les appeler capitalistes car, lorsque existe la nationalisation totale de l'économie (bien qu'en réalité aucun régime stalinien n'ait atteint ce point-là), la production et la force de travail perdent leur caractère marchand. Tout au contraire, Marx était capable d'envisager théoriquement la possibilité d'un pays dans lequel tout le capital social se trouve entre les mains d'un seul agent sans que ce pays cesse d'être capitaliste : « Le capital pourra grossir ici par grandes masses en une seule main, parce que là il s'échappera d'un grand nombre. Dans une branche de production particulière, la centralisation n'aurait atteint sa dernière limite qu'au moment où tous les capitaux qui s'y trouvent engagés ne formeraient plus qu'un seul capital individuel. Dans une société donnée elle n'aurait atteint sa dernière limite qu'au moment où le capital national tout entier ne formerait plus qu'un seul capital entre les mains d'un seul capitaliste ou d'une seule compagnie de capitalistes. » ([5] [1653])
Du point de vue du marché mondial, les « nations » ne sont, de toutes façons, rien de plus que des capitalistes ou des compagnies particuliers, et les rapports sociaux en leur sein sont entièrement dictés par les lois globales de l'accumulation capitaliste. Ca ne change pas grand chose si l'achat et la vente ont disparu à l'intérieur de telles ou telles frontières nationales : de tels pays ne sont pas plus des « îles de non capitalisme » dans l'économie capitaliste mondiale, que les kibboutz ne sont des îles de socialisme en Israël.
Ainsi la théorie marxiste contient-elle donc toutes les prémisses nécessaires au rejet de l'identification entre le capitalisme d'Etat et le socialisme. De surcroît, déjà à leur époque, Marx et Engels se sont trouvés confrontés à la nécessité de traiter cette déviation « socialiste d'Etat ».
« Le socialisme allemand »
L'Allemagne n'a jamais traversé de phase de capitalisme libéral : la faiblesse de la bourgeoisie allemande a fait que c'est un puissant Etat bureaucratique dominé par des éléments semi-féodaux qui a veillé sur le développement du capitalisme en Allemagne. Le résultat a été ce qu'Engels a appelé « cette vénération superstitieuse de l'Etat » ([6] [1654]) qui était particulièrement forte en Allemagne et a énormément corrompu le mouvement ouvrier dans ce pays. Cette tendance était personnifiée par Ferdinand Lassalle dont la croyance dans la possibilité d'utiliser l'Etat existant par les ouvriers l'a même conduit à faire une alliance avec le régime de Bismarck « contre les capitalistes. » Mais le problème ne se réduisait pas au « socialisme d'Etat bismarckien » de Lassalle. Il y avait, dans le mouvement ouvrier allemand, un courant marxiste dirigé par Liebknecht et Bebel. Mais cette tendance est souvent tombée dans le genre de marxisme qui a amené Marx lui-même à déclarer qu'il n'était pas marxiste : une tendance mécaniste, schématique, et surtout, manquant d'audace révolutionnaire. Le fait même que ce courant s'appelait « social-démocrate », constituait en lui-même un pas en arrière : dans les années 1840, la social-démocratie avait été synonyme du « socialisme réformiste » de la petite-bourgeoisie, et Marx et Engels s'étaient délibérément définis comme communistes pour souligner le caractère prolétarien et révolutionnaire de la politique qu'ils défendaient.
Les faiblesses du courant Liebknecht-Bebel se révélèrent ouvertement en 1875, lorsqu'il fusionna avec le groupe de Lassalle pour former le Parti Ouvrier Social Démocrate (SDAP, plus tard SDP). Le document fondateur du nouveau parti, le Programme de Gotha faisait un certain nombre de concessions totalement inacceptables au Lassallisme. C'est ce qui amena Marx à rédiger la Critique du Programme de Gotha au cours de la même année.
Cette attaque cinglante contre les profondes confusions contenues dans le programme du nouveau parti resta un document « interne » jusqu'à 1891 : jusque là, Marx et Engels avaient eu peur que sa publication ne provoque une scission prématurée dans le SPD. On peut rétrospectivement se poser la question de la sagesse d'une telle décision, mais la logique qui y présidait est assez claire : avec toutes ses erreurs, le SPD était une réelle expression du mouvement prolétarien - il l'a montré en particulier dans la position internationaliste adoptée par Liebknecht et son courant -et même par beaucoup de Lassalliens -durant la guerre franco-prussienne et la Commune de Paris. Plus encore, le développement rapide du parti allemand avait déjà démontré l'importance croissante du mouvement en Allemagne pour l'ensemble de la classe ouvrière internationale. Marx et Engels ont vu la nécessité de mener un combat long et patient contre les erreurs idéologiques du SPD, et ils l'ont fait dans nombre de documents écrits après la Critique. Mais cette lutte était motivée par l'effort de instruire le parti, non de le détruire. C'est là la méthode qui a toujours fondé la lutte de la gauche marxiste contre la montée de l'opportunisme au sein du parti de classe : c'était une lutte pour le parti tant que celui-ci contenait une vie prolétarienne en son sein.
Dans la critique que font Marx et Engels du parti allemand, nous pouvons voir l'esquisse de bien des questions reprises plus tard par leurs successeurs, et qui devaient devenir des questions de vie ou de mort dans les grands événements historiques du début du 20e siècle. Et ce n'est absolument pas par hasard que celles-ci furent toutes centrées autour de la conception marxiste de la révolution prolétarienne, qui a toujours été la question clé qui différenciait les révolutionnaires des réformistes et des utopistes dans le mouvement ouvrier.
Réforme ou révolution
Dans la seconde moitié du 19e siècle, le capitalisme a connu sa plus grande accélération et un développement mondial. Dans ce contexte, la classe ouvrière a été capable d'arracher des concessions significatives à la bourgeoisie, améliorant considérablement les terribles conditions de travail et d'existence qui avaient présidé durant les phases antérieures de la vie du capitalisme (limitation du temps de travail, du travail des enfants, augmentation des salaires réels, etc.). Combiné à cela, il y eut des gains de nature plus politique - le droit de se réunir, de former des syndicats, de participer aux élections, etc. -qui permirent à la classe ouvrière de s'organiser et de s'exprimer dans la bataille pour l'amélioration de sa situation au sein de la société bourgeoise.
Marx et sa tendance ont toujours soutenu la nécessité de cette lutte pour des réformes, rejetant les arguments sectaires d'éléments tels que Proudhon, et, plus tard, Bakounine, qui voyaient ces luttes comme futiles ou comme une diversion par rapport à la voie vers la révolution. Contre de telles idées, Marx a affirmé qu'une classe incapable de défendre ses intérêts les plus immédiats, ne serait jamais capable d'organiser une nouvelle société.
Mais le succès même de la lutte pour des réformes a eu des conséquences négatives - la croissance de courants qui transformèrent cette lutte en une idéologie de réformisme, rejetant ouvertement le but communiste final en faveur de la lutte pour des acquis immédiats, ou bien amalgamant les deux en un mélange confus et déroutant. Marx et Engels peuvent ne pas avoir vu tous les dangers qu'impliquait la croissance de tels courants -c'est-à-dire qu'ils finiraient par attirer la majorité des organisations de la classe ouvrière au service de la bourgeoisie et de son Etat - mais le combat contre le réformisme en tant que type d'idéologie bourgeoise au sein du mouvement prolétarien, combat qui devait ultérieurement occuper les énergies de tant de révolutionnaires tels Lénine et Luxemburg, a certainement sérieusement commencé avec eux.
Ainsi, dans la Critique du Programme de Gotha, Marx souligne que non seulement les revendications immédiates que celui-ci contient (sur l'éducation, le travail des enfants) sont formulées de façon confuse ; mais pire que ça, le parti nouvellement formé ne parvient absolument pas à faire la distinction entre ces revendications immédiates et le but ultime. C'est particulièrement vrai dans l'appel à « des coopératives de production avec l'aide de l'Etat, sous le contrôle démocratique du peuple travailleur » qui serait sensé paver le chemin vers « l'organisation socialiste du travail ». Marx critique sans merci cette panacée du prophète Lassalle : « Au lieu de découler du processus de transformation révolutionnaire de la société, "l'organisation socialiste de l'ensemble du travail résulte" de "l'aide de l'Etat", aide que l'Etat fournit aux coopératives de production que lui-même (et non le travailleur) a "suscitées". Croire qu'on peut construire une société nouvelle au moyen de subventions de l'Etat aussi facilement qu'on construit un nouveau chemin de fer, voilà qui est bien digne de la présomption de Lassalle ! » ([7] [1655]).
C'est un avertissement explicite vis-à-vis de ceux qui proclament que l'Etat capitaliste existant peut être d'une quelconque façon utilisé comme instrument de création du socialisme - même s'ils le présentent d'une façon plus sophistiquée qu'elle ne l'est dans le Programme de Gotha.
A la fin des années 1870, les défenseurs du réformisme dans le parti allemand sont devenus encore plus culottés, au point de mettre en question le fait que le parti se présente comme ...une organisation de la classe ouvrière. Dans leur « Circulaire à A. Bebel, W. Liebknecht, W.Bracke » rédigée en Septembre 1879, Marx et Engels portent ce qui constitue probablement l'attaque la plus lucide contre les éléments opportunistes qui infiltraient de plus en plus le mouvement :
« On joue aujourd'hui au social-démocrate, comme on jouait au démocrate bourgeois en 1848. Comme ces derniers considéraient la république démocratique comme quelque chose de très lointain, nos sociaux-démocrates d'aujourd'hui considèrent le renversement de l'ordre capitaliste comme un objectif lointain, et, par conséquent, comme quelque chose qui n'a absolument aucune incidence sur la pratique politique actuelle. On peut donc à coeur joie faire le philanthrope, l'intermédiaire, et couper la poire en deux. Et c'est ce que l'on fait aussi dans la lutte de classe entre prolétariat et bourgeoisie. On la reconnaît sur le papier - de toute façon, il ne suffit pas de la nier pour qu'elle cesse d'exister -, mais dans la pratique on la camoufle, on la dilue et on l'édulcore. Le parti social-démocrate ne doit pas être un parti ouvrier ; il ne doit pas s'attirer la haine de la bourgeoisie, aucune autre ; c'est avant tout dans bourgeoisie qu'il faut faire une propagande énergique. Au lieu de s'appesantir sur des objectifs lointains qui, même s'ils ne peuvent être atteints par notre génération, effraient les bourgeois, le parti ferait mieux d'user toute son énergie à des réformes petites-bourgeoises de rafistolage qui vont consolider le vieil ordre social et peuvent éventuellement transformer la catastrophe finale en un processus de dissolution lent, fragmentaire, si possible pacifique. » ([8] [1656])
Telles sont les grandes lignes de la critique marxiste envers toutes les variantes ultérieures de réformisme qui devaient avoir un effet désastreux dans les rangs de la classe ouvrière international.
La dictature du prolétariat contre l’« Etat du peuple »
L'incapacité du Programme de Gotha à définir le lien réel entre les phases défensive et offensive du mouvement prolétarien s'exprimait également dans sa totale confusion sur l'Etat. Marx démolit son appel à fonder un « Etat libre et une société socialiste » comme un non-sens, puisque l'Etat et la liberté sont deux principes opposés : « La liberté consiste à transformer l'Etat, organe supérieur de la société, en un organe entièrement subordonné à elle. » ([9] [1657]). Dans une société pleinement développée, il n'y aura pas d'Etat. Mais plus important encore est la mise en évidence par Marx que cet appel à un « Etat du peuple » qui devrait se réaliser par l'attribution de réformes « démocratiques » que nombre de pays capitalistes avaient déjà concédées, constituait un moyen d'esquiver la question cruciale de la dictature du prolétariat. C'est dans ce contexte que Marx soulève la question : « Quelle transformation subira l'Etat dans une société communiste ? Autrement dit : quelles fonctions sociales s'y maintiendront-elles qui soient analogues aux fonctions actuelles de l'Etat ? Cette question ne peut avoir de réponse que par la science, et ce n'est pas en accouplant de mille manières le mot Peuple avec le mot Etat qu'on fera avancer le problème d'un saut de puce. Entre la société capitaliste et la société communiste, se place la période de transformation révolutionnaire de la première en la seconde. A quoi correspond une période de transition politique où l'Etat ne saurait être autre chose que la dictature révolutionnaire du prolétariat.
Le programme n'a pas à s'occuper, pour l’instant, de cette dernière, non plus que de la nature de l'Etat futur dans la société communiste » ([10] [1658])
Comme nous l'avons vu dans le précédent article de cette série, cette notion de dictature du prolétariat était, en 1875, quelque chose de très réel pour Marx et sa tendance : la Commune de Paris, quatre ans seulement auparavant, avait été le premier épisode vivant de la classe ouvrière au pouvoir, et il avait montré qu'un tel bouleversement politique et social ne pouvait avoir lieu que si les ouvriers renversaient l'appareil d'Etat et le remplaçaient par leurs propres organes de pouvoir. Le Programme de Gotha a démontré que cette leçon n'avait pas été assimilée par le mouvement ouvrier dans son ensemble, et, au fur et à mesure que grandissait le courant réformiste dans le mouvement, elle devait être de plus en plus oubliée.
Dans l'intérêt de l'exactitude historique, il est nécessaire de souligner que Marx et Engels n'avaient pas eux-mêmes pleinement assimilé cette leçon. Dans un discours au Congrès de L'Internationale à La Haye, en septembre 1872, Marx pouvait encore développer que « Il faut tenir compte des institutions, des coutumes et des traditions des différents pays, et nous ne nions pas qu'il y a des pays, comme l'Amérique et l'Angleterre, et si je connaissais mieux ses institutions, la Hollande, où les ouvriers peuvent parvenir à leurs buts par des moyens pacifiques. Ceci étant dit, nous devons reconnaître que dans la plupart des pays du continent, il faudra forcer le levier de la révolution ; le recours à la force sera nécessaire un jour afin d'établir la domination du travail ».
Il faut dire que cette idée était une illusion de la part de Marx - la mesure du poids de l'idéologie démocratique, même sur les éléments les plus avancés du mouvement ouvrier. Dans les années qui suivirent, toutes sortes d'opportunistes devaient se saisir de telles illusions pour donner l'estampille d'approbation de Marx à leurs efforts pour abandonner toute idée de révolution violente et calmer la classe ouvrière avec la croyance qu'elle pourrait se débarrasser, pacifiquement et par des moyens légaux, du capitalisme, en utilisant les organes de la démocratie bourgeoise. Mais la tradition marxiste authentique n'est pas avec eux. Elle est avec les pairs de Pannekoek, Boukharine et Lénine qui ont pris les éléments les plus audacieux et révolutionnaires de la pensée de Marx sur la question, ce qui menait inexorablement à la conclusion que pour établir la domination du travail dans n'importe quel pays, la classe ouvrière devrait utiliser le levier de la force, et, d'abord et avant tout, contre l'appareil d'Etat existant, quelles que soient ses formes démocratiques. De plus, c'est la réalité, l'évolution réelle de l'Etat démocratique, qui leur ont permis de tirer cette conclusion, car, comme le dit Lénine dans L'Etat et la révolution :
«Aujourd'hui en 1917, à l'époque de la première grande guerre impérialiste, cette restriction de Marx ne joue plus. L'Angleterre comme l'Amérique, les plus grands et les derniers représentants de la "liberté" anglo-saxonne dans le monde entier (absence de militarisme et de bureaucratisme) ont glissé entièrement dans le marais européen, fangeux et sanglant, des institutions militaires et bureaucratiques, qui se subordonnent tout et écrasent de tout leur poids. Maintenant en Angleterre comme en Amérique, la "condition première de toute révolution populaire réelle", c'est la démolition, la destruction de la "machine d'Etat toute prête". » ([11] [1659])
La critique du substitutionisme
L'Association internationale des travailleurs (AIT) avait proclamé que « l'émancipation des travailleurs doit être l'oeuvre des travailleurs eux-mêmes ». Bien qu'il ne fût pas possible dans le mouvement ouvrier au 19e siècle de clarifier tous les aspects des rapports entre le prolétariat et sa minorité révolutionnaire, cette affirmation constitue une prémisse de base pour toute clarification ultérieure. Et, dans les polémiques au sein du mouvement après 1871, la fraction marxiste a eu de nombreuses occasions pour pousser la question plus loin que dans l'affirmation générale de l'AIT. En particulier dans le combat contre les véritables éléments réformistes qui infestaient le parti allemand, Marx et Engels étaient amenés à montrer que les visions élitistes et hiérarchiques des rapports entre le parti et la classe provenaient de l'idéologie bourgeoise et petite-bourgeoise, dont étaient porteurs, en particulier, les intellectuels des classes moyennes qui voyaient le mouvement ouvrier comme le véhicule de leurs propres schémas d'amélioration de la société.
La réponse des marxistes à ce danger n'était pas de se retirer dans l'ouvriérisme, dans l'idée qu'une organisation uniquement composée d'ouvriers industriels serait la meilleure garantie contre la pénétration des idées de la classe ennemie. « C'est un phénomène inévitable et inhérent au cours historique que des individus ayant appartenu jusqu'alors à la classe dominante se rallient au prolétariat en lutte et lui apportent des éléments de formation théorique. C'est ce que nous avons expliqué déjà dans le Manifeste Communiste, cependant, il convient défaire deux observations à ce sujet :
Premièrement : ces gens, pour être utiles au mouvement prolétarien, doivent vraiment lui apporter des éléments de formation d'une valeur réelle, or ce n'est pas du tout le cas de la grande majorité des bourgeois allemands convertis... Deuxièmement : lorsque ces individus venant d'autres classes se rallient au mouvement prolétarien, la première chose qu'il faut exiger d'eux, c'est de n'apporter avec eux aucun vestige de leurs préjugés bourgeois, petits-bourgeois, etc., mais de s'approprier sans réserve les conceptions prolétariennes. Or, ces messieurs ont démontré qu'ils sont enfoncés jusqu'au cou dans les idées bourgeoises et petites-bourgeoises... Nous ne pouvons donc marcher avec des gens qui expriment ouvertement que les ouvriers sont trop incultes pour s'émanciper eux-mêmes et qu'ils doivent donc être libérés d'abord par en haut, par les grands et philanthropes petits bourgeois. » ([12] [1660])
L'idée que les ouvriers ne pourraient s'émanciper que grâce à l'action bénévole d'un Etat tout puissant va de pair avec celle d'un parti de « bienfaiteurs » descendus tout droit du ciel pour libérer ces pauvres ouvriers des ténèbres de leur ignorance et de leur servitude. Elles font toutes deux partie du même emballage réformiste socialiste d'Etat que Marx et son courant ont combattu avec tant d'énergie. Il faut dire, cependant, que l'illusion selon laquelle une petite élite pourrait agir au nom de la classe ouvrière ou à sa place, ne se limitait pas à ces éléments réformistes : elle pouvait être également défendue par des courants authentiquement prolétariens et révolutionnaires, et les Blanquistes en étaient l'exemple par excellence. La version blanquiste du substitutionisme était un vestige de la première phase du mouvement révolutionnaire ; dans son Introduction à La guerre civile en France, Engels montre comment l'expérience vivante de la Commune de Paris avait réfuté, dans la pratique, la conception blanquiste de la révolution :
« Elevés à l'école de la conspiration, liés par une stricte discipline qui lui est propre, (les blanquistes) partaient de cette idée qu'un nombre relativement petit d'hommes résolus et bien organisés était capable, le moment venu, non seulement de s'emparer du pouvoir, mais aussi, en déployant une grande énergie et de l'audace, de s'y maintenir assez longtemps pour réussir à entraîner la masse du peuple dans la révolution et à la rassembler autour de la petite troupe directrice. Pour cela, il fallait avant toute autre chose la plus stricte centralisation dictatoriale de tout le pouvoir entre les mains du nouveau gouvernement révolutionnaire. Et que fit la Commune qui, en majorité, se composait précisément de blanquistes ? Dans toutes ses proclamations aux Français de la province, elle les conviait à une libre fédération de toutes les communes françaises avec Paris, à une organisation nationale qui, pour la première fois, devait être effectivement créée par la nation elle-même. Quant à la force répressive du gouvernement naguère centralisé, l'armée, la police politique, la bureaucratie créées par Napoléon en 1798, reprises, depuis, avec reconnaissance par chaque nouveau gouvernement et utilisées par lui contre ses adversaires, c'est justement cette force qui devait partout être renversée, comme elle l'avait été déjà à Paris. » ([13] [1661])
Que ce qu'il y avait de meilleur chez les blanquistes ait été obligé d'aller au-delà de leur propre idéologie s'est également confirmé dans les débats au sein de l'organe central de la Commune : lorsqu'un membre important du Conseil de la Commune a voulu suspendre les règles démocratiques de celle-ci et ériger un « Comité de Salut public » dictatorial sur le modèle de la révolution française bourgeoise, un nombre considérable de ceux qui s'y opposèrent étaient des blanquistes - preuve qu'un courant authentiquement prolétarien peut être influencé par le développement du mouvement réel de la classe, chose qui est rarement arrivé dans le cas des réformistes qui représentaient une tendance très matérielle de l'organisation de la classe à tomber entre les mains de son ennemi de classe.
Le contenu économique de la transformation communiste
Bien que le Programme de Gotha parle de « l'abolition du système salarié », sa vision sous-jacente de la société future était celle d'un « socialisme d'Etat ». Nous avons vu qu'il contenait la notion absurde d'un mouvement vers le socialisme au moyen de coopératives ouvrières assistées par l'Etat. Mais même lorsqu'il traite plus directement de la société socialiste future (dans laquelle existe toujours un «Etat libre »...), il est incapable d'aller au-delà de la perspective d'une société essentiellement capitaliste, dirigée par l'Etat au bénéfice de tous. Marx est capable de détecter cela sous le couvert des belles phrases du Programme, en particulier les parties qui parlent de la nécessité que « le travail collectif soit réglementé en communauté avec partage équitable du produit » et « d'abolir le système salarié avec la loi d'airain des salaires ». Ces expressions reflètent la contribution lassallienne à la théorie économique qui était, en fait, un abandon complet de la vision scientifique de Marx qui voit l'origine de la plus-value dans un temps de travail non payé, extrait des ouvriers. Les mots vides du Programme sur la «juste distribution » dissimulent le fait qu'il ne fait en réalité aucun projet pour se débarrasser des mécanismes fondamentaux de la production de valeur qui constitue la source infaillible de toute « injustice » dans la distribution des produits du travail.
Contre ces confusions, Marx affirme que : «Au sein de la société coopératrice, fondée sur la propriété commune des moyens de production, les producteurs n'échangent pas leurs produits ; de même, le travail employé à des produits n'apparaît pas davantage ici comme valeur de ces produits, comme une qualité réelle possédée par eux, puisque désormais, au rebours de ce qui se passe dans la société capitaliste, ce n'est plus par la voie d'un détour, mais directement, que les travaux de l'individu deviennent partie intégrante du travail de la communauté. L'expression : "produit du travail", condamnable, même aujourd'hui, à cause de son ambiguïté, perd ainsi toute signification. » ([14] [1662])
Mais plutôt que d'offrir une vision utopique de l'abolition immédiate de toutes les catégories de la production capitaliste, Marx souligne la nécessité de distinguer les phases inférieure et supérieure du communisme : « Ce à quoi nous avons affaire ici, c'est à une société communiste non pas telle qu'elle s'est développée sur une base qui lui soit propre, mais telle qu'elle vient, au contraire, de sortir de la société capitaliste ; par conséquent, une société qui, sous tous les rapports, économique, moral, intellectuel, porte encore les marques matérielles de l'ancienne société du sein de laquelle elle sort. » ([15] [1663])
Dans cette phase, existe encore la pénurie ainsi que tous les vestiges de la « normalité » capitaliste. Au niveau économique, l'ancien système salarié a été remplacé par un système de bons du travail : « le producteur reçoit donc individuellement... l'équivalent exact de ce qu'il a donné à la société. Ce qu'il lui a donné, c'est son quantum individuel de travail... Il reçoit de la société un bon constatant qu'il a fourni tant de travail (défalcation faite du travail effectué pour le fonds collectif) et, avec ce bon, il retire des stocks sociaux une quantité d'objets de consommation correspondant à la valeur de son travail. » ([16] [1664])
Comme Marx le souligne dans Le Capital, ces bons ne sont plus de l'argent au sens où ils ne peuvent ni circuler, ni être accumulés ; ils ne peuvent qu'« acheter » des articles de consommation individuels. D'une autre côté, ils ne sont pas complètement libérés des principes de l'échange de marchandises : « C'est évidemment ici le même principe que celui qui règle l'échange des marchandises pour autant qu'il est un échange de valeurs égales. Le fond et la forme diffèrent parce que, les conditions étant différentes, nul ne peut rien fournir d'autre que son travail £t que, par ailleurs, rien d'autre que des objets de consommation individuelle ne eut entrer dans la propriété de l'individu. Mais en ce qui concerne le partage de ces objets entre producteurs pris individuellement, le principe directeur est le même que pour l'échange de marchandises équivalentes : un même quantité de travail sous une forme s'échange contre une même quantité de travail sous une autre forme. Le droit égal est donc toujours ici, en principe, le droit bourgeois... » ([17] [1665]) parce que, comme l'explique Marx, les ouvriers ont des besoins et des capacités très différents. C'est seulement dans la phase supérieure du communisme, quand « toutes les sources de la richesse collective jailliront avec abondance, alors seulement l'étroit horizon du droit bourgeois pourra être complètement dépassé et la société pourra écrire sur ses drapeaux : De chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins !» ([18] [1666])
Quelle est la cible exacte de cette polémique ? Ce qu'il y a derrière, c'est la conception classique du communisme non comme un « état » qui doit être imposé mais en tant que « mouvement réel qui abolit l'état de choses existant » comme l'a exprimé L'idéologie allemande trente ans auparavant. Marx élabore donc la vision de la dictature du prolétariat comme initiant un mouvement vers le communisme, d'une société communiste émergeant de l'effondrement du capitalisme et de la révolution prolétarienne. Contre la vision socialiste d'Etat selon laquelle la société capitaliste se transforme elle-même, en quelque sorte, en communisme à travers l'action de l'Etat opérant comme employeur unique et bénévole de la société, Marx envisage une dynamique vers le communisme fondée sur une base communiste.
L'idée des bons du travail doit être considérée à cette lumière. Dans le premier exemple, ils sont conçus comme une attaque contre la production de valeur, comme un moyen de se débarrasser de l'argent en tant que marchandise universelle, pour mettre halte à la dynamique de l'accumulation. Ils ne sont pas considérés comme un but, mais comme un moyen vers un but, moyen qui pourrait être immédiatement introduit par la dictature du prolétariat comme première étape d'une société d'abondance qui n'aura plus besoin de mesurer la consommation individuelle en fonction de la production individuelle.
Au sein du mouvement révolutionnaire, il y a eu et continue d'y avoir un débat pour savoir si ce système est le plus approprié pour réaliser ces buts. Pour un certain nombre de raisons, nous dirions qu'il ne l'est pas. Pour commencer, la socialisation « objective » de bien des aspects de la consommation (électricité, gaz, logement, transport, etc.) sera, dans le futur, rendue possible très rapidement par la fourniture gratuite de la plus grande part de ce genre de biens et de services, étant uniquement assujettis au contrôle de l'ensemble des réserves par les ouvriers ; de même, pour beaucoup d'articles de consommation individuels, un système de rationnement contrôlé par les conseils ouvriers aurait l'avantage d'être plus «collectif», moins dominé par les conventions de l'échange de valeur. Nous reviendrons là-dessus et sur d'autres problèmes dans un autre article. Notre préoccupation principale, ici, est de mettre à nu la méthode fondamentale de Marx : pour lui, le système des bons du travail avait une validité comme moyen d'attaquer les fondements du système de travail salarié et c'est par rapport à ce critère qu'il doit être jugé ; en même temps, il en reconnaissait clairement les limites, parce que le communisme intégral ne peut être réalisé en une nuit, mais seulement après « une période de transition plus ou moins longue ». En ce sens, Marx est lui-même le critique le plus sévère du système des bons du travail, insistant sur le fait qu'ils n'échappent pas à « l'étroit horizon du droit bourgeois » et qu'ils incarnent la persistance de la loi de la valeur. Ici, tout faux radicalisme est fatal (et, en fait, conservateur dans la pratique) parce qu'il amènerait le prolétariat à mélanger des moyens temporaires et contingents avec les buts réels. Ceci est, comme nous le verrons, une erreur dans laquelle beaucoup de révolutionnaires sont tombés durant la période de soi-disant communisme de guerre en Russie. Pour Marx, il fallait toujours garder en tête le but final du communisme, sinon le mouvement qui y conduit s'égarerait, et, finalement, serait pris une fois de plus dans l'orbite de la planète Capital.
Le prochain article de cette série examinera le combat de Marx contre la principale version du faux radicalisme à l'époque : le courant anarchiste autour de Bakounine.
CDW.
« Voila ce qui distingue les marxistes des anarchistes : les premiers tout en se proposant de supprimer complètement l'Etat, ne croient la chose réalisable qu'après la suppression des classes par la révolution socialiste, comme résultat de l'instauration du socialisme qui mène à la disparition de l'Etat; les seconds veulent la suppression complète de l'Etat du jour au lendemain, sans comprendre les conditions qui la rendent possible (...) » Lénine, L'Etat et la révolution
chap. 6, Oeuvres choisies II, Ed. Moscou.
[1] [1667] Revue Internationale n° 77, 8e partie
[2] [1668] Lire l'article de cette série dans la Revue Internationale n° 72
[3] [1669] Cf. Le Capital, Volume 3, chapitre XXXVI.
[4] [1670] Anti-Dühring, Chapitre 2 : « Notions théoriques », Editions sociales (3e édition), page 315. Engels continue plus loin : « En poussant de plus en plus à la transformation des grands moyens de production socialisés en propriété d'Etat, (le mode de production capitaliste) montre lui-même la voie à suivre pour accomplir ce bouleversement. Le prolétariat s'empare du pouvoir d'Etat et transforme les moyens de production d'abord en propriété d'Etat », ce dont il conclut que « le premier acte dans lequel l'Etat apparaît réellement comme représentant de toute la société, - la prise de possession des moyens de production au nom de la société -, est en même temps son dernier acte propre en tant qu'Etat. » (ibid., pages 316 et 317). Engels se réfère ici sans aucun doute à l'Etat post-révolutionnaire qui se forme après la destruction du vieil Etat bourgeois. Cependant, l'expérience de la révolution russe a mené le mouvement révolutionnaire à mettre en question cette formulation même : la propriété des moyens de production même par « Etat-Commune » ne conduit pas à la disparition de l'Etat, et peut même contribuer à son renforcement et à sa perpétuation. Mais évidemment Engels ne bénéficiait pas d'une telle expérience.
[5] [1671] Le Capital, Chapitre XXV, septième section, Editions La Pléiade, Tome I, page 1139. Bien que Marx utilise ici le terme « société », il ne peut que vouloir dire « pays » et non société capitaliste comme un seul tout : comme il le remarque ailleurs, un capital qui n'affronte pas d'autres capitaux, n'existe pas.
Le capitalisme ne peut exister sans la concurrence entre des unités capitalistes. De plus, l'histoire a montré que l'Etat-nation constitue le niveau le plus élevé d'unité effective que le capital puisse atteindre. Ceci a été confirmé récemment par la désintégration des blocs impérialistes formés en 1945 : une fois que la nation dominante n'est plus capable d'imposer l'unité du bloc, il éclate en différentes unités nationales qui le composent et sont concurrentes.
[6] [1672] Introduction à La guerre civile en France, Ed. sociales, page 301.
[7] [1673] Editions Spartacus, page 32.
[8] [1674] « La social-démocratie allemande », Editions 10 18, page 146.
[9] [1675] Critique du Programme de Gotha, Ed. Spartacus, page 33.
[10] [1676] Ibid., page 34. Dans le précédent article de cette série, nous faisons référence à l'expérience de la révolution russe qui selon nous a montré la nécessité de faire une distinction entre l'Etat de la période de transition et la dictature du prolétariat, entre l'organe qui émane de la société transitoire et a la tâche de maintenir sa cohésion, et les instruments réels du pouvoir prolétarien (les conseils ouvriers, les comités d'usines, etc.) qui ont la tâche d'initier et de diriger le processus de transformation communiste. A certaines occasions, des groupes du milieu prolétarien ont utilisé ce passage de la Critique du Programme de Gotha (c'est-à-dire que l'Etat ne peut être que la dictature du prolétariat) pour argumenter contre cette distinction qui serait en contradiction avec Marx et le marxisme. En réponse, nous ne pouvons qu'affirmer que le mouvement réel de la classe a clarifié cette question dans la pratique ainsi qu'en théorie ; mais il est également important de comprendre le contexte historique de ce passage qui était une polémique contre ceux qui voulaient laisser l'Etat bourgeois existant tel quel et avaient peur de l'idée même de révolution.
[11] [1677] Editions sociales, pages 57-58.
[12] [1678] « Circulaire à A. Bebel », idem note 8, pages 147-148-149.
[13] [1679] Idem note 6, pages 299-300.
[14] [1680] Idem note 9, pages 21 -22.
[15] [1681] Idem
[16] [1682] Idem
[17] [1683] Idem
[18] [1684] Idem, page 24.
Approfondir:
Questions théoriques:
- Communisme [492]
Heritage de la Gauche Communiste:
Revue Internationale no 79 - 4e trimestre 1994
- 2787 reads
Editorial : les grandes puissances répandent le chaos
- 2432 reads
Jeudi 8 septembre 1994, une semaine après le retrait définitif des troupes russes de la totalité du territoire de l’ex-RDA, le tour était venu aux trois alliés d'hier, Américains, Britanniques et Français d'évacuer Berlin. Quel symbole ! S'il est une ville qui, à elle seule, résume ces 45 années d'affrontements Est-Ouest, ce demi siècle de guerre dite froide, cynique euphémisme d'historien car il n'y a qu'à voir combien furent chauds et sanglants les bras de fer engagés en Corée et au Viêt-nam, c'est bien Berlin. La sinistre page d'histoire des rivalités impérialistes qui avait commencé à s'écrire dès la fin du second conflit mondial entre les Etats-Unis, la défunte URSS et leurs alliés respectifs, et dont l'Allemagne, à travers Berlin, avait constitué un des enjeux principaux, est donc tournée. Pourtant, force est de constater que la fin de cette époque, qui en réalité a débuté dès novembre 1989 avec la chute du mur de Berlin, ne correspond en rien à ce « nouvel ordre mondial » tant promis par tous les dirigeants des grands Etats capitalistes. Les dividendes de la paix se font décidément attendre.
En fait, jamais nous n'avons été aussi éloignés d'un monde fondé sur la concorde entre les Etats et sur la prospérité économique. En revanche, à l'exception peut-être des deux premiers conflits mondiaux, jamais l'humanité n'a eu autant à subir la barbarie, la sauvagerie d'un mode de production décadent, le capitalisme, qui partout se distingue à travers l'éternelle litanie des massacres, des épidémies, des exodes et des destructions.
Bombardements en Bosnie, attentats au Maghreb, massacres au Rwanda, tueries au Yémen, embuscades en Afghanistan, exode à Cuba, famine en Somalie... les contrées du globe épargnées par le chaos se font de plus en plus rares. C'est chaque jour désormais que sur tous les continents habités la liste des pays sombrant dans le désordre le plus total s'allonge.
Cela d'ailleurs, plus personne ne l'ignore. Il faut dire que quotidiennement les médias bourgeois et leurs zélés journalistes aux ordres ne manquent pas de nous montrer, de nous faire lire et entendre jusque dans les moindres détails la façon dont souffrent des millions d'êtres humains de part le monde. C'est, paraît-il, la déontologie de nos informateurs qui l'exige. Les citoyens des pays démocratiques peuvent et surtout doivent savoir. Nous vivons là, soi-disant, les temps modernes du triomphe de l'information objective. En vérité, si les renseignements bourgeois sont toujours bien à même de nous jeter à la figure le film de l'agonie de centaines de milliers d'individus comme au Rwanda, ils en masquent toujours les causes réelles. Constamment ils font passer pour vraies de fausses explications.
Le déchaînement du chaos porte la signature des grandes puissances
Pour ce qui est du dernier massacre en date, celui des populations ruandaises où près de 500 000 personnes ont péri, les interprétations fallacieuses de la bourgeoisie n'ont pas manqué. Tout, à peu près, a été dit au sujet des haines inexpiables qu'entretiennent entre eux les Tutsis et les Hutus et sur leurs différends remontant, paraît-il, à la nuit des temps. Rien n'est plus faux. Les vrais barbares se sont, entre autres, les officiels français, hauts fonctionnaires et diplomates aux discours onctueux, défenseurs acharnés des intérêts de l'impérialisme français dans la région. Car c'est bel et bien la bourgeoisie française qui, des années durant, a équipé militairement les troupes majoritairement hutues de feu le président Habyarimana, les sinistres FAR, responsables des premières tueries et des premiers exodes massifs de populations essentiellement tutsies. Cette orgie meurtrière, les autorités locales l'avaient planifiée ; ça, tous les grands journalistes et autres experts patentés se sont bien gardés de le dévoiler avant ou pendant les massacres. De même, très peu de choses ont filtré quant au soutien massif de la part des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne dont a bénéficié l'autre faction, tout aussi assassine, du FPR majoritairement tutsie. Il n'y a rien d'étonnant à ce que la France n'ait pas vigoureusement dénoncé cet appui américain au FPR, sans quoi elle n'aurait pas pu se draper dans sa vertueuse défense des Droits de l'Homme dont elle est, à l'en croire, la patrie universellement garante. L'opération Turquoise n'a été que l'alibi humanitaire du criminel Etat français, la défense de ses sordides intérêts impérialistes, son mobile. Toutefois cette intervention n'a pu ni empêcher la poursuite des tueries, tel n'était pas son but, ni, par-dessus tout, empêcher la prise de Kigali par les pro-américains du FPR. Pour Paris, c'est nettement plus fâcheux. Mais qu'à cela ne tienne, les fameuses FAR, réfugiées au Zaïre et manipulées par la France, seront encouragées à harceler, voire à reprendre le pouvoir au FPR.
Ainsi, toute puissance démontre par-là qu'elle est toujours prompte à déchaîner le chaos dans le pré-carré de sa rivale. Afin donc de mieux déstabiliser une position française, les Etats-Unis et l'Angleterre ont sciemment, en aidant le FPR, joué la carte du désordre. Si elle le peut, la bourgeoisie française finira tôt ou tard par leur rendre la monnaie de leur pièce. Le calvaire qu'endure la population ruandaise est donc loin d'être achevé. La guerre, le choléra, la dysenterie ou la famine n'ont pas fini de faire de nouvelles victimes et au bout du compte, de tous ces fléaux, le Rwanda ne se relèvera pas.
A l'aune de cet exemple on comprend mieux la situation en Algérie. Les acteurs, les armes utilisées, les objectifs sont les mêmes. Ici aussi il s'agit pour l'impérialisme américain de déloger la France d'une de ses traditionnelles zones d'influence, le Maghreb. C'est délibérément que les Etats-Unis, par l'intermédiaire de l'Arabie Saoudite qui finance le FIS (Front Islamique du Salut), cherchent à chasser la France de la région. Ainsi, d'attentats en exécutions fomentés par un FIS sponsorisé par Washington, de répression en incarcérations pratiquées par des militaires parrainés par Paris, l'Algérie est en proie aux pires convulsions. Ici aussi on peut imaginer le chemin de croix que représente pour ces populations la prise en tenailles entre le FIS et les militaires. En outre, il y a fort à parier que bientôt toute l'Afrique du Nord connaîtra le même sort. Les enjeux étant de nature identique, comme le reconnaît le géopoliticien Y. Lacoste, dans une interview donnée à la revue L'Histoire n°180: «A la suite de l'Algérie, la Tunisie va sans doute basculer. Et même le Maroc... Aussi allons-nous au-devant d'une période très difficile pour la France. »
Plus proche encore des grandes métropoles industrialisées d'Europe que l'Algérie, il y a l'ex-Yougoslavie où, depuis plus de trois ans déjà, la guerre et l'anarchie règnent en maîtres. Régulièrement pourtant, on n'hésite pas à nous y annoncer l'imminence de la paix. Systématiquement cependant, la réalité se charge de tailler en pièces toutes les calembredaines pacifistes dont nous abreuve la bourgeoisie.
Souvenons-nous. L'hiver dernier, c'est Sarajevo qui était censée retrouver un peu de calme. Messes célébrées, concerts retransmis en mondovision, collectes organisées pour venir en aide aux enfants de cette ville martyre, rien n'avait manqué pour fêter solennellement l'arrêt des combats, consécutif aux bons offices des chancelleries des « grandes démocraties ». Qu'en reste-t-il à présent ? Les bombardements et les tirs des snipers ont repris sur la ville, à tel point que le Pape, Jean-Paul II lui-même, n'a pas pris le risque de vérifier si, en septembre, sa papamobile résisterait à l'épreuve du gros calibre. Il a préféré se rendre à Zagreb, en Croatie. C'est moins dangereux, pour le moment. Pour le moment seulement, car tous les agissements des grandes puissances participent à l'aggravation du conflit. Pour exemple, la récente initiative américaine de constitution d'une fédération croato-bosniaque qui vise à détacher la Croatie de son alliance avec l'Allemagne, risque de porter la confrontation à un niveau plus élevé encore. En effet, la politique de la Maison Blanche, en étant prête à épauler les Croates dans leur entreprise d'annexion de la Krajina, qui est une enclave serbe sur leur territoire, aura pour conséquence l'opposition, à grande échelle cette fois-ci, des Croato-bosniaques aux Serbes. Ici, mais sûrement plus qu'ailleurs étant donné l'importance stratégique des Balkans, comme en Somalie, en Afghanistan ou au Yémen, l'exacerbation des tensions entre les grandes puissances conduit et conduira à la désolation. Certes, encore s'agit-il là de pays sous-développés où le prolétariat, trop faible, ne peut empêcher le déchaînement de la barbarie. Néanmoins, ce qu'il faut constater, c'est qu'autant naguère le capitalisme avait encore les moyens de repousser à la périphérie ce chaos, autant à présent il ne peut empêcher le rapprochement des manifestations de celui-ci des grandes métropoles industrialisées. Les convulsions qui secouent l'Algérie et l'ex-Yougoslavie l'attestent.
De même, ce qui frappe actuellement c'est le nombre de zones géographiques totalement ravagées par la guerre et les fléaux. D'une certaine manière, jusque dans les années soixante-dix, grosso modo, un conflit chassait l'autre. Désormais, comme en Afghanistan, ils se poursuivent sous d'autres formes. Ce phénomène n'est pas un hasard. A l'instar d'un cancéreux parvenu au stade terminal et dans le corps duquel les métastases prolifèrent, le capitalisme de cette fin de siècle est dévoré par les cellules folles de la guerre qu'il ne peut stopper.
Le capitalisme se décompose : seul le prolétariat offre une perspective
Certains ne manqueront pas d'objecter qu'il est certaines régions de la planète où la paix des braves est possible. Il en serait apparemment ainsi en Irlande du Nord où l'IRA semble déposer les armes. Rien n'est plus trompeur. En forçant les extrémistes catholiques du Nord à négocier, les Etats-Unis cherchent à faire pression sur l'Angleterre afin que celle-ci n'ait plus de prétexte à son maintien en Ulster. Pourquoi ? Parce que la Grande-Bretagne n'est plus le docile allié d'hier.
Depuis l'effondrement de l'URSS les divergences d'intérêts impérialistes vont bon train des deux côtés de l'Atlantique, et ce tout particulièrement à propos de l'ex-Yougoslavie. La « pax capitalista » n'est jamais qu'un moment particulier dans le combat que se livrent les Etats. En fait, la décomposition capitaliste a plutôt tendance à affecter de plus en plus certains pays industrialisés. Bien sûr, le niveau des manifestations de celle-ci est encore infiniment moins catastrophique comparé aux pays précédemment cités. Mais tel est pourtant le cas en Italie et ce précisément à cause des rivalités impérialistes qui traversent cet Etat. Si historiquement l'Etat démocratique italien ne s'est jamais distingué par sa stabilité ([1] [1685]), cette fragilité s'en trouve aujourd'hui aggravée, du fait des * rivalités qu'opposent en son sein différentes factions qui n'ont pas les mêmes options en matière d'alignements impérialistes. La clique de Berlusconi a plutôt choisi l'alliance américaine, tandis que l'autre, celle qui contrôle la magistrature, penche plutôt en faveur d'une alliance avec la France et l'Allemagne. Cet affrontement qui voit cette dernière faction n'avoir de cesse de dévoiler scandales sur scandales, conduit le pays à une situation de quasi paralysie. Bien évidemment, l'heure n'est pas venue d'un contexte à la ruandaise, où l'on verrait les bourgeois italiens régler leurs comptes à la machette. Non, pour le moment les coups de flingue et les pains de plastic suffisent. Le niveau de développement du pays n'est pas le même, l'histoire non plus, mais surtout et en premier lieu, la classe ouvrière italienne n'est pas prête à se ranger derrière tel ou tel clan bourgeois en présence.
Il en va d'ailleurs ainsi de l'ensemble du prolétariat des pays centraux. Cependant, ce non embrigadement de la seule classe capable d'apporter une perspective à l'humanité n'empêche pas pour autant le capitalisme de littéralement pourrir sur pied. Au contraire, c'est bien cette situation de blocage historique où ni le prolétariat ne peut imposer sa perspective historique immédiatement, c'est-à-dire le renversement du système, et où ni la bourgeoisie ne peut déclencher la guerre mondiale, qui est à l'origine de la phase de décomposition. Toutefois il est certain que si la classe ouvrière ne parvient pas au terme de sa mission historique, tous les scénarios les plus effroyables sont plausibles. De guerres en abominations de toute sortes, l'humanité finirait par être anéantie.
La classe bourgeoise n'a donc strictement rien à présenter face à la faillite de son organisation sociale. Elle ne nous propose que la résignation, l'acceptation de toute cette barbarie au nom de la fatalité, autant dire le suicide.
Car même en la reprise économique mondiale elle ne croit pas. Et pour cause. Elle sait que, même si elle parvient à relancer la production, en se livrant à une nouvelle fuite dans l'endettement (en particulier public), elle ne pourra plus résorber véritablement le chômage ni empêcher de violentes et destructrices explosions financières. La saturation du marché mondial et sa conséquence, à savoir la recherche de débouchés, cette autre guerre, commerciale cette fois, en obligeant tous les Etats et les entreprises à licencier, conduit les capitalistes à scier la branche sur laquelle ils sont assis. Finalement, comme c'est écrit dans le dernier roman du français J. Attali ce « brillant penseur» bourgeois, ex-conseiller de Mitterrand, ex-président de la BERD et personnage probablement le plus diplômé de France, il n'y a pas d'avenir sinon pour un monde abominable fait de trafics d'organes et où les pères tuent leur fils. Cet ouvrage qui s'intitule « Il viendra », mais il est déjà là, n'est jamais qu'un triste résumé du monde actuel et du néant qu'il nous garantit si le prolétariat ne le renverse pas.
Arkady, 17 septembre 1994[1] [1686] Voir à ce sujet dans la Revue internationale n° 76 et 77 la série « Comment est organisée la bourgeoisie ».
Questions théoriques:
- Décomposition [3]
- Guerre [129]
Les commémorations de 1944 : 50 ans de mensonges impérialistes (2e partie)
- 3486 reads
Dans la première partie de cet article nous nous sommes efforcés de souligner l'ignominie des commémorations du débarquement de 1944, lequel n'a signifié aucune libération « sociale » pour le prolétariat mais un massacre inouï au cours de l'ultime année de la guerre, misère et terreur au cours des années de reconstruction. L'ensemble des camps capitalistes antagonistes a été responsable de la guerre qui s'est terminée par un repartage-dépeçage du monde entre grandes puissances. Comme nous l'avons souligné à plusieurs reprises dans cette revue, le prolétariat n'est pas apparu au devant de la scène contrairement à la première guerre mondiale. Les ouvriers de tous les pays sont restés tétanisés par la terreur capitaliste. Mais si la classe ouvrière n'a pu se porter à la hauteur de sa capacité historique, à renverser la bourgeoisie, cela ne signifie pas qu'elle ait «disparu», ni qu'elle ait complètement abandonné sa combativité, ni que ses minorités révolutionnaires soient restées totalement paralysées.
La classe ouvrière est la seule force capable de s'opposer au déchaînement de la barbarie impérialiste comme elle l'a prouvé de manière incontestable au cours de la première guerre mondiale. Aussi, la bourgeoisie ne s'est-elle lancée dans la guerre qu'après avoir réuni les conditions pour l'embrigadement et l'impuissance du prolétariat international. La bourgeoisie démocratique actuelle peut pérorer sur sa libération. Ses prédécesseurs avaient pris avec vigilance toutes les précautions, avant, pendant et après-guerre pour éviter que le prolétariat n'ébranle à nouveau son édifice de barbarie comme en 1917 en Russie et 1918 en Allemagne. Cette expérience de la vague révolutionnaire surgie au cours et contre la guerre avait confirmé que la bourgeoisie n'est justement pas une classe toute-puissante. La lutte de masse du prolétariat qui débouche sur sa phase insurrectionnelle est une bombe sociale mille fois plus paralysante que la bombe atomique préparée par les nazis et achevée sous les auspices des chefs « démocratiques » et staliniens. Tout le déroulement de la seconde guerre mondiale, une fois qu'on cesse de se laisser abuser par le bourrage de crâne dithyrambique sur la chronologie des seules batailles militaires contre le mal hitlérien, révèle que le prolétariat est resté une des préoccupations centrales de la bourgeoisie dans les divers camps antagonistes. Cela ne signifie pas que le prolétariat était en mesure de menacer l'ordre existant comme deux décennies auparavant mais qu'il restait une préoccupation de premier plan de la bourgeoisie dans la mesure, notamment, où elle ne pouvait massacrer complètement cette classe qui produit l'essentiel de la richesse de la société. Il fallait détruire sa conscience. Il fallait faire perdre aux ouvriers l'idée même qu'ils existent comme corps social antagonique aux intérêts de la « nation », faire oublier aux ouvriers qu'unis massivement ils sont en mesure de changer le cours de l'histoire.
Comme nous le rappellerons brièvement ici, à chaque fois que le prolétariat a menacé de se redresser et tenté de s'affirmer comme classe, l'Union sacrée des impérialistes s'est rétablie par-delà les lignes de bataille. La bourgeoisie nazie, démocratique ou stalinienne, a réagi implicitement, sans concertation même souvent, pour préserver l'ordre social capitaliste. Les défenses immunitaires de l'ordre social réactionnaire surgissent naturellement. De cette longue défaite, de cette capacité de la bourgeoisie décadente à défendre son ordre de terreur, le prolétariat ne peut pas ne pas tirer les enseignements un demi-siècle plus tard.
1. L'avant-guerre
La guerre de 1939-45 n'a été possible que parce que le prolétariat, dans les années 1930, n'avait plus la force suffisante pour empêcher le conflit mondial, qu'il avait perdu la conscience de son identité de classe. C'était le résultat de trois étapes d'annihilation de la menace prolétarienne :
- l'épuisement de la grande vague révolutionnaire de l'après 1917, close avec le triomphe du stalinisme et de la théorie du « socialisme dans un seul pays » adoptée par l'Internationale communiste ;
- la liquidation des convulsions sociales dans le centre décisif où se jouait l'alternative capitalisme ou socialisme : en Allemagne, principalement sous la houlette de la Social-démocratie elle-même, le nazisme ne venant que parachever le travail pour imposer aux prolétaires une terreur sans précédent ;
- le dévoiement total du mouvement ouvrier dans les pays démocratiques sous le masque de la « liberté face au fascisme », avec l'idéologie des «fronts populaires » qui servit à paralyser plus subtilement les ouvriers des pays industrialisés que « l'union nationale » de 1914.
En Europe, cette formule des «fronts populaires » n'était que l'anticipation du Front National des PC et autres partis de gauche au cours de la guerre. Les prolétaires des pays développés étaient mis en condition pour ployer derrière l'antifascisme ou derrière le fascisme, idéologies symétriques les soumettant à la défense de « l'intérêt national », c'est-à-dire à l'impérialisme de leurs bourgeoisies respectives. Dans les années 1930, les ouvriers allemands n'étaient pas les « victimes du Traité de Versailles », comme leur clamaient leurs gouvernants, mais de la même crise qui frappait leurs frères de classe du monde entier. Les ouvriers d'Europe de l'ouest et des Etats-Unis n'étaient pas plus victimes d'Hitler, seul «fauteur de guerre » devant l'éternel, que de leur propre bourgeoisie « démocratique » soucieuse de la défense de ses sordides intérêts impérialistes. En 1936, les mystifications sur l'antifascisme et la « défense de la démocratie » se caractérisent par le bourrage de crâne pour pousser les ouvriers à prendre partie entre les fractions rivales de la bourgeoisie : fascisme/antifascisme, droite/gauche, Franco/République. Dans la plupart des pays européens, ce sont des gouvernements de gauche ou des partis de gauche « en opposition » et avec l'appui idéologique de la Russie stalinienne, qui génèrent l'idéologie des « Fronts Populaires », qui, comme leur nom l'indique, ont servi à convaincre les ouvriers d'accepter - à travers cette nouvelle version de l'alliance des classes ennemies - des sacrifices inimaginables.
La guerre d'Espagne a été la répétition générale de la guerre mondiale par la confrontation des différents impérialismes qui se sont logés derrière chacune des fractions de la bourgeoisie espagnole. Elle a surtout été le laboratoire de ces «fronts populaires » permettant la concrétisation et la désignation de « l'ennemi » contre qui on appelait les ouvriers d'Europe occidentale à se mobiliser derrière leur bourgeoisie : le fascisme. Les centaines de milliers d'ouvriers espagnols massacrés ont été une « preuve » de la nécessité de la « guerre démocratique », mieux que l'assassinat d'un archiduc à Sarajevo 20 ans auparavant.
La bourgeoisie n'a pu faire la guerre qu'en trompant les prolétaires, en leur faisant croire que c'était aussi leur guerre :
« C'est l'arrêt de la lutte de classe, ou plus exactement la destruction de la puissance de classe du prolétariat, la destruction de sa conscience, la déviation de ses luttes, que la bourgeoisie parvient à opérer par l'entremise de ses agents dans le prolétariat, en vidant ses luttes de leur contenu révolutionnaire et les engageant sur les rails du réformisme et du nationalisme, qui est la condition ultime et décisive de l'éclatement de la guerre impérialiste. » ([1] [1687])
En fait, instruite par l'expérience de la vague révolutionnaire qui a débuté au cours même de la première guerre mondiale, la bourgeoisie, avant que de se lancer dans la seconde guerre mondiale, s'est assurée d'un écrasement complet du prolétariat, une soumission sans commune mesure avec celle qui avait permis le déclenchement de la « Grande Guerre ».
En particulier, il faut constater que, concernant l'avant-garde politique du prolétariat, plus nettement qu'en 1914, l'opportunisme a clairement triomphé dans les partis ouvriers plusieurs années avant le début du conflit, transformant ces derniers en des agences de l'Etat bourgeois. En 1914, dans la plupart des pays, il existe encore des courants révolutionnaires dans les partis de la 2e internationale. Par exemple les bolcheviks russes ou les spartakistes allemands étaient membres des partis social-démocrates et ont mené la lutte au sein de ces partis. Lorsque la guerre éclate, les partis social-démocrates ne sont pas en totalité aux ordres de la bourgeoisie. En leur sein continue à se manifester une vie prolétarienne qui va brandir le flambeau de l'internationalisme prolétarien, particulièrement aux conférences de Zimmerwald et Kienthal. En revanche, les partis se réclamant de la 3e Internationale ont fini dans le giron bourgeois au cours des années 1930, bien avant le début de la guerre mondiale pour laquelle ils vont servir de zélés sergents-recruteurs. Et ils pourront même bénéficier du renfort des organisations trotskistes qui passent à ce moment-là, avec armes et bagages, dans le camp de la bourgeoisie en embrassant la cause d'un des camps impérialiste contre l'autre (au nom de la défense de l'URSS, de l'anti-fascisme et autres thèmes crapuleux). Enfin, l'éclatement, l'extrême isolement des minorités révolutionnaires qui maintiennent, elles, les positions de principe contre la guerre confirment l'ampleur de la défaite subie par le prolétariat.
Atomisés, émiettés politiquement du fait de la trahison des partis qui parlaient en leur nom et de la quasi inexistence de leur avant-garde communiste, les prolétaires, ont donc réagi par la débandade généralisée au moment du déclenchement de la guerre.
2. Pendant la guerre
Comme lors du premier conflit mondial, il faut que s'écoulent au moins deux ou trois années avant que la classe ouvrière, assommée par l'entrée en guerre, ne puisse retrouver le chemin de ses combats. Malgré les conditions épouvantables de la guerre mondiale, et en particulier de la terreur qu'elle faisait régner, la classe ouvrière se montre toutefois capable de lutter sur son terrain. Cependant, du fait de la terrible défaite subie préalablement à la guerre, la plupart de ses combats n'auront pas une envergure susceptible de tracer à moyen terme la voie vers la révolution, ni pour inquiéter sérieusement les bourgeoisies en lice. La plupart des mouvements sont dispersés, coupés des leçons des luttes antérieures et surtout pas encore armés par une réelle réflexion sur les raisons de l'échec de la vague révolutionnaire internationale qui avait débuté en Russie, en 1917.
Dans les pires conditions donc, les ouvriers se montrent capables de relever la tête dans la plupart des pays belligérants, mais la censure et le matraquage des ondes sont omniprésents quand la presse n'a pas disparu. Dans les usines bombardées, dans les camps de prisonniers, dans les quartiers, les ouvriers tendent naturellement à retrouver leurs méthodes classiques de protestation. En France, par exemple, dès la seconde moitié de 1941 on compte des dizaines de grèves pour des revendications de salaires et de temps de travail. Il existe une propension des ouvriers à tourner le dos à toute participation à la guerre (bien que le pays soit à moitié occupé) : « le sentiment de classe restait plus fort que tout devoir national.» ([2] [1688]) La grève des mineurs du Pas-de-Calais est significative à cet égard. Ils font porter aux seuls patrons français la responsabilité de l'aggravation des conditions de travail, n'obéissant pas encore aux mots d'ordre des staliniens en faveur de la « lutte patriotique ». La description de cette grève est saisissante :
« La grève du 7 de Dourges a éclaté comme éclatent les grèves dans toutes les fosses, depuis qu'elles existent. Le mécontentement règne. On en a assez. Pas plus en 1941 qu'en 1936 ou en 1902, les mineurs n'ont consulté le registre des lois. Ils ne se sont pas préoccupés s'il y avait des compagnies assistées de l'infanterie de ligne ou un gouvernement de Front populaire en puissance, ou des hitlériens prêts à les déporter. Au fond du puits, ils se sont consultés, ils se sont mis d'accord. Ils ont crié "Vive la grève" et ils ont chanté la gorge serrée, les larmes aux yeux, des larmes de joie, les larmes de la réussite. » ([3] [1689]) Le mouvement s'étendra pendant plusieurs jours, laissant la soldatesque allemande impuissante, entraînant plus de 70 000 mineurs. Le mouvement sera sévèrement réprimé ([4] [1690]).
L'année 1942 connaît d'autres luttes ouvrières, certaines avec des manifestations de rues. L'instauration de la « relève » (travail obligatoire en Allemagne), entraînera même des grèves avec occupation, avant que PCF et trotskistes ne dévient ce combat vers la lutte nationaliste. Il faut noter, cependant, que ces grèves et manifestations demeurent limitées au plan économique, face au rationnement de la nourriture et du ravitaillement. Le mois de janvier, dans le Borinage, en Belgique, a été marqué par toute une série de grèves et de mouvements de protestation dans les charbonnages. En juin, éclate une grève à la fabrique Nationale de Herstal et on voit des manifestations de ménagères devant l'Hôtel de Ville de Liège. Face à l'annonce de la déportation obligatoire de milliers de travailleurs à l'hiver 1942, 10 000 ouvriers se mettent en grève encore une fois à Liège, et le mouvement en entraînera 20 000 autres. A la même époque, grève de travailleurs italiens en Allemagne dans une grande fabrique d'avions. Début 1943, en Allemagne, à Essen, grève des ouvriers étrangers, français entre autres.
Le prolétariat n'est pas en mesure de s'élever dans une lutte frontale contre la guerre, c'est-à-dire contre sa propre bourgeoisie, au niveau des ouvriers russes de 1917. Restant à ce stade, la lutte revendicative qui ne se généralise pas peut être une protestation contre les patrons et les syndicats briseurs de grèves, mais tout en permettant la poursuite plus effective de la guerre par le gouvernement, lorsque les patrons accordent des hausses de salaires (aux USA et en Angleterre par exemple). Là réside le danger que vienne se greffer l'idéologie nationaliste de la Libération. Bien avant l'instauration en France du « travail obligatoire » (qui a été du pain béni pour l'Union Nationale en 1942-43), la bourgeoisie britannique disposa d'un fanatique partisan du travail obligatoire avec le PC britannique devenu hystérique après l'attaque de l'Allemagne contre la Russie au milieu de l'année 1941. Dès lors, de concert avec les trotskistes à travers les syndicats, il ne fut plus question de faire grève mais de développer la production visant à favoriser l'effort de guerre pour soutenir le bastion (l'impérialisme) russe. ([5] [1691])
Malgré l'extrême faiblesse du prolétariat, la poursuite de la guerre mondiale joue néanmoins contre la bourgeoisie. Ainsi on peut mesurer la crue des journées de grève en Angleterre. Autant la période de déclaration de guerre montre un brutal freinage, autant dès 1941 le nombre de grèves va s'accroître jusqu'en 1944, puis décroître après la « Victoire».
Faisant le bilan de cette période de guerre, le groupe de la Gauche Communiste de France ne niera pas l'importance de ces grèves et les aura soutenues dans leurs objectifs immédiats, mais il ne « se leurre pas sur leur portée encore limitée et contingente. » ([6] [1692]) Face à cet ensemble de grèves relativement dispersées et sans liaisons la plupart du temps, du fait du règne de la censure militariste, la bourgeoisie mondiale s'est toujours efforcée d'éviter leur radicalisation, faisant souvent des concessions économiques mineures, tant du côté allemand que du côté des alliés, et en ayant recours toujours au syndicalisme qui, sous ses diverses formes, était et reste un instrument de l'Etat bourgeois. Les relations sociales ne pouvaient rester longtemps pacifiques dans la guerre d'autant que l'inflation s'était aggravée.
La gravité terrible de la situation permet de comprendre pourquoi les minorités révolutionnaires espéraient la révolution plus qu'elle n'était contenue dans le véritable rapport de forces entre les classes. L'Europe entière vivait « au ras des rutabagas », seuls les travailleurs qui effectuaient de quinze à vingt heures supplémentaires par semaine étaient en mesure d'acheter des produits alimentaires dont le prix avait décuplé en trois ans. Dans une telle situation de priva tions et de haine doublée d'impuissance face aux internements et déportations, l'éclatement de la lutte massive de près de deux millions d'ouvriers italiens en mars 1943, d'une durée de plusieurs mois, plus encore que cette série des grèves qui se vérifie au niveau international, vient alerter la bourgeoisie mondiale, sonner l'heure de la préparation du mensonge de la Libération comme seule issue possible à la guerre.
Il ne s'agit pas de surestimer la portée de ce mouvement, mais de mesurer que face à cette action autonome du prolétariat italien sur son terrain de classe, la bourgeoisie italienne a pris immédiatement ses propres mesures, et a été aidée en cela par l'ensemble de la bourgeoisie mondiale, confirmant sa vigilance de l'avant-guerre.
Fin mars, 50 000 ouvriers de Turin se mettent en grève pour l'obtention d'une prime « de bombardement », pour l'augmentation des rations de vivres sans se soucier de ce qu'en pensera Mussolini. Leur rapide victoire encourage l'action de classe dans toute l'Italie du nord contre le travail de nuit dans les régions menacées de bombardements. Ce mouvement triomphe à son tour. Les concessions ne calment pas la classe ouvrière, de nouvelles grèves surgissent accompagnées de manifestations contre la guerre. La bourgeoisie italienne prend peur et tourne casaque en 24 heures. Mais la bourgeoisie alliée veille et occupe l'Italie du Sud à l'automne. Cette résurgence du prolétariat doit être contrée en replâtrant l'Union nationale sur une base royaliste et démocratique. Victor-Emmanuel sort de dessous la table pour faire arrêter Mussolini, avec la complicité des vieilles barbes fascistes Grandi et Ciano, soudainement converties à l'anti-fascisme. Malgré tout, les manifestations de masse continuent à se répandre à Turin, Milan, Bologne. Les cheminots organisent des grèves imposantes. Face à l'ampleur de ce mouvement, l'intérimaire gouvernemental Badoglio finit par s'enfuir en Sicile pour laisser Mussolini -libéré par Hitler -revenir assumer la répression avec les nazis et le consentement tacite de Churchill. La soldatesque allemande bombarde sauvagement les villes ouvrières. Churchill qui a déclaré qu'il faut « laisser les italiens mijoter dans leur jus », affirme ne vouloir traiter qu'avec un gouvernement de l'ordre. Il n'est pas question que la classe ouvrière apparaisse comme libératrice (d'autant qu'elle est capable d'aller plus loin pour son propre compte), les Alliés anglo-saxons veulent changer les pantins et tirer les ficelles eux-mêmes. Après la terrible répression et le gonflement concomitant des rangs de la résistance bourgeoise des partisans, les Alliés pourront avancer depuis le sud pour « libérer » le nord et réinstaller Badoglio ([7] [1693]). Comme en France face au travail obligatoire, la bourgeoisie réussira à embrigader les ouvriers italiens battus sur leur terrain de classe dans l'idéologie de l'Union Nationale jusqu'à la dite Libération, sévèrement contrôlée par les milices staliniennes et la mafia.
Ce magnifique mouvement débuté en mars 1943 n'est pas un accident ou une rareté dans l'horreur de l'holocauste universel. Au cours de cette même année 1943, comme nous venons de le souligner, existait une timide vague de reprise des luttes au niveau international, sur laquelle nous ne disposons évidemment que de maigres informations. Quelques exemples : grève à l'usine Coqueril de Liège ; 3500 ouvriers en lutte à l'usine d'aviation de la Clyde et grève des mineurs près de Doncaster en Angleterre (mai 1943) ; grève des ouvriers étrangers à l'usine Messerschmidt en Allemagne ; grève à AEG, un importante usine près de Berlin où, pour protester contre une mauvaise cantine, des ouvriers hollandais entraînent des ouvriers belges, français mais aussi allemands dans la lutte ; grèves à Athènes et manifestations de ménagères ; 2000 ouvrières sont en grève en Ecosse en décembre 1943...
La grève massive des ouvriers italiens est restée cloisonnée en Italie, puis la résistance a dénaturé son sens. Cependant, le massacre est là aussi un aboutissement de l'échec ouvrier en pleine guerre : quand le prolétariat se laisse enfermer dans l'ornière nationaliste, il est férocement décimé. C'est une tactique constante de la bourgeoisie de faire régner la terreur après de telles tentatives. Et cette terreur est nécessaire à la bourgeoisie car elle n'a pas terminé la guerre et elle veut avoir les mains libres jusqu'à la fin de celle-ci, notamment sur d'autres théâtres d'opération qu'en Europe.
En Europe de l'Est, partout où risquaient de surgir des soulèvements ouvriers même sans perspective révolutionnaires, la bourgeoisie pratique la politique préventive de la terre brûlée.
A Varsovie, durant l'été 1944, les ouvriers sont restés contrôlés par le PS polonais depuis Londres. Ils participent à l'insurrection lancée par la« Résistance » lorsqu'ils apprennent que « l'Armée rouge » est entrée dans les faubourgs de la capitale, de l'autre côté de la Vistule. Et c'est avec le consentement tacite des Alliés, tout comme c'est avec la passivité évidente de l'Etat stalinien que l'Etat allemand a pu assurer son rôle de gendarme et de boucher, massacrant des dizaines de milliers d'ouvriers, rasant la ville. Huit jours plus tard Varsovie est un cimetière. Ensuite c'est au tour de Budapest où l'armée « rouge » laisse accomplir aussi le massacre puis fait son entrée comme une armée de fossoyeurs.
Pour sa part, la bourgeoisie « libératrice » d'occident ne veut pas de risques d'explosions sociales anti-guerres dans les pays vaincus. Pour ce faire, elle procède à des bombardements monstrueux sur les villes allemandes, des bombardements qui n'ont pas, la plupart du temps, d'intérêt militaire mais qui visent en priorité les quartiers ouvriers (à Dresde en février 1945, il y a près de 150 000 morts, plus du double qu'à Hiroshima). Il s'agit d'exterminer le plus possible de prolétaires et de terroriser les survivants pour qu'ils ne s'avisent pas de renouer avec leurs combats révolutionnaires de 1918 à 1923. De même, la bourgeoisie « démocratique » se donne les moyens d'occuper systématiquement les territoires d'où les nazis ont dû se replier. Il n'est pas question de laisser l'Allemagne vaincue se doter de son propre gouvernement succédant aux hitlériens. Toutes les offres de négociations ou d'Armistice par les opposants à Hitler ont été rejetées. Laisser se former un gouvernement allemand autochtone dans un pays « vaincu » aurait empêché de dormir les Churchill, Roosevelt et Staline, cela aurait constitué un risque majeur. Comme en 1918, un Etat allemand vaincu ne pouvait qu'être affaibli face à la classe ouvrière, révoltée par le meurtre massif et la misère noire, et aux soldats en débandade. Les armées alliées se chargeront de faire régner l'ordre elles-mêmes dans toute l'Allemagne pour une durée indéterminée (et restant sur place finalement jusqu'en 1994, mais pour d'autres raisons), en faisant peser pour longtemps un des plus grossiers mensonges du siècle : la «culpabilité collective» du peuple allemand.
3. Vers la « Libération »
Dans les tous derniers mois de Ma guerre, l'Allemagne est marquée par une série d'émeutes, de désertions, de grèves. Mais nul besoin de potiche démocratique à la Badoglio dans l'enfer des bombardements. Terrorisée, la classe ouvrière allemande est prise entre le marteau et l'enclume, entre les armées alliées et la soldatesque russe qui va déferler. Tout au long de la route de la débâcle de l'armée allemande les déserteurs sont pendus pour dissuader les autres. La situation aurait pu devenir inquiétante si la bourgeoisie n'avait pas continué à baliser le terrain de misère pour l'immédiat après-guerre. La répression féroce sera suffisante et la paix sociale préservée par l'occupation et la partition sans vergogne de l'Allemagne. Même s'ils pouvaient à juste titre se réjouir des réactions du prolétariat en Allemagne, nos camarades de cette époque surestimaient ce à quoi la bourgeoisie savait avoir affaire :
« Quand les soldats refusent de se battre, frisent en plusieurs endroits la guerre civile, quand les marins manifestent les armes à la main contre la guerre, quand les ménagères, la Volksturm, les réfugiés viennent augmenter la nervosité de la situation allemande, la plus formidable machine militaire et policière se casse et la révolte est en perspective immédiate. Von Rundstedt reprend la politique de Ebert en 1918, il espère par la paix éviter la guerre civile. Les alliés, eux, ont compris la menace révolutionnaire des événements italiens commencés en 1943. La paix maintenant c'est se trouver face à la crise qui sévit en Europe le plus intensément, sans armes, pour masquer les contradictions qui vont se solutionner par la guerre de classe. L’effort de guerre, la peste brune, la caserne, ne pourront plus servir de prétexte soit pour alimenter les industries hypertrophiées, soit pour continuer à tenir la classe ouvrière dans l'état d'esclavage et de famine actuels. Mais, fait encore plus grave, c'est la perspective du retour des soldats allemands dans leurs foyers détruits et de la répétition de la révolution de 1918 qui devient inévitable (...) Aux grands maux, des moyens héroïques : détruire, tuer, affamer, anéantir la classe ouvrière allemande. Nous sommes loin de la peste brune et de son châtiment, nous sommes très loin des promesses de paix des capitalistes. La démocratie a prouvé qu'elle était plus apte à défendre les intérêts bourgeois que la dictature fasciste. » ([8] [1694])
En réalité, dans les pays vaincus, dont l'Allemagne, on assiste à la ruée des armées américaines et russes qui jamais ne laissent un no man's land dans les villes conquises et étouffent toute velléité de résistance prolétarienne. Dans les pays vainqueurs se déploie un chauvinisme incroyable, bien pire que lors de la première guerre mondiale. Comme le supputait la minorité révolutionnaire, craignant la contagion des soldats allemands démobilisés dont certains ne cachent pas leur joie, sourient sur les vieux films et jettent leurs casquettes en l'air, la bourgeoisie démocratique décide de les interner en France et en Angleterre. Une partie de l'armée allemande désintégrée est retenue à l'étranger; 400 000 soldats, maintenus prisonniers, sont amenés et internés en Angleterre plusieurs années après la fin de la guerre pour éviter que, comme leurs pères, ils ne fomentent une révolution une fois de retour au pays dans la misère européenne de l'immédiat après-guerre. ([9] [1695])
La plupart des groupes révolutionnaires se sont enthousiasmés au vu de ces faits, plaquant le schéma de la révolution victorieuse en Russie par l'éruption du prolétariat contre la guerre. Or, de même qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, de même les conditions de 1917 ne pouvaient pas se reproduire parce que la bourgeoisie en avait tiré les leçons.
Après le formidable mouvement des ouvriers d'Italie, en 1943, il faudra près de deux ans à la minorité révolutionnaire la plus claire pour tirer les leçons de cet échec des ouvriers, au niveau international, pour mettre à profit une nouvelle fois des conditions drastiques de la guerre mondiale pour s'orienter vers la révolution : la bourgeoisie a su garder l'initiative et a profité de l'absence de partis révolutionnaires.
« Enrichi par l'expérience de la première guerre, incomparablement mieux préparé à l'éventualité de la menace révolutionnaire, le capitalisme international a réagi solidairement avec une extrême habileté et prudence contre un prolétariat décapité de son avant-garde. A partir de 1943, la guerre se transforme en guerre civile. En l'affirmant nous n'entendons pas dire que les antagonismes inter-impérialistes ont disparu, ou qu'ils ont cessé d'agir dans la poursuite de la guerre. Ces antagonismes subsistaient et ne faisaient que s'amplifier, mais dans une mesure moindre et acquérant un caractère secondaire, en comparaison de la gravité présentée pour le monde capitaliste par la menace d'une explosion révolutionnaire. La menace révolutionnaire sera le centre des soucis et des préoccupations du capitalisme dans les deux blocs : c'est elle qui déterminera en premier lieu le cours des opérations militaires, leur stratégie et le sens de leur déroulement. (...) A l'encontre de la première guerre impérialiste, où le prolétariat une fois engagé dans le cours de la révolution garde l'initiative et impose au capitalisme mondial l'arrêt de la guerre, dans cette guerre-ci, dès le premier signal de la révolution en Italie, en 1943, c'est le capitalisme qui se saisira de l'initiative et poursuivra implacablement une guerre civile contre le prolétariat, empêchera par la force toute concentration de forces prolétariennes, n'arrêtera pas la guerre, même quand, après la disparition du gouvernement d'Hitler, l'Allemagne demandera avec insistance l'Armistice, afin de s'assurer par un carnage monstre et un massacre préventif impitoyable, contre toute velléité de menace de révolution du prolétariat allemand (...) La révolte des ouvriers et des soldats, qui, dans certaines villes, se sont rendus maîtres des fascistes, a forcé les alliés à précipiter leur marche et à finir cette guerre d'extermination avant le plan prévu. » ([10] [1696])
L'action des minorités révolutionnaires
La guerre n'a pu se produire, comme nous l'avons vu, que parce que le processus de dégénérescence de la 3e Internationale et de passage dans le camp bourgeois des partis communistes était achevé. Les minorités révolutionnaires qui ont combattu la montée du stalinisme et du fascisme du point de vue de classe ont toutes été vaincues, épuisées dans les pays démocratiques, éliminées et déportées en Russie et en Allemagne. De l'unité mondiale que représentent les Internationales à chaque époque, il ne reste plus que des bribes, des fractions, des minorités dispersées et souvent sans lien entre elles. Le mouvement de l'Opposition de gauche avec Trotsky qui a représenté un courant de combat contre la dégénérescence de la révolution en Russie s'est peu à peu enferré dans les positions opportunistes sur le Front Unique (possibilité d'alliance avec les partis de gauche de la bourgeoisie) et dans son successeur 1'« anti-fascisme ». Si Trotsky meurt, assassiné comme Jaurès (parce qu'il symbolise aux yeux de la bourgeoisie mondiale le danger prolétarien plus encore que le grand tribun de la 2e Internationale), au début du second holocauste mondial, ses partisans ne valent guère mieux que les sociaux-chauvins du début du siècle puisqu'ils prennent parti pour un camp impérialiste : celui de la Russie et celui de la Résistance.
La plupart des minorités, fragiles esquifs dans le désarroi du prolétariat, avaient éclaté au moment de la guerre. Seule la Fraction italienne autour de la revue Bilan annonçait depuis les années 1930 que le mouvement ouvrier était entré dans une période de défaites qui conduirait à la guerre. ([11] [1697])
Le passage à la clandestinité entraîna tout d'abord l'éparpillement, la perte des précieux contacts bâtis pendant des années. En Italie, il ne subsiste aucun groupe organisé. En France, ce n'est qu'en 1942, en pleine guerre impérialiste, que se regroupent des militants ayant combattu dans la Fraction italienne réfugiée dans ce pays, et qui avaient délimité des positions politiques de classe face à l'opportunisme des organisations trotskistes. Il se dénomme Noyau français de la Gauche communiste. Ces courageux militants produisent une déclaration de principes qui rejette très nettement la « défense de l'URSS»:
« L'Etat soviétique, instrument de la bourgeoisie internationale, exerce une fonction contre-révolutionnaire. La défense de l'URSS au nom de ce qu'il reste des conquêtes d'Octobre doit donc être rejetée et faire place à la lutte sans compromis contre les agents staliniens de la bourgeoisie (...) La démocratie et le fascisme sont deux aspects de la dictature de la bourgeoisie qui correspondent aux besoins économiques et politiques de la bourgeoisie à des moments donnés. En conséquence la classe ouvrière qui doit instaurer sa propre dictature après avoir brisé l'Etat capitaliste, n'a pas à prendre parti pour l'une ou l'autre de ces formes. »
Des contacts sont rétablis avec les éléments du courant révolutionnaire en Belgique, en Hollande et avec des révolutionnaires autrichiens réfugiés en France. Dans les conditions très dangereuses de la clandestinité, à partir de Marseille, des débats très importants seront menés sur les raisons du nouvel échec du mouvement ouvrier, sur la nouvelle délimitation des «frontières de classe ». Cette minorité révolutionnaire ne cessera pas d'intervenir pour autant contre la guerre capitaliste, pour l'émancipation du prolétariat, en totale continuité avec le combat de la 3e Internationale à son origine. D'autres groupes émergeront plus ou moins clairement du giron trotskiste en refusant également la défense de l'URSS impérialiste et contre tous les chauvinismes : le groupe espagnol de Munis, les Revolutionare Kommunisten Deutschlands d'Autriche, et des groupes conseillistes hollandais. Les tracts de ces groupes contre la guerre, diffusés clandestinement, posés sur les banquettes de trains, sont vilipendés par la bourgeoisie « résistante », des staliniens aux démocrates, comme « hitléro-troskystes ». Ceux qui les diffusent risquent d'être fusillés sur place (voir les documents publiés ci-dessous et leur présentation).
En Italie, à la suite du puissant mouvement de lutte de 1943, les éléments de la Gauche dispersés se regroupent autour de Damen puis, ultérieurement autour de la figure mythique de Bordiga, personnalité de la gauche des 2e et 3e Internationale. Ils constituent, en juillet 1943, le Partito comunista internazionalista mais, croyant comme la plupart des révolutionnaires à une poussée insurrectionnelle de la classe ouvrière, ils subiront la Libération capitaliste et, malgré leur courage, éprouveront de grandes difficultés à défendre des positions claires face aux ouvriers entraînés derrière les sirènes bourgeoises ([12] [1698]). Ils se montreront incapables de favoriser le regroupement des révolutionnaires au niveau international et se retrouveront à l'état d'infime minorité après guerre. En particulier, ils se refuseront à tout travail sérieux avec le noyau français qui se nomme désormais Gauche Communiste de France ([13] [1699]).
En fait, malgré tout leur courage, les groupes révolutionnaires qui ont défendu des positions de classe, internationalistes, au cours de la seconde guerre mondiale, ne pouvaient pas influencer le cours des événements, compte tenu de la terrible défaite qu'avait subi le prolétariat et de la capacité de la bourgeoisie à prendre systématiquement les devants pour empêcher le développement de tout mouvement de classe vraiment menaçant. Mais leur contribution au combat historique du prolétariat, ne pouvait en rester là. Elle passait principalement par une réflexion permettant de tirer les enseignements des événements considérables qui venaient de se dérouler, une réflexion qu'il s'agit de poursuivre jusqu'à aujourd'hui.
Quels enseignements pour les révolutionnaires ?
C'est respecter la tradition marxiste portée par ces groupes du passé qu'être capable de continuer avec leur méthode critique, de passer au crible nous-mêmes leurs erreurs. C'est cela rester fidèle au combat qu'ils ont mené. Si la Gauche Communiste de France a su corriger son erreur d'appréciation sur la possibilité d'une inversion du cours de défaite au cours de la guerre mondiale, sans forcément tirer toutes les implications du fait que celle-ci ne favorise plus la révolution, les autres groupes, en Italie en particulier, ont maintenu la vision schématique du « défaitisme révolutionnaire ».
Constituant de manière volontariste et aventuriste un parti en Italie autour des personnalités de l'IC comme Bordiga et Damen, les révolutionnaires italiens ne se donnaient pas réellement les moyens de « restaurer les principes », encore moins de tirer les véritables enseignements de l'expérience passée. Ce Parti Communiste Internationaliste devait non seulement faillir - se retrouvant rapidement à l'état de secte - mais favoriser le rejet de la méthode d'analyse marxiste par un dogmatisme stérile qui ne fait que répéter les schémas du passé sur la question de la guerre en particulier. Le PCI persiste à la Libération à croire en l'ouverture d'un cycle révolutionnaire en parodiant Lénine : « La transformation de la guerre impérialiste en guerre civile commence après la fin de la guerre » ([14] [1700]). Reprendre l'analyse de Lénine selon lequel chaque prolétariat devait souhaiter « la défaite de sa propre bourgeoisie » tremplin pour la révolution -position déjà erronée à l'époque puisqu'elle induisait que les ouvriers des pays vainqueurs, eux, n'auraient pas disposé de ce même tremplin -, faire reposer la réussite de la révolution sur l'échec de sa propre bourgeoisie, relevaient d'un automatisme abstrait. En réalité, déjà dans la première vague révolutionnaire elle-même, la guerre, après avoir été un ferment de premier ordre dans la mobilisation du prolétariat, avait conduit à une division de celui-ci entre les ouvriers des pays vaincus, les plus combatifs et les plus lucides, et ceux des pays vainqueurs sur qui la bourgeoisie réussit à faire peser l'euphorie de la « victoire » pour paralyser leur combat et leur prise de conscience. En outre, l'expérience des années 1917-18, avait aussi fait la preuve que, face à un mouvement révolutionnaire qui se développe à partir de la guerre mondiale, la bourgeoisie dispose toujours d'une carte, qu'elle ne s'est pas privée déjouer en novembre 1918, alors que se développait la révolution en Allemagne : mettre un terme à la guerre, c'est-à-dire supprimer le principal aliment de l'action et de la prise de conscience du prolétariat.
En leur temps, nos camarades de la Gauche communiste s'étaient trompés lorsqu'ils avaient, en se basant sur le seul exemple de la révolution russe, sous-estimé les conséquences paralysantes de la guerre impérialiste mondiale pour le prolétariat. La seconde guerre mondiale se devait d'apporter les éléments pour une meilleure analyse de cette question cruciale. Aussi, répéter aujourd'hui les erreurs du passé, c'est entraver le véritable chemin vers les affrontements de classe : en s'avérant impuissant à enrichir la méthode marxiste, en s'interdisant d'être le guide dont le prolétariat a besoin comme le révèlent malheureusement ceux qui se prétendent les seuls héritiers de la Gauche Communiste Italienne. ([15] [1701])
La question de la guerre a toujours été une question de premier plan dans le mouvement ouvrier. En même temps que l'exploitation et les attaques découlant de la crise économique, la guerre impérialiste moderne reste un facteur majeur de prise de conscience de la nécessité de la révolution. Il est évident que la permanence des guerres dans la phase de décadence du capitalisme doit être un précieux facteur de réflexion. Aujourd'hui que l'effondrement du diabolisé bloc de l'Est a momentanément repoussé la possibilité d'une nouvelle guerre mondiale, cette réflexion ne doit pas s'arrêter. Les guerres que nous connaissons aux frontières de l'Europe sont là pour rappeler au prolétariat que « celui qui oublie la guerre la subira un jour » ([16] [1702]). Il reste de la plus haute responsabilité du prolétariat de s'ériger contre cette société en décomposition. La perspective d'une autre société sous le contrôle du prolétariat passe nécessairement par la prise de conscience qu'il doit lutter sur son terrain social et y trouver sa puissance. La lutte du prolétariat croissante est une lutte antinomique à l'Etat, et donc antinomique aux objectifs militaires de la bourgeoisie.
Malgré les chants dithyrambiques sur le « nouvel ordre mondial » instaurés en 1989, la classe ouvrière des pays industrialisés ne doit se faire aucune illusion sur le répit qui lui est promis en attendant la prochaine destruction de l'humanité. Un sort que le capital, pour sa part, nous promet de façon inéluctable, qu'il découle d'une troisième guerre mondiale, au cas où se reconstituerait un nouveau système de blocs impérialistes, ou d'un total pourrissement de la société accompagné de famines, d'épidémies et d'une multiplication des conflits guerriers dans lesquels les armes nucléaires, qui aujourd'hui se propagent partout, reprendraient du service.
L'alternative reste bien ou révolution communiste ou destruction de l'humanité. Unis et déterminés les prolétaires peuvent désarmer la minorité qui tire les ficelles, et même les bombes atomiques seront frappées d'obsolescence. Ainsi, nous devons combattre fermement l'argument pacifiste bourgeois, qui n'a pas changé, selon lequel une telle technique moderne empêcherait désormais toute révolution prolétarienne. La technique est produite par les hommes, elle obéit à une politique déterminée. La conduite de la politique impérialiste reste étroitement déterminée, comme nous le démontre le déroulement de la deuxième guerre mondiale, par la soumission de la classe ouvrière. Or, désormais, depuis la reprise historique du prolétariat, à la fin des années 1960, les enjeux sont posés simultanément, même si le prolétariat mondial n'en tire pas encore toutes les leçons. Là où la guerre ne fait pas ses ravages, la crise économique s'appesantit, décuple la misère et révèle la faillite du capitalisme.
Les minorités révolutionnaires doivent ainsi passer au crible l'expérience antérieure. Il était « minuit dans le siècle » au coeur du plus grand crime que l'humanité ait connu, mais il serait plus criminel encore de croire que l'humanité en a fini avec ses risques de destruction totale. Dénoncer les guerres actuelles n'est pas suffisant, les minorités révolutionnaires doivent être capable d'analyser les arcanes de la politique impérialiste de la bourgeoisie mondiale, non pour prétendre pouvoir mettre le feu à la mèche là où le militarisme règne en maître, dans tous les foyers guerriers qui dévastent le monde aujourd'hui, mais pour indiquer au prolétariat que la lutte, beaucoup plus qu' « au front » se mène « à l'arrière ».
Combattre la guerre impérialiste omniprésente, lutter contre les attaques de la crise économique bourgeoise, signifie développer toute une série de luttes et d'expériences qui conduiront à l'étape de la guerre civile révolutionnaire, là où la bourgeoisie se croit en paix. Une longue période de combats de classe est encore nécessaire, rien ne sera facile.
Le prolétariat n'a pas le choix. Le capitalisme ne peut que mener à la destruction de l'humanité si le prolétariat s'avérait une nouvelle fois impuissant à le détruire.
Damien
[1] [1703] Rapport sur la situation internationale de la conférence de juillet 1945 de la Gauche Communiste de France, Revue Internationale n° 59.
[2] [1704] Grégoire Madjarian, « Conflits, pouvoirs et société à la Libération», et aussi intéressant, l'ouvrage de Stéphane Courtois «Le PCF dans la guerre».
[3] [1705] Mémoires d'Auguste Lecoeur, ex-bras droit du chef stalinien français Thorez, exclu après-guerre, et donc plus libre d'exprimer la vérité de la lutte que lorsqu'il mentait avec les autres sur la primauté de la lutte nationaliste.
[4] [1706] Par la force des choses, ce mouvement était prématuré et isolé, il ne pouvait avoir l'effet de résonance de la lutte massive des ouvriers italiens en 1943. Il faut noter cependant la différence entre l'occupation craintive de la soldatesque allemande (les officiers n'osent jamais descendre dans les fosses) et la dictature exercée par le PCF à la Libération sur les mineurs. Une émission de télévision de la 3e chaine française, au mois d'août, offrit des révélations stupéfiantes de la part de quelques mineurs survivants de la # bataille de la production ». Valets du pouvoir gaulliste, les ministres staliniens exigèrent un effort considérable au point que ce fut une véritable hécatombe... après-guerre. Des milliers de leurs compagnons, morts de silicose, du fait de la mécanisation et des cadences à outrance, furent donc les martyrs, non pas des <r boches » ni de la lutte <r anti-boche », mais des ordres du ministre stalinien Thorez. Pour le «r redressement du pays », Thorez n'avait pas hésité à vociférer : « Si des mineurs doivent mourir à la tâche, leurs femmes les remplaceront ». Il n'y a pas qu'en Russie totalitaire que l'espérance de vie était de très courte durée...
[5] [1707] « Anti-Parliamentary communism, The movement for Workers'Councils, 1917-45 », Mark Shipway.
[6] [1708] Rapport sur la situation internationale, juillet 1945.
[7] [1709] Nous traitons de ce mouvement de 1943 en Italie dans la Revue Internationale n° 75.
[8] [1710] « La Paix », L'Etincelle n° 5, organe de la Gauche Communiste de France, mai 1945.
[9] [1711] « La rééducation des prisonniers allemands en Angleterre, de 1945 à 1948», Henry Faulk, ed Chatto & Windus, Londres 1977.
[10] [1712] Extraits du Rapport sur la situation internationale, Gauche Communiste de France, juillet 1945, reproduit in Revue Internationale n° 59, 1989.
[11] [1713] Nous n'avons pas la place\de
revenir en détail ici sur les débats dans la Fraction italienne ni sur les divergences
entre les différents groupes, mais nous tenons à la disposition de nos
lecteurs l'histoire de La Gauche Communiste d'Italie.
[12] [1714] Voir les articles : « Les ambiguïtés de Battagîia Comunista sur la question des "partisans" », Revue internationale n°8, déc. 1976, « Le PCI à ses origines : tel qu'il prétend être, tel qu'il est », Revue internationale n° 32, 1er trim. 1983 et « A propos des origines du PCI », Revue internationale n° 34, 3e trim. 1983..
[13] [1715] Sur l'histoire de ces groupes, consulter La Gauche communiste d'Italie, et la Revue internationale n° 34, 35, 38, 39, 64, 65, 66.
[14] [1716] Cité dans Internationalisme n° 36, 1948, reprint m Revue Internationale n° 36, 1er trim. 1984.
[15] [1717] Au moment de la guerre du Golfe nous avons démontré quel mauvais usage les courants qui se réclament de la Gauche italienne pouvaient encore faire du « défaitisme révolutionnaire » avec leur appel « à la fraternisation entre soldats irakiens et occidentaux » (voir notre article « Le milieu politique prolétarien face à la guerre du Golfe », Revue Internationale n° 64, 1er trim. 1991). Dans une zone et des conditions où le prolétariat est extrêmement faible lancer en l'air de tels mots d'ordre relève du volontarisme anarchiste ne pouvant au mieux que valoriser des désertions individuelles. Ces camarades devraient se demander pourquoi la bourgeoisie a les moyens de mener des guerres locales sans être inquiétée par le prolétariat et pourquoi elle n'a pas les moyens de les déclencher au coeur des métropoles industrialisées. Pire encore, ces mots d'ordre, repris en gros par toutes les sectes gauchistes, ne sont souvent que la feuille de vigne du soutien à l'impérialisme des petits pays opprimés par les gros. Ainsi, dernièrement, le n° 427 du Prolétaire titrait benoîtement avec pour mot d'ordre : « Impérialisme français hors d’Afrique et du Rwanda ! ». Que l'impérialisme français soit un boucher dans sa résistance au coup de pied au derrière que lui inflige l'impérialisme américain, portant même la plus lourde responsabilité dans le massacre de plus de 500 000 êtres humains au Rwanda, nous sommes les premiers à le dénoncer. Mais nous aurions honte de reprendre le mot d'ordre que s'approprie l'impérialisme américain ! Un tel mot d'ordre a certainement pour le PCI une consonance très « défaitiste » et alors ? L'impérialisme français est effectivement défait au Rwanda, en quoi cela a-t-il fait avancer d'un pas la conscience de classe des ouvriers en France ?
[16] [1718] Albert Camus.
Evènements historiques:
- Deuxième guerre mondiale [1286]
Courants politiques:
- Gauche Communiste [49]
Questions théoriques:
- Impérialisme [321]
Documents : la gauche communiste de France en 1944
- 3165 reads
Présentation
Nous publions ci-après un tract de la Fraction française de la Gauche Communiste qui a été collé sur les murs de Paris en août 1944 pour s'opposer à l'ordre de mobilisation générale lancé par les F.F.I. le 18 août.
Nous publions également l'article paru en première page de L'Etincelle, journal du même groupe, paru en août 1944.
La Fraction française de la Gauche Communiste s'est créée à Marseille au début de cette même année.
C'est autour de la Fraction Italienne de la Gauche Communiste ([1] [1719]) reconstituée à Marseille que s'est développé en 1942 un noyau d'une dizaine d'éléments français : certains venaient de rompre d'avec le trotskisme et d'autres, encore jeunes, se rapprochaient des positions politiques révolutionnaires.
Un peu d'histoire
La Gauche Communiste italienne (GCI) est bien connue de nos lecteurs. Cependant, en quelques lignes, il nous faut rappeler que la Gauche italienne a une longue tradition politique, théorique, et de lutte dans le mouvement ouvrier italien et international. Son existence remonte à quelques années avant la première guerre mondiale (au combat des jeunes du Parti Socialiste Italien (PSI) contre la guerre coloniale en Tripolitaine ([2] [1720]), 1910-1912), la GCI est le principal acteur de la création à Livourne du Parti communiste italien en 1921. Dans le milieu des années 1920, elle maintient toujours des positions révolutionnaires contre l'Internationale communiste en dégénérescence et se bat en son sein jusqu'en 1928, date de son exclusion définitive, ainsi que de celle d'autres courants de Gauche comme l'Opposition de Gauche russe avec Trotsky lui-même. Enfin, à l'arrivée du fascisme en Italie, nombre de ses membres se trouvent en prison ou relégués dans les îles de la mer Tyrrhénienne. Dès lors, c'est dans l'émigration en France et en Belgique que la Gauche italienne continue son combat politique et internationaliste, d'abord dans l'Opposition de Gauche Internationale, qui n'est pas encore trotskiste, puis presque seule après son exclusion de cette dernière.
Dans les années 1930, la vague révolutionnaire est bien terminée, la révolution russe est restée isolée et définitivement vaincue, la classe ouvrière est battue ; et, plus les années passent, plus les révolutionnaires se retrouvent seuls et de plus en plus éloignés de leur classe : la classe ouvrière. « Il est minuit dans le siècle » selon les paroles de Victor Serge, mais la volonté communiste de la Gauche italienne ne faiblit pas ; elle maintiendra pendant toute cette période les principes communistes et internationalistes. C'est la seule organisation révolutionnaire qui comprend que le cours historique n'est plus favorable à la classe ouvrière et que le cours est ouvert à la guerre impérialiste mondiale. Cette compréhension de la situation politique lui permet de saisir que la guerre d'Espagne en 1936, comme la guerre d'Ethiopie ou en Mandchourie n’est que des préludes à la future guerre impérialiste généralisée. Elle défend alors l'idée que le prolétariat est battu et que la période n'est pas encore à la formation de nouveaux partis révolutionnaires. Dès lors son rôle, en tant que fraction d'un futur parti communiste, est de maintenir les « principes communistes » et de préparer « les cadres révolutionnaires » du futur parti qui naîtra avec le resurgissement du prolétariat dans une autre période historique.
Le début de la deuxième guerre a fini par avoir raison de la Gauche italienne et par disperser ses membres. Elle disparaît en août 1939 à la déclaration de guerre, le Bureau International de Bruxelles se dissout.
Mais des éléments rescapés de la « gauche italienne » se regroupent à Marseille et décident de continuer le combat pour l'internationalisme prolétarien ; ils dénoncent seuls et à contre-courant la guerre impérialiste. Ils appellent les prolétaires de tous les pays d'Europe à se battre contre tous les Etats capitalistes : démocratiques, fascistes, staliniens. ([3] [1721])
Une surestimation de la période historique
Quand se développe de puissants mouvements de grèves en Italie en 1943, à Turin, Milan, etc. ([4] [1722]), c'est enfin (!) une nouvelle perspective qui s'ouvre aux yeux de ces révolutionnaires. Ils estiment que le cours historique qui entraînait la classe ouvrière de défaites en défaites s'est enfin inversé. « Après 3 années de guerre, l'Allemagne et par là, l'Europe présente les premiers signes de faiblesses... On peut dire que les conditions objectives ouvrent l'ère de la révolution. » (Projet de résolution sur les perspectives et les tâches de la période transitoire, conférence de juillet 1943). ([5] [1723])
Les événements insurrectionnels qui viennent de se produire en Italie sont très importants, mais la bourgeoisie veille ; elle ne fera pas les mêmes erreurs qu'elle a commises à la fin de la première guerre mondiale et qui ont conduit à la révolution en Russie et en Allemagne.
Les révolutionnaires eux commettent une double erreur :
- ils sous-estiment la bourgeoisie (cf. article ci dessus), ils estiment que de la guerre impérialiste sortira la révolution prolétarienne comme en 1871, 1905 et surtout 1917;
- ils sous-estiment la défaite subie par la classe ouvrière qui a été battue idéologiquement à la fin des années 1920, puis physiquement pour enfin être écrasée et assassinée dans la guerre impérialiste.
Les documents que nous reproduisons ci-dessous montrent cette surestimation : les slogans appellent les ouvriers à ne pas marcher derrière la Résistance, mais à organiser leurs « Comités d'action » pour suivre l'exemple des ouvriers italiens.
Après la trahison des partis communistes et des groupes trotskistes passés avec « armes et bagages » dans un camp impérialiste : celui des « démocraties » et du stalinisme, ils sont, et c'est leur immense mérite, l'expression de la classe ouvrière et la seule flamme révolutionnaire et internationaliste dans l'hystérie nationaliste, chauvine et revancharde de la « Libération ». C'est contre le courant et contre l'union nationale retrouvée : de la droite aux trotskistes en passant par les staliniens, que ces ouvriers et ces apatrides de la Gauche Communiste de France vont coller et diffuser leurs tracts et leurs journaux.
Il fallait un courage fou pour s'opposer à tous et appeler les ouvriers à déserter l'encadrement des « partisans », et passer entre les filets de la Gestapo, de la police de Vichy, des réseaux gaullistes et des « tueurs » staliniens.
RX.
TRACTS :
OUVRIERS!
Les troupes anglo-américaines viennent remplacer le GENDARME ALLEMAND dans l'oeuvre de répression de la classe ouvrière et de sa réintégration dans la guerre impérialiste.
La RESISTANCE vous pousse à l'insurrection, mais sous sa direction et pour des buts capitalistes.
Le PARTI COMMUNISTE abandonnant la cause du prolétariat a sombré dans le patriotisme funeste à la classe ouvrière.
- Ne répondez pas à l'insurrection qui se fera avec votre sang pour le plus grand bien du capitalisme international.
- Agissez en tant que prolétaires et non en tant que Français revanchards.
- Refusez d'être réintégrés dans la guerre impérialiste.
OUVRIERS!
- Organisez vos comités d'action et quand les conditions le permettront, vous suivrez l'exemple des ouvriers italiens.
Plus que jamais votre arme demeure LA LUTTE DE CLASSE sans considération de frontières et de nations.
Plus que jamais votre place n'est à côté, ni du fascisme, ni de la démocratie bourgeoise.
Plus que jamais le capitalisme ANGLO-AMERICAIN, RUSSE ET ALLEMAND SONT LES EXPLOITEURS DE LA CLASSE OUVRIERE.
La grève qui s'est déclenchée a été provoquée par LA BOURGEOISIE et pour SES INTERETS.
Demain pour lutter contre le chômage qu'elle ne peut résoudre, vous serez MOBILISES ET ENVOYES SUR LE FRONT IMPERIALISTE.
LE CAPITALISME INTERNATIONAL NE PEUT PLUS VIVRE QUE DANS LA GUERRE.
LES ARMEES ANGLO-AMERICAINES VOUS LE FERONT COMPRENDRE COMME VOUS L'A FAIT SENTIR L'ARMEE ALLEMANDE !
VOUS NE SORTIREZ DE LA GUERRE IMPERIALISTE QUE PAR LA GUERRE CI VILE !
PROLETARIAT CONTRE CAPITALISME !
GAUCHE COMMUNISTE FRANÇAISE
Août 1944
L'Etincelle
FRACTION FRANÇAISE GAUCHE COMMUNISTE
Août 1944.
« Le monde va changer de base, Nous ne sommes rien, soyons tout ! »
Ouvriers,
Après 5 ans de guerre, avec sa longue suite de misère, de morts et de carnage, la bourgeoisie faiblit sous les coups d'une crise qui ouvre les portes de la guerre civile. L'Europe demain sera un vaste champ en éruption où les armées contre-révolutionnaires anglaises, américaines et russes, implacablement, essayeront d'étouffer les mouvements révolutionnaires de la classe ouvrière.
La tâche de répression entre les belligérants est déjà répartie. L'Italie, vaste champ d'expérience, a enseigné au capitalisme le danger de laisser subsister sur les chemins de la guerre des concentrations ouvrières susceptibles toujours de réapparaître comme classe indépendante, comme les ouvriers italiens l'ont prouvé.
Voilà pourquoi depuis deux ans l'Allemagne vous entrepose dans ses immenses usines où, côte à côte, les prolétaires européens s'échinent et se crèvent à fabriquer des armes pour la guerre impérialiste. Voilà pourquoi depuis deux ans les patriotards à la solde du capitalisme vous poussent vers le maquis pour vous faire perdre votre conscience de classe en vous transformant en revanchards. Tous les centres industriels importants de la France sont vides de plus en plus pour amoindrir les risques de la guerre civile et permettre la réduction des foyers révolutionnaires qui jailliront de cette guerre.
Le drainage de toutes les énergies ouvrières s'est fait dans l'esprit politique de vous affaiblir dans votre conscience et de vous parquer comme des animaux pour vous fouetter et vous abattre dès vos premiers murmures.
La guerre actuellement ne se joue pas entre les impérialistes belligérants, mais entre le capitalisme conscient de sa volonté de demeurer au pouvoir malgré l'impossibilité que l'Histoire lui impose et le prolétariat aveuglé par la démagogie qui jaillira spontanément des cadres du système bourgeois.
Les armes démagogiques et répressives du capitalisme sont déjà à pied d'oeuvre.
Au camp de concentration, au maquis, à l'exploitation forcenée de tous les ouvriers en Allemagne viennent s'ajouter les bombardements des villes, surtout là où des mouvements de grèves éclatent, comme à Milan, à Naples, à Marseille. Par radio, la tromperie bourgeoise emprunte une tenue et un langage qui s'auréole de la Révolution d'Octobre, et qui depuis 1933, date de la mort de l'Internationale Communiste, vous a conduit de défaites en défaites à la guerre impérialiste.
L'Armée Rouge, usurpatrice d'un nom qui s'est couvert de gloire parce qu'elle fut une armée ouvrière luttant révolutionnairement pour la dictature du prolétariat viendra continuer l'oeuvre de mort du fascisme, avec ses étiquettes de Soviets pour déguiser sous une unanimité à coups de crosse, l'exploitation capitaliste.
De Gaulle, « ce négrier », comme l'appelaient avant 1941 les staliniens dans une accolade anglo-américaine et russe vous étouffera sous l'habit kaki de votre nouvelle mobilisation.
L'Europe est mûre pour la guerre civile, le capitalisme est prêt à réagir pour vous conduire vers la guerre impérialiste.
Ouvriers, chaque arme du capitalisme contient en elle une arme dangereuse pour lui.
A la réduction des foyers révolutionnaires, la situation répond par une concentration plus dense de la classe ouvrière dans un point névralgique du capitalisme.
A la politique patriotarde, la solidarité prolétarienne s'est créée dans les usines allemandes et se fortifiera par la nécessité inéluctable pour les ouvriers de se défendre en tant qu'ouvriers dans une Europe livrée demain à la famine et au chômage.
La crise qui déferlera au lendemain de la transformation de la guerre impérialiste en guerre civile n'épargnera pas les armées impérialistes des soubresauts sociaux de leurs arrières, ainsi que de la contamination révolutionnaire venant des insurrections du prolétariat européen qu'elles auront à mater. La cause du prolétariat français est irrémédiablement soudée à la cause du prolétariat européen après quatre années de centralisation et de concentration économique. Les ennemis les plus dangereux pour la classe ouvrière européenne et mondiale sont les capitalismes anglo-américain et russe qui n'entendent pas se laisser déposséder.
Ouvriers, quel que soit le nom que vous donnerez à vos organismes unitaires, l'exemple des Soviets russes de la Révolution d'Octobre 1917 doit vous enseigner le chemin, sans compromis ni opportunisme, du pouvoir.
Ni la démocratie, ni le stalinisme avec leur démagogie de « Pain, Paix et Liberté » ne pourront vous libérer de l'oppression et de la famine qui pointent, dans un monde où le capitalisme ne peut apporter que la guerre.
La société est dans une impasse infranchissable sans la Révolution prolétarienne.
Le premier pas à faire, c'est de briser d'avec la guerre impérialiste par une claire conscience de classe qui proclame avant tout la lutte de classe partout et toujours. La crise dans la bourgeoisie mondiale, qui s'est ouverte en Italie et en Allemagne, forge les conditions et les armes favorables à la guerre civile, début spontané de la Révolution.
Ouvriers ! Brisez d'avec toute anglofolie, americanofolie et russofolie,
Rejetez tout patriotisme dont le capitalisme lui même ne sait que faire,
Proclamez votre solidarité de classe et organisez la pour pouvoir résister victorieusement le jour de la Révolution,
Coupez court d'avec tous les partis traîtres à la cause ouvrière qui vous ont conduits à cette guerre impérialiste et qui tentent de vous y faire rester. Le gaullisme, la social-démocratie, le stalinisme, le trotskisme, voilà les paravents derrière lesquels l'ennemi de classe tentera de pénétrer dans vos rangs pour vous abattre.
Ouvriers ! Le salut ne peut venir que de vous parce que l'Histoire vous a donné toutes les possibilités de comprendre votre mission historique et les armes pour les accomplir.
En avant pour la transformation de la guerre impérialiste en guerre civile !
Les ouvriers italiens vous ont montré la voie, à vous de répondre coup pour coup à la contre-révolution qui se camoufle dans vos rangs !
La F.F.G.C.
Evènements historiques:
- Deuxième guerre mondiale [1286]
Courants politiques:
- Gauche Communiste [49]
Questions théoriques:
- Impérialisme [321]
Polémique avec Prometeo - Communist Review : la conception du B.I.P.R.de la decadence du capitalisme
- 4712 reads
La guerre impérialiste est-elle une solution à la crise des cycles d'accumulation du capitalisme ?
Le futur Parti communiste mondial, la nouvelle Internationale, se construira sur des positions politiques qui dépasseront les erreurs, les insuffisances ou les questions non résolues, de l'ancien parti, l'Internationale communiste. Pour cette raison, il est vital de poursuivre le débat des organisations qui se réclament de la Gauche communiste. Parmi ces positions, nous considérons comme fondamentale la notion de la décadence du capitalisme. Nous avons montré, dans les numéros précédents de la Revue Internationale, comment l'ignorance de cette notion par le courant bordiguiste conduisait à des aberrations théoriques sur la question de la guerre impérialiste, et amenait à un désarmement politique de la classe ouvrière ([1] [1729]).
Nous abordons dans cet article les positions du Partito Comunista Internazionalista et de la Communist Workers'Organisation, qui forment ensemble le Bureau International pour le Parti Révolutionnaire (BIPR) ([2] [1730]), organisations qui fondent quant à elles clairement la nécessité de la révolution communiste sur l'analyse que le capitalisme, depuis la 2e guerre mondiale, est entré dans sa phase de décadence.
Cependant, tout en se distinguant ainsi des groupes bordiguistes, aussi bien BC que la CWO défendent toute une série d'analyses qui impliquent, à notre avis, une relativisation ou même un rejet de la notion de décadence du capitalisme.
Dans cet article, nous examinerons une
série d'arguments que défendent ces organisations sur le rôle des guerres
mondiales et sur la nature de l'impérialisme, qui, selon nous, les empêchent de
défendre au fond et jusqu'au bout, dans toutes ses implications, la position
communiste sur la décadence du capitalisme.
La
nature de la guerre impérialiste
Le BIPR explique la guerre impérialiste généralisée, un phénoméne essentiel du capitalisme décadent de la manière suivante : « Et de la même façon qu'au 19e siécle les crises du capitalisme conduisaient à la dévaluation du capital existant (par le biais des faillites), ouvrant ainsi un nouveau cycle d'accumulation fondé sur la concentration et la fusion, au 20e siécle, les crises de l'impérialisme mondial ne peuvent plus se résoudre que par une dévaluation plus grande encore du capital existant, par la faillite économique de pays entiers. Telle est précisément la fonction économique de la guerre mondiale. Comme cela s'est produit en 1914 et en 1939, c'est la "solution" inexorable de l'impérialisme à la crise de l'économie mondiale. » ([3] [1731]).
Cette vision de la «fonction économique de la guerre mondiale », «faillite économique de pays entiers », par analogie avec les faillites du siécle dernier, revient en fait à concevoir la guerre mondiale comme le moyen que trouve le capitalisme pour relancer un « nouveau cycle d'accumulation », ce qui signifie attribuer à la guerre mondiale une rationalité économique.
Les guerres du siècle passé avaient cette rationalité : elles permettaient, dans le cas des guerres nationales (comme les guerres italiennes ou la guerre franco-prussienne) de constituer de grandes unités nationales qui signifiaient une avancée réelle dans le développement du capitalisme, et, dans le cas des guerres coloniales, une extension des rapports de production capitalistes aux régions les plus éloignées du globe, contribuant à la formation du marché mondial.
Il ne se passe pas la même chose au 20e siécle, dans la période de décadence du capitalisme. La guerre impérialiste n'a pas une rationalité économique. Si la «fonction économique » de la guerre mondiale consistant en la destruction de capital peut sembler analogue à ce qui se passait au siécle dernier, ce n'est qu'une apparence. Comme le pressent confusément le BIPR en accolant des guillemets au mot « solution », la fonction de la guerre est radicalement différente au 20e siécle. Elle n'est précisément pas une solution face à une crise cyclique « ouvrant ainsi un nouveau cycle d'accumulation », mais elle est la manifestation la plus aigue de la crise permanente du capitalisme, elle exprime la tendance au chaos et à la désintégration qui s'est emparée du capitalisme mondial, et elle est de plus un accélérateur puissant de cette tendance.
Les
80 dernières années ont confirmé pleinement cette analyse. Les guerres impérialistes
sont l'expression la plus achevée de l'engrenage infernal du chaos et de la
désintégration dans lequel est enfermé le capitalisme dans sa période de décadence.
Il ne s'agit plus d'un cycle passant d'une phase d'expansion à une phase de
crise, de guerres nationales et coloniales, pour déboucher sur une nouvelle
expansion, manifestant le dé-veloppement global du mode de production
capitaliste, mais d'un cycle passant de la crise à la guerre impérialiste
généralisée pour le rapartage du marché mondial, puis de la reconstruction
d'aprés-guerre à une nouvelle crise plus large, comme ce fut le cas par deux
fois au cours de ce siécle.
La
nature de la reconstruction aprés la 2e guerre mondiale
Pour le BIPR « le capitalisme a vécu, bien sûr, les deux crises précédentes (il se référe à la 1e et à la 2e guerre mondiale) d'une manière dramatique, mais il avait encore devant lui des marges assez vastes pour espérer un développement ultérieur y inclus dans le cadre général de la décadence. » ([4] [1732])
Le BIPR se rend compte de la gravité des destructions, des souffrances, que provoquent les guerres impérialistes et pour cela dit que c'est quelque chose de « dramatique ». Mais les guerres de la période ascendante étaient aussi « dramatiques » : elles provoquaient des destructions, la faim, des souffrances innombrables. Le capitalisme est né « dans la boue et le sang » comme le disait Marx.
Cependant, il y a une différence abyssale entre les guerres de la période ascendante et les guerres de la période décadente: dans les premières, « le capitalisme a des marges assez vastes de développement » pour reprendre les termes du BIPR, dans les secondes ces marges se sont dramatiquement réduites et n'offrent plus un champ suffisant pour l'accumulation du capital.
Là réside la différence essentielle entre les guerres de l'une et de l'autre période, entre ascendance et décadence du capitalisme. Aussi, penser qu'à travers la 1e et la 2e guerre mondiale, le capitalisme « avait encore devant lui des marges assez vastes pour espérer un développement ultérieur» , c'est jeter par dessus bord l'essentiel de la période de décadence du capitalisme.
Il est évident que cette analyse sur les « marges de développement » du capitalisme dans la décadence est trés liée aux explications du BIPR sur la crise fondées sur la seule théorie de la tendance à la baisse du taux de profit, sans tenir compte de la théorie développée par Rosa Luxemburg de la saturation du marché mondial, cependant, sans entrer dans cette discussion, un simple bilan de la reconstruction qui a suivi la 2e guerre mondiale dément ces prétendues « marges assez vastes de développement. »
Selon les apparences, aprés le cataclysme de la guerre, en 1945 l'économie mondiale non seulement « était revenue à la normale » mais avait de plus dépassé les niveaux de croissance précédents. Cependant; nous ne pouvons pas nous laisser aveugler par les chiffres mirifiques fournis par les statistiques. Si on laisse de côté le probléme de la manipulation de ces dernières par les gouvernements et les institutions économiques, phénoméne qui existe, mais qui est totalement secondaire dans le cas qui nous occupe, nous avons l'obligation d'analyser la nature et la composition de cette croissance.
Si nous procédons à cette analyse, nous voyons qu'une part importante de cette croissance est composée d'une part de la production d'armement et des dépenses de défense, et d'autre part de toute une série de dépenses (bureaucratie étatique, marketing et publicité, médias de « communication ») qui sont totalement improductives du point de vue de la production globale.
Commençons par la question de l'armement. A la différence de la période postérieure à la 1e guerre mondiale, en 1945 les armées ne sont pas complétement démobilisées et les dépenses d'armement augmentent de manière pratiquement ininterrompue jusqu'à la fin des années 1980.
Les dépenses militaires représentaient pour les Etats-Unis, avant l'effondrement de l'URSS, 10 % du Produit National Brut. En URSS elles représentaient 20-25 %, dans les pays de 1’Union européenne elle sont actuellement 3-4 %, dans les pays du « tiers-monde », elles atteignent dans beaucoup de cas 25 %.
La production d'armement augmente dans un premier temps le volume de la production, cependant, dans la mesure oú ces valeurs créées ne « retournent » pas dans le processus productif mais que leur aboutissement est ou bien la destruction ou bien de rouiller dans les casernes ou les silos nucléaires, elles représentent en fait la stérilisation, la destruction d'une partie de la production globale : avec la production d'armes et les dépenses militaires « une part chaque fois plus grande de cette production va à des produits qui n'apparaissent pas dans le cycle suivant. Le produit quitte la sphére de la production et ne retourne pas dans celle-ci. Un tracteur retourne à la production sous la forme de gerbes de blé, un tank non. » ([5] [1733])
De la même manière, la période d'aprés-guerre a signifié un accroissement formidable des dépenses improductives: l’Etat a développé une immense bureaucratie, les entreprises ont suivi la même régle en augmentant de manière disproportionnée les systémes de contrôle et d'administration de la production, la commercialisation des produits, face aux difficultés de la vente sur le marché, a pris des proportions chaque fois plus grandes jusqu'à représenter prés de 50 % du prix des marchandises. Les statistiques capitalistes attribuent à cette masse formidable de dépenses un signe positif, en les comptabilisant comme « secteur tertiaire ». Cependant, cette masse croissante de dépenses improductives constitue plutôt une soustraction pour le capital global. « Lorsque les rapports de production capitalistes cessent d'être porteurs du développement des forces productives pour en devenir des entraves, tous les 'faux frais" qu'ils peuvent occasionner deviennent de simples gaspillages. Ce qu'il est important de noter, c'est que cette inflation de 'faux-frais" a été un phénopéne inévitable qui s'est imposé au capitalisme avec autant de violence que ses contradictions. L'histoire des nations capitalistes depuis un demi-siécle est rempli de "politiques d'austérité", d'essais, de retour en arrière, de luttes contre l'expansion incontrôlée des frais de l'Etat, des dépenses improductives en général. (..) Toutes ces tentatives aboutissent cependant systématiquement à des échecs. (..) Plus le capitalisme connaît de difficultés, plus il doit développer ses 'faux -frais". Ce cercle vicieux, cette gangréne qui ronge le systéme du salariat n'est qu'un des symptômes d'une même maladie : la décadence capitaliste. »([6] [1734])
Une fois vue la nature de la croissance aprés la 2e boucherie impérialiste, voyons maintenant sa répartition dans les différentes aires du capitalisme mondial.
En commençant par l'ex-URSS et les pays qui ont constitué son bloc, une part non négligeable de la « reconstruction » en URSS s'est faite par le transfert d'usines entières de Tchécoslovaquie, Pologne, Hongrie, ex-RDA, Mandchourie, etc., sur le territoire de 1’URSS, ce qui ne signifie pas globalement une véritable croissance mais un simple changement de localisation géographique.
D'un autre côté, comme nous l'avons mis en évidence depuis des années ([7] [1735]), l'économie des régimes staliniens produisait des marchandises d'une qualité plus que douteuse, de telle manière qu'une grande proportion était inutilisable. Sur le papier la production a pu croître à des niveaux «formidables », et le BIPR tombe dans le panneau à pieds joints ([8] [1736]), mais en réalité la croissance a été en grande partie fictive.
En ce qui concerne les pays qui sont sortis des vagues successives de « décolonisation », dans l'article « Des nations mort-nées » ([9] [1737]), nous avions mis en évidence le mensonge de ces « taux de croissance plus grands que ceux du monde industrialisé ». Aujourd’hui, nous pouvons voir qu'un grand nombre de ces pays est entré dans un processus accéléré de chaos et de décomposition, de faim, d’épidémies, de destructions et de guerres. Dans ces pays la guerre impérialiste comme mode de vie permanent du capitalisme décadent s'est imposée depuis le début comme une plaie dévastatrice constituant un terrain d’affrontement permanent entre les grandes puissances avec la complicité active des bourgeoisies locales.
Du point de vue strictement économique, l'immense majorité de ces pays est embourbée depuis des décennies dans une situation de marasme total. Et aujourd'hui par exemple les «fantastiques » taux de croissance des fameux « Quatre dragons asiatiques » ne doivent pas nous tromper. Ces pays se sont fait une petite place sur le marché mondial par la vente à des prix dérisoires de certains produits de consommation et de quelques composants auxiliaires de l'industrie électronique. Ces prix viennent d’une part de la surexploitation de la main d’oeuvre ([10] [1738]) et, surtout, du recours systématique aux crédits d’Etat à l'exportation et au dumping (vente au-dessous de la valeur).
Ces pays ne peuvent pas échapper, comme les autres, à une loi implacable qui opére pour toutes les nations qui sont arrivées trop tard sur le marché mondial : « La loi de l'offre et de la demande joue contre tout développement de nouveaux pays. Dans un monde oú les marchés sont saturés, l'offre dépasse la demande et les prix sont déterminés par les coûts de production les plus bas. De ce fait, les pays ayant les coûts de production les plus élevés sont contraints de vendre leurs marchandises avec des profits réduits quand ce n'est pas à perte. Cela raméne leur taux d'accumulation à un niveau extrêmement bas et, même avec une main d'oeuvre trés bon marché, ils ne parviennent pas à réaliser les investissements nécessaires à l'acquisition massive d'une technologie moderne, ce qui a pour résultat de creuser encore plus le fossé qui sépare ces pays des grandes puissances industrielles. » ([11] [1739])
Quant aux pays industriels, il est certain qu'entre 1945 et 1967, ils ont connu une réelle croissance économique (de laquelle il faut décompter le volume énorme des dépenses militaires et improductives).
Cependant, nous devons faire au moins deux précisions. En premier lieu : « Certains taux de croissance atteints depuis la deuxiéme guerre mondiale approchent - voire dépassent - ceux atteints au cours de la phase ascendante du capitalisme avant 1913. C'est le cas pour les pays comme la France et le Japon. C'est cependant loin d'être le cas pour la première puissance industrielle, les USA (50 % de la production mondiale au début des années 1950, 4,6 % de taux de crois-sance annuel moyen entre 1957 et 1965 contre 6,9% entre 1850 et 1880 »([12] [1740]). De plus, la production mondiale entre 1913 et 1959 (y compris la fabrication d'armements) croît de 250 % , alors que si elle l'avait fait au même rythme moyen qu'entre 1880 et 1890, période d'apogée du capitalisme, elle aurait crù de 450 %. ([13] [1741])
En deuxiéme lieu, la croissance de ces pays s'est faite au prix d'un appauvrissement croissant du reste du monde.Durant les années 70, le systéme de crédits massifs aux pays du « tiers-monde » de la part des grands pays industrialisés pour qu'il absorbent les énormes stocks de marchandises invendables, a donné l'apparence d'une « grande croissance » à toute l'économie mondiale. La crise de la dette qui a éclaté à partir de 1982, a dégonflé cette énorme bulle, mettant en évidence un probléme trés grave pour le capital: « pendant des années, une bonne partie de la production mondiale n'a pas été vendue mais tout simplement donnée. Cette production, qui peut correspondre à des biens réellement fabriqués, n'est donc pas une production de valeur, c'est à dire la seule chose qui intéresse le capitalisme. Elle n'a pas permis une réelle accumulation de capital. Le capital global s'est reproduit sur des bases de plus en plus étroites. Pris comme un tout, le capitalisme ne s'est donc pas enrichi. Au contraire, il s'est appauvri. » ([14] [1742])
Il est significatif qu'aprés la crise de la dette dans le « tiers-monde » entre 1982 et 1985, la « solution » ait été l'endettement massif des Etats-Unis qui, entre 1982 et 1988, sont passés du statut de pays créditeur à celui de premier pays endetté du monde.
Cela montre l'impasse dans laquelle se trouve le capitalisme là oú il est le plus fort, dans les grandes métropoles industrialisées d'Occident.
De ce point de vue, l'explication que donne BC de la crise de la dette américaine, est erronée et représente une forte sous-estimation : « mais le véritable levier qui a été utilisé pour drainer les richesses de tous les coins de la terre vers les Etats-Unis fut la politique d'élévation des taux d'intérêt » BC caractérise cette politique comme « appropriation de la plus-value au travers du contrôle de la rente financière » en signalant que «du développement des profits au moyen du développement de la production industrielle, on est passé au développement des profits grâce au développement de la rente financière. » ([15] [1743])
BC devrait se demander pourquoi on passe «du développement des profits au moyen du développement de la production industrielle » au « développement des profits grâce au développement de la rente financière. » Et la réponse est évidente : alors que dans les années 1960, un développement industriel était encore possible pour les grands pays capitalistes, alors que dans les années 1970, les crédits massifs aux pays du « tiers-monde » et de l’Est ont permis de maintenir à flot ce « développement », dans les années 1980, ces robinets se sont fermés définitivement et ce furent les Etats-Unis qui ont apporté une nouvelle fuite en avant avec leurs immenses dépenses en armements.
Voilà pourquoi BC se trompe en
considérant comme « lutte pour la rente
financière » le processus d'endettement massif des Etats-Unis et se rend
ainsi incapable de comprendre la situation des années 1990 oú les possibilités
d'un endettement des Etats-Unis dans les proportions des années 1980,
n'existent plus. Le capitalisme a le plus développé » s'est fermé une autre de
ses portes illusoires face à la crise ([16] [1744]).
Le rapport entre la guerre impérialiste et la crise capitaliste
Pour BC, la guerre a devient à l'ordre du jour de l'histoire quand les contradictions du processus d'accumulation du capital se développent jusqu'à déterminer une surproduction de capital et une chute du taux de profit. » ([17] [1745]) Historiquement, et historiquement seulement, cette position est juste. L'ére de l'impérialisme, la guerre impérialiste généralisée, naît de la situation d'impasse dans laquelle se trouve le capitalisme dans sa phase de décadence, quand il ne peut plus poursuivre son accumulation à cause de la pénurie des nouveaux marchés qui lui permettaient jusque là d'étendre ses rapports de production.
BC s'essaie à démontrer, à partir d'une série d'éléments sur le chômage avant la 1e guerre mondiale, et sur le chômage et l'utili-sation de la capacité productive avant la 2e, que « les données (..) montrent sans équivoque le lien étroit qui existe entre le cours du cycle économique et les deux guerres mondiales. »([18] [1746])
Outre le fait que les données sont limitées exclusivement aux Etats-Unis, nous renvoyons ici sans la reprendre à l'argumentation développée dans les articles déjà cités de la Revue Internationale n° 77 et 78 en réponse à Programme communiste qui énonce la même idée.
Le déchaînement de la guerre requiert, outre les conditions économiques, une condition décisive : l'enrôlement du prolétariat dans les grands pays industrialisés pour la guerre impérialiste. Sans cette condition, même si toutes les conditions u objectives u existent, la guerre ne peut être déchaînée. Nous ne revenons pas sur cette position fondamentale que BC rejette également ([19] [1747]). Disons simplement que le lien mécanique entre guerre et crise économique que le BIPR prétend établir (coincidant sur cette position avec le bordiguisme qui rejette la notion de déca-dence), entraîne une sous-estimation du probléme de la guerre dans le capitalisme décadent.
Rosa Luxemburg dans L'accumulation du capital souligne que « plus s'accroît la violence avec laquelle à l'intérieur et à l'extérieur le capital anéantit les couches non-capitalistes et avilit les conditions d'existence de toutes les classes laborieuses, plus l'histoire quotidienne de l'accumulation dans le monde se transforme en une série de catastrophes et de convulsions, qui, se joignant aux crises économiques périodiques finiront par rendre impossible la continuation de l'accumulation et par dresser la classe ouvrière internationale contre la domination du capital avant même que celle-ci ait atteint économiquement les dernières limites objectives de son développement. » ([20] [1748])
En général, la guerre et la crise économique ne sont pas des phénoménes liés dans un rapport mécanique. Dans le capitalisme ascendant, la guerre est au service de l'économie. Dans le capitalisme décadent, c'est l’inverse : surgissant de la crise historique du capitalisme, la guerre impérialiste acquiert sa propre dynamique et devient progressivement le mode de vie même du capitalisme. La guerre, le militarisme, la production d'armes, tendent à mettre à leur service l'activité économique, provoquant des déformations monstrueuses des propres lois de l'accumulation capitaliste et générant des convulsions supplémentaires dans la sphére économique.
C'est ce que pose avec lucidité le 2e congrés de 1`Internationale communiste :
« La guerre a fait subir au
capitalisme une évolution. (..) La guerre l'a accoutumé, comme aux actes les
plus ordinaires, à réduire par le blocus des pays entiers à la famine, à
bombarder et incendier des villes et villages pacifiques, à infecter les
sources et les rivières en y jetant des cultures du choléra, à transporter de
la dynamite dans des valises diplomatiques, à émettre des billets de banque
faux imitant ceux de l'ennemi, à employer la corruption, l'espionnage et la
contrebande dans des proportions jusque-là inouies. Les moyens d'action
appliqués à la guerre restérent en vigueur dans le monde commercial aprés la
conclusion de la paix. Les
opérations commerciales de quelque importance s'effectuent sous l'égide de 1’Etat.
Ce dernier est devenu semblable à une association de malfaiteurs armés jusqu
aux dents. » ([21] [1749])
La nature des « cycles d'accumulation » dans la décadence capitaliste
Selon BC, « chaque fois que le systéme ne peut contrecarrer par une impulsion antagonique
les causes qui provoquent la chute du taux de profit, se posent alors deux
types de problémes : a) la destruction du capital en excés ; b) l'extension de
la domination impéréaliste sur le marché international. » ([22] [1750]).
Avant tout, il faut préciser que BC a un siécle de retard: la question de « l'extension de la domination impérialiste sur le monde » a commencé à se poser chaque fois plus de manière aiguë dans la dernière décennie du siécle passé. Depuis 1914, cette question ne se pose plus pour la simple raison que tout le monde est pris, et bien pris, dans les filets sanglants de l'impérialisme. La question qui se répéte et s'aggrave depuis 1914 n'est pas l'extension de l'impérialisme mais le partage du monde entre les différents vautours impérialistes.
L'autre « mission » que BC assigne à la guerre impérialiste – « la destruction du ca-pital en excés » - tend à comparer les destructions de forces productives qui se produisaient au 19e siécle comme conséquences des crises cycliques du systéme, avec les destructions causées par les guerres impérialistes de ce siécle. Néammoins BC reconnaît la différence qualitative entre ces destruc-tions: « alors, il s'agissait du coût douloureux d'un développement "nécessaire" des forces productives, aujourd'hui nous sommes en présence d'une oeuvre de dévastation systématique projetée à échelle planétaire, aujourd'hui au sens économique, demain au sens physique, plongeant l'humanité dans l'abîme de la guerre. » ([23] [1751]) Mais pas suffisamment, et BC a toujours persisté à relativiser cette différence pour insister bien plus sur une identité de fonctionnement du capitalisme dans sa phase ascendante et dans sa phase de décadence : « toute l'histoire du capitalisme est la course sans fin vers un équilibre impossible, seules les crises, c'est à dire famine, chômage, guerre et mort pour les travailleurs, sont les moments par lesquels les rapports de production créent de nouveau les conditions pour un cycle ultérieur d'accumulation qui aura comme ligne d'arrivée une autre crise encore plus profonde et plus vaste » ([24] [1752]).
Il est certain qu'aussi bien dans le capitalisme ascendant que dans le capitalisme décadent, le systéme ne peut se libérer des crises périodiques qui l'aménent au blocage et à la paralysie. Cependant, constater cela nous laisse sur le terrain des économistes bourgeois qui nous confortent en répétant: « aprés une récession, vient une reprise et ainsi de suite. »
Certes, BC ne reprend pas ces chiméres et défend clairement la nécessité de détruire le capitalisme et de faire la révolution, mais il reste prisonnier du schéma du « cycle de l'accumulation. »
En fait :
- les crises cycliques de la période ascendante sont différentes des crises de la période décadente ; la racine de la guerre impérialiste ne se situe pas dans la crise de chaque cycle d'accumulation, ce n'est pas une sorte de dilemme qui se reproduit chaque fois qu'un cycle d'accumulation entre en crise, mais elle se situe dans une situation historique permanente qui domine toute la décadence capitaliste.
Alors que dans la période ascendante, les crises étaient de courte durée et survenaient de manière assez régulière chaque 7 ou 10 ans, depuis 1914, durant 80 ans, en nous limitant exclusivement aux grands pays industrialisés, nous avons eu :
- 10 ans de guerres impérialistes (1914-18 et 1939-45) avec plus de 80 millions de morts;
- 46 ans de crise ouverte : 1918-22, 1929-39, 1945-50, 1967-94 (nous ne prenons pas en compte les courts moments entre 1929-39 et 1967-94 de o reprise dopée u qui se sont intercalés entre ces années) ;
- 24 ans seulement (à peine le quart de la période) de reprise économique : 1922-29 et 1950-67.
Tout cela montre que le simple schéma de l'accumulation ne suffit pas à expliquer la réalité du capitalisme décadent et paralyse la compréhension de ses phénoménes.
Bien que BC reconnaisse le phénoméne du capitalisme fEtat, essentiel dans la décadence, il n'en tire pas toutes ses conséquences ([25] [1753]). En effet, une caractéristiqüe essentielle de la décadence, qui affecte de manière décisive la manifestation des a crises cycliques », est l'intervention massive de lEtat (liée étroitement à la formation d'une économie de guerre), au moyen de toute une série de mécanismes que les économistes appellent a politique économique ». Cette intervention altére profondément la loi de la valeur provoquant des déformations monstrueuses dans l'ensemble de l'économie mondiale, qui aggravent et aiguisent systématiquement les contradictions du systéme, conduisant à des convulsions brutales non seulement dans l'appareil économique mais dans toutes les sphéres de la société.
Ainsi, le poids permanent de la guerre dans toute la vie sociale et, fautre part, le capitalisme dEtat, transforment radicalement la substance et la dynamique des cycles économiques : « Les conjonctures ne sont pas déterminées par le rapport entre la capacité de production et la taille du marché existant à un moment donné, mais par des causes essentiellement politiques. (..) Dans ce cadre, ce ne sont nullement des problémes d'amortissement du capital qui déterminent la durée des phases du développement économique mais en grande partie, l'ampleur des destructions subies au cours de la guerre précédente. (..) Contrairement au siécle dernier caractérisé par le "laisser faire", l'ampleur des destructions des récessions au 20e siécle est limitée par des mesures artificielles mises en place par les Etats et leurs institutions de recherche pour retarder la crise généralisée (..) [avec] tout un éventail de mesures politiques qui tendent à rompre avec le strict fonctionnement économique du capitalisme » ([26] [1754]).
Le probléme de la guerre ne peut pas se situer dans la dynamique des « cycles d'accumulation » que, d'autre part, BC élargit à sa guise pour la période de décadence en l'identifiant avec les cycles « crise-guerre-reconstruction », alors que, comme nous l'avons vu, ces cycles n'ont pas une nature strictement économique.
Rosa Luxemburg précise: « Il est cependant trés important de constater de prime abord que cette succession périodique des conjonctures et la crise, si elles sont des éléments essentiels de la reproduction, ne constituent cependant pas le véritable probléme de la reproduction capitaliste. Successions périodiques de conjonctures et crise sont la forme spécifique du mouvement vers la production capitaliste, mais non pas ce mouvement lui-même. » ([27] [1755])
Le probléme de la guerre dans le capitalisme décadent, doit être situé en-dehors des strictes oscillations du cycle économique, en-dehors des va-et-vient et des conjonctures du taux de profit.
« Dans cette ére non seulement la bourgeoisie ne peut plus développer les forces productives mais elle ne subsiste qu'à la condition de se livrer à leur destruction et d'anéantir les richesses accumulées, fruit du travail social des siécles passés. La guerre impérialiste généralisée est la manifestation principale de ce processus de décomposition et de destruction dans laquelle est entré la société capitaliste. » ([28] [1756])
Le BIPR a les mains liées par ses théories sur les cycles d'accumulation selon la tendance à la chute du taux de profit et explique la guerre au travers du « déterminisme économique » des crises des cycles d'accumulation.
Comme marxistes, il est clair que nous savons trés bien que « l'infrastructure économique détermine toute la superstructure de la société ». Mais nous ne le comprenons pas d'une manière abstraite comme un calque qu'il faut appliquer mécaniquement à chaque situation, mais d'un point de vue historico-mondial. Et c'est pour cela que nous comprenons que le capitalisme décadent dont le marasme et le chaos ont une origine économique, a aggravé ceux-ci à tel point qu'on ne peut les comprendre limités à un strict économisme.
« L'autre aspect de l'accumulation capitaliste concerne les relations entre le capital et les modes de production non capitalistes, il a le monde entier pour théâtre. Ici les méthodes employées sont la politique coloniale, le systéme des emprunts internationaux, la politique des sphéres d'intérêts, la guerre. La violence, l'escroquerie, l'oppression, le pillage se déploient ouvertement, sans masque, et il est difficile de reconnaître les lois rigoureuses du processus économique dans l'enchevêtrement des violences et des brutalités politiques.
La théorie libérale bourgeoise n'envisage que l'aspect unique de la "concurrence pacifique", des merveilles de la technique et de l'échange pur de marchandises ; elle sépare le domaine économique du capital de l'autre aspect, celui des coups de force considérés comme des incidents plus ou moins fortuits de la politique extérieure. » ([29] [1757]).
Le BIPR dénonce avec rigueur la barbarie du capitalisme, les conséquences catastrophiques de ses politiques, de ses guerres. Cependant, il n'arrive pas à avoir, comme il convient d'avoir avec une théorie conséquente de la décadence, une vision unitaire et globale de la guerre et de l'évolution économique. L'aveuglement et l'irresponsabilité qu'implique cette faiblesse, est manifeste dans cette formulation: « Dés les premières manifestations de la crise économique mondiale notre parti a soutenu que l'issue était obligatoire. L'alternative qui se pose est nette : ou dépassement bourgeois de la crise à travers la guerre mondiale vers un capitalisme monopoliste concentré ultérieurement dans les mains d'un petit numéro de groupes de puissances, ou la révolution prolétarienne. » ([30] [1758])
Le BIPR n'est pas assez conscient de ce que signifierait une 3e guerre mondiale: purement et simplement l'anéantissement complet de la planéte. Même aujourd'hui oú la chute de 1’URSS et la disparition postérieure du bloc occidental rendent difficile la reconstitution de nouveaux blocs, les risques de destruction de l'humanité sous la forme d'une succession chaotique de guerres locales continuent à être trés graves.
Le degré de putréfaction du capitalisme, la gravité de ses contradictions ont atteint un tel niveau que dans ces conditions une 3e guerre mondiale conduirait à la destruction de l’humanité.
C'est une rêverie grossière, un jeu ridicule avec des schémas et des « théories » qui ne répondent pas à la réalité historique, que de supposer qu'aprés une 3e guerre mondiale puisse apparaître « un capitalisme monopo-liste concentré en un petit nombre de puissances ». C'est de la science-fiction... mais ancrée lamentablement dans des phénoménes de la fin du siécle dernier.
Le débat entre les révolutionnaires doit partir du niveau le plus élevé atteint par l'ancien parti, 1’Internationale communiste qui a dit trés clairement à la fin de la 1e Guerre mondiale: « Les contradictions du régime capitaliste se révélérent b l'humanité à la suite de la guerre, sous forme de souffrances physiques.- la faim, le froid, les maladies épidemiques et une recrudescence de barbarie. Ainsi est jugée sans appel la vieille que-relle académique des socialistes sur la théorie de la paupérisation et du passage progressif du capitalisme au socialisme. (..) Maintenant ce n'est pas seulement la paupérisation sociale, mais un appauvrissement physiologique, biologique, qui se présente à nous dans toute sa réalité hideuse. » ([31] [1759])
La fin de la 2e guerre mondiale a confirmé, en allant beaucoup plus loin, cette analyse cruciale de l’IC. Depuis lors, la vie capitaliste, dans la « paix » comme dans la guerre, a aggravé les tendances que les révolutionnaires avaient prédites, à des niveaux qu'ils ne pouvaient imaginer à l'origine. A quoi bon jouer avec des hypothéses ridicules sur un « capitalisme monopoliste » aprés une 3e guerre mondiale ? L'alternative n'est pas « révolution prolétaienne ou guerre pour accoucher d'un capitalisme monopoliste », mais révolution prolétarienne ou destruction de 1’humanité.
Adalen, 1/9/94.
[1] [1760] Voir Revue Internationale n° 77 et 78, « Le rejet de la notion de décadence », Polémique avec Programme communiste.
[2] [1761] Le Partito Comunista Intemazionalista (PCInt) publie le journal Battaglia Comunista (BC) et la revue théorique Prometeo. La Communist Workers'Organisation (CWO) publie le journal Workers'Voice. La Communist Review est publiée conjointement par ces deux organisations et contient des articles du BIPR comme tel ainsi que des traductions d'articles de Prometeo.
[3] [1762] Crise du capitalisme et perspectives du BIPR, dans la Communist Review n° 4, automne 1985.
[4] [1763] Communist Review, n° 1, « Crise et impérialisme ».
[5] [1764] Internationalisme n° 46, organe de la GCF, été 1952.
[6] [1765] La décadence du capitalisme, brochure du CCI.
[7] [1766] Voir « La crise en RDA », Revue Internationale n° 22, 3e trimestre 1980, « La crise dans les pays de 1’Est », n° 23.
[8] [1767] En 1988, lorsque le chaos et la failite de l'économie soviétique étaient d'une évidence criante, le BIPR disait que « dans les années 1970 les taux de croissance de la Russie étaient encore le double de ceux de l'occident et égaux à ceux du Japon. Y compris dans la crise des débuts des années 1980 le taux de croissance russe était de 2-3 % plus important que celui de n'importe quelle puissance occidentale. Dans ces années, la Russie avait atteint largement la capacité militaire des Etats-Unis, avait dépassé sa technologie spatiale et pouvait engager les plus grands projets de construction depuis 1945. .v (Communist Review, n° 6)
[9] [1768] Revue Internationale n° 69, 2e trimestre 1992, 3e partie de la série « Bilan de 70 années de 'libération nationale' ».
[10] [1769] Il suffit de souligner l'importance qu'a en Chine le travail forcé pratiquement gratuit des prisonniers. Une étude d'Asian-Watch (organisation américaine de « défense des droits de l'homme ») a révélé l'existence de ces goulags chinois qui emploient 20 millions de travailleurs. Dans ces « camps de ré-éducation » sont effectués les travaux sous contrat pour les entreprises occidentales (françaises, américaines, etc.). Les défauts de qualité que détectent les contractants occidentaux sont immédiatement répercutés aux prisionnier responsable de l' « erreur » par des châtiments brutaux devant tous ses camarades.
[11] [1770] Revue internationale n° 23, « La lutte du prolétariat dans la décadence du capitalisme ».
[12] [1771] La décadence du capitalisme, brochure du CCI.
[13] [1772] Idem.
[14] [1773] Revue Internationale n° 59, 4e trimestre 1989, « La situation internationale ».
[15] [1774] Prometeo n° 6, « Les Etats-Unis et la domination du monde ».
[16] [1775] BC, lancé dans la
spéculation de sa théorie de « la lutte pour le partage de la rente
financière », se met sur un terrain dangereux en affirmant que celle-ci « étant une forme d'appropriation parasitaire,
le contrôle de la rente exclut la possibilité de la redistribution de la
richesse entre les différentes catégories et classes sociales par la croissance
de la production et la circulation de marchandises. » Depuis quand la
croissance de la production et de la distribution de marchandises tend à
redistribuer la richesse sociale ? Comme marxistes, nous avions compris que la
croissance de la production capitaliste tend à « redistribuer » la
richesse au bénéfice des capitalistes et au détriment des ouvriers. Mais BC
découvre le contraire en tombant sur le terrain de la gauche du capital et des
syndicats qui demande des investissements « pour qu'il y ait du travail et du bien-être ». Face à une
telle « théorie », il faudrait rappeler ce que disait Marx au citoyen
Weston dans Salaire, prix et profit: « Ainsi le citoyen Weston oublie-t-il
que cette soupière, oú les travailleurs mangent, est emplie du produit tout
entier du travail national : que ce qui les empêche d’y puiser davantage, ce n'est
point l'étroitesse de la soupière, ce n'est point l'insuffisance de son
contenu, c'est seulement la petitesse de leurs cuillers ». (Chapitre 1,
« Salaire, prix et monnaie »,
La Pléiade).
[17] [1776] Prometeo n° 6, décembre 1993, « Les Etats-Unis et la domination du monde ».
[18] [1777] « Crise et impérialisme », Revue Communiste n° 1.
[19] [1778] cf. Revue internationale n° 36, « La vision de BC sur le cours historique ».
[20] [1779] Chap. 32.
[21] [1780] Manifeste du 2° Congrés de l’Intemationale communiste.
[22] [1781] Prometeo n° 6, décembre 1993, « Les Etats-Unis et la domination du monde ».
[23] [1782] Battaglia comunista n° 10 (octobre 93).
[24] [1783] 2e Conférence des groupes de la Gauche communiste, Textes préparatoires volume 1, « Sur la théorie des crises en général », contribution du PCInt-BC, voir la citation.
[25] [1784] De manière explicite, les camarades identifient le capitalisme décadent avec le « capitalisme des monopoles » : « C'est précisément dans cette phase historique que le capitalisme entre dans sa phase décadente. La libre concurrence aiguisée par la chute du taux de profit, crée son contraire, le monopole, qui est la forme d'organisation que le capitalisme se donne pour contenir la menace d'une chute ultérieure du profit» (2e Conférence internationale, texte cité). Les monopoles survivent dans décadence mais n'en constituent pas, loin de là, l'essentiel. Cette vision est trés liée à la théorie de l'impérialisme et à l'insistance de BC sur le « partage de la rente financière ». II doit être clair que cette théorie rend difficile la compréhension à fond de la tendance universelle (pas seulement dans les pays staliniens) au capitalisme d'Etat.
[26] [1785] « La lutte du prolétariat dans le capitalisme décadent », Revue internationale n° 23.
[27] [1786] L'accumulation du capital, Chap. 1.
[28] [1787] « Notre réponse » [à Vercesi], texte de la Gauche communiste de France, publié dans le Bulletin international de discussion, Fraction italienne de la Gauche communiste, n° 5, mai 1944.
[29] [1788] L'accumulation du capital, Chap. 31.
[30] [1789] Revue Communiste n°1, « Crise et impérialisme ».
[31] [1790] « Manifeste de l’Internationale Communiste » 1° congrès de l’IC, mars 1919.
Courants politiques:
- TCI / BIPR [137]
Approfondir:
Questions théoriques:
- Décadence [32]
Heritage de la Gauche Communiste:
Le communisme n'est pas un bel idéal, mais une nécessite matérielle [10e partie]
- 4471 reads
Anarchisme ou communisme
Dans le dernier article de cette série, nous avons examiné le combat qu'a mené, dans l'Association internationale des travailleurs (AIT), la tendance marxiste contre les idéologies réformistes et «socialistes d'Etat» au sein du mouvement ouvrier, notamment dans le parti allemand. Pourtant, selon le courant anarchiste ou « antiautoritaire » de Mikhaïl Bakounine, Marx et Engels auraient incarné et inspiré la tendance socialiste d'Etat, et étaient les instigateurs les plus en vue de ce «socialisme allemand » qui avait pour but non pas de remplacer le capitalisme par une société libre et sans Etat, mais par une terrible tyrannie bureaucratique dont ils seraient eux-mêmes les gardiens. Jusqu'à aujourd'hui, les anarchistes de même que les libéraux présentent les critiques de Bakounine à Marx comme l'expression d'une profonde perspicacité sur la véritable nature du marxisme, comme une explication prophétique des raisons pour lesquelles les théories de Marx conduiraient inévitablement aux pratiques de Staline.
Mais, comme nous tenterons de le montrer dans cet article, la « critique radicale » du marxisme par Bakounine, comme toutes les critiques ultérieures, n'est radicale qu'en apparence. La réponse que Marx et son courant apportèrent à ce pseudo-radicalisme, allait nécessairement de pair avec la lutte contre le réformisme, car les deux idéologies représentaient la pénétration, dans les rangs du prolétariat, de points de |vue étrangers à la classe.
Le noyau petit-bourgeois de l'anarchisme
Le développement de l'anarchisme dans la seconde moitié du 19e siècle était le produit de la résistance des couches petites-bourgeoises -artisans, commerçants, petits paysans- à la marche triomphante du capital, résistance au processus de prolétarisation qui les privait de leur « indépendance » sociale passée. Plus fort dans les pays où le capital industriel s'est développé tardivement, à la périphérie orientale et méridionale de l'Europe, il exprimait à la fois la rébellion de ces couches contre le capitalisme, et leur incapacité à voir plus loin que celui-ci, vers le futur communiste ; au contraire, il énonçait leur désir de retour à un passé semi-mythique de communautés locales libres et de producteurs strictement indépendants, débarrassés de l'oppression du capital industriel et de l'Etat bourgeois centralisé.
Le «père» de l'anarchisme, Pierre-Joseph Proudhon, était l'incarnation classique de cette attitude, avec sa haine féroce non seulement envers l'Etat et les grands capitalistes, mais envers le collectivisme sous toutes ses formes, y compris envers les syndicats, les grèves et les expressions similaires de la collectivité de la classe ouvrière. A l'encontre de toutes les tendances profondes qui se développaient au sein de la société capitaliste, l'idéal de Proudhon était une société « mutualiste », fondée sur la production artisanale individuelle, liée par le libre-échange et le libre-crédit.
Marx avait déjà démoli les vues de Proudhon dans son livre Misère de la à Philosophie, publié en 1847, et l'évolution du capital lui-même, dans la seconde partie du siècle, avait fait la démonstration pratique de l'obsolescence des idées de Proudhon. Pour « l'ouvrier de masse» de l'industrie capitaliste, il était de plus en plus évident que, pour résister à l'exploitation capitaliste et l'abolir tout à la fois, seules une lutte collective et une appropriation collective des moyens de production pouvaient offrir un espoir.
Face à cela, le courant bakouniniste qui, à partir de 1860, a tenté de combiner « l'anti-autoritarisme » de Proudhon avec une approche collectiviste et même communiste des questions sociales, semble clairement constituer une avancée par rapport au Proudhonisme classique. Bakounine a même écrit à Marx pour exprimer son admiration vis-à-vis de son travail scientifique, déclarant être son disciple et lui offrant de traduire Le capital en russe. Et cependant, malgré son retard idéologique, le courant proudhonien avait, à certains moments, joué un rôle constructif dans la formation du mouvement ouvrier : Proudhon avait été un facteur de l'évolution de Marx vers le communisme dans les années 1840, et les proudhoniens avaient participé à la fondation de TAIT. L'histoire du Bakouninisme, au contraire, est quasiment entièrement une chronique du travail négatif et destructeur qu'il a mené contre l'Internationale. Même l'admiration que Bakounine professait envers Marx, faisait partie de ce syndrome : Bakounine confessait lui-même que « c'est également par tactique, par politique personnelle que j'ai tant honoré et loué Marx », son but ultime étant de briser la « phalange » marxiste qui dominait l'Internationale ([1] [1791]).
La raison essentielle en est que, tandis que le Proudhonisme précédait le marxisme, et les groupes proudhoniens la 1ère Première Internationale, le bakouninisme s'est développé, dans une large mesure, en réaction au marxisme et contre le développement d'une organisation prolétarienne internationale centralisée.
Dans le morceau suivant Marx et Engels expliquent cette évolution en se référant au problème général des « sectes », mais ce sont surtout les bakouninistes qui sont visés, puisque le passage vient du texte « Les prétendues scissions dans l'Internationale » (1872) qui était une réponse du Conseil général aux intrigues de Bakounine contre l'AIT :
« La première phase dans la lutte du prolétariat contre la bourgeoisie est marquée par le mouvement sectaire. Il a sa raison d'être à une époque où le prolétariat n'est pas encore assez développé pour agir comme classe. Des penseurs individuels font la critique des antagonismes sociaux, et en donnent des solutions fantastiques que la masse des ouvriers n'a qu'à accepter, à propager, et à mettre en pratique. Par leur nature même, les sectes formées par ces initiateurs sont abstentionnistes, étrangères à toute action réelle, à la politique, aux grèves, aux coalitions, en un mot à tout mouvement d'ensemble...Ces sectes, leviers du mouvement à leur origine, lui font obstacle dès qu'il les dépasse. » ([2] [1792])
L'organisation prolétarienne contre les intrigues de la petite-bourgeoisie
Le principal enjeu de la lutte entre marxistes et bakouninistes était l'Internationale elle-même : rien ne démontre plus clairement l'essence petite-bourgeoise de l'anarchisme que son approche de la question organisationnelle, et ce n'est pas un hasard si la question qui a mené à la scission ouverte entre les deux courants, n'a pas été un débat abstrait sur la société future, mais a porté sur le fonctionnement de l'organisation prolétarienne, son mode d'opération interne. Mais, comme nous le verrons, ces différences organisationnelles étaient également liées à des visions différentes de la société future et des moyens de la créer.
A partir du moment où ils ont rejoint l'Internationale, à la fin des années 1860, mais surtout dans la période qui a suivi la défaite de la Commune, les bakouninistes ont crié haro sur le rôle du Conseil général, organe central de l'Internationale qui se trouvait à Londres et était donc fortement influencé par Marx et Engels. Pour Bakounine, le Conseil général n'était qu'une simple couverture pour Marx et « sa coterie » ; il se présenta donc comme le champion de la liberté et de l'autonomie des sections locales contre les prétentions tyranniques des « socialistes allemands ». Cette campagne fut liée à dessein à la question de la société future, puisque les bakouninistes défendaient que l'Internationale elle-même devait constituer l'embryon du nouveau monde, le précurseur de la fédération décentralisée des communes autonomes. Dans cette même perspective, la domination autoritaire des marxistes dans l'Internationale exprimait la vision qu'auraient ces derniers du futur : une nouvelle bureaucratie d'Etat traitant les ouvriers avec arrogance au nom du socialisme.
Il est parfaitement vrai que l'organisation prolétarienne, aussi bien pour ce qui est de son fonctionnement interne que pour sa fonction externe, est déterminée par la nature de la société communiste pour laquelle elle combat, ainsi que par la classe qui est porteuse de cette société. Mais contrairement à la vision anarchiste, le prolétariat n'a rien à craindre de la centralisation en soi : le communisme est effectivement la centralisation des capacités productives mondiales qui remplace l'anarchie de la concurrence capitaliste. Et afin d'atteindre cette étape, le prolétariat doit centraliser ses propres forces combattantes pour renverser un ennemi qui a souvent montré sa capacité à s'unir contre lui. C'est pourquoi les marxistes ont répondu aux sarcasmes de Bakounine en soulignant que son programme d'autonomie locale complète des sections signifiait la fin de l'Internationale en tant que corps uni. En tant qu'organisation de l'avant-garde prolétarienne, en tant qu' « organisation réelle et militante de la classe prolétaire dans tous les pays, unie dans la lutte commune contre les capitalistes, les propriétaires fonciers et leur pouvoir de classe organisé dans l'Etat » ([3] [1793]), l'Internationale ne pouvait parler de 100 voix différentes : elle devait être capable de formuler les buts de la classe ouvrière de façon claire et sans ambiguïté. Et pour qu'elle puisse le faire, l'Internationale avait besoin d'organes centraux effectifs - pas de façade, dissimulant les ambitions de dictateurs et de carriéristes ; de corps élus et rendant des comptes, chargés de maintenir l'unité de l'organisation entre ses Congrès.
De leur côté, les bakouninistes voulaient réduire le Conseil général à « un simple bureau de correspondance et de statistique. Ses fonctions administratives cessant, ses correspondances se réduiraient nécessairement à la reproduction des renseignements déjà publiés dans les journaux de l'Association. Le bureau de correspondance serait donc éludé. Quant à la statistique, c'est un travail irréalisable sans une puissante organisation, et surtout, comme le disent expressément les statuts originaux, sans une direction commune. Or, comme tout cela sent fortement "l'autoritarisme", il y aura peut-être un bureau, mais certainement pas de statistique. En un mot, le Conseil général disparaît. La même logique frappe conseils fédéraux, comités locaux et autres centres "autoritaires". Restent seules les sections autonomes. » ([4] [1794])
Plus loin dans le même texte, Marx et Engels argumentent que si l'anarchie voulait simplement dire le but ultime du mouvement de la classe - l'abolition des classes sociales et donc de l'Etat qui est le garant des divisions de classes - alors tous les socialistes étaient pour. Mais le courant de Bakounine y mettait autre chose dans sa pratique, puisqu'il proclamait « l'anarchie dans les rangs prolétaires comme le moyen le plus infaillible de briser la puissante concentration des forces sociales et politiques entre les mains des exploiteurs. Sous ce prétexte, elle demande à l'Internationale, au moment où le vieux monde cherche à l'écraser, de remplacer son organisation par l'anarchie. La police internationale ne demande rien de plus pour éterniser la république-Thiers, en la couvrant du manteau impérial ». ([5] [1795])
Mais dans le projet de Bakounine, il y avait bien plus qu'une opposition abstraite à toute forme d'autorité et de centralisation. En fait, ce à quoi s'opposait Bakounine avant tout, c'était à « l'autorité » de Marx et de son courant ; et ses tirades contre leur soi-disant propension aux manoeuvres secrètes et au complot étaient fondamentalement une projection de sa propre conception profondément hiérarchique et élitiste de l'organisation. Sa bataille contre le Conseil général était motivée en réalité par sa détermination à établir un centre de pouvoir alternatif, caché.
Quand Marx et Engels évoquaient l'histoire des organisations « sectaires », ils ne se référaient pas seulement aux idées utopiques floues qui ont souvent caractérisé de tels groupes, mais également à leurs pratiques politiques et à leur fonctionnement, hérités des sociétés secrètes bourgeoises et petites-bourgeoises, avec leurs traditions clandestines, leurs serments et autres rituels occultes, parfois combinés à une propension au terrorisme et à l'assassinat. Comme on l’a vu dans un précédent article ce cette série ([6] [1796]), la formation de la Ligue des Communistes en 1847 avait déjà marqué une rupture définitive avec ces traditions. Mais Bakounine était imprégné de ces pratiques et ne les a jamais abandonnées. Tout au long de sa carrière politique, il a toujours eu pour politique de former des groupes secrets directement sous son contrôle, plus fondés sur les « affinités » personnelles que sur tout autre critère politique, et il utilisait ces réseaux secrets d'influence pour gagner de l'hégémonie dans les organisations plus grandes.
N'ayant pas réussi à transformer la Ligue de la paix et de la liberté en sa propre version d'organisation socialiste, Bakounine forma l'Alliance de la démocratie socialiste en 1868. Elle avait des branches à Barcelone, Madrid, Lyon, Marseille, Naples et en Sicile ; la principale section se trouvait à Genève avec un Bureau central sous le contrôle personnel de Bakounine. L'aspect « socialiste » de l'Alliance était très vague et confus, définissant son but comme « l'égalisation sociale et économique des classes » (plutôt que leur abolition), et elle était fixée, de façon obsessionnelle, sur « l'abolition du droit d'héritage » comme clé du dépassement de la propriété privée.
Peu après sa formation, l'Alliance a posé sa candidature à l'Internationale. Le Conseil général a critiqué les confusions de son programme et insisté sur le fait qu'elle ne pouvait être admise dans l'Internationale comme organisation internationale parallèle ; elle devait se dissoudre et faire de chacune de ses sections, des sections de l'Internationale.
Bakounine était tout à fait d'accord avec ces termes pour la simple raison que l'Alliance n'était, pour lui, que la façade d'un dédale de plus en plus ésotérique de sociétés secrètes, certaines fictives et d'autres réelles ; d'une hiérarchie byzantine qui n'avait finalement à répondre que devant le « citoyen B. » lui-même. L'histoire complète des sociétés secrètes de Bakounine reste encore à découvrir, mais il est certain que, derrière l'Alliance (qui de toutes façons ne fut pas réellement dissoute lors de son entrée dans l'AIT), la « Fraternité Internationale » constituait un cercle interne qui avait déjà opéré dans la Ligue de la Paix et la Liberté. Il existait aussi une vague «Fraternité Nationale» à mi-chemin entre l'Alliance et la «Fraternité Internationale». Il peut y en avoir eu d'autres. La question est que de telles formations traduisent un mode de fonctionnement entièrement étranger au prolétariat. Là où les organisations prolétariennes fonctionnent à travers des organes centraux élus, rendant des comptes, la hiérarchie compliquée de Bakounine n'était redevable devant personne d'autre que lui-même. Là où les organisations prolétariennes, même lorsqu'elles doivent agir dans la clandestinité, sont fondamentalement ouvertes à leurs camarades, Bakounine traite les membres de niveau « moyen » de son organisation comme de simples fantassins qu'on manipule à volonté, et qui sont inconscients des buts qu'ils servent réellement.
Il n'est donc pas surprenant que cette conception élitiste des rapports au sein de l'organisation prolétarienne se trouve reproduite dans la vision de Bakounine de la fonction de l'organisation révolutionnaire dans l'ensemble de la classe. La polémique du Conseil général contre les bakouninistes, «L'Alliance de la Démocratie Socialiste et l'AIT », rédigée en 1873, met en évidence les perles suivantes dans les écrits de Bakounine :
« Il est nécessaire qu'au milieu de l'anarchie populaire qui constituera la vie même et toute l'énergie de la révolution, l'unité de la pensée et de l'action révolutionnaire se trouve un organe. Cet organe doit être l'association secrète et universelle des frères internationaux. » ([7] [1797]) Admettant que les révolutions ne puissent être faites par des individus ou des sociétés secrètes, ces derniers ont la tâche d'organiser « non l'armée de la révolution - l'armée doit toujours être le peuple - mais un état-major révolutionnaire composé d'individus dévoués, énergiques, intelligents et surtout amis sincères et non ambitieux ni vaniteux, du peuple, capables de servir d'intermédiaires entre l'idée révolutionnaire et les instincts populaires. Le nombre de ces individus ne doit donc pas être immense. Pour l'organisation internationale dans toute l'Europe, cent révolutionnaires sérieusement et fortement alliés suffisent... » ([8] [1798])
Marx et Engels qui ont écrit le texte en collaboration avec Paul Lafargue, font les commentaires suivants :
«Ainsi donc, tout se transforme. L'anarchie, la "vie populaire déchaînée, les mauvaises passions" et le reste ne suffisent plus. Pour assurer le succès de la révolution, il faut l'unité de la pensée et de l'action. Les Internationaux tâchent de créer cette unité par la propagande, par la discussion, et l'organisation publique du prolétariat, à Bakounine, il ne faut qu'une organisation secrète de cent hommes, représentants privilégiés de l'idée révolutionnaire, état-major en disponibilité de la révolution nommée par lui-même et commandée par le permanent "citoyen B.". L'unité de la pensée et de l'action ne veulent dire autre chose qu'orthodoxie et obéissance aveugle...Nous sommes en pleine Compagnie de Jésus. » ([9] [1799])
La haine véritable de Bakounine envers l'exploitation et l'oppression capitalistes n'est pas en question. Mais les activités dans lesquelles il s'engageait, étaient profondément dangereuses pour le mouvement ouvrier. Incapable d'arracher le contrôle de l'Internationale, il était réduit à un travail de sabotage et de désorganisation, à provoquer des querelles internes interminables qui ne pouvaient qu'affaiblir l'Internationale. Son penchant pour la conspiration et la phraséologie assoiffée de sang a fait de lui le dupe spontané d'un élément ouvertement pathologique comme Netchaïev dont les actes criminels ont menacé de porter le discrédit sur l'Internationale tout entière.
Ces dangers furent amplifiés dans la période qui suivit la Commune, lorsque le mouvement prolétarien était en plein désarroi et que la bourgeoisie, convaincue que l'Internationale avait « créé » le soulèvement des ouvriers de Paris, persécutait partout ses membres et cherchait à détruire l'organisation. L'Internationale, dirigée par le Conseil général, devait réagir très fermement aux intrigues de Bakounine, affirmant le principe d'une organisation ouverte en opposition à celui du secret et de la conspiration : « Contre toutes ces intrigues, il n'y a qu'un seul moyen, mais il est d'une efficacité foudroyante ; c'est la plus complète publicité. Dévoiler ces menées dans leur ensemble, c'est les rendre impuissantes. » ([10] [1800])
Le Conseil a aussi appelé et obtenu, au Congrès de La Haye en 1872, l'expulsion de Bakounine et de son associé Guillaume - non à cause des nombreuses différences idéologiques qui existaient sans aucun doute, mais à cause de leurs pratiques politiques qui mettaient en danger l'existence même de l'Internationale.
En fait, la lutte pour la préservation de l'Internationale avait, à ce moment-là, plus une signification historique qu'immédiate. Les forces de la contre-révolution donnaient le ton, et les intrigues de Bakounine ne faisaient qu'accélérer un processus de fragmentation qu'imposaient les conditions générales auxquelles la classe était confrontée. Dans la mesure où ils étaient conscients de ces conditions défavorables, les marxistes considéraient qu'il valait mieux que l'Internationale soit (au moins temporairement) démantelée que de tomber aux mains de courants politiques qui auraient sapé son but essentiel et fait tomber dans le discrédit jusqu'à son nom même. C'est pourquoi -toujours au Congrès de La Haye - Marx et Engels demandèrent que le Conseil général soit transféré à New York. C'était la fin effective de l'Internationale, mais lorsque le renouveau de la lutte de classe permit la formation de la deuxième Internationale, presque 20 ans après, ce devait être sur une base politique bien plus claire.
Le matérialisme historique contre l'idéalisme a-historique
De façon immédiate, la question organisationnelle était au coeur de la scission dans l'Internationale. Mais intimement liées aux divergences entre marxistes et anarchistes sur l'organisation, il existait toute une série de questions théoriques plus générales qui, elles aussi, révélaient les origines de classe différentes de ces deux points de vue.
Au niveau le plus «abstrait», Bakounine, malgré ses déclarations sur le matérialisme contre l'idéalisme, rejetait ouvertement la méthode matérialiste historique de Marx. Le point de départ était la question de l'Etat. Dans un texte rédigé en 1872, Bakounine établit tout à fait ouvertement les divergences :
« ...les sociologues de l'école de M. Marx, tels que M. Engels vivant, tels que feu Lassalle, par exemple, m'objecteront que l'Etat ne fut point la cause de cette misère, de cette dégradation et de cette servitude des masses ; que la situation misérable des masses, aussi bien que la puissance despotique de l'Etat, furent au contraire, l'une et l'autre, les effets d'une cause plus générale, les produits d'une phase inévitable dans le développement économique de la société, d'une phase qui, au point de vue de l'histoire, constitue un véritable progrès, un pas immense vers ce qu'ils appellent, eux, la révolution sociale. » ([11] [1801])
De son côté, Bakounine défend non seulement la vision que l'Etat est la « cause » de la souffrance des masses, et son abolition immédiate la pré-condition de leur délivrance : il rejette aussi logiquement la vision matérialiste de l'histoire qui considère que le communisme n'est possible que comme résultat de toute une série de développements dans l'organisation sociale et les capacités productives de l'homme développements qui incluent la dissolution des communautés humaines originelles, ainsi que la montée et la chute d'une succession de sociétés de classe. En opposition à cette approche scientifique, Bakounine y substitue une approche morale :
« Matérialistes et déterministes, comme M. Marx lui-même, nous aussi nous reconnaissons l'enchaînement fatal des faits économiques et politiques dans l'histoire. Nous reconnaissons bien la nécessité, le caractère inévitable de tous les événements qui se passent, mais nous ne nous inclinons pas indifféremment devant eux, et surtout nous nous gardons bien de les louer et de les admirer lorsque, par leur nature, ils se montrent en opposition flagrante avec le but suprême de l'histoire, avec l'idéal foncièrement humain qu'on retrouve, sous des formes plus ou moins manifestes, dans les instincts, dans les aspirations populaires et sous les symboles religieux de toutes les époques, parce qu'il est inhérent à la race humaine, la plus sociable de toutes les races animales sur la terre. Ce but, cet idéal, aujourd'hui mieux conçus que jamais, peuvent se résumer en ces mots : c'est le triomphe de l'humanité, c'est la conquête et l'accomplissement de la pleine liberté et du plein développement matériel, intellectuel et moral de chacun, par l'organisation absolument spontanée et libre de la solidarité économique et sociale aussi complète que possible de tous les êtres humains vivant sur la terre. Maintenant, tout ce qui dans l'histoire se montre conforme à ce but, du point de vue humain - et nous ne pouvons pas en avoir d'autre - est bon ; tout ce qui lui est contraire est mauvais. » ([12] [1802])
II est vrai, comme nous l'avons en fait montré dans cette série d'articles, que « l'idéal » du communisme est apparu dans les luttes des opprimés et des exploités tout au long de l'histoire, et que cette lutte correspond aux besoins les plus fondamentaux de l'homme. Mais le marxisme a démontré pourquoi, jusqu'à l'époque capitaliste, de telles aspirations étaient condamnées à rester un idéal ; pourquoi, par exemple, non seulement les rêves communistes de la révolte des esclaves de Spartacus, mais aussi la nouvelle forme féodale d'exploitation qui sortait la société de l'impasse de l'esclavage, constituaient des moments nécessaires de l'évolution des conditions qui font du communisme une possibilité réelle aujourd'hui. Pour Bakounine, cependant, alors que les premiers peuvent être considérés comme « bons », la seconde ne pouvait être considérée que comme « mauvaise », Aussi argumente-t-il, dans le texte qu'on vient de citer, que, tandis que la « liberté comparativement si hautement humaine » dans la Grèce antique était bonne, la conquête ultérieure de la Grèce par les romains plus barbares était mauvaise, et ainsi de suite à travers les siècles.
A partir de là, il devient impossible de juger si une formation sociale ou une classe sociale joue un rôle progressif ou régressif dans le processus historique ; à la place, tout est mesuré en fonction d'un idéal abstrait, d'un absolu moral qui reste inchangé tout au long de l'histoire.
Aux marges du mouvement révolutionnaire aujourd'hui, il y a nombre de courants « modernistes » qui se sont spécialisés dans le rejet de la notion de décadence du capitalisme : les plus cohérents de ceux-ci (comme le Groupe Communiste Internationaliste, ou le groupe Wildcat au Royaume Uni) en sont arrivés à rejeter la conception marxiste de progrès, puisque argumenter qu'un système social est en déclin, signifie évidemment qu'il a été en ascendance à un moment. Ils concluent que le progrès est une notion complètement bourgeoise et que le communisme était possible à n'importe quel moment de l'histoire.
Il s'avère que ces modernistes ne sont pas si modernes après tout : ils sont de fidèles épigones de Bakounine qui a également été amené à rejeter l'idée de progrès et disait que la révolution sociale était possible à n'importe quel moment. Dans son travail de base, Etatisme et Anarchie (1873), Bakounine développe que les deux conditions essentielles d'une révolution sociale sont : la souffrance poussée à l'extrême, presqu'au point du désespoir, et l'inspiration d'un « idéal universel ». C'est pourquoi, dans le même passage, il affirme que l'Italie constitue le lieu le plus mûr pour une révolution sociale, en opposition aux pays industriellement plus développés où les ouvriers sont « relativement nombreux » et « si imprégnés de divers préjugés bourgeois qu'ils ne diffèrent pas de la bourgeoisie, sauf par le revenu ».
Mais le « prolétariat » révolutionnaire italien de Bakounine consiste en « deux ou trois millions d'ouvriers des villes, principalement dans les usines et les petits ateliers, et approximativement vingt millions de paysans totalement dépossédés ». En d'autres termes, le prolétariat de Bakounine est en fait un nouveau nom pour la notion bourgeoise de « peuple » - tous ceux qui souffrent, quelle que soit leur place dans les rapports de production, quelle que soit leur capacité à s'organiser, à devenir conscients d'eux-mêmes en tant que force sociale. En fait, Bakounine chante ailleurs les louanges du potentiel révolutionnaire des peuples slaves ou latins (en opposition aux allemands vis-à-vis desquels Bakounine a gardé une haine chauvine toute sa vie durant) ; il défend même, comme le note le Conseil général dans le texte « L'Alliance de la démocratie socialiste et l'AIT », que « le brigand, en Russie, est le véritable et l'unique révolutionnaire. »
Tout cela est totalement cohérent avec le rejet du matérialisme par Bakounine : si la révolution sociale est possible à tout moment, alors n'importe quelle force opprimée peut la réaliser, les brigands ou les paysans. En fait non seulement la classe ouvrière dans son sens marxiste n'a pas de rôle particulier à jouer dans ce processus, mais encore Bakounine se répand en injures contre les marxistes parce qu'ils affirment que la classe ouvrière doit exercer sa dictature sur la société :
« Si le prolétariat devient la classe dominante, qui, demandera-t-on, dominera-t-il ? C'est donc qu'il restera encore une classe soumise à cette nouvelle classe régnante, à cet Etat nouveau, ne fût-ce, par exemple, que la plèbe des campagnes qui, on le sait, n'est pas en faveur chez les marxistes et qui, située au plus bas degré de la civilisation, sera probablement dirigée par le prolétariat des villes et des fabriques. » ([13] [1803])
Ce n'est pas le lieu ici de traiter la question des rapports entre la classe ouvrière et la paysannerie dans la révolution communiste. Il suffit de dire que la classe ouvrière n'a aucun intérêt à établir un nouveau système d'exploitation après avoir renversé la bourgeoisie. Mais, ce que les peurs de Bakounine révèlent, c'est précisément le fait qu'il n'aborde pas la question du point de vue du prolétariat, mais ce celui des « opprimés en général » - du point de vue de la petite-bourgeoise, pour être précis.
Incapable de saisir que le prolétariat est la classe révolutionnaire dans la société, non seulement parce qu'il souffre mais aussi parce qu'il contient en lui-même les germes d'une organisation sociale nouvelle et plus avancée, Bakounine n'est pas non plus capable d'envisager la révolution autrement que comme un «grand feu de joie », un épanchement de « mauvaises passions », un acte de destruction et non de création :
« Une insurrection populaire, par sa nature même, est instinctive, chaotique et destructrice... les masses sont toujours prêtes à se sacrifier, et ceci les transforme en une horde sauvage et brutale, capable de réaliser des exploits héroïques et apparemment impossibles...Cette passion négative, c'est vraie, est loin d'être suffisante pour atteindre le niveau élevé de la cause révolutionnaire ; mais sans elle, la révolution serait impossible. La révolution requiert une destruction étendue et générale, une destruction féconde et rénovatrice, car c'est par cette voie et uniquement par elle que naissent de nouveaux mondes ». ([14] [1804])
De tels passages confirment non seulement que Bakounine a, de façon générale, une vision non prolétarienne ; mais ils nous permettent aussi de comprendre pourquoi il n'a jamais rompu avec une vision élitiste du rôle de l'organisation révolutionnaire. Tandis que, pour le marxisme, l'avant-garde révolutionnaire est le produit d'une classe devenant consciente d'elle-même, pour Bakounine les masses populaires ne peuvent jamais aller au-delà du niveau de la rébellion instinctive et chaotique : en conséquence, s'il faut réaliser plus que cela, cela nécessite le travail d'un « quartier général» qui agit derrière la scène. Bref, c'est la vieille notion idéaliste du Saint-Esprit qui descend sur quelque chose d'inconscient. Les anarchistes qui ne manquent jamais d'attaquer la mauvaise formulation de Lénine sur la conscience révolutionnaire introduite dans le prolétariat de l'extérieur, sont curieusement silencieux sur la version bakouniniste de la même notion...
La lutte politique contre l’indifférentisme politique
En lien étroit avec la question organisationnelle, l'autre grand point de dispute entre les marxistes et les anarchistes était la question de la « politique ». Le Congrès de La Haye fut un champ de bataille sur cette question : la victoire du courant marxiste (soutenu à cette occasion par les Blanquistes) a été formulée dans une résolution qui disait « le prolétariat ne peut agir en tant que classe qu'en se constituant en parti politique distinct, opposé à tous les vieux partis formés par les classes possédantes » et que « la conquête du pouvoir politique devient le grand devoir du prolétariat » dans la lutte pour son émancipation.
Cette discussion contenait deux dimensions. La première fait écho à la question de la nécessité matérielle. Puisque pour Bakounine, la révolution était possible à tout moment, toute lutte pour des réformes constituait fondamentalement une diversion par rapport à cette grande fin ; et si cette lutte allait au-delà de la sphère strictement économique (que les Bakouninistes acceptaient à contrecoeur sans jamais en comprendre vraiment la signification), sur le terrain de la politique bourgeoise -du parlement, des élections, des campagnes pour changer les lois - elle ne pouvait signifier autre chose qu'une capitulation face à la bourgeoisie. Aussi, selon Bakounine, « l'Alliance, prenant le programme de l'Internationale au sérieux, avait repoussé avec dédain toute transaction avec la politique bourgeoise, si radicale qu'elle se dise et si socialiste qu'elle se grime, recommandant au prolétariat comme la seule voie d'une émancipation réelle, comme la seule politique pour lui vraiment salutaire, la politique exclusivement négative de la démolition des institutions politiques, du pouvoir politique, du gouvernement en général, de l'Etat... » ([15] [1805])
Derrière ces phrases hautement radicales, gît l'incapacité des anarchistes à saisir que la révolution prolétarienne, la lutte directe pour le communisme, n'était pas encore à l'ordre du jour parce que le système capitaliste n'avait pas encore épuisé sa mission historique, et que le prolétariat était face à la nécessité de se consolider comme classe, pour arracher toutes les réformes qu'il pouvait à la bourgeoisie afin, avant tout, de se renforcer pour la lutte révolutionnaire future. Dans une période où le parlement était une véritable arène de lutte entre fractions de la bourgeoisie, le prolétariat avait les moyens d'y entrer sans se subordonner à la classe dominante ; cette stratégie n'est devenue impossible qu'avec l'entrée du capitalisme dans sa phase décadente, totalitaire. Evidemment, la pré-condition en était que la classe ouvrière eût son propre parti politique, distinct et opposé à tous les partis de la classe dominante, comme le dit la résolution de l'Internationale, sinon, il agirait simplement comme un appendice des partis bourgeois plus progressifs au lieu de les soutenir de façon tactique à certains moments. Tout cela n'avait aucun sens pour les anarchistes. Mais leur opposition « puriste » à toute intervention dans le jeu politique bourgeois ne les armait pas pour défendre l'autonomie du prolétariat dans les situations réelles et concrètes : un exemple de premier ordre en est donné dans l'article d'Engels : « Les bakouninistes à l'oeuvre » écrit en 1873. Analysant les soulèvements d'Espagne qui ne pouvaient certainement pas avoir un caractère socialiste prolétarien étant donnée l'arriération du pays, Engels montre comment l'opposition des anarchistes à la revendication d'une république, leurs phrases sonnantes sur l'établissement immédiat de la Commune révolutionnaire, ne les avaient pas empêchés, dans la pratique, d'être à la queue de la bourgeoisie. Les commentaires acerbes d'Engels sont comme une prédiction de ce que les anarchistes allaient faire en Espagne 1936, quoique dans un contexte historique différent :
« Les bakouninistes furent forcés, dés qu'ils se trouvèrent en face d'une véritable situation révolutionnaire, de jeter par-dessus bord tout leur programme antérieur. Tout d'abord, ils ont sacrifié la théorie faisant un devoir de s'abstenir de toute activité politique, et notamment, de la participation aux élections. Puis ce fut l'anarchie, l'abolition de l'Etat ; au lieu d'abolir l'Etat, ils ont tenté plutôt de créer une multitude d'Etats nouveaux et petits. Ensuite ils ont laissé tomber le principe selon lequel les ouvriers ne doivent prendre part à aucune révolution qui n'ait pour but l'émancipation immédiate et complète du prolétariat, et ils prirent eux-mêmes part à un mouvement de toute notoriété purement bourgeois. Enfin, ils foulèrent aux pieds le principe qu'ils venaient eux-mêmes de proclamer: à savoir que l'instauration d'un gouvernement révolutionnaire n'est qu'une nouvelle duperie et une nouvelle trahison à l'égard de la classe ouvrière, alors qu'ils figuraient fort tranquillement dans les comités gouvernementaux des diverses villes et cela presque partout comme une minorité impuissante dominée et politiquement exploitée par les bourgeois. » ([16] [1806])
La seconde dimension de cette discussion sur l'action politique était la question du pouvoir. Nous avons déjà vu que, pour les marxistes, l'Etat constitue un produit de l'exploitation, non sa cause. Il est l'émanation inévitable d'une société divisée en classe et il ne peut disparaître qu'une fois que les classes auront cessé d'exister. Mais, contrairement à la vision des anarchistes, cela ne peut être le résultat d'une grande « liquidation sociale » faite en une nuit. Cela nécessite une période plus ou moins longue de transition durant laquelle le prolétariat doit d'abord prendre en mains le pouvoir politique, et utiliser ce pouvoir pour lancer la transformation économique et sociale.
En défendant, au nom de la liberté et de l'opposition à toute forme d'autorité, que la classe ouvrière devait s'abstenir de conquérir le pouvoir politique, les anarchistes empêchaient donc la classe ouvrière d'établir sa base première. C'était nécessairement un acte « autoritaire ». Selon les fameux termes d'Engels :
« Ont-ils jamais vu une révolution, ces messieurs ? Une révolution est certainement la chose la plus autoritaire qui soit ; c'est l'acte par lequel une partie de la population impose sa volonté à l'autre au moyen de fusils, de baïonnettes et de canons, moyens autoritaires s'il en est ; et le parti victorieux s'il ne veut pas avoir combattu en vain, doit maintenir son pouvoir par la peur que ses armes inspireront aux réactionnaires. La Commune de Paris aurait-elle duré un seul jour, si elle ne s'était pas servie de cette autorité du peuple armé envers les bourgeois ? Ne peut-on, au contraire, lui reprocher de ne pas s'en être servi assez largement ? Donc, de deux choses l'une : ou les antiautoritaires ne savent pas ce qu'ils disent, et, dans ce cas, ils ne sèment que la confusion ; ou bien, ils le savent et, dans ce cas, ils trahissent le mouvement du prolétariat. Dans un cas comme dans l'autre, ils servent la réaction. » ([17] [1807])
Ailleurs, Engels souligne que la revendication par Bakounine de l'abolition immédiate de l'Etat avait montré sa véritable valeur dans la farce de Lyon en 1870 (c'est-à-dire peu de temps avant le soulèvement véritable des ouvriers à Paris). Bakounine et une poignée de ses supporters s'étaient établis sur les marches de la Mairie de Lyon et avaient déclaré l'abolition de l'Etat et son remplacement par une fédération de communes ; malheureusement, « l'Etat, sous la forme et l'espèce de deux compagnies de gardes nationaux bourgeois, entra par la porte qu'on avait oublié de garder, balaya la salle, et fit reprendre à la hâte le chemin de Genève à Bakounine », son décret miraculeux en poche. ([18] [1808])
Mais si les marxistes niaient que l'Etat puisse être supprimé par décret, cela ne voulait pas dire qu'ils voulaient établir une nouvelle dictature sur les masses : l'autorité qu'ils défendaient était celle du prolétariat en armes, non celle d'une faction ou d'une clique particulière. Et à la suite des écrits de Marx sur la Commune, c'était tout simplement une calomnie de proclamer, comme le faisait sans cesse Bakounine, que les marxistes voulaient prendre le contrôle de l'Etat existant, que, tout comme les Lassaliens, ils étaient pour un « Etat du peuple » - notion violemment critiquée par Marx dans sa Critique du Programme de Gotha ([19] [1809]). La. Commune avait mis au clair que la première action de la classe ouvrière révolutionnaire était la destruction de l'Etat bourgeois et la création de nouveaux organes de pouvoir dont la forme correspondait aux besoins et aux buts de la révolution. C'est évidemment une légende anarchiste de proclamer que, dès le lendemain de la Commune, Marx aurait laissé tomber, de façon opportuniste, ses visions autoritaires et aurait adopté les positions de Bakounine, que l'expérience de la Commune aurait donné raison aux principes anarchistes et réfuté les principes marxistes. En fait, à lire les écrits de Bakounine sur la Commune (en particulier dans L'empire allemand du Knout et la révolution sociale), on ne peut qu'être marqué par le caractère abstrait de ses réflexions, par l'absence de tentatives d'assimiler et lier entre elles les leçons essentielles de cet événement, comment il se perd en divagations floues sur Dieu et la religion. On ne peut les comparer aux leçons concrètes que Marx a tirées de la Commune, leçons sur la forme réelle de la dictature prolétarienne (l'armement des ouvriers, les délégués révocables, la centralisation « par en bas » ([20] [1810]). En fait, même après la Commune, Bakounine était tout à fait incapable de voir comment le prolétariat pouvait s'organiser comme force unie. Dans Etatisme et Anarchie, Bakounine argumente contre l'idée de la dictature du prolétariat par des questions naïves comme « Est-ce à dire que le prolétariat sera tout entier à la direction des affaires publiques ? », ce à quoi Marx répond, dans les notes qu'il a écrites sur le livre de Bakounine (rédigées en 1874-75, mais publiées seulement en 1926) : « Le comité exécutif d'un syndicat le compose-t-il à lui tout seul ? ». Ou quand Bakounine écrit « On compte environ quarante millions d'allemands. Se peut-il que ces quarante millions fassent partie du gouvernement ? », Marx répond « Certainement ! Car la chose commence par l'autonomie de la Commune » ([21] [1811]). En d'autres termes, Bakounine n'a rien compris à la signification de la Commune en tant que nouvelle forme de pouvoir politique qui n'était pas basé sur le divorce entre une minorité de gouvernants et une majorité de gouvernés, mais permettait que la majorité exploitée exerce un pouvoir réel sur une minorité d'exploiteurs, participe au processus révolutionnaire et assure que les nouveaux organes de pouvoir n'échappent pas à son contrôle. Cette immense découverte pratique de la classe ouvrière fournissait une réponse réaliste à la question souvent posée sur les révolutions : comment empêcher un nouveau groupe de privilégiés d'usurper le pouvoir au nom de la révolution ? Les marxistes furent capables de tirer cette leçon, même si cela nécessitait de corriger leur position précédente sur la possibilité de s'emparer de l'Etat existant. Pour leur part, les anarchistes ne furent capables de voir dans la Commune qu'une confirmation de leur principe éternel, qui ne se différencie pas des préjugés bourgeois libéraux : tous les pouvoirs sont corrompus et le mieux est ne rien avoir à faire avec la conception indigne d'une classe qui a pour but de faire la révolution la plus radicale de tous les temps.
La société future : la vision artisanale de l'anarchisme
Ce serait une erreur de simplement ridiculiser les anarchistes ou de croire qu'ils ont toujours manqué de perspicacité. Si l'on se plonge dans les écrits de Bakounine ou d'un de ses proches associés comme James Guillaume, on peut certainement trouver des images d'une grande force avec des éclairs de sagesse sur la nature du processus révolutionnaire, en particulier à travers l'insistance permanente sur le fait que « la révolution ne doit pas être faite pour le peuple mais par le peuple et ne peut réussir si elle n'implique pas de façon enthousiaste toutes les masses du peuple » ([22] [1812]). Nous pouvons même présumer que les idées des bakouninistes qui parlaient des Communes révolutionnaires basées sur « des mandats impératifs, responsables et révocables » dès 1869 (dans le «Programme de la Fraternité internationale » que Marx et Engels citent dans « l’Alliance de la démocratie socialiste et l'Internationale » eurent un impact direct, en particulier sur la Commune de Paris, puisque certains de ses dirigeants étaient des adeptes de Bakounine (Varlin, par exemple).
Mais comme on l’a dit à plusieurs occasions, les idées justes de l'anarchisme sont comparables à une horloge arrêtée qui donne l'heure juste deux fois par jour ; ce qui manque, c'est une méthode cohérente qui permette de saisir, du point de vue du prolétariat, une réalité mouvante. Nous avons déjà vu que c'est le cas lorsque l'anarchisme traite des questions d'organisation et de pouvoir politique. Ce n'est pas moins le cas quand il fait ses prescriptions pour la société future qui, dans certains textes (Le catéchisme révolutionnaire de Bakounine, 1866, ou La construction du nouvel ordre social de Guillaume, 1876) ressemblent à des « recettes de cuisine pour les marmites de l'avenir » telles que Marx a toujours refusé d'en écrire. Néanmoins, ces livres sont utiles pour démontrer que les « pères » de l'anarchisme n'ont jamais saisi les problèmes du communisme à la racine - et en premier lieu, la nécessité d'abolir le chaos des rapports marchands et de mettre les forces productives du monde dans les mains d'une communauté humaine unifiée. Dans la description du futur par les anarchistes, malgré toutes les références au collectivisme et au communisme, le point de vue de l'artisan n'est jamais dépassé. D'après le texte de Guillaume, par exemple, ce serait une bonne chose que la terre soit labourée en commun, mais la question cruciale c'est que les paysans gagnent leur indépendance ; qu'ils l'obtiennent par la propriété individuelle ou collective « est d'importance secondaire » ; de même, les ouvriers deviendront propriétaires des moyens de production à travers des corporations de commerce séparées, et la société dans son ensemble sera organisée à travers une fédération de communes autonomes. En d'autres termes, c'est un monde encore divisé en une multitude de propriétaires indépendants (individus ou corporations) qui ne peuvent avoir de lien qu'au moyen de l'échange, à travers des rapports marchands. Dans le texte de Guillaume, ceci est tout à fait explicite : les diverses associations de producteurs et les communes doivent être liées au moyen des bons offices d'une « Banque d'échange » qui organisera l'achat et la vente au nom de la société.
Guillaume défend l'idée que la société sera capable de produire des biens en abondance et que l'échange sera remplacé par la simple distribution. Mais n'ayant pas de véritable théorie du capital et de son mode d'opération, les anarchistes sont incapables de voir qu'une société d'abondance ne peut émerger qu'à travers une lutte incessante contre la production marchande et la loi de la valeur, puisque ces dernières sont précisément ce qui maintient les forces productives de l'humanité en esclavage. Un retour à un système de simple production marchande ne peut certainement pas conduire à une société d'abondance. En fait, un tel système ne peut exister sur une base stable, puisque la production simple de marchandises engendre inévitablement une production élargie de marchandises - et toute la dynamique de l'accumulation capitaliste. Aussi, tandis que le marxisme, parce qu'il exprime le point de vue de la seule classe de la société capitaliste qui ait un véritable avenir, voit la libération des forces productives comme le fondement d'un développement illimité du potentiel de l'homme, l'anarchisme, et son point de vue artisanal, est prisonnier dans la vision d'un ordre statique d'échange libre et égal. Ce n'est pas une véritable anticipation du futur, mais la nostalgie d'un passé qui n'a jamais été.
CDW.
[1] [1813] Cité dans La vie de Marx, l'homme et le lutteur, B. Nicolaïevski, Ed. Gallimard, p. 332.
[2] [1814] Marx/Bakounine, Socialisme autoritaire ou libertaire, Editions 10 18, Tome I, p. 279.
[3] [1815] Ibid.
[4] [1816] Ibid, p. 290.
[5] [1817] Ibid, p. 300.
[6] [1818] Revue Internationale, n° 71, 4e trim. 1992.
[7] [1819] Marx/Bakounine, Socialisme autoritaire ou libertaire, Editions 10 18, Tome II, p. 148.
[8] [1820] Ibid
[9] [1821] Ibid,p. 149.
[10] [1822] Ibid., p. 130
[11] [1823] Ecrit contre Marx, ibid., Tome II, p. 49.
[12] [1824] Ibid, pp. 50-51.
[13] [1825] Etatisme et Anarchie cité dans la critique de Marx, ibid. Tome II, p. 375.
[14] [1826] Etatisme et Anarchie.
[15] [1827] Ecrit contre Marx, ibid., Tome II, p. 11.
[16] [1828] Les bakouninistes au travail, IV, in Sur l'anarcho-syndicalisme. Ed. du Progrès, p. 159.
[17] [1829] De l'autorité, ibid. Tome II, p. 120.
[18] [1830] L'Alliance de la Démocratie Socialiste et l’AIT, ibid., Tome II, p. 159.
[19] [1831] Voir l'article de la Revue Internationale, n° 78, 3etrim. 1994.
[20] [1832] Voir l'article de la Revue Internationale, n° 77, 2e trim. 1994.
[21] [1833] Ibid Marx/Bakounine, Tome II, p. 378.
[22] [1834] Le catéchisme national, 1866.
Approfondir:
Questions théoriques:
- Communisme [492]
Heritage de la Gauche Communiste:
Revue Int. 1995 - 80 à 83
- 4354 reads
Revue Internationale no 80 - 1e trimestre 1995
- 3389 reads
Crise économique : une « reprise » sans emplois
- 4137 reads
Apparemment, presque tous les indicateurs économiques statistiques sont clairs : l'économie mondiale est enfin en train de sortir de la pire récession qu'elle ait connue depuis la guerre. La production augmente, les profits sont de retour. L'assainissement semble avoir été payant. Et pourtant aucun gouvernement n'ose chanter victoire, tous appellent à encore de nouveaux sacrifices, tous restent extrêmement prudents et, surtout, tous disent que, de toutes façons, pour ce qui est du chômage, c'est-à-dire l'essentiel, il n'y a pas grand chose de vraiment bon à attendre. ([1] [1835])
Mais, qu'est-ce qu'une « reprise » qui ne crée pas d'emplois ou qui ne crée que des emplois précaires ?
Au cours des deux dernières années, dans les pays anglo-saxons, qui sont censés être les premiers à être sortis de la récession ouverte commencée à la fin des années 1980, la « reprise » s'est concrétisée essentiellement par une modernisation extrême de l'appareil productif dans les entreprises qui ont survécu au désastre. Celles qui survivent l'ont fait au prix de violentes restructurations, entraînant des licenciements massifs et des dépenses non moins massives pour remplacer le travail vivant par du travail mort, par des machines. L'augmentation de la production que les statistiques enregistrent dans les derniers mois, est pour l'essentiel le résultat non pas d'une augmentation du nombre de travailleurs intégrés mais d'une plus grande productivité des travailleurs ayant déjà un emploi. Cette augmentation de la productivité, qui compte pour 80 % dans la hausse de la production au Canada, par exemple, un des pays les plus avancés dans la «reprise», est due pour l'essentiel à de très forts investissements pour moderniser les machines, les communications, développer l'automatisation, et non à l'ouverture de nouvelles usines. Aux Etats-Unis ce sont les investissements en biens d'équipement, principalement l'informatique, qui expliquent pour l'essentiel la croissance de l'investissement au cours des dernières années. L'investissement en construction non-résidentielle est resté presque stagnant. Ce qui veut dire qu'on modernise les usines existantes mais qu'on n'en construit pas de nouvelles.
Une reprise « Mickey Mouse »
Actuellement en Grande-Bretagne, où le gouvernement ne cesse de claironner ses statistiques faisant état d'une baisse continue du chômage, environ 6 millions de personnes travaillent une moyenne de seulement 14,8 heures par semaine. C'est ce genre d'emplois, aussi précaires que mal payés, qui dégonfle les statistiques du chômage. Les travailleurs britanniques appellent ça les « Mickey Mouse jobs ».
Pendant ce temps, les programmes de restructuration des grandes entreprises continuent : 1 000 suppressions d'emplois dans une des plus grandes compagnies d'électricité en Grande-Bretagne, 2 500 dans la deuxième entreprise de télécommunications.
En France, la Société nationale des chemins de fer annonce, pour 1995, 4 800 suppressions de postes, Renault 1 735, Citroën 1 180. En Allemagne, le géant Siemens annonce qu'il supprimera « au moins » 12 000 emplois en 1994-1995, après les 21 000 qu'il a déjà supprimés en 1993.
L'insuffisance de marchés
Pour chaque entreprise, accroître sa productivité est une condition de survie. Globalement cette concurrence impitoyable se traduit par d'importants gains de productivité. Mais cela pose le problème de l'existence de marchés suffisants pour pouvoir écouler la production toujours plus grande que les entreprises sont capables de créer avec le même nombre de travailleurs. Si les marchés restent insuffisants, la suppression de postes est inévitable.
« Il faut faire entre 5 et 6 % de hausse de productivité par an, et tant que le marché ne progresse pas plus vite, des postes disparaissent. » C'est ainsi que les industriels français de l'automobile résumaient leur situation à la fin de l'année 1994 ([2] [1836]).
La dette publique
Comment « faire progresser le marché » ?
Dans le n° 78 de la Revue internationale, nous avons développé comment, face à la récession ouverte depuis la fin des années 1980, les gouvernements ont eu massivement recours à l'endettement public.
Celui-ci permet en effet de financer des dépenses qui contribuent à créer des marchés « solvables » pour une économie qui en manque cruellement parce qu'elle ne peut se créer des débouchés spontanément. Le bond fait par la croissance de cet endettement dans les principaux pays industriels ([3] [1837]) est en partie à la base du rétablissement des profits.
La dette publique permet à des capitaux « oisifs », qui ont de plus en plus de mal à se placer de façon rentable, de le faire en Bons d'Etat, s'assurant un rendement convenable et sûr. Le capitaliste peut tirer sa plus-value non plus du résultat de son propre travail de gérant du capital, mais du travail de l'Etat collecteur d'impôts ([4] [1838]).
Le mécanisme de la dette publique se traduit par un transfert de valeurs des poches d'une partie des capitalistes et des travailleurs vers celle des détenteurs de Bons de la dette publique, un transfert qui emprunte le chemin des impôts, puis celui des intérêts versés sur la dette. C'est ce que Marx appelle le « capital fictif ».
Les effets stimulateurs de l'endettement public sont aléatoires, mais les dangers qu'il cumule pour l'avenir sont certains ([5] [1839]). La « reprise » actuelle coûtera très cher demain au niveau financier.
Pour les prolétaires, cela veut dire qu'à l'intensification de l'exploitation dans les lieux de travail doit s'ajouter l'aggravation du poids de l'extorsion fiscale. L'Etat doit prélever une masse croissante d'impôts pour rembourser le capital et les intérêts de la dette.
Détruire du capital pour en maintenir la rentabilité
Lorsque l'économie capitaliste fonctionne de façon saine, l'augmentation ou le maintien des profits est le résultat de la croissance du nombre de travailleurs exploités, ainsi que de la capacité à en extraire une plus grande masse de plus-value. Lorsqu'elle vit dans une phase de maladie chronique, malgré le renforcement de l'exploitation et de la productivité, l'insuffisance des marchés l'empêche de maintenir ses profits, sa rentabilité sans réduire le nombre d'exploités, sans détruire du capital.
Alors que le capitalisme tire son profit de l'exploitation du travail, celui-ci se trouve dans « l'absurdité » de payer des chômeurs, des ouvriers qui ne travaillent pas, ainsi que des paysans pour qu'ils ne produisent pas et mettent leurs terres en jachère.
Les frais sociaux de « maintien du revenu » atteignent jusqu'à 10% de la production annuelle de certains pays industrialisés. Du point de vue du capital c'est un « péché mortel », une aberration, du gaspillage, de la destruction de capital. C'est avec toute la sincérité d'un capitaliste convaincu que le nouveau porte-parole des républicains à la Chambre des représentants, aux Etats-Unis, Newt Gingrich, est parti en guerre contre toutes « les aides du gouvernement aux pauvres ».
Mais, le point de vue du capital est celui d'un système sénile, qui s'auto-détruit dans des convulsions entraînant le monde dans un désespoir et une barbarie sans fin. Ce qui est une aberration, ce n'est pas que l'Etat bourgeois jette quelques miettes à des hommes qui ne travaillent pas, mais qu'il y ait des hommes qui ne puissent participer au processus productif alors que le cancer de la misère matérielle s'étend chaque jour un peu plus sur la planète.
C'est le capitalisme qui est devenu une aberration historique. L'actuelle « reprise » sans emplois en est encore une confirmation. Le seul « assainissement » possible de l'organisation « économique » de la société c'est la destruction du capitalisme lui-même, l'instauration d'une société où l'objectif de la production n'est plus le profit, la rentabilité du capital, mais la satisfaction pure et simple des besoins humains.
RV, 27 décembre 94
« Il va de soi que l'économie politique ne considère le prolétaire qu'en tant que travailleur : c'est celui qui, n'ayant ni capital ni rente foncière, vit uniquement de son travail, d'un travail abstrait et monotone. Elle peut donc affirmer que, tout comme une bête de somme quelconque, le prolétaire mérite de gagner suffisamment pour pouvoir travailler. Quand il ne travaille pas, elle ne le considère pas comme un être humain ; cette considération, elle l'abandonne à la justice criminelle, aux médecins, à la religion, aux statistiques, à la politique, à la charité publique. »
Marx, Ebauche d'une critique de l'économie politique, Ed. La Pléiade, II
25 ans d'augmentation du chômage
Depuis un quart de siècle, depuis la fin des années 1960, le fléau du chômage n'a cessé de s'étendre et de s'intensifier dans le monde. Ce développement s'est fait de façon plus ou moins régulière, connaissant des accélérations et des reculs plus ou moins violents. Mais la tendance générale à la hausse s'est confirmée récession après récession.
Les données représentées dans ces graphiques sont les chiffres officiels du chômage. Elles sous-estiment fortement la réalité puisqu'elles ne prennent pas en compte les chômeurs en « stage de formation », ni les jeunes participant à des programmes de travail à peine rémunérés, ni les travailleurs « préretraités », ni les travailleurs contraints à se vendre « à temps partiel », de plus en plus nombreux, ni ceux que les experts appellent les « travailleurs découragés », c'est-à-dire les chômeurs qui n'ont plus l'énergie de continuer à chercher du travail.
Ces courbes ne rendent en outre pas compte des aspects qualitatifs de ce chômage. Elles ne montrent pas que, parmi les chômeurs, la proportion de ceux de « longue durée » ne cesse de croître, ou que les allocations de chômage sont de plus en plus maigres, de courte durée et difficiles à obtenir.
Non seulement le nombre de chômeurs a augmenté pendant plus de 25 ans, mais en outre la situation de chômeur est devenue de plus en plus intenable.
Le chômage massif et chronique est devenu partie intégrante de la vie des hommes de la fin du 20e siècle et ce faisant, il a entrepris de détruire le peu de sens que le capitalisme pouvait encore donner à cette vie. On interdit aux jeunes d'entrer dans le monde des adultes, et on devient « vieux » plus vite. Le manque d'avenir historique du capitalisme prend la forme de l'angoisse du désespoir chez les individus.
Le fait que le chômage soit devenu massif et chronique constitue la preuve la plus indiscutable de la faillite historique du capitalisme comme mode d'organisation de la société.
Pourquoi les capitalistes suppriment-ils des emplois ?
Ce n'est pas par plaisir que les capitalistes refusent d'exploiter un plus grand nombre de prolétaires ou de continuer à exploiter les anciens. Leur profit, ils le tirent du travail vivant, digéré par la machine d'exploitation salariale. Le travail des autres est la « poule aux oeufs d'or » du capital. Celui-ci ne tient pas, en soi, à la tuer. Mais le capital n'a qu'une seule religion : le profit. Un capitaliste qui ne fait pas de profit est condamné à disparaître. Le capital n'embauche pas par humanisme mais parce que ça lui rapporte. Et si ses profits sont insuffisants, il licencie, il supprime des postes de travail. Le profit est l'alpha et l'oméga de la bible du capital.
Les graphiques ci-dessous reproduisent, pour les Etats-Unis et le Canada, l'évolution simultanée des profits des entreprises et du nombre de chômeurs depuis 1965. Ils montrent comment les chutes de la masse des profits commencées en 1973-74, puis en 1979 et en 1988, se sont accompagnées d'une hausse du chômage. Lorsque les profits baissent, et parce que les profits baissent, les capitalistes licencient. Le chômage ne diminue que lorsque ces profits augmentent à nouveau. Mais, comme on peut le voir sur les courbes, le nombre de chômeurs ne redescend jamais aux niveaux antérieurs. Les périodes d'embauche ne sont que des répits dans une tendance générale à l'augmentation du chômage.
Le capital ne peut assurer l'existence de son profit qu'en rejetant dans le chômage un nombre toujours plus grand de prolétaires.
[1] [1840] Les prévisions officielles de l'OCDE annoncent une diminution des taux de chômage en 1995 et 1996. Mais le niveau de ces baisses est ridicule : elle serait de 0,3 % en Italie (11,3 % de chômage officiel en 1994, 11 % prévu pour 1996) ; de 0,5 % aux Etats-Unis (de 6,1 % en 1994 à 5,6 % en 1996) ; de 0,7 % en Europe Occidentale (de 11,6 % à 10,9 %) ; au Japon aucune diminution n'est prévue.
[2] [1841] Libération, 16/12/1994.
[3] [1842] Entre 1989 et 1994, la dette publique, mesurée en pourcentage du produit intérieur annuel brut, est passée de 53 à 65 % aux Etats-Unis, de 57 à 73 % en Europe ; ce pourcentage atteint, en 1994, 123 % pour un pays comme l'Italie, 142 % pour la Belgique.
[4] [1843] Cette évolution de la classe dominante vers un corps parasite qui vit aux dépens de son Etat est typique des sociétés décadentes. Dans le Bas-empire romain, comme dans le féodalisme décadent ce phénomène fut un des principaux facteurs du développement massif de la corruption.
[5] [1844] Voir « Vers une nouvelle tourmente financière », Revue Intarnationale, n° 78.
Récent et en cours:
- Crise économique [28]
Questions théoriques:
- Décadence [32]
La première et la deuxième internationale devant le problème de la guerre - Bilan n°21, juillet-août 1935
- 6212 reads
Document
C'est à propos de la guerre des Balkans, à la veille de la 1re guerre mondiale que les révolutionnaires, en particulier Rosa Luxemburg et Lénine, affirment au congrès de Bâle en 1912 la position internationaliste caractéristique de la nouvelle phase historique du capitalisme : « Il n'y a plus de guerres défensives ou offensives ». Dans la phase « impérialiste », « décadente » du capitalisme, toutes les guerres entre puissances sont également réactionnaires. Contrairement à ce qui se passait au 19e siècle, lorsque la bourgeoisie pouvait encore mener des guerres contre le féodalisme, les prolétaires n'ont plus de camp à soutenir dans ces guerres. La seule réponse possible à la barbarie guerrière du capitalisme décadent est la lutte pour la destruction du capitalisme lui-même. Ces positions, ultra-minoritaires en 1914, au moment de l'éclatement de la 1re guerre mondiale, allaient cependant constituer la base des plus grands mouvements révolutionnaires de ce siècle : la révolution russe de 1917, la révolution allemande de 1919, qui mirent fin au bain de sang commencé en 1914.
Aujourd'hui que pour la première fois depuis la fin de la 2e guerre mondiale, la guerre sévit en Europe, encore dans les Balkans, il est indispensable de se réapproprier l'expérience de la lutte des révolutionnaires contre la guerre. C'est pourquoi nous publions cet article qui résume de façon remarquable un aspect crucial de l'action des révolutionnaires face à un des pires fléaux du capitalisme.
CCI, décembre 1994
BILAN n°21, juillet-août 1935
La première et la deuxième internationale devant le problème de la guerre - BILAN n°21, juillet-août 1935
Ce serait fausser l'histoire que d'affirmer que la lre et la 2e Internationale n'ont pas songé au problème de la guerre et qu'elles n'ont pas essayé de le résoudre dans l'intérêt de la classe ouvrière. On pourrait même dire que le problème de la guerre fut à l'ordre du jour dès le début de la lre Internationale (guerre de 1859 de la France et du Piémont contre l'Autriche ; de 1864 : la Prusse et l'Autriche contre le Danemark ; de 1866 : la Prusse et l’Italie contre l'Autriche et l'Allemagne du Sud ; 1870 : la France contre l'Allemagne et nous ne mentionnons pas la guerre de Sécession de 1861-65 aux Etats-Unis, l'insurrection de la Bosnie-Herzégovine, en 1878 contre l'annexion autrichienne -qui passionna beaucoup les internationalistes de l'époque- etc., etc.)
Ainsi, si on considère le nombre de guerres qui surgirent pendant cette période, il est permis d'affirmer que le problème fut plus «brûlant» pour la lre Internationale que pour la 2e qui fut surtout l'époque des expéditions coloniales, du partage de l'Afrique, car pour les guerres européennes - exception faite de la courte guerre de 1897 entre la Turquie et la Grèce- il faut attendre les guerres balkaniques, celle entre l’Italie et la Turquie pour la Libye, qui sont déjà des signes avant-coureurs de la conflagration mondiale.
Tout cela explique - et nous écrivons après une expérience vécue - le fait que nous, de la génération qui lutta avant la guerre impérialiste de 1914, avons peut-être considéré le problème de la guerre, plus comme une lutte idéologique que comme un danger réel et imminent ; le dénouement de conflits aigus, sans le recours aux armes, tels Fachoda ou Agadir nous avait influencés dans le sens de croire fallacieusement que grâce à « l'interdépendance » économique, aux liens toujours plus nombreux et plus étroits entre pays, il s'était ainsi constitué une sûre défense contre l'éclosion d'une guerre entre puissances européennes et que l'augmentation des préparatifs militaires des différents impérialistes au lieu de conduire inévitablement à la guerre, vérifiait le principe romain « si vis pacem para bellum » si tu veux la paix prépare la guerre.
A l'époque de la lre Internationale la panacée universelle pour empêcher la guerre était la suppression des armées permanentes et leur remplacement par des milices (type suisse). C'est d'ailleurs ce qu'affirma la 2e Conférence de Lausanne - en 1867 - de l'Internationale envers un mouvement de pacifistes bourgeois qui avaient constitué une Ligue pour la Paix qui tenait des congrès périodiques. L'Internationale décida d'y participer (ce congrès se tint à Genève où Garibaldi fit son intervention pathétiquement théâtrale avec sa célèbre phrase « l'esclave seul a le droit de faire la guerre aux tyrans ») et fit souligner par ses délégués « qu'il ne suffit pas de supprimer les armées permanentes pour en finir avec la guerre, mais qu'une transformation de tout l'ordre social était à cette fin également nécessaire »
Au 3e congrès de l'Internationale -tenu à Bruxelles en 1868 - on vota une motion sur l'attitude des travailleurs dans le cas d'un conflit entre les grandes puissances d'Europe où ils étaient invités à empêcher une guerre de peuple à peuple et où on leur recommandait de cesser tout travail en cas de guerre. Deux ans après, l'Internationale se trouva devant le fait de la guerre franco-allemande qui éclata en juillet 1870.
Le premier manifeste de l'Internationale est assez anodin : «... sur les ruines que vont faire les deux armées ennemies, est-il écrit, il ne restera d'autre puissance réelle que le socialisme. Ce sera alors pour l'Internationale le moment de se demander ce qu'elle doit faire. D'ici là, soyons calmes et veillons. »(!!!)
Le fait que la guerre fut menée par Napoléon « le petit », détermina une orientation plutôt défaitiste parmi les larges couches de la population française dont les internationalistes se firent l'écho dans leur opposition à la guerre.
D'autre part, parce que l'on considère généralement l'Allemagne comme « injustement » attaquée par « Bonaparte », on fournit ainsi une certaine justification - puisqu'il s'agissait d'une guerre « défensive » - à la position de défense du pays des travailleurs allemands.
La chute de l'Empire, après le désastre de Sedan, apporta un bouleversement de ces positions.
« Nous répétons ce que nous déclarions en 1793 à l'Europe coalisée, écrivaient les internationalistes français dans leur manifeste au peuple allemand : le peuple français ne fait pas la paix avec un ennemi qui occupe notre territoire, seulement sur les rives du fleuve contesté (le Rhin) les ouvriers se tendront les mains pour créer les Etats-Unis d'Europe, la République Universelle. »
La fièvre patriotique s'intensifia jusqu'à présider à la naissance même de la glorieuse Commune de Paris.
D'un autre côté pour le prolétariat allemand c'était maintenant une guerre de la monarchie et du militarisme prussiens contre la « république française », le « peuple français ». De là vint le mot d'ordre de « paix honorable et sans annexions » qui en déterminant la protestation de Liebknecht et Bebel contre l'annexion de l'Alsace-Lorraine au Reichstag les fit condamner pour « haute trahison ».
Au sujet de la guerre franco-allemande de 1870, et de l'attitude du mouvement ouvrier, il reste encore à élucider un autre point.
En réalité à cette époque Marx envisageait la possibilité de « guerres progressives » - la guerre contre la Russie du tsar avant tout - dans une époque où le cycle des révolutions bourgeoises n'était pas encore clos, de même qu'il envisageait la possibilité d'un croisement du mouvement révolutionnaire bourgeois avec la lutte révolutionnaire du prolétariat avec l'intervention de ce dernier, fut-ce au cours d'une guerre, pour hâter son triomphe final.
« La guerre de 1870, écrivit Lénine dans sa brochure sur Zimmerwald, fut une "guerre progressive" comme celles de la révolution française qui tout en portant en elles, incontestablement, des éléments de pillage et de conquêtes eurent la fonction historique de détruire ou d'ébranler le féodalisme et l'absolutisme de la vieille Europe dont les fondements reposaient encore sur le servage. »
Mais si une telle perspective était admissible pour l'époque où vécut Marx, bien que déjà elle s'avéra dépassée par les événements, bavarder sur la guerre « progressive » ou « nationale » ou «juste », c'est plus qu'une tromperie, c'est une trahison dans la dernière étape du capitalisme, dans sa phase impérialiste. En effet, comme l'écrivit Lénine, l'union avec la bourgeoisie nationale de son propre pays c'est l'union contre l'union du prolétariat révolutionnaire international, c'est en un mot l'union avec la bourgeoisie contre le prolétariat, la trahison de la révolution, du socialisme.
D'autre part, on ne doit pas oublier d'autres problèmes qui en 1870 influencèrent le jugement de Marx et qu'il mit d'ailleurs en évidence dans une lettre à Engels, le 20 juillet 1870. La concentration du pouvoir de l'Etat, suite à la victoire de la Prusse, ne pouvait qu'être utile à la concentration de la classe ouvrière allemande, favorable à ses luttes de classe et aussi, écrivit Marx « la prépondérance allemande transportera le centre de gravité du mouvement ouvrier européen de France en Allemagne et en conséquence déterminera le triomphe définitif du socialisme scientifique sur le proudhonisme et le socialisme utopique. » ([1] [1845])
Pour en terminer avec la lre Internationale, nous marquerons encore que, chose étrange, la Conférence de Londres de 1871 de cette dernière ne traita pas de ces problèmes pourtant d'actualité pas plus d'ailleurs que le Congrès de La Haye en septembre 1872, où une relation fut donnée par Marx en langue allemande sur les événements s'étant déroulés depuis 1869 -date du dernier Congrès de l'Internationale. On traita, en réalité, très superficiellement des événements de l'époque pour se limiter à exprimer : l'admiration du Congrès pour les héroïques champions tombés victimes de leur dévouement et ses salutations fraternelles aux victimes de la réaction bourgeoise.
Le premier Congrès de l'Internationale reconstituée à Paris en 1889 reprit l'ancien mot d'ordre de la « substitution des milices populaires aux armées permanentes » et le congrès suivant, tenu à Bruxelles en 1891, adopta une résolution appelant tous les travailleurs à protester par une agitation incessante, contre toutes les tentatives de guerre en y ajoutant comme une sorte de consolation, que la responsabilité des guerres retomberait en tout cas, sur les classes dirigeantes...
Le Congrès de Londres de 1896 - où eut lieu la séparation définitive avec les anarchistes - dans une résolution programmatique sur la guerre affirma génériquement que « la classe ouvrière de tous les pays doit s'opposer à la violence provoquée par les guerres ».
En 1900, à Paris, en conséquence de l'accroissement de la force politique des partis socialistes, fut élaboré le principe - qui devint l'axiome de toute agitation contre la guerre : « les députés socialistes de tous les pays sont tenus à voter contre toutes les dépenses militaires, navales et contre les expéditions coloniales ».
Mais c'est à Stuttgart (1907) qu'eurent lieu les plus amples débats sur le problème de la guerre.
A côté des fanfaronnades de l'histrion Hervé sur le devoir de « répondre à la guerre par la grève générale et l'insurrection » fut présentée la motion de Bebel d'accord substantiellement avec Guesde, laquelle bien que juste dans ses prévisions théoriques était insuffisante par rapport au rôle et aux tâches du prolétariat.
Ce fut à ce Congrès que pour « empêcher de lire les déductions orthodoxes de Bebel à travers les lunettes opportunistes » (Lénine), Rosa Luxemburg - en accord avec les bolcheviks russes - fit ajouter des amendements qui soulignaient que le problème consistait non seulement à lutter contre l'éventualité de la guerre ou de la faire cesser le plus rapidement possible, mais aussi et surtout à utiliser la crise causée par la guerre pour accélérer la chute de la bourgeoisie ; « à tirer de toute façon parti de la crise économique et politique pour soulever le peuple et précipiter, par là même, la chute de la domination capitaliste ».
En 1910, à Copenhague, on confirma la résolution précédente surtout pour ce qui regarde le strict devoir des élus socialistes de refuser tous les crédits de guerre.
Finalement, comme on le sait, pendant la guerre des Balkans et devant le danger imminent d'une conflagration mondiale surgissant de cette poudrière de l'Europe - aujourd'hui les poudrières se sont multipliées à l'infini - un congrès spécial tenu à Bâle en novembre 1912 rédigea le célèbre manifeste qui en reprenant toutes les affirmations de Stuttgart et de Copenhague, flétrissait la future guerre européenne comme « criminelle » et comme « réactionnaire » pour tous les gouvernements et ne pouvant qu' « accélérer la chute du capitalisme en provoquant immanquablement la révolution prolétarienne ».
Mais le manifeste tout en affirmant que la guerre qui menaçait était une guerre de rapines, une guerre impérialiste pour tous les belligérants et qu'elle devait conduire à la révolution prolétarienne, s'efforçait avant tout à démontrer que cette guerre imminente ne pouvait être justifiée par l'ombre d'un intérêt de défense nationale. Cela signifiait implicitement que l'on admettait qu'en régime capitaliste et en pleine expansion impérialiste pouvaient exister des cas de participation justifiée à une guerre de « défense nationale » de la classe exploitée.
Deux ans après éclatait la guerre impérialiste et avec elle l'effondrement de la 2e Internationale. Cette débâcle était la conséquence directe des équivoques et des contradictions insurmontables contenues dans toutes les résolutions. Plus particulièrement l'interdiction de voter les crédits de guerre ne résolvait pas le problème de la « défense du pays » devant l'attaque d'un pays « agresseur ». C'est par cette brèche que se rua toute la meute des chauvins et des opportunistes. « L'Union sacrée » était scellée sur l'effondrement de l'entente de classe internationale des travailleurs.
Comme nous l'avons vu pour la seconde Internationale, si on regarde superficiellement le langage de ses résolutions, elle aurait adopté envers la guerre non seulement une position de principe de classe, mais aussi aurait donné des moyens pratiques en arrivant jusqu'à la formulation, plus ou moins explicite de la transformation de la guerre impérialiste en révolution prolétarienne. Mais si l'on va au fond des choses, on constate que la seconde Internationale dans son ensemble, tout en posant le problème de la guerre, l'a résolu d'une façon formaliste et simpliste. Elle dénonça la guerre avant tout pour ses horreurs et atrocités, parce que le prolétariat devait fournir la chair à canon aux classes dominantes. L'antimilitarisme de la seconde Internationale eut une forme purement négative et fut laissé presque exclusivement à la jeunesse socialiste et dans certains pays avec l'hostilité manifeste du parti lui-même.
Aucun parti, excepté les bolcheviks pendant la révolution russe de 1904-05, n'a pratiqué ou même envisagé la possibilité d'un travail illégal systématique dans l'armée. On s'est borné à des manifestes ou à des journaux contre la guerre et contre l'armée au service du capital, que l'on collait sur les murs ou que l'on distribuait à la rentrée des classes, en invitant les ouvriers à se rappeler que malgré l'uniforme de soldat ils devaient rester des prolétaires. Devant l'insuffisance et la stérilité de ce travail Hervé eut beau jeu, surtout dans les pays latins, avec sa démagogie verbale du « drapeau dans le fumier » et en propageant la désertion, le rejet des armes et le fameux « tirez sur vos officiers ».
En Italie - où seul exemple dans la 2e Internationale le parti socialiste devait en octobre
1912 protester par une grève générale de 24 heures contre une expédition coloniale, celle de la Tripolitaine - un jeune ouvrier, Masetti, sut être conséquent avec les suggestions de Hervé et soldat à Boulogne tira sur son colonel pendant les exercices militaires. C'est l'unique fait positif de toute la comédie hervéiste.
Moins d'un mois après, le 4 août, momentanément ignoré des masses ouvrières englouties dans le carnage, le manifeste du Comité central bolchevik relevait le drapeau de la continuité de la lutte ouvrière avec ses affirmations historiques : la transformation de la guerre impérialiste actuelle en guerre civile.
La révolution d'Octobre était en marche.
Gatto Mammone
[1] [1846] Si l'on tient compte de tous ces éléments qui eurent une influence décisive surtout dans la première phase de la guerre franco-allemande, sur le jugement et la pensée de Marx-Engels, on peut expliquer certaines expressions hâtives et très peu heureuses de ces derniers telles : « Les Français ont besoin d'être rossés », « C'est nous qui avons gagné les premières batailles », « Ma confiance dans la force militaire prussienne croît chaque jour » et enfin le fameux « Bismarck comme en 1866 travaille pour nous ».
Toutes ces expressions extraites d'une correspondance strictement intime de Marx et Engels fournirent aux chauvins de 1914 -entre autre au vieux James Guillaume qui ne pouvait oublier son exclusion de l'Internationale avec Bakounine en 1872 - l'occasion de transformer les fondateurs du socialisme scientifique en précurseurs du pangermanisme et de l’hégémonie allemande...
Conscience et organisation:
- La première Internationale [1847]
- La Seconde Internationale [1848]
Courants politiques:
- Gauche Communiste [49]
Questions théoriques:
- Guerre [129]
- Impérialisme [321]
Enseignements de 1917-23 : La première vague révolutionnaire du prolétariat mondial
- 7231 reads
Il y a de cela 80 ans, la Première Guerre mondiale inaugurait la période de décadence du capitalisme mondial, « l’ère des guerres et des révolutions » comme l'avait définie l'Internationale communiste. Si la guerre impérialiste mettait en lumière la réalité et l'avenir qu'offrait le capitalisme décadent à l'humanité, la vague révolutionnaire qui s'ensuivit et qui mit un terme à la boucherie impérialiste, secouant l'ordre bourgeois de fond en comble, d'Afrique du Sud jusqu'en Allemagne, de Russie jusqu'au Canada, montra quelle était la seule alternative à cette barbarie capitaliste : la révolution prolétarienne mondiale.
Cette vague révolutionnaire dont le point culminant fut la Révolution russe (voir Revue internationale n° 72, 73 et 75) constitue une véritable mine d'enseignements pour le mouvement ouvrier. Véritable vitrine à l'échelle mondiale de la lutte de classe dans la période de décadence capitaliste, la vague révolutionnaire de 1917-23 confirma pleinement et définitivement la plupart des positions politiques que défendent aujourd'hui les révolutionnaires (contre les syndicats et les partis « socialistes », contre les luttes de « libération nationale », la nécessité de l'organisation générale de la classe ouvrière en conseils ouvriers, etc.). Cet article se concentre sur quatre questions :
-comment la vague révolutionnaire transforma la guerre impérialiste en guerre civile entre les classes ;
- comment elle démontra la thèse historique des communistes quant à la nature mondiale de la révolution prolétarienne ;
-comment la guerre, tout en étant le facteur à l'origine de cette vague révolutionnaire, ne pose cependant pas les conditions les plus favorables pour la révolution prolétarienne ;
- l'importance déterminante de la lutte du prolétariat dans les pays les plus industrialisés du capitalisme.
La vague révolutionnaire met un terme à la Première Guerre mondiale
Dans la Revue internationale n° 78 («Polémique
avec Programme communiste », IIe partie), nous démontrons que la
déclaration de guerre en 1914 n'obéit pas directement à des causes
économiques, mais qu'elle survient parce que la bourgeoisie est parvenue, grâce
au réformisme dominant dans les partis sociaux-démocrates, à défaire
idéologiquement la classe ouvrière. Dans le même sens, la fin de la guerre
n'est pas le fruit d'une décision de la bourgeoisie mondiale qui, pour ainsi
dire, aurait «fait un bilan » et conclu que l'hécatombe était «
suffisante », qu'il fallait faire évoluer les «affaires », passant
de la destruction à la reconstruction. En novembre 1918, on ne relève pas la
moindre défaite significative des puissances centrales ([1] [1849]). Ce
qui met vraiment le Kaiser dans l'obligation de demander l'armistice, c'est
le besoin urgent de faire face à la révolution qui s'étendait en Allemagne. Et
si, pour leur part, les forces de l'Entente ne profitent pas alors de cette faiblesse
de leur ennemi impérialiste, c'est parce qu'elles sont conscientes de la nécessité
de resserrer les rangs contre l'ennemi commun, contre le danger représentant,
pour tout le capitalisme, l'extension de la révolution prolétarienne qui mûrit
jusque dans les propres pays composant l'Entente, même si à un niveau plus
embryonnaire.
Comment s'est développée cette réponse du prolétariat à la guerre ?
Avec l'accroissement de la barbarie de la boucherie mondiale, le prolétariat se défaisait progressivement du poids de la défaite d'août 1914([2] [1850]). Dès février 1915, les ouvriers de la vallée de la Clyde (Grande-Bretagne) lancent une grève sauvage (c'est-à-dire contre l'avis du syndicat), et cet exemple sera repris par les ouvriers des usines d'armement et les métallos de Liverpool. Des grèves éclatent en France, celles des travailleurs du textile de Vienne et de Lagors. En 1916, les ouvriers de Petrograd empêchent par la grève générale une tentative par le gouvernement de militarisation des travailleurs. En Allemagne, la Ligue Spartakus appelle à une manifestation d'ouvriers et de soldats, qui joint rapidement le mot d'ordre « A bas le gouvernement ! » à celui de « A bas la guerre ! ». C'est dans ce climat d'accumulation de signes de mécontentement que parviennent les premières nouvelles de la Révolution de février en Russie...
Une vague de grèves se répand en avril 1917 en Allemagne (Halle, Kiel, Berlin...). L'insurrection est évitée de justesse à Leipzig et les premiers conseils ouvriers se constituent tout comme en Russie. Sur le front oriental, le Premier mai, les drapeaux rouges flottent sur les tranchées russes et allemandes. Un tract circule parmi les soldats allemands : « Nos frères héroïques de Russie ont mis à terre dans leur pays le joug maudit des bouchers (...) Votre bonheur, votre progrès, dépendent de votre capacité à poursuivre et mener plus loin l'exemple de vos frères russes... Une révolution victorieuse demande moins de sacrifices qu'une guerre sauvage... »
En France, ce même Premier mai, dans un climat de grèves ouvrières (celle des métallos de Paris s'étend à 100 000 travailleurs d'autres secteurs), un meeting de solidarité avec les ouvriers russes proclame : « La révolution russe est le signal de la révolution universelle ». Sur le front, des conseils clandestins de soldats font circuler de la propagande révolutionnaire et collectent de l'argent pris sur la solde misérable pour soutenir les grèves à l'arrière.
De grandes manifestations contre la guerre se déroulent aussi en Italie. L'une d'elles, à Turin, voit surgir le mot d'ordre «Faisons comme en Russie » qui est repris rapidement dans tout le pays. Et effectivement, quand les regards de tous les ouvriers et soldats du monde entier se tourneront vers Petrograd en octobre 1917, ce mot d'ordre deviendra un puissant stimulant à des mobilisations destinées à en finir une fois pour toutes avec la boucherie impérialiste.
Ainsi, les ouvriers en Finlande, qui avaient déjà tenté une première insurrection quelques jours après Petrograd, prennent les armes en janvier 1918 et occupent les édifices publics à Helsinki et dans le sud du pays. Dans le même temps, une rébellion dans la flotte de la Mer noire oblige la Roumanie, où la Révolution russe avait un écho immédiat, à signer l'armistice avec les puissances centrales. En Russie même, la Révolution met un terme à l'implication du pays dans la guerre impérialiste, la révolution se trouvant à la merci - dans l'attente de son extension sur le plan international - de la rapine des puissances centrales sur de vastes territoires russes, lors de la paix dite « de Brest-Litovsk ».
En janvier 1918, les travailleurs de Vienne connaissent les conditions « de paix » draconiennes que leur gouvernement veut imposer à la Russie révolutionnaire. Face à la menace d'intensification de la guerre, les ouvriers de Daimler provoquent une grève qui en quelques jours va s'étendre et toucher 700 000 travailleurs dans tout l'Empire, au cours de laquelle s'organisent les premiers conseils ouvriers. A Budapest, le mot d'ordre de ralliement de la grève est : « A bas la guerre ! Vivent les ouvriers russes ! ». Il faut les appels au calme incessants des « socialistes » pour parvenir, non sans mal, à apaiser cette vague de luttes et écraser les révoltes de la flotte basée à Carthage ([3] [1851]). Fin janvier, on compte 1 million de grévistes en Allemagne. Malheureusement, les ouvriers laissent la direction de leur lutte entre les mains des « socialistes » qui s'allient avec les syndicats et l’Etat-major militaire pour y mettre fin et envoyer au front plus de 30 000 travailleurs qui s'étaient illustrés dans le combat prolétarien. C'est dans cette même période que surgissent les premiers conseils ouvriers en Pologne, dans les mines de Dombrowa et Lublin...
Le mouvement de solidarité avec la Révolution russe se développe aussi en Angleterre. La visite du délégué soviétique Litvinov, en janvier 1918, coïncide avec une grande vague de grèves et provoque de telles manifestations à Londres qu'un journal bourgeois, The Herald, les qualifie « d'ultimatum pour la paix des ouvriers au gouvernement ». En mai 1918 éclate en France la grève de Renault, qui s'étend rapidement à 250 000 travailleurs de Paris. En solidarité, les travailleurs de la région de la Loire se remettent en grève, contrôlant la région pendant dix jours.
Les dernières offensives militaires provoquent cependant une paralysie momentanée des luttes, mais leur échec convainc les ouvriers que la lutte de classe est le seul moyen de mettre un terme à la guerre. En octobre, en Autriche, éclatent les luttes des journaliers et la révolte contre l'envoi au front des régiments les plus « rouges » de Budapest, ainsi que des grèves et des manifestations massives. Le 4 novembre, la bourgeoisie de la « double couronne » se désengage enfin de la guerre.
En Allemagne, le Kaiser tente une « démocratisation » du régime (libération de Liebknecht, participation des « socialistes » au gouvernement) pour exiger du peuple allemand « qu'il verse jusqu'à la dernière goutte de son sang ». Mais les marins de Kiel refusent, le 3 novembre, d'obéir aux officiers qui veulent tenter une ultime bataille suicide de la flotte ; ils hissent le drapeau rouge sur l'ensemble de la flotte et organisent un conseil ouvrier avec les ouvriers de la ville. L'insurrection s'étend en quelques jours aux principales villes d'Allemagne ([4] [1852]). Le 9 novembre, quand l'insurrection gagne Berlin, la bourgeoisie allemande ne commet pas l'erreur du Gouvernement provisoire russe (qui avait maintenu sa participation dans la guerre, ce qui avait été un facteur de fermentation et de radicalisation de la révolution) et sollicite l'armistice. Le 11 novembre, la bourgeoisie met fin à la guerre impérialiste pour s'affronter à la classe ouvrière.
Le caractère international de la classe ouvrière et de sa révolution
Alors que les révolutions bourgeoises se limitaient à implanter le capitalisme dans le cadre de la nation, la révolution prolétarienne est nécessairement mondiale. Si les révolutions bourgeoises pouvaient s'échelonner sur plus d'un siècle, la lutte révolutionnaire du prolétariat, de par sa propre nature, tend à prendre la forme d'une gigantesque vague qui parcours la planète. Telle est depuis toujours la thèse historique des révolutionnaires. Dans ses Principes du communisme, Engels soulignait déjà :
« Cette révolution pourra-t-elle se produire en un seul pays ?
Réponse : non. La grande industrie, en créant le marché mondial, a déjà établi entre tous les peuples de la terre, principalement entre les peuples civilisés, des relations telles que chaque peuple ressent le contrecoup de ce qui se passe chez les autres. Elle a par ailleurs amené tous les pays civilisés à un même stade d'évolution sociale : dans tous ces pays la bourgeoisie et le prolétariat sont devenus les deux classes les plus importantes de la société et la lutte entre ces deux classes est devenue la lutte capitale de notre époque. La révolution communiste ne sera donc pas une révolution nationale uniquement, elle se fera simultanément dans tous les pays civilisés c'est-à-dire au moins en Angleterre, en Amérique, en France et en Allemagne. (...) Ce sera une révolution universelle, dont le terrain sera lui aussi universel. »
La vague révolutionnaire de 1917-23 a confirmé cela de façon éclatante. En 1919, le premier ministre britannique Lloyd George écrit : « L'Europe entière est envahie par l'esprit de la révolution. Il existe un sentiment profond parmi les ouvriers contre les conditions existantes, non de mécontentement mais de colère et de révolte (...). L'ensemble de l'ordre politique, social et économique est remis en question par les masses de la population, d'un bout à l'autre d'Europe » (cité par E.H. Carr, La Révolution bolchevique).
Mais le prolétariat ne parvient pas à transformer cette formidable vague de luttes en combat unifié. Nous verrons d'abord les faits pour mieux pouvoir par la suite analyser les obstacles sur lesquels a trébuché le prolétariat dans la généralisation de la révolution.
De novembre 1918 à août 1919 : les tentatives insurrectionnelles dans les pays vaincus...
Quand la révolution démarre en Allemagne, trois importants détachements du prolétariat d'Europe sont déjà pratiquement neutralisés (Hollande, Suisse et Autriche). En octobre 1918 éclatent des mutineries dans l'armée en Hollande (le propre commandement militaire coule sa flotte plutôt que de laisser les marins s'en emparer) et des conseils ouvriers se forment à Rotterdam et Amsterdam. Les « socialistes » prennent part à la révolte pour mieux pouvoir la neutraliser. Leur leader, Troëlstra, le reconnaît plus tard : « Si je n'étais pas intervenu révolutionnairement, les éléments ouvriers les plus énergiques auraient pris le chemin du bolchevisme » (P.-J. Troëlstra, De Revolutie en de SDAP). Désorganisée par ses propres « organisateurs », privée de l'appui des soldats, la lutte prend fin avec le mitraillage des ouvriers qui, le 13 novembre, s'étaient réunis dans un meeting près d'Amsterdam. La « Semaine rouge » se conclut par 5 morts et des dizaines de blessés.
Ce même jour, en Suisse, une grève générale de 400 000 ouvriers a lieu pour protester contre l'usage de la troupe contre les manifestations de commémoration du premier anniversaire de la Révolution russe. Le journal Volksrecht proclame : « Résister jusqu'au bout. Sont en notre faveur la révolution en Autriche et en Allemagne, les actions des ouvriers en France, le mouvement des prolétaires de Hollande et, principalement, le triomphe de la révolution en Russie ».
Là aussi, les « socialistes » et les syndicats donnent la consigne de cesser la lutte « pour ne pas jeter les masses désarmées sous les balles de l'ennemi », alors que c'est précisément ce pas en arrière qui va désorienter les masses et les diviser, ouvrant alors les vannes de la terrible répression qui mettra fin à la « Grande grève ». De son côté, le gouvernement de la « paisible » Suisse militarise les cheminots, organise une garde contre-révolutionnaire, rase sans scrupule les locaux des ouvriers, en emprisonne des centaines et instaure la peine de mort contre les « subversifs ».
La République est proclamée en Autriche le 12 novembre. Au moment de hisser le drapeau national rouge et blanc, des groupes de manifestants arrachent la frange blanche.
Hissés sur les épaules de la statue de Pallas Athénée, dans le centre de Vienne, les divers orateurs appellent l'assemblée composée de dizaines de milliers de travailleurs à passer directement à la dictature du prolétariat. Mais les « socialistes », appelés en renfort parce qu'ils sont les seuls à avoir une influence sur les masses ouvrières, déclarent : « Le prolétariat détient déjà le pouvoir. Le parti ouvrier gouverne la république » et entreprennent systématiquement d'affaiblir les conseils ouvriers, les transformant en conseils de production, comme ils transforment les comités de soldats en comités de régiments (massivement infiltrés par les officiers). Cette contre-offensive de la bourgeoisie va paralyser le prolétariat en Autriche, et servir de modèle de la contre-révolution pour la bourgeoisie allemande.
En Allemagne, l'armistice et la proclamation de la République vont provoquer un sentiment naïf de « victoire » que paiera très cher le prolétariat. Alors que les travailleurs ne parviennent pas à unifier les différents foyers de lutte et hésitent à se lancer dans la destruction de l'appareil d'Etat bourgeois ([5] [1853]), la contre-révolution s'organise et coordonne les syndicats, les partis « socialistes » et le haut-commandement militaire. A partir de décembre, la bourgeoisie passe à l'offensive par de constantes provocations au prolétariat de Berlin, dans le but de le faire partir en lutte et de l'isoler du reste du prolétariat allemand. Le 4 janvier 1919, le gouvernement destitue le préfet de police Eischorn, défiant l'opinion des travailleurs. Le 6 janvier, un demi million de prolétaires berlinois sort dans la rue. Le lendemain même, à la tête des corps-francs (officiers et sous-officiers démobilisés payés par le gouvernement), le « socialiste » Noske écrase les ouvriers de Berlin. Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht sont assassinés quelques jours plus tard.
Bien que les événements de Berlin alertent les ouvriers d'autres villes (en particulier à Brème où les locaux syndicaux sont pris d'assaut et le contenu de leurs caisses distribué entre les chômeurs), le gouvernement parvient malgré tout à diviser cette riposte, de façon à concentrer ses forces dans un premier temps sur Brème, ensuite sur les ouvriers de Rhénanie et de la Ruhr, pour finir par revenir éteindre les dernières braises à Berlin, au cours de la tristement célèbre « Semaine sanglante » au cours de laquelle sont assassinés 1 200 ouvriers en mars. Ensuite seront écrasés les ouvriers de Mansfeld, de Leipzig et la République des Conseils de Magdebourg...
En avril 1919, les travailleurs proclament à Munich la République des Conseils de Bavière, qui constitue avec la Révolution hongroise et l'Octobre russe les seules expériences de prise de pouvoir par le prolétariat. Les ouvriers bavarois en armes sont même capables de défaire la première armée contre-révolutionnaire envoyée contre eux par le Président destitué Hoffmann. Mais hélas, comme nous l'avons vu, le reste du prolétariat allemand a déjà subi de sévères défaites et ne peut apporter son soutien à ses frères, cependant que la bourgeoisie lève une armée qui écrasera l'insurrection au cours des premiers jours de mai. Parmi les troupes qui sèment la terreur à Munich s'illustrent alors des noms tels que Himmler, Rudolf Hess, Von Epp..., futurs dignitaires du nazisme encouragés dans leur furie anti-prolétarienne par un gouvernement qui se proclame « socialiste ».
Le 21 mars 1919, à la suite d'une formidable vague de grèves et de meetings, les conseils ouvriers prennent le pouvoir en Hongrie. Par une erreur tragique, les communistes s'unifient dans ce même temps avec les « socialistes » qui vont s'employer à saboter la révolution, alors même que les «démocraties » occidentales (et en particulier la France et l'Angleterre) imposent un blocus économique auquel s'ajoute une intervention militaire des armées roumaine et tchèque. En mai, alors que sont vaincus les conseils ouvriers de Bavière, la situation de la révolution hongroise est désespérée. Une formidable réaction ouvrière parvient toutefois à rompre l'encerclement militaire, réaction à laquelle participent aussi bien des travailleurs hongrois, autrichiens, polonais et russes, que des tchèques ou des roumains. A la longue, cependant, le sabotage des « socialistes » et l'isolement de la révolution vont avoir raison de la résistance prolétarienne et les troupes roumaines prennent Budapest le 1er août, instaurant un gouvernement syndical qui liquidera les conseils ouvriers. Mission accomplie, les syndicats confient le pouvoir à l'amiral Horty (lui aussi futur collaborateur des nazis) qui déchaînera alors une terreur sanglante contre les ouvriers (8 000 exécutions, 100 000 déportations...). La chaleur de la révolution hongroise pousse les mineurs de Dombrowa (Pologne) à prendre le pouvoir dans la région et ils forment une Garde ouvrière pour se défendre de la sanglante répression d'un autre « socialiste », Pilsudski. La République rouge de Dombrowa s'éteint avec les conseils ouvriers hongrois.
La révolution hongroise provoque les dernières réactions ouvrières en Autriche et en Suisse, en juin 1919. La police de Vienne, forte des leçons apprises de ses acolytes allemands, machine une provocation (l'assaut du local du PC) pour précipiter l'insurrection alors que le prolétariat est encore faible et désorganisé. Les ouvriers tombent dans ce piège et laissent dans les rues de Vienne plus de 30 morts. Il advient la même chose en Suisse, après la grève générale des ouvriers de Zurich et Bâle.
...et dans les pays « vainqueurs »
A nouveau dans la région de La Clyde en Grande-Bretagne, plus de 100 000 ouvriers sont en grève dès janvier 1919. Le 31 janvier (le « Vendredi rouge »), au cours d'une concentration ouvrière à Glasgow, les prolétaires s'affrontent durement aux régiments appuyés par l'artillerie que le gouvernement à dépêchés sur place. Les mineurs sont prêts à entrer en lutte, mais les syndicats parviennent à stopper ce mouvement pour « donner une marge de confiance au gouvernement afin que celui-ci étudie la nationalisation (!) des mines » (Hinton et Hyman, Trade Unions and Révolution).
A Seattle, aux Etats-Unis, éclate une grève dans les chantiers navals qui s'étend à toute la ville en quelques jours. Grâce à des assemblées massives et un comité de grève élu et révocable, les ouvriers contrôlent le ravitaillement et la défense contre les troupes envoyées par le gouvernement. La « Commune de Seattle » restera cependant isolée et, un mois plus tard, au prix de centaines d'emprisonnements, les travailleurs des chantiers navals reprendront le travail. Plus tard éclateront d'autres luttes comme celle des mineurs de Buttle (Montana), qui va jusqu'à s'organiser en conseil d'ouvriers et de soldats, et la grève de 400 000 ouvriers de la sidérurgie. Mais, là non plus, les luttes ne parviennent pas à s'unifier.
Au Canada, pendant la grève générale de Winnipeg, en mai 1919, le gouvernement local organise un meeting patriotique pour tenter de contrecarrer la pression ouvrière avec le chauvinisme de la victoire. Mais les soldats, après avoir décrit les horreurs de la guerre, proclament la nécessité de « transformer la guerre impérialiste en guerre de classes », et cette radicalisation pousse le mouvement jusqu'à s'étendre aux travailleurs de Toronto. Les travailleurs laissent une fois de plus la direction de la lutte entre les mains des syndicats, ce qui les conduit immanquablement à l'isolement et à la défaite, puis à subir la terreur du « lumpen » de la ville dont le gouvernement a nommé certains éléments « commissaires extraordinaires ».
Mais la vague révolutionnaire ne reste pas cantonnée aux pays directement concernés par la boucherie impérialiste. En Espagne éclate en 1919 une grève à La Canadien se qui s'étend rapidement à tout le cordon industriel de Barcelone. Sur les murs des haciendas andalouses, les journaliers à moitié analphabètes écrivent « Vivent les soviets ! » et « Vive Lénine ! ». Les mobilisations des journaliers durant les années 1918-19 resteront dans l'histoire sous le nom des « deux années bolcheviques ».
Mais des épisodes de cette vague se déroulent également loin des grandes concentrations ouvrières d'Europe et d'Amérique du Nord. En Argentine, en 1919, durant la « Semaine sanglante » de Buenos Aires, les ouvriers répliquent par la grève générale à la répression déchaînée par le gouvernement contre les ouvriers de l'usine « Talleres Vasena ». Après cinq jours de combats de rue, l'artillerie bombarde les quartiers ouvriers causant 3 000 morts. Au Brésil, la grève de 200 000 travailleurs à Sao Paolo fraternise avec les régiments envoyés par le gouvernement pour les réprimer. Dans les favelas de Rio de Janeiro, une «République ouvrière » est proclamée en 1918, qui reste isolée et cède sous la pression de l'état de siège décrété par le gouvernement.
En Afrique du Sud, pays de la « haine raciale », les luttes ouvrières mettent en évidence la nécessité et la possibilité de lutter unis : « La classe ouvrière d'Afrique du Sud ne pourra s'émanciper tant qu'elle n'aura pas dépassé les préjugés racistes et l'hostilité envers les travailleurs d'une autre couleur » (The International, journal des Ouvriers industriels d'Afrique). En mars 1919, la grève des tramways s'étend à tout Johannesburg, avec assemblées et meetings de solidarité avec la Révolution russe. Et au Japon, en 1918, se déroulèrent les fameux « meetings du riz » contre l'expédition de riz aux troupes japonaises envoyées contre la révolution en Russie.
1919-1921 : le redressement tardif du prolétariat des pays « vainqueurs » et le poids de la défaite en Allemagne
Le prolétariat jouait très gros durant cette première phase de la vague révolutionnaire. D'abord, il fallait que le bastion révolutionnaire russe sorte de l'asphyxie de l'isolement ([6] [1854]). Mais se jouait aussi le cours même de la révolution, puisque des détachements du prolétariat (Allemagne, Autriche, Hongrie...) s'étaient engagés dans le combat, ce qui était déterminant pour le futur de la révolution mondiale du fait de leur force et de leur expérience. Mais la première phase de la vague révolutionnaire va se solder, nous l'avons vu, par de profondes défaites que le prolétariat ne parviendra pas à surmonter.
Les travailleurs d'Allemagne appuient en 1920 la grève générale convoquée par les syndicats contre le « putsch de Kapp », pour rétablir le soi-disant gouvernement démocratique de Scheidemann. Les travailleurs de la Ruhr refusent cependant de remettre au pouvoir celui qui a déjà assassiné 30 000 ouvriers, prennent les armes et forment « l'Armée rouge de la Ruhr ». Dans certaines villes (Duisbourg), ils vont jusqu'à emprisonner les leaders socialistes et les syndicalistes. Mais la lutte reste à nouveau isolée. Début avril, l'armée allemande réorganisée écrase la révolte de la Ruhr.
En 1921, la bourgeoisie allemande va se consacrer à « nettoyer » les révolutionnaires irréductibles en Allemagne centrale, utilisant toujours de nouvelles provocations (l'assaut des usines Leuna à Mansfeld). Les communistes du KAPD, en pleine désorientation, tombent dans le piège et appellent à « l'action de mars », au cours de laquelle les ouvriers de Mansfeld, Halle, etc., ne parviennent pas à vaincre la bourgeoisie malgré des combats héroïques. Celle-ci profitera de la dispersion du mouvement pour d'abord massacrer les ouvriers en Allemagne centrale, ensuite les ouvriers qui à Hambourg, Berlin et dans la Ruhr s'étaient solidarisés avec le mouvement.
Pour la lutte de la classe ouvrière, internationale par nature, ce qui advient dans une partie du monde a des répercussions dans les autres. C'est ce qui explique que quand le prolétariat des pays vainqueurs de la guerre (Angleterre, France, Italie...) entre massivement en lutte, une fois passée l'euphorie chauvine de la « victoire », les répercussions des défaites successives du prolétariat en Allemagne le rendront plus vulnérable aux pires mystifications : nationalisations, « contrôle ouvrier » de la production, confiance aux syndicats, manque de confiance en ses propres forces...
Une grève générale des cheminots, extrêmement dure, éclate en Angleterre en septembre 1919. Malgré les manoeuvres d'intimidation de la bourgeoisie (navires de guerre à l'embouchure de la Tamise, patrouilles de soldats dans les rues de Londres), les ouvriers ne cèdent pas. Bien au contraire, les ouvriers des transports veulent à leur tour partir en grève, mais les syndicats les en empêchent. Il adviendra la même chose plus tard, quand les mineurs appelleront à la solidarité des cheminots. Le bonze syndical de service proclamera : « A quoi bon l'aventure d'une grève générale, puisque nous avons à notre disposition un moyen plus simple, moins coûteux et certainement moins dangereux. Nous devons montrer à tous les travailleurs que le meilleur moyen est d'utiliser intelligemment le pouvoir que nous offre la Constitution la plus démocratique du monde, qui leur permet d'obtenir tout ce qu'ils désirent » ([7] [1855]).
Comme les travailleurs peuvent le constater immédiatement, la « bourgeoisie la plus démocratique du monde » n'hésite pas à engager des tueurs, des briseurs de grève, des provocateurs, et la vague de licenciements qui s'ensuit touche un million d'ouvriers.
Malgré tout, les ouvriers continuent à faire confiance aux syndicats. Ils le paieront très cher: en avril 1921, les mineurs décident une grève générale, mais le syndicat fait machine arrière en laissant les ouvriers isolés et désorientés (le 15 avril reste le « Vendredi noir » dans la mémoire ouvrière), à la merci des attaques gouvernementales. Une fois qu'elle aura défait les principaux bastions ouvriers, cette bourgeoisie qui « permet aux ouvriers d'obtenir tout ce qu'ils désirent » réduira les salaires de plus de 7 millions d'ouvriers.
En France, l'aggravation des conditions de vie de la classe ouvrière (essentiellement la pénurie d'aliments et de combustible) provoquera une vague de luttes ouvrières au cours des premiers mois de 1920. Dès février, les cheminots constituent le centre du mouvement de grèves qui parvient à s'étendre et provoquer la solidarité d'autres secteurs malgré l'opposition des syndicats. Prenant le train en marche, si l'on peut dire, le syndicat CGT décide de prendre la tête de la lutte et décide alors d'une tactique de « vagues d'assaut », qui consiste à faire débrayer un jour les mineurs, le lendemain les métallos, etc. ; de cette façon, ils parviennent à empêcher le mouvement de s'unifier, l'éparpillent et le font péricliter. Le 22 mai, il ne reste plus que les cheminots en grève, c'est la défaite : 18 000 licenciements disciplinaires. Les syndicats sont bien sûr déconsidérés à l'issue de cette bataille (plus de 60 % de démissions) mais leur sabotage des luttes a porté ses fruits : le prolétariat français est défait et se trouve à la merci des expéditions punitives des « Ligues civiques».
En Italie, où s'étaient développées de formidables luttes ouvrières contre la guerre impérialiste tout au long de 1917-18, et d'autres encore contre l'expédition d'approvisionnement aux armées qui combattaient la révolution en Russie ([8] [1856]), le prolétariat est cependant incapable de se lancer à l'assaut de l'Etat bourgeois. En réaction à la faillite de nombreuses entreprises, l'été 1920 voit une fièvre « d'occupations » embraser le pays, impulsées par les syndicats : elles dévient le prolétariat de la perspective d'affrontement contre l’Etat, tout en l'enchaînant au « contrôle de la production » dans chaque usine. Il suffit de rappeler que le propre gouvernement Giolitti prévient les chefs d'entreprise qu'il «n'utilisera pas l'armée pour déloger les ouvriers, car cela déplacerait la lutte de l'usine vers la rue » (cité par M. Ferrara, Conversations avec Togliatti). La combativité ouvrière s'effiloche dans ces occupations d'usines. La défaite de ce mouvement, quoiqu'il soit prolongé par de nouvelles mais isolées grèves en Lombardie, à Venise, etc., ouvrira les vannes de la contre-révolution qui, dans ce cas précis, a pris la forme du fascisme.
La classe ouvrière subit aussi d'importantes défaites aux Etats-Unis (grèves dans les mines de charbon, dans les mines de lignite d'Alabama, dans les chemins de fer) en 1920. La contre-offensive capitaliste impose les « conventions ouvertes » (impossibilité de conventions collectives) qui aboutissent à une baisse des salaires de l'ordre de 30 %.
Les derniers soubresauts de la vague révolutionnaire
Bien qu'elle continue à exploser dans d'héroïques combats, la vague révolutionnaire est entrée dans sa phase finale à partir de 1921. D'autant plus que le poids des défaites conduit les révolutionnaires de l'Internationale communiste à commettre des erreurs toujours plus graves (application de la politique de «front unique », soutien aux luttes de « libération nationale », expulsion de 1’IC des fractions révolutionnaires de la Gauche communiste...), qui provoquent encore plus de confusions et à leur tour, dans une spirale dramatique, provoquent de nouvelles défaites.
En Allemagne; la combativité ouvrière est toujours plus dévoyée vers « l’antifascisme » (par exemple lorsque l'extrême-droite assassine Ersberger, ou quand un belliciste exige que Kiel soit rasée de la carte en novembre 1918) ou vers le nationalisme. Quand la Ruhr est envahie par les armées belge et française en 1923, le KPD brandit le drapeau abject du « national-bolchèvisme » en appelant le prolétariat à défendre la « patrie allemande », soi-disant progressiste, contre l'impérialisme représenté par les puissances de l'Entente. En octobre de cette même année, le Parti communiste, qui siège au gouvernement en Saxe et Thuringe, prend la décision de provoquer des insurrections, dont la première a lieu le 20 octobre à Hambourg. Le KPD revient sur sa décision quand les ouvriers sont déjà dans la rue, et ces derniers doivent seuls faires face à une terrible répression. Exsangue, démoralisé, cruellement réprimé, le prolétariat allemand est défait. Quelques jours plus tard, Hitler lancera son fameux «putsch de la bière », tentative de coup d’Etat lancée depuis une brasserie de Munich, qui échouera (comme on sait, Hitler parviendra au pouvoir par la « voie parlementaire » dix ans plus tard).
Le prolétariat polonais, qui en 1920 avait fait front avec sa bourgeoisie contre l'invasion du pays par l'Armée rouge, retrouve son terrain de classe en 1923 avec une nouvelle vague de grèves. Mais l'isolement international permet à la bourgeoisie de garder le contrôle de la situation et de monter toute une série de provocations (l'incendie de la poudrerie de Varsovie, dont seront accusés les communistes) pour s'affronter aux travailleurs tant que ceux-ci sont encore dispersés. Une insurrection éclate le 6 novembre à Cracovie, mais les mensonges des « socialistes » parviennent à désorienter et démoraliser les travailleurs (notamment en parvenant à ce que ceux-ci leur rendent les amies). Malgré la vague de grèves de solidarité avec Cracovie (Dombrowa, Gornicza, Tarnow...), la bourgeoisie parvient en quelques jours à éteindre cette flambée ouvrière.
En 1926, le prolétariat polonais servira de chair à canon dans la rivalité entre fractions de la bourgeoisie qui opposa le gouvernement « philo-fasciste » et Pilsudski soutenu par la gauche en tant que « défenseur de la liberté ».
En Espagne, les vagues de luttes seront systématiquement freinées par le PSOE (Parti socialiste) et le syndicat UGT, ce qui permettra au général Primo de Rivera d'imposer sa dictature en 1923 ([9] [1857]).
En Angleterre, après quelques mouvements divisés et très isolés (marche des chômeurs sur Londres en 1921 et 1923, grève générale dans le bâtiment en 1924), la bourgeoisie confirmera sa victoire en 1926. Face à une nouvelle vague de luttes des mineurs, les syndicats organisent une « grève générale » qu'ils annuleront 10 jours plus tard, abandonnant les mineurs qui reprendront le travail en décembre au prix de milliers de licenciements. La défaite de cette lutte consacrera la victoire de la contre-révolution en Europe.
Dans cette phase définitive de déclin de la vague révolutionnaire, les mouvements révolutionnaires du prolétariat dans les pays de la périphérie du capitalisme sont à leur tour défaits. En Afrique du Sud, c'est le cas avec la « Révolte rouge du Transvaal » contre le remplacement des travailleurs de race blanche par des travailleurs de race noire moins payés, en 1922, qui s'était étendue à d'autres secteurs d'industrie (mines de charbon, chemins de fer...), toutes races confondues, et qui avait pris parfois des tournures insurrectionnelles. En 1923, l'armée hollandaise et les tueurs à gage engagés par les planteurs locaux s'unissent pour venir à bout de la grève des chemins de fer à Java, qui s'était étendue à Surabaj et à Jemang (Indonésie).
En Chine, le prolétariat avait été conduit (par la néfaste thèse de 1’IC sur l'appui aux mouvements de « libération nationale ») à soutenir les actions de la bourgeoisie nationaliste organisée dans le Kuomintang, qui pourtant n'hésitait pas à réprimer sauvagement les travailleurs quand ceux-ci luttaient sur leur terrain de classe, comme à Canton en 1925, lors de la grève générale. En février et mars 1927, les ouvriers de Shanghaï préparent par des insurrections l'entrée dans la ville du général nationaliste Tchang Kaï-Chek. Ce leader « progressiste » (selon 1’IC) n'hésite pas non plus, sitôt la ville prise, à s'allier avec les commerçants, les paysans, les intellectuels et surtout le « lumpen » pour réprimer par le sang et le feu la grève générale décrétée par le Conseil ouvrier de Shanghaï pour protester contre l'interdiction du droit de grève décrétée par le « libérateur ». Et malgré les horreurs commises dans les quartiers ouvriers de Shanghaï pendant les deux mois de la répression, 1’IC appellera encore à soutenir « l'aile gauche » du Kuomintang, installée à Wuhan. Cette gauche nationaliste a fusillé sans sourciller les ouvriers qui, par leurs grèves, « irritaient les industriels étrangers (...), en gênant leurs intérêts commerciaux » (M. N. Roy, Révolution et contre-révolution en Chine). Quand le PC décide enfin l'insurrection, alors que le mouvement ouvrier est défait, il ne fait qu'augmenter les dégâts : lors de la Commune de Canton, en décembre 1927, 2 000 ouvriers périssent assassinés.
Cette lutte du prolétariat en Chine n'est que l'épilogue tragique de la vague révolutionnaire mondiale et, comme l'analysèrent les révolutionnaires de la Gauche communiste, elle marque une étape décisive dans le passage des partis « communistes » dans les rangs de la contre-révolution. Cette contre-révolution s'étend comme une immense et profonde nuit qui durera plus de 40 ans, pour s'achever avec le resurgissement des combats de la classe ouvrière à la fin des années 1960.
La guerre ne crée pas les conditions les plus favorables à la révolution
Pourquoi cette vague révolutionnaire a-t-elle échoué ? Il ne fait pas de doute que les incompréhensions du prolétariat et de ses minorités révolutionnaires quant aux conditions de la nouvelle période historique ont pesé lourdement ; mais il faut aussi comprendre que les conditions objectives créées par la guerre impérialiste ont empêché ces torrents de luttes de se rejoindre dans un combat unifié. Dans l'article « Les conditions historiques de la généralisation de la lutte de la classe ouvrière » (Revue Internationale n° 26), nous disions : « La guerre est un grave moment de la crise du capitalisme, mais nous ne pouvons pour autant nier que c'est également une réponse du capitalisme à sa propre crise, un moment avancé de sa barbarie et que, en tant que tel, il ne joue pas forcément en faveur des conditions de la généralisation de la révolution ».
On peut le vérifier à la lumière des faits de cette vague révolutionnaire.
La guerre suppose un bain de sang pour le prolétariat
Comme l'explique Rosa Luxemburg :
« Mais pour que le socialisme puisse faire sa trouée et remporter la victoire, il faut qu'existent des masses dont la puissance réside tant dans leur niveau culturel que dans leur nombre. Et ce sont ces masses précisément qui sont décimées dans cette guerre. La fleur de l'âge viril et de la jeunesse, des centaines de milliers de prolétaires dont l'éducation socialiste, en Angleterre et en France, en Belgique, en Allemagne et en Russie, était le produit d'un travail d'agitation et d'instruction d'une dizaine d'années, d'autres centaines de milliers qui demain pouvaient être acquis au socialisme - ils tombent et ils tuent misérablement sur les champs de bataille. Le fruit de dizaines d'années de sacrifices et d'efforts de plusieurs générations est anéanti en quelques semaines, les troupes d'élite du prolétariat international sont décimées » (Rosa Luxemburg, La crise de la social-démocratie, Chap. VII).
Une très grande partie des 70 millions de soldats était constituée de prolétaires qui avaient dû laisser leur place dans les usines aux femmes, aux enfants, à la main d'œuvre immigrée des colonies n'ayant que très peu d'expérience des luttes. En outre, l'armée dilue ces prolétaires dans une masse inter-classiste avec les paysans, le lumpen... C'est ce qui fait que les actions de ces soldats (désertions, insubordinations...) ne se si tuent pas sur un terrain de lutte authentiquement prolétarien, même si, pour autant, la bourgeoisie n'en profite pas. Les désertions dans l'armée austro-hongroise, par exemple, sont en grande partie dues au refus des tchèques et des hongrois... de se battre pour l'Empereur de Vienne. Les mutineries dans l'armée française ne se dirigent pas contre la guerre elle-même, mais contre « une certaine façon de mener la guerre » (l'inefficacité de certaines manoeuvres, etc.). La radicalité et la conscience qui se développent chez certains soldats (fraternisations, refus de réprimer des luttes ouvrières...) sont surtout la conséquence de la mobilisation à l'arrière. Et quand la question se pose, après l'armistice, de détruire le capitalisme pour en finir une bonne fois avec les guerres, les soldats sont le secteur le plus hésitant et rétrograde. C'est d'ailleurs pour cela que la bourgeoisie allemande, par exemple, fait en sorte de surdimensionné le poids des Conseils de soldats face aux Conseils ouvriers.
Le prolétariat « ne contrôle pas » la guerre
La guerre mondiale exige une défaite préalable du prolétariat. Et même dans les pays où le poids de l'idéologie réformiste qui a présidé à cette défaite est le plus faible, les luttes cessent en 1914 : en Russie, par exemple, la vague croissante de luttes qui s'était développée en 1912-1913 s'interrompt brusquement.
Mais en outre, au cours même de la guerre, la lutte de classe est mise au second plan derrière le vacarme des opérations militaires. Quand bien même les défaites militaires accentuent le mécontentement (l'échec de l'offensive de l'armée russe en juin 17 provoque les Journées de juin), il n'en est pas moins vrai que les offensives du rival impérialiste et les succès militaires de son propre impérialisme poussent le prolétariat dans les bras des « intérêts de la Patrie ». C'est ainsi qu'en automne 1918 ont lieu les dernières offensives militaires allemandes, à un moment historique crucial pour la révolution mondiale (quelques mois à peine après le Révolution russe) :
- elles paralysent la vague de grèves qui se propageait depuis janvier en Allemagne et en Autriche, grâce aux « conquêtes » réalisées en Russie et en Ukraine, présentées comme étant « la paix du pain » par les propagandistes des armées ;
- elles poussent les soldats français, qui commençaient à fraterniser avec les ouvriers de la Loire, à resserrer les rangs derrière leur bourgeoisie ; ces mêmes soldats seront ceux qui réprimeront les grèves dès l'été.
Et surtout, lorsque la bourgeoisie voit menacée sa domination de classe par le prolétariat, elle peut priver la révolution montante de son principal stimulant. Si la bourgeoisie russe n'avait pas compris cela, tel n'est pas le cas de la bourgeoisie en Allemagne qui est beaucoup plus expérimentée (et avec elle l'ensemble de la bourgeoisie mondiale). Pour intenses que soient les antagonismes impérialistes entre les fractions capitalistes nationales, c'est la solidarité qui les unit dès qu'il s'agit de manifester une solidarité de classe pour s'affronter au prolétariat.
Le sentiment de soulagement que provoque l'Armistice parmi les ouvriers affaiblit leurs luttes (en Allemagne par exemple) mais renforce par contre le poids des mystifications bourgeoises. En présentant la guerre impérialiste comme une « anomalie » du fonctionnement du capitalisme (la Grande guerre devait être la « der des der »), la bourgeoisie tente de faire croire aux ouvriers que la révolution n'est pas nécessaire, que tout « redevient comme avant ». Cette sensation de « retour à la normale » renforce les moyens de la contre-révolution : les partis « socialistes » et leur fameuse « évolution progressive vers le socialisme » et les syndicats avec leurs armes habituelles (« contrôle ouvrier de la production », nationalisations...).
La guerre brise la généralisation des luttes
Enfin, la guerre brise la généralisation des luttes en divisant la riposte ouvrière entre pays vainqueurs et pays vaincus. Les gouvernements de ces derniers sont certainement affaiblis par la défaite militaire, mais l'effondrement d'un gouvernement ne signifie pas forcément un renforcement du prolétariat. Après la chute de l'Empire hongrois, par exemple, le «prolétariat des nations opprimées » est entraîné à la guerre pour « l'indépendance » de la Tchécoslovaquie, de la Hongrie, de la Yougoslavie... ([10] [1858]). Les ouvriers hongrois qui ont pris Budapest le 30 octobre, la grève générale en Slovaquie de 1918..., sont dévoyés de leur cours et entraînés sur le terrain pourri de la « libération nationale ». En Galicie (alors en Autriche), les mouvements qui s'étaient développés contre la guerre cèdent le pas aux manifestations « pour l'indépendance de la Pologne et la défaite de l'Allemagne ! ». Le prolétariat de Vienne se retrouve pratiquement isolé lors de sa tentative insurrectionnelle de novembre 1918.
Dans les pays vaincus, la révolte est plus immédiate mais aussi plus désespérée, et en conséquence dispersée et inorganisée. Parce qu'isolée de la lutte des ouvriers des pays vainqueurs, la rage des prolétaires dans les pays vaincus peut finalement être facilement déviée vers le « revanchardisme ». Tel sera le cas en Allemagne en 1923, après l'invasion de la Ruhr par les années franco-belges.
Par contre, dans les pays vainqueurs, la combativité ouvrière se voit étouffée par l'euphorie chauvine de la victoire ([11] [1859]), ce qui fait que les luttes ne peuvent se développer que plus lentement, comme si les ouvriers attendaient les « dividendes de la victoire » ([12] [1860]). Il faudra attendre que les mystifications s'évanouissent au feu des terribles conditions de vie de l'après-guerre (en particulier quand le capitalisme entrera en 1920 dans une phase de crise économique) pour que les ouvriers entrent massivement en lutte, en Angleterre, France, Italie... Mais alors le prolétariat des pays vaincus a déjà subi des défaites décisives, comme nous l'avons vu. La fragmentation des luttes ouvrières entre pays vainqueurs et pays vaincus permet en outre à la bourgeoisie de coordonner l'ensemble de ses forces, les engageant en renfort dans les pays où se mène ponctuellement le combat contre le prolétariat. Comme le dénonçait Karl Marx après l'écrasement de la Commune de Paris : « Le fait sans précédent qu'après la guerre la plus terrible des temps modernes, le vaincu et le vainqueur fraternisent pour massacrer en commun le prolétariat (...) La domination de classe ne peut plus se cacher sous un uniforme national, les gouvernements nationaux ne font qu'UN contre le prolétariat » (Marx, La Guerre civile en France, Chap. IV).
Les exemples ne manquent pas :
- Avant même la fin de la guerre, les pays de l'Entente ferment les yeux quand l'armée allemande écrase la révolution ouvrière de Finlande en mars 1918, et aussi quand elle écrase, en septembre 1918, la révolte dans l'armée hongroise à Vladai.
- Contre la révolution en Allemagne, c'est le président des USA Wilson lui-même qui impose au Kaiser l'entrée des « socialistes » au gouvernement, car c'est la seule force capable de s'affronter à la révolution. L'Entente fournit peu après 5 000 mitrailleuses au gouvernement allemand pour massacrer les révoltes ouvrières. Et en mars 1919, l'armée de Noske manoeuvrera avec le complet accord de Clemenceau à travers la zone « démilitarisée » de la Ruhr pour écraser l'un après l'autre tous les foyers de révolution.
- Sous les ordres du colonel anglais Cunningham, de sinistre mémoire, un centre coordinateur de la contre-révolution fonctionne dès la fin de 1918 à Vienne ; c'est lui qui coordonne l'action des armées tchèque et roumaine en Hongrie. Quand en juillet 1919 l'armée des Conseils en Hongrie tente une action militaire sur le front roumain, l'armée roumaine l'attend, prévenue de cette opération par les « socialistes » hongrois qui en avaient avisé le « centre anti-bolchevique » de Vienne.
- Le chantage de « l'aide humanitaire » de l'Entente s'ajoute à la collaboration militaire, pour forcer le prolétariat à accepter sans rechigner l'exploitation et la misère. Quand les Conseils hongrois appellent, en mars 1919, les ouvriers autrichiens à se joindre à la lutte, le « révolutionnaire » F. Adler leur répond : « Vous nous appelez à suivre votre exemple. Nous le ferions de tout coeur mais nous ne le pouvons malheureusement pas. Il n'y a plus trace de nourriture dans notre pays. Nous sommes totalement les esclaves de l'Entente ». (Arbeiter-Zeitung, 23 mars 1919).
En conclusion, nous pouvons donc affirmer que, contrairement à ce que pensaient nombre de révolutionnaires ([13] [1861]), la guerre ne crée pas les conditions les plus favorables à la généralisation de la révolution. Cela ne veut en rien dire que nous serions « pacifistes », comme le colportent les groupes révolutionnaires bordiguistes. Au contraire, nous défendons avec Lénine que « la lutte pour la paix sans action révolutionnaire n'est qu'une phrase creuse et mensongère ». C'est précisément notre rôle d'avant-garde de cette lutte révolutionnaire qui exige de nous que nous tirions les leçons des expériences ouvrières, et d'affirmer (Op. cit., Revue internationale n° 26.) que le mouvement de luttes contre la crise économique du capitalisme qui s'est développé à partir de la fin des années 1960, s'il peut paraître moins « radical », plus tortueux et contradictoire, établit une base matérielle autrement plus ferme pour la révolution mondiale du prolétariat :
- La crise économique frappe tous les pays sans exception. Indépendamment du niveau de dévastation que la crise peut provoquer dans les différents pays, il est absolument sûr qu'il n'y a ni « vainqueurs », ni « vaincus », pas plus qu'il n'y a de pays « neutre ».
- Contrairement aux conditions créées par la guerre impérialiste, qui font que la bourgeoisie peut décréter la paix pour contrer le danger d'une révolution ouvrière, la crise économique ne peut être interrompue, pas plus que ne peuvent être évitées les attaques toujours plus violentes contre les travailleurs.
- Il est très significatif que ces groupes qui nous taxent de « pacifistes » soient les mêmes qui tendent à sous-estimer les luttes ouvrières contre la crise.
Le rôle décisif des principales concentrations ouvrières
Quand le prolétariat prend le pouvoir en Russie, les mencheviks et, avec eux, l'ensemble des « socialistes » et centristes dénoncent « l'aventurisme » des bolcheviks : d'après eux, la Russie est un pays « sous-développé », pas encore mûr pour la révolution socialiste. C'est précisément la juste défense du caractère prolétarien de la Révolution d'Octobre qui conduit les bolcheviks à expliquer le « paradoxe » du surgissement de la révolution mondiale à partir de la lutte d'un prolétariat « sous-développé » comme le prolétariat russe ([14] [1862]), au moyen de la thèse erronée selon laquelle la chaîne de l'impérialisme mondial se briserait d'abord en ses maillons les plus faibles ([15] [1863]). Mais une analyse de la vague révolutionnaire permet de réfuter d'une manière marxiste aussi bien le mythe selon lequel le prolétariat des pays du tiers-monde ne serait pas prêt pour la révolution socialiste que son apparente « antithèse », selon laquelle il disposerait de plus grandes facilités.
1) Précisément, la Première Guerre mondiale marque le moment historique de l'entrée du capitalisme dans sa phase de décadence. Cela signifie que les conditions de la révolution prolétarienne (développement suffisant des forces productives, mais aussi de la classe révolutionnaire chargée d'enterrer la société moribonde) existent au niveau mondial.
Le fait que la vague révolutionnaire s'étende aux quatre coins de la planète et que, dans tous les pays, les luttes ouvrières affrontent l'action contre-révolutionnaire de toutes les fractions de la bourgeoisie, met clairement en évidence que le prolétariat (indépendamment du degré de développement qu'il ait pu atteindre dans chaque pays) n'a pas de tâches différentes en Europe et dans le « tiers-monde ». Il n'y a donc pas un prolétariat « prêt » pour le socialisme (dans les pays développés) et un prolétariat « immature pour la révolution » qui devrait encore traverser la «phase démocratico-bourgeoise ». Précisément, la vague révolutionnaire internationale que nous sommes en train d'analyser montre comment les ouvriers d'un pays en retard, comme la Norvège, découvrent que : « les revendications des travailleurs ne peuvent être satisfaites par des moyens parlementaires, mais par les actions révolutionnaires de tout le peuple travailleur » (Manifeste du conseil ouvrier de Cristiania, mars 1918). Cette vague révolutionnaire montre aussi comment les ouvriers des plantations indonésiennes, ou bien ceux des favelas de Rio, construisent des Conseils ouvriers ; comment les travailleurs berbères s'unissent aux immigrés européens contre la bourgeoisie « nationaliste » dans une grève générale dans les ports d'Algérie en 1923...
Proclamer aujourd'hui, comme le font certains groupes du milieu révolutionnaire, que le prolétariat de ces pays sous-développés, contrairement à celui des pays avancés, devrait construire des syndicats, ou soutenir la révolution « nationale des fractions progressistes » de la bourgeoisie, équivaut à jeter par dessus bord les leçons des défaites sanglantes subies par ces prolétaires de la main de l'alliance de toutes les fractions (« progressistes » et « réactionnaires ») de la bourgeoisie, ou de syndicats (y compris dans leurs variantes les plus radicales comme les syndicats anarchistes en Argentine) qui ont montré qu'ils étaient devenus des agents anti-ouvriers de l'Etat capitaliste, autant dans le centre comme à la périphérie du capitalisme.
2) Cependant, le fait que l'ensemble du capitalisme et du prolétariat mondial soient « mûrs » pour la révolution socialiste ne signifie pas que la révolution mondiale puisse commencer dans n'importe quel pays, ou que la lutte des travailleurs des pays plus retardés du capitalisme aient la même responsabilité, le même caractère déterminant, que les combats du prolétariat dans les pays plus avancés. Précisément, la vague révolutionnaire de 1917-23 démontre d'une manière frappante que la révolution ne pourra partir dans l'avenir que du prolétariat des concentrations plus développées, c'est-à-dire de ces bataillons de la classe ouvrière qui, de par leur poids sur la société, de par l'expérience historique accumulée au fil des années de combat contre l'Etat capitaliste et ses mystifications, jouent un rôle central et décisif dans la confrontation mondiale entre le prolétariat et la bourgeoisie.
Eclairés par la lutte du prolétariat de ces pays plus développés, les travailleurs forment des Conseils ouvriers jusqu'en Turquie (où en 1920 existera un groupe spartakiste), en Grèce, en Indonésie même, au Brésil... En Irlande (où d'après Lénine le prolétariat devait encore lutter pour la « libération nationale », ce qui était une analyse erronée), l'influx de la vague révolutionnaire ouvre une parenthèse lumineuse, quand les travailleurs, au lieu de lutter avec la bourgeoisie irlandaise pour son « indépendance » vis-à-vis de la Grande-Bretagne, luttent sur le terrain du prolétariat international. Durant l'été 1920 surgissent des Conseils ouvriers à Limerick, et des révoltes de journaliers éclatent à l'ouest du pays, en butte à la répression autant des troupes anglaises que de l'IRA (quand ces ouvriers occupent des propriétés appartenant à des irlandais).
Quand la bourgeoisie parvient à défaire les bataillons ouvriers décisifs en Allemagne, France, Angleterre, Italie..., la classe ouvrière mondiale se trouve gravement affaiblie, et les luttes ouvrières dans les pays de la périphérie capitaliste ne pourront pas renverser le cours de la défaite du prolétariat mondial. Les énormes preuves de courage et de combativité que donnent les ouvriers en Amérique, Asie..., privés de la contribution des bataillons centraux de la classe ouvrière, se perdront, comme nous l'avons vu, dans de gravissimes confusions (comme par exemple lors de l'insurrection en Chine) qui vont les conduire inévitablement à la défaite. Dans les pays où le prolétariat est plus faible, ses maigres forces et expériences sont cependant confrontées à l'action combinée des bourgeoisies qui ont plus d'expérience dans leur lutte de classe contre le prolétariat ([16] [1864]), quand les bourgeoisies française, anglaise et américaine entreprennent d'une manière coordonnée une action contre-révolutionnaire. En Chine aussi, les « démocraties » occidentales apportent leur appui financier et militaire tout d'abord aux « seigneurs de la guerre », puis aux leaders du Kuomintang.).
De ce fait, le maillon crucial où se jouait le devenir de la vague révolutionnaire était l'Allemagne, dont le prolétariat représentait un authentique phare pour les travailleurs du monde entier. Mais en Allemagne, le prolétariat plus développé et aussi plus conscient affrontait, et c'est logique, la bourgeoisie qui avait accumulé une vaste expérience de confrontations avec le prolétariat. Il suffit de voir la « puissance » de l'appareil spécifiquement anti-ouvrier de l'Etat capitaliste allemand : un Parti socialiste et des syndicats qui se sont maintenus à tous moments organisés et coordonnés pour saboter et écraser la révolution.
Pour rendre possible l'unification mondiale du prolétariat, il faut dépasser les mystifications les plus subtiles de la classe ennemie, il faut affronter les appareils anti-ouvriers les plus sophistiqués... En fait, il faut défaire la fraction la plus forte de la bourgeoisie mondiale. Seuls les bataillons les plus développés et conscients de la classe ouvrière mondiale peuvent être à la hauteur de cette tâche.
La thèse selon laquelle la révolution devait surgir nécessairement de la guerre, ainsi que celle du « maillon le plus faible », furent des erreurs des révolutionnaires dans cette période-là, dans leur désir de défendre la révolution prolétarienne mondiale. Ces erreurs, cependant, furent transformées en dogmes par la contre-révolution triomphante après la défaite de la vague révolutionnaire, et aujourd'hui elles font malheureusement partie du « corps de doctrine » des groupes bordiguistes.
La défaite de la vague révolutionnaire du prolétariat de 1917-23 ne signifie pas que la révolution prolétarienne soit impossible. Au contraire, presque 80 ans plus tard, le capitalisme a prouvé, guerre après guerre, barbarie après barbarie, qu'il ne peut sortir du bourbier historique de sa décadence. Et le prolétariat mondial a dépassé la nuit de la contre-révolution, débutant malgré ses limitations un nouveau cours ouvert vers des affrontements de classe décisifs, vers une nouvelle tentative révolutionnaire. Dans ce nouvel assaut mondial contre le capitalisme, la classe ouvrière devra, pour pouvoir triompher, s'approprier les leçons de ce qui constitue sa principale expérience historique. Il est de la responsabilité de ses minorités révolutionnaires d'abandonner le dogmatisme et le sectarisme pour pouvoir discuter et clarifier le bilan indispensable de cette expérience.
Etsoem
[1] [1865] Le retrait des troupes allemandes de leurs positions en France et en Belgique coûta 378 000 hommes à la Grande-Bretagne et 750 000 à la France.
[2] [1866] La défaite idéologique du prolétariat en 1914 n'avait pas été une défaite physique, ce qui explique que réapparaissent immédiatement les grèves, les assemblées, la solidarité... Celle de 1939, par contre, est complète, joignant la défaite physique (l'écrasement de la vague révolutionnaire) à la défaite idéologique (l'antifascisme).
[3] [1867] Cf. « De l’austromarxisme à l’austrofascisme », Revue Internationale, n° 10.
[4] [1868] Cf. « Il y a 70 ans, la révolution en Allemagne », Revue Internationale, n° 55 et 56.
[5] [1869] Hésitations qui malheureusement touchèrent aussi les révolutionnaires. Cf. noire brochure La Gauche hollandaise.
[6] [1870] Cf. «r L'Isolement est la mort de la révolution », Revue Internationale, n° 75.
[7] [1871] Cité par Edouard Dolléans, Histoire du mouvement ouvrier.
[8] [1872] Cf. « Révolution et contre-révolution en Italie », Revue Internationale, n° 2 et 3.
[9] [1873] Cf. Bilan de 70 ans de "libération nationale', Revue Internationale, n° 66
[10] [1874] Cf. « Bilan de 70 ans de "libération nationale" », Revue Internationale, n° 66
[11] [1875] En France, ce n'est que dans la partie <r vaincue » (l'Alsace et la Lorraine) qu'éclatèrent des grèves importantes en novembre 1918 (dans les chemins de fer et les mines) et qu'il y eut des Conseils de soldats.
[12] [1876] Le pays capitaliste le plus faible, celui qui perd la guerre, est précisément celui qui l'avait déclarée, ce qui permet à la bourgeoisie de renforcer le chauvinisme par des campagnes sur les « indemnités de guerre ».
[13] [1877] Même les groupes révolutionnaires qui tirèrent le bilan le plus sérieux et lucide de cette vague révolutionnaire se trompèrent sur cette question ; ce qui fut le cas par exemple de la Gauche communiste de France qui attendait de la Seconde Guerre mondiale une nouvelle vague révolutionnaire.
[14] [1878] Dans notre brochure Russie 1917, début de la révolution mondiale, nous montrons d'une part, que la Russie n'était pas un pays si en retard (5e puissance industrielle au niveau mondial), et que d'autre part, le fait qu'elle ait été en avant par rapport au reste du prolétariat ne peut être attribué à ce supposé « retard » du capitalisme russe, mais plutôt au fait que, la révolution surgissant de la guerre, la bourgeoisie mondiale n'a pas pu venir en aide à la bourgeoisie russe (de la même façon qu'elle put le faire en 1918-20 durant la «guerre civile »)t ceci ajouté à l'absence d'amortisseurs sociaux (syndicats, démocratie...) du tsarisme.
[15] [1879] Nous avons exposé notre critique de cette « théorie du maillon le plus faible » dans « Le prolétariat d'Europe occidentale au centre de la généralisation de la lutte de classes », et dans « A propos de la théorie du maillon le plus faible », Revue Internationale n° 31 et 37.
[16] [1880] Comme on le vit dans la Révolution russe elle-même (Cf. Revue Internationale, n° 75).
Conscience et organisation:
- Troisième Internationale [1881]
Questions théoriques:
- Internationalisme [1058]
Heritage de la Gauche Communiste:
- La Révolution prolétarienne [1149]
Guy Debord : La deuxième mort de l’« Internationale situationniste »
- 8598 reads
Guy Debord s'est donné la mort le 30 novembre 1994. En France, où il vivait, toute la presse a parlé de ce suicide car Debord, bien qu'il ait toujours limité ses apparitions publiques, était un personnage connu. Sa célébrité, il ne la devait pas aux « oeuvres » qu'il avait produites dans ce qui constituait le « métier » que lui ont attribué les médias, cinéaste, et qui ont toujours eu une diffusion limitée, mais en tant qu'écrivain (La société du spectacle, 1967) et surtout comme fondateur et principal animateur de l'Internationale Situationniste. En tant qu'organisation révolutionnaire, c'est ce dernier aspect de la vie de Guy Debord qui nous intéresse dans la mesure où l'IS, si elle a disparu il y a plus de 20 ans, a eu, en son temps, une certaine influence sur des groupes et éléments qui s'orientaient vers des positions de classe.
Nous ne ferons pas ici une histoire de l’IS ni l'exégèse des 12 numéros de sa revue publiée entre 1958 et 1969. Nous nous contenterons de rappeler que l’IS est née non pas en tant que mouvement politique à proprement parler, mais en tant que mouvement culturel regroupant un certain nombre « d'artistes » (peintres, architectes, etc.) provenant de diverses tendances (Internationale Lettriste, Mouvement pour un Bauhaus Imaginiste, Comité psycho géographique de Londres, etc.) qui se proposaient de faire une critique « révolutionnaire » de l'art tel qu'il existe dans la société actuelle. C'est ainsi que dans le premier numéro de la revue de l'IS (juin 1958) on trouve reproduite une Adresse distribuée lors d'une assemblée générale des critiques d'art internationaux où l'on peut lire : «Dispersez-vous, morceaux de critiques d'art, critiques de fragments d'art. C'est maintenant dans l'Internationale situationniste que s'organise l'activité artistique unitaire de l'avenir. Vous n'avez plus rien à dire. L'Internationale situationniste ne vous laissera aucune place. Nous vous réduirons à la famine. »
Il faut remarquer que, même si l'IS se revendique d'une révolution radicale, elle estime qu'il est possible d'organiser au sein même de la société capitaliste « l'activité artistique de l'avenir ». Plus : cette activité est conçue comme une sorte de marchepied vers cette révolution puisque : « Des éléments d'une vie nouvelle doivent être déjà en formation parmi nous - dans le champ de la culture -, et c'est à nous de nous en servir pour passionner le débat. » ([1] [1882]). L'auteur de ces dernières lignes était d'ailleurs un peintre danois relativement célèbre.
Le type de préoccupations qui animait les fondateurs de l’IS révélait qu'il ne pouvait s'agir d'une organisation exprimant un effort de la classe ouvrière vers sa prise de conscience, mais bien une manifestation de la petite bourgeoisie intellectuelle radicalisée. C'est pour cela d'ailleurs que les positions proprement politiques de 1’IS, si elles voulaient se réclamer du marxisme tout en rejetant le stalinisme et le trotskisme, étaient de la plus grande confusion. C'est ainsi qu'en annexe du n°1 de la publication paraît une prise de position à propos du coup d'Etat du 13 mai 1958 qui a vu l'armée française basée en Algérie se dresser contre le pouvoir du gouvernement de Paris : on y parle du « peuple français », des « organisations ouvrières » pour désigner les syndicats et les partis de gauche, etc. Deux ans plus tard, on trouve encore des accents tiers-mondistes dans le n°4 de la revue : « Nous saluons dans l'émancipation des peuples colonisés et sous-développés, réalisée par eux-mêmes, la possibilité de s'épargner les stades intermédiaires parcourus ailleurs, tant dans l'industrialisation que dans la culture et l'usage même d'une vie libérée de tout » ([2] [1883]). Quelques mois plus tard, Debord est un des 121 signataires (principalement artistes et intellectuels) de la « Déclaration sur le droit à l'insoumission dans la guerre d'Algérie » où l'on peut lire : « La cause du peuple algérien, qui contribue de façon décisive à ruiner le système colonial, est la cause de tous les hommes libres ». L’IS n° 5 revendique collectivement ce geste sans même la moindre critique aux concessions à l'idéologie démocratique et nationaliste que contient la «Déclaration ».
Notre but ici n'est pas d'accabler l'IS ni de tirer sur l'ambulance (ou plutôt sur le cercueil de l'IS). Mais il est important qu'il reste clair, notamment pour ceux qui ont pu être influencés par les positions de cette organisation, que la réputation de « radicalisme » dont elle était entourée, son intransigeance et son refus de toute compromission étaient très fortement exagérés. C'est avec les plus grandes peines que l'IS a commencé à se dégager des aberrations politiques de ses origines, et en particulier des concessions aux conceptions gauchistes ou anarchistes. Ce n'est que progressivement qu'elle va se rapprocher des positions communistes de gauche, en fait celles du conseillisme, en même temps que les pages de sa publication font une place croissante aux questions politiques au détriment des divagations « artistiques ». Debord qui pendant une période est en lien étroit avec le groupe qui publie Socialisme ou Barbarie (S. ou B.), est l'instigateur de cette évolution. C'est ainsi qu'en juillet 1960, il publie un document, « Préliminaires pour une définition de l’unité du programme révolutionnaire », en compagnie de P. Canjuers, membre de S. ou B. Cependant, S. ou B. qui pendant un temps inspire l'évolution de l’IS, est lui-même un courant politique des plus confus. Issu d'une scission tardive (1949) au sein de la « 4e internationale » trotskiste, ce courant ne sera jamais capable de rompre son cordon ombilical avec le trotskisme pour rejoindre les positions de la Gauche communiste. Après avoir engendré à son tour plusieurs scissions qui donneront le « Groupe de Liaison pour l'Action des travailleurs », la revue Information et Correspondance Ouvrières et le groupe « Pouvoir Ouvrier », S. ou B. va terminer sa trajectoire, sous la haute autorité de Cornélius Castoriadis (qui au début des années 1980 apportera sa caution aux campagnes reaganiennes sur la prétendue « supériorité militaire de l'URSS ») en cénacle d'intellectuels rejetant explicitement le marxisme.
La confusion extrême des positions politiques de l'IS, on la retrouve encore en 1966 quand elle essaie de prendre position sur le coup d'Etat militaire de Boumédienne en Algérie et qu'elle ne trouve rien d'autre à faire que de défendre de façon « radicale » l'autogestion (c'est-à-dire la vieille recette anarchiste d'origine proudhonienne qui conduit à faire participer les ouvriers à leur propre exploitation) :
« Le seul programme des éléments socialistes algériens est la défense du secteur autogéré, pas seulement comme il est, mais comme il doit devenir... De l'autogestion maintenue et radicalisée peut partir le seul assaut révolutionnaire contre le régime existant... L'autogestion doit devenir la solution unique aux mystères du pouvoir en Algérie, et doit savoir qu'elle est cette solution. » ([3] [1884]). Et même en 1967, avec le n°11 de sa revue qui contient pourtant les positions politiques les plus claires, l'IS continue encore à cultiver l'ambiguïté sur un certain nombre de points, particulièrement sur les prétendues luttes de « libération nationale ». C'est ainsi qu'à côté d'une dénonciation vigoureuse du tiers-mondisme et des groupes gauchistes qui s'en font les promoteurs, l'IS finit par faire des concessions à ce même tiers-mondisme : « Il est évidemment impossible de chercher, aujourd'hui, une solution révolutionnaire à la guerre du Vietnam. Il s'agit avant tout de mettre fin à l'agression américaine, pour laisser se développer, d'une façon naturelle, la véritable lutte sociale du Vietnam, c'est-à-dire de permettre aux travailleurs vietnamiens de retrouver leurs ennemis de l'intérieur : la bureaucratie du Nord et toutes les couches possédantes et dirigeantes du Sud. » (...) « Seul un mouvement révolutionnaire arabe résolument internationaliste et anti-étatiste, peut à la fois dissoudre l'Etat d'Israël et avoir pour lui la masse de ses exploités. Seul, par le même processus, il pourra dissoudre tous les Etats arabes existants et créer l'unification arabe par le pouvoir des Conseils » ([4] [1885]).
En fait, les ambiguïtés dont ne s'est jamais départie l'IS, notamment sur cette question, permettent en partie d'expliquer le succès qu'elle a connu à un moment où les illusions tiers-mondistes étaient particulièrement fortes au sein de la classe ouvrière et surtout dans le milieu étudiant et intellectuel. Il ne s'agit pas de dire que l’IS a recruté ses adeptes sur la base de ses concessions au tiers-mondisme mais de considérer que si l’IS avait été parfaitement claire sur la question des prétendues « luttes de libération nationale », il est probable que beaucoup de ses admirateurs de l'époque se seraient détournés d'elle. ([5] [1886])
Une autre raison du « succès » de l’IS dans le milieu des intellectuels et des étudiants consiste évidemment dans le fait qu'elle a adressé en priorité sa critique aux aspects idéologiques et culturels du capitalisme. Pour elle, la société actuelle est celle du « spectacle », ce qui est un nouveau terme pour désigner le capitalisme d'Etat, c'est-à-dire un phénomène spécifique de la période de décadence du capitalisme déjà analysé par les révolutionnaires : l'omniprésence de l'Etat capitaliste dans toutes les sphères du corps social, y compris dans la sphère culturelle. De même, si l’IS est très claire pour affirmer que seul le prolétariat constitue une force révolutionnaire dans la société actuelle, elle donne une définition de cette classe qui permet à la petite bourgeoisie intellectuelle révoltée de se considérer comme en faisant partie et donc d'être une force « subversive » : « Suivant la réalité qui s'esquisse actuellement, on pourra considérer comme prolétaires les gens qui n'ont aucune possibilité de modifier l'espace-temps social que la société leur alloue à consommer... » ([6] [1887]). Et la vision typiquement petite-bourgeoise de l’IS sur cette question est confirmée par son analyse, proche de celle de Bakounine, du « lumpenproletariat » qui serait appelé à constituer une force pour la révolution puisque « ... le prolétariat nouveau tend à se définir négativement comme un "Front contre le travail forcé" dans lequel se trouvent réunis tous ceux qui résistent à la récupération par le pouvoir » ([7] [1888]).
Ce qui plaît particulièrement aux éléments révoltés de « l'intelligentsia », ce sont les méthodes qu'emploie l’IS pour sa propagande : le sabotage spectaculaire des manifestations culturelles et artistiques ou le détournement de bandes dessinées et de photos-romans (par exemple, on fait dire à une pin up nue le slogan célèbre du mouvement ouvrier : « L'émancipation des travailleurs sera l'oeuvre des travailleurs eux-mêmes »). De même, les slogans situationnistes ont un franc succès dans cette couche sociale : « Vivre sans temps mort et jouir sans entrave », « Demandons l'impossible », « Il faut prendre ses désirs pour la réalité ». L'idée d'une mise en application immédiate des thèses situationnistes sur la « critique de la vie quotidienne » ne fait en réalité qu'exprimer l'immédiatisme d'une couche sociale sans avenir, la petite bourgeoisie. Enfin, une brochure écrite par un situationniste, en 1967 : De la misère en milieu étudiant, où les étudiants sont présentés comme les êtres les plus méprisés au monde avec les curés et les militaires, contribue à la notoriété de l’IS dans une couche de la population dont le masochisme est à la mesure de l'absence de tout rôle sur la scène sociale et historique.
Les événements de mai 1968 en France, c'est-à-dire le pays où l'IS a le plus d'écho, constituent une sorte d'apogée du mouvement situationniste : les slogans « situs » sont sur tous les murs ; dans les médias, « situationniste » est synonyme de « révolutionnaire radical » ; le premier Comité d'Occupation de la Sorbonne est composé en bonne partie de membres ou de sympathisants de l'IS. A cela, il n'est rien de surprenant. En effet, ces événements marquent à la fois les derniers feux des révoltes étudiantes qui avaient débuté en 1964, en Californie, et inaugurent, de façon magistrale, la reprise historique du prolétariat après 4 décennies de contre-révolution. La simultanéité des deux phénomènes et le fait que la répression de l’Etat contre la révolte étudiante a constitué le déclic d'un mouvement de grève massif dont les conditions avaient mûri avec les premières atteintes de la crise économique, a permis aux situationnistes d'exprimer les aspects les plus radicaux de cette révolte tout en ayant un certain impact sur certains des secteurs de la classe ouvrière qui commençaient à rejeter les structures bourgeoises d'encadrement que sont les syndicats ainsi que les partis de gauche et gauchistes.
Cependant, la reprise des combats de classe, qui a provoqué l'apparition et la floraison de toute une série de groupes révolutionnaires, dont notre propre organisation, a signé l'arrêt de mort de 1’IS. Elle s'avère incapable de comprendre la signification véritable des combats de 1968. En particulier, persuadée que c'est contre le « spectacle » que les ouvriers s'étaient dressés et non contre les premières atteintes d'une crise ouverte et sans issue de l'économie capitaliste, elle écrit stupidement: «L'éruption révolutionnaire n'est pas venue d'une crise économique... ce qui a été attaqué de front en Mai, c'est l'économie capitaliste FONCTIONNANT BIEN» ([8] [1889]) ([9] [1890]). Partant d'une telle vision, il n'est pas surprenant qu'elle puisse considérer, de façon totalement mégalomane, que: «L'agitation déclenchée en janvier 68 à Nanterre par quatre ou cinq révolutionnaires qui allaient constituer le groupe des enragés [influencé par les idées situationnistes], devait entraîner, sous cinq mois, une quasi liquidation de l'Etat » ([10] [1891]) A partir de là, l’IS va entrer dans une période de crise qui va aboutir à sa dissolution en 1972.
C'est « par défaut » que 1’IS avait pu avoir un impact, avant et au cours des événements de 1968, sur les éléments Rapprochant vers les positions de classe, du fait de la disparition ou de la sclérose des courants communistes du passé au cours de la période de contre-révolution. Dès lors que s'étaient constituées, sur la lancée de 1968, des organisations se rattachant à l'expérience de ces courants, et alors que la révolte étudiante était morte, il n'existait plus de place pour l’IS. Son auto-dissolution était la conclusion logique de cette faillite, de la trajectoire d'un mouvement qui, en refusant de se rattacher fermement aux fractions communistes du passé, ne pouvait avoir un avenir. Le suicide de Guy Debord ([11] [1892]) appartient probablement à cette même logique.
Fabienne.
[1] [1893] IS n° 1, p.23, « Les situationnistes et l'automation », par Asger Jorn.
[2] [1894] « La chute de Paris », IS n°4, page 9.
[3] [1895] IS n° 10, page 21, mars 66
[4] [1896] IS n° 11, « Deux guerres locales », pp. 21 -22
[5] [1897] La meilleure preuve du manque de rigueur (pour ne pas dire plus) de l'IS sur cette question nous a été donnée par le fait que celui à qui elle avait confié le soin d'exposer ses thèses sur ce sujet (voir « Contributions servant à rectifier l'opinion du public sur la révolution dans les pays sous-développés », IS n° 11, pp. 38-40), Mustapha Khayati, s'est engagé peu après dans les rangs du Front Populaire Démocratique de Libération Palestinien sans que cela provoque son exclusion immédiate de l'IS, puisque c'est lui-même qui en a démissionné. A sa conférence de Venise, en septembre 1969, l'IS s'est contentée d'accepter cette démission avec l'argument qu'elle n'acceptait pas la « double appartenance ». En somme, que Khayati devienne membre d'un groupe conseilliste comme ICO ou bien qu'il s'enrôle dans une année bourgeoise (pourquoi pas dans la police, c'est la même chose), cela ne fait pas de différence pour l'IS.
[6] [1898] IS n° 8, « Domination de la nature, idéologie et classes »
[7] [1899] « Banalités de base », IS n° 8, page 42
[8] [1900] Enragés et situationnistes dans le mouvement des occupations, René Viennet, p. 209.
[9] [1901] Dans une polémique contre notre publication en France, l'IS écrit : « Quant aux débris du vieil ultra-gauchisme non trotskyste, il leur fallait au moins une crise économique majeure. Ils subordonnaient tout mouvement révolutionnaire à son retour, et ne voyaient rien venir. Maintenant qu'ils ont reconnu une crise révolutionnaire en mai, il leur faut prouver qu'il y avait donc là, au printemps 68, cette crise économique "invisible". Ils s'y emploient sans crainte du ridicule, en produisant des schémas sur la montée du chômage et des prix. Ainsi, pour eux, la crise économique n'est plus cette réalité objective, terriblement voyante, qui fut tant vécue et décrite jusqu'en 1929, mais une sorte de présence eucharistique qui soutient leur religion. » (IS n° 12, p. 6) Si cette crise était « invisible » pour l'IS, elle ne l'était pas pour notre courant puisque notre publication au Venezuela (la seule qui existait à l'époque), Internacionalismo, y avait consacré un article en janvier 1968, et l'histoire s'est chargée de donner raison au CCI sur la réalité de la crise du système capitaliste.
[10] [1902] Ibidem, page 25
[11] [1903] Si toutefois il s'est suicidé... Une autre hypothèse est toujours envisageable : son ami Gérard Lebovici a été assassiné en 1984.
Géographique:
- France [1248]
Histoire du mouvement ouvrier:
- Mai 1968 [1249]
Courants politiques:
Construction de l'organisation révolutionnaire : les 20 ans du Courant Communiste International.
- 10556 reads
Il y a 20 ans, en janvier 1975, était constitué le Courant Communiste International. C'est une durée importante pour une organisation internationale du prolétariat si l'on pense que l'AIT n'avait vécu que 12 ans (1864-1876), l'Internationale Socialiste 25 ans (1889-1914) et l'Internationale Communiste 9 ans (1919-1928). Evidemment, nous ne prétendons pas que notre organisation ait joué un rôle comparable à celui des internationales ouvrières. Cependant, l'expérience des vingt années d'existence du CCI appartient pleinement au prolétariat dont notre organisation est une émanation au même titre que les internationales du passé et que les autres organisations qui défendent aujourd'hui les principes communistes. En ce sens, il est de notre devoir, et cet anniversaire nous en donne l'occasion, de livrer à notre classe quelques uns des enseignements que nous tirons de ces deux décennies de combat.
Lorsqu'on compare le CCI aux organisations qui ont marqué l'histoire du mouvement ouvrier, notamment les internationales, on peut être saisi d'un certain vertige : alors que des millions ou des dizaines de millions d'ouvriers appartenaient, ou étaient influencés par ces organisations, le CCI n'est connu de par le monde que par une infime minorité de la classe ouvrière. Cette situation, qui est aujourd'hui d'ailleurs le lot de toutes les autres organisations révolutionnaires, si elle doit nous inciter à la modestie, n'est pas pour nous, cependant, un motif de sous-estimation du travail que nous accomplissons, encore moins de découragement. L'expérience historique du prolétariat, depuis que cette classe est apparue comme un acteur de la scène sociale, il y a un siècle et demi, nous a montré que les périodes où les positions révolutionnaires ont exercé une réelle influence sur les masses ouvrières sont relativement réduites. C'est d'ailleurs en s'appuyant sur cette réalité que les idéologues de la bourgeoisie ont prétendu que la révolution prolétarienne est une pure utopie puisque la majorité des ouvriers ne croit pas qu'elle soit nécessaire ou possible. Mais ce phénomène, qui était déjà sensible lorsqu'il existait des partis ouvriers de masse, comme à la fin du siècle dernier et au début du 20e siècle, s'est encore amplifié après la défaite de la vague révolutionnaire qui a surgi au cours et à la suite de la première guerre mondiale.
Après que la classe ouvrière ait fait trembler la bourgeoisie mondiale, celle-ci a pris sa revanche en lui faisant subir la plus longue et profonde contre-révolution de son histoire. Et ce sont justement les organisations que la classe s'était données pour son combat, les syndicats ainsi que les partis socialistes et les partis communistes, qui ont constitué, en passant dans le camp bourgeois, le fer de lance de cette contre-révolution. Les partis socialistes, dans leur grande majorité, s'étaient déjà mis au service de la bourgeoisie lors de la guerre elle-même, appelant les ouvriers à « l’Union nationale », participant même, dans certains pays, aux gouvernements qui déchaînaient la boucherie impérialiste. Puis, quand la vague révolutionnaire s'est déployée, avec et à la suite de la révolution d'octobre 1917 en Russie, ces mêmes partis se sont faits les exécuteurs des hautes oeuvres de la bourgeoisie, soit en sabotant délibérément le mouvement, comme en Italie en 1920, soit en jouant directement le rôle de « chien sanglant », en prenant la direction du massacre des ouvriers et des révolutionnaires, comme en Allemagne en 1919. Par la suite, les partis communistes, constitués autour des fractions des PS qui avaient refusé de marcher dans la guerre impérialiste et qui avaient pris la tête de la vague révolutionnaire en se ralliant à l'Internationale Communiste (fondée en mars 1919), ont suivi le chemin de leurs prédécesseurs socialistes. Entraînés par la défaite de la révolution mondiale et par la dégénérescence de la révolution en Russie, ils ont rejoint au cours des années 1930 le camp capitaliste pour se faire, au nom de l'antifascisme et de la «défense de la Patrie socialiste », les meilleurs sergents recruteurs pour la seconde guerre mondiale. Principaux artisans des mouvements de « résistance » contre les armées occupantes d'Allemagne et du Japon, ils ont poursuivi leur sale besogne en encadrant férocement les prolétaires dans la reconstruction des économies capitalistes détruites.
Tout au cours de cette période, l'influence massive que pouvaient avoir les partis socialistes ou « communistes » sur la classe ouvrière était à la mesure de la chape idéologique qui étouffait la conscience des prolétaires saoulés de chauvinisme et qui, soit s'étaient détournés de toute perspective de renversement du capitalisme, soit étaient conduits à confondre cette perspective avec le renforcement de la démocratie bourgeoise, soit subissaient le mensonge suivant lequel les Etats capitalistes du bloc de l'Est étaient des incarnations du « socialisme ». Alors qu'il était « minuit dans le siècle », les forces réellement communistes qui avaient été chassées de l'Internationale communiste dégénérescente se sont retrouvées dans un isolement extrême, quand elles n'étaient pas, purement et simplement, exterminées par les agents staliniens ou fascistes de la contre-révolution. Dans les pires conditions de l'histoire du mouvement ouvrier, les quelques poignées de militants qui ont réussi à échapper au naufrage de l'IC ont poursuivi un travail de défense des principes communistes afin de préparer le futur resurgissement historique du prolétariat. Beaucoup y ont laissé leur vie ou s'y sont épuisés à tel point que leurs organisations, les fractions et groupes de la Gauche communiste, ont disparu ou bien ont été frappées de sclérose.
La terrible contre-révolution qui a écrasé la classe ouvrière après ses combats glorieux du premier après-guerre s'est prolongée pendant près de 40 ans. Mais lorsque les derniers feux de la reconstruction du second après-guerre se sont éteints et que le capitalisme a de nouveau été confronté à la crise ouverte de son économie, à la fin des années 1960, le prolétariat a redressé la tête. Mai 1968 en France, le « Mai rampant » de 1969 en Italie, les combats ouvriers de l'hiver 1970 en Pologne et toute une série de luttes ouvrières en Europe et sur d'autres continents : c'en était fini de la contre-révolution. Et la meilleure preuve de ce changement fondamental du cours historique a été le surgissement et le développement en de nombreux endroits du monde de groupes se rattachant, souvent de façon confuse, à la tradition et aux positions de la Gauche communiste. Le CCI s'est constitué en 1975 comme regroupement d'un certain nombre de ces formations que la reprise historique du prolétariat avait fait surgir. Le fait que, depuis cette date, le CCI non seulement se soit maintenu, mais qu'il se soit étendu, en doublant le nombre de ses sections territoriales, constitue la meilleure preuve de cette reprise historique du prolétariat, le meilleur indice que celui-ci n'ait pas été battu et que le cours historique reste toujours aux affrontements de classe. C'est là la première leçon qu'il s'agit de tirer de ces 20 ans d'existence du CCI ; en particulier contre l'idée partagée par beaucoup d'autres groupes de la Gauche communiste qui considèrent que le prolétariat n'est pas encore sorti de la contre-révolution.
Dans la Revue Internationale n° 40, à l'occasion du 10e anniversaire du CCI, nous avions déjà tiré un certain nombre d'enseignements de notre expérience au cours de cette première période. Nous ne les rappellerons que brièvement ici afin de souligner plus particulièrement ceux que nous tirons de la période qui a suivi. Cependant, avant de dresser un tel bilan, il faut revenir rapidement sur l'histoire du CCI. Et pour les lecteurs qui n'ont pu prendre connaissance de l'article d'il y a dix ans, nous en reproduisons ici de larges extraits qui traitent justement de cette histoire.
Revue Internationale n° 80
La constitution d'un pôle de regroupement international
La « préhistoire » du CCI
« La première expression organisée de notre courant a surgi au Venezuela en 1964. Elle consistait en un petit noyau d'éléments très jeunes qui ont commencé à évoluer vers les positions de classe à travers des discussions avec un camarade plus âgé [il s'agit du camarade Marc dont nous reparlerons plus loin] ayant derrière lui toute une expérience militante au sein de l'Internationale Communiste, dans les fractions de gauche qui en avaient été exclues à la fin des années 1920, et notamment dans la "Fraction de gauche du Parti Communiste d'Italie", et qui avait fait partie de la "Gauche Communiste de France" jusqu'à sa dissolution en 1952. D'emblée donc, ce petit groupe du Venezuela - qui, entre 1964 et 1968, a publié une dizaine de numéros de la revue Internacionalismo- s'est situé en continuité politique avec les positions qui avaient été celles de la Gauche communiste et notamment de la GCF. Cela s'est particulièrement exprimé par un rejet très net de toute politique de soutien aux prétendues "luttes de libération nationale" dont le mythe, dans ce pays d'Amérique latine, pesait très lourdement sur les éléments qui essayaient de s'approcher vers les positions de classe. Cela s'est exprimé également par une attitude d'ouverture et de contact vers les autres groupes communistes, attitude qui avait déjà caractérisé la Gauche Communiste Internationale avant la seconde guerre mondiale et la GCF après celle-ci. C'est ainsi que le groupe Internacionalismo a établi ou tenté d'établir des contacts et des discussions avec le groupe américain News and Letters... et, en Europe, avec toute une série de groupes se situant sur des positions de classe (...) Avec le départ de plusieurs de ses éléments vers la France en 1967 et 1968, ce groupe a interrompu pendant plusieurs années sa publication avant de reprendre Internacionalismo Nouvelle Série (en 1974) et d'être une partie constitutive du CCI en 1975.
La deuxième expression organisée de notre courant est apparue en France sur la lancée de la grève générale de mai 1968 qui marque le resurgissement historique du prolétariat mondial après plus de 40 ans de contre-révolution. Un petit noyau se forme à Toulouse autour d'un militant d’Internacionalismo, noyau qui participe activement dans les discussions animées du printemps 1968, adopte une déclaration de principes en juin et publie le premier numéro de la revue Révolution Internationale à la fin de la même année. Immédiatement, ce groupe reprend la politique d'Internacionalismo de recherche des contacts et discussions avec les autres groupes du milieu prolétarien tant au niveau national qu'international (...) A partir de 1970, il établira des liens plus étroits avec deux groupes qui surnagent au milieu de la décomposition générale du courant conseil liste qui a suivi mai 1968 : l’ "Organisation Conseil liste de Clermont-Ferrand" et les Cahiers du Communisme de Conseil (Marseille) après une tentative de discussion avec le "Groupe de Liaison pour l'Action des Travailleurs" (GLAT) qui avait fait apparaître que ce groupe s'éloignait de plus en plus du marxisme. La discussion avec les deux groupes précédents s'avérera par contre beaucoup plus fructueuse et, après toute une série de rencontres où ont été examinées de façon systématique les positions de base de la gauche communiste, aboutira à une unification en 1972 de RI de l' "Organisation Communiste de Clermont" et des Cahiers du Communisme de Conseil autour d'une plate-forme qui reprend de façon plus précise et détaillée la déclaration de principes de RI de 1968. Ce nouveau groupe va publier la revue Révolution Internationale (Nouvelle Série) ainsi qu'un Bulletin d'Etude et de Discussion et va constituer l'animateur du travail de contacts et discussions internationales en Europe, jusqu'à la fondation du CCI deux ans et demi plus tard.
Sur le continent américain, les discussions engagées par Internacionalismo avec News and Letters ont laissé des traces aux USA et, en 1970, se constitue à New York un groupe (dont font partie d'anciens militants de News and Letters...,) autour d'un texte d'orientation reprenant les mêmes positions fondamentales que Internacionalismo et RL Ce groupe commence la publication de la revue Internationalism et s'engage dans la même orientation que ses prédécesseurs d'établissement de discussions avec les autres groupes communistes. C'est ainsi qu'il maintient des contacts et discussions avec Root and Branch de Boston (qui est inspiré par les positions conseillistes de Paul Mattick) mais qui se révèlent infructueux, ce groupe évoluant de plus en plus vers un cénacle de marxologie. C'est ainsi surtout qu'en 1972, Internationalism envoie à une vingtaine de groupes une proposition de correspondance internationale dans les termes suivants :
(...) "Avec le réveil de la classe ouvrière, il y a eu un développement considérable de groupes révolutionnaires qui se revendiquent d'une perspective communiste internationaliste. Cependant, les contacts et la correspondance entre groupes ont été malheureusement négligés et laissés au hasard. C'est pourquoi Internationalism propose, en vue d'une régularisation et d'un élargissement de ces contacts, une correspondance suivie entre groupes se réclamant de cette perspective..."
Dans sa réponse positive RI précise : "Comme vous, nous sentons la nécessité de ce que les activités et la vie de nos groupes aient un caractère aussi international que les luttes actuelles de la classe ouvrière. C'est pour cette raison que nous avons entrepris des contacts épistolaires ou directs avec un certain nombre de groupes européens auxquels a été envoyée votre proposition (...) Nous pensons que votre initiative permettra d'élargir le champ de ces contacts et, tout au moins, de mieux connaître et faire connaître nos positions respectives. Nous pensons également que la perspective d'une éventuelle conférence internationale est la suite logique de cette correspondance (...)"
Par sa réponse RI soulignait donc la nécessité de s'acheminer vers la tenue de conférences internationales de groupes de la gauche communiste. Cette proposition se trouvait en continuité des propositions répétées (en 1968, 69 et 71) qui avaient été faites au "Partito Comunista Internazionalista" (Battaglia) d'appeler à de telles conférences dans la mesure où cette organisation était à l'époque en Europe la plus importante et sérieuse dans le camp de la Gauche Communiste (à côté du PC/-Programma qui, lui, se confortait dans son "splendide isolement". Mais ces propositions, en dépit de l'attitude ouverte et fraternelle de Battaglia, avaient été à chaque fois repoussées...
En fin de compte, l'initiative l’Internationalism et la proposition de RI devaient aboutir à la tenue, en 1973 et en 1974, d'une série de conférences et rencontres en Angleterre et en France au cours desquelles s'étaient opérées une clarification et une décantation qui se sont traduites notamment par une évolution vers les positions de Rl-Internationalism, du groupe anglais World Révolution (issu d'une scission de Solidarity London qui allait publier le premier numéro de sa revue en mai 1974. Cette clarification et cette décantation avaient également et surtout créé les bases qui allaient permettre la constitution du CCI en janvier 1975. Pendant cette même période, en effet, RI avait poursuivi son travail de contacts et discussions au niveau international, non seulement avec des groupes organisés mais également avec des éléments isolés, lecteurs de sa presse et sympathisant avec ses positions. Ce travail avait conduit à la constitution de petits noyaux en Espagne et en Italie autour de ces mêmes positions et qui, en 1974, ont commencé la publication de Action Proletaria et Rivoluzione Internazionale.
Ainsi, à la conférence de janvier 1975, étaient présents Internacionalismo, Révolution Internationale, Internationalism, World Révolution, Accion Proletaria et Rivoluzione Internazionale partageant les orientations politiques développées à partir de 1964 par Internacionalismo. Etaient également présents Revolutionary Perpectives (qui avait participé aux conférences de 1973-74), le "Revolutionary Workers Group" de Chicago (avec qui RI et Internationalism avaient engagé des discussions en 1974) et "Pour une Intervention Communiste" (qui publiait la revue Jeune Taupe et était constitué de camarades ayant quitté RI en 1973...). Quant au groupe Workers Voice qui avait participé activement aux conférences des années précédentes, il avait rejeté l'invitation à cette conférence car il estimait désormais que RI, WR, etc. étaient des groupes bourgeois (sic) à cause de la position de la majorité de leurs militants (...) sur la question de l'Etat dans la période de transition du capitalisme au communisme. Cette question figurait d'ailleurs à l'ordre du jour de la conférence de janvier 1975... Cependant, elle n'y fut pas discutée, la conférence préférant consacrer un maximum de temps et d'attention à des questions beaucoup plus cruciales à ce moment là :
- l'analyse de la situation internationale ;
- les tâches des révolutionnaires dans celle-ci ;
- l'organisation dans le courant international.
Finalement, les six groupes dont les plates-formes étaient basées sur les mêmes orientations décidaient de s'unifier en une organisation unique dotée d'un organe central international et publiant une revue trimestrielle en trois langues anglais, français et espagnol (...) qui prenait la relève du Bulletin d'Etude et de Discussion de RI. Le CCI était fondé. Comme l'écrivait la présentation du n° 1 de la Revue Internationale "Un grand pas vient d'être fait". En effet, la fondation du CCI constituait l'aboutissement d'un travail considérable de contacts, de discussions, de confrontations entre les différents groupes que la reprise historique des combats de classe avait fait surgir... Mais surtout, elle jetait les bases pour un travail bien plus considérable encore. »
Les dix premières années : la consolidation du pôle international
« Ce travail, les lecteurs de la Revue Internationale (ainsi que de notre presse territoriale) ont pu le constater depuis 10 ans et vient confirmer ce que nous écrivions dans la présentation du numéro 1 de la Revue : "D'aucuns pensent que c'est là [la constitution du CCI et la publication de la Revue] une action précipitée. Rien de tel. On nous connaît assez pour savoir que nous n'avons rien de ces braillards activistes dont l'activité ne repose que sur un volontarisme aussi effréné qu'éphémère." ([1] [1905]) (...) Tout au long de ses dix années d'existence, le CCI a évidemment rencontré de nombreuses difficultés, a dû surmonter de nombreuses faiblesses, dont la plupart étaient liées à la rupture d'une continuité organique avec les organisations communistes du passé, à la disparition ou à la sclérose des fractions de gauche qui s'étaient détachées de l'Internationale Communiste lors de sa dégénérescence. Il a également dû combattre l'influence délétère de la décomposition et de la révolte des couches de la petite bourgeoisie intellectuelle, influence particulièrement sensible après 1968, à la suite des mouvements estudiantins. Ces difficultés et faiblesses se sont par exemple traduites par plusieurs scissions (dont nous avons rendu compte dans notre presse) et par des soubresauts importants en 1981, en même temps que l'ensemble du milieu révolutionnaire et qui ont notamment abouti à la perte de la moitié de notre section en Grande-Bretagne. Face à ses difficultés de 1981, le CCI a même été conduit à organiser une conférence extraordinaire en janvier 1982 en vue de réaffirmer et de préciser ses bases programmatiques, en particulier sur la fonction et la structure de l'organisation révolutionnaire. De même, certains des objectifs que s'était fixés le CCI n'ont pu être atteints. C'est ainsi que la diffusion de notre presse est restée en deçà de nos espérances. (...)
Cependant, s'il nous faut faire un bilan global de ces 10 années, il faut affirmer qu'il est nettement positif. Il est particulièrement positif si on le compare à celui des autres organisations communistes qui existaient au lendemain de 1968. Ainsi, les groupes du courant conseilliste, même ceux qui avaient fait un effort pour s'ouvrir au travail international, comme ICO, ont soit disparu, soit sombré dans la léthargie : le GLAT, ICO, l'Internationale Situationniste, le Spartacusbond, Root and Branch, le PIC, les groupes conseillistes du milieu Scandinave, la liste est longue (et non exhaustive) ... Quant aux organisations se rattachant à la gauche italienne et qui, toutes, s'auto-proclamaient LE PARTI, soit elles ne sont pas sorties de leur provincialisme, soit elles se sont disloquées ou ont dégénéré en groupes gauchistes, tel Programme Communiste ([2] [1906]), soit elles en sont aujourd'hui encore à imiter ce que le CCI a réalisé il y a dix ans, et ceci de façon poussive et dans la confusion comme c'est le cas de Battaglia Comunista et de la CWO (avec le BIPR). Aujourd'hui, après l'effondrement comme un château de cartes du (prétendu) Parti Communiste International, après les échecs du FOR... aux USA (Focus), le CCI reste la seule organisation communiste vraiment implantée au niveau international.
Depuis sa fondation en 1975, le CCI non seulement a renforcé ses sections territoriales d'origine, mais il s'est implanté dans d'autres pays. La poursuite du travail de contacts et de discussions à l'échelle internationale, l'effort de regroupement des révolutionnaires ont permis l'établissement de nouvelles sections du CCI : -1975, constitution de la section en Belgique qui publie en deux langues la revue, puis le journal Internationalisme et qui comble le vide laissé par la disparition, au lendemain de la seconde guerre, de la Fraction Belge de la Gauche Communiste Internationale.
-1977, constitution du noyau aux Pays-Bas qui entreprend la publication de la revue Wereld Revolutie ; c'est un événement de premier plan dans ce pays qui fut la terre d'élection du conseillisme.
-1978, constitution de la section en Allemagne qui commence la publication de la Revue Internationale en langue allemande et l'année suivante de la revue territoriale Weltrevolution ; la présence d'une organisation communiste en Allemagne est évidemment de la plus haute importance compte tenu de la place prise par le prolétariat de ce pays dans le passé et qu'il prendra dans l'avenir.
- 1980, constitution de la section en Suède qui publie la revue Internationell Révolution (...).
Si nous soulignons le contraste entre la relative réussite de l'activité de notre courant et l'échec des autres organisations c'est parce que cela met en évidence la validité des orientations qui furent les nôtres depuis 20 ans (1964) dans le travail de regroupement des révolutionnaires, de construction d'une organisation communiste, orientations qu'il est de notre responsabilité de dégager pour l'ensemble du milieu communiste (...) »
Les principales leçons des dix premières années
« Les bases sur lesquelles s'est appuyé, dès avant sa constitution formelle, notre courant dans son travail de regroupement ne sont pas nouvelles. Elles ont toujours, par le passé, constitué les piliers de ce type de travail. On peut les résumer ainsi :
- la nécessité de rattacher l'activité révolutionnaire aux acquis passés de la classe, à l'expérience des organisations communistes qui ont précédé, de concevoir l'organisation présente comme un maillon de toute une chaîne d'organismes passés et futurs de la classe ;
- la nécessité de concevoir les positions et analyses communistes, non comme un dogme mort, mais comme un programme vivant, en constant enrichissement et approfondissement ;
- la nécessité d'être armés d'une conception claire et solide sur l'organisation révolutionnaire, sur sa structure et sa fonction au sein de la classe. »
Ces enseignements que nous tirions il y a déjà dix ans (et qui étaient plus développés dans la Revue Internationale n° 40 à laquelle nous recommandons à nos lecteurs de se reporter) restent évidemment toujours valables et notre organisation a veillé en permanence à les mettre en pratique. Cependant, alors que sa tâche centrale au cours de sa première décennie d'existence était de construire un pôle de regroupement international des forces révolutionnaires, sa responsabilité essentielle, dans la période qui a suivi, a consisté à faire face à toute une série d'épreuves (à « l'épreuve du feu », en quelque sorte) découlant en particulier des bouleversements qui allaient se produire sur la scène internationale.
L'épreuve du feu
Ainsi, lors du 6e congrès du CCI, qui s'est tenu en novembre 1985, quelques mois après les dix ans du CCI, nous disions : « A la veille des années 1980, le CCI a désigné celles-ci comme les "années de vérité", celles où les enjeux majeurs de toute la société allaient clairement se révéler dans leur formidable ampleur. A la moitié de cette décennie, l'évolution de la situation internationale a pleinement confirmé cette analyse :
-par une nouvelle aggravation des convulsions de l'économie mondiale qui se manifeste dès le début des années 1980 par la récession la plus importante depuis celle des années 1930; - par une intensification des tensions entre blocs impérialistes qui se révèle notamment durant ces mêmes années, tant par un bond considérable des dépenses militaires que par le développement d'assourdissantes campagnes bellicistes dont s'est fait le chantre Reagan, chef de fie du bloc le plus puissant; - par la reprise, dans la seconde moitié de 1983, des combats de classe après leur repli momentané de 1981 à 1983 à la veille et à la suite de la répression des ouvriers de Pologne, reprise qui se caractérise, en particulier, par une simultanéité des combats sans exemple par le passé, notamment dans les centres vitaux du capitalisme et de la classe ouvrière en Europe occidentale" (Résolution sur la situation internationale, Revue internationale n° 44, page 9).
Ce cadre s'est révélé valable jusqu'à la fin des années 1980, même si, évidemment, la bourgeoisie s'est fait, pendant un temps, un devoir de présenter la « reprise » de 1983 à 1990, basée sur un formidable endettement de la première puissance mondiale, comme une « sortie définitive » de la crise. Les faits sont têtus, comme disait Lénine, et depuis le début des aimées 1990, les tricheries capitalistes ont débouché sur une récession ouverte encore plus longue et brutale que les précédentes et qui est venue transformer l'euphorie du bourgeois moyen en une profonde morosité.
De même, la vague des luttes ouvrières ouverte en 1983 s'est poursuivie, avec des moments de répit et des moments de plus grande intensité jusqu'en 1989, obligeant notamment la bourgeoisie à mettre en avant des formes variées du syndicalisme de base (telles les coordinations) afin de suppléer au discrédit croissant des structures syndicales officielles.
Cependant, il est un des aspects de ce cadre qui a été radicalement remis en cause en 1989 : celui des conflits impérialistes, non pas que la théorie marxiste ait été brusquement mise en défaut par leur « dépassement », mais parce qu'un des deux principaux protagonistes de ces conflits, le bloc de l'Est, s'est brutalement effondré. Ce que nous avions appelé les « années de vérité » ont été fatales à un régime aberrant établi sur les ruines de la révolution de 1917 et au bloc sur lequel il imposait son emprise. Un événement historique d'une telle ampleur, qui a bouleversé la carte du monde, a créé une situation nouvelle, inédite dans l'histoire, dans le domaine des conflits impérialistes. Ceux-ci n'ont pas disparu, mais ils ont pris des formes inconnues jusqu'à présent que les révolutionnaires avaient le devoir de comprendre et d'analyser.
En même temps, ces bouleversements qui affectaient les pays qui se présentaient comme « socialistes » ont porté un coup très dur à la conscience et à la combativité de la classe ouvrière internationale laquelle a dû faire face au recul le plus important depuis sa reprise historique de la fin des années 1960.
Ainsi, la situation internationale depuis dix ans a imposé au CCI de faire face aux défis suivants :
- être partie prenante des combats de classe qui se sont déroulés entre 1983 et 1989 ;
-comprendre la nature des événements de 1989 et les conséquences qu'ils allaient avoir, tant dans le domaine des conflits impérialistes que dans celui de la lutte de classe ;
-plus généralement, élaborer un cadre de compréhension de la période de la vie du capitalisme dont l'effondrement du bloc de l'Est a constitué la première grande manifestation.
Etre partie prenante des combats de classe
A la suite du 6e congrès de la section en France (la plus importante du CCI) tenu en 1984, le 6e congrès du CCI a inscrit cette préoccupation au centre de son ordre du jour. Cependant, l'effort que faisait notre organisation internationale depuis plusieurs mois pour se porter à la hauteur de ses responsabilités face à la classe s'était heurté, dès le début de 1984, à la survivance, en notre sein, de conceptions qui sous-estimaient la fonction de l'organisation des révolutionnaires comme facteur actif du combat prolétarien. Le CCI a identifié ces conceptions comme participant de glissements centristes vers le conseillisme résultant, pour une bonne partie, des conditions historiques qui avaient présidé à sa constitution alors qu'il existait, parmi les groupes et éléments qui avaient participé à celle-ci une forte méfiance envers tout ce qui pouvait ressembler au stalinisme. Dans la lignée du conseillisme, ces éléments avaient tendance à mettre sur un même plan le stalinisme, les conceptions de Lénine en matière d'organisation et l'idée même du parti prolétarien. Dans les années 1970, le CCI avait fait la critique des conceptions conseillistes, mais de façon encore insuffisante, si bien qu'elles continuaient de peser sur certaines parties de l'organisation. Lorsque le combat contre les vestiges de conseillisme a débuté, à la fin de 1983, un certain nombre de camarades ont refusé de voir la réalité de leurs faiblesses conseillistes s'imaginant que le CCI était en train de mener une « chasse aux sorcières ». Pour esquiver le problème qui était posé, celui de leur centrisme envers le conseillisme, ils ont fait la « découverte » que le centrisme ne pouvait plus exister dans la période de décadence du capitalisme ([3] [1907]). A ces incompréhensions politiques, il s'ajoutait de la part de ces camarades, dont la plupart étaient des intellectuels peu préparés à subir la critique, un sentiment d'orgueil blessé ainsi que de « solidarité » envers leurs amis qu'ils estimaient injustement « attaqués ». C'était une sorte de « remake » du 2e congrès du POSDR, comme nous le faisions apparaître dans la Revue Internationale n° 45, où le centrisme en matière d'organisation et le poids de l'esprit de cercle, dans lequel les liens affinitaires priment sur les liens politiques, avaient conduit à la scission des mencheviks. La « tendance » qui s'est formée au début de 1985 allait suivre le même chemin pour scissionner lors du 6e Congrès du CCI et constituer une nouvelle organisation, la « Fraction Externe du CCI » (FECCI). Cependant, il existe une différence majeure entre la fraction des mencheviks et la FECCI puisque si la première allait prospérer en rassemblant les courants les plus opportunistes de la social-démocratie Russe pour finir dans le camp de la bourgeoisie, la FECCI, pour sa part, s'est contentée de jouer un rôle de parasite, consacrant l'essentiel de ses énergies à discréditer les positions et les organisations communistes sans être capable de regrouper autour d'elle. Pour finir, la FECCI a rejeté la plate-forme du CCI alors qu'elle expliquait, au moment de sa constitution, qu'elle se donnait comme tâche principale de défendre cette plateforme que le CCI, « dégénérescent » à ses dires, était en train de trahir.
En même temps que le CCI menait le combat en son sein contre les vestiges de conseillisme, il participait activement aux combats de la classe ouvrière comme notre presse territoriale en a rendu compte régulièrement au cours de cette période. Malgré ses faibles forces, notre organisation était présente dans les différentes luttes. Non seulement elle y a diffusé sa presse et des tracts, mais elle a participé directement, chaque fois que c'était possible, aux assemblées ouvrières pour y défendre la nécessité de l'extension des luttes et de leur prise en main par les ouvriers en dehors des différentes formes de syndicalisme, syndicalisme « officiel » ou syndicalisme « de base ». Ainsi, en Italie, lors de la grève de l'école de 1987, l'intervention de nos camarades avait eu un impact non négligeable dans les COBAS (Comités de Base) où ils étaient présents, avant que ces organismes, avec le reflux du mouvement, ne soient récupérés par le syndicalisme de base.
Au cours de cette période, un des meilleurs indices du début d'impact que nos positions commençaient à rencontrer parmi les ouvriers consistait dans le fait que le CCI était devenu une sorte de « bête noire » pour certains groupes gauchistes. Ce fut particulièrement le cas en France où, lors de la grève des chemins de fer de la fin 1986 et lors de la grève des hôpitaux de l'automne 1988, le groupe trotskiste « Lutte Ouvrière » avait mobilisé ses « gros bras » pour empêcher nos militants d'intervenir lors des assemblées convoquées par les « coordinations ». En même temps, les militants du CCI ont participé activement -et souvent ils en étaient les animateurs - à plusieurs comités de lutte rassemblant les travailleurs qui ressentaient la nécessité de se regrouper en dehors des syndicats pour pousser en avant le combat.
Il ne s'agit évidemment pas de « gonfler » l'impact que les révolutionnaires, et notre organisation en particulier, ont pu avoir sur les luttes ouvrières entre 1983 et 1989. Globalement, le mouvement est resté prisonnier du syndicalisme, ses variantes « de base » venant prendre le relais des syndicats officiels là où ils étaient trop discrédités. Notre impact est resté très ponctuel et était de toutes façons limité par le fait que nos forces sont encore très réduites. Mais s'il est une leçon que nous devons tirer de cette expérience, c'est que, au moment où se développent les luttes, les révolutionnaires rencontrent un écho là où ils sont présents car les positions qu'ils défendent et les perspectives qu'ils mettent en avant apportent une réponse aux questions que se posent les ouvriers. Et pour cela, ils n'ont nullement besoin de « cacher leur drapeau », de faire la moindre concession aux illusions qui peuvent encore peser sur la conscience des ouvriers, en particulier concernant le syndicalisme. C'est un enseignement qui vaut pour tous les groupes révolutionnaires qui, souvent, restent paralysés face aux luttes parce que celles-ci ne se posent pas encore la question du renversement du capitalisme, ou bien qui se croient obligés, pour « se faire entendre », de travailler dans les structures du syndicalisme de base, apportant par ce fait leur caution à ces organismes capitalistes.
Comprendre la nature des événements de 1989
Autant il est de la responsabilité des révolutionnaires d'être présents « sur le terrain » au moment des luttes ouvrières, autant il leur revient d'être capables, à chaque instant, de donner à l'ensemble de la classe ouvrière un cadre d'analyse clair des événements qui se déroulent dans le monde.
Cette tâche concerne au premier chef la compréhension des contradictions économiques qui affectent le système capitaliste : les groupes révolutionnaires qui n'ont pas été capables de mettre en évidence le caractère insoluble de la crise dans laquelle est plongé ce système, montrant par là qu'ils n'avaient pas compris le marxisme dont pourtant ils se revendiquent, n'ont été d'aucune utilité pour la classe ouvrière. Ce fut le cas, par exemple, d'un groupe comme le « Ferment Ouvrier Révolutionnaire » qui s'est même refusé à reconnaître qu'il y avait une crise. Les yeux braqués sur les caractéristiques spécifiques de la crise de 1929, il a nié l'évidence pendant des années... jusqu'à en disparaître.
Il appartient aussi aux révolutionnaires d'être en mesure d'évaluer les différents pas qu'accomplit le mouvement de la classe, de reconnaître ses moments d'avancée comme aussi ses moments de recul. C'est un tâche qui conditionne étroitement le type d'intervention qu'ils mènent parmi les ouvriers puisque leur responsabilité, lorsque le mouvement va de l'avant, est de pousser celui-ci le plus loin possible et, en particulier, d'appeler à son extension, alors qu'aux moments de repli, appeler à la lutte revient à pousser les ouvriers à se battre dans l'isolement et appeler à l'extension contribue à l'extension... de la défaite. C'est d'ailleurs souvent à ce moment-là que les syndicats appellent, pour leur part, à l'extension.
Enfin, le suivi et la compréhension des différents conflits impérialistes constituent aussi une responsabilité de premier ordre des communistes. Une erreur dans ce domaine peut avoir des conséquences dramatiques. Ainsi, à la fin des années 1930, la majorité de la Fraction communiste italienne, avec à sa tête son principal animateur, Vercesi, considère que les différentes guerres de l'époque, notamment la guerre d'Espagne, n'augurent en aucune façon un conflit généralisé. L'éclatement de la guerre mondiale, en septembre 1939, laissera la Fraction complètement désemparée et il faudra deux années pour qu'elle puisse se reconstituer, dans le sud de la France, et reprendre un travail militant.
Pour ce qui concerne la période actuelle, il était de la plus grande importance de comprendre clairement la nature des événements qui se sont déroulés au cours de l'été et de l'automne 1989 dans les pays du bloc de l'Est. Pour sa part, dès l'arrivée de Solidarnosc au gouvernement en Pologne, en plein coeur de l'été, dans une période où habituellement « l'actualité est en vacances », le CCI se mobilise pour comprendre cet événement ([4] [1908]). Il adopte la position que ce qui se passe en Pologne signe l'entrée de l'ensemble des régimes staliniens d'Europe dans une crise sans commune mesure avec les précédentes : « La perspective pour l'ensemble des régimes staliniens n'est... nullement celle d'une "démocratisation pacifique" ni d'un "redressement" de l'économie. Avec l'aggravation de la crise mondiale du capitalisme, ces pays sont entrés dans une période de convulsions d'une ampleur inconnue dans leur passé pourtant déjà "riche" de soubresauts violents. » (Revue Internationale n° 59, « Convulsions capitalistes et luttes ouvrières»). Cette idée est développée dans des « Thèses sur la crise économique et politique en URSS et dans les pays de l'Est» rédigées dès le 15 septembre (près de 2 mois avant la chute du mur de Berlin) et adoptées début octobre par le CCI. Dans ces thèses ont peut lire (voir la Revue Internationale n° 60) :
« ... dans la mesure même où le facteur pratiquement unique de cohésion du bloc russe est la force armée, toute politique tendant à faire passer au second plan ce facteur porte avec elle l'éclatement du bloc. Dès à présent, le bloc de l'Est nous présente le tableau d'une dislocation croissante... Dans cette zone, les forces centrifuges sont tellement fortes qu'elles se déchaînent dès qu'on leur en laisse l'occasion. (...)
C'est un phénomène similaire qu'on retrouve dans les républiques périphériques de l'URSS... Les mouvements nationalistes qui, à la faveur du relâchement du contrôle central du parti russe, s'y développent aujourd'hui... portent avec eux une dynamique de séparation d'avec la Russie. » (Point 18) « ... quelle que soit l'évolution future de la situation dans les pays de l'Est, les événements qui les agitent actuellement signent la crise historique, l'effondrement définitif du stalinisme... Dans ces pays s'est ouverte une période d'instabilité, de secousses, de convulsions, de chaos sans précédent dont les implications dépasseront très largement leurs frontières. En particulier, l'effondrement qui va encore s'accentuer du bloc russe ouvre les portes à une déstabilisation du système de relations internationales, des constellations impérialistes qui étaient sorties de la seconde guerre mondiale avec les accords de Yalta. » (point 20)
Quelques mois plus tard (janvier 1990), cette dernière idée est précisée dans les termes suivants :
« La configuration géopolitique sur laquelle a vécu le monde depuis la seconde guerre mondiale est désormais complètement remise en cause par les événements qui se sont déroulés au cours de la seconde moitié de l'année 1989. Il n'existe plus aujourd'hui deux blocs impérialistes se partageant la mainmise sur la planète. Le bloc de l'Est, c'est une évidence (...) a cessé d'exister. (...) Cette disparition du bloc de l'Est signifie-t-elle que, désormais, le monde sera dominé par un seul bloc impérialiste ou que le capitalisme ne connaîtra plus d'affrontements impérialistes ? De telles hypothèses seraient tout à fait étrangères au marxisme. (...) Aujourd'hui, l'effondrement de ce bloc ne saurait remettre en selle ce genre d'analyses : cet effondrement porte avec lui, à terme, celui du bloc occidental. (...) La disparition du gendarme impérialiste russe, et celle qui va en découler pour le gendarme américain vis-à-vis de ses principaux "partenaires" d'hier, ouvrent la porte au déchaînement de toute une série de rivalités plus locales. Ces rivalités et affrontements ne peuvent pas, à l'heure actuelle, dégénérer en un conflit mondial... En revanche, du fait de la disparition de la discipline imposée par la présence des blocs, ces conflits risquent d'être plus violents et plus nombreux, en particulier, évidemment, dans les zones où le prolétariat est le plus faible...
La disparition des deux constellations impérialistes qui étaient sorties de la seconde guerre mondiale porte, avec elle, la tendance à la recomposition de deux nouveaux blocs. Cependant, une telle situation n'est pas encore à l'ordre du jour... » (Revue Internationale n°61, «Après l'effondrement du bloc de l'Est, déstabilisation et chaos »)
Les événements qui se sont déroulés par la suite, en particulier la crise et la guerre du Golfe en 1990-91 ([5] [1909]), sont venus confirmer notre analyse. Aujourd'hui, l'ensemble de la situation mondiale, notamment ce qui se passe dans l'ex-Yougoslavie, fait la preuve plus qu'évidente de la disparition complète de tout bloc impérialiste en même temps que certains pays d'Europe, notamment la France et l'Allemagne, essayent péniblement d'impulser la reconstitution d'un nouveau bloc, basé sur l'Union Européenne, qui pourrait tenir tête à la puissance américaine.
Pour ce qui concerne l'évolution de la lutte de classe, les « thèses » de l'été 1989 se prononçaient également dessus : « Même dans sa mort, le stalinisme rend un dernier service à la domination capitaliste : en se décomposant, son cadavre continue encore à polluer l'atmosphère que respire le prolétariat... C'est donc à un recul momentané de la conscience du prolétariat... qu'il faut s'attendre... En particulier, l'idéologie réformiste pèsera très fortement sur les luttes de la période qui vient, favorisant grandement l'action des syndicats... Compte tenu de l'importance historique des faits qui le déterminent, le recul actuel du prolétariat, bien qu'il ne remette pas en cause le cours historique, la perspective générale aux affrontements de classe, se présente comme bien plus profond que celui qui avait accompagné la défaite de 1981 en Pologne » (point 22)
Là aussi, les cinq dernières années ont amplement confirmé cette prévision. Depuis 1989, nous avons assisté au recul le plus important de la classe ouvrière depuis son surgissement historique, à la fin des années 1960. C'est une situation à laquelle les révolutionnaires devaient être préparés afin de pouvoir y adapter leur intervention et, surtout, ne pas «jeter l'enfant avec Veau du bain » en considérant que ce long recul remettait en cause de façon définitive la capacité du prolétariat à mener et développer ses combats contre le capitalisme. En particulier, les manifestations de regain de la combativité ouvrière, notamment à l'automne 1992 en Italie et à l'automne 1993 en Allemagne (voir la Revue Internationale n° 72 et n° 75) ne devaient être ni surestimées (compte tenu de la profondeur du recul prolétarien) ni sous-estimées en ce qu'elles constituent les signes avant-coureurs d'une reprise inévitable des combats et du développement de la conscience de la classe dans tous les pays industrialisés.
Le marxisme est une méthode scientifique. Cependant, à l'opposé des sciences de la nature, il ne peut vérifier la validité de ses thèses en les soumettant à l'expérience de laboratoire ou en faisant appel à des moyens d'observation plus puissants. Son « laboratoire », c'est la réalité sociale, et il démontre sa validité en étant capable de prévoir l'évolution de celle-ci. Ainsi, le fait que le CCI ait été capable de prévoir, dès les premiers symptômes de l'effondrement du bloc de l'Est, les principaux événements qui allaient bouleverser le monde depuis 5 ans n'est pas à considérer comme une aptitude particulière à lire dans le marc de café où à interpréter la configuration des astres. C'est tout simplement la preuve de son attachement à la méthode marxiste, et c'est donc à celle-ci qu'il faut attribuer le succès de nos prévisions.
Cela dit, il ne suffit pas de se réclamer du marxisme pour être capable de l'utiliser efficacement. En fait, notre capacité à comprendre rapidement les enjeux de la situation mondiale découlait de la mise en application de la même méthode que nous avions reprise de Bilan et dont soulignions il y a déjà dix ans qu'elle était un des enseignements principaux de notre propre expérience : la nécessité de se rattacher fermement aux acquis du passé, la nécessité de concevoir les positions et analyses communistes, non comme un dogme mort mais comme un programme vivant.
Ainsi, les thèses de 1989 commencent par rappeler, dans les dix premiers points, quel est le cadre que s'était donné notre organisation au début des années 1980, à la suite des événements de Pologne, pour la compréhension des caractéristiques des pays et du bloc de l'Est. C'est à partir de cette analyse que nous avons été en mesure de mettre en évidence que c'en était fini des régimes staliniens d'Europe et du bloc de l'Est. Et c'est en nous appuyant sur un acquis encore plus ancien du mouvement ouvrier (notamment mis en évidence par Lénine contre Kautsky) : il ne peut exister un seul bloc impérialiste, que nous avons annoncé que l'effondrement du bloc de l'Est ouvrait la porte à la disparition du bloc occidental.
De même, il nous fallait, pour comprendre ce qui était en train de se passer, remettre en cause le schéma qui avait été valable pendant plus de quarante ans : le partage du monde entre le bloc occidental dirigé par les Etats-Unis et le bloc de l'Est dirigé par 1’URSS. Il nous fallait également être en mesure de considérer que ce dernier pays, progressivement constitué depuis Pierre le Grand, ne survivrait pas à l'effondrement de son empire. Encore une fois, nous n'avons aucun mérite particulier d'avoir fait preuve de la capacité à remettre en cause les schémas du passé. Cette démarche, nous ne l'avons pas inventée. Elle nous a été enseignée par l'expérience vivante du mouvement ouvrier et particulièrement par ses principaux combattants : Marx, Engels, Rosa Luxemburg, Lénine...
Enfin, la compréhension des bouleversements de la fin des années 1980 devait être replacée dans une analyse générale de l'étape actuelle de la décadence du capitalisme.
Le cadre de compréhension de la période présente du capitalisme
C'est ce travail que nous avions commencé à faire depuis 1986 en indiquant que nous étions entrés dans une phase nouvelle de la décadence capitaliste, celle de la décomposition de ce système. Cette analyse a été précisée au début de 1989 dans les termes suivants :
« Jusqu'à présent, les combats de classe qui, depuis vingt ans, se sont développés sur tous les continents, ont été capables d'empêcher le capitalisme décadent d'apporter sa propre réponse à l'impasse de son économie : le déchaînement de la folie ultime de sa barbarie, une nouvelle guerre mondiale. Pour autant, la classe ouvrière n'est pas encore en mesure d'affirmer, par des luttes révolutionnaires, sa propre perspective ni même de présenter, au reste de la société ce futur qu'elle porte en elle. C'est justement cette situation d'impasse momentanée, où, à l'heure actuelle, ni l'alternative bourgeoise, ni l'alternative prolétarienne ne peuvent s'affirmer ouvertement, qui est à l'origine de ce phénomène de pourrissement sur pied de la société capitaliste, qui explique le degré particulier et extrême atteint aujourd'hui par la barbarie propre à la décadence de ce système. Et ce pourrissement est amené à s'amplifier encore avec l'aggravation inexorable de la crise économique. » (Revue Internationale n° 57, « La décomposition du capitalisme »)
Evidemment, dès que s'est annoncé l'effondrement du bloc de l'Est, nous avons replacé un tel événement dans ce cadre de la décomposition :
«En réalité, l'effondrement actuel du bloc de l'Est constitue une des manifestations de la décomposition générale de la société capitaliste dont l'origine se trouve... dans l'incapacité pour la bourgeoisie d'apporter sa propre réponse, la guerre généralisée, à la crise ouverte de l'économie mondiale. » (Revue Internationale n° 60, « Thèses... », point 20)
De même, en janvier 1990, nous avons dégagé les implications pour le prolétariat de la phase de décomposition et de la nouvelle configuration de l'arène impérialiste : « Dans un tel contexte de perte de contrôle de la situation par la bourgeoisie mondiale, il n'est pas dit que les secteurs dominants de celle-ci soient aujourd'hui en mesure de mettre en oeuvre l'organisation et la discipline nécessaires à la reconstitution de blocs militaires. (...) C'est pour cela qu'il est fondamental de mettre en évidence que, si la solution du prolétariat - la révolution communiste - est la seule qui puisse s'opposer à la destruction de l'humanité (qui constitue la seule "réponse" que la bourgeoisie puisse apporter à sa crise), cette destruction ne résulterait pas nécessairement d'une troisième guerre mondiale. Elle pourrait également résulter de la poursuite, jusqu 'à ses conséquences extrêmes (catastrophes écologiques, épidémies, famines, guerres locales déchaînées, etc.) de cette décomposition. (...) la poursuite et l'aggravation du phénomène de pourrissement de la société capitaliste exercera, encore plus qu'au cours des années 1980, ses effets nocifs sur la conscience de la classe. Par l'ambiance générale de désespoir qui pèse sur toute la société, par la décomposition même de l'idéologie bourgeoise dont les émanations putrides viennent empoisonner l'atmosphère que respire le prolétariat, ce phénomène va constituer pour lui, jusqu'à la période prérévolutionnaire, une difficulté supplémentaire sur le chemin de sa prise de conscience. » (Revue Internationale n°61, « Après l'effondrement du bloc de l'Est, déstabilisation et chaos »)
Ainsi, notre analyse sur la décomposition nous permet de mettre en évidence l'extrême gravité des enjeux de la situation historique présente. En particulier, elle nous conduit à souligner que le chemin du prolétariat vers la révolution communiste sera beaucoup plus difficile que les révolutionnaires n'avaient pu le prévoir dans le passé. C'est là aussi un autre enseignement qu'il s'agit de tirer de l'expérience du CCI au cours des dix dernières années et qui rejoint une préoccupation mise en avant par Marx au milieu du siècle dernier : les révolutionnaires n'ont pas pour rôle de consoler la classe ouvrière mais au contraire de souligner aussi bien l'absolue nécessité de son combat historique que la difficulté de celui-ci. Ce n'est qu'en ayant une claire conscience de cette difficulté que le prolétariat (et avec lui les révolutionnaires eux-mêmes) sera en mesure de ne pas se démoraliser face aux embûches qu'il affrontera, qu'il trouvera la force et la lucidité pour les surmonter pour parvenir au renversement de la société d'exploitation ([6] [1910]).
Dans le bilan des dix dernières années du CCI, nous ne pouvons passer sous silence deux faits très importants touchant à notre vie organisationnelle.
Le premier fait est très positif. C'est l'extension de la présence territoriale du CCI avec la constitution en 1989 d'un noyau en Inde qui publie, en langue hindi, Communist Internationalist et d'une nouvelle section au Mexique, pays de la plus haute importance sur le continent américain, et qui publie Révolution Mundial.
Le deuxième fait est beaucoup plus désolant : c'est la disparition de notre camarade Marc, le 20 décembre 1990. Nous ne reviendrons pas ici sur le rôle de premier plan qu'il a joué dans la constitution du CCI et, avant cela, dans le combat des fractions communistes aux moments les plus noirs de la contre-révolution. La Revue Internationale (n° 65 et 66) y a consacré un long article. Disons simplement que, à côté de « l'épreuve du feu » qu'ont représenté pour le CCI, comme pour l'ensemble du milieu révolutionnaire, les convulsions du capitalisme mondial depuis 1989, la perte de notre camarade était aussi pour nous une autre « épreuve du feu ». Beaucoup de groupes de la gauche communiste n'ont pas survécu à la disparition de leur principal animateur. Cela a été le cas du FOR, par exemple. Et d'ailleurs, certains « amis » nous ont prédit avec « sollicitude » que le CCI ne survivrait pas à Marc. Pourtant, le CCI est encore là, et il a réussi à tenir le cap depuis 4 ans malgré les tempêtes qu'il a rencontrées.
Là dessus non plus nous ne nous accordons aucun mérite particulier : l'organisation révolutionnaire n'existe pas grâce à tel ou tel de ses militants, aussi valeureux soit-il. Elle est un produit historique du prolétariat et si elle ne survit pas à l'un de ses militants, c'est qu'elle n'a pas correctement assumé la responsabilité que la classe lui a confiée et que ce militant lui-même a failli d'une certaine façon. Si le CCI a réussi à franchir avec succès les épreuves qu'il a rencontrées, c'est avant tout parce qu'il a eu le souci permanent de se rattacher à l'expérience des organisations communistes qui l'ont précédé, de concevoir son rôle comme un combat à long terme et non en vue de « succès » immédiats. Depuis le siècle dernier, cette démarche a été celle des militants révolutionnaires les plus lucides et solides : nous nous en revendiquons et c'est notre camarade Marc qui, en grande partie, nous a appris à le faire. Il nous a aussi appris, par son exemple, ce que veut dire le dévouement militant sans lequel une organisation révolutionnaire ne peut survivre, aussi claire qu'elle puisse être :
« Sa grande fierté, ce n'est pas dans sa contribution exceptionnelle qu'il l'a placée mais dans le fait que, jusqu'au bout, il est resté fidèle, de tout son être, au combat du prolétariat. Et cela aussi était un enseignement précieux pour les nouvelles générations de militants qui n'ont pas eu l'occasion de connaître l'énorme dévouement à la cause révolutionnaire qui était celui des générations du passé. C'est en premier lieu sur ce plan que nous voulons être à la hauteur du combat que, désormais sans sa présence vigilante et lucide, chaleureuse et passionnée, nous sommes déterminés à poursuivre. » (« Marc », Revue Internationale n°66).
Vingt après la constitution du CCI, nous poursuivons le combat.
FM
[1] [1911] Le fait que nous en soyons aujourd'hui au n° 80 de la Revue Internationale démontre donc que sa régularité a été maintenue sans défaillance.
[2] [1912] Au début des années 1980, le PCl-Programma avait changé le titre de sa publication en Combat qui dériva assez rapidement vers le gauchisme. Depuis, quelques éléments de ce groupe ont repris la publication de Programma Comunista qui défend les positions bordiguistes classiques.
[3] [1913] Voir à ce sujet les articles que nous avons publiés dans les n° 41 à 45 de notre Revue Internationale.
[4] [1914] Il faut noter que pratiquement tous les groupes du milieu prolétarien sont passes à côté de la compréhension des événements de 1989 comme nous le mettons en évidence dans nos articles « Le vent d'Est et la réponse des révolutionnaires» et « Face aux bouleversements à l'Est, une avant-garde en retard» dans la Revue Internationale n°61 et 62. La palme revient sans contestation possible à la FECCI (qui avait quitté le CCI en prétextant que celui-ci dégénérait et était incapable de faire un travail théorique) : il lui a fallu DEUX ANS pour se rendre compte que le bloc de l'Est avait disparu (voir notre article « A quoi sert la FECCI ? » dans la Revue internationale n° 70).
[5] [1915] Nous avons rendu compte de ces événements dans la Revue Internationale n° 64 et 65. En particulier, nous écrivions, avant même la « tempête du désert » : « Dans la nouvelle période historique où nous sommes entrés, et les événements du Golfe viennent de le confirmer, le monde se présente comme une immense foire d'empoigne, où jouera à fond la tendance au "chacun pour soi", où les alliances entre Etats n'auront pas, loin de là, le caractère de stabilité qui caractérisait les blocs, mais seront dictés par les nécessités du moment. Un monde de désordre meurtrier, de chaos sanglant, dans lequel le gendarme américain tentera de faire régner un minimum d'ordre par l'emploi de plus en plus massif et brutal de sa puissance militaire. » («Militarisme et décomposition », Revue Internationale n° 64, p. 13). De même nous rejetions l'idée, colportée par les gauchistes mais partagée par la plupart des groupes du milieu prolétarien, que la guerre du Golfe était une «r guerre pour le pétrole » (« Le milieu politique prolétarien face à la guerre du Golfe»).
[6] [1916] Il n'est pas nécessaire ici de revenir plus longuement sur notre analyse sur la décomposition. Elle apparaît dans chacun de nos textes traitant de la situation internationale. Ajoutons simplement que, à travers un débat en profondeur dans notre organisation, cette analyse a été progressivement précisée (voir à ce propos nos textes : « La décomposition, phase ultime de la décadence du capitalisme», «Militarisme et décomposition» et « Vers le plus grand chaos de l'histoire » publiés respectivement dans les n° 62, 64 et 68 de la Revue internationale).
Conscience et organisation:
Courants politiques:
- Gauche Communiste [49]
Revue Internationale no 81 - 2e trimestre 1995
- 3859 reads
Editorial : guerre et mensonges de la « démocratie »
- 3196 reads
En cette année où la bourgeoisie célèbre à grand renfort de propagande médiatique le cinquantenaire de la fin de la seconde guerre mondiale, les guerres se déchaînent dans le monde, jusqu'aux portes de l'Europe la plus développée, avec le conflit ouvert depuis près de quatre ans dans l'ex-Yougoslavie. La « paix » n'est pas plus au rendez-vous avec la disparition du bloc de l'Est et de l'URSS qu'elle ne l'a été il y a cinquante ans au lendemain de la défaite de l'Allemagne et du Japon face aux Alliés. La nouvelle « ère de paix », promise il y a cinq ans par les vainqueurs de la « guerre froide », n'a pas plus d'existence que la « paix » promise par les vainqueurs de la seconde guerre mondiale. Pire : alors que l'existence de deux blocs impérialistes pouvait imposer une certaine « discipline » dans la situation internationale au lendemain de la 2e guerre mondiale et lors des années de « reconstruction », aujourd'hui, c'est la tendance au chaos généralisé qui domine dans les relations internationales.
« Paix » d'hier et « paix » d'aujourd'hui : toujours la guerre
Il y a cinquante ans, dès la signature des accords de Yalta qui scellèrent, en février 1945, le repartage du monde en zones d'influence dominées par les vainqueurs et leurs alliés, Etats-Unis et Grande-Bretagne d'un côté, URSS de l'autre, la nouvelle ligne des affrontements inter-impérialistes était tracée. A peine la guerre était-elle terminée que s'enclenchait la confrontation entre le bloc de l'Ouest emmené par les Etats-Unis et le bloc de l'Est sous la houlette de l'URSS. Cette confrontation allait se développer pendant plus de quarante ans, certes avec la « paix » en Europe (une « paix » essentiellement imposée par la nécessité de la reconstruction), mais surtout avec la guerre : guerre de Corée, guerre du Vietnam, conflits meurtriers où chacun des protagonistes locaux recevait le soutien de l'un ou l'autre bloc, quand il n'était pas poussé par eux. Et si cette « guerre froide » n'a pas débouché sur la 3e guerre mondiale, c'est parce que la classe ouvrière a réagi internationalement contre les conséquences de la crise économique, sur le terrain de la défense de ses conditions d'existence, à partir de la fin des années 1960, entravant l'embrigadement nécessaire à un affrontement généralisé, en particulier dans les pays les plus industrialisés.
En 1989, la disparition du bloc de l'Est engendrée par la perte de contrôle par le stalinisme, forme de capitalisme d'Etat devenue inapte à faire face aux conditions de la crise économique, et par l'incapacité de l'URSS à maintenir la discipline de son bloc, puis la dislocation de l'URSS elle-même, ont mis un terme définitif à la « guerre froide » et ont totalement bouleversé la situation planétaire héritée de la seconde guerre mondiale. Cette nouvelle situation a provoqué à son tour l'éclatement du bloc de l'Ouest qui ne devait sa cohésion qu'à la menace de T « ennemi commun ». Tout comme les vainqueurs de la 2e guerre mondiale se sont retrouvés être les protagonistes de la nouvelle division du monde, ce sont désormais les vainqueurs de la « guerre froide », les anciens alliés de l'ex-bloc de l'ouest, qui se retrouvent être les nouveaux adversaires de la confrontation impérialiste inhérente à la perpétuation du capitalisme et de ses lois de l'exploitation, du profit et de la concurrence. Et si, à la différence de la situation de l'après-guerre, il ne s'est pas déjà constituée une nouvelle division en deux blocs impérialistes, du fait des conditions historiques de la période actuelle ([1] [1917]) les tensions impérialistes n'en ont pas pour autant disparu. Elles n'ont fait que s'aiguiser. Dans tous les conflits qui surgissent de la décomposition dans laquelle plongent de plus en plus de pays, ce ne sont pas seulement les caractéristiques locales qui dessinent la forme et l'ampleur des affrontements, mais surtout les nouveaux clivages entre grandes puissances ([2] [1918]).
Il ne peut pas y avoir de « paix » dans le capitalisme. La « paix » n'est qu'un moment de la préparation à la guerre impérialiste. Les commémorations de la fin de la 2e guerre mondiale, qui présentent la politique des pays « démocratiques » dans la guerre comme celle qui permit le retour de la « paix », font partie des campagnes idéologiques destinées à masquer leur véritable responsabilité de pourvoyeurs de chair à canon et de principaux fauteurs de guerre.
Mensonges d'hier et mensonges d'aujourd'hui
L'an dernier la bourgeoisie avait fêté la « Libération », le « Débarquement de Normandie » et d'autres épisodes de 1944 ([3] [1919]) par des articles de presse, des programmes de télévision et de radio, des cérémonies politico-médiatiques et des défilés militaires. Les commémorations se poursuivent en 1995 pour rappeler les dernières batailles de 1945, la capitulation de l'Allemagne et du Japon, 1' « armistice », le tout pour raconter une fois encore l'édifiante histoire de comment les régimes « démocratiques » parvinrent à vaincre la « bête immonde » du nazisme et à instaurer durablement la « paix » dans une Europe dévastée par la barbarie hitlérienne.
Ce n'est pas simplement l'opportunité du calendrier qui explique tout le battage fait autour de la fin de la deuxième guerre mondiale. Aujourd'hui, alors que les conflits se multiplient, alors que la crise économique entraîne un chômage de plus en plus massif et de longue durée, alors que la décomposition sociale fait des ravages, la classe dominante, la classe capitaliste, a besoin de tout son arsenal idéologique pour défendre les vertus de la « démocratie » bourgeoise, en particulier sur la question de la guerre. L'histoire de la fin de la 2e guerre mondiale, qui présente les faits avec l'apparence de l'objectivité, fait partie de cet arsenal. Les appels répétés à se « souvenir » de cette histoire, à l'occasion des anniversaires des événements de 1945, visent à faire passer l'idée que le camp « démocratique », en mettant fin à la guerre, ramena la « paix » et la « prospérité » en Europe. Un tel «jugement de l'Histoire» est bien sûr fait pour décerner un certificat de bonne conduite à la « démocratie », à lui donner une caution « historique », destinée à crédibiliser les discours sur les « opérations humanitaires », les « accords de paix » et la « défense des droits de l'homme » qui couvrent la réalité de la barbarie capitaliste actuelle. Les mensonges d'aujourd'hui se trouvent ainsi renforcés par les mensonges d'hier.
Les « grandes démocraties » ne mènent pas plus aujourd'hui qu'hier une politique de « paix ». Au contraire, aujourd'hui comme hier, ce sont les grandes puissances capitalistes qui portent la plus grande responsabilité dans la guerre. Les commémorations à répétition de la fin de la deuxième guerre mondiale, et leur message sur le retour de la « paix en Europe », prétendent nous rappeler l'histoire et honorer la mémoire des cinquante millions de victimes du plus grand massacre que le monde ait connu. Elles sont en fait un des aspects des campagnes idéologiques de « défense de la démocratie ». Elles servent à détourner l'attention de la classe ouvrière de la politique actuelle de cette même « démocratie » : le développement des tensions impérialistes et le « chacun pour soi » qui ramènent aujourd'hui la guerre en Europe, avec le conflit dans l'ex-Yougoslavie ([4] [1920]). Elles sont de plus une gigantesque falsification de l'histoire en mentant sur les causes, le déroulement et le dénouement de la 2e guerre mondiale et sur les cinquante ans de « paix » qui l'ont suivie.
Nous ne reviendrons pas longuement dans cet article sur la question de la nature de la guerre impérialiste dans la période de décadence du capitalisme, sur les véritables causes de la 2e guerre mondiale et sur le rôle qu'y ont joué les « grandes démocraties » qui se présentent comme les garants de la « paix » du monde. Nous avons souvent traité cette question dans la Revue Internationale ([5] [1921]), montrant notamment comment, contrairement à la propagande qui présente la 2e guerre mondiale comme le résultat de la folie d'un Hitler, la guerre est le résultat inéluctable de la crise historique du mode de production capitaliste. Et si par deux fois, pour des raisons historiques, c'est l'impérialisme allemand qui donna le signal de la guerre, la responsabilité des Alliés est entière dans le déchaînement des destructions et du carnage. « La seconde boucherie mondiale constitua pour la bourgeoisie une formidable expérience, pour tuer et massacrer des millions de civils sans défense, mais aussi pour dissimuler, masquer, justifier ses propres crimes de guerre monstrueux, en "diabolisant" ceux de la coalition impérialiste antagoniste. Au sortir de la seconde guerre mondiale, les "grandes démocraties", malgré tous leurs efforts pour se donner un air respectable, apparaissent plus que jamais maculées des pieds à la tête par le sang de leurs innombrables victimes. » ([6] [1922]) L'engagement des Alliés dans la guerre mondiale n'était en rien déterminé par une volonté de « paix » et d' « harmonie entre les peuples », il était le produit de la défense de leurs intérêts impérialistes. Leur première préoccupation était de gagner la guerre, la deuxième d'enrayer tout risque de soulèvement ouvrier, comme cela s'était produit en 1917-18, ce qui explique le soin et la minutie qu'ils mirent dans leur stratégie de bombardements et d'occupation militaire ([7] [1923]), la troisième de se partager les bénéfices de la victoire.
La fin de la guerre sonna ainsi l'heure du repartage du monde entre les vainqueurs. En février 1945, les accords de Yalta signés par Roosevelt, Churchill et Staline, devaient symboliser l'unité des vainqueurs et le retour définitif de la « paix » pour l'humanité. Nous avons déjà dit plus haut ce qu'il en était de 1' « unité » des vainqueurs et « il est clair que l'ordre de Yalta n'était rien d'autre qu'une redistribution des cartes sur la scène impérialiste mondiale, laquelle ne pouvait déboucher que sur un déplacement de la guerre sous une autre forme : celle de la guerre "froide" entre l'URSS et l'alliance du camp "démocratique" (...). » Quant à la « paix » d'après-guerre « rappelons simplement que durant ce qu'on a appelé la "guerre froide", puis la "détente", autant de vies humaines ont été sacrifiées dans les massacres impérialistes opposant l'URSS et les Etats-Unis que durant la seconde boucherie mondiale. » ([8] [1924]) Et surtout, à la fin de la guerre on compte cinquante millions de victimes, en grande majorité dans la population civile, essentiellement dans les principaux pays belligérants (Russie, Allemagne, Pologne, Japon), et les destructions sont considérables, massives et systématiques. C'est ce « prix » de la guerre qui révèle la vraie nature du capitalisme au 20e siècle, quelle que soit sa forme : « fasciste », « stalinienne » ou « démocratique », et non la « paix » des cimetières et des ruines qui va régner pendant la période de la reconstruction. Le fait que les cinquante ans écoulés depuis 1945 n'ont plus vu de développement de la guerre en Europe n'a pas pour explication le caractère pacifique de la « démocratie » rétablie à la fin de la 2e guerre mondiale. La « paix » est revenue en Europe avec la victoire de l'alliance militaire des pays « démocratiques » et de l'URSS « socialiste » dans une guerre qu'ils ont menée jusqu'au bout, massacrant des millions de civils, sans plus d'égard pour les vies humaines que leur ennemi.
Au cas où la construction des mensonges d'aujourd'hui risquerait de se fissurer sous les coups d'une réalité qui parvient parfois à se dévoiler, le rappel et le martelage des mensonges d'hier viennent à point nommé pour consolider l'image des hauts faits de la « démocratie », garante de la « paix » et de la « stabilité » du .monde, alors que les événements de la situation mondiale ne cessent de contredire tous les discours de « paix ».
Les guerres de la décomposition capitaliste
Comme nous l'avons souvent analysé depuis les événements de 1989, la réunification de l'Allemagne et la destruction du mur de Berlin, la fin de la division du monde en deux blocs impérialistes rivaux n'a pas apporté la « paix », mais au contraire le déchaînement du chaos. La nouvelle situation historique n'a pas apaisé les rivalités impérialistes entre les grandes puissances. Si elle a fait disparaître l'ancienne rivalité est-ouest, issue du traité de Yalta, du fait de la disparition du bloc impérialiste russe, elle a par contre aiguisé les conflits entre les anciens alliés du bloc de l'ouest, qui ne sont plus désormais tenus par la discipline de bloc face à l'ennemi commun.
Cette nouvelle situation a ainsi engendré des massacres à répétition. Les Etats-Unis ont donné le signal avec la guerre du Golfe, en 1990-91. Puis, l'Allemagne, suivie par la France, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis ainsi que la Russie, ont transformé l'ex-Yougoslavie en un champ de bataille meurtrier, aux frontières de l'Europe « démocratique ». Ce pays est ainsi devenu depuis près de quatre ans le « laboratoire » de la capacité des puissances européennes à faire triompher leurs nouvelles ambitions impérialistes : l'accès à la Méditerranée pour l’Allemagne ; l'opposition de la France et de la Grande-Bretagne à ces visées ; et pour tous, la tentative de s'affranchir de la pesante tutelle des Etats-Unis, qui font tout pour garder leur rôle de gendarme du monde.
Ce sont les grandes puissances « démocratiques » qui ont allumé le brasier de l'ex-Yougoslavie. Ce sont ces mêmes grandes puissances qui mettent à feu et à sang des régions entières de l'Afrique, comme le Libéria ou le Rwanda ([9] [1925]), qui attisent les massacres comme en Somalie ou en Algérie, qui multiplient les foyers de guerre et de tension où les affrontements ne s'éteignent que pour s'embraser de nouveau avec une violence redoublée, comme en témoigne ce qui se passe maintenant au Burundi voisin du Rwanda. Au Moyen-Orient, après la guerre du Golfe, les Etats-Unis ont imposé leur domination sans partage sur la région, une « paix » armée qui constitue une poudrière prête à tout moment à s'embraser : entre Israël et les territoires palestiniens, au Liban ; autour du Kurdistan, en Turquie ([10] [1926]), en Irak, en Iran. En Amérique latine, pourtant « chasse gardée » des Etats-Unis, les nouvelles oppositions impérialistes des anciens alliés sont également présentes dans les conflits qui surgissent. Aussi bien la « révolte » des « zapatistes » de l'Etat du Chiapas au Mexique, soutenue en sous-main par les puissances européennes, que le regain de la guerre frontalière entre Pérou et Equateur, où les Etats-Unis poussent ce dernier à l'affrontement au régime péruvien ouvert à l'influence du Japon, manifestent que les grandes puissances sont prêtes à utiliser toutes les opportunités pour défendre leurs sordides intérêts impérialistes. Même si elles ne visent pas un gain immédiat pour leurs intérêts économiques et politiques dans tous les lieux de conflit, elles sont toujours prêtes à semer le désordre et fomenter la déstabilisation du terrain de leur adversaire. La prétendue « impuissance » à « contenir les conflits » et les « opérations humanitaires » ne sont que la couverture idéologique des agissements impérialistes pour la défense, chacun pour soi, de ses intérêts stratégiques.
Il existe des lignes de force majeures qui tendent à polariser la stratégie des impérialismes au niveau international : les Etats-Unis d'un côté, qui cherchent à maintenir leur leadership et leur statut de super-puissance; l'Allemagne de l'autre, qui assume le rôle de principal prétendant à la constitution d'un nouveau bloc. Mais ces tendances majeures ne parviennent pas à « ordonner » la situation : les Etats-Unis perdent de leur influence, ils n'ont plus la menace de l'ennemi commun à faire prévaloir pour tenir leurs « alliés » ; l'Allemagne n'a pas encore la stature d'une tête de bloc après cinquante ans d'allégeance obligée aux Etats-Unis et au « parapluie » de l'OTAN ainsi que de partition du pays entre les deux grands vainqueurs de la seconde guerre mondiale. Cette situation, conjuguée au fait que, dans les principaux pays développés, la classe ouvrière n'est pas acquise à la défense des intérêts du capital national et n'est pas embrigadée dans les visées impérialistes de la bourgeoisie, est à la base du désordre qui domine aujourd’hui les relations internationales.
Ce désordre n'est pas près de s'achever. Au contraire, il s'est encore accentué ces derniers mois avec les distances qu'est en train de prendre la Grande-Bretagne, le plus fidèle « lieutenant » des Etats-Unis depuis la première guerre mondiale, avec la politique américaine. La rupture est encore loin d'être consommée entre ces deux anciens alliés de toujours, mais l'évolution de la politique britannique de ces dernières années va clairement dans ce sens, constituant un fait historique de première importance qui manifeste la domination de la tendance au « chacun pour soi » au détriment de la discipline des alliances internationales. L'alliance entre France et Grande-Bretagne dans l'ex-Yougoslavie, visant à contrer la poussée allemande mais en même temps à tenir les Etats-Unis hors du jeu, a été une première étape de cette évolution. La création d'une force inter-africaine de « maintien de la paix et de prévention des crises en Afrique » entre ces mêmes pays a marqué un net revirement de la politique britannique qui, quelques mois auparavant, aidait encore les Etats-Unis à éliminer la présence française du Rwanda. Enfin l'accord franco-britannique de coopération militaire, par la constitution d'une unité commune de l'armée de l'air, vient de sanctionner le choix de plus en plus tranché de la Grande-Bretagne de prendre ses distances avec les Etats-Unis. Les Etats-Unis pour leur part ne cessent de faire pression sur la Grande-Bretagne contre cette évolution, par leur politique de soutien ouvert et désormais officiel au Sinn Fein qui développe depuis toujours le terrorisme séparatiste en Irlande du nord ; la tension entre les deux pays sur cette question n'a jamais été aussi forte. Le rapprochement franco-britannique n'est cependant pas pour autant un facteur de renforcement de la tendance à la constitution d'un nouveau bloc impérialiste autour de l'Allemagne. Au contraire, même s'il n'a pas provoqué un relâchement de l'alliance franco-allemande aussi important que celui qui mine désormais les relations entre Etats-Unis et Grande-Bretagne, il ne fait pas l'affaire de l'Allemagne. La Grande-Bretagne ne se rapprochera pas de l'Allemagne, par contre la France, forte de ce nouvel appui pour tenir tête à son encombrant tuteur germanique, risque de se montrer plus difficilement contrôlable par celui-ci.
Ainsi, loin des discours de « paix et de prospérité » qui avaient salué l'effondrement du bloc de l'Est et de l'URSS, les dernières années ont au contraire montré le hideux visage de guerres meurtrières, l'aiguisement des tensions impérialistes et un marasme grandissant de la situation économique et sociale, et cela pas seulement dans les pays de la périphérie du monde capitaliste, mais au coeur des pays les plus industrialisés.
Crise et « démocratie »
La « prospérité » n'est pas plus à l'ordre du jour que la « paix ». Dans les pays développés, la « reprise » économique de ces derniers mois est surtout spectaculaire en ce qu'elle n'entrave en rien la montée inexorable du chômage ([11] [1927]). Dans ces pays, ce n'est pas vers une amélioration mais vers une détérioration toujours plus grande des conditions de vie que s'achemine la société. Et en même temps que le chômage massif et les attaques sur les salaires qui rognent les conditions de vie des travailleurs, la décomposition sociale apporte chaque jour son lot de « faits divers » et de ravages destructeurs, parmi les sans- travail, chez les jeunes en particulier, mais également dans les comportements aberrants qui se développent comme une gangrène au sein de la population, que ce soit le fait des institutions rongées par une corruption de plus en plus évidente ou celui des individus entraînés par l'ambiance de désespoir qui envahit! Tous les pores de la vie sociale. Tous ces éléments ne sont pas le tribut à payer pour la « modernisation » du système capitaliste mondial ou les dernières manifestations de l'héritage d'une situation passée. Tout cela est au contraire le résultat de la perpétuation des lois de ce système capitaliste, la loi du profit et de l'exploitation de la force de travail, la loi de la concurrence et de guerre, que porte en lui le capitalisme comme mode de production dominant la planète et régissant les rapports sociaux, tout cela est la manifestation de la faillite définitive du capitalisme Dans la classe ouvrière, la conscience de cette faillite, si elle est loin d'être entièrement inexistante, est complètement obscurcie par l'idéologie que déverse en permanence la classe dominante. A travers ses moyens de propagande que sont les médias aux ordres, par les discours et les activités des partis, des syndicats, et de toutes les institutions au service de la bourgeoisie, cette dernière, au-delà des divergences qui opposent ses diverses fractions, martèle ses thèmes :
- « le système capitaliste n'est pas parfait, mais il est le seul système viable » ;
- « la démocratie a ses brebis galeuses, mais c'est le seul régime politique qui possède les bases et les principes nécessaires à la paix, aux droits de l'homme et à la liberté » ;
- « le marxisme a fait faillite ; la révolution communiste a mené à la barbarie stalinienne, la classe ouvrière doit se détourner de l'internationalisme et de la lutte de classe, et s'en remettre au capital, seul capable de subvenir à ses besoins ; toute tentative de bouleversement révolutionnaire de la société est au mieux une utopie, et revient, au pire, à faire le jeu de dictateurs cupides et sanguinaires qui ne respectent pas les lois de la démocratie. »
Bref, il faudrait croire en la « démocratie » bourgeoise ; elle seule aurait un avenir. Et face à l'inquiétude profonde qu'engendre la situation actuelle, face à la brutalité des événements de la situation internationale et de la réalité quotidienne, face à l'angoisse de l'avenir que le chômage massif provoque dans la population, dans les familles, dans un contexte où la classe ouvrière n'est pas prête au sacrifice du sang pour les intérêts du capitalisme, ce message n'est pas simple à faire passer. Le battage sur les «opérations humanitaires», supposées démontrer la capacité des « grandes démocraties » à maintenir la « paix », a ses limites : celle de l'inévitable poursuite des guerres et des massacres. Les opérations en Somalie et la prestation des troupes de l'ONU dans l'ex-Yougoslavie en sont une claire illustration. Le battage sur la « reprise économique » a lui aussi ses limites : celui du chômage persistant et des attaques sur les salaires. Les « opérations mains propres» à l'italienne, visant à redonner de la moralité à la vie politique ont elles aussi leurs limites : ce sont toujours les mêmes qui sont aux commandes et les affaires et scandales, s'ils visent à faire croire à la moralisation de la politique bourgeoise, ont aussi leurs revers, celui de dévoiler la corruption généralisée. C'est pourquoi la commémoration de la fin de la 2e guerre mondiale est autant d' « actualité » ([12] [1928]), pour venir renforcer la propagande de la « défense de la démocratie » qui est aujourd'hui le thème principal de l'idéologie de soumission du prolétariat aux intérêts de la bourgeoisie, contre le développement de la prise en main de ses luttes contre le capitalisme.
MG, 23/3/95.
[1] [1929] Voir « Militarisme el décomposition », Revue Internationale n° 64. 1er trim. 91.
[2] [1930] Voir « Les grandes puissances, 1 auteurs de guerre », Revue Internationale n° 77, 2e trim. 94, et « Derrière les mensonges de "paix", la barbarie capitaliste », Revue Internationale n° 78.
[3] [1931] Voir « Commémorations de 1944 : 50 ans de mensonges impérialistes », Revue Internationale n° 78 et 79.
[4] [1932] Voir « Tous contre tous », Revue Internationale n° 80.
[5] [1933] Quelques articles : « Guerre, militarisme et blocs impérialistes », Revue Internationale n° 52 et 53, 1er-2ème trim. 88 ; « Les vraies causes de la 2e guerre mondiale » (Gauche communiste de France, 1945), Revue Internationale n° 59, 4e trim. 89 ; « Les massacres et les crimes des "grandes démocraties" », Revue Internationale n° 66, 3e trim. 91.
[6] [1934] « Les massacres et les crimes des "grandes démocraties" »,
[7] [1935] « Commémorations de 1944 : 50 ans de mensonges impérialistes », Revue Internationale n° 79, « Les luttes ouvrières en Italie 1943 », Revue Internationale n° 75, 4e trim. 93.
[8] [1936] « Un demi-siècle de conflits guerriers et de mensonges pacifistes », Révolution internationale n° 242, février 95.
[9] [1937] « Les grandes puissances répandent le chaos », Revue Internationale n° 79.
[10] [1938] A l'heure où nous bouclons ce numéro, la Turquie vient de lancer une vase opération militaire au Kurdistan. 35 000 soldats « nettoient » actuellement le nord de l'Irak. Il est sûr qu'une telle invasion a l'aval des grandes puissances. La Turquie, allié « naturel » de l'Allemagne mais également place- forte du dispositif de l'impérialisme américain, n'agit certainement pas seule. Voir les articles dans notre presse territoriale sur ces événements.
[11] [1939] Voir « Une reprise sans emplois », Revue Internationale n° 80.
[12] [1940] II est significatif à cet égard que c'est non seulement dans les pays vainqueurs, aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, en France, ainsi qu'en Russie, que se déroulent des célébrations de l'année 1945, mais également en Allemagne et au Japon, les grands vaincus de la guerre. En Allemagne par exemple, la propagande officielle a utilisé le douloureux souvenir des bombardements massifs de la ville de Dresde par l'aviation des Alliés en février 1945, qui firent plusieurs dizaines milliers de victimes (35 000 victimes dénombrées, en réalité entre 135 000 et 200 000), en rappelant en partie l'inanité et l'inutilité du point de vue de la stratégie militaire d'un tel massacre, ce qui est un fait officiellement reconnu aujourd'hui, mais surtout en justifiant la « leçon » que la « démocratie » infligea à l'Allemagne : « Nous voulons que le bombardement de Dresde soit un jour anniversaire pour tous les morts de la Seconde guerre mondiale. Nous ne devons pas oublier que c'est Hitler qui a commencé la guerre, et que c'est Goering qui rêvait de "coventryser" [référence au bombardement de Coventry par l'Allemagne] toutes les villes britanniques. Nous ne pouvons nous permettre aujourd'hui de dire que nous sommes les victimes des bombardements alliés. Savoir si ce bombardement était nécessaire est l'affaire des historiens. » (Ulrich Hôver, porte-parole du maire de Dresde, Libération, 13/2/95). De même au Japon où se prépare la célébration de l'anniversaire de la capitulation d'août 1945, le gouvernement veut faire passer un projet de résolution reconnaissant que le Japon était l'agresseur. Là aussi c'est significatif du besoin de la bourgeoisie, au niveau international, de rallier la mystification la plus efficace aujourd'hui que représente la « défense de la démocratie ».
Questions théoriques:
- Guerre [129]
- Impérialisme [321]
Heritage de la Gauche Communiste:
Tourmente financière : La folie ?
- 2838 reads
Un mot revient de plus en plus souvent dans les commentaires des médias à propos de la situation financière mondiale : « folie ». Folie de la spéculation monétaire qui fait circuler plus de 1000 milliards de dollars par jour, soit à peu près la valeur de la production annuelle de la Grande-Bretagne ; folie des « produits dérivés », ces investissements destinés à spéculer en bourse, basés sur des mécanismes qui n'ont rien à voir avec les réalités économiques, utilisant des modèles mathématiques si complexes que seuls quelques jeunes experts arrivent à les comprendre, mais qui mobilisent des masses de plus en plus énormes d'argent et peuvent en quelques jours faire s'écrouler les plus « respectables » des institutions bancaires; folie de la spéculation immobilière qui rend actuellement le mètre carré de bureau dans certains quartiers de Bombay plus cher qu'à New York, mais qui par ailleurs pousse une grande partie des banques françaises vers la faillite : folie des fluctuations monétaires qui en quelques semaines déstabilisent le commerce mondial....
Ces manifestations de « folie » nous sont présentées comme le produit des nouvelles libertés de circulation des capitaux au niveau international, des progrès de l'informatique et des communications ou encore de la trop grande avidité de certains « spéculateurs ». // suffirait de remettre un peu d'ordre dans tout cela, en renforçant les contrôles sur « les spéculateurs » et sur certains mouvement de capitaux pour que tout se calme et que l'on profite en paix de la prétendue « reprise » de l'économie mondiale. Mais la réalité est beaucoup plus grave et dramatique que ce que les « experts » veulent bien se raconter et nous faire croire.
Le début d'une nouvelle tourmente financière
Depuis le début de 1995, le monde financier a été secoué par des événements aussi spectaculaires que significatifs. Parmi eux, il faut citer :
-aux Etats-Unis, la banqueroute de l'Orange County en Californie, haut lieu du libéralisme économique pur et dur (c'est de là qu'était partie la candidature de Reagan au nom du « moins d'Etat »). Le gouvernement local avait placé une grande partie de ses avoirs en produits spéculatifs à haut risque. La hausse des taux d'intérêt a provoqué sa banqueroute totale ;
-en France, la découverte de l'énorme déficit du Crédit Lyonnais, une des plus grandes banques européennes, confrontée à des pertes gigantesques du fait d'opérations spéculatives mineuses, en particulier dans l'immobilier. L'évaluation du coût de l'opération de « sauvetage » atteint des chiffres pharamineux, de l'ordre de 26 milliards de dollars ;
- la faillite d'une des plus vieilles et « respectables » banques de Grande-Bretagne, la Barings, où la Reine elle-même a une partie de ses dépôts, sous l'effet d'un mauvais placement spéculatif réalisé par un de ses jeunes « génies de la finance » de son agence de Singapour sur la bourse de Tokyo ;
- l'effondrement de la SASEA, la plus grande faillite bancaire dans l'histoire de ce temple de la finance mondiale qu'est la Suisse ;
- la mise en cessation de paiement du principal courtier de la Bourse de Bombay, capitale financière de l'Inde, qui vient de contraindre les autorités à fermer celle-ci pendant plusieurs jours pour éviter que la catastrophe n'entraîne une réaction en chaîne ;
-on pourrait encore citer cette scène surréaliste, significative de la folie qui se développe dans le monde financier, où l'on a vu, au mois de mars, à la Bourse de Karachi (Pakistan), dix chèvres noires être égorgées après avoir été le plus solennellement du monde promenées dans les salles de change, pour tenter de conjurer le sort qui faisait plonger les valeurs à leur niveau le plus bas depuis 16 mois...
Parmi les événements qui marquent ce qui constitue le début d'une véritable nouvelle tourmente financière mondiale, il en est un qui a revêtu une importance particulière et qui mérite qu'on s'y arrête : la crise mexicaine.
La crise financière mexicaine
La crise de paiement qu'a connu le Mexique au début de 1995 n'est pas un soubresaut comme un autre dans les convulsions qui régulièrement secouent les pays du « tiers-monde ». Déjà, en 1982, en pleine récession mondiale, c'est l'insolvabilité de ce pays qui avait déclenché une puissante crise financière mondiale. Aujourd'hui, avec ses 90 millions d'habitants, le Mexique représente la 13e économie mondiale, et se situe au 6e rang mondial pour les réserves pétrolières. Il y a encore quelques mois, ce pays était présenté comme un modèle de réussite économique, sinon « le modèle », et c'est avec les félicitations des « experts » du monde entier qu'il venait de faire son entrée dans l'ALENA et l'OCDE à côté des pays les plus industrialisés.
La fuite soudaine d'une grande partie des capitaux étrangers du Mexique, la violente dévaluation du Peso à laquelle ce pays a dû recourir, la menace d'insolvabilité pour rembourser les 7 milliards de dollars d'intérêts qu'il doit payer sur sa dette publique avant le mois de juin prochain, ont été déclenchés par la hausse des taux d'intérêt américains. Sa banqueroute n'est pas tant le produit de ses seules faiblesses internes que de la fragilité et instabilité du système financier mondial, rongé jusqu'à la moelle par des années de spéculations et manipulations en tout genre. L'ampleur et la rapidité sans précédents de la réaction des principales puissances économiques en sont une preuve indiscutable.
Lorsque dans la Revue Internationale n° 78 (3e trimestre 94) nous tracions la perspective d'une prochaine tourmente financière mondiale, nous nous fondions sur le fait que les déficits des Etats et surtout le développement des dettes publiques (en particulier dans les pays développés) constituaient une bombe a retardement qui tôt ou tard devrait exploser, l'élément déclencheur devant être l'inévitable hausse des taux d'intérêt que le financement de ces dettes devrait entraîner. La crise mexicaine constitue une première vérification de cette perspective.
La panique internationale déclenchée par l'insolvabilité potentielle du Mexique est significative de la fragilité et du degré de maladie du système financier mondial. Le prêt consenti au départ par le FMI au Mexique, 7,75 milliards de dollars, est le plus important jamais accordé par cet organisme. Le « paquet » de crédits internationaux rassemblé par l'ensemble des plus grandes puissances financières sous la pression des Etats-Unis, 50 milliards de dollars, est sans précédent. La déclaration de Michel Camdessus, directeur du FMI, pour justifier l'urgence et l'ampleur de l'opération de sauvetage donnait la mesure de l'événement en parlant du risque d'une « véritable catastrophe mondiale ».
La dévaluation du Peso mexicain ne pouvait pas ne pas avoir de conséquences sur le système monétaire international. Les monnaies ont constitué au cours des dernières années un des domaines privilégiés de la spéculation. A la suite du Peso, le dollar canadien a chuté à son niveau le plus bas depuis 9 ans. La lire italienne, la peseta, l'escudo, sans parler des monnaies d'Amérique latine ont été soumis a de fortes pressions. Mais surtout, le dollar US, la monnaie mondiale, a commencé à être fortement attaqué.
La crise mexicaine a eu aussi d'autres répercussions. Depuis décembre dernier, les Bourses latino-américaines ont connu une chute spectaculaire de leurs valeurs. ([1] [1941]) L'effondrement mexicain a provoqué une accélération de cette chute, en particulier en Argentine. L'indice de l’International Herald Tribune, qui mesure l'évolution moyenne de l'ensemble des Bourses du sous-continent est passé de 160 à 80 entre décembre 1994 et le début de février 1995. Les « experts » ont raison de craindre la possibilité de contagion à partir du Mexique et la nécessité de nouvelles opérations de sauvetage. La situation de certaines de économies dites « émergentes » est, à ce niveau, particulièrement dangereuse pour l'économie mondiale dans la mesure où elles disposent de très peu de réserves de devises. C'est le cas en particulier pour la Chine, l'Indonésie et les Philippines. ([2] [1942])
Un avertissement
Lors du 25e forum de Davos, en janvier, en Suisse, où se sont retrouvés pendant une semaine un millier d'hommes d'affaires et ministres de tous les pays pour analyser la situation économique mondiale, la crise mexicaine a clairement été identifiée comme un « avertissement » et la crainte de la contagion était sur toutes les lèvres. Voici comment un journal français rendait compte de l'ambiance de cette « Mecque du libéralisme économique » :
« Désormais, tous les regards sont tournés vers l'Asie, où la perspective d'une crise chinoise entretient le spectre d'un grand tourbillon des capitaux... Déjà, certaines banques occidentales se plaignent de problèmes de remboursement posés par certaines entreprises d'Etat chinoises. Une étincelle pourrait tout faire sauter. Zhu Rongu, vice-premier ministre chinois, chargé de l'économie est venu à Davos rassurer les milieux d'affaires : "Nous sommes sûrs de faire redescendre le taux d'inflation cette année (...) La Chine honorera ses engagements internationaux !" Mais les chiffres qu'il a assenés pour montrer la place que tenait désormais la Chine dans l'économie mondiale ont plus inquiété l'auditoire qu'ils ne l'ont rassuré : "En hausse de 32 %, les investissements étrangers directs ont atteint 32 milliards de dollars en 1994, ce qui place la Chine au second rang derrière les Etats-Unis (...) Sur les 500 plus grandes entreprises du monde recensées par le magazine Fortune, plus de 100 ont investi en Chine." Des chiffres qui montrent à quel point un choc sur l'économie chinoise pourrait affecter l'économie mondiale, à commencer parles pays asiatiques dont le développement rapide était jusque là réputé solide. »([3] [1943]).
Un récent rapport du Pentagone craint que la mort de Deng soit suivie d'un démembrement des provinces dans un affrontement entre « conservateurs » et « réformateurs ». Ce rapport affirme explicitement: « La Chine constitue le plus grand facteur d'incertitude pour l'Asie. »
Une autre source d'inquiétude pour les financiers internationaux c'est la Russie. L'économie de ce pays continue sa plongée dans le chaos le plus total, illustrant on ne peut mieux l'idée du développement de la folie (la deuxième puissance militaire du monde, disposant d'un arsenal nucléaire capable de détruire plusieurs fois la planète, a comme chef d'Etat un alcoolique dont on estime qu'il n'a que deux ou trois heures de lucidité par jour). Noyé dans d'énormes dettes internationales, le capital russe continue de supplier le F.M.I. et autres bailleurs de fonds internationaux de lui venir en aide, sans résultat. Sa situation sur le marché international est pourtant plus que dangereuse : ses réserves de devises sont tombées à 2 milliards de dollars. Le budget de 1995 est calculé sur la base d'une aide de 10 milliards de dollars venant de l'étranger. Mais personne, et en premier lieu le F.M.I. n'a envie de jeter l'argent dans ce qui apparaît comme un trou sans fond.
La crise monétaire
Un autre aspect des turbulences financières actuelles se situe au niveau des monnaies. Comme on l'a vu, l'effondrement du Peso mexicain a eu des répercussions immédiates sur le cours d'autres monnaies, en particulier le dollar. Mais, depuis lors, le calme n'est toujours par revenu dans ce domaine. Au contraire. La lire italienne, la peseta espagnole ont continué de se dévaluer, battant des records historiques face au mark allemand. La livre britannique et même le franc français continuent d'être fortement sous pression. Le SME, ce système destiné à maintenir un minimum d'ordre entre les principales monnaies de l'Union Européenne, et qui avait déjà récemment été soumis à rude épreuve (il n'a pu survivre qu'au prix d'un très fort élargissement des marges de fluctuation entre les monnaies qui en font partie), se voit de nouveau battu en brèche. Quant au dollar, il poursuit sa chute, encouragée en partie par l'intérêt qu'y voient les capitalistes américains pour accroître la compétitivité de leurs produits à l'exportation. Mais la dévaluation de la principale monnaie de la planète traduit tout d'abord la réalité du développement des déficits et de l'endettement de la première économie mondiale : la dette publique américaine, le déficit du gouvernement fédéral ainsi que le déficit du commerce extérieur n'ont cessé de croître, et c'est fondamentalement cette réalité que sanctionne la faiblesse du dollar.
La valeur, la solidité des monnaies repose, en dernière instance, sur la « confiance » qu'ont les capitalistes en leur propre économie, et en leurs propres institutions financières, au premier rang desquelles se trouve l'organisme émetteur de la monnaie : l'Etat. Or, ni pour l'une, ni pour les autres il n'y a de fondements pour une quelconque « confiance ». L'économie mondiale reste étouffée par le manque de débouchés solvables, noyée dans la surproduction, et l'accroissement de la productivité du travail n'a fait qu'aggraver le problème. Quant aux institutions financières, la débauche spéculative des dernières années, la fuite en avant dans l'endettement depuis deux décennies, les multiples « tricheries » auxquelles elles se sont livrées pour survivre, ont définitivement ruiné la « confiance » qu'elles pouvaient mériter. C'est pourquoi, les actuelles secousses du système monétaire international ne constituent pas un simple réajustement momentané, mais une manifestation du délabrement croissant du système financier international et de l'impasse du capitalisme lui même.
Un krach financier est inévitable. Sous certains aspects, il est même déjà en cours. Même du point de vue du capitalisme, une forte « purge » de la « bulle spéculative » est indispensable. Celle du krach de l'automne 1987 n'eut pas de conséquences négatives immédiates sur la croissance de la production. Au contraire. Elle n'en fut pas moins le signe annonciateur de la récession qui s'est ouverte à la fin de 1989. Aujourd'hui, la bulle spéculative et, surtout, l'endettement des Etats ont augmenté de façon inouïe. Dans ces circonstances, nul ne peut prévoir où s'arrêtera la violence d'une telle purge. Mais, en tout état de cause, elle se traduira par une destruction massive de capital fictif qui jettera dans la ruine des pans entiers du capital mondial, ouvrant la voie à une nouvelle aggravation de la récession économique au niveau réel.
Spéculation et surproduction
Les dégâts financiers provoqués par les contrecoups d'années de « folie » spéculative sont tellement importants que même les plus acharnés défenseurs du capitalisme sont contraints de constater que quelque chose de grave se passe dans leur économie. Mais, il n'en déduisent pas pour autant que ce pourrait être le système lui-même qui est profondément malade, mortellement condamné par son incapacité à dépasser ses contradictions fondamentales, en particulier son incapacité à créer des débouchés solvables suffisants pour sa production. Ils ne voient la crise au niveau de la spéculation que pour mieux se la cacher au niveau réel. Ils croient, et font croire, que les difficultés au niveau réel de la production (surproduction, chômage, entre autres) sont le produit des excès spéculatifs, alors qu'en dernière instance, s'il y a eu « folie spéculative » c'est parce qu'il y avait déjà des difficultés réelles. Marx dénonçait déjà cette mystification au siècle dernier :
« La crise elle même éclate d'abord dans le domaine de la spéculation, et ce n'est que plus tard qu'elle s'installe dans la production. A l'observation superficielle, ce n'est pas la surproduction, mais la sur-spéculation pourtant simple symptôme de la surproduction -qui paraît être la cause de la crise. La désorganisation ultérieure de la production n'apparaît pas comme un résultat nécessaire de sa propre exubérance antérieure, mais connue une simple réaction de la spéculation en train de s'effondrer. » ([4] [1944])
Les forces de « gauche » de l'appareil politique bourgeois, les partis « ouvriers », les syndicats et les gauchistes, reprennent aujourd'hui cette façon mystifiée de voir la réalité en disant aux exploités que, pour résoudre leurs problèmes, il suffit d'exiger des gouvernements une plus grande sévérité contre les « spéculateurs ». Comme toujours, elles détournent sur de fausses cibles le mécontentement qui normalement se développe contre les fondements mêmes du système. Là où la réalité met en évidence l'impasse historique du mode de production capitaliste, l'incompatibilité totale entre les intérêts de la classe exploitée et ceux de la classe dominante, elles posent les problèmes en termes de « meilleure gestion » du système par cette dernière. Elles ne dénoncent la spéculation que pour mieux défendre le système qui l'engendre.
La « folie » que les différents « observateurs critiques » constatent au niveau financier mondial n'est pas le produit de quelques dérapages de spéculateurs avides de profit immédiat. Cette folie n'est que la manifestation d'une réalité beaucoup plus profonde et tragique : la décadence avancée, la décomposition du mode de production capitaliste, incapable de dépasser ses contradictions fondamentales et empoisonné par plus de deux décennies de manipulations de ses propres lois.
La véritable folie ce n'est pas la spéculation mais le maintien du mode de production capitaliste. L'issue pour la classe ouvrière, et pour l'humanité ne réside pas dans une quelconque politique des Etats contre la spéculation et quelques agents financiers, mais dans la destruction du capitalisme lui-même.
RV.
[1] [1945] Le développement de la spéculation dans les Bourses de certains pays sous-développés, au cours de la période récente, est une manifestation évidente de la folie financière qui n'a cessé de se développer pendant la « reprise ». Les profits qui y ont été réalisés sont aussi fabuleux qu'artificiels. En 1993, aux Philippines, la performance boursière a été de + 146,3%, à Hongkong de +131 %, au Brésil de +91,3 %. En 1994 les Philippines et Hongkong perdent -9,6 % et -37,8 % mais le Brésil gagne encore +50,9% (en francs français, mais +1112% en monnaie locale), le Pérou +37,69 %, le Chili +33,8 %. Les capitaux spéculatifs s'y précipitent avec d'autant plus d'intérêt qu'en 1994 certaines Bourses occidentales s'érodent fortement : -13 % en Grande Bretagne. -17 % en France.
[2] [1946] Le cas du Mexique résume la réalité du mirage des soi-disant « économies émergentes » (certains pays d'Amérique Latine, tels le Chili, ou d'Asie, tels l'Inde et surtout la Chine) qui ont connu dans les dernières années un certain développement économique grâce à d'importants afflux de capitaux étrangers. Les « économies émergentes » ne sont pas la nouvelle espérance de l'économie mondiale. Elles ne sont que des manifestations aussi fragiles qu'aberrantes d'un système en folie.
[3] [1947] Libération, 30 janvier 1995.
[4] [1948] Marx, « Revue de mai à octobre 1850 », publié par Maximilien Rubel, dans Etudes de Marxologie, n° 7, août 1963.
Questions théoriques:
- L'économie [86]
- Décadence [32]
REVOLUTION ALLEMANDE(I) : les débuts de la révolution
- 3728 reads
Les révolutionnaires en Allemagne pendant la première guerre mondiale
Lorsqu'en août 1914 est déclenchée la première guerre mondiale, qui causera plus de vingt millions de victimes, le rôle déterminant que jouent les syndicats, et surtout la social-démocratie, est clair aux yeux de tous.
Au Reichstag, le SPD approuve unanimement le vote des crédits de guerre. Simultanément, les syndicats appellent à l'Union Sacrée interdisant toute grève et se prononçant pour la mobilisation de toutes les forces dans la guerre.
Voila comment la social-démocratie justifie le vote des crédits de guerre par son groupe parlementaire : « A l'heure du danger, nous n'abandonnons pas notre propre pairie. Nous nous sentons par là en concordance de vues avec l'Internationale, qui a reconnu de tous temps le droit de chaque peuple à l'indépendance nationale et à l'autodéfense, de même que nous condamnons en accord avec elle toute guerre de conquête. Inspirés par ces principes, nous votons les crédits de guerre demandés. » Patrie en danger, défense nationale, guerre populaire pour la civilisation et la liberté, tels sont les « principes » sur lesquels s'appuie la représentation parlementaire de la social-démocratie.
Dans l'histoire du mouvement ouvrier, cet événement représente la première grande trahison d'un parti du prolétariat. Comme classe exploitée, la classe ouvrière est une classe internationale. C'est pourquoi l'internationalisme est le principe le plus fondamental pour toute organisation révolutionnaire du prolétariat ; la trahison de ce principe conduit inéluctablement l'organisation qui la commet dans le camp ennemi, celui du capital.
Alors que le capital en Allemagne n'aurait jamais déclenché la guerre s'il n'avait pas été certain de pouvoir compter sur le soutien des syndicats et de la direction du SPD, alors que la trahison de ceux-ci n'est pas une surprise pour la bourgeoisie, elle provoqua un énorme choc dans les rangs du mouvement ouvrier. Même Lénine, au début, ne veut pas croire que le SPD a voté les crédits de guerre. Il considère les premières informations comme une manipulation visant à diviser le mouvement ouvrier. ([1] [1949])
En effet, vu l'accroissement des tensions impérialistes depuis des années, la II° Internationale est intervenue précocement contre ces préparatifs guerriers. Lors des congrès de Stuttgart en 1907 et de Bâle en 1912 - et jusqu'aux derniers jours de juillet 1914 même - elle se prononce contre la propagande et les visées guerrières de la classe dominante ; et cela, malgré une résistance acharnée de son aile droite, déjà très puissante.
« Au cas où la guerre viendrait cependant à éclater, il est du devoir de la social-démocratie d'agir pour la faire cesser promptement et de s'employer, de toutes ses forces, à exploiter la crise économique et politique créée par la guerre pour agiter le peuple et précipiter ainsi l'abolition de la domination capitaliste. » (Résolution adoptée en 1907 et confirmée en 1912.)
« Il y a péril en la demeure, la guerre mondiale menace ! Les classes dominantes qui, en temps de paix, vous étranglent, vous méprisent, vous exploitent, veulent vous transformer en chair à canon. Partout il doit résonner aux oreilles des despotes : Nous refusons la guerre ! A bas la guerre ! Vive la fraternisation internationale des peuples ! » (Appel du comité directeur du SPD du 25 juillet 1914, c'est-à-dire dix jours avant l'approbation de la guerre le 4 août 1914.)
Quand les députés du SPD votent en faveur de la guerre, c'est en tant que représentants du plus grand parti ouvrier d'Europe, parti dont l'influence dépasse largement le cadre de l'Allemagne, parti qui est le produit de plusieurs décennies de travail et d'effort (souvent dans les conditions les plus défavorables, comme ça a été le cas sous la loi anti-socialiste, lorsqu'il était interdit), parti qui détient plusieurs dizaines de quotidiens et d'hebdomadaires. En 1899, le SPD possédait 73 journaux dont le tirage global atteignait 400.000 exemplaires et 49 d'entre eux paraissaient six fois par semaine. En 1900, ce parti comptait plus de 100.000 membres.
Ainsi, au moment de la trahison de la direction du SPD, le mouvement révolutionnaire se trouve face à une question fondamentale : faut-il laisser cette organisation ouvrière de masse passer corps et biens dans le camp de l'ennemi ?
Mais la direction du SPD en Allemagne n'est pas la seule à avoir trahi. En Belgique, le président de l'Internationale, Vandervelde, devient ministre du gouvernement bourgeois, ainsi que le socialiste Jules Guesde en France. Dans ce pays, le Parti Socialiste va se déterminer unanimement en faveur de la guerre. En Angleterre, où le service militaire n'existait pas, le Labour Party prend en mains l'organisation du recrutement. Même si, en Autriche, le Parti Socialiste ne vote pas formellement pour la guerre, il fait une propagande effrénée en sa faveur. En Suède, en Norvège, en Suisse, aux Pays-Bas les dirigeants socialistes votent les crédits de guerre. En Pologne, le Parti Socialiste se prononce, en Galicie-Silésie, en faveur du soutien à la guerre, mais contre, en Pologne russe. La Russie offre une image partagée : les anciens dirigeants du mouvement ouvrier de ce pays, comme Plekhanov, le chef des anarchistes russes, Kropotkine, mais aussi une poignée de membres du Parti Bolchevik de l'émigration en France, appellent à la défense contre le militarisme allemand. En Russie, la fraction sociale-démocrate de la Douma fait une déclaration contre la guerre. C'est la première déclaration officielle contre la guerre de la part d'un groupe parlementaire de l'un des principaux pays belligérants. Le Parti Socialiste italien prend, dès le début, position contre la guerre. En décembre 1914 le parti exclut de ses rangs un groupe de renégats qui, sous la direction de Benito Mussolini, se rangent du côté de la bourgeoisie favorable à l'Entente et font de la propagande pour la participation de l'Italie à la guerre mondiale. Le Parti Social-démocrate Ouvrier de Bulgarie (Tesniaks) adopte aussi une position internationaliste conséquente.
L'Internationale, l'orgueil de la classe ouvrière, s'effondre dans les flammes de la guerre mondiale. Le SPD devient un « cadavre puant ». L'Internationale se désintégre et se transforme, comme l'écrit Rosa Luxemburg, en « un amas de bêtes fauves prises de rage nationaliste qui s'entre-déchirent mutuellement pour la plus grande gloire de la morale et de l'ordre bourgeois ». Seuls quelques groupes en Allemagne - Die Internationale, « Lichtstrahlen », la Gauche de Brème -, le groupe de Trotsky, Martov, une partie des syndicalistes français, le groupe De Tribune (avec Gorter, Pannekoek) en Hollande, ainsi que les Bolcheviks, défendent le point de vue résolument internationaliste.
Parallèlement à cette trahison décisive de la majorité des partis de la II° Internationale, la classe ouvrière subit un matraquage idéologique qui parvient à lui inoculer la dose fatale de poison nationaliste. En août 1914, ce n'est pas seulement la plus grande partie de la petite-bourgeoise qui est embrigadée derrière les visées expansionnistes de l'Allemagne, mais aussi des secteurs entiers de la classe ouvrière, galvanisés par le nationalisme. De plus, la propagande bourgeoise entretient l'illusion qu’ « en l'espace de quelques semaines, au plus tard d'ici Noël », la guerre sera terminée et tout le monde rentré chez soi.
A la veille de la guerre, malgré ses conditions particulièrement défavorables, la minorité de révolutionnaires qui reste intransigeante sur le principe de l'internationalisme prolétarien ne va ni se résigner ni abandonner le combat.
Les révolutionnaires et leur lutte contre la guerre
Alors que la grande majorité de la classe ouvrière reste grisée par le nationalisme, le soir du quatre août 1914 les principaux représentants de la Gauche de la social-démocratie organisent une réunion dans l'appartement de Rosa Luxemburg, rassemblant K. et H. Duncker, H. Eberlein, J. Marchlewski, F. Mehring, E. Meyer, W. Pieck. Même si leur nombre ce soir-là est réduit, leur action au cours des quatre années suivantes va connaître un immense rayonnement.
Plusieurs questions essentielles sont à l'ordre du jour de cette conférence :
- l'évaluation du rapport de force entre les classes,
- l'évaluation du rapport de force au sein du SPD,
- les objectifs de la lutte contre la trahison de la direction du parti,
- les perspectives et les moyens de cette lutte.
La situation générale, à l'évidence très défavorable, ne constitue en rien un motif de résignation pour les révolutionnaires. Leur attitude n'est pas de rejeter l'organisation mais, au contraire, de continuer, développer le combat en son sein et lutter avec détermination pour lui conserver ses principes prolétariens.
Au sein du groupe parlementaire social-démocrate au Reichstadt il y a eu, avant le vote en faveur des crédits de guerre, un débat interne au cours duquel 78 députés se sont prononcés pour, et 14 autres contre ce vote. Par discipline de fraction, les 14 députés - dont Liebknecht- se sont plies à la majorité et ont voté les crédits. Ce fait a été tenu secret par la direction du SPD.
Au niveau local dans le parti, les choses apparaissent bien moins unitaires. Des protestations contre la direction s'élèvent aussitôt de la part de nombreuses sections (Ortsvereine). Le 6 août, l'écrasante majorité de rassemblée de la section locale de Stuttgart exprime sa défiance à la fraction parlementaire. La gauche réussit même à exclure la droite du parti, à lui arracher le journal local. A Hambourg, Laufenberg et Wolfheim rassemblent l'opposition autour d’eux, à Brème, le Bremer-Burger-Zeitung intervient avec détermination contre la guerre ; le Bramschweiger Volksfreund, le Gothaer Volksblat, Der Kampf de Duisburg, des journaux de Nuremberg, Halle, Leipzig et Berlin élèvent également des protestations, reflétant l'opposition de larges parties de la base du parti. Lors d'une assemblée à Stuttgart le 21 septembre 1914, une critique est adressée à l'altitude de Liebknecht. Lui-même dira par la suite que d'avoir agi comme il l'avait fait, par discipline de fraction, avait été une erreur désastreuse. Comme, dès le début de la guerre, tous les journaux sont soumis à la censure, les expressions de protestations sont immédiatement réduites au silence. L'opposition dans le SPD s'appuie alors sur la possibilité de faire entendre sa voix à l'étranger. Le Berner Tagwacht va devenir le porte-parole de la gauche du SPD ; de même, les internationalistes vont exprimer leur position dans la revue Lichtstrahlen, éditée par Borchardt de septembre 1913 à avril 1916.
Un examen de la situation au sein du SPD montre que si la direction a trahi, l'ensemble de l'organisation ne s'est pas laissé embrigader dans la guerre. C'est pourquoi la perspective apparaît clairement : pour défendre l'organisation, pour ne pas l'abandonner aux mains des traîtres, il faut décider leur expulsion et rompre clairement avec eux.
Au cours de la conférence dans l'appartement de Rosa Luxemburg est discutée la question : doit-on, en signe de protestation ou par dégoût face à la trahison, quitter le parti ? Unanimement, cette idée est rejetée pour la raison qu'il ne faut pas abandonner l'organisation, l'offrir, pour ainsi dire en cadeau, à la classe dominante. On ne peut pas, en effet, quitter le parti, qui a été bâti au prix d'énormes efforts, tout comme des rats quittent un navire. C'est pourquoi se battre pour l'organisation ne signifie pas alors en sortir mais combattre pour sa reconquête.
Personne ne pense, à ce moment-là, à quitter l'organisation. Le rapport de forces ne contraint pas la minorité à le faire. De même il ne s'agit pas, pour l'instant, de construire une nouvelle organisation indépendante. Rosa Luxemburg et ses camarades, par leur attitude, font ainsi partie des défenseurs les plus conséquents de la nécessité de l'organisation.
Le fait est que, longtemps avant que la classe ouvrière n'émerge de son abrutissement, les internationalistes ont déjà engagé le combat. Comme avant-garde, ils n'attendent pas les réactions de la classe ouvrière dans son ensemble mais se portent à la tête du combat de leur classe. Alors que le poison nationaliste poursuit son effet sur la classe ouvrière, que celle-ci est livrée idéologiquement et physiquement au feu de la guerre impérialiste, les révolutionnaires - dans les conditions les plus difficiles de l'illégalité - ont eux-mêmes déjà démasqué la nature impérialiste du conflit. Là aussi, dans leur travail contre la guerre, les révolutionnaires ne se mettent pas en position d'attendre que le processus de prise de conscience de plus larges parties de la classe ouvrière se fasse seul. Les internationalistes assument leurs responsabilités de révolutionnaires, en tant que membres d'une organisation politique du prolétariat. Il ne s'est pas passé un jour de guerre sans qu'ils ne se réunissent, autour des futurs Spartakistes, pour entreprendre aussitôt la défense de l'organisation et poser les bases effectives pour la rupture avec les traîtres. On est loin du prétendu spontanéisme des Spartakistes et de Rosa Luxemburg.
Les révolutionnaires entrent aussitôt en contact avec les internationalistes des autres pays. Ainsi, Liebknecht est envoyé à l'étranger en tant que représentant le plus éminent. Il prend contact avec les Partis Socialistes de Belgique et de Hollande.
La lutte contre la guerre est impulsée sur deux plans : d'une part sur le terrain parlementaire, où les Spartakistes peuvent encore utiliser la tribune du Parlement, d'autre part - c'est le plus important - par le développement de la résistance au niveau local dans le parti et au contact direct avec la classe ouvrière.
C'est ainsi qu'en Allemagne, Liebknecht lui-même devient le porte-flambeau de la lutte.
Au sein du Parlement, il parvient à attirer de plus en plus de députés de son côté. Il est clair qu'au début, la crainte et les hésitations dominent. Mais le 22 octobre 1914, cinq députés SPD quittent la salle en signe de protestation ; le 2 décembre, Liebknecht est le seul à voter ouvertement contre les crédits de guerre; en mars 1915, lors du vote de nouveaux crédits, environ 30 députés quittent la salle et une année plus tard, le 19 août 1915, 36 députés votent contre les crédits.
Mais le véritable centre de gravité se trouve, naturellement, dans l'activité de la classe ouvrière elle-même, à la base des partis ouvriers d'une part, et dans les actions de masse de la classe ouvrière dans les usines et dans la rue, d'autre part.
Immédiatement après le déclenchement de la guerre, les révolutionnaires avaient énergiquement et clairement pris position sur la nature impérialiste de celle-ci. ([2] [1950]) En avril 1915 est imprimé le premier et unique numéro de Die Internationale à 9 000 exemplaires, dont 5 000 sont vendus dés le premier soir (D'où le nom du groupe « Die Internationale »).
A partir de l'hiver 1914-15, les premiers tracts illégaux contre la guerre sont diffusés, dont le plus célèbre d'entre eux : » L'ennemi principal se trouve dans notre propre pays ».
Le matériel de propagande contre la guerre circule dans de nombreuses assemblées locales de militants. Le fait que Liebknecht ait refusé de voter les crédits de guerre est publiquement connu et fait rapidement de lui l'adversaire de la guerre le plus célèbre, d'abord en Allemagne, puis dans les pays voisins par la suite. Toutes les prises de positions des révolutionnaires sont considérés comme « hautement dangereuses » par les services de sécurité bourgeois. Dans les assemblées locales de militants, les représentants des dirigeants traîtres du parti dénoncent les militants qui distribuent du matériel de propagande contre la guerre. Souvent ces derniers sont ensuite arrêtés ! Le SPD est divisé au plus profond de lui-même !
Hugo Eberlein rapportera plus tard, lors du congrès de fondation du KPD le 31 décembre 1918, qu'il existait une liaison avec plus de 300 villes. Pour mettre fin au danger croissant de la résistance à la guerre dans les rangs du parti, la direction décide, en janvier 1915, en commun accord avec le commandement militaire de la bourgeoisie, de faire taire définitivement Liebknecht en le mobilisant dans l'année. Il est ainsi interdit de prise de parole et ne peut plus se rendre dans les assemblées de militants. Le 18 février 1915, Rosa Luxemburg est incarcérée jusqu'en février 1916 et, à l'exception de quelques mois entre février et juillet 1916, elle restera en prison jusqu'en octobre 1918. En septembre 1915 Ernst Meyer, Hugo Eberlein et, par la suite, Franz Mehring - âgé de 70 ans - et beaucoup d'autres encore, sont également incarcérés.
Mais, même dans ces conditions particulièrement difficiles, ils vont poursuivre leur travail contre la guerre et tout entreprendre pour continuer à développer un travail organisationnel.
Entre-temps, la réalité de la guerre commence à sortir de plus en plus d'ouvriers de leur ivresse nationaliste. L'offensive allemande en France est rapidement tombée en panne et une longue guerre de positions prend place. Rien que fin 1914, 800 000 soldats sont déjà tombés. La guerre de positions en France et en Belgique coûte, au printemps 1915, des centaines de milliers de morts. Sur la Somme, 60 000 soldats trouvent la mort le même jour. Sur le front, la désillusion s'installe rapidement, mais surtout, sur le «front de l'intérieur », la classe ouvrière est précipitée dans la misère. Les femmes sont mobilisées dans la production d'armements, les produits alimentaires augmentent terriblement, puis sont rationnés. Le 18 mars 1915 se produit la première manifestation de femmes contre la guerre. Du 15 au 18 octobre on signale des affrontements sanglants entre la police et des manifestants contre la guerre, à Chemnitz. En novembre 1915 entre 10 000 et 15 000 manifestants défilent contre la guerre à Berlin. Dans d'autres pays, il se produit également des mouvements dans la classe ouvrière. En Autriche, de nombreuses « grèves sauvages », contre la volonté des syndicats, sont déclenchées. En Grande-Bretagne 250 000 mineurs, dans le sud du Pays de Galles, font grève ; en Ecosse, dans la vallée de la Clyde, ce sont les ouvriers de la construction mécanique. En France des grèves se produisent dans le secteur du textile.
La classe ouvrière commence lentement à s'arracher aux brumes nationalistes dans lesquelles elle se trouve, et manifeste de nouveau sa volonté de défendre ses intérêts de classe exploitée. L'union sacrée, un peu partout, commence à vaciller.
La réaction des révolutionnaires au niveau international
Avec le déclenchement de la première guerre mondiale et la trahison des différents partis de la 2e Internationale, une époque se termine. L'Internationale meurt car plusieurs de ses partis-membres ne représentent plus une orientation internationaliste. Ils sont passés du côté de leurs bourgeoisies nationales respectives. Une Internationale, composée de différents partis nationaux membres, ne trahit pas en tant que telle ; elle meurt et perd son rôle pour la classe ouvrière. Elle ne peut plus être redressée en tant que telle.
Mais la guerre a permis une clarification au sein du mouvement ouvrier international : d'un côté les partis qui ont trahi, de l'autre la gauche révolutionnaire qui continue de défendre de façon conséquente et inflexible les positions de classe, mais qui au début ne forme qu'une petite minorité. Entre les deux se trouve un courant centriste, oscillant entre les traîtres et les internationalistes, hésitant constamment à prendre position sans ambiguïté et refusant la rupture claire avec les social-patriotes.
En Allemagne même, l'opposition à la guerre est au départ divisée en plusieurs regroupements :
- les hésitants, dont la plupart appartiennent à la fraction parlementaire social-démocrate au Reichstag : Haase, Ledebour sont les plus connus ;
- le groupe autour de Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg, « Die Internationale », qui prend le nom de Spartakusbund à partir de 1916 ;
- les groupes autour de la Gauche de Brème (le Bremer Burgerzeitung paraît à partir de juillet 1916), avec J. Knief et K. Radek à leur tête, le groupe autour de J. Borchardt (« Lichtstrahlen »), plus ceux qui existent dans d'autres villes (à Hambourg autour de Wolfheim et Laulenberg, à Dresde autour de O. Ruhle). Fin 1915 la Gauche de Brème et le groupe de Borchardt fusionnent et prennent le nom d'Internationale Sozialisten Deutschlands (1SD).
Après une première phase de désorientation et de rupture des contacts, à partir du printemps 1915, les conférences internationales des Femmes Socialistes (du 26 au 28 mars) et des Jeunes Socialistes (du 5 au 7 avril) se tiennent à Bénie. Et après plusieurs ajournements, du 5 au 8 septembre, 37 délégués de 12 pays européens se réunissent à Zimmerwald (non loin de Berne). La délégation la plus importante numériquement est celle d'Allemagne, comprenant dix représentants, délégués par trois groupes oppositionnels : les Centristes, le groupe « Die Internationale » (E. Meyer, B. Thalheimer), les ISD (J. Borchardt). Alors que les Centristes se prononcent pour mettre fin à la guerre sans bouleversement des rapports sociaux, la Gauche fait du lien entre guerre et révolution la question centrale. La conférence de Zimmerwald, après d'âpres discussions, se sépare en adoptant un Manifeste appelant les ouvriers de tous les pays à lutter pour l'émancipation de la classe ouvrière et pour les buts du socialisme, au moyen de la lutte de classe prolétarienne la plus intransigeante. En revanche, les Centristes refusent d'y faire figurer la nécessité de la rupture organisationnelle avec le social-chauvinisme et l'appel au renversement de son propre gouvernement impérialiste. Le Manifeste de Zimmerwald va cependant connaître un énorme retentissement dans la classe ouvrière et parmi les soldats. Même s'il s'agit d'un compromis critiqué par la gauche, vu que les Centristes hésitent encore très fortement devant des prises de positions tranchées, il constitue néanmoins un pas décisif vers l'unification des forces révolutionnaires.
Dans un article déjà paru de la Revue Internationale nous avons fait la critique du groupe « Die Internationale » qui, au début, hésite encore à reconnaître la nécessité de transformer la guerre impérialiste en guerre civile.
Le rapport de forces est ébranlé
Les révolutionnaires impulsent ainsi le processus vers leur unification et leur intervention rencontre un écho de plus en plus grand.
Le 1° mai 1916 à Berlin, environ 10 000 ouvriers manifestent contre la guerre. Liebknecht prend la parole pour crier « A bas la guerre ! A bas le gouvernement ! » A ces paroles il est arrêté, ce qui va déclencher une grande vague de protestation. L'intervention courageuse de Liebknecht sert à ce moment-là de stimulant et d'orientation aux ouvriers. La détermination des révolutionnaires à lutter contre le courant social-patriote et à poursuivre la défense des principes prolétariens ne les conduit pas à un isolement plus important, mais a un effet d'encouragement sur le reste de la classe ouvrière pour entrer en lutte.
En mai 1916, les mineurs du district de Beuthen entrent en grève pour des hausses de salaires. A Leipzig, Brunswick et Coblence se produisent des manifestations ouvrières contre la faim et des rassemblements contre la vie chère. L'état de siège est décrété à Leipzig. Les actions des révolutionnaires, le fait que malgré la censure et l'interdiction de se réunir l'information au sujet de la riposte croissante contre la guerre se répande, va donner une impulsion supplémentaire à la combativité de la classe ouvrière dans son ensemble.
Le 27 mai 1916, 25 000 ouvriers manifestent à Berlin contre l'arrestation de Liebknecht. Un jour plus tard se produit la première grève de masse politique contre son emprisonnement, rassemblant 55 000 ouvriers. A Brunswick, Brème, Leipzig et dans de nombreuses autres villes, il y a aussi des rassemblements de solidarité et des manifestations de la faim. Dans une douzaine de villes il y a des rassemblements ouvriers. Nous avons ici une claire concrétisation des rapports existants entre les révolutionnaires et la classe ouvrière. Les révolutionnaires ne se trouvent pas en dehors de la classe ouvrière, ou au dessus d'elle, mais n'en sont que sa partie la plus claire, la plus déterminée et rassemblée dans des organisations politiques. Mais leur rayonnement dépend de la « réceptivité » de la classe ouvrière dans son ensemble. Même si le nombre des éléments organisés dans le mouvement spartakiste est encore réduit, des centaines de milliers d'ouvriers suivent cependant leurs mots d'ordre. Ils sont de plus en plus les porte-parole de l'état d'esprit des masses.
De ce fait, la bourgeoisie va tout faire pour isoler les révolutionnaires de la classe ouvrière en déclenchant, dans cette phase, une vague de répression. De nombreux membres de la Ligue Spartakiste sont alors placés en détention préventive. R. Luxemburg et presque toute la Centrale de Spartakus sont arrêtés au cours de la seconde moitié de 1916. De nombreux Spartakistes sont dénoncés par les fonctionnaires du SPD pour avoir distribué des tracts dans des réunions du SPD ; les cachots de la police se remplissent de militants spartakistes.
Tandis que les massacres sur le front de l'Ouest (Verdun) causent de plus en plus de victimes, la bourgeoisie exige de plus en plus des ouvriers sur « le front de l'intérieur », dans les usines. Toute guerre ne peut être faite que si la classe ouvrière est prête à faire le sacrifice de toute sa vie au profit du capital. Or, à ce moment-là, la classe dominante se heurte à une résistance de plus en plus forte.
Les protestations contre la faim ne cessent de se développer (la population n'obtient que le tiers de ses besoins en calories !). A l'automne 1916 il y a, quasiment tous les jours, des protestations ou des manifestations dans les grandes villes - en septembre à Kiel, en novembre à Dresde, en janvier 1917, un mouvement des mineurs de la Ruhr. Le rapport de forces entre le capital et le travail commence lentement à se renverser. Au sein du SPD, la direction social-patriote rencontre de plus en plus de difficultés. Même si, grâce à une collaboration étroite avec la police, elle fait embarquer et envoyer au front tout ouvrier oppositionnel, même si, dans les votes à l'intérieur du parti, elle maintient des rapports de majorité en sa faveur grâce aux manipulations, elle ne parvient plus à mater la résistance croissante face à son attitude. La minorité révolutionnaire gagne progressivement en influence dans le parti. A partir de l'automne 1916, de plus en plus de sections locales (Ortsvereine) décident la grève des cotisations versées à la direction.
L'opposition tend dès ce moment-là, en cherchant à unifier ses forces, à éliminer le comité directeur pour reprendre le parti en main.
Le comité directeur du SPD voit clairement le rapport de forces se développer à son désavantage. Suite à la réunion, le 7 janvier 1917, d'une conférence nationale de l'opposition, le comité directeur décide alors l'exclusion de tous les oppositionnels. La scission s'accomplit. La rupture organisationnelle est inévitable. Les activités internationalistes et la vie politique de la classe ouvrière ne peuvent plus se développer au sein du SPD mais, désormais, seulement à l'extérieur de celui-ci. Toute vie prolétarienne au sein du SPD s'est éteinte suite à l'expulsion des minorités révolutionnaires. Le travail au sein du SPD n'est plus possible ; les révolutionnaires doivent s'organisera l'extérieur. ([3] [1951])
L'opposition se trouve désormais face à la question : quelle organisation ériger ? Disons seulement ici qu'à partir de cette période du printemps 1917, les différents courants au sein de la Gauche en Allemagne empruntent différentes directions.
Dans un prochain article nous aborderons plus en profondeur la question de l'appréciation du travail organisationnel de ce moment-là.
La Révolution russe, début de la vague révolutionnaire
Au même moment, au niveau international, la pression de la classe ouvrière est en train de franchir un seuil décisif.
En février (mars pour le calendrier occidental), les ouvriers et les soldats, en Russie, créent à nouveau, dans leur lutte contre la guerre, comme en 1905, des conseils ouvriers et de soldats. Le Tsar est renversé. Un processus révolutionnaire, qui va très rapidement connaître un écho dans les pays voisins et dans le monde entier, s'enclenche dans ce pays. Cet événement va faire naître un espoir immense dans les rangs ouvriers.
Le développement ultérieur des luttes ne peut pleinement être compris qu'à la lumière de la révolution en Russie. Car le fait que la classe ouvrière ait renversé la classe dominante dans un pays, qu'elle commence à ébranler les fondements capitalistes, agit comme un phare qui éclaire la direction à suivre. Et c'est dans cette direction que la classe ouvrière du monde entier commence à braquer les yeux.
Les luttes de la classe ouvrière en Russie ont un puissant retentissement, surtout en Allemagne.
Dans la Ruhr il y a, du 16 au 22 février 1917, une vague de grèves. D'autres actions de masse se produisent dans de nombreuses villes allemandes. Il ne va plus se passer de semaines sans d'importantes actions de résistance, revendiquant des hausses de salaires et un meilleur ravitaillement. Dans presque toutes les grandes cités sont signalés des troubles dus aux difficultés d'approvisionnement. Lorsqu'en avril une nouvelle réduction des rations alimentaires est annoncée, la colère de la classe ouvrière déborde. A partir du 16 avril, il se produit une grande vague de grèves de masse à Berlin, Leipzig, Magdebourg, Hanovre, Brunswick, Dresde. Les chefs de l'armée, les principaux politiciens bourgeois, les dirigeants des syndicats et du SPD, notamment Ebert et Scheidemann, se concertent pour tenter de maîtriser le mouvement de grèves.
Les ouvriers sont plus de 300 000, dans plus de 30 usines, à faire grève. C'est, après les luttes contre l'arrestation de Liebknecht en juillet 1916, la seconde grande grève de masse.
« D'innombrables assemblées eurent lieu dans des salles ou en plein air, des discours furent prononcés et des résolutions adoptées. L'état de siège fut ainsi rompu en un clin d'oeil et réduit à néant dès que la masse se fut mise en mouvement et, déterminée, eût pris possession de la rue. » (Spartakusbriefe, avril 1917)
La classe ouvrière en Allemagne emboîte ainsi le pas de ses frères de classe de Russie, qui s'affrontent au capital dans un gigantesque combat révolutionnaire.
Ils luttent exactement avec les moyens décrits par Rosa Luxemburg dans sa brochure Grève de masse, écrite suite aux luttes de 1905 : assemblées massives, manifestations, rassemblements, discussions et résolutions communes dans les usines, assemblées générales, jusqu'à la formation des conseils ouvriers.
Depuis que les syndicats ont été intégrés à l'Etat à partir de 1914, ils lui servent de rempart contre les réactions ouvrières. Ils sabotent les luttes par tous les moyens. Le prolétariat se doit de se mettre lui-même en activité, s'organiser par lui-même, s'unifier par lui-même. Aucune organisation construite à l'avance ne peut lui épargner cette tâche. Et les ouvriers d'Allemagne, le pays industriel le plus développé d'alors, ont démontré leur capacité à s'organiser par eux-mêmes. Contrairement au discours que l'on nous sert sans cesse aujourd'hui, la classe ouvrière est parfaitement capable d'entrer massivement en lutte et de s'organiser pour cela. Dans cette perspective, sa lutte ne doit plus se dérouler dans le cadre syndical et réformiste, c'est à dire par branches d'activité séparées les unes des autres. La classe ouvrière montre qu'elle est désormais capable de s'unifier au delà des secteurs professionnels et des branches d'activité et d'entrer en action pour des revendications partagées par tous : le pain et la paix, la libération de ses militants révolutionnaires. De partout, en effet, résonne l'appel pour la libération de Liebknecht.
Les luttes ne peuvent plus être soigneusement préparées à l'avance, à la façon d'un état-major comme au siècle précédent. La tâche de l'organisation politique est d'assumer, dans les luttes, un rôle de direction politique et non d'organiser les ouvriers.
Lors de la vague de grèves de 1917 en Allemagne, les ouvriers, pour la première fois, s'affrontent directement aux syndicats. Alors que ceux-ci, au siècle précédent, ont été créés par la classe ouvrière elle-même, depuis le début de la guerre ils sont devenus des défenseurs du capital dans les usines et ils constituent désormais un obstacle pour la lutte prolétarienne. Les ouvriers en Allemagne font les premiers l'expérience que désormais, dans leur lutte, ils ne peuvent aller de l'avant que contre les syndicats.
Les effets du commencement de la révolution en Russie se propagent d'abord parmi les soldats. Ces événements révolutionnaires sont discutés avec le plus grand enthousiasme ; de fréquentes fraternisations ont lieu sur le front de l'est entre soldats allemands et russes. Durant l'été 1917 se produisent les premières mutineries dans la flotte allemande. La répression sanglante est sans doute, encore ici, en mesure d'étouffer les premières flammes mais il ne lui est plus possible de stopper l'extension de l'élan révolutionnaire à long terme.
Les partisans de Spartakus et les membres des Linksradikale de Brème disposent d'une large influence parmi les marins.
Dans les villes industrielles, la riposte ouvrière continue à se développer : de la région de la Ruhr à l'Allemagne centrale, de Berlin à la Baltique, partout la classe ouvrière fait front à la bourgeoisie. Le 16 avril, les ouvriers de Leipzig publient un appel aux ouvriers des autres villes pour qu'ils s'unissent à eux.
L'intervention des révolutionnaires
Les Spartakistes se trouvent aux avant-postes dans ces mouvements. Depuis le printemps 1917, en reconnaissant la signification du mouvement en Russie, ils jettent un pont en direction de la classe ouvrière russe et mettent en évidence la perspective de l'extension internationale des luttes révolutionnaires. Dans leurs brochures, dans des tracts, dans des polémiques, face à la classe ouvrière, ils interviennent sans cesse contre les centristes, oscillants et hésitants, qui esquivent les prises de position claires ; ils contribuent à la compréhension de la nouvelle situation, démasquent sans cesse la trahison des social-patriotes et montrent à la classe ouvrière comment retrouver la voie de son terrain de classe.
Les Spartakistes, notamment, mettent constamment en avant que :
- si la classe ouvrière développe un rapport de forces suffisant, elle sera en mesure de mettre un tenue à la guerre et de provoquer le renversement de la classe capitaliste ;
- dans cette perspective, il est nécessaire de reprendre le flambeau révolutionnaire allumé par la classe ouvrière en Russie. A ce niveau, le prolétariat en Allemagne occupe une place centrale et décisive !
« En Russie les ouvriers et les paysans (...) ont renversé le vieux gouvernement tsariste et ont pris en main la conduite de leur destin. Les grèves et les arrêts de travail d'une telle ténacité et unité nous garantissent actuellement non seulement de petits succès mais la fin du génocide, le renversement du gouvernement allemand et de la domination des exploiteurs ...La classe ouvrière ne fut jamais aussi puissante au cours de la guerre que maintenant quand elle se manifeste unie et solidaire dans son action et son combat ; la classe dominante, jamais aussi mortelle ... Seule la révolution allemande peut apporter à tous les peuples la paix ardemment désirée et la liberté. La révolution russe victorieuse unie à la révolution allemande victorieuse sont invincibles. A partir du jour où s'effondrera le gouvernement allemand -y compris le militarisme allemand - sous les coups révolutionnaires du prolétariat, s'ouvrira une ère nouvelle : une ère dans laquelle les guerres, l'exploitation et l'oppression capitalistes devront disparaître à tout jamais. » (Tract spartakiste, avril 1917)
« Il s'agit de briser la domination de la réaction et des classes impérialistes en Allemagne, si nous voulons mettre fin au génocide ... Ce n'est que par la lutte des masses, par le soulèvement des masses, par les grèves de masse qui arrêtent toute l'activité économique et l'ensemble de l'industrie de guerre, ce n'est que par la révolution et la conquête de la république populaire en Allemagne qu'il sera mis un ternie au génocide et que la paix générale sera instaurée. Et ce n'est qu'ainsi que la révolution russe pourra aussi être sauvée. »
« La catastrophe internationale ne peut que dompter le prolétariat international. Seule la révolution prolétarienne mondiale peut liquider la guerre impérialiste mondiale. » {Lettre de Spartacus n°6, août 1917)
La Gauche radicale est consciente de sa responsabilité et comprend pleinement tout ce qui est en jeu si la révolution en Russie reste isolée : « ... Le destin de la révolution russe : elle atteindra son objectif exclusivement comme prologue de la révolution européenne du prolétariat. Si en revanche les ouvriers européens, allemands, continuent à rester spectateurs de ce drame captivant et jouent les badauds, alors le pouvoir russe des soviets ne devra pas s'attendre à autre chose qu'au destin de la Commune de Paris (C'est à dire la défaite sanglante). » (Spartakus, janvier 1918)
C'est pourquoi le prolétariat en Allemagne, qui se trouve à une position-clé pour l'extension de la révolution, doit prendre conscience de son rôle historique.
« Le prolétariat allemand est le plus fidèle, le plus sûr allié de la révolution russe et de la révolution internationale prolétarienne. » (Lénine)
En examinant l'intervention des Spartakistes dans son contenu, nous pouvons constater qu'elle est clairement internationaliste et qu'elle donne une juste orientation au combat des ouvriers : le renversement du gouvernement bourgeois avec le renversement mondial de la société capitaliste comme perspective, la mise à nu de la tactique de sabotage des forces au service de la bourgeoisie.
L'extension de la révolution aux pays centraux du capitalisme : une nécessité vitale
Si le mouvement révolutionnaire en Russie, à partir de février 1917, est dirigé principalement contre la guerre, il n'a pas la force, par lui-même, d'y mettre fin. Pour cela, il est indispensable que la classe ouvrière des grands bastions industriels du capitalisme entre en scène. Et c'est avec la conscience profonde de cette nécessité que, dès la prise de pouvoir des soviets en Octobre 1917, le prolétariat de Russie lance un appel à tous les ouvriers des pays belligérants:
« Le gouvernement des ouvriers et des paysans créé par la révolution des 24/25 octobre et s'appuyant sur les soviets ouvriers, de soldats et de paysans propose à tous les peuples belligérants et à leurs gouvernements d'entamer des négociations sur une paix équitable et démocratique. » (26 novembre 1917)
La bourgeoisie mondiale, de son côté, est consciente du danger que recèle une telle situation pour sa domination. Voilà pourquoi il s'agit pour elle, à ce moment-là, de tout faire pour étouffer la flamme qui s'est allumée en Russie. Voilà pourquoi la bourgeoisie allemande, avec la bénédiction générale, poursuivra son offensive guerrière contre la Russie après avoir signé un accord de paix avec le gouvernement des soviets à Brest-Litovsk en janvier 1918. Dans leur tract intitulé « L'heure de la décision », les Spartakistes lancent, dans ce sens, un avertissement aux ouvriers :
« Pour le prolétariat allemand sonne désormais l'heure de la décision ! Soyez sur vos gardes ! Car avec ces négociations le gouvernement allemand vise justement à jeter de la poudre aux yeux au peuple, à prolonger et aggraver la misère et la détresse du génocide. Le gouvernement et les impérialistes allemands ne font que poursuivre par de nouveaux moyens leurs anciens buts. Sous couvert du droit à l'autodétermination des nations doivent être créés dans les provinces russes occupées des états fantoches - condamnés à une pseudo-existence, dépendants économiquement et politiquement des "libérateurs" allemands - qui bien entendu les avaleront ensuite à la première occasion favorable. »
Cependant, une année supplémentaire s'écoulera avant que la classe ouvrière des centres industriels soit suffisamment forte pour repousser le bras assassin de l'impérialisme.
Mais, dès 1917, le retentissement de la révolution victorieuse en Russie d'une part, comme l'intensification de la guerre par les impérialistes d'autre part, poussent de plus en plus les ouvriers à vouloir mettre un tenue à la guerre.
La flamme de la révolution se propage, en effet, dans les autres pays.
- En Finlande, en janvier 1918, un comité exécutif ouvrier est créé, préparant la prise du pouvoir. Ces luttes vont être ensuite défaites militairement en mars 1918. L'année allemande mobilisera à elle seule plus de 15 000 soldats. Le bilan des ouvriers massacrés s'élèvera à plus de 25 000 morts.
- Le 15 janvier 1918 débute à Vienne une grève de masse politique qui s'étend quasiment à l'ensemble de l'empire des Habsbourg. A Brünn, Budapest, Graz, Prague, Vienne, et dans d'autres villes, se produisent de gigantesques manifestations pour la paix.
Un conseil ouvrier est formé, unissant les actions de la classe ouvrière. Le 1er février 1918 les marins de la flotte austro-hongroise se soulèvent, dans le port de guerre de Cattaro, contre la poursuite de la guerre et fraternisent avec les ouvriers en grève de l'arsenal.
- A la même période, des grèves ont lieu en Angleterre, en France et en Hollande. (Voir à ce sujet l'article de la Revue Internationale n° 80)
Les luttes de janvier : le SPD, fer de lance de la bourgeoisie contre la classe ouvrière
Après la poursuite de l'offensive allemande contre le jeune pouvoir révolutionnaire ouvrier en Russie, la colère dans les rangs de la classe ouvrière déborde. Le 28 janvier 400 000 ouvriers de Berlin entrent en grève, notamment dans les usines d'armement. Le 29 janvier le nombre des grévistes s'élève même à 500 000. Le mouvement se propage dans d'autres villes : à Munich, une assemblée générale de grévistes lance l'appel suivant : « Les ouvriers de Munich en grève adressent leurs saints fraternels aux ouvriers belges, français, anglais, italiens, russes et américains. Nous nous semons un avec eux dans la détermination à mettre de suite un terme à la guerre mondiale ... Nous voulons solidairement imposer la paix mondiale ... Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! » (Cité par R. Millier, p. 148.)
Dans ce mouvement de masse, le plus important de la guerre, les prolétaires forment un conseil ouvrier à Berlin. Un tract des Spartakistes y appelle de la façon suivante :
« Nous devons créer une représentation librement élue sur le modèle russe et autrichien et ayant pour tâche de diriger cette lutte-ci et les prochaines. Chaque usine élit un homme de confiance pour 1000 ouvriers. » Au total plus de 1800 délégués se réunissent.
Par ailleurs, ce même tract déclare : « Les dirigeants des syndicats, les socialistes de gouvernement et autres piliers de l'effort de guerre ne doivent sous aucun prétexte être élus dans les délégations ... Ces hommes de paille et ces agents volontaires du gouvernement, ces ennemis mortels de la grève de masse n'ont rien à faire parmi les ouvriers en lutte ! (...) Lors de la grève de masse d'avril 1917 ils ont cassé les reins du mouvement de grève de la façon la plus perfide en exploitant les confusions de la masse et en orientant le mouvement dans de fausses voies. (...) Ces loups déguisés en agneaux menacent le mouvement d'un danger bien plus grave que la police impériale-prussienne. »
Au coeur des revendications on trouve : la paix, l'adjonction de représentants ouvriers de tous les pays aux négociations de paix... L'assemblée des conseils ouvriers, de son côté, déclare : « Nous adressons aux prolétaires d'Allemagne, ainsi qu'à ceux des autres pays belligérants dans leur ensemble, l'appel pressant, comme nos camarades d'Autriche-Hongrie nous v ont déjà précédé avec succès, à désormais entrer pareillement dans des grèves de masse, car seule la lutte de classe internationale solidaire nous apportera définitivement la paix, la liberté et le pain. »
Un autre tract des Spartakistes souligne : « Nous devons parler russe à la réaction. » Il appelle à des manifestations de rue en solidarité.
La lutte ayant entraîné un million d'ouvriers, la classe dominante va choisir une tactique qu'elle réutilisera sans cesse par la suite contre la classe ouvrière. C'est le SPD qui est le fer de lance de la bourgeoisie pour torpiller le mouvement de l'intérieur. Ce parti traître, tirant profit de son influence encore importante en milieu ouvrier, parvient à envoyer dans le Comité d'action, à la direction de la grève, trois de ses représentants qui mettent toute leur énergie en oeuvre pour briser le mouvement. Ils jouent le rôle de saboteurs de l'intérieur. Ebert reconnaît carrément : « Je suis entré dans la direction de la grève avec l'intention délibérée d'y mettre fin rapidement et de préserver le pays de tout dommage. (...) C'était finalement le devoir des travailleurs que de soutenir leurs frères et leurs pères du front et de leur fournir de meilleures armes. Les travailleurs de France et d'Angleterre ne perdent pas une heure de travail pour aider leurs frères du front. La victoire est évidemment le voeu de tous les Allemands. » (Ebert, 30 janvier 1918) Les ouvriers paieront très cher leurs illusions vis à vis de la social-démocratie et de ses dirigeants.
Après avoir mobilisé les ouvriers dans la guerre depuis 1914, le SPD s'oppose maintenant, de toutes ses forces, aux grèves. Cela montre la clairvoyance et l'instinct de survie de la classe dominante, sa conscience du danger que constitue pour elle la classe ouvrière. Les Spartakistes, de leur côté, dénoncent haut et fort le danger mortel représenté par la social-démocratie contre laquelle ils mettent en garde le prolétariat. Aux méthodes perfides de la social-démocratie, la classe dominante ajoute des interventions directes et brutales, à l'aide de l'année, contre les grévistes. Une douzaine d'ouvriers sont abattus et plusieurs dizaines de milliers incorporés de force... quoique ceux-ci, faisant de l'agitation au sein de l'année dans les mois qui vont suivre, contribueront à sa déstabilisation.
Les grèves sont finalement brisées le 3 février.
Nous pouvons constater que la classe ouvrière en Allemagne applique exactement les mêmes moyens de lutte qu'en Russie : grève de masse, conseils ouvriers, délégués élus et révocables, manifestations de rue massives, qui constituent depuis les armes « classiques » de la classe ouvrière.
Les Spartakistes développent une orientation juste pour le mouvement mais ne disposent pas encore d'une influence déterminante. « Une foule des nôtres s'étaient trouvés parmi les délégués, mais ils étaient dispersés, n'avaient pas de plan d'action et se perdaient dans la masse. » (Barthel, p. 591)
Cette faiblesse des révolutionnaires et le travail de sabotage de la social-démocratie sont les facteurs décisifs dans le coup d'arrêt que subit le mouvement de la classe à ce moment-là.
« Si nous n'étions pas entrés dans le comité de grève, je suis convaincu que la guerre et tout le reste auraient été liquidés dès janvier. Il y avait le danger d'un effondrement total et de l'irruption d'une situation à la russe. Par notre action il fut bientôt mis fin à la grève et tout fut remis en ordre. » (Scheidemann.)
Le mouvement en Allemagne se heurte à un ennemi bien plus fort qu'en Russie. La classe capitaliste dans ce pays a, en effet, déjà tiré les leçons pour agir, par tous les moyens, contre la classe ouvrière.
Déjà, à cette occasion, le SPD fait la preuve de sa capacité à poser des chausse-trapes et à briser le mouvement en se plaçant à sa tête. Dans les luttes ultérieures cela va se révéler encore plus destructeur.
La défaite de janvier 1918 offre aux forces du capital la possibilité de continuer sa guerre encore quelques mois.
Au cours de l'année 1918, l'armée va engager d'autres offensives. Celles-ci coûtent, pour la seule Allemagne et uniquement pour 1918, 550 000 morts et pratiquement un million de blessés.
Suite aux événements de janvier 1918, la combativité n'est malgré tout pas brisée. C'est précisément sous la pression de la situation militaire qui va s'aggravant, qu'un nombre croissant de soldats désertent et que le front commence à se désagréger. A partir de l'été, non seulement la disposition à lutter, dans les usines, recommence à se développer mais, de plus, les chefs de l'armée sont obligés de reconnaître ouvertement qu'ils n'arrivent plus à tenir les soldats sur le front. Pour la bourgeoisie, de ce fait, le cessez-le-feu devient une nécessité pressante.
La classe dominante montre ainsi qu'elle a tiré des leçons de ce qui s'est passé en Russie.
Alors qu'en avril 1917, la bourgeoisie allemande fait traverser l'Allemagne à Lénine en wagon plombé, dans l'espoir que l'action des révolutionnaires russes permette un développement du chaos en Russie et, ainsi, facilite la réalisation des buts impérialistes allemands (l'année allemande ne s'attend pas, à ce moment-là, à ce qu'il se produise ensuite une révolution prolétarienne en octobre 1917), il lui faut maintenant éviter, à tout prix, un développement révolutionnaire identique à celui de la Russie.
Le SPD entre alors dans le gouvernement bourgeois, nouvellement formé, pour servir de frein.
« Si nous refusons notre collaboration dans ces circonstances, il faudrait alors compter avec le danger très sérieux (...) que le mouvement nous passe sur le corps et qu' ensuite un régime bolchevik prenne momentanément place chez nous aussi. » (G. Noske, 23 septembre 1918)
En cette fin de 1918, les usines sont à nouveau en ébullition, des grèves éclatent sans cesse en différents lieux. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que le mouvement de grèves de masse n'atteigne l'ensemble du pays. La combativité montante fournit le sol nourricier à l'action des soldats eux-mêmes. Lorsque l'armée commande une nouvelle offensive de la Hotte en octobre, des mutineries éclatent. Les marins de Kiel et d'autres ports de la Baltique refusent de partir en mer. Le 3 novembre s'élève une vague de protestations et de grèves contre la guerre. Partout, des conseils ouvriers et de soldats sont créés. En l'espace d'une semaine, l'ensemble de l'Allemagne est « submergée » par une vague de conseils ouvriers et de soldats.
Si en Russie, après février 1917, ce fut la poursuite de la guerre par le gouvernement Kerenski qui donna une impulsion décisive au combat du prolétariat, au point que celui-ci s'est emparé du pouvoir en octobre pour mettre fin définitivement à la boucherie impérialiste, en Allemagne, la classe dominante, mieux armée que la bourgeoisie russe, va tout faire pour défendre son pouvoir.
Ainsi, le 11 novembre, soit une semaine après le développement des luttes ouvrières et leur extension fulgurante, après l'apparition des conseils ouvriers, elle signe l'armistice. Tirant les leçons de la Russie, elle ne commet pas l'erreur de provoquer une radicalisation fatale de la vague ouvrière en continuant la guerre coûte que coûte. En y mettant fin, elle tente de couper l'herbe sous les pieds du mouvement, afin que l'extension de la révolution ne se produise pas. De plus, elle fait entrer en campagne sa principale pièce d'artillerie : le SPD, et les syndicats à ses côtés.
« Le socialisme de gouvernement, par son entrée au ministère, se pose en défenseur du capitalisme et barre le chemin à la révolution prolétarienne montante. La révolution prolétarienne marchera sur son cadavre. » (Spartakusbrief n°12, octobre 1918)
A la fin du mois de décembre, Rosa Luxemburg précise : « Dans toutes les révolutions antérieures, les combattants s'affrontaient de façon ouverte, classe contre classe, épée contre bouclier... Dans la révolution d'aujourd'hui les troupes qui défendent l'ordre ancien se rangent non sous leur propre drapeau et dans l'uniforme de la classe dominante... mais sous le drapeau de la révolution. C'est un parti socialiste qui est devenu l'instrument le plus important de la contre-révolution bourgeoise. »
Nous aborderons, dans un prochain article, le rôle contre-révolutionnaire du SPD face au développement ultérieur des luttes.
La fin de la guerre permise par l'action des révolutionnaires
La classe ouvrière en Allemagne n'aurait jamais pu développer cette capacité de mettre fin à la boucherie impérialiste sans la participation constante et l'intervention des révolutionnaires dans ses rangs. Le passage de la situation d'ivresse nationaliste, dans laquelle pataugeait la classe ouvrière en 1914, au soulèvement de novembre 1918, qui met fin à la guerre, n'a été possible que grâce à l'activité inlassable des révolutionnaires. Ce n'est pas le pacifisme qui a permis la fin des massacres mais le soulèvement révolutionnaire du prolétariat.
Si les internationalistes n'avaient pas courageusement, dès le début, mis en évidence la trahison des social-patriotes, s'ils n'avaient pas fait entendre leur voix fortement et clairement dans les assemblées, dans les usines, dans la rue, s'ils n'avaient pas démasqué avec détermination les saboteurs de la lutte de classe, la riposte ouvrière n'aurait pu se développer, et encore moins aboutir.
En jetant un regard lucide sur cette période de l'histoire du mouvement ouvrier, et en tirant un bilan du point de vue du travail des révolutionnaires, nous pouvons dégager des leçons cruciales pour aujourd'hui.
La poignée de révolutionnaires, qui a continué de défendre les principes internationalistes en août 1914, ne s'est pas laissée intimider ou démoraliser par son nombre réduit et l'ampleur de la tâche qu'elle avait à assumer. Elle conservait la confiance en sa classe et a continué à intervenir résolument, malgré d'immenses difficultés, pour tenter de renverser le rapport de forces, pourtant particulièrement défavorable. Dans les sections du parti, à la base, les révolutionnaires ont regroupé le plus rapidement possible leurs forces sans jamais renoncer à leurs responsabilités.
En défendant face aux ouvriers des orientations politiques capitales, sur la base d'une analyse juste de l'impérialisme et des rapports de forces entre les classes, ils ont indiqué, avec la plus grande clarté, la véritable perspective et ils ont servi de boussole politique à leur classe.
Leur défense de l'organisation politique du prolétariat a été, elle aussi, conséquente. Autant quand il s'agissait de ne pas abandonner, sans combattre, le SPD aux mains des traîtres que lorsqu'il a fallu construire une nouvelle organisation. Nous aborderons, dans notre prochain numéro, les éléments essentiels de ce combat.
Les révolutionnaires sont, dès le début de la guerre, intervenus pour défendre l'internationalisme prolétarien et l'unification internationale des révolutionnaires (Zimmerwald et Kienthal), ainsi que celle de la classe ouvrière dans son ensemble.
En reconnaissant que la fin de la guerre ne pouvait être obtenue par des moyens pacifistes, mais uniquement par la guerre de classe, la guerre civile, qu'il était donc nécessaire de renverser la domination capitaliste pour émanciper le monde de la barbarie, ils sont intervenus concrètement pour le dépassement de la société capitaliste.
Ce travail politique n'aurait pas été possible sans la clarification théorique et programmatique effectuée avant la guerre. Leur combat, à la tête duquel se trouvaient Rosa Luxemburg et Lénine, était en continuité avec les positions de la Gauche au sein de la 2e Internationale.
Nous pouvons constater que, même si le nombre des révolutionnaires et leur influence étaient réduits au début de la guerre (l'appartement de Rosa Luxemburg disposait d'une place suffisante pour accueillir les principaux militants de la gauche le 4 août 1914 ; les délégués de Zimmerwald tenaient tous dans trois taxis), leur travail allait s'avérer déterminant. Même si, au départ, leur presse ne circulait qu'en très faible nombre, les prises de position et les orientations qu'elle contenait étaient cruciales pour le développement ultérieur de la conscience et du combat de la classe ouvrière.
Tout cela doit nous servir d'exemple et nous ouvrir les yeux sur l'importance du travail des révolutionnaires. En 1914, la classe a eu besoin de quatre années pour se remettre de sa défaite et pour s'opposer massivement à la guerre. Aujourd'hui, les ouvriers des centres industriels ne s'entre-déchirent pas dans une boucherie impérialiste mais doivent se défendre contre les conditions de vie de plus en plus misérables que leur fait subir le capitalisme en crise.
Mais, de la même manière qu'au début du siècle elle n'aurait jamais été capable de mettre fin à la guerre si les révolutionnaires, en son sein, n'avaient pas combattu clairement et de façon décidée, la classe ouvrière, pour mener son combat d'aujourd'hui et assumer ses responsabilités de classe révolutionnaire, a un besoin vital de ses organisations politiques et de leur intervention. C'est ce que nous concrétiserons dans d'autres articles.
DV.
[1] [1952] « Mais non. c'est un mensonge ! C'est une falsification de ces messieurs les impérialistes ! le vrai Vorwàrts est vraisemblablement sous séquestre ' » (Zinoviev au sujet de Lénine)
[2] [1953] A. Pannekoek : Le Socialisme et la grande guerre européenne : F. Mehring : Sur la nature de la guerre ; Lénine : L'Effondrement de la II° Internationale. Le Socialisme et la guerre. Les Tâches de la social-démocratie révolutionnaires dans la guerre européenne ; C. Zelkin et K. Duncker : Thèses sur la guerre ; R. Luxemburg : La Crise de la social-démocratie {Brochure de Junius) ; K. Liebknecht : L'Ennemi principal se trouve dans notre propre pays.
[3] [1954] De 1914 à 1917. le nombre des membres du SPD est passé de un million à environ 200 000.
Géographique:
- Allemagne [98]
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Allemande [1955]
Conscience et organisation:
Approfondir:
- Révolution Allemande [1957]
Heritage de la Gauche Communiste:
- La Révolution prolétarienne [1149]
Chine 1928-1949 : maillon de la guerre imperialiste (I)
- 5138 reads
Selon l'histoire officielle, une « révolution populaire » aurait triomphé en Chine en 1949. Cette idée, répandue autant par la démocratie occidentale que par le maoïsme, fait partie de la monstrueuse mystification, mise en place avec la contre-révolution stalinienne, sur la soi-disant création des « Etats socialistes ». Il est vrai que la Chine connut durant la période de 1919 à 1927 un imposant mouvement de la classe ouvrière, partie intégrante de la vague révolutionnaire internationale qui secouait le monde capitaliste à cette époque; ce mouvement, cependant, se solda par un massacre de la classe ouvrière. Par contre, ce que les idéologues de la bourgeoisie présentent comme le « triomphe de la révolution chinoise » n'est que l'instauration d'un régime de capitalisme d'Etat dans sa variante maoïste, la culmination de la période de conflits impérialistes en territoire chinois, période ouverte à partir de 1928, après la défaite de la révolution prolétarienne.
Dans la première partie de cet article, nous exposerons les conditions dans lesquelles a surgi la révolution prolétarienne en Chine, en en tirant quelques unes des principales leçons. Nous consacrerons prochainement une deuxième partie à la période des conflits impérialistes, durant laquelle apparut le maoïsme, et à la dénonciation des aspects fondamentaux de cette forme de l'idéologie bourgeoise.
La 3e Internationale et la révolution en Chine
L'évolution de l'Internationale communiste (IC) et son action en Chine jouèrent un rôle crucial dans le cours de la révolution dans ce pays. L'IC représente le plus grand effort, réalisé à ce jour par la classe ouvrière, pour se doter d'un parti mondial capable de guider sa lutte révolutionnaire. Cependant, sa formation tardive au cours même de la vague révolutionnaire mondiale, sans avoir eu au préalable le temps suffisant pour se consolider organiquement et politiquement, la conduisit, malgré la résistance de ses fractions de gauche ([1] [1958]), vers une dérive opportuniste. En effet, devant le recul de la révolution et l'isolement de la Russie soviétique, le Parti bolchevique - le plus influent au sein de l'Internationale - commença à hésiter entre la nécessité d'asseoir les bases pour une nouvelle montée de la révolution dans le futur, même au prix du sacrifice du triomphe en Russie, ou bien celle de défendre l'Etat russe surgi de la révolution, au prix d'accords et d'alliances conclues avec les bourgeoisies nationales. Ces accords et alliances représentèrent une énorme source de confusion pour le prolétariat international et contribuèrent à accélérer sa défaite dans de nombreux pays. La dérive opportuniste de l'IC, l'abandon des intérêts historiques de la classe ouvrière au profit d'une politique de collaboration entre les classes, la conduisit à une dégénérescence progressive qui culmina en 1928, avec l'abandon de l'internationalisme prolétarien au nom de la prétendue « défense du socialisme dans un seul pays » ([2] [1959]).
La perte de confiance dans la classe ouvrière conduisit progressivement l'IC, devenue de plus en plus un instrument du gouvernement russe, à vouloir créer une barrière de protection contre la pénétration des grandes puissances impérialistes, au moyen de l'appui aux bourgeoisies des « pays opprimés » d'Europe orientale, du Moyen et d'Extrême-Orient. Cette politique s'avéra désastreuse pour la classe ouvrière internationale. En effet, pendant que l'IC et le gouvernement russe soutenaient politiquement et matériellement les bourgeoisies nationalistes supposées « révolutionnaires » de Turquie, de Perse, de Palestine, d'Afghanistan... et finalement de Chine, ces mêmes bourgeoisies, qui acceptaient en toute hypocrisie l'aide soviétique sans rompre leurs liens avec les puissances impérialistes ni avec la noblesse foncière qu'elles étaient censées combattre, écrasaient les luttes ouvrières et anéantissaient les organisations communistes avec les armes mêmes que leur fournissait la Russie. Idéologiquement, cet abandon des positions prolétariennes trouvait sa justification dans les « Thèses sur la question nationale et coloniale » du 2e Congrès de la 3e internationale (dans la rédaction desquelles Lénine et Roy avaient eu un rôle prépondérant). Ces Thèses contiennent assurément une ambiguïté théorique de principe, en opérant une distinction erronée entre bourgeoisies « impérialistes » et « anti-impérialistes », ce qui allait ouvrir la voie aux plus grandes erreurs politiques. En effet, à cette époque, la bourgeoisie avait cessé d'être révolutionnaire et avait pris partout un caractère impérialiste, y compris dans les « pays opprimés » : non seulement de par les nombreux liens qu'elle avait avec l'une ou l'autre des grandes puissances impérialistes, mais aussi parce qu'à partir de la prise de pouvoir par la classe ouvrière en Russie, la bourgeoisie internationale avait formé un front commun contre tout mouvement révolutionnaire de masse. Le capitalisme était entré dans sa phase de décadence, et l'ouverture de l'ère de la révolution prolétarienne avait définitivement clos l'ère des révolutions bourgeoises.
Les Thèses, malgré cette erreur, étaient cependant capables de prévenir certains glissements opportunistes, qui malheureusement iraient en se généralisant peu de temps après. Le rapport présenté par Lénine reconnaissait que, dans cette nouvelle période, « un certain rapprochement se produit entre la bourgeoisie des pays exploiteurs et celle des pays coloniaux, de telle façon que, très fréquemment, la bourgeoisie des pays opprimés, tout en appuyant les mouvements nationaux, est en même temps d'accord avec la bourgeoisie impérialiste, c'est-à-dire qu'elle lutte avec celle-ci contre les mouvements révolutionnaires » ([3] [1960]). C'est pourquoi les Thèses appelaient à s'appuyer essentiellement sur les paysans et insistaient avant tout sur la nécessité pour les organisations communistes de maintenir leur indépendance organique et de principe face à la bourgeoisie : « L'Internationale communiste ne doit soutenir les mouvements révolutionnaires dans les colonies et les pays arriérés, qu'à la condition que les éléments des plus purs partis communistes - et communistes en fait - soient groupés et instruits de leurs tâches particulières, c'est-à-dire de leur mission de combattre le mouvement bourgeois et démocratique... consentant toujours le caractère indépendant de mouvement prolétarien même dans sa forme embryonnaire » ([4] [1961]). Mais le soutien inconditionnel, ignominieux, de l'Internationale au Kuomintang en Chine allait manifester l'oubli de tout cela : tant du fait que la bourgeoisie nationale n'était plus révolutionnaire et se trouvait étroitement liée aux puissances impérialistes, que de la nécessité de forger un Parti communiste capable de lutter contre la démocratie bourgeoise, en même temps que de l'indispensable indépendance du mouvement de la classe ouvrière.
La « Révolution » de 1911 et le Kuomintang
Le développement de la bourgeoisie chinoise et son mouvement politique durant les premières décennies du 20e siècle, loin de montrer ses aspects prétendument « révolutionnaires », nous donne plutôt une illustration de l'extinction du caractère révolutionnaire de la bourgeoisie et de la transformation de l'idéal national et démocratique en pure mystification, au moment où le capitalisme entre dans sa phase de décadence. L'inventaire des faits nous montre, non pas une classe révolutionnaire, mais une classe conservatrice, conciliante, dont le mouvement politique ne cherchait ni à expulser complètement la noblesse ni à rejeter les « impérialistes », mais plutôt à se faire une place à leur côté.
Les historiens ont coutume de souligner les différences d'intérêts, censées exister, entre les différentes fractions de la bourgeoisie chinoise. Ainsi, il est courant d'identifier la fraction spéculatrice commerçante comme une alliée de la noblesse et des « impérialistes », tandis que la bourgeoisie industrielle et l'intelligentsia composeraient la fraction « nationaliste », « moderne », « révolutionnaire ». En réalité, ces différences n'étaient pas aussi marquées. Non seulement parce que ces fractions étaient intimement liées, pour raisons de négoce ou par liens familiaux, mais surtout parce que les attitudes, autant de la fraction commerçante que de la fraction industrielle et de l'intelligentsia, n'étaient pas très différentes : toutes deux cherchaient en permanence l'appui des « seigneurs de la guerre » liés à la noblesse foncière ainsi que celui des gouvernements des grandes puissances.
Vers 1911, la dynastie mandchoue était déjà complètement pourrie et sur le point de tomber. Ce n'était pas le produit d'une quelconque action révolutionnaire de la bourgeoisie nationale, mais la conséquence du partage de la Chine entre les mains des grandes puissances impérialistes qui avait mené au dépeçage du vieil Empire. La Chine tendait de plus en plus à resté divisée en régions contrôlées par des militaristes possédant des armées mercenaires plus ou moins puissantes, toujours prêts à se vendre au plus offrant et derrière lesquels se trouvait l'une ou l'autre grande puissance. La bourgeoisie chinoise, de son côté, se sentait appelée à prendre la place de la dynastie, en tant qu'élément unificateur du pays, bien que ce ne fut pas dans le sens de briser le régime de production, dans lequel se mêlaient les intérêts des propriétaires fonciers et des impérialistes avec les siens propres, mais plutôt dans le but de le maintenir. C'est dans ce cadre que se déroulèrent les événements qui vont de ce qu'on a appelé la « Révolution de 1911 » jusqu'au « Mouvement du 4 mai 1919».
La «Révolution de 1911 » commença par une conspiration des militaristes conservateurs soutenus par l'organisation bourgeoise nationaliste de Sun Yat-sen, la Toung Meng-houi. Les militaristes renièrent l'Empereur et proclamèrent un nouveau régime à Wou-Tchang. Sun Yat-sen, qui se trouvait aux Etats-Unis en quête d'un soutien financier pour son organisation, fut appelé à occuper la présidence d'un nouveau gouvernement, des négociations entre les deux gouvernements commencèrent et, au bout de quelques semaines, on décida le retrait de l'Empereur ainsi que celui de Sun Yat-sen, en échange d'un gouvernement unifié avec à sa tête Yuan Che-kai qui était le chef des troupes impériales, le véritable homme fort de la dynastie, tout ceci signifie que la bourgeoisie laissait de côté ses prétentions « révolutionnaires » et « anti-impérialistes » en échange du maintien de l'unité du pays.
Fin 1912 se forme le Kuomintang, la nouvelle organisation de Sun Yat-sen représentant cette bourgeoisie. En 1913, le Kuomintang participe à des élections présidentielles, restreintes aux classes sociales possédantes, desquelles il sort vainqueur. Cependant, le tout nouveau président, Sun Chao-yen est assassiné. Sun Yat-sen essaya alors de former un nouveau gouvernement en s'alliant avec quelques militaristes sécessionnistes du centre-sud du pays, mais il fut défait par les forces de Pékin.
Comme on peut le voir, les velléités nationalistes de la bourgeoisie chinoise étaient soumises au jeu des seigneurs de la guerre et, par conséquent, à celui des grandes puissances. L'éclatement de la Première Guerre mondiale assujettit encore davantage le mouvement poli tique de la bourgeoisie chinoise au jeu des intérêts impérialistes. En 1915, plusieurs provinces devinrent « indépendantes », les seigneurs de la guerre se partagèrent le pays, soutenus par l'une ou l'autre des grandes puissances. Dans le Nord, le gouvernement de Anfou - soutenu par le Japon - disputait la première place à celui de Chili - soutenu par la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. De son côté, la Russie tsariste essayait de faire de la Mongolie un protectorat. On se disputait aussi le Sud. Sun Yat-sen réalisa de nouvelles alliances avec certains seigneurs de la guerre. Le décès de l'homme fort de Pékin aiguisa encore davantage la lutte entre les militaristes.
C'est dans ce contexte, à la fin de la guerre en Europe, que vit le jour en Chine le « Mouvement du 4 mai 1919 », tant vanté par les idéologues comme un « véritable mouvement anti-impérialiste ». En réalité, ce mouvement de la petite-bourgeoisie n'était pas dirigé contre l'impérialisme en général, mais plutôt contre le Japon en particulier : en effet, celui-ci avait réussi à obtenir la province chinoise de Chan-Tong lors de la Conférence de Versailles (la conférence au cours de laquelle les pays démocratiques vainqueurs se partagèrent le monde), ce à quoi les étudiants chinois s'opposaient. Cependant il faut noter que l'objectif de ne pas céder de territoires chinois au Japon répondait également aux intérêts d'une autre puissance rivale : les Etats-Unis, qui parvinrent finalement à « libérer » la province de Chan-Tong de la domination exclusivement japonaise en 1922. C'est-à-dire qu'indépendamment de l'idéologie radicale du mouvement du 4 mai, celui-ci resta également dans le cadre des conflits impérialistes. Et il ne pouvait en être autrement.
Par contre, il faut souligner que pendant le mouvement du 4 mai, dans un sens différent, la classe ouvrière fit sa première apparition dans les manifestations, arborant non seulement les mots d'ordre nationalistes du mouvement, mais aussi ses propres revendications de classe.
La fin de la guerre en Europe ne mettra un terme ni aux guerres entre les militaristes ni aux luttes entre grandes puissances pour le partage de la Chine. Cependant, peu à peu vont prendre forme deux gouvernements plus ou moins instables : l'un dans le nord, dont le siège était à Pékin, sous les ordres du militariste Wou Pei-fou ; l'autre au sud, ayant pour siège Canton et ayant à sa tête Sun Yat-sen et le Kuomintang. L'histoire officielle présente le gouvernement du nord comme l'expression des forces « réactionnaires », de la noblesse et des impérialistes, et le gouvernement du sud comme l'expression des forces nationalistes et « révolutionnaires », à savoir la bourgeoisie, la petite-bourgeoisie et les travailleurs. Il s'agit d'une scandaleuse mystification.
En réalité Sun Yat-sen et le Kuomintang ont toujours été soutenus par les seigneurs de la guerre du sud : en 1920 Tchen Choung-ming, qui avait occupé Canton, invita Sun Yat-sen à former un autre gouvernement. En 1922, Sun Yat-sen suivant la tendance des militaristes du sud tenta pour la première fois d'avancer vers le nord ; il fut défait et expulsé du gouvernement mais, en 1923, il retourna à Canton avec l'appui des militaristes. D'un autre côté, on parle beaucoup de l'alliance du Kuomintang avec l'URSS. En réalité, l'URSS entretenait des relations et des alliances avec tous les gouvernements proclamés de Chine, y compris ceux du nord. Ce fut le penchant définitif du nord pour le Japon qui obligea l'URSS à privilégier sa relation avec le gouvernement de Sun Yat-sen ; lequel, par ailleurs, n'abandonna jamais son jeu consistant à demander de l'aide à différentes puissances impérialistes. Ainsi en 1925, peu avant sa mort et alors qu'il se rendait dans le nord pour négocier, Sun Yat-sen, passa par le Japon à la recherche d'appuis pour son gouvernement.
C'est ce parti, le Kuomintang, représentant crime bourgeoisie nationale (commerçante, industrielle et intellectuelle) intégrée dans le jeu des grandes puissances impérialistes et des seigneurs de la guerre, que l'Internationale communiste arrivera à déclarer « Parti sympathisant ». C'est à ce parti que devront se soumettre jour après jour les communistes en Chine, au nom de la prétendue « révolution nationale », et, pour lui, ils devront «jouer les Coolies » ([5] [1962]).
Le Parti communiste de Chine » à la croisée des chemins
L'histoire officielle présente le surgissement du Parti communiste en Chine comme un sous-produit du mouvement de l'intelligentsia bourgeoisie des débuts du siècle. Le marxisme aurait été importé d'Europe parmi d'autres « philosophies » occidentales, et la fondation du Parti communiste ferait parti du surgissement de beaucoup d'autres organisations littéraires, philosophiques et politiques de cette époque. Avec ce genre d'idées, les historiens bourgeois créent un pont entre le mouvement politique de la bourgeoisie et celui de la classe ouvrière et donnent finalement, à la formation du Parti communiste, une signification spécifiquement nationale. En réalité, le surgissement du parti communiste en Chine - comme dans beaucoup d'autres pays à l'époque - n'est pas fondamentalement lié au développement de l'intelligentsia chinoise, mais à l'avancée du mouvement révolutionnaire international de la classe ouvrière.
Le Parti communiste de Chine (PCC) fut créé en 1920 et 1921, à partir de petits groupes marxistes, anarchistes et socialistes, sympathisants de la Russie soviétique. Comme tant d'autres partis, le PCC naquit directement en tant que composante de l'IC et sa croissance fut liée au développement des luttes ouvrières qui ne manquèrent pas de surgir suivant l'exemple des mouvements insurrectionnels en Russie et en Europe Occidentale. C'est ainsi que, de quelques dizaines de militants en 1921, le parti se développera en quelques années pour en compter un millier ; durant la vague de grèves de 1925 il atteint 4000 membres et, au moment de la période insurrectionnelle de 1927, il en comptait près de 60 000. Ce rapide accroissement numérique exprime, d'une certaine façon, la volonté révolutionnaire qui animait la classe ouvrière chinoise durant la période de 1919 à 1927 (la majorité des militants, à cette époque, sont des ouvriers des grandes villes industrielles). Cependant il faut dire que l'accroissement numérique n'exprimait pas un renforcement équivalent du parti. L'admission hâtive des militants contredisait la tradition du parti bolchevique de former une organisation solide, bien trempée, de l'avant-garde de la classe ouvrière, plutôt qu'une organisation de masse. Mais ce qui s'avéra pire que tout fut l'adoption, à partir de son second congrès, d'une politique opportuniste dont il n'allait plus parvenir à se défaire.
Vers le milieu de 1922, à la demande de l'Exécutif de l'Internationale, le PCC lance le malencontreux mot d'ordre du « Front unique anti-impérialiste avec le Kuomintang », et de l'adhésion individuelle des communistes à ce dernier. Cette politique de collaboration de classes (qui commença à s'étendre en Asie à partir de la « Conférence des peuples d'Orient » de janvier 1922) était le résultat des négociations, engagées en secret, entre l'URSS et le Kuomintang. Dès juin 1923 (3° congrès du PCC) est votée l'adhésion des membres du parti au Kuomintang. Le Kuomintang lui-même est admis dans l'IC en 1926 comme organisation sympathisante et participe au 7e Plénum de l'IC, alors même que l'opposition unifiée (Trotsky, Zinoviev,..) n'est pas autorisée à y participer. En 1926, tandis que le Kuomintang préparait le coup final contre la classe ouvrière, à Moscou on élaborait l'infâme théorie selon laquelle le Kuomintang était un « bloc anti-impérialiste comprenant quatre classes » (le prolétariat, la paysannerie, la petite-bourgeoisie et la bourgeoisie).
Cette politique eut les plus funestes conséquences sur le mouvement de la classe ouvrière en Chine. Tandis que le mouvement de grèves et les manifestations se développaient spontanément et impétueusement, le parti communiste, noyé au sein du Kuomintang, s'avérait incapable d'orienter la classe ouvrière, de faire preuve d'une politique de classe indépendante. La classe ouvrière, dépourvue également d'organisations unitaires comme les conseils ouvriers pour sa lutte politique, s'en remit, à la demande du PCC lui-même, au Kuomintang, c'est-à-dire accorda sa confiance à la bourgeoisie.
Cependant, il est certain que la politique opportuniste de subordination au Kuomintang a rencontré, dès le début, une résistance constante au sein du PCC (comme ce fut le cas du courant représenté par Chen Tou-hsiou). Déjà, dès le 2° congrès du PCC, une opposition s'était dressée contre les thèses défendues par le délégué de l'Internationale (Sneevliet), suivant lesquelles le Kuomintang ne serait pas un parti bourgeois, mais un front de classes auquel le PCC devrait se soumettre. Pendant toute la période d'union avec le Kuomintang, les voix n'ont pas manqué de se faire entendre, au sein du parti communiste, pour dénoncer les préparatifs anti-prolétariens de Chang Kai-chek ; demandant, par exemple, que les armes fournies par l'URSS soient destinées à l'armement des ouvriers et des paysans, plutôt que de venir renforcer l'armée de Chang Kai-chek, comme cela fut le cas, affirmant, enfin, l'urgence de sortir de la souricière que constituait le Kuomintang pour la classe ouvrière : « La révolution chinoise a deux chemins possibles : l'un est celui que le prolétariat peut tracer et par lequel nous pourrons atteindre nos objectifs révolutionnaires ; l'autre est celui de la bourgeoisie, et cette dernière trahira la révolution au cours de son développement ». ([6] [1963])
Cependant il s'avéra impossible, pour un parti jeune et sans expérience, de passer outre les directives erronées de l'Exécutif de l'Internationale, et il retomba dedans. Le résultat fut que, tandis que le prolétariat s'engageait dans un combat contre les fractions des classes possédantes adversaires du Kuomintang, celui-ci lui préparait déjà le coup de poignard dans le dos : ce que la classe ouvrière s'avéra incapable d'empêcher parce que son parti ne l'avait pas prévenue. Et s'il est vrai que la révolution en Chine avait peu de chance de triompher - en effet au niveau international la colonne vertébrale de la révolution mondiale, le prolétariat en Allemagne, était cassée depuis 1919- l'opportunisme de la 3e Internationale précipita la défaite.
La classe ouvrière se soulève
Le maoïsme a prétexté de la faiblesse de la classe ouvrière en Chine pour justifier le déplacement du PCC vers les campagnes à partir de 1927. Certes, la classe ouvrière en Chine, au début du siècle, était minuscule en nombre comparativement à la paysannerie (une proportion de 2 à 100), mais son poids politique ne suivait pas la même proportion.
D'une part, il y avait déjà environ 2 millions d'ouvriers urbains hautement concentrés dans le bassin du fleuve Yang-Tseu avec la cité côtière de Shanghai et la zone industrielle de Wou-Han (la triple ville Han-Keou, Wou-Tchang, Han-Yang) , dans le complexe Canton-Hong-Kong et dans les mines de la province du Yunnan (sans compter les 10 millions d'artisans plus ou moins prolétarisés qui peuplaient les villes). Cette concentration donnait à la classe ouvrière une force extraordinaire, capable de paralyser et de prendre en mains les centres vitaux de la production capitaliste. De plus, dans les provinces du sud (surtout à Kouang-Tong) existait une paysannerie étroitement liée aux ouvriers, en effet elle fournissait en forces de travail les villes industrielles et pouvait constituer une force d'appoint pour le prolétariat urbain.
D'autre part, il serait erroné de considérer la force de la classe ouvrière en Chine en se basant exclusivement sur son nombre en comparaison avec les autres classes du pays. Le prolétariat est une classe historique qui puise sa force dans son existence mondiale, et l'exemple de la révolution en Chine en est une preuve concrète. Le mouvement de grèves n'avait pas son épicentre en Chine mais en Europe, c'était une manifestation de l'onde d'expansion de la révolution mondiale. Les ouvriers de Chine, comme ceux d'autres parties du monde, se lançaient dans la lutte face à l'écho de la révolution triomphante en Russie et des tentatives insurrectionnelles en Allemagne et dans d'autres pays d'Europe.
Au début, comme la majorité des usines de Chine étaient d'origine étrangère, les grèves ont une teinte « anti-étrangers » et la bourgeoisie nationale pensa s'en servir comme instrument de pression. Cependant, le mouvement de grèves prendra de plus en plus un caractère de classe affirmé, contre la bourgeoisie en général, qu'elle soit nationale ou étrangère. Les grèves revendicatives se succèdent de façon croissante à partir de 1919, malgré la répression (il n'était pas rare que des ouvriers soient décapités ou brûlés dans les chaudières des locomotives). Vers le milieu de 1921, éclate la grève dans les textiles de Hou-Nan. Au début de 1922, une grève des marins de Hong-Kong se poursuit durant trois mois jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Dans les premiers mois de 1923 éclate une vague d'une centaine de grèves dans lesquelles prennent part plus de 300 000 ouvriers ; en février, le militariste Wou Pei-fou ordonne la répression de la grève des chemins de fer au cours de laquelle sont assassinés 35 ouvriers, et laissant de nombreux blessés. En juin 1924 éclate une grève générale à Canton - Hongkong qui durera trois mois. En février 1925 les ouvriers du coton de Shanghai se mettent en grève. C'est le prélude du gigantesque mouvement de grèves qui allait parcourir toute la Chine durant l'été 1925.
Le mouvement du 30 mai
En 1925, la Russie soutenait fermement le gouvernement de Canton du Kuomintang. Déjà depuis 1923, l'alliance entre l'URSS et le Kuomintang avait été déclarée ouvertement ; une délégation militaire du Kuomintang commandée par Chang Kai-chek s'était rendue à Moscou et, dans le même temps, une délégation de l'Internationale donnait au Kuomintang des statuts et une structure organisationnelle et militaire. En 1924, le premier Congrès officiel du Kuomintang approuva l'alliance et, en mai, s'établit l'Académie Militaire de Wham-poa avec des armes et des conseillers militaires soviétiques, dirigée par Chang Kai-chek. En fait, ce que faisait le Gouvernement russe, c'était former une armée moderne, au service de la fraction de la bourgeoisie groupée au sein du Kuomintang, ce dont celle-ci avait jusqu'alors manqué. En mars 1925; Sun Yat-sen se rend à Pékin (l'URSS continuait aussi à maintenir des relations avec le gouvernement de Pékin) pour essayer de construire une alliance visant à unifier le pays, mais il meurt des suites d'une maladie avant d'avoir atteint son but.
C'est dans ce contexte d'alliance idyllique que surgit, de toutes ses forces, le mouvement de la classe ouvrière, rappelant à la bourgeoisie du Kuomintang et aux opportunistes de l'Internationale l'existence de la lutte de classe.
Au début de 1925 monta la vague d'agitations et de grèves. Le 30 mai, la police anglaise de Shanghai ouvrit le feu sur une manifestation d'étudiants et d'ouvriers : 12 manifestants furent tués. Ce fut le détonateur d'une grève générale à Shanghai qui commença à s'étendre rapidement aux principaux ports commerciaux du pays. Le 19 juin éclate également la grève générale à Canton. Quatre jours plus tard les troupes britanniques de la concession britannique de Shameen (proche de Canton) ouvrirent le feu contre une autre manifestation. En riposte, les ouvriers de Hongkong se mirent en grève. Le mouvement s'étendit, arrivant jusqu'à la lointaine Pékin où, le 30 juillet, eut lieu une manifestation de quelques 200 000 travailleurs, et renforçant l'agitation paysanne dans la province de Kouang-Tong.
A Shanghai les grèves durèrent trois mois ; à Canton-Hong-Kong éclata une grève-boycott qui dura jusqu'en octobre de l'année suivante. A ce moment-là, commencèrent à se créer des milices ouvrières. Des milliers d'ouvriers rallièrent les rangs du parti communiste. La classe ouvrière en Chine se montrait pour la première fois en tant que force réellement capable de menacer le régime capitaliste dans son ensemble.
Malgré le fait que le mouvement du 30 mai eut comme conséquence directe la consolidation et l'extension dans le sud du pouvoir du gouvernement de Canton, ce même mouvement réveilla l'instinct de classe de la bourgeoisie nationaliste groupée dans le Kuomintang, et qui jus qu'alors avait « laissé faire » les grévistes tant qu'ils dirigeaient leurs luttes essentiellement contre les usines et les concessions étrangères. Les grèves de l'été 1925 avaient revêtu un caractère anti-bourgeois, ne « respectant » même pas les capitalistes nationaux. Ainsi, la bourgeoisie nationaliste et «révolutionnaire », avec à sa tête le Kuomintang (soutenu par les grandes puissances et avec l'appui aveugle de Moscou), se lança rageusement avant tout dans l'affrontement avec celui qu'elle avait identifié comme étant son ennemi de classe mortel : le prolétariat.
Le coup de force et l'expédition au nord de Chang Kai-chek
Entre les derniers mois de 1925 et les premiers de 1926 se déroule ce que les historiens ont décidé de nommer la «polarisation entre la gauche et la droite du Kuomintang », celle qui selon eux comporterait le fractionnement de la bourgeoisie en deux parties, l'une demeurant fidèle au nationalisme, l'autre virant vers une alliance avec l'impérialisme. Cependant nous avons déjà vu que, même les fractions de la bourgeoisie les plus « anti-impérialistes », ne cessèrent jamais leurs relations avec les impérialistes. Ce qui se passait en réalité ce n'était pas que la bourgeoisie se fractionnait, mais qu'elle se préparait à affronter la classe ouvrière, se débarrassant des éléments gênants au sein du Kuomintang (les militants communistes, une partie de la petite-bourgeoisie et quelques généraux fidèles à l'URSS). Ainsi donc, le Kuomintang, se sentant suffisamment de force politique et militaire, ôtait son masque de « bloc de classes » et apparaissait pour ce qu'il avait toujours réellement été : le parti de la bourgeoisie.
Fin 1925 le chef de la «gauche », Liao Ching-hai, fut assassiné et le harcèlement contre les communistes commença. Ceci constitua le prélude du coup de force de Chang Kai-chek, devenu l'homme fort du Kuomintang, qui marqua le début de la réaction de la bourgeoisie contre le prolétariat. Le 20 mars, Chang Kai-chek à la tête des cadets de l'Académie de Whampoa, proclame la loi martiale à Canton, ferme les locaux des organisations ouvrières, désarme les piquets de grève et fait arrêter nombre de militants communistes. Dans les mois suivants, les communistes seront éjectés de tous les postes à responsabilité du Kuomintang.
L'Exécutif de l'Internationale, à la botte de Boukharine et de Staline, demeure « aveugle » devant la réaction du Kuomintang et, malgré l'opposition insistante d'une grande partie du PCC, il donne l'ordre de maintenir l'alliance, cachant les événements aux membres de l'Internationale et des PC ([7] [1964]). Enhardi, Chang Kai-chek exige de l'URSS un soutien militaire dans son expédition vers le nord qui commence en juillet 1926.
Comme tant d'autres actions de la bourgeoisie, l'expédition dans le nord est faussement présentée par l'histoire officielle comme un « événement révolutionnaire », comme une tentative d'étendre le régime « révolutionnaire » et d'unifier la Chine. Mais les intentions du Kuomintang de Chang Kai-chek étaient loin d'être aussi altruistes. Son grand rêve (à l'égal d'autres militaristes) consistait en l'appropriation du port de Shanghai et l'obtention, de la part des grandes puissances, de l'administration de sa riche douane. Pour ce faire, il pouvait compter sur un argument de chantage extrêmement puissant : sa capacité à contenir et soumettre le mouvement ouvrier.
Dès le début de l'expédition militaire du Kuomintang, la loi martiale est décrétée dans les régions qu'il contrôle déjà. Ainsi, au moment même où les travailleurs du nord préparaient avec enthousiasme l'appui aux forces du Kuomintang, celui-ci interdisait formellement les grèves ouvrières dans le sud. En septembre, une force de gauche du Kuomintang prend Han-Keou, mais Chang Kai-chek refuse de la soutenir et s'établit à Nanchang. En octobre, on donne l'ordre aux communistes de freiner le mouvement paysan dans le sud et l'armée met un terme à la grève-boycott de Canton/Hong-Kong. Ceci constitua pour les grandes puissances (au premier rang desquelles l'Angleterre) la preuve la plus tangible que l'avancée vers le nord du Kuomintang n'avait aucune prétention anti-impérialiste et, peu de temps après, commencèrent les négociations secrètes avec Chang Kai-chek.
Fin 1926, le bassin industriel du fleuve Yang-Tseu bouillonnait d'agitation. En octobre, le militariste Sia-chao (qui venait de rejoindre le Kuomintang) avança sur Shanghai, mais il s'arrêta à quelques kilomètres de la ville, laissant les troupes « ennemies » du nord (sous les ordres de Sun Chouan-fang) entrer les premières dans la ville, étouffant ainsi un soulèvement imminent. En janvier 1927, les masses travailleuses occupèrent au moyen d'actions spontanées les concessions britanniques de Han-Keou (dans la triple ville de Wou-Han) et de Jiujiang. Alors, l'armée du Kuomintang ralentit son avance pour permettre, dans la plus pure tradition des armées réactionnaires, que les seigneurs de la guerre locaux puissent réprimer les mouvements ouvrier et paysan. Au même moment, Chang Kai-chek se lance publiquement à l'attaque des communistes et le mouvement paysan de Kouang-Tong (dans le sud) est étouffé. Voila le scénario selon lequel se déroula le mouvement insurrectionnel de Shanghai.
L'insurrection de Shanghai
Le mouvement insurrectionnel de Shanghai est le point culminant d'une décennie de luttes constantes et ascendantes de la classe ouvrière. Il constitue le point le plus élevé atteint par la révolution en Chine. Cependant, les conditions dans lesquelles il mûrissait ne pouvaient guère être plus défavorables pour la classe ouvrière. Le parti communiste se trouvait pieds et poings liés, désarticulé, frappé et soumis par le Kuomintang. La classe ouvrière, trompée par la mystification du « bloc des quatre classes », ne s'était pas non plus dotée d'organismes unitaires, chargés de centraliser effectivement sa lutte, de type conseils ouvriers ([8] [1965]). Pendant ce temps, les canonnières des puissances impérialistes étaient pointées sur la ville, et le Kuomintang lui-même s'approchait de Shanghai, paraissant arborer la bannière de la « révolution anti-impérialiste », mais avec le véritable but d'écraser les ouvriers. Seuls, la volonté révolutionnaire et l'héroïsme de la classe ouvrière peuvent expliquer sa capacité à s'emparer dans de telles conditions, et même si ce n'est que pour quelques jours, de la ville qui représente le coeur du capitalisme en Chine.
En février 1927, le Kuomintang reprend son avancée. Le 18, l'armée nationaliste se trouve à Chiaching, à 60 kilomètres de Shanghai. A ce moment-là, devant la défaite imminente de Sun Chouan-fang, éclata la grève générale à Shanghai : « ...le mouvement du prolétariat de Shanghai, du 19 au 24 février, constitua objectivement une tentative du prolétariat de Shanghai d'assurer son hégémonie. Aux premières nouvelles de la défaite de Sun Chouan-fang, à Zhejiang, l'atmosphère de Shanghai devint brûlante et, pendant les deux jours, éclata avec la puissance d'une force élémentaire une grève de 300 000 travailleurs qui se transforma irrésistiblement en insurrection armée pour rapidement sombrer dans le néant, par manque de direction... » ([9] [1966]).
Le Parti communiste, pris par surprise, hésitait à lancer le mot d'ordre de l'insurrection alors que celle-ci se déroulait dans les rues. Le 20, Chang Kai-chek ordonna d'un coup de suspendre l'attaque contre Shanghai. Ce fut le signal pour les forces de Sun Chouan-fang de déchaîner la répression dans laquelle des dizaines d'ouvriers furent assassinés et qui parvint à contenir momentanément le mouvement.
Durant les semaines qui suivirent, Chang Kai-chek manoeuvra habilement pour éviter d'être relevé du commandement de l'armée et pour faire taire les rumeurs d'une alliance avec la droite et les puissances, et sur ses préparatifs anti-ouvriers.
Enfin, le 21 mars 1927 éclate la tentative insurrectionnelle finale. Ce jour-là, on proclame une grève générale à laquelle participent pratiquement tous les ouvriers de Shanghai : 800 000 ouvriers. « Tout le prolétariat était en grève, ainsi que la majeure partie de la petite-bourgeoisie (épiciers, artisans, etc.) (...) en une dizaine de minutes, toute la police fut désarmée. A deux heures, les insurgés possédaient déjà quelques 1500 fusils. Immédiatement après, les forces insurgées se dirigèrent vers les principaux édifices gouvernementaux et s'employèrent à désarmer les troupes. De sérieux combats s'engagèrent dans le quartier ouvrier de Tchapei... Finalement, le deuxième jour de l'insurrection, à quatre heures de l'après-midi, l'ennemi (environ 3000 soldats) était définitivement défait. Une fois ce rempart mis à bas, tout Shanghai (excepté les concessions et le quartier international) se trouvait entre les mains des insurgés » ([10] [1967]). Cette action, après la révolution en Russie et les tentatives insurrectionnelles en Allemagne et dans d'autres pays européens, constitua une nouvelle secousse contre l'ordre capitaliste mondial. Elle montra tout le potentiel révolutionnaire de la classe ouvrière. Cependant, la machine répressive de la bourgeoisie était déjà en marche et le prolétariat n'était pas en état de l'affronter.
La bourgeoisie « révolutionnaire » massacre le prolétariat
Les ouvriers prirent la ville de Shanghai... seulement pour en ouvrir les portes à l'armée nationale « révolutionnaire » du Kuomintang qui finit par entrer dans la ville. Elle finissait à peine de s'installer à Shanghai quand Chang Kai-chek commença à préparer la répression, en accord avec la bourgeoisie spéculatrice et les bandes mafieuses de la ville. Ainsi commença un rapprochement ouvert avec les représentants des grandes puissances et avec les seigneurs de la guerre du nord. Le 6 avril Chang Tso-lin (en accord avec Chang Kai-chek) attaqua l'ambassade de Russie à Pékin et arrêta des militants du Parti communiste qui furent, par la suite, assassinés.
Le 12 avril se déchaîna à Shanghai la répression massive et sanglante préparée par Chang Kai-chek. Les bandes du lumpenproletariat des sociétés secrètes, qui avaient toujours joué le rôle de briseurs de grèves, furent envoyées contre les ouvriers. Les troupes du Kuomintang prétendument « alliées » des ouvriers -furent directement utilisées pour désarmer et arrêter les milices prolétariennes. Le jour suivant, le prolétariat essaya de réagir en lançant une grève, mais les contingents des manifestants furent interceptés par la troupe, occasionnant de nombreuses victimes. Immédiatement la loi martiale fut appliquée et toutes les organisations ouvrières interdites. En peu de jours 5 000 ouvriers furent assassinés, parmi lesquels de nombreux militants du parti communiste. Les rafles et les assassinats allaient continuer pendant des mois.
Simultanément, par une manoeuvre conjointe, les militaires du Kuomintang qui étaient restés à Canton déchaînèrent un autre massacre, exterminant encore des milliers d'ouvriers.
La révolution prolétarienne, noyée dans le sang des ouvriers de Shanghai et de Canton, résistait encore de façon précaire à Wou-Han. Cependant, de nouveau, le Kuomintang, et plus particulièrement son aile gauche, ôta son masque « révolutionnaire » et, en juillet, rejoignit les rangs de Chang Kai-chek, déchaînant là aussi la répression. Ainsi, les hordes militaires se livrèrent à la destruction et au massacre dans les campagnes des provinces du centre et du sud. Les travailleurs furent assassinés par dizaines de milliers dans toute la Chine.
L'Exécutif de l'Internationale, tentant de masquer sa politique néfaste et criminelle de collaboration de classe, se déchargea de toute responsabilité sur le PCC et ses organes centraux et, plus particulièrement, sur le courant qui, justement, s'était opposé à cette politique (celui de Chen Tou-hsiou). Pour parachever le tout, il ordonna au Parti communiste de Chine, déjà affaibli et démoralisé, de s'engager dans une politique aventureuse qui se termina par la soi-disant « insurrection de Canton ». Cette tentative absurde de coup de force « planifié » ne fut pas suivie par le prolétariat de Canton et n'aboutit qu'à soumettre encore plus ce dernier à la répression. Cela marque pratiquement la fin du mouvement ouvrier en Chine, dont on ne verra plus d'expression significative pendant les quarante années suivantes.
La politique de l'Internationale face à la Chine fut un des axes de dénonciation du stalinisme montant, qui se trouve à l'origine de 1' « Opposition de gauche », le courant incarné par Trotsky (dans lequel ce même Chen Tou-hsiou finit par s'engager). Ce courant, confus et tardif, d'opposition à la dégénérescence de la 3e Internationale, bien qu'il se soit maintenu sur un terrain de classe prolétarien à propos de la Chine - dénonçant la soumission du PCC au Kuomintang comme étant la cause de la défaite de la révolution - ne parvint jamais à dépasser le cadre erroné des Thèses du deuxième congrès de l'Internationale sur la question nationale. Ce qui à son tour, sera un des facteurs qui le mèneront à une dérive opportuniste (par une ironie de l'histoire, Trotsky soutiendra le nouveau front de classes résultant, en Chine, des luttes impérialistes à partir des années 30), jusqu'à son passage dans le camp de la contre-révolution, au cours de la deuxième guerre mondiale ([11] [1968]). D'une façon ou d'une autre, tout ce qui demeurait révolutionnaire internationaliste en Chine, fut appelé désormais « trotskisme » (des années après, Mao Tsé-tung poursuivra comme « agents trotskistes de l'impérialisme japonais » les quelques internationalistes qui s'opposaient à sa politique contre-révolutionnaire).
Quant au Parti communiste de Chine, il fut littéralement anéanti, après que près de 25 000 de ses militants aient été assassinés des mains du Kuomintang et les autres emprisonnés ou persécutés. Sans doute, des rescapés du parti communiste, ainsi que quelques détachements du Kuomintang, purent se réfugier à la campagne. Mais, à ce déplacement géographique, correspondait un déplacement politique toujours plus profond : dans les années suivantes, le parti adopta une idéologie bourgeoise, sa base sociale - dirigée par la petite-bourgeoisie et la bourgeoise devint à prédominante paysanne et il participa aux campagnes de guerres impérialistes. Au prix du maintien de son nombre, le parti communiste de Chine cessa d'être un parti de la classe ouvrière et se convertit en organisation de la bourgeoisie. Mais cela est déjà une autre histoire, objet de la seconde partie de cet article.
Signalons, en guise de conclusion, quelques enseignements tirés du mouvement révolutionnaire en Chine :
* La bourgeoisie chinoise ne cessa pas d'être révolutionnaire au moment où elle se lança contre le prolétariat en 1927. Déjà depuis la «révolution de 1911 », la bourgeoisie nationaliste avait montré son aptitude à partager le pouvoir avec la noblesse, à s'allier avec les militaristes et à se soumettre aux puissances impérialistes. Ses aspirations démocratiques, « anti-impérialistes » et même « révolutionnaires », n'étaient que le masque qui cachait ses intérêts réactionnaires ; ceux-ci furent mis à nu quand le prolétariat commença à représenter un menace. Dans la période de décadence du capitalisme, les bourgeoisies des pays faibles sont aussi réactionnaires et impérialistes que celles des grandes puissances.
* La lutte de classe du prolétariat en Chine de 1919 à 1927 ne peut être analysée dans un contexte purement national. Elle constitue un moment de la vague révolutionnaire mondiale qui ébranla le capitalisme au début du siècle. La force élémentaire avec laquelle se souleva le mouvement ouvrier en Chine, secteur du prolétariat mondial considéré alors comme faible, au point d'être capable de prendre spontanément entre ses mains les grandes villes, montre le potentiel que la classe ouvrière possède pour abattre la bourgeoisie, même si pour ce faire elle a besoin de sa conscience et de son organisation révolutionnaires.
Le prolétariat ne peut plus s'allier avec une fraction de la bourgeoisie quelle qu'elle soit. Par contre, il peut entraîner dans son mouvement révolutionnaire des secteurs de la petite-bourgeoisie urbaine et rurale (comme le montrèrent l'insurrection de Shanghai et le mouvement paysan de Kouang-Tong). Cependant, le prolétariat ne doit pas fusionner organiquement avec ces secteurs dans un quelconque «front », il doit au contraire maintenir à tous moments son autonomie de classe.
Pour vaincre, le prolétariat a besoin d'un parti politique qui l'oriente dans les moments déterminants, ainsi que d'une organisation unitaire en conseils ouvriers. Il doit en particulier se doter à temps de son Parti communiste mondial, ferme dans les principes et trempé par la lutte, avant que n'éclate la prochaine vague révolutionnaire internationale. Ce parti doit être capable de combattre en permanence l'opportunisme qui sacrifie l'avenir de la révolution au nom de « résultats immédiats »
Leonardo.
[1] [1969] Nous ne pouvons, dans le cadre de cet article, développer sur la lutte menée par les Fractions de gauche de l'Internationale contre l'opportunisme et la dégénérescence de celle-ci. lutte qui se déroulait à la même époque que les événements en Chine. Ces derniers sont d'ailleurs les seuls, à notre connaissance, qui aient donné lieu à un manifeste signé en commun par toute l'Opposition, y compris la gauche italienne. Il s'agit du Manifeste « Aux communistes chinois et du monde entier!» (La Vérité, 12 septembre 1930). Sur cette question, nous recommandons notre brochure La Gauche communiste d'Italie et la série d'articles sur La Gauche hollandaise.
[2] [1970] Cette dégénérescence allait de pair avec celle de l'Etat surgi de la révolution, qui mena à la reconstitution de l'Etat capitaliste sous sa forme stalinienne. Cf. Manifeste du 9e Congrès du CCI.
[3] [1971] Lénine, Rapport de la Commission nationale et coloniale pour le Deuxième congrès de l'Internationale communiste, 26 juillet 1920. Extrait de La Question chinoise dans l'Internationale communiste, présentation et compilation de Pierre Broué.
[4] [1972] « Thèses et additions sur la question nationale et coloniale », 2e congrès, Les quatre premiers congrès mondiaux de l'Internationale communiste, 19i'9-23, Ed. Maspéro.
[5] [1973] Autrement dit les porteurs d'eau. Expression utilisée par Borodine, délégué de l'IC en Chine en 1926. E.-Il. Carr, Le Socialisme dans un seul pays.
[6] [1974] Chen Tou-hsiou ; cité par lui-même dans sa «Lettre à tous les membres du PCC» 1929; Extrait de La question chinoise... op. cit.
[7] [1975] Chang Kai-chek avait été nommé membre honoraire quelques semaines auparavant, et le Kuomintang « parti sympathisant » de l'Internationale. Même après le coup de force, les conseillers russes refusèrent de fournir 5000 fusils aux ouvriers et paysans du sud, les réservant pour l'année de Chang Kai-chek.
[8] [1976] On parle beaucoup du rôle d'organisation joué par les syndicats dans le mouvement révolutionnaire en Chine. Il est vrai que durant cette période, les syndicats surgissent et se développent au rythme du développement du mouvement de grèves. Cependant, dans la mesure où ils n'essaient pas de contenir le mouvement dans le cadre de revendications économiques, leur politique restera soumise au Kuomintang (y compris les syndicats influencés par le PCC). Le mouvement de Shanghai se donnera ainsi comme objectif d'ouvrir la voie à l'armée nationaliste. En décembre 1927, les syndicats du Kuomintang iront même jusqu'à participer à la répression contre les ouvriers. Que les seules organisations de masse dont disposent les ouvriers soient les syndicats ne constitue évidemment pas un avantage, mais traduit leur faiblesse.
[9] [1977] Lettre de Shanghai de trois membres de la mission de TIC en Chine, datée du 17 mars 1927. Extraite de La Question chinoise, op. cit
[10] [1978] Neuberg, L'Insurrection armée. Ce livre, écrit semble-t-il aux alentours de 1929 (après le 6e congrès de l'IC), contient quelques informations valables sur les événements de l'époque. Cependant, il tend à voir l'insurrection comme un coup de main et fait une apologie grossière du stalinisme. D'autre part, on ne doit pas s'étonner du fait que la tentative insurrectionnelle de Shanghai, malgré son ampleur et son écrasement sanglant, soit à peine mentionnée (quand elle n'est pas totalement occultée), aussi bien dans les livres historiques - qu'ils soient « pro-occidentaux » ou « pro-maoïstes » - que dans les manuels maoïstes. C'est sur la base de cette occultation qu'il a été possible de maintenir le mythe selon, lequel ce qui était en jeu dans les années 1920, c'était une « révolution bourgeoise ».
[11] [1979] Pour connaître plus complètement notre position sur Trotsky et le trotskisme, on peut lire notre brochure Le trotskisme contre la classe ouvrière.
Géographique:
- Chine [1980]
Conscience et organisation:
- Troisième Internationale [1881]
Personnages:
- Chang-Kai-Shek [1981]
- Sun-Yat-Sen [1982]
Courants politiques:
- Maoïsme [1983]
Heritage de la Gauche Communiste:
- La Révolution prolétarienne [1149]
Le communisme n'est pas un bel idéal, mais une nécessite matérielle [11e partie]
- 3929 reads
MARX DE LA MATURITE :
COMMUNISME DU PASSE, COMMUNISME DE L'AVENIR
Au cours de cette série, nous avons montré comment le travail révolutionnaire de Marx est passé par plusieurs phases, correspondant aux changements de conditions de la société bourgeoise et de la lutte de classes en particulier. La dernière décennie de sa vie, suite à la défaite de la Commune de Paris et à la dissolution de la Première Internationale, a été en conséquence, comme dans les années 1850, consacrée en priorité à la recherche scientifique et à la réflexion théorique, plutôt qu'à l'activité militante ouverte.
Pendant cette période, une partie considérable des énergies de Marx a été orientée vers sa gigantesque critique de l'économie politique bourgeoise, aux volumes restants du Capital, qu'il n'a jamais pu terminer lui-même. Une santé défectueuse a sans doute joué un rôle considérable là-dedans. Mais ce qui a été mis en lumière récemment, c'est le niveau jusqu'auquel Marx, dans cette période, a été « distrait » par des questions qui, à première vue, pourraient apparaître comme étant une diversion par rapport à l'aspect noeudal du travail de sa vie : nous faisons référence à ses préoccupations anthropologiques et ethnologiques, stimulées par la parution en 1877 du livre Ancient society ([1] [1984]) de Henry Morgan. Le degré auquel Marx a été absorbé par ces questions a été révélé par la publication en 1974 de ses Cahiers ethnologiques, sur lesquels il a travaillé dans la période 1881-82 et qui sont la base de L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'Etat, de Engels. Engels a écrit ce livre comme un « legs » de Marx, autrement dit en reconnaissance de l'importance que Marx accordait à l'élude scientifique des premières formes de sociétés humaines, en particulier celles précédant la formation des classes et de l'Etat.
En lien étroit avec ces recherches, Marx manifestait un intérêt croissant pour la question russe, intérêt qui s'était développé depuis le début des années 1870, mais auquel la publication du livre de Morgan avait donné une impulsion considérable. Il est bien connu que les réflexions de Marx sur les problèmes posés par le mouvement révolutionnaire naissant en Russie l'ont incité à apprendre le russe et à accumuler une immense bibliothèque de livres sur la Russie. Il a même été amené à dissimuler à Engels -qui devait le harceler constamment pour le presser de terminer Le Capital - la quantité de temps qu'il consacrait à la question russe.
Les préoccupations du Marx de la maturité ont fait surgir des interprétations contradictoires et des controverses qui s'appuient sur la comparaison avec les arguments des travaux du «jeune» Marx. C'est par exemple la vision de Riazanov qui, au nom de l'Institut Marx-Engels de Moscou, a publié la lettre de Marx à Vera Zassoulitch (et les brouillons de cette lettre) en 1924, après qu'elles aient été « enterrées » par certains éléments du mouvement marxiste russe (Zassoulitch, Axelrod, Plekhanov, etc.) D'après Riazanov, l'absorption de Marx dans ces questions, en particulier la question russe, était essentiellement due aux capacités intellectuelles déclinantes de Marx. D'autres, en particulier des éléments qui avaient été à la « pointe » du mouvement politique prolétarien, tels que Raya Dunayevskaya et Franklin Rosement ([2] [1985]), ont justement répondu à de telles idées et ont tenté de dégager l'importance des préoccupations du Marx d'âge mûr. Mais, ce faisant, ils ont introduit de nombreuses confusions qui ont ouvert la porte en grand à l'utilisation frauduleuse de cette phase des travaux de Marx.
L'article qui suit n'est pas du tout une tentative d'examiner les Cahiers ethnologiques, les écrits de
Marx sur la Russie ni même L'origine de la famille de Engels au niveau de
profondeur requis. Les Cahiers, en
particulier, sont un territoire presque inexploré et requièrent une immense
exploration et un « décodage » : ils sont, en grande partie, sous forme de
notes, une série de notes marginales et d'extraits et, pour la plupart d'entre
eux, écrits en un curieux mélange d'anglais et d'allemand. De plus, la majorité
des «fouilles » qui y ont été faites concernent le livre de Morgan. C'est sans
doute la partie la plus importante et elle a servi de base principale pour
L'origine de la famille. Mais les Cahiers
contiennent aussi les notes de Marx sur Le
village aryen de J.-P. Phear (une étude des formes sociales communautaires
en Inde), sur les Lectures sur les
institutions de l'histoire primitive de H.-S. Maine (qui sont centrées sur
les vestiges des formations sociales communautaires en Irlande) et sur Les origines de la civilisation de J.
Lubbock, ce qui révèle l'intérêt de Marx pour les créations idéologiques des
sociétés primitives, en particulier le développement de la religion. Il y
aurait beaucoup à dire, spécialement à propos de cette dernière, mais nous
n'avons pas l'intention de nous engager sur ces problèmes ici. Notre but,
beaucoup plus limité, est d'affirmer l'importance et la pertinence des travaux
de Marx sur ces sujets en même temps que de critiquer certaines fausses
interprétations qui en ont été faites.
La propriété privée, l'Etat et la famille ne sont pas éternels
Ce n'est pas la première fois que l'intérêt de Marx pour la question du « communisme primitif» est évoqué dans cette série d'articles. Nous avons montré, par exemple, dans la Revue Internationale n° 75, que les Grundrisse et Le Capital défendent déjà l'idée que les premières sociétés humaines étaient caractérisées par l'absence d'exploitation de classe et de propriété privée ; que des vestiges de ces formes communautaires avaient persisté dans tous les systèmes de classe pré-capitalistes ; et que ces vestiges, de concert avec les souvenirs à demi distordus qui survivent dans la conscience populaire, ont souvent fourni les bases des révoltes des classes exploitées de ces systèmes. Le capitalisme, en généralisant les rapports marchands et la guerre économique de tous contre tous, a effectivement dissout ces restes communautaires (au moins dans les pays où il a pris racine) ; mais ce faisant, il jetait les fondements d'une forme de communisme plus élevé. La reconnaissance du fait que plus on remonte loin dans l'histoire de la société humaine, plus on se rend compte qu'elle est basée sur les formes de propriété communautaire, était déjà un argument vital contre la vision bourgeoise selon laquelle le communisme va, d'une façon ou d'une autre, à rencontre les fondements de la nature humaine.
La publication de l'étude de Morgan sur la société américaine « indienne » (en particulier les Iroquois) a donc été d'une importance considérable pour Marx et Engels. Bien que Morgan ne fût pas révolutionnaire, ses études empiriques ont apporté une confirmation éclatante de la thèse du communisme primitif, rendant évident que des institutions qui, comme les fondations de l'ordre bourgeois, étaient considérées comme éternelles et immuables, ont une histoire : qu'elles avaient été totalement inexistantes à des époques reculées, n'avaient émergé qu'au travers d'un processus long et tortueux, que leur forme avait changé quand la forme de la société changeait et qu'elles pouvaient donc changer encore et même être abolies dans une société différente.
La conception de l'histoire de Morgan n'était pas tout à fait la même que celle de Marx et Engels, mais elle n'était pas incompatible avec la conception matérialiste. En fait, il a insisté fortement sur l'importance centrale de la production des moyens d'existence comme facteur d'évolution d'une forme sociale vers une autre et a tenté de systématiser une série de stades dans l'histoire humaine {« sauvagerie », « barbarie », « civilisation », ainsi que divers sous-phases au sein de ces époques) qu'Engels a, pour l'essentiel, repris dans L'origine de la famille. Cette périodisation a été extrêmement importante pour comprendre l'ensemble du processus de développement historique et les origines de la société de classe. De plus, dans les travaux antérieurs de Marx, le matériel de base utilisé pour étudier le communisme primitif était principalement tiré de formes sociales européennes archaïques et disparues (par exemple, teutonnes et classiques) ou bien des vestiges communautaires qui persistaient dans le système asiatique et qui furent anéanties par le développement colonial. Maintenant, Marx et Engels pouvaient élargir le champ en étendant leur étude à des peuples qui étaient encore à un stade « pré-civilisé », mais dont les institutions étaient assez avancées pour permettre de comprendre les mécanismes de la transition d'une société primitive, ou plutôt barbare, à une société basée sur les divisions de classe. En somme, c'était un laboratoire vivant pour l'étude de formes sociales en évolution. Pas étonnant que Marx ait été aussi enthousiaste et se soit efforcé de le comprendre avec tant de profondeur. Des pages et des pages de ses notes traitent dans le moindre détail du mode de parenté, des coutumes et de l'organisation sociale des tribus que Morgan étudie. C'est comme si Marx cherchait à se faire une image aussi claire que possible d'une formation sociale qui apporte la preuve empirique que le communisme n'est pas un rêve futile mais une possibilité concrète, enracinée dans les conditions matérielles de l'humanité.
L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'Etat : le titre de Engels reflète les principales subdivisions des notes de Marx sur Morgan, dans lesquelles Marx cherche à établir comment, d'un côté, ces piliers « sacrés » de l'ordre bourgeois n'ont pas toujours existé et comment, d'autre part, ils ont évolué depuis l'intérieur des communautés archaïques.
Ainsi, les notes de Marx se centrent sur le fait que, dans la société sauvage (c'est-à-dire les société de chasse-cueillette), il n'y a virtuellement pas d'idée de propriété à part pour quelques objets personnels. Dans les sociétés plus avancées (barbares), en particulier avec le développement de l'agriculture, la propriété reste d'abord essentiellement collective, il n'y a pas encore de classe vivant du travail d'une autre. Mais les germes de la différenciation peuvent être distingués dans l'organisation de la « gens », des systèmes de clans, au sein de la tribu, où la propriété peut être transmise dans un groupe plus restreint. « L'héritage : son premier grand règne commença avec l'institution de la gens, qui distribua les effets d'une personne morte parmi ses gentilices. » ([3] [1986]) Le « ver » de la propriété privée est donc déjà présent « dans le fruit » de l'ancien système communautaire, dont l'existence n'est pas causé par la bonté innée de l'humanité, mais parce que les conditions matérielles dans lesquelles les premières communautés humaines évoluaient ne permettaient aucune autre forme ; en changeant les conditions matérielles, en lien avec le développement des forces productives, la propriété communautaire se transformait éventuellement en barrière au développement et était remplacée par des formes plus compatibles avec l'accumulation des richesses. Mais le prix à payer pour ce développement a été l'apparition de la division en classes, l'appropriation des richesses sociales par une minorité privilégiée. Et, là encore, c'est à travers la transformation du clan, ou de la gens, en castes puis en classes que ce développement fatidique eut lieu.
L'apparition des classes aboutit aussi à l'apparition de l'Etat. La reconnaissance par Marx d'une tendance, au sein des institutions « de gouvernement » iroquoises, vers la séparation entre la fiction publique et la pratique réelle est développée par Engels dans la thèse selon laquelle l'Etat « n'est en aucune façon une puissance imposée de l'extérieur à la société » (L'origine de la famille) ; qu'il n'est pas le résultat d'une conspiration imposée par une minorité mais émerge du sol de la société à un certain niveau de développement (une thèse magnifiquement confirmée par l'expérience de la révolution russe et l'émergence de l'Etat transitoire des Soviets, du sein de la situation post-révolutionnaire). Comme la propriété privée et les classes, l'Etat surgit des contradictions apparaissant dans l'ordre communautaire originel. Mais en même temps, et cela ne fait aucun doute, avec l'expérience de la Commune de Paris encore très présente à son esprit, Marx est à l'évidence fasciné par les système des « conseils » iroquois, s'intéressant en détail à la structure des prises de décision et des coutumes et traditions qui accompagnent les assemblées tribales : « Le Conseil - instrument de gouvernement et autorité suprême sur la gens, la confédération tribale (...) la forme du Conseil la plus simple et la plus basse - celle de la Gens ; une assemblée démocratique, où chaque membre adulte mâle et femelle avait une voix sur toutes les questions posées devant elle ; elle élisait et déposait ses sachems et chefs (...) Elle était le germe du conseil de la tribu, plus élevé, et de celui, encore plus élevé, de la confédération, chacun d'eux étant composé exclusivement de chefs et de représentants. » ([4] [1987])
Ainsi, de même que la notion de propriété, qui était à l'origine collective, porta un coup aux notions bourgeoises d'économie politique - les « Robinsonnades » qui voyaient l'envie de propriété privée comme inhérente à la nature humaine - les travaux de Morgan ont confirmé que les être humains n'ont pas toujours eu besoin d'une autorité contrôlée par une minorité spécialisée, un pouvoir d'Etat, pour diriger leur vie sociale. Comme la Commune, les conseils iroquois étaient la preuve de la capacité de l'humanité à se gouverner elle-même.
La citation ci-dessus mentionne l'égalité des hommes et des femmes dans la démocratie tribale. De nouveau, Marx note que, même là, on peut voir des signes de différenciation : « Dans cette aire comme ailleurs, Marx distingue des germes de stratification au sein de l'organisation gentilice, à nouveau en termes de séparation entre sphères "publique" et "privée", ce qu'il voit à son tour comme un reflet de l'émergence graduelle d'une caste tribale propriétaire et privilégiée. Après avoir reproduit l'observation de Morgan selon laquelle, dans le Conseil des Chefs, les femmes sont libres d'exprimer leurs souhaits et opinions "par l'intermédiaire d'un orateur de leur choix", // ajoute, en le soulignant, que la "décision (était) prise par le Conseil (composé d'hommes)". » ([5] [1988])
Mais Rosemont continue en disant « Marx était néanmoins indubitablement impressionné par le fait que, chez les Iroquois, les femmes bénéficiaient d'une liberté et d'un niveau d'implication sociale beaucoup plus élevé que les femmes (ou les hommes !) de toute nation civilisée. » Cette compréhension participe de la véritable percée que les recherches de Morgan ont permis à Marx et Engels de faire, sur la question de la famille.
Dès le Manifeste Communiste, la tendance autour de Marx et Engels a dénoncé la nature hypocrite et oppressive de la famille bourgeoise et a ouvertement défendu son abolition dans une société communiste. Mais désormais, les travaux de Morgan permettaient aux marxistes de démontrer, par l'exemple historique, le fait que la famille patriarcale monogame n'était pas le fondement moral irremplaçable de tout ordre social ; en fait, son arrivée est assez tardive dans l'histoire de l'humanité et, là encore, plus on regarde loin en arrière, plus il devient évident que le mariage, l'éducation des enfants étaient à l'origine des fonctions communautaires, qu'un « communisme vivant » ([6] [1989]) prévalait au sein des peuples tribaux. Ce n'est pas le lieu ici de rentrer dans les détails complexes sur l'évolution des institutions du mariage relevés par Marx et résumés par Engels, ou de juger la vision de Engels à la lumière de recherches ethnologiques plus récentes. Mais, même si certaines de leurs hypothèses sur l'histoire de la famille étaient fausses, le point essentiel reste : la famille patriarcale, où l'homme considère la femme comme sa propriété privée, n'est pas « la façon dont les choses ont toujours été », mais le produit d'un type particulier de société - une société fondée sur la propriété privée (en fait, comme Engels le souligne dans L'origine de la famille, le terme même de famille, venant du latin «familias », est totalement lié à l'esclavage, dans la mesure où à l'origine, dans la Rome Antique, il désignait la maisonnée d'un propriétaire d'esclaves, ceux sur qui il avait le pouvoir de vie et de mort ( esclaves et femmes compris). Dans une société où n'existaient ni les classes ni la propriété privée, les femmes ne pouvaient pas être considérées comme des biens ou des servantes mais jouissaient réellement d'un statut bien plus élevé que dans les société « civilisées » ; l'oppression des femmes se développe donc avec l'émergence graduelle de la société de classe même si, comme pour la propriété privée et l'Etat, les germes peuvent déjà en être relevés dans la vieille communauté.
Cette vision sociale et historique de l'oppression des femmes a été une
réfutation de toutes les visions ouvertement réactionnaires qui admettaient
une quelconque base inhérente, biologique, au statut « inférieur » des femmes. La clef du statut inférieur de la femme à
travers les âges ne se trouve pas dans la biologie (même si des différences
biologiques ont eu un effet sur le développement de la domination mâle), mais
dans l'histoire - dans l'évolution de formes sociales particulières,
correspondant au développement matériel des forces productives. Mais cette
analyse va aussi à l'encontre de l'interprétation féministe qui (bien qu'elle
emprunte beaucoup à la position marxiste) tend aussi inévitablement à faire de
l'oppression des femmes quelque chose de biologiquement inhérent, bien que
cette fois ce soit chez le mâle plutôt que chez la femelle. En tout cas, à la
fois le féminisme et la vision réactionnaire achevée conduisent à la même
conclusion : que l'oppression des femmes ne pourra jamais être abolie tant que
la société sera composée d'hommes et de femmes (le « séparatisme radical », malgré toute son absurdité, est réellement
la forme la plus consistante du féminisme). Pour les communistes, par contre,
si l'oppression des femmes a eu son début dans l'histoire, elle peut aussi y
avoir sa fin - par la révolution communiste qui procure aux hommes et aux
femmes les conditions matérielles pour entrer en relation les uns avec les
autres et pour éduquer les enfants, en dehors des pressions sociales et
économiques qui les ont jusqu'ici enfermés dans leurs rôles respectifs et
restrictifs. Nous reviendrons sur ce point dans un article ultérieur.
La dialectique de
l'histoire : Marx contre Engels ?
Dunayevskaya et Rosemont ont tous deux noté, dans leurs commentaires sur les Cahiers, que l'intérêt du Marx de la maturité pour le communisme primitif représentait un retour à certains des thèmes de sa jeunesse, en particulier ceux des Manuscrits économiques et philosophiques de 1844. Ces derniers représentaient une anthropologie plutôt « philosophique » ; dans les Cahiers, Marx s'orientait vers une anthropologie historique, mais sans renoncer aux préoccupations de ses travaux antérieurs. De même que le thème des rapports homme-femme avait été posé de façon un peu abstraite en 1844, et qu'il était traité maintenant « dans la chair ». Ces commentaires sont justes tant que l'on garde en tête, comme nous l'avons montré dans la Revue Internationale n° 75, que les « thèmes de 1844 » ont continué d'être un élément vital de la pensée de Marx dans ses travaux de la maturité, comme Le Capital et les Grundrisse, et qu'ils n'ont pas soudain ressurgi en 1881. En tout cas, ce qui ressort d'une lecture des Cahiers, c'est le respect de Marx, non seulement pour l'organisation sociale des « sauvages » et des « barbares », mais aussi pour leur réussite culturelle, leur mode de vie, leur « vitalité », qu'il considérait comme étant « incomparablement supérieure (...) à celle des Sémites, des Grecs, des Romains et a fortiori à celle des sociétés capitalistes modernes » ([7] [1990]). Ce respect peut se constater dans sa défense fréquente de leur intelligence, contre les « têtes de pioche » bourgeois (et racistes) comme Lubbock et Maine, des qualités imaginatives inhérentes à leurs mythes et légendes ; on peut le voir, surtout, dans la description détaillée de leurs coutumes, de leurs banquets, fêtes et danses, d'un mode de vie dans lequel travail et jeu, politique et célébration ne sont pas encore devenus des catégories totalement séparées. C'est là une concrétisation d'un des thèmes centraux qui ont vu le jour dans les Manuscrits de 1844 et dans les Grundrisse : que dans les sociétés pré-capitalistes, et en particulier dans les pré-civilisées, la vie humaine était, sous bien des aspects, moins aliénée que ce qu'elle est devenue sous le capitalisme ; que les peuples du communisme primitif nous donnent une idée de l'être humain complet du communisme de demain. Ainsi Marx, dans sa réponse à Vera Zassoulitch sur la commune russe (voir plus loin) était tout disposé à souscrire à la vision selon laquelle « le nouveau système vers lequel tend la société moderne "sera une reprise, sous une forme supérieure, d'un type social archaïque". » ([8] [1991]) Marx citait ici, probablement de mémoire, les lignes de Morgan par lesquelles Engels clos L'origine de la famille.
Ce concept de « reprise » à un niveau supérieur est partie intégrante de la pensée dialectique, mais constitue un véritable casse-tête pour la perspective bourgeoise qui nous propose le choix entre une vision linéaire de l'histoire et une idéalisation naïve du passé. A l'époque où Marx écrivait, la tendance dominante de la pensée bourgeoise était un évolutionnisme simpliste dans lequel le passé, et surtout le passé primitif, était rejeté dans un brouillard d'ombre et de superstition infantile, le plus à même de justifier la « civilisation actuelle » et la soumission ou l'extermination des primitifs qui se trouvaient sur son chemin. Aujourd'hui la bourgeoisie continue d'exterminer ce qui reste de peuples primitifs, mais elle n'a plus la même foi inébranlable dans sa mission civilisatrice et il y a une forte contre-tendance, en particulier au sein de la petite-bourgeoisie, vers le « primitivisme », le désire désespéré de retourner au mode de vie primitif, imaginé maintenant comme une sorte de paradis perdu.
Dans ces deux perspectives, il est impossible de voir la société primitive avec lucidité en reconnaissant à la fois sa « grandeur », comme Engels l'a montré, et ses limites : l'absence d'individualité et de liberté réelles dans une communauté dominée par la pénurie ; la restriction de la communauté à la tribu et donc la fragmentation essentielle de l'espèce à cette époque; l'incapacité pour l'espèce humaine, dans ces formations, de se saisir elle-même comme un être actif, créateur, et donc sa soumission aux projections mythiques et aux traditions ancestrales immuables. La vision dialectique est résumée par Engels dans L'origine de la famille : « La puissance de ces communautés primordiales devait être brisée, et elle a été brisée », permettant ainsi à l'humanité de se libérer des limites énumérées ci-dessus. « Mais elle a été brisée par des influences qui, depuis le début, nous apparaissent comme une dégradation, une chute de la grandeur morale simple de l'ancienne société gentilice ». Une chute qui est aussi une avancée ; ailleurs dans la même oeuvre, Engels écrit : « La monogamie a été une grande avancée historique mais en même temps elle a inauguré, de concert avec l'esclavage et le bien-être privé, cette époque, qui dure jusqu'à aujourd'hui, dans laquelle chaque avancée est en même temps une régression relative, dans laquelle le bien être et le développement d'un groupe sont atteint par la misère et la répression de l'autre. » Ce sont là des concepts scandaleux pour le sens commun bourgeois mais, exactement comme « la reprise à un niveau supérieur » qui les complète, ils sont parfaitement sensés du point de vue dialectique qui voit l'histoire avancer à travers le heurt des contradictions.
Il est important de citer Engels à ce propos parce qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'il a dévié de la vision de l'histoire de Marx vers une version de l'évolutionnisme bourgeois. C'est une question plus large que nous devrons aborder ailleurs ; qu'il nous suffise de dire pour le moment que toute une masse de littérature, allant du « marxisme » académique à l'anti-marxisme académique et à diverses tendances du modernisme et du conseillisme, a éclos dans les dernières années pour essayer de prouver le niveau auquel Engels était accusé d'être tombé dans le déterminisme économique, le matérialisme mécanique et même le réformisme, faisant subir une distorsion à la pensée de Marx sur tout un ensemble de questions vitales. L'argument est souvent étroitement lié à l'idée d'une rupture totale de continuité entre la Première et la Deuxième Internationale, conception chère au conseillisme. Mais ce qui est particulièrement significatif à ce propos c'est le fait que Raya Dunayevskaya. à qui Rosemont fait écho, a aussi accusé Engels d'avoir échoué dans la transmission du legs de Marx en transposant les Cahiers ethnologiques dans L'origine de la famille.
D'après Dunayevskaya, le livre de Engels est coupable quand il parle d'une « défaite historique mondiale du sexe féminin » coïncidant avec l'apparition de la civilisation. Pour elle, il s'agit là d'une simplification de la pensée de Marx ; dans les Cahiers, ce dernier dit que les germes de l'oppression des femmes sont déjà en cours de développement dans la stratification de la société barbare, avec le pouvoir croissant des chefs et la transformation, qui en résulte, des conseils tribaux en organes de décision formels, plus que réels. Plus généralement, elle pense que Engels perd de vue la vision dialectique de Marx, réduisant sa vision du développement historique complexe, multilinéaire, en une vision unilinéaire du progrès, à travers des stades définis de façon rigide.
Il est possible que l'utilisation par Engels de la phrase « défaite historique mondiale du sexe féminin » (qu'il a prise à Bachofen plutôt qu'à Marx) donne l'impression d'un événement historique concret et unique au lieu d'un processus très long, qui avait déjà son origine dans la communauté primitive, et en particulier dans les dernières phases de celle-ci. Mais cela ne prouve pas que l'approche fondamentale de Engels dévie de celle de Marx ; tous les deux sont conscients du fait que « la famille, la propriété privée et l'Etat » émergent des contradictions du vieil ordre gentilice. En réalité, dans le cas de l'Etat, Engels a fait des avancées considérables au niveau théorique : les Cahiers eux-mêmes ne contiennent que très peu de matériel brut pour les arguments importants sur l'émergence de l'Etat, contenus dans L'origine de la famille. Et nous avons déjà montré comment, sur ces questions, Engels était complètement d'accord avec Marx sur la vision de l'Etat comme produit d'une longue évolution historique au sein des vieilles communautés.
Nous avons aussi montré que Engels était en accord avec Marx pour réfuter l'évolutionnisme linéaire bourgeois qui ne parvient pas à comprendre le « prix » que l'humanité a payé pour le progrès, et la possibilité de réappropriation, à un niveau supérieur, de ce qui a été « perdu ».
C'est plutôt Dunayevskaya qui ne parvient pas à faire la critique la plus pertinente à la présentation de l'histoire de la société de classe par Engels dans son livre : son échec à intégrer le concept de mode de production asiatique, l'image d'un mouvement rectiligne et universel depuis la société primitive jusqu'à l'esclavage, la féodalité et le capitalisme. Même en tant que description des origines de la civilisation « occidentale », c'est simplificateur, dans la mesure où les sociétés esclavagistes de l'antiquité étaient influencées, sur de nombreux plans, par les formes asiatiques qui les précédaient et étaient contemporaines. L'omission de Engels, ici, ne fait pas que biffer un vaste chapitre de l'histoire de la civilisation, mais elle donne aussi l'impression d'une évolution fixe, unilinéaire, valable pour toutes les parties du globe et, en ce sens, apporte de l'eau au moulin de l'évolutionnisme bourgeois. Plus important encore, son erreur a été exploitée, par la suite, par les bureaucrates staliniens qui étaient directement intéressés à obscurcir toute la conception du despotisme asiatique, dans la mesure où celle-ci prouvait qu'une exploitation de classe peut exister sans aucune forme discernable de propriété privée « individuelle » - et donc que le système stalinien pouvait être considéré lui-même comme un système d'exploitation de classe. Et bien sûr, en tant que penseurs bourgeois, les staliniens se sentaient beaucoup plus sur leur terrain avec une vision linéaire, d'un progrès avançant inexorablement de l'esclavage au féodalisme et au capitalisme, et culminant dans la réussite suprême de l'histoire : le « socialisme réel » de l'URSS. En dépit de cette erreur importante, la tentative d'enfoncer un coin entre Marx et Engels est en contradiction fondamentale avec la longue histoire de collaboration entre eux. En réalité, quand il a été question d'expliquer le mouvement dialectique de l'histoire, et de la nature elle-même, Engels nous a donné certaines des explications les plus claires de toute la littérature marxiste. L'évidence historique et celle des textes donnent peu de base à ce « divorce » entre Marx et Engels. Ceux qui défendent cela se posent souvent en défenseurs radicaux de Marx et en fustigateurs du réformisme. Mais ils finissent généralement par détruire la continuité essentielle du mouvement marxiste.
Marxisme et question coloniale
La défense de la notion de communisme primitif était une défense du projet communiste en général. Mais ce n'était pas seulement le cas au niveau le plus historique et global. Cela avait aussi une signification politique plus concrète et immédiate. Il est nécessaire de rappeler ici le contexte historique dans lequel Marx et Engels ont élaboré leurs travaux sur la question « ethnologique ». Dans les années 1870 et 1880, une nouvelle phase de la vie du capitalisme s'ouvrait. La bourgeoisie venait juste de vaincre la Commune de Paris ; et, si cela ne signifiait pas déjà que tout le système capitaliste était entré dans son époque de sénilité, cela mettait sans aucun doute un terme définitif à la période des guerres nationales dans les centres du capitalisme et, plus généralement, à la période dans laquelle la bourgeoisie pouvait jouer un rôle révolutionnaire sur la scène de l'histoire. Le système capitaliste entrait alors dans sa dernière phase d'expansion et de conquête mondiales, non plus à travers la lutte de classes bourgeoises naissantes, cherchant à établir des Etats nationaux viables, mais à travers la méthode de l'impérialisme, des conquêtes coloniales. Les trois dernières décennies du 19e siècle ont ainsi vu virtuellement la totalité du globe être conquise et partagée entre les grandes puissances impérialistes.
Et partout, les victimes les plus immédiates de cette conquête ont été les « peuples coloniaux » - essentiellement des paysans encore liés aux vieilles formes de production communautaires et de nombreux groupes tribaux. Comme Rosa Luxemburg l'explique, dans son livre L'accumulation du capital : « Le capitalisme a besoin de couches sociales non-capitalistes comme débouchés pour sa plus-value, comme source d'approvisionnement pour ses moyens de production et comme réservoir de main d'oeuvre pour son système de salariat. Pour toutes ces raisons, les formes de production basées sur l'économie naturelle ne sont d'aucune utilité pour le capital. » ([9] [1992])
D'où la nécessité pour le capital de balayer, par tous les moyens militaires et économiques dont il dispose, ces restes de production communiste qu'il rencontre partout dans les territoires nouvellement conquis. Parmi ces victimes du monstre impérialiste, les « sauvages », ceux vivant dans la forme de communisme primitif la plus élémentaire, sont de loin les plus nombreux : comme l'a montré Luxemburg, tandis que les communautés paysannes pouvaient être détruites par le « colonialisme de la marchandise », par les impôts et autres pressions économiques, les chasseurs primitifs ne pouvaient être qu'exterminés ou mis de force au travail parce que, non seulement, ils occupaient de vastes territoires convoités par l'agriculture capitaliste, mais qu'ils ne produisaient pas de plus-value susceptible d'entrer dans le processus de circulation capitaliste.
Les « sauvages » ne se sont pas couchés et soumis à ce processus. L'année avant que Morgan ne publie son étude sur les iroquois, tribu indienne de la partie est des Etats-Unis, les tribus de « l’ouest » ont vaincu Custer à Little Big Horn. Mais la « dernière résistance de Custer » fut en réalité la dernière résistance des indigènes américains contre la destruction définitive de leur ancien mode de vie.
La question de la compréhension de la nature de la société primitive était donc d'une importance politique immédiate pour les communistes dans cette période. D'abord parce que, de même que le christianisme avait été l'excuse idéologique pour les conquêtes coloniales dans la première période de la vie du capitalisme, les théories ethnologiques bourgeoises du 19e siècle étaient souvent utilisées comme justification « scientifiques » de l'impérialisme. C'est la période qui a vu le début des théories racistes sur la Responsabilité de l'Homme Blanc et sur la nécessité d'apporter la civilisation aux sauvages plongés dans les ténèbres. L'ethnologie évolutionniste bourgeoise, qui posait comme principe l'ascension linéaire des sociétés primitives aux sociétés modernes, fournissait une justification plus subtile pour la même « mission civilisatrice ». Ensuite, ces notions commençaient déjà à infiltrer le mouvement ouvrier, bien qu'elles n'aient atteint leur plein épanouissement qu'avec la théorie du « colonialisme socialiste » à la période de la Deuxième Internationale, avec le socialisme « chauvin » de figures telles que Hynderman en Grande-Bretagne. En fait, la question de la politique coloniale devait être une ligne de démarcation claire entre les fractions de droite et de gauche de la social-démocratie, un test d'identité internationaliste, comme dans le cas du Parti Socialiste Italien. ([10] [1993])
Quand Marx et Engels écrivaient sur les questions ethnologiques, ces problèmes ne faisaient que commencer à émerger. Mais les contours de l'avenir prenaient déjà forme. Marx avait déjà compris que la Commune de Paris marquait la fin de la période des guerres nationales révolutionnaires. Il avait reconnu la conquête britannique de l'Inde, la politique coloniale française en Algérie (où il se rendit pour une cure de repos peu avant sa mort), le pillage de la Chine, le massacre des indigènes américains; tout cela montre que son intérêt croissant pour la communauté primitive n'était pas simplement un intérêt « archéologique »; pas plus qu'il se ramenait à la nécessité bien réelle de dénoncer l'hypocrisie et la cruauté de la bourgeoisie et de sa « civilisation ». En fait, cet intérêt était directement lié à la nécessité d'élaborer une perspective communiste pour la période qui s'ouvrait alors. Cela est surtout montré par l'attitude de Marx sur la question russe.
La question russe et la perspective communiste
L'intérêt de Marx pour la question russe ressurgit au début des années 1870. Mais l'aspect le plus curieux du développement de sa pensée sur cette question est fourni par sa réponse à Vera Zassoulitch alors membre de cette fraction du populisme révolutionnaire qui plus tard, avec Plékhanov, Axelrod et d'autres, forma le groupe Emancipation du travail, le premier courant vraiment marxiste en Russie. La lettre de Zassoulitch, datée du 16 février 1881, demandait à Marx de clarifier sa position sur l'avenir de la commune rurale, l'obschina : devait-elle être dissoute par l'avancée du capitalisme en Russie ou était-elle capable, « libérée des impôts exorbitants, des paiements à la noblesse et à une administration arbitraire ..., de se développer dans une direction socialiste, c'est-à-dire d'organiser graduellement sa production et sa distribution sur une base collective. »
Les écrits précédents de Marx tendaient à voir la commune russe comme une source directe de la « barbarie » russe : et dans une réponse au jacobin russe Tkachev (1875), Engels avait souligné la tendance à la dissolution de l'obschina.
Marx passa de nombreuses semaines à réfléchir à sa réponse, qui occupa quatre brouillons séparés, tout ceux qu'il a rejetés étant beaucoup plus longs que la lettre de réponse qu'il envoya finalement. Ces brouillons sont pleins de réflexions importantes sur la commune archaïque et le développement du capitalisme, et montrent explicitement le niveau auquel ses lectures de Morgan l'avaient conduit à repenser certaines suppositions qu'il avait faites auparavant. A la fin, admettant que sa santé défectueuse l'empêchait d'achever une réponse plus élaborée, il résuma sa réflexion, premièrement en rejetant l'idée que sa méthode d'analyse conduisait à la conclusion que chaque pays ou région était mécaniquement condamnée à passer par la phase bourgeoise de production ; et deuxièmement en concluant que « l'étude spéciale que j'en ai faite, y compris une recherche de sources matérielles originales, m'a convaincu que la commune est le pivot de la régénérescence sociale en Russie. Mais pour qu'elle puisse jouer ce rôle, les influences néfastes l'assaillant de tous côtés doivent d'abord être éliminées, et elle doit ensuite être assurée des conditions normales pour un développement spontané. » (8 mars 1881)
Les brouillons de la réponse n'ont été découverts qu'en 1911 et n'ont pas été publiés avant 1924 ; la lettre elle-même a été « enterrée » par les marxistes russes pendant des décennies. Riazanov, qui était responsable de la publication des brouillons, a essayé de trouver des motifs psychologiques à cette « omission » mais il apparaît que les «fondateurs du marxisme russe » n'étaient pas très satisfaits de cette lettre du «fondateur du marxisme ». Une telle interprétation est renforcée par le fait que Marx tendait à soutenir l'aile terroriste du populisme russe, la Volonté du Peuple, contre ce à quoi il faisait référence comme les « doctrines assommantes » du groupe Répartition Noire de Plékhanov et Zassoulitch, même si, comme nous l'avons vu, c'est ce dernier qui a constitué la base du groupe Emancipation du Travail sur un programme marxiste.
Les gauchistes académistes qui sont spécialisés dans l'étude du Marx de la maturité, se sont beaucoup occupés de cette modification de la position de Marx dans les dernières années de sa vie. Shanin, l'éditeur de Marx de la maturité et le chemin de la Russie, la principale compilation de textes sur cette question, voit correctement les brouillons et la lettre finale comme un magnifique exemple de la méthode scientifique de Marx, de son refus d'imposer des schémas rigides à la réalité, de sa capacité à changer d'avis quand les théories précédentes ne correspondent pas aux faits. Mais, comme pour toutes les formes de gauchisme, cette vérité de base est alors déformée au service de fins capitalistes.
Pour Shanin, les interrogations de Marx sur l'idée linéaire, évolutionniste, selon laquelle la Russie devait passer par la phase de développement capitaliste, avant de pouvoir être intégrée au socialisme, prouve que Marx était un maoïste avant Mao ; ce socialisme pourrait être le résultat de révolutions paysannes dans la périphérie. « Tandis que, au niveau de la théorie, Marx allait être "engelsisé" et Engels, par la suite, "kautskisé" et "plékhanovisé" dans un moule évolutionniste, les révolutions se développaient, au tournant du siècle, dans les sociétés arriérées/ « en développement » .- Russie 1905 et 1917, Turquie 1906, Iran 1909, Mexique 1910, Chine 1910 et 1927. Les insurrections paysannes étaient centrales dans la plupart d'entre elles. Aucune n'était une "révolution bourgeoise" au sens ouest-européen et certaines d'entre elles se sont révélées, en fin de compte, être socialistes dans la direction et les résultats. Dans la vie politique des mouvements socialistes du vingtième siècle il y avait un besoin urgent de réviser les stratégies ou de disparaître. Lénine, Mao et Ho ont choisi la première solution. Cela signifiait parler un "double langage" - un pour la stratégie et la tactique, l'autre pour les ersatz conceptuels et de doctrine, au nombre desquels les "révolutions prolétariennes" en Chine ou au Viêt-nam, réalisées par des paysans et des "cadres", sans ouvriers d'industrie, ne sont que des exemples particulièrement dramatiques. » ([11] [1994])
Toutes les rêvasseries sophistiquées de Shanin à propos de la dialectique et de la méthode scientifique révèlent alors leur véritable objet : faire une apologie de la contre-révolution stalinienne dans les pays périphériques du capital et rattacher les horribles distorsions du marxisme, de Mao ou Ho, à rien moins que Marx lui-même.
Des écrivains comme Dunayevskaya et Rosement considèrent le stalinisme comme une forme de capitalisme d'Etat. Mais ils sont pleins d'admiration pour le livre de Shanin : « un travail d'une impeccable érudition qui est aussi une contribution majeure pour la clarification de la perspective révolutionnaire aujourd'hui. » ([12] [1995]). Et cela pour une bonne raison : ces écrivains peuvent ne pas partager l'admiration de Shanin pour Ho, Mao et leurs semblables, mais ils considèrent eux aussi que le coeur de la synthèse du Marx « de la maturité » est la recherche d'un sujet révolutionnaire autre que la classe ouvrière. Pour Rosemont, le Marx de la maturité était «plongé jusqu'au cou dans l'étude d'expériences nouvelles (pour lui) de résistance et de révolte contre l'oppression - par les indiens nord-américains, les aborigènes australiens, les paysans égyptiens et russes » ; et cet intérêt « concerne aussi l'avenir des mouvements révolutionnaires d'aujourd'hui, pleins de promesse dans le tiers-monde, le quart-monde et le notre. » ([13] [1996]) Le « quart-monde » est celui des peuples tribaux restant ; ainsi, les peuples primitifs d'aujourd'hui, comme ceux de l'époque de Marx, font partie d'un nouveau sujet révolutionnaire. Les écrits de Dunayevskaya sont, eux aussi, remplis d'une recherche de nouveaux sujets révolutionnaires et ils sont généralement constitués d'un fatras de catégories comme les femmes, les homosexuels, les ouvriers d'industrie, les noirs et les mouvements de « libération nationale » du tiers-monde.
Mais toutes ces lectures du Marx « de la maturité » sortent ses contributions de leur contexte historique. La période dans laquelle Marx se débattait avec le problème de la communauté archaïque était, comme nous l'avons vu, une période de « transition » dans la mesure où, alors qu'elle montrait la mort future de la société bourgeoise (la Commune de Paris étant le signe avant-coureur de la future révolution prolétarienne), il y avait encore de vastes étendues pour l'expansion du capital à la périphérie. La reconnaissance, par Marx, de la nature ambiguë de cette période est résumée dans une phrase du « second brouillon » de sa réponse à Zassoulitch : « le système capitaliste a dépassé son apogée à l'Ouest, approchant du moment où il ne sera plus qu'un système social régressif. » ([14] [1997])
Dans cette situation, où les symptômes du déclin sont déjà apparents dans le centre du système mais où le système comme un tout continue à s'étendre à une allure extraordinaire, les communistes étaient confrontés à un véritable dilemme. Parce que, comme nous l'avons déjà dit, cette expansion ne peut plus prendre la forme de révolutions bourgeoises contre les féodaux ou d'autres classes dépassées, mais la forme de conquêtes coloniales, d'annexions impérialistes toujours plus violentes, vis-à-vis des zones du globes restées non-capitalistes. Il ne peut pas être question que le prolétariat « soutienne » le colonialisme comme il avait soutenu la bourgeoisie contre la féodalité ; la préoccupation de Marx dans ses investigations sur la question russe était plutôt celle-là : l'humanité pouvait-elle, dans ces zones, s'épargner le passage par l'enfer du développement capitaliste ? Il est certain que rien, dans l'analyse de Marx, ne suggère que chaque pays particulier doive mécaniquement passer par la phase du développement capitaliste avant que la révolution communiste mondiale soit possible ; il avait, en fait, rejeté la déclaration de son critique russe, Mikhailovsky, selon laquelle sa théorie serait « une théorie historico-philosophique du Progrès Universel » ([15] [1998]), et qui insistait sur le fait que le processus par lequel les paysans étaient expropriés et transformés en prolétaires devait inévitablement être le même dans tous les pays. Pour Marx et Engels la question clef était la révolution prolétarienne en Europe, comme Engels l'avait déjà montré dans sa réponse à Tkachev et comme cela avait été rendu parfaitement explicite dans l'introduction à l'édition russe du Manifeste Communiste, publié en 1882. Si la révolution était victorieuse dans les centres industrialisés du capital, alors l'humanité pourrait s'épargner quantité de souffrances sur tout le globe et les formes vestiges de propriété communautaire pourraient être directement intégrées dans le système communiste mondial : « Si la révolution russe devient le signal d'une révolution prolétarienne à l'Ouest, de telle sorte que les deux peuvent se compléter, alors l'actuelle propriété communautaire du sol russe pourra servir de point de départ à un développement communiste. »
C'était une hypothèse parfaitement raisonnable à cette époque. En fait, il est évident aujourd'hui que, si les révolutions prolétariennes de 1917-23 axaient été victorieuses - si la révolution prolétarienne à l'Ouest était venue en aide à la révolution russe -, les terribles ravages du « développement » capitaliste à la périphérie auraient pu être évités, les formes résiduelles de la propriété communautaire auraient pu être intégrées à un communisme global et nous ne serions pas confrontés aujourd'hui à la catastrophe sociale, économique et écologique qui est le lot du « tiers-monde ».
En outre, il y a une bonne part de vision prophétique dans la préoccupation de Marx à propos de la Russie. Déjà, depuis la guerre de Crimée, Marx et Engels avaient la profonde conviction qu'une espèce de soulèvement social était sur le point d'avoir lieu en Russie (ce qui explique en partie leur soutien à La Volonté du Peuple, qu'ils jugeaient comme le plus sincère et le plus dynamique des mouvements révolutionnaires de Russie) ; et que, même s'il ne revêtait pas un caractère clairement prolétarien, il serait indubitablement l'étincelle qui allumerait l'affrontement révolutionnaire général en Europe. ([16] [1999])
Marx se trompait à propos de l'imminence de ce soulèvement. Le capitalisme s'est développé en Russie, même sans l'émergence d'une classe bourgeoise forte et indépendante ; il a en grande partie, même si incomplètement, dissout la communauté paysanne archaïque ; et le principal protagoniste de la véritable révolution russe a été, en fait, la classe ouvrière industrielle. Mais surtout, la révolution en Russie n'a pas éclaté avant que le capitalisme, comme un tout, ne soit devenu un « régime social régressif», c'est-à-dire qu'il soit entré dans sa phase de décadence, réalité démontrée par la guerre de 1914-18.
Néanmoins, le rejet par Marx de la nécessité pour chaque pays de passer mécaniquement par des stades, sa répugnance à soutenir les formes naissantes du capitalisme en Russie, son intuition d'après laquelle un soulèvement social en Russie serait le coup d'envoi de la révolution prolétarienne internationale ; dans tout cela il anticipait brillamment la critique du gradualisme menchevik et du « phasisme » initié par Trotski, continué par les bolcheviks et justifié pratiquement par la révolution d'Octobre.
Dans le même sens, ce n'est pas un hasard si les marxistes russes, qui avaient eu formellement raison en voyant que le capitalisme se développerait en Russie, ont « perdu » la lettre de Marx : la majorité d'entre eux, après tout, furent les pères fondateurs du menchevisme.
Mais, ce qui pour Marx était une série d'anticipations profondes dans une période particulièrement complexe de l'histoire du capitalisme devient, avec les « interprètes » actuels du Marx de la maturité, une apologie a-historique des nouvelles « voies de la révolution » et des nouveaux « sujets révolutionnaires », à une époque où le capitalisme est dans un profond déclin depuis huit décennies. Un des plus clairs indicateurs de ce déclin est précisément la manière suivant laquelle le capitalisme, à la périphérie, a détruit les vieilles économies paysannes, les vestiges de l'ancien système communautaire, sans être capable d'intégrer la masse des paysans sans terre, qui en résultait, au travail productif. La misère, les taudis, les famines et les guerres qui ravagent le « tiers-monde » aujourd'hui sont une conséquence directe de cette limite atteinte par le « développement » capitaliste. En conséquence, il ne peut pas être question aujourd'hui d'utiliser les vestiges de la communauté archaïque comme tremplin pour la production communiste, parce que le capitalisme les a effectivement détruit sans rien mettre d'autre à la place. Et il n'y a pas de nouveau sujet révolutionnaire attendant d'être découvert parmi les paysans ou parmi les restes tragiques de peuples primitifs. L'implacable « progrès » de la décadence, au cours de ce siècle, a au moins rendu plus évident que, non seulement la classe ouvrière est le seul sujet révolutionnaire, mais encore que la classe ouvrière des nations capitalistes les plus développées est la clef de la révolution pour le monde entier.
CDW.
Le prochain article de cette série examinera de plus près la façon dont les fondateurs du marxisme ont traité la question de la «femme ».
[1] [2000] Ancient society, or Researches in the line of Human Progress from Savagery. through Barbarism to Civilisation. H-L. Morgan. London 1877.
[2] [2001] Raya Dunayevskaya était une dirigeante de la tendance Johnson-Forest qui a rompu avec le trotskysme après la deuxième guerre mondiale sur la question du capitalisme d'Etat et de la défense de l'URSS Mais c'était une rupture très partielle qui a conduit Dunayevskaya dans l'impasse du groupe News and Letters. groupe qui a amalgamé de l'hégelianisme, du conseillisme, du féminisme et le vieux gauchisme ordinaire, en un mélange aboutissant à un étrange culte de la personnalité autour des innovations « philosophiques » de Raya. Elle a écrit sur les Cahiers ethnologiques dans son livre RosaLuxemburg, la libération de la femme et la philosophie de la révolution de Marx (New-Jersey, 1981), où elle cherchait à récupérer à la fois Luxemburg et les Cahiers ethnologiques derrière l'Idée de la Libération de la Femme. Rosemont, dont l'article Karl Marx et les iroquois' contient un tas d'éléments intéressants, est un dirigeant du Groupe Surréaliste Américain, qui a défendu certaines positions prolétariennes mais qui, de par sa nature même, a été incapable de faire une critique claire du gauchisme et, encore moins, de l'esprit de rébellion petit-bourgeois duquel il a émergé au début des années 70.
[3] [2002] Les Cahiers ethnologiques de Karl Marx, édités par Lawrence Krader aux Pays-Bas en 1974, p. 128.
[4] [2003] Ibid p. 150.
[5] [2004] Rosement, « Karl Marx et les Iroquois » in Arsenal. Surrealist Subversion, n° 4, 1989.
[6] [2005] Cahiers, p. 115.
[7] [2006] « Brouillons de réponse » à Vera Zassoulitch. in Théodore Shanin. Marx de la maturité et le chemin de la Russie : Marx et la périphérie du capitalisme. New-York 1983. p. 107 et suivantes.
[8] [2007] Ibid p.107.
[9] [2008] Chapitre 27.
[10] [2009] Voir notre brochure sur La Gauche Communiste d'Italie.
[11] [2010] Marx de la maturité et le chemin de la Russie, pp. 24-25.
[12] [2011] Rosemont. Karl Marx et les Iroquois.
[13] [2012] Ibid.
[14] [2013] Karl Marx et le chemin de la Russie, p. 103.
[15] [2014] Lettre à l'éditeur de Otechesvenneye Zapiski, 1878.
[16] [2015] D'après un autre gauchiste académiste cité dans le livre de Shanin. Haruki Wada. Marx et Engels auraient même soutenu la perspective d'une sorte de développement socialiste « séparé » en Russie, basé sur la commune paysanne et plus ou moins indépendant de la révolution ouvrière européenne. Il prétend que la formulation du Manifeste n'est pas défendue dans les brouillons pour Zassoulitch et que ces derniers correspondent plus au point de vue particulier de Engels qu'à celui de Marx. L'indigence de l'argumentation de Wada sur le sujet est déjà exposée dans un autre article du livre - « Marx de la maturité, continuité, contradiction et enseignements », par Derek Sayer et Philip Corrigan. En tout cas comme nous t'avons montré dans notre article de la Revue Internationale n° 72 (« 1848 : Le communisme comme programme politique ») l'idée du socialisme dans un seul pays, même quand il est basé sur une révolution prolétarienne, est complètement étranger à la fois à Marx et à Engels.
Approfondir:
Questions théoriques:
- Communisme [492]
Heritage de la Gauche Communiste:
Revue Internationale no 82 - 3e trimestre 1995
- 3287 reads
Aggravation de la guerre en ex-Yougoslavie : Plus les puissances parlent de paix, plus elles sèment la guerre
- 6668 reads
La barbarie guerrière qui depuis quatre ans répand la mort, la destruction et la misère dans l'ex-Yougoslavie a connu au cours du printemps 1995 un nouvel enfoncement dans l'horreur. Pour la première fois les deux fronts principaux de cette guerre, en Croatie et en Bosnie, après une brève période de moindre intensité guerrière, se sont rallumés simultanément, menaçant d'entraîner un embrasement généralisé sans précédent. Derrière leurs discours « pacifistes » et « humanitaires », les grandes puissances, véritables responsables et instigateurs de la plus sanglante guerre en Europe depuis le deuxième conflit mondial, franchissent de nouvelles étapes dans leur engagement. Les deux plus importantes, par le nombre de soldats déjà envoyés sur place sous l'uniforme de l'ONU, la Grande-Bretagne et la France, ont entrepris d'accroître fortement leur présence, qui plus est, en constituant une force militaire spéciale, la Force de réaction rapide (FRR), dont la spécificité est d'être moins dépendante de l'ONU et plus directement sous le commandement de leurs gouvernements nationaux.
L'épais tissu de mensonges qui recouvre l'action criminelle des principaux impérialismes de la planète dans cette guerre s'est encore déchiré un peu plus, laissant entrevoir le caractère sordide des intérêts et des motifs qui les animent.
Pour les prolétaires, en particulier en Europe, la sourde inquiétude que développe cette boucherie ne doit pas être un sujet de lamentations impuissantes, mais doit développer leur prise de conscience de la responsabilité de leurs propres gouvernements nationaux, de l'hypocrisie des discours que les classes dominantes entretiennent ; prise de conscience du fait que la classe ouvrière des principaux pays industrialisés constitue la seule force capable de mettre un terme à cette guerre, et à toutes les guerres.
Les femmes, les enfants, les vieillards qui, à Sarajevo comme dans tant d'autres villes en ex-Yougoslavie, sont obligés de se terrer dans les caves et les souterrains, sans électricité, sans eau, pour échapper à l'enfer des bombardements et des « snipers », les hommes qui en Bosnie comme en Croatie ou en Serbie sont mobilisés de force pour aller risquer leur vie sur le front ont-ils quelque raison d'espérer en apprenant l'actuel afflux massif de nouveaux « soldats de la paix » vers leur pays ? Les 2 000 marines américains qui accompagnent le porte-avions Roosevelt dépêché en mai dans l'Adriatique, les 4 000 soldats français et britanniques qui ont déjà commencé à débarquer avec des tonnes de nouvelles armes en ex-Yougoslavie, viennent-ils, comme le prétendent leurs gouvernements, pour soulager les souffrances d'une population qui a déjà connu plus de 250 000 morts et 3 millions et demi de personnes « déplacées u pour fait de guerre ?
Les Casques bleus de l'ONU apparaissent comme des bienfaiteurs lorsqu'ils escortent des convois de vivres pour les populations de villes assiégées, lorsqu'ils se présentent comme une force d'interposition entre belligérants. Ils apparaissent comme des victimes lorsque, comme récemment, ils sont pris en otages par une des armées locales. Mais derrière cette apparence se cache en réalité l'action cynique des classes dominantes des grandes puissances qui les commandent, et pour qui la population de l'ex-Yougoslavie n'est que de la chair à canon dans la guerre qui les oppose pour se partager les zones d'influence dans cette partie stratégiquement cruciale de l'Europe. La nouvelle aggravation que vient de connaître cette guerre au cours du printemps dernier en est une flagrante illustration. L'offensive de l'armée croate commencée début mai, en Slavonie occidentale, l'offensive bosniaque déclenchée au même moment juste à la fin de la « trêve u signée en décembre dernier, mais aussi la mascarade des Casques bleus pris en otages par les Serbes de Bosnie, ne sont pas des incidents locaux déterminés par la seule logique des combats sur place, mais des actions préparées et réalisées avec la participation active, sinon l'initiative, des grandes puissances impérialistes.
Comme nous l'avons mis en évidence tout au long des articles consacrés depuis quatre ans dans cette revue à la guerre dans les Balkans, les cinq pays qui constituent le dit «groupe de contact » (Etats-Unis, Russie, Allemagne, France, Grande-Bretagne), entité supposée chercher les moyens de mettre un terme à ce conflit, ont soutenu et soutiennent activement chacune l'un des camps en présence localement. Et l'actuelle recrudescence de la guerre ne peut être comprise en dehors de la logique et de l'action de gangsters à la tête des ces puissances. C'est l'Allemagne, en poussant la Slovénie et la Croatie à proclamer leur indépendance vis-à-vis de l'ancienne confédération yougoslave, qui a fait éclater ce pays et joué un rôle primordial dans le déclenchement de la guerre en 1991. Face à cette poussée de l'impérialisme allemand, ce sont les quatre autres puissances qui ont soutenu et encouragé le gouvernement de Belgrade à mener une contre-offensive. Ce fut la première phase de la guerre, particulièrement meurtrière. Elle aboutit en 1992 à ce que la Croatie vit près d'un tiers de son territoire contrôlé par les armées et les milices Serbes. La France et la Grand-Bretagne, sous couvert de l'ONU, avaient alors envoyé les plus importants contingents de Casques bleus qui, sous prétexte d'empêcher les affrontements, se sont systématiquement employés à assurer le maintien du statu quo en faveur de l'armée serbe. En 1992 le gouvernement des Etats-Unis s'est prononcé pour l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine et a soutenu le secteur musulman de cette province, dans une guerre contre l'armée croate (toujours soutenue par l'Allemagne) et l'armée serbe (soutenue par la GrandeBretagne, la France et la Russie). En 1994, l'administration de Clinton est parvenue à imposer un accord pour la constitution d'une fédération entre la Bosnie et la Croatie contre la Serbie et, à la fin de l'année, sous l'égide de l'exprésident Carier, à obtenir la signature d'une trêve entre la Bosnie et la Serbie. Au début 1995, les principaux fronts en Croatie et en Bosnie semblent donc relativement apaisés. Et Washington ne se prive pas de présenter cet état de choses comme le triomphe de l'action pacificatrice des puissances, en particulier de la sienne. Mais, en réalité, il ne s'agit que d'un répit partiel en vue de permettre le réarmement de la Bosnie, essentiellement par les Etats-Unis, préparant une contre-offensive contre les armées serbes. En effet, après quatre ans de guere, celles-ci, avec l'appui des Etats britannique, français et russe, contrôlent toujours 70 % du territoire de la Bosnie et plus du quart de celui de la Croatie. Le gouvernement de Belgrade lui-même reconnaît que son camp, qui inclut les u Républiques serbes » de Bosnie et de Croatie (Krajina), récemment a réunifiées o, devra reculer. Mais, malgré des négociations où l'on retrouve tous les différends entre puissances, aucun accord n'est atteint. ([1] [2016]) Ce qui ne peut être obtenu par la négociation, le sera donc par la force militaire. Ainsi, ce à quoi nous assistons aujourd'hui n'est rien d'autre que la suite logique, préméditée, d'une guerre où les grandes puissances n'ont cessé de jouer en sous-main un rôle prépondérant.
Et contrairement à ce qu'affirment hypocritement les gouvernements de celles-ci, qui présentent le renforcement actuel de leur piésence dans le conflit comme une action en vue de limiter la violence des nouveaux affrontements, ces derniers sont le produit direct de leur propre action guerrière.
L'invasion d'une partie de la Slavonie occidentale par la Croatie, au début du mois de mai, ainsi que la reprise des combats en divers points du front de 1 200 kilomètres qui oppose le gouvernement de Zagreb aux Serbes de Krajina ; le déclenchement, au même moment, d'une offensive de l'armée bosniaque se déployant au nord de la Bosnie dans l'enclave de Bihac, dans la région du corridor serbe de Brcko et enfin autour de Sarajevo en vue de forcer l'armée serbe à relâcher la pression sur le siège de la ville ; tout cela n'a pas été fait en dehors de la volonté des puissances, encore moins contre une soi-disant volonté pacificatrice de ces dernières. Il est clair que ces actions ont été entreprises avec l'accord et à l'initiative des gouvernements américain et allemand. ([2] [2017])
La mascarade des otages
La réaction du camp adverse n'est pas moins significative de l'engagement des autres puissances : la Grande-Bretagne, la France et la Russie, aux côtés de la Serbie. Mais ici les choses ont été moins apparentes. Parmi les alliés au camp serbe, seule la Russie clame ouvertement son engagement. La France et la Grande-Bretagne ont, par contre, jusqu'à présent, toujours entretenu un discours de a neutralité » dans le conflit. Qui plus est, en de nombreuses occasions, leurs gouvernements ont fait de grandes déclarations d'hostilité aux Serbes. Cela ne les a jamais empêchés de leur prêter main forte sur le terrain militaire comme sur le terrain diplomatique.
On connaît les faits : suite à l'offensive croato-bosniaque, l'armée des Serbes de Bosnie répond par une intensification des bombardements en Bosnie et plus particulièrement sur Sarajevo. L'OTAN, c'est-à-dire essentiellement le gouvernement Clinton, effectue, en représailles, deux bombardements aériens d'un dépôt de munitions près de Pale, la capitale des Serbes de Bosnie. Le gouvernement de Pale riposte en prenant en otage 343 Casques bleus, en majorité français et britanniques, dont quelquesuns sont placés comme o boucliers humains u, enchaînés prés d'objectifs militaires susceptibles d'être bombardés. Immédiatement une grande opération médiatique est mise en place exposant les photos de soldats enchaînés. Les gouvernements français et britannique dénoncent u l'odieuse action terroriste » contre les forces de l'ONU, et en premier lieu contre les pays qui fournissent le plus grand nombre de soldats dans les rangs des Casques bleus: la France et la Grande-Bretagne. Le gouvernement serbe de Milosevic, à Belgrade, se déclare en désaccord avec l'action des Serbes de Bosnie, tout en dénonçant les bombardements de l'OTAN. Mais, rapidement, ce qui au départ pouvait apparaître comme un affaiblissement de l'alliance franco-britannique avec le camp serbe, comme une vérification dans la pratique du rôle o humanitaire u, neutre, non-pro-serbe des forces de l'ONU, va révéler sa réalité : celle d'une imposture, une de plus, qui sert aussi bien les gouvernements serbes que les alliés de la FORPRONU.
Pour les gouvernements de ces deux puissances, la prise en otage de leurs soldats a apporté deux avantages majeurs pour leur action dans cette guerre. Premièrement, de façon immédiate, cela a contraint l'OTAN, c'est-à-dire les Etats-Unis à cesser tout bombardement supplémentaire sur leurs alliés serbes. Au début de la crise, le gouvernement français avait été contraint d'accepter le premier bombardement, mais il avait ouvertement exprimé une vigoureuse désapprobation du second. L'utilisation par le gouvernement serbe des otages comme boucliers, a permis de régler la question de façon immédiate. Deuxièmement, et surtout, la prise d'otages, présentée comme une « insupportable humiliation », a constitué un excellent prétexte pour justifier l'envoi immédiat par les deux pays de milliers de nouveaux soldats en ex-Yougoslavie. La Grande-Bretagne, à elle seule, a annoncé le triplement du nombre de ses soldats en mission.
Le coup a été bien monté. D'un côté, les gouvernements britannique et français, exigeant de pouvoir envoyer sur place de nouveaux renforts pour o sauver l'honneur et la dignité de nos soldats humiliés par les Serbes de Bosnie » ; de l'autre, Karadzic, chef du gouvernement de Pale, justifiant son attitude par la nécessité de protéger ses troupes contre les bombardements de l'OTAN ; au centre, Milosevic, chef du gouvernement de Belgrade, jouant les « médiateurs ». Le résultat fut spectaculaire. Alors que depuis des semaines les gouvernements britannique et français o menaçaient » de retirer leurs troupes de l'ex-Yougoslavie si l'ONU ne leur accordait pas une plus grande indépendance de mouvement et d'action (en particulier la possibilité de se regrouper a pour mieux se défendre »), ils décident d'augmenter massivement leurs effectifs sur place grâce à cette justification. ([3] [2018])
Au début de la mascarade, au moment des premières prises d'otages, la presse suggéra que peut-être certains des otages avaient été torturés. Quelques jours plus tard, lorsque les premiers otages français furent libérés, certains ont livré leur témoignage : « Nous avons fait de la musculation et du tennis de table... On a visité toute la Bosnie, on s'est promenés... (Les Serbes) ne nous considéraient pas- comme des ennemis. » ([4] [2019]) Tout aussi parlante est l'attitude conciliante prise par le commandement français des forces de l'ONU sur place, quelques jours seulement après que le gouvernement français ait crié sur tous les toits qu'il avait donné des a consignes de fermeté » contre les Serbes : « Nous appliquerons strictement les principes du maintien de la paix jusqu'à nouvel avis... Nous pouvons essaver d'établir des contacts avec les Serbes de Bosnie, nous pouvons es-sa - ver d'acheminer l'aide alimentaire, nous pouvons essayer de ravitailler nos troupes. » ([5] [2020]) Le journal français Le Monde s'en offusquait ouvertement : « Tranquillement, tandis que 144 soldats de l'ONU étaient toujours otages des Serbes, la FORPRONU revendiquait solennellement sa paralvsie. » Et de citer un officier de la FORPRONU : « Depuis quelques jours nous sentions une tendance au relâchement. L'émotion provoquée par les images des boucliers humains s'estompe, et nous craignons que nos gouvernements n'aient envie de passer l'éponge, d'éviter l'affrontement. »
Si les Serbes de Bosnie ne considéraient pas les o otages » français « comme des ennemis », si cet officier de la FORPRONU avait l'impression que les gouvernements français et britannique avaient envie o d'éviter l'affrontement » c'est tout simplement parce que, quels que soient les dérapages qui peuvent se produire entre les troupes serbes et celles de l'ONU sur le terrain, leurs gouvernements sont alliés dans cette guerre, et parce que « l'affaire des otages » n'a été qu'un chapitre de plus dans la série des mensonges et des manipulations auxquelles se livrent les classes dominantes pour couvrir leur oeuvre meurtrière et barbare.
La signification de la constitution de la Force de Réaction Rapide
Le résultat principal du coup monté des otages aura été la constitution de la FRR. La définition de la fonction de cc nouveau corps militaire franco-britannique, supposé venir en aide aux forces de l'ONU en ex-Yougoslavie, a varié au cours des semaines où les gouvernements des deux puissances tutélaires se sont attachées à en faire accepter, difficilement, l'existence et le financement par leurs o partenaires » au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. ([6] [2021]) Mais, quels que soient les méandres des formulations diplomatiques employées dans ces débats d'hypocrites, ce qui est important c'est la signification profonde de cette initiative. Sa portée doit être comprise sur deux plans : la volonté des grandes puissances de renforcer leur engagement militaire dans ce conflit, d'une part ; d'autre part, la nécessité pour ces puissances de se dégager, ou du moins de prendre leurs distances par rapport au carcan que constitue, pour leur action, le cadre de la comédie « humanitaire onusienne ».
Les bourgeoisies française et britannique savent que leur prétention à continuer de jouer un rôle comme puissance impérialiste sur la planète, dépend, en grande mesure, de leur capacité à affirmer leur présence dans cette zone, cruciale stratégiquement. Les Balkans, tout comme la zone du Moyen-Orient, constituent un enjeu majeur dans la lutte que se livrent au niveau mondial les grandes puissances. En être absent, c'est renoncer au statut de grande puissance. La réaction du gouvernement allemand, face à la constitution de la FRR, est particulièrement significative de ce souci commun à tous les principaux Etats européens : « L'Allemagne ne pourra plus longtemps demander à ses alliés français et britanniques de faire le sale boulot, tandis qu'elle se réserve les places de spectateur dans l’Adriatique, tout en revendiquant un rôle politique mondial. Elle doit aussi assumer sa part de risque. » ([7] [2022]) Cette déclaration des milieux gouvernementaux de Bonn est particulièrement hypocrite : comme on l'a vu, lé capital allemand a, depuis le début de la guerre en ex-Yougoslavie, largement pris sa part dans le « sale boulot » des grandes puissances dans cette guerre. Elle illustre de plus clairement le véritable esprit qui anime les soi-disant « pacificateurs humanitaires » lorsqu'ils prétendent « venir en aide » à la population civile dans les Balkans.
L'autre aspect important dans la constitution de la FRR est la volonté de la France et de la Grande-Bretagne de se donner les moyens d'assurer plus librement la défense de leurs propres intérêts impérialistes spécifiques. Ainsi, à la fin du mois de mai, un porte-parole du ministère de la défense britannique, interrogé sur la question de savoir si la FRR serait placée sous l'égide de l'ONU, répondait que les « renforts seraient sous le commandement de l'ONU », mais il ajoutait aussitôt : « ils disposeront aussi de leur propre commandement » ([8] [2023]). Au même moment, des officiers français affirmaient que ces forces auraient « leurs propres peintures de guerre et leurs insignes », n'agiraient plus sous le Casque bleu et que leurs engins ne seraient pas obligatoirement peints en blanc. Au moment où nous écrivons, la question de savoir de quelle couleur seront les « peintures de guerre » des soldats de la FRR reste encore dans le flou. Mais, la signification de la constitution de cette nouvelle force militaire est parfaitement claire : les grandes puissances affirment plus clairement qu'auparavant l'autonomie de leur action impérialiste.
Non, la population de l'ex-Yougoslavie, qui subit depuis quatre ans les horreurs de la guerre, n'a rien de positif à attendre de la venue de ces nouvelles « forces de la paix ». Celles-ci ne viennent que pour continuer et intensifier l'action barbare et sanguinaire que les grandes puissances y mènent depuis le début du conflit.
Vers l'extension et l'intensification de la barbarie guerrière
Tous les gouvernements en ex-Yougoslavic se sont dès à présent engagés dans une nouvelle flambée guerrière. Izetbegovic, chef du gouvernement bosniaque, a clairement annoncé l'ampleur de l'offensive que son armée a déclenchée : Sarajcvo ne doit plus passer un hiver assiégée par les armées serbes. Des experts de l'ONU ont estimé qu'une tentative de briser ce siège devrait coûter près de 15 000 morts aux forces bosniaques. Tout aussi clairement, le gouvernement croate a signifié que l'offensive en Slavonie occidentale n'était que le point de départ d'une opération qui doit s'étendre sur tout le front qui l'oppose aux Serbes de Krajina, en particulier sur la côte dalmate. Quant au gouvernement des Serbes de Bosnie, il a déclaré l'état de guerre dans la zone de Sarajcvo et mobilise toute sa population. A la mi juin, alors que les diplomates américains s'attachaient à négocier une reconnaissance de la Bosnie par les gouvernements serbes, Slavisa Rakovic, un des conseillers du gouvernement de Pale, déclarait froidement qu'il était o pessimi.sle à court terme u et qu'il croyait o plus en une recrudescence de la guerre qu'en une possibilité d'aboutissement des négociations, car l'été est idéal pour se battre. » ([9] [2024])
Les Serbes de Bosnie ne se battent et ne se battront évidemment pas seuls. Les « Républiques serbes » de Bosnie et de Krajina viennent de proclamer leur unification. Quant au gouvernement de Belgrade, qui est supposé appliquer un embargo sur les armes vis-à-vis des Serbes de Bosnie, il est connu qu'il n'en a jamais rien été et que, quelles que soient les divergences plus ou moins réelles qui peuvent exister entre les différents partis serbes au pouvoir, leur coopération militaire face aux armées croate et bosniaque sera totale. ([10] [2025])
Mais les antagonismes entre le différents nationalismes de l'ex-Yougoslavie ne suffiraient pas à entretenir et développer la guerre, si les grandes puissances mondiales ne les alimentaient et ne les exacerbaient, si les discours a pacifistes » de ces dernières étaient autre chose que la couverture idéologique de leur propre politique impérialiste. Le pire ennemi de la paix en ex-Yougoslavie n'est autre que la guerre impitoyable à laquelle se livrent les grandes puissances. Celles-ci trouvent toutes, à des degrés divers, un intérêt au maintien de la guerre dans les Balkans. Au delà des positions géo-stratégiques que chacune d'elles défend ou essaie de conquérir_ elles y voient d'abord et avant tout un moyen d'empêcher ou de détruire les alliances des autres puissances concurrentes. « Dans une telle situation d'instabilité, il est plus facile pour chaque puissance de créer des troubles chez ses adversaires, de saboter les alliances qui lui portent ombrage, que de développer pour sa part des alliances solides et assurer une stabilité sur ses terres. »([11] [2026])
Cette guerre a constitué pour le capital allemand ou français un puissant instrument pour briser l'alliance entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, tout comme pour saboter la structure de l'OTAN, instrument de domination du capital américain sur les anciens membres du bloc occidental. Un haut fonctionnaire du Département d'Etat américain le reconnaissait explicitement récemment : « La guerre en Bosnie a créé les pires tensions dans l'OTAN depuis la crise de Suez. » (International Herald Tribune, 13.06.95). Parallèlement, pour Washington, cette guerre constitue un moyen d'entraver la consolidation de l'Union européenne autour de l'Allemagne. Santer, le nouveau président de la commission de l'Union européenne s'en est amèrement plaint, début juin, en commentant l'évolution de la situation dans les Balkans.
L'aggravation actuelle de la barbarie guerrière en Yougoslavie est ainsi la concrétisation de l'avancée de la décomposition capitaliste telle qu'elle exacerbe tous les antagonismes entre fractions du capital, imposant le règne du « chacun pour soi » et du « tous contre tous ».
La guerre comme facteur de prise de conscience du prolétariat
La guerre dans l'ex-Yougoslavie, constitue le conflit le plus sanglant en Europe depuis la dernière guerre mondiale. Depuis un demi-siècle, l'Europe, avait été épargnée par les multiples guerres entre les deux principaux camps impérialistes. Ces affrontements ensanglantaient les zones du « tiers-monde », par luttes de « libération nationale » interposées. L'Europe était demeurée un « havre de paix ». La guerre en ex-Yougoslavie, en mettant fin à cette situation, revêt une importance historique majeure. Pour le prolétariat européen, la guerre est de moins en moins une réalité exotique qui se déroule à des milliers de kilomètres et dont on suit les développements sur les écrans de télévision à l'heure des repas.
Cette guerre n'avait jusqu'à présent que faiblement constitué un facteur de préoccupation dans l'esprit des prolétaires des pays industrialisés d'Europe occidentale. Les bourgeoisies européennes ont su présenter ce conflit comme une autre guerre « éloignée », où les Etats « démocratiques » se doivent de remplir une mission « humanitaire » et « civilisatrice », dans le but de pacifier des « ethnies » qui s'entre-tuent sans raison. Même si quatre ans d'images médiatiques manipulées n'ont pas pu cacher la réalité sordide et sauvage de la guerre, même si dans l'esprit des prolétaires cette guerre apparaît comme une des horreurs qui se développent actuellement sur toute la planète, le sentiment prédominant généralement parmi les exploités a été celui d'une relative indifférence résignée. Sans enthousiasme on s'est efforcé de croire à la réalité des discours officiels sur les « missions humanitaires » des soldats de l'ONU et de l'OTAN.
L'évolution actuelle de ce conflit, avec le changement d'attitude auquel sont contraints les gouvernements des principales puissances impliquées va entraîner un changement cet état d'esprit. Le fait que les gouvernements de France et de Grande-Bretagne décident d'envoyer des milliers de nouveaux soldats sur le terrain, et que ceux-ci soient désormais envoyés non plus seulement comme des représentants d'une organisation internationale comme l'ONU, mais comme des soldats portant l'uniforme et le drapeau de leur patrie, est en train de donner une nouvelle dimension à la guerre et à la façon de la percevoir. La participation active des « Grands » au conflit se dévoile sous son vrai jour. Le voile « humanitaire » dont ils recouvrent leur action se déchire de plus en plus, laissant apparaître la sordide réalité des motivations impérialistes.
L'intensification actuelle de la guerre en ex-Yougoslavie se produit à un moment où les perspectives économiques mondiales connaissent une nouvelle dégradation importante, annonçant de nouvelles attaques sur les conditions d'existence de la classe ouvrière, en particulier dans les pays les plus industrialisés. Guerre et crise économique, barbarie et misère, chaos et paupérisation, plus que jamais la faillite du capitalisme, le désastre qu'entraîne la survie de ce système en décomposition, mettent la classe ouvrière mondiale devant ses responsabilités historiques. Dans ce contexte, la brutale accélération de la guerre en ex-Yougoslavie doit constituer un facteur supplémentaire de prise de conscience de ces responsabilités.
Il revient aux révolutionnaires de contribuer de toute leur énergie au processus de cette prise de conscience dont ils sont un élément indispensable. Ils doivent en particulier mettre en évidence que la compréhension du rôle joué par les grandes puissances dans cette guerre permet de combattre le sentiment d'impuissance que la classe dominante distille depuis le début de celle-ci. Les gouvernements des grandes puissances industrielles et militaires ne peuvent faire la guerre que parce que la classe ouvrière de leur pays le leur permet, en ne parvenant pas encore à y unifier consciemment ses forces contre le capital. C'est le prolétariat des grands pays industrialisés qui, par son expérience historique, par le fait que la bourgeoisie n'y est pas parvenue à l'embrigader suffisamment idéologiquement pour l'envoyer à une nouvelle guerre mondiale, qui est le seul capable de faire obstacle aux guerres et de mettre fin à la la barbarie capitaliste en général. C'est cela que l'aggravation de la guerre en ex-Yougoslavie doit rappeler aux prolétaires.
RV, 19 juin 95
[1] [2027] Il est particulièrement significatif que les négociations avec les différents gouvernements serbes sur la reconnaissance de la Bosnie, soient menées non pas par des représentants bosniaques, mais par des diplomates de Washington. Tout aussi significative de l'engagement des puissances dans cette guerre aux côtés de tel ou tel belligérant, sont les positions défendues par chacune d'entre elles à propos de cette négociation. Un des marchandages proposé au gouvernement de Milosevic est qu'il reconnaisse la Bosnie en échange d'une levée des sanctions économiques internationales qui pèsent toujours sur la Serbie. Mais lorsqu'il s'agit de définir cette levée des sanctions, on retrouve les clivages qui divisent les puissances : pour les Etats-Unis cette levée doit être entièrement conditiomielle et pouvoir être suspendue à tout moment en fonction de chaque action du gouvernement serbe ; pour la France et la Grande-Bretagne, par contre, cette levée doit être garantie pendant une période d'au moins six mois ; pour la Russie, elle doit être inconditionnelle et sans limite de temps.
[2] [2028] Le 6 mars de cette année, un accord militaire a été signé entre le gouvernement de la Croatie et celui des Musulmans de Bosnie en vue de se rc défendre contre l'agresseur commun s. Cependant, cet accord entre la Croatie et la Bosnie, et parallèlement entre les Etats-Unis et l'Allemagne, pour mener une contre-offensive contre les armées serbes ne peut étre que provisoire et circonstanciel. Dans la partie de la Bosnie contrôlée par la Croatie, les deux armées se font face et à tout moment les affrontements peuvent reprendre comme ce fut le cas dans les premières années de la guerre. La situation dans la ville de Mostar, la plus importante de la région, qui fut l'objet d'affrontements particulièrement sanglants entre Croates et Musulmans, est à cet égard éloquente. Bien que supposée vivre sous un gouvernement croato-bosniaque commun, avec une présence active de représentants de IUnion européenne, la ville reste divisée en deux parties bien distinctes et les hommes musulmans, en âge de combattre, sont strictement interdits de séjour dans la partie croate. Mais par ailleurs et surtout, l'antagonisme qui oppose le capital américain au capital allemand en ex-Yougoslavie, comme dans le reste du monde, constitue la principale ligne de fracture dans les tensions inter-impérialistes depuis l'effondrement du bloc de l'Est (voir en particulier, K Tous contre tous N dans Revue internationale n° 80, 1 er trimestre 1995)
[3] [2029] L'exigence de la France et de la Grande-Bretagne que les forces de l'ONU sur place soient regroupées afin de « mieux se défendre contre les Serbes v est, elle aussi, une manceuvre hypocrite. Loin de traduire une action contre les armées serbes, une telle mesure impliquerait l'abandon de la présence des Casques bleus dans presque toutes les enclaves encerclées par celles-ci en Bosnie (à l'exception des trois principales). Cela impliquerait leur laisser toute possibilité de s'en emparer de façon plus définitive, tout en permettant de concentrer K l'aide s des Casques bleus dans les zones les plus importantes.
[4] [2030] Libération, 7.06.95
[5] [2031] Le Monde, 14.0G.95
[6] [2032] La discussion qui a eu lieu à ce propos entre le président français Chirac, lors de son voyage pour le sommet du G7 en juin, et le speaker de la Chambre des représentants des Etats-Unis, Newl Gingrich, fut qualifié de x directe ,u et K musclée ». Le gouvernement russe, n'en a accepté le principe qu'après avoir ouvertement marqué son opposition et sa méfiance.
[7] [2033] Libération, 12.06.95
[8] [2034] Libération, 31.05.95
[9] [2035] Le Monde, 14.06.9 5
[10] [2036] Le gouvernement de Belgrade avait obtenu un allégement de l'embargo économique international à son égard en échange de l'engagement de ne plus fournir des amies au gouvernement de Pale. Mais les salaires des officiers serbes de Bosnie sont, et ont toujours été payés par Belgrade. Celle-ci n'a jamais cessé de fournir en secret des armes aux x frères de Bosnie s et, par exemple, le système de défense radar anti-aérien des deux e Républiques » est toujours resté lié.
[11] [2037] Résolution sur la situation internationale, l le congrès du CCI (publiée dans ce numéro).
Géographique:
- Europe [95]
Questions théoriques:
- Guerre [129]
- Impérialisme [321]
11e Congrès du CCI : Le combat pour la défense et la construction de l'organisation
- 3092 reads
Le CCI vient de tenir son 11e Congrès international. Dans la mesure où les organisations communistes sont une partie du prolétariat, un produit historique de celui-ci de même que partie prenante et facteur actif de son combat pour son émancipation, leur Congrès, qui représente leur instance suprême, est un fait de première importance pour la classe ouvrière. C'est pour cette raison qu'il appartient aux communistes de rendre compte de ce moment essentiel de la vie de leur organisation.
Pendant plusieurs jours, les délégations venues de 12 pays ([1] [2038]) représentant plus d'un milliard et demi d'habitants et surtout les plus grandes concentrations prolétariennes du monde (Europe occidentale et Amérique du nord) ont débattu, tiré des enseignements, tracé des orientations sur les questions essentielles auxquelles est confrontée notre organisation. L'ordre du jour de ce congrès comprenait essentiellement deux points : les activités et le fonctionnement de notre organisation, la situation internationale. ([2] [2039]) Cependant, c'est de très loin le premier point qui a occupé le plus grand nombre de séances et suscité les débats les plus passionnés. Il en a été ainsi parce que le CCI a été confronté à des difficultés organisationnelles de premier plan qui nécessitaient une mobilisation toute particulière de toutes les sections et de tous les militants.
Les problèmes organisationnels dans l'histoire du mouvement ouvrier...
L'expérience historique des organisations révolutionnaires du prolétariat démontre que les questions touchant à leur fonctionnement sont des questions politiques à part entière méritant la plus grande attention, la plus grande profondeur.
Les exemples de cette importance de la question organisationnelle sont nombreux dans le mouvement ouvrier mais on peut plus particulièrement évoquer celui de l'AIT (Association Internationale des Travailleurs, appelée également plus tard 1re Internationale) et celui du 2e congrès du Parti Ouvrier Social Démocrate Russe (POSDR) tenu en 1903.
L'AIT avait été fondée en septembre 1864 à Londres à l'initiative d'un certain nombre d'ouvriers anglais et français. Elle s'était donnée d'emblée une structure de centralisation, le Conseil central qui, après le congrès de Genève en 1866, s'appellera Conseil général. Au sein de cet organe, Marx va jouer un rôle de premier plan puisque c'est à lui qu'il est revenu de rédiger un grand nombre de ses textes fondamentaux comme l'Adresse inaugurale de l'AIT, ses statuts ainsi que l'Adresse sur la Commune de Paris (La guerre civile en France) de mai 1871. Rapidement, l'AIT (« L'Internationale », comme l'appelaient alors les ouvriers) est devenue une « puissance » dans les pays avancés (en premier lieu ceux d'Europe occidentale). Jusqu'à la Commune de Paris de 1871, elle a regroupé un nombre croissant d'ouvriers et a constitué un facteur de premier plan de développement des deux armes essentielles du prolétariat, son organisation et sa conscience. C'est à ce titre, d'ailleurs, qu'elle fera l'objet d'attaques de plus en plus acharnées de la part de la bourgeoisie : calomnies dans la presse, infiltration de mouchards, persécutions contre ses membres, etc. Mais ce qui a fait courir le plus grand danger à l'AIT, ce sont des attaques qui sont venues de certains de ses propres membres et qui ont porté contre le mode d'organisation de l'Internationale elle-même.
Déjà, au moment de la fondation de l'AIT, les statuts provisoires qu'elle s'est donnée sont traduits par les sections parisiennes, fortement influencées par les conceptions fédéralistes de Proudhon, dans un sens qui atténue considérablement le caractère centralisé de l'Internationale. Mais les attaques les plus dangereuses viendront plus tard avec l'entrée dans les rangs de l'AIT de l'« Alliance de la démocratie socialiste », fondée par Bakounine et qui allait trouver un terrain fertile dans des secteurs importants de l'Internationale, du fait des faiblesses qui pesaient encore sur elle et qui résultaient de l'immaturité du prolétariat à cette époque, un prolétariat qui ne s'était pas encore dégagé des vestiges de l'étape précédente de son développement.
« La première phase dans la lutte du prolétariat contre la bourgeoisie est marquée par le mouvement sectaire. Il a sa raison d'être à une époque où le prolétariat n'est pas encore assez développé pour agir comme classe. Des penseurs individuels font la critique des antagonismes sociaux, et en donnent des solutions fantastiques que la masse des ouvriers n'a qu'à accepter, à propager, et à mettre en pratique. Par leur nature même, les sectes formées par ces initiateurs sont abstentionnistes, étrangères à toute action réelle, à la politique, aux grèves, aux coalitions, en un mot à tout mouvement d'ensemble. La masse du prolétariat reste toujours indifférente ou même hostile à leur propagande... Ces sectes, leviers du mouvement à leurs origines, lui font obstacle dès qu'il les dépasse ; alors elles deviennent réactionnaires... Enfin, c'est là l'enfance du mouvement prolétaire, comme l'astrologie et l'alchimie sont l'enfance de la science. Pour que la fondation de l'Internationale fut possible, il fallait que le prolétariat eût dépassé cette phase.
En face des organisations fantaisistes et antagonistes des sectes, l'Internationale est l'organisation réelle et militante de la classe des prolétaires dans tous les pays, liés les uns avec les autres, dans leur lutte commune contre les capitalistes, les propriétaires fonciers et leur pouvoir de classe organisé dans l'Etat. Aussi les statuts de l'Internationale ne connaissent-ils que de simples sociétés "ouvrières" poursuivant toutes le même but et acceptant toutes le même programme qui se limite à tracer les grands traits du mouvement prolétaire et en laisse l'élaboration théorique à l'impulsion donnée par les nécessités de la lutte pratique, et à l'échange des idées qui se fait, dans les sections, admettant indistinctement toutes les convictions socialistes dans leurs organes et leurs congrès.
De même que, dans toute nouvelle phase historique, les vieilles erreurs reparaissent un instant pour disparaître bientôt après ; de même, l'Internationale a vu renaître dans son sein des sections sectaires... » (Les prétendues scissions dans l'Internationale, chapitre IV, circulaire du Conseil général du 5 mars 1872)
Cette faiblesse était particulièrement accentuée dans les secteurs les plus arriérés du prolétariat européen, là où il venait à peine de sortir de l'artisanat et de la paysannerie, notamment dans les pays latins. Ce sont ces faiblesses que Bakounine, qui n'est entré dans l'Internationale qu'en 1868, après l'échec de la « Ligue de la Paix et de la Liberté » (dont il était un des principaux animateurs et qui regroupait des républicains bourgeois), a mises à profit pour essayer de la soumettre à ses conceptions « anarchistes » et pour en prendre le contrôle. L'instrument de cette opération était l'« Alliance de la démocratie socialiste », qu'il avait fondée comme minorité de la « Ligue de la Paix et de la Liberté ». C'était une société à la fois publique et secrète et qui se proposait en réalité de former une internationale dans l'Internationale. Sa structure secrète et la concertation qu'elle permettait entre ses membres devait lui assurer le « noyautage » d'un maximum de sections de l'AIT, celles où les conceptions anarchistes avaient le plus d'écho. En soi, l'existence dans l'AIT de plusieurs courants de pensée n'était pas un problème. ([3] [2040]) En revanche, les agissements de l'Alliance, qui visait à se substituer à la structure officielle de l'Internationale, ont constitué un grave facteur de désorganisation de celle-ci et lui ont fait courir un danger de mort. L'Alliance avait tenté de prendre le contrôle de l'Internationale lors du Congrès de Bâle, en septembre 1869. C'est en vue de cet objectif que ses membres, notamment Bakounine et James Guillaume, avaient appuyé chaleureusement une résolution adminitrative renforçant les pouvoirs du Conseil général. Mais ayant échoué, l'Alliance, qui pour sa part s'était donnée des statuts secrets basés sur une centralisation extrême, ([4] [2041]) a commencé à faire campagne contre la « dictature » du Conseil général qu'elle voulait réduire au rôle « d'un bureau de correspondance et de statistiques » (suivant les termes des alliancistes), d'une « boîte aux lettres » (comme leur répondait Marx). Contre le principe de centralisation exprimant l'unité internationale du prolétariat, l'Alliance préconisait le « fédéralisme », la complète « autonomie des sections » et le caractère non obligatoire des décisions des congrès. En fait, elle voulait pouvoir faire ce qu'elle voulait dans les sections dont elle avait pris le contrôle. C'était la porte ouverte à la désorganisation complète de l'AIT.
C'est à ce danger que devait parer le Congrès de la Haye de 1872 qui a débattu de la question de l'Alliance sur base du rapport d'une commission d'enquête et a finalement décidé l'exclusion de Bakounine ainsi que de James Guillaume, principal responsable de la fédération jurassienne de l'AIT qui se trouvait complètement sous le contrôle de l'Alliance. Ce congrès fut à la fois le point d'orgue de l'AIT (c'est d'ailleurs le seul congrès où Marx se soit rendu, ce qui situe l'importance qu'il lui attribuait) et son chant du cygne du fait de l'écrasement de la Commune de Paris et de la démoralisation qu'il avait provoquée dans le prolétariat. De cette réalité, Marx et Engels étaient conscients. C'est pour cela que, en plus des mesures visant à soustraire l'AIT de la main mise de l'Alliance, ils ont proposé que le Conseil général soit installé à New-York, loin des conflits qui divisaient de plus en plus l'Internationale. C'était aussi un moyen de permettre à l'AIT de mourir de sa belle mort (entérinée par la conférence de Philadelphie de juillet 1876) sans que son prestige ne soit récupéré par les intrigants bakouninistes.
Ces derniers, et les anarchistes ont par la suite perpétué cette légende, prétendaient que Marx et le Conseil général ont obtenu l'exclusion de Bakounine et Guillaume à cause des différences dans la façon d'envisager la question de l'Etat ([5] [2042]) (quand ils n'ont pas expliqué le conflit entre Marx et Bakounine par des questions de personnalité). En somme, Marx aurait voulu régler par des mesures administratives un désaccord portant sur des questions théoriques générales. Rien n'est plus faux.
Ainsi, au Congrès de la Haye, aucune mesure n'a été requise contre les membres de la délégation espagnole qui partageaient la vision de Bakounine, qui avaient appartenu à l'Alliance, mais qui ont assuré ne plus en faire partie. De même, l'AIT « anti-autoritaire » qui s'est formée après le congrès de la Haye avec les fédérations qui ont refusé ses décisions, n'était pas constituée des seuls anarchistes puisqu'on y a retrouvé, à côté de ces derniers, des lassaliens allemands grands défenseurs du « socialisme d'Etat » suivant les propres termes de Marx. En réalité, la véritable lutte au sein de l'AIT était entre ceux qui préconisaient l'unité du mouvement ouvrier (et par conséquent le caractère obligatoire des décisions des congrès) et ceux qui revendiquaient le droit de faire ce que bon leur semblait, chacun dans son coin, condidérant les congrès comme de simples assemblées où l'on devait se contenter « d'échanger des points de vue » mais sans prendre de décisions. Avec ce mode d'organisation informel, il revenait à l'Alliance d'assurer, de façon secrète, la véritable centralisation entre toutes les fédérations, comme il était d'ailleurs explicitement dit dans nombre de correspondances de Bakounine. La mise en oeuvre des conceptions « anti-autoritaires » dans l'AIT constituait le meilleur moyen de la livrer aux intrigues, au pouvoir occulte et incontrôlé de l'Alliance, c'est-à-dire des aventuriers qui la dirigeaient.
Le 2e congrès du POSDR allait être l'occasion d'un affrontement similaire entre les tenants d'une conception prolétarienne de l'organisation révolutionnaire et les tenants d'une conception petite bourgeoise.
Il existe des ressemblances entre la situation du mouvement ouvrier en Europe occidentale du temps de l'AIT et celle du mouvement en Russie au début du siècle. Dans les deux cas nous nous trouvons à une étape d'enfance de celui-ci, le décalage dans le temps s'expliquant par le retard du développement industriel de la Russie. L'AIT avait eu comme vocation de rassembler au sein d'une organisation unie les différentes sociétés ouvrières que le développement du prolétariat faisait surgir. De même, le 2e congrès du POSDR avait comme objectif de réaliser une unification des différents comités, groupes et cercles se réclamant de la Social-Démocratie qui s'étaient développés en Russie et en exil. Entre ces différentes formations, il n'existait pratiquement aucun lien formel après la disparition du comité central qui était sorti du 1er congrès du POSDR en 1897. Dans le 2e congrès, comme dans l'AIT, on a vu donc s'affronter une conception de l'organisation représentant le passé du mouvement, celle des « mencheviks » (minoritaires) et une conception exprimant ses nouvelles exigences, celle des « bolcheviks » (majoritaires) :
- « Sous le nom de "minorité" se sont groupés dans le Parti, des éléments hétérogènes qu'unit le désir conscient ou non, de maintenir les rapports de cercle, les formes d'organisation antérieures au Parti. Certains militants éminents des anciens cercles les plus influents, n'ayant pas l'habitude des restrictions en matière d'organisation, que l'on doit s'imposer en raison de la discipline du Parti, sont enclins à confondre machinalement les intérêts généraux du Parti et leurs intérêts de cercle qui, effectivement, dans la période des cercles, pouvaient coïncider. » (Lénine, Un pas en avant, deux pas en arrière)
D'une façon qui s'est confirmée par la suite (déjà lors de la révolution de 1905 et encore plus, bien entendu, au moment de la révolution de 1917, où les mencheviks se sont placés du côté de la bourgeoisie), la démarche des mencheviks était déterminée par la pénétration, dans la Social-Démocratie russe, de l'influence des idéologies bourgeoises et petites-bourgeoises. En particulier, comme le note Lénine : « Le gros de l'opposition [les mencheviks] a été formé par les éléments intellectuels de notre Parti » qui ont donc constitué un des véhicules des conceptions petites bourgeoises en matière d'organisation. De ce fait, ces éléments « ... lèvent naturellement l'étendard de la révolte contre les restrictions indispensables qu'exige l'organisation, et ils érigent leur anarchisme spontané en principe de lutte, qualifiant à tort cet anarchisme... de revendication en faveur de la "tolérance", etc. » (Lénine, Un pas en avant, deux pas en arrière). Et, de fait, il existe beaucoup de similitudes entre le comportement des mencheviks et celui des anarchistes dans l'AIT (à plusieurs reprises, Lénine parle de « l'anarchisme de grand seigneur » des mencheviks).
C'est ainsi que, comme les anarchistes après le congrès de La Haye, les mencheviks se refusent à reconnaître et à appliquer les décisions du 2e congrès en affirmant que « le congrès n'est pas une divinité » et que « ses décisions ne sont pas sacro-saintes ». En particulier, de la même façon que les bakouninistes entrent en guerre contre le principe de centralisation et la « dictature du conseil général » après qu'ils aient échoué à en prendre le contrôle, une des raisons pour lesquelles les mencheviks, après le congrès, commencent à rejeter la centralisation réside dans le fait que certains d'entre eux ont été écartés des organes centraux qui ont été nommés à celui-ci. On retrouve des ressemblances même dans la façon dont les mencheviks mènent campagne contre la « dictature personnelle » de Lénine, sa « poigne de fer » qui fait écho aux accusations de Bakounine contre la « dictature » de Marx sur le Conseil général.
« Lorsque je considère la conduite des amis de Martov après le congrès, (...) je puis dire seulement que c'est là une tentative insensée, indigne de membres du Parti, de déchirer le Parti... Et pourquoi ? Uniquement parce qu'on est mécontent de la composition des organismes centraux, car objectivement, c'est uniquement cette question qui nous a séparés, les appréciations subjectives (comme offense, insulte, expulsion, mise à l'écart, flétrissure, etc.) n'étant que le fruit d'un amour-propre blessé et d'une imagination malade. Cette imagination malade et cet amour-propre blessé mènent tout droit aux commérages les plus honteux : sans avoir pris connaissance de l'activité des nouveaux centres, ni les avoir encore vus à l'oeuvre, on va répandant des bruits sur leur "carence", sur le "gant de fer" d'Ivan Ivanovitch, sur la "poigne" d'Ivan Nikiforovitch, etc. (...) Il reste à la social-démocratie russe une dernière et difficile étape à franchir, de l'esprit de cercle à l'esprit de parti ; de la mentalité petite-bourgeoise à la conscience de son devoir révolutionnaire ; des commérages et de la pression des cercles, considérés comme moyens d'action, à la discipline. » (« Relation du 2e Congrès du POSDR », Oeuvres, Tome 7)
Avec l'exemple de l'AIT et celui du 2e congrès du POSDR, ont peut voir toute l'importance des questions liées au mode d'organisation des formations révolutionnaires. En effet, c'est autour de ces questions qu'allait se produire en premier lieu une décantation décisive entre, d'un côté, le courant prolétarien et, de l'autre, les courants petits-bourgeois ou bourgeois. Cette importance n'est pas fortuite. Elle découle du fait qu'un des canaux privilégiés par lesquels s'infiltrent au sein de ces formations les idéologies des classes étrangères au prolétariat, bourgeoisie et petite bourgeoisie, est justement celui de leur mode de fonctionnement.
L'histoire du mouvement ouvrier est riche d'autres exemples de ce type. Si nous n'avons évoqué ici que ces deux-là, c'est évidemment pour une question de place mais aussi parce qu'il existe des similitudes importantes, comme nous le verrons plus loin, entre les circonstances historiques de la constitution de l'AIT, du POSDR et du CCI lui-même.
... et dans l'histoire du CCI
Le CCI a déjà été conduit à plusieurs reprises à se pencher avec attention sur ce type de question. Ce fut le cas, par exemple, lors de sa conférence de fondation, en janvier 1975, où il avait examiné la question de la centralisation internationale (voir le « Rapport sur la question de l'organisation de notre courant », Revue internationale n° 1). Un an après, au moment de son premier congrès, notre organisation est revenue là-dessus avec l'adoption de statuts (voir l'article « Les statuts des organisations révolutionnaires du prolétariat », Revue internationale n° 5). Enfin, le CCI, en janvier 1982, a consacré une conférence internationale extraordinaire à cette question suite à la crise qu'il avait traversée en 1981. ([6] [2043]) Face à la classe ouvrière et au milieu politique prolétarien, le CCI ne s'était pas caché des difficultés qu'il avait rencontrées au début des années 1980. C'est ainsi qu'en parlait la résolution adoptée par le 5e Congrès et citée par la Revue internationale n° 35 :
- « Depuis son 4e Congrès (1981), le CCI a connu la crise la plus grave de son existence. Une crise qui, au delà des péripéties particulières de "l'affaire Chénier" ([7] [2044]), a secoué profondément l'organisation, lui a fait frôler l'éclatement, a provoqué directement ou indirectement le départ d'une quarantaine de ses membres, a réduit de moitié les effectifs de sa deuxième section territoriale. Une crise qui s'est traduite par tout un aveuglement, une désorientation comme le CCI n'en avait pas connue depuis sa création. Une crise qui a nécessité, pour être dépassée, la mobilisation de moyens exceptionnels : la tenue d'une Conférence Internationale extraordinaire, la discussion et l'adoption de textes d'orientation de base sur la fonction et le fonctionnement de l'organisation révolutionnaire, l'adoption de nouveaux statuts. »
Une telle attitude de transparence à l'égard des difficultés que rencontrait notre organisation ne correspondait nullement à un quelconque « exhibitionnisme » de notre part. L'expérience des organisations communistes est partie intégrante de l'expérience de la classe ouvrière. C'est pour cela qu'un grand révolutionnaire comme Lénine a pu consacrer tout un livre, Un pas en avant, deux pas en arrière, à tirer les leçons politiques du 2e Congrès du POSDR. C'est pour cela également que nous portons ici à la connaissance de nos lecteurs de larges extraits de la résolution adoptée à l'issue de notre 11e Congrès. En rendant compte de sa vie organisationnelle, le CCI ne fait donc pas autre chose qu'assumer sa responsabilité face à la classe ouvrière.
Evidemment, la mise en évidence par les organisations révolutionnaires de leurs problèmes et discussions internes constituent un plat de choix pour toutes les tentatives de dénigrement dont celles-ci font l'objet de la part de leurs adversaires. C'est le cas aussi et particulièrement pour le CCI. Certes, ce n'est pas dans la presse bourgeoise que l'on trouve des manifestations de jubilation lorsque nous faisons état des difficultés que notre organisation peut rencontrer aujourd'hui, celle-ci est encore trop modeste en taille et en influence parmi les masses ouvrières pour que les officines de propagande bourgeoise aient intérêt a parler d'elle pour essayer de la discréditer. Il est préférable pour la bourgeoisie de faire un mur de silence autour des positions et de l'existence des organisations révolutionnaires. C'est pour cela que le travail de dénigrement de celles-ci et de sabotage de leur intervention est pris en charge par toute une série de groupes et d'éléments parasitaires dont la fonction est d'éloigner des positions de classe les éléments qui s'approchent de celles-ci, de les dégoûter de toute participation au travail difficile de développement d'un milieu politique prolétarien.
L'ensemble des groupes communistes a été confronté aux méfaits du parasitisme, mais il revient au CCI, parce que c'est aujourd'hui l'organisation la plus importante du milieu prolétarien, de faire l'objet d'une attention toute particulière de la part de la mouvance parasitaire. Dans celle-ci on trouve des groupes constitués tels le « Groupe Communiste Internationaliste » (GCI) et ses scissions (comme « Contre le Courant »), le défunt « Communist Bulletin Group » (CBG) ou l'ex-« Fraction Externe du CCI » qui ont tous été constitués de scissions du CCI. Mais le parasitisme ne se limite pas à de tels groupes. Il est véhiculé par des éléments inorganisés, ou qui se retrouvent de temps à autre dans des cercles de discussion éphémères, dont la préoccupation principale consiste à faire circuler toutes sortes de commérages à propos de notre organisation. Ces éléments sont souvent d'anciens militants qui, cédant à la pression de l'idéologie petite-bourgeoise, n'ont pas eu la force de maintenir leur engagement dans l'organisation, qui ont été frustrés que celle-ci n'ait pas « reconnu leurs mérites » à la hauteur de l'idée qu'ils s'en faisaient eux-mêmes ou qui n'ont pas supporté les critiques dont ils ont été l'objet. Il s'agit également d'anciens sympathisants que l'organisation n'a pas voulu intégrer parce qu'elle jugeait qu'ils n'avaient pas la clarté suffisante ou qui ont renoncé à s'engager par crainte de perdre leur « individualité » dans un cadre collectif (c'est le cas, par exemple du défunt « collectif Alptraum » au Mexique ou de « Kamunist Kranti » en Inde). Dans tous les cas, il s'agit d'éléments dont la frustration résultant de leur propre manque de courage, de leur veulerie et de leur impuissance s'est convertie en une hostilité systématique envers l'organisation. Ces éléments sont évidemment absolument incapables de construire quoi que ce soit. En revanche, ils sont souvent très efficaces, avec leur petite agitation et leurs bavardages de concierges pour discréditer et détruire ce que l'organisation tente de construire.
Cependant, ce ne sont pas les grenouillages du parasitisme qui vont empêcher le CCI de faire connaître à l'ensemble du milieu prolétarien les enseignements de sa propre expérience. En 1904, Lénine écrivait, dans la préface de Un pas en avant, deux pas en arrière :
- « Ils [nos adversaires] exultent et grimacent à la vue de nos discussions ; évidemment, ils s'efforceront, pour les faire servir à leurs fins, de brandir tels passages de ma brochure consacrés aux défauts et aux lacunes de notre Parti. Les social-démocrates russes sont déjà suffisamment rompus aux batailles pour ne pas se laisser troubler par ces coups d'épingle, pour poursuivre, en dépit de tout, leur travail d'autocritique et continuer à dévoiler sans ménagement leurs propres lacunes qui seront comblées nécessairement et sans faute par la croissance du mouvement ouvrier. Que messieurs nos adversaires essaient donc de nous offrir, de la situation véritable de leurs propres "partis", une image qui ressemblerait même de loin à celle que présentent les procès-verbaux de notre deuxième congrès ! » (Oeuvres, Tome 7, page 216)
C'est exactement avec le même état d'esprit que nous portons ici à la connaissance de nos lecteurs de larges extraits de la résolution adoptée à l'issue de notre 11e Congrès. Ce n'est pas une manifestation de faiblesse du CCI mais, au contraire, un témoignage de sa force.
Les problèmes affrontés par le CCI dans la dernière période
« Le 11e congrès du CCI l'affirme donc clairement : le CCI se trouvait dans une situation de crise latente, une crise bien plus profonde que celle qui a frappé l'organisation au début des années 80, une crise qui, si la racine des faiblesses n'avait pas été identifiée, risquait d'emporter l'organisation. » (Résolution d'activités, point 1)
« Les causes de la gravité du mal qui risquait d'engloutir l'organisation sont multiples, mais on peut en mettre en évidence les principales :
- le fait que la conférence extraordinaire de janvier 82, destinée à remonter la pente après la crise de 1981, ne soit pas allée jusqu'au bout de l'analyse des faiblesses qui affectaient le CCI ;
- plus encore, le fait que le CCI n'ait pas pleinement intégré les acquis de cette conférence elle-même (...) ;
- le renforcement de la pression destructrice que la décomposition du capitalisme fait peser sur la classe et sur ses organisations communistes.
En ce sens, la seule façon dont le CCI pouvait affronter efficacement le danger mortel qui le menaçait consistait :
- dans l'identification de l'importance de ce danger (...) ;
- dans une mobilisation de l'ensemble du CCI, des militants, des sections et des organes centraux autour de la priorité de la défense de l'organisation ;
- dans la réappropriation des acquis de la conférence de 1982 ;
- dans un approfondissement de ces acquis, sur la base du cadre qu'ils avaient donné. » (Ibid, point 2)
Le combat pour le redressement du CCI a débuté à l'automne 1993 par la mise en discussion dans toute l'organisation d'un texte d'orientation qui rappelait et actualisait les enseignements de 1982 tout en se penchant sur l'origine historique de nos faiblesses. Au centre de notre démarche se trouvaient donc les préoccupations suivantes : la réappropriation des acquis de notre propre organisation et de l'ensemble du mouvement ouvrier, la continuité avec les combats de celui-ci et particulièrement de sa lutte contre la pénétration en son sein des idéologies étrangères, bourgeoises et petites-bourgeoises.
- « Le cadre de compréhension que s'est donné le CCI pour mettre à nu l'origine de ses faiblesses s'inscrivait dans le combat historique mené par le marxisme contre les influences de l'idéologie petite-bourgeoise pesant sur les organisations du prolétariat. Plus précisément, il se référait au combat du Conseil général de l'AIT contre l'action de Bakounine et de ses fidèles, ainsi que de celui de Lénine et des bolcheviks contre les conceptions opportunistes et anarchisantes des mencheviks lors du 2e congrès du POSDR et à la suite de celui-ci. En particulier, il importait pour l'organisation d'inscrire au centre de ses préoccupations, comme l'ont fait les bolcheviks à partir de 1903, la lutte contre l'esprit de cercle et pour l'esprit de parti. Cette priorité du combat était donnée par la nature des faiblesses qui pesaient sur le CCI du fait de son origine dans les cercles apparus dans la foulée de la reprise historique du prolétariat à la fin des années 1960 ; des cercles fortement marqués par le poids des conceptions affinitaires, contestataires, individualistes, en un mot des conceptions anarchisantes, particulièrement marquées par les révoltes étudiantes qui ont accompagné et pollué la reprise prolétarienne. C'est en ce sens que le constat du poids particulièrement fort de l'esprit de cercle dans nos origines était partie prenante de l'analyse générale élaborée depuis longtemps et qui situait la base de nos faiblesses dans la rupture organique des organisations communistes du fait de la contre-révolution qui s'était abattue sur la classe ouvrière à partir de la fin des années 1920. Cependant, ce constat nous permettait d'aller plus loin que les constats précédents et de nous attaquer plus en profondeur à la racine de nos difficultés. Il nous permettait en particulier de comprendre le phénomène, déjà constaté dans le passé mais insuffisamment élucidé, de la formation de clans au sein de l'organisation : ces clans étaient en réalité le résultat du pourrissement de l'esprit de cercle qui se maintenait bien au-delà de la période où les cercles avaient constitué une étape incontournable de la reformation de l'avant-garde communiste. Ce faisant, les clans devenaient, à leur tour, un facteur actif et le meilleur garant du maintien massif de l'esprit de cercle dans l'organisation. » (Ibid, point 4)
Ici, la résolution fait référence à un point du texte d'orientation de l'automne 1993 qui met en évidence la question suivante :
- « En effet, un des graves dangers qui menacent en permanence l'organisation, qui remettent en cause son unité et risquent de la détruire, est la constitution, même si elle n'est pas délibérée ou consciente, de "clans". Dans une dynamique de clan, les démarches communes ne partent pas d'un réel accord politique mais de liens d'amitié, de fidélité, de la convergence d'intérêts "personnels" spécifiques ou de frustrations partagées. Souvent, une telle dynamique, dans la mesure où elle ne se fonde pas sur une réelle convergence politique, s'accompagne de l'existence de "gourous", de "chefs de bande", garants de l'unité du clan, et qui peuvent tirer leur pouvoir soit d'un charisme particulier, pouvant même étouffer les capacités politiques et de jugement d'autres militants, soit du fait qu'ils sont présentés, ou qu'ils se présentent, comme des "victimes" de telle ou telle politique de l'organisation. Lorsqu'une telle dynamique apparaît, les membres ou sympathisants du clan ne se déterminent plus, dans leur comportement ou les décisions qu'ils prennent, en fonction d'un choix conscient et raisonné basé sur les intérêts généraux de l'organisation, mais en fonction du point de vue et des intérêts du clan qui tendent à se poser comme contradictoires avec ceux du reste de l'organisation. »
Cette analyse se basait sur des précédents historiques dans le mouvement ouvrier (par exemple, l'attitude des anciens rédacteurs de l'Iskra, regroupés autour de Martov et qui, mécontents des décisions du 2e congrès du POSDR, avaient formé la fraction des mencheviks) mais aussi sur des précédents dans l'histoire du CCI. Nous ne pouvons entrer en détail dans celle-ci mais nous pouvons affirmer que les « tendances » qu'a connues le CCI (celle qui allait scissionner en 1978 pour former le « Groupe Communiste Internationaliste », la « tendance Chénier » en 1981, la « tendance » qui a quitté le CCI lors de son 6e Congrès pour former la « Fraction Externe du CCI ») correspondaient bien plus à des dynamiques de clan qu'à de réelles tendances basées sur une orientation positive alternative. En effet, le moteur principal de ces « tendances » n'était pas constitué par les divergences que leurs membres pouvaient avoir avec les orientations de l'organisation (ces divergences étaient on ne peut plus hétéroclites, comme l'a démontré la trajectoire ultérieure des « tendances ») mais par un rassemblement des mécontentements et des frustrations contre les organes centraux et par les fidélités personnelles envers des éléments qui se considéraient comme « persécutés » ou insuffisamment reconnus.
Le redressement du CCI
Si l'existence de clans dans l'organisation n'avait plus le même caractère spectaculaire que par le passé, il n'en continuait pas moins à miner sourdement mais dramatiquement le tissu organisationnel. En particulier, l'ensemble du CCI (y compris les militants directement impliqués) a mis en évidence qu'il était confronté à un clan occupant une place de premier plan dans l'organisation et qui, même s'il n'était pas un simple « produit organique des faiblesses du CCI », avait « concentré et cristallisé un grand nombre des caractéristiques délétères qui affectaient l'organisation et dont le dénominateur commun était l'anarchisme (vision de l'organisation comme somme d'individus, approche psychologisante et affinitaire des rapports politiques entre militants et des questions de fonctionnement, mépris ou hostilité envers les conceptions politiques marxistes en matière d'organisation) » (Résolution d'activités, point 5)
C'est pour cela que :
- « La compréhension par le CCI du phénomène des clans et de leur rôle particulièrement destructeur lui a permis en particulier de mettre le doigt sur un grand nombre des dysfonctionnements qui affectaient la plupart des sections territoriales (...). Elle lui a permis également de comprendre les origines de la perte, signalée par le rapport d'activités du 10e congrès, de "l'esprit de regroupement" qui caractérisait les premières années du CCI... » (Ibid, point 5)
Finalement, après plusieurs jours de débats très animés, avec une profonde implication de toutes les délégations et une très grande unité entre elles, le 11e Congrès du CCI a pu parvenir aux conclusions suivantes :
- « ... le congrès constate le succès global du combat engagé par le CCI à l'automne 1993 (...) le redressement, quelquefois spectaculaire, des sections parmi les plus touchées par les difficultés organisationnelles en 1993 (...), les approfondissements provenant de nombreuses parties du CCI (...), tous ces faits confirment la pleine validité du combat engagé, de sa méthode, de ses bases théoriques aussi bien que de ses aspects concrets (...) Le Congrès souligne en particulier les approfondissements réalisés par l'organisation dans la compréhension de toute une série de questions auxquelles se sont confrontées et se confrontent les organisations de la classe : avancées dans la connaissance du combat de Marx et du Conseil général contre l'Alliance, du combat de Lénine et des bolcheviks contre les mencheviks, du phénomène de l'aventurisme politique dans le mouvement ouvrier (représentés notamment par les figures de Bakounine et de Lassalle), porté par des éléments déclassés, ne travaillant pas à priori pour les services de l'Etat capitaliste, mais finalement plus dangereux que les agents infiltrés de celui-ci. » (Ibid, point 10)
« Sur base de ces éléments, le 11e Congrès constate donc que le CCI est aujourd'hui bien plus fort qu'il n'était au précédent congrès, qu'il est incomparablement mieux armé pour affronter ses responsabilités face aux futurs surgissements de la classe, même si, évidemment, il est encore en convalescence » (Ibid, point 11)
Ce constat de l'issue positive du combat mené par l'organisation depuis l'automne 1993 n'a cependant créé aucun sentiment d'euphorie dans le Congrès. Le CCI a appris à se méfier des emballements qui sont bien plus tributaires de la pénétration dans les rangs communistes de l'impatience petite-bourgeoise que d'une démarche prolétarienne. Le combat mené par les organisations et les militants communistes est un combat à long terme, patient, souvent obscur, et le véritable enthousiasme qui habite les militants ne se mesure pas à des envolées euphoriques mais à la capacité de tenir, contre vents et marées, à résister face à la pression délétère que l'idéologie de la classe ennemie fait peser sur leurs têtes. C'est pour cela que le constat du succès qui a couronné le combat de notre organisation au cours de la dernière période ne nous a conduits à nul triomphalisme :
- « Cela ne signifie pas que le combat que nous avons mené soit appelé à cesser. (...) Le CCI devra le poursuivre à travers une vigilance de chaque instant, la détermination d'identifier chaque faiblesse et de l'affronter sans attendre. (...) En réalité, l'histoire du mouvement ouvrier, y compris celle du CCI, nous enseigne, et le débat nous l'a amplement confirmé, que le combat pour la défense de l'organisation est permanent, sans répit. En particulier, le CCI doit garder en tête que le combat mené par les bolcheviks pour l'esprit de parti contre l'esprit de cercle s'est poursuivi durant de longues années. Il en sera de même pour notre organisation qui devra veiller à débusquer et éliminer toute démoralisation, tout sentiment d'impuissance résultant de la longueur du combat. » (Ibid, point 13)
Avant de conclure cette partie sur les questions d'organisation qui ont été discutées lors du congrès, il importe de préciser que les débats menés par le CCI durant un an et demi n'ont donné lieu à aucune scission (contrairement à ce qui s'était passé, par exemple, lors du 6e congrès, ou en 1981). Il en est ainsi parce que, d'emblée, l'organisation s'est retrouvée en accord avec le cadre théorique qui avait été donné pour la compréhension des difficultés qu'elle rencontrait. L'absence de divergences sur ce cadre a permis que ne se cristallise pas une quelconque « tendance » ou même une quelconque « minorité » théorisant ses particularités. Pour une grande part, les discussions ont porté sur comment il convenait de concrétiser ce cadre dans le fonctionnement quotidien du CCI tout en conservant le souci permanent de rattacher ces concrétisations à l'expérience historique du mouvement ouvrier. Le fait qu'il n'y ait pas eu de scission est un témoignage de la force du CCI, de sa plus grande maturité, de la volonté manifestée par la très grande majorité de ses militants de mener résolument le combat pour sa défense, pour assainir son tissu organisationnel, pour dépasser l'esprit de cercle et toutes les conceptions anarchisantes considérant l'organisation comme une somme d'individus ou de petits groupes affinitaires.
Les perspectives de la situation internationale
L'organisation communiste, évidemment, n'existe pas pour elle-même. Elle n'est pas spectateur mais acteur des luttes de la classe ouvrière et sa défense intransigeante vise justement à lui permettre de tenir son rôle. C'est avec cet objectif que le Congrès a consacré une partie de ses débats à l'examen de la situation internationale. Il a discuté et adopté plusieurs rapports sur cette question ainsi qu'une résolution qui en fait la synthèse et qui est publiée dans ce même numéro de la Revue Internationale. C'est pour cela que nous ne nous étendrons pas sur cet aspect des travaux du congrès. Nous nous contenterons d'évoquer ici, et de façon brève, uniquement le dernier des trois aspects de la situation internationale (évolution de la crise économique, conflits impérialistes et rapports de force entre les classes) qui ont été discutés au congrès.
Cette résolution l'affirme clairement :
- « Plus que jamais, la lutte du prolétariat représente le seul espoir d'avenir pour la société humaine. » (point 14)
Cependant, le Congrès a confirmé ce que le CCI avait annoncé dès l'automne 1989 :
- « Cette lutte, qui avait ressurgi avec puissance à la fin des années 1960, mettant un terme à la plus terrible contre-révolution qu'aie connue la classe ouvrière, a subi un recul considérable avec l'effondrement des régimes staliniens, les campagnes idéologiques qui l'ont accompagné et l'ensemble des événements (guerre du Golfe, guerre en Yougoslavie, etc.) qui l'ont suivi. » (Ibid)
Et c'est principalement pour cette raison qu'aujourd'hui :
- « C'est de façon sinueuse, avec des avancées et des reculs, dans un mouvement en dents de scie que se développent les luttes ouvrières. » (Ibid)
Cependant, la bourgeoisie sait très bien que l'aggravation de ses attaques contre la classe ouvrière ne pourra qu'impulser de nouveaux combats de plus en plus conscients. Elle s'y prépare en développant toute une série de manœuvres syndicales de même qu'en confiant à certains de ses agents le soin de renouer avec des discours encensant la « révolution », le « communisme » ou le « marxisme ». C'est pour cela que :
- « Il appartient aux révolutionnaires, dans leur intervention, de dénoncer avec la plus grande vigueur aussi bien les manoeuvres crapuleuses des syndicats que ces discours prétendument "révolutionnaires". Il leur revient de mettre en avant la véritable perspective de la révolution prolétarienne et du communisme comme seule issue pouvant sauver l'humanité et comme résultat ultime des combats ouvriers. » (point 17)
Après avoir reconstitué et rassemblé ses forces, le CCI est à nouveau prêt, à la suite de son 11e Congrès, pour assumer cette responsabilité.
[2] [2046]. Il était également prévu un point sur l'examen du milieu politique prolétarien qui constitue une préoccupation permanente de notre organisation. Faute de temps, il a dû être supprimé mais cela ne signifie nullement que nous relâchions notre attention sur cette question. Bien au contraire : c'est en ayant surmonté nos propres difficultés organisationnelles que nous pourrons apporter notre meilleure contribution au développement de l'ensemble du milieu prolétarien.
[3] [2047]. « Les sections de la classe ouvrière dans les divers pays se trouvant placées dans des conditions diverses de développement, il s'ensuit nécessairement que leurs opinions théoriques, qui reflètent le mouvement réel, sont aussi divergentes. Cependant, la communauté d'action établie par l'Association internationale des travailleurs, l'échange des idées facilité par la publicité faite par les organes des différentes sections nationales, enfin les discussions directes aux congrès généraux, ne manqueront pas d'engendrer graduellement un programme théorique commun. » (Réponse du Conseil général à la demande d'adhésion de l'Alliance, 9 mars 1869). Il faut noter que l'Alliance avait déposé une première demande d'adhésion avec des statuts où il était prévu qu'elle se dotait d'une structure internationale parallèle à celle de l'AIT (avec un comité central et la tenue d'un congrès dans un local séparé lors des congrès de l'AIT). Le Conseil général avait refusé cette demande en faisant valoir que les statuts de l'Alliance étaient contraires à ceux de l'AIT. Il avait précisé qu'il était prêt à admettre les différentes sections de l'Alliance si celle-ci renonçait à sa structure internationale. L'Alliance avait accepté cette condition mais elle s'était maintenue conformément à ses statuts secrets.
Vie du CCI:
- Défense de l'organisation [2052]
Conscience et organisation:
Heritage de la Gauche Communiste:
11e congrès du CCI : Résolution sur la situation internationale
- 2545 reads
1) La reconnaissance par les communistes du caractère historiquement limité du mode de production capitaliste, de la crise irréversible dans laquelle ce système est plongé aujourd'hui, constitue la base de granit sur laquelle se fonde la perspective révolutionnaire du combat du prolétariat. En ce sens, toutes les tentatives, comme celles que l'on voit à l'heure actuelle, de la part de la bourgeoisie et de ses agents pour accréditer que l'économie mondiale « sort de la crise » ou que certaines économies nationales « émergentes » pourront prendre le relais des vieux secteurs économiques essoufflés, constituent une attaque en règle contre la conscience prolétarienne.
2) Les discours officiels sur la « reprise » font grand cas de l'évolution des indices de la production industrielle ou du redressement des profits des entreprises. Si effectivement, en particulier dans les pays anglo-saxons, on a assisté récemment à de tels phénomènes, il importe de mettre en évidence les bases sur lesquelles ils se fondent :
- le retour des profits découle bien souvent, notamment pour beaucoup de grandes entreprises, des bénéfices spéculatifs ; il a comme contrepartie une nouvelle flambée des déficits publics ; il résulte enfin de l'élimination par les entreprises des « branches mortes », c'est-à-dire de leurs secteurs les moins productifs ;
- le progrès de la production industrielle résulte pour une bonne partie d'une augmentation très importante de la productivité du travail basée sur une utilisation massive de l'automatisation et de l'informatique.
C'est pour ces raisons qu'une des caractéristiques majeures de la « reprise » actuelle, c'est qu'elle n'a pas été capable de créer des emplois, de faire reculer le chômage de façon significative de même que le travail précaire qui, au contraire, n'a fait que s'étendre, car le capital veille en permanence à garder les mains libres pour pouvoir jeter à la rue, à tout instant, la force du travail excédentaire.
3) S'il constitue avant tout une attaque contre la classe ouvrière, un facteur brutal de développement de la misère et de l'exclusion, le chômage constitue aussi un indice de premier plan de la faillite du capitalisme. Le capital vit de l'exploitation du travail vivant : au même titre que la mise au rebut de pans entiers de l'appareil industriel, et plus encore, la mise sur la touche d'une proportion considérable de la force de travail constitue une réelle automutilation de la part du capital. Il rend compte de la faillite définitive du mode de production capitaliste dont la fonction historique était justement d'étendre le salariat à l'échelle mondiale. Cette faillite définitive du capitalisme, elle s'illustre également dans l'endettement dramatique des Etats qui a connu, au cours des dernières années, une nouvelle flambée : entre 1989 et 1994, la dette publique est passée de 53% à 65% du produit intérieur brut aux Etats-Unis, de 57% à 73% en Europe jusqu'à atteindre 142% dans le cas de la Belgique. En fait, les Etats capitalistes sont en cessation de paiement. S'ils étaient soumis aux mêmes lois que les entreprises privées, ils seraient déjà déclarés officiellement en faillite. Cette situation ne fait qu'exprimer le fait que le capitalisme d'Etat constitue la réponse que le système oppose à son impasse, mais une réponse qui n'est en aucune façon une solution et qui ne peut servir éternellement.
4) Les taux de croissance, quelques fois à deux chiffres, des fameuses « économies émergentes » ne viennent nullement contredire le constat de faillite générale de l'économie mondiale. Ils résultent d'une arrivée massive de capitaux attirés par le coût incroyablement bas de la force de travail dans ces pays, d'une exploitation féroce des prolétaires, de ce que la bourgeoisie pudiquement appelle les « délocalisations ». Cela signifie que ce développement économique ne peut qu'affecter la production des pays les plus avancés, dont les Etats, de façon croissante, se dressent contre les « pratiques commerciales déloyales » de ces pays « émergents ». En outre, les performances spectaculaires qu'on se plaît à y relever recouvrent bien souvent un délabrement de secteurs entiers de l'économie de ces pays : le « miracle économique » de la Chine signifie plus de 250 millions de chômeurs en l'an 2000. Enfin, le récent effondrement financier d'un autre pays « exemplaire », le Mexique, dont la monnaie a perdu la moitié de sa valeur du jour au lendemain, qui a nécessité l'injection d'urgence de près de 50 milliards de $ de crédits (de très loin la plus grande opération de « sauvetage » de l'histoire du capitalisme) résume la réalité du mirage que constitue « l'émergence » de certains pays du tiers-monde. Les économies « émergentes » ne sont pas la nouvelle espérance de l'économie mondiale. Elles ne sont que des manifestations, aussi fragiles qu'aberrantes, d'un système en folie. Et cette réalité ne sera pas contredite par la situation des pays d'Europe de l'Est, dont l'économie était sensée, il y a peu encore, s'épanouir au soleil du libéralisme. Si quelques pays (comme la Pologne) réussissent pour le moment à sauver les meubles, le chaos qui déferle sur l'économie de la Russie (chute de près de 30% de la production sur 2 ans, plus de 2000% de hausse des prix sur cette même période) vient illustrer de façon saisissante à quel point les discours qu'on avait entendus en 1989 étaient mensongers. L'état de l'économie russe est tellement catastrophique, que la Mafia qui en contrôle une bonne partie des rouages, fait figure, non pas de parasite comme c'est le cas dans certains pays occidentaux, mais comme un des piliers lui assurant un minimum de stabilité.
5) Enfin, l'état de faillite potentielle dans lequel se trouve le capitalisme, le fait qu'il ne peut vivre éternellement en tirant des traites sur l'avenir, en essayant de contourner la saturation générale et définitive des marchés par une fuite en avant dans l'endettement, fait peser des menaces de plus en plus fortes sur l'ensemble du système financier mondial. L'émoi provoqué par la faillite de la banque britannique Barings suite aux acrobaties d'un « golden boy », l'affolement qui a suivi l'annonce de la crise du peso mexicain, sans commune mesure avec le poids de l'économie du Mexique dans l'économie mondiale, sont des indices indiscutable de la véritable angoisse qui étreint la classe dominante devant la perspective d'une « véritable catastrophe mondiale » de ses finances, suivant les mots du directeur du FMI. Mais cette catastrophe financière n'est pas autre chose que le révélateur de la catastrophe dans laquelle est plongé le mode de production capitaliste lui-même et qui précipite le monde entier dans les convulsions les plus considérables de son histoire.
6) Le terrain sur lequel se manifestent le plus cruellement ces convulsions est celui des affrontements impérialistes. Cinq ans à peine se sont écoulés depuis l'effondrement du bloc de l'Est, depuis les promesses d'un « nouvel ordre mondial » tenues par les dirigeants des principaux pays d'Occident, et jamais le désordre des relations entre Etats n'a été aussi flagrant. S'il était basé sur la menace d'un affrontement terrifiant entre superpuissances nucléaires, si ces deux superpuissances n'avaient de cesse de s'affronter par pays interposés, « l'ordre de Yalta » contenait un certain élément « d'ordre », justement. En l'absence de possibilité d'une nouvelle guerre mondiale du fait du non embrigadement du prolétariat des pays centraux, les deux gendarmes du monde veillaient à maintenir dans un cadre « acceptable » les affrontements impérialistes. Il leur fallait notamment éviter qu'ils ne viennent semer le chaos et les destructions dans les pays avancés et particulièrement sur le terrain principal des deux guerres mondiales, l'Europe. Cet édifice a volé en éclats. Avec les affrontements sanglants dans l'ex-Yougoslavie, l'Europe a cessé d'être un « sanctuaire ». En même temps, ces affrontements ont mis en évidence combien était désormais difficile que se mette en place un nouvel « équilibre », un nouveau « partage du monde » succédant à celui de Yalta.
7) Si l'effondrement du bloc de l'Est était pour une bonne part imprévisible, la disparition de son rival de l'Ouest ne l'était nullement. Il fallait ne rien comprendre au marxisme (et admettre la thèse kautskyste, balayée par les révolutionnaires dès la première guerre mondiale, d'un « super-impérialisme ») pour penser qu'il pourrait se maintenir un seul bloc. Fondamentalement, toutes les bourgeoisies sont rivales les unes des autres. Cela se voit clairement dans le domaine commercial où domine « la guerre de tous contre tous ». Les alliances diplomatiques et militaires ne sont que la concrétisation du fait qu'aucune bourgeoisie ne peut faire prévaloir ses intérêts stratégiques seule dans son coin contre toutes les autres. L'adversaire commun est le seul ciment de telles alliances, et non une quelconque « amitié entre les peuples » dont on peut voir aujourd'hui à quel point elles sont élastiques et mensongères alors que les ennemis d'hier (comme la Russie et les Etats-Unis) se sont découvert une soudaine « amitié » et que les amitiés de plusieurs décennies (comme celle entre l'Allemagne et les Etats-Unis) font place à la brouille. En ce sens, si les événements de 1989 signifiaient la fin du partage du monde issu de la seconde guerre mondiale, la Russie cessant définitivement de pouvoir diriger un bloc impérialiste, ils portaient avec eux la tendance à la reconstitution de nouvelles constellations impérialistes. Cependant, si sa puissance économique et sa localisation géographique désignaient l'Allemagne comme seul pays pouvant succéder à la Russie dans le rôle de leader d'un éventuel futur bloc opposé aux Etats-Unis, sa situation militaire est très loin de lui permettre dès à présent de réaliser une telle ambition. Et en l'absence d'une formule de rechange des alignements impérialistes pouvant succéder à ceux qui ont été balayés par les bouleversements de 1989, l'arène mondiale est soumise comme jamais par le passé, du fait de la gravité sans précédent de la crise économique qui attise les tensions militaires, au déchaînement du « chacun pour soi », d'un chaos que vient aggraver encore la décomposition générale du mode de production capitaliste.
8) Ainsi la situation résultant de la fin des deux blocs de la « guerre froide » est dominée par deux tendances contradictoires - d'un côté, le désordre, l'instabilité dans les alliances entre Etats et de l'autre le processus de reconstitution de deux nouveaux blocs - mais qui sont néanmoins complémentaires puisque la deuxième ne vient qu'aggraver la première. L'histoire de ces dernières années l'illustre de façon claire :
- la crise et la guerre du Golfe de 90-91, voulues par les Etats-Unis, participent de la tentative du gendarme américain de maintenir sa tutelle sur ses anciens alliés de la guerre froide, tutelle que ces derniers sont conduits à remettre en cause avec la fin de la menace soviétique ;
- la guerre en Yougoslavie est le résultat direct de l'affirmation des nouvelles ambitions de l'Allemagne principal instigateur de la sécession slovène et croate qui met le feu aux poudres dans la région ;
- la poursuite de cette guerre sème la discorde aussi bien dans le couple franco-allemand, associé dans le leadership de l'Union européenne (qui constitue une première pierre de l'édifice d'un potentiel nouveau bloc impérialiste), que dans le couple anglo-américain, le plus ancien et le plus fidèle que le 20e siècle ait connu.
9) Plus encore que les coups de bec entre le coq français et l'aigle allemand, l'ampleur des infidélités actuelles dans le mariage vieux de 80 ans entre la Blanche Albion et l'oncle Sam constitue un indice irréfutable de l'état de chaos dans lequel se trouve aujourd'hui le système des relations internationales. Si, après 1989, la bourgeoisie britannique s'était montrée dans un premier temps la plus fidèle alliée de sa consoeur américaine, notamment au moment de la guerre du Golfe, le peu d'avantages qu'elle avait retiré de cette fidélité de même que la défense de ses intérêts spécifiques en Méditerranée et dans les Balkans, qui lui dictait une politique pro-Serbe, l'ont conduite à prendre des distances considérables avec son alliée et à saboter systématiquement la politique américaine de soutien à la Bosnie. Avec cette politique, la bourgeoisie britannique a réussi à mettre en oeuvre une solide alliance tactique avec la bourgeoisie française avec comme objectif de renforcer la discorde dans le tandem franco-allemand, démarche à laquelle cette dernière s'est complaisamment prêtée dans la mesure où la montée en puissance de son alliée allemande lui crée des inquiétudes. Cette situation nouvelle s'est notamment concrétisée par une intensification de la collaboration militaire entre les bourgeoisies britannique et française, par exemple avec le projet de création d'une unité aérienne commune et surtout avec l'accord créant une force inter-africaine « de maintien de la paix et de prévention des crises en Afrique » qui constitue un revirement spectaculaire de l'attitude britannique après son soutien à la politique américaine au Rwanda visant à chasser l'influence française dans ce pays.
10) Cette évolution de l'attitude de la Grande-Bretagne envers son grand allié, dont le mécontentement s'est exprimé notamment le 17 mars à travers l'accueil par Clinton de Jerry Addams, le chef du Sinn Fein irlandais, est un des événements majeurs de la dernière période sur l'arène mondiale. Il est révélateur de l'échec que représente pour les Etats-Unis l'évolution de la situation dans l'ex-Yougoslavie où l'occupation directe du terrain par les armées britanniques et françaises sous l'uniforme de la FORPRONU a contribué grandement à déjouer les tentatives américaines de prendre position solidement dans la région via son allié bosniaque. Il est significatif du fait que la première puissance mondiale éprouve de plus en plus de difficultés à jouer son rôle de gendarme du monde, rôle que supportent de moins en moins les autres bourgeoisies qui tentent d'exorciser le passé où la menace soviétique les obligeait à se soumettre aux diktats venus de Washington. Il existe aujourd'hui un affaiblissement majeur, voire une crise du leadership américain qui se confirme un peu partout dans le monde et dont le départ piteux des GI's de Somalie, 2 ans après leur arrivée spectaculaire et médiatique, donne une image. Cet affaiblissement du leadership des Etats-Unis permet d'expliquer pourquoi certaines autres puissances se permettent de venir les narguer dans leur pré-carré d'Amérique latine :
- tentative des bourgeoisies française et espagnole de promouvoir une « transition démocratique » à Cuba AVEC Castro, et non SANS lui, comme le voudrait l'Oncle Sam ;
- rapprochement de la bourgeoisie péruvienne avec le Japon, confirmée avec la réélection récente de Fujimori ;
- soutien de la bourgeoisie européenne, notamment par le biais de l'Eglise, à la guérilla zapatiste du Chiapas, au Mexique.
11) En réalité, cet affaiblissement majeur du leadership américain exprime le fait que la tendance dominante, à l'heure actuelle, n'est pas tant celle à la constitution d'un nouveau bloc, mais bien le « chacun pour soi ». Pour la première puissance mondiale, dotée d'une supériorité militaire écrasante, il est beaucoup plus difficile de maîtriser une situation marquée par l'instabilité généralisée, la précarité des alliances dans tous les coins de la planète, que par la discipline obligée des Etats sous la menace des mastodontes impérialistes et de l'apocalypse nucléaire. Dans une telle situation d'instabilité, il est plus facile pour chaque puissance de créer des troubles chez ses adversaires, de saboter les alliances qui lui portent ombrage, que de développer pour sa part des alliances solides et s'assurer une stabilité sur ses terres. Une telle situation favorise évidemment le jeu des puissances de second plan dans la mesure même où il est toujours plus facile de semer le trouble que de maintenir l'ordre. Et une telle réalité est encore accentuée par la plongée de la société capitaliste dans la décomposition généralisée. C'est pour cela que les Etats-Unis eux-mêmes sont appelés à user abondamment de ce type de politique. C'est comme cela qu'on peut expliquer, par exemple, le soutien américain à la récente offensive turque contre les nationalistes kurdes dans le Nord de l'Irak, offensive que l'allié traditionnel de la Turquie, l'Allemagne a considérée comme une provocation et a condamnée. Il ne s'agit pas d'une sorte de « renversement d'alliance » entre la Turquie et l'Allemagne, mais d'une pierre (de grosse taille) jetée par les Etats-Unis dans le jardin de cette « alliance » et qui révèle l'importance de l'enjeu que représente pour les deux caïds impérialistes un pays comme la Turquie. De même, il est significatif de la situation mondiale actuelle que les Etats-Unis soient amenés à employer, dans un pays comme l'Algérie par exemple, les mêmes armes qu'un Khaddafi ou un Khomeiny : le soutien du terrorisme et de l'intégrisme islamique. Cela dit, dans cette pratique réciproque de déstabilisation des positions respectives entre les Etats-Unis et les autres pays, il n'y a pas un trait d'égalité : si la diplomatie américaine peut se permettre d'intervenir dans le jeu politique intérieur de pays comme l'Italie (soutien à Berlusconi), l'Espagne (scandale du GAL attisé par Washington), la Belgique (affaire Augusta) ou la Grande-Bretagne (opposition des « euro-sceptiques » à Major), le contraire ne saurait exister. En ce sens, le trouble qui peut se manifester au sein de la bourgeoisie américaine face à ses échecs diplomatiques ou aux débats internes sur des choix stratégiques délicats (par exemple vis-à-vis de l'alliance avec la Russie) n'a rien à voir avec les convulsions politiques pouvant affecter les autres pays. C'est ainsi, par exemple, que les dissensions étalées lors de l'envoi de 30 000 GI's à Haïti relevaient non de réelles divisions mais essentiellement d'un partage des tâches entre cliques bourgeoises accentuant les illusions démocratiques et qui a facilité l'arrivée d'une majorité républicaine au Congrès américain souhaitée par les secteurs dominants de la bourgeoisie.
12) Malgré leur énorme supériorité militaire et le fait que celle-ci ne puisse pas leur servir au même degré que par le passé, malgré qu'ils soient obligés de réduire quelque peu leurs dépenses de défense face à leurs déficits budgétaires, les Etats-Unis n'en renoncent pas moins à poursuivre la modernisation de leurs armements en faisant appel à des armes toujours plus sophistiquées, notamment en poursuivant le projet de « la guerre des étoiles ». L'emploi de la force brute, ou sa menace, constitue le moyen essentiel pour la puissance américaine de faire respecter son autorité (même si elle ne se prive pas d'employer les moyens de la guerre économique : pressions sur les institutions internationales comme l'OMC, sanctions commerciales, etc.). Que cette carte s'avère impuissante, voire facteur d'un chaos plus grand encore, comme on l'a vu dès le lendemain de la guerre du Golfe et comme la Somalie l'a illustré encore récemment, ne fait que confirmer le caractère insurmontable des contradictions qui assaillent le monde capitaliste. Le renforcement considérable auquel on assiste aujourd'hui du potentiel militaire de puissances comme la Chine et le Japon, qui viennent concurrencer les Etats-Unis dans l'Asie du sud-est et dans le Pacifique, ne peut évidemment que pousser ce dernier pays vers le développement et l'emploi de ses armements.
13) Le chaos sanglant dans les rapports impérialistes qui caractérise la situation du monde d'aujourd'hui, trouve dans les pays de la périphérie son terrain de prédilection, mais l'exemple de l'ex-Yougoslavie à quelques centaines de kilomètres des grandes concentrations industrielles d'Europe fait la preuve que ce chaos se rapproche des pays centraux. Aux dizaines de milliers de morts provoqués par les troubles en Algérie ces dernières années, au million de cadavres des massacres du Rwanda font pièce les centaines de milliers de tuées en Croatie et en Bosnie. En fait, c'est aujourd'hui par dizaines que se comptent les zones d'affrontements sanglants de par le monde en Afrique, en Asie, en Amérique latine, en Europe, témoignant de l'indicible chaos que le capitalisme en décomposition engendre dans la société. En ce sens, la complicité a peu près générale qui entoure les massacres perpétrés en Tchétchénie par l'armée russe, qui tente de freiner l'éclatement de la Russie faisant suite à la dislocation de l'ancienne URSS, sont révélateurs de l'inquiétude qui saisit la classe dominante devant la perspective de l'intensification de ce chaos. Il faut l'affirmer clairement : seul le renversement du capitalisme par le prolétariat peut empêcher que ce chaos croissant n'aboutisse à la destruction de l'humanité.
14) Plus que jamais, la lutte du prolétariat représente le seul espoir d'avenir pour la société humaine. Cette lutte, qui avait resurgi avec puissance à la fin des années 60, mettant un terme à la plus terrible contre-révolution qu'ai connue la classe ouvrière, a subi un recul considérable avec l'effondrement des régimes staliniens, les campagnes idéologiques qui l'ont accompagné et l'ensemble des événements (guerre du Golfe, guerre en Yougoslavie, etc.) qui l'ont suivi. C'est sur les deux plans de sa combativité et de sa conscience que la classe ouvrière a subi, de façon massive, ce recul, sans que cela remette en cause toutefois, comme le CCI l'avait déjà affirmé à ce moment-là, le cours historique vers les affrontements de classe. Les luttes menées au cours des dernières années par le prolétariat sont venues confirmer ce qui précède. Elles ont témoigné, particulièrement depuis 1992, de la capacité du prolétariat à reprendre le chemin du combat de classe, confirmant ainsi que le cours historique n'avait pas été renversé. Elles ont témoigné aussi des énormes difficultés qu'il rencontre sur ce chemin, du fait de la profondeur et de l'extension de son recul. C'est de façon sinueuse, avec des avancées et des reculs, dans un mouvement en dents de scie que se développent les luttes ouvrières.
15) Les mouvements massifs en Italie, à l'automne 1992, ceux en Allemagne de 1993 et beaucoup d'autres exemples ont rendu compte du potentiel de combativité qui croissait dans les rangs ouvriers. Depuis, cette combativité s'est exprimée lentement, avec de longs moments de mise en sommeil, mais elle ne s'est pas démentie. Les mobilisations massives à l'automne 94 en Italie, la série de grèves dans le secteur public en France au printemps 95, sont des manifestations, parmi d'autres, de cette combativité. Cependant, il importe de mettre en évidence que le tendance vers le débordement des syndicats qui s'était exprimée en 92 en Italie ne s'est pas confirmée, bien au contraire, en 1994 où la manifestation « monstre » de Rome était un chef d'oeuvre de contrôle syndical. De même, la tendance à l'unification spontanée, dans la rue, qui était apparue (bien que de façon embryonnaire) à l'automne 93 dans la Ruhr en Allemagne a, depuis, laissé la place à des manoeuvres syndicales de grande envergure, telle la « grève » de la métallurgie du début 95, parfaitement maîtrisées par la bourgeoisie. De même, les récentes grèves en France, en fait des journées d'action des syndicats, ont constitué un succès pour ces derniers.
16) Outre de la profondeur du recul subi en 1989, les difficultés qu'éprouve aujourd'hui la classe ouvrière pour avancer sur son terrain sont le résultat de toute une série d'obstacles supplémentaires promus ou exploités par la classe ennemie. C'est dans le cadre du poids négatif qu'exerce la décomposition générale du capitalisme sur les consciences ouvrières, sapant la confiance du prolétariat en lui-même et dans la perspective de sa lutte, qu'il importe de placer ces difficultés. Plus concrètement, le chômage massif et permanent qui se développe aujourd'hui, s'il est un signe indiscutable de la faillite du capitalisme, a pour effet majeur de provoquer une forte démoralisation, un fort désespoir dans des secteurs importants de la classe ouvrière dont certains sont plongés dans l'exclusion sociale et même la lumpenisation. Ce chômage a également pour effet de servir d'instrument de chantage et de répression de la bourgeoisie envers les secteurs ouvriers qui ont encore du travail. De même, les discours sur la « reprise », et les quelques résultats positifs (en termes de profits et de taux de croissance) que connaît l'économie des principaux pays, sont amplement mis à profit pour développer les discours des syndicats sur le thème : « les patrons peuvent payer ». Ces discours sont particulièrement dangereux en ce sens qu'ils amplifient les illusions réformistes des ouvriers, les rendant beaucoup plus vulnérables à l'encadrement syndical, qu'ils contiennent l'idée qui si les patrons « ne peuvent pas payer », il ne sert à rien de lutter ce qui est un facteur supplémentaire de division (outre la division entre chômeurs et ouvriers au travail) entre les différents secteurs de la classe ouvrière travaillant dans des branches affectées de façon inégale par les effets de la crise.
17) Ces obstacles ont favorisé la reprise en main par les syndicats de la combativité ouvrière, la canalisant dans des « actions » qu'ils contrôlent entièrement. Cependant, les manoeuvres présentes des syndicats ont aussi, et surtout, un but préventif : il s'agit pour eux de renforcer leur emprise sur les ouvriers avant que ne se déploie beaucoup plus leur combativité, combativité qui résultera nécessairement de leur colère croissante face aux attaques de plus en plus brutales de la crise. De même, il faut souligner le changement récent dans un certain nombre de discours de la classe dominante. Alors que les premières années après l'effondrement du bloc de l'Est ont été dominées par les campagnes sur le thème de « la mort du communisme », « l'impossibilité de la révolution », on assiste aujourd'hui à un certain retour à la mode de discours favorables au « marxisme », à la « révolution », au « communisme » de la part des gauchistes, évidemment, mais même au-delà d'eux. Il s'agit là aussi d'une mesure préventive de la part de la bourgeoisie destinée à dévoyer la réflexion de la classe ouvrière qui tendra à se développer face à la faillite de plus en plus évidente du mode de production capitaliste. Il appartient aux révolutionnaires, dans leur intervention, de dénoncer avec la plus grande vigueur aussi bien les manoeuvres crapuleuses des syndicats que ces discours prétendument « révolutionnaires ». Il leur revient de mettre en avant la véritable perspective de la révolution prolétarienne et du communisme comme seule issue pouvant sauver l'humanité et comme résultat ultime des combats ouvriersVie du CCI:
- Résolutions de Congrès [131]
Conscience et organisation:
REVOLUTION ALLEMANDE (II) : les débuts de la révolution
- 3400 reads
Dans le dernier article de la Revue Internationale, nous avons démontré que la riposte de la classe ouvrière se fit de plus en plus forte au fur et à mesure du développement de la 1re guerre mondiale. Début 1917 - après deux ans et demi de barbarie -, la classe ouvrière parvenait à développer au niveau international un rapport de forces permettant de soumettre de plus en plus la bourgeoisie à sa pression. En février 1917, les ouvriers de Russie se soulevaient et renversaient le tsar. Mais pour mettre un terme à la guerre ils durent déposer le gouvernement bourgeois et prendre le pouvoir en octobre 1917. La Russie avait démontré que l'établissement de la paix était impossible sans le renversement de la classe dominante. La prise de pouvoir victorieuse devait connaître un puissant retentissement dans la classe ouvrière des autres pays. Pour la première fois dans l'histoire, la classe ouvrière était parvenue à s'emparer du pouvoir dans un pays. Cela devait être un fanal pour les ouvriers des autres pays, en particulier d'Autriche, de Hongrie, de toute l'Europe Centrale, mais principalement d'Allemagne.
Ainsi, dans ce pays, après la vague de patriotisme chauvin initiale, la classe ouvrière lutte de façon croissante contre la guerre. Aiguillonnée par le développement révolutionnaire en Russie et faisant suite à plusieurs mouvements avant-coureurs, une grève de masse éclate en avril 1917. En janvier 1918 environ un million d'ouvriers se jettent dans un nouveau mouvement de grève et fondent un conseil ouvrier à Berlin. Sous l'influence des événements de Russie la combativité sur les fronts militaires s'effrite de plus en plus au cours de l'été 1918. Les usines bouillonnent ; de plus en plus d'ouvriers s'assemblent dans les rues afin d'intensifier la riposte à la guerre. La classe dominante d'Allemagne, consciente du rayonnement de la révolution russe parmi les ouvriers, s'évertue - dans le but de sauver sa propre peau - à élever un rempart contre l'extension de la révolution.
Tirant la leçon des événements révolutionnaires en Russie et confrontée à un exceptionnel mouvement de luttes ouvrières, l'armée contraint fin septembre le Kaiser à l'abdication et investit un nouveau gouvernement. Mais la combativité de la classe ouvrière reste sur sa lancée et l'agitation continue sans trêve.
Le 28 octobre débute en Autriche, dans les provinces tchèques et slovaques comme à Budapest, une vague de grèves qui conduit au renversement de la monarchie. Partout apparaissent des conseils ouvriers et de soldats, à l'image des soviets russes.
En Allemagne, la classe dominante, mais aussi les révolutionnaires, se préparent désormais à la phase déterminante des affrontements. Les révolutionnaires préparent le soulèvement. Bien que la plupart des dirigeants spartakistes (Liebknecht, Luxemburg, Jogiches) se trouvent en prison et bien que, durant quelque temps, l'imprimerie illégale du parti se trouve paralysée par un coup de filet de la police, les révolutionnaires n'en continuent pas moins de préparer l'insurrection autour du groupe Spartakus.
Début octobre les Spartakistes tiennent une conférence avec les Linksradikale de Brême et d'autres villes. Au cours de cette conférence on signale le début des affrontements révolutionnaires ouverts et un appel est adopté et largement diffusé à travers tout le pays ainsi que sur le front. Ses principales idées sont : les soldats ont commencé à se libérer de leur joug, l'armée s'effondre ; mais ce premier élan de la révolution trouve la contre-révolution à son poste. Les moyens de répression de la classe dominante faisant défaillance, la contre-révolution cherche à endiguer le mouvement en accordant les pseudo-droits « démocratiques ». Le parlementarisme et le nouveau mode de scrutin ont pour but d'amener le prolétariat à continuer à supporter sa situation.
« Au cours de la discussion sur la situation internationale fut exprimé le fait que la révolution russe a apporté au mouvement en Allemagne un soutien moral essentiel. Les délégués décident de transmettre aux camarades de Russie l'expression de leur gratitude, de leur solidarité et de leur sympathie fraternelle et promettent de confirmer cette solidarité non par des paroles, mais par des actions correspondant au modèle russe.
Il s'agit pour nous de soutenir par tous les moyens les mutineries des soldats, de passer à l'insurrection armée, d'élargir l'insurrection armée à la lutte pour tout le pouvoir au profit des ouvriers et des soldats et d'assurer la victoire grâce aux grèves de masses des ouvriers. Voilà la tâche des tout prochains jours et semaines à venir. »
Dés le début de ces affrontements révolutionnaires, nous pouvons affirmer que les Spartakistes percent aussitôt à jour les manoeuvres politiques de la classe dominante. Ils mettent à nu le caractère mensonger de la démocratie et reconnaissent sans hésitation les pas indispensables à l'avancée du mouvement : préparer l'insurrection c'est soutenir la classe ouvrière en Russie non seulement en paroles mais aussi en actes. Ils comprennent que la solidarité de la classe ouvrière dans cette nouvelle situation ne peut se limiter à des déclarations mais nécessite que les ouvriers eux-mêmes entrent en lutte. Cette leçon constitue depuis lors un fil rouge dans l'histoire du mouvement ouvrier et de ses luttes.
La bourgeoisie elle aussi fourbit ses armes. Le 3 octobre 1918, elle dépose le Kaiser pour le remplacer par un nouveau prince, Max von Baden et fait entrer le SPD au gouvernement.
La direction du SPD (parti fondé au siècle précédent par la classe ouvrière elle-même) avait trahi en 1914 et avait exclu les internationalistes regroupés autour des Spartakistes et des Linksradikale ainsi que les Centristes. Le SPD ne recèle depuis lors plus aucune vie prolétarienne en son sein. Il soutient depuis le début de la guerre la politique impérialiste. Il va également agir contre le soulèvement révolutionnaire de la classe ouvrière.
Pour la première fois, la bourgeoisie appelle au gouvernement un parti issu de la classe ouvrière et récemment passé dans le camp du Capital afin d'assurer, dans cette situation révolutionnaire, la protection de l'Etat capitaliste. Alors que de nombreux ouvriers entretiennent encore des illusions, les révolutionnaires comprennent immédiatement le rôle nouvellement échu à la social-démocratie. Rosa Luxemburg écrit en octobre 1918 : « Le socialisme de gouvernement, par son entrée au ministère, se pose en défenseur du capitalisme et barre le chemin à la révolution prolétarienne montante. »
A partir de janvier 1918, lorsque le premier conseil ouvrier apparaît au cours des grèves de masse à Berlin, les « Délégués » révolutionnaires (Revolutionnäre Obleute) et les Spartakistes se rencontrent secrètement régulièrement. Les « Délégués » révolutionnaires sont très proches de l'USPD. Sur cette toile de fond d'accroissement de la combativité, de désagrégation du front, de poussée des ouvriers pour passer à l'action, ils commencent fin octobre, au sein d'un comité d'action formé après la conférence mentionnée ci-dessus, à discuter des plans concrets en vue d'une insurrection.
Le 23 octobre Liebknecht est libéré de prison. Plus de 20 000 ouvriers viennent le saluer à son arrivée à Berlin.
Après l'expulsion de Berlin des membres de l'ambassade russe par le gouvernement allemand sous l'insistance du SPD, après les rassemblements de soutien à la révolution russe organisés par les révolutionnaires, le comité d'action discute de la situation. Liebknecht insiste sur la nécessité de la grève générale et sur les manifestations de masse qui doivent s'armer dans la foulée. Lors de la réunion des « Délégués » du 2 novembre, il propose même la date du 5 avec les mots d'ordre de : « Paix immédiate et levée de l'état de siège, Allemagne république socialiste, formation d'un gouvernement des conseils ouvriers et de soldats. » (Drabkin, p. 104)
Les « Délégués » révolutionnaires qui pensent que la situation n'est pas mûre plaident pour une attente supplémentaire. Pendant ce temps les membres de l'USPD, dans les différentes villes, attendent de nouvelles instructions car personne ne veut entrer en action avant Berlin. La nouvelle d'un soulèvement imminent se répand cependant dans d'autres villes du Reich.
Tout cela va être accéléré par les événements de Kiel.
Alors que le 3 novembre la flotte de Kiel doit prendre la mer pour continuer la guerre, les marins se révoltent et se mutinent. Des conseils de soldats sont aussitôt créés, suivis dans le même élan par la formation de conseils ouvriers. Le commandement de l'armée menace de bombarder la ville. Mais, après avoir compris qu'il ne materait pas la mutinerie par la violence, il fait appel à son cheval de Troie : le dirigeant du SPD Noske. Celui-ci parvient après son arrivée sur les lieux à s'introduire frauduleusement dans le conseil ouvrier.
Mais ce mouvement des conseils ouvriers et de soldats a déjà lancé un signal à l'ensemble du prolétariat. Les conseils forment des délégations massives d'ouvriers et de soldats qui se rendent dans d'autres villes. D'énormes délégations sont envoyées à Hambourg, Brême, Flensburg, dans la Ruhr et même jusqu'à Cologne. Celles-ci s'adressent aux ouvriers réunis en assemblées et appellent à la formation de conseils ouvriers et de soldats. Des milliers d'ouvriers se déplacent ainsi des villes du nord de l'Allemagne jusqu'à Berlin et dans d'autres villes en province. Nombre d'entre eux sont arrêtés par les soldats restés loyaux au gouvernement (plus de 1300 arrestations rien qu'à Berlin le 6 novembre) et enfermés dans les casernes - dans lesquelles ils poursuivent cependant leur agitation.
En une semaine des conseils ouvriers et de soldats surgissent dans les principales villes d'Allemagne et les ouvriers prennent eux-mêmes l'extension de leur mouvement en main. Ils n'abandonnent pas leur sort aux syndicats ou au parlement. Ils ne combattent plus par branches, isolés les uns des autres, avec des revendications de secteur spécifiques ; au contraire, dans chaque ville, ils s'unissent et formulent des revendications communes. Ils agissent par eux-mêmes et recherchent l'union des ouvriers des autres villes ! ([1] [2053])
Moins de deux ans après leurs frères de Russie, les ouvriers allemands donnent un exemple clair de leur capacité à diriger eux-mêmes leur lutte. Jusqu'au 8 novembre, dans presque toutes les villes - à l'exception de Berlin - des conseils d'ouvriers et de soldats sont mis sur pieds.
Le 8 novembre des « hommes de confiance » du SPD rapportent : « Il est impossible d'arrêter le mouvement révolutionnaire ; si le SPD voulait s'opposer au mouvement, il serait tout simplement renversé par le flot. »
Lorsque les premières nouvelles de Kiel arrivent à Berlin le 4 novembre, Liebknecht propose au Comité exécutif l'insurrection pour le 8 novembre. Alors que le mouvement s'étend spontanément dans tout le pays, il apparaît évident que le soulèvement à Berlin (siège du gouvernement) exige de la part de la classe ouvrière une démarche organisée, clairement orientée vers un objectif : celui de rassembler l'ensemble de ses forces. Mais le Comité exécutif continue à hésiter. Ce n'est qu'après l'arrestation de deux de ses membres en possession du projet d'insurrection qu'on se décide à passer à l'action le lendemain. Les Spartakistes publient le 8 novembre 1918 l'appel suivant :
« Maintenant que l'heure d'agir est arrivée, il ne doit plus y avoir d'hésitation. Les mêmes "socialistes" qui ont accompli quatre années durant leur rôle de souteneur au service du gouvernement (...) mettent aujourd'hui tout en oeuvre afin d'affaiblir Votre lutte et miner le mouvement.
Ouvriers et soldats ! Ce que Vos camarades ont réussi à accomplir à Kiel, Hambourg, Brême, Lübeck, Rostock, Flensburg, Hanovre, Magdebourg, Brunswick, Munich et Stuttgart, Vous devez aussi réussir à l'accomplir. Car de ce que Vous remporterez de haute lutte, de la ténacité et du succès de Votre lutte, dépend la victoire de Vos frères là-bas et dépend la victoire du prolétariat du monde entier. Soldats ! Agissez comme Vos camarades de la flotte, unissez-vous à Vos frères en tenue de travail. Ne Vous laissez pas utiliser contre Vos frères, n'obéissez pas aux ordres des officiers, ne tirez pas sur les combattants de la Liberté. Ouvriers et soldats ! Les objectifs prochains de Votre lutte doivent être :
1) La libération de tous les prisonniers civils et militaires.
2) L'abolition de tous les Etats et la suppression de toutes les dynasties.
3) L'élection de conseils ouvriers et de soldats, l'élection de délégués dans toutes les usines et les unités de la troupe.
4) L'établissement immédiat de relations avec les autres conseils ouvriers et de soldats allemands.
5) La prise en charge du gouvernement par les commissaires des conseils ouvriers et de soldats.
6) La liaison immédiate avec le prolétariat international et tout spécialement avec la République Ouvrière russe.
Vive la République socialiste !
Vive l'Internationale ! »
Le groupe « Internationale » (Groupe Spartakus), le 8 novembre.
Les événements du 9 novembre
Aux premières heures du matin du 9 novembre le soulèvement révolutionnaire commence à Berlin.
« Ouvriers, soldats, camarades !
L'heure de la décision est là ! Il s'agit d'être à la hauteur de la tâche historique...
Nous exigeons non pas l'abdication d'un seul homme mais la république !
La république socialiste et toute ses conséquences. En avant pour la lutte pour la paix, la liberté et la pain.
Sortez des usines ! Sortez des casernes ! Tendez Vous les mains ! Vive la république socialiste. » (Tract spartakiste)
Des centaines de milliers d'ouvriers répondent à l'appel du groupe Spartakus et du Comité exécutif, cessent le travail et affluent en de gigantesques cortèges de manifestations vers le centre de la ville. A leur tête marchent des groupes d'ouvriers armés. La grande majorité des troupes s'unit aux ouvriers manifestants et fraternise avec eux. A midi Berlin se trouve aux mains des ouvriers et des soldats révolutionnaires. Les lieux importants sont occupés par les ouvriers. Une colonne de manifestants, ouvriers et soldats, se rend devant la demeure des Hohenzollern. Liebknecht y prend la parole :
« La domination du capitalisme qui a transformé l'Europe en cimetière est désormais brisée. (...) Ce n'est pas parce que le passé est mort que nous devons croire que notre tâche est terminée. Il nous faut tendre toutes nos forces pour construire le gouvernement des ouvriers et des soldats (...). Nous tendons la mains (aux ouvriers du monde entier) et les invitons à achever la révolution mondiale (...). Je proclame la libre république socialiste d'Allemagne. » (Liebknecht, le 9 novembre)
De plus, il met en garde les ouvriers afin qu'ils ne se contentent pas de ce qui est atteint et il les appelle à la prise du pouvoir et à l'unification internationale de la classe ouvrière.
Le 9 novembre, l'ancien régime n'utilise pas la force pour se défendre. Cependant si cela se produit ainsi c'est non pas parce qu'il hésite à verser le sang (il a des millions de morts sur la conscience) mais parce que la révolution lui a désorganisé l'armée en lui retirant un grand nombre de soldats qui auraient pu tirer sur le peuple. Tout comme en Russie, en février 1917, lorsque les soldats se sont rangés du côté des ouvriers en lutte, la réaction des soldats allemands est un facteur important dans le rapport de force. Mais ce n'est que par l'auto-organisation, la sortie des usines et « l'occupation de la rue », par l'unification massive de la classe ouvrière, que la question nodale des prolétaires en uniforme pouvait se résoudre. En réussissant à les convaincre de la nécessité de la fraternisation, les ouvriers montrent que ce sont eux qui détiennent le rôle dirigeant !
L'après-midi du 9 novembre des milliers de délégués se réunissent au Cirque Busch. R. Müller, l'un des principaux dirigeants des « Délégués » révolutionnaires lance un appel pour que : « le 10 novembre soit organisée dans toutes les usines et dans toutes les unités des troupes de Berlin l'élection de conseils ouvriers et de soldats. Les conseils élus devant tenir une assemblée au Cirque Busch à 17 heures pour élire le gouvernement provisoire. Les usines doivent élire un membre au conseil ouvrier pour 1000 ouvriers et ouvrières, de même tous les soldats doivent élire un membre au conseil de soldats par bataillon. Les usines plus petites (de moins de 500 employés) doivent élire chacune un délégué. L'assemblée insiste sur la nomination par l'assemblée des conseils d'un organe de pouvoir. »
Les ouvriers effectuent ainsi les premiers pas pour créer une situation de double pouvoir. Parviendront-ils à aller aussi loin que leurs frères de classe de Russie ?
Les Spartakistes, pour leur part, soutiennent que la pression et les initiatives provenant des conseils locaux doivent être renforcées. La démocratie vivante de la classe ouvrière, la participation active des ouvriers, les assemblées générales dans les usines, la désignation de délégués responsables devant elles et révocables, voilà ce que doit être la pratique de la classe ouvrière !
Les ouvriers et les soldats révolutionnaires occupent le soir du 9 novembre l'imprimerie du Berliner-Lokal-Anzeiger et impriment le premier numéro du journal Die rote Fahne qui, immédiatement, met en garde : « Il n'y a aucune communauté d'intérêt avec ceux qui vous ont trahi quatre années durant. A bas le capitalisme et ses agents ! Vive la révolution ! Vive l'Internationale ! »
La question de la prise
du pouvoir par la classe ouvrière :
la bourgeoisie l'arme au pied
Le premier conseil ouvrier et de soldats de Berlin (surnommé l'Exécutif) se considère rapidement comme organe de pouvoir. Dans sa première proclamation du 11 novembre, il se proclame instance suprême de contrôle de toutes les administrations publiques des communes, des Länder et du Reich ainsi que de l'administration militaire.
Mais la classe dominante ne cède pas de plein gré le terrain à la classe ouvrière. Au contraire, elle va opposer la résistance la plus acharnée.
En effet, tandis que Liebknecht proclame la république socialiste devant la demeure des Hohenzollern, le prince Max von Baden abdique et confie les affaires gouvernementales à Ebert nommé chancelier. Le SPD proclame la « libre république d'Allemagne ».
Ainsi, officiellement le SPD prend en charge les affaires gouvernementales et appelle aussitôt « au calme et à l'ordre » en annonçant la tenue de prochaines « élections libres » ; il se rend compte qu'il ne peut s'opposer au mouvement qu'en le sapant de l'intérieur.
Il proclame son propre conseil ouvrier et de soldats composé uniquement de fonctionnaires du SPD et à qui personne n'a conféré aucune sorte de légitimité.
Après cela, le SPD déclare que le mouvement est dirigé en commun par lui et l'USPD.
Cette tactique d'investir le mouvement et de le détruire de l'intérieur a, depuis lors, toujours été réutilisée par les gauchistes avec leurs comités de grève bidons, auto-proclamés, et leurs coordinations.
La social-démocratie et ses successeurs, les groupes de l'extrême gauche capitaliste, sont des spécialistes pour se placer à la tête du mouvement et faire en sorte d'apparaître comme s'ils en sont les représentants légitimes.
Alors qu'il cherche à couper l'herbe sous le pied de l'Exécutif en agissant directement en son sein, le SPD annonce la formation d'un gouvernement commun avec l'USPD. Celui-ci accepte alors qu'en revanche les Spartakistes (qui en sont encore membres à ce moment-là) repoussent cette offre. Si aux yeux de la grande majorité des ouvriers la différence entre l'USPD et les Spartakistes est peu nette, ces derniers ont cependant une attitude claire vis-à-vis de la formation du gouvernement. Ils sentent le piège et comprennent qu'on ne s'assoit pas dans la même barque que l'ennemi de classe.
Le meilleur moyen pour combattre les illusions des ouvriers sur les partis de gauche n'est pas, comme le répètent aujourd'hui sans cesse les trotskistes et autres gauchistes, de les porter au gouvernement pour que se déchire le voile de leurs mensonges. Pour développer la conscience de classe, c'est la démarcation de classe la plus claire et la plus stricte qui est indispensable et rien d'autre.
Le soir du 9 novembre, le SPD et la direction de l'USPD se font proclamer commissaires du peuple et gouvernement investi par le Conseil Exécutif.
Le SPD a fait la démonstration de toute son adresse. Il peut maintenant agir contre la classe ouvrière aussi bien depuis les bancs du gouvernement qu'au nom de l'Exécutif des conseils. Ebert est en même temps chancelier du Reich et commissaire du peuple élu par l'Exécutif des conseils ; il peut ainsi donner l'apparence d'être du côté de la révolution. Le SPD avait déjà la confiance de la bourgeoisie mais en parvenant à capter celle des ouvriers avec autant d'adresse il montre ses capacités de manoeuvres et de mystification. C'est aussi une leçon, pour la classe ouvrière, sur la manière trompeuse dont les forces de la gauche du Capital peuvent agir.
Examinons de plus près la manière d'agir du SPD notamment lors de l'assemblée du conseil ouvrier et de soldats du 10 novembre où environ 3 000 délégués sont présents. Aucun contrôle des mandats n'est effectué et de ce fait les représentants des soldats se retrouvent en majorité.
Ebert prend la parole en premier. D'après lui, « le vieux différend fratricide » aurait pris fin, le SPD et l'USPD ayant formé un gouvernement commun, il s'agirait maintenant « d'entreprendre en commun le développement de l'économie sur la base des principes du socialisme. Vive l'unité de la classe ouvrière allemande et des soldats allemands. » Au nom de l'USPD Haase célèbre « l'unité retrouvée » : « Nous voulons consolider les conquêtes de la grande révolution socialiste. Le gouvernement sera un gouvernement socialiste. »
« Ceux qui hier encore travaillaient contre la révolution, ne sont maintenant plus contre elle. » (E. Barth, le 10 novembre 1918) « Tout doit être fait pour que la contre-révolution ne se soulève pas. »
Ainsi, alors que le SPD emploie tous les moyens pour mystifier la classe ouvrière, l'USPD contribue à servir de couverture à ses manoeuvres. Les Spartakistes se rendant compte du péril, Liebknecht déclare au cours de cette assemblée :
« Je dois verser de l'eau dans le vin de votre enthousiasme. La contre-révolution est déjà en marche, elle est déjà en action... Je vous le dis : les ennemis vous entourent ! (Il énumère les intentions contre-révolutionnaires de la social-démocratie) Je sais combien vous est désagréable ce dérangement, mais même si vous me fusillez, j'exprimerai ce que je tiens pour indispensable de dire. »
Les Spartakistes mettent ainsi en garde contre l'ennemi de classe qui est présent et insistent sur la nécessité de renverser le système. Pour eux l'enjeu n'est pas un changement de personnes mais le dépassement du système lui-même.
A l'inverse, le SPD, avec l'USPD à sa remorque, agit pour que le système reste en place faisant croire qu'avec un changement de dirigeants et l'investiture d'un nouveau gouvernement la classe ouvrière a remporté la victoire.
Là aussi le SPD donne une leçon aux défenseurs du Capital par la manière de détourner la colère sur des personnalités dirigeantes pour éviter que ne soit porté atteinte au système dans son ensemble. Cette manière d'agir a constamment été mise en pratique par la suite. ([2] [2054])
Le SPD enfonce le clou dans son journal du 10 novembre où il écrit sous le titre « L'unité et non la lutte fratricide » :
« Depuis hier le monde du travail a le sentiment de faire flamboyer la nécessité de l'unité interne. De pratiquement toutes les villes, de tous les Länder, de tous les Etats de la fédération nous entendons que le vieux Parti et les Indépendants se sont à nouveau retrouvés le jour de la révolution et se sont réunifiés dans l'ancien Parti. (...) L'oeuvre de réconciliation ne doit pas faillir à cause de quelques aigris dont le caractère ne serait pas suffisamment fort pour dépasser les vieilles rancoeurs et les oublier. Le lendemain d'un tel triomphe magnifique (sur l'ancien régime) doit-on offrir au monde le spectacle du déchirement mutuel du monde du travail dans une absurde lutte fratricide ? » (Vorwærts, 10 novembre 1918)
Les deux armes du capital pour assumer le sabotage politique
A partir de là le SPD met en campagne tout un arsenal d'armes contre la classe ouvrière. A côté de « l'appel à l'unité », il injecte surtout le poison de la démocratie bourgeoise. Selon lui, l'introduction du « suffrage universel, égal, direct et secret pour tous les hommes et femmes d'âge adulte fut à la fois présenté comme la plus importante conquête politique de la révolution et comme le moyen de transformer l'ordre de la société capitaliste vers le socialisme suivant la volonté du peuple selon un plan méthodique. » Ainsi, avec la proclamation de la république et du fait que des ministres SPD soient au pouvoir, il fait croire que le but est atteint et avec l'abdication du Kaiser et la nomination d'Ebert à la chancellerie que le libre Etat Populaire est créé. En réalité ce n'est qu'un anachronisme de peu d'importance qui vient d'être éliminé en Allemagne car la bourgeoisie est depuis longtemps la classe politiquement dominante ; à la tête de l'Etat se trouve désormais non plus un monarque mais un bourgeois. Cela ne change pas grand chose... Aussi il est clair que l'appel à des élections démocratiques est directement dirigé contre les conseils ouvriers. De plus, c'est avec une propagande idéologique intensive, fallacieuse et criminelle que le SPD bombarde la classe ouvrière :
« Qui veut le pain, doit vouloir la paix. Qui veut la paix, doit vouloir la Constituante, la représentation librement élue de l'ensemble du peuple allemand. Qui contrecarre la Constituante ou bien tergiverse, vous ôte la paix, la liberté et le pain, vous dérobe les fruits immédiats de la victoire de la révolution : c'est un contre-révolutionnaire. »
« La socialisation aura lieu et devra avoir lieu (...) de par la volonté du peuple du travail qui, fondamentalement, veut abolir cette économie animée par l'aspiration des particuliers au profit. Mais cela sera mille fois plus facile à imposer si c'est la Constituante qui le décrète, que si c'est la dictature d'un quelconque comité révolutionnaire qui l'ordonne (...). »
« L'appel à la Constituante est l'appel au socialisme créateur, constructeur, à ce socialisme qui augmente le bien-être du peuple, qui élève le bonheur et la liberté du peuple et pour lequel seul il vaut de lutter. »
« L'unité allemande exige l'Assemblée Nationale. Ce n'est que sous sa protection que pourra se développer la nouvelle culture allemande, qui a constamment formé le but et le coeur de notre volonté nationale. »
« Les conquêtes de la révolution sont si fermement ancrées dans la volonté de tout le peuple, que seuls les poltrons peuvent avoir des cauchemars à cause de la contre-révolution. » (Tract du SPD)
Si nous citons aussi exhaustivement le SPD, ce n'est que pour mieux se faire une réelle idée des arguties et de la ruse qu'utilise la gauche du Capital.
Nous avons ici encore une caractéristique classique de l'action de la bourgeoisie contre la lutte de classe dans les pays hautement industrialisés : lorsque le prolétariat exprime sa force et aspire à son unification, ce sont toujours les forces de gauche qui interviennent avec la plus adroite des démagogies. Ce sont elles qui prétendent agir au nom des ouvriers et cherchent à saboter les luttes de l'intérieur empêchant le mouvement de franchir les étapes décisives.
La classe ouvrière révolutionnaire en Allemagne trouve face à elle un adversaire incomparablement plus fort que celui que les ouvriers russes ont affronté. Pour la tromper le SPD est amené à adopter un langage radical dans le sens supposé des intérêts de la révolution et se place ainsi à la tête du mouvement, alors qu'il est, en réalité, le principal représentant de l'Etat bourgeois. Il n'agit pas contre la classe ouvrière en tant que parti extérieur à l'Etat, mais comme fer de lance de celui-ci.
Les premiers jours de l'affrontement révolutionnaire montrent déjà à l'époque le caractère général de la lutte de classe dans les pays hautement industrialisés : une bourgeoisie rompue à toutes les ruses s'affrontant à une classe ouvrière forte. Il serait illusoire de penser que la victoire puisse facilement revenir à la classe ouvrière.
Comme nous le verrons plus tard, les syndicats, de leur côté, agissent comme second pilier du Capital et collaborent avec les patrons immédiatement après le déclenchement du mouvement. Après avoir organisé durant le conflit la production de guerre, ils doivent intervenir avec le SPD pour défaire le mouvement. Quelques concessions sont faites, parmi lesquelles la journée de huit heures, afin d'empêcher la radicalisation ultérieure de la classe ouvrière.
Mais, même le sabotage politique, le travail de sape de la conscience de la classe ouvrière par le SPD ne suffit pas : simultanément ce parti traître scelle un accord avec l'armée pour une action militaire.
La répression
Le commandant en chef de l'armée, le général Groener, qui au cours de la guerre avait collaboré quotidiennement avec le SPD et les syndicats, en tant que responsable des projets d'armements, explique :
« Nous nous sommes alliés pour combattre le Bolchevisme. La restauration de la monarchie était impossible. (...) J'avais conseillé au Feldmarschall de ne pas combattre la révolution par les armes, parce qu'il était à craindre que compte tenu de l'état des troupes un tel moyen irait à l'échec. Je lui ai proposé que le haut commandement militaire s'allie avec le SPD vu qu'il n'y avait aucun parti disposant de suffisamment d'influence dans le peuple, et parmi les masses pour reconstruire une force gouvernementale avec le commandement militaire. Les partis de droite avaient complètement disparu et il était exclu de travailler avec les extrémistes radicaux. Il s'agissait en premier lieu d'arracher le pouvoir des mains des conseils ouvriers et de soldats de Berlin. Dans ce but une entreprise fut prévue. Dix divisions devaient entrer dans Berlin. Ebert était d'accord. (...) Nous avons élaboré un programme qui prévoyait, après l'entrée des troupes, le nettoyage de Berlin et le désarmement des Spartakistes. Cela fut aussi convenu avec Ebert, auquel je suis particulièrement reconnaissant pour son amour absolu de la patrie. (...) Cette alliance fut scellée contre le danger bolchevik et le système des conseils. » (octobre-novembre 1925, Zeugenaussage)
Dans ce but, Groener, Ebert et consorts sont chaque jour en liaison téléphonique entre 23 heures et une heure du matin sur des lignes secrètes et se rencontrent pour se concerter sur la situation.
Contrairement à la Russie où, en octobre, le pouvoir tomba aux mains des ouvriers quasiment sans une goutte de sang, la bourgeoisie en Allemagne s'apprête immédiatement, à côté du sabotage politique, à déclencher la guerre civile. Dés le premier jour, elle réunit tous les moyens nécessaires à la répression militaire.
L'intervention
des révolutionnaires
Pour évaluer l'intervention des révolutionnaires nous devons examiner leur capacité à analyser correctement le mouvement de la classe, l'évolution du rapport de forces, ce « qui a été atteint », et leur capacité à donner les perspectives les plus claires. Que disent les Spartakistes ?
« La révolution est commencée. L'heure n'est ni à la jubilation devant ce qui est accompli, ni au triomphe devant l'ennemi abattu, mais à la plus sévère autocritique et au rassemblement de fer des énergies afin de poursuivre le travail entamé. Car ce qui est accompli est minime et l'ennemi N'EST PAS vaincu. Qu'est-ce qui est atteint ? La monarchie a été balayée, le pouvoir gouvernemental suprême est passé dans les mains des représentants des ouvriers et des soldats. Mais la monarchie n'a jamais été le véritable ennemi, elle n'était que la façade, que l'enseigne de l'impérialisme. (...) Rien moins que l'abolition de la domination du Capital, la réalisation de l'ordre de la société socialiste constituent l'objectif historique de l'actuelle révolution. C'est une tâche considérable qui ne s'accomplit pas en un tour de main à l'aide de quelques décrets venus d'en haut mais qui ne peut être menée heureusement à son terme à travers toutes les tempêtes que par l'action propre et consciente de la masse des travailleurs des villes et des campagnes, et grâce à la maturité spirituelle la plus élevée et à l'idéalisme inépuisable des masses populaires.
- Tout le pouvoir dans les mains des conseils ouvriers et de soldats, sauvegarde de l'oeuvre révolutionnaire contre ses ennemis aux aguets : telle est l'orientation de toutes les mesures du gouvernement révolutionnaire.
- Le développement et la réélection des conseils locaux d'ouvriers et de soldats pour que le premier geste impulsif et chaotique de leur surgissement puisse être remplacé par le processus conscient d'auto-compréhension des buts, des tâches et de la marche de la révolution ;
- Le rassemblement permanent de ces représentants des masses et transfert du pouvoir politique effectif du petit comité du comité exécutif (Vollzugsrat) à la base plus large du conseil ouvrier et de soldats ;
- La convocation dans les plus brefs délais du parlement des ouvriers et des soldats afin que les prolétaires de toute l'Allemagne se constituent en classe, en pouvoir politique compact et se mettent derrière l'oeuvre de la révolution pour en former le rempart et la force de frappe ;
- L'organisation sans retard, non pas des "paysans", mais des prolétaires de la campagne et des petits paysans, qui jusqu'alors se trouvent encore en dehors de la révolution ;
- La formation d'une Garde Rouge prolétarienne pour la protection permanente de la révolution et d'une Milice Ouvrière pour que l'ensemble du prolétariat soit en permanence vigilant ;
- La suppression des organes de l'état policier absolutiste et militaire de l'administration, de la justice et de l'armée, (...)
- La convocation immédiate d'un congrès ouvrier mondial en Allemagne pour indiquer nettement et clairement le caractère socialiste et international. L'Internationale, la révolution mondiale du prolétariat sont les seuls points d'ancrage du futur de la révolution allemande. »
(R. Luxemburg, « Le début », Die Rote Fahne, 18 novembre 1918)
Destruction des positions du pouvoir politique de la contre-révolution, érection et consolidation du pouvoir prolétarien, voilà quelles sont les deux tâches que les Spartakistes mettent au premier plan avec une remarquable clarté.
« Le bilan de la première semaine de la révolution est que dans l'Etat des Hohenzollern rien n'a été fondamentalement changé, le conseil ouvrier et de soldats fonctionne comme représentant du gouvernement impérialiste qui a fait banqueroute. Tous ses faits et gestes sont inspirés par la peur de la masse des ouvriers. (...)
L'état réactionnaire du monde civilisé ne se transformera pas en état populaire révolutionnaire en 24 heures. Des soldats qui, hier encore, se faisaient les gendarmes de la réaction et assassinaient des prolétaires révolutionnaires en Finlande, en Russie, en Ukraine, dans les pays baltes et des ouvriers qui ont laissé faire cela tranquillement ne sont pas devenus en 24 heures les porteurs conscients des buts du socialisme. » (18 novembre)
L'analyse des Spartakistes affirmant qu'il ne s'agit pas d'une révolution bourgeoise mais de la contre-révolution bourgeoise déjà en marche, leur capacité à analyser la situation avec clairvoyance et selon une vue d'ensemble, concrétisent le caractère indispensable, pour le mouvement de la classe, de ses organisations politiques révolutionnaires.
Les conseils ouvriers,
fer de lance de la révolution
Comme nous l'avons décrit plus haut, dans les grandes villes, pendant les premiers jours de novembre, des conseils ouvriers et de soldats ont été formés partout. Même si les conseils surgissent « spontanément », leur apparition n'est nullement une surprise pour les révolutionnaires. Ils sont déjà apparus en Russie, de même qu'en Autriche et en Hongrie. Comme le disait l'Internationale Communiste par la voix de Lénine en mars 1919 : « Cette forme, c'est le régime des soviets avec la dictature du prolétariat. La dictature du prolétariat : ces mots étaient du "latin" pour les masses jusqu'à nos jours. Maintenant, grâce au système des soviets, ce latin est traduit dans toutes les langues modernes ; la forme pratique de la dictature est trouvée par les masses ouvrières. » (Discours d'ouverture au premier congrès de l'Internationale Communiste)
L'apparition des conseils ouvriers reflète la volonté de la classe ouvrière de prendre en main son destin. Les conseils ouvriers peuvent seulement apparaître lorsque dans l'ensemble de la classe il y a une activité massive et qu'un développement profond de la conscience de classe se soit mis en marche. C'est pourquoi les conseils ne sont que le fer de lance d'un mouvement profond et global de la classe, et ils sont fortement dépendants des activités de l'ensemble de la classe. Si la classe affaiblit ses activités dans les usines, si la combativité se tasse et la conscience recule dans la classe, cela se répercute sur la vie même des conseils. Ils sont le moyen de centraliser les luttes de la classe et ils sont le levier par lequel la classe réclame et impose le pouvoir dans la société.
Dans beaucoup de villes les conseils ouvriers commencent, en effet, à prendre des mesures pour s'opposer à l'Etat bourgeois. Dés le début de l'existence des conseils, les ouvriers tentent de paralyser l'appareil d'Etat bourgeois, de prendre leurs propres décisions à la place du gouvernement bourgeois et de les mettre en pratique. C'est le début de la période de double pouvoir, comme en Russie après la révolution de février. Ce phénomène apparaît partout mais il est le plus visible à Berlin où siège le gouvernement.
Le sabotage de la bourgeoisie
Parce que les conseils ouvriers sont le levier de la centralisation de la lutte ouvrière, parce que toutes les initiatives des masses ouvrières convergent en leur sein, il est vital pour la classe de maintenir son contrôle sur eux.
En Allemagne la classe capitaliste utilise un véritable cheval de Troie contre les conseils grâce au SPD. Celui-ci, qui a été jusqu'en 1914 un parti ouvrier, les combat, les sabote de l'intérieur et les détourne de leur objectif au nom de la classe ouvrière.
Déjà au niveau de leur composition, il utilise toutes les ruses pour y faire introduire ses délégués. Le Conseil Exécutif de Berlin au début est composé de six représentants respectivement du SPD et de l'USPD et de douze délégués des soldats. Cependant, à Berlin, le SPD réussit - sous prétexte d'une nécessaire parité de voix et de la nécessaire unité de la classe ouvrière - à faire pénétrer un nombre important de ses hommes dans le Conseil Exécutif sans que la décision soit prise par une quelconque assemblée ouvrière. Grâce à cette tactique d'insistance sur la « parité (des voix) entre les partis » le SPD reçoit plus de délégués qu'il n'a d'influence réelle dans la classe. En province les choses ne sont pas très différentes : pour quelques 40 grandes villes, quasiment trente conseils ouvriers et de soldats se retrouvent sous l'influence dominante des dirigeants du SPD et de l'USPD. Ce n'est que dans les villes où les Spartakistes ont une plus grande influence que les conseils ouvriers s'engagent dans une voie radicale.
En ce qui concerne les tâches des conseils, le SPD essaie de les stériliser. Alors que les conseils de par leur nature tendent à agir comme contre-pouvoir face au pouvoir de l'Etat bourgeois, voire même à le détruire, le SPD s'arrange pour affaiblir et assujettir ces organes de la classe à l'Etat bourgeois. Il le fait en propageant l'idée que les conseils doivent se concevoir comme des organes transitoires jusqu'à la tenue des élections pour l'assemblée nationale, mais aussi, pour leur faire perdre leur caractère de classe, qu'ils doivent s'ouvrir à toute la population, à toutes les couches du peuple. Dans beaucoup de villes le SPD crée des « comités de salut public » qui incluent toutes les parties de la population -des paysans aux petits commerçants jusqu'aux ouvriers- ayant les mêmes droits dans ces organismes.
Alors que les Spartakistes poussent dès le début à la formation de Gardes Rouges pour pouvoir imposer si nécessaire par la force les mesures prises, le SPD torpille cette initiative dans les conseils de soldats en disant que cela « exprime une méfiance vis à vis des soldats ».
Dans le Conseil Exécutif de Berlin il y a constamment des confrontations sur les mesures et la direction à prendre. Bien que l'on ne puisse pas dire que tous les délégués ouvriers aient une clarté et une détermination suffisante sur toutes les questions, le SPD fait tout pour saper l'autorité du conseil de l'intérieur comme de l'extérieur.
C'est ainsi que :
- dès que le Conseil Exécutif donne des instructions, le Conseil des Commissaires du Peuple (dirigé par le SPD) en impose d'autres ;
- l'Exécutif ne possédera jamais sa propre presse et devra aller mendier de la place dans la presse bourgeoise pour la publication de ses résolutions. Les délégués du SPD ont tout fait pour qu'il en soit ainsi ;
- lorsqu'en novembre et décembre des grèves éclatent dans les usines de Berlin, le Comité Exécutif, sous l'influence du SPD, prend position contre elles, bien qu'elles expriment la force de la classe ouvrière et qu'elles auraient pu permettre de corriger des erreurs du Comité Exécutif ;
- finalement le SPD -en tant que force dirigeante du gouvernement bourgeois- utilise la menace des Alliés, soi-disant prêts à intervenir militairement et à occuper l'Allemagne pour empêcher sa « bolchévisation », pour faire hésiter les ouvriers et freiner le mouvement. Ainsi, par exemple, il fait croire que, si les conseils ouvriers vont trop loin, les USA vont cesser toute livraison de produits alimentaires à la population affamée.
Que ce soit à travers la menace directe de l'extérieur ou par le sabotage de l'intérieur, le SPD utilise tous les moyens contre la classe ouvrière en mouvement.
Dès le départ, il s'évertue à isoler les conseils de leur base dans les usines.
Ceux-ci se composent, dans chaque entreprise, de délégués élus par les assemblées générales et qui sont responsables devant celles-ci. Si les ouvriers perdent ou abandonnent leur pouvoir de décision dans les assemblées générales, si les conseils se détachent de leur « racines », de leur « base » dans les entreprises ils sont eux-mêmes affaiblis et deviendront inévitablement les victimes de la contre-offensive de la bourgeoisie. C'est pourquoi dés le départ le SPD pousse à ce que leur composition se fasse sur la base d'une répartition proportionnelle des sièges entre les partis politiques. L'éligibilité et la révocabilité des délégués par les assemblées n'est pas un principe formel de la démocratie ouvrière, mais le levier, le « volant » avec lequel le prolétariat peut - en partant de sa plus petite cellule de vie - diriger et contrôler sa lutte. L'expérience en Russie avait déjà montré combien est essentielle l'activité des comités d'usines. Si les conseils ouvriers n'ont plus à rendre des comptes devant la classe, devant les assemblées qui les ont élus, si la classe n'est pas capable d'exercer son contrôle sur eux cela signifie que son mouvement est affaibli, que le pouvoir lui échappe.
Déjà en Russie, Lénine l'avait clairement mis en évidence :
« Pour contrôler, il faut détenir le pouvoir. (...) Si je mets au premier plan le contrôle, en masquant cette condition fondamentale, je dis une contre-vérité et je fais le jeu des capitalistes et des impérialistes. (...) Sans pouvoir, le contrôle est une phrase petite-bourgeoise creuse qui entrave la marche et la développement de la révolution. »
(Conférence d'avril, Rapport sur la situation actuelle, 7 mai, Oeuvres complètes, tome 24, p. 230)
Alors qu'en Russie, dès les premières semaines, les conseils qui s'appuyaient sur les ouvriers et les soldats disposaient d'un réel pouvoir, l'Exécutif des conseils de Berlin, lui, en est dépossédé. Rosa Luxemburg le constate avec justesse :
« L'Exécutif des conseils unis de Russie est - quoi que l'on puisse écrire contre lui - assurément une tout autre chose que l'exécutif de Berlin. L'un est la tête et le cerveau d'une puissante organisation prolétarienne révolutionnaire, l'autre est la cinquième roue du carrosse d'une clique gouvernementale crypto-capitaliste ; l'un est la source inépuisable de la toute-puissance prolétarienne, l'autre est sans force et sans orientation ; l'un est l'esprit vivant de la révolution, l'autre est son sarcophage. » (R. Luxemburg, 12 décembre 1918)
Le Congrès national des conseils
Le 23 novembre l'Exécutif de Berlin appelle à la tenue d'un congrès national des conseils à Berlin pour le 16 décembre. Cette initiative, censée réunir toutes les forces de la classe ouvrière, va en réalité être utilisée contre elle. Le SPD impose que, dans les différentes régions du Reich, soit élu un « délégué ouvrier » pour 200 000 habitants et un représentant des soldats pour 100 000 soldats, moyen par lequel la représentation des ouvriers est amoindrie alors que celle des soldats est largement majorée. Au lieu d'être un reflet de la force et de l'activité de la classe dans les usines, ce congrès national, sous l'impulsion du SPD, va échapper à l'initiative ouvrière.
De plus, selon les mêmes saboteurs, ne doivent être désignés « délégués ouvriers » que les « travailleurs manuels et intellectuels ». Ainsi tous les fonctionnaires du SPD et des syndicats sont présentés avec la « mention de leur profession » ; par contre les membres de la Ligue Spartakus, qui apparaissent ouvertement, sont exclus. En utilisant toutes les ficelles possibles les forces de la bourgeoisie réussissent à s'imposer tandis que les révolutionnaires, qui agissent à visage découvert, se voient interdits de parole.
Lorsque le congrès des conseils se réunit le 16 décembre il rejette, en premier lieu, la participation des délégués russes. « L'assemblée générale réunie le 16 décembre ne traite pas de délibérations internationales mais seulement d'affaires allemandes dans lesquelles les étrangers ne peuvent bien sûr pas participer... La délégation russe n'est rien d'autre qu'un représentant de la dictature bolchevik. » Telle est la justification que donne le Vorwærts n°340 (11 décembre1918). En faisant adopter cette décision, le SPD prive d'emblée la conférence de ce qui aurait du être son caractère le plus fondamental : être l'expression de la révolution prolétarienne mondiale qui avait commencé en Russie.
Dans la même logique de sabotage et de dévoiement, le SPD fait voter l'appel à l'élection d'une assemblée constituante pour le 19 janvier 1919.
Les Spartakistes, ayant compris la manoeuvre, appellent à une manifestation de masse devant le congrès. Plus de 250 000 manifestants se rassemblent sous le mot d'ordre :« Pour les conseils ouvriers et de soldats, non à l'assemblée nationale ! »
Alors que le congrès est en train d'agir contre les intérêts de la classe ouvrière, Liebknecht s'adresse aux participants de la manifestation : « Nous demandons au congrès qu'il prenne tout le pouvoir politique dans ses mains pour réaliser le socialisme et qu'il ne le transfère pas à la constituante qui ne sera nullement un organe révolutionnaire. Nous demandons au congrès des conseils qu'il tende la main à nos frères de classe en Russie et qu'il appelle des délégués russes à venir se joindre aux travaux du congrès. Nous voulons la révolution mondiale et l'unification de tous les ouvriers de tous les pays dans les conseils ouvriers et de soldats. » (17 décembre 1918)
Les révolutionnaires ont compris la nécessité vitale de la mobilisation des masses ouvrières, la nécessité d'exercer une pression sur les délégués, d'en élire de nouveaux, de développer l'initiative des assemblées générales dans les usines, de défendre l'autonomie des conseils contre l'assemblée nationale bourgeoise, d'insister sur l'unification internationale de la classe ouvrière.
Mais, même après cette manifestation massive, le congrès continue de rejeter la participation de Rosa Luxemburg et de Karl Liebknecht, sous prétexte qu'ils ne sont pas ouvriers, alors que la bourgeoisie, elle, a déjà réussi à faire pénétrer ses hommes dans les conseils. Pendant le congrès les représentants du SPD défendent l'armée pour la protéger d'un délitement encore plus grand par les conseils de soldats. Le congrès décide également de ne plus recevoir aucune délégation d'ouvriers et de soldats pour ne plus devoir se plier à leur pression.
A la fin de ses travaux, il va jusqu'à accentuer la confusion en déblatérant sur de prétendues premières mesures de socialisation alors que les ouvriers n'ont même pas encore pris le pouvoir. « Réaliser des mesures socio-politiques dans des entreprises individuelles, isolées est une illusion, tant que la bourgeoisie a encore le pouvoir politique dans ses mains. » (IKD, Der Kommunist). La question centrale du désarmement de la contre-révolution et du renversement du gouvernement bourgeois, tout cela est mis de côté.
Que doivent faire les révolutionnaires contre un tel développement ?
Le 16 décembre à Dresde, Otto Rühle, qui a entre-temps viré au conseillisme, jette l'éponge vis à vis du conseil ouvrier et de soldats local dès que les forces social-démocrates de la ville ont pris le dessus. Les Spartakistes, par contre, n'abandonnent pas le terrain à l'ennemi. Après avoir dénoncé le congrès national des conseils, ils en appellent à l'initiative de la classe ouvrière :
« Le congrès des conseils a outrepassé ses pleins pouvoirs, il a trahi le mandat qui lui avait été remis par les conseils d'ouvriers et de soldats, il a supprimé le sol sur lequel son existence et son autorité étaient fondées. Les conseils d'ouvriers et de soldats vont désormais développer leur pouvoir et défendre leur droit à l'existence avec une énergie décuplée. Ils déclareront nulle et non avenue l'oeuvre contre-révolutionnaire de leurs hommes de confiance indignes. » (Rosa Luxemburg, Les Mamelouks d'Ebert, 20 décembre 1918)
Le sang de la révolution c'est l'activité des masses
La responsabilité des Spartakistes est de pousser en avant l'initiative des masses, d'intensifier leurs activités. C'est cette orientation qu'ils vont mettre en avant dix jours plus tard lors du congrès de fondation du KPD. Nous reprendrons les travaux de ce congrès de fondation dans un prochain article.
Les Spartakistes ont, en effet, compris que le pouls de la révolution bat dans les conseils ; la révolution prolétarienne est la première révolution qui est faite par la grande majorité de la population, par la classe exploitée. Contrairement aux révolutions bourgeoises qui peuvent être faites par des minorités, la révolution prolétarienne peut seulement être victorieuse si elle est constamment alimentée, nourrie et poussée en avant par la source de l'activité de toute la classe. Les délégués des conseils, les conseils ne sont pas une partie isolée de la classe qui peut et doit s'isoler, voire se protéger de celle-ci, ou qui devrait tenir le reste de la classe dans la passivité. Non, la révolution peut seulement avancer par la participation consciente, vigilante, active et critique de la classe.
Pour la classe ouvrière en Allemagne, cela signifie, à ce moment-là, qu'elle doit entrer dans une nouvelle phase où il lui faut renforcer la pression à partir des usines. Quant aux Communistes, leur agitation dans les conseils locaux est la priorité absolue. Ainsi les Spartakistes suivent la politique que Lénine avait déjà prônée en avril 1917 lorsque la situation en Russie était comparable à celle que connaît l'Allemagne : « Expliquer aux masses que les Soviets des députés ouvriers sont la seule forme possible de gouvernement révolutionnaire, et que, par conséquent, notre tâche, tant que ce gouvernement se laisse influencer par la bourgeoisie, ne peut être que d'expliquer patiemment, systématiquement, opiniâtrement aux masses les erreurs de leur tactique, en partant essentiellement de leurs besoins pratiques.
Tant que nous sommes en minorité, nous nous appliquons à critiquer et à expliquer les erreurs commises, tout en affirmant la nécessité du passage de tout le pouvoir aux Soviets des députés ouvriers, afin que les masses s'affranchissent de leurs erreurs par l'expérience. » (Thèses d'avril, n°4)
Nous ne pouvons pas vraiment comprendre la dynamique dans les conseils si nous n'analysons pas de plus près le rôle des soldats.
Le mouvement révolutionnaire de la classe a été initié par la lutte contre la guerre. Mais c'est fondamentalement le mouvement de résistance des ouvriers dans les usines qui « contamine » les millions de prolétaires en uniforme qui se trouvent sur le front (le pourcentage d'ouvriers parmi les soldats est beaucoup plus élevé en Allemagne qu'il ne l'était en Russie). Finalement les mutineries de soldats ainsi que les soulèvements des ouvriers dans les usines créent un rapport de forces obligeant la bourgeoisie à mettre terme à la guerre. Tant que la guerre dure, les ouvriers en uniforme sont les meilleurs alliés des ouvriers en lutte à l'arrière. C'est grâce à leur résistance croissante qu'un rapport de forces favorable est créé sur le front intérieur ; comme le rapporte Liebknecht : « ceci avait eu comme conséquence la déstabilisation dans l'armée. Mais dés que la bourgeoisie mit fin à la guerre une scission au sein de l'armée se fit jour. La masse des soldats est révolutionnaire contre le militarisme, contre la guerre et contre les représentants ouverts de l'impérialisme. Par rapport au socialisme, elle est encore indécise, hésitante, immature. » (Liebknecht, 19 novembre 1918) Tant que perdure la guerre et que les troupes restent encore mobilisées, des conseils de soldats sont formés.
« Les conseils de soldats sont l'expression d'une masse composée de toutes les classes de la société, au sein de laquelle le prolétariat l'emporte sans doute de loin, mais certainement pas le prolétariat conscient des buts et disposé à la lutte de classe. Ils sont souvent formés directement d'en haut par l'entremise des officiers et des cercles de la haute noblesse, qui, ainsi, s'adaptant adroitement, cherchaient à conserver leur influence sur les soldats en se faisant élire comme leurs représentants. » (Liebknecht, 21 novembre 1918)
En tant que telle l'armée est un instrument classique de répression et de conquête impérialiste, contrôlée et dirigée par des officiers soumis à l'Etat exploiteur. Dans une situation révolutionnaire, où des milliers de soldats sont en effervescence, où les rapports hiérarchiques classiques ne sont plus respectés, mais où les ouvriers en uniforme décident collectivement, tout cela peut entraîner la désagrégation de l'armée d'autant plus qu'ils sont armés. Mais pour atteindre une telle situation, il faut que la classe ouvrière, par son mouvement, soit un pôle de référence suffisamment fort pour les soldats.
Lors de la phase finale de la guerre cette dynamique existe. C'est pour cela que la bourgeoisie, sentant ce danger se développer, arrête la guerre pour empêcher une radicalisation encore plus importante. La nouvelle situation ainsi créée permet à la classe dominante de « calmer » les soldats et de les éloigner de la révolution alors que, de son côté, le mouvement de la classe ouvrière n'est pas encore suffisamment fort pour attirer de son côté la majorité d'entre eux. Cela permettra à la bourgeoisie de mieux manipuler les soldats à sa faveur.
Si pendant la phase ascendante du mouvement les soldats ont eu un poids important et, en fait, étaient indispensables pour mettre un terme à la guerre, leur rôle va changer quand la bourgeoisie engage sa contre-offensive.
L'oeuvre révolutionnaire ne peut se réaliser qu'internationalement
Alors que les capitalistes se sont combattus quatre années durant dans la guerre et ont sacrifié des millions de vies humaines, immédiatement après l'éclatement de la révolution en Russie et surtout lorsque le prolétariat en Allemagne commence à se lancer à l'assaut, ils se retrouvent unis contre la classe ouvrière. Les Spartakistes comprennent quel danger il peut résulter de l'isolement de la classe ouvrière en Russie et en Allemagne. Le 25 novembre ils lancent l'appel suivant :
« Aux prolétaires de tous les pays ! L'heure des comptes avec la domination capitaliste a sonné. Mais cette grande tâche ne peut pas être accomplie par le seul prolétariat allemand. Il ne peut lutter et vaincre qu'en faisant appel à la solidarité des prolétaires du monde entier. Camarades des pays belligérants, nous connaissons votre situation. Nous savons bien que vos gouvernements, parce qu'ils ont obtenu la victoire, aveuglent maintes parties du peuple de l'éclat de la victoire. (...) Vos capitalistes victorieux se tiennent prêts à abattre dans le sang notre révolution qu'ils craignent tout autant que la Vôtre. La "victoire" ne Vous a Vous-mêmes pas rendus plus libres, elle n'a fait que Vous rendre plus esclaves. Si Vos classes dominantes réussissent à étrangler la révolution prolétarienne en Allemagne et en Russie, elles se retourneront contre Vous avec une férocité redoublée. (...) L'Allemagne accouche de la révolution sociale mais seul le prolétariat mondial peut réaliser le socialisme. » (Aux prolétaires de tous les pays, Spartakusbund, 25 novembre 1918).
Alors que le SPD met tout en oeuvre pour séparer les ouvriers d'Allemagne de ceux de Russie, les révolutionnaires s'engagent de toutes leurs forces pour l'unification de la classe ouvrière.
A cet égard les Spartakistes sont conscients qu' « Aujourd'hui il règne naturellement parmi les peuples de l'Entente une puissante griserie de la victoire ; et la liesse à propos de la ruine de l'impérialisme allemand et de la libération de la France et de la Belgique est si bruyante que nous n'attendons pas pour le moment d'écho révolutionnaire de la part de la classe ouvrière de nos ennemis jusqu'à ce jour. » (Liebknecht, 23 décembre 1918) Ils savent que la guerre a creusé une dangereuse division dans les rangs de la classe ouvrière. Les défenseurs du Capital, notamment le SPD, commencent à dresser les ouvriers en Allemagne contre ceux des autres pays. Ils brandissent même la menace d'interventions étrangères. Tout cela a depuis lors été souvent utilisé par la classe dominante.
La bourgeoisie a tiré les leçons de la Russie
La signature par la bourgeoisie, sous la direction du SPD, de l'armistice mettant fin à la guerre le 11 novembre, par crainte que la classe ouvrière ne poursuive sa radicalisation et n'emprunte « les voies russes », inaugure une nouvelle situation.
Comme le dit R. Müller, l'un des principaux membres des « Délégués » révolutionnaires : « L'ensemble de la politique de guerre avec tous ses effets sur la situation des ouvriers, l'Union Sacrée avec la bourgeoisie, tout ce qui avait attisé la colère noire des ouvriers était oublié. »
La bourgeoisie a tiré les leçons de la Russie. Si la bourgeoisie de ce pays avait mis fin à la guerre en avril ou mars 1917, la révolution d'octobre n'aurait sûrement pas été possible ou en tous cas aurait été bien plus difficile. Il est donc nécessaire d'arrêter la guerre pour espérer couper l'herbe sous le pied du mouvement révolutionnaire de la classe. Là aussi les ouvriers en Allemagne se trouvent face à une situation différente de celle qu'ont connue leurs frères de classe de Russie.
Les Spartakistes comprennent que la fin de la guerre constitue un tournant dans les luttes et que l'on ne doit pas s'attendre à une victoire immédiate contre le Capital.
« Si l'on se situe sur le terrain du développement historique, on ne peut pas, dans une Allemagne qui a offert l'image épouvantable du 4 août et des quatre années qui ont suivi, s'attendre à voir surgir soudain le 9 novembre 1918 une révolution de classe grandiose et consciente de ses buts ; ce que nous a fait vivre le 9 novembre, c'était pour les trois-quarts plus l'effondrement de l'impérialisme existant, plutôt que la victoire d'un principe nouveau. Simplement pour l'impérialisme, colosse aux pieds d'argile, pourri de l'intérieur, l'heure était venue, il devait s'écrouler ; ce qui suivit fut un mouvement plus ou moins chaotique sans plan de bataille, très peu conscient ; le seul lien cohérent, le seul principe constant et libérateur était résumé dans le mot d'ordre : création de conseils d'ouvriers et de soldats. » (Congrès de fondation du KPD, R. Luxemburg)
C'est pourquoi il ne faut pas confondre le début du mouvement avec son terme, son but final, car « aucun prolétariat dans le monde, même le prolétariat allemand, ne peut du jour au lendemain se débarrasser des stigmates d'un asservissement millénaire. Pas plus politiquement que spirituellement, la situation du prolétariat trouve son état le plus élevé le PREMIER jour de la révolution. Ce ne sont que les luttes de la révolution qui élèveront en ce sens le prolétariat à sa complète maturité. » (R. Luxemburg, 3 décembre 1918)
Le poids du passé
Les causes de ces grandes difficultés de la classe se trouvent, à juste titre selon les Spartakistes, dans le poids du passé. La confiance encore très importante que beaucoup d'ouvriers ont envers la politique du SPD est une dangereuse faiblesse. Nombreux sont ceux qui considèrent que la politique de guerre de ce parti était grandement due à un déboussolement passager. Bien plus encore, pour eux la guerre n'est le résultat que d'une manigance ignoble de la clique gouvernementale qui vient d'être renversée. Et se souvenant de la situation tant soit peu supportable qu'ils connaissaient dans la période d'avant-guerre, ils espérant se sortir bientôt et définitivement de la misère présente. D'ailleurs, les promesses de Wilson annonçant l'union des nations et la démocratie semblent offrir des garanties contre de nouvelles guerres. La république démocratique qui leur est « proposée » n'apparaît pas, à leurs yeux, comme la république bourgeoise mais comme le terrain duquel va éclore le socialisme. Bref, la pression des illusions démocratiques, le manque d'expérience dans la confrontation avec les saboteurs que sont les syndicats et le SPD sont déterminants.
« Dans toutes les révolutions antérieures, les combattants s'affrontaient de façon ouverte, classe contre classe, programme contre programme, épée contre bouclier. (...) (Auparavant) c'était toujours des partisans du système renversé ou menacé qui, au nom de ce système et dans le but de le sauver, prenaient des mesures contre-révolutionnaires. (...) Dans la révolution d'aujourd'hui les troupes qui défendent l'ordre ancien se rangent non sous leur propre drapeau et dans l'uniforme de la classe dominante, mais sous le drapeau du parti social-démocrate. (...) La domination de classe bourgeoise mène aujourd'hui sa dernière lutte historique mondiale sous un drapeau étranger, sous le drapeau de la révolution elle-même. C'est un parti socialiste, c'est à dire la création la plus originale du mouvement ouvrier et de la lutte des classe qui s'est lui-même transformé en instrument le plus important de la contre-révolution bourgeoise. Le fond, la tendance, la politique, la psychologie, la méthode, tout cela est capitaliste de bout en bout. Seuls restent le drapeau, l'appareil et la phraséologie du socialisme. » (R. Luxemburg, Une victoire à la Pyrrhus, 21 décembre 1918)
On ne peut formuler plus clairement le caractère contre-révolutionnaire du SPD.
C'est pourquoi les Spartakistes définissent la prochaine étape du mouvement ainsi : « Le passage de la révolution de soldats prédominante le 9 novembre 1918 à une révolution ouvrière spécifique, le passage d'un bouleversement superficiel, purement politique à un processus de longue haleine d'une confrontation économique générale entre le Travail et le Capital, réclame de la classe ouvrière révolutionnaire un tout autre degré de maturité politique, d'éducation et de ténacité que celui qui a suffi pour la première phase du début. » (R. Luxemburg, 3 janvier 1919)
Le mouvement de début novembre n'a sans doute pas été uniquement une « révolution de soldats » car, sans les ouvriers dans les usines, les soldats ne seraient jamais parvenu à une telle radicalisation. Les Spartakistes voient la perspective d'un véritable pas en avant lorsque, dans la seconde moitié de novembre et en décembre, des grèves éclatent dans la Ruhr et en Haute Silésie. Cela révèle une activité de la classe ouvrière dans les usines mêmes, un recul du poids de la guerre et du rôle des soldats. Après la fin des hostilités, l'effondrement de l'économie conduit à une détérioration encore plus importante des conditions de vie de la classe ouvrière. Dans la Ruhr de nombreux mineurs cessent le travail et pour imposer leurs revendications ils se rendent souvent dans les autres mines afin de trouver la solidarité de leurs frères de classe et construire ainsi un front puissant. Les luttes vont ainsi se développer, connaître des reculs pour se redévelopper avec une nouvelle force.
« Dans la révolution d'aujourd'hui les grèves qui viennent d'éclater (...) sont le tout début d'un affrontement général entre Capital et Travail, elles annoncent le commencement d'une lutte de classe puissante et directe, dont l'issue ne saurait être autre que l'abolition des rapports du salariat et l'introduction de l'économie socialiste. Elles sont le déclenchement de la force sociale vivante de la révolution actuelle : l'énergie de classe révolutionnaire des masses prolétariennes. Elles ouvrent une période d'activité immédiate des masses les plus larges. »
C'est pourquoi, R. Luxemburg souligne justement :
« Suite à la première phase de la révolution, celle de la lutte principalement politique, vient la phase de lutte renforcée, intensifiée essentiellement économique. (...) Dans la phase révolutionnaire à venir, non seulement les grèves s'étendront de plus en plus, mais elles se trouveront au centre, au point décisif de la révolution, refoulant les questions purement politiques. » (R. Luxemburg, Congrès de fondation du KPD)
Après que la bourgeoisie ait mis fin à la guerre sous la pression de la classe ouvrière, qu'elle soit passée à l'offensive pour parer les premières tentatives de prise de pouvoir par le prolétariat, le mouvement entre dans une nouvelle étape. Ou bien la classe ouvrière est en mesure de développer une nouvelle force de poussée à l'initiative des ouvriers dans les usines et de parvenir à « passer à une révolution ouvrière spécifique », ou bien la bourgeoisie pourra poursuivre sa contre-offensive.
Nous aborderons dans le prochain article la question de l'insurrection, les conceptions fondamentales de la révolution ouvrière, le rôle que doivent y jouer les révolutionnaires et qu'ils y ont effectivement joué.
DV.
Géographique:
- Allemagne [98]
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Allemande [1955]
Conscience et organisation:
Approfondir:
- Révolution Allemande [1957]
Heritage de la Gauche Communiste:
- La Révolution prolétarienne [1149]
Réponse au BIPR [l° partie] : La nature de la guerre impérialiste
- 4020 reads
Le BIPR a répondu à notre article de polémique «La conception du BIPR sur la décadence du capitalisme» (Revue Internationale n° 79) dans l’Internationalist Communist Review n 13. Cette réponse expose les positions de façon réfléchie. En ce sens, c'est une contribution au nécessaire débat qui doit exister entre les organisations de la Gauche communiste qui ont une responsabilité décisive dans la construction du parti communiste du prolétariat.
Le débat entre le BIPR et le CCI se situe à l'intérieur du cadre de la Gauche communiste :
- ce n'est pas un débat académique et abstrait, mais il constitue une polémique militante pour nous doter de positions claires, épurées de toute ambiguïté ou concession à l'idéologie bourgeoise, et en particulier, sur des questions telles que la nature des guerres impérialistes ou les fondements matériels de la nécessité de la révolution communiste ;
- c'est un débat entre partisans de l'analyse de la décadence du capitalisme : depuis le début du siècle, le système est entré dans une crise sans issue qui présente une menace croissante d'anéantissement de l'humanité et de la planète.
Dans ce cadre, l'article de réponse du BIPR insiste sur leur vision de la guerre impérialiste comme moyen de dévalorisation du capital et reprise du cycle d'accumulation, et justifie cette position par une explication de la crise historique du capitalisme basée sur la baisse tendancielle du taux de profit.
Ces deux questions sont l'objet de notre réponse. ([1] [2057])
Ce qui nous unit avec le BIPR
Dans une polémique entre révolutionnaires, à cause précisément de son caractère militant, nous devons partir de ce qui nous unit afin d'aborder, dans ce cadre global, ce qui nous sépare. C'est la méthode qu'a toujours appliqué le CCI, à la suite de Marx, Lénine, Bilan, etc., et que nous avons employée dans la polémique avec le PCI (Programma) ([2] [2058]) sur la même question que nous discutons maintenant avec le BIPR. Souligner cela nous paraît très important parce que, en premier lieu, les polémiques entre révolutionnaires ont toujours comme fil conducteur la lutte pour la clarification et le regroupement, dans la perspective de la constitution du parti mondial du prolétariat. En second lieu parce que, entre le BIPR et le CCI, sans nier ni relativiser l'importance et les conséquences des divergences que nous avons sur la compréhension de la nature de la guerre impérialiste, ce que nous partageons est beaucoup plus important :
1. Pour le BIPR, les guerres impérialistes n'ont pas des objectifs limités mais sont des guerres totales dont les conséquences dépassent de loin celles qu'elles pouvaient avoir dans la période ascendante.
2. Les guerres impérialistes unissent les facteurs économiques et politiques en un tout inséparable.
3. Le BIPR rejette l'idée selon laquelle le militarisme et la production d'armement seraient des moyens de « l'accumulation du capital ». ([3] [2059])
4. En tant qu'expression de la décadence du capitalisme, les guerres impérialistes contiennent la menace de la destruction de l'humanité.
5. Il existe actuellement dans le capitalisme des tendances importantes au chaos et à la décomposition (même si, comme nous le verrons plus loin, le BIPR ne leur accorde pas la même importance que nous).
Ces éléments de convergence expriment la capacité commune que nous avons de dénoncer et de combattre les guerres impérialistes comme moments ultimes de la crise historique du capitalisme, engageant le prolétariat à ne pas choisir entre les différents loups impérialistes, appelant à la révolution prolétarienne mondiale comme seule solution à l'impasse sanglante à laquelle le capitalisme conduit l'humanité, combattant à mort les endormeurs pacifistes et dénonçant les mensonges capitalistes selon lesquels « nous sommes en train de sortir de la crise. »
Ces éléments, expression et patrimoine commun de la Gauche communiste, rendent nécessaire et possible que, face à des événements d'envergure comme les guerres du Golfe ou de l'ex-Yougoslavie, les groupes de la Gauche communiste fassent des manifestes communs qui expriment, face à la classe, la voix unie des révolutionnaires. C'est pour cela que nous avions proposé, dans le cadre des Conférences internationales de 1977-80, de faire une déclaration commune face à la guerre d'Afghanistan et nous avons regretté que ni BC, ni la CWO (qui plus tard constituèrent le BIPR) n'acceptent cette initiative. Loin d'être une proposition « d'union circonstancielle et opportuniste », ces initiatives communes sont des instruments de la lutte pour la clarification et la délimitation des positions au sein de la Gauche communiste, parce qu'elles établissent un cadre concret et militant (l'engagement aux côtés de la classe ouvrière face à des situations importantes de l'évolution historique) dans lequel il est possible de débattre sérieusement des divergences. Ce fut la méthode de Marx et de Lénine à Zimmerwald. Alors qu'il existait des divergences beaucoup plus importantes que celles qui peuvent exister aujourd'hui entre le CCI et le BIPR, Lénine a accepté de souscrire au Manifeste de Zimmerwald. D'autre part, au moment de la constitution de la 3e Internationale, il y avait entre les fondateurs des désaccords importants, non seulement sur l'analyse de la guerre impérialiste, mais aussi sur des questions comme l'utilisation du parlement ou des syndicats et pourtant, cela ne les empêcha pas de s'unir pour combattre pour la révolution mondiale qui était en marche. Ce combat en commun ne fut pas le moyen de faire taire les divergences, mais au contraire donna la plate-forme militante au sein de laquelle les aborder de façon sérieuse et non de façon académique, ou selon des impulsions sectaires.
La fonction de la guerre impérialiste
Les divergences entre Le BIPR et le CCI ne portent pas sur les causes générales de la guerre impérialiste. Nous en tenant au patrimoine commun de la Gauche communiste, nous voyons la guerre impérialiste comme expression de la crise historique du capitalisme. Cependant, la divergence surgit au moment de voir le rôle de la guerre au sein du capitalisme décadent. Le BIPR pense que la guerre remplit une fonction économique : permettre une dévalorisation du capital et, en conséquence, ouvrir la possibilité que le capitalisme entreprenne un nouveau cycle d'accumulation.
Cette appréciation paraît complètement logique : n'y a-t-il pas, avant une guerre mondiale, une crise générale, comme en 1929 par exemple ? Crise de surproduction d'hommes et de marchandises. La guerre impérialiste n'est-elle pas une « solution » en détruisant en grand nombre des ouvriers, des machines et des bâtiments ? Après cela, la reconstruction ne reprend-elle pas et, avec elle, le dépassement de la crise ? Pourtant, cette vision, apparemment si simple et cohérente, est profondément superficielle. Elle saisit - comme nous verrons plus loin - une partie du problème (effectivement, le capitalisme décadent se meut dans un cycle infernal de crise - guerre - reconstruction -nouvelle crise, etc) mais cela n'aborde pas le fond du problème : d'une part, la guerre est beaucoup plus qu'un simple moyen de rétablissement du cycle de l'accumulation capitaliste et, d'autre part, ce cycle se trouve profondément perverti et dégénéré, et il est très loin d'être un cycle classique de la période ascendante.
Cette vision superficielle de la guerre impérialiste a des conséquences militantes importantes que le BIPR n'est pas capable de percevoir. En effet, si la guerre permet de rétablir le mécanisme de l'accumulation capitaliste, en réalité cela veut dire que le capitalisme pourra toujours sortir de la crise à travers le mécanisme douloureux et brutal de la guerre. C'est la vision, qu'au fond, nous propose la bourgeoisie : la guerre est un moment horrible que n'apprécie aucun gouvernant, mais c'est le moyen inévitable qui permet de retrouver une nouvelle ère de paix et de prospérité.
Le BIPR dénonce ces supercheries mais il ne se rend pas compte que cette dénonciation se trouve affaiblie par sa théorie de la guerre comme « moyen de dévalorisation du capital ». Pour comprendre les conséquences dangereuses qu'entraîné sa position, il faut examiner cette déclaration du PCI (Programma) : « La crise tire son origine de l'impossibilité de poursuivre l'accumulation, impossibilité qui se manifeste quand l'accroissement de la masse de production ne réussit plus à compenser la chute du taux de profit. La masse du surtravail total n'est plus à même d'assurer du profit au capital avancé, de reproduire les conditions de rentabilité des investissements. En détruisant du capital constant (travail mort) à grande échelle, la guerre joue alors un rôle économique fondamental : grâce aux épouvantables destructions de l'appareil productif, elle permet en effet une future expansion gigantesque de la production pour remplacer ce qui a été détruit, donc une expansion parallèle du profit, de la plus-value totale, c'est-à-dire du surtravail dont est friand le capital. Les conditions de reprise du processus d'accumulation sont rétablies. Le cycle économique repart. (...) Le système capitaliste mondial, entre vieux dans la guerre, mais y trouve un bain de jouvence dans le bain de sans qui lui donne une nouvelle jeunesse et il en ressort avec la vitalité d'un robuste nouveau-né. » ([4] [2060])
Dire que le capitalisme « retrouve la jeunesse » chaque fois qu'il sort d'une guerre mondiale comporte quelques claires conséquences révisionnistes : la guerre mondiale ne mettrait pas à l'ordre du jour la nécessité de la révolution prolétarienne mais la reconstruction d'un capitalisme revenu à ses origines. C'est mettre par terre l'analyse de la 3e Internationale qui disait clairement : « une nouvelle époque surgit. Epoque de désagrégation du capitalisme, de son effondrement intérieur. Epoque de la révolution communiste du prolétariat. » Cela signifie, purement et simplement, rompre avec une position fondamentale du marxisme : le capitalisme n'est pas un système éternel, mais un mode de production auquel les limites historiques imposent une époque de décadence dans laquelle la révolution communiste est à l'ordre du jour.
Cette déclaration, nous la citons et nous la critiquons dans notre polémique sur la conception de la guerre et de la décadence du PCI (Programma) dans la Revue Internationale n° 77 et 78. Cela est ignoré par le BIPR qui, dans sa réponse, semble défendre le PCI (Programma) quand il affirme : « Leur débat avec les bordiguistes se centre sur un point de vue apparent selon lequel il existe un rapport mécanique entre guerre et cycle d'accumulation. Nous disons "apparent" parce que, comme d'habitude, le CCI ne donne aucune citation montrant que la vision historique des bordiguistes serait aussi schématique. Nous sommes peu enclins à accepter leurs assertions sur Programme Communiste au vu de la manière dont ils interprètent nos points de vue. » ([5] [2061])
La citation que nous donnons dans la Revue Internationale n° 77 parle d'elle-même et met en évidence que, dans la position du PCI (Programma), il y a un peu plus que du « schématisme » : si le BIPR prend la tangente avec des pleurnicheries sur nos « mauvaises interprétations » c'est parce que, sans oser reprendre les aberrations du PCI (Programma), ses ambiguïtés y conduisent : « Nous disons, nous, que la fonction (souligné dans l'original) économique de la guerre mondiale (c'est-à-dire ses conséquences pour le capitalisme) est de dévaloriser le capital comme prélude nécessaire pour un possible nouveau cycle d'accumulation. » ([6] [2062])
Cette vision de la «fonction économique de la guerre impérialiste » vient de Boukharine. Celui-ci, dans un livre qu'il écrivit en 1915 (L'économie mondiale et l’impérialisme) et qui constitue un apport sur des questions comme le capitalisme d'Etat ou la libération nationale, glisse cependant vers une erreur importante en voyant les guerres impérialistes comme un instrument de développement capitaliste : « la guerre ne peut arrêter le cours général du développement du capitalisme mondial mais, au contraire, elle est l'expression de l'expansion au maximum du processus de centralisation... La guerre rappelle, par son influence économique, sur beaucoup d'aspects, les crises industrielles desquelles elle se distingue, de beaucoup, par l'intensité supérieure des commotions et des ravages qu'elle produit. » ([7] [2063])
La guerre impérialiste n'est pas un moyen de « dévalorisation du capital » mais une expression du processus historique de destruction, de stérilisation de moyens de production et de vie, qui caractérise globalement le capitalisme décadent.
Destruction et stérilisation de capital n'est pas la même chose que dévalorisation de capital. La période ascendante du capitalisme comportait des crises cycliques périodiques qui conduisaient à des dévalorisations périodiques de capitaux. C'est le mouvement signalé par Marx : « En même temps que baisse le taux de profit, la masse de capital s'accroît. Parallèlement se produit une dépréciation du capital existant qui arrête cette baisse et imprime un mouvement plus rapide à l'accumulation de valeur-capital. .. La dépréciation périodique du capital existant, qui est un moyen immanent au mode de production capitaliste, d'arrêter la baisse du taux de profit et d'accélérer l'accumulation de valeur-capital par la formation de capital neuf, perturbe les conditions données, dans lesquelles s'accomplissent les procès de circulation et de reproduction du capital et, par suite, s'accompagne de brusques interruptions et de crises du procès de production. » ([8] [2064])
Le capitalisme, par sa nature même, depuis ses origines, aussi bien dans la période ascendante que dans la période décadente, tombe constamment dans la surproduction et, en ce sens, les périodes de ponction de capital lui sont nécessaires pour reprendre avec plus de force son mouvement normal de production et de circulation de marchandises. Dans la période ascendante, chaque étape de dévalorisation de capital se résolvait par une expansion à une échelle supérieure des rapports de productions capitalistes. Et cela était possible parce que le capitalisme trouvait des nouveaux territoires pré-capitalistes qu'il pouvait intégrer dans sa sphère et soumettre aux rapports salariaux et mercantiles qui lui sont propres. Pour cette raison « les crises du 19e siècle que Marx décrit sont encore des crises de croissance, des crises dont le capitalisme sort à chaque fois renforcé... Après chaque crise, il y a encore des débouchés nouveaux à conquérir par les pays capitalistes. » ([9] [2065])
Dans la période décadente, ces crises de dévalorisation du capital se poursuivent et deviennent plus ou moins chroniques ([10] [2066]). Cependant, à cet aspect inhérent et consubstantiel du capitalisme, se superpose une autre caractéristique de sa période de décadence et qui est le fruit de l'aggravation extrême des contradictions que contient cette époque : la tendance à la destruction et à la stérilisation de capital.
Cette tendance provient de la situation de blocage historique qui détermine l'époque de décadence du capitalisme : « Qu'est-ce que la guerre impérialiste mondiale ? C'est la lutte par des moyens violents, à laquelle sont obligés de se livrer les différents groupes capitalistes, non pour conquérir de nouveaux marchés et sources de matières premières, mais pour le repartage de ceux qui existent, un repartage au bénéfice de certains et au détriment des autres. Le cours à la guerre s'ouvre, et a ses racines, dans la crise économique générale et permanente qui éclate, et marque par là la fin des possibilités de développement à laquelle a conduit le régime capitaliste. » Dans le même sens « le capitalisme décadent est la phase dans laquelle la production ne peut plus continuer qu'à condition (souligné dans l'original) de prendre la forme matérielle de produits et moyens de production qui ne servent pas au développement et à l'amplification de la production mais à sa limitation et à sa destruction. » ([11] [2067])
Dans la décadence, le capitalisme ne change, en aucune façon, de nature. Il continue à être un système d'exploitation, il continue d'être affecté (à une échelle bien supérieure) par la tendance à la dépréciation du capital (tendance qui devient permanente). Cependant, l'essentiel de la décadence est le blocage historique du système duquel naît une tendance puissante à l'autodestruction et au chaos : « L'absence d'une classe révolutionnaire présentant la possibilité historique d'engendrer et de présider à l'instauration d'un système économique correspondant à la nécessité historique, conduit la société et sa civilisation à une impasse où l'écroulement, l'effondrement interne, sont inévitables. Marx donnait comme exemples d'une telle impasse historique les civilisations Grecque et Romaine dans l'antiquité. Engels, appliquant cette thèse à la société bourgeoise, arrive à la conclusion que l'absence ou l'incapacité du prolétariat appelé à résoudre, dépasser, les contradictions antithétiques qui surgissent de la société capitaliste, ne peut aboutir qu'au retour à la barbarie. » ([12] [2068])
La position de l'Internationale Communiste sur la guerre impérialiste
Le BIPR ironise sur notre insistance sur ce trait crucial du capitalisme décadent : « Pour le CCI tout se réduit au "chaos" et à la "décomposition" et avec eux on n'a pas besoin de trop s'embarrasser d'une analyse détaillée des choses. C'est la clé de leur position. » ([13] [2069]) Nous reviendrons sur cette question, cependant, nous voulons préciser sur cette accusation de simplisme que, ce qu'elle suppose de l'avis du BIPR (une négation du marxisme comme méthode d'analyse de la réalité!), ce dernier devrait l'appliquer au 1er congrès de l'IC, à Lénine et à Rosa Luxemburg.
Ce n'est pas l'objet de cet article de mettre en évidence les limites de la position de l'IC ([14] [2070]), mais de nous appuyer sur les points clairs de celle-ci. En examinant les documents fondateurs de l'Internationale Communiste, nous y voyons des indications claires rejetant l'idée de la guerre comme « solution » à la crise capitaliste et la vision d'un capitalisme d'après-guerre qui fonctionne « normalement » suivant les cycles d'accumulation propres à sa période d'ascendance.
« La politique de paix de l'Entente dévoile ici définitivement aux yeux du prolétariat international la nature de l'impérialisme de l'Entente et de l'impérialisme en général. Elle prouve en même temps que les gouvernements impérialistes sont incapables de conclure une paix 'juste et durable" et que le capital financier est incapable de rétablir l'économie détruite. Le maintien de la domination du capital financier mènerait soit à la destruction totale de la société civilisée ou à l'augmentation de l'exploitation, de l'esclavage, de la réaction politique, des armements et finalement à de nouvelles guerres destructrices. » ([15] [2071])
L'IC établit clairement que le capital ne peut pas rétablir l'économie détruite, c'est-à-dire qu'il ne peut pas rétablir, par la guerre, un cycle d'accumulation « normal », sain, qu'il ne peut pas trouver en somme une « nouvelle jeunesse » comme le dit le PCI (Programma). Qui plus est, au lieu provoquer un « rétablissement », cette situation profondément viciée et altérée permet le développement « des armements, de la réaction politique, de l'accroissement de l'exploitation. »
Dans le Manifeste du 1er congrès, l'IC explique que : « La répartition des matières premières, l'exploitation du naphte de Bakou ou de Roumanie, de la houille du Donetz, du froment d'Ukraine, l'utilisation des locomotives, des wagons et des automobiles d'Allemagne, l'approvisionnement en pain et en viande de l'Europe affamée, toutes ces questions fondamentales de la vie économiques du monde ne sont plus réglées par la libre concurrence, ni même par des combinaisons de trusts ou de consortiums nationaux et internationaux. Elles sont tombées sous le joug de la tyrannie militaire pour lui servir de sauvegarde désormais. Si l'absolue sujétion du pouvoir politique au capital financier a conduit l'humanité à la boucherie impérialiste, cette boucherie a permis au capital financier, non seulement de militariser jusqu'au bout l'Etat, mais de se militariser lui-même, de sorte au 'il ne peut plus remplir ses fonctions essentielles que par le fer et le sang. » ([16] [2072])
La perspective que trace l'IC est celle d'une « militarisation de l'économie »; question que toutes les analyses marxistes mettent en évidence comme expression de l'aggravation des contradictions capitalistes et non comme leur allégement ou leur relativisation, fussent-elles momentanées (le BIPR dans sa réponse rejette le militarisme comme moyen d'accumulation). De même l'IC insiste sur le fait que l'économie mondiale ne peut revenir à la période libérale ni même à celle des trusts, et finalement exprime une idée très importante : « le capitalisme ne put déjà plus remplir ses fonctions économiques essentielles si ce n'est au moyen du fer et du sang. » Cela ne peut s'interpréter que d'une manière : à travers la guerre mondiale, le mécanisme de l'accumulation ne peut plus fonctionner normalement, pour le faire il a besoin « du fer et du sang ».
La perspective que l'IC retient pour l'après-guerre c'est l'aggravation des guerres : « Les opportunistes qui, avant la guerre, invitaient les ouvriers à modérer leurs revendications sous le prétexte du passage progressif au socialisme et qui, pendant la guerre, les ont obligés à renoncer à la lutte de classe au nom de l'Union Sacrée et de la défense nationale, exigent du prolétariat un nouveau sacrifice, cette fois avec la proposition d'en finir avec les conséquences horribles de la guerre. Si de telles prêches parvenaient à influencer les masses ouvrières, le développement du capitalisme se poursuivrait, sacrifiant de nombreuses générations sous des formes nouvelles de sujétion, encore plus concentrées et plus monstrueuses, avec la perspective fatale d'une nouvelle guerre mondiale. » ([17] [2073])
Ce fut une tragédie historique que l'IC ne développe pas ce corps d'analyse clair et que, de plus, dans son étape de dégénérescence, elle le contredise ouvertement avec des positions insinuant la conception d'un capitalisme « revenu à la normale », réduisant les analyses sur le déclin et la barbarie du système à de simples proclamations rhétoriques. Cependant, la tâche de la Gauche communiste consiste à préciser et à détailler ces lignes générales léguées par l'IC et il est clair que, des citations ci-dessus, ne se dégage pas une orientation qui va dans le sens d'un capitalisme qui revient à un cycle constant d'accumulation -crise - guerre dévalorisante - nouvelle accumulation... mais bien dans le sens d'une économie mondiale profondément altérée, incapable de retrouver les conditions normales de l'accumulation et à deux doigts de nouvelles convulsions et destructions.
L'irrationalité de la guerre impérialiste
Cette sous-estimation de l'analyse fondamentale de l'IC (et de Rosa Luxemburg et Lénine) est manifeste dans le rejet, par le BIPR, de notre notion de l'irrationalité de la guerre : « Mais l'article du CCI altère la signification de cette affirmation (de la fonction de la guerre, ndt) parce que leur commentaire suivant est que cela signifierait que nous serions d'accord avec le fait qu'"i\ y a une rationalité dans le phénomène de la guerre mondiale". Cela impliquerait que nous voyons la destruction de valeurs comme l'objectif du capitalisme, c'est-à-dire que ce serait la cause (souligné dans l'original) directe de la guerre. Mais les causes ne sont pas la même chose que les conséquences. La classe dominante des Etats impérialistes ne va pas à la guerre consciemment pour dévaloriser le capital. » ([18] [2074])
Dans la période ascendante du capitalisme, les crises cycliques ne sont pas provoquées consciemment par la classe dominante. Pourtant, les crises cycliques ont une « rationalité économique » : elles permettent de dévaloriser le capital et, en conséquence, de reprendre l'accumulation capitaliste à un autre niveau. Le BIPR pense que les guerres mondiales de la décadence remplissent un rôle de dévalorisation du capital et de reprise de l'accumulation. C'est-à-dire qu'il leur attribue une rationalité économique de nature similaire à celle des crises cycliques de la période ascendante.
Et c'est là justement l'erreur centrale comme nous en avions averti la CWO voilà seize ans, dans notre article « Théories économiques et lutte pour le socialisme » : « On peut voir l'erreur de Boukharine répétée dans l'analyse de la CWO : "Chaque crise mène (à travers la guerre) à une dévalorisation du capital constant, élevant ainsi le taux de profit et permettant au cycle de reconstruction - le boom, dépression, guerre - de se répéter encore." RP n° 6. Ainsi pour la CWO, les crises du capitalisme décadent sont vues en terme économique, comme les crises cycliques du capitalisme ascendant répétées au plus, haut niveau.» ([19] [2075])
Le BIPR situe la différence entre ascendance et décadence uniquement dans l'amplitude des interruptions périodiques du cycle de l'accumulation : « Les causes de la guerre viennent des efforts de la bourgeoisie pour défendre ses valeurs de capital face à celles de ses rivales. Sous le capitalisme ascendant de telles rivalités s'expriment au niveau économique et entre firmes rivales. Celles qui peuvent atteindre un niveau de concentration de capital plus élevé (tendance capitaliste à la concentration et au monopole) sont en position de pousser leurs concurrents contre le mur. Cette rivalité conduit aussi à une sur-accumulation de capital qui débouchait sur les crises décennales du 20e siècle. Le capitalisme pouvait se dévaloriser à chaque crise et ainsi une nouvelle phase d'accumulation pouvait recommencer, bien que le capital soit plus centralisé et concentré... A l'époque du capitalisme monopoliste, dans laquelle la concentration a atteint le niveau de l'Etat national, l'économique et le politique s'interpénètrent dans l'étape décadente ou impérialiste du capitalisme. A cette époque, les politiques que requiert la défense des intérêts du capital impliquent les Etats eux-mêmes et aboutissent à des rivalités entre les puissances impérialistes. » ([20] [2076]) Comme conséquence de cela « les guerres impérialistes n'ont pas des objectifs aussi limités (que ceux de la période ascendante, ndt). La bourgeoisie,... une fois embarquée dans la guerre, la fait jusqu'à l'anéantissement d'une nation ou d'un bloc de nations. Les conséquences de la guerre ne se limitent pas à une destruction physique de capital, mais aussi à une dévalorisation massive du capital existant. » ([21] [2077])
Au fond de cette analyse, il y a une forte tendance à l'économisme qui ne conçoit la guerre que comme un produit immédiat et mécanique de l'évolution économique. Dans l'article de la Revue Internationale n° 79, nous montrions que la guerre a une cause économique globale (la crise historique du capitalisme), mais cela n'implique pas que chaque guerre a une motivation économique immédiate et directe. Le BIPR cherche dans la guerre du Golfe une cause économique et tombe dans le terrain de l'économisme le plus vulgaire en disant que c'est une guerre pour les puits de pétrole. Il explique également la guerre yougoslave par la soif d'on ne sait quels marchés de la part des grandes puissances. ([22] [2078]) II est vrai que par la suite, sous la pression de nos critiques et des évidences empiriques, il a corrigé ces analyses, mais cela ne l'a jamais conduit à remettre en cause cet économisme vulgaire qui ne peut pas concevoir la guerre sans une cause immédiate et mécanique de type « économique ». ([23] [2079])
Le BIPR confond rivalité commerciale et rivalité impérialiste, qui ne sont pas nécessairement identiques. La rivalité impérialiste a pour cause fondamentale une situation économique de saturation du marché mondial, mais cela ne veut pas dire qu'elle a pour origine directe la simple concurrence commerciale. Son origine est économique, stratégique et militaire, et en elle se concentrent des facteurs historiques et politiques.
De même, dans la période ascendante du capitalisme, les guerres (de libération nationale ou coloniales) si elles ont bien une finalité économique globale (la constitution de nouvelles nations ou l'expansion du capitalisme à travers la formation de colonies) ne sont pas dictées directement par des rivalités commerciales. Par exemple, la guerre franco-prussienne avait des origines dynastiques et stratégiques mais ne venait ni d'une crise commerciale insoluble pour aucun belligérants ni d'une particulière rivalité commerciale. Cette question, le BIPR est capable de la comprendre jusqu'à un certain point quand il dit : « Même si les guerres post-napoléoniennes du 19e siècle avaient leurs horreurs (comme le voit correctement le CCI) la véritable différence était qu'on luttait pour des objectifs spécifiques qui permettaient d'arriver à des solutions rapides et négociées. La bourgeoisie du 19e siècle avait encore la mission programmatique de détruire les résidus du vieux mode de production et de créer de véritables nations. » ([24] [2080]) De plus, il voit très bien la différence avec la période décadente : « le coût d'un développement capitaliste supérieur des forces productives n'est pas inévitable. De plus, ce coût a atteint une telle échelle qu'il a causé la destruction de la vie civilisée aussi bien à court terme (milieu ambiant, famines, génocides) qu'à long terme (guerre impérialiste généralisée). » ([25] [2081])
Les constatations sont correctes et nous les partageons pleinement, mais nous devons leur poser une question très simple : que signifie le fait que les guerres de la décadence ont des « objectifs totaux » et que le prix du maintien du capitalisme peut aller jusqu'à supposer la destruction de l'humanité ? Est-ce que ces situations de convulsion et de destruction, dont le BIPR reconnaît qu'elles sont qualitativement différentes de celles de la période ascendante, peuvent correspondre à une situation économique de reproduction normale et saine des cycles d'accumulation du capital, qui seraient identiques à celle de la période ascendante ?
La maladie mortelle du capitalisme décadent, le BIPR la situe seulement dans les moments de guerre généralisée, mais ne la voit pas dans les moments d'apparente normalité, dans les périodes où, selon lui, se développe le cycle d'accumulation du capital. Cela le conduit à une dangereuse dichotomie : d'un côté il conçoit des époques de développement des cycles normaux d'accumulation du capital où nous assistons à une croissance économique réelle, où se produisent des « révolutions technologiques », où le prolétariat croît. Dans ces époques de pleine vigueur du cycle d'accumulation, le capitalisme paraît revenir à ses origines, sa croissance semble le montrer dans une position analogue à celle de sa jeunesse (cela, le BIPR n'ose pas le dire, tandis que le PCI (Programma) le dit ouvertement). D'un autre côté, il y a les époques de guerre généralisée dans lesquelles la barbarie du capitalisme décadent se manifeste dans toute sa brutalité et toute sa violence.
Cette dichotomie rappelle fortement celle qu'exprimait Kautsky avec sa thèse du « super-impérialisme » : d'un côté il reconnaissait que, à travers la 1ère guerre mondiale, le capitalisme était entré dans une période où pouvaient se produire de grandes catastrophes et convulsions mais, en même temps, il établissait qu'il y avait une tendance « objective » à la concentration suprême du capitalisme en un grand trust impérialiste qui permettrait un capitalisme pacifique. Dans l'introduction au livre de Boukharine déjà cité (L'économie mondiale et l'impérialisme), Lénine dénonçait cette contradiction centriste de Kautsky : « Kautsky s'est promis d'être marxiste dans l'époque des graves conflits et des catastrophes qu'il s'est vu contraint de prévoir et de définir très nettement quand, en 1909, il a écrit son œuvre sur ce thème. Maintenant qu'il est absolument hors de doute que cette période est arrivée, Kautsky se contente de continuer à promettre d'être marxiste dans une époque future, qui n'arrivera peut-être jamais, celle du super-impérialisme. En un mot, il promet d'être marxiste, quand on voudra, mais dans une autre époque, pas à présent, dans les conditions actuelles, dans l'époque que nous vivons.»
Nous nous gardons bien de dire qu'il arrivera la même chose au BIPR. L'analyse marxiste de la décadence du capitalisme, il la garde jalousement pour la période où la guerre éclate, tandis que pour la période d'accumulation il se permet une analyse qui fait des concessions aux mensonges bourgeois sur la « prospérité » et la « croissance » du système.
La sous-estimation de la gravité du processus de décomposition du capitalisme
Cette tendance à garder l'analyse marxiste de la décadence pour la période de la guerre généralisée explique la difficulté qu'a le BIPR à comprendre l'étape actuelle de la crise historique du capitalisme : « Le CCI a été conséquent depuis sa fondation voilà 20 ans en laissant de côté toute tentative d'analyse sur la façon dont le capitalisme s'est conduit dans la crise actuelle. Il pense que toute tentative de voir les traits spécifiques de la crise présente revient à dire que le capitalisme a résolu la crise. Il ne s'agit pas de cela. Ce qui incombe aux marxistes actuellement c'est d'essayer de comprendre pourquoi la crise présente dépasse en durée la Grande Dépression de 1873-96. Mais, tandis que cette dernière était une crise alors que le capitalisme entrait dans sa phase monopoliste et qu'il était encore possible de la résoudre par une simple dévalorisation économique, la crise actuelle menace l'humanité d'une catastrophe beaucoup plus grande. » ([26] [2082])
II n'est pas certain que le CCI ait renoncé à analyser les détails de la crise présente. Le BIPR peut s'en convaincre en étudiant les articles que nous publions régulièrement, dans chaque numéro de la Revue Internationale, sur la crise dans tous ses aspects. Pour nous, la crise ouverte en 1967 est la réapparition de façon ouverte d'une crise chronique et permanente du capitalisme en décadence, c'est la manifestation d'un freinage profond et toujours plus incontrôlable du mécanisme d'accumulation capitaliste. Les « traits spécifiques » de la crise actuelle constituent les diverses tentatives du capital, à travers le renforcement de l'intervention de l'Etat, la fuite en avant dans l'endettement et les manipulations monétaires et commerciales, pour éviter une explosion incontrôlable de sa crise de fond et, en même temps, la mise en évidence de l'échec de telles remèdes et leurs effets pervers qui aggravent encore plus le mal incurable du capitalisme.
Le BIPR voit comme la «grande tâche » des marxistes d'expliquer la longue durée de la crise actuelle. Cela ne nous surprend pas qu'il soit étonné par la durée de la crise, dans la mesure où il ne comprend pas le problème de fond : nous n'assistons pas à la fin d'un cycle d'accumulation mais à une situation historique de blocage prolongé, d'altération profonde du mécanisme d'accumulation, une situation, comme disait l'IC, où le capitalisme ne peut plus assurer ses fonctions économiques essentielles autrement que par le fer et le sang.
Ce problème de fond qu'a le BIPR le conduit à ironiser une fois de plus à propos de notre position sur la situation historique actuelle de chaos et de décomposition du capitalisme : « Même si on peut être d'accord sur le fait qu'il y a des tendances à la décomposition et au chaos (vingt ans après la fin du cycle d'accumulation, il est difficile de voir comment il pourrait en être autrement) celles-ci ne peuvent être utilisées comme slogans pour éviter une analyse concrète de ce qui se passe. » ([27] [2083])
Comme on le voit, ce qui préoccupe le plus le BIPR c'est notre supposé « simplisme », une sorte de « paresse intellectuelle » qui trouverait refuge dans des cris radicaux sur la gravité et le chaos de la situation du capitalisme, comme un tic pour ne pas engager une analyse concrète de ce qui est en train de se passer.
La préoccupation du BIPR est juste. Les marxistes ne se gênent pas et nous ne nous gênons pas (c'est une de nos obligations dans le combat du prolétariat) pour analyser en détails les événements en évitant de tomber dans les généralités rhétoriques dans le style du « marxisme orthodoxe » de Longuet en France ou des imprécisions anarchistes qui réconfortent mais qui, dans les moments décisifs, conduisent à de graves divagations opportunistes, si ce n'est à des trahisons éhontées.
Cependant, pour pouvoir faire une analyse concrète de « ce qui se passe », il faut avoir un cadre global clair, et c'est sur ce terrain que le BIPR a des problèmes. Comme il ne comprend pas la gravité et la profondeur des altérations et le degré de dégénérescence et des contradictions du capitalisme dans les « moments normaux », dans les phases du cycle d'accumulation, tout le procès de décomposition et de chaos du capitalisme mondial qui s'est considérablement accéléré avec l'effondrement du bloc de l'Est en 1989, leur échappe des mains, il est incapable de le comprendre.
Le BIPR devrait se rappeler les stupidités lamentables qu'il a dit au moment de l'effondrement des pays staliniens, spéculant sur les «fabuleux marchés » que ces champs de ruines pourraient offrir aux pays occidentaux et croyant qu'ils apporteraient un allégement de la crise capitaliste. Par la suite, face au poids de l'évidence empirique et grâce à nos critiques, le BIPR a corrigé ses erreurs. Cela est très bien et montre son sens des responsabilités et son sérieux face au prolétariat. Mais le BIPR devrait aller au fond des choses. Pourquoi tant de gaffes ? Pourquoi doit-il changer sous la pression des faits eux-mêmes ? Quelle est cette avant-garde qui doit changer de position à la suite des événements, incapable, à chaque fois, de les prévoir ? Le BIPR devrait étudier attentivement les documents où nous avons exposé les lignes générales du processus de décomposition du capitalisme. ([28] [2084]) II constaterait qu'il n'y a pas de problème de « simplisme » de notre part mais du retard et de l'incohérence de la sienne.
Ces problèmes trouvent une nouvelle démonstration dans la spéculation suivante : « Une preuve de plus de l'idéalisme du CCI est l'accusation finale qu'il porte au Bureau qui "n'a pas une vision unitaire et globale de la guerre" ce qui conduirait à 'l'aveuglement et l'irresponsabilité" (sic) de ne pas voir qu'une prochaine guerre pourrait signifier "rien de moins que l'anéantissement complet de la planète". Le CCI pourrait avoir raison, encore qu'il nous plairait de connaître les bases scientifiques de cette prévision. Nous-mêmes avons toujours dit que la prochaine guerre menaçait l'existence de l'humanité. Cependant, il n'y a pas de certitude absolue de cette destruction totale de tout ce qui existe. La prochaine guerre impérialiste pourrait ne pas aboutir à la destruction finale de l'humanité. Il y a des armes de destruction massive qui n'ont pas été utilisées dans les conflits antérieurs (comme par exemple les armes chimiques ou biologiques) et il n'y a pas de garantie qu'un holocauste nucléaire pourrait embraser toute la planète. En fait, les préparatifs actuels des puissances impérialistes comprennent l'élimination des armes de destruction massive en même temps que se développent les armes conventionnelles. Même la bourgeoisie comprend qu'une planète détruite ne sert à rien (même si les forces qui mènent à la guerre et la nature de la guerre échappent, en dernière instance, à son contrôle). » ([29] [2085])
Le BIPR devrait apprendre un peu de l'histoire : pendant la 1ère guerre mondiale, toutes les armées ont employé les forces maximum de destruction, on chercherait vainement un génie plus meurtrier. Pendant la 2e guerre mondiale, alors que l'Allemagne était déjà vaincue il y eu les bombardements massifs de Dresde, utilisant les bombes incendiaires et à fragmentation et enuite, contre le Japon, lui aussi vaincu, les Etats-Unis utilisèrent la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki. Par la suite, la masse de bombes qui en 1971 est tombée sur Hanoi en une nuit dépassait la masse de bombes tombée sur l'Allemagne pendant toute l'année 1945. A son tour, le « tapis de bombes » que les « alliés » ont largué sur Bagdad a battu le triste record de Hanoi. Dans la même guerre du Golfe, ont été testées, par l'expérimentation sur les propres soldats nord-américains, de nouvelles armes de type nucléaire-conventionnel et chimique. On commence à savoir maintenant que les Etats-Unis ont fait, dans les années 1950, des expérimentations d'armes bactériologiques sur leur propre population... Et, face à cette masse d'évidences qu'on peut lire dans une quelconque publication bourgeoise, le BIPR a la bêtise et l'ignorance de spéculer sur le degré de contrôle de la bourgeoisie, sur son « intérêt » à éviter un holocauste total ! De manière suicidaire le BIPR rêve que soient utilisées des armes « moins destructrices » alors que 80 années d'histoire prouvent l'exact contraire.
Dans cette spéculation stupide le BIPR non seulement ne comprend pas la théorie, mais encore ignore superbement l'évidence écrasante et répétée des fait. Il devrait comprendre le caractère gravement erroné et révisionniste de ces illusions stupides de petits-bourgeois impuissants qui cherchent à s'en tirer coûte que coûte, sous prétexte que « la bourgeoisie elle-même comprend qu'une planète détruite ne sert à rien. »
Le BIPR doit dépasser le centrisme, les oscillations entre une position cohérente sur la guerre et la décadence du capitalisme et les théorisations spéculatives, que nous avons critiquées, sur la guerre comme moyen de dévalorisation du capital et de reprise de l'accumulation. En effet ces erreurs conduisent le BIPR à ne pas considérer et prendre au sérieux comme instrument cohérent d'analyse ce qu'il dit lui-même : « même si les forces qui mènent à la guerre et la nature de la guerre échappent, en dernière instance, à son contrôle. »
Cette phrase est pour le BIPR une simple parenthèse rhétorique alors que, s'il veut être pleinement fidèle à la Gauche communiste et comprendre la réalité historique, il devra la prendre pour guide d'analyse, pour axe de réflexion pour comprendre concrètement les faits et les tendances historiques du capitalisme actuel.
Adalen
[1] [2086] Dans sa réponse, le BIPR développe d'autres questions, comme celle d'une conception particulière du capitalisme d'Etat, que nous ne traiterons pas ici.
[2] [2087] Voir Revue Internationale n° 77 et 78 : « Le rejet de la notion de décadence conduit à la démobilisation du prolétariat face à la guerre ».
[3] [2088] Le BIPR affirme son accord avec notre position, mais au lieu de reconnaître l'importance et les conséquences de cette convergence d'analyse, il réagit de façon sectaire et nous accuse d'être malhonnête dans la manière de prendre position contre l'erreur commise par Rosa Luxemburg sur « le militarisme comme secteur de l'accumulation du capital ». En réalité, comme nous le montrerons plus loin, la compréhension du fait que le militarisme n'est pas un moyen d'accumulation du capital est un argument en faveur de notre thèse fondamentale sur le freinage croissant de l'accumulation dans la période de décadence, et non un démenti de cette thèse. D'autre part, le BIPR se trompe quand il dit que c'est grâce à sa critique que nous avons changé de position sur la question du militarisme. Il devrait lire les documents de nos prédécesseurs (la Gauche Communiste de France) qui ont contribué de façon fondamentale à l'analyse de l'économie de guerre à partir d'une critique systématique de l'idée de Ver-cesi sur « la guerre comme solution à la crise capitaliste ». Voir « Le renégat Vercesi », 1944.
[4] [2089] PC n° 90 page 24, cité dans la Revue Internationale n° 77.
[5] [2090] « Les Bases Matérielles de la Guerre Impérialiste », Internationalist Communist Review n° 13, p. 29.
[6] [2091] « Les Bases Matérielles de la Guerre Impérialiste », Internationalist Communist Review n° 13, p. 29.
[7] [2092] Traduit par nous de l'édition espagnole
[8] [2093] Le Capital, Livre III, section 3, chapitre 15.
[9] [2094] « Les théories des crises, de Marx à l'Internationale communiste », Revue Internationale n° 22.
[10] [2095] Voir l'article polémique avec le BIPR dans la Revue Internationale n° 79, paragraphe « La nature des cycles d'accumulation dans la décadence du capitalisme ».
[11] [2096] .«Le renégat Vercesi », mai 1944 dans le Bulletin international de la Fraction Italienne de la Gauche Communiste n° 5. 11.
[12] [2097] . Idem
[13] [2098] « Les Bases Matérielles de la Guerre Impérialiste », p. 30.
[14] [2099] L'IC, à son premier congrès, considérait comme tâche urgente et prioritaire de pousser en avant les tentatives révolutionnaires du prolétariat mondial et de regrouper ses forces d'avant-garde. En ce sens, son analyse sur la guerre et l'après-guerre, sur l'évolution du capitalisme, etc., ne pouvait pas aller plus loin que l'élaboration de quelques lignes générales. Le cours postérieur des événements, la défaite du prolétariat et la progression rapide de la gangrène opportuniste au sein de PIC, ont conduit à contrecarrer ces lignes générales et les tentatives d'élaboration théorique (en particulier la polémique de Boukharine contre Rosa Luxemburg dans son livre L'impérialisme et l'accumulation du capital en 1924) et ont constitué une régression brutale par rapport à la clarté des deux premiers congrès.
[15] [2100] « Thèses sur la situation internationale et la politique de l'Entente », documents du 1er congrès de l’IC
[16] [2101] . Idem.
[17] [2102] . Idem.
[18] [2103] . « Les Bases Matérielles de la Guerre Impérialiste », p. 29.
[19] [2104] . Revue Internationale n° 16 p.14-15.
[20] [2105] . « Les Bases Matérielles de la Guerre Impérialiste », p.29-30.
[21] [2106] . Idem.
[22] [2107] Voir « Le milieu politique prolétarien face à la guerre du Golfe », Revue Internationale n° 64.
[23] [2108] .Battaglia Comunista de janvier 1991, à propos de la guerre du Golfe, annonçait : « la 3e guerre mondiale a commencé le 17 janvier » (jour des premiers bombardements directs des « alliés » sur Bagdad). Le n° suivant mit un voile sur cette gaffe mais, au lieu de tirer les leçons de cette erreur, persista : « en ce sens, affirmer que la guerre qui a commencé le 17 janvier marque le début du 3e conflit mondial n'est pas un accès de fantaisie, mais prend acte de ce que s'est ouverte la phase dans laquelle les conflits commerciaux, qui se sont accentués depuis le début des années 70, ne peuvent trouver de solution si ce n'est dans la guerre généralisée. » Voir Revue Internationale n°72, « Comment ne pas comprendre le développement du chaos et des conflits impérialistes », où nous analysions et critiquions ces dérapages lamentables, ainsi que d'autres.
[24] [2109] « Les Bases Matérielles de la Guerre Impérialiste ».
[25] [2110] . Idem.
[26] [2111] . Idem.
[27] [2112] . Idem.
[28] [2113] . Voir Revue Internationale n° 60, « Thèses sur les pays de l'Est » au sujet de l'effondrement du stalinisme, Revue Internationale n° 62, « La décomposition du capitalisme » et Revue Internationale n° 64, « Militarisme et décomposition ».
[29] [2114] . « Les Bases Matérielles de la Guerre Impérialiste », p. 36.
Courants politiques:
- TCI / BIPR [137]
Approfondir:
Questions théoriques:
- Guerre [129]
Heritage de la Gauche Communiste:
Revue Internationale no 83 - 4e trimestre 1995
- 3141 reads
Ex-YOUGOSLAVIE : un nouveau cran dans l’escalade guerriere
- 2958 reads
Face à l’anarchie et au chaos grandissant qui caractérisent les rapports de la bourgeoisie au niveau international depuis l’effondrement du bloc de l’Est il y a six ans, on assiste à une nouvelle pression très forte des Etats-Unis, comme lors de la guerre du Golfe, pour réaffirmer leur leadership menacé et leur rôle de gendarme du « nouvel ordre mondial ». Parmi les expressions les plus significatives de cette pression, le Proche-Orient reste un terrain privilégié des manoeuvres de la bourgeoisie américaine. Les Etats-Unis profitent à la fois de leur solide tutelle sur un Etat israélien isolé dans la région, obligé de marcher derrière eux, et de la situation de dépendance d’Arafat, placé sur un siège éjectable, pour accélérer le processus de « pax americana » et renforcer leur contrôle et leur mainmise sur cette zone stratégique essentielle, plus que jamais soumise à des convulsions.
De même, le régime affaibli de Saddam Hussein se retrouve la cible favorite des manoeuvres de la Maison Blanche. La bourgeoisie américaine se prépare également à accroître sa pression militaire sur « le boucher de Bagdad » au moment où les rats quittent le navire pour rallier la Jordanie (autre solide base des intérêts américains au Moyen-Orient), en particulier deux de ses gendres dont l’un était le responsable des programmes militaires irakiens. Ce ralliement permet aux Etats-Unis de raviver le souvenir de sa démonstration de force dans la guerre du Golfe et de justifier le renfort de troupes américaines massées à la frontière koweïtienne, en relançant les rumeurs d’arsenaux d’armes bactériologiques et de préparatifs d’invasion par l’Irak du Koweït et de l’Arabie Saoudite. Mais la principale réaffirmation de cette pression reste, après trois ans d’échecs, le rétablissement spectaculaire de la situation américaine dans l’ex-Yougoslavie, zone centrale de conflits où la première puissance impérialiste ne peut se permettre d’être absente.
En fait, la multiplication et l’ampleur grandissante de ces opérations de police ne sont que l’expression d’une fuite en avant dans la militarisation du système capitaliste tout entier et de son enfoncement dans la barbarie guerrière.
Le mythe que la guerre et la barbarie qui se déchaînent dans l’ex-Yougoslavie depuis quatre ans serait une simple affaire d’affrontements interethniques entre cliques nationalistes locales est démenti de façon cinglante par la réalité.
Le nombre de frappes aériennes contre les positions serbes autour de Sarajevo et des autres « zones de sécurité », près de 3 500 « actions » en douze jours d’une opération baptisée « Deliberate Force », fait de cette opération le plus important engagement militaire de l’OTAN depuis sa création en 1949.
Les grandes puissances sont les vrais responsables du déchaînement de la barbarie
Ce sont les mêmes puissances qui n’ont cessé de pousser depuis quatre ans leurs pions les uns contre les autres sur l’échiquier yougoslave. Il n’y a qu’à remarquer la composition du « groupe de contact » qui prétend chercher les moyens de mettre un terme au conflit : les Etats-Unis, l’Allemagne, la Russie, la Grande-Bretagne et la France, pour constater que c’est tout le gratin des grandes puissances impérialistes de la planète (à l’exception du Japon et de la Chine, trop éloignés du théâtre des opérations) qui y sont représentés.
Comme nous l’avons déjà mis en évidence, « c’est l’Allemagne, en poussant la Slovénie et la Croatie à proclamer leur indépendance vis-à-vis de l’ancienne confédération yougoslave, qui a fait éclater ce pays et joué un rôle primordial dans le déclenchement de la guerre en 1991. Face à cette poussée de l’impérialisme allemand, ce sont les quatre autres puissances qui ont soutenu et encouragé le gouvernement de Belgrade à mener une contre-offensive (...) particulièrement meurtrière ». Ce sont « la France et la Grande-Bretagne, sous couvert de l’ONU, qui ont alors envoyé les plus importants contingents de Casques bleus et, sous prétexte d’empêcher les affrontements, se sont systématiquement employés à assurer le maintien du statu quo en faveur de l’armée serbe. En 1992, c’est “ le gouvernement des Etats-Unis qui s’est prononcé pour l’indépendance de la Bosnie-Herzegovine et a soutenu le secteur musulman de cette province, dans une guerre contre l’armée croate (toujours soutenue par l’Allemagne) et l’armée serbe (soutenue par la Grande-Bretagne, la France et la Russie). En 1994, c’est l’administration de Clinton qui est parvenue à imposer un accord pour la constitution d’une fédération entre la Bosnie et la Croatie contre la Serbie. A la fin de l’année, c’est sous l’égide de l’ex-président Carter, qu’a été obtenue la signature d’une trêve entre la Bosnie et la Serbie (...) Mais malgré des négociations où l’on a retrouvé tous les différends entre grandes puissances, aucun accord n’a été atteint. Ce qui ne pouvait être obtenu par la négociation, devait donc l’être par la force militaire. Il est clair que l’invasion d’une partie de la Krajina occidentale par la Croatie, au début du mois de mai, ainsi que la reprise des combats en divers points du front ou le déclenchement au même moment d’une offensive de l’armée bosniaque ont été entreprises avec l’accord et à l’initiative des gouvernements américain et allemand. » ([1] [2115]). La réaction du camp adverse n’est pas moins significative de l’engagement des autres puissances.
Nous avons largement développé, dans les colonnes de notre précédente revue (1), le contenu et le sens de la manoeuvre franco-britannique de concert avec les forces serbes qui avaient abouti à la création de la FRR et à l’expédition sur place, sous couleur nationale, de troupes de ces deux puissances. Cette manoeuvre, à travers une opération de sabotage des forces de l’OTAN, représentait un cinglant camouflet pour la puissance impérialiste qui prétend jouer le rôle de gendarme du monde.
Les Etats-Unis avaient besoin de frapper un grand coup pour rétablir la situation à leur profit. Pour cela, ils ont utilisé les populations civiles avec le même cynisme que leurs adversaires.
Tous ces brigands impérialistes se combattent les uns les autres, par cliques slaves interposées, et poursuivent, chacun de leur côté, la défense de leurs sordides intérêts particuliers, au détriment direct des populations, partout transformées en otages permanents, en victimes de leurs règlements de compte.
Ce sont en effet les grandes puissances qui sont les véritables responsables des massacres et d’un exode qui, depuis 1991, a précipité plus de 4 millions et demi de réfugiés en de longs cortèges d’hommes , de femmes, de vieillards et d’enfants hagards, démunis, ballottés le long des routes, de zones de combat en zones de combat. Ce sont les grandes puissances capitalistes, à travers leurs sanglantes rivalités impérialistes, qui ont encouragé, chacune de leur côté, les opérations de « nettoyage » et de « purification ethnique » pratiquées par les cliques nationalistes rivales sur le terrain.
C’est ainsi que la Forpronu, sous l’égide de la France et de la Grande-Bretagne, a donné son aval aux Serbes de Bosnie pour éliminer les poches de Srebrenica et de Zepa en juillet 1995. Tandis que ces deux puissances polarisaient l’attention sur leur « mission de protection » autour de Gorazde et de Sarajevo, la Forpronu prêtait main-forte aux Serbes pour vider les enclaves de leurs occupants. Sans cette aide, l’éjection de tous ces réfugiés n’aurait jamais été possible. De fait, la « protection » ces enclaves par l'ONU avait permis aux Serbes de porter leurs efforts militaires sur des zones de confrontation plus vitales. Et pour que ces enclaves puissent être récupérées par les forces serbes au moment le plus opportun, l’ONU avait même préalablement désarmé leur population, bien entendu sous couvert de « sa mission pour la paix ». Le gouvernement bosniaque lui-même s’est fait le complice de ce forfait, démontrant le peu de cas qu’il faisait aussi de sa chair à canon, en parquant les populations déplacées à l’intérieur des zones de combat.
La bourgeoisie américaine a recouru aux mêmes méthodes crapuleuses. C’est ainsi que, pour couvrir l’offensive croate en Krajina, les Etats-Unis inondaient au même moment les médias de photos prises par satellite montrant de la terre fraîchement remuée supposés révéler l’existence de charniers oeuvre des troupes serbes dans la région de Srebrenica. Ce sont encore les images d’horreur venant des obus tirés sur le marché de Sarajevo qui ont justifié la riposte de l’OTAN. Le prétexte de la réponse militaire apparaît cousue de fil blanc. Il est en effet peu probable que Karadzic ait été assez fou pour aller s’exposer à des lourdes représailles en tirant des obus sur le marché de Sarajevo qui ont fait 37 morts et une centaine de blessés. Quand on sait que ces tirs ont été effectués juste sur la ligne de front séparant les armées serbes et bosniaques (chaque camp a rejeté la responsabilité de ce massacre sur l’autre), on peut supposer qu’il s’agissait d’une « provocation » montée de toutes pièces. Une opération de l’envergure des bombardements de l’OTAN ne s’improvise pas et cela servait trop bien les intérêts de la Maison Blanche. Ce ne serait pas la première fois que la première puissance impérialiste mondiale organise une telle mise en scène. Il faut se rappeler, entre autres exemples, que le président Lyndon Johnson avait prétexté l’attaque d’un navire américain par un bateau nord-viêtnamien pour déclencher la guerre du Vietnam. On devait apprendre quelques années plus tard qu’il n’en était rien et que l’opération avait été montée entièrement par le Pentagone. Il est donc tout à fait dans les méthodes de gangsters des grandes puissances de créer de toutes pièces de semblables prétextes pour justifier leurs actions.
A la provocation franco-britannique, dont les prétentions de « trouble fête » arrogants et l’ardeur belliqueuse grandissante, devenaient de plus en plus intolérables, il s’agissait de répliquer par d’autres manoeuvres, de tendre d’autres pièges, démontrant une capacité impérialiste supérieure, une véritable suprématie militaire.
Face à son échec et à l’enlisement de la situation en Bosnie depuis trois ans, la bourgeoisie américaine était placée devant la nécessité de réaffirmer son leadership à l’échelle mondiale.
Il ne pouvait être admissible pour la première puissance mondiale ayant longtemps misé sur le soutien à la fraction musulmane qui s’est révèlée être la plus faible, d’être mise hors jeu dans un conflit primordial, situé sur le sol européen et un des plus cruciaux pour affirmer son hégémonie.
Cependant, les Etats-Unis sont confrontés à une difficulté majeure qui souligne la faiblesse fondamentale de leur situation en Yougoslavie. Le recours à des changements de tactique succsssifs qui s’est traduit par leur soutien à la Serbie en 1991, à la Bosnie en 1992 et à la Croatie en 1994 (sous condition de collaboration de celle-ci avec les forces bosniaques) démontre qu’ils ne peuvent disposer d’alliés attitrés dans la région.
Derrière l’offensive croate, l’action conjuguée des Etats-Unis et de l'Allemagne
Dans un première phase, elle s’est retrouvée contrainte, pour sortir de l’impasse et se remettre en selle au centre du jeu impérialiste, en conservant un rôle de premier plan, de s’appuyer sur la partie la plus forte, la Croatie et d'abandonner son allié d’hier, la Bosnie. La Maison Blanche a utilisé la fédération croato-musulmane et la confédération de cette dernière avec la Croatie qu’elle avait supervisée au printemps 1994. Leur rôle et l’appui logistique du Pentagone ont été déterminants pour assurer le succès de la « guerre éclair » en trois jours de l’armée croate en Krajina (grâce à la localisation précise par satellite des positions serbes). Les Etats-Unis ont d’ailleurs été les seuls à saluer publiquement le succès de l’offensive croate. Ainsi, l’offensive croate dans la Krajina a-t-elle été préparée à l'avance, organisée et dirigée avec maestria à la fois par l’Allemagne et par les Etats-Unis. Car, pour cela, la bourgeoisie américaine a accepté de pactiser paradoxalement avec le « diable » en s’alliant conjoncturellement avec son plus dangereux grand adversaire impérialiste, l’Allemagne, en favorisant les intérêts les plus véritablement antagoniques à ceux des Etats-Unis.
La constitution d’une véritable armée croate (100 000 hommes pour investir la Krajina) a été puissamment aidée par l’Allemagne, qui lui a manifesté un soutien discret mais constant et efficace, notamment à travers la livraison de matériel militaire lourd en provenance de l’ex-RDA, via la Hongrie. La reconquête de la Krajina correspond à un succès et à une avancée indiscutables pour l’Allemagne. Elle permet en priorité à la bourgeoisie germanique de faire un grand pas dans la direction de son objectif stratégique essentiel : l’accès aux ports dalmates sur toute la côte adriatique qui lui libèrent un débouché en eau profonde vers la Méditerranée. La libération de la Krajina, et de Knin en particulier, ouvre en même temps à la Croatie et à sa vieille alliée, l’Allemagne un carrefour routier comme ferroviaire, reliant le sud et le nord de la Dalmatie. La bourgeoisie allemande était de même particulièrement intéressée comme la Croatie par l’élimination de la menace serbe pesant sur la poche de Bihac, faisant office de verrou à toute la côte dalmate.
En infligeant une première défaite aux troupes serbes ([2] [2116]), cette stratégie était fondamentalement dirigée contre les « seconds couteaux » français et britanniques.). La FRR s’est ridiculisée et son utilité est apparue d’autant plus dérisoire qu’elle s’occupait à percer inutilement une étroite voie d’accès vers Sarajevo pendant que le bulldozer croate abattait le mur serbe dans la Krajina. Coincée sur le mont Igman autour de la pseudo-défense de Sarajevo, elle se retrouvait non seulement momentanément discréditée sur la scène internationale, mais aussi auprès des Serbes eux-mêmes, ce qui ne pouvait profiter qu’à un autre rival, la Russie qui se confirmait ainsi dès lors comme un bien meilleur et plus sûr allié à leurs yeux.
Derrière les frappes anti-serbe, le bras-de-fer des Etats-Unis envers les autres puissances impérialistes
Dans une autre étape, la réponse de la bourgeoisie américaine s’inscrivait dans un scénario qui rappelle la guerre du Golfe. Toujours dirigé contre les positions serbes, le bombardement intensif de l’OTAN réaffirmait la suprématie américaine en s’adressant encore plus directement à toutes les autres grandes puissances.
Il fallait en particulier mettre un terme à tous les stratagèmes guerriers ([3] [2117]) et toutes les manigances diplomatiques avec la Serbie du couple franco-anglais.
Cependant, en passant à la deuxième phase de leur initiative, les Etats-Unis prenaient un nouveau risque de se déconsidérer. Le plan de paix, sur lequel débouchait l’offensive en Krajina apparaissait ouvertement comme une « trahison de la cause bosniaque », en consacrant le dépeçage du territoire bosniaque avec l’octroi de 49 % aux conquêtes militaires de la Serbie et 51 % à la confédération croato-musulmane qui relègue de fait avec l’aide germano-américaine le reste de la Bosnie au rang de quasi-protectorat de la Croatie. Ce plan, véritable poignard planté dans le dos par ses alliés, ne pouvait que susciter l’hostilité du président bosniaque Izetbegovic. Alors que l’émissaire américain court-circuitait la France et la Grande-Bretagne, seuls interlocuteurs accrédités par la Serbie parmi les puissances occidentales depuis trois ans, en allant négocier directement à Belgrade, c’est avec un culot monstre pour des alliés patentés de Milosevic ([4] [2118]), que la France et la Grande-Bretagne ont cru pouvoir saisir l’occasion de prendre les Etats-Unis à contre-pied en se présentent comme les grands et indéfectibles défenseurs de la cause bosniaque et de la population assiégée de Sarajevo ([5] [2119]). C’est ainsi que le gouvernement français a tenté de se présenter comme un allié inconditionnel d’Izetbegovic en le recevant à Paris. Mais c’était là sauter à pieds joints dans un piège tendu par les Etats-Unis pour donner à ces deux larrons une leçon magistrale. En utilisant le prétexte des obus tirés sur le marché de Sarajevo, les Etats-Unis ont immédiatement mobilisé les forces de l’OTAN et ont mis au pied du mur le couple franco-britannique en lui déclarant en substance très probablement : « Vous voulez aider les Bosniaques ? Très bien. Nous aussi. Alors vous nous suivez, nous sommes les seuls à avoir les moyens de le faire, nous sommes les seuls à pouvoir imposer un rapport de force efficace aux Serbes. Nous l’avons déjà prouvé en réalisant en trois jours le dégagement de la poche de Bihac, à travers la reconquête de la Krajina, ce que vous n’avez pu accomplir pendant trois ans. Nous allons le prouver encore en libérant Sarajevo de l’étau serbe, ce que votre FRR n’a pas réussi non plus à faire. Si vous vous dégonflez, si vous ne nous suivez pas, vous démontrerez que vous ne faites que du bluff avec vos rodomontades guerrières, que vous n’êtes que des braillards incapables et vous perdrez tout le crédit qui vous reste encore sur la scène internationale. » Ce chantage ne laissait plus le moindre choix au tandem franco-britannique, que de participer à l’opération en étant contraint de bombarder ses alliés serbes, tout en replaçant la FRR sous le patronage direct de l’OTAN. Tout en évitant l’une et l’autre de causer des pertes importantes ou irréparables à leurs alliés serbes, chacune des deux puissances réagit alors à sa manière. Alors que la Grande-Bretagne se fait discrète, la France, au contraire, ne peut s’empêcher de continuer à jouer les fiers-à-bras militaristes et cherche désormais à se présenter, en faisant de la surenchère antiserbe verbale, comme le plus résolu partisan de la manière forte, le meilleur lieutenant des Etats-Unis et le plus fidèle comme indispensable allié de la Bosnie. Cette forfanterie qui va même jusqu’à se targuer d’être l’artisan essentiel du « plan de paix » ne change rien au fait que le gouvernement français s’est fait proprement « moucher » et a dû rentrer dans le rang.
De fait, pour cette deuxième partie de l’opération, les Etats-Unis ont agi pour leur propre compte en contraignant tous ses concurrents impérialistes à se plier à leur volonté. Si l’aviation germanique a participé pour la première fois à une action de l’OTAN, c’est sans enthousiasme et en faisant grise mine. Placée devant le fait accompli du cavalier seul américain, la bourgeoisie allemande ne pouvait que suivre une action qui ne servait en rien ses projets. De même, la Russie, principal soutien des Serbes, malgré ses bruyants renâclements et ses gesticulations (saisie du conseil de sécurité de l’ONU) face à la poursuite des bombardements de l’OTAN apparaît comme impuissante face à la situation qui lui est imposée.
A travers cette entreprise, les Etats-Unis ont marqué un point important. Ils sont parvenus à réaffirmer leur suprématie impérialiste en affichant leur supériorité militaire écrasante. Ils ont montré une fois de plus que la force de leur diplomatie reposait sur la force de leurs armes. Ils ont démontré qu’ils étaient les seuls à pouvoir imposer une véritable négociation parce qu’ils étaient capables de mettre sur la balance des tractations la menace de leurs armes, avec un impressionnant arsenal guerrier derrière eux.
Ce que confirme cette situation, c’est que, dans la logique de l’impérialisme, la seule force réelle se trouve sur le terrain militaire. Quand le gendarme intervient, il ne peut le faire qu’en frappant encore plus fort que les autres puissances impérialistes ne peuvent le faire.
Cependant, cette offensive se heurte à plusieurs obstacles et la force de frappe de l’OTAN n’apparaît plus que comme une pâle réplique de la guerre du Golfe.
- L’efficacité des raids aériens ne peut être que limitée et a permis aux troupes serbes d’enterrer sans trop de dommages la majeure partie de leur artillerie. Dans la guerre moderne, l'aviation est une arme décisive, mais elle ne peut permettre, à elle seule, de gagner la guerre. L'utilisation des blindés et de l'infanterie reste indispensable.
- La stratégie américaine elle-même est limitée : les Etats-Unis ne sont nullement intéressés à anéantir les forces serbes en leur livrant une guerre totale, dans la mesure où elle entend préserver le potentiel militaire de la Serbie pour pouvoir l’utiliser et se retourner ultérieurement contre la Croatie, dans l’optique de son antagonisme fondamental avec l’Allemagne. De plus, une guerre à outrance contre la Serbie comporterait le risque d’envenimer les frictions avec la Russie et de compromettre leur alliance privilégiée avec le gouvernement d’Eltsine.
Ces limites favorisent les manoeuvres de sabotage des « alliés » contraints et forcés de marcher dans les raids américains, manoeuvres qui se révèlent quatre jours à peine après l’accord de Genève, qui aurait dû constituer le couronnement de l’habilité diplomatique américaine.
D’une part, la bourgeoisie française s'est retrouvée en première ligne de ceux qui demandaient l’arrêt des bombardements de l’OTAN « pour permettre l’évacuation des armes lourdes par les Serbes », alors que l’ultimatum américain exige précisément l’inverse : l’arrêt des bombardements conditionné par le retrait des armes lourdes des abords immédiats de Sarajevo. D’autre part, alors que les Etats-Unis cherchaient à passer à un degré plus élevé de pression sur les Serbes de Bosnie en bombardant le quartier général de Karadzic à Pale, c’est la Forpronu qui lui a mis des bâtons dans les roues en manifestant des états d’âme et en s’opposant au déclenchement de bombardement prenant pour cible des « objectifs civils » ([6] [2120]).
L’accord de Genève signé le 8 septembre par les belligérants, sous l’égide de la bourgeoisie américaine et en présence de tous les membres du « groupe de contact », ne constitue donc nullement un « premier pas vers la paix », contrairement à ce que proclamait le diplomate américain Holbrooke. Il ne fait que sanctionner un moment d’un rapport de forces qui, de fait, constitue un pas supplémentaire vers le déchaînement d’une barbarie dont les populations locales vont faire atrocement les frais. Ce sont elles qui paient la note de l’opération par de nouveaux massacres.
Comme lors de la guerre du Golfe, les médias osent nous parler cyniquement de guerre propre, de « frappes chirurgicales ». Odieux mensonges ! Il faudra des mois ou des années pour lever un coin du voile sur l’ampleur et l’horreur que représentent pour la population ces nouveaux massacres perpétrés par les nations les plus « démocratiques » et « civilisées ».
Dans leur affrontement, chaque grande puissance alimente aussi crapuleusement l’une que l’autre sa propagande belliciste sur la Yougoslavie En Allemagne, de virulentes campagnes anti-serbe sont organisées évoquant les atrocités commises par les partisans tchechniks. En France, au milieu d’une odieuse campagne belliciste à géométrie variable, et ailleurs, selon le camp soutenu, tantôt on ne perd pas jamais une occasion de rappeler le rôle joué par les « oustachis » croates aux côtés des forces nazies dans la seconde guerre mondiale, tantôt on évoque la folie sanguinaire des Serbes de Bosnie ou tantôt on vilipende le fanatisme musulman des combattants bosniaques..
L’hypocrite concert international des pleureuses et des intellectuels de tout poil qui n’ont cessé de jouer de la corde humanitaire pour réclamer « des armes pour la Bosnie » ne sert qu’à faire avaliser dans la population occidentale la politique impérialiste de leur bourgeoisie nationale. Ce sont ces laquais de la bourgeoisie qui peuvent maintenant se féliciter à travers les bombardements de l’OTAN « d’ajouter la paix à la guerre », selon l’expression du mitterrandien amiral Sanguinetti. Venant renforcer les campagnes médiatiques montrant à la une les images des carnages les plus horribles dans la population civile, ces bonnes âmes volant au secours de la veuve et de l’orphelin ne sont que de vulgaires sergents-recruteurs pour la guerre. Ce sont les plus dangereux rabatteurs de la bourgeoisie. Ils sont de la même espèce que les antifascistes de 1936 qui enrôlaient les ouvriers pour la guerre d’Espagne. L’histoire a démontré leur fonction réelle : celle de pourvoyeurs de chair à canon dans la préparation de la guerre impérialiste.
Une expression de l’enfoncement du capitalisme dans sa décomposition
La situation actuelle est devenue un véritable détonateur qui risque de mettre le feu aux poudres dans les Balkans.
Jamais, avec l’intervention de l’OTAN, l’accumulation et la concentration d’engins de mort n’ont été aussi impressionnantes sur le sol yougoslave.
La nouvelle perspective est celle d’un affrontement direct des armées serbes et croates et plus seulement de milices formées de bric et de broc.
La poursuite des opérations militaires par les armées croates, bosniaques et serbes le prouve déjà, l’accord de Genève comme ses conséquences ne font qu’aviver et relancer les tensions entre les belligérants qui entendent chacun modifier la nouvelle donne à leur profit, en particulier :
- alors que les bombardements massifs et meurtriers de l’OTAN visaient à réduire les ambitions des forces serbes, celles-ci vont chercher à résister au recul qu’elles ont subi et se préparent à disputer de plus belle le sort non réglé des enclaves de Sarajevo, de Gorazde ou du corridor de Brcko ;
- les nationalistes croates, encouragés par leurs succès militaires antérieurs et poussés par l’Allemagne, ne peuvent que chercher à affirmer leurs visées pour reconquérir la riche Slavonie orientale, région située au contact de la Serbie ;
- les forces bosniaques vont tout faire pour ne pas être les laissés pour compte du « plan de paix » et poursuivre leur offensive en cours dans le nord de la Bosnie vers la région serbe de Banja Luka.
L’afflux de réfugiés de toutes sortes constitue un risque majeur d’entraîner d’autres régions, comme surtout le Kosovo ou la Macédoine, dans l’embrasement guerrier mais aussi d’autres nations sur le sol européen, de l’Albanie à la Roumanie, en passant par la Hongrie.
Par effet de « boule de neige », la situation est porteuse d’une implication impérialiste plus importante des grandes puissances européennes, y compris de la part de voisins d’une importance stratégiques majeure, comme surtout la Turquie et l’Italie ([7] [2121]).
La France et la Grande-Bretagne, puissances réduites à jouer pour l’heure les mouches du coche, ne peuvent que multiplier les tentatives pour mettre des bâtons dans les roues des autres protagonistes, en particulier vis-à-vis des Etats-Unis ([8] [2122]).
C’est un nouveau cran qui est franchi dans l’escalade de la barbarie. Loin de s’orienter vers un règlement du conflit, ce sont au contraire vers des désordres de plus en plus guerriers et sanglants que se dirige l’ex-Yougoslavie, sous l’action « musclée » des grandes puissances. Tous ces éléments confirment la prépondérance et l’accélération de la dynamique du « chacun pour soi » à l’oeuvre depuis la dissolution des blocs impérialistes et ils traduisent en même temps une accélération de la dynamique impérialiste et une fuite en avant dans l’aventure guerrière.
La prolifération, le développement multiforme de toutes ces entreprises guerrières est le pur produit de la décomposition du capitalisme, comme les métastases d’un cancer généralisé qui gangrène d’abord les organes les plus faibles de la société, là où le prolétariat n’a pas de moyens suffisants pour s’opposer au déchaînement du nationalisme le plus abject et hystérique. La bourgeoisie des pays avancés cherche à profiter de l’imbroglio yougoslave, de la brume « humanitaire » dans laquelle elle enrobe son implication pour distiller une atmosphère d'union sacrée. Pour la classe ouvrière, il doit être clair qu’il n’y a pas à choisir, ni se laisser entraîner sur ce terrain pourri.
La prise de conscience par les prolétaires des pays centraux de la responsabilité primordiale des grandes puissances, de leur propre bourgeoisie dans le déchaînement de cette barbarie guerrière, qu’il s’agit d’un règlement de compte entre brigands impérialistes est une condition indispensable pour comprendre leurs propres responsabilités historiques. C’est bien parce que c’est la même bourgeoisie qui, d’un côté, pousse les populations à s’exterminer entre elles, et qui, de l’autre, précipite la classe ouvrière vers le chômage, la misère ou un seuil d’exploitation insupportable, que seul le développement des luttes ouvrières sur leur propre terrain de classe, sur le terrain de l’internationalisme prolétarien peut en même temps s’opposer aux attaques de la bourgeoisie et à ses menées guerrières.
CB, 14 septembre 95.
[6] [2128]. Comme le notait Le Monde du 14 septembre, avec de délicats euphémismes : « Les forces de l’ONU, composées essentiellement de troupes françaises, ont le sensation, jour après jour, que les opérations leur échappent au profit de l’OTAN. L’Alliance atlantique mène , certes, des raids aériens sur des cibles déterminées conjointement avc l’ONU. Mais les détails des opérations sont planifiés par les bases de l’OTAN en Italie et par le Pentagone. L’utilisation, dimanche dernier, de missiles Tomahawk contre des installations serbes, dans la région de Banja Luka (sans passer par une consultation préalable de l’ONU ni des autres gouvernements des puissances associées aux raids, NDLR) n’a fait que renforcer ces craintes. »
[7] [2129] Il est particulièrement significatif de voir l’Italie réclamer une part plus importante dans la gestion du conflit bosniaque et refuser d’accueillir sur son territoire où sont installées les bases de l’OTAN les bombardiers furtifs F-117 américains pour protester contre sa mise à l’écart du « groupe de contact » et des instances décisionnelles de l’OTAN.
[8] [2130] En tout premier lieu, pour être capable de riposter à l’offensive américaine au niveau requis, sous peine d’être évincé de cette région, le couple actuel franco-britannique ne peut qu’être poussé dans cet engrenage guerrier, à renforcer son engagement militaire dans le conflit.
Géographique:
- Europe [95]
Questions théoriques:
- Décomposition [3]
- Impérialisme [321]
50 ans après : Hiroshima, Nagasaki, ou les mensonges de la bourgeoisie
- 6497 reads
-
Avec le cinquantième anniversaire des bombes d’Hiroshima et de Nagasaki, la bourgeoisie franchit un nouveau sommet dans le cynisme et le mensonge. Car ce summum de la barbarie ne fut pas perpétré par un dictateur ou un fou sanguinaire, mais par la « très vertueuse démocratie » américaine. Pour justifier ce crime monstrueux, l’ensemble de la bourgeoisie mondiale a répété sans vergogne le mensonge colporté à l’époque de ces sinistres évènements, selon lequel la bombe atomique n’aurait été utilisée que pour abréger et limiter les souffrances causées par la poursuite de la guerre avec le Japon. La bourgeoisie américaine a même récemment poussé le cynisme jusqu’à vouloir faire éditer un timbre anniversaire ainsi légendé : « les bombes atomiques ont accéléré la fin de la guerre. Août 1945 ». Même si au Japon cet anniversaire fut une occasion supplémentaire pour marquer l’opposition croissante à l’ex-parrain US, le premier ministre a cependant apporté sa contribution précieuse au mensonge de la nécessité de la bombe pour que triomphent la paix et la démocratie, en présentant et ce, pour la première fois, les excuses du Japon pour les crimes commis durant la seconde guerre mondiale. Ainsi, vainqueurs et vaincus se retrouvent unis pour développer cette campagne répugnante visant à justifier un des plus grands crimes de l’histoire.
LA JUSTIFICATION D’HIROSHIMA ET NAGASAKI : UN GROSSIER MENSONGE
Les deux bombes atomiques lâchées sur le Japon en août 1945 firent, au total, 522 000 victimes. De nombreux cancers du poumon et de la thyroïde ne se déclarèrent que dans les années 1950 et 1960 et, aujourd’hui, les effets de l’irradiation continuent encore de faire des victimes : les leucémies sont dix fois plus nombreuses à Hiroshima que dans le reste du Japon !
Pour justifier un tel crime et répondre au choc légitime provoqué par l’horreur des effets de la bombe, Truman, le président américain qui ordonna l’holocauste nucléaire, ainsi que son complice Winston Churchill répandirent une fable aussi cynique que mensongère. A les en croire, l’emploi de l’arme atomique aurait épargné la vie d’environ un million de vies humaines, pertes qu’aurait selon eux nécessairement entraîné l’invasion du Japon par les troupes US. En somme, malgré les apparences, les bombes qui ont ravagé Hiroshima et Nagasaki et qui continuent encore cinquante ans après à dispenser la mort, seraient des bombes pacifistes ! Or, ce mensonge particulièrement odieux est totalement démenti par de nombreuses études historiques émanant de la bourgeoisie elle-même.
Lorsqu’on examine la situation militaire du Japon au moment où l’Allemagne capitule, on constate que celui-ci est déjà totalement vaincu. L’aviation, arme essentielle de la seconde guerre mondiale, y est exsangue, réduite à un petit nombre d’appareils généralement pilotés par une poignée d’adolescents aussi fanatisés qu’inexpérimentés. La marine, tant marchande que militaire, est pratiquement détruite. La défense antiaérienne n’est plus qu’une gigantesque passoire, ce qui explique que les B 29 US aient pu se livrer à des milliers de raids durant tout le printemps 1945 sans pratiquement essuyer de pertes. Et cela, c’est Churchill lui-même qui le souligne dans le tome 12 de ses mémoires !
Une étude des services secrets US de 1945, publiée par le New York Times en 1989, révèle quant à elle que : « Conscient de la défaite, l’empereur du Japon avait décidé dès le 20 juin 1945 de cesser toute hostilité et d’entamer à partir du 11 juillet des pourparlers en vue de la cessation des hostilités »[1] [2131].
Or, bien que parfaitement au courant de cette réalité, Truman, après avoir été informé du succès du premier tir expérimental nucléaire dans les sables du désert du nouveau Mexique en Juillet 1945[2] [2132], et ce au moment même où se tient la conférence de Potsdam entre lui-même, Churchill et Staline[3] [2133], décide alors d’utiliser l’arme atomique contre les villes japonaises. Qu’une telle décision ne soit en aucune façon motivée par la volonté de précipiter la fin de la guerre avec le Japon est également attesté par une conversation entre le physicien Léo Szilard, l’un des pères de la bombe, et le secrétaire d’Etat américain, J. Byrnes. A Szilard qui s’inquiétait des dangers de l’utilisation de l’arme atomique, J. Byrnes répond qu’il « ne prétendait pas qu’il était nécessaire d’utiliser la bombe pour gagner la guerre. Son idée était que la possession et l’utilisation de la bombe rendraient la Russie plus contrôlable ».1
Et s’il était encore besoin d’une argumentation supplémentaire, laissons parler certains des plus hauts dirigeants de l’armée américaine elle-même. Pour l’amiral W. Leahy, chef d’état major, « Les japonais étaient déjà battus et prêts à capituler. L’usage de cette arme barbare n’a apporté aucune contribution matérielle à notre combat contre le Japon. »1 C'est un avis que partageait aussi Eisenhower.
La thèse de l’utilisation de l’arme atomique pour forcer le Japon à capituler et stopper la boucherie ne correspond à aucune réalité. C’est un mensonge forgé de toutes pièces pour les besoins de la propagande guerrière de la bourgeoisie, un des fleurons du gigantesque bourrage de crâne qu’a nécessité la justification idéologique de ce plus grand massacre de l’histoire que fut la guerre de 1939-45, de même que la préparation idéologique de la guerre froide.
Et il convient de souligner que, quels que soient les états d’âme de certains membres de la classe dominante, devant l’utilisation de cette arme terrifiante qu’est la bombe nucléaire, la décision du président Truman, est tout sauf celle d’un fou ou d’un individu isolé. Elle est au contraire l’expression d’une logique implacable, celle de l’impérialisme, celle de tous les impérialismes, et cette logique signifie la mort et la destruction de l’humanité pour que survive une classe, la bourgeoisie, confrontée à la crise historique de son système d’exploitation et à sa décadence irréversible.
L’OBJECTIF RÉEL DES BOMBES D’HIROSHIMA ET NAGASAKI
A l’opposé des tombereaux de mensonges colportés depuis 1945 sur la prétendue victoire de la Démocratie synonyme de paix, la seconde boucherie mondiale est à peine terminée que se dessine déjà la nouvelle ligne d’affrontement impérialiste qui va ensanglanter la planète. De la même façon que dans le traité de Versailles de 1919 était inscrite l’inéluctabilité d’une nouvelle guerre mondiale, Yalta contenait la fracture impérialiste majeure entre le grand vainqueur de 1945, les Etats-Unis, et son challenger russe. Puissance économique mineure, la Russie peut accéder, grâce à la seconde guerre mondiale, à un rang impérialiste de dimension mondiale, ce qui ne peut que menacer la super puissance américaine. Dès le printemps 1945, l’URSS utilise sa force militaire pour se constituer un bloc dans l’Est de l’Europe. Yalta n’avait fait que sanctionner le rapport de forces existant entre les principaux requins impérialistes qui étaient sortis vainqueurs du plus grand carnage de l’histoire. Ce qu’un rapport de forces avait instauré, un autre pouvait le défaire. Ainsi, à l’été 1945, la véritable question qui se pose à l’Etat américain n’est pas de faire capituler le Japon le plus vite possible comme on nous l’enseigne dans les manuels scolaires, mais bien de s’opposer et de contenir la poussée impérialiste du « grand allié russe » !
W. Churchill, le véritable dirigeant de la seconde guerre mondiale, du côté des« Alliés », a pris très vite la mesure du nouveau front en train de s’ouvrir et va exhorter sans relâche les Etats-Unis à y faire face. Il écrit dans ses mémoires : « Plus une guerre menée par une coalition approche de sa fin, plus les aspects politiques prennent d’importance. A Washington surtout on aurait du voir plus grand et plus loin... La destruction de la puissance militaire de l’Allemagne avait provoqué une transformation radicale des rapports entre la Russie communiste et les démocraties occidentales. Elles avaient perdu l’ennemi commun qui était à peu près leur seul trait d’union. » Et il en conclut que : « la Russie soviétique était devenue un danger mortel pour le monde libre, qu’il fallait créer sans retard un nouveau front pour arrêter sa marche en avant et qu’en Europe ce front devait se trouver le plus à l’Est possible »[4] [2134]. On ne saurait être plus clair : par ces mots, Churchill analyse fort lucidement que, alors que la seconde guerre mondiale n’est pas encore terminée, une nouvelle guerre est d’ores et déjà en train de commencer !
Dès le printemps 1945, Churchill fait tout pour s’opposer aux avancées de l’armée russe en Europe de l'est (en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Yougoslavie, etc.). Il cherche avec obstination à faire adhérer à ses vues le nouveau président américain, Truman, lequel, après certaines hésitations[5] [2135] se ralliera pleinement à la thèse de Churchill selon laquelle « la menace soviétique avait déjà remplacé l’ennemi nazi » (Ibid.).
On comprend dès lors aisément le total soutien que Churchill et son gouvernement unanime apportèrent à la décision de Truman de faire procéder à des bombardements atomiques sur les villes japonaises. Churchill écrivait le 22 Juillet 1945 : « [avec la bombe] nous avons désormais en mains quelque chose qui rétablira l’équilibre avec les russes. Le secret de cet explosif et la capacité de l’utiliser modifieront complètement l’équilibre diplomatique qui était à la dérive depuis la défaite de l’Allemagne ». Que cela entraîne la mort, dans d’atroces souffrances, de centaines de milliers d’êtres humains laissait de marbre ce « grand défenseur du monde libre », ce « sauveur de la démocratie ». Lorsqu’il apprit la nouvelle de l’explosion d’Hiroshima, il... sauta de joie et l’un de ses conseillers, Lord Alan Brooke, précise même : « Churchill fut enthousiaste et se voyait déjà en mesure d’éliminer tous les centres industriels de la Russie et toutes les zones à forte concentration de population »[6] [2136]. Voilà ce que pensait ce défenseur de la civilisation et des irremplaçables valeurs humanistes à l’issue d’une boucherie ayant fait 50 millions de morts !
L’holocauste nucléaire qui s’est abattu sur le Japon en août 1945, cette manifestation terrifiante de la barbarie absolue qu’est devenue la guerre dans la décadence du capitalisme, ne fut donc en aucune façon perpétrée par la « blanche démocratie » américaine pour limiter les souffrances dues à la poursuite de la guerre avec le Japon, pas plus qu’elle ne correspondait à un besoin militaire. Son véritable objectif était d’adresser un message de terreur à l’URSS pour forcer cette dernière à limiter ses prétentions impérialistes et à accepter les conditions de la « pax americana ». Plus concrètement, il fallait immédiatement signifier à l'URSS qui, conformément aux accords de Yalta, déclarait au même moment la guerre au Japon, qu'il était hors de question pour elle de tenter de participer à l'occupation de ce pays, contrairement au cas de l'Allemagne. Et c’est pour que ce message soit suffisamment fort que l’Etat américain lança une deuxième bombe contre une ville d’importance mineure sur le plan militaire, à savoir Nagasaki, où l’explosion anéantit le principal quartier ouvrier ! C’est aussi la raison du refus de Truman de se ranger à l’avis de certains de ses conseillers pour lesquels l’explosion d’une bombe nucléaire sur une zone peu peuplée du Japon eut été amplement suffisante pour amener le Japon à capituler. Non, dans la logique meurtrière de l’impérialisme, la vitrification nucléaire de deux villes était nécessaire pour intimider Staline, pour rabattre les ambitions impérialistes de l’ex-allié soviétique.
LES LECONS DE CES TERRIBLES EVENEMENTS
Quelles leçons la classe ouvrière doit-elle tirer de cette terrible tragédie et de sa répugnante utilisation par la bourgeoisie ?
En premier lieu, que ce déchaînement inouï de la barbarie capitaliste est tout sauf une fatalité, dont l’humanité serait la victime impuissante. L’organisation scientifique d’un tel carnage n’a été possible que parce que le prolétariat était vaincu à l’échelle mondiale par la contre-révolution la plus terrible et la plus implacable de toute son histoire. Brisé par la terreur stalinienne et fasciste, totalement déboussolé par l’énorme et monstrueux mensonge identifiant stalinisme et communisme, il s’est laissé finalement embrigader dans le piège mortel de la défense de la démocratie avec la complicité aussi active qu’irremplaçable des staliniens. Cela jusqu’à finir transformé en une gigantesque masse de chair à canon que la bourgeoisie pouvait utiliser à merci. Aujourd’hui, quelles que soient les difficultés que connaît le prolétariat pour approfondir son combat, la situation est tout autre. Dans les grandes concentrations prolétariennes, ce qui est à l'ordre du jour, en effet, ce n'est pas, comme au cours des années 30, l’union sacrée avec les exploiteurs, mais bel et bien l’élargissement et l’approfondissement de la lutte de classe.
A l’opposé du grand mensonge développé jusqu’à l’écoeurement par la bourgeoisie, lequel présente la guerre inter-impérialiste de 1939-45 comme une guerre entre deux « systèmes », l’un fasciste, l’autre démocratique, les cinquante millions de victimes de cet immense carnage ne sont autres que celles du système capitaliste comme un tout. La barbarie, les crimes contre l’humanité n’ont pas été l’apanage du seul camp fasciste. Les prétendus « défenseurs de la civilisation » rassemblés sous la bannière de la Démocratie, à savoir nos fameux « Alliés » ont les mains tout aussi souillées de sang que celles des « puissances de l’Axe » et le déchaînement du feu nucléaire en août 1945, même s’il est particulièrement atroce, n’est qu’un des nombreux crimes perpétrés tout au long de la guerre par ces « chevaliers blancs de la démocratie »[7] [2137].
L’horreur d’Hiroshima signifie aussi le début d’une nouvelle période dans l’enfoncement du capitalisme dans sa décadence. Elle exprime que désormais la guerre permanente est devenue le mode de vie quotidien du capitalisme. Si le traité de Versailles annonçait la prochaine guerre mondiale, la bombe sur Hiroshima marquait, quant à elle, le réel début de ce qu’on a appelé « la guerre froide » mettant aux prises l’URSS et les Etats-Unis et qui allait ensanglanter les quatre coins de la planète pendant plus de 40 ans. C’est pourquoi les lendemains de 1945, contrairement aux années qui suivirent 1918, ne voient aucun désarmement mais au contraire un accroissement gigantesque des dépenses d’armement chez tous les vainqueurs du conflit (dès 1949, l’URSS se dote de sa première bombe atomique). Dans ce cadre, l’ensemble de l’économie, sous la houlette du capitalisme d’Etat - quelles que soient les formes revêtues par ce dernier - est mise au service de la guerre. Et contrairement, là aussi, à la période qui suit la fin du premier conflit mondial le capitalisme d’Etat ne va cesser partout de se renforcer et d’exercer son emprise totalitaire sur l’ensemble de la société. Seul l’Etat peut en effet mobiliser les gigantesques ressources nécessaires pour notamment développer l’arsenal nucléaire. Ainsi le projet Manhattan ne fut que le premier d’une longue et funeste série conduisant à la plus folle et gigantesque course aux armements de l’histoire.
Loin de sanctionner l’avènement d’une ère de paix, 1945 ouvre au contraire une période de barbarie exacerbée par la menace constante d’une destruction nucléaire de la planète. Si Hiroshima et Nagasaki hantent toujours aujourd’hui la mémoire de l’humanité, c’est parce qu’ils symbolisent, ô combien tragiquement, comment et en quoi, la survie du capitalisme décadent menace directement jusqu’à la survie même de l’espèce humaine.
Cette terrible épée de Damoclès suspendue sur la tête de l’humanité confère donc au prolétariat, seule force capable de s’opposer réellement à la barbarie guerrière du capitalisme, une immense responsabilité. Car, bien que cette menace se soit momentanément éloignée avec la fin des blocs russe et américain, cette responsabilité reste entière et le prolétariat ne doit en aucune façon baisser la garde. En effet, la guerre n’a jamais été aussi présente qu’aujourd’hui, que ce soit en Afrique, en Asie, aux confins de l’ex-URSS ou à travers le conflit sanglant qui en déchirant la Yougoslavie porte la guerre en Europe, et, ce, pour la première fois depuis 1945[8] [2138] ! Et il n’est que de constater l’acharnement de la bourgeoisie à justifier l’emploi de la bombe en août 1945 pour comprendre que lorsqu’un Clinton déclare « si c’était à refaire, nous le referions »[9] [2139], il n’exprime ici rien d’autre que le sentiment de l’ensemble de sa classe. Derrière les discours hypocrites sur le danger de la prolifération nucléaire, chaque Etat met tout en oeuvre, qui, pour se doter d’un tel arsenal, qui, pour perfectionner l’arsenal existant. Plus encore, les recherches en vue d’une miniaturisation de l’arme atomique et donc de la banalisation de son usage, ne cessent de se multiplier. Pour preuve cet extrait d’un article paru dans Libération du 5 août 1995 : « Les réflexions des états-majors occidentaux autour de la riposte "du fort au fou" remettent en selle l’idée d’un usage tactique, limité du nucléaire. Après Hiroshima, le passage à l’acte devenait tabou. Après la guerre froide, l’absolu du tabou vacille. »
L’horreur de l’utilisation de l’arme nucléaire n’appartient donc pas à un passé révolu, mais représente au contraire, si le prolétariat laissait faire, le futur que réserve le capitalisme en décomposition à l’humanité. La décomposition ne supprime ni n’atténue l’omniprésence de la guerre. Elle ne fait que rendre son danger plus incontrôlable de par le chaos et le « tous contre tous » que génère la décomposition. Partout déjà on voit les grandes puissances impérialistes attiser le chaos pour défendre leurs sordides intérêts impérialistes, et l’on peut être sûr que si la classe ouvrière ne s’oppose pas à leurs actions criminelles, elles n’hésiteront pas à utiliser toutes les armes dont elles disposent, des bombes à fragmentation (elles ont été largement employées contre l’Irak) aux armes chimiques et nucléaires. Face à la seule perspective qu’offre le capitalisme en décomposition, celle de la destruction morceau par morceau de la planète et de ses habitants, le prolétariat ne doit céder ni à l’appel des sirènes du pacifisme, ni à celles de la défense de la démocratie au nom de laquelle furent vitrifiées les villes d’Hiroshima et de Nagasaki. Il doit au contraire rester fermement sur son terrain de classe : celui de la lutte contre le système d’exploitation et de mort qu’est le capitalisme. Du spectacle des horreurs, des atrocités présentes et passées que les médias étalent aujourd'hui complaisamment, qu'il provienne des images d'archives de la guerre mondiale ou de celles tirées des conflits actuels, le classe ouvrière ne doit pas tirer un sentiment d'impuissance. C'est ce que veulent justement la bourgeoisie avec cet étalage : terroriser les prolétaires, leur communiquer l'idée qu'ils ne peuvent rien faire à cela, que l'Etat capitaliste, avec ses énormes moyens de destruction, est de toutes façons le plus fort, que lui seul peut apporter la paix puisqu'aussi bien il commande à la guerre. Tout au contraire, le tableau de la barbarie que déchaîne le capitalisme doit servir à la classe ouvrière pour renforcer, dans ses luttes, sa conscience et sa volonté d'en finir avec ce système.
RN, 24 août 95.
[1] [2140] Le Monde Diplomatique, août 1990.
[2] [2141] Pour la mise au point de la bombe atomique, l’Etat américain a mobilisé toutes les ressources de la science et les a mises au service de l’armée. Deux milliards de dollars de l'époque furent consacrés au projet « Manhattan » mis sur pied par ce grand humaniste qu'était Roosevelt. Toutes les universités du pays apportèrent leur concours. Y participèrent directement ou indirectement les plus grands physiciens, de Einstein à Oppenheimer. Six prix Nobel travaillèrent à l’élaboration de la bombe. Cette gigantesque mobilisation de toutes les ressources scientifiques pour la guerre exprime un trait général de la décadence du capitalisme. Le capitalisme d’Etat, qu’il soit ouvertement totalitaire ou qu’il revête les oripeaux démocratiques, colonise et militarise toute la science. Sous son règne, cette dernière ne se développe et ne vit que par et pour la guerre. Depuis 1945, cette réalité n’a cessé de s’exacerber.
[3] [2142] Cette conférence avait pour but essentiel, notamment pour Churchill, qui en fut le véritable initiateur, de signifier à l’URSS de Staline qu’elle devait réfréner ses ambitions impérialistes et qu’il y avait des limites à ne pas franchir.
[4] [2143] Mémoires, Tome 12, Mai 1945.
[5] [2144] Pendant tout le printemps 1945, Churchill ne cesse de tempêter face à ce qu’il appelle la mollesse américaine devant le grignotage de tout l’Est de l’Europe par les troupes russes. Si cette hésitation du gouvernement US à s’opposer frontalement aux appétits impérialistes de l’Etat russe traduit la relative inexpérience de la bourgeoisie américaine dans ses nouveaux habits de superpuissance mondiale, alors que la bourgeoisie britannique disposait sur ce plan d’une expérience séculaire, elle est aussi l’expression d’arrière-pensées pas très amicales à l’égard du « frère » britannique. Le fait que la Grande-Bretagne sorte très affaiblie de la guerre et que ses positions en Europe soient menacées par « l’ours russe » ne peut que la rendre plus docile face aux diktats que l’Oncle Sam ne vas pas tarder à imposer, y compris à ses plus proches alliés. C’est un exemple supplémentaire des rapports « francs et harmonieux » régnant entre les différents requins impérialistes.
[6] [2145] Le Monde Diplomatique, août 1990.
[7] [2146] Voir Revue internationale n° 66, « Les crimes des grandes démocraties ».
[8] [2147] Au lendemain de 1945, la bourgeoisie a présenté la « guerre froide » comme une guerre entre deux systèmes de nature différentes : la démocratie face au communisme totalitaire. Par ce mensonge, elle continuait à gravement déboussoler la classe ouvrière tout en dissimulant la nature classiquement et sordidement impérialiste de la nouvelle guerre opposant les alliés d’hier. D’une certaine façon, elle a refait le coup en 1989 en clamant qu’avec la « chute du communisme » la paix allait enfin pouvoir régner. Or, depuis lors, du Golfe à la Yougoslavie, on a vu ce que valait cette promesse des Bush, Gorbatchev et consorts.
[9] [2148] Libération, 11 avril 1995.
Géographique:
- Japon [2149]
Questions théoriques:
- Guerre [129]
FRIEDRICH ENGELS : il y a cent ans disparaissait un « grand forgeron du socialisme »
- 4510 reads
« Friedrich Engels s'est éteint à Londres le 5 août 1895. Après son ami Karl Marx (mort en 1883), [...] Marx et Engels ont été les premiers à montrer que la classe ouvrière et ses revendications sont un produit nécessaire du régime économique actuel qui crée et organise inéluctablement le prolétariat en même temps que la bourgeoisie ; ils ont montré que ce ne sont pas les tentatives bien intentionnées d'hommes au coeur généreux qui délivreront l'humanité des maux qui l'accablent aujourd'hui, mais la lutte de classe du prolétariat organisé. Marx et Engels ont été les premiers à expliquer, dans leurs oeuvres scientifiques, que le socialisme n'est pas une chimère, mais le but final et le résultat nécessaire du développement des forces productives de la société actuelle. »
C'est par ces lignes que Lénine commençait, un mois après le décès du compagnon de Marx, une courte biographie d'un des meilleurs militants du combat communiste.
Un combattant exemplaire du prolétariat
Engels, né à Barmen en 1820 dans la province rhénane de la Prusse, fut en effet un exemple de militant dévoué toute sa vie au combat de la classe ouvrière. Issu d'une famille d'industriels il aurait pu vivre richement et confortablement sans se soucier du combat politique. Or, comme Marx et beaucoup de jeunes étudiants révoltés par la misère du monde dans lequel ils vivaient, il va très jeune acquérir une maturité politique exceptionnelle au contact de la lutte des ouvriers en Angleterre, en France puis en Allemagne. Il était inévitable que dans la période historique où le prolétariat se constituait en classe, développait son combat politique il attirât un certain nombre d'éléments intellectuels dans ses rangs.
Engels fut toujours modeste sur sa trajectoire individuelle, ne manquant jamais de saluer l'apport considérable de son ami Marx. Cependant, à peine âgé de 25 ans, il agit en précurseur. Il est témoin en Angleterre de la marche catastrophique de l'industrialisation et du paupérisme. Il perçoit les promesses, en même temps que les faiblesses, du mouvement ouvrier dans ses balbutiements (le Chartisme). Il prend conscience que « l'énigme de l'histoire » réside dans ce prolétariat méprisé et méconnu, il fréquente les meetings ouvriers à Manchester où il voit les prolétaires s'attaquer franchement au christianisme et prétendre s'occuper de leur avenir.
En 1844, Engels écrit un article, Contribution à la critique de l'économie politique, pour les Annales franco-allemandes, revue publiée en commun à Paris par Arnold Ruge, un jeune démocrate, et par Marx qui, à ce moment-là, se situe encore sur le terrain de la lutte pour la conquête de la démocratie contre l'absolutisme prussien. C'est ce texte qui ouvre véritablement les yeux à Marx sur la nature profonde de l'économie capitaliste. Puis, l'ouvrage d'Engels, La condition de la classe laborieuse en Angleterre, publié en 1845, devient un livre de référence pour toute une génération de révolutionnaires. Comme l'écrit Lénine, Engels fut donc le premier à déclarer que le prolétariat « n'est pas seulement » une classe qui souffre, mais que la situation économique intolérable où il se trouve le pousse irrésistiblement en avant et l'oblige à lutter pour son émancipation finale. Deux ans plus tard, c'est aussi Engels qui rédige sous forme de questionnaire Les principes du communisme qui servira de canevas à la rédaction du mondialement connu Manifeste communiste, signé par Marx et Engels.
En fait, l'essentiel de l'immense contribution que Engels a faite au mouvement ouvrier est le fruit d'une étroite collaboration avec Marx, et réciproquement. Ils font véritablement connaissance à Paris durant l'été 1844. Dès lors commencera un travail commun pour toute une vie, une confiance réciproque rare, mais qui ne reposera pas simplement sur une amitié hors du commun, mais sur une communion d'idées, une conviction partagée du rôle historique du prolétariat et un combat constant pour l'esprit de parti, pour gagner de plus en plus d'éléments au combat révolutionnaire.
Ensemble, dès leur rencontre, Marx et Engels vont très vite dépasser leurs visions philosophiques du monde pour se consacrer à cet événement sans précédent dans l'histoire, le développement d'une classe, le prolétariat, à la fois exploitée et révolutionnaire. Une classe d'autant plus révolutionnaire qu'elle a cette particularité d'acquérir une claire « conscience de classe » débarrassée des préjugés et des auto-mystifications qui pesaient sur les classes révolutionnaires du passé, telle la bourgeoisie. De cette réflexion commune sortiront deux livres : La Sainte Famille publié en 1844 et L'idéologie allemande écrit entre 1844 et 1846, mais qui ne sera publié qu'au 20e siècle. Dans ces livres, Marx et Engels règlent leur compte aux conceptions philosophiques des « jeunes hégéliens », leurs premiers compagnons de combat, qui n'ont pas su dépasser une vision bourgeoise ou petite bourgeoise du monde. En même temps, ils y font l'exposé d'une vision matérialiste et dialectique de l'histoire, une vision qui rompt avec l'idéalisme (qui considère que « ce sont les idées qui gouvernent le monde ») mais aussi avec le matérialisme vulgaire qui ne reconnaît aucun rôle actif à la conscience. Pour leur part, Marx et Engels considèrent que « quand la théorie s'empare des masses, elle devient force matérielle ». C'est ainsi que les deux amis, totalement convaincus de cette unité entre l'être et la conscience, ne vont jamais séparer le combat théorique du prolétariat de son combat pratique, ni leur propre participation à ces deux formes du combat.
En effet, contrairement à l'image que la bourgeoisie en a souvent donnée, Marx et Engels ne furent jamais des « savants en chambre », coupés des réalités et des combats pratiques. En 1847, le Manifeste qu'ils rédigent ensemble s'appelle en réalité Manifeste du Parti communiste et doit servir de programme à la « Ligue des Communistes », une organisation qui s'apprête à prendre part aux combats qui s'annoncent. En 1848, lorsqu'éclate une série de révolutions bourgeoises sur le continent européen, Marx et Engels y participent activement afin de contribuer à l'éclosion des conditions qui permettront le développement économique et politique du prolétariat. Rentrés en Allemagne, ils publient un quotidien, La Nouvelle Gazette Rhénane qui devient un instrument de combat. Plus concrètement encore, Engels s'engage dans les troupes révolutionnaires qui mènent le combat dans le pays de Bade.
Après l'échec et la défaite de cette vague révolutionnaire européenne, la participation à celle-ci vaudra à Engels, aussi bien qu'à Marx, d'être poursuivis par toutes les polices du continent, ce qui les contraint de s'exiler en Angleterre. Marx s'installe définitivement à Londres alors qu'Engels va travailler jusqu'en 1870 dans l'usine de sa famille à Manchester. L'exil ne paralyse nullement leur participation aux combats de la classe. Ils poursuivent leur activité au sein de la Ligue des communistes jusqu'en 1852, date à laquelle, pour éviter à celle-ci une dégénérescence suite au reflux des luttes, ils se prononcent pour sa dissolution.
En 1864, lorsque se constitue, dans la foulée d'une reprise internationale des combats ouvriers, l'Association internationale des travailleurs, ils y participent activement. Marx devient membre du Conseil général de l'AIT et Engels l'y rejoint en 1870 lorsqu'il peut enfin se libérer de son travail à Manchester. C'est un moment crucial dans la vie de l'AIT et c'est côte à côte que les deux amis vont participer aux combats que mène l'Internationale : la Commune de Paris de 1871, la solidarité aux réfugiés après celle-ci (au Conseil Général, c'est Engels qui anime le service d'aide matérielle aux communards émigrés à Londres) et surtout la défense de l'AIT contre les menées de l'Alliance de la Démocratie socialiste animée par Bakounine. Marx et Engels sont présents, en septembre 1872, au Congrès de La Haye qui barre la route de l'Alliance et c'est Engels qui rédige la plus grande partie du rapport, confié par le Congrès au Conseil général, sur les intrigues des bakouninistes.
L'écrasement de la Commune a porté un coup très brutal au prolétariat européen et l'AIT, la « vieille internationale » comme l'appelleront désormais Marx et Engels, s'éteint en 1876. Les deux compagnons ne cessent pas pour autant le combat politique. Ils suivent de très près les partis socialistes qui se constituent et se développent dans la plupart des pays d'Europe, une activité que Engels poursuivra énergiquement après la mort de Marx en 1883. Ils sont particulièrement attentifs au mouvement qui se développe en Allemagne et qui devient le phare du prolétariat mondial. Ils y interviennent pour combattre toutes les confusions qui pèsent sur le Parti social-démocrate comme en témoignent la Critique du Programme de Gotha (rédigée par Marx en 1875) et la Critique du Programme d'Erfurt (Engels, 1891).
Ainsi, Engels, tout comme Marx, fut avant tout un militant du prolétariat, partie prenante des différents combats menés par celui-ci. Au soir de sa vie, Engels confia que rien n'avait été plus passionnant que le combat de propagande militante. Il évoquait, en particulier sa joie de collaborer à une presse quotidienne dans l'illégalité, avec La Nouvelle Gazette Rhénane en 1848, puis avec le Sozialdemocrat dans les années 1880, lorsque le parti subissait les rigueurs de la loi de Bismark contre les socialistes.
La collaboration d'Engels et de Marx fut particulièrement féconde ; même éloignés l'un de l'autre, ou lorsque leurs organisations étaient dissoutes, ils continuèrent à lutter, entourés de compagnons fidèles eux aussi au travail de fraction indispensable dans les périodes de reflux, maintenant cette activité de minorité par de multiples correspondances.
C'est à cette collaboration également qu'on doit les ouvrages théoriques majeurs rédigés aussi bien par Engels que par Marx. Ceux écrits par Engels résultaient grandement de l'échange permanent d'idées et de réflexions qu'il avait avec Marx. Il en est ainsi de L'Anti-Dühring (publié en 1878 et qui a constitué un des instruments essentiels de la formation des militants socialistes d'Allemagne) comme de L'Origine de la famille, de la propriété privée et de l'Etat (1884) qui expose le plus précisément la conception communiste de l'Etat sur laquelle se baseront par la suite les révolutionnaires (notamment Lénine dans L'Etat et la révolution). Même Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande, publié après la mort de Marx, n'a pu être écrit qu'à la suite de la réflexion menée en commun, depuis leur jeunesse, par les deux amis.
Réciproquement, sans la contribution d'Engels, l'ouvrage majeur de Marx, Le Capital, n'aurait jamais vu le jour. Déjà, c'est Engels, comme on l'a vu, qui en 1844 avait fait comprendre à Marx la nécessité de s'attaquer à une critique de l'économie politique. Par la suite, toutes les avancées, toutes les hypothèses contenues dans Le Capital ont fait l'objet de longues correspondances : c'est ainsi par exemple qu'Engels, directement impliqué dans la fonctionnement d'une entreprise capitaliste, a pu fournir des informations de première main sur ce fonctionnement. De même, les encouragements et les conseils permanents d'Engels ont contribué beaucoup à ce que le premier livre de l'ouvrage soit publié en 1867. Enfin, alors que Marx avait laissé à sa mort une masse considérable de brouillons, c'est Engels qui les a mis en forme pour en faire les livres II et III du Capital (publiés en 1885 et 1894).
Engels et la 2e Internationale
Ainsi, Engels, qui n'a jamais prétendu qu'au rôle de « second violon », a laissé cependant au prolétariat une oeuvre à la fois profonde et d'une grande lisibilité. Mais il a aussi et surtout permis, après la mort de Marx, que soient légués un « esprit de parti », une expérience et des principes organisationnels qui on valeur de continuité et qui ont été transmis jusqu'à la IIIe Internationale.
Engels avait participé à la fondation, en 1847, de la Ligue des Communistes puis de l'AIT en 1864. Après la dissolution de la 1ère Internationale, Engels joua un rôle important dans le maintien des principes lors de la reconstitution d'une deuxième Internationale à laquelle il ne ménagea jamais ses conseils. Il avait estimé prématurée la fondation de cette nouvelle Internationale, mais pour combattre la réapparition d'intrigants comme Lassalle ou la résurgence de l'opportunisme anarchisant, il avait mis tout son poids pour vaincre l'opportunisme au congrès international de fondation à Paris en 1889. En fait, jusqu'à sa mort, Engels s'efforcera de lutter contre l'opportunisme qui ressurgira, notamment dans la social-démocratie allemande, contre la veulerie de l'influence petite-bourgeoise, contre l'élément anarchiste destructeur de toute vie organisationnelle et contre l'aile réformiste de plus en plus séduite par les chants de sirène de la démocratie bourgeoise.
A la fin du siècle dernier, la bourgeoisie avait toléré le développement du suffrage universel. En Allemagne, en particulier, le nombre d'élus socialistes put donner une impression de force dans le cadre de la légalité aux éléments réformistes et opportunistes du parti. L'historiographie bourgeoise et les ennemis du marxisme se sont servis de déclarations d'Engels, en partie justifiées, contre les vieilleries barricadières, pour laisser croire que le vieux militant était devenu un pacifiste réformiste lui aussi ([1] [2150]). En particulier, la préface qu'il écrivit, en 1895, au texte de Marx sur Les luttes de classe en France, était invoquée comme démonstration qu'Engels jugeait périmé le temps des révolutions. C'est vrai que cette introduction contenait des formulations fausses (2), [2151] mais le texte publié n'avait presque plus rien à voir avec l'original. En effet, ce document avait été tronqué une première fois par Kautsky pour éviter des poursuites judiciaires, puis, une autre fois, le texte avait été vraiment expurgé par Wilhem Liebknecht. Engels écrivit à Kautsky pour exprimer son indignation de trouver dans le Vorwärts un extrait de son introduction qui le faisait « apparaître comme un partisan à tout prix de la légalité » (1er avril 1895). Deux jours après, il se plaignait également à Lafargue : « Liebknecht vient de me jouer un joli tour. Il a pris de mon introduction aux articles de Marx sur la France de 1848-1850 tout ce qui a pu lui servir pour soutenir la tactique à tout prix paisible et antiviolente qu'il lui plaît de prêcher depuis quelques temps. »
Malgré les multiples mises en garde d'Engels, l'inféodation à l'opportunisme des Bernstein, Kautsky et compagnie allait déboucher sur l'éclatement de la deuxième Internationale en 1914 contre la vague social-chauviniste. Mais, cette internationale avait bien été un lieu du combat révolutionnaire contrairement aux dénégations des modernes conteurs d'histoire à la GCI (3). [2152] Ses acquis politiques, l'internationalisme qu'elle avait affirmé à ses congrès (notamment ceux de 1907 à Stuttgart et de 1912 à Bâle), les principes organisationnels (défense de la centralisation, combat contre les intrigants et les jeunes arrivistes, etc.) n'étaient pas perdus pour l'aile gauche de l'Internationale d'Engels, puisque les Lénine, Rosa Luxemburg, Pannekoek et Bordiga, parmi tant d'autres, allaient reprendre l'étendard révolutionnaire farouchement défendu par le vieux combattant jusqu'au bout.
oOo
La fille de Marx, Eleanor, dans un article que lui avait demandé une revue socialiste allemande pour les 70 ans d'Engels, a rendu un hommage mérité à l'homme et au militant : « Il n'y a qu'une chose qu'Engels n'a jamais pardonné - la fausseté. Un homme qui n'est pas vrai envers lui, plus encore celui qui n'est pas fidèle à son parti, ne trouve aucune pitié auprès d'Engels. Ce sont, pour lui, des péchés impardonnables. Engels ne connaît pas d'autres péchés... Engels, qui est l'homme le plus exact du monde, qui a plus que n'importe qui, un sentiment très vif du devoir et surtout de la discipline envers le parti, n'est pas le moins du monde un puritain. Personne, comme lui, n'est capable de tout comprendre, et, partant, personne ne pardonne aussi aisément nos petites faiblesses ». En republiant ce texte, la presse socialiste de l'époque (numéro d'août 1895 du Devenir social), presse socialiste de l'époque salua la mémoire du grand combattant : « Un homme est mort qui s'est volontairement maintenu au second plan, pouvant être au premier. L'idée, son idée, est debout, partout vivante, plus vivante que jamais, et défiant toutes les attaques, grâce aux armes qu'il a, avec Marx, contribué à lui fournir. On n'entendra plus retentir sur l'enclume le marteau de ce vaillant forgeron ; le bon ouvrier est tombé ; le marteau échappé de ses mains puissantes est à terre et y restera peut-être longtemps ; mais les armes qu'il a forgées sont toujours là, solides et brillantes. S'il n'est pas donné à beaucoup d'en pouvoir forger de nouvelles, ce que, du moins, nous pouvons tous faire, ce que nous devons faire, c'est de ne pas laisser rouiller celles qui nous ont été livrées ; et, à cette condition, elles nous gagneront la victoire pour laquelle elles ont été faites ».
F. Médéric
(3) [2155]Sur la défense du caractère prolétarien de la deuxième internationale, voir notre article « La continuité des organisations politiques du prolétariat : la nature de classe de la social-démocratie », Revue Internationale n° 50.
Heritage de la Gauche Communiste:
REVOLUTION ALLEMANDE (III) : l'insurrection prématurée
- 3912 reads
Ce troisième article consacré aux luttes révolutionnaires en Allemagne de 1918-1919 ([1] [2156]) aborde une des questions les plus délicates du combat prolétarien : les conditions et l’opportunité de l’insurrection. L’expérience allemande, pour négative qu’elle fut, constitue dans ce domaine une très riche source d’enseignements pour les combats révolutionnaires à venir.
En novembre 1918, en se soulevant, la classe ouvrière contraint la bourgeoisie en Allemagne à mettre fin à la guerre. Pour saboter la radicalisation du mouvement et la répétition des “ événements de Russie ”, la classe capitaliste utilise, au sein des luttes le SPD ([2] [2157]) comme fer de lance contre la classe ouvrière. Grâce à une politique de sabotage particulièrement habile, le SPD, avec l'aide des syndicats, a tout fait pour saper la force des conseils ouvriers.
Face au développement explosif du mouvement, voyant partout des mutineries de soldats et le passage de ceux-ci du côté des ouvriers en insurrection, il est impossible, à la bourgeoisie, d'envisager une politique de répression immédiate. Elle se doit d'abord d'agir politiquement contre la classe ouvrière pour ensuite obtenir la victoire militaire. Nous avons analysé en détails dans la Revue internationale n° 82 le sabotage politique qu'elle a accompli. Nous voulons aborder ici son action au niveau de l'insurrection ouvrière.
Les préparatifs en vue d'une action militaire sont engagés depuis le premier jour. Ce ne sont pas les partis de droite de la bourgeoisie qui organisent cette répression mais celui qui passe encore pour “ le grand parti du prolétariat ”, le SPD, et cela en étroite collaboration avec l'armée. Ce sont ces “ démocrates ” tant célébrés qui entrent en action comme dernière ligne de défense du capitalisme. Ce sont eux qui se révèlent le rempart le plus efficace du capital. Le SPD commence par mettre systématiquement sur pieds des corps-francs dans la mesure où les unités des troupes régulières infestées par le “ virus des luttes ouvrières ” suivent de moins en moins le gouvernement bourgeois. Ainsi des unités de volontaires, bénéficiant de soldes spéciales, vont servir d'auxiliaires à la répression.
Les provocations militaires des 6 et 24 décembre 1918
Le 6 décembre, juste un mois après le début des luttes, le SPD donne l'ordre à ses sbires d'entrer en force dans les locaux du journal de Spartakus, Die Rote Fahne. K. Liebknecht, R. Luxemburg, quelques autres Spartakistes, mais aussi des membres du Conseil exécutif de Berlin sont arrêtés. Simultanément, les troupes loyales au gouvernement attaquent une manifestation de soldats démobilisés et de déserteurs ; quatorze manifestants sont tués. En réaction plusieurs usines entrent en grève le 7 décembre ; partout des assemblées générales se tiennent dans les usines. Le 8 décembre se produit pour le première fois une manifestation d'ouvriers et de soldats en armes rassemblant plus de 150 000 participants. Dans des villes de la Ruhr, comme à Mülheim, les ouvriers et les soldats arrêtent des patrons de l'industrie.
Face aux provocations du gouvernement les révolutionnaires ne poussent pas à l'insurrection immédiate mais appellent à la mobilisation massive des ouvriers. Les Spartakistes analysent, en effet, que les conditions nécessaires au renversement du gouvernement bourgeois ne sont pas encore réunies notamment au niveau des capacités de la classe ouvrière. ([3] [2158])
Le Congrès national des conseils qui se tient à la mi-décembre 1918 illustre cette situation et la bourgeoisie va en tirer profit (voir le dernier article dans la Revue internationale n° 82). Lors de ce Congrès, les délégués décident de soumettre leurs décisions à une Assemblée nationale qu'il faut élire. Simultanément est mis en place un “ Conseil central ” (Zentralrat) composé exclusivement de membres du SPD prétendant parler au nom des conseils d’ouvriers et de soldats d'Allemagne. Après ce congrès la bourgeoisie se rend compte qu'elle peut utiliser immédiatement cette faiblesse politique de la classe ouvrière en déclenchant une seconde provocation militaire : les corps-francs et les troupes gouvernementales passent à l'offensive le 24 décembre. Onze marins et plusieurs soldats sont tués. De nouveau une grande indignation s'élève parmi les ouvriers. Ceux de la “ Société des moteurs Daimler ” et de nombreuses autres usines berlinoises réclament la formation d'une Garde Rouge. Le 25 décembre ont lieu de puissantes manifestations en riposte à cette attaque. Le gouvernement est contraint de reculer. Suite au discrédit grandissant qui frappe l'équipe au pouvoir, l'USPD ([4] [2159]), qui en faisait partie jusqu'alors aux côtés du SPD, se retire.
Cependant la bourgeoisie ne lâche pas pied. Elle continue à vouloir procéder au désarmement du prolétariat à Berlin et se prépare à lui porter un coup décisif.
Le SPD appelle au meurtre des communistes
Afin de dresser la population contre le mouvement de la classe ouvrière, le SPD se fait le porte-voix d'une ignoble et puissante campagne de calomnie contre les révolutionnaires et va même jusqu'à appeler au meurtre des Spartakistes : “ Vous voulez la paix ? Alors chacun doit faire en sorte que la tyrannie des gens de Spartakus prenne fin ! Vous voulez la liberté ? Alors mettez les fainéants armés de Liebknecht hors d'état de nuire ! Vous voulez la famine ? Alors suivez Liebknecht ! Vous voulez devenir les esclaves de l'Entente ? Liebknecht s'en occupe ! A bas la dictature des anarchistes de Spartakus ! Seule la violence peut être opposée à la violence brutale de cette bande de criminels ! ” (Tract du conseil municipal du Grand-Berlin du 29 décembre 1918)
“ Les agissements honteux de Liebknecht et de Rosa Luxemburg salissent la révolution et mettent en péril toutes ses conquêtes. Les masses ne doivent plus tolérer une minute de plus que ces tyrans et leurs partisans paralysent ainsi les instances de la République. (...) C'est par le mensonge, la calomnie et la violence qu'ils renverseront et abattront tout obstacle qui osera s'opposer à eux.
Nous avons fait la révolution pour mettre fin à la guerre ! Spartakus veut une nouvelle révolution pour commencer une nouvelle guerre. ” (tract du SPD, janvier 1919)
Fin décembre, le groupe Spartakus quitte l'USPD et s'unit aux IKD ([5] [2160]) pour former le KPD. La classe ouvrière dispose ainsi d'un Parti communiste qui est né en plein mouvement et qui, d'emblée, est la cible des attaques du SPD, le principal défenseur du capital.
Pour le KPD c'est l'activité des masses ouvrières les plus larges qui est indispensable pour s'opposer à cette tactique du capital. “ Après la première phase de la révolution, celle de la lutte essentiellement politique, s'ouvre la phase de la lutte renforcée, intensifiée et principalement économique. ” (R. Luxemburg au Congrès de fondation du KPD). Le gouvernement SPD “ ne viendra pas à bout des flammes de la lutte de classe économique. ” (Ibid.) C'est pourquoi le capital, avec le SPD à sa tête, va tout faire pour empêcher tout élargissement des luttes sur ce terrain en provoquant des soulèvements armés prématurés des ouvriers et en les réprimant. Il s'agit, pour lui, dans un premier temps d'affaiblir le mouvement en son centre, à Berlin, pour ensuite s'attaquer au reste de la classe ouvrière.
Le piège de l'insurrection prématurée à Berlin
En janvier la bourgeoisie réorganise les troupes stationnées à Berlin. En tout, elle masse plus de 80 000 soldats autour de la ville dont 10 000 forment des troupes de choc. Au début du mois, elle lance une nouvelle provocation contre les ouvriers afin de les amener à en découdre militairement. Le 4 janvier, en effet, le préfet de police de Berlin, Eichhorn, est démis de ses fonctions par le gouvernement bourgeois. Ceci est aussitôt ressenti comme une agression par la classe ouvrière. Le soir du 4 janvier, les “ hommes de confiance révolutionnaires ” ([6] [2161]) se réunissent en une séance à laquelle participent Liebknecht et Pieck au nom du KPD, fondé quelques jours auparavant. Un “ Comité révolutionnaire provisoire ”, qui s'appuie sur le cercle des “ hommes de confiance ”, est créé. Mais dans le même temps le Comité exécutif des conseils de Berlin (Vollzugsrat) et le Comité central (Zentralrat) nommé par le congrès national des conseils -tous deux dominés par le SPD- continuent d'exister et d'agir au sein de la classe.
Le Comité d'action révolutionnaire appelle à un rassemblement de protestation pour le dimanche 5 janvier. Environ 150 000 ouvriers s'y rendent après une manifestation devant la préfecture de police. Le soir du 5 janvier quelques manifestants occupent les locaux du journal du SPD Vorwærts et d'autres maisons d'édition. Ces actions sont probablement suscitées par des agents provocateurs, en tout cas elles se produisent sans que le Comité n'en ait connaissance et sans son approbation.
Mais les conditions pour le renversement du gouvernement ne sont pas réunies et c'est ce que met en évidence le KPD dans un tract au tout début du mois de janvier :
“ Si les ouvriers de Berlin dispersaient aujourd'hui l'Assemblée nationale, s'ils jetaient en prison les Ebert-Scheidemann alors que les ouvriers de la Ruhr, de Haute-Silésie et les ouvriers agricoles des pays de l'est de l'Elbe restent calmes, les capitalistes seraient alors en mesure de soumettre Berlin dés le lendemain en l'affamant. L'offensive de la classe ouvrière contre la bourgeoisie, le combat pour la prise du pouvoir par les conseils d’ouvriers et de soldats doivent être l'oeuvre de l'ensemble du peuple travailleur dans tout le Reich. Seule la lutte des ouvriers des villes et des campagnes en tout lieu et en permanence, s'accélérant et allant croissant, à condition qu'elle se transforme en un flot puissant traversant toute l'Allemagne à grand fracas, seule la vague initiée par les victimes de l'exploitation et de l'oppression, submergeant tout le pays, permettront de faire éclater le gouvernement du capitalisme, de disperser l'Assemblée nationale et d'installer sur leurs ruines le pouvoir de la classe ouvrière qui conduira le prolétariat à la complète victoire dans la lutte ultérieure contre la bourgeoisie. (...)
Ouvriers et ouvrières, soldats et marins ! Convoquez partout des assemblées et éclairez les masses sur le bluff de l'Assemblée nationale. Dans chaque atelier, dans chaque unité de troupe, dans chaque ville, voyez et examinez si votre conseil d’ouvriers et de soldats a vraiment été élu, s'il ne comporte pas en son sein des représentants du système capitaliste, des traîtres à la classe ouvrière comme les hommes de Scheidemann, ou des éléments inconsistants et oscillants comme les Indépendants. Convainquez alors les ouvriers et faites élire des communistes. (...) Là où vous possédez la majorité dans les conseils ouvriers, faites que ces conseils ouvriers établissent immédiatement des liaisons avec les autres conseils ouvriers de la région. (...) Si ce programme est réalisé (...) l'Allemagne de la république des conseils aux côtés de la république des conseils des ouvriers russes entraînera les ouvriers d'Angleterre, de France, d'Italie sous le drapeau de la révolution... ”. Cette analyse montre que le KPD voit clairement que le renversement de la classe capitaliste n'est pas encore possible dans l'immédiat et que l'insurrection n'est pas encore à l'ordre du jour.
Après la gigantesque manifestation de masse du 5 janvier, se tient à nouveau le soir même une séance des “ hommes de confiance ” avec la participation de délégués du KPD et de l'USPD ainsi que de représentants des troupes de la garnison. Marqués par l'impression laissée par la puissante manifestation de la journée, les présents élisent un comité d'action (Aktionsauschuß) comprenant 33 membres à la tête duquel sont placés Ledebour comme président, Scholze pour les “ hommes de confiance révolutionnaires ” et K. Liebknecht pour le KPD. Pour le lendemain 6 janvier la grève générale et une nouvelle manifestation sont décidés.
Le Comité d'action distribue un tract d'appel à l'insurrection avec le mot d'ordre : “ Luttons pour le pouvoir du prolétariat révolutionnaire ! A bas le gouvernement Ebert-Scheidemann ! ”
Des soldats viennent proclamer leur solidarité au Comité d'action. Une délégation de soldats assure qu'elle se mettra du côté de la révolution dès la déclaration de la destitution de l'actuel gouvernement Ebert-Scheidemann. Là-dessus, K. Liebknecht pour le KPD, Scholze pour les “ hommes de confiance révolutionnaires ” signent un décret proclamant cette destitution et la prise en charge des affaires gouvernementales par un comité révolutionnaire. Le 6 janvier, environ 500 000 personnes manifestent dans la rue. Dans tous les quartiers de la ville ont lieu des manifestations et des rassemblements ; les ouvriers du Grand-Berlin réclament des armes. Le KPD exige l'armement du prolétariat et le désarmement des contre-révolutionnaires. Alors que le mot d'ordre “ A bas le gouvernement ! ” a été donné par le Comité d'action, celui-ci ne prend aucune initiative sérieuse pour réaliser cette orientation. Dans les usines, aucune troupe de combat n'est organisée, aucune tentative n'est faite pour prendre en mains les affaires de l'Etat et pour paralyser l'ancien gouvernement. Non seulement le Comité d'action ne possède aucun plan d'action, mais le 6 janvier il est lui même mis en demeure, par des soldats de la marine, de quitter le bâtiment où il siège, ce qu'il fait effectivement !
Les masses d'ouvriers en manifestation attendent des directives dans les rues pendant que les dirigeants siègent désemparés. Alors que la direction du prolétariat demeure dans l'expectative, hésite, ne possède même aucun plan, la gouvernement mené par le SPD, de son côté, se remet rapidement du choc causé par cette première offensive ouvrière. De toutes parts se rassemblent autour de lui des forces qui lui viennent en aide. Le SPD appelle à des grèves et à des manifestations de soutien en faveur du gouvernement. Une campagne acharnée et perfide est lancée contre les communistes : “ Là où règne Spartakus, toute liberté et sécurité individuelle sont abolies. Les périls les plus graves menacent le peuple allemand et en particulier la classe ouvrière allemande. Nous ne voulons pas nous laisser terroriser plus longtemps par ces criminels à l'esprit égaré. L'ordre doit enfin être établi à Berlin et la construction paisible d'une Allemagne révolutionnaire nouvelle doit être garantie. Nous vous convions à cesser le travail en protestation contre les brutalités des bandes spartakistes et à vous rassembler immédiatement devant l'hôtel du gouvernement du Reich. ” (...)
“ Nous ne devons pas trouver le repos tant que l'ordre n'est pas rétabli à Berlin et tant que la jouissance des conquêtes révolutionnaires n'est pas garantie à l'ensemble du peuple allemand. A bas les meurtriers et les criminels ! Vive la république socialiste ! ” (Comité exécutif du SPD, 6 janvier 1919)
La cellule de travail des étudiants berlinois écrit : “ Vous, citoyens, sortez de vos demeures et mettez vous aux côtés des socialistes majoritaires ! La plus grande hâte est nécessaire ! ” (Tract du 7-8 janvier 1919).
De son côté Noske déclare avec cynisme le 11 janvier : “ Le gouvernement du Reich m'a transmis le commandement des soldats républicains. Un ouvrier se trouve donc à la direction des forces de la République socialiste. Vous me connaissez, moi et mon passé dans le Parti. Je me porte garant qu'aucun sang inutile ne sera versé. Je veux assainir, non anéantir. L'unité de la classe ouvrière doit être faite contre Spartakus pour que la démocratie et le socialisme ne sombrent pas. ”
Le Comité central (Zentralrat), “ nommé ” par le Congrès national des conseils et surtout dominé par le SPD, proclame : “ ... une petite minorité aspire à l'instauration d'une tyrannie brutale. Les agissements criminels de bandes armées mettant en danger toutes les conquêtes de la révolution, nous contraignent à conférer les pleins pouvoirs extraordinaires au gouvernement du Reich afin que l'ordre (...) soit enfin rétabli dans Berlin. Toutes les divergences d'opinions doivent s'effacer devant le but (...) de préserver l'ensemble du peuple travailleur d'un nouveau et terrible malheur. Il est du devoir de tous les conseils d'ouvriers et de soldats de nous soutenir dans notre action, nous et le gouvernement du Reich, par tous les moyens (...) ” (Edition spéciale du Vorwærts, 6 janvier 1919).
Ainsi, c'est au nom de la révolution et des intérêts du prolétariat que le SPD (avec ses complices) se prépare à massacrer les révolutionnaires du KPD. C'est avec la plus ignoble duplicité qu'il appelle les conseils à se ranger derrière le gouvernement pour agir contre ce qu'il nomme “ les bandes armées ”. Le SPD fournit même une section militaire qui reçoit des armes dans les casernes et Noske est placé à la tête des troupes de répression : “ Il faut un chien sanglant, je ne recule pas devant cette responsabilité. ”
Dés le 6 janvier se produisent des combats isolés. Tandis que le gouvernement ne cesse de masser des troupes autour de Berlin, le soir du 6, siège l'Exécutif des conseils de Berlin. Celui-ci, dominé par le SPD et l'USPD, propose au Comité d'action révolutionnaire des négociations entre les “ hommes de confiance révolutionnaires ” et le gouvernement, au renversement duquel le Comité révolutionnaire vient justement d'appeler. L’Exécutif des conseils joue le rôle de “ conciliateur ” en proposant de concilier l'inconciliable. Cette attitude déboussole les ouvriers et en particulier les soldats déjà hésitants. C'est ainsi que les marins décident d'adopter une politique de “ neutralité ”. Dans les situations d'affrontement direct entre les classes, toute indécision peut rapidement conduire la classe ouvrière à une perte de confiance dans ses propres capacités et à adopter une attitude de méfiance vis à vis de ses organisations politiques. Le SPD, en jouant cette carte, contribue à affaiblir le prolétariat de façon dramatique. Simultanément, par l'intermédiaire d'agents provocateurs (comme cela sera révélé par la suite), il pousse les ouvriers à l’affrontement. C'est ainsi que le 7 janvier, ceux-ci occupent par la force les locaux de plusieurs journaux.
Face à cette situation, la direction du KPD, contrairement au Comité d'action révolutionnaire, a une position très claire : se basant sur l'analyse de la situation faite au cours de son congrès de fondation, elle considère l'insurrection comme prématurée.
Le 8 janvier Die Rote Fahne écrit : “ Il s'agit aujourd'hui de procéder à la réélection des conseils d’ouvriers et de soldats, de reprendre l'Exécutif des conseils de Berlin sous le mot d'ordre : dehors les Ebert et consorts ! Il s'agit aujourd'hui de tirer les leçons des expériences des huit dernières semaines dans les conseils d’ouvriers et de soldats et d'élire des conseils qui correspondent aux conceptions, aux buts et aux aspirations des masses. Il s'agit en un mot de battre les Ebert-Scheidemann dans ce qui forme les fondements de la révolution, les conseils d'ouvriers et de soldats. Ensuite, mais seulement ensuite, les masses de Berlin et aussi de l'ensemble du Reich auront dans les conseils d’ouvriers et de soldats de véritables organes révolutionnaires qui leur donneront, dans tous les moments décisifs, de véritables dirigeants, de véritables centres pour l'action, pour les luttes et pour la victoire. ”
Les Spartakistes appellent ainsi la classe ouvrière à se renforcer d'abord au niveau des conseils en développant les luttes sur son propre terrain de classe, dans les usines, et en en délogeant les Ebert, Scheidemann et Cie. C'est par l'intensification de sa pression, à travers ses conseils, qu'elle pourra donner une nouvelle impulsion à son mouvement pour ensuite se lancer dans la bataille de la prise du pouvoir politique.
Ce jour même, R. Luxemburg et L. Jogisches critiquent violemment le mot d'ordre de renversement immédiat du gouvernement lancé par le Comité d'action mais aussi et surtout le fait que celui-ci, par son attitude hésitante voire capitularde, se montre incapable de diriger le mouvement de la classe. Ils reprochent plus particulièrement à K. Liebknecht d'agir de sa propre autorité, de se laisser entraîner par son enthousiasme et son impatience au lieu d'en référer à la direction du Parti et de prendre appui sur le programme et les analyses du KPD.
Cette situation montre que ce n'est ni le programme ni les analyses politiques de la situation qui font défaut mais la capacité du parti, en tant qu'organisation, à jouer son rôle de direction politique du prolétariat. Fondé depuis quelques jours seulement, le KPD n'a pas l'influence dans la classe ni encore moins la solidité et la cohésion organisationnelles qu'avait notamment le parti bolchevik un an auparavant en Russie. Cette immaturité du parti communiste en Allemagne est à la base de la dispersion qui existe dans ses rangs, laquelle va peser lourdement et de façon dramatique dans la suite des événements.
Dans la nuit du 8 au 9 janvier, les troupes gouvernementales se lancent à l'assaut. Le Comité d'action qui n'analyse toujours pas correctement le rapport de forces, pousse à agir contre le gouvernement : “ Grève générale ! Aux armes ! Il n'y a pas le choix ! Il faut combattre jusqu'au dernier. ” De nombreux ouvriers suivent l'appel, mais à nouveau, ils attendent des directives précises du Comité. En vain. En effet, rien n'est fait pour organiser les masses, pour provoquer la fraternisation entre les ouvriers révolutionnaires et les soldats... C'est ainsi que les troupes gouvernementales entrent dans Berlin et livrent pendant plusieurs jours de violents combats de rue contre les ouvriers armés. Nombre d'entre eux sont tués et blessés dans des affrontements qui ont lieu, de façon dispersée, dans différents quartiers de Berlin. Le 13 janvier la direction de l'USPD proclame la fin de la grève générale et le 15 janvier Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht sont assassinés par les sbires du régime dirigé par les Social-démocrates ! La campagne criminelle lancée par le SPD sur le thème “ Tuez Liebknecht ! ” se conclut sur un succès de la bourgeoisie. Le KPD est, à ce moment-là, privé de ses plus importants dirigeants.
Alors que le KPD fraîchement fondé a correctement analysé le rapport de forces et a mis en garde contre une insurrection prématurée, produit d'une provocation de l'ennemi, le Comité d'action dominé par les “ hommes de confiance révolutionnaires ” a une appréciation fausse de la situation. C'est falsifier l'histoire que de parler d'une prétendue “ semaine de Spartakus ”. Les Spartakistes se sont au contraire prononcé contre toute précipitation. La rupture de la discipline de parti par Liebknecht et Pieck en est la preuve à contrario. C'est l'attitude précipitée des “ hommes de confiance dés révolutionnaires ”, brûlant d'impatience et en définitive manquant de réflexion, qui est à l'origine de cette défaite sanglante. Le KPD, quant à lui, ne possède pas, à ce moment-là, la force de retenir le mouvement comme les Bolcheviks étaient parvenus à le faire en juillet 1917. Comme l'avouera le social-démocrate Ernst, nouveau Préfet de police qui a remplacé Eichorn démis de ses fonctions : “ Tout succès des gens de Spartakus était dés le départ exclu compte tenu que par nos préparatifs nous les avions contraints à frapper prématurément. Leurs cartes furent découvertes plus tôt qu'ils ne le souhaitaient et c'est pourquoi nous étions en mesure de les combattre. ”
La bourgeoisie, suite à ce succès militaire, comprend immédiatement qu'elle doit accentuer son avantage. Elle lance une vague de répression sanglante où des milliers d'ouvriers berlinois ainsi que de communistes sont assassinés, suppliciés et jetés en prisons. Le meurtre perpétré contre R. Luxemburg et K. Liebknecht n'est pas une exception mais révèle la détermination bestiale de la bourgeoisie à éliminer ses ennemis mortels, les révolutionnaires.
Le 19 janvier, la “ démocratie ” triomphe : les élections à l'Assemblée nationale ont lieu. Sous la pression des luttes ouvrières, le gouvernement a, entre temps, transféré son siège à Weimar. La république de Weimar s'instaure ainsi sur des milliers de cadavres ouvriers
L'insurrection est-elle l'affaire du parti ?
Sur cette question de l'insurrection le KPD s'appuie clairement sur les positions du marxisme et particulièrement sur ce qu'avait écrit Engels après l'expérience des luttes de 1848 :
“ L'insurrection est un art. C'est une équation aux données les plus incertaines, dont les valeurs peuvent changer à tout moment ; les forces de l'adversaire ont de leur côté tous les avantages de l'organisation, de la discipline et de l'autorité ; dés que l'on n'est plus en mesure de s'opposer à elles en position de forte supériorité, on est battu et anéanti. Deuxièmement, dés que l'on s'est engagé sur le chemin de l'insurrection, il faut agir avec la plus grande détermination et passer à l'offensive. La défensive est la mort de toute insurrection armée ; l'issue est perdue avant même de s'être mesuré à l'ennemi. Prends ton adversaire en défaut tant que ses forces sont dispersées ; fais en sorte d'obtenir quotidiennement de nouvelles victoires, si menues soient-elles ; conserve toi la suprématie morale que t'a créée la première victoire du soulèvement ; attire à toi les éléments hésitants qui suivent toujours l'élan le plus fort et se mettent toujours du côté le plus sûr ; contraint tes ennemis à la retraite avant même qu'ils ne soient en mesure de rassembler leurs forces contre toi... ” (Révolution et contre-révolution en Allemagne)
Les spartakistes utilisent la même démarche vis à vis de la question de l'insurrection que Lénine en avril 1917 :
“ Pour réussir, l'insurrection doit s'appuyer non pas sur un complot, non pas sur un parti, mais sur la classe d'avant-garde. Voilà le premier point. L'insurrection doit s'appuyer sur l'élan révolutionnaire du peuple. Voilà le second point. L'insurrection doit surgir à un tournant de l'histoire de la révolution ascendante où l'activité de l'avant-garde du peuple est la plus forte, où les hésitations sont fortes dans les rangs de l'ennemi et faibles dans ceux des amis de la révolution. Voilà le troisième point. Telles sont les trois conditions qui font que, dans la façon de poser la question de l'insurrection, le marxisme se distingue du blanquisme. ” (Lettre au comité central du POSDR, septembre 1917)
Qu'en est-il concrètement en janvier 1919 sur cette question fondamentale ?
L'insurrection s'appuie sur l'élan révolutionnaire de la classe
La position du KPD lors de son congrès de fondation est que la classe n'est pas encore mûre pour l'insurrection. En effet, après le mouvement dominé au départ par les soldats, une nouvelle impulsion provenant des usines, des assemblées et des manifestations est indispensable. C'est la condition pour que la classe acquière, dans son mouvement, plus de force et plus de confiance en elle-même. C'est la condition pour que l'insurrection ne soit pas l'affaire d'une minorité, l'affaire de quelques éléments désespérés et impatients, mais au contraire qu'elle puisse s'appuyer sur “ l'élan révolutionnaire ” de l'immense majorité des ouvriers.
De plus, en janvier, les conseils ouvriers n'exercent pas un réel double pouvoir dans la mesure où le SPD a réussi à les saboter de l'intérieur. Comme nous l'avons présenté dans le dernier numéro, le Congrès national des conseils à la mi-décembre a été une victoire pour la bourgeoisie et malheureusement aucune nouvelle stimulation des conseils ne s'est produite depuis. L'appréciation qu'a le KPD du mouvement de la classe et du rapport de forces est parfaitement lucide et réaliste.
Pour certains, c'est le parti qui prend le pouvoir. Alors, il faut expliquer comment une organisation révolutionnaire, aussi forte soit-elle, pourrait le faire alors que la grande majorité de la classe ouvrière n'a pas encore développé suffisamment sa conscience de classe, hésite et oscille, alors qu'elle n'a pas été capable de se doter de conseils ouvriers suffisamment puissants pour s'opposer au régime bourgeois. Développer une telle position c'est totalement méconnaître les caractéristiques fondamentales de la révolution prolétarienne et de l'insurrection que soulignait en premier Lénine : “ L'insurrection doit s'appuyer non pas sur un parti, mais sur la classe d'avant-garde. ” Même en octobre 1917 les Bolcheviks tenaient particulièrement à ce que ce ne soit pas le parti bolchevik qui prenne le pouvoir mais le Soviet de Pétrograd.
L'insurrection prolétarienne ne peut “ se décréter d'en haut ”. Elle est, au contraire, une action consciente des masses qui doivent auparavant développer leur propre initiative et la maîtrise de leurs luttes. C'est sur cette base que les directives et orientations données par les conseils et le parti seront suivies.
L'insurrection prolétarienne ne peut être un putsch, comme essaient de le faire croire les idéologues bourgeois. Elle est l'oeuvre de l'ensemble de la classe ouvrière. Pour secouer le joug du capitalisme, la seule volonté de quelques-uns, même s'il s'agit des éléments les plus clairs et déterminés de la classe, ne suffit pas. “ (...) le prolétariat insurgé ne peut compter que sur son nombre, sur sa cohésion, sur ses cadres, sur son état-major. ” (Trotsky, Histoire de la Révolution Russe, “ L'art de l'insurrection ”)
Ce degré de maturité n'avait pas été atteint, en janvier, dans la classe ouvrière en Allemagne.
Le rôle des communistes est central
Le KPD est conscient, à ce moment-là, que sa responsabilité essentielle est de pousser au renforcement de la classe ouvrière et en particulier au développement de sa conscience de la même manière que Lénine l'a fait auparavant en Russie dans ses “ Thèses d'Avril ” :
“ Travail de propagande 'et rien de plus', semblerait-il. C'est en réalité un travail révolutionnaire éminemment pratique ; car on ne saurait faire progresser une révolution qui s'est arrêtée, grisée de phrases, et qui 'marque le pas' non point à cause d'obstacles extérieurs, non point à cause de la violence qu'exercerait la bourgeoisie (...), mais à cause de l'aveugle crédulité des masses.
C'est uniquement en combattant cette aveugle crédulité (...) que nous pouvons nous dégager de l'emprise de la phraséologie révolutionnaire déchaînée et stimuler réellement aussi bien la conscience prolétarienne que la conscience des masses, leur initiative audacieuse et décidée (...). ” (Lénine, “ Les tâches du prolétariat dans notre révolution ”, point 7, avril 1917)
Lorsque le point d'ébullition est atteint, le parti doit justement “ au moment opportun surprendre l'insurrection qui monte ”, pour permettre à la classe de passer à l'insurrection au bon moment. Le prolétariat doit sentir “ au dessus de lui une direction perspicace, ferme et audacieuse ” sous la forme du parti. (Trotsky, Histoire de la Révolution Russe, “ L'art de l'insurrection ”)
Mais à la différence des Bolcheviks en juillet 1917, le KPD, en janvier 1919, ne possède pas encore suffisamment de poids pour être en mesure de peser de façon décisive sur le cours des luttes. Il ne suffit pas, en effet, que le parti ait une position juste, encore faut-il qu’il est une influence importante dans la classe. Et ce n'est pas le mouvement insurrectionnel prématuré à Berlin ni encore moins la défaite sanglante qui s'en est suivie qui vont permettre à celle-ci de se développer. La bourgeoisie, au contraire, réussit à affaiblir de façon dramatique l'avant-garde révolutionnaire en éliminant ses meilleurs militants mais également en faisant interdire son principal outil d'intervention dans la classe, Die Rote Fahne. Dans une situation où l'intervention la plus large du parti est absolument indispensable, le KPD se retrouve, pendant des semaines entières, sans pouvoir disposer de son organe de presse.
Le drame des luttes dispersées
Au cours de ses semaines, au niveau international, la classe ouvrière dans plusieurs pays affronte le capital. Alors qu'en Russie l'offensive des troupes blanches contre-révolutionnaires se renforce contre le pouvoir ouvrier, la fin de la guerre entraîne une certaine accalmie sur le front social dans les “ pays vainqueurs ”. En Angleterre et en France il y a une série de grèves, mais les luttes ne prennent pas la même orientation radicale qu'en Russie et en Allemagne. Les luttes en Allemagne et en Europe centrale restent ainsi relativement isolées de celles des autres centres industriels européens. En mars les ouvriers de Hongrie établissent une république des conseils qui est rapidement écrasée dans le sang par les troupes contre-révolutionnaires, grâce, ici encore à l’habile travail de la Social-démocratie locale.
A Berlin, après avoir défait l'insurrection ouvrière, la bourgeoisie poursuit une politique en vue de dissoudre les conseils de soldats et de créer une armée destinée à la guerre civile. Par ailleurs, elle s'attaque au désarmement systématique du prolétariat. Mais la combativité ouvrière continue de s'exprimer un peu partout dans le pays. Le centre de gravité du combat, au cours des mois qui suivent, va se déplacer à travers l'Allemagne. Dans presque toutes les grandes villes vont se produire des affrontements extrêmement violents entre la bourgeoisie et le prolétariat mais malheureusement isolés les uns des autres.
Brême en janvier...
Le 10 janvier, par solidarité avec les ouvriers berlinois, le conseil d’ouvriers et de soldats de Brême proclame l'instauration de la République des conseils. Il décide l'éviction des membres du SPD de son sein, l'armement des ouvriers et le désarmement des éléments contre-révolutionnaires. Il nomme un gouvernement des conseils responsable devant lui. Le 4 février le gouvernement du Reich rassemble des troupes autour de Brême et passe à l'offensive contre la ville insurgée, restée isolée. Le jour même, Brême tombe aux mains des chiens sanglants.
La Ruhr en février...
Dans la Ruhr, la plus grande concentration ouvrière, la combativité n'a cessé de s'exprimer depuis la fin de la guerre. Déjà avant la guerre, il y avait eu, en 1912, une longue vague de grèves. En juillet 1916, en janvier 1917, en janvier 1918, en août 1918 les ouvriers réagissent contre la guerre par d'importants mouvements de luttes. En novembre 1918, les conseils d'ouvriers et de soldats se trouvent pour la plupart sous l'influence du SPD. A partir de janvier et février 1919, de nombreuses grèves sauvages éclatent. Les mineurs en lutte se rendent dans les puits voisins pour élargir et unifier le mouvement. Souvent des oppositions violentes se produisent entre les ouvriers en lutte et les conseils encore dominés, par des membres du SPD. Le KPD intervient :
“ La prise du pouvoir par le prolétariat et l'accomplissement du socialisme ont pour présupposé que la grande majorité du prolétariat s'élève à la volonté d'exercer la dictature. Nous ne pensons pas que ce moment soit déjà arrivé. Nous pensons que le développement des prochaines semaines et des prochains mois fera mûrir dans l’ensemble du prolétariat la conviction que c'est seulement dans sa dictature que réside son salut. Le gouvernement Ebert-Scheidemann épie la moindre occasion pour étouffer dans le sang ce développement. Comme à Berlin, comme à Brême il va tenter d'étouffer isolément les foyers de la révolution, pour ainsi éviter la révolution générale. Le prolétariat a le devoir de faire échouer ces provocations en évitant de s'offrir de plein gré en sacrifice aux bourreaux dans des soulèvements armés. Il s'agit bien plus, jusqu'au moment de la prise du pouvoir, d'élever à son plus haut point l'énergie révolutionnaire des masses grâce aux manifestations, aux rassemblements, à la propagande, à l'agitation et à l'organisation, de gagner les masses dans une proportion de plus en plus importante et de préparer les esprits pour l'heure venue. Surtout il faut partout pousser à la réélection des conseils ouvriers sous le mot d'ordre :
Les Ebert-Scheidemann hors des conseils !
Dehors les bourreaux ! ”
(Appel de la Centrale du KPD du 3 février pour la réélection des conseils ouvriers)
Le 6 février, 109 délégués des conseils siègent et réclament la socialisation des moyens de production. Derrière cette revendication, il y a la reconnaissance croissante par les ouvriers que le contrôle des moyens de production ne doit pas rester aux mains du capital. Mais, tant que le prolétariat ne détient pas le pouvoir politique, tant qu'il n'a pas renversé le gouvernement bourgeois, cette revendication peut se retourner contre lui. Toutes les mesures de socialisation sans disposer du pouvoir politique ne sont pas seulement de la poudre aux yeux mais aussi un moyen que peut utiliser la classe dominante pour étrangler la lutte. C'est ainsi que le SPD promet une loi de socialisation qui prévoit une “ participation ” et un pseudo-contrôle de la classe ouvrière sur l'Etat. “ Les conseils ouvriers sont constitutionnellement reconnus comme représentation d'intérêts et de participation économique et sont ancrés dans la Constitution. Leur élection et leurs prérogatives seront réglementées par une loi spéciale qui prendra effet immédiatement. ”
Il est prévu que les conseils soient transformés en “ comités d'entreprise ” (Betribräte) et qu'ils aient pour fonction de participer au processus économique par la cogestion. Le but premier de cette proposition est de dénaturer les conseils et de les intégrer dans l'Etat. Ils ne sont plus ainsi des organes de double pouvoir contre l'Etat bourgeois mais au contraire servent à la régulation de la production capitaliste. De plus, cette mystification entretient l'illusion d'une transformation immédiate de l'économie dans “ sa propre usine ” et les ouvriers sont ainsi facilement enfermés dans une lutte locale et spécifique au lieu de s'engager dans un mouvement d'extension et d'unification du combat. Cette tactique, utilisée pour la première fois par la bourgeoisie en Allemagne, s'illustre à travers quelques occupations d'usines. Dans les luttes en Italie de 1919-1920 elle sera appliquée par la classe dominante avec grand succès.
A partir du 10 février, les troupes responsables des bains de sang de Brême et de Berlin marchent sur la Ruhr. Les conseils d'ouvriers et de soldats de l'ensemble du bassin décident la grève générale et appellent à la lutte armée contre les corps-francs. De partout s'élève l'appel “ Sortez des usines ! ” Un nombre très important d'affrontements armés a lieu et toujours sur le même schéma. La rage des ouvriers est telle que les locaux du SPD sont souvent attaqués, comme le 22 février à Mülheim-Ruhr où une réunion social-démocrate est mitraillée. A Gelsenkirchen, Dortmund, Bochum, Duisburg, Oberhausen, Wuppertal, Mülheim-Ruhr et Düsseldorf des milliers d'ouvriers sont en armes. Mais là aussi, comme à Berlin, l'organisation du mouvement fait cruellement défaut, il n'y a pas de direction unie pour orienter la force de la classe ouvrière, alors que l'Etat capitaliste, avec le SPD à sa tête, agit de façon organisée et centralisée.
Jusqu'au 20 février, 150 000 ouvriers sont en grève. Le 25 février, la reprise du travail est décidée et la lutte armée est suspendue. La bourgeoisie peut à nouveau déchaîner sa répression et les corps-francs investissent la Ruhr ville par ville. Cependant, début avril, une nouvelle vague de grèves reprend : le 1er, il y a 150 000 grévistes ; le 10, 300 000 et à la fin du mois leur nombre retombe à 130 000. A la mi-avril, à nouveau, la répression et la chasse aux communistes se déchaînent. Le rétablissement de l'ordre dans la Ruhr devient une priorité pour la bourgeoisie car simultanément à Brunswick, Berlin, Francfort, Dantzig et en Allemagne centrale d'importantes masses entrent en grève.
l'Allemagne centrale en février et en mars...
A la fin février, au moment où le mouvement se termine dans la Ruhr écrasé par l’armée, le prolétariat d'Allemagne centrale entre en scène. Alors que le mouvement dans la Ruhr s'est cantonné aux secteurs du charbon et de l'acier, ici il concerne tous les ouvriers de l'industrie et des transports. Dans presque toutes les villes et les grosses usines les ouvriers se joignent au mouvement.
Le 24 février la grève générale est proclamée. Les conseils d'ouvriers et de soldats lancent immédiatement un appel à ceux de Berlin pour unifier le mouvement. Une fois encore, le KPD met en garde contre toute action précipitée : “ Tant que la révolution n'a pas ses organes d'action centraux, nous devons opposer l'action d'organisation des conseils qui se développe localement en mille endroits. ” (Tract de la Centrale du KPD). Il s'agit de renforcer la pression à partir des usines, d'intensifier les luttes économiques et de renouveler les conseils ! Aucun mot d'ordre appelant au renversement du gouvernement n'est formulé.
Grâce à un accord sur la socialisation, la bourgeoisie parvient, ici aussi, à briser le mouvement. Les 6 et 7 mars le travail reprend. Et à nouveau la même action commune entre l'armée et le SPD se met en place : “ Pour toutes les opérations militaires (...) il est opportun de prendre contact avec les membres dirigeants du SPD fidèles au gouvernement. ” (Märcker, dirigeant militaire de la répression en Allemagne centrale). La vague de grève ayant débordé sur la Saxe, la Thüringe et l'Anhalt, les sbires de la bourgeoisie exercent leur répression jusqu'en mai.
Berlin, à nouveau, en mars...
Le mouvement dans la Ruhr et en Allemagne centrale touchant à sa fin, le prolétariat de Berlin entre à nouveau en lutte le 3 mars. Ses principales orientations sont : le renforcement des conseils d’ouvriers et de soldats, la libération de tous les prisonniers politiques, la formation d'une garde ouvrière révolutionnaire et l'établissement de contacts avec la Russie. La dégradation rapide de la situation de la population après la guerre, l'explosion des prix, le développement du chômage massif suite à la démobilisation, poussent les ouvriers à développer des luttes revendicatives. A Berlin, les communistes réclament de nouvelles élections aux conseils ouvriers pour accentuer la pression sur le gouvernement. La direction du KPD de la circonscription du Grand-Berlin écrit : “ Croyez vous atteindre vos objectifs révolutionnaires grâce au bulletin de vote ? (...) Si vous voulez faire progresser la révolution, alors engagez toutes vos forces dans le travail au sein des conseils d’ouvriers et de soldats. Faites en sorte qu'ils deviennent de véritables instruments de la révolution. Procédez à de nouvelles élections aux conseils d’ouvriers et de soldats. ”
Le SPD, de son côté, se prononce contre un tel mot d'ordre. Encore une fois, il se livre au sabotage du mouvement au niveau politique mais aussi, comme nous le verrons, au niveau répressif. Lorsque les ouvriers berlinois entrent en grève début mars, le conseil exécutif composé de délégués du SPD et de l'USPD prend la direction de la grève. Le KPD, lui, refuse d'y siéger : “ Accepter les représentants de cette politique dans le comité de grève signifie la trahison de la grève générale et de la révolution. ”
Comme le font aujourd'hui les socialistes, staliniens et autres représentants de la gauche du capital, le SPD a réussi à investir le comité de grève grâce à la crédulité d'une partie des ouvriers mais surtout grâce à toutes sortes de manoeuvres, magouilles et duperies. C'est pour ne pas avoir les mains liées que les spartakistes refusent, à ce moment-là, de siéger aux côtés de ces bourreaux de la classe ouvrière.
Le gouvernement fait interdire Die Rote Fahne alors que le SPD arrive à faire imprimer son journal. Les contre-révolutionnaires peuvent ainsi développer leur propagande répugnante tandis que les révolutionnaires sont condamnés au silence. Avant d'être interdit, Die Rote Fahne met en garde les ouvriers :
“ Cessez le travail ! Restez pour l'instant dans les usines. Rassemblez vous dans les usines. Convainquez les hésitants et ceux qui traînent. Ne vous laissez pas entraîner dans d'inutiles fusillades que guette Noske pour faire à nouveau couler le sang ”.
Rapidement, en effet, la bourgeoisie suscite des pillages, grâce à ses agents provocateurs, qui servent de justification officielle à l'engagement de l'armée. Les soldats de Noske détruisent en tout premier lieu les locaux de la rédaction de Die Rote Fahne. Les principaux membres du KPD sont à nouveau jetés en prison. Léo Jogisches est fusillé. C'est justement parce que Die Rote Fahne a mis en garde la classe ouvrière contre les provocations de la bourgeoisie, qu'il est la cible immédiate des troupes contre-révolutionnaires.
La répression à Berlin commence le 4 mars. Environ 1 200 ouvriers sont passés par les armes. Pendant des semaines la Sprée rejette des cadavres sur ses rives. Quiconque se trouve en possession d'un portrait de Karl et de Rosa est arrêté. Nous le répétons : ce ne sont pas les fascistes qui sont responsables de cette répression sanglante mais le SPD !
Alors que le 6 mars la grève générale est brisée en Allemagne centrale, celle de Berlin prend fin le 8.
En Saxe, en Bade et en Bavière aussi il y a, durant ces mêmes semaines, des luttes importantes mais jamais le lien ne réussit à se faire entre ces différents mouvements.
La république des conseils de Bavière en avril 1919
En Bavière aussi la classe ouvrière est en lutte. Le 7 avril le SPD et l'USPD, cherchant “ à regagner la faveur des masses par une action pseudo-révolutionnaire ” (Léviné), proclament la République des conseils. Comme en janvier à Berlin, le KPD constate que le rapport de forces n'est pas favorable aux ouvriers et prend position contre l'instauration de cette République. Pourtant les communistes de Bavière appellent les ouvriers à élire un “ conseil véritablement révolutionnaire ” en vue de la mise en place d'une véritable République des conseils communiste. E. Léviné se retrouve, le 13 avril, à la tête d'un nouveau gouvernement qui prend, sur les plans économique, politique et militaire, des mesures énergiques contre la bourgeoisie. Malgré cela, cette initiative est une lourde erreur des révolutionnaires de Bavière qui agissent à l'encontre des analyses et orientations du Parti.
Maintenu dans un total isolement par rapport au reste de l'Allemagne, le mouvement voit se développer une contre-offensive d'ampleur de la part de la bourgeoisie. Munich est affamée et 100 000 soldats s'amassent dans ses alentours. Le 27 avril le Conseil exécutif de Munich est renversé. De nouveau le bras de la répression sanglante s'abat et frappe : des milliers d'ouvriers sont fusillés ou tués dans les combats ; les communistes sont pourchassés et Léviné est condamné à mort.
oOo
Les générations actuelles du prolétariat ont du mal à imaginer ce que peut représenter la puissance d'une vague de luttes quasi-simultanées dans les grandes concentrations du capitalisme et la pression gigantesque que cela exerce sur la classe dominante.
A travers son mouvement révolutionnaire en Allemagne, la classe ouvrière a prouvé qu'elle est en mesure, face à une bourgeoisie parmi les plus expérimentées, d'établir un rapport de force qui aurait pu conduire au renversement du capitalisme. Cette expérience montre que le mouvement révolutionnaire du début du siècle n'était pas réservé au prolétariat de “ pays arriérés ” comme la Russie mais qu'il a impliqué massivement les ouvriers du pays le plus développé industriellement d'alors.
Mais la vague révolutionnaire, de janvier à avril 1919, s'est développée dans la dispersion. Ces forces, concentrées et unies, auraient suffi au renversement du pouvoir bourgeois. Elles se sont au contraire éparpillées et le gouvernement est ainsi parvenu à les affronter et à les anéantir paquet par paquet. L'action de celui-ci, dès janvier à Berlin, avait décapité et brisé les reins de la révolution.
Richard Müller, l'un des dirigeants des “ hommes de confiance révolutionnaires ”, qui se sont caractérisés pendant longtemps par leurs grande hésitation, ne peut s'empêcher de constater : “ Si la répression des luttes de janvier à Berlin ne s'était pas produite, alors le mouvement aurait pu obtenir plus d'élan ailleurs au printemps et la question du pouvoir se serait posée plus précisément dans toute sa portée. Mais la provocation militaire avait en quelque sorte coupé l'herbe sous le pied du mouvement. L'action de janvier avait fourni des arguments pour les campagnes de calomnies, le harcèlement et la création d'une atmosphère de guerre civile. ”
Sans cette défaite, le prolétariat de Berlin aurait pu opportunément soutenir les luttes qui se sont développées dans les autres régions d'Allemagne. Par contre, cet affaiblissement du bataillon central de la révolution a permis aux forces du capital de passer à l'offensive et d'entraîner partout les ouvriers dans des affrontements militaires prématurés et dispersés. La classe ouvrière, en effet, n'est pas parvenue à mettre sur pied un mouvement large, uni et centralisé. Elle n'a pas été capable d'imposer un double pouvoir dans tout le pays à travers le renforcement des conseils et de leur centralisation.
Seul l'établissement d'un tel rapport de force peut permettre de se lancer dans une action insurrectionnelle, celle-ci exigeant la plus grande conviction et coordination dans l’action. Et cette dynamique ne peut se développer sans l'intervention claire et déterminée d’un parti politique au sein du mouvement. C'est ainsi que le prolétariat peut se sortir victorieusement de son combat historique.
La défaite de la révolution en Allemagne durant les premiers mois de l'année 1919 n'est pas seulement le fait de l'habileté de la bourgeoisie autochtone. Elle est aussi le résultat de l'action concertée de la classe capitaliste internationale. Cette dernière qui, pendant 4 années, s'est entre-déchirée avec la plus extrême violence, a dépassé ses profondes divisions et retrouvé une unité pour faire face au prolétariat révolutionnaire. Lénine le met clairement en évidence quand il affirme que tout a été
Alors que la classe ouvrière en Allemagne offre des luttes dispersées, les ouvriers en Hongrie en mars se dressent contre le capital dans des affrontements révolutionnaires. Le 21 mars 1919 la République des conseils est proclamée en Hongrie mais elle est cependant écrasée dans l'été par les troupes contre-révolutionnaires.
La classe capitaliste internationale se tenait unie derrière la bourgeoisie en Allemagne. Alors que pendant quatre années auparavant elle s'était entre-déchirée le plus violemment, elle s'affrontait unie à la classe ouvrière. Lénine pensait que tout avait été “ fait pour s'entendre avec les conciliateurs allemands afin d'étouffer la révolution allemande. ” (Rapport du Comité central pour le 9e Congrès du PCR). C'est une leçon que la classe ouvrière doit retenir : chaque fois qu'elle met en danger le capitalisme, elle trouve face à elle non pas une classe dominante divisée mais des forces du capital unies internationalement.
Cependant si le prolétariat en Allemagne avait pris le pouvoir, le front capitaliste aurait été enfoncé et la révolution russe ne serait pas restée isolée.
Lorsque la 3e Internationale est fondée à Moscou en mars 1919, pendant que se développent encore les luttes en Allemagne, cette perspective semble à portée de main à l'ensemble des communistes. Mais la défaite ouvrière en Allemagne va entamer le déclin de la vague révolutionnaire internationale et notamment celui de la révolution russe. C'est l'action de la bourgeoisie, avec le SPD comme tête de pont qui va permettre l'isolement puis la dégénérescence de la révolution bolchevik et accoucher ultérieurement du stalinisme.
***
Dans le prochain article on abordera l'intervention des révolutionnaires dans les luttes depuis 1914 et on examinera à nouveau la question si l'échec de la révolution doit exclusivement être mis au compte de la faiblesse ou de l'absence d'un parti.
DV.
[6] [2167]. Les “ hommes de confiance révolutionnaires ”, Revolutionnäre Obleute (RO), sont constitués, à l’origine, essentiellement de délégués syndicaux élus dans les usines, mais qui ont rompu avec les directions social-chauvines des centrales syndicales. Ils sont le produit direct de la résistance de la classe ouvrière contre la guerre et contre la trahison des partis ouvriers et des syndicats. Malheureusement, la révolte contre la direction syndicale, les conduit souvent à être rétifs à l’idée de centralisation et à développer un point de vue trop localiste, voire usiniste. Ils seront toujours mal à l’aise dans les questions politiques générales et souvent une proie facile pour la politique de l’USPD.
Géographique:
- Allemagne [98]
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Allemande [1955]
Conscience et organisation:
Approfondir:
- Révolution Allemande [1957]
Heritage de la Gauche Communiste:
- La Révolution prolétarienne [1149]
Réponse au BIPR [2° partie] : Les théories sur la crise historique du capitalisme
- 4694 reads
Dans l’Internationalist Communist Review n° 13, le BIPR répond à notre article de polémique "La conception du BIPR sur la décadence du capitalisme" paru dans le n° 79 de la Revue Internationale. Dans la Revue Internationale n° 82 nous avons publié la 1re partie de cet article, montrant les implications négatives qu'a la conception du BIPR sur le. guerre impérialiste comme moyen de dévalorisation du capital et de renaissance des cycles d'accumulation. Dans cette 2e partie, nous allons analyser la théorie économique qui sous-tend cette conception : la théorie de la baisse tendancielle du taux de profit.
L'explication de la crise historique du capitalisme dans le mouvement marxiste,
Les économistes bourgeois, depuis les classiques (Smith, Ricardo, etc.), s'appuient sur deux dogmes intangibles :
1. L'ouvrier est un citoyen libre qui vend sa force de travail en échange d'un salaire. Le salaire est sa participation à la rente sociale, au même titre que le bénéfice qui rémunère l'entrepreneur.
2. Le capitalisme est un système éternel. Ses crises sont temporaires ou conjoncturelles, et proviennent des disproportions entre les différentes branches de production, des déséquilibres dans la distribution ou d'une mauvaise gestion. Cependant, à la longue, le capitalisme n'a pas de problème de réalisation des marchandises : la production trouve toujours son marché, atteignant l'équilibre entre l'offre (la production) et la demande (la consommation).
Marx a combattu à mort ces dogmes de l'économie bourgeoise. 11 a démontré que le capitalisme n'est pas un système éternel : "Dans le cours de leur développement, les forces productives de la société entrent en contradiction avec les rapports de production existants ou, ce qui n'en est que l'expression juridique, avec les rapports de propriété dans lesquels elles se sont mues jusqu'alors. De forme de développement des forces productives qu'ils étaient, ces rapports se transforment en frein de ces forces. Alors s'ouvre une période de révolution sociale. " (Préface à la Contribution à la critique de l'économie politique). Cette période de crise historique, de décadence irréversible du capitalisme, s'est ouverte avec la première guerre mondiale. Depuis lors, une fois vaincue la tentative révolutionnaire mondiale du prolétariat de 1917-23, la survie du capitalisme coûte à l'humanité des océans de sang (100 millions de morts dans des guerres impérialistes entre 1914 et 1968), de sueur (accroissement brutal de l'exploitation de la classe ouvrière) et de larmes (la terreur du chômage, les barbaries de toutes sortes, la déshumanisation des rapports sociaux).
Cependant cette analyse fondamentale, patrimoine commun de la Gauche communiste, n'est pas expliquée de la même manière au sein du milieu politique révolutionnaire actuel. Il existe deux théories pour expliquer la décadence du capitalisme, la théorie de la baisse tendancielle du taux de profit et celle que l'on appelle la "théorie des marchés", basée essentiellement sur la contribution de Rosa Luxemburg.
Le BIPR adhère à la première théorie, tandis que nous nous revendiquons de la seconde ([1] [2168]). Pour que la polémique entre les deux théories soit fructueuse, il est nécessaire de la baser sur une compréhension de l'évolution du débat au sein du mouvement marxiste.
Marx vivait à l'époque de l'apogée du capitalisme. Bien qu'à cette époque la crise historique du système ne se posait pas de manière aussi dramatique qu'aujourd'hui, il fut capable de voir dans les crises cycliques de croissance qui secouaient périodiquement le capitalisme une manifestation de ses contradictions et l'annonce des convulsions qui le conduiraient à la ruine.
"(...) Marx a mis en évidence deux contradictions fondamentales qui se trouvaient à la base des crises de croissance que le capitalisme a traversées au 19e siècle, et qui allaient, à un moment donné, pousser le capitalisme dans une phase de déclin historique, le plonger dans une crise mortelle qui mettrait la révolution communiste à l'ordre du jour. Ces deux contradictions sont : 1) la tendance du taux de profit à baisser, avec l'inévitabilité de l'élévation constante de la composition organique du capital, et 2) le problème de la surproduction, une maladie innée du système capitaliste qui produit plus que le marché ne peut absorber. " ([2] [2169])
Comme nous verrons plus loin, "Bien que Marx ait élaboré un cadre dans lequel ces deux phénomènes sont intimement liés, il n'a jamais terminé son examen du système capitaliste de sorte que, selon ses différents écrits, il donne plus ou moins d'importance à l'un ou l'autre phénomène comme cause fondamentale de la crise (...) C'est le caractère inachevé de la pensée de Marx sur ce sujet crucial - qui n'est pas déterminé par l'incapacité personnelle de Marx à achever Le Capital mais, comme nous l'avons dit, par les limites de la période historique dans laquelle il écrivait - qui a amené la controverse au sein du mouvement ouvrier sur les fondements économiques du déclin du capitalisme. " ([3] [2170])
A la fin du siècle dernier, les conditions du capitalisme commencèrent à changer : l'impérialisme comme politique de rapine et d'affrontement entre puissances se développait à pas de géant et, d'autre part, le capitalisme montrait des signes croissants de maladie (inflation, développement du militarisme dans les pays "arrivés trop tard" tels l'Allemagne ou la Russie) qui venaient contrecarrer fortement une croissance et une prospérité ininterrompues depuis la décennie 1870. Dans ce contexte apparût, au sein de la 2e Internationale, un courant opportuniste qui mettait en question la thèse marxiste de l'effondrement du capitalisme et misait sur une transition graduelle vers le socialisme à travers des réformes successives d'un capitalisme dont "les contradictions s'amenuisaient". Les théoriciens de ce courant concentraient leur artillerie, précisément contre la deuxième des contradictions relevées par Marx : la tendance à la surproduction. Ainsi Bernstein disait : "Marx se contredit en reconnaissant que la cause ultime des crises est la limitation de la consommation des masses. En réalité, la théorie de Marx sur la crise ne diffère pas beaucoup du sous-consumérisme de Rodbertus. " ([4] [2171])
En 1902, Tugan-Baranovski, un révisionniste russe, attaqua la théorie de Marx sur la crise du capitalisme, niant que celui-ci puisse rencontrer un problème de marché et affirmant que les crises se produisent en conséquence "disproportion" entre les différents secteurs.
Tugan-Baranovski alla même plus loin que ses collègues révisionnistes allemands (Bernstein, Schmidt, Vollmar, etc.).Il revint aux dogmes de l'économie bourgeoise, reprit concrètement l'idée de Say (amplement critiquée par Marx), basée sur la thèse selon laquelle "le capitalisme n'a aucun problème de réalisation si ce n'est quelques troubles conjoncturels " ([5] [2172]). Il y eut une réponse très ferme de la 2e Internationale par Kautsky, qui alors se situait encore dans les rangs révolutionnaires : "Les capitalistes et les ouvriers qu'ils exploitent constituent un marché pour les moyens de consommation produits par l'industrie, marché qui s'agrandit avec l'accroissement de la richesse des premiers et le nombre des seconds, mais moins vite cependant que l'accumulation du capital et que la productivité du travail, et qui ne suffit pas à lui seul pour absorber les moyens de consommation produits par la grande industrie capitaliste. L'industrie doit chercher des débouchés supplémentaires à l'extérieur de sa sphère dans les professions et les nations qui ne produisent pas encore selon le mode capitaliste. (...) Ces débouchés supplémentaires ne possèdent pas, et de loin, l'élasticité et la capacité d'extension de la production capitaliste... Telle est, en quelques mots, la théorie des crises adoptée généralement, pour autant que nous le sachions, par les "marxistes orthodoxes" et fondée par Marx. " ([6] [2173])
Cependant, la polémique s'est radicalisée quand Rosa Luxemburg a publié L'accumulation du capital. Dans ce livre, Rosa Luxemburg essaie d'expliquer le développement vertigineux de l'impérialisme et la crise toujours plus profonde du capitalisme. Elle démontre que le capitalisme s'est développé historiquement en étendant, à des régions ou secteurs pré-capitalistes, ses rapports de production basés sur le travail salarié et qu'il atteint ses limites historiques quand ces rapports embrassent toute la planète. Dès lors, il n'existe plus de territoires nouveaux correspondant aux nécessités d'expansion qu'imposé la croissance de la productivité du travail et de la composition organique du capital : "Ainsi le capitalisme ne cesse de croître grâce à ses relations avec les couches sociales et les pays non capitalistes, poursuivant l'accumulation à leurs dépens mais en même temps les décomposant et les refoulant pour s'implanter à leur place. Mais à mesure qu'augmenté le nombre des pays capitalistes participant à la chasse aux territoires d'accumulation et à mesure que se rétrécissent les territoires encore disponibles pour l'expansion capitaliste la lutte du capital pour ses territoires d'accumulation devient de plus en plus acharnée et ses campagnes engendrent à travers le monde une série de catastrophes économiques et politiques : crises mondiales, guerres, révolutions. " ([7] [2174])
Les critiques de Rosa Luxemburg nient que le capitalisme ait un problème de réalisation, c'est-à-dire oublient cette contradiction du système que Marx a affirmé avec acharnement contre les économistes bourgeois, et qui constitue la base de "¡a théorie de la crise fondée par Marx", comme l'a rappelé, quelques années auparavant, Kautsky contre le révisionniste Tugan-Baranovski.
Les contradicteurs de Rosa Luxemburg s'érigent en défenseurs "orthodoxes et inconditionnels " de Marx et, plus particulièrement, de ses schémas de la reproduction élargie présentés dans le tome II du Capital. C'est-à-dire qu'ils affaiblissent la pensée de Marx en interprétant faussement un aspect du Capital en l'isolant du reste de l'analyse globale ([8] [2175]). Leurs arguments sont très variés. Eckstein disait qu'il n'y a pas de problème de réalisation parce que les tableaux de la reproduction élargie de Marx expliquent "parfaitement" qu'il n'y a aucune partie de la production qui ne soit pas vendue. Hilferding ressuscite la théorie de la "proportionnalité entre les secteurs " disant que les crises sont dues à l'anarchie de la production et que la tendance du capitalisme à la concentration réduit cette anarchie et, partant, les crises. Finalement, Bauer dit que Rosa Luxemburg avait signalé un problème réel mais que celui-ci avait une solution dans le capitalisme : l'accumulation suit la croissance de la population.
A cette époque, seul un rédacteur d'un périodique socialiste local opposa à Rosa Luxemburg la théorie de la baisse tendancielle du taux de profit. A ses objections celle-ci répondit ainsi.: "Ou alors, il reste la consolation vague du petit "expert" de la Dresdener Volkszeitung, qui, après avoir exécuté mon livre, déclare que le capitalisme finira par s'effondrer "à cause de la baisse du taux de profit". Comment le brave homme imagine-t-il les choses ? Arrivé à un certain point, la classe capitaliste, désespérée de l'insignifiance du taux de profit se pendra-t-elle collectivement, ou bien déclarera-t-elle que, puisque les affaires vont si mal, il ne vaut pas la peine de s'embarrasser de soucis et de tourments, passera-t-elle la main au prolétariat ? En tout cas cette consolation est réduite à néant par une seule phrase de Marx : "Pour les grands capitalistes, la baisse du taux de profit est compensée par sa masse." // coulera encore de l'eau sous les ponts avant que la baisse du taux de profit ne provoque l'effondrement du capitalisme. " ([9] [2176])
Lénine et les bolcheviks ne participaient pas à cette polémique ([10] [2177]). Il est certain que Lénine avait combattu la théorie des populistes sur les marchés, une théorie sous-consumériste dans la lignée des erreurs de Sismondi. Pourtant, jamais Lénine n'a nié le problème des marchés : dans son analyse du problème de l'impérialisme, bien qu'il s'appuie principalement sur la théorie de Hilferding sur la concentration du capital financier ([11] [2178]), il ne manque pas de reconnaître que celle-ci surgit sous la pression de la saturation générale du marché mondial. Ainsi, dans L'impérialisme stade suprême du capitalisme, il répond à Kautsky en soulignant que "la caractéristique de l'impérialisme est précisément la tendance à l'annexion non seulement des région agraires, mais aussi des plus industrielles, car, la division du monde une fois terminée, oblige à procédera un nouveau partage, à étendre la main sur tout type de territoire. "
Dans la 3e Internationale dégénérescente Boukharine, dans le livre L'impérialisme et l'accumulation du capital, attaque la thèse de Rosa Luxemburg dans le contexte du développement d'une théorie qui ouvrira les portes au triomphe du stalinisme : la théorie de la "stabilisation" du capitalisme (qui présupposait la thèse révisionniste selon laquelle il était capable de dépasser les crises) et de la "nécessité" pour l'URSS de "coexister" pour un temps prolongé avec le système capitaliste. La critique fondamentale de Boukharine à Rosa Luxemburg est que celle-ci se serait limitée à privilégier la contradiction concernant le marché, oubliant toutes les autres, dont celle de la théorie de la baisse tendancielle du taux de profit. ([12] [2179])
A la fin des années 1920 et au début des années 1930 "Paul Mattick, qui appartenait au mouvement des Communistes de Conseils, reprenait la critique d’Henrik Grossman à Rosa Luxemburg et l'idée que la crise permanente du capitalisme a lieu lorsque la composition organique du capital atteint une telle ampleur qu'il y a de moins en moins de plus-value pour relancer l'accumulation. Cette idée de base - tout en étant davantage élaborée sur de nombreux points - est aujourd'hui défendue par de nombreux groupes révolutionnaires comme la CWO. Battaglia Comunista et certains des groupes qui surgissent en Scandinavie. " ([13] [2180])
La théorie marxiste de la crise ne se base pas uniquement sur la baisse tendancielle du taux de profit.
II doit être clair que la contradiction dont souffre le capitalisme dans la réalisation de la plus-value joue un rôle fondamental dans la théorie marxiste de la crise, et que les tendances révisionnistes attaquent cette thèse avec une rage particulière. Le BIPR prétend le contraire. Ainsi, dans sa Réponse, il nous dit : "Pour Marx, la source de toute crise authentique se trouve au sein même du système capitaliste, dans les rapports entre capitalistes et ouvriers. Il l'a présentée quelques fois comme une crise née de la capacité limitée des ouvriers à consommer le produit de leur propre travail (...) Il continuait en ajoutant que cela n'est pas dû à la surproduction "en soi" (...) Et Marx continue en expliquant que celles-ci sont causées par la chute du taux de profit (...) La crise dévalorise le capital et permet un nouveau cycle d'accumulation. " ([14] [2181]). L'assurance du BIPR est telle qu'il se permet d'ajouter que "les "cycles schématiques de l'accumulation" dont nous sommes heureux d'être prisonniers, se produisent exactement comme Marx les avait prévus. " ([15] [2182])
C'est une déformation de la pensée de Marx de dire qu'il expliquait la crise historique du capital uniquement par la théorie de la baisse tendancielle du taux de profit. Pour trois raisons fondamentales :
1) Marx mettait l'accent sur les deux contradictions (baisse du taux de profit et surproduction) :
- Il a établi que le processus de production capitaliste comporte deux parties, la production proprement dite et sa réalisation. Dit simplement, le profit inhérent à l'exploitation n'est rien pour le capitaliste individuel ni non plus pour le capitalisme dans sa globalité si les marchandises produites ne sont pas vendues : "La masse totale des marchandises, le produit total, la partie qui représente le capital constant et le capital variable comme celle qui représente la plus-value, doivent être vendues. Si cette vente n'est pas effective ou si elle ne se réalise que de façon partielle ou se fait à des prix inférieurs aux prix de production, l'ouvrier, bien entendu, est exploité, mais le capitaliste ne réalise pas cette exploitation comme telle. " ([16] [2183])
- Il a souligné l'importance vitale du marché dans le développement du capitalisme : "// est nécessaire que le marché augmente sans cesse, de façon que ses connexions internes et les conditions qui le régulent acquièrent toujours plus la forme de lois naturelles (...) Cette contradiction interne trouve sa solution dans l'extension du champs extérieur de la production" ([17] [2184]). Mais plus loin, il s'interroge : "Comment serait-il possible que la demande de ces marchandises, de celles dont manque la grande masse de la population, soit insuffisante et qu'il faille chercher cette demande à l'étranger, dans des marchés éloignés, pour pouvoir payer aux ouvriers du pays la quantité moyenne de subsistances indispensables ? Parce que le système spécifiquement capitaliste, avec ses interdépendances internes, est le seul où le produit excédentaire acquiert une forme telle que son possesseur ne peut se permettre de le consommer tant qu'il n'est pas transformé en capital. " ([18] [2185])
- Il a condamné sans rémission la thèse de Say selon laquelle il n'y aucun problème de réalisation dans le capitalisme : "La conception que Ricardo a repris du vide et insubstantiel Say que la surproduction ou, pour le moins, la saturation générale du marché, est impossible, se base sur le principe que les produits s'échangent toujours contre des produits ou, comme l'a dit Mill, la demande n'est déterminée que par la production. " ([19] [2186])
- Il a insisté sur le fait que la surproduction permanente exprime les limites historiques du capitalisme : "Si l'on admet que le marché doit se développer en même temps que la production, on admet, d'un autre côté, la possibilité de surproduction, parce que le marché est extrêmement limité au sens géographique (...) Il est parfaitement possible que les limites du marché ne puissent se développer assez rapidement pour la production ou que les nouveaux marchés puissent être rapidement absorbés par la production de façon que le marché élargi représente une entrave pour la production, comme l'était le marché antérieur plus limité." ([20] [2187])
2) Marx a établi l'ensemble des causes qui contrecarrent la baisse tendancielle du taux de profit. Dans le chapitre XTV du Livre 3 du Capital, il analyse les six causes qui contrecarrent cette tendance : augmentation du niveau d'exploitation du travail, réduction du salaire en dessous de sa valeur, réduction du coût du capital constant, surpopulation relative, commerce extérieur, augmentation du capital-actions.
- Il concevait la baisse tendancielle du taux de profit comme une expression de l'augmentation constante de la productivité du travail, tendance que le capitalisme développe à un niveau jamais vu dans les modes de productions antérieurs : "A mesure que diminue progressivement le capital variable relativement au capital constant, la composition organique de l'ensemble du capital s'élève de plus en plus, et la conséquence immédiate de cette tendance c'est que le taux de plus-value se traduit par un taux de profit général en baisse continuelle ... Par conséquent, la tendance progressive à la baisse du taux de profit général est tout simplement une manière, propre au mode de production capitaliste, d'exprimer le progrès de la productivité sociale du travail. " ([21] [2188])
- Il a précisé que ce n'est pas une loi absolue, mais une tendance qui contient toute une série d'effets contraires (exposés plus haut) qui naissent de cette tendance même : "Et ainsi donc nous avons vu qu'en général les mêmes causes qui provoquent la baisse du taux de profit général suscitent des effets contraires qui freinent, ralentissent et paralysent partiellement cette baisse. Ils ne suppriment pas la loi, mais en affaiblissent l'effet. Sinon ce n'est pas la baisse du taux de profit général qui serait incompréhensible, mais inversement la lenteur relative de cette baisse. C'est ainsi que la loi n'agit que sous forme de tendance dont l'effet n'apparaît d'une façon frappante que dans des circonstances déterminées et sur de longues périodes de temps. " ([22] [2189])
- En rapport avec la baisse tendancielle du taux de profit, Marx souligne l'importance primordiale du "commerce extérieur" et surtout de la recherche continue de nouveaux marchés : "Mais ce même commerce extérieur favorise dans la métropole le développement du mode de production capitaliste et entraîne ainsi la réduction du capital variable par rapport au capital constant ; et d'un autre côté il crée par rapport à l'étranger une surproduction et donc il finirá de nouveau par agir en sens opposé. " ([23] [2190])
3) Finalement, au contraire de ce que pense le BIPR, Marx ne voyait pas la dévalorisation de capital comme l'unique moyen dont dispose le capitalisme pour surmonter les crises, il a insisté à plusieurs reprises sur l'autre moyen : la conquête de nouveaux marchés.
"Comment la bourgeoisie surmonte-t-elle cette crise ? D'une part par la destruction obligée d'une masse de forces productives ; et d'autre part par la conquête de not veaux marchés et l'exploitation plus intensives des précédents. " ([24] [2191])
"La production capitaliste est une phase économique de transition pleine de contradictions internes qui ne se développent et deviennent perceptibles que dans le cours de sa propre évolution. Cette tendance à se créer un marché et à l'annuler en même temps est justement une de ces contradictions. Une autre contradiction est la "situation sans issue" à quoi cela conduit, et qui dans un pays sans marché extérieur comme la Russie, survient plus avant que dans des pays qui ont plus ou moins de capacités pour rivaliser sur le marché mondial. Cependant, dans ces derniers pays, cette situation apparemment sans issue trouve un remède dans les moyens héroïques de la politique commerciale; c'est-à-dire, dans l'ouverture violente de nouveaux marchés. Le dernier en date des nouveaux marchés que s'est ouvert de cette façon le commerce anglais et qui s'est montré apte à animer temporairement le dit commerce, est la Chine. " ([25] [2192])
Le problème de l'accumulation
Cependant, le BIPR nous donne un autre argument "de poids " : "comme nous l'avons souligné plus haut, cette théorie (il se réfère à celle de Rosa Luxemburg) réduit à un non-sens Le Capital de Marx, puisque celui-ci développe son analyse en considérant un système capitaliste fermé qui n'a pas d"'acheteurs tiers" (et cependant, il fut capable de découvrir le mécanisme de la crise)". ([26] [2193])
II est tout à fait certain que Marx soulignait que "l'introduction du commerce extérieur dans l'analyse de la valeur des marchandises annuellement produites ne peut créer que de la confusion, sans apparier aucun élément nouveau ni au problème ni à sa solution " ([27] [2194]). Il est vrai que, dans le dernier chapitre du 2e livre, Marx, essayant de comprendre les mécanismes de la reproduction élargie du capitalisme, affirme que l'on doit faire abstraction des "éléments extérieurs ", que l'on doit supposer qu'il n'y a que des capitalistes et des ouvriers et, partant de ces présupposés, il élabore les schémas de la reproduction élargie du capital. Ces fameux schémas ont servi de "bible" aux révisionnistes pour "démontrer" que "Marx donnait dans le 3e Livre du Capital une explication suffisante de l'accumulation, que les schémas prouvaient clairement que le capital peut parfaitement croître et la production s'étendre, sans qu'il y ait dans le monde d'autre mode de production que la production capitaliste ; celle-ci trouve en elle-même, d'après eux, ses propres débouchés ; c'est seulement mon incompréhension absolue des schémas de Marx qui m'a conduite à voir là un problème. " ([28] [2195])
Il est absurde de prétendre que l'explication des crises capitalistes est contenue dans les fameux schémas de l'accumulation. Le centre de la critique de Rosa Luxemburg est précisément la supposition sur laquelle elle est élaborée : "la réalisation de la plus-value aux fins d'accumulation est un problème insoluble pour une société qui ne compte que des capitalistes et des ouvriers. " ([29] [2196]). Partant de là, elle en démontre l'inconsistance : "Pour qui les capitalistes produisent-ils ce qu'ils ne consomment pas ; ce dont ils se 'privent', c'est-à-dire ce qu'ils accumulent ? Ce ne peut pas être pour l'entretien d'une armée toujours plus importante d'ouvriers, puisqu'en régime capitaliste la consommation des ouvriers est une conséquence de l'accumulation ; jamais son moyen ni sa fin (...) Qui donc réalise la plus-value qui croît constamment ? Le schéma répond : les capitalistes eux-mêmes et seulement eux ([30] [2197]). Et que font-ils de leur plus-value croissante ? Le schéma répond ils l'utilisent pour élargir de plus en plus leur production. Ces capitalistes sont fanatiques de la production pour elle-même, ils font construire de nouvelles machines pour construire avec elles, à son tour, de nouvelles machines. Mais ce qui résultera de là n'est pas une accumulation de capital, mais une production croissante de moyens de production sans fin et il faut avoir l'audace de Tugan-Baranovski pour supposer que ce carrousel incessant, dans le vide, peut être un miroir théorique fidèle de la réalité capitaliste et une véritable conscience de la doctrine marxiste. " ([31] [2198])
De là, elle conclut que "Marx a exposé de façon très détaillée et claire, sa propre conception du cours caractéristique de l'accumulation capitaliste dans toute son œuvre, en particulier dans le Livre III. Et il a suffisamment approfondi cette conception pour s'apercevoir que les schémas insérés à la fin du Livre II sont insuffisants. Si l'on examine le schéma de la reproduction élargie, du point de vue de la théorie de Marx, on s'aperçoit nécessairement qu'il se trouve en contradiction avec elle sur divers aspects. " ([32] [2199])
Le capitalisme dépend, pour son développement historique, d'un milieu ambiant pré capitaliste avec lequel il établit une relation qui comprend, de façon indissociable, trois éléments : échange (acquisition de matières premières en échange de produits manufacturés), destruction de ces formes sociales (destruction de l'économie naturelle de subsistance, séparation des paysans et artisans de leur moyens de travail) et intégration à la production capitaliste (développement du travail salarié et de l'ensemble des institutions capitalistes).
Ces rapports d'échange-destruction-intégration embrasse le long processus de formation (16e et 17e siècles), apogée (19e siècle) et décadence (20e siècle) du système capitaliste et constitue une nécessité vitale pour l'ensemble de ses rapports de production : "le processus d'accumulation du capital est lié, par ses rapports de valeur et de marchandises : capital constant, capital variable et plus-value, à des formes de production non capitalistes. L'accumulation du capital ne peut pas être ignorée sous le prétexte de la domination exclusive et absolue du mode de production capitaliste, puisque, sans le milieu non capitaliste, elle est inconcevable de toute façon. " ([33] [2200])
Pour Battaglia Comunista ce processus historique qui se développe au niveau du marché mondial n'est rien d'autre que le reflet d'un processus beaucoup plus profond : "bien qu'on parte du marché et des contradiction qui s'y manifestent (production-circulation, déséquilibre entre l'offre et la demande) il faut revenir aux mécanismes qui règlent l'accumulation pour avoir une vision plus juste du problème. Le capitalisme en tant qu'unité production-circulation nous oblige à considérer ce qui se passe sur le marché comme conscience de la maturation des contradictions qui sont à la base des rapports de production, et non l'inverse. C'est le cycle économique et la nécessité de la valorisation du capital qui conditionnent le marché. Ce n'est qu'en partant des lois contradictoires qui règlent le processus d'accumulation qu'il est possible d'expliquer les lois du marché. " ([34] [2201])
La réalisation de la plus-value, le fameux "saut périlleux de la marchandise" dont parlait Marx, constituerait la "surface" du phénomène, la "caisse de résonance" des contradictions de l'accumulation. Cette vision avec ses airs de "profondeur" ne renferme pas autre chose qu'un profond idéalisme : les "lois du marché " seraient le résultat "extérieur" des lois "internes" du processus d'accumulation. Ce n'est pas la vision de Marx, pour qui les deux moments de la production capitaliste (la production et la réalisation) ne sont pas le reflet l'un de l'autre, mais les deux parties inséparables de l'unité globale qu'est l'évolution historique du capitalisme : "la marchandise entre dans le processus de circulation non seulement comme une valeur d'usage particulière, par exemple une tonne de fer, mais aussi comme une valeur d'usage ayant un prix déterminé, supposons une once d'or. Ce prix qui est, pour partie, l'exposant du "quantum" de temps de travail contenu dans le fer, c'est-à-dire de sa quantité de valeur, exprime en même temps la capacité qu'a le fer de se convertir en or (...) Si cette transsubstantiation ne s'opère pas, la tonne de fer non seulement cesse d'être une marchandise, mais aussi un produit, car précisément elle est une marchandise parce qu'elle constitue une non valeur pour son possesseur, ou dit autrement, parce que son travail n'est pas un travail réel tant qu'il n'est pas un travail utile pour les autres (...) La mission du fer ou de son possesseur consiste donc à découvrir dans le monde des marchandises le lieu oit le fer attire l'or. Cette difficulté, le "saut périlleux" de la marchandise, sera vaincue si la vente s'effectue réellement. " ([35] [2202])
Toute tentative de séparer la production de la réalisation empêche de comprendre le mouvement historique du capitalisme qui le mène à son apogée (formation du marché mondial) et à sa crise historique (saturation chronique du marché mondial) : "Les capitalistes se voient forcés d'exploiter à une échelle toujours plus élevée les gigantesques moyens de production déjà existants (...) A mesure que croît la masse de production et, par conséquent, la nécessité de marchés plus étendus, le marché mondial se réduit de plus en plus et il reste de moins en moins de marchés nouveaux à exploiter, parce que chaque crise antérieure soumet au marché mondial un nouveau marché non encore conquis ou que le marché exploitait superficiellement. " ([36] [2203]) Ce n'est que dans le cadre de cette unité que l'on peut intégrer de façon cohérente la tendance à l'élévation continue de la productivité du travail : "Le capital ne consiste pas à ce que le travail accumulé serve le travail vivant comme moyen pour une nouvelle production. Il consiste à ce que le travail vivant serve au travail accumulé comme moyen pour conserver et augmenter la valeur d'échange. " ([37] [2204])
Quand Lénine étudie le développement du capitalisme en Russie, il utilise la même méthode : "L'important c'est que le capitalisme ne peut subsister et se développer sans un accroissement constant de sa sphère de domination, sans coloniser de nouveaux pays et enrôler les vieux pays non capitalistes dans le tourbillon de l'économie mondiale. Et cette particularité du capitalisme s'est manifestée et continue de sa manifester avec une force énorme dans la Russie postérieure à la Réforme. " ([38] [2205])
Les limites historiques du capitalisme
Le BIPR pense cependant que Rosa Luxemburg s'est acharnée à chercher des causes "extérieures" à la crise du capitalisme : "à l'origine, Luxemburg défendait l'idée que la cause de la crise devait être cherchée dans les rapports de valeur inhérents au mode de production capitaliste lui-même (...) Mais la lutte contre le révisionnisme au sein de la social-démocratie allemande semble l'avoir conduite, en 1913, à chercher une autre théorie économique avec laquelle contrecarrer l'affirmation révisionniste selon laquelle la baisse tendancielle du taux de profit ne serait pas valide. Dans L'accumulation du capital elle conclut qu'il y a un défaut dans l'analyse de Marx et elle décide que la cause de la crise capitaliste est extérieure aux rapports capitalistes."([39] [2206])
Les révisionnistes ont reproché à Rosa Luxemburg d'avoir soulevé un problème inexistant alors que, selon eux, les tableaux de la reproduction élargie de Marx "démontrent" que toute la plus-value se réalise à l'intérieur du capitalisme. Le BIPR n'a pas recours à ces tableaux, mais sa méthode revient au même : pour lui, Marx, avec son schéma des cycles de l'accumulation, avait donné la solution. Le capitalisme se produit et se développe jusqu'à ce que le taux de profit chute et alors le blocage de la production que provoque cette tendance se transforme "objectivement" en une dépréciation massive des capitaux. A travers cette dépréciation, le taux de profit se restaure, le processus reprend, et ainsi de suite. Il est vrai que le BIPR admet que, historiquement, du fait de l'augmentation de la composition organique du capital et de la tendance à la concentration et à la centralisation du capital, l'évolution est beaucoup plus compliquée : au 20e siècle ce processus de concentration fait que les dévalorisations nécessaires de capital ne peuvent plus se limiter à des moyens strictement économiques (fermetures d'entreprises, licenciement d'ouvriers) mais requièrent d'énormes destructions réalisées par la guerre mondiale (voir la première partie de cet article).
Cette explication est, dans le meilleur des cas, une description des mouvements conjoncturels du capital mais ne permet pas de comprendre le mouvement global, historique, du capitalisme. Avec elle, nous avons un thermomètre pas très fiable (nous avons expliqué, en suivant Marx, les causes qui contrarient la loi) des convulsions et de la marche du capitalisme mais on ne comprend pas, ni même on ne commence à présenter, le pourquoi, la cause profonde de la maladie. Avec le fait aggravant que, dans la décadence, l'accumulation est profondément bloquée et ses mécanismes (y compris, par conséquent, la tendance à la baisse du taux de profit) ont été altérés et pervertis par l'intervention massive de l'Etat. ([40] [2207])
Le BIPR nous rappelle que, pour Marx, les causes de la crises sont internes au capitalisme.
Le BIPR voit-il quelque chose de "plus interne" au capitalisme que la nécessité impérieuse qu'il a d'élargir constamment la production au-delà des limites du marché ? Le capitalisme n'a pas pour fin la satisfaction des besoins de consommation (au contraire de la féodalité qui avait pour fin de satisfaire les besoins de consommation des nobles et des curés). Ce n'est pas non plus un système de production simple de marchandises (formes que l'on a pu voir dans l'antiquité et, jusqu'à un certain point, au 14e et 15e siècles). Son but est la production d'une plus-value toujours supérieure à partir des rapports de valeur basés sur le travail salarié. Cela l'oblige à chercher constamment de nouveaux marchés. Pourquoi ? Pour établir un régime d'échanges simples de marchandises ? Pour la rapine et l'obtention d'esclaves ? Non, bien que ces formes aient accompagné le développement du capitalisme, elles ne constituent pas son essence interne, laquelle réside dans la nécessité pour lui d'étendre toujours plus les rapports de production basés sur le travail salarié : "le capital, par malheur pour lui, ne peut pas commercer avec des clients non capitalistes sans les ruiner. Qu'il lui vende des biens de consommation, qu'il lui vende des biens de production, il détruit automatiquement l'équilibre précaire de toute économie pré-capitaliste. Introduire des vêtements bon marché, implanter le chemin de fer, installer une usine, suffît à détruire toute la vieille organisation économique. Le capitalisme aime ses clients pré-capitalistes comme l'ogre aime les enfants : en les dévorant. Le travailleur des économies pré-capitalistes qui a la malchance de se voir touché par le commerce avec les capitalistes sait que, tôt ou tard, il finira, dans le meilleur des cas, prolétarisé par le capital et, dans le pire - et c'est ce qui est de plus en plus fréquent depuis que le capitalisme est entré en décadence - dans la misère et l'indigence. " ([41] [2208])
Dans la phase ascendante, au 19e siècle, ce problème de la réalisation paraissait secondaire dans la mesure où le capitalisme trouvait toujours de nouvelles aires pré-capitalistes à intégrer dans sa sphère et, par conséquent, à vendre ses marchandises. Cependant, le problème de la réalisation est devenu décisif au 20e siècle, quand les territoires pré-capitalistes sont chaque fois plus insignifiants par rapport à ses nécessités d'expansion. C'est pourquoi nous disons que la théorie de Rosa Luxemburg "fournit une explication des conditions historiques concrètes qui déterminent l'ouverture de la crise permanente du système : plus le capitalisme intègre à lui-même les aires d'économie non-capitalistes restantes, plus il crée un monde à sa propre image, moins il peut étendre son marché de façon permanente et trouver de nouveaux débouchés pour la réalisation de cette partie de la plus-value qui ne peut être réalisée ni par les capitalistes, ni par le prolétariat. L'incapacité du système à continuer de s'étendre comme auparavant a ouvert la nouvelle époque de l’impérialisme et des guerres impérialistes qui ont constitué le signal de la fin de la mission historique progressiste du capitalisme, menaçant l'humanité de retourner dans la barbarie. " ([42] [2209])
Nous ne nions pas, quant à nous, la baisse tendancielle du taux de profit, nous voyons son efficience en fonction d'une vision historique de l'évolution du capitalisme. Celui-ci est secoué par toute une série de contradictions ; la contradiction entre le caractère social de la production et le caractère privé de son appropriation, entre l'augmentation incessante de la productivité du travail et la diminution proportionnelle du travail vivant, la baisse tendancielle du taux de profit susmentionnée. Mais ces contradictions purent être un stimulant au développement du capitalisme tant que celui-ci avait la possibilité d'étendre son système de production à l'échelle mondiale. Quand le capitalisme atteignit ses limites historiques, ces contradictions, de stimulantes qu'elles étaient, se transformèrent en entraves pesantes, en facteurs d'accélération des difficultés et convulsions du système.
L'accroissement de la production dans la décadence capitaliste
Le BIPR nous fait une objection réellement choquante : "Si les marchés étaient déjà saturés en 1913, si toutes les possibilités pré capitalistes étaient épuisées et que l'on ne pouvait en créer de nouvelles (à part en allant sur Mars). Si le capitalisme est allé beaucoup plus loin au niveau de la croissanee qu'au siècle précédent ; comment tout cela est-il possible d'après la théorie de Luxemburg ? " ([43] [2210])
Quand, dans l'article polémique de la Revue Internationale n° 79, nous mettions en évidence la nature et la composition de "la croissance économique " réalisée après la 2e guerre mondiale, le BIPR nous a critiqué, laissant entendre qu'il y avait eu une "véritable croissance du capitalisme dans la décadence" et, contre notre défense des positions de Rosa Luxemburg, il disait "nous avons déjà vu comment le CCI règle le problème : en niant empiriquement qu'il y avait eu une réelle croissance. " ([44] [2211])
Nous ne pouvons pas répéter ici l'analyse de la nature de la "croissance" depuis 1945. Nous invitons les camarades à lire l'article "Le mode de vie du capitalisme dans la décadence ", paru dans la Revue Internationale n° 56, qui montre clairement que "les taux de croissance d'après 1945 (les plus élevés de l'histoire du capitalisme) " [ont été] "un soubresaut drogué qui constitue une fuite en avant d'un système aux abois. Les moyens mis en œuvre (crédits massifs, interventions étatiques, production militaire croissante, frais improductifs, etc.) pour sa réaliser viennent à épuisement. ". Ce que nous voulons aborder est quelque chose d'élémentaire pour le marxisme : la croissance quantitative de la production ne signifie pas nécessairement le développement du capitalisme.
Le problème chronique, sans issue, du capitalisme dans la décadence est l'absence de nouveaux marchés qui soient au niveau de la croissance qu'imposé à la production l'augmentation constante de la productivité du travail et de la composition organique du capital. Cette croissance constante aggrave toujours plus le problème de la surproduction, puisque la proportion de travail accumulé (capital constant) est de plus en plus supérieure au travail vivant (capital variable, moyens de vie des ouvriers).
Toute l'histoire de la survie du capitalisme au 20e siècle depuis la défaite de la vague révolutionnaire de 1917-23, est l'histoire d'un effort désespéré pour manipuler la loi de la valeur, via l'endettement, l'hypertrophie des dépenses improductives, le développement des armements, pour pallier cette absence chronique de nouveaux marchés. Et l'histoire a montré que ces efforts n'ont pas fait autre chose qu'aggraver les problèmes et aviver les tendances du capitalisme décadent à l'autodestruction : l'aggravation de la crise chronique du capitalisme accentue les tendances permanentes à la guerre impérialiste, à la destruction généralisée. ([45] [2212])
En réalité, les chiffres de croissance "fabuleux" de la production, qui éblouissent tellement le BIPR, illustrent la contradiction insoluble qu'impliqué, pour le capitalisme, sa tendance à développer la production de façon illimitée, bien au-delà des capacités d'absorption du marché. Ces chiffres, loin de démentir les théories de Rosa Luxemburg, les confirment pleinement. Quand on voit le développement débridé et incontrôlé de la dette, sans comparaison dans l'histoire humaine, quand on le compare à l'existence d'une inflation permanente et structurelle, quand on voit que depuis l'abandon de l'étalon-or le capitalisme a allègrement éliminé toute référence aux monnaies (Actuellement, Fort-Knox ne couvre que 3 % des dollars qui circulent aux Etats-Unis), quand on le compare avec l'intervention massive des Etats pour contrôler artificiellement l'édifice économique (et cela depuis plus de 50 ans), n'importe quel marxiste tant soit peu sérieux doit rejeter cette "fabuleuse croissance" comme fausse monnaie et conclure qu'il s'agit d'une croissance droguée et frauduleuse.
Le BIPR, au lieu de s'affronter à cette réalité, préfère spéculer sur les "nouvelles réalités " du capitalisme. Ainsi, dans sa réponse, il se propose d'aborder : "la restructuration (et, osons le dire, la croissance) de la classe ouvrière, la tendance des Etats capitalistes à être économiquement diminués par le volume du marché mondial et l'augmentation du capital qui est contrôlé par les institutions financières (lesquelles sont, au moins, quatre fois supérieures à ce que seraient l'ensemble des Etats) ont produit une extension de l'économie mondiale depuis l'époque de Rosa Luxemburg et Boukharine jusqu'à l'économie globalisée. " ([46] [2213])
Quand il y a dans le monde 820 millions de chômeurs (chiffres du BIT, décembre 1994), le BIPR parle de croissance de la classe ouvrière ! Quand le travail précaire croît de façon irréversible, le BIPR, tel un nouveau Don Quichotte, voit les moulins à vent de la "croissance" et de la "restructuration" de la classe ouvrière. Quand le capitalisme se rapproche de plus en plus d'une catastrophe financière aux proportions incalculables, le BIPR spécule allègrement sur "l'économie globale" et le "capital contrôlé par les institutions financières". Une fois de plus, il voit le monde selon ses rêves : sa Dulcinée de Toboso de I"'économie globale" consiste en la prosaïque réalité d'un effort désespéré des ces Etats "toujours plus diminués " pour contrôler l'escalade de la spéculation, provoquée justement par la saturation des marchés ; ses gigantesques constructions d'un "capital contrôlé par les institutions financières" sont des bulles monstrueusement gonflées par la spéculation et qui peuvent déchaîner une catastrophe pour l'économie mondiale.
Le BIPR nous annonce que "tout le passé doit être soumis à une analyse marxiste rigoureuse qui demande du temps pour être développée" ([47] [2214]). Ne serait-il pas plus efficace pour le travail de la Gauche Communiste que le BIPR consacre son temps à expliquer les phénomènes qui démontrent la paralysie et la maladie mortelle de l'accumulation tout au long de la décadence capitaliste ? Marx disait que l'erreur n'était pas dans la réponse, mais dans la question elle-même. Se poser la question de "l'économie globale " ou de la "restructuration de la classe ouvrière " c'est s'enfoncer dans les sables mouvants du révisionnisme, alors qu'il y a "d'autres questions ", comme la nature du chômage massif de notre époque, l'endettement, etc., qui permettent d'affronter les problèmes de fond dans le cadre de la compréhension de la décadence capitaliste.
Conclusions militantes
Dans la première partie de cet article, nous avons insisté sur l'importance de ce qui nous unit au BIPR : la défense intransigeante de la position marxiste de la décadence du capitalisme, base de granit de la nécessité de la révolution communiste. Ce qui est fondamental c'est la défense de cette position et la compréhension, jusqu'au bout, de ses implications. Comme nous l'expliquons dans "Marxisme et théorie des crises", on peut défendre la position sur la décadence du capitalisme sans partager pleinement notre théorie de la crise basée sur l'analyse de Rosa Luxemburg ([48] [2215]). Cependant, une telle attitude comporte le risque de défendre cette position sans véritable cohérence, de "donner des coups d'épée dans l'eau ". La cible militante de notre polémique est justement celle-là : les inconséquences et les déviations des camarades qui les portent à affaiblir la position de classe sur la décadence du capitalisme.
Avec son rejet viscéral et sectaire de la thèse de Rosa Luxemburg (et de Marx lui-même) sur la question des marchés, le BIPR ouvre la porte de ses analyses aux courants révisionnistes des Tugan-Baranovski et Cie.
Ainsi, il nous dit que "les cycles d'accumulations sont inhérents au capitalisme et il explique pourquoi, aux différents moments, la production capitaliste et la croissance capitaliste peuvent être plus hautes ou plus basses que dans des périodes précédentes. " ([49] [2216]). Il reprend là une vieille affirmation de Battaglia Comunista, lors de la Conférence internationale des Groupes de la gauche communiste, selon laquelle "le marché n'est pas une entité physique existant en dehors du système de production capitaliste qui, une fois saturé, arrêterait le mécanisme productif, au contraire, c'est une réalité économique, à l'intérieur et à l'extérieur du système, qui se dilate et se contracte suivant le cours contradictoire du processus d'accumulation. " ([50] [2217])
Le BIPR ne se rend-il pas compte qu'avec cette "méthode", il entre de plain-pied dans le monde de Say où, en dehors de différences conjoncturelles, "tout le produit est consommé et tout ce qui est consommé est produit" ? Le BIPR ne comprend-il pas qu'avec cette analyse la seule chose qu'il fait c'est rejoindre la noria de ceux qui "constatent" que le marché "se contracte ou se dilate selon le rythme de l'accumulation", mais qui n'expliquent absolument rien sur l'évolution historique de l'accumulation capitaliste ? Le BIPR ne voit-il pas qu'il est en train de tomber dans les mêmes erreurs que Marx a critiquées : "l'équilibre métaphysique entre les achats et les ventes se réduit à ce que chaque achat est une vente et chaque vente un achat, ce qui est une médiocre consolation pour les possesseurs de marchandises qui ne peuvent pas vendre et, par conséquent acheter. " ([51] [2218])
Cette porte que le BIPR laisse entrouverte aux théories révisionnistes explique la propension qu'il a à se perdre dans des spéculations absurdes et stériles sur la "restructuration de la classe ouvrière" ou "l'économie globale". Cela rend compte aussi de sa tendance à se laisser guider par les chants de sirène de la bourgeoisie : ce fut d'abord la "révolution technologique", puis vint le fabuleux marché des pays de l'Est, plus tard ce fut la guerre yougoslave "négociée". Il est vrai que le BIPR corrige ses erreurs après coup sous la pression des critiques du CCI et de l'écrasante évidence des faits. Cela démontre sa responsabilité et ses liens solides avec la Gauche communiste, mais le BIPR nous accordera que ces erreurs montrent que sa position sur la décadence du capitalisme n'est pas suffisamment consistante, qu'elle aboutit à "donner des coup d'épée dans l'eau" et qu'il doit l'établir sur des bases beaucoup plus solides.
Le BIPR se retrouve avec les révisionnistes adversaires de Rosa Luxemburg dans leur refus de considérer sérieusement le problème de la réalisation, mais il diverge radicalement d'eux dans le rejet de la vision d'une tendance à la diminution des contradictions du capitalisme. Au contraire, à juste titre, le BIPR voit que chaque phase de la crise dans le cycle de l'accumulation suppose une aggravation beaucoup plus importante et plus profonde des contradictions du capitalisme. Le problème concerne précisément les périodes au cours lesquelles, selon lui, l'accumulation capitaliste se rétablit pleinement. Sur ces périodes, en considérant uniquement la tendance la baisse tendancielle du taux de profit et en refusant de voir la saturation chronique du système, le BIPR oublie ou relativise la position révolutionnaire sur la décadence du capitalisme.
Adalen
[1] [2219] .Nous avons développé notre position dans de nombreux articles de la Revue Internationale, en particulier: "Marxisme et théories des crises" (n° 13), "Théories économiques et lutte pour le socialisme" (n° 16), "Les théories des crises depuis Marx jusqu'à l'IC" (n°22), "Critique de Boukharine" (n°29 et 30), la 7e partie de la série "Le communisme n'est pas un bel idéal mais une nécessité matérielle" (n° 76). Le BIPR, dans sa réponse, dit que le CCI ne poursuit pas la critique de ses positions annoncée dans l'article "Marxisme et théories des crises" de la Revue Internationale n° 13. La simple énumération de la liste des articles exposée ci-dessus démontre qu'il se trompe totalement, ce qui réduit à néant son affirmation selon laquelle le CCI n'aurait aucun argument à opposer à ses propres articles.
[2] [2220] « Marxisme et théorie des crises », Revue Internationale n° 13.
[3] [2221] « Marxisme et théorie des crises », Revue Internationale n° 13
[4] [2222] Bernstein, Socialisme théorique et social-démocratie pratique. (Rodbertus était un socialiste bourgeois du milieu du siècle passé qui formula sa "loi" de la part décroissante des salaires. Selon lui, les crises du capitalisme sont dues à cette loi et, pour cette raison, il défend l'intervention de l'Etat pour augmenter les salaires comme remède à la crise. Les révisionnistes de la 3e Internationale accusèrent Marx d'avoir cédé à la thèse de Rodbertus, appelée "sous-consumériste", et ils en vinrent i répéter ces accusations contre Rosa Luxemburg.)
[5] [2223] Say était un économiste bourgeois français du début du 19e siècle qui, dans son apologie du capitalisme, insistait sur le fait que celui-ci n'avait aucun problème de marché puisqu'il "crée son propre marché ". Une telle théorie équivaut i poser le capitalisme comme un système éternel sans aucune possibilité de crise autre que des convulsions temporaires provoquées par "la mauvaise gestion" ou par des "disproportions entre les divers secteurs productifs ". Comme on le voit, les campagnes actuelles de la bourgeoisie sur la "reprise" n'ont rien d'original !
[6] [2224] Cité par Rosa Luxemburg dans son livre L'accumulation du capital, chapitre "Critique des critiques".
[7] [2225] . Idem.
[8] [2226] Cette technique de l'opportunisme a été, par la suite, reprise à son compte par le stalinisme et la social-démocratie, puis par les forces de gauche du capital (particulièrement les gauchistes), qui utilisent effrontément tel ou tel passage de Lénine, de Marx, etc., pour justifier des positions qui n'ont rien à voir avec ces derniers.
[9] [2227] Rosa Luxemburg, Op. cit.
[10] [2228] Il convient de préciser que, dans la polémique suscitée par le livre de Rosa Luxemburg, Pannekoek, qui n'était ni opportuniste ni révisionniste i cette époque, mais au contraire avec la Gauche de la 2e Internationale, a pris parti contre la thèse de Rosa Luxemburg.
[11] [2229] . Nous avons expliqué à de nombreuses reprises que Lénine, face au problème de la 1ère guerre mondiale, et en particulier dans son livre L'impérialisme stade suprême du capitalisme, défendait correctement la position révolutionnaire sur la crise historique du capitalisme (il l'appelait crise de décomposition et de parasitisme du capital) et la nécessité de la révolution prolétarienne mondiale. C'est là l'essentiel, même s'il s'appuyait sur les théories erronées sur le capital financier et la "concentration du capital" de Hilferding qui, en particulier par ses épigones, a affaibli la cohérence de sa position contre l'impérialisme. Voir notre critique dans la Revue Internationale n° 19, "A propos de l'impérialisme".
[12] [2230] . Pour une critique de Boukharine, voir "Le véritable dépassement du capitalisme c'est l'élimination du salariat" dans la Revue Internationale n° 29 et 30.
[13] [2231] . "Marxisme et théories des crises" Revue Internationale n° 13.
[14] [2232] . "The Material Basis of Imperialist War, A Brief Reply to the ICC", Internationalist Communist Review, n° 13, p. 32-33.
[15] [2233] . Idem, p. 32.
[16] [2234] Le Capital, livre III, section 3, chapitre XV
[17] [2235] . Idem.
[18] [2236] . Idem.
[19] [2237] . Marx, Théories sur la plus-value
[20] [2238] . Idem.
[21] [2239] . Le Capital, Livre III, section 3, chapitre XIII. 1\.Le Capital, Livre III, section 3, Chap.XIV.
[22] [2240] Le Capital, Livre III, section 3, chapitre XIII. 1\.Le Capital, Livre III, section 3, Chap.XV.
[23] [2241] . Idem.
[24] [2242] . Le Manifeste Communiste.
[25] [2243] . Lettres de Marx et Engels à Nikolai
[26] [2244] . "A Brief Reply to the ICC ", p. 33.
[27] [2245] . Le Capital, Livre II, section 3, chapitre XX.
[28] [2246] . Rosa Luxemburg, L'Accumulation du capital, chap. "Critique des critiques ".
[29] [2247] . Idem.
[30] [2248] . Dans le Livre III, Marx souligne que "dire que les capitalistes peuvent échanger et consommer leurs marchandises rien qu'entre eux, c'est oublier complètement qu'il s'agit de valoriser le capital, pas de le consommer. " (section 3, chapitre XV).
[31] [2249] . Rosa Luxemburg, L'accumulation du Capital
[32] [2250] . Idem.
[33] [2251] . Idem.
[34] [2252] 2e Conférence Internationale des Groupes de la Gauche Communiste, Textes préparatoires, tome l,p. 7.
[35] [2253] . Marx : Contribution à la critique de l'économie politique, chapitre II.
[36] [2254] . Marx, Travail salarié et capital
[37] [2255] . Idem.
[38] [2256] . Lénine, Le développement du capitalisme en Russie
[39] [2257] . "A Brief Reply to the ICC", p. 33.
[40] [2258] . Voir la Revue Internationale n° 79 et 82
[41] [2259] . "Critique de Boukharine", 2e partie, Revue Internationale n° 30.
[42] [2260] . "Le capitalisme n'est pas un bel idéal mais une nécessité matérielle" VII, Revue Internationale a" 76.
[43] [2261] . "A Brief Reply to the ICC", p. 33.
[44] [2262] . Idem.
[45] [2263] . Voir la lre partie de cet article dans la Revue Internationale n° 82.
[46] [2264] . "A Brief Reply to the ICC", p. 35.
[47] [2265] . Idem.
[48] [2266] La plate-forme du CCI admet que des camarades défendent l'explication de la crise sur la base de la théorie de la baisse tendancielle du taux de profit.
[49] [2267] . "A Brief Reply to the ICC ", p. 31.
[50] [2268] 2ème Conférence des Groupes de la Gauche Communiste, Textes préparatoires. Vol. 1.
[51] [2269] . Marx, Contribution à la critique de l'économie politique.
Courants politiques:
- TCI / BIPR [137]
Approfondir:
Questions théoriques:
- Guerre [129]
Heritage de la Gauche Communiste:
Parasitisme politique : le “C.B.G” fait le travail de la bourgeoisie
- 2978 reads
Dans la Revue Internationale n° 82 et dans sa presse territoriale dans 12 pays, le CCI a publié des articles sur son 11e congrès. Ces articles informent le milieu révolutionnaire et la classe ouvrière de la lutte politique qui a eu lieu récemment dans le CCI pour l'établissement d'un fonctionnement marxiste réel à tous les niveaux de notre vie organisationnelle. Au centre de ce combat se situait le dépassement de ce que Lénine appelait “l'esprit de cercle”. Cela requiert, en particulier, la liquidation des groupements informels basés sur des fidélités personnelles et sur l'individualisme petit-bourgeois, ce à quoi Rosa Luxemburg se référait comme des “tribus” ou des “clans”. Les articles que nous avons publiés situaient le combat actuel dans la continuité de ceux menés par les marxistes contre les bakouninistes dans la 1ère Internationale, par les bolchéviks contre le menchévisme dans le Parti russe, mais aussi par le CCI tout au long de son histoire. En particulier, nous affirmions la base anti-organisationnelle petite-bourgeoise des différentes ruptures qui ont eu lieu dans l'histoire du CCI, et qui n'étaient ni motivées ni justifiées par des divergences politiques. Elles étaient le résultat de comportements organisationnels non marxistes, non prolétariens, de ce que appelait l'anarchisme de l'intelligentsia et de la bohème littéraire.
UN PROBLEME DE TOUT LE MILIEU POLITIQUE PROLETARIEN
Si nous avons rapporté nos débats internes dans notre presse, ce n'est pas par exhibitionnisme, mais parce que nous sommes convaincus que les problèmes que nous avons rencontrés ne sont pas du tout spécifiques au CCI. Nous sommes convaincus que le CCI n'aurait pu survivre s'il n'avait éradiqueé de ses rangs des concessions à des idées anarchistes sur les questions organisationnelles. Nous voyons que le même danger menace le milieu révolutionnaire dans son ensemble. Le poids des idées et des comportements de la petite-bourgeoisie, la résistance à la discipline organisationnelle et aux principes collectifs, ont affecté tous les groupes à un niveau plus ou moins élevé. La rupture de la continuité organique avec les organisations révolutionnaires du passé pendant les 50 ans de contre-révolution, l'interruption du processus de transmission de l'expérience organisationnelle inappréciable d'une génération marxiste à la suivante, ont rendu les nouvelles générations de militants prolétariens de l'après-68 particulièrement vulnérables à l'influence de la petite-bourgeoisie révoltée (mouvements étudiants, contestataires, etc).
Aussi, notre lutte actuelle n'est pas une affaire interne au CCI. Les articles sur le congrès ont pour but la défense de l'ensemble du milieu prolétarien. Ils constituent un appel à tous les groupes marxistes sérieux pour clarifier la conception prolétarienne du fonctionnement et pour faire connaître les leçons de leur lutte contre la désorganisation petite-bourgeoise. Le milieu révolutionnaire comme un tout a besoin d'être beaucoup plus vigilant vis-à-vis de l'intrusion des modes de comportement étrangers au prolétariat. Il a besoin d'organiser consciemment et ouvertement sa propre défense.
L'ATTAQUE DU PARASITISME CONTRE LE CAMP PROLETARIEN
La première réaction publique à nos articles sur le 11e congrès est venue, non pas du milieu prolétarien, mais d'un groupe qui lui est ouvertement hostile. Sous le titre “Le CCI atteint Waco”, le soi-disant “Communist Bulletin Group” (CBG), dans son 16e et dernier Bulletin n'a pas honte de dénigrer les organisations marxistes, dans la meilleure tradition bourgeoise.
“Salem ou Waco auraient été des lieux appropriés pour ce congrès particulier. Alors qu'il serait tentant de railler ou de ridiculiser ce congrès-procès truqué où, entre autre, Bakounine et Lassale furent dénoncés comme étant `pas nécessairement' des agents de la police et Martov caractérisé "d'anarchiste", le sentiment dominant est une grande tristesse de voir qu'une organisation autrefois dynamique et positive en soit réduite à ce triste état.”
“Dans la meilleure tradition stalinienne, le CCI a alors procédé à la ré-écriture de l'histoire (comme il l'a fait après la scission de 1985), pour montrer que toutes les divergences majeures (...) ont été provoquées non pas par des militants ayant des avis divergents sur une question, mais par l'intrusion d'idéologies étrangères dans le corps du CCI.”
“Ce que le CCI ne peut pas saisir c'est que c'est sa propre pratique monolithique qui cause problème. Ce qui s'est sans doute passé au 11e congrès est simplement le triomphe bureaucratique d'un clan sur un autre, une empoignade pour le contrôle des organes centraux, ce qui était largement prévisible après la mort de leur membre fondateur MC.”
Pour le CBG, ce qui s'est passé au congrès du CCI a dû être “deux jours, ou plus, de bataille psychologique. Les lecteurs qui ont quelques connaissances sur les techniques de lavage de cerveaux pratiquées par les sectes religieuses comprendront ce processus. Ceux qui ont eu des lectures sur les tortures mentales infligées à ceux qui confessaient d'impossibles "crimes" lors des procès spectacles de Moscou saisiront, de même, ce qui s'est passé.”
Et là, le CBG se cite lui-même dans un texte de 1982, après que ses membres eurent quitté le CCI :
“Pour chaque militant se posera toujours la question : jusqu'où puis-je aller dans la discussion avant d'être condamné comme une force étrangère, une menace, un petit-bourgeois ? Jusqu'où puis-je aller avant d'être considéré avec suspicion ? Jusqu'où avant d'être un agent de la police ?”
Ces citations parlent d'elles-mêmes. Elles révèlent mieux que tout la vraie nature, non pas du CCI, mais du CBG. Leur message est clair : les organisations révolutionnaires sont comme la mafia. Les “luttes de pouvoir” y ont lieu exactement comme dans la bourgeoisie.
La lutte contre les clans, que tout le 11e congrès a unanimement soutenue, est transformée par le CBG, “sans aucun doute”, en une lutte entre clans. Les organes centraux sont inévitablement “monolithiques”, l'identification de la pénétration d'influences non-prolétariennes, tâche primordiale des révolutionnaires, est présentée comme un moyen de briser les “opposants”. Les méthodes de clarification des organisations prolétariennes - débat ouvert dans toute l'organisation, publication de ses résultats pour informer la classe ouvrière - deviennent la méthode de “lavage du cerveau” des sectes religieuses.
Ce n'est pas seulement l'ensemble du milieu révolutionnaire d'aujourd'hui qui est attaqué ici. C'est toute l'histoire et les traditions du mouvement ouvrier qui sont insultés.
En réalité, les mensonges et les calomnies du CBG sont tout à fait dans la ligne de la campagne de la bourgeoisie mondiale sur la prétendue mort du communisme et du marxisme. Au centre de cette propagande, se trouve une seule idée qui porte en elle le plus grand mensonge de l'histoire : la rigueur organisationnelle de Lénine et des bolcheviks conduit nécessairement au stalinisme. Dans la version du CBG de cette propagande c'est le bolchévisme du CCI qui conduit “nécessairement” à son prétendu “stalinisme”. Evidemment, le CBG ne sait ni ce qu'est le milieu révolutionnaire, ni ce qu'il en est du stalinisme.
Ce qui a provoqué la frénésie petite-bourgeoise du CBG c'est, encore une fois, la façon résolue, indubitable avec laquelle le CCI a affirmé sa fidélité à l'approche organisationnelle de Lénine. Nous pouvons rassurer tous les éléments parasites : plus la bourgeoisie attaque l'histoire de notre classe, plus nous affirmerons fièrement notre fidélité au bolchévisme.
En déversant des ordures sur l'avant-garde prolétarienne, le CBG a démontré une fois de plus qu'il ne fait pas partie du milieu révolutionnaire, mais qu'il y est opposé. Le fait que le CCI ait mené le combat organisationnel le plus important de son histoire ne l'intéresse pas le moins du monde.
En soi, il n'y a rien de nouveau à ce que les révolutionnaires qui défendent la rigueur organisationnelle contre la petite-bourgeoisie soient attaqués, et même dénigrés. Marx devint l'objet d'une campagne de toute la bourgeoisie à cause de sa résistance à l'Alliance de Bakounine. Lénine a été personnellement insulté à cause de son opposition aux menchéviks en 1903 : pas seulement par les réformistes et les opportunistes avérés, mais même par des camarades tels que Trotsky. Mais personne, au sein du mouvement ouvrier, ni Trotsky ni même les réformistes, n'a jamais parlé de la lutte de Marx ou de Lénine dans les termes employés par le CBG . La différence est que la “polémique” du CBG a pour but la destruction du milieu révolutionnaire, pas seulement du CCI.
LA NATURE DU PARASITISME
Nous allons décevoir le CBG qui déclare que le CCI traite ceux qui sont en désaccord avec lui d'agents de la police. Bien que le CBG soit en “désaccord” avec nous, nous considérons qu'ils ne sont ni des espions ni une organisation bourgeoise. Les gens du CBG n'ont pas une plate-forme politique bourgeoise. Programmatiquement, ils adhèrent même à certaines positions prolétariennes. Ils sont contre les syndicats et le soutien aux luttes de “libération nationale”.
Mais, si leurs positions politiques tendent à leur éviter de rejoindre la bourgeoisie, leur comportement organisationnel leur interdit toute participation dans la vie du prolétariat. Leur activité principale consiste à attaquer les groupes marxistes révolutionnaires. Le Communist Bulletin n° 16 l'illustre parfaitement. Depuis plusieurs années, le groupe n'a rien publié. L'éditorial du n° 16 nous informe : “C'est un secret de polichinelle que depuis au moins deux ans, l'organisation a cessé de fonctionner de façon significative (...) ça n'a de groupe que le nom.”
Le groupe prétend qu'après une telle inactivité et une telle insignifiance organisationnelle, il a tout à coup produit un nouveau “bulletin” dans le but d'informer le monde qu'il avait décidé de... cesser d'exister ! Mais il est clair qu'en réalité, la vraie raison de sa publication était d'attaquer encore une fois le CCI et son congrès. Il est révélateur que le n° 16 ne s'attaque pas à la bourgeoisie : par exemple, il n'y a pas de défense de l'internationalisme prolétarien face à la guerre des Balkans. C'est tout-à-fait dans la lignée des 15 précédents numéros qui étaient aussi essentiellement consacrés à calomnier les groupes prolétariens. Et nous sommes sûrs qu'en dépit de leur dissolution annoncée ils continueront à faire de même. En fait, l'abandon de leur prétention à être un groupe politique leur permettra de centrer encore plus exclusivement leur travail nuisible et d'allié objectif de la bourgeoisie sur le dénigrement du camp marxiste.
L'existence de groupes qui, bien que n'étant ni mandatés ni payés par la bourgeoisie, font cependant, de leur plein gré, une partie du travail de la classe dominante, est un phénomène hautement significatif. Dans le mouvement marxiste, nous appelons de tels gens des parasites, des vampires vivant sur le dos des forces révolutionnaires. Ils n'attaquent pas le camp marxiste par allégeance au capital, mais du fait de leur haine aveugle et impuissante du mode de vie de la classe ouvrière, la nature collective et impersonnelle de cette lutte. De tels éléments petits-bourgeois et déclassés sont motivés par un esprit de vengeance vis-à-vis d'un mouvement politique qui ne peut se permettre de faire des concessions à leurs besoins individuels, à leur soif de gloriole, de flatteries et de pompe.
LA TRAJECTOIRE DU “CBG”
Afin de saisir la nature de ce parasitisme (qui n'est pas nouveau dans le mouvement ouvrier) il est nécessaire d'étudier son origine et son développement. Le CBG peut servir d'exemple type. ses origines se situent dans la phase des cercles de la nouvelle génération de révolutionnaires qui se sont développés après 1968, donnant naissance à un petit groupe de militants liés par un mélange de fidélités politiques et personnelles. Le groupe informel en question rompît avec la Communist Workers Organisation (CWO) et se rapprocha du CCI vers la fin des années 1970. Dans les discussions à cette époque, nous critiquions le fait qu'ils voulaient entrer dans le CCI “en tant que groupe” plutôt qu'individuellement. Cela présentait le risque qu'ils forment une organisation au sein de l'organisation, sur une base non politique, affinitaire et menaçant ainsi l'unité organisationnelle prolétarienne. Nous condamnions aussi le fait que, en quittant la CWO, ils avaient emmené une partie de son matériel - en violation des principes révolutionnaires.
Au sein du CCI, le groupe essaya de maintenir son identité informelle séparée, malgré le fait que la pression, au sein d'une organisation internationale centralisée, pour soumettre chaque partie au tout a été beaucoup plus forte que dans la CWO. Cependant, “l'autonomie” des “amis” qui formeront plus tard le CBG a pu survivre du fait qu'au sein du CCI d'autres regroupements du même type, les restes des cercles à partir desquels le CCI s'était formé, continuaient d'exister. Cela est particulièrement le cas de notre section britannique, World Revolution, que les ex-membres de la CWO ont rejoint, et qui était déjà divisée par l'existence de deux “clans”. Ces clans devinrent rapidement un obstacle à l'application pratique des statuts du CCI dans toutes ses parties.
Quand le CCI, aux alentours de cette période, a été infiltré par un agent de l'Etat, Chénier, membre du parti socialiste français de Mitterrand qui, après son exclusion, du CCI, rejoignit ce parti, la section britannique devint la cible principales de ses manipulations. Comme résultat de ces manipulations, et avec la découverte de l'agent Chénier, la moitié de notre section britannique quittaé le CCI. Aucun d'entre eux n'a été exclu, contrairement aux assertions du CBG. ([1] [2270])
Les ex-membres de la CWO, qui démissionnèrent à cette époque, formèrent alors le CBG.
Nous pouvons en tirer les leçons suivantes :
- Bien qu'ils n'aient pas de positions politiques particulières les distinguant des autres, fondamentalement la même clique est entrée et a quitté à la fois la CWO et le CCI, avant de former le CBG. Cela révèle le refus et l'incapacité de ces gens de s'intégrer dans le mouvement ouvrier, de soumettre leur identité de petit groupe à quelque chose de plus grand qu'eux.
- Bien qu'il proclament avoir été exclus du CCI, ou qu'ils ne pouvaient pas y rester à cause de “l'impossibilité de débattre”, en réalité ces gens ont fui le débat politique qui se tenait dans l'organisation. Au nom du “combat contre le sectarisme” ils ont tourné le dos aux deux organisations communistes les plus importantes existant en Grande-Bretagne, la CWO et le CCI, malgré l'absence de toute divergence politique majeure. C'est la façon dont ils “combattent le sectarisme”.
Le milieu politique ne devrait pas se laisser tromper par les phrases vides sur le “monolithisme” et la prétendue “peur du débat” du CCI. Le CCI se situe dans la tradition de la Gauche Italienne et de Bilan, courant qui, pendant la guerre d'Espagne a même refusé d'exclure ou de rompre avec sa minorité qui appelait ouvertement à la participation à la guerre impérialiste dans les milices républicaines, ([2] [2271]) parce que la clarification politique doit toujours précéder toute séparation politique.
- Ce que le CBG reprochait au CCI, c'était sa méthode prolétarienne rigoureuse dans le débat, par la polémique et la polarisation, où “on appelle un chat un chat” et où les positions petites-bourgeoises ou opportunistes sont appelées par leur nom. Une atmosphère difficilement acceptable pour les cercles et les clans, avec leur double langage et leur fausse diplomatie, leur fidélités et leurs trahisons personnelles. Et qui, certainement, ne plaisait pas aux “copains”, aux lâches petits-bourgeois qui ont fui la confrontation politique et se sont retirés de la vie de la classe.
- Plus grave encore, et pour la deuxième fois, le CBG a participé au vol de matériel de l'organisation en la quittant. Ils l'ont justifié avec la vision du parti marxiste comme étant une société par action : quiconque investit son temps dans le CCI a le droit de prendre sa part des ressources quand il le quitte. Qui plus est, ils se sont permis de déterminer quelle “part” leur revenait. Il devrait aller sans dire que si de telles méthodes devaient être tolérées, cela signifierait la fin de toute possibilité d'existence pour les organisation marxistes. Les principes révolutionnaires sont là remplacés part la loi de la jungle bourgeoise.
- Quand le CCI vint récupérer le matériel volé à l'organisation ces courageux “révolutionnaires” nous menacèrent d'appeler la police.
- Les membres du futur CBG étaient les principaux collaborateurs de l'agent provocateur Chénier au sein de l'organisation, et ses principaux défenseurs après son exclusion. C'est ce qui est derrière les allusions à la soit-disant attitude du CCI d'étiqueter ses “dissidents” comme agents de la police. Les CCI est, selon les mensonges du CBG, supposé avoir dénoncé Chénier parce qu'il était en désaccord avec la majorité du CCI sur l'analyse des élections françaises de 1981. Une telle accusation à l'aveuglette est tout autant un crime contre les organisations révolutionnaires que d'envoyer la police contre elles. Dans une telle situation, les révolutionnaires qui sont en désaccord avec un jugement de l'organisation et en particulier le militant accusé lui-même, n'ont pas seulement le droit mais le devoir de faire objection à cela s'ils le jugent nécessaire ou illégitime, et même de demander qu'un tribunal d'honneur, avec la participation d'autres groupes révolutionnaires, reconsidère une telle accusation. Dans le mouvement ouvrier du passé il aurait été impensable de suggérer qu'une organisation ouvrière soulève de telles accusations contre un individu pour tout autre motif que sa défense contre l'Etat. De telles accusations ne peuvent que détruire la confiance dans l'organisation et ses organes centraux, une confiance indispensable pour la défense contre les infiltrations de l'Etat.
UNE HAINE AVEUGLE ET IMPUISSANTE
C'est cette résistance jusqu'au bout des éléments anarchistes petits-bourgeois et déclassés contre leur intégration et leur subordination à la grande mission historique et mondiale du prolétariat, bien qu'il y ait de la sympathie pour certaines de ses positions politiques, qui conduit au parasitisme, à la haine ouverte et au sabotage politique du mouvement marxiste.
La réalité sordide et corrosive du CBG lui-même montre le mensonge de ses déclarations selon lesquelles il a quitté le CCI “afin de pouvoir discuter”. Là encore, nous laisserons les parasites parler d'eux-mêmes. D'abord leur abandon de toute fidélité au prolétariat commence à être théorisée ouvertement. “Une vision très sombre de la nature de la période a commencé à s'exprimer”, nous disent-ils ; “des éléments au sein du CBG se demandent si la classe pourra maintenant émerger APRES TOUT ?”.
En face du “difficile débat” voilà comment le CBG, ce géant “anti-monolithique”, se “débrouille” avec les “divergences”.
“Nous étions mal armés pour affronter ces questions. Il y avait un silence plus ou moins assourdissant en réponse ... le débat ne tournait pas vraiment en eau de boudin parce qu'il restait largement ignoré. C'était profondément malsain pour l'organisation. Le CBG se flattait d'être ouvert à toute discussion au sein du mouvement révolutionnaire, mais là c'était un de ses propres débats, sur un sujet au coeur même de son existence, qui lui bouchait les oreilles et lui fermait la bouche.”
Il est donc tout-à-fait logique que, à la fin de sa croisade contre la conception marxiste de la rigueur organisationnelle et méthodologique comme préalable à tout réel débat, le CBG “découvre” que l'organisation elle-même bloque le débat :
“Afin de permettre au débat d'avoir lieu ... nous avons décidé de mettre fin à la vie du CBG.”
L'organisation comme entrave au débat ! Vive l'anarchisme ! Vive le liquidationnisme organisationnel ! Imaginez la gratitude de la classe dominante face à la propagation de tels “principes” au nom du “marxisme” !
LE PARASITISME : FER DE LANCE CONTRE LES FORCES PROLETARIENNES
Bien que la domination de classe de la bourgeoisie ne soit, pour le moment, certainement pas menacée, les aspects essentiels de la situation mondiale actuelle l'obligent à être particulièrement vigilante dans la défense de ses intérêts. L'approfondissement inexorable de sa crise économique, le développement des tensions impérialistes et la résistance d'une génération d'ouvriers qui n'a pas encore subi de défaite décisive contiennent la perspective d'une déstabilisation dramatique de la société bourgeoise. Tout cela impose à la bourgeoisie la tâche historique et mondiale de détruire l'avant-garde marxiste révolutionnaire du prolétariat. Aussi insignifiant qu'apparaisse le camp marxiste aujourd'hui, la classe dominante est déjà obligée d'essayer sérieusement d'y semer la confusion et de l'affaiblir.
A l'époque de la 1re Internationale, la bourgeoisie se chargea elle-même de la tâche de dénigrer publiquement l'organisation des révolutionnaires. Toute la presse de la bourgeoisie calomniait l'Association Internationale des Travailleurs et son Conseil Général, opposant au prétendu “centralisme dictatorial” de Marx les charmes de son propre passé progressiste et révolutionnaire.
Aujourd'hui, au contraire, la bourgeoisie des puissances dominantes n'a pas intérêt à attirer l'attention sur les organisations révolutionnaires qui sont, pour le moment, si minoritaires que même leurs noms sont en général inconnus des ouvriers. De plus, une attaque directe de l'Etat contre eux, que ce soit par ses médias ou par ses organes de répression, pourrait provoquer un réflexe de solidarité au sein d'une minorité politiquement significative d'ouvriers à la conscience de classe plus élevée. Dans cette situation, la bourgeoisie préfère garder un profil bas et laisser le travail de dénigrement aux parasites politiques. Ces parasites, sans le vouloir ni même sans s'en rendre compte, sont intégrés dans la stratégie anti-prolétarienne de la classe dominante. La bourgeoisie sait très bien que le meilleur moyen, en même temps que le plus efficace, pour détruire le camp révolutionnaire c'est de l'intérieur, en dénigrant, démoralisant et divisant celui-ci. Les parasites accomplissent cette tâche sans même qu'on leur ait demandé. En présentant les groupes marxistes comme staliniens, comme des sectes bourgeoises dominées par les luttes de pouvoir, à l'image de la bourgeoisie elle-même, comme historiquement insignifiants, ils soutiennent l'offensive du capital contre le prolétariat. En détruisant la réputation du milieu, le parasitisme ne contribue pas seulement aux attaques des forces prolétariennes d'aujourd'hui - il prépare le terrain pour la répression politique effective du camp marxiste dans l'avenir. Si la bourgeoisie reste à l'arrière-plan aujourd'hui afin de permettre au parasitisme de faire son sale boulot, c'est avec l'intention de sortir de l'ombre demain pour décapiter l'avant-garde révolutionnaire.
L'incapacité de la plupart des groupes révolutionnaires de reconnaître le caractère réel des groupes parasites est l'une des plus grandes faiblesses du milieu aujourd'hui. Le CCI est déterminé à assumer ses responsabilités en combattant cette faiblesse. Il est grand temps pour les groupes sérieux du milieu politique prolétarien, pour le milieu comme un tout, d'organiser sa propre défense contre les éléments les plus pourris de la petite-bourgeoisie revancharde. Au lieu de flirter avec de tels groupes de façon opportuniste, il est de la responsabilité du milieu de mener une lutte sans merci et implacable contre le parasitisme politique. La formation du futur parti de classe, le succès de la lutte libératrice du prolétariat, dépendront à un degré non négligeable de notre capacité à mener ce combat à bonne fin.
KR.
[2] [2273]. Voir La Gauche communiste d'Italie.
Courants politiques:
Questions théoriques:
- Décomposition [3]
Revue Int. 1996 - 84 à 87
- 4148 reads
Revue Internationale no 84 - 1e trimestre 1996
- 2945 reads
Greves en france : Lutter derriere les syndicats mene a la defaite
- 4124 reads
Des centaines de milliers de travailleurs en grève. Les transports urbains complètement paralysés. Une grève qui s'étend au sein du secteur public : d’abord les chemins de fer, le métro et les bus, ensuite la poste, les secteurs de la production et de la distribution de l’électricité, de la distribution du gaz, des télécom, de l’enseignement, de la santé. Certains secteurs du privé également en lutte, comme les mineurs qui s’affrontent violemment à la police. Des manifestations rassemblant à chaque fois un nombre important de manifestants de différents secteurs : le 7 décembre, à l'appel de différents syndicats ([1] [2274]), on compte environ un million de manifestants contre le plan Juppé ([2] [2275]) dans les principales villes de France. Deux millions le 12 décembre.
Le mouvement de grèves et de manifestations ouvrières se déroule sur toile de fond d’agitation des étudiants avec la participation de ceux-ci à certaines manifestations ou assemblées générales ouvrières. La référence à mai 1968 est de plus en plus présente dans les médias, lesquelles ne manquent pas d’établir le parallèle : le ras le bol généralisé, les étudiants dans la rue, les grèves qui s’étendent.
Serait-on en présence d'un nouveau mouvement social comparable à celui de mai 1968 qui avait donné le coup d’envoi de la première vague internationale de lutte de classe après 50 ans de contre révolution ? Non. Il ne s'agit nullement de cela. En réalité, le prolétariat en France est la cible d’une manoeuvre d’ampleur destinée à l'affaiblir dans sa conscience et dans sa combativité, une manoeuvre qui s'adresse également à la classe ouvrière des autres pays afin de lui faire tirer de fausses leçons des événements en France. C’est la raison pour laquelle, à l’inverse de ce qui se passe quand la classe ouvrière entre en lutte de sa propre initiative, sur son propre terrain, la bourgeoisie en France et dans d’autres pays a donné un tel retentissement à ces événements.
LA BOURGEOISIE UTILISE ET RENFORCE LES DIFFICULTES DE LA CLASSE OUVRIERE
Les événement de mai 1968 en France avaient été annoncés par toute une série de grèves dont la caractéristique majeure était une tendance au débordement des sydicats, voire à la confrontation avec ces derniers. Ce n’est en rien la situation aujourd’hui, ni en France, ni dans les autres pays.
Il est vrai que l’ampleur et la généralisation des attaques que la classe ouvrière a subies depuis le début des années 1990 tendent à alimenter sa combativité ainsi que nous le mettions en évidence dans la résolution sur la situation internationale adoptée par notre 11e Congrès international : « Les mouvement massifs en Italie, à l'automne 1992, ceux en Allemagne de 1993 et beaucoup d'autres exemples ont rendu compte du potentiel de combativité qui croissait dans les rangs ouvriers. Depuis, cette combativité s'est exprimée lentement, avec de longs moments de mise en sommeil, mais elle ne s'est pas démentie. Les mobilisations massives à l'automne 1994 en Italie, la série de grèves dans le secteur public en France au printemps 1995, sont des manifestations, parmi d'autres, de cette combativité » ([3] [2276]).
Cependant, la manière dont se développe cette combativité est encore profondément marquée par le recul que la classe ouvrière a subi lors de l’effondrement du bloc de l’Est et le déchaînement des campagnes sur la « mort du communisme », recul le plus important depuis la reprise historique de ses combats de classe en 1968 : « Les luttes menées par le prolétariat au cours de ces dernières années ont aussi témoigné des énormes difficultés qu'il rencontre sur le chemin du combat de classe, du fait de la profondeur et de l'extension de son recul. C'est de façon sinueuse, avec des avancées et des reculs, dans un mouvement en dents de scie que se développent les luttes ouvrières. »
Partout la classe ouvrière trouve face à elle une classe bourgeoise à l’offensive politique pour affaiblir sa capacité à riposter aux attaques et à surmonter le profond recul de sa conscience. A l’avant garde de cette offensive, les syndicats : « Les manoeuvres présentes des syndicats ont aussi et surtout un but préventif. Il s'agit pour eux de renforcer leur emprise sur les ouvriers avant que ne se déploie beaucoup plus leur combativité, combativité qui résultera nécessairement de leur colère croissante face aux attaques de plus en plus brutales de la crise (...) Déjà les grèves du printemps en France, en fait des journées d'action des syndicats, ont constitué un succès pour ces derniers. »
Au niveau international et depuis quelques mois, la classe ouvrière des pays industrialisés est soumise à un véritable bombardement d’attaques. En Suède, Belgique, Italie, Espagne, pour ne citer que les derniers exemples en date. En France, jamais depuis le premier plan Delors en 1983, la bourgeoisie n'avait osé porter un tel coup de massue aux ouvriers avec, à la fois : augmentation du taux de TVA, c'est-à-dire des taxes à la consommation (entraînant, évidemment, une hausse des prix), augmentation des impôts et du forfait hospitalier (montant de la journée d'hôpital non remboursé par la Sécurité sociale), gel des salaires des fonctionnaires, baisse des pensions de retraites, augmentation de la durée de travail nécessaire avant de pouvoir prendre la retraite pour certaines catégories de fonctionnaires, alors que, dans le même temps, les chiffres officiels de la bourgeoisie commencent à montrer une reprise de l’augmentation du chômage. En fait, comme ses consoeurs de tous les autres pays, la bourgeoisie française est confrontée à une aggravation croissante de la crise mondiale du capitalisme qui l'oblige à attaquer toujours plus les conditions d'existence des prolétaires. Et cela est d'autant plus indispensable pour elle qu'elle a pris un retard important tout au long des années où la gauche, avec Mitterrand et le PS, se trouvait à la tête de l'Etat ce qui dégarnissait passablement le terrain social et l'obligeait à une certaine « timidité » dans ses politiques anti-ouvrières.
Une telle avalanche d'attaques ne pouvait qu’alimenter la combativité ouvrière qui s'était déjà exprimée à différents moments et dans différents pays : Suède, France, Belgique, Espagne...
En effet, face à cela, les prolétaires ne peuvent rester passifs. Ils n'ont d'autre issue que de se défendre dans la lutte. Mais, pour empêcher que la classe ouvrière n’entre dans le combat avec ses propres armes, la bourgeoisie a pris les devants et elle l’a poussée à partir prématurément en lutte sous le contrôle total des syndicats. Elle n’a pas laissé aux ouvriers le temps de se mobiliser à leur rythme et avec leurs moyens : les assemblées générales, les discussions, la participation aux assemblées d'autres lieux de travail que le sien, l'entrée en grève si le rapport de forces le permet, l'élection de comités de grèves, les délégations aux autres assemblées d’ouvriers en lutte.
Ainsi le mouvement de grèves qui vient de se dérouler en France, s'il révèle l'existence d'un profond mécontentement dans la classe ouvrière, est avant tout le résultat d’une manoeuvre de très grande ampleur de la bourgeoisie visant à amener les travailleurs à une défaite massive et, surtout à provoquer, chez eux une profonde désorientation.
UN PIEGE TENDU AUX OUVRIERS
Pour mettre en place son piège, la bourgeoisie a manoeuvré de main de maître, faisant coopérer de façon très efficace ses différentes fractions qui se sont partagées le travail : la droite, la gauche, les médias, les syndicats, la base radicale de ceux-ci constituée essentiellement de militants des fractions d’extrême gauche.
En premier lieu, pour engager sa manoeuvre, la bourgeoisie doit faire partir en grève un secteur de la classe ouvrière. Le développement du mécontentement au sein de celle-ci en France, aggravé par les récentes attaques sur la Sécurité sociale, pour être réel n'est cependant pas encore assez mûr pour provoquer l'entrée en lutte massive de ses secteurs les plus décisifs, particulièrement ceux de l'industrie. C’est un facteur favorable à la bourgeoisie car, en poussant dans la grève le secteur qu'elle va provoquer, il n'y a pas le risque que les autres suivent spontanément et débordent l'encadrement syndical. Le secteur « choisi » est celui des conducteurs de train. Avec le « contrat de plan » qu'elle annonce pour la compagnie des chemins de fer (SNCF), la bourgeoisie les menace de devoir travailler huit années supplémentaires avant de pouvoir partir en retraite sous le prétexte qu'ils sont des « privilégiés » sur ce plan par rapport aux autres employés de l'Etat. C'est tellement énorme que les ouvriers ne prennent même pas la peine de réfléchir avant de se lancer dans la bagarre. C'est justement ce qui était recherché par la bourgeoisie : ils s'engouffrent dans l'encadrement que leur avaient préparé les syndicats. En vingt-quatre heures, les conducteurs du métro et des bus parisiens, menacés de perdre certains avantages catégoriels de même type, sont entraînés dans un piège similaire. Les syndicats mettent le paquet pour forcer l'entrée en grève, alors que de nombreux ouvriers, perplexes, ne comprennent pas cette précipitation. La direction de la RATP (Régie des transports parisiens) vient à la rescousse des syndicats en prenant l'initiative de fermer certaines lignes et en faisant tout pour empêcher de travailler ceux qui le désirent.
Pourquoi la bourgeoisie a-t-elle choisi ces deux catégories de travailleurs pour engager sa manoeuvre ?
Certaines de leurs caractéristiques constituaient des éléments favorables à la mise en oeuvre du plan bourgeois. Ces deux catégories ont effectivement des statuts particuliers dont la modification constitue un prétexte tout trouvé pour déclencher une attaque les concernant spécifiquement. Mais il y a surtout la garantie que, une fois les cheminots et les conducteurs du métro et des bus en grève, l'ensemble des transports publics sera paralysé. Outre le fait qu'un tel mouvement ne peut passer inaperçu pour aucun ouvrier, c'est un moyen supplémentaire, et d'une très grande efficacité, que se donne ainsi la bourgeoisie pour éviter les débordements, alors que son objectif est de poursuivre l'extension de la grève à d'autres secteurs du secteur public. Ainsi, sans transports, le principal et quasiment unique moyen de se rendre aux manifestations, c'est de prendre les cars syndicaux. Aucune possibilité de se rendre massivement à la rencontre d'autres ouvriers en grève, dans leurs assemblées générales. Enfin, la grève des transports c'est, en plus de tout cela, un moyen de diviser les ouvriers en les montant les uns contre les autres, alors que ceux qui sont privés de transports doivent faire face aux pires difficultés pour rejoindre quotidiennement leur lieu de travail.
Mais les cheminots ne sont pas seulement un moyen de la manoeuvre, ils sont également spécifiquement visés par elle. La bourgeoisie était consciente des avantages qu'elle tirerait à épuiser et embrouiller la conscience de ce secteur de la classe ouvrière qui s'était illustré en décembre 1986 par sa capacité à s'affronter à l'encadrement syndical pour entrer en lutte.
Une fois ces deux secteurs en grève sous le contrôle total des syndicats, la phase suivante de la manoeuvre peut être exécutée : la grève dans un secteur traditionnellement combatif et avancé de la classe ouvrière, celui des postes, et tout particulièrement, en son sein, les centres de tri. Dans les années 1980, ces derniers avaient souvent résisté aux pièges des syndicats, n'hésitant pas à la confrontation avec eux. En incorporant ce secteur au « mouvement », la bourgeoisie vise à l’emprisonner dans les mailles de la manoeuvre, afin de le neutraliser et de lui infliger la même défaite qu’à d’autres secteurs. De plus, la manoeuvre s’en trouverait encore plus efficace face aux secteurs qui ne sont pas encore en grève, le mouvement obtenant ainsi une certaine légitimité apte à diminuer partout ailleurs la méfiance ou le scepticisme à son égard. Néanmoins, vis-à-vis de ce secteur, la bourgeoisie se devait de procéder plus finement encore que précédemment avec les cheminots ou de métro. Pour cela, elle a suscité et organisé des « délégations d’ouvriers », ne présentant aucun signe apparent d’appartenance syndicale (et probablement composés d’ouvriers sincères trompés par des syndicalistes de base), qui sont venues appeler à la lutte les ouvriers des centres de tri réunis en assemblées générales. Trompés sur la véritable signification de ces délégations, les ouvriers des principaux centres de tri postal se laissent ainsi entraîner dans la lutte. Afin de donner le maximum d'impact médiatique à l’événement, la bourgeoise a dépêché sur place ses journalistes, et le journal Le Monde en fera la une de son édition du soir même.
A ce stade de déploiement de la manoeuvre, l’ampleur déjà atteinte par le mouvement donne du poids aux arguments des syndicats pour y agglomérer de nouveaux secteurs : les ouvriers de l'électricité, du gaz, des télécom, les enseignants. Face aux hésitations de certains ouvriers sur le bien fondé de la « lutte maintenant », face à leur insistance pour en discuter les modalités et les revendications, les syndicats opposent la formule péremptoire « c’est maintenant qu’il faut y aller » et culpabilisent ceux qui ne sont pas encore en lutte : « nous sommes les derniers à ne pas encore être en grève ».
Afin d’augmenter davantage encore le nombre des grévistes, il faut faire croire qu'il se développe un vaste et profond mouvement social. A les en croire tous, syndicats, gauche, gauchistes, le mouvement susciterait même un immense espoir dans l'ensemble de la classe ouvrière. A l’appui de cela, il y a la publication quotidienne par les médias d’un « indice de popularité » de la grève, toujours favorable à celle-ci dans l'ensemble de la « population ». C'est vrai que la grève est « populaire » et qu'elle est ressentie par beaucoup d'ouvriers comme un moyen d'empêcher le gouvernement d'asséner ses attaques. Mais la sollicitude dont elle est l'objet dans les médias, et particulièrement à la télévision, est bien la preuve que la bourgeoisie est intéressée à ce qu'il en soit ainsi et que cette popularité soit gonflée au maximum.
Les étudiants font aussi partie, à leur insu, de la mise en scène. On les a fait descendre dans la rue pour donner l’impression d’une montée générale des mécontentements, pour faire croire qu’il y a des ressemblances pleines d’espoir avec mai 1968, et en même temps pour noyer les revendications ouvrières dans les revendications inter-classistes dont sont porteurs les étudiants. On les retrouve même jusque dans les assemblées sur les lieux de travail, « à la rencontre des luttes ouvrières », et cela avec la bénédiction des syndicats. ([4] [2277])
Toute initiative est retirée à la classe ouvrière qui n'a d'autre choix que de suivre les syndicats. Dans les assemblées générales convoquées par ces derniers, l’insistance pour que les ouvriers s'expriment n'a d'autre signification que de donner un simulacre de vie à l'assemblée alors que tout est décidé par ailleurs. Au sein de celles-ci, la pression syndicale pour l'entrée en grève est tellement forte que des fractions significatives d’ouvriers, pour le moins dubitatifs sur la nature de cette grève, n’osent pas s’exprimer. Pour certains autres au contraire, complètement mystifiés, c’est l’euphorie d’une unité factice. En fait, une des clés de la réussite de la manoeuvre de la bourgeoisie est le fait que les syndicats ont systématiquement repris à leur compte, pour les dénaturer et les retourner contre elle, des aspirations et des moyens de lutte de la classe ouvrière :
- la nécessité de réagir massivement, et non en ordre dispersé, face aux attaques bourgeoises ;
- l'élargissement de la lutte à plusieurs secteurs, le dépassement des barrières corporatistes ;
- la tenue quotidienne d'assemblées générales sur chaque lieu de travail, chargées notamment de se prononer sur l'entrée en lutte ou la poursuite du mouvement ;
- l'organisation de manifestations de rue où de grandes masses d'ouvriers, de différents secteurs et de différents lieux, puisent un sentiment de solidarité et de force. ([5] [2278])
En outre, les syndicats ont pris le soin, dans la plus grande partie du mouvement, d'afficher leur unité. On a même pu voir, abondamment médiatisée, les poignées de main entre les chefs des deux syndicats traditionnellement « ennemis » : la CGT et Force Ouvrière (qui s'était constituée comme scission de la CGT, avec le soutien des syndicats américains, au temps de la Guerre froide). Cette « unité » des syndicats, qu'on retrouvait souvent dans les manifestations sous forme de banderoles communes CGT-FO-CFDT-FSU, était bien propre à entraîner un maximum d'ouvriers dans la grève derrière eux puisque, pendant des années, une des causes du discrédit des syndicats et du refus des ouvriers de suivre leurs mots d'ordre de grève était justement leurs chamailleries perpétuelles. Dans ce domaine, les trotskystes ont apporté leur petite contribution puisqu'ils n'ont cessé de réclamer l'unité entre les syndicats, faisant de celle-ci une sorte de précondition au développement des luttes.
Du côté de la droite au pouvoir, après la détermination affichée au début du mouvement, on simule des signes de faiblesse (auxquels les médias font toute la publicité nécessaire), qui donnent à penser que les grévistes pourraient bien gagner, obtenir le retrait du plan Juppé, avec, pourquoi pas, la chute du gouvernement. En fait, le gouvernement fait durer les choses sachant pertinemment que les ouvriers qui ont mené une grève longue ne sont pas de si tôt disposés à reprendre la lutte. Ce n'est qu'au bout de 3 semaines qu'il annonce le retrait de certaines des mesures qui avaient mis le feu aux poudres : retrait du « contrat de plan » dans les chemins de fer et, plus généralement, des dispositions concernant les retraites des agents de l'Etat. L'essentiel de sa politique, cependant, est maintenu : les augmentations d'impôts, le blocage des salaires des fonctionnaires et, surtout, les attaques sur la Sécurité sociale.
Les syndicats, en même temps que les partis de gauche, chantent victoire et s'emploient, dès lors, à faire reprendre le travail. Ils s’y prennent de façon tellement habile qu’ils ne se démasquent pas : leur tactique consiste à laisser s’exprimer, sans pression de leur part cette fois-ci, les assemblées générales majoritairement en faveur de la reprise du travail. Ce sont les cheminots, dont les syndicats soulignent la « victoire », qui, le vendredi 15 décembre, donnent le signal de cette reprise comme ils avaient donné le signal de l'entrée dans la grève. La télévision montre à répétition l'image des quelques trains qui recommencent à circuler. Le lendemain, un samedi, les syndicats organisent d'immenses manifestations auxquelles sont conviés les ouvriers du secteur privé (c'est-à-dire, principalement, de l'industrie). C'est l'enterrement en grande pompe du mouvement, un baroud d'honneur qui permet de faire passer plus facilement aux ouvriers la pillule amère de leur défaite sur les revendications essentielles. Dépôt après dépôt, les assemblées de cheminots votent la fin de la grève. Dans les autres secteurs, la lassitude générale et l’effet d’entraînement font le reste. Le lundi 18, la tendance à la reprise est presque générale. Le mardi 19, la CGT, seule, organise une journée d'action et des manifestations : comparée à celle des semaines précédentes, la mobilisation est ridicule ce qui ne peut que convaincre les derniers « récalcitrants » qu'il faut reprendre le travail. Le jeudi 21, gouvernement, syndicats et patronat du privé se retrouvent lors d'un « sommet » : c'est l'occasion pour les syndicats, qui dénoncent les propositions gouvernementales, de continuer à se présenter comme les « défenseurs des ouvriers ».
UNE ATTAQUE POLITIQUE CONTRE LA CLASSE OUVRIERE
La bourgeoisie vient de réussir à faire passer une attaque considérable, le plan Juppé, et à épuiser les ouvriers afin d’amoindrir leur capacité de riposte aux futures attaques.
Mais les objectifs de la bourgeoisie vont bien au delà de cela. La manière dont elle a organisé sa manoeuvre était destinée à faire en sorte que, non seulement les ouvriers ne puissent pas, en préparation de leurs luttes futures, tirer d’enseignements de cette défaite, mais surtout de les rendre vulnérables aux messages empoisonnés qu’elle veut faire passer.
L’ampleur que la bourgeoisie a donnée à la mobilisation, la plus importante depuis des années quant au nombre de grévistes et de manifestants, et dont les syndicats ont été les artisans reconnus, est destinée à donner du poids à l’idée selon laquelle il n’y a qu’avec les syndicats qu’on peut faire quelque chose. Et c’est d’autant plus crédible que, durant le déroulement de la lutte, parfaitement contrôlée par eux, ils ne se sont pas trouvés en situation d’être démasqués, même partiellement, comme c’est le cas lorsqu’il s’agit pour eux de casser un mouvement spontané de la classe. De plus, ils ont su prendre en compte, dans leur stratégie, le fait que, majoritairement, la classe ouvrière, même si elle pouvait les suivre, ne leur faisait néanmoins pas fondamentalement confiance. C’est la raison pour laquelle ils ont pris soin de faire « participer », de façon ostensible, visible par tous, des « non syndiqués » (ouvriers sincères et naïfs ou sous-marins des syndicats) dans les différentes « instances de lutte » comme les « comités de grève » auto-proclamés. Ainsi, en même temps que l’emprise des syndicats sur la classe ouvrière pourra, sous l’effet de la manoeuvre, se renforcer, la confiance des ouvriers dans leur propre force, c’est-à-dire dans leur capacité d’entrer en lutte par eux-mêmes, et de la conduire eux-mêmes, va s’amoindrir pour un long moment. Cette recrédibilisation des syndicats constituait pour la bourgeoisie un objectif fondamental, un préalable indispensable avant de porter les attaques à venir qui seront encore bien plus brutales que celles d'aujourd'hui. C'est à cette condition seulement qu'elle peut espérer saboter les luttes qui ne manqueront pas de surgir au moment de ces attaques. C'est sûrement là un des aspects essentiels de la défaite politique que la bourgeoisie a infligée à la classe ouvrière.
Un autre bénéficiaire de la manoeuvre au sein de la bourgeoisie, c’est la gauche du capital. Les élections présidentielles en France de mai 1995, ont placé toutes les forces de gauche dans l'opposition. Aucune d’entre elles n’étant directement impliquée dans la décision des attaques actuelles, elles ont eu les coudées franches pour les dénoncer et tenter de faire oublier qu’elles-mêmes, PS et PC de 1981 à 1984, et PS tout seul ensuite, ont aussi mené la même politique anti-ouvrière. C’est donc un renforcement de la politique de partage du travail droite au pouvoir, gauche dans l’opposition qu’a permis cette manoeuvre : la droite étant chargée d’assumer la responsabilité des attaques anti-ouvrières, et la gauche dans l’opposition ayant pour rôle de mystifier le prolétariat, d'encadrer et de saboter ses luttes, à travers notamment ses courroies de transmission syndicales.
Un des autres objectifs de premier plan que s'était donnés la bourgeoisie c'est de faire croire aux ouvriers, sur base de l’échec d’une lutte qui s’était étendue à différents secteurs, que l’extension, cela ne sert à rien. En effet, des fractions importantes de la classe ouvrière croient avoir réalisé l’élargissement de la lutte aux autres secteurs ([6] [2279]), c’est-à-dire ce vers quoi avaient tendu les luttes ouvrières depuis 1968, et jusqu’à l’effondrement du bloc de l’Est. C’est sur ces acquis des luttes depuis 1968 que la bourgeoisie s’est d’ailleurs appuyée pour entraîner les ouvriers des centres de tri dans la manoeuvre, comme le montrent les arguments employés pour les faire débrayer : « Les ouvriers des PTT ont été vaincus en 74 parce qu'ils sont restés isolés. De même les cheminots en 86, parce qu'ils n'ont pas réussi à étendre leur mouvement. Aujourd’hui, il faut saisir l‘occasion qui se présente ». Ce sont ces acquis qui étaient dans la ligne de mire de la manoeuvre, pour les dénaturer.
Il est encore trop tôt pour évaluer l'importance de l'impact de cet aspect de la manoeuvre (alors que la recrédibilisation des syndicats est, dès à présent, incontestable). Mais il est clair que le trouble chez les ouvriers risque encore de se trouver renforcé par le fait que le secteur des cheminots, lui, a obtenu satisfaction sur la revendication qui l’avait fait entrer en lutte, le retrait du « plan d'entreprise » et des attaques sur l’accession à la retraite. Ainsi l’illusion qu’on peut obtenir quelque chose en luttant seul dans son secteur va-t-elle se développer et constituer un puissant stimulant au développement du corporatisme. Sans parler de la division ainsi créée dans les rangs ouvriers alors que ceux qui sont entrés en lutte derrière les cheminots, et qui n’ont rien obtenu du tout, vont avoir le sentiment d’avoir été lâchés.
Sur ce plan, les analogies sont grandes avec une autre manoeuvre, celle qui a présidée à la lutte dans les hôpitaux à l’automne 1988. Elle était alors destinée à désamorcer la montée de la combativité dans l’ensemble de la classe ouvrière en faisant éclater prématurément la lutte dans un secteur particulier, celui des infirmières. Celles-ci, organisées au sein de la coordination du même nom, ultra corporatiste, organe préfabriqué par la bourgeoisie pour remplacer les syndicats trop discrédités, se sont vues au terme de leur lutte, accorder un certain nombre d’avantages sous forme d’augmentations de salaires (le milliard de francs que le gouvernement avait prévu à cet effet avant même que la grève ne démarre). Les autres travailleurs des hôpitaux, qui s’étaient massivement engagés dans la bataille en même temps que les infirmières, eux, n’ont rien obtenu. Quant à la combativité dans les autres secteurs, elle est retombée, résultat du désarroi des ouvriers face à l’élitisme et au corporatisme des infirmières.
Enfin, en invoquant aussi souvent et avec tant d’insistance une prétendue similitude entre ce mouvement et celui de mai 1968, la bourgeoisie cherchait, comme on l’a déjà dit, à entraîner dans la manoeuvre le plus grand nombre possible d’ouvriers. Mais c’était également pour elle le moyen d’attaquer la conscience des ouvriers. En effet, pour des millions d’ouvriers, mai 1968 demeure une référence, y compris pour ceux qui n’y ont pas participé parce que trop jeunes ou pas encore nés, ou habitant d’autres pays mais qui ont été à l’époque enthousiasmés par cette première manifestation du ressurgissement du prolétariat sur son terrain de classe, après quarante années de contre révolution. Ces générations d’ouvriers ou fractions de la classe ouvrière qui n’ont pas directement vécu ces événements, plus vulnérables à l’intoxication idéologique sur cette question, étaient particulièrement la cible de la bourgeoisie qui visait à leur faire penser que, finalement, mai 1968 n’avait peut être pas été tellement différent de la grève syndicale d’aujourd’hui. Ainsi c’est une nouvelle attaque à l’identité même de la classe ouvrière dont il s’agit, pas aussi profonde que celles sur la « mort du communisme », mais qui constitue un obstacle supplémentaire sur la voie de la récupération du recul qui a suivi l'effondrement du bloc de l'Est.
LES VERITABLES LECONS A TIRER DE CES EVENEMENTS
La leçon première que tirait le CCI de la manoeuvre de la lutte des infirmières en 1988 ([7] [2280]), reste encore tragiquement d’actualité : « Il importe de souligner la capacité de la bourgeoisie d’agir de façon préventive et en particulier de susciter le déclenchement de mouvements sociaux de façon prématurée lorsqu’il n’existe pas encore dans l’ensemble du prolétariat une maturité suffisante permettant d’aboutir à une réelle mobilisation. Cette tactique a déjà été souvent employée dans le passé par la classe dominante, notamment dans des situations où les enjeux étaient encore bien plus cruciaux que ceux de la période actuelle. L’exemple le plus marquant nous est donné par ce qui s’est passé à Berlin en janvier 1919 où, à la suite d’une provocation délibérée du gouvernement social-démocrate, les ouvriers de cette ville s’étaient soulevés alors que ceux de la province n’étaient pas encore prêts à se lancer dans l’insurrection. Le massacre de prolétaires (ainsi que la mort des deux principaux dirigeants du Parti communiste d’Allemagne : Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht) qui en a résulté a porté un coup fatal à la révolution dans ce pays où, par la suite, la classe ouvrière a été défaite paquet par paquet. » Face à un tel danger il importe que la classe ouvrière puisse le plus largement possible tirer les enseignements de ses expériences, au niveau historique, comme au niveau de ses luttes de la dernière décennie.
Un autre enseignement important c'est que la lutte de classes est une préoccupation majeure de la bourgeoisie internationale, et que, sur ce plan, comme nous l’a déjà montré sa réaction face aux luttes de 1980 en Pologne, elle sait oublier ses divisions. Black-out face aux mouvements qui se déroulent sur un terrain de classe et risquent d’avoir un effet d’entraînement d’un pays à l’autre, ou du moins d’influencer positivement les ouvriers. Inversement, la plus grande publicité donnée, d’un pays à l’autre, aux résultats des manoeuvres contre la classe ouvrière. Il n’y a aucune illusion à se faire, le déchaînement du chacun pour soi, dans la guerre commerciale et les rivalités impérialistes, ne va en rien entraver l’unité internationale dont la bourgeoisie sait faire preuve contre la lutte de classe.
Ce que montrent également les récentes grèves en France c'est que l'extension des luttes entre les mains des syndicats est une arme de la bourgeoisie. Et plus une telle extension prend de l'ampleur, plus la défaite qu’elle permet d’infliger aux ouvriers est étendue et profonde. Là aussi il est vital que les ouvriers apprennent à déceler les pièges de la bourgeoisie. A chaque fois que les syndicats appellent à l'extension, c'est soit qu’ils sont contraints de coller à un mouvement qui se développe, pour ne pas être débordés, soit pour entraîner dans la défaite un maximum d’ouvriers, alors que la dynamique de le lutte commence à s’inverser. C'est ce qu'ils avaient fait lors de la grève des cheminots en France début 1987 quand ils ont appelé à l'« extension » et au « durcissement » du mouvement, non pas lors de la montée de la lutte (à laquelle ils s'étaient ouvertement opposés), mais lors de son déclin, dans le but d'entraîner le plus possible de secteurs de la classe ouvrière derrière la défaite des cheminots. Ces deux situations mettent en évidence la nécessité impérative pour les ouvriers de contrôler leur lutte, du début à la fin. Ce sont leurs assemblées générales souveraines qui doivent prendre en charge l’extension, afin que celle-ci ne tombe pas aux mains de syndicats. Evidemment, ceux-ci ne se laisseront pas faire, mais il faut imposer que la confrontation avec eux se déroule au grand jour, dans les assemblées générales souveraines, qui élisent des délégués révocables au lieu d’être de vulgaires rassemblements manipulés à leur guise par les syndicats comme ce fut le cas dans la présente vague de grèves.
Mais la prise en main de leur lutte par les ouvriers passe nécessairement par la centralisation de toutes leurs assemblées qui envoient leurs délégués à une assemblée centrale. A son tour elle élit un comité central de lutte. C’est cette assemblée qui garantit en permanence l’unité de la classe et qui permet une mise en oeuvre coordonnée des modalités de la lutte : si tel jour il est opportun ou non de faire grève, quels secteurs doivent faire grève, etc. C’est elle également qui doit décider de la reprise générale du travail, du repli en bon ordre lorsque le rapport de force immédiat le nécessite. Ceci n’est pas une vue de l’esprit, ni une pure abstraction, ni un rêve. Un tel organe de lutte, le Soviet, les ouvriers russes l’on fait surgir dans les grèves de masse de 1905, puis en 1917 lors de la révolution. La centralisation de la lutte par le Soviet, c’est là une des leçons essentielles de ce premier mouvement révolutionnaire du siècle et que les ouvriers dans leurs luttes futures devront se réapproprier. Voici ce qu’en disait Trotsky dans son livre 1905 : « Qu’est ce que le Soviet ? Le conseil des députés ouvriers fut formé pour répondre à un besoin pratique suscité par les conjonctures d’alors : il fallait avoir une organisation jouissant d’une autorité indiscutable, libre de toute tradition, qui grouperait du premier coup les multitudes disséminées et dépourvues de liaison ; cette organisation (...) devait être capable d’initiative et se contrôler elle-même d’une manière automatique : l’essentiel, enfin, c’était de pouvoir la faire surgir dans les vingt quatre heures (...) pour avoir de l’autorité sur les masses, le lendemain même de sa formation, elle devait être instituée sur la base d’une très large représentation. Quel principe devait-on adopter ? La réponse venait toute seule. Comme le seul lien qui existât entre les masses prolétaires, dépourvues d’organisation, était le processus de la production, il ne restait plus qu’à attribuer le droit de représentation aux entreprises et aux usines. » ([8] [2281]).
Si le premier exemple d'une telle centralisation vivante d'un mouvement de la classe nous vient d'une période révolutionnaire, cela ne signifie pas que ce soit uniquement dans une telle période que la classe ouvrière puisse centraliser sa lutte. La grève de masse des ouvriers en Pologne en 1980, si elle n’a pas donné naissance à des soviets qui sont des organes de prise de pouvoir, nous en a néanmoins fourni une illustration magistrale. Rapidement, dès le début de la grève, les assemblées générales ont envoyé des délégués (en général deux par entreprise) à une assemblée centrale, le MKS, pour toute une région. Cette assemblée se réunissait quotidiennement dans les locaux de l'entreprise phare de la lutte, les chantiers navals Lénine de Gdansk et les délégués venaient ensuite rendre compte de ses délibérations aux assemblées de base qui les avaient élus et qui prenaient position sur ces délibérations. Dans un pays où les luttes précédentes de la classe ouvrière avaient été impitoyablement noyées dans le sang, la force du mouvement avait paralysé le bras assassin du gouvernement l'obligeant à venir négocier avec le MKS dans ses locaux mêmes. Evidemment, si d'emblée les ouvriers de Pologne, en 1980, avaient réussi à se donner une telle forme d'organisation, c'est que les syndicats officiels étaient totalement discrédités puisqu'ils étaient ouvertement les flics de l'Etat stalinien (et c'est la constitution du syndicat « indépendant » Solinarnosc qui a seule permis l'écrasement sanglant des ouvriers en décembre 1981). C'est la meilleure preuve que non seulement les syndicats ne sont pas une organisation, même imparfaite, de la lutte ouvrière, mais qu'ils constituent, au contraire, tant qu'ils peuvent semer des illusions, le plus grand obstacle à une organisation véritable de cette lutte. Ce sont eux qui, par leur présence et leur action, entravent le mouvement spontané de la classe, né des nécessités de la lutte même, vers une auto-organisation.
Evidemment, du fait justement de tout le poids du syndicalisme dans les pays centraux du capitalisme, ce n’est pas d’emblée la forme des MKS, encore moins des soviets, qu'y prendront les prochaines luttes de la classe. Néanmoins, celle-ci doit leur servir de référence et de guide, et les ouvriers devront se battre pour que leurs assemblées générales soient réellement souveraines et se déterminent dans le sens de l’extension, du contrôle et de la centralisation du mouvement par elles mêmes.
En fait, les prochaines luttes de la classe ouvrière, et pour un certain temps encore, seront marquées par le sceau du recul, exploité par toutes sortes de manoeuvres de la bourgeoisie. Face à cette situation difficile de la classe ouvrière, mais qui ne remet néanmoins pas en cause la perspective d’affrontements de classe décisifs entre bourgeoisie et prolétariat, l’intervention des révolutionnaires est irremplaçable. Afin qu’elle soit le plus efficace possible, et qu’elle ne favorise pas, sans le vouloir, les plans de la bourgeoisie, les révolutionnaires ne doivent pas laisser la moindre prise, dans leurs analyses et leurs mots d’ordre, à la pression idéologique ambiante et doivent être les premiers à déceler et dénoncer les manoeuvres de l’ennemi de classe.
L'ampleur de la manoeuvre élaborée par la bourgeoisie en France, le fait, notamment, qu'elle se soit permise de provoquer des grèves massives qui ne pourront qu'aggraver encore un peu plus ses difficultés économiques, sont en soi le signe que la classe ouvrière et sa lutte n'ont pas disparu comme aimaient à le répéter, pendant des années, les « experts » universitaires aux ordres. Elle démontre que la classe dominante sait parfaitement que les attaques de plus en plus brutales qu'elle devra mener provoqueront nécessairement des luttes de grande ampleur. Même si aujourd'hui elle a marqué un point, si elle a remporté une victoire politique, l'issue de la bataille est loin d'être jouée. En particulier, la bourgeoisie ne pourra empêcher que s'effondre de plus en plus son système économique, ni que se déconsidèrent ses syndicats, comme ce fut le cas au cours des années 1980, au fur et à mesure qu'ils saboteront les luttes ouvrières. Mais la classe ouvrière ne pourra l'emporter que si elle est capable de prendre la mesure de toute la capacité de son ennemi, même appuyé sur un système moribond, à semer des obstacles, les plus subtils et sophistiqués qui soient, sur le chemin de son combat.
BN, 23 décembre 1995.
[8] [2289] Voir notre article « Révolution de 1905 : enseignements fondamentaux pour le prolétariat », dans la Revue internationale n° 43.
Géographique:
- France [1248]
Heritage de la Gauche Communiste:
- La question syndicale [2290]
Tensions imperialistes : derriere les accords de paix, la guerre de tous contre tous
- 2957 reads
A en croire les médias, la raison aurait enfin prévalu : l'action des grandes puissances, au premier rang desquelles les Etats-Unis, aurait permis le début d'une réelle résolution du conflit le plus sanglant qu'a connu l'Europe depuis 1945. Les accords de Dayton signifieraient le retour de la paix dans l'ex-Yougoslavie. De même, tous les espoirs seraient permis au Moyen-Orient, l'assassinat de Rabin n'ayant fait que renforcer la détermination des “ colombes ” et de leur tuteur américain à mener à bien jusqu'au bout le “ processus de paix ”. Dernier cadeau de Noël de Washington : le plus vieux conflit en Europe, celui opposant la Grande-Bretagne aux républicains d'Irlande du Nord, serait lui aussi en passe d'être surmonté.
Face à ces mensonges cyniques, les prolétaires doivent garder en mémoire ce que promettait déjà la bourgeoisie en 1989, après l'effondrement du bloc de l'Est : un “ nouvel ordre mondial ”, une “ nouvelle ère de paix ”. On sait ce qu'il en est advenu en réalité : guerre du Golfe, guerre en Yougoslavie, en Somalie, au Rwanda, etc. L'heure n'est pas à la paix mais, beaucoup plus gravement encore qu'il y a cinq ans, au déchaînement de la guerre de tous contre tous qui caractérise les rapports entre les principales puissances impérialistes de la planète.
Loin d'être les “ colombes ” de la paix ou les pompiers acharnés à éteindre chaque foyer d'incendie guerrier que nous présentent les médias aux ordres de la bourgeoisie, les grandes puissances impérialistes sont les principaux fauteurs de guerre, de l'ex-Yougoslavie au Rwanda, en passant par l'Algérie et le Moyen-Orient. Par cliques ou pays interposés, elles se livrent une guerre qui, pour être encore en partie masquée, n'en est pas moins de plus en plus féroce. Les fameux accords de Dayton ne sont qu'un moment de la guerre opposant la première puissance mondiale à ses ex‑alliés du défunt bloc américain.
Derrière les accords de Dayton, le succès d'une contre offensive des Etats-Unis
En imposant les accords de Dayton, en envoyant 30 000 soldats lourdement armés dans l'ex-Yougoslavie, ce ne sont pas les Serbes ou les Croates que visent les Etats-Unis, ce sont leurs anciens alliés européens devenus les principaux contestataires de leur suprématie mondiale : la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Leur but n'est pas la paix, mais la réaffirmation de leur hégémonie. De même, si les bourgeoisies française, britannique et allemande envoient un contingent dans l'ex‑Yougoslavie, ce n'est pas pour imposer la paix aux belligérants ou défendre la population martyre de Sarajevo, mais pour défendre leurs propres intérêts impérialistes. Sous le couvert de l'action humanitaire et des forces dites de paix de la Forpronu, Paris, Londres et Bonn (plus discrètement mais avec une efficacité redoutable), n'ont cessé d'attiser la guerre en favorisant l'action de leurs protégés. Avec l'IFOR, la Force d'interposition sous l'égide de l'OTAN, c'est la même action criminelle qui va être perpétrée, mais à une échelle encore plus large, comme en témoigne l'importance des forces engagées, en hommes et en matériel. Le territoire de l'ex-Yougoslavie va continuer à être le principal champ de bataille des grandes puissances impérialistes en Europe.
La détermination américaine à revenir au premier plan de la scène yougoslave et à reprendre fermement la baguette de chef d'orchestre est à la hauteur des enjeux stratégiques vitaux représentés par ce pays situé en Europe, au carrefour de l'Europe et du Moyen-Orient. Mais, plus fondamentalement encore, il s'agit comme l'a clairement souligné Clinton, avec le soutien de l'ensemble de la bourgeoisie américaine, lors de son discours pour justifier l'envoi des troupes américaines, de “ l'affirmation du leadership américain dans le monde ”. Et afin que personne ne doute de la détermination de Washington à remplir cet objectif, il a précisé qu'il “ assumait l'entière responsabilité des dommages que pourraient subir les soldats américains. ” Ce langage ouvertement guerrier et cette fermeté qui tranchent après les flottements sur l'ex-Yougoslavie de la part de la bourgeoisie américaine s'expliquent par l'ampleur de la contestation de sa domination par l'Allemagne, le Japon et la France, mais aussi, changement historique, par son plus vieux et fidèle allié, la Grande-Bretagne. Réduits au rôle de simple challenger dans l'ex‑Yougoslavie, les Etats-Unis se devaient de frapper un grand coup pour enrayer la remise en cause la plus grave de leur supériorité mondiale depuis 1945.
Dans le n° 83 de la Revue internationale, nous avons explicité en détail la stratégie mise en oeuvre en ex-Yougoslavie, nous n'y reviendrons donc pas ici ; nous aborderons les résultats de cette contre-offensive de la première puissance mondiale. Celle-ci a été largement couronnée de succès. Les impérialismes britannique et français, quasiment seuls sur le terrain jusqu'à présent - ce qui leur conférait une importante capacité de manoeuvre face à tous leurs rivaux impérialistes, manoeuvre qui a culminé avec la création de la FRR - vont devoir désormais “ coexister ” avec un fort contingent américain et être obligés, bon gré mal gré, de subir les diktats de Washington, l'ONU étant écartée au profit de l'IFOR placée directement sous le commandement américain, sous couvert de l'OTAN. Le déroulement même des pourparlers de Dayton s'inscrit totalement dans le cadre du rapport de forces imposé par les Etats-Unis à leurs “ alliés ” européens. “ Selon une source française, ces pourparlers se sont déroulés dans une atmosphère euro-américaine "insupportable". Ces trois semaines n'ont été, à en croire cette source, qu'une succession de vexations et d'humiliations infligées aux Européens par des Américains qui voulaient mener seuls la danse ” ([1] [2291]). Le fameux “ groupe de contact ” qui était dominé par le duo franco-britannique s'est vu réduit à Dayton à un misérable strapontin et a dû, pour l'essentiel, obtempérer aux conditions dictées par les Etats-Unis :
- la relégation de l'ONU au rôle de simple observateur avec la disparition de la Forpronu, outil précieux dont s'étaient servi Paris et Londres pour la défense de leurs intérêts impérialistes, et son remplacement par une IFOR dominée et commandée par les Etats-Unis ;
- la dissolution de la FRR ;
- le développement des livraisons d'armes et de l'encadrement de l'armée bosniaque par les Etats-Unis.
Quant à la tentative française d'utiliser les états d'âme russes face au rouleau compresseur américain, proposant de placer les troupes russes de l'IFOR sous leur contrôle, pour tenter d'enfoncer un coin dans l'alliance russo-américaine, elle a piteusement échoué, le contingent russe étant finalement placé sous le commandement des Etats-Unis. Et Washington a enfoncé le clou en soulignant que les vraies négociations avaient lieu à Dayton et que la conférence prévue à Paris en décembre ne serait qu'une simple chambre d'enregistrement des décisions prises... aux Etats-Unis... et par eux.
Ainsi, grâce avant tout à leur puissance militaire et au fait que la seule loi qui régisse la jungle de l'impérialisme est la loi du plus fort, la première puissance mondiale est parvenue non seulement à rétablir spectaculairement ses positions dans l'ex-Yougoslavie, mais à rabattre sérieusement les prétentions de tous ceux qui osaient contester sa toute-puissance, au premier rang desquels le tandem franco-britannique. Le coup porté aux bourgeoisies britannique et française est d'autant plus rude que, derrière leur présence en ex-Yougoslavie, ces dernières défendent leur statut de puissances militaires méditerranéennes de premier plan et, par là-même, leur statut de puissances qui, bien que moyennes et historiquement déclinantes, entendent continuer à jouer un rôle d'importance mondiale. Avec le renforcement de la présence de l'armée américaine en Méditerranée, c'est leur rang impérialiste qui se trouve directement menacé. Cette vaste contre-offensive américaine vise avant tout à punir les trublions franco-britanniques. Mais l'Allemagne est elle aussi touchée par cette stratégie. Pour l'impérialisme allemand, l'enjeu essentiel est, via l'ex-Yougoslavie, l'accès à la Méditerranée et la route du Moyen-Orient. Grâce aux victoires de ses protégés croates, il avait commencé à réaliser cet objectif. La forte présence américaine ne peut que le gêner en limitant sa marge de manoeuvre. Ainsi, le fait que la Hongrie, pays lié à l'Allemagne, accepte de servir de base arrière aux troupes américaines ne peut que signifier une menace directe pour les intérêts de l'impérialisme allemand. Ceci confirme que l'alliance nouée avec les Etats-Unis au cours du printemps 1995 ne peut être que momentanée. Les Etats-Unis se sont appuyés sur l'Allemagne, par croates interposés, pour rétablir leur position, mais cet objectif étant atteint, il n'est désormais plus question pour eux de laisser librement agir leur plus dangereux concurrent, la seule des grandes puissances qui a la capacité de devenir à terme le chef de file d'un nouveau bloc impérialiste.
Dans cette zone stratégique vitale qu'est la Méditerranée, les Etats-Unis ont donc fait la claire démonstration de qui mène la danse, et ils ont infligé un coup très sérieux à tous leurs rivaux en brigandage impérialiste dans ce qui reste plus que jamais l'enjeu décisif de la foire d'empoigne de l'impérialisme : l'Europe. Mais en rappelant qu'ils étaient bien décidés à utiliser leur force militaire, c'est aussi à l'échelle mondiale qu'ils mènent cette contre-offensive, car c'est au niveau mondial que se pose le problème de la défense de leur suprématie menacée par le déchaînement du chacun pour soi et la lente montée en puissance de l'impérialisme allemand. Au Moyen-Orient, de l'Irak à l'Iran, en passant par la Syrie, partout les Etats-Unis ont accentué la pression pour imposer “ l'ordre américain ”, en isolant et en déstabilisant les Etats qui refusent les diktats de Washington et sont sensibles aux sirènes européennes ou japonaises. Ils cherchent à évincer l'impérialisme français de ses chasses gardées en Afrique. Ils favorisent l'action des fractions islamistes en Algérie, et ils n'hésitent pas à fomenter en sous-main l'utilisation de ce qui était jusqu'à présent l'arme des faibles, le terrorisme ([2] [2292]). Ils ne sont certainement pas étrangers aux troubles affectant la Côte d'Ivoire et le Sénégal, et alors que Paris cherchait à stabiliser ses relations avec la fraction au pouvoir au Rwanda, le premier résultat de la nouvelle mission de l'inusable Jimmy Carter est une nouvelle dégradation des rapports entre Kigali et Paris. En Asie, confrontée à un Japon supportant de plus en plus mal sa tutelle, comme l'ont illustré les manifestations massives contre les bases américaines à Okinawa, et à une Chine entendant bien profiter de la fin des blocs pour affirmer ses prétentions impérialistes, y compris lorsque celles-ci s'opposent aux intérêts des Etats-Unis, la première puissance mondiale alterne carotte et bâton pour mettre au pas tous ceux qui contestent sa domination. Elle est ainsi récemment parvenue à imposer le maintien de ses bases militaires au Japon.
Mais c'est sans aucun doute le voyage triomphal que vient d'accomplir Clinton en Irlande qui illustre le plus fortement la détermination de la bourgeoisie américaine à punir “ les traîtres ” et à rétablir ses positions. En imposant à la bourgeoisie britannique la reprise des négociations avec les nationalistes irlandais, en affichant ouvertement sa sympathie pour G. Adams, le patron du Sinn Fein, Clinton adresse à la Grande-Bretagne en substance le message suivant : si tu ne rentres pas dans le rang, si tu ne reviens pas à de meilleurs sentiments envers l'ami américain, sache que même sur ton sol tu n'es pas à l'abri de nos représailles. A travers ce voyage, Washington exerce donc une très forte pression sur son ex-allié britannique, pression à la mesure de l'importance historique du divorce survenu au sein de la plus vieille et solide alliance impérialiste du 20e siècle. Cependant, le fait même que les Etats-Unis soient obligés d'utiliser de tels moyens pour tenter de ramener dans leur orbite la bourgeoisie dont ils étaient le plus proche, témoigne en même temps des limites, malgré ses succès indéniables, de la contre-offensive américaine.
Les limites de la contre offensive
Comme le reconnaissent les diplomates eux-mêmes, les accords de Dayton n'ont rien réglé sur le fond, tant sur le futur de la Bosnie, divisée en deux, voire trois entités, que sur l'antagonisme fondamental opposant Zagreb et Belgrade. Cette “ paix ” n'est donc rien d'autre qu'une trêve lourdement armée, avant tout parce que ces accords imposés par les Etats-Unis ne sont qu'un moment du rapport de forces mettant aux prises Washington et les autres grandes puissances impérialistes. Pour le moment, ce rapport de forces penche clairement en faveur des Etats-Unis, qui ont contraint leurs rivaux à céder, bon gré mal gré, mais les Etats-Unis n'ont cependant remporté qu'une bataille et non la guerre elle-même. La lente érosion de leur prépondérance mondiale est enrayée, mais elle n'est pas arrêtée pour autant.
Aucune puissance impérialiste ne peut espérer rivaliser sur le terrain strictement militaire avec la première puissance mondiale et cela confère à cette dernière un formidable atout vis-à-vis de tous ses concurrents, en limitant considérablement leur marge de manoeuvre. Mais les lois de l'impérialisme les contraignent - ne serait-ce que pour subsister sur l'arène impérialiste - à continuer par tous les moyens à chercher à s'affranchir de la pesante tutelle américaine. Ne pouvant que difficilement s'opposer directement aux Etats-Unis, ils ont recours à ce qu'on peut appeler une stratégie de contournement.
La France et la Grande-Bretagne ont ainsi dû accepter l'éviction de la Forpronu et de la FRR au profit de l'IFOR, mais le fait qu'elles participent à cette force avec un contingent qui, si l'on additionne les troupes françaises et britanniques, est d'une importance presque égale aux troupes déployées par Clinton, ne signifie aucunement qu'elles vont docilement se plier aux ordres du commandement américain. Avec une telle force, le tandem franco-britannique se dote des moyens nécessaires à la défense de ses prérogatives impérialistes et donc à la tentative de contrecarrer à la première occasion l'action entreprise par Washington. Le sabotage sera plus facile à réaliser que lors de la guerre du Golfe, du fait d'abord de la nature du terrain, ensuite et surtout parce que cette fois Londres et Paris sont dans le même camp, celui des opposants à la politique américaine, et enfin parce que le contingent des Etats-Unis est beaucoup moins imposant que celui de “ La Tempête du Désert ”. Si la France et la Grande-Bretagne augmentent encore leur présence militaire dans l'ex-Yougoslavie, c'est donc pour garder intacte leur force de nuisance et mettre le maximum de bâtons dans les roues des Etats-Unis, tout en conservant les moyens de contrarier l'avancée de l'impérialisme allemand dans cette région.
Significative également de cette stratégie de contournement, est la bruyante sollicitude de la bourgeoisie française pour les quartiers serbes de Sarajevo, avec la lettre adressée à Clinton à ce sujet par Chirac et le soutien affiché des officiers français de la Forpronu à Sarajevo aux manifestations des nationalistes serbes. Devant la fermeté montrée par Washington, Paris recule et prétend qu'il ne s'agit que d'une maladresse d'un général qui est alors relevé de ses fonctions, mais ce n'est que partie remise jusqu'à la prochaine occasion. Un autre exemple est la bonne opération réalisée par la France avec les élections en Algérie et la confortable réélection de l'homme de la bourgeoisie française, le sinistre Zéroual. Les manoeuvres de Paris autour de la prétendue “ rencontre manquée ” entre Chirac et Zeroual à New York ont permis à la France de détourner et de reprendre à son compte la revendication américaine d' “ élections libres ” en Algérie, et les Etats-Unis se sont ainsi trouvés en position de ne plus pouvoir contester les résultats d'une élection à la participation aussi importante.
La récente décision française de se rapprocher des structures de l'OTAN, par la présence désormais permanente en son sein du chef d'état-major de l'armée française, est aussi une illustration de la même stratégie. Sachant qu'elle ne peut lutter à armes égales avec la bourgeoisie américaine, la bourgeoisie française fait au sein de l'OTAN dominée par les Etats-Unis ce que la Grande-Bretagne fait au sein de la CE dominée par l'Allemagne : s'intégrer pour en contrecarrer la politique.
Avec le sommet euro-méditerranéen de Barcelone, la France là encore chasse directement sur les plates-bandes américaines. D'une part, elle renforce les liens de l'Europe avec les principaux protagonistes du conflit du Moyen-Orient, la Syrie et Israël, alors que les Etats-Unis ont réduit l'Europe au rôle de simple spectateur du “ processus de paix ”. D'autre part, elle s'oppose aux manoeuvres de déstabilisation dont elle est victime au Maghreb à travers la mise sur pied d'une tentative de coordination des politiques de sécurité face au terrorisme islamiste. Si les résultats de ce sommet sont limités, il ne faut cependant pas sous-estimer leur importance à l'heure où les Etats-Unis renforcent leur présence en Méditerranée et font le forcing pour imposer la “ pax americana ” au Moyen-Orient.
Mais là où la limite de la contre-offensive des Etats-Unis se vérifie avec le plus de force, c'est dans le maintien et même le renforcement de l'alliance franco-britannique. Celle-ci s'est développée ces derniers mois dans des domaines aussi essentiels que la coopération militaire, l'intervention en ex-Yougoslavie et la coordination de la lutte contre le terrorisme islamiste. Après avoir affiché un bruyant soutien à la reprise des essais nucléaires français, la bourgeoisie britannique brave directement Washington en acceptant d'aider Paris dans la lutte contre un terrorisme islamiste largement téléguidé par les Etats-Unis, attestant par là-même de la profondeur de la distance prise avec la bourgeoisie américaine.
Tous cela illustre l'importance des obstacles auxquels sont confrontés les Etats-Unis pour mettre fin et dépasser la crise de leur hégémonie. Ils peuvent marquer des points importants contre leurs adversaires et remporter des succès spectaculaires, mais ils ne peuvent construire et imposer autour d'eux un ordre ressemblant, ne serait-ce que de loin, à ce qui prévalait à l'époque du bloc américain. La disparition des deux blocs impérialistes qui avaient dominé la planète pendant plus de quarante ans, en mettant fin au chantage nucléaire grâce auquel les deux chefs de file imposaient leurs diktats à tous les membres de leur bloc, a libéré le chacun pour soi au point que celui-ci est désormais devenu la tendance dominante régissant l'ensemble des rapports impérialistes. Dès que les Etats-Unis bombent le torse en faisant étalage de leur supériorité militaire, tous leurs rivaux reculent, mais ce recul est tactique et momentané, et en aucune façon une réelle allégeance et soumission. Plus les Etats-Unis s'efforcent de réaffirmer leur prédominance impérialiste, en rappelant avec brutalité qui est le plus fort, plus les contestataires de l'ordre américain renforcent leur détermination à la remettre en cause, car pour eux, il s'agit d'une question de vie et de mort, celle de leur capacité à tenir leur rang dans l'arène impérialiste.
C'est cela qui explique que le succès remporté par les Etats-Unis lors de la guerre du Golfe en 1991 a été aussi éphémère et rapidement suivi par une très sensible aggravation de la contestation de l'autorité américaine à l'échelle mondiale, dont le divorce de la Grande-Bretagne avec les Etats-Unis est la manifestation la plus éclatante. A l'heure où l'opération montée par la bourgeoisie américaine en ex-Yougoslavie n'est, malgré son succès actuel, qu'une pâle réplique de celle qui avait été déployée en Irak, les points importants marqués depuis l'été 1995 par la première puissance mondiale ne peuvent pas fondamentalement renverser la tendance à l'affaiblissement historique de la suprématie des Etats-Unis dans le monde, malgré leur supériorité militaire.
Le chacun pour soi et l'instabilité des alliances impérialistes
Le chacun pour soi, qui caractérise de manière croissante l'ensemble des rapports impérialistes, est à la racine de l'affaiblissement de la superpuissance américaine, mais celle-ci n'est pas la seule à en subir les conséquences. Toutes les alliances impérialistes, y compris les plus solides sont affectées. Les Etats-Unis ne peuvent pas ressusciter un bloc impérialiste à leur dévotion, mais leur plus dangereux concurrent, le seul qui puisse espérer être un jour en mesure de diriger un nouveau bloc impérialiste, l'Allemagne, souffre de la même incapacité. L'impérialisme allemand a marqué de nombreux points sur la scène impérialiste, en ex-Yougoslavie où il s'est rapproché de son objectif d'accès à la Méditerranée et au Moyen-Orient, par Croates interposés ; en Europe de l'Est, où il est très solidement implanté ; en Afrique, où il n'hésite pas à semer la perturbation dans les zones d'influence de la France ; en Asie, où il cherche à développer ses positions ; au Moyen-Orient, où il faut désormais compter avec lui ; sans oublier l'Amérique Latine. Partout l'impérialisme allemand tend à s'affirmer comme une puissance conquérante face aux Etats-Unis sur la défensive et aux “ seconds couteaux ” que sont la France et la Grande-Bretagne, en utilisant à fond sa force économique, mais aussi de plus en plus, même si c'est discrètement, sa force militaire. Avec l'arsenal d'armes conventionnelles récupérées de l'ancienne Allemagne de l'Est, l'Allemagne est désormais le deuxième vendeur d'armes du monde, loin devant la France et la Grande-Bretagne réunies. Et jamais l'armée allemande n'a été autant mise à contribution depuis 1945 que dans la période actuelle. Cette avancée correspond à la tendance embryonnaire au développement d'un bloc allemand, mais au fur et à mesure que l'impérialisme allemand démontre sa puissance, presque symétriquement surgissent les obstacles à cette tendance. Plus l'Allemagne montre ses muscles, plus son plus fidèle et solide allié, la France, prend ses distances avec son trop puissant voisin. De la question de l'ex-Yougoslavie à la reprise des essais nucléaires français essentiellement dirigés contre l'Allemagne, en passant par le futur de l'Europe, les frictions ont succédé aux frictions entre les deux Etats, alors que, a contrario, d'excellents rapports se nouaient entre le vieil et irréductible ennemi de l'Allemagne, la Grande-Bretagne, et la France. La multiplication des rencontres entre Chirac et Kohl et les déclarations lénifiantes qui s'en suivent ne doivent pas faire illusion ; elles sont plus le signe de la dégradation que de la bonne santé des rapports franco-allemands. L'ensemble des facteurs politiques, géographiques et historiques, dans le cadre de la tendance dominante au chacun pour soi, pousse à un refroidissement de l'alliance franco-allemande. Celle-ci s'était forgée pendant la “ guerre froide ” dans le cadre du “ bloc occidental ” d'une part, et elle avait d'autre part pour but, côté français, de contrer l'action du cheval de Troie des Etats-Unis dans la CEE, la Grande-Bretagne. Ces deux facteurs ayant disparu - avec la fin du bloc de l'ouest et la très sensible prise de distance de la bourgeoisie britannique vis-à-vis de son tuteur américain -, la France, effrayée par la puissance de son voisin qui a gagné trois guerres contre elle depuis 1870, est poussée à un rapprochement avec la Grande-Bretagne, pour mieux résister à la pression venue d'outre-Atlantique, mais aussi pour se protéger de la trop puissante Allemagne. Impérialismes tous deux déclinants, la France et la Grande-Bretagne tentent de mettre en commun ce qui leur reste de puissance militaire pour se défendre face à Washington et à Berlin. La solidité de l'axe Paris-Londres dans l'ex-Yougoslavie trouve là sa racine, d'autant plus que ces deux puissances militaires méditerranéennes ne peuvent que voir leur statut dévalorisé par une avancée allemande et une trop forte présence américaine.
Tous les ponts ne peuvent pas être brutalement coupés entre la France et l'Allemagne, étant donné l'étroitesse et l'ancienneté des relations entre les deux pays, notamment sur le plan économique. Mais l'alliance franco-allemande ressemble de plus en plus à un souvenir, et la tendance à la constitution d'un futur bloc impérialiste autour de l'Allemagne est considérablement entravée.
Le développement du chacun pour soi, engendré par la décomposition du système capitaliste, et déchaîné par la fin des blocs impérialistes, mine les alliances impérialistes les plus solides, celle entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, ou encore celle entre la France et l'Allemagne, même si cette dernière n'avait pas la même solidité et ancienneté. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura plus d'alliances impérialistes. Tout impérialisme pour survivre doit nouer des alliances. Mais désormais ces alliances seront plus instables, plus fragiles, plus sujettes à retournement. Certaines auront une solidité relative, à l'image de l'alliance franco-britannique actuelle, mais cette solidité ne saurait de comparer à celle ayant existé pendant près d'un siècle entre Londres et Washington, ou même à celle entre Bonn et Paris depuis la 2e guerre mondiale. D'autres seront purement circonstancielles, comme celle nouée au printemps 1995 entre les Etats-Unis et l'Allemagne. D'autres encore seront à géométrie variable, tantôt avec l'un sur telle question, tantôt avec l'autre sur un front différent.
Cela aura pour résultat un monde encore plus instable et dangereux, où la généralisation de la guerre du tous contre tous entre les grandes puissances impérialistes entraînera dans son sillage toujours plus de guerres, de souffrances et de destructions pour l'immense majorité de l'humanité. L'utilisation de la force brute, à l'image de ce que font les grands Etats soi-disant civilisés dans l'ex-Yougoslavie, ne peut que s'intensifier. A l'heure où la nouvelle récession ouverte que connaît le capitalisme mondial pousse la bourgeoisie à asséner de nouveaux coups terribles à la classe ouvrière, celle-ci doit se rappeler que le capitalisme c'est la misère, mais c'est aussi la guerre et son cortège d'indicible barbarie et, qu'elle seule, par sa lutte peut y mettre fin.
RN, 11 décembre 1995.
Questions théoriques:
- Guerre [129]
- Impérialisme [321]
Chine 1928-1949 : maillon de la guerre imperialiste (II)
- 3800 reads
Dans la première partie de cet article (Revue internationale, n° 81), nous avons tenté de nous réapproprier l'expérience historique révolutionnaire de la classe ouvrière en Chine. L'héroïque tentative insurrectionnelle du prolétariat de Shanghai le 21 mars 1927 fut à la fois le point culminant du mouvement formidable de la classe ouvrière qui avait commencé en Chine en 1919 et la dernière explosion de la vague révolutionnaire internationale qui avait fait trembler le monde capitaliste depuis 1917. Et pourtant, les forces alliées de la réaction capitaliste (le Kuomintang, les « seigneurs de la guerre » et les grandes puissances impérialistes), renforcées qui plus est par la complicité de l'Exécutif d'une Troisième internationale (IC) en plein processus de dégénérescence, parvinrent à détruire ce mouvement de fond en comble.
Les événements postérieurs n'eurent plus rien à voir avec la révolution prolétarienne. Ce que l'histoire officielle nomme la « révolution populaire chinoise » ne fut en réalité qu'une succession effrénée de luttes pour la contrôle du pays entre fractions bourgeoises antagoniques, chacune d'elles servant d'ailleurs de paravent à l'une ou l'autre des puissances impérialistes. La Chine était devenue une « région chaude » supplémentaire des affrontements impérialistes qui allaient déboucher sur la seconde guerre mondiale.
La liquidation du parti prolétarien
Selon l'histoire officielle, 1928 est une date décisive pour la vie du Parti communiste chinois (PCC), puisque cette année-là vit la création de « l'Armée rouge » et le début de la « nouvelle stratégie » basée sur la mobilisation des paysans, promus « piliers » de la « révolution populaire ». Ce fut effectivement une date décisive pour le PCC, mais pas dans le sens donné par l'histoire officielle. L’année 1928 fut de fait, celle de la liquidation du Parti communiste de Chine en tant qu'instrument de la classe ouvrière. La compréhension de cet événement est la base pour comprendre l'évolution postérieure de la Chine.
D'une part, le parti fut désarticulé et sévèrement décimé avec la défaite du prolétariat. Comme nous l'avons déjà mentionné, quelques 25 000 militants communistes furent assassinés et plusieurs milliers souffrirent les persécutions du Kuomintang. Ces militants étaient l'avant-garde du prolétariat révolutionnaire des grandes villes, qui s'était regroupée massivement au sein du Parti durant les années précédentes, faute d'organismes unitaires du type conseils ouvriers. Dorénavant, non seulement le parti ne verra plus l'adhésion de nouvelles vagues d'ouvriers, mais sa composition sociale même se transformera radicalement ainsi que ses principes politiques, comme nous l'aborderons par la suite.
Car la liquidation du Parti ne fut pas seulement physique, ce fut avant tout une liquidation politique. La période de répression féroce contre le Parti communiste chinois coïncida avec l'irrésistible ascension du stalinisme en URSS et dans l'Internationale. La simultanéité de ces événements favorisa de façon dramatique l'opportunisme qui depuis des années était inoculé au sein du PCC par l'Exécutif de l'IC, jusqu'à provoquer un processus de dégénérescence foudroyante.
Entre les mois d'août et de décembre 1927, on vit ainsi le PCC prendre la tête d'une série de tentatives aventureuses, chaotiques et désespérées, parmi lesquelles nous pouvons citer en particulier la « Révolte d'automne » (soulèvement de quelques milliers de paysans dans certaines régions qui se trouvaient sous l'influence du Parti), la mutinerie des régiments nationalistes de Nantchang (parmi lesquels agissaient quelques communistes), et enfin, du 11 au 14 décembre, la soi-disant « insurrection » de Canton, qui en réalité ne fut qu'une tentative d'insurrection planifiée et qui, ne bénéficiant pas du soutien de l'ensemble du prolétariat de la ville, se termina par un nouveau bain de sang. Toutes ces actions se conclurent en défaites désastreuses au bénéfice des forces du Kuomintang, accélérant la dispersion et la démoralisation du Parti communiste, signifiant en fin de compte l'écrasement des derniers soubresauts révolutionnaires de la classe ouvrière.
Ces tentatives aventureuses avaient été incitées par les éléments que Staline avait placés à la tête du PCC, et avaient comme objectif de justifier la thèse de Staline sur « l'ascension de la révolution chinoise », bien que ces échecs furent utilisés postérieurement pour expulser, à travers de sordides manoeuvres, tous ceux qui précisément s'étaient opposés à elles.
1928 fut l'année du triomphe total de la contre-révolution stalinienne. Le IXe Plénier de l'IC valida le « rejet du trotskisme » comme condition d'adhésion et, pour finir, le VIe Congrès adopta la théorie du « socialisme en un seul pays », c'est-à-dire l'abandon de l'internationalisme prolétarien, point d'orgue qui signa la fin de l'Internationale en tant qu'organisation de la classe ouvrière. C'est dans ce cadre que se tint -en URSS- le 6e Congrès du PCC, qui pour ainsi dire initia la stalinisation « officielle » du Parti en prenant la décision de préparer une équipe de jeunes dirigeants inconditionnels de Staline ; c'était là un bouleversement radical de ce Parti, devenu un instrument du nouvel impérialisme russe ascendant. Cette équipe d’« étudiants retournés » devait tenter de s'imposer à la direction du parti chinois deux ans plus tard, en 1930.
« L'Armée rouge » et les nouveaux « Seigneurs de la guerre »
La stalinisation ne fut cependant pas l'unique expression de la dégénérescence du PCC. L'échec de la série d'aventures durant la seconde moitié de l'année 1927 provoqua aussi la fuite de certains groupes qui y avaient participé vers des régions difficiles d'accès aux troupes gouvernementales. Ces groupes commencèrent à se réunir en détachements militaires, et l'un d'entre eux était celui de Mao Tsé-Toung.
Il faut préciser que jamais Mao Tsé-Toung n'avait donné de preuves particulières d'intransigeance prolétarienne. Tout juste avait-il occupé un poste administratif de second ordre durant l'alliance entre le PCC et le Kuomintang, parmi les représentants de l'aile opportuniste. Une fois cette alliance brisée, il avait fui dans sa région natale du Junan où il dirigea la « révolte paysanne de l'automne », conformément aux directives staliniennes. Le désastre qui conclut cette aventure le força à se replier encore davantage jusqu'au massif montagneux de Chingkang, accompagné par une centaine de paysans. Pour pouvoir s'y établir, il conclut un pacte avec les bandits qui contrôlaient cette zone, apprenant d'eux les méthodes d'assaut. Son groupe enfin fusionna avec un détachement du Kuomintang commandé par l'officier Chu Te, qui fuyait lui aussi vers la montagne après l'échec du soulèvement de Nantchang.
Selon l'histoire officielle, le groupe de Mao serait à l'origine de la soi-disant Armée « rouge », ou « populaire », et des « bases rouges » (régions contrôlées par le PCC). Mao aurait « découvert » quelque chose comme la « stratégie correcte » pour la révolution chinoise. A vrai dire, le groupe de Mao ne fut jamais qu'un des multiples détachements similaires qui se formèrent simultanément dans une demi-douzaine de régions. Tous engagèrent une politique de recrutement parmi la paysannerie, d'avancée et d'occupation de certaines régions, parvenant même à résister aux assauts du Kuomintang durant quelques années, jusqu'en 1934. Ce qu'il faut retenir d'important ici, c’est la fusion politique et idéologique qui eut lieu entre l'aile opportuniste du PCC, certaines fractions du Kuomintang (le parti officiel de la bourgeoisie nationaliste) et même des mercenaires provenant de bandes de paysans déclassés. En réalité, le déplacement géographique qui s'opérait sur la scène historique, des villes vers la campagne, ne correspondait pas simplement à un changement de stratégie, il exprimait avec éclat la transformation de la nature de classe du Parti communiste.
Selon les historiens maoïstes, en effet, « l'Armée rouge » serait une armée de paysans guidée par le prolétariat. A la tête de cette armée ne se trouvait bien sûr pas la classe ouvrière, mais des militants du PCC -d'origine petite-bourgeoise pour la plupart- qui jamais n'avaient pleinement adhéré aux perspectives de la lutte du prolétariat (perspectives qu'ils finiront par rejeter définitivement avec la défaite du mouvement), mêlés à des officiers du Kuomintang. Ce mélange se consolidera par la suite avec un nouveau déplacement de professeurs et d'étudiants universitaires nationalistes et libéraux vers la campagne, ceux-ci formeront plus tard les cadres « éducateurs » des paysans durant la guerre contre le Japon.
Socialement, le Parti communiste de Chine deviendra alors le représentant des couches de la bourgeoisie et de la petite-bourgeoisie déplacées par les conditions dominantes en Chine: des intellectuels, des militaires de carrière qui ne trouvaient de postes ni dans les gouvernements locaux car seuls y accédaient les notables, ni dans le gouvernement central très fermé et monolithique de Tchang-Kai Shek. L'idéologie des dirigeants de « l'Armée rouge » devint alors une espèce de compote à base de stalinisme et du « sunyasenisme ». Un langage pseudo marxiste plein de phrases sur le prolétariat qui ne faisaient que nuancer légèrement ce qui était devenu de plus en plus ouvertement le véritable objectif à atteindre : établir, avec l'aide d'un gouvernement « ami », un gouvernement bourgeois « démocratique » pour remplacer le gouvernement bourgeois « dictatorial » de Tchang-Kai Shek. Dans les conditions crées par la décadence du capitalisme, ceci impliquait l'immersion totale du nouveau PCC et de son « Armée rouge » dans les conflits impérialistes.
La paysannerie chinoise est-elle une classe spéciale ?
Il est cependant vrai que les rangs de « l'Armée rouge » étaient surtout constitués de paysans pauvres. Ce fait (avec aussi le fait que le Parti continuait à s'appeler « communiste ») se trouve à la base de la création du mythe de la « Révolution populaire chinoise ».
C'est en réalité dès la seconde partie des années 1920 qu'apparurent des théorisations au sein du PCC, surtout parmi ceux qui se méfiaient de la classe ouvrière, sur le caractère de classe particulièrement révolutionnaire de la paysannerie chinoise. On pouvait lire, par exemple, que « les grandes masses paysannes se sont soulevées pour accomplir leur mission historique... détruire les forces féodales rurales » ([1] [2295]). En d'autres termes, certains considéraient que la paysannerie était une classe historique capable de réaliser certains objectifs révolutionnaires indépendamment des autres classes. Avec la dégénérescence politique du PCC, ces soi-disant théorisations allèrent bien plus loin, jusqu'à attribuer à la paysannerie rien de moins que la capacité de remplacer le prolétariat dans la lutte révolutionnaire. ([2] [2296])
En s'appuyant sur l'histoire des rébellions paysannes en Chine, ils prétendaient démontrer l'existence d'une « tradition » (pour ne pas parler de « conscience ») révolutionnaire dans la paysannerie chinoise. Ce que nous démontre en réalité l'histoire, c'est précisément l'absence d'un projet révolutionnaire historique dans la paysannerie, qu'elle soit chinoise ou d'autres parties du monde, comme l'a démontré mille fois le marxisme. Pendant la période ascendante du capitalisme, elle pu dans le meilleur des cas ouvrir la voie aux révolutions bourgeoises, mais dans la phase de décadence les paysans pauvres ne peuvent lutter de façon révolutionnaire que dans la mesure où ils adhèrent aux objectifs révolutionnaires de la classe ouvrière, car dans le cas contraire ils deviennent des instruments de la classe dominante.
La rébellion des Taïpings (principal et plus « pur » mouvement de la paysannerie chinoise, qui éclata en 1850 contre la dynastie mandchoue et ne fut totalement défait qu'en 1864) avait montré les limites de la lutte de la paysannerie. Les Taïpings voulaient instaurer le règne de Dieu sur Terre, une société sans propriété privée individuelle, sur laquelle régnerait un monarque légitime, véritable fils de Dieu, qui serait le dépositaire de toute la richesse de la communauté. Cela veut bien dire que s'ils avaient bien reconnu la propriété privée comme source de tous leurs maux, cette conscience n'était pas accompagnée -et ne pouvait l'être en aucune façon- d'un projet viable de société future mais d'un utopique retour à la dynastie idyllique perdue. Durant les premières années, les puissances militaires qui pénétraient déjà en Chine laissèrent faire les Taïpings, les utilisant pour affaiblir la dynastie, et la rébellion s'étendit à tout le royaume, mais les paysans furent incapables de former un gouvernement central et d'administrer les terres. Le mouvement atteint son point culminant en 1856 lorsque la tentative de prise de Pékin, capitale impériale, échoua. Le mouvement commença alors à s'éteindre, victime d'une répression massive à laquelle collaborèrent bien sûr les puissances impérialistes susnommées. Ainsi, la révolte des Taïpings affaiblit la dynastie mandchoue, mais ce ne fut que pour ouvrir les portes à l'expansion impérialiste de la Grande-Bretagne, de la France et de la Russie. La paysannerie avait servi la table de la bourgeoisie. ([3] [2297])
Des années plus tard, en 1898, éclata une autre révolte de moindre envergure, celle des Boxers, dirigée à ses origines contre la dynastie et les étrangers. Cette révolte marqua cependant la décomposition et la fin des mouvements paysans indépendants, l'impératrice ayant réussi à s'en emparer et à l'utiliser dans sa propre guerre contre les étrangers. Avec la désintégration de la dynastie et la fragmentation de la Chine aux débuts du siècle, beaucoup de paysans pauvres ou sans terres s'engagèrent dans les armées professionnelles des seigneurs de la guerre régionaux. Enfin, les traditionnelles sociétés secrètes pour la protection des paysans se transformèrent en mafias au service des capitalistes, dont le rôle dans les villes était de contrôler la force de travail et de servir de briseurs de grèves.
Les théorisations sur la nature révolutionnaire de la paysannerie trouvaient bien évidemment leur justification dans l'effervescence effective de la paysannerie, en particulier dans le sud de la Chine. Ces théorisations, cependant, ignoraient totalement le fait que cette réanimation était due à la révolution dans les grandes villes industrielles et que, précisément, l'unique espoir d'émancipation des paysans ne pouvait venir que de la victoire du prolétariat urbain.
Mais la mise sur pied d'une « Armée rouge » n'eut rien à voir avec le prolétariat, ni avec sa révolution. On peut dire qu'elle n'eut rien à voir même avec la constitution de milices révolutionnaires propres aux périodes insurrectionnelles. Il est certain que les paysans s'engageaient dans « l'Armée rouge » ; poussés par les terribles conditions de vie qu'ils subissaient, espérant obtenir ou défendre des terres, cherchant à gagner une subsistance comme soldats. Toutes ces raisons étaient exactement celles qui les poussaient aussi à s'engager dans n'importe quelle armée des seigneurs de la guerre qui pullulaient alors en Chine.
L'« Armée rouge » dû d'ailleurs, dans un premier temps, donner l'ordre à ses troupes d'arrêter les mises à sac des régions conquises. L'« Armée rouge » était un corps totalement étranger au prolétariat, comme cela put se vérifier en 1930 quand, après avoir pris l'importante ville de Changsha, elle ne put la garder que quelques jours parce que les ouvriers de la ville la reçurent froidement quand ce n'est pas avec hostilité, et rejetèrent l'appel à la soutenir par une nouvelle « insurrection ».
La différence entre les dirigeants de cette armée et les seigneurs de la guerre traditionnels résidait dans le fait que ceux-ci s'étaient déjà établis dans la structure sociale chinoise et faisaient visiblement partie de la classe dominante, alors que ceux-là luttaient pour s'y faire une place, ce qui leur permettait d'alimenter les espoirs des paysans et leur donnait un caractère plus dynamique et agressif, une plus grande flexibilité au moment de passer des alliances et de se vendre à l'impérialisme le plus offrant.
En résumé, on pourrait dire que la défaite de la classe ouvrière en 1927 ne projeta pas la paysannerie à la tête de la révolution, mais bien au contraire la jeta dans la tempête de conflits nationalistes et impérialistes, dans lesquels elle ne joua le rôle que de chair à canon.
Les conflits impérialistes
Dès que le prolétariat fut écrasé, le Kuomintang devint pour un certain temps l'institution la plus puissante de Chine, la seule force capable de garantir l'unité du pays -en combattant ou en s'alliant aux seigneurs de la guerre régionaux- et, de ce fait, devint aussi l'enjeu des disputes entre puissances impérialistes. Nous avons déjà cité celles-ci quand nous avons dit que depuis 1911, l'effort des grandes puissances impérialistes transparaissait derrière les conflits pour former un gouvernement national. Au début des années 30, le rapport de forces entre elles s'était modifié sous plusieurs aspects.
D'un côté, à partir de la contre-révolution stalinienne s'initia une nouvelle politique impérialiste russe. La « défense de la patrie socialiste » impliquait la création d'une zone d'influence autour d'elle, qui lui serve de protection rapprochée. Cela se traduisit en Chine par le soutien aux « bases rouges » formées à partir de 1928 à qui Staline prédisait un avenir radieux, mais aussi et surtout par la recherche d'une alliance avec le gouvernement du Kuomintang.
D'un autre côté, les États-Unis montraient toujours plus leur volonté de dominer exclusivement toutes les régions baignées par le Pacifique, remplaçant grâce à leur domination économique croissante les vieilles puissances telles que la France ou la Grande-Bretagne dans leurs anciens empires coloniaux. Pour y parvenir, il leur fallait qui plus est mettre un terme aux rêveries expansionnistes du Japon. Il était de toute façon évident depuis le début du siècle que le Pacifique serait trop étroit pour les États-Unis et le Japon. L'affrontement entre les deux puissances éclata réellement dix ans avant le bombardement de Pearl-Harbor, dans la guerre pour le contrôle de la Chine et du gouvernement du Kuomintang.
Ce fut en fin de compte le Japon qui dut prendre l'initiative du conflit impérialiste en Chine, car de toutes les puissances engagées dans ce pays elle était celle qui avait le plus besoin de marchés, de matières premières et de main d'oeuvre bon marché. Elle occupa la Mandchourie en septembre 1931, et dès janvier 1932 envahit les provinces du nord de la Chine, établissant une tête de pont à Shanghai après avoir bombardé « préventivement » les quartiers ouvriers de la ville. Le Japon parvint à s'allier avec quelques seigneurs de la guerre et commença à instaurer ce qui fut appelé les « régimes fantoches ». D'ailleurs, Tchang-Kai Shek n'offrit qu'un simulacre de résistance à l'invasion, étant lui-même déjà en tractations avec le Japon. C'est alors que les États-Unis et l'URSS réagirent, chacun de son côté, en faisant pression sur le gouvernement de Tchang-Kai Shek pour qu'il résiste effectivement à l'invasion japonaise. Les USA réagirent cependant avec plus de calme, car ils attendaient que le Japon s'enlise dans une longue et usante guerre en Chine, ce qui ne manqua pas d'arriver. Staline, quand à lui, ordonna en 1932 aux « bases rouges » qu'elles déclarent la guerre au Japon, tout en établissant simultanément des relations diplomatiques avec le régime de Tchang-Kai Shek alors que celui-ci livrait de furieuses attaques contre les « bases rouges ». En 1933, Mao Tsé-Toung et Fang Chi Ming proposèrent une alliance avec quelques généraux du Kuomintang qui s'étaient rebellés contre Tchang-Kai Shek à cause de sa politique de collaboration avec le Japon, mais les étudiants « retournés » rejetèrent cette alliance... pour ne pas affaiblir les liens qui se tissaient entre l'URSS et le régime de Tchang-Kai Shek. Cet épisode montre bien que le PCC s'était bien engagé dans le jeu des querelles et des alliances inter-bourgeoises, bien que Staline à ce moment-là n'ait considéré « l'Armée rouge » que comme un « élément de pression » et ait préféré s'appuyer sur une alliance durable avec Tchang-Kai Shek.
La « Longue marche »...vers la guerre impérialiste
C'est dans ce cadre de tensions impérialistes croissantes que pendant l'été 1934, les détachements de « l'Armée rouge » qui se cantonnaient dans les « bases de guérilla » du sud et du centre du pays commencèrent à se déplacer vers le nord-ouest, vers les régions agrestes plus éloignées du contrôle du Kuomintang, et à se concentrer dans la région de Chan-Si. Cet épisode, connu sous le nom de « la Longue marche » est selon l'histoire officielle l'acte le plus significatif et épique de la « révolution populaire chinoise ». Les livres d'histoire regorgent d'actes d'héroïsme, narrant l'odyssée de ces régiments à travers marécages, torrents et montagnes... L'analyse des événements met cependant rapidement à découvert les sordides intérêts bourgeois qui étaient en jeu dans cet épisode.
L'objectif fondamental de la Grande marche était avant tout l'embrigadement des paysans dans la guerre impérialiste qui mijotait entre le Japon, la Chine, la Russie et les Etats-Unis. De fait, Po Ku (stalinien membre du groupe des « étudiants retournés ») avait déjà posé la question de l'éventualité de la mobilisation de régiments de « l'Armée rouge » pour lutter contre les japonais. Les livres d'histoire soulignent que la sortie de la région sudiste de Chan-Si de la « zone soviétique » fut le résultat de l'insupportable siège mis en place par le Kuomintang, mais ils restent ambigus au moment d'expliquer que les forces de « l'Armée rouge » furent expulsées principalement à cause du changement de tactique ordonné par les staliniens, passant de la forme de la guérilla, qui avait permis à « l'Armée rouge » de résister pendant des années, à la forme des combats frontaux contre le Kuomintang. Ces affrontements provoquèrent la rupture de la frontière « de sécurité » protégeant la zone des guérillas et l'urgence de la nécessité de l'abandonner, mais ce ne fut en rien « l'erreur grave » des « étudiants retournés » (comme plus tard Mao en fit l'accusation, malgré qu'il ait lui-même participé à cette stratégie) : bien au contraire, ce fut un succès pour les objectifs des staliniens, qui voulaient obliger les paysans armés à abandonner les terres qu'ils avaient jusque là défendues avec tant d'acharnement, pour marcher vers le nord et se concentrer en une seule armée régulière prête pour la guerre qui s'annonçait.
Les livres d'histoire tentent aussi de donner à la Longue marche un caractère classiste, une espèce de mouvement social ou de lutte de classe. « L'Armée rouge » aurait sur son passage « semé le grain de la révolution », par la propagande et même en distribuant la terre aux paysans. Ces actions n'avaient comme but que d'utiliser ces paysans pour protéger les arrières du gros des troupes de « l'Armée rouge ». Dès le début de la Longue marche, la population civile habitant les « bases rouges » fut utilisée pour couvrir la retraite de l'Armée. Cette tactique, saluée pour son ingéniosité par les historiens, qui consiste à laisser les populations civiles servir de cible pour protéger les manoeuvres de l'armée régulière, est propre des armées des classes exploiteuses, et il n'y a rien d'héroïque à laisser assassiner femmes, vieillards et enfants pour protéger des soldants entraînés.
La Longue marche ne fut pas une voie de la lutte de classe ; bien au contraire, elle fut la voie vers des accords et des alliances avec ceux qui étaient jusque là catalogués comme « réactionnaires féodaux et capitalistes », et qui comme par magie devenaient de « bons patriotes ». Le 1er août 1935, alors que les régiments de la Longue marche étaient en garnison à Sechouan, le PCC lança un appel à l'unité nationale de toutes les classes pour expulser le Japon hors de Chine. En d'autres termes, le PCC appelait tous les travailleurs à abandonner la lutte de classe pour s'unir avec leurs exploiteurs et servir de chair à canon dans la guerre que livraient ces derniers. Cet appel était une application anticipée des résolutions du septième et dernier congrès de l'Internationale communiste qui se tenait à la même époque et qui lança le fameux mot d'ordre « du Front populaire antifasciste », grâce auquel les partis communistes stalinisés purent collaborer avec leurs bourgeoisies nationales et devenir le meilleur instrument pour envoyer les travailleurs se faire étriper dans la deuxième boucherie impérialiste mondiale qui s'annonçait.
La Grande marche atteint officiellement son apogée en octobre 1935, lorsque le détachement de Mao arriva à Ye-Nan (province de Shan-Si dans le nord-ouest du pays). Des années plus tard, le maoïsme fit de la Longue marche l'oeuvre glorieuse et exclusive de Mao Tsé-Toung. L'histoire officielle préfère passer sous silence que Mao n'avait fait que prendre la tête d'une « base rouge » qui existait déjà bien avant son arrivée et qu'il n'arriva en catastrophe à son terme qu'avec 7 000 des 90 000 hommes qui étaient partis avec lui de Kiangsi, car des milliers parmi eux étaient morts (plus souvent du fait des difficultés naturelles que victimes des attaques du Kuomintang) et d'autres milliers étaient restés à Sechuan, divisés par une scission entre cliques dirigeantes. Ce n'est qu'à la fin de 1936 que le gros de « l'Armée rouge » se concentra enfin réellement, quand arrivèrent les régiments en provenance de Junan et Sechuan.
L'alliance du PCC et du Kuomintang
En 1936, l'effort de recrutement de paysans du PCC fut étayé par des vagues de centaines d'étudiants nationalistes qui allèrent à la campagne après le mouvement anti-japonais des intellectuels bourgeois fin 1935 ([4] [2298]). Il ne faut bien sûr pas en déduire que les étudiants devenaient communistes, mais plutôt que le PCC était déjà devenu un organe reconnu par la bourgeoisie, ayant le même intérêt de classe.
Cependant, le bourgeoisie chinoise n'était pas unanime dans son opposition au Japon. Elle était divisée en fonction des penchants respectifs de chacune de ses fractions envers les grandes puissances. On peut le vérifier en examinant le cas du généralissime Tchang-Kai Shek lequel, comme nous l'avons vu, ne se décidait pas à entreprendre une campagne frontale contre le Japon et attendait que le combat entre les grandes puissances indique clairement de quel côté pencher. Les généraux du Kuomintang et les Seigneurs de la guerre régionaux étaient aussi divisés de façon identique.
C'est dans cette ambiance qu'eut lieu le fameux « incident de Sian ». En décembre 1936, Chang-Hsueh-Liang (un général antijaponais du Kuomintang) et Yang-Hu-Cheng, Seigneur de guerre de Sian, qui entretenaient de bons rapports avec le PCC, mirent Tchang-Kai Shek en état d'arrestation et allaient le juger pour haute trahison. Staline ordonna cependant immédiatement et sans discussion au PCC non seulement qu'il libère Tchang-Kai Shek, mais en outre qu'il enrôle ses armées dans le Front populaire. Dans les jours suivants eurent lieu des négociations entre le PCC, représenté par Chou-En-Lai, Yeh-Chien-Ying (autant dire Staline), les Etats-Unis représentés par Tu-Song, le plus puissant et corrompu monopoliste de Chine, parent de Tchang, et Tchang-Kai Shek lui-même qui fut finalement obligé de pencher du côté des Etats-Unis et de l'URSS (alliance provisoire contre le Japon) ; c'est à ce prix qu'il pu continuer à être le chef du gouvernement national et qu'il peut mettre sous son commandement le PCC et « l'Armée rouge » (qu'il rebaptisa Huitième régiment). Chou-en-Lai et d'autres « communistes » participèrent à ce gouvernement de Tchang tandis que l'URSS et les Etats-Unis prêtaient militairement main forte à Tchang-Kai Shek. Quand à Chang-Hsueh-Liang et Yang-Hu-Cheng, ils furent livrés à la vengeance de Tchang-Kai Shek qui emprisonna le premier et assassina le second.
C'est ainsi que fut signée la nouvelle alliance entre le PCC et le Kuomintang. Ce n'est que grâce aux contorsions idéologiques les plus grotesques et la propagande la plus abjecte que le PCC pu justifier auprès des travailleurs son traité avec Tchang-Kai Shek, ce boucher qui avait écrasé la révolution prolétarienne et assassiné des dizaines de milliers d'ouvriers et de militants communistes en 1927.
Il est certain que les hostilités entre les forces armées du Kuomintang dirigées par Tchang et « l'Armée rouge » reprirent en 1938. C'est ce qui permet aux historiens officiels d'agiter l'idée de la possibilité que le pacte avec le Kuomintang n'eût été qu'une tactique du PCC au sein de la « révolution ». Mais l'importance historique réelle de ce pacte n'est pas tant dans le succès ou l'échec du pacte entre le PCC et le Kuomintang que dans la mise en évidence historique de l'absence d'antagonisme de classe entre ces deux forces ; dans la mise en évidence historique que le PCC n'avait plus rien à voir avec le parti prolétarien des années 20 qui s'était affronté au capital et qu'il était devenu un instrument aux mains de la bourgeoisie, le champion des embrigadeurs de paysans pour la boucherie impérialiste.
Bilan : une lueur dans la nuit de la contre-révolution
En juillet 1937, le Japon entreprit l'invasion à grande échelle de la Chine et ce fut le début de la guerre sino-japonaise. Seule une poignée de groupes révolutionnaires qui survécurent à la contre-révolution, ceux de la Gauche communiste, tels le Groupe communiste internationaliste de Hollande ou le groupe de la Gauche communiste italienne qui publiait en France la revue Bilan, furent capables d'anticiper et de dénoncer que ce qui se jouait en Chine n'était ni une « libération nationale », ni encore moins la « révolution », mais la prédominance d'une des grandes puissances impérialistes ayant des intérêts dans la région : le Japon, les Etats-Unis ou l'URSS. Que la guerre sino-japonaise, au même titre que la guerre espagnole et les autres conflits régionaux, était le prélude assourdissant de la deuxième boucherie impérialiste mondiale. Au contraire, l'Opposition de gauche de Trotsky, qui lors de sa constitution en 1928 était également parvenue à dénoncer la politique criminelle de Staline de collaboration avec le Kuomintang comme une des causes de la défaite de la révolution prolétarienne en Chine, cette Opposition de gauche, prisonnière d'une analyse erronée du cours historique qui lui faisait voir dans chaque nouveau conflit impérialiste régional une nouvelle possibilité révolutionnaire, et prisonnière en général d'un opportunisme croissant, considérait la guerre sino-japonaise comme « progressiste », comme un pas en avant vers la « troisième révolution chinoise ». Fin 1937, Trotsky affirmait sans honte que « s'il y a une guerre juste, c'est la guerre du peuple chinois contre ses conquérants... toutes les organisations ouvrières, toutes les forces progressives de la Chine, sans rien céder de leur programme et de leur indépendance politique, feront jusqu'au bout leur devoir dans cette guerre de libération, indépendamment de leur attitude vis-à-vis du gouvernement Tchang-Kai Shek. » ([5] [2299]) Avec cette politique opportuniste de défense de la patrie « indépendamment de leur attitude face au gouvernement », Trotsky ouvrait complètement les portes à l'enrôlement des ouvriers dans les guerres impérialistes derrière leurs gouvernements, et à la transformation, à partir de la deuxième guerre mondiale, des groupes trotskistes en sergents-recruteurs de chair à canon pour le capital. La Gauche communiste italienne, au contraire, dans son analyse de la Chine, a été capable de maintenir fermement la position internationaliste de la classe ouvrière. La position sur la Chine constitua un des points cruciaux de la rupture de ses relations avec l'Opposition de gauche de Trotsky. Ce qui se dessinait était une frontière de classe. Pour Bilan, « Les positions communistes en face des événements de Chine, d'Espagne et de la situation internationale actuelle ne peuvent être fixées que sur la base de l'élimination rigoureuse de toutes les forces agissant au sein du prolétariat et qui disent au prolétariat de participer au massacre de la guerre impérialiste. » ([6] [2300]) « (...) Tout le problème consiste à déterminer quelle classe mène la guerre et à établir une politique correspondante. Dans le cas qui nous occupe, il est impossible de nier que c'est la bourgeoisie chinoise qui mène la guerre, et qu'elle soit agresseur ou agressée, le devoir du prolétariat est de lutter pour le défaitisme révolutionnaire tout autant qu’au Japon. » ([7] [2301]) Dans le même sens, la Fraction belge de la Gauche communiste internationale (liée à Bilan) écrivait : « Aux côtés de Tchang-Kai Chek, bourreau de Canton, le stalinisme participe à l'assassinat des ouvriers et des paysans chinois sous la bannière de la 'guerre d'indépendance'. Et seule leur rupture totale avec le Front national, leur fraternisation avec les ouvriers et les paysans japonais, leur guerre civile contre le Kuomintang et tous ses alliés, sous la direction d'un Parti de classe, peut les sauver du désastre. » ([8] [2302]) La voix ferme des groupes de la gauche communiste ne fut pas écoutée par une classe ouvrière défaite et démoralisée, qui se laissa entraîner à la boucherie mondiale. Cependant, la méthode d'analyse et les positions de ces groupes représentèrent la permanence et l'approfondissement du marxisme et constituèrent le pont entre la vieille génération révolutionnaire qui avait vécu la vague insurrectionnelle du prolétariat au début du siècle et la nouvelle génération révolutionnaire qui surgit avec la fin de la contre-révolution à la fin des années 1960.
1937-1949 : avec l'URSS ou les Etats-Unis ?
Comme nous le savons, la seconde guerre mondiale se termina par la défaite du Japon, et des puissances de l'Axe en 1945, et cette défaite impliqua l'abandon total de la Chine par ces puissances. Mais la fin de la guerre mondiale ne marqua pas la fin des affrontements impérialistes. Immédiatement s'établit la rivalité entre les deux grandes puissances, USA et URSS, qui maintiendront le monde pendant plus de quarante ans au bord de la troisième -et dernière- guerre mondiale. Et alors même que se retirait l'armée japonaise, la Chine devenait déjà un terrain d'affrontement entre ces deux puissances.
Il n'est pas fondamental de relater les vicissitudes de la guerre sino-japonaise dans cet article, dont le but est de démystifier la soi-disant « révolution populaire chinoise ». Il est cependant intéressant d'en souligner deux aspects en lien avec la politique menée par le PCC entre 1937 et 1945.
Le premier concerne l'explication de l'extension rapide des zones occupées par « l'Armée rouge » entre 1936 et 1945. Comme nous l'avons dit, Tchang-Kai Shek n'était pas partisan d'opposer frontalement ses armées aux japonais, et il tendait à reculer et se retirer à chacune des avancées de ceux-ci. L'armée japonaise quand à elle avançait rapidement en territoire chinois, mais n'avait pas la capacité d'établir une administration propre dans les zones occupées : elle dut très rapidement se limiter à occuper les voies de communication et les villes importantes. Cette situation provoqua deux phénomènes : le premier, c'est que les Seigneurs de la guerre régionaux se retrouvaient isolés du gouvernement central, ce qui les conduisait soit à collaborer avec les japonais dans les fameux « gouvernements fantoches », soit à collaborer avec « l'Armée rouge » pour résister à l'invasion ; le second, c'est que le PCC sut profiter habilement du vide politique créé par l'invasion japonaise dans le nord-ouest de la Chine et mettre en place sa propre administration.
Connue sous le nom de « Nouvelle démocratie », cette administration a été saluée par les historiens comme un « régime démocratique » d'un « type nouveau ». La « nouveauté » n'était pas feinte, car pour la première fois dans l'histoire un parti « communiste » mettait en place un gouvernement de collaboration de classe ([9] [2303]), s'efforçait de préserver les rapports d'exploitation et protégeait jalousement les intérêts de la classe capitaliste et des grands propriétaires. Le PCC avait compris qu'il n'était pas indispensable de réquisitionner les terres et de les donner aux paysans pour obtenir leur soutien : inondés par les exactions de toute sorte, il suffisait d'une petite diminution des impôts (si petite que les grands propriétaires et les capitalistes y étaient favorables) pour que les paysans soient favorables à l'administration du PCC et s'engagent dans « l'Armée rouge ». Parallèlement à ce « nouveau régime », le PCC installa aussi un gouvernement de collaboration de classe (entre bourgeoisie, grands propriétaires et paysans) connu sous le nom des « Trois tiers », dont un tiers des postes était occupé par les « communistes », un tiers par des membres d'organisations paysannes et le troisième par les grands propriétaires et capitalistes. Une fois de plus, les contorsions idéologiques les plus saugrenues des théoriciens style Mao Tsé-Toung furent nécessaires au PCC pour « expliquer » aux travailleurs ce « nouveau type » de gouvernement.
Le second aspect de la politique du PCC qu'il faut souligner est moins connu, car pour des raisons idéologiques évidentes, les historiens tant maoïstes que pro-américains préfèrent l'occulter bien qu'ils soient parfaitement documentés. L'implication de l'URSS dans la guerre en Europe qui l'empêcha de prêter une « aide » efficace au PCC pendant des années, les nouvelles oscillations entre le Japon et les Etats-Unis du gouvernement de Tchang-Kai Shek à partir de 1938 dans l'attente de l'issue du conflit mondial ([10] [2304]) et l'engagement dans la guerre du Pacifique des américains à partir de 1941, tous ces événements pesèrent fortement pour faire basculer le PCC du côté des Etats-Unis.
A partir de 1944, une mission d'observation du gouvernement des Etats-Unis s'établit dans la base rouge du Yenan, avec comme mission de sonder les possibilités de collaboration entre les Etats-Unis et le PCC. Pour les dirigeants de ce parti, et en particulier pour la clique de Mao Tsé-Toung et Chu-Teh, il était clair que les Etats-Unis seraient les grands vainqueurs de la guerre et ils envisageaient de se mettre sous leur tutelle. La correspondance de John Service ([11] [2305]), un des responsables de cette mission, signale avec insistance au sujet des leaders du PCC, que :
- le PCC considère comme hautement improbable l'instauration d'un régime soviétique en Chine et qu'il recherche davantage l'instauration d'un régime « démocratique » du type occidental, qu'il est même disposé à participer à un gouvernement de coalition avec Tchang-Kai Shek pourvu d'éviter la guerre civile à la fin de la guerre contre le Japon ;
- le PCC pense qu'une période très longue de plusieurs dizaines d'années sera nécessaire au développement du capitalisme en Chine, condition pour que puisse être envisagée l'instauration du socialisme. Et si ce jour lointain venait à exister, ce socialisme s'installerait de façon progressive et non à travers des expropriations violentes. Que, donc, en installant un gouvernement national, le PCC était disposé à mener à son terme une politique de « portes ouvertes » aux capitaux étrangers et principalement aux capitaux américains ;
- le PCC, prenant en compte aussi bien la faiblesse de l'URSS que la corruption de Tchang-Kai Shek et son attirance vers le Japon, désirait l'aide politique, financière et militaire des Etats-Unis. Qu'il était même disposé à changer de nom (comme il l'avait déjà fait avec « l'Armée rouge ») afin de pouvoir bénéficier de cette aide.
Les membres de la mission américaine insistèrent auprès de leur gouvernement sur le fait que le futur était du côté du PCC. Les Etats-Unis cependant ne se décidèrent jamais à utiliser des « communistes » et finalement, un an plus tard, quand le Japon se retira en 1945 et que la Russie envahit rapidement le nord de la Chine, il ne resta pas d'autre issue au PCC et à Mao Tsé-Toung que de s'aligner, momentanément, sur l'URSS.
***
Entre 1946 et 1949, l'affrontement entre les deux superpuissances provoqua directement l'affrontement entre le PCC et le Kuomintang. Au cours de cette guerre, beaucoup de généraux du Kuomintang passèrent avec armes et bagages du côté des « forces populaires ». On peut dès lors compter quatre périodes au cours desquelles la bourgeoisie et la petite-bourgeoisie renforcèrent le PCC. Celle qui vint parachever la défaite de la classe ouvrière fin 1928, celle qui trouva ses origines dans le mouvement étudiant en 1935, celle de la période de guerre contre le Japon et, finalement, celle qui fut provoquée par l'effondrement du Kuomintang. Les « vieux bourgeois » (exception faite des grands monopolistes directement alliés à Tchang-Kai Shek comme les Soong) se retrouvèrent au PCC et se mêlèrent aux « nouveaux » bourgeois issus de la guerre.
En 1949, le Parti communiste de Chine, à la tête de la soi-disant « Armée rouge », prit le pouvoir et proclama la République populaire. Mais cela n'eut absolument rien à voir avec le communisme. La nature de classe du parti « communiste » qui prit le pouvoir en Chine était totalement étrangère au communisme, était totalement antagonique au prolétariat. Le régime qui s'instaura alors ne fut jamais qu'une variante du capitalisme d'État. Le contrôle de l'URSS sur la Chine ne dura qu'une dizaine d'années et s'acheva avec la rupture des relations entre les deux pays. A partir de 1960, la Chine tenta de « se rendre indépendante » des grandes puissances et prétendit se hisser elle-même à leur niveau en tentant de créer un « troisième bloc » mais dès 1970 elle dû se décider à virer définitivement vers le bloc occidental dominé par les Etats-Unis. Beaucoup d'historiens, russes en tête, accusèrent alors Mao de trahison. Les communistes savent très bien que le tournant de Mao vers les Etats-Unis ne fut en aucune façon une trahison de Mao, mais au contraire l'aboutissement de son rêve.
Ldo.
(La troisième et dernière partie de cet article sera consacrée à l'ascension du maoïsme)
Géographique:
- Chine [1980]
Personnages:
- Mao Zedong [2317]
Evènements historiques:
- Taïpings [2318]
Courants politiques:
- Maoïsme [1983]
Questions théoriques:
- Impérialisme [321]
Questions d'organisation, I : la première internationale et la lutte contre le sectarisme
- 3819 reads
Avec la lutte du bolchevisme contre le menchevisme au début de ce siècle, la confrontation entre le marxisme et l'anarchisme dans la Première Internationale, l'Association internationale des travailleurs (AIT), constitue probablement l'exemple le plus illustre de la défense des principes organisationnels prolétariens dans l'histoire du mouvement ouvrier. Il est essentiel pour les révolutionnaires d'aujourd'hui qu'un demi-siècle de contre-révolution stalinienne sépare de l'histoire organisationnelle vivante de leur classe, de se réapproprier les leçons de cette expérience. Ce premier article se concentrera sur la « préhistoire » de cette bataille afin de mettre en évidence comment Bakounine est arrivé à la conception de prendre le contrôle du mouvement ouvrier au moyen d'une organisation secrète sous son contrôle personnel. Nous montrerons comment cette conception a inévitablement amené à ce que Bakounine soit manipulé par la classe dominante dans le but de détruire l'AIT. Et nous montrerons les racines fondamentalement anti-prolétariennes des conceptions de Bakounine, précisément sur le plan organisationnel. Le second article traitera ensuite de la lutte qui a eu lieu dans l'AIT elle-même, et montrera l'opposition radicale, sur la conception du fonctionnement et du militantisme, qui existe entre le point de vue marxiste prolétarien et le point de vue anarchiste petit-bourgeois et déclassé.
LA SIGNIFICATION HISTORIQUE DE LA LUTTE DU MARXISME CONTRE L'ANARCHISME ORGANISATIONNEL
L'AIT s'est éteinte avant tout à cause de la lutte entre Marx et Bakounine, lutte qui, au Congrès de La Haye en 1872, a trouvé sa première conclusion avec l'exclusion de Bakounine et de son bras droit, J. Guillaume. Mais ce que les historiens bourgeois présentent comme un clash entre personnalités, et les anarchistes comme une lutte entre les versions « autoritaire » et « libertaire » du socialisme, était en réalité une lutte de l'ensemble de l'AIT contre ceux qui avaient bafoué les statuts. Bakounine et Guillaume furent exclus à La Haye parce qu'ils avaient construit un « fraternité » secrète au sein de l'AIT, une organisation dans l'organisation ayant une structure et des statuts propres. Cette organisation, la soi-disant « Alliance pour la démocratie socialiste », avait une existence et une activité cachées et son but était de retirer l'AIT du contrôle de ses membres et de la placer sous celui de Bakounine.
UNE LUTTE A MORT ENTRE POSITIONS ORGANISATIONNELLES
La lutte qui a eu lieu dans l'AIT, n'était donc pas une lutte entre l'« autorité » et la « liberté », mais bien entre des principes organisationnels complètement opposés et irréconciliables.
1) D'un côté, il y avait la position, défendue de façon la plus déterminée par Marx et Engels mais qui était aussi celle de l'ensemble du Conseil général et de la vaste majorité de ses membres, selon laquelle une organisation prolétarienne ne peut pas dépendre de la volonté des individus, des caprices de « camarades dirigeants », mais doit fonctionner selon des règles obligatoires sur lesquelles tous sont d'accord et qui sont valables pour tous, appelées statuts. Les statuts doivent garantir le caractère unitaire, centralisé, collectif d'une telle organisation, permettre que les débats politiques prennent une forme ouverte et disciplinée, et que les décisions prises impliquent tous ses membres. Quiconque est en désaccord avec les décisions de l'organisation ou n'est plus d'accord avec des points des statuts, etc. a non seulement la possibilité mais aussi le devoir de présenter ses critiques ouvertement face à l'ensemble de l'organisation, mais dans le cadre prévu dans ce but. Cette conception organisationnelle que l'Association internationale des travailleurs a développé pour elle-même, correspondait au caractère collectif, unitaire et révolutionnaire du prolétariat.
2) De l'autre côté, Bakounine représentait la vision élitiste petite-bourgeoise des « chefs géniaux » dont la clarté politique et la détermination extraordinaires étaient supposées garantir la « passion » et la trajectoire révolutionnaires. Ces chefs se considèrent donc comme « moralement justifiés » dans la tâche de rassembler et d'organiser leurs disciples dans le dos de l'organisation afin de prendre le contrôle de celle-ci et d'assurer qu'elle accomplisse sa mission historique. Puisque l'ensemble des membres sont considérés comme trop stupides pour saisir la nécessité de tels messies révolutionnaires, ils doivent être amenés à faire ce qu'on considère être « bon pour eux » sans qu'ils en soient conscients et même contre leur volonté. Les statuts, les décisions souveraines des congrès ou des organes élus existent pour les autres, mais ne vont que dans le sens de l'élite.
Tel était le point de vue de Bakounine. Avant de rejoindre l'AIT, il a expliqué à ses disciples pourquoi l'AIT n'était pas une organisation révolutionnaire: les proudhoniens étaient devenus réformistes, les blanquistes avaient vieilli, et les allemands et le Conseil général que soi-disant ceux-ci dominaient, étaient « autoritaires ». Il est frappant de voir comment Bakounine considérait l'AIT comme la somme de ses parties. Selon Bakounine, ce qui manquait avant tout, c'était la « volonté » révolutionnaire. C'est ça que l'Alliance voulait assurer en passant par dessus le programme et les statuts et en trompant ses membres.
Pour Bakounine, l'organisation que le prolétariat avait forgée, qu'il avait construite au cours d'années de travail acharné, ne valait rien. Ce qui était tout pour lui, c'étaient les sectes conspiratrices qu'il avait lui-même créées et contrôlées. Ce n'est pas l'organisation de classe qui l'intéressait, mais son propre statut personnel et sa réputation, sa « liberté » anarchiste ou ce qu'on appelle aujourd'hui « réalisation de soi ». Pour Bakounine et ses semblables, le mouvement ouvrier n'était rien d'autre que le véhicule de la réalisation de leur individu et de leurs projets individualistes.
SANS ORGANISATION REVOLUTIONNAIRE,PAS DE MOUVEMENT OUVRIER REVOLUTIONNAIRE.
Marx et Engels, au contraire, savaient ce que veut dire la construction de l'organisation pour le prolétariat. Alors que les livres d'histoire prétendent que le conflit entre Marx et Bakounine était essentiellement de nature politique générale, l'histoire réelle de l'AIT révèle, avant tout, une lutte pour l'organisation. Quelque chose qui semble particulièrement ennuyeux pour les historiens bourgeois. Pour nous, au contraire, c'est quelque chose d'extrêmement important et riche de leçons. Ce que nous montre Marx, c'est que sans organisation révolutionnaire, il ne peut y avoir ni mouvement de classe révolutionnaire, ni théorie révolutionnaire.
Et, en fait, l'idée que la solidité, le développement et la croissance organisationnels sont des pré-requis pour le développement programmatique du mouvement ouvrier, se trouve à la base même de l'ensemble de l'activité politique de Marx et d'Engels ([1] [2319]). Les fondateurs du socialisme scientifique ne savaient que trop bien que la conscience de classe prolétarienne ne peut être le produit d'individus, mais requiert un cadre organisé et collectif. C'est pourquoi la construction de l'organisation révolutionnaire est l'une des plus importantes et des plus difficiles tâches du prolétariat révolutionnaire.
LA LUTTE A PROPOS DES STATUTS
Nulle part Marx et Engels n'ont lutté avec autant de détermination et de façon aussi fructueuse pour la compréhension de cette question que dans les rangs de l'AIT. Fondée en 1864, l'AIT a surgi à une époque où le mouvement ouvrier organisé était encore principalement dominé par des idéologies et des sectes petites-bourgeoises et réformistes. A ses débuts, l'Association internationale des travailleurs se composait de ces différentes tendances. En son sein jouaient un rôle prépondérant les représentants opportunistes des trade-unions anglais, le proudhonisme réformiste petit-bourgeois des pays latins, le blanquisme conspiratif et, en Allemagne, la secte dominée par Lassalle. Bien que les différents programmes et les différentes visions du monde fussent opposées les unes aux autres, les révolutionnaires de l'époque étaient sous la pression énorme du regroupement de la classe ouvrière qui réclamait l'unité. Pendant la première réunion à Londres, quasiment personne n'avait la moindre idée de la façon dont ce regroupement pourrait avoir lieu. Dans cette situation, les éléments véritablement prolétariens avec Marx à leur tête, ont plaidé pour repousser temporairement la clarification théorique entre les différents groupes. Les longues années d'expérience politique des révolutionnaires et la vague internationale de luttes de l'ensemble de la classe devaient être utilisées pour forger l'organisation unitaire. L'unité internationale de cette organisation, incarnée par les organes centraux, le Conseil général en particulier, et par les statuts qui devaient être acceptés par tous les membres, permettrait à l'AIT de clarifier, pas à pas, les divergences politiques et d'atteindre un point de vue unifié. Ce regroupement à grande échelle avait des chances de réussir tant que la lutte de classe internationale était encore en développement.
La contribution la plus décisive du marxisme à la fondation de l'AIT réside donc clairement au niveau de la question organisationnelle. Les différentes sectes présentes à la réunion de fondation n'ont pas été capables de concrétiser la volonté de liens internationaux que les ouvriers anglais et français, les premiers, réclamaient. Le groupe bourgeois Atto di fratellanza, adepte de Mazzini, voulait imposer les statuts conspiratifs d'une secte secrète. L'« Adresse inaugurale » que Marx, mandaté par la comité organisationnel, a présenté alors, défendait le caractère prolétarien et unitaire de l'organisation, et établissait la base indispensable pour un travail de clarification ultérieur. Si l'AIT a pu aller plus loin ensuite et dépasser les visions conspiratrices, sectaires, petites-bourgeoises et utopistes, c'est qu'en premier lieu, ses différents courants, de façon plus ou moins disciplinée, se sont soumis à des règles communes.
La spécificité des bakouninistes, parmi ces différents courants, a résidé dans leur refus de respecter les statuts C'est pourquoi c'est l'Alliance de Bakounine qui faillit détruire le premier parti international du prolétariat. La lutte contre l'Alliance est restée dans l'histoire comme la grande confrontation entre l'anarchisme et le marxisme. C'est certainement le cas. Mais au coeur de cette confrontation ne résidaient pas des questions politiques générales telles que le rapport à l'Etat, mais des principes organisationnels.
Les proudhoniens par exemple partageaient beaucoup de vues de Bakounine. Mais ils étaient pour la clarification de leurs positions selon les règles de l'organisation. Ils croyaient aussi que les statuts de l'organisation devaient être respectés par tous ses membres sans exception. C'est pourquoi les « collectivistes » belges en particulier ont été capables de s'approcher du marxisme sur d'importantes questions. Leur porte-parole le plus connu, De Paepe, était l'un des principaux combattants contre la sorte d'organisation secrète que Bakounine croyait nécessaire.
LA FRATERNITE SECRETE DE BAKOUNINE
Et cette question se trouvait précisément au centre de la lutte de l'AIT contre Bakounine. Les historiens anarchistes aussi admettent le fait que lorsqu'il a rejoint l'AIT en 1869, Bakounine disposait d'une fraternité secrète avec laquelle il voulait prendre le contrôle de l'AIT.
« Voilà une société qui, sous le masque de l'anarchisme le plus outré, dirige ses coups non contre les gouvernements existants, mais contre les révolutionnaires qui n'acceptent pas son orthodoxie ni sa direction. Fondée par la minorité d'un congrès bourgeois, elle se faufile dans les rangs de l'organisation internationale de la classe ouvrière, essaie d'abord de la régir et travaille à la désorganiser dès qu'elle voit son plan échouer. Elle substitue effrontément son programme sectaire et ses idées étroites au large programme, aux grandes aspirations de notre Association ; elle organise dans les sections publiques de l'Internationale, ses petites sections secrètes qui, obéissant au même mot d'ordre, en bien des cas réussissent à les dominer par leur action concertée d'avance ; elle attaque publiquement, dans ses journaux, tous les éléments qui refusent de s'assujettir à ses volontés ; elle provoque la guerre ouverte - ce sont ses propres mots - dans nos rangs ». Tels sont les termes du rapport « Un complot contre l'Internationale », documents publiés par ordre du Congrès international de La Haye de 1872.
La lutte de Bakounine et de ses amis contre l'Internationale était à la fois le produit de la situation historique spécifique de l'époque, et de facteurs plus généraux qui existent toujours aujourd'hui. A la base de ses activités, se trouve l'infiltration de l'individualisme et du factionnalisme petits-bourgeois, incapables de se soumettre à la volonté et à la discipline de l'organisation. A cela, s'ajoutait l'attitude conspiratrice de la bohème déclassée qui ne pouvait se passer de manoeuvres et de complots en faveur de ses propres buts personnels. Le mouvement ouvrier a toujours été confronté à de telles attitudes puisque l'organisation ne peut se mettre complètement à l'abri de l'influence des autres classes de la société. D'un autre côté, le complot de Bakounine a pris la forme historique concrète d'une organisation secrète d'un type qui appartenait au passé du mouvement ouvrier de l'époque. Nous devrons étudier l'histoire concrète de Bakounine pour être capables de comprendre ce qui est valable de façon plus générale, ce qui est important pour nous de saisir aujourd'hui.
LE BAKOUNINISME S'OPPOSE A LA RUPTURE DU PROLETARIAT AVEC LE SECTARISME PETIT-BOURGEOIS
La fondation de l'AIT, marquant la fin de la période de contre-révolution ouverte en 1849, a provoqué des réactions de peur et de haine extrêmement fortes (selon Marx, même exagérées) chez les classes dominantes: parmi les vestiges de l'aristocratie féodale et, surtout, de la part de la bourgeoisie en tant qu'ennemi historique direct du prolétariat. Espions et agents provocateurs furent envoyés pour infiltrer ses rangs. Des campagnes de calomnies coordonnées, souvent hystériques ont été montées contre elle. Ses activités ont été, chaque fois que possible, entravées et réprimées par la police. Ses membres étaient soumis à des procès et jetés en prison. Mais l'inefficacité de ces mesures est rapidement apparue tant que la lutte de classe et les mouvements révolutionnaires se développaient. Ce n'est qu'avec la défaite de la Commune de Paris que le désarroi dans les rangs de l'Association a commencé à prendre le dessus.
Ce qui alarmait le plus la bourgeoisie, à part l'unification internationale de son ennemi, c'était la montée du marxisme et le fait que le mouvement ouvrier abandonnait sa forme sectaire d'organisation clandestine et devenait un mouvement de masse. La bourgeoisie se sentait bien plus en sécurité tant que le mouvement ouvrier révolutionnaire prenait la forme de groupements sectaires, secrets et fermés, autour d'une figure dirigeante unique, représentant un schéma utopique ou un complot, plus ou moins complètement isolés du prolétariat dans son ensemble. De telles sectes pouvaient être surveillées, infiltrées, dévoyées et manipulées bien plus facilement qu'une organisation de masse dont la force et la sécurité principale résident dans son ancrage dans l'ensemble de la classe ouvrière. Pour la bourgeoisie, c'était avant tout la perspective de l'activité socialiste révolutionnaire envers le prolétariat comme classe, chose que les sectes de la période précédente ne pouvaient assumer, qui présentait un danger pour sa domination même de classe. Le lien entre le socialisme et la lutte de classe, entre le Manifeste communiste et les vastes mouvements de grève, entre les aspects économiques et politiques de la lutte de classe du prolétariat, c'est cela qui a causé à la bourgeoisie tant de nuits blanches à partir de 1864. C'est ce qui explique la sauvagerie incroyable avec laquelle elle a massacré la Commune de Paris, et la force de la solidarité internationale de toutes les fractions des classes exploiteuses avec ce massacre.
Aussi, l'un des thèmes principaux de la propagande bourgeoise contre l'AIT était l'accusation qu'en réalité, une puissante organisation secrète se trouvait derrière elle et qu'elle conspirait pour abattre l'ordre dominant. Derrière cette propagande qui constituait une excuse de plus aux mesures de répression, il y avait avant tout la tentative de la bourgeoisie de convaincre les ouvriers que ce dont elle avait toujours le plus peur, c'étaient des conspirateurs et non des mouvements de masse. Il est clair que les exploiteurs ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour encourager les différentes sectes et les différents conspirateurs qui étaient encore actifs dans le mouvement ouvrier, à se développer au dépens du marxisme et du mouvement de masse. En Allemagne, Bismarck a encouragé la secte lassallienne à résister aux mouvements de masse de la classe et aux traditions marxistes de la Ligue des communistes. En France, la presse mais aussi les agents provocateurs ont tenté d'attiser la méfiance toujours existante des conspirateurs blanquistes à l'égard de l'activité de masse de l'AIT. Dans les pays slaves et latins, une campagne hystérique a été montée contre une soi-disant « domination allemande » de l'AIT par des « marxistes adorant l'Etat autoritaire ».
Mais c'est Bakounine, avant tout, qui s'est senti encouragé par cette propagande. Avant 1864, Bakounine avait, malgré lui, au moins partiellement reconnu la supériorité du marxisme sur sa propre version putschiste petite-bourgeoise du socialisme révolutionnaire. Depuis le surgissement de l'AIT et avec l'assaut politique de la bourgeoisie contre elle, Bakounine s'est senti confirmé et renforcé dans sa méfiance envers le marxisme et le mouvement prolétarien. En Italie qui était devenue le centre de son activité, les différentes sociétés secrètes: les carbonari, Mazzini, la Camorra etc. qui avaient commencé à dénoncer l'AIT et à combattre son influence dans la péninsule, acclamèrent Bakounine comme un « vrai » révolutionnaire. Il y a eu des déclarations publiques demandant que Bakounine prenne la direction de la révolution européenne. Le panslavisme de Bakounine était bienvenu comme allié naturel de l'Italie dans sa lutte contre l'occupation des forces autrichiennes. A l'encontre de ça, on rappelait que Marx considérait l'unification de l'Allemagne comme plus importante pour le développement de la révolution en Europe que l'unification de l'Italie. Les autorités italiennes comme les parties les plus éclairées des autorités suisses commencèrent à tolérer avec bienveillance la présence de Bakounine alors qu' auparavant, il avait été victime de la répression étatique européenne la plus brutale.
LES DEBATS ORGANISATIONNELS SUR LA QUESTION DE LA CONSPIRATION
Mikhaïl Bakounine, fils d'une gens plutôt pauvre, a d'abord rompu avec son milieu et sa classe à cause d'une grande soif de liberté personnelle, chose qu'on ne pouvait atteindre à l'époque ni dans l'armée, ni dans la bureaucratie d'Etat, ni dans la propriété terrienne. Cette motivation montre déjà la distance qui sépare sa carrière politique du caractère collectif et discipliné de la classe ouvrière. A l'époque, le prolétariat existait à peine en Russie.
Quand à l'époque, au début des années 1840, Bakounine arrive en Europe comme réfugié politique, avec déjà derrière lui l'histoire d'une conspiration politique, les débats dans le mouvement ouvrier sur les questions organisationnelles battent déjà leur plein. En France en particulier.
Le mouvement ouvrier révolutionnaire était alors principalement organisé sous forme de sociétés secrètes. Cette forme avait surgi non seulement parce que les organisations ouvrières étaient hors-la-loi, mais aussi parce que le prolétariat, encore numériquement faible et à peine sorti de l'artisanat petit-bourgeois, n'avait pas encore trouvé la voie qui lui était propre. Comme l'écrit Marx sur la situation en France:
« On sait que jusqu'en 1830, les bourgeois libéraux étaient à la tête des conjurations contre la Restauration. Après la révolution de Juillet, les bourgeois républicains prirent leur place; le prolétariat déjà formé à la conspiration sous la Restauration, apparut à l'avant-scène dans la mesure où les bourgeois républicains, effrayés par les combats de rue pourtant vains, reculaient devant les conspirations. La "Société des Saisons" avec laquelle Blanqui et Barbès firent les émeutes de 1830 était déjà exclusivement prolétarienne, tout comme l'étaient, après la défaite, les "Nouvelles Saisons" (...). Ces conspirations n'englobèrent jamais, naturellement, la grande masse du prolétariat parisien (...). » (Marx-Engels, La Nouvelle Gazette rhénane - Revue politique et économique, IV, avril 1850, compte rendu des ouvrages suivants : A. Chenu, Les Conspirateurs. Les sociétés secrètes, La préfecture de police sous Caussidière. Les corps francs, Paris, 1850 ; Lucien de la Hodde, La naissance de la République en février 1848.)
Mais les éléments prolétariens ne se sont pas limités à cette rupture décisive avec la bourgeoisie. Ils ont commencé à mettre en question dans la pratique la domination des conspirations et des conspirateurs.
« A mesure que le prolétariat parisien entre lui-même en scène en tant que parti, ces conspirateurs perdirent leur influence dirigeante, furent dispersés et trouvèrent une dangereuse concurrence dans les sociétés secrètes prolétariennes qui ne se proposaient pas comme but immédiat l'insurrection, mais l'organisation et la formation du prolétariat. Déjà l'insurrection de 1839 avait un caractère nettement prolétarien et communiste. Mais après elle, il y eut des scissions à propos desquelles les vieux conspirateurs se désolent vraiment. Or il s'agissait de scissions qui découlaient du besoin des ouvriers de s'entendre sur leurs intérêts de classe et qui se manifestaient en partie dans les vieilles conjurations et en partie dans les nouvelles sociétés de propagande. L'agitation communiste que Cabet entreprit avec force aussitôt après 1839, les polémiques qui s'élevèrent au sein même du parti communiste, débordèrent le cadre des conspirateurs. Chenu comme de la Hodde reconnaissent que les communistes étaient de loin la fraction la plus puissante du prolétariat révolutionnaire de l'époque de la révolution de février. Les conspirateurs, afin de ne pas perdre leur influence sur les ouvriers et, par là, leur contrepoids vis-à-vis des "habits noirs" (en français dans le texte), durent suivre ce mouvement et adopter des idées socialistes ou communistes. » (ibid.)
La conclusion intermédiaire de ce processus fut la Ligue des communistes qui non seulement a adopté le Manifeste communiste mais également les premiers statuts prolétariens d'un parti de classe libéré de toute conspiration :
« Par conséquent, la Ligue des communistes n'était pas une société conspiratrice, mais une société qui s'efforçait en secret de créer l'organisation du parti prolétarien, étant donné que le prolétariat allemand est officiellement privé igni et aqua, du droit d'écrire, de parler et de s'associer. Dire qu'une telle société conspire n'est vrai que dans la mesure où vapeur et électricité conspirent contre le statu quo. » (Marx, Révélations sur le procès des communistes à Cologne, 1853)
C'est également cette question qui a mené à la scission de la tendance Willich-Schapper.
« Ainsi, une fraction se détacha - ou, si l'on préfère, fut détachée - de la Ligue des communistes ; elle réclamait sinon des conspirations réelles, du moins l'apparence de la conspiration, partant l'alliance directe avec les démocratiques héros du jour - la fraction Willich-Schapper. »
Ce qui a insatisfait ces gens, est la même chose qui a éloigné Bakounine du mouvement ouvrier.
« Il est évident qu'une telle société secrète qui a pour but la création non pas du parti de gouvernement mais du parti d'opposition de l'avenir ne pouvait guère séduire des individus qui, d'une part, veulent masquer leur nullité personnelle en se rengorgeant sous le manteau théâtral des conspirations, et, d'autre part, désirent satisfaire leur ambition bornée le jour de la prochaine révolution, mais avant tout avoir un semblant d'importance momentanée, participer à la curée démagogique et être bien accueillis par les charlatans démocratiques. » (ibid.)
Après la défaite des révolutions européennes de 1848-49, la Ligue a démontré une dernière fois à quel point elle avait dépassé la nature de secte. Elle a tenté, à travers un regroupement avec les chartistes en Angleterre et les blanquistes en France, de fonder une nouvelle organisation internationale : la Société universelle des communistes révolutionnaires. Une telle organisation devait être régie par des statuts applicables à tous ses membres internationalement, abolissant la division entre une direction secrète et des membres considérés comme une masse de manoeuvre. Ce projet, tout comme la Ligue elle-même, s'est effondré à cause du recul international du prolétariat après la défaite de la révolution. C'est pourquoi ce n'est que plus de dix ans plus tard, avec l'apparition d'une nouvelle vague prolétarienne et la fondation de l'AIT, que le coup décisif contre le sectarisme a pu être porté.
LES PREMIERS PRINCIPES ORGANISATIONNELS PROLETARIENS
A l'époque où Bakounine est revenu de Sibérie en Europe occidentale au début des années 1860, les premières principales leçons de la lutte organisationnelle du prolétariat avaient déjà été tirées et étaient à la portée de quiconque voulait les assimiler. Ces leçons avaient été acquises à travers des années d'expérience amère durant lesquelles les ouvriers avaient été logiquement utilisés comme chair à canon par la bourgeoisie et la petite-bourgeoisie dans leur propre lutte contre le féodalisme. Durant cette lutte, les éléments révolutionnaires prolétariens s'étaient séparés de la bourgeoisie non seulement politiquement mais aussi organisationnellement, et avaient développé des principes d'organisation en accord avec leur propre nature de classe. Les nouveaux statuts définissaient l'organisation comme un organisme conscient, collectif et uni. La séparation entre la base composée d'ouvriers inconscients de la vie politique réelle de l'organisation et la direction composée de conspirateurs professionnels, était surmontée. Les nouveaux principes de centralisation rigoureuse, y compris l'organisation du travail illégal, excluaient la possibilité d'une organisation secrète au sein de l'organisation ou à sa tête. Alors que la petite-bourgeoisie et surtout les éléments déclassés radicalisés avaient justifié la nécessité d'un fonctionnement secret d'une partie de l'organisation par rapport à l'ensemble de celle-ci comme moyen de se protéger envers l'ennemi de classe, la nouvelle compréhension prolétarienne montrait que, précisément, cette élite conspiratrice amenait à l'infiltration par la classe ennemie, en particulier par la police politique, dans les rangs prolétariens. C'est avant tout la Ligue de Communistes qui a démontré que la transparence et la solidité organisationnelles constituent la meilleure protection contre la destruction par l'Etat.
Marx avait déjà dressé un portrait des conspirateurs de Paris avant la révolution de 1848 qui pouvait aisément s'appliquer à Bakounine. Nous y trouvons une expression claire de la critique de la nature petite-bourgeoise du sectarisme qui ouvrait largement la porte non seulement à la police, mais aussi à la bohème déclasseé.
« Leur existence incertaine, dépendant pour chacun pris à part, plus du hasard que de leur activité ; leur vie déréglée dont les seuls points d'attache sont les tavernes des marchands de vin, ces lieux de rendez-vous des conspirateurs ; leurs inévitables accointances avec toutes sortes de gens louches, tout cela les situe dans ces milieux que l'on appelle à Paris la bohème. Ces bohèmes démocrates d'origine prolétarienne - il existe aussi une bohème d'origine bourgeoise, ces démocrates flâneurs et ces piliers d'estaminet - sont ou bien des ouvriers qui ont abandonné leur métier et sont tombés en complète dissolution, ou bien des sujets qui proviennent du lumpenprolétariat et dont toutes les habitudes dissolues de cette classe se retrouvent dans leur nouvelle existence. On conçoit comment, dans ces conditions, quelques repris de justice se trouvent mêlés presque à tous les procès de conspiration.
Toute la vie de ces conspirateurs de profession porte la marque de la bohème. Sergents recruteurs de la conjuration, ils traînent de marchand de vin en marchand de vin, prennent le pouls des ouvriers, choisissent leurs gens, les attirent dans la conjuration à force d'enjôlement et en faisant payer soit à la caisse de la société soit au nouvel ami les litres de l'inévitable consommation. (...) à chaque instant il peut être appelé aux barricades et y tomber ; au moindre de ses pas, la police lui tend des pièges qui peuvent l'amener en prison ou même aux galères. De tels périls pimentent le métier et en font le charme : plus grande est l'incertitude, plus le conspirateur s'empresse de retenir la jouissance du moment. En même temps, l'habitude du danger le rend au plus haut point indiffèrent à la vie et à la liberté. » (ibid.)
Il va sans dire que ces gens « (...) méprisent au plus haut point la préparation théorique des ouvriers quant à leurs intérêts de classe. » (ibid.)
« Le trait essentiel de la vie du conspirateur, c'est la lutte contre la police, avec laquelle il a en fait exactement le même rapport que les voleurs et les prostituées. La police ne tolère pas seulement les conspirations comme un mal nécessaire : elle les tolère comme des centres faciles à surveiller. (...) Les conjurés sont en contact incessant avec la police, ils entrent à tout moment en collusion avec elle ; ils font la chasse aux mouchards, comme les mouchards font la chasse aux conspirateurs. L'espionnage est l'une de leurs occupations majeures. Aussi, dans ces conditions, pas étonnant que, facilité par la misère et la prison, par les menaces et les promesses, s'effectue le petit saut qui sépare le conspirateur artisanal de l'espion de police stipendié. » (ibid.)
Telle est la compréhension qui se trouve à la base des statuts de l'AIT et qui a assez inquiété la bourgeoisie pour qu'elle exprime ouvertement sa préférence pour Bakounine.
LA POLITIQUE DE CONSPIRATION BAKOUNINE EN ITALIE
Pour comprendre comment Bakounine a pu finir par être manipulé par les classes dominantes contre l'AIT, il est nécessaire de rappeler brièvement sa trajectoire politique ainsi que la situation en Italie après 1864. Les historiens anarchistes chantent les louanges du « grand travail révolutionnaire » de Bakounine en Italie où il a créé une série de sectes secrètes et tenté d'infiltrer et de gagner de l'influence dans différentes « conspirations ». Ils pensent généralement que c'est l'Italie qui a hissé Bakounine sur le piédestal de « pape de l'Europe révolutionnaire ». Mais comme ils évitent soigneusement de rentrer dans les détails de la réalité de ce milieu, il nous faut ici les déranger.
Bakounine a gagné sa réputation au sein du camp socialiste grâce à sa participation à la révolution de 1848-49 en tant que dirigeant à Dresde. Emprisonné, extradé en Russie et finalement banni en Sibérie, Bakounine n'est pas revenu en Europe avant de réussir à s'enfuir en 1861. Dès qu'il est arrivé à Londres, il est allé voir Herzen, le leader révolutionnaire libéral russe bien connu. Là, il a immédiatement commencé à regrouper, indépendamment d'Herzen, l'émigration politique autour de sa propre personne. C'était un cercle de slaves que Bakounine s'est attaché à travers un panslavisme teinté d'anarchisme. Il s'est tenu éloigné du mouvement ouvrier anglais comme des communistes, surtout du club éducatif des ouvriers allemands à Londres. N'ayant pas de possibilité de conspiration (la fondation de l'AIT se préparait), il est parti en Italie en 1864 chercher des disciples pour son « panslavisme » réactionnaire et ses groupements secrets.
« En Italie, il trouva une quantité de sociétés politiques secrètes ; il trouva une intelligentsia déclassée prête à tout instant à se laisser entraîner dans les complots, une masse paysanne constamment au bord de la famine et enfin un lumpenprolétariat grouillant, représenté surtout par les lazzaroni de Naples, ville où après un bref séjour à Florence, il n'avait pas tardé à aller s'établir et où il vécut plusieurs années. » (Franz Mehring, Karl Marx, histoire de sa vie, 1918)
Bakounine a fui les ouvriers d'Europe occidentale pour les déclassés d'Italie.
LES SOCIETES SECRETES COMME VEHICULES DE REVOLTE
Dans la période de réaction qui a suivi la défaite de Napoléon durant laquelle la Sainte Alliance sous Metternich appliquait le principe de l'intervention armée contre tout soulèvement social, les classes de la société exclues du pouvoir étaient obligées de s'organiser en sociétés secrètes. Ce n'était pas le cas seulement pour les ouvriers, la petite-bourgeoisie et la paysannerie, mais également pour des parties de la bourgeoisie libérale et même les aristocrates insatisfaits. Presque toutes les conspirations à partir de 1820, celles des décembristes en Russie ou des carbonari en Italie, s'organisaient selon le modèle de la franc-maçonnerie qui avait surgi en Angleterre au 17e siècle et dont les buts de « fraternité internationale » et de résistance à l'Eglise catholique avaient attiré des européens éclairés tels que Diderot et Voltaire, Lessing et Goethe, Pouchkine, etc. Mais comme beaucoup de choses en ce « siècle des lumières », comme les « despotes éclairés » tels que Catherine, Frédéric le Grand ou Marie-Thérèse, la franc-maçonnerie avait une essence réactionnaire sous la forme d'une idéologie mystique, d'une organisation élitiste avec différents « grades » d'« initiation », de son caractère aristocratique ténébreux, de ses penchants à la conspiration et à la manipulation. En Italie, qui était à l'époque la Mecque des sociétés secrètes non prolétariennes, des manoeuvres et des conspirations débridées, les gulefi, federati, adelfi et carbonari se sont développés à partir de 1820 et 1830. La plus fameuse d'entre elles, les carbonari, était une société secrète terroriste, défendant un mysticisme catholique et dont les structures et les « symboles » venaient de la franc-maçonnerie.
Mais à l'époque où Bakounine est allé en Italie, les carbonari se trouvaient déjà dans l'ombre de la conspiration de Mazzini. Les mazzinistes représentaient un pas en avant par rapport aux carbonari puisqu'ils luttaient pour une république italienne unie et centralisée. Non seulement Mazzini travaillait souterrainement, mais il faisait aussi de l'agitation vers la population. Après 1848, des sections ouvrières se sont même formées. Mazzini représentait aussi un progrès organisationnel puisqu'il a aboli le système des carbonari selon lequel les militants de base devaient suivre aveuglément et sans connaissance les ordres de la direction sous peine de mort. Mais, dès que l'AIT s'est érigée en force indépendante de son contrôle, Mazzini a commencé à la combattre comme une menace à son propre mouvement nationaliste.
Quand Bakounine est arrivé à Naples, il a immédiatement mené la lutte contre Mazzini - mais du point de vue des carbonari dont il défendait les méthodes ! Loin d'être sur ses gardes, Bakounine s'est plongé dans tout ce milieu non transparent afin de prendre la direction du mouvement conspiratif. Il a fondé l'Alliance de la social-démocratie avec, à sa direction, la Fraternité internationale secrète, un « ordre de révolutionnaires disciplinés ».
UN MILIEU MANIPULE PAR LA REACTION
L'aristocrate révolutionnaire déclassé Bakounine a trouvé en Italie un terrain encore bien plus adapté qu'en Russie. C'est là que sa conception organisationnelle a muri jusqu'à son plein épanouissement. C'était un sombre marais où s'est développée toute une série d'organisations anti-prolétariennes. Ces groupements d'aristocrates ruinés, souvent dépravés, de jeunes déclassés ou même de purs criminels lui paraissaient plus révolutionnaires que le prolétariat. L'un de ces groupes était la Camorra qui correspondait à la vision romantique de Bakounine sur le banditisme révolutionnaire. La domination de la Camorra, organisation secrète venant d'une organisation de forçats à Naples, était devenue quasi officielle après l'amnistie de 1860. En Sicile, vers la même époque, l'aile armée de l'aristocratie rurale dépossédée infiltrait l'organisation locale secrète de Mazzini. A partir de ce moment-là, elle s'est appelée « Mafia », ce qui correspondait aux initiales de son slogan de bataille « Mazzini Autorizza Furti, Incendi, Avvelenamenti » (« Mazzini autorise le vol, l'incendie, l'empoisonnement »). Bakounine n'a pas su dénoncer ces éléments, ni se distancier clairement d'eux.
Dans ce milieu, la manipulation directe de l'Etat ne manquait pas non plus. Nous pouvons être sûrs que cette manipulation a joué un rôle dans la façon dont le milieu italien a célébré Bakounine comme la véritable alternative révolutionnaire face à la « dictature allemande de Marx ». Cette propagande était en fait identique à celle que répandaient les organes de police de Louis-Napoléon en France.
Comme nous le dit Engels, les carbonari et beaucoup de groupes similaires étaient manipulés et infiltrés par les services secrets russes et d'autres (voir Engels, La politique étrangère du tsarisme russe). Cette infiltration d'Etat s'est surtout renforcée après la défaite de la révolution européenne de 1848. Le dictateur français, l'aventurier Louis-Napoléon qui, après la défaite de cette révolution, est devenu le fer de lance de la contre-révolution qui a suivi, s'est allié à Palmerston à Londres mais surtout avec la Russie afin de maintenir à terre le prolétariat européen. A partir de 1864, la police secrète de Louis-Napoléon était surtout en action pour détruire l'AIT. Un de ses agents était « M. Vogt », associé de Lassalle, qui a calomnié Marx en public comme étant prétendument à la tête d'un gang de chantage.
Mais l'axe principal de la diplomatie secrète de Louis-Napoléon se trouvait en Italie où la France essayait d'exploiter le mouvement national à ses propres fins. En 1859, Marx et Engels ont souligné qu'à la tête de l'Etat français se trouvait un ex-membre des carbonari (La politique monétaire en Europe - La position de Louis Napoléon).
Bakounine qui se trouvait dans ce marais jusqu'au cou croyait, évidemment, qu'il pourrait manipuler ce tas d'ordures pour ses propres buts révolutionnaires. En fait, c'est lui qui était manipulé. Jusqu'à ce jour, nous ne connaissons pas en détail tous les « éléments » avec lesquels il « conspirait ». Mais il existe quelques indications. Par exemple, en 1865, Bakounine rédige, comme le rapporte l'historien anarchiste Max Nettlau, ses Manuscrits maçonniques, « un écrit qui se fixait pour but de proposer les idées de Bakounine à la franc-maçonnerie italienne. »
« Les manuscrits maçonniques font référence au Syllabus de triste réputation, la condamnation par le Pape de la pensée humaine en décembre 1864 ; Bakounine voulait se joindre à l'indignation soulevée contre la papauté pour pousser en avant la franc-maçonnerie ou sa fraction susceptible d'évoluer ; il commence même en disant que pour redevenir un corps vivant et utile, la franc-maçonnerie doit se remettre sérieusement au service de l'humanité. » (Max Nettlau, Histoire de l'anarchisme, tome 2)
Nettlau essaie même de prouver fièrement, en comparant différentes citations, que Bakounine avait influencé la pensée de la franc-maçonnerie à l'époque. C'était en réalité l'inverse. C'est à cette époque que Bakounine a adopté des parties de l'idéologie de société secrète mystique de la franc-maçonnerie. Une vision du monde qu'Engels décrivait déjà parfaitement à la fin des années 40 à propos d'Heinzen.
« Il prend les écrivains communistes pour des prophètes ou des prêtres qui détiennent pour eux une sagesse secrète qu'ils cachent aux non-initiés pour les tenir en tutelle (...) comme si les représentants du communisme avaient intérêt à maintenir les ouvriers dans l'obscurité, comme s'ils manipulaient ceux-ci ainsi que les illuminés du siècle dernier voulaient manipuler le peuple. » (Engels, Les Communistes et Karl Heinzen, 1847)
Là réside également la clé du « mystère » bakouniniste selon lequel dans la société anarchiste future, sans Etat ni autorité, il faudra toujours une société secrète.
Marx et Engels, sans penser à Bakounine, ont exprimé cela par rapport au philosophe anglais, pseudo-socialiste à une époque, Carlyle:
« La différence de classes, historiquement produite, devient ainsi une différence naturelle que l'on doit reconnaître et vénérer comme une partie de l'éternelle loi de la nature, en s'inclinant devant ce qui est noble et sage dans la nature: le culte du génie. Toute la conception du processus de développement historique devient une pâle trivialité de la sagesse des illuminés et des francs-maçons du siècle passé (...). Nous voici ramenés à la vieille question de savoir qui devrait en fait régner, question débattue de long en large avec une superbe aussi futile qu'altière ; elle reçoit en fin de compte la réponse logique : règneront ceux qui possèdent noblesse, sagesse et savoir (...) » (Engels, La Nouvelle Gazette rhénane - Revue économique et politique, IV, 1850, compte rendu de l'ouvrage de Carlyle : Latter-Day Pamphlets)
BAKOUNINE « DECOUVRE » L'INTERNATIONALE
Dès le début, la bourgeoisie européenne a essayé d'utiliser le marais des sociétés secrètes italiennes contre l'Internationale. Déjà lors de sa fondation en 1864 à Londres, les tenants de Mazzini lui-même avaient tenté d'imposer leurs propres statuts sectaires et de prendre donc le contrôle de l'Association. Le représentant de Mazzini à ce moment, Major Wolff, devait plus tard être démasqué comme un agent de la police. Après l'échec de cette tentative, la bourgeoisie a mis sur pied la Ligue pour la paix et la liberté, et l'a utilisée pour attirer Bakounine dans la toile d'araignée de ceux qui voulaient miner l'AIT.
Bakounine attendait la « révolution » en Italie. Tandis qu'il manoeuvrait dans le marais de la noblesse ruinée, de la jeunesse déclassée et du lumpen-prolétariat urbain, l'Association internationale des travailleurs s'était dressée, sans sa participation, jusqu'à devenir la force révolutionnaire dominante dans le monde. Bakounine a dû reconnaître que dans sa tentative de devenir le pape révolutionnaire de l'Europe, il avait choisi le mauvais cheval. C'est alors, en 1867, que la Ligue pour la paix et la liberté fut fondée, de façon évidente, contre l'AIT. Bakounine et sa « fraternité » a rejoint la Ligue dans le but d'« unir la Ligue, avec la Fraternité en son sein comme force révolutionnaire inspiratrice, avec l'Internationale » (Nettlau, ibid.).
Assez logiquement mais sans même s'en apercevoir lui-même, en faisant ce pas, Bakounine devenait le fer de lance de la tentative des classes dominantes de détruire l'AIT.
LA « LIGUE POUR LA PAIX ET LA LIBERTE »
La Ligue, à l'origine idée du chef guérillero italien Garibaldi et du poète français Victor Hugo, fut fondée plus particulièrement par la bourgeoisie suisse et soutenue par des parties des sociétés secrètes italiennes. Sa propagande pacifiste de désarmement et sa revendication des « Etats Unis d'Europe » avaient en réalité comme but principal d'affaiblir et diviser l'AIT. A une époque où l'Europe était divisée en une partie occidentale au capitalisme développé et une partie orientale « féodale » sous le knout russe, l'appel au désarmement constituait une revendication favorisée par la diplomatie russe. L'AIT comme tout le mouvement ouvrier avait, dès le début, adopté le slogan du rétablissement d'une Pologne démocratique comme rempart contre la Russie qui, bien des fois, constituait le pilier de la réaction européenne. La Ligue dénonçait maintenant cette politique comme « militariste », tandis que le panslavisme de Bakounine était présenté comme étant vraiment révolutionnaire et dirigé contre tous les militarismes. De cette façon, la bourgeoisie a renforcé les bakouninistes contre l'AIT
« L'Alliance de la démocratie socialiste est d'origine toute bourgeoise. Elle n'est pas issue de l'Internationale ; elle est le rejeton de la Ligue pour la paix et la liberté, société mort-née de républicains bourgeois. L'Internationale était déjà fortement établie quand Mikhaïl Bakounine se mit en tête de jouer un rôle comme émancipateur du prolétariat. Elle ne lui offrit que le champ d'action commun à tous ses membres. Pour y devenir quelque chose, il aurait d'abord dû y gagner ses éperons par un travail assidu et dévoué ; il crut trouver meilleure chance et une route plus facile du côté des bourgeois de la Ligue. » (« Un complot contre l'Internationale, l'Alliance de la démocratie socialiste et l'Association Internationale des Travailleurs », rapport et documents publiés par ordre du Congrès international de La Haye).
La proposition que Bakounine lui-même avait faite, d'une alliance de la Ligue et de l'AIT fut cependant rejetée par le congrès de Bruxelles de l'AIT. A cette époque, il devenait déjà clair également qu'une majorité écrasante rejetterait l'abandon du soutien à la Pologne contre la réaction russe. Aussi n'y avait-il rien d'autre à faire pour Bakounine que de rejoindre l'AIT afin de la saper de l'intérieur. Cette orientation fut soutenue par la direction de la Ligue au sein de laquelle il avait déjà établi une base puissante.
« L'alliance entre bourgeois et travailleurs rêvée par Bakounine ne devait pas se limiter à une alliance publique. Les statuts secrets de l'Alliance de la démocratie socialiste (...) contiennent des indications qui montrent qu'au sein même de la Ligue, Bakounine avait jeté les bases d'une société secrète qui devait la mener. Non seulement les noms des groupes directeurs sont identiques à ceux de la Ligue (...) mais les statuts secrets déclarent que la "plus grande partie des membres fondateurs de l'Alliance"sont des "ci-devant membres du Congrès de Berne". » (ibid.)
Ceux qui connaissent la politique de la Ligue peuvent supposer que dès le début, elle a été créée pour utiliser Bakounine contre l'AIT - une tâche pour laquelle Bakounine avait été bien préparé en Italie. Le fait également que plusieurs activistes proches de Bakounine et de la Ligue furent ultérieurement démasqués comme agents de la police, parle dans ce sens. En fait, rien ne pouvait être plus dangereux pour l'AIT que la corrosion de l'intérieur à travers des éléments qui n'étaient pas, eux-mêmes, des agents de l'Etat et qui avaient une certaine réputation dans le mouvement ouvrier, mais poursuivaient leurs propres buts personnels aux dépens du mouvement.
Même si Bakounine ne voulait pas servir de cette manière la contre-révolution, lui et ses semblables en portent l'entière responsabilité à travers la façon dont ils se sont mis aux côtés des éléments les plus réactionnaires et sinistres de la classe dominante.
Il est vrai que l'Internationale ouvrière était consciente des dangers que représentait une telle infiltration. La conférence des délégués de Londres par exemple a adopté la résolution suivante:
« Dans les pays où l'organisation régulière de l'Association internationale des travailleurs est momentanément devenue impraticable, par suite de l'intervention gouvernementale, l'Association et ses groupes locaux pourront se constituer sous diverses dénominations, mais toute constitution de sections internationales sous forme de société secrète est et reste formellement interdite. » (« Résolution générale relative aux pays où l'organisation régulière de l'Internationale est entravée par le gouvernement » adoptée à la conférence de Londres, septembre 1871)
Marx qui avait proposé la résolution, la justifia ainsi:
« En France et en Italie, où il y a une situation politique telle, que s'associer constitue un acte répréhensible, les gens seront très fortement enclins à se laisser entraîner dans des sociétés secrètes dont le résultat est toujours négatif. Au demeurant, ce type d'organisation se trouve en contradiction avec le développement du mouvement prolétarien, car ces sociétés, au lieu d'éduquer les ouvriers, les soumettent à des lois autoritaires et mystiques qui empêchent leur autonomie et détournent leur conscience dans une fausse direction. » (Intervention de Marx à la conférence de Londres de septembre 1871)
Néanmoins, malgré cette vigilance, l'Alliance de Bakounine a réussi à pénétrer l'Internationale. Dans le second article de cette série, nous décrirons la lutte dans les rangs de celle-ci, allant aux racines des différentes conceptions de l'organisation et du militantisme entre le parti du prolétariat et la secte petite-bourgeoise.
KR.
Conscience et organisation:
- La première Internationale [1847]
Approfondir:
- Questions d'organisation [2321]
Heritage de la Gauche Communiste:
Le communisme n'est pas un bel idéal mais une nécessité matérielle [12° partie]
- 3515 reads
1883-1895 LES PARTIS SOCIALDEMOCRATES FONT AVANCER LA CAUSE DU COMMUNISME
Cette série arrive maintenant à l'époque qui a suivi la mort de Marx en 1883 ; c'est une coïncidence que la majeure partie des matériaux que nous allons examiner dans les deux articles qui suivent, se situent dans les années qui séparent la mort de Marx et celle d'Engels, qui a eu lieu il y a 100 ans ce mois-ci. L'immensité de la contribution de Marx à une compréhension scientifique du communisme a fait qu'une partie considérable de cette série a été consacrée au travail de cette grande figure du mouvement ouvrier. Mais, de la même façon que Marx n'a pas inventé le communisme (voir le 2e article de cette série: " Comment le prolétariat a gagné Marx au communisme ", dans la Revue internationale n' 69), le mouvement communiste n'a pas arrêté l'élaboration et la clarification de ses buts historiques avec la mort de Marx. Cette tâche fut poursuivie par les partis social-démocrates ou socialistes qui commencèrent à devenir une force considérable durant les deux dernières décennies du 19e siècle; le camarade et ami de toute la vie de Marx, Engels, a naturellement joué un rôle clé dans la poursuite de ce travail. Comme nous le verrons, il n'était pas le seul; mais nous ne pouvons certainement pas rendre à Engels d'hommage plus militant que de montrer l'importance de la part qu'il a prise dans la définition du projet communiste de la classe ouvrière.
Il y a aujourd’hui beaucoup de courants qui pensent que se réclamer du communisme révolutionnaire signifie rejeter les vêtements de la social-démocratie, renier toute la période qui va de la mort de Marx à la première guerre mondiale (au moins) comme étant une sorte de période noire ou de chemin évolutionniste sans issue sur la route qui mène de Marx jusqu'à eux. Les conseillistes, les modernistes, les anarcho-bordiguistes comme le Groupe communiste internationaliste (GCI) et une foule d'autres sous-espèces du marais affirment que, loin d'avoir apporté quelque chose à notre compréhension de la révolution communiste, les partis socialistes n'étaient rien d'autre que des instruments d'intégration du prolétariat dans la société bourgeoise. La « preuve » en résiderait principalement dans les activités syndicales et parlementaires de la Social-démocratie. En même temps ils pensent que le véritable but de ces partis, la société à laquelle ces derniers se référaient le plus fréquemment comme étant le " socialisme " n'était en réalité qu'une forme de capitalisme d’Etat. Bref, les partis qui se disent " socialistes " aujourd'hui le Labour Party de Blair, les Partis Socialistes de Mitterrand et Gonzales seraient en fait les héritiers légitimes des partis social-démocrates des années 1880, 1890 et 1900.
Pour certains de ces courants " anti-socialdémocrates ", le communisme authentique ne fut restauré qu'avec Lénine, Luxemburg et leurs semblables après la 1ère guerre mondiale, après la mort définitive de la 2e Internationale et la trahison de ses partis. D'autres, plus " radicaux ", ont découvert que Bolcheviks et Spartakistes n'étaient eux-mêmes rien d'autre que des restes de la social-démocratie: les premiers véritables révolutionnaires du 20e siècle seraient donc les communistes de gauche des années 1920 et 1930. Mais puisqu'il existe une continuité directe entre les Gauches social-démocrates (c'est-à-dire non seulement les courants de Lénine et Luxemburg, mais aussi de Pannekoek, Gorter, Bordiga et d'autres) et la gauche communiste ultérieure, nos ultra-radicaux souvent, pour être surs de ne pas se tromper, considèrent personne d'autre qu'eux-mêmes comme premiers communistes véritables de ce siècle. Qui plus est, ce radicalisme rétrospectif sans vergogne est également appliqué aux précurseurs de la social-démocratie: d'abord à Engels qui, nous dit-on, n'aurait jamais véritablement acquis la méthode de Marx et serait certainement devenu, a peu près, un vieux réformiste à la fin de sa vie; et puis, assez souvent, la hache s'abat sur Marx lui-même et son insistance fastidieuse sur des notions "bourgeoises " telles que la science ou le progrès et le déclin historiques. Par une étrange coïncidence, la découverte finale est souvent la suivante : la véritable tradition révolutionnaire se trouve dans la révolte courageuse des Ludistes ou... de Michel Bakounine.
Le CCI a déjà consacré tout un article à ce type d’arguments dans la Revue internationale n° 50, dans la série en défense de la notion de décadence du capitalisme. Nous n'avons pas l’intention de répéter ici tous les contre-arguments. II suffit de dire que la " méthode " sur laquelle se basent de tels arguments est précisément celle de l’anarchisme a-historique, idéaliste et moralisateur. Pour l’anarchisme, la conscience n'est pas considérée comme le produit d'un mouvement collectif évoluant historiquement. C’est pourquoi, les véritables lignes de continuité et de discontinuité du mouvement réel ne présentent pas d'intérêt pour lui. Aussi, les idées révolutionnaires cessent d’être le produit d’une classe révolutionnaire et de ses organisations, mais deviennent, pas essence, 1’inspiration de brillants individus ou cercles d’initiés. D'où l'incapacité pathétique des " anti-social-démocrates " à voir que 1es groupes et conceptions révolutionnaires d’aujourd’hui n'ont pas surgi tout faits, tels Athéna du front de Zeus, mais sont les descendants organiques d'un long processus de gestation, de toute une série de luttes au sein du mouvement ouvrier: la lutte pour construire la Ligue des communistes contre les vestiges de l’utopisme et du sectarisme; la lutte de la tendance marxiste dans l’AIT contre le " socialisme d Etat " d'un côté et l’anarchisme de l'autre; la lutte pour construire 1a Seconde Internationale sur une base marxiste et, plus tard, la lutte des Gauches pour la maintenir sur cette base marxiste contre le développement du révisionnisme et du centrisme ; la lutte de ces mêmes Gauches pour former la Troisième Internationale après la mort de la Seconde,et la lutte des tractions de Gauche contre la dégénérescence de 1’internationale Communiste, durant le reflux de la vague révolutionnaire d’après-guerre ; la lutte de ces fractions pour préserver les principes communistes et développer la théorie communiste durant les années noires de la contre-révolution ; la lutte pour la réappropriation des positions communistes avec la reprise historique du prolétariat à la fin des années 1960. En fait, le thème central de cette série d'articles a été de démontrer que notre compréhension des buts et des moyens de la révolution communiste n'aurait jamais existé sans cette suite de combats.
Mais une compréhension de ce qu'est la société communiste et des moyens d'y parvenir ne peut exister dans le vide, dans la seule tête d'individus privilégiés. Elle se développe et est défendue dans et par les organisations collectives de la classe ouvrière, et les luttes que l'on mentionne ci-dessus n'étaient rien d'autre que des luttes pour l'organisation révolutionnaire, des luttes pour le parti. La conscience communiste d'aujourd'hui n'existerait pas sans la chaîne des organisations prolétariennes qui nous relie aux débuts mêmes du mouvement ouvrier.
Pour les anarchistes, au contraire, la lutte qui les relie au passé est une lutte contre le parti puisque l’idéologie anarchiste reflète la résistance désespérée de la petite-bourgeoisie contre les précieux acquis organisationnels de la classe ouvrière. Le combat marxiste contre faction destructrice des Bakouninistes dans l’AIT a prélevé un lourd tribut sur cette dernière. Mais le fait que ce combat fut un succès historique, sinon immédiat, a été confirmé par la formation des partis social-démocrates et de la Seconde Internationale, sur des bases bien plus avancées que celles de l’Association Internationale des Travailleurs. Alors que cette dernière était une collection hétérogène de tendances politiques différentes, les partis socialistes se formèrent explicitement sur la base du marxisme ; alors que l'AIT combinait les tâches politiques à celles des organisations unitaires de la classe, les partis politiques de la Deuxième Internationale étaient tout-à-fait distincts des organisations unitaires de la classe de cette époque, les syndicats. C'est pourquoi, malgré toutes leurs critiques à ses faiblesses programmatiques, le principal parti social-démocrate de l'époque, le SPD allemand, reçut le soutien enthousiaste de Marx et Engels.
Nous n'entrerons pas plus avant, ici, dans la question spécifique de l'organisation bien que, précisément parce qu'elle est si fondamentale et constitue une condition sine qua non pour toute activité révolutionnaire, elle réapparaitra inévitablement dans la dernière partie de cette étude, comme elle fa fait dans les parties précédentes. Nous ne pouvons pas non plus consacrer trop de temps à répondre aux arguments des anti-social-démocrates sur les questions syndicale et parlementaire, bien que nous serons obligés d'y revenir plus loin, spécifiquement. Une chose qui doit être dite ici, c'est qu’il n'y a pas de point commun entre la condamnation globale de nos ultra-radicaux et les critiques authentiques qui doivent être faites aux pratiques et aux théories des partis socialistes. Alors que ces dernières viennent de l'intérieur du mouvement ouvrier, la première part d'un point de vue totalement différent Ainsi, les anti-social-démocrates n'écouteront pas l'argument selon lequel les activités syndicale et parlementaire avaient un sens pour la classe ouvrière au siècle dernier, quand le capitalisme était encore dans sa phase historiquement ascendante et pouvait encore accorder des réformes significatives, mais qu'elles font perdu et sont devenues anti-ouvrières dans la période de décadence, lorsque la révolution prolétarienne a été mise à l’ordre du jour de l'histoire. Cet argument est rejeté parce que la notion de décadence est rejetée; la notion de décadence, dans des cas de plus en plus nombreux, est rejetée parce qu'elle implique que le capitalisme a été, à l'époque, ascendant; et ceci est rejeté parce que cela impliquerait une concession à la notion de progrès historique qui, dans le cas d'anti-décadentistes " cohérents " comme le GCI ou " Wildcat ", serait une notion totalement bourgeoise. Mais maintenant il est devenu clair que ces hyper-ultra radicaux ont rejeté toute notion de matérialisme historique et se sont réalignés sur les anarchistes pour qui la révolution sociale est possible depuis qu'il existe des souffrances dans le monde.
Le but central de cette partie de notre étude, en continuité avec les articles précédents de la série, doit montrer que " la société du futur " définie par les partis socialistes était vraiment une société communiste; que malgré la mort de Marx, la vision communiste n'a pas disparu ou stagné durant cette période, mais qu'elle a avancé et s'est approfondie. Ce n'est que sur cette base que nous pouvons examiner les limites de cette vision et les faiblesses de ces partis en particulier en ce qui concerne " le chemin du pouvoir ", la voie par laquelle la classe_ ouvrière parviendrait à la révolution communiste.
La définition du socialisme par Engels
Dans un précédent article de cette série(Revue internationale n° 78, " Communisme contre socialisme d’Etat ") nous avons vu que Marx et Engels étaient extrêmement critiques envers les bases programmatiques du SPD, qui s'est formé en 1875 par la fusion de la fraction marxiste de Bebel et Liebnecht avec l’Association Générale des Travailleurs de Lassalle. Le nom même du nouveau parti les avait irrités : " Social-démocrate " étant un terme totalement inadéquat pour un parti "dont le programme économique n'est pas seulement complètement socialiste mais directement communiste et dont le but final est la disparition de l'Etat et donc aussi de la démocratie. " (Engels, 1875). Plus significatif encore, Marx écrivit sa convaincante Critique du Programme de Gotha pour mettre en lumière la compréhension superficielle, dans le SPD, de ce qu'impliquait précisément la transformation communiste, montrant que les marxistes allemands, dans leur ensemble, avaient fait trop de concessions à l'idéologie " socialiste d'Etat " de Lassalle. Engels n'a pas édulcoré ces critiques dans les années ultérieures. En fait, sa colère contre le Programme d’Erfurt du SPD de 1891 l’a amené à publier la Critique du
Programme de Gotha : à l'origine, la publication de cette dernière avait été "bloquée " par Liebnecht, et Marx et Engels n'avaient pas poursuivi le sujet de peur de rompre l'unité du nouveau parti. Mais, de toute évidence, Engels pensait que les critiques du vieux programme étaient toujours valables pour le nouveau. Nous reviendrons plus loin au Programme d'Erfurt, quand nous traiterons en particulier de l'attitude des social-démocrates envers le parlementarisme et la démocratie bourgeoise.
Néanmoins, les écrits d’Engels sur le socialisme durant cette période fournissent la preuve la plus claire qu'en dernière analyse, le programme de la Social-Démocratie était réellement "directement communiste ". Le travail théorique le plus important d’Engels à l'époque fut l’Anti Duhring, d'abord rédigé en 1878, puis revu, republié et plusieurs fois traduit dans les années 1880 et 1890. Une partie de cet ouvrage fut également publiée comme brochure populaire en 1892 sous le titre de Socialisme utopique, socialisme scientifique, et il était sans aucun doute l'un des plus lus et des plus influents des travaux marxistes de l’époque. Et évidemment, l’Anti-Duhring était éminemment un texte de "parti ", puisqu'il fut écrit en réponse aux proclamations grandiloquentes de l’académiste allemand Duhring selon lesquelles il aurait fondé un " système socialiste " complet, très en avance sur toute théorie du socialisme existant jusque là, depuis les utopistes jusqu'à Marx lui-même. En particulier, Marx et Engels étaient préoccupés par le fait que " le Dr Duhring faisait en sorte de former autour de lui une secte, le noyau d'un futur parti distinct. Il était donc devenu nécessaire de relever le gant qui nous avait été jeté, et de mener le combat que nous le voulions ou pas. " (Introduction à l'édition anglaise de Socialisme utopique, socialisme scientifique, 1892). La première motivation de ce texte était donc de défendre l'unité du parti contre les effets destructeurs du sectarisme. Ceci a amené Engels à s'arrêter longuement sur les prétentieuses " découvertes " de Duhring dans les domaines de la science, de la philosophie et de l'histoire, défendant la méthode matérialiste historique contre la nouvelle soupe d'idéalisme étatique et de matérialisme vulgaire de Duhring. En même temps, en particulier dans la partie parue comme brochure séparée, Engels était obligé de réaffirmer un postulat fondamental du Manifeste communiste: les idées socialistes et communistes n'étaient pas l'invention de "prétendus réformateurs universels " tel le professeur Duhring, mais le produit d'un mouvement historique réel, le mouvement du prolétariat. Duhting se considérait bien au-dessus de ce prosaïque mouvement de masse ; mais en fait son " système " constituait une absolue régression par rapport su socialisme scientifique développé par Marx ; et même en comparaison des utopistes, tels que Fourier, envers lequel Duhring n'avait que dédain alors qu'il était grandement respecté par Marx et Engels, Duhring n'était qu'un nain intellectuel.
Plus directement lié au contexte de cette étude est le fait qu'à rencontre de la fausse vision de Duhring d'un " socialisme " opérant sur la base de l’échange de marchandises, c'est-à-dire des rapports de production existants, Engels était amené à réaffirmer certains fondements du communisme, en particulier que :
- les rapports marchands capitalistes, après avoir été facteur d'un progrès matériel sans précédent, ne pouvaient, en fin de compte, que conduire la société bourgeoise dans des contradictions insolubles, des crises et l'autodestruction: " le mode de production se rebelle contre le mode d'échange... D'une part, donc, le mode de production capitaliste est convaincu de sa propre incapacité de continuer à administrer ces forces productives. D'autre part, ces forces productives elles-mêmes poussent avec une puissance croissante à la suppression de la contradiction, à leur affranchissement de leur qualité de capital, à la reconnaissance effective de leur caractère de forces productives sociales. " (Anti Dühring, IIIe partie, Chap. 2)
- la prise en main des moyens de production par l’Etat capitaliste constituait la réponse de la bourgeoisie à cette situation, mais pas sa solution. II n'était pas question de confondre cette étatisation capitaliste avec la socialisation communiste: " L'Etat moderne, quelqu’un soit la forme, est une machine essentiellement capitaliste : l'Etat des capitalistes, le capitaliste collectif en idée. Plus il fait passer de forces productives dans sa propriété, et plus il devient capitaliste collectif en fait, plus il exploite de citoyens. Les ouvriers restent des salariés, des prolétaires. Le rapport capitaliste n'est pas supprimé, il est au contraire poussé à son comble. Mais, arrivé à ce comble, il se renverse. " (Ibid). De façon compréhensible, les communistes d’aujourd’hui aiment utiliser ce passage prophétique contre toutes les variétés modernes de "socialisme " d’Etat, en fait de capitalisme d’Etat, que propagent ceux qui prétendent être les héritiers du mouvement ouvrier du 19ème siècle - les " socialistes " officiels, les staliniens, les trotskistes, avec leur défense éternelle de la nature progressiste des nationalisations. Les termes d’Engels montrent qu'il y a cent ans et plus, existait une clarté sur cette question dans le mouvement ouvrier;
- contrairement au socialisme prussien de Duhring, selon lequel tous les citoyens seraient heureux sous l'égide de l’Etat paternaliste, l’Etat n'a aucune place dans une société authentiquement socialiste ([1] [2322]).
"Dès qu'il n’y a plus de classe sociale à tenir dans l'oppression ; dès que, avec la domination de classe et la lutte pour l'existence individuelle motivée par l'anarchie antérieure de la production, sont éliminés également les collisions et les excès qui en résultent, il n’y a plus rien à réprimer qui rende nécessaire un pouvoir de répression, un Etat. Le premier acte dans lequel 1’Etat apparaît réellement comme représentant de toute la société ([2] [2323]), - la prise de possession des moyens de production au nom de la société - est en même temps son dernier acte propre en tant qu’Etat. L'intervention d'un pouvoir d’Etat dans des rapports sociaux devient superflue dans un domaine après l'autre, et encore alors naturellement en sommeil. Le gouvernement des personnes fait place à l'administration des choses et à la direction des opérations de production. L’Etat n'est pas 'aboli', il s'éteint. ". (Ibid)
- et, finalement, contre toutes les tentatives de gérer les rapports de production existants, le socialisme requiert l'abolition de la production de marchandises: "Avec la prise de possession des moyens de production par la société, la production marchande est éliminée, et par suite, la domination du produit sur le producteur. L'anarchie à l'intérieur de la production sociale est remplacée par l'organisation planifiée consciente. La lutte pour l'existence individuelle cesse. Par là, pour la première fois, l'homme se sépare, dans un certain sens, définitivement du règne animal, passe des conditions animales d'existence à des conditions réellement humaines. Le cercle des conditions de vie entourant 1’homme, qui jusqu'ici dominait l‘homme, passe maintenant sous la domination et le contrôle des hommes qui, pour la première fois, deviennent des maîtres réels et conscients de la nature, parce que en tant que maîtres de leur propre vie en société. Les lois de leur propre pratique sociale qui, jusqu'ici, se dressaient devant eux comme des lois naturelles, étrangères et dominatrices, sont dès lors appliquées par les hommes en pleine connaissance de cause, et par là dominées. La vie en société propre aux hommes qui, jusqu'ici, se dressait devant eux comme octroyée par la nature et l'histoire, devient maintenant leur acte propre et libre. Les puissances étrangères, objectives qui, jusqu'ici, dominaient 1’histoire, passent sous le contrôle des hommes eux-mêmes. Ce n'est qu'à partir de ce moment que les hommes feront eux-mêmes leur histoire en pleine conscience ; ce n'est qu'à partir de ce moment que les causes sociales mises par eux en mouvement auront d'une façon prépondérante, et dans une mesure toujours croissante les effets voulus par eux. C'est le bond de l’humanité du règne de la nécessité dans le règne de la liberté. " (lbid). Dans ce passage élevé, Engels regarde clairement vers l’avant, vers un stade très avancé de l’avenir communiste. Mais il montre avec certitude, contre tous ceux qui tentent d’établir une barrière entre Marx et Engels, que le -Général " partageait la conviction du "Maure " selon laquelle le haut bout but envisageable du communisme est de se débarrasser du fléau de l’aliénation et de commencer une vie véritablement humaine, où les puissances créatrices et sociales de 1’homme ne se retourneront plus contre lui, mais seront au service de sa véritables besoins et désirs.
Mais, ailleurs dans le même livre, Engels revient de ces réflexions " cosmiques " à une question plus terre à terre : les "principes fondamentaux de la production et de la distribution communiste " comme la Gauche hollandaise les a appelés par la suite. Après avoir démoli les fantaisies néoproudhoniennes de Duhring sur l'établissement de la " vraie valeur " et le paiement aux ouvriers de "la totalité de la valeur produite ", Engels explique: "Dès que la société se met en possession des moyens de production et les emploie pour une production immédiatement socialisée, le travail de chacun, si différent que soit son caractère spécifique d'utilité, devient d'emblée et directement du travail social. La quantité de travail social que contient un produit n'a pas besoin, dès lors, d'être d'abord constatée par un détour; l'expérience quotidienne indique directement quelle quantité est nécessaire en moyenne. La société peut calculer simplement combien il y a d'heures de travail dans une machine à vapeur, dans un hectolitre de froment de la dernière récolte, de cent mètres carrés de tissu de qualité déterminée. 1l ne peut donc pas lui venir à l'idée de continuer à exprimer les quanta de travail qui sont déposés dans les produits et qu'elle connaît d'une façon directe et absolue, dans un étalon seulement relatif, flottant, inadéquat, autrefois inévitable comme expédient, en un tiers produit, au lieu de le faire dans son étalon naturel, adéquat, absolu, le temps... Donc; dans les conditions supposées plus haut, la société n'attribue pas non plus de valeurs aux produits. Elle n'exprimera pas le fait simple que les cent mètres carrés de tissu ont demandé pour leur production, disons mille heures de travail, sous cette forme louche et absurde qu'ils 'vaudraient' mille heures de travail. Certes, la société sera obligée de savoir, même alors, combien de travail il faut pour produire chaque objet d'usage. Elle aura à dresser le plan de production d'après les mayens de production, dont font tout spécialement partie les forces de travail. Ce sont,enfin de compte, les effets utiles des divers objets d'usage, pesés entre eux et par rapport aux quantités de travail nécessaires à leur production, qui détermineront le plan. Les gens régleront tout très simplement sans intervention de la fameuse 'valeur'. " (lbid)
Telle était la conception de la société socialiste ou communiste d’Engels ; mais ce n'était pas sa propriété personnelle. Sa position exprimait ce qu'il y avait de mieux dans les partis social-démocrates, même si ces derniers comprenaient des éléments et des courants qui ne voyaient pas les choses aussi clairement.
Pour démontrer que le point de vue d’Engels n'était pas une quelconque exception individuelle, mais le patrimoine d'un mouvement collectif, nous tenterons d'examiner les positions défendues par d'autres figures de ce mouvement qui ont montré une préoccupation particulière pour ce que devraient être les formes de la société future. Et nous ne pensons pas qu'il soit accidentel que la période que nous étudions soit exceptionnellement riche en réflexions sur ce à quoi pourrait ressembler la société communiste. Nous devons rappeler que les années 1880 et 1890 étaient le "chant du cygne " de la société bourgeoise, le zénith de sa gloire impériale, la dernière phase de l’optimisme capitaliste avant les années sombres qui allaient mener à la première guerre mondiale. Une période de conquêtes économiques et coloniales gigantesques durant laquelle les dernières aires " non civilisées " du globe allaient être ouvertes aux géants impérialistes; une période aussi de rapide développement du progrès technologique, qui a vu le développement massif de l’électricité, l'apparition du téléphone, de l'automobile et bien d'autres choses encore. C'était une période durant laquelle les descriptions de l'avenir devinrent le fond de commerce de nombreux écrivains, scientifiques, historiens... et pas seulement de quelques fieffés mercantis ([3] [2324]). Bien que ce vertigineux " progrès " bourgeois ait fasciné et tourné la tête à beaucoup d'éléments du mouvement socialiste, ouvrant la porte aux illusions du révisionnisme, les éléments les plus clairs du mouvement, comme nous allons le voir brièvement, ne furent pas entraînés: ils pouvaient voir les nuages de la tempête s'amonceler au loin. Mais, bien qu'ils n'aient pas perdu la conviction que le renversement révolutionnaire du capitalisme restait me nécessité, ils commencèrent à envisager les immenses possibilités contenues dans les forces productives que le capitalisme avait développées. Ils commencèrent donc à chercher comment ces possibilités pourraient être mises en œuvre par la société communiste d'une façon plus détaillée que Marx et Engels ne l'avaient jamais tenté - au point même que beaucoup de leurs travaux ont été rejetés comme " utopiques ". C'est une accusation que nous examinerons avec soin, mais nous pouvons affirmer tout de suite que, même s'il y a une certaine vérité dans cette accusation, cela ne rend pas toutes ces réflexion sans utilité pour nous.
Plus spécifiquement, nous voulons nous centrer sur trois figures majeures du mouvement socialiste: August Bebel, William Morris et Karl Kautsky. Nous examinerons ce dernier dans un autre article, non parce qu'il serait une figure moins significative, mais parce que son travail le plus important a été publié plus tard dans une période légèrement postérieure ; et parce que lui, plus que les deux autres, soulève la question des moyens vers la révolution sociale. D'un autre côté, les deux premiers, peuvent être examinés principalement sous l'angle de déterminer comment les socialistes de la fin du 19e siècle définissaient les buts ultimes de leur mouvement.
Le choix de ces deux figures n'est pas arbitraire. Bebel, comme nous l'avons vu, fut un membre fondateur du SPD, un proche associé de Marx et Engels pendant des années, et une figure d'une autorité considérable dans le mouvement socialiste international. Son travail politique le plus connu, La femme et le socialisme (publié en 1883 pour la première fois, mais substantiellement revu et développé durant les deux décennies suivantes) est devenu l'un des documents les plus influents dans le mouvement ouvrier de la fin du 19e siècle, non seulement parce qu'il traite de la question de la femme, mais surtout parce qu'il contient un exposé clair de la façon dont les choses pourraient se passer dans une société socialiste dans tous les principaux domaines de la vie: non seulement les rapports entre les sexes, mais aussi dans le domaine du travail, de l'éducation, des rapports entre la ville et la campagne... Le livre de Bebel fut une source d'inspiration pour des centaines de milliers d'ouvriers conscients, désireux d'apprendre et de discuter ce que la vie pourrait être dans une société véritablement humaine. Il constitue un étalon très précis pour évaluer la compréhension, par le mouvement social-démocrate, de ses buts durant cette période.
William Morris n'est pas un personnage de
la même stature internationale que Bebel et il n'est pas bien connu en dehors
de la
Grande-Bretagne. Mais nous pensons cependant qu'il est
important d'inclure certaines de ses contributions comme un complément à celles
de Bebel, entre autres pour montrer que " même en Angleterre ", que
Marx et Engels ont souvent vu comme un désert pour les idées révolutionnaires,
la période de la 2e Internationale a vu un développement de la pensée
communiste. C'est vrai qu'il est probablement plus largement connu comme artiste
et dessinateur, comme poète et écrivain de romans héroïques, que comme
socialiste; Engels lui-même tendait à le repousser comme un " socialiste
sentimental " et sans aucun doute beaucoup de camarades
ont-ils, comme Engels, rejeté son livre News front Nowhere (Nouvelles de nulle part, 1890) non seulement parce qu'il considère
la société communiste sous la forme d'un " voyage de rêve " vers
le futur, mais aussi à cause du ton de nostalgie médiévale qui se dégage de cet
ouvrage, et de beaucoup d'autres de ses écrits. Mais si William Morris a
commencé sa critique de la civilisation bourgeoise d'un point de vue d'artiste,
il est devenu un authentique disciple du marxisme et a consacré tout le reste
de sa vie à la cause de la guerre de classe et de la construction d'une
organisation socialiste en Grande Bretagne et c'est sur cette base, comme un
artiste qui s'est armé avec le marxisme, qu'il a été capable d'avoir une vision
particulièrement forte de l'aliénation du travail sous le capitalisme et ainsi
de comment cette aliénation pourrait être surmontée.
Encore une fois, le socialisme contre le capitalisme
d'Etat
Dans le prochain article de cette série nous examinerons plus en profondeur les portraits de la société socialiste dépeints par Bebel et Morris, en particulier les points qu'ils font sur les aspects plus " sociaux " de la transformation révolutionnaire : les rapports entre les hommes et les femmes, l'interaction de l'humanité avec l'environnement naturel, la nature du travail dans une société communiste. Mais auparavant, il est nécessaire d'ajouter de nouvelles preuves que ces porte-paroles de la Social-démocratie comprenaient les caractéristiques fondamentales de la société communiste et que cette compréhension était, dans ses caractéristiques principales, en accord avec celle de Marx et Engels.
L'astuce de base qu'utilisent les anti social-démocrates pour montrer que la social-démocratie était, dès le départ, un instrument de récupération capitaliste, consiste à identifier les partis socialistes aux courants réformistes qui émergèrent en leur sein. Mais ces courants ne surgirent pas comme leur produit organique, mais comme croissance parasitaire, nourrie par les fumées nocives de la société bourgeoise qui les entourait. II est bien connu, par exemple, que la première chose que le révisionniste Bernstein a "révisé " c'est la théorie marxiste de la crise. Théorisant la longue période de " prospérité " capitaliste à la fin du siècle dernier, le révisionnisme déclara que les crises faisaient partie du passé et a ainsi ouvert la porte à la perspective d'une transition graduelle et pacifique au socialisme. Plus tard dans l’histoire du SPD, certains des anciens défenseurs de 1" orthodoxie " marxiste sur ces questions, comme Kautsky et Bebel lui-même, allaient, en fait, faire tout un tas de concessions à ces perspectives réformistes. Mais à l'époque ou La femme et le socialisme a été écrit, c'est Bebel qui disait: "L'avenir de la société bourgeoise est menacé de toutes parts par de graves dangers, et il ne lui est pas possible d’ y échapper. La crise devient donc permanente et internationale. Cela résulte du fait que tous les marchés sont saturés de biens. Et déjà, plus de biens encore pourraient être produits; mais la grande majorité du peuple souffre du besoin de moyens de vie parce qu'ils n'ont pas de revenus pour satisfaire leur besoins par l'achat. Ils manquent de vêtements, de linge, de mobilier, de logement, de nourriture pour le corps et pour l'esprit, de moyens de se distraire, toutes choses qu'ils pourraient consommer en grande quantité. Mais tout cela n'existe pas pour eux. Des centaines de milliers d'ouvriers sont même laissés sur le bord de la route et rendus tout à fait incapables de consommer parce que leur force de travail est devenu 'superflue' aux yeux des capitalistes. N'est-il pas évident que notre système social souffre de manques sérieux ? Comment pourrait-il y avoir 'surproduction' alors qu'il n’y a pas défaut de capacité à consommer, c'est-à-dire de besoins qui demandent satisfaction ? Objectivement, ce n'est pas la production, en et pour elle-même, qui donne naissance à ces conditions et contradictions triviales, c'est le système sous lequel la production est menée, et le produit distribué. " (La femme et le socialisme, Chap. VI)
Loin de rejeter la notion de crise capitaliste, Bebel réaffirme ici qu'elle s'enracine dans les contradictions fondamentales du système lui-même; de plus, en introduisant le concept de crise " permanente ", Bebel anticipe l’avènement du déclin historique du système. Et, comme Engels qui, peu avant sa mort, exprimait sa peur que la croissance du militarisme n'entraîne l’Europe dans une guerre dévastatrice, Bebel voyait aussi que l'effondrement économique du système devait conduire à un désastre militaire: "L'état militaire et politique de l’Europe a connu un développement qui ne peut que finir par une catastrophe, qui conduira la société capitaliste à sa ruine. Ayant atteint son plus haut point de développement, elle a produit les conditions qui finiront par rendre son existence impossible, elle creuse sa propre tombe; elle se tue avec les mêmes moyens qu'elle-même, comme les systèmes sociaux les plus révolutionnaires du passé, avait fait naître. "(Op. cit.)
C'est précisément le cours du capitalisme vers la catastrophe qui fait du renversement révolutionnaire du système une nécessité absolue :
"Par conséquent, nous imaginons le jour où tous les maux décrits auront atteint une telle maturité qu'ils seront devenus douloureusement sensibles aux sentiments et à la vue de la grande majorité, au point de ne plus être supportables; après quoi un irrésistible désir de changement radical s'emparera de la société et alors, le remède le plus rapide sera considéré comme le plus efficace. -(Op. cit)
Bebel fait aussi écho à Engels en mettant au clair que l'étatisation de l'économie par le régime existant ne constitue pas une réponse à la crise du système, encore moins un pas vers le socialisme:
"... ces institutions (télégraphe, chemin de fer, Poste, etc.), administrées par l’Etat, ne sont pas des institutions socialistes, comme on le croit par erreur. Ce sont des entreprises d'affaire qui sont gérées de façon aussi capitaliste que si elles étaient dans du mains privées ... les socialistes mettent en garde contre la croyance que la propriété étatique actuelle puisse être considérée comme du socialisme, comme la réalisation d'aspirations socialistes. " (Op. cit.)
William Morris a écrit beaucoup de diatribes contre les tendances croissantes vers le "socialisme d'Etat " qui étaient représentées, en Grande-Bretagne, en particulier par la Société Fabienne de Bernard Shaw, les Webbs, HG. Wells et autres. Et News from Nowhere a été écrit en réponse au roman d’Edward Bellamy Looking Backward (Regards en Arrière) qui se proposait de décrire le futur socialiste, mais un futur qui arriverait de façon tout-à-fait pacifique, les énormes trusts capitalistes évoluant vers des instituions " socialistes " ; évidemment, c'était un " socialisme " dans lequel chaque détail de la vie individuelle était planifié par une bureaucratie omnipotente; dans News from Nowhere, au contraire, la grande révolution (prévue pour 1952...) avait lieu comme réaction ouvrière contre une longue période de "socialisme étatique " où ce dernier n'était plus capable de contenir les contradictions du système.
Contre les apôtres du "socialisme d’Etat ", Bebel et Morris affirmaient le principe fondamental du marxisme selon lequel le socialisme est une société sans Etat :
"L’Etat est, par conséquent, l'organisation nécessaire inévitable d'un ordre social qui reste sous un régime de classes. A partir du moment où les antagonismes de classes tombent avec l'abolition de la propriété privée, l'Etat perd à la fois la nécessité et la possibilité de son existence... -(La Femme et le Socialisme, Chap. VII). Pour Bebel, la vieille machine étatique devait être remplacée par un système d'auto-administration populaire, évidemment modelé sur la Commune de Paris:
" Comme dans la société primitive, tous les membres de la communauté, qui sont en âge de le faire, participent aux élections, sans distinction de sexe, et ont une voix dans le choix des personnes à qui sera confiée l'administration. A la tête de toutes les administrations locales se trouve l'administration centrale - on notera, pas un gouvernement ayant le pouvoir de régner, mais un collège exécutif de jonctions administratives. Que l'administration centrale soit choisie directement par le vote populaire ou désignée par l'administration locale est une question abstraite. Ces questions n'auront pas, alors, l'importance qu'elles ont aujourd’hui ; la question n'est plus de remplir du postes qui confèrent un honneur spécial, qui investissent le titulaire d'un pouvoir et d’une influence plus grands, ou qui rapportent de gros revenus ; la question est ici d'occuper des positions de confiance pour lesquelles les plus aptes, hommes ou femmes, sont retenus ; et ceux-ci peuvent être rappelés ou réélus en fonction des circonstances ou selon ce que les électeurs jugent préférable. Tous les postes ont une échéance donnée. Les titulaires ne sont, par conséquent revêtus d'aucune 'qualité de fonctionnaire particulière; la notion de continuité de fonction est absente, tout comme l'ordre de promotion hiérarchique. " (Op. cit.)
De même, dans News front Nowhere, Morris envisage une société opérant sur la base d'assemblées locales où tout débat a pour but de réaliser l'unanimité, mais qui utilise, quand celle-ci ne peut être obtenue, le principe majoritaire. Tout cela était diamétralement opposé aux conceptions paternalistes des Fabiens et autres " socialistes d'Etat " qui, dans leur sénilité, furent horrifiés par la démocratie directe d’Octobre 1917, mais trouvèrent la façon de faire de Staline tout à-fait à leur gout : « nous avons vu le futur, et ça marche " comme l’ont dit les Webbs après leur voyage en Russie où la contre-révolution avait accompli son œuvre sur tout ce non-sens pénible du " gouvernement par le bas ".
Egalement d'accord avec la définition d'Engels de la nouvelle société socialiste, Bebel et Morris affirment que le socialisme signifie la fin de la production de marchandises. Beaucoup de l’humour des News from Nawhere repose sur les difficultés qu'éprouve un visiteur en provenance des vieux mauvais jours pour s'habituer à une société où ni les marchandises ni la force de travail n'ont de " valeur ". Bebel le résume ainsi :
" La société socialiste ne produit pas de 'marchandises' à 'acheter' ou à 'vendre'; elle produit des choses nécessaires à la vie, qui sont utilisées, consommées, et n'ont aucun autre objet Dans la société socialiste, par conséquent, la capacité de consommer n'est pas liée, comme dans la société bourgeoise, à la capacité individuelle d'acheter; elle est liée à la capacité collective de produire. Si le travail et les moyens de travail existent, tous les besoins peuvent être satisfaits ; la capacité sociale de consommer n'est liée qu'à la satisfaction des consommateurs. " (La Femme et le Socialisme)
Et Bebel continue en disant que " il n y a pas de 'marchandises' dans la société socialiste, ni il ne peut y avoir 'd'argent'; ailleurs, il parle du système des bons du travail comme moyen de distribution. Ceci exprime une évidente faiblesses dans la façon dont Bebel présente la société future, car il fait peu ou pas de distinction entre une société communiste pleinement développée et la période de transition qui y mène : pour Marx (et aussi pour Morris, voir ses notes au Manifeste de la " Socialist League ", 1885), les bons du travail n'étaient qu'une mesure de transition vers une distribution complètement gratuite, et exprimaient certains stigmates de la société bourgeoise (voir " Le communisme contre le socialisme d’Etat ", Revue internationale n° 78). La pleine signification de cette faiblesse théorique sera examinée dans un autre article. Ce qu'il est important d'établir ici, c'est que le mouvement social-démocrate était fondamentalement clair sur ses buts finaux, même si les moyens de les atteindre causaient souvent des problèmes bien plus profonds.
" Le socialisme révolutionnaire international "
Dans " Le communisme contre le socialisme d’Etat ", nous avions noté que, dans certains passages, même Marx et Engels ont fait des concessions à l'idée que le communisme pourrait, au moins pendant un temps, exister au sein des frontières d'un Etat national. Mais de telles confusions n'ont pas été solidifiées dans une théorie du " socialisme " national ; l'objectif d'ensemble de leur réflexion était de démontrer que la révolution prolétarienne elle-même et la construction du communisme n'étaient possibles qu'à l’échelle internationale.
On peut dire la même chose des partis socialistes dans la période que nous considérons. Même si un parti comme le SPD fut affaibli dès le départ par un programme qui faisait bien trop de concessions à une route " nationale '" vas le socialisme, et même si de telles conceptions devaient être théorisées, avec des conséquences fatales, quand les partis socialistes devinrent une composante très " respectable " de la vie politique nationale, les écrits de Bebel et Morris sont nourris d'une vision fondamentalement internationale et internationaliste du socialisme :
"Le nouveau système socialiste s'appuiera sur une base internationale. Les peuples fraterniseront; ils se tendront la main et ils s'efforceront d'étendre graduellement les nouvelles conditions à toutes les races de la terre. " (La Femme et le Socialisme)
Le Manifeste de la " Socialist League " de Morris, écrit en 1885, présente l'organisation comme " défendant les principes du Socialisme révolutionnaire international; c'est-à-dire que nous voulons un changement des bases de la société - un changement qui détruira les distinctions de classe et de nationalité. "(publié par EP. Thomson, William Morris, Romantic to Revolutionnary, 1955). Le Manifeste poursuit en soulignant que " le Socialisme révolutionnaire achevé ... ne peut pas arriver dans un seul pays sans l'aide des ouvriers de toute la civilisation. Pour nous, ni les frontières géographiques, ni l'histoire politique, ni race ni religion ne font des rivaux ou des ennemis, pour nous il n’y a pas de nations, mais des masses d'ouvriers et d'amis divers, dont la sympathie mutuelle est contrariée ou pervertie par des groupes de maîtres et de voleurs dont c'est l'intérêt d'attiser la rivalité et la haine entre les habitants des différents pays. "
Dans un article paru dans The Commonweal (Le Bien Public), le journal de la " League ", en 1887, Morris relie cette perspective internationale à la question de la production pour l’usage ; dans la société socialiste, " toutes les nations civilisées ([4] [2325]) formeraient une grande communauté, s'entendant ensemble sur le genre et la quantité de ce qu'il faut produire et distribuer; travaillant à telle ou telle production là où elle peut être le mieux réalisée ; évitant le gâchis par tous les moyens. Il est plaisant de penser aux gâchis qu'ils éviteraient, combien une telle révolution ajouterait au bienêtre du monde. " (" Comment nous vivons et comment nous pourrions vivre ", republié dans The Political Writings of William Morris). La production pour l'usage ne peut être établie que lorsque le marché mondial a été remplacé par une communauté globale. II est possible de trouver des passages où tous les grands militants socialistes " oublient " cela. Mais ces défaillances n'expriment pas la véritable dynamique de leur pensée.
De plus, cette vision internationale ne se restreignait pas à un avenir révolutionnaire lointain ; comme on peut le voir dans le passage du Manifeste de la " Socialist League ", cette vision exigeait aussi une opposition active aux efforts que faisait alors la bourgeoisie pour attiser les rivalités nationales entre les ouvriers. II réclamait, par dessus tout, une attitude concrète et intransigeante envers la guerre inter-capitaliste.
Pour Marx et Engels, la position internationaliste prise par Bebel et W. Liebknecht pendant la guerre franco-prussienne était la preuve de leur conviction socialiste et les a persuadés de persévérer avec les camarades allemands, malgré toutes leurs faiblesses théoriques. De même l'une des raisons pour lesquelles Engels avait, au début, soutenu le groupe qui devait former la " Socialist League " dans sa scission avec la Fédération social-démocrate d’Hyndman en 1884, était l’opposition de principe de la première au " socialisme chauvin " d'Hyndman qui approuvait les conquêtes coloniales de l'impérialisme britannique et ses massacres, sous le prétexte qu'il apportait la civilisation à des peuples "barbares " et "sauvages ". Et comme grandissait la menace que les grandes puissances impérialistes se battent bientôt directement entre elles, Morris et la " League " prirent une position clairement internationaliste sur la question de la guerre :
"Si la guerre devient vraiment imminente, notre devoir de socialistes est suffisamment clair, et ne diffère pas de ce que nous devons faire couramment. Accroître la diffusion du sentiment international chez les ouvriers par tous les moyens possibles ; montrer à nos propres ouvriers que la concurrence et les rivalités étrangères, ou la guerre commerciale, culminant en fin de compte dans la guerre ouverte, sont nécessaires aux classes pilleuses et que les querelles de race et commerciales de ces classes ne nous concernent que dans la mesure où nous pouvons les utiliser comme moyen pour propager le mécontentement et la révolution ; que les intérêts des ouvriers sont les mêmes dans tous les pays et qu'ils ne peuvent jamais être les ennemis les uns des autres ; que les hommes des classes laborieuses, donc, doivent faire la sourde oreille aux sergents recruteurs et refuser d'être habillés de rouge et pris pour faire partie de la machine de guerre moderne pour la gloire et l'honneur d'un pays dont ils n'ont que la part du chien, faite de beaucoup de coups de pieds et de quelques penny - tout cela nous devons le prêcher tout le temps, même si dans l'éventualité d'une guerre imminente nous devons le prêcher de façon plus soutenue. " Commonweal, 1er janvier 1887, cité par EP. Thompson)
II n'y a aucune continuité entre une telle déclaration et les épanchements des social chauvins qui, en 1914, devinrent eux-mêmes les sergents recruteurs de la bourgeoisie. Entre l'une et les autres, il y a une rupture de classe, une trahison de la classe ouvrière et de sa mission communiste, qui avait été défendue pendant trois décennies par les partis socialistes et la Seconde Internationale.
CDW
[1] [2326] Engels, dans ses travaux, fait peu ou pas de distinction entre les termes de " socialisme " et de " communisme ", même si ce dernier, compris dans son sens le plus prolétarien et insurrectionnel, a été en général le terme préféré de Marx et Engels pour la future société sans classes. C'est surtout le stalinisme qui, prenant telle ou telle phrase dans les travaux des révolutionnaires du passé, cherchait i faire une distinction tranchée et rapide entre socialisme et communisme, pour prouver qu’une société dominée par une bureaucratie toute-puissante et fonctionnant sur la base du travail salarié pouvait constituer du " socialisme " ou " le stade le plus bas du communisme ". Et, de fait, le sous-fifre stalinien qui a écrit l'introduction, aux Edition de Moscou en 1971, de La société du futur, une brochure tirée du chapitre de conclusion du livre de Bebel La femme et le socialisme, est très critique vis-à-vis de la façon dont Bebel appelle sa future société, sans classes, sans argent, le " socialisme ". Il est aussi intéressant de noter qu'un groupe anti social-démocrate comme Radical Chains fait aussi une séparation entre socialisme et communisme, ce dernier étant le but authentique et le premier définissant précisément le programme du stalinisme, de la social-démocratie du XXe siècle et des gauchistes. Radical chains nous informe gentiment que ce socialisme a " échoué ". Cette formulation justifie donc la vision fondamentalement trotskiste de Radical chains selon laquelle le stalinisme, et d'autres formes de capitalisme d'Etat totalitaire, ne sont pas réellement capitalistes. Malgré toutes les critiques de cet horrible " socialisme ", Radical chains en reste prisonnier.
[2] [2327] Ici, nous voulons répéter la précision que nous avions faite quand nous avions cité ce passage dans la Revue internationale n° 78: "Engels se réfère ici, sans aucun doute à l’Etat postrévolutionnaire qui se forme après la destruction du vieil Etat bourgeois. Cependant, l'expérience de la révolution russe a conduit le mouvement révolutionnaire à mettre en cause cette formulation même : la propriété des moyens de production, même par l' Etat-Commune", ne conduit pas à la disparition de l Etat, et peut même contribuer à son renforcement et à sa perpétuation. Mais évidemment Engels ne bénéficiait pas d'une telle expérience. "
[3] [2328] C’est une période dans laquelle l'avenir, surtout l'avenir à la fois apparemment et authentiquement révélé par la science, avait un pouvoir d'attraction puissant. Dans la sphère littéraire, ces années ont w un rapide développement du genre " science-fiction "(HG. Wells étant l'exemple le plus significatif).
[4] [2329] L'utilisation du mot " civilisé " dans ce contexte reflète le fait qu'il y avait encore des zones du globe que le capitalisme n'avait que commencé à pénétrer. II n'avait pas de connotation chauvine de supériorité sur les peuples indigènes. Nous avons déjà noté que Morris était un critique impitoyable de l'oppression coloniale. Et, dans ses notes au Manifeste de la " Socialist League ", écrites avec Belfort Bax, il fait la preuve d'une claire maîtrise de la dialectique historique marxiste, expliquant que la future société communiste est le retour à " un point qui représente le vieux principe élevé à un niveau supérieur " - le vieux principe étant celui du communisme primitif (cité dans EP. Thomson). Voir l'article de cette série " Communisme du passé et de l'avenir " dans la Revue internationale n° 81 pour une élaboration plus approfondie de ce thème.
Conscience et organisation:
- La Seconde Internationale [1848]
Approfondir:
Questions théoriques:
- Communisme [492]
Heritage de la Gauche Communiste:
Revue Internationale no 85 - 2e trimestre 1996
- 3117 reads
Conflits imperialistes : la progression inexorable du chaos et du militarisme
- 2667 reads
Comme on l'a vu en décembre 1995 avec la manoeuvre orchestrée contre la classe ouvrière en France et plus largement contre le prolétariat européen, la bourgeoisie parvient toujours à s'unir à l'échelle internationale pour affronter le prolétariat. Il en va tout autrement sur le plan des relations inter-impérialistes, où la loi de la jungle reprend pleinement ses droits. Les « victoires de la paix » qui, fin 1995, ont été célébrées par les médias aux ordres ne sont que de sinistres mensonges et ne constituent rien d'autre que de simples épisodes dans la lutte à mort que se livrent les grandes puissances impérialistes, soit ouvertement, soit le plus souvent derrière le masque de prétendues forces d'interposition, telles l'IFOR en ex-Yougoslavie. En effet, cette phase finale de la décadence du système capitaliste qu'est la décomposition est avant tout caractérisée, à l'échelle des rapports inter-impérialistes, par le « chacun pour soi », la guerre de tous contre tous, tendance à ce point dominante depuis la fin de la guerre du Golfe qu'elle supplante pour le moment quasi-totalement cette autre tendance inhérente à l'impérialisme dans la décadence, celle à la constitution de nouveaux blocs impérialistes. D'où :
- une exacerbation de ces manifestations typiques de la crise historique du mode de production capitaliste que sont le militarisme, le recours systématique à la force brute pour lutter contre ses rivaux impérialistes et l'horreur quotidienne de la guerre pour des fractions toujours plus nombreuses de la population mondiale, victimes impuissantes de la foire d'empoigne mortelle de l'impérialisme. Si la superpuissance militaire américaine, pour défendre sa suprématie, est aux avant-postes dans cet usage de la force, les autres « grandes démocraties » que sont la Grande-Bretagne, la France et - fait d'importance historique - l'Allemagne, n'en marchent pas moins résolument - même si c'est dans la limite de leurs moyens - au même pas cadencé ([1] [2330]) ;
- une contestation grandissante du leadership de la première puissance mondiale par la plupart de ses ex‑alliés et féaux ;
- une remise en cause ou un affaiblissement des alliances impérialistes les plus solides et anciennes, comme l'attestent la rupture historique survenue au sein de l'alliance anglo-américaine de même que le net refroidissement des relations entre la France et l'Allemagne ;
- l'incapacité de l'Union Européenne à constituer un pôle alternatif à la superpuissance américaine, comme l'ont illustré de manière éclatante les divisions opposant les différents Etats européens à propos d'un conflit se déroulant à leurs portes, à savoir dans l'ex-Yougoslavie.
C'est à partir de ce cadre, que nous pouvons comprendre l'évolution d'une situation impérialiste infiniment plus complexe et instable qu'à l'époque des deux grands blocs impérialistes, et en dégager les principaux traits :
- l'origine et le succès de la contre-offensive américaine, avec pour épicentre l'ex-Yougoslavie ;
- les limites de cette même contre-offensive, marquées notamment par la volonté persistante de la Grande-Bretagne à remettre en cause son alliance avec le parrain américain ;
- le rapprochement franco-britannique en même temps que la prise de distance de la France à l'égard de son allié allemand.
Le succès de la contre-offensive des Etats-Unis
Dans la résolution sur la situation internationale du 11e congrès du CCI (Revue Internationale n° 82) était souligné « l'échec que représente pour les Etats-Unis l'évolution de la situation en Yougoslavie, où l'occupation directe du terrain par les armées britannique et française sous l'uniforme de la FORPRONU a contribué grandement à déjouer les tentatives américaines de prendre position solidement dans la région via son allié bosniaque. Il est significatif du fait que la première puissance mondiale éprouve de plus en plus de difficultés à jouer son rôle de gendarme du monde, rôle que supportent de moins en moins bien les autres bourgeoisies qui tentent d'exorciser le passé où la menace soviétique les obligeait à se soumettre aux diktats venus de Washington. Il existe aujourd'hui un affaiblissement majeur, voire une crise du leadership américain qui se confirme un peu partout dans le monde. » Nous expliquions cet affaiblissement majeur du leadership des Etats Unis par le fait que « la tendance dominante, à l'heure actuelle, n'est pas tant à la constitution d'un nouveau bloc mais bien le chacun pour soi. »
Au printemps 1995 la situation était effectivement dominée par l'affaiblissement de la première puissance mondiale, mais elle s'est nettement modifiée depuis, marquée à partir de l'été 1995 par une vigoureuse contre‑offensive menée par Clinton et son équipe. La constitution de la FRR par le tandem franco-britannique, en réduisant les Etats-Unis au rôle de simple challenger sur la scène yougoslave et, plus fondamentalement encore, la trahison de leur plus vieux et fidèle lieutenant, la Grande-Bretagne, affaiblissaient sérieusement la position américaine en Europe et rendaient indispensable une riposte d'ampleur visant à enrayer le grave déclin du leadership de la première puissance mondiale. Cette contre-offensive, menée avec brio, fut conduite en s'appuyant fondamentalement sur deux atouts. D'abord celui que confère aux Etats-Unis leur statut de seule superpuissance militaire, capable de mobiliser rapidement des forces militaires, d'un niveau tel qu'aucun de leur rivaux ne peut espérer être en mesure de se confronter à elles. Ce fut la constitution de l'IFOR, évinçant totalement la FORPRONU, avec tout l'appui de la formidable logistique de l'armée américaine : moyens de transport, force aéronavale à l'énorme puissance de feu et satellites militaires d'observation. C'est cette démonstration de force qui imposa aux européens la signature des accords de Dayton. Ensuite, appuyé solidement sur cette force militaire, Clinton, sur le plan diplomatique, misa à fond sur les rivalités minant les puissances européennes les plus engagées en ex-Yougoslavie, en utilisant en particulier très habilement l'opposition entre France et Allemagne, opposition venant s'ajouter à l'antagonisme traditionnel entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne ([2] [2331]).
La présence directe dans l'ex-Yougoslavie et plus largement en Méditerranée, d'un fort contingent américain porte un rude coup à deux Etats parmi les plus en pointe dans la contestation du leadership américain : la France et la Grande-Bretagne. Cela d'autant plus que tous deux revendiquent un statut impérialiste de premier plan en Méditerranée et que, pour préserver leur statut, ils s'étaient évertués depuis le début de la guerre en ex-Yougoslavie à empêcher une intervention américaine qui ne pouvait qu'affaiblir leur position en Méditerranée.
Depuis, les Etats-Unis se sont affirmés clairement les maîtres du jeu dans l'ex-Yougoslavie. C'est avec un certain succès qu'ils font pression sur Milosevic afin que celui-ci distende les liens qui l'unissaient étroitement à ses parrains franco-britanniques, en alternant la carotte et le bâton. Ils maintiennent solidement sous leur coupe leurs « protégés » bosniaques en les rappelant fermement à l'ordre dès lors que ceux-ci manifestent la moindre velléité d'indépendance, comme on l'a vu avec le coup monté de toutes pièces par les Etats-Unis, consistant à faire soudainement une large publicité sur certains liens entre la Bosnie et l'Iran. Ils ménagent l'avenir en opérant un net rapprochement avec Zagreb, la Croatie restant la seule force en mesure de s'opposer efficacement à la Serbie. Et ils ont su, pour le moment, retourner à leur profit les vives tensions agitant leur créature, la fédération croato-musulmane dans la ville de Mostar. Ils ont, de toute évidence, laissé, voire encouragé, les nationalistes croates à s'en prendre notamment à l'administrateur allemand de la ville, ce qui a eu pour résultat le départ précipité de ce dernier et son remplacement par un médiateur américain, remplacement sollicité à la fois par les fractions croate et musulmane. En nouant de bonnes relations avec la Croatie, les Etats-Unis visent avant tout l'Allemagne, laquelle reste le grand protecteur de la Croatie. En effet, même si, ce faisant, ils exercent une certaine pression sur l'Allemagne, ils continuent de la ménager tentant ainsi de maintenir et d'accentuer les graves divisions survenues au sein de l'alliance franco-allemande à propos de l'ex-Yougoslavie. De plus, en entretenant une alliance tactique et circonstancielle avec Bonn en ex-Yougoslavie, ils peuvent espérer contrôler d'autant mieux l'activité de l'Allemagne qui reste le plus dangereux de leurs rivaux impérialistes, leur présence militaire massive sur le terrain, limitant de fait la marge de manoeuvre de l'impérialisme allemand.
Ainsi, trois mois après la mise en place de l'IFOR, la bourgeoisie américaine contrôle solidement la situation et contre, pour le moment, efficacement les « peaux de banane » lancées par la France et la Grande Bretagne pour tenter de saboter la belle machine américaine. D'épicentre de la contestation de la suprématie de la première puissance mondiale, l'ex-Yougoslavie s'est transformée en un tremplin pour la défense de ce leadership en Europe et en Méditerranée, c'est-à-dire dans la zone centrale du champ de bataille des rivalités inter-impérialistes. Ainsi, la présence militaire américaine en Hongrie ne peut que constituer une menace pour la zone d'influence traditionnelle de l'impérialisme allemand dans l'est de l'Europe. Ce n'est certainement pas un hasard si d'importantes tensions surgissent au même moment entre Prague et Bonn à propos des Sudètes, les Etats-Unis soutenant clairement dans cette affaire les positions tchèques. De même, un pays comme la Roumanie, allié traditionnel de la France, ne peut lui aussi que subir les effets de cette implantation américaine.
La position de force acquise par les Etats-Unis à partir de l'ex-Yougoslavie s'est aussi concrétisée lors des tensions apparues en mer Egée entre la Grèce et la Turquie. Washington a tout de suite donné de la voix et, très vite, les deux protagonistes se sont pliés à ces injonctions, même si le feu couve encore sous la braise. Mais, au‑delà de l'avertissement à ces deux pays, les Etats-Unis ont surtout su mettre à profit ces événements pour souligner l'impuissance de l'Union Européenne face à des tensions touchant directement son sol, soulignant du même coup qui est le vrai patron en Méditerranée. Toutes choses qui n'ont pas été sans provoquer l'agacement du ministre des affaires étrangères de sa très gracieuse Majesté !
Mais si l'Europe constitue l'enjeu central pour la préservation du leadership américain, c'est à l'échelle mondiale que les Etats-Unis doivent défendre ce dernier. Dans ce cadre, le Moyen-Orient continue d'être un champ de manoeuvre privilégié de l'impérialisme américain. Malgré le sommet de Barcelone initié par la France et ses tentatives de se réintroduire sur la scène moyen-orientale, malgré le succès qu'a constitué pour l'impérialisme français l'élection de Zéroual en Algérie et les crocs en jambe de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne visant à jouer les trouble-fête sur les chasses gardées de l'Oncle Sam, celui-ci renforce sa pression et a marqué des points importants au cours de cette dernière année. En faisant nettement progresser les accords israélo-palestiniens, dont l'élection triomphale d'Arafat dans les territoires palestiniens a constitué le couronnement, et en profitant à fond de la dynamique créée par l'assassinat de Rabin pour accélérer les négociations entre la Syrie et Israël, la première puissance mondiale renforce son emprise sur cette région derrière le masque de la « pax américana » et ses moyens de pressions à l'égard d'Etats tels que l'Iran, qui continue à contester la suprématie américaine au Moyen-Orient ([3] [2332]). Il faut noter également qu'après une éphémère et partielle stabilisation de la situation en Algérie autour de l'élection du sinistre Zéroual, la fraction de la bourgeoisie algérienne liée à l'impérialisme français est à nouveau confrontée à des attentats et des coups de main en série derrière lesquels, par « islamistes » interposés, il y a certainement la main des Etats-Unis.
Là où la première puissance mondiale se heurte au « chacun pour soi »
La vigoureuse contre-offensive de la bourgeoisie américaine a modifié la donne impérialiste, mais elle ne l'a pas affectée en profondeur. Les Etats-Unis ont clairement réussi à démontrer qu'ils restent la seule superpuissance mondiale et qu'ils n'hésitent pas à mobiliser leur formidable machine militaire pour défendre leur leadership partout où celui-ci est menacé, toute puissance impérialiste contestant leur suprématie s'exposant dès lors à subir les foudres américaines. Sur ce plan, le succès est total et le message a été clairement entendu. Cependant, malgré les batailles importantes remportées, les Etats-Unis ne sont pas parvenus à briser, à éradiquer réellement le phénomène qui a précisément nécessité tout ce déploiement de force : la tendance au chacun pour soi qui domine l'arène impérialiste. Momentanément et partiellement freinée, mais en aucune façon détruite; celle-ci persiste à secouer toute la scène impérialiste, alimentée en permanence par la décomposition affectant l'ensemble du système capitaliste. Elle reste la tendance dominante régissant l'ensemble des rapports inter-impérialistes, contraignant chaque rival impérialiste des Etats-Unis à contester ouvertement ou de façon plus sournoise et masquée la suprématie de ces derniers, même s'il n'y a aucune égalité entre les forces en présence. La décomposition et sa monstrueuse progéniture qu'est la guerre du tous contre tous portent à l'incandescence ce trait typique de la décadence du capitalisme qu'est l'irrationnalité de la guerre dans la phase de l'impérialisme. C'est là l'obstacle principal auquel se heurte la superpuissance mondiale, obstacle ne pouvant que générer des difficultés sans cesse renouvelées pour celui qui aspire à demeurer le « gendarme du monde ».
Ainsi, leur marge de manoeuvre se voyant sérieusement limitée en ex-Yougoslavie, la France, la Grande-Bretagne, mais aussi, l'Allemagne, vont faire porter ailleurs leurs efforts pour tenter d'effriter et d'affaiblir le leadership américain. A cet égard, l'impérialisme français se montre particulièrement actif. Evincé de façon quasi-totale du Moyen-Orient, celui-ci tente par tous les moyens de se réintroduire dans cette région hautement stratégique. S'appuyant sur ses liens traditionnels avec l'Irak, il joue les bons offices entre ce dernier et l'ONU et verse des larmes de crocodile sur les conséquences terribles pour la population de l'embargo imposé à l'Irak par les Etats-Unis, tout en cherchant à renforcer son influence au Yémen et au Qatar. Il n'hésite pas à marcher sur les plates‑bandes de l'Oncle Sam, en prétendant jouer un rôle dans les négociations syro-israëliennes et en offrant à nouveau ses services militaires au Liban Il continue de chercher à préserver ses chasses gardées au Maghreb en étant très offensif vis à vis du Maroc et de la Tunisie, en même temps qu'il défend ses zones d'influence traditionnelles en Afrique Noire. Et là, désormais aidé par son nouveau complice britannique - auquel, en guise de remerciement, il a permis, fait inconcevable il y a encore quelques années, d'intégrer le Cameroun à la zone du Commonwealth - il manoeuvre à tout va, de la Côte d'Ivoire au Niger (dont il a soutenu le récent coup d'Etat) jusqu'au Rwanda. Chassé de ce dernier pays par les Etats-Unis, il utilise cyniquement les masses de réfugiés Hutus basés au Zaïre pour déstabiliser la clique pro-américaine qui dirige désormais le Rwanda.
Mais les deux manifestations les plus significatives de la détermination de la bourgeoisie française à résister coûte que coûte au bulldozer de l'Oncle Sam sont, d'une part, le récent voyage de Chirac aux Etats-Unis et, d'autre part, la décision d'une transformation radicale des forces armées françaises. En allant rencontrer le grand patron américain, le président français prenait acte de la nouvelle donne impérialiste créée par la démonstration de force de la première puissance mondiale, il n'allait pas pour autant à Canossa. Ce voyage n'avait en effet rien d'un acte d'allégeance à Washington. Le président français y a clairement réaffirmé la volonté d'autonomie de l'impérialisme français en exaltant la défense européenne. Mais prenant acte du fait qu'on ne peut que très difficilement s'opposer ouvertement à la puissance militaire américaine, il a inauguré une nouvelle stratégie, celle plus efficace du cheval de Troie. C'est là tout le sens de la réintégration quasi-totale de la France à l'OTAN. Désormais, c'est de l'intérieur que l'impérialisme français entend bien continuer à saboter « l'ordre américain ». La décision de transformer l'armée française en une armée de métier, capable d'aligner à tout moment 60 000 hommes pour des opérations extérieures, est l'autre volet de cette nouvelle stratégie, et traduit la ferme volonté de la bourgeoisie française de défendre ses intérêts impérialistes, y compris contre le gendarme américain. Il convient ici de souligner un fait d'importance : dans la mise en oeuvre de cette tactique du cheval de Troie, tout comme dans cette réorganisation de ses forces militaires, la France se met résolument à « l'école anglaise ». La Grande-Bretagne a en effet une longue expérience de cette stratégie du contournement. Ainsi, son adhésion à la CEE n'a eu pour but essentiel que de mieux saboter cette structure de l'intérieur. De même, l'armée de métier britannique a largement démontré son efficacité car, avec un effectif nettement inférieur à celui de la France, elle a pu néanmoins pendant la Guerre du Golfe tout comme en ex-Yougoslavie mobiliser plus rapidement des forces supérieures en nombre. Ainsi aujourd'hui, derrière le bruyant activisme d'un Chirac sur la scène impérialiste, il faut voir le plus souvent la présence de la Grande-Bretagne en coulisse. La relative efficacité de la bourgeoisie française pour défendre son rang sur la scène impérialiste doit, sans nul doute, beaucoup aux conseils avisés venus de la bourgeoisie la plus expérimentée du monde et à l'étroite concertation qui s'est développée entre ces deux Etats au cours de l'année écoulée.
Mais, là où la force de la tendance au chacun pour soi, en même temps que les limites du succès de la démonstration de force des Etats-Unis sont les plus patentes, c'est bien dans la rupture de l'alliance impérialiste unissant la Grande-Bretagne et les Etats-Unis depuis près d'un siècle. Malgré la formidable pression exercée par les Etats-Unis pour punir de sa trahison la « perfide Albion » et la ramener à de meilleurs sentiments à l'égard de son ex-allié et ex-chef de bloc, la bourgeoisie britannique maintient sa politique de distanciation à l'égard de Washington, comme en témoigne notamment son rapprochement croissant avec la France, même si, à travers cette alliance, la Grande-Bretagne vise aussi à contrer l'Allemagne. Cette politique n'est pas unanimement partagée par l'ensemble de la bourgeoisie anglaise, mais la fraction Thatcher - qui prône quant à elle le maintien de l'alliance avec les Etats-Unis - reste pour le moment très minoritaire, et Major bénéficie sur ce plan du total soutien des travaillistes. Cette rupture entre Londres et Washington souligne l'énorme différence avec la situation qui avait prévalu lors de la guerre du Golfe où la Grande-Bretagne restait le fidèle lieutenant de l'Oncle Sam. Cette défection de la part de son plus vieil et solide allié est une très sérieuse épine dans le pied de la première puissance mondiale, laquelle ne saurait tolérer une aussi grave remise en cause de sa suprématie. C'est pourquoi Clinton utilise la vieille question irlandaise pour tenter de faire rentrer le traître dans le rang. A la fin de l'année 1995, Clinton, lors de son voyage triomphal en Irlande, n'a pas hésité à traiter la plus vieille démocratie du monde comme une simple « république bananière » en prenant ouvertement fait et cause pour les nationalistes irlandais et en imposant à Londres un médiateur américain en la personne du sénateur G. Mitchell. Le plan concocté par ce dernier ayant essuyé une fin de non-recevoir de la part du gouvernement Major, Washington est alors passé à une étape supérieure en utilisant l'arme du terrorisme, via la reprise des attentats par l'IRA, devenue le bras armé des Etats-Unis pour leurs basses oeuvres sur le sol britannique. Cela illustre la détermination de la bourgeoisie américaine à ne reculer devant aucun moyen pour réduire à merci son ancien lieutenant, mais cette utilisation du terrorisme atteste plus encore de la profondeur du divorce survenu entre les deux ex-alliés et de l'incroyable chaos caractérisant aujourd'hui les relations impérialistes entre les membres de l'ex-bloc de l'Ouest, derrière la façade de « l'amitié indéfectible » unissant les grandes puissances démocratiques des deux côtés de l'Atlantique. Pour le moment ce déchaînement de pressions de la part de l'ex-chef de bloc ne semble avoir pour seul résultat que de renforcer la volonté de résistance de l'impérialisme britannique, même si les Etats-Unis sont loin d'avoir dit leur dernier mot et feront tout pour tenter de modifier cette situation.
Ce développement du chacun pour soi auquel continue de se heurter le gendarme américain a connu ces derniers temps un développement spectaculaire en Asie, au point qu'on peut dire qu'un nouveau front est en train de s'ouvrir dans cette région pour les Etats-Unis. Ainsi, le Japon devient-il un allié de moins en moins docile, car libéré du carcan des blocs, il aspire à obtenir un rang impérialiste beaucoup plus conforme à sa puissance économique, d'où sa revendication d'un siège permanent au Conseil de Sécurité de l'ONU.
Les manifestations contre la présence militaire américaine dans l'archipel d'Okinawa, la nomination d'un nouveau premier ministre nippon connu pour ses diatribes anti-américaines et son nationalisme intransigeant, témoignent du fait que le Japon supporte de plus en plus difficilement le pesante tutelle américaine, et veut pouvoir affirmer davantage ses prérogatives impérialistes. Les conséquences ne peuvent être que la déstabilisation d'une région où de nombreux conflits de souveraineté sont latents, tel celui opposant la Corée du Sud et le Japon à propos du petit archipel de Tokdo. Mais ce qui est le plus révélateur du développement des tensions impérialistes dans cette partie du monde, c'est la nouvelle agressivité de la Chine vis à vis de Taiwan. Au delà des motivations intérieures de la bourgeoisie chinoise, confrontée à la délicate succession de Deng Tsiao Ping, et de la question de Taiwan, cette posture guerrière de l'impérialisme chinois signifie surtout qu'il est désormais prêt à braver son ex-chef de bloc, les Etats-Unis, pour défendre ses propres prérogatives impérialistes. Ainsi, la Chine a clairement réfuté les nombreuse mises en garde venant de Washington, distendant, pour le moins, les liens qui l'unissaient aux Etats-Unis, au point d'obliger ces derniers à montrer une nouvelle fois leurs muscles en dépêchant une armada dans le détroit de Formose. Dans un tel contexte d'accumulation de tensions impérialistes et de remise en cause, ouverte ou cachée, du leadership de la première puissance mondiale en Asie, le rapprochement marqué de Paris à l'égard de Pékin à travers le voyage de H. de Charette, l'invitation à Paris de Li Peng, de même que la tenue d'un premier sommet Euro-Asiatique, prennent tout leur sens. Si les motivations économiques d'une telle réunion sont bel et bien présentes, celle-ci est surtout l'occasion pour l'Union Européenne de venir chasser sur les plates-bandes de l'oncle Sam, en prétendant, quelles que soient les graves divisions qui la minent, constituer le « troisième pôle du triangle Europe-Asie-Amérique. »
Ainsi, malgré la ferme
réaffirmation de sa suprématie, le gendarme du monde voit sans cesse se
reconstituer devant lui le mur du chacun pour soi. Face à cette mine qui ne
peut que menacer la préservation de leur leadership, les Etats-Unis seront
contraints de toujours plus recourir à l'usage de la force brute et, ce
faisant, le gendarme devient lui même un des principaux propagateurs du chaos
qu'il prétend combattre. Ce chaos, généré par la décomposition du système capitaliste
à l'échelle mondiale, ne peut que tracer un sillon de plus en plus destructeur
et meurtrier sur l'ensemble de la planète.
L'alliance franco-allemande à l'épreuve
Si le leadership de la première puissance mondiale est menacé par l'exacerbation de la guerre du tous contre tous qui affecte l'ensemble des rapports impérialistes, le chaos caractérisant de manière croissante les relations impérialistes renvoie en même temps à un avenir de plus en plus hypothétique la tendance à la constitution de nouveaux blocs impérialistes. En témoigne avec éclat la zone de fortes turbulences dans laquelle est rentrée l'alliance franco-allemande.
Le marxisme a toujours souligné qu'une alliance inter impérialiste n'avait rien à voir avec un mariage d'amour ou avec une réelle amitié entre les peuples. L'intérêt guide seul une telle alliance et chaque membre d'une telle constellation impérialiste entend bien d'abord et avant tout y défendre ses propres intérêts et en tirer le maximum de profit. Toutes choses s'appliquant parfaitement « au moteur de l'Europe » qu'était le couple franco-allemand et expliquant que c'est essentiellement la France qui est à l'origine de la distanciation des liens entre les deux alliés. En effet, la vision de cette alliance n'a jamais été la même des deux côtés du Rhin. Pour l'Allemagne, les choses sont simples. Puissance économique dominante en Europe, handicapée par sa faiblesse sur le plan militaire, l'Allemagne a tout intérêt à une alliance avec une puissance nucléaire européenne, et ce ne peut être qu'avec la France, la Grande-Bretagne demeurant, malgré sa rupture avec les Etats-Unis, son ennemi irréductible. Historiquement, l'Angleterre a toujours lutté contre la domination de l'Europe par l'Allemagne, et la réunification, le poids accru de l'impérialisme allemand en Europe ne peuvent que renforcer sa détermination à s'opposer à tout leadership germanique sur le continent européen. Si la France a pu hésiter à s'opposer à l'impérialisme allemand, dans les années trente certaines fractions de la bourgeoisie française étaient plutôt enclines à une alliance avec Berlin. La Grande-Bretagne, quant à elle, s'est constamment opposée à toute constellation impérialiste dominée par l'Allemagne. Face à cet antagonisme historique, il n'y a pour la bourgeoisie d'outre-Rhin aucune carte de rechange possible en Europe occidentale et elle se sent d'autant plus à l'aise au sein de son alliance avec la France qu'elle sait y être, malgré les prétentions « du coq gaulois », en position de force. Dès lors, les pressions qu'elle exerce sur un allié de plus en plus récalcitrant n'ont pour but essentiel que de le forcer à lui rester fidèle.
Il en va tout autrement pour la bourgeoisie française pour laquelle s'allier avec l'Allemagne était avant tout un moyen de contrôler cette dernière, tout en espérant exercer un co-leadership sur l'Europe. La guerre dans l'ex-Yougoslavie et plus généralement la montée en puissance d'une Allemagne résolument conquérante a sonné le glas de cette utopie qu'entretenait une majorité de la bourgeoisie française, laquelle voyait resurgir le spectre redouté de la « Grande Allemagne », ravivé par le souvenir de trois guerres perdues face à un trop puissant voisin germanique.
On peut dire que, quelque part, la bourgeoisie française s'est sentie flouée et, à partir de là, elle s'est employée à distendre des liens qui ne faisaient qu'accroître ses faiblesses de puissance historiquement déclinante. Tant que la Grande-Bretagne restait fidèle aux Etats-Unis, la marche de manoeuvre de l'impérialisme français était très limitée, réduite à tenter de circonvenir l'expansion impérialiste de son trop puissant allié, en cherchant à l'emprisonner au sein de l'alliance.
L'avancée réalisée par l'Allemagne en ex-Yougoslavie vers la Méditerranée, via les ports croates, a sanctionné l'échec de cette politique défendue par Mitterrand, et dès que la Grande-Bretagne a rompu son alliance privilégiée avec Washington, la bourgeoisie française a saisi cette occasion pour prendre clairement ses distances avec l'Allemagne. Le rapprochement marqué avec Londres, initié par Balladur et amplifié par Chirac, permet à l'impérialisme français d'espérer contenir beaucoup plus efficacement l'expansion impérialiste allemande, tout en résistant avec plus de force aux pressions du gendarme américain. Même si cette nouvelle version de « l'Entente Cordiale » est l'union des petits contre les deux grands que sont l'Allemagne et les Etats-Unis, il ne faut pas pour autant la sous-estimer. Sur le plan militaire, c'est une puissance significative au niveau conventionnel et plus encore nucléaire. Cela l'est aussi sur le plan politique, la redoutable expérience de la bourgeoisie anglaise - héritage de la domination qu'elle exerça longtemps sur le monde - ne peut comme, nous l'avons vu, qu'accroître la capacité de ces deux « seconds couteaux » à défendre chèrement leur peau, tant vis à vis de Washington que de Bonn. De plus, même s'il est pour le moment encore difficile de juger de la pérennité de cette nouvelle alliance impérialiste des deux côtés de la Manche - durement exposée aux pressions des Etats-Unis et de l'Allemagne - un ensemble de facteurs militent cependant en faveur d'une certaine durée et solidité du rapprochement franco-britannique. Ces deux Etats sont tous deux des puissances impérialistes historiquement déclinantes, d'ex-grandes puissances coloniales menacées et par la première puissance mondiale, et par la première puissance européenne, toutes choses créant un solide intérêt commun. C'est d'ailleurs pour cela que l'on voit Londres et Paris développer une coopération en Afrique et aussi au Moyen Orient et ce, alors qu'elles y étaient encore il y a peu rivales, sans même parler de leur concertation exemplaire dans l'ex-Yougoslavie. Mais le facteur qui confère le plus de solidité à cet axe franco-britannique est le fait qu'il s'agit de deux puissances de force sensiblement égale, tant au niveau économique que militaire, et que, de ce fait, aucune ne peut craindre d'être dévorée par l'autre, considération revêtant toujours une importance cruciale dans les alliances que nouent les requins impérialistes.
Ce développement d'une concertation étroite entre la France et la Grande-Bretagne ne peut signifier qu'un affaiblissement marqué de l'alliance franco-allemande. Affaiblissement qui, s'il peut faire en partie le jeu des USA, en éloignant considérablement la perspective d'un nouveau bloc dominé par l'Allemagne, est au contraire totalement opposé aux intérêts de cette dernière. La radicale réorientation de l'armée et de l'industrie militaire françaises décidée par Chirac, si elle traduit la capacité de la bourgeoisie française à tirer les leçons de la guerre du Golfe et du sérieux revers subi en ex-Yougoslavie et à répondre aux nécessités générales auxquelles est confronté l'impérialisme français dans la défense de ses positions à l'échelle mondiale, vise néanmoins également directement l'Allemagne, à plusieurs niveaux :
- malgré les proclamations de Chirac selon lesquelles rien ne serait fait sans une étroite concertation avec Bonn, la bourgeoisie allemande a été mise devant le fait accompli, la France se contentant de communiquer des décisions sur lesquelles elle ne compte pas revenir ;
- il s'agit bien d'une profonde réorientation de la politique impérialiste française, comme l'a parfaitement compris le ministre de la défense allemand en déclarant, « si la France voit sa priorité à l'extérieur du noyau dur de l'Europe, alors c'est là une nette différence avec l'Allemagne » ([4] [2333])
- à travers la mise en place d'une armée de métier et en privilégiant des forces d'opération extérieures, la France signifie clairement sa volonté d'autonomie par rapport à l'Allemagne et facilite les conditions d'interventions communes avec la Grande-Bretagne, puisqu'alors que l'armée allemande est une armée basée essentiellement sur la conscription, l'armée française va désormais se conformer au modèle anglais, reposant sur des corps professionnels ;
- enfin, l'Eurocorps, symbole par excellence de l'alliance franco-allemande, est directement menacé par cette réorganisation, le groupe chargé de la défense au sein du parti dominant de la bourgeoisie française, le RPR, demandant sa suppression pure et simple.
Tout ceci atteste de la détermination de la bourgeoisie française à s'émanciper de l'Allemagne, mais on ne saurait cependant mettre sur le même plan le divorce survenu au sein de l'alliance anglo-américaine et ce qui n'est, pour le moment, qu'un affaiblissement marqué de l'alliance entre les deux côtés du Rhin. Tout d'abord, l'Allemagne n'entend pas rester sans réagir face à son allié rebelle. Elle dispose de moyens importants pour faire pression sur ce dernier, ne serait-ce que de par l'importance des relations économiques entre les deux pays et la puissance économique considérable dont dispose l'impérialisme allemand. Mais, plus fondamentalement, la position particulière dans laquelle se trouve la France ne peut que rendre extrêmement difficile une totale rupture avec l'Allemagne. L'impérialisme français est pris en étau entre les deux grands que sont les Etats-Unis et l'Allemagne et est confronté à leur double pression. En tant que puissance moyenne et malgré l'oxygène que lui procure son alliance avec Londres, elle est contrainte de chercher à s'appuyer momentanément sur l'un des grands, pour mieux résister à la pression exercée par l'autre et est ainsi amené à jouer sur plusieurs tableaux à la fois. Dans la situation de chaos grandissant que provoque le développement de la décomposition, ce double ou triple jeu consistant à prendre tactiquement appui sur un ennemi ou un rival pour mieux faire face à un autre, sera de plus en plus monnaie courante. C'est dans ce cadre, que se comprend le maintien de certains liens impérialistes entre la France et l'Allemagne, ainsi au Moyen-Orient voit-on les deux requins parfois se soutenir l'un l'autre pour mieux pénétrer les chasses gardées de l'oncle Sam, phénomène pouvant aussi s'observer en Asie. En témoigne également la signature d'un accord particulièrement important en matière de construction en commun de satellites d'observation militaire avec le projet Hélios, dont le but est de disputer la suprématie américaine dans ce domaine essentiel de la guerre moderne (Clinton ne s'y est pas trompé en envoyant, en vain, le directeur de la CIA à Bonn pour empêcher cet accord), ou celui concernant la décision de produire certains missiles en commun. Si l'intérêt de l'Allemagne à cette poursuite de la coopération dans le domaine de la haute technologie militaire est évident, l'impérialisme français y trouve aussi son compte. Car il sait qu'il ne pourra plus assurer seul des projets de plus en plus coûteux et si la coopération avec l'Angleterre se développe activement, elle est encore limitée de par la dépendance dans laquelle reste cette dernière vis à vis des Etats-Unis, notamment en matière nucléaire. De plus la France sait être sur ce plan dans une position de force face à l'Allemagne. Ainsi à propos d'Hélios elle a exercé un véritable chantage : si Bonn refusait de participer au projet, elle mettait fin à la production d'hélicoptères, en cessant ses activités au sein du groupe Eurocopter.
Au fur et à mesure que le système capitaliste s'enfonce dans la décomposition, l'ensemble des rapports inter-impérialistes porte de plus en plus l'empreinte d'un chaos grandissant, mettant à mal les alliances les plus solides et anciennes et déchaînant la guerre du tous contre tous. Le recours à l'usage de la force brute de la part de la première puissance mondiale s'avère non seulement impuissant à réellement enrayer cette progression du chaos, mais devient un facteur supplémentaire de la propagation de cette lèpre qui ronge l'impérialisme .Les seuls vrais gagnants de cette spirale infernale sont le militarisme et la guerre, qui tels un moloch ne cessent de réclamer un nombre toujours accru de victimes pour satisfaire leur effroyable appétit. Six ans après l'effondrement du bloc de l'Est censé inaugurer « l'ère de la paix », la seule alternative reste plus que jamais celle tracée par l'Internationale Communiste lors de son premier Congrès : « Socialisme ou Barbarie ».
RN, 10/3/96
Questions théoriques:
- Décomposition [3]
- Impérialisme [321]
Lutte de classe : le retour en force des syndicats contre la classe ouvriere
- 3507 reads
Chaque jour qui passe témoigne un peu plus de la barbarie sans nom dans laquelle s'enfonce le monde capitaliste. « Plus que jamais, la lutte du prolétariat représente le seul espoir d'avenir pour la société humaine. Cette lutte, qui avait resurgi avec puissance à la fin des années 60, mettant un terme à la plus terrible contre-révolution qu'ai connue la classe ouvrière, a subi un recul considérable avec l'effondrement des régimes staliniens, les campagnes idéologiques qui l'ont accompagné et l'ensemble des événements (guerre du Golfe, guerre en Yougoslavie, etc.) qui l'ont suivi. C'est sur les deux plans de sa combativité et de sa conscience que la classe ouvrière a subi, de façon massive, ce recul, sans que cela remette en cause toutefois, comme le CCI l'avait déjà affirmé à ce moment-là, le cours historique vers les affrontements de classe. Les luttes menées au cours des dernières années par le prolétariat sont venues confirmer ce qui précède. Elles ont témoigné, particulièrement depuis 1992, de la capacité du prolétariat à reprendre le chemin du combat de classe, confirmant ainsi que le cours historique n'avait pas été renversé. Elles ont témoigné aussi des énormes difficultés qu'il rencontre sur ce chemin, du fait de la profondeur et de l'extension de son recul. C'est de façon sinueuse, avec des avancées et des reculs, dans un mouvement en dents de scie que se développent les luttes ouvrières. » ([1] [2338])
Les grèves et les manifestations ouvrières qui ont secoué la France à la fin de l'automne 1995 sont venues illustrer cette réalité : la capacité du prolétariat à reprendre le chemin du combat mais aussi les énormes difficultés qu'il rencontre sur ce chemin. Dans le précédent numéro de la Revue Internationale, nous avons déjà dégagé, à chaud, la signification de ces mouvements sociaux ([2] [2339])
« En réalité, le prolétariat en France est la cible d'une manoeuvre d'ampleur destinée à l'affaiblir dans sa conscience et dans sa combativité, une manoeuvre qui s'adresse également à la classe ouvrière des autres pays afin de lui faire tirer de fausses leçons des événements en France. (...)
Face à cela [les attaques brutales que le capitalisme en crise déchaîne contre la classe ouvrière] les prolétaires ne peuvent rester passifs. Ils n'ont d'autre issue que de se défendre dans la lutte. Mais, pour empêcher que la classe ouvrière n'entre dans le combat avec ses propres armes, la bourgeoisie a pris les devants et elle l'a poussée à partir prématurément en lutte sous le contrôle total des syndicats. Elle n'a pas laissé aux ouvriers le temps de se mobiliser à leur rythme et avec leurs moyens. (...)
Le mouvement de grèves qui vient de se dérouler en France, s'il révèle l'existence d'un profond mécontentement dans la classe, est avant tout le résultat d'une manoeuvre de très grande ampleur de la bourgeoisie visant à amener les travailleurs à une défaite massive et, surtout, à provoquer chez eux une profonde désorientation » ([3] [2340])
L'importance de ce qui s'est passé en France à la fin 1995
Le fait que les mouvements sociaux de la fin de l'année 1995 en France soient fondamentalement le résultat d'une manoeuvre de la bourgeoisie ne saurait en atténuer l'importance ni signifier que la classe ouvrière est aujourd'hui une troupe de moutons à la merci de la classe dominante. En particulier, ces événements apportent un démenti cinglant à toutes les « théories » (relancées abondamment lors de l'effondrement des régimes staliniens) sur la « disparition » de la classe ouvrière ainsi qu'à leur variantes évoquant soit la « fin des luttes ouvrières », soit (c'est la version « de gauche » de ces théories) la « recomposition » de la classe sensée porter avec elle une atteinte majeure à ces luttes. ([4] [2341]).
Ce témoignage des réelles potentialités de la classe à l'heure actuelle nous est apporté par le fait même de l'ampleur des grèves et des manifestations de novembre-décembre 1995 : des centaines de milliers de grévistes, plusieurs millions de manifestants. Cependant, on ne peut s'arrêter à ce simple constat : après tout, au cours des années 1930, on a assisté à des mouvements de très grande ampleur comme les grèves de mai-juin 1936 en France ou l'insurrection des ouvriers d'Espagne contre le coup d'Etat fasciste du 18 juillet de la même année. Ce qui différencie fondamentalement les mouvements de la classe aujourd'hui de ceux des années 1930 c'est que ces derniers s'inscrivaient dans une longue suite de défaites de la classe ouvrière au lendemain de la vague révolutionnaire qui avait surgi au cours de la première guerre mondiale, des défaites qui avaient plongé le prolétariat dans la plus profonde contre-révolution de son histoire. Dans ce contexte de défaite physique et surtout politique du prolétariat, les manifestations de combativité de la classe avaient été facilement dévoyées par la bourgeoisie sur le terrain pourri de l'antifascisme, c'est-à-dire de la préparation de la seconde boucherie impérialiste. Nous ne reviendrons pas ici sur notre analyse du cours historique ([5] [2342]), mais ce qu'il s'agit d'affirmer clairement c'est que nous ne sommes pas aujourd'hui dans la même situation que dans les années 1930. Les mobilisations actuelles du prolétariat ne peuvent être en aucune façon des moments de la préparation de la guerre impérialiste mais prennent leur signification dans la perspective d'affrontements de classe décisifs contre le capitalisme plongé dans une crise sans issue.
Cela dit, ce qui confère une importance de premier plan aux mouvements sociaux de la fin de l'automne 1995 en France, ce n'est pas tant la grève et les manifestations ouvrières par elles-mêmes, que l'ampleur de la manoeuvre bourgeoise qui se trouve à leur origine.
Bien souvent, on peut évaluer l'état réel du rapport de forces entre les classes, dans la façon dont agit la bourgeoisie face au prolétariat. En effet, la classe dominante dispose de multiples moyens pour évaluer ce rapport de forces : sondages d'opinion, enquêtes de police (par exemple, en France, c'est une des missions des Renseignements Généraux, c'est-à-dire de la police politique, que de « tâter le pouls » des secteurs de la population « à risque », en premier lieu de la classe ouvrière). Mais l'instrument le plus important est constitué par l'appareil syndical qui est bien plus efficace encore que les sociologues des instituts de sondage ou que les fonctionnaires de police. En effet, cet appareil, dans la mesure où il a comme fonction de constituer l'instrument par excellence d'encadrement des exploités au service de la défense des intérêts capitalistes, où il dispose, en outre, d'une expérience de plus de 80 ans dans ce rôle, est particulièrement sensible à l'état d'esprit des travailleurs, à leur volonté et à leur capacité à engager des combats contre la bourgeoisie. C'est lui qui est chargé d'avertir en permanence les patrons et le gouvernement de l'importance du danger représenté par la lutte de classe. C'est d'ailleurs à cela que servent les rencontres périodiques entre les responsables syndicaux et le patronat ou le gouvernement : se concerter pour préparer ensemble la meilleure stratégie permettant à la bourgeoisie de porter ses attaques contre la classe ouvrière avec le maximum d'efficacité. Dans le cas des mouvements sociaux de la fin de l'année 1995 en France, l'ampleur et la sophistication de la manoeuvre organisée contre la classe ouvrière suffisent, à elles seules, à souligner à quel point la lutte de classe, la perspective de combats ouvriers de grande envergure, constituent aujourd'hui pour la bourgeoisie une préoccupation centrale.
La manoeuvre de la bourgeoisie contre la classe ouvrière
L'article du précédent numéro de la Revue Internationale décrit par le détail les différents aspects de la manoeuvre et comment ont collaboré à celle-ci tous les secteurs de la classe dominante, depuis la droite jusqu'aux organisations d'extrême gauche. Nous nous contenterons ici d'en rappeler les éléments essentiels :
- depuis l'été 1995, avalanche d'attaques de tous ordres (depuis une aggravation brutale des impôts jusqu'à une remise en cause des régimes de retraite des travailleurs du secteur public, en passant par le blocages des salaires de ces derniers, le tout étant couronné par un plan de réforme de la Sécurité sociale, le « plan Juppé » destiné à augmenter les cotisations des salariés et à réduire les remboursements des frais de maladie ;
- véritable provocation contre les cheminots sous la forme d'un « contrat de plan » entre l'Etat et la SNCF (la société des chemins de fer) qui prévoit un allongement de 7 ans du travail des conducteurs et des milliers de suppressions d'emplois ;
- utilisation de la mobilisation immédiate des cheminots comme « exemple à suivre » par les autres travailleurs du secteur public : contrairement à leur pratique habituelle d'enfermement des luttes, les syndicats se font les propagandistes zélés de leur extension et réussissent à entraîner de nombreux autres travailleurs, notamment dans les transports urbains, la poste, les télécommunications, l'électricité et le gaz, l'enseignement, les impôts ;
- médiatisation extrême des grèves qui sont présentées de façon très favorable à la télévision, on voit même des intellectuels signer en masse des déclarations en faveur de ce « réveil de la société » contre la « pensée unique » ;
- contribution des gauchistes à la manoeuvre : ils approuvent totalement l'attitude des syndicats à qui ils reprochent seulement de ne pas avoir fait la même chose plus tôt ;
- attitude intransigeante, dans un premier temps, du gouvernement qui rejette dédaigneusement les appels des syndicats à la négociation : l'arrogance et la morgue du Premier Ministre Juppé, personnage antipathique et impopulaire, sert admirablement les discours « combatifs » et jusqu'au-boutistes des syndicats ;
- puis, après trois semaines de grève, retrait par le gouvernement du « contrat de plan » dans les chemins de fer et des mesures contre les régimes de retraite des fonctionnaires : les syndicats crient victoire et parlent du « recul » du gouvernement ; malgré des résistances dans quelques centres « durs », les cheminots reprennent le travail, donnant le signal de la fin de la grève dans les autres secteurs.
Au total, grâce à ce prétendu « recul » prévu à l'avance, la bourgeoisie a remporté une victoire en faisant passer l'essentiel des mesures qui touchent tous les secteurs de la classe ouvrière comme l'augmentation des impôts et la réforme de la Sécurité Sociale, et même des mesures concernant spécifiquement les secteurs qui se sont mobilisés comme le blocage des salaires des agents de l'Etat. Mais la plus grande victoire de la bourgeoisie est politique : les travailleurs qui ont fait trois semaines de grève ne sont pas prêts à se relancer dans un mouvement de ce type lorsque pleuvront les nouvelles attaques. De plus, et surtout, ces grèves et ces manifestations ont permis aux syndicats de redorer de façon considérable leur blason : alors qu'auparavant l'image qui collait aux syndicats en France était celle de la dispersion des luttes, des journées d'action poussives et de la division, ils sont apparus tout au long du mouvement (principalement les deux principaux d'entre eux : la CGT d'obédience stalinienne et Force Ouvrière dirigée par des socialistes) comme ceux sans qui rien n'aurait été possible, ni l'élargissement et l'unité du mouvement, ni l'organisation de manifestations massives, ni les prétendus « reculs » du gouvernement. Comme nous le disions dans l'article du précédent numéro de la Revue Internationale :
« Cette recrédibilisation des syndicats constituait pour la bourgeoisie un objectif fondamental, un préalable indispensable avant de porter les attaques à venir qui seront encore bien plus brutales que celles d'aujourd'hui. C'est à cette condition seulement qu'elle peut espérer saboter les luttes qui ne manqueront pas de surgir au moment de ces attaques. »
En fait, l'importance considérable que la bourgeoisie accorde à la recrédibilisation des syndicats s'est confirmée amplement à la suite du mouvement, notamment dans la presse avec de nombreux articles soulignant le « come back » syndical. Il est intéressant de noter que dans une des feuilles confidentielles que se donne la bourgeoisie pour informer ses principaux responsables, on peut lire : « Un des signes les plus clairs de cette reconquête syndicale est la volatilisation des coordinations. Elles avaient été perçues comme le témoignage de la non-représentativité syndicale. Qu'elles n'aient pas surgi cette fois montre que les efforts des syndicats pour mieux "coller au terrain" et restaurer un "syndicalisme de proximité" n'ont pas été vains. » ([6] [2343]). Et cette feuille se plaît à citer une déclaration, présentée comme « un soupir de soulagement », d'un patron du secteur privé : « Nous avons enfin à nouveau un syndicalisme fort. »
Les incompréhensions du milieu révolutionnaire
Le fait de constater que les mouvements de la fin 1995 en France résultent avant tout d'une manoeuvre très soigneusement élaborée et mise en place par tous les secteurs de la bourgeoisie ne constitue en aucune façon une quelconque remise en cause des capacités de la classe ouvrière à affronter le capital dans des combats de très grande ampleur, bien au contraire. C'est justement dans les moyens considérables mis en oeuvre par la classe dominante pour prendre les devants des combats futurs du prolétariat qu'on peut déceler à quel point celle-ci est préoccupée par cette perspective. Encore faut-il pour cela qu'on soit en mesure d'identifier la manoeuvre déployée par la bourgeoisie. Malheureusement si cette manoeuvre n'a pu être démasquée par les masses ouvrières, et elle était suffisamment sophistiquée pour qu'il en soit ainsi, elle a également trompé ceux dont une des responsabilités essentielles est de dénoncer tous les coups fourrés que les exploiteurs portent contre les exploités : les organisations communistes.
Ainsi les camarades de Battaglia Comunista (BC) pouvaient-ils écrire, dans le numéro de décembre 1995 de leur journal : « Les syndicats ont été pris à contre-pied par la réaction décidée des travailleurs contre les plans gouvernementaux. »
Et il ne s'agit pas là d'un jugement hâtif de BC résultant d'une information encore insuffisante puisque, dans le numéro de janvier 1996, BC revient à la charge avec la même idée :
« Contre le plan Juppé, les employés du secteur public se sont mobilisés spontanément. Et c'est bien de rappeler que les premières manifestations des travailleurs se sont déroulées sur le terrain de la défense immédiate des intérêts de classe, prenant par surprise les organisations syndicales elles-mêmes, démontrant encore une fois que lorsque le prolétariat bouge pour se défendre contre les attaques de la bourgeoisie, il le fait presque toujours en dehors et contre les directives syndicales. Ce n'est que dans une seconde phase que les syndicats français, surtout Force Ouvrière et la CGT, ont pris en marche le train de la protestation récupérant ainsi de leur crédibilité aux yeux des travailleurs. Mais l'implication aux apparences de radicalité de Force Ouvrière et des autres syndicats cachait de mesquins intérêts de la bureaucratie syndicale qu'on ne peut comprendre que si l'on connaît le système de protection sociale français [où les syndicats, particulièrement Force Ouvrière, assurent la gestion des fonds, ce qui est justement remis en cause par le plan Juppé] ».
C'est un peu la même thèse qu'on retrouve de la part de l'organisation-soeur de BC au sein du Bureau International pour le Parti Révolutionnaire, la Communist Workers' Organisation (CWO). Dans sa revue Revolutionary Perspectives n° 1, 3e Série, on peut lire :
« Les syndicats, particulièrement FO, la CGT et la CFDT ([7] [2344]) s'opposaient à ce changement. Cela aurait constitué un coup majeur porté contre les prérogatives des dirigeants syndicaux. Cependant, tous, à un moment ou à un autre, avant les annonces de Juppé, avaient soit accueilli favorablement le dialogue avec le Gouvernement, soit accepté la nécessité de nouveaux impôts. C'est seulement quand la colère ouvrière contre les dernières propositions est devenue claire que les syndicats ont commencé à se sentir menacés par plus important que la perte de leur contrôle sur des domaines financiers majeurs. »
Dans l'analyse des deux groupes du BIPR, il existe toute une insistance sur le fait que les syndicats ne cherchaient qu'à défendre des « intérêts mesquins » en appelant à la mobilisation contre le plan Juppé sur la Sécurité Sociale. Même si les dirigeants syndicaux sont évidemment sensibles à leurs petits intérêts de boutique, une telle analyse de leur attitude revient à observer la réalité par le petit bout de la lorgnette. C'est comme si on interprétait les disputes dont sont coutumières les centrales syndicales uniquement comme manifestation de la concurrence entre elles sans y voir l'aspect fondamental : un des moyens par excellence de diviser la classe ouvrière. En réalité, ces « intérêts mesquins » des syndicats ne peuvent s'exprimer que dans le cadre de ce qui constitue leur rôle dans la société d'aujourd'hui : celui de pompiers de l'ordre social capitaliste, de flics de l'Etat bourgeois dans les rangs ouvriers. Et s'il leur faut renoncer à leurs « intérêts mesquins » et de boutique pour pouvoir tenir ce rôle, ils n'hésitent pas à le faire car ils ont un parfait sens des responsabilités dans la défense des intérêts du capital contre la classe ouvrière. En menant leur politique de la fin 1995, les dirigeants syndicaux savaient parfaitement qu'elle allait permettre à Juppé de faire passer son plan qui les privait de certaines de leurs prérogatives financières, mais ils avaient fait leur deuil de celles-ci au nom des intérêts supérieurs de l'Etat capitaliste. En fait, il est de loin préférable pour les appareils syndicaux de laisser croire qu'ils prêchent pour leur propre chapelle (ils pourront toujours se réfugier derrière l'argument que leur propre force contribue à celle de la classe ouvrière) plutôt que de se démasquer pour ce qu'ils sont réellement : des rouages essentiels de l'ordre bourgeois.
En réalité, si nos camarades du BIPR sont tout à fait clairs sur la nature parfaitement capitaliste des syndicats, ils commettent une sous-estimation considérable du degré de solidarité qui les lient à l'ensemble de la classe dominante et, notamment, de leur capacité à organiser avec le gouvernement et les patrons des manoeuvres destinées à piéger la classe ouvrière.
Ainsi, tant pour la CWO que pour BC, il existe l'idée, bien qu'avec des nuances ([8] [2345]), que les syndicats ont été surpris, voire débordés, par l'initiative de la classe ouvrière. Rien n'est plus contraire à la réalité. S'il existe un exemple depuis ces dix dernières années en France où les syndicats ont parfaitement prévu et contrôlé un mouvement social, c'est bien celui de la fin 1995. Plus, c'est un mouvement qu'ils ont suscité de façon systématique, avec la complicité du gouvernement, comme nous l'avons vu plus haut et analysé par le détail dans notre précédent article. Et la meilleure preuve qu'il n'y avait aucun « débordement » ni aucune « surprise » pour la bourgeoisie et son appareil syndical, c'est la couverture médiatique que la bourgeoisie des autres pays a immédiatement donnée aux événements. Depuis longtemps, et particulièrement depuis les grandes grèves de Belgique qui, à l'automne 1983, avaient annoncé la sortie de la classe de la démoralisation et la désorientation qui avaient accompagné la défaite des ouvriers en Pologne, en 1981, la bourgeoisie s'est fait un devoir d'organiser au niveau international un black-out complet autour des luttes ouvrières. Ce n'est que lorsque ces luttes correspondent à une manoeuvre planifiée par la bourgeoisie, comme ce fut le cas en Allemagne au printemps 1992, que le black-out fait alors place à une profusion d'informations (orientées, évidemment). Dans ce cas déjà, les grèves du secteur public, et notamment dans les transports, avaient comme objectif de « présenter les syndicats, qui avaient systématiquement organisé toutes les actions, maintenant les ouvriers dans la plus grande passivité, comme les véritables protagonistes contre les patrons » ([9] [2346]). Dans le cas des mouvements de la fin 1995 en France, on a assisté, de ce point de vue, à un « remake » de ce que la bourgeoisie avait fomenté en Allemagne trois ans et demi plus tôt. En fait, l'intense bombardement médiatique qui a accompagné ces mouvements (même au Japon c'est de façon quotidienne que la télévision diffusait abondamment des images de la grève et des manifestations) ne signifie pas seulement que la bourgeoisie et ses syndicats les contrôlaient parfaitement et depuis le début, non seulement qu'ils avaient été prévus et planifiés par ces derniers, mais aussi que c'est à l'échelle internationale que la classe dominante avait organisé cette manoeuvre afin de porter un coup à la conscience de la classe ouvrière des pays avancés.
La meilleure preuve de cette réalité est la façon dont la bourgeoisie belge a manoeuvré à la suite des mouvements sociaux en France :
- alors que les médias parlent à propos de la France d'un « nouveau mai 68 », les syndicats lancent, fin novembre 1995, exactement comme en France, des mouvements contre les atteintes au secteur public, et particulièrement contre la réforme de la Sécurité Sociale ;
- c'est alors que la bourgeoisie organise une véritable provocation en annonçant des mesures d'une brutalité inouïe dans les chemins de fer (SNCB) et les transports aériens (Sabena) ; comme en France, les syndicats se portent résolument au devant de la mobilisation dans ces deux secteurs présentés comme exemplaires, et les cheminots belges sont invités à faire comme leurs collègues français ;
- la bourgeoisie fait alors mine de reculer ce qui est évidemment présenté comme une victoire de la mobilisation syndicale et qui permet le succès d'une grande manifestation de tout le secteur public, le 13 décembre, parfaitement contrôlée par les syndicats et où l'on note la présence d'une délégation de cheminots français de la CGT ; le quotidien De Morgen titre le 14 décembre : « Comme en France, ou presque » ;
- deux jours plus tard, nouvelle provocation gouvernementale et patronale à la SNCB et à la Sabena où la direction annonce le maintien de ses mesures : les syndicats relancent des luttes « dures » (il y a des affrontements avec la police sur l'aéroport de Bruxelles bloqué par les grévistes) et essaient d'élargir la manoeuvre aux autres secteurs du public et aussi dans le privé où des délégations syndicales venues « apporter leur solidarité » aux travailleurs de la Sabena affirment que « leur lutte constitue un laboratoire social pour l'ensemble des travailleurs » ;
- finalement, début janvier, le patronat fait de nouveau mine de reculer en annonçant l'ouverture du « dialogue social », tant à la SNCB qu'à la Sabena, « sous la pression du mouvement » ; comme en France, le mouvement se solde par une victoire et une crédibilisation des syndicats.
Franchement camarades du BIPR, pensez-vous que cette remarquable ressemblance entre ce qui s'est passé en France et en Belgique était le fruit du hasard, que la bourgeoisie et ses syndicats n'avait rien prévu à l'échelle internationale ?
En réalité, l'analyse de la CWO et de BC témoigne d'une dramatique sous-estimation de l'ennemi capitaliste, de sa capacité de prendre les devants lorsqu'il sait que les attaques de plus en plus brutales qu'il sera conduit à porter contre la classe ouvrière provoqueront nécessairement de la part de celle-ci des réactions de grande envergure dans lesquelles les syndicats devront être mis abondamment à contribution pour la préservation de l'ordre bourgeois. La position prise par ces organisations donne l'impression d'une naïveté incroyable, d'une vulnérabilité déconcertante face aux pièges tendus par la bourgeoisie.
Cette naïveté, nous l'avions déjà constatée à plusieurs reprises, notamment de la part de BC. C'est ainsi que cette organisation, lors de l'effondrement du bloc de l'Est, était tombée dans le piège des campagnes bourgeoisies sur les perspectives souriantes que cet événement était sensé représenter pour l'économie mondiale ([10] [2347]). Parallèlement, BC avait marché à fond dans le mensonge de la prétendue « insurrection » en Roumanie (en réalité un coup d'Etat permettant le remplacement par d'anciens apparatchiks à la Ion Iliescu d'un Ceaucescu honni). A cette occasion, BC n'avait pas craint d'écrire : « La Roumanie est le premier pays dans les régions industrialisées dans lequel la crise économique mondiale a donné naissance à une réelle et authentique insurrection populaire dont le résultat a été le renversement du gouvernement en place (...) en Roumanie, toutes les conditions objectives et presque toutes les conditions subjectives étaient réunies pour transformer l'insurrection en une réelle et authentique révolution sociale. » Camarades de BC, lorsqu'on est conduit à écrire de telles sottises, on doit essayer d'en tirer des leçons. En particulier, on se méfie un peu plus des discours de la bourgeoisie. Sinon, si l'on se laisse piéger par les trucs de la classe bourgeoise destinés à berner les masses ouvrières, comment peut-on se prétendre l'avant garde de celles-ci ?
La nécessité d'un cadre d'analyse historique
En réalité, les bourdes commises par BC (tout comme la CWO qui, en 1981, appelait les ouvriers de Pologne à « La révolution maintenant ! ») ne sont pas réductibles à des caractéristiques psychologiques ou intellectuelles, la naïveté, de leurs militants. Il existe dans ces organisations des camarades expérimentés et d'une intelligence correcte. La véritable cause des erreurs à répétition de ces organisations, c'est qu'elles se sont systématiquement refusées à prendre en compte le seul cadre dans lequel on puisse comprendre l'évolution de la lutte du prolétariat : celui du cours historique aux affrontements de classe qui a succédé, à la fin des années 1960, à la période de contre-révolution. Nous avons déjà, à plusieurs reprises mis en évidence cette grave erreur de BC à laquelle s'est ralliée la CWO ([11] [2348]). En réalité, c'est la notion même de cours historique que BC remet en cause : « Quand nous parlons d'un "cours historique" c'est pour qualifier une période... historique, une tendance globale et dominante de la vie de la société qui ne peut être remise en cause que par des événements majeurs de celle-ci... En revanche, pour Battaglia... il s'agit d'une perspective qui peut être remise en cause, dans un sens comme dans l'autre, à chaque instant puisqu'il n'est pas exclu qu'au sein même d'un cours à la guerre il puisse intervenir "une rupture révolutionnaire"... la vision de Battaglia ressemble à une auberge espagnole : dans la notion de cours historique chacun apporte ce qu'il veut. On trouvera la révolution dans un cours vers la guerre comme la guerre mondiale dans un cours aux affrontements de classe. Ainsi chacun y trouve son compte : en 1981, le CWO appelait les ouvriers de Pologne à la révolution alors que le prolétariat mondial était supposé n'être pas encore sorti de la contre révolution. Finalement, c'est la notion de cours qui disparaît totalement ; voila où en arrive BC : éliminer toute notion d'une perspective historique... En fait, la vision de BC (et du BIPR) porte un nom : l'immédiatisme. » ([12] [2349])
C'est l'immédiatisme qui explique la « naïveté » de BC : hors d'un cadre historique de compréhension des évènements, cette organisation en est conduite à croire ce que les medias bourgeois racontent à leur propos.
C'est l'immédiatisme qui permet de comprendre pourquoi, par exemple, en 1987-88 les groupes du BIPR, face aux luttes ouvrières, s'amusent à la balançoire entre un total scepticisme et un grand enthousiasme : la lutte de 1987 dans le secteur de l'école, en Italie, d'abord considérée par BC sur le même plan que celle des pilotes d'avion ou des magistrats devient par la suite le début « d'une phase nouvelle et intéressante de la lutte de classe en Italie. » A la même période, on peut voir la CWO osciller de la même façon face aux luttes en Grande-Bretagne. ([13] [2350])
C'est le même immédiatisme qui fait écrire à BC de janvier 1996 que « La grève des travailleurs français, au delà de l'attitude opportuniste (sic) des syndicats, représente vraiment un épisode d'une importance extraordinaire pour la reprise de la lutte de classe ». Pour BC, ce qui faisait cruellement défaut dans cette lutte, pour lui éviter la défaite, c'est un parti prolétarien. Si le parti qui, effectivement, devra être constitué pour que le prolétariat puisse réaliser la révolution communiste, devait s'inspirer de la même démarche immédiatiste que celle dont ne s'est pas départie, malgré toutes ses bourdes, le BIPR, alors, il faudrait craindre pour le sort de la révolution.
En fait, c'est justement en tournant fermement le dos à l'immédiatisme, en ayant la préoccupation constante de replacer les moments actuels de la lutte de classe dans leur contexte historique qu'on peut les comprendre et assumer un véritable rôle d'avant garde de la classe.
Ce cadre, c'est évidemment celui du cours historique, nous n'y reviendrons pas. Mais, plus précisément, c'est celui qui prévaut depuis l'effondrement des régimes staliniens à la fin des années 1980 et qui est sommairement rappelé au début de cet article. C'est dès la fin de l'été 1989, deux mois avant la chute du mur de Berlin que le CCI s'est attelé à élaborer le nouveau cadre d'analyse permettant de comprendre l'évolution de la lutte de classe :
« C'est donc à un recul momentané de la conscience du prolétariat... qu'il faut s'attendre. Si les attaques incessantes et de plus en plus brutales que le capitalisme ne manquera pas d'asséner contre les ouvriers vont les contraindre à mener le combat, il n'en résultera pas, dans un premier temps, une plus grande capacité pour la classe à avancer dans sa prise de conscience. En particulier, l'idéologie réformiste pèsera très fortement sur les luttes de la période qui vient, favorisant grandement l'action des syndicats.
Compte tenu de l'importance historique des faits qui le déterminent, le recul actuel du prolétariat, bien qu'il ne remette pas en cause le cours historique, la perspective générale aux affrontements de classe, se présente comme bien plus profond que celui qui avait accompagné la défaite de 1981 en Pologne. » ([14] [2351])
Par la suite, le CCI a été conduit à intégrer dans ce cadre les nouveaux événements de très grande importance qui se sont succédés :
« Une telle campagne [sur la "mort du communisme" et le "triomphe" du capitalisme] a obtenu un impact non négligeable parmi les ouvriers, affectant leur combativité et leur conscience. Alors que cette combativité connaissait un nouvel essor, au printemps 1990, notamment à la suite des attaques résultant du début d'une récession ouverte, elle a été de nouveau atteinte par la crise et la guerre du Golfe. Ces événements tragiques ont permis de faire justice du mensonge sur le "nouvel ordre mondial" annoncé par la bourgeoisie lors de la disparition du bloc de l'Est sensé être le principal responsable des tension militaires (...) Mais en même temps, la grande majorité de la classe ouvrière des pays avancés, à la suite des nouvelles campagnes de mensonges bourgeois, a subi cette guerre avec un fort sentiment d'impuissance qui a réussi à affaiblir considérablement ses luttes. Le putsch de l'été 1991 en URSS et la nouvelle déstabilisation qu'il a entraînée, de même que la guerre civile en Yougoslavie, ont contribué à leur tour à renforcer ce sentiment d'impuissance. L'éclatement de l'URSS et la barbarie guerrière qui se déchaîne en Yougoslavie sont la manifestation du degré de décomposition atteint aujourd'hui par la société capitaliste. Mais, grâce à tous les mensonges assénés par ses médias, la bourgeoisie a réussi à masquer la cause réelle de ces événements pour en faire une nouvelle manifestation de la "mort du communisme", ou bien une question de "droit des peuples à disposer d'eux-mêmes" face auxquelles les ouvriers n'ont d'autre alternative que d'être des spectateurs passifs et de s'en remettre à la "sagesse" de leurs gouvernements. » ([15] [2352])
En fait, la guerre en Yougoslavie, par son horreur, sa durée et par le fait qu'elle se déroulait tout près des grandes concentrations prolétariennes d'Europe occidentale a constitué un des éléments essentiels permettant d'expliquer l'importance des difficultés rencontrées par le prolétariat à l'heure actuelle. En effet, elle cumule (même si à un niveau moindre) les dégâts provoqués par l'effondrement du bloc de l'Est, des illusions et un désarroi important parmi les ouvriers, et ceux provoqués par la guerre du Golfe, un profond sentiment d'impuissance, sans pour autant apporter, comme cette dernière, une mise en évidence des crimes et de la barbarie des grandes « démocraties ». Elle constitue une claire illustration de comment la décomposition du capitalisme, dont elle est aujourd'hui une des manifestations les plus spectaculaires, joue comme un obstacle de premier plan contre le développement des luttes et de la conscience du prolétariat.
Un autre aspect qu'il importe de souligner, notamment parce qu'il concerne l'arme par excellence de la bourgeoisie contre la classe ouvrière, les syndicats, c'est le fait qui était déjà signalé en septembre 1989 dans nos « thèses » : « l'idéologie réformiste pèsera très fortement sur les luttes dans la période qui vient, favorisant grandement l'action des syndicats. » Cela découlait du fait, non pas que les ouvriers se faisaient encore des illusions sur « le paradis socialiste », mais que l'existence d'un type de société présenté comme « non capitaliste » semblait signifier qu'il pouvait exister autre chose sur terre que le capitalisme. La fin de ces régimes a été présenté comme « la fin de l'histoire » (terme utilisé très sérieusement par des « penseurs » bourgeois). Dans la mesure où le terrain par excellence des syndicats et du syndicalisme est l'aménagement des conditions de vie du prolétariat dans le capitalisme, les événements de 1989, aggravés par toute la succession de coups portés à la classe ouvrière depuis, ne pouvaient qu'aboutir, comme on l'a constaté effectivement, à un retour en force des syndicats ; un retour en force célébré par la bourgeoisie lors des mouvements sociaux de la fin 1995.
En fait, cette remise en selle des syndicats ne s'est pas faite immédiatement. Ces organisations avaient amassé, tout au long des année 1980 notamment, un tel discrédit, du fait de leur contribution permanente au sabotage des luttes ouvrières, qu'il leur était difficile de revenir du jour au lendemain dans le rôle de défenseurs intransigeants de la classe ouvrière. Aussi, leur retour en scène s'est-il produit en plusieurs étapes au cours desquelles ils se sont de plus en plus présentés comme l'instrument indispensable des combats ouvriers.
Un exemple de ce retour en force progressif des syndicats nous est donné par l'évolution de la situation en Allemagne où, après les grandes manoeuvres dans le secteur public du printemps 1992, il y avait encore eu place pour les luttes spontanées, en dehors des consignes syndicales, de l'automne 1993, dans la Ruhr avant qu'au début 1995, les grèves dans la métallurgie ne les remettent beaucoup plus en selle. Mais l'exemple le plus significatif de cette évolution est celui de l'Italie. A l'automne 1992, l'explosion violente de colère ouvrière contre le plan Amato voit des centrales syndicales prises pour cible de cette même colère. Ensuite, un an plus tard, ce sont les « coordinations des conseils de fabrique », c'est-à-dire des structures du syndicalisme de base qui animent les grandes « mobilisations » de la classe ouvrière et les grandes manifestations qui parcourent le pays. Enfin, la manifestation « monstre » de Rome, au printemps 1994, la plus imposante depuis la seconde guerre mondiale, a constitué un chef d'oeuvre du contrôle syndical.
Pour comprendre ce retour en force des syndicats, il importe de souligner qu'il a été facilité et permis par le maintien de l'idéologie syndicale dont les syndicats « de base » ou « de combat » sont les ultimes défenseurs. En Italie, par exemple, ce sont eux qui ont animé la contestation des syndicats officiels (en apportant aux manifestations les oeufs et les boulons destinés aux bonzes) avant que d'ouvrir le chemin de la récupération syndicale de 1994 par leurs propres « mobilisations » de 1993. Ainsi, dans les combats à venir, après que les syndicats officiels se soient à nouveau discrédités du fait de leur indispensable travail de sabotage, la classe ouvrière devra encore s'attaquer au syndicalisme et à l'idéologie syndicaliste représentés par les syndicats de base qui ont si bien travaillé pour leurs grands frères au cours de ces dernières années.
Cela signifie que c'est encore un long chemin qui attend la classe ouvrière. Mais les difficultés qu'elle rencontre ne doivent pas être un facteur de démoralisation, particulièrement parmi ses éléments les plus avancés. La bourgeoisie, pour sa part, sait parfaitement quelles sont les potentialités que porte en lui le prolétariat. C'est pour cela qu'elle organise des manoeuvres comme celle de la fin 1995. C'est pour cela que, cet hiver, lors du colloque de Davos qui traditionnellement rassemble les 2000 « décideurs » les plus importants du monde dans le domaine économique et politique (et où participait Marc Blondel, chef du syndicat français Force Ouvrière) on a pu voir ces décideurs se préoccuper avec inquiétude de l'évolution de la situation sociale. C'est ainsi que parmi beaucoup d'autres, on a pu entendre des discours de ce genre : « Il faut créer la confiance parmi les salariés et organiser la coopération entre les entreprises afin que les collectivités locales, les villes et les régions bénéficient de la mondialisation. Sinon, nous assisterons à la résurgence de mouvements sociaux comme nous n'en avons jamais vus depuis la seconde guerre. » ([16] [2353])
Ainsi, comme les révolutionnaires l'ont toujours mis en évidence, et comme nous le confirme la bourgeoisie elle-même, la crise de l'économie capitaliste constitue le meilleur allié du prolétariat, celui qui lui ouvrira les yeux sur l'impasse du monde actuel et lui fournira la volonté de le détruire malgré les multiples obstacles que tous les secteurs de la classe dominante ne manqueront pas de semer sur son chemin.
FM, 12/03/96.
[1] [2354] « Résolution sur la situation internationale », 11e Congrès du CCI, point 14, Revue Internationale n° 82.
[16] [2369] Rosabeth Moss Kanter, ancien directeur de la Harvard Business Review, citée par Le Monde Diplomatique de mars 1996.
Géographique:
- France [1248]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [143]
Heritage de la Gauche Communiste:
- La question syndicale [2290]
Revolution allemande (IV) : fraction ou nouveau parti ?
- 3962 reads
Dans les trois précédents articles, nous avons montré que la classe ouvrière, par ses luttes, avait contraint le Capital à mettre fin à la première guerre mondiale. Afin d'empêcher une extension de la vague révolutionnaire, le Capital a tout entrepris pour séparer la classe ouvrière d'Allemagne de celle de Russie, pour saboter toute radicalisation ultérieure des luttes. Dans cet article nous voulons montrer comment les révolutionnaires en Allemagne ont été confrontés à la question de la construction de l'organisation face à la trahison de la social-démocratie.
Le déclenchement de la première guerre mondiale n'a été possible que parce que les partis de la 2e Internationale, dans leur majorité, se sont soumis aux intérêts de chaque capital national. Après l'engagement sans hésitation des syndicats dans la politique d' « Union sacrée » avec la bourgeoisie, l'approbation des crédits de guerre par la fraction parlementaire et l'Exécutif du SPD a rendu possible le déclenchement de la guerre par le capital allemand. Le vote des crédits de guerre n'est pas une surprise dans la mesure où il constitue l'aboutissement de toute un processus de dégénérescence de l'aile opportuniste de la Social-démocratie. L'aile gauche avait déjà lutté de toutes ses forces, avant la guerre, contre cette dégénérescence. Dès le premier jour des hostilités les internationalistes se rassemblent sous la bannière du groupe qu'ils vont nommer « Spartakus ». La première des responsabilités qu'ils se fixent est la défense de l'internationalisme prolétarien contre la trahison de la direction du SPD. Cela ne signifie pas, pour eux, de faire seulement de la propagande en faveur de cette position programmatique fondamentale mais aussi et surtout de défendre l'organisation politique de la classe ouvrière, dont la direction a trahi, contre son étranglement par les forces du capital. Les internationalistes, à l'unanimité, sont décidés à ne pas laisser tomber le parti aux mains des traîtres et tous travaillent à sa reconquête. Aucun d'entre eux ne veut en sortir de plein gré. Au contraire, tous choisissent d'accomplir un travail de fraction en son sein afin d'en expulser la direction social-patriote.
Les principaux bastions de la trahison sont constitués par les syndicats qui sont irrémédiablement intégrés dans l'État bourgeois. Il n'y a là plus rien à reconquérir. Le SPD constitue, quant à lui, un lieu de trahison mais en même temps un lieu où s'exprime une résistance prolétarienne. Même la fraction parlementaire du Reichstag se divise clairement entre traîtres et internationalistes. Comme nous l'avons montré dans l'article de la Revue internationale n° 81, des voix contre la guerre se sont élevées rapidement au Reichstag malgré de grandes difficultés et une certaine hésitation. Mais, dès ce moment-là, c'est surtout à la base du parti-même que se développe le levier le plus puissant contre la trahison.
« Nous accusons la fraction du Reichstag d'avoir trahi les principes fondamentaux du parti, et, avec eux, l'esprit de la lutte des classes. La fraction parlementaire s'est ainsi elle-même mise en dehors du parti ; elle a cessé d'être la représentante autorisée de la social-démocratie allemande. » ([1] [2370])
Tous les internationalistes sont d'accord pour ne pas abandonner l'organisation aux traîtres. « Cela ne signifie pas que la séparation immédiate d'avec les opportunistes soit, dans tous les pays, souhaitable ou même possible ; cela signifie que la séparation est, historiquement, mure, qu'elle est devenue inéluctable et qu'elle représente un pas en avant, une nécessité pour le combat révolutionnaire du prolétariat, que le tournant historique de l'entrée du capitalisme "pacifique" dans le stade de l'impérialisme met une telle séparation à l'ordre du jour. » ([2] [2371])
Nous avons montré dans la Revue internationale n° 81 que les Spartakistes et les « Linksradikale », dans d'autres villes, poursuivent, dans un premier temps, le but de construire un rapport de forces qui doit mettre la direction social-patriote en minorité. Mais ensuite, comment mettre à exécution la rupture organisationnelle avec les traîtres ? Il est clair que traîtres et internationalistes ne peuvent pas coexister dans le même parti. Les uns doivent l'emporter sur les autres. Le fait est que la direction, à cause de la résistance des Spartakistes, se trouve de plus en plus dans l'embarras, que le parti dans son ensemble suit de moins en moins les traîtres.Ces derniers sont ainsi contraints d'engager une offensive contre les internationalistes pour les asphyxier.
La question se pose alors : comment réagir face à cette attaque? Faut-il claquer la porte et fonder aussitôt une nouvelle organisation en dehors du SPD ?
Par rapport à cela, des divergences apparaissent au sein de la Gauche. Alors que les social-patriotes commencent à chasser les révolutionnaires du SPD (d'abord de la fraction parlementaire, ensuite du parti lui même ; ainsi après Liebknecht, exclu en décembre 1915, c'est au tour des députés ayant voté contre les crédits de guerre d'être éjectés du groupe parlementaire au printemps 1916) est discutée la question : jusqu'à quel point faut-il lutter pour reconquérir l'organisation ?
L'attitude de Rosa Luxemburg est claire : « On peut "sortir" de petites sectes et de cénacles quand ils ne vous conviennent plus pour fonder de nouvelles sectes et de nouveaux cénacles. Vouloir, par une simple "sortie", libérer les masses de prolétaires du joug horriblement pesant et funeste et leur montrer ainsi par ce vaillant exemple la voie à suivre, n'est que rêverie immature. Se donner l'illusion de libérer les masses en déchirant sa carte de membre n'est que l'expression renversée du fétichisme de la carte du parti comme pouvoir illusoire. Ces deux attitudes ne sont que les pôles différents du crétinisme organisationnel (...). La décomposition de la social-démocratie allemande fait partie d'un processus historique aux dimensions les plus larges, de l'affrontement général entre bourgeoisie et classe ouvrière, champ de bataille qu'il est impossible de déserter par dégoût. Il nous faut livrer ce combat titanesque jusqu'aux dernières extrémités. Il nous faut arracher pour le rompre de toutes nos forces réunies le mortel noeud coulant que la social-démocratie allemande officielle, les syndicats libres officiels et la classe dominante ont glissé autour de la gorge des masses trompées et trahies. La liquidation de ce tas de putréfaction organisée qui s'appelle aujourd'hui social-démocratie, n'est pas une affaire privée qui dépende de la décision personnelle d'un ou de plusieurs groupes. (...) Elle doit être réglée comme large question publique du pouvoir en déployant toutes nos forces. » ([3] [2372])
« Le mot d'ordre n'est ni scission ni unité ; ni nouveau parti ni vieux parti, mais reconquête du parti de bas en haut par la rébellion des masses qui doivent prendre dans leurs propres mains les organisations et leurs moyens, non par des mots mais par une rébellion en actes. (...) Le combat décisif pour le parti a commencé. » ([4] [2373])
Le travail de fraction
Alors que Rosa Luxemburg maintient fermement l'idée de rester le plus longtemps possible dans le SPD et qu'elle est le plus fortement convaincue de la nécessité du travail de fraction, la Gauche de Brême commence à soutenir la nécessité d'une organisation indépendante.
Jusque fin 1916, début 1917, cette question ne constitue pas un point de litige. K. Radek, l'un des principaux représentants de la Gauche de Brême affirme lui-même :
« Faire la propagande en faveur de la scission ne signifie pas que nous devrions sortir dés maintenant du parti. Au contraire : nos efforts doivent viser à nous emparer de toutes les organisations et de tous les organes possibles du parti. (...) Notre devoir est de nous maintenir à nos postes le plus longtemps possible, car plus longtemps nous nous y maintiendrons, plus nombreux seront les ouvriers qui nous suivront dans le cas où nous serions exclus par les social-impérialistes qui naturellement comprennent parfaitement quelle est notre tactique, même si nous la passions sous silence. (...) L'une des tâches de l'heure est que les organisations locales du parti qui se trouvent sur le terrain de l'opposition s'unissent et établissent une direction provisoire de l'opposition déterminée. » ([5] [2374])
C'est donc un mensonge que d'affirmer que la Gauche de Brême aurait aspiré à une séparation organisationnelle immédiatement en août 1914. Ce n'est qu'à partir de 1916, lorsque le rapport de forces au sein du SPD commence à être de plus en plus chancelant, que les groupes de Dresde et de Hambourg commencent à plaider pour une organisation indépendante, même s'ils n'ont pas sur cette question de conceptions organisationnelles solides.
Le bilan des deux premières années de la guerre montre que les révolutionnaires ne se sont pas laissés museler et qu'aucun des groupes n'a renoncé à son indépendance organisationnelle. S'ils avaient abandonné l'organisation aux mains des social-patriotes en 1914 cela aurait signifié jeter les principes par dessus bord. Et même en 1915, quand le mécontentement dans la classe ouvrière commence à s'exprimer et que de plus en plus d'actions de riposte se mettent en mouvement, ce n'est pas encore le moment pour édifier une nouvelle organisation indépendante en dehors du SPD. Tant qu'il n'existe pas un rapport de forces suffisant, tant qu'il n'existe pas suffisamment de force pour combattre dans les rangs prolétariens eux-mêmes et que les révolutionnaires se trouvent être encore en si petite minorité, bref, tant que les conditions pour la « fondation du parti » ne sont pas remplies, il est nécessaire d'effectuer un travail de fraction dans le SPD.
Un rapide tour d'horizon de la situation, à ce moment-là, montre que le choc de la trahison de la direction du parti en août 1914 continue à faire sentir ses effets, que la classe ouvrière, avec la victoire passagère du nationalisme, a essuyé une lourde défaite et que, de ce fait, il est impossible de fonder un nouveau parti. Il s'agit d'abord de mener la lutte pour l'ancien parti, accomplir un dur travail de fraction et ensuite effectuer les préparatifs pour la construction d'un nouveau parti. La fondation immédiate de celui-ci en 1914 est impensable car la classe ouvrière doit d'abord se remettre des effets de la défaite. Pour les internationalistes, ni la sortie directe du SPD, ni la fondation d'un nouveau parti ne sont à l'ordre du jour à ce moment-là.
En septembre 1916 le Comité directeur du SPD convoque une conférence nationale du parti. Bien que les mandats des délégués soient manipulés par ses soins, la direction perd de son emprise sur l'opposition. Cette dernière décide de ne plus verser de cotisations à l'Exécutif. Mais celui-ci réplique aussitôt par l'exclusion de tous ceux qui adoptent cette attitude et en premier lieu la Gauche de Brême.
Dans cette situation qui s'envenime rapidement, où le Comité directeur se trouve de plus en plus récusé dans le parti, où la classe réagit de plus en plus contre la guerre, où l'Exécutif a commencé à procéder à des exclusions plus importantes, les Spartakistes ne se prononcent toujours pas pour partir, pour quitter le SPD « par tranches » comme le recommandent une partie des camarades de Brême suite à la tactique de la grève des cotisations :
« Une telle scission dans les circonstances données ne signifierait pas l'expulsion hors du parti des majoritaires et des hommes de Scheidemann à laquelle nous aspirons mais conduirait nécessairement à disperser les meilleurs camarades du parti dans des petits cercles et à les condamner à la complète impuissance. Nous tenons cette tactique pour dommageable et même néfaste. » ([6] [2375]) Les Spartakistes se prononcent pour une démarche unitaire et non pas dispersée vis-à-vis des social-patriotes. En même temps, ils soulignent le critère clair déterminant leur présence dans le SPD :
« L'appartenance à l'actuel SPD ne devra être maintenue par l'opposition que tant que son action politique indépendante ne sera pas entravée et paralysée par celui-ci. L'opposition ne demeure dans le parti que pour combattre sans cesse la politique de la majorité et pour s'interposer, pour protéger les masses de la politique impérialiste pratiquée sous le manteau par la social-démocratie et afin d'utiliser le parti comme terrain de recrutement pour la lutte de classes prolétarienne anti-impérialiste. » E. Meyer déclare :
« Nous ne restons dans le parti que tant que nous pouvons y mener la lutte de classes contre le Comité directeur du parti. Du moment que nous en serions empêchés, nous ne voudrions pas y rester. Nous ne sommes pas pour la scission. » ([7] [2376])
La Ligue Spartakiste cherche, en effet, à former dans le SPD une organisation de l'ensemble de l'opposition. C'est ce qui a constitué l'orientation de la conférence de Zimmerwald et comme Lénine le souligne avec justesse : « L'opposition allemande manque énormément encore d'un sol solide. Elle est encore dispersée, s'éparpille en courants autonomes, auxquels il manque en premier lieu un fondement commun indispensable à sa capacité d'action. Nous considérons de notre devoir de fondre les forces dispersées en un organisme capable d'agir. » ([8] [2377])
Tant que les Spartakistes restent dans le SPD en tant que groupe autonome, ils forment un pôle de référence politique qui lutte contre la dégénérescence du parti, contre la trahison d'une partie de celui-ci. Suivant les principes d'organisation du mouvement ouvrier la fraction ne prend pas d'existence séparée, d'indépendance organisationnelle mais reste au sein du parti. Ce n'est qu'avec l'exclusion du parti que l'existence indépendante sur le plan organisationnel de la fraction est possible.
Par contre, les autres regroupements de la Gauche, et surtout les « Lichtstrahlen » ([9] [2378]), celui autour de Borchardt et à Hambourg, commencent dans cette phase-ci, au cours de l'année 1916, à se prononcer clairement pour la construction d'une organisation indépendante.
Comme nous l'avons déjà exposé, cette aile de la Gauche (surtout de Hambourg et de Dresde) prend pour prétexte la trahison de la direction social-patriote pour remettre en question la nécessité du parti en général. Par crainte d'une nouvelle bureaucratisation, par peur de voir la lutte ouvrière étouffée par la Gauche à cause de l'organisation, ils commencent à rejeter toute organisation politique. Au départ, cela prend la forme d'une méfiance vis-à-vis de la centralisation, d'une revendication du fédéralisme. A ce moment-là, cela s'illustre par un refus de lutter contre les social-patriotes à l'intérieur du parti. Mais cela constitue l'acte de naissance du futur communisme de conseils qui va connaître dans les années suivantes un grand développement.
Le principe d'un travail de fraction conséquent et la poursuite de la résistance au sein du SPD, tels qu'ils sont mis en pratique en Allemagne par les Gauches au cours de cette période, serviront ensuite d'exemple pour les camarades de la Gauche italienne, dix années plus tard, dans leur combat au sein de l'Internationale Communiste contre la dégénérescence de celle-ci. Ce principe défendu par Rosa Luxemburg et la grande majorité des Spartakistes va être bien vite rejeté par des parties de la Gauche qui, dés que surgiront des divergences, sans aucune commune mesure encore avec la trahison commise par les social-patriotes du SPD, quitteront immédiatement l'organisation.
Les différents courants au sein du mouvement ouvrier
Le mouvement ouvrier, au cours des premières années de guerre, s'est divisé dans tous les pays en trois courants. Lénine esquisse ces trois courants en avril 1917 dans Les Tâches du prolétariat dans notre révolution de la façon suivante :
- « Les social-chauvins, socialistes en paroles, chauvins en fait ; qui admettent la "défense de la patrie" dans une guerre impérialiste. (...) Ce sont nos adversaires de classe. Ils sont passés du côté de la bourgeoisie. »
- « (...) les véritables internationalistes que représente le mieux "la Gauche de Zimmerwald". Caractère distinctif essentiel : rupture complète avec le social-chauvinisme (...). Lutte révolutionnaire intransigeante contre son propre gouvernement impérialiste et sa propre bourgeoisie impérialiste. »
- Entre ces deux tendances, il existe un troisième courant que Lénine qualifie de « "centre", qui hésite entre les social-chauvins et les véritables internationalistes. (...) Le "centre" jure ses grands dieux qu'il est (...) pour la paix, (...) et pour la paix avec les social-chauvins. Le "centre" est pour "l'unité", le centre est l'adversaire de la scission. (...) le "centre" n'est pas convaincu de la nécessité d'une révolution contre son propre gouvernement, ne la préconise pas, ne poursuit pas une lutte révolutionnaire intransigeante, invente pour s'y soustraire les faux-fuyants les plus plats, bien qu'à résonance archi-marxiste. »
Ce courant centriste ne possède aucune clarté programmatique mais est au contraire incohérent, inconséquent, prêts à toutes les concessions possibles, recule devant toute définition programmatique, cherche "à s'adapter" à toute nouvelle situation. Il est l'endroit où s'affrontent les influences petites-bourgeoises et révolutionnaires. Ce courant s'est retrouvé en majorité à la conférence de Zimmerwald en 1915. En Allemagne même il est important en nombre. Lors de la conférence de l'opposition tenue le 7 janvier 1917 il représente la majorité des 187 délégués ; seulement 35 délégués sont des Spartakistes.
Le courant centriste se compose lui-même d'une aile droite et d'une aile gauche. L'aile droite est proche des social-patriotes tandis que l'aile gauche est plus ouverte à l'intervention des révolutionnaires.
En Allemagne Kautsky se trouve la tête de ce courant qui s'unifie en mars 1916 au sein du SPD sous le nom de « Sozialdemokratische Arbeitsgemeinschaft » (SAG, Collectif social-démocrate de Travail) et qui est le plus fort surtout au sein de la fraction parlementaire. Haase et Ledebour sont les principaux députés centristes au Reichstag.
Dans le SPD il n'existe donc pas seulement les traîtres et les révolutionnaires mais aussi un courant centriste qui, pendant une longue période, attire vers lui la majorité des ouvriers.
« Et quiconque, s'écartant du terrain de la réalité, se refuse à reconnaître l'existence de ces trois tendances, à les analyser, à lutter de façon conséquente pour celle qui est véritablement internationaliste, se condamne à l'inertie, à l'impuissance et à l'erreur. » ([10] [2379])
Alors que les social-patriotes continuent à vouloir injecter à haute dose le poison nationaliste à la classe ouvrière et que les Spartakistes mènent une lutte acharnée contre eux, les centristes oscillent entre ces deux pôles, allant de l'un à l'autre. Quelle attitude doivent alors adopter les Spartakistes vis-à-vis de ce centre ? L'aile rassemblée autour de Rosa Luxemburg et de Karl Liebknecht soulignent que « politiquement on doit taper sur les centristes », que les révolutionnaires doivent intervenir vis-à-vis d'eux.
L'intervention vis-à-vis du centrisme : la clarté politique d'abord, avant l'unité
En janvier 1916, au cours d'une conférence convoquée par les adversaires à la guerre Rosa Luxemburg esquisse déjà sa position vis-à-vis des Centristes : « Notre tactique dans cette conférence doit partir, non pas de l'idée de mettre toute l'opposition d'accord, mais inversement de sélectionner dans toute cette bouillie le petit noyau solide et apte à l'action que nous pouvons regrouper autour de notre plate-forme. A l'inverse, concernant un rassemblement organisationnel, la plus grande prudence est requise. Car l'union des Gauches ne fait, d'après mes longues années d'amère expérience dans le parti, que lier les mains des quelques uns capables d'agir. »
Pour elle, toute association organisationnelle avec les Centristes au sein du SPD est exclue. « Bien sûr l'unité fait la force, mais l'unité des convictions solides et profondes, non pas celle de l'addition mécanique et superficielle d'éléments profondément divergents. Ce n'est pas dans le nombre que réside sa force, mais dans l'esprit, dans la clarté, dans la détermination qui nous animent. » ([11] [2380])
De même Liebknecht souligne en février 1916 : « Non pas l'unité à tout prix, mais la clarté avant tout. Obtenue au moyen de la mise en évidence intransigeante et de la discussion en profondeur de toute divergence pour un accord sur les principes et la tactique dans la perspective d'être en mesure d'agir, dans la perspective de l'unité, telle est la voie que nous nous devons d'emprunter. L'unité ne doit pas former le début de ce processus de fermentation mais doit en être la conclusion. » ([12] [2381])
La clé de voûte de la méthode de R. Luxemburg et des autres Spartakistes est l'exigence de la clarté programmatique. En exigeant la solidité programmatique, en persistant à ne pas se noyer politiquement, quitte à être numériquement réduits, mais en restant clairs quant au contenu, R. Luxemburg ne fait pas preuve de sectarisme, mais se situe en continuité de la vieille méthode marxiste. R. Luxemburg n'est pas la seule dépositaire de cette rigueur et de ce tranchant programmatique ; la même méthode sera ensuite aussi utilisée par les camarades de la Gauche d'Italie, lorsqu'ils mettront en garde, au moment où ils analyseront le bilan de la Russie, et dans les années 1930, contre toute tendance à faire des concessions politiques sur le plan programmatique uniquement dans le but de grandir numériquement. De plus, il est possible que Rosa Luxemburg commence à percevoir les répercussions de la nouvelle situation ouverte avec l'entrée en décadence du système capitaliste. Dans cette période en effet, il ne peut plus y avoir de partis de masse de la classe ouvrière mais seulement des partis numériquement réduits qui se doivent d'être programmatiquement solides. Ainsi, la solidité, la rigueur du programme constitue la boussole du travail des révolutionnaires envers les Centristes qui, par définition, oscillent et redoutent la clarté politique.
Lorsqu'en mars 1917 les Centristes, après leur expulsion du SPD, veulent fonder leur propre organisation, les Spartakistes reconnaissent la nécessité d'une intervention vis-à-vis d'eux. Ils endossent la responsabilité qui est celle des révolutionnaires vis-à-vis de leur classe.
Dans le contexte du développement de la révolution en Russie et d'une radicalisation croissante des luttes de la classe ouvrière en Allemagne même, il s'agit, pour les Spartakistes, de ne pas se couper des meilleurs éléments qui sont encore sous l'influence du centrisme pour les faire avancer et les pousser à effectuer une clarification. Nous devons considérer ces courants centristes, comme le « Collectif de travail social-démocrate » (SAG), de la même manière que nombre de partis qui adhèreront à l'Internationale Communiste en mars 1919, c'est à dire non homogènes et n'offrant aucune stabilité ou cohérence.
Les mouvements centristes sont l'expression de l'immaturité de la conscience dans la classe; ils peuvent donc, avec la tendance de la lutte de classes à se développer, s'engager dans un processus de clarification et ainsi accomplir leur destin historique : disparaître. Pour cela, à côté de la dynamique de la lutte des classes, il est indispensable qu'il existe un pôle de référence organisateur en mesure de jouer le rôle de pôle de clarté vis-à-vis des Centristes. Sans l'existence et l'intervention d'une organisation révolutionnaire qui pousse en avant les éléments ouverts et réceptifs pris dans le Centrisme, tout développement et toute séparation de ceux-ci du Centrisme est impossible.
Lénine résume cette tâche ainsi : « Le manque le plus important de l'ensemble du marxisme révolutionnaire en Allemagne est l'absence d'une organisation illégale qui suit sa ligne de façon systématique et qui éduque les masses dans l'esprit des tâches nouvelles : une telle organisation devrait prendre une claire position aussi bien vis-à-vis de l'opportunisme que du kautskysme. » ([13] [2382])
Comment exercer alors l'activité de pôle de référence ? En février les Centristes proposent pour les 6 et 8 avril 1917 une conférence en vue de la fondation d'une organisation commune adoptant pour nom USPD (Parti social-démocrate indépendant). De profondes divergences s'expriment à ce sujet parmi les révolutionnaires internationalistes.
La Gauche de Brême prend position contre la participation de la gauches révolutionnaire à cette organisation commune. Radek pense que : « Seul un noyau clair et organisé peut exercer une influence sur les ouvriers radicaux du Centre. Jusqu'à maintenant, tant que nous agissions sur le terrain du vieux parti, on pouvait se tirer d'affaire avec les liaisons lâches entre les différents radicaux de la gauche. Maintenant (...) seul un parti radical de gauche doté d'un programme clair et de ses propres organes peut rassembler les forces dispersées, les unir et les accroître. (Nous ne pouvons remplir notre devoir) que par l'organisation des radicaux de gauche en leur propre parti. » ([14] [2383])
Les Spartakistes eux-mêmes ne sont pas unanimes sur la question. Lors d'une conférence préparatoire de la Ligue Spartakiste le 5 avril, de nombreux délégués prennent position contre l'entrée dans l'USPD. Mais ce point de vue là ne parvient visiblement pas à s'imposer puisque les Spartakistes s'affilient à l'USPD. L'intention des Spartakistes est d'en retirer les meilleurs éléments pour les gagner à leur cause.
« Le Collectif de travail social-démocrate possède dans ses rangs tout une série d'éléments ouvriers qui, politiquement et par leur état d'esprit, comptent parmi les nôtres et ne suivent le collectif de travail que par manque de contact avec nous ou par absence de connaissance des rapports effectifs au sein de l'opposition ou pour tout autre cause fortuite... » ([15] [2384])
« Il s'agit donc d'utiliser le nouveau parti qui va réunir des masses plus importantes comme champ de recrutement pour nos conceptions, pour la tendance déterminée de l'opposition ; il s'agit ensuite de contester au collectif de travail l'influence politique et spirituelle sur les masses au sein même du parti ; il s'agit enfin de propulser le parti comme un tout en avant par notre activité dans ses organisations même tout comme par nos propres actions indépendantes, ainsi qu'éventuellement d'agir contre son influence dommageable sur la classe. » ([16] [2385])
Au sein de la Gauche, les arguments pour ou centre cette adhésion sont nombreux. La question qui se pose est : est-il préférable de mener un travail de fraction en dehors de l'USPD ou d'agir sur celui-ci de l'intérieur? Si le souci des Spartakistes d'intervenir vis-à-vis de l'USPD pour en arracher les meilleurs éléments est parfaitement valable, il est autrement plus difficile de voir si cela doit se faire « de l'intérieur » ou « de l'extérieur ».
La question ne peut cependant se poser que parce que les Spartakistes considèrent à juste titre l'USPD comme un courant centriste appartenant à la classe ouvrière. Ce n'est pas un parti de la bourgeoisie.
Même Radek et avec lui la Gauche de Brême reconnaissent la nécessité de l'intervention vis-à-vis de ce mouvement centriste : « C'est en suivant notre chemin - sans aller de gauche ou de droite - que nous luttons pour les éléments indéterminés. Nous voulons essayer de les faire se ranger de notre côté. S'ils ne sont pas dés maintenant en mesure de nous suivre, si leur orientation vers nous doit se produire ultérieurement, au moment où les nécessités de la politique exigeront de nous l'indépendance organisationnelle, rien ne doit s'opposer à celle-ci. Nous devrons suivre notre chemin. (L'USPD) est un parti qui à plus ou moins brève ou longue échéance se trouvera broyé entre les meules de la droite et de la gauche déterminées. » ([17] [2386])
On ne peut comprendre la signification de l'USPD centriste et le fait qu'elle possède encore une grande influence au sein des masses ouvrières qu'en se représentant la situation d'ébullition croissante de la classe ouvrière. A partir du printemps il y a une vague de grèves dans le nord, dans la Ruhr en mars, une série de grèves de masse impliquant plus de 300 000 ouvriers à Berlin en avril, un mouvement de grèves et de protestation durant l'été à Halle, Brunswick, Magdebourg, Kiel, Wuppertal, Hambourg, Nuremberg, en juin se produisent les premières mutineries dans la flotte. Il ne peut être mis fin à tous ces mouvements que par la répression la plus brutale.
En tous cas, l'aile gauche se trouve provisoirement divisée entre les Spartakistes, d'une part, et la Gauche de Brême et les autres parties de la Gauche révolutionnaire, d'autre part. La Gauche de Brême réclame la fondation rapide du parti, tandis que les Spartakistes adhèrent majoritairement à l'USPD en tant que fraction.
DV.
[13] [2399] Lénine, juillet 1916, Oeuvres complètes, tome 22, p. 312.
[14] [2400] K. Radek, Unter eigenem Banner, p. 414.
[15] [2401] L. Jogisches, 25 décembre 1916.
[16] [2402] Spartakus im Kriege, p. 184.
[17] [2403] Einheit oder Spaltung ?
Géographique:
- Allemagne [98]
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Allemande [1955]
Approfondir:
- Révolution Allemande [1957]
Questions théoriques:
- Parti et Fraction [67]
Heritage de la Gauche Communiste:
- La Révolution prolétarienne [1149]
Questions d'organisation, II : la lutte de la premiere internationale contre l' « alliance » de bakounine
- 4812 reads
Nous consacrons la deuxième partie de cet article à la manière dont l'Alliance de Bakounine s'y est pris pour prendre le contrôle de la Première Internationale, l'Association Internationale des Travailleurs (AIT), et la détruire. Nous essaierons de montrer, aussi concrètement que possible, les tactiques utilisées contre le mouvement ouvrier, en nous basant sur l'analyse faite par l'Internationale elle-même. Nous sommes convaincus que l'identification de ces tactiques de la bourgeoisie et du parasitisme, la capacité à tirer les leçons du combat contre Bakounine, sont aujourd'hui indispensables pour la défense du milieu révolutionnaire.
Dans la première partie de cette série ([1] [2404]), nous avons montré que la fameuse lutte au sein de l'AIT, qui devait conduire à l'exclusion de Bakounine et à la condamnation de son « Alliance secrète de la Démocratie Socialiste » au congrès de La Haye, était plus qu'une lutte du marxisme contre l'anarchisme. C'était une lutte à mort entre ceux qui se consacraient à la construction du parti révolutionnaire du prolétariat et tous ceux qui ne recherchaient que sa destruction. Ces derniers n'incluaient pas seulement les anarchistes déclarés, mais toutes les variantes les plus diverses du parasitisme organisationnel. Le but de l'« Alliance » secrète de Bakounine n'était rien moins que de prendre le contrôle de l'Association Internationale des Travailleurs, à travers un complot caché, dans le but de détruire sa nature prolétarienne. Dans cette tentative, les bakouniniens étaient soutenus par une série d'éléments bourgeois, petits-bourgeois et déclassés qui existaient à l'intérieur des différentes sections de l'Internationale sans en partager les buts. Et, derrière la scène, le complot était encouragé par les classes dominantes elles-mêmes. Elles encourageaient et manipulaient Bakounine et ses adeptes, souvent même à leur insu. La presse bourgeoise se faisait l'écho des campagnes de calomnies de l'Alliance contre Marx et le Conseil Général, portant aux nues « l'esprit de liberté » des anarchistes qui condamnaient « les méthodes dictatoriales » des marxistes. Leurs espions et agents provocateurs, envoyés pour infiltrer l'AIT, faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour soutenir Bakounine et ses alliés parasites, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Association. La police politique facilitait le travail de sape contre les statuts de l'Internationale, en arrêtant des militants de manière à garantir le succès des manoeuvres de l'Alliance.
D'emblée, la bourgeoisie a utilisé sa police, ses tribunaux, ses prisons, et plus tard ses pelotons d'exécution contre l'AIT. Mais ce n'était pas là son arme la plus dangereuse. En effet, le Congrès de La Haye a montré « comment plus les persécutions ont augmenté et plus l'organisation des travailleurs qu'est l'AIT s'est renforcée. » ([2] [2405]).
L'arme la plus dangereuse de la bourgeoisie consistait précisément dans la tentative de détruire l'AIT de l'intérieur, à travers l'infiltration, la manipulation et l'intrigue. Cette stratégie consiste à provoquer le soupçon, la démoralisation, les divisions et les clashes au sein d'une organisation prolétarienne, pour l'amener à se détruire elle-même. Alors que la répression porte toujours avec elle le risque de provoquer la solidarité de la classe ouvrière avec ses victimes, la destruction de l'intérieur permet, non seulement de détruire un parti ou un groupe prolétarien, mais de ruiner sa réputation et de l'effacer ainsi de la mémoire collective et des traditions de la classe ouvrière. Plus généralement elle vise à calomnier la discipline organisationnelle, en la présentant comme une « dictature » et à dénigrer la lutte contre l'infiltration policière, le combat contre les ambitions de pouvoir destructrices des éléments déclassés de la classe dominante et la résistance contre l'individualisme petit-bourgeois, en les présentant comme la manifestation d'une « élimination bureaucratique de rivaux ».
Avant de montrer comment la bourgeoisie, avec l'aide du parasitisme politique et de Bakounine en particulier, entreprit ce travail de destruction et de dénigrement, nous allons rapidement rappeler l'ampleur de la peur que l'AIT inspirait à la bourgeoisie.
La bourgeoisie se sent menacée par l'AIT
Le rapport du Conseil Général au cinquième congrès annuel de l'Association Internationale des Travailleurs à la Haye en septembre 1872, écrit au lendemain de la défaite de la Commune de Paris, déclarait :
« Depuis notre dernier Congrès à Bâle, deux grandes guerres ont changé la face de l'Europe, la guerre franco-allemande et la guerre civile en France. Ces deux guerres ont été précédées, accompagnées et suivies par une troisième : la guerre contre l'Association Internationale des Travailleurs. »
Ainsi, à la veille du plébiscite qui servit à Louis Napoléon à préparer sa guerre contre la Prusse, des membres de l'AIT furent arrêtés le 23 avril 1870 à Paris, sous le prétexte d'être mêlés à un complot visant à assassiner Louis Bonaparte. Simultanément des arrestations d'internationalistes eurent lieu à Lyon, Rouen, Marseille, Brest et dans d'autres villes.
« Jusqu'à la proclamation de la République, les membres du Conseil Fédéral de Paris sont restés en prison, tandis que les autres membres de l'Association étaient quotidiennement dénoncés aux foules comme des traîtres agissant pour le compte de la Prusse.
Avec la capitulation de Sedan, tandis que le second Empire se terminait comme il avait commencé, par une parodie, la guerre franco-allemande est entrée dans sa seconde phase. Elle est devenue une guerre contre le peuple français... De ce moment, elle s'est trouvée contrainte non seulement de combattre la République en France, mais simultanément l'Internationale en Allemagne. » ([3] [2406]).
« Si la guerre contre l'Internationale a été localisée d'abord en France et ensuite en Allemagne, elle est devenue générale à partir du surgissement puis de la défaite de la Commune de Paris. Le 6 juin 1871, Jules Favre envoya une circulaire aux puissances étrangères, exigeant l'extradition des réfugiés de la Commune en tant que criminels de droit commun et réclamant une croisade générale contre l'Internationale comme ennemi de la famille, de la religion, de l'ordre et de la propriété. » ([4] [2407]).
Il s'ensuivit une nouvelle offensive, coordonnée internationalement, de la bourgeoisie pour détruire l'AIT. Les chanceliers d'Autriche-Hongrie et d'Allemagne, Beust et Bismarck, tinrent deux « réunions au sommet » presque entièrement consacrée à travailler aux moyens de cette destruction. Les tribunaux autrichiens, par exemple, en condamnant les chefs du parti prolétarien à la servitude pénale en juillet 1870, décrétèrent ce qui suit :
« L'Internationale vise à émanciper la classe ouvrière de la domination de la classe possédante et de la dépendance politique. Cette émancipation est incompatible avec les institutions existantes de l'Etat autrichien. De là, quiconque accepte et défend les principes du programme de l'Internationale, conspire pour renverser le gouvernement Autrichien et est, en conséquence, coupable de haute trahison. » ([5] [2408])
Aux derniers jours de la Commune de Paris, tous les secteurs de la classe dominante avait compris le danger mortel que l'organisation socialiste internationale représentait pour sa domination. Même si l'AIT n'a pas pu elle-même jouer un rôle dirigeant dans les événements de la Commune de Paris, la bourgeoisie était tout à fait consciente que ce surgissement, la première tentative de la classe ouvrière pour détruire l'Etat bourgeois et le remplacer par sa propre domination de classe, n'aurait pas été possible sans l'autonomie et la maturité politiques et organisationnelles du prolétariat, une maturité que l'AIT cristallisait.
Plus encore, c'est la menace politique que l'existence même de l'AIT faisait peser sur la domination à long terme du capital qui, dans une grande mesure, explique la sauvagerie avec laquelle la Commune de Paris a été réprimée conjointement par les Etats français et allemand.
Après la Commune de Paris : la bourgeoisie essaie de briser et de discréditer l'AIT
En fait, comme Marx et Engels avaient tout juste commencé à le comprendre au moment du fameux congrès de La Haye en 1872, la défaite de la Commune, et du prolétariat français comme un tout, signifiait le commencement de la fin pour l'AIT. L'association des secteurs décisifs des ouvriers d'Europe et d'Amérique, fondée en 1864, n'était pas une création artificielle, mais le produit de la montée de la lutte de classe à cette époque. L'écrasement de la Commune signifiait la fin de cette vague de luttes et ouvrait une période de défaite et de désorientation politique. Comme après la défaite des révolutions de 1848-49, quand la Ligue des Communistes avait été victime d'une semblable désorientation, beaucoup de ses membres refusant de reconnaître que la période révolutionnaire était terminée, l'AIT, après 1871, était entrée dans une période de déclin. Dans cette situation, la principale préoccupation de Marx et Engels fut de faire en sorte que l'AIT termine son travail en bon ordre. C'est dans cette perspective qu'au Congrès de La Haye, ils ont proposé de transférer le Conseil Général à New York, où il serait tenu à distance de la ligne de front de la répression bourgeoise et des dissensions internes. Ils voulaient avant tout préserver la réputation de l'Association, défendre ses principes politiques et organisationnels, de manière à ce que ceux-ci puissent être transmis aux futures générations de révolutionnaires. En particulier, l'expérience de l'AIT devait servir de base pour la construction d'une Seconde Internationale, aussitôt que les conditions objectives le permettraient.
Pour les classes dominantes, cependant, il n'était pas question de permettre que l'AIT termine sa tâche en bon ordre et de la laisser transmettre ainsi aux générations prolétariennes à venir les enseignements de ces premiers pas dans la construction d'une organisation internationale, statutairement centralisée. Le massacre des ouvriers de Paris donnait le signal : il s'agissait de mener à son terme tout le travail de sape interne et de discrédit de l'AIT qui avait déjà commencé bien avant la Commune. Les représentants les plus intelligents des classes dominantes craignaient que l'AIT reste dans l'histoire comme un moment décisif de l'adoption du marxisme par le mouvement ouvrier. Bismark était un de ces intelligents représentants des exploiteurs, lui qui, au long des années 1860, avait secrètement, et quelquefois ouvertement, soutenu les Lassaliens au sein du mouvement ouvrier allemand, dans le but de combattre le développement du marxisme. Mais il y en eut d'autres, comme nous allons le voir, qui se sont unis pour désorienter et naufrager l'avant-garde politique de la classe ouvrière.
L'Alliance de Bakounine : fondée pour attaquer l'AIT
« L'Alliance de la démocratie socialiste fut fondée par M. Bakounine vers la fin de l'année 1868. C'était une société internationale prétendant fonctionner, en même temps en dehors et en dedans de l'Association internationale des travailleurs. Se composant de membres de cette dernière qui réclamaient le droit de participer à toutes ses réunions, elle voulait cependant se réserver celui d'avoir ses propres groupes locaux, ses fédérations nationales, et d'organiser ses congrès particuliers, à côté et en sus de ceux de l'Internationale. En d'autres termes, l'Alliance prétendait dès le début former une sorte d'aristocratie au sein de notre association, un corps d'élite avec un programme à elle et avec des privilèges particuliers. » ([6] [2409]).
Bakounine avait échoué dans son projet original d'unifier sous son propre contrôle l'AIT et la Ligue de la Paix et la Liberté, ses propositions ayant été rejetées par le congrès général de toute l'AIT à Bruxelles. Bakounine expliquait cette défaite à ses amis bourgeois de la Ligue en ces termes : « Je ne pouvais pas prévoir que le Congrès de l'Internationale nous répondrait par une insulte aussi grossière que prétentieuse, mais cela est dû aux intrigues d'une certaine coterie d'Allemands qui déteste les Russes et tout le monde excepté eux-mêmes. » ([7] [2410]).
Concernant cette lettre, Nicolai Outine, dans son rapport au Congrès de La Haye, souligne un des aspects centraux de la politique de Bakounine :
« Elle prouve que c'est déjà de cette époque, sinon d'avant, que datent les calomnies de Bakounine contre le citoyen Marx, contre les Allemands et contre toute l'Internationale, qui était déjà accusée alors, et a priori - puisque Bakounine ignorait tout à ce moment tant de l'organisation que de l'activité de l'Association -, d'être une marionnette aveugle entre les mains du citoyen Marx et de la clique allemande (plus tard devenue pour les partisans de Bakounine une clique autoritaire à l'esprit bismarckien) ; de cette époque également date la haine rancunière de Bakounine pour le Conseil général et pour certains de ses membres en particulier. » ([8] [2411]).
Devant cet échec, Bakounine dût changer de tactique et demander son admission dans l'AIT. Mais il ne modifia pas sa stratégie de base :
« Pour se faire reconnaître comme chef de l'Internationale, il fallait se présenter comme chef d'une autre armée dont le dévouement absolu envers sa personne lui devait être assuré par une organisation secrète. Après avoir ouvertement implanté sa société dans l'Internationale, il comptait en étendre les ramifications dans toutes les sections et en accaparer par ce moyen la direction absolue. Dans ce but, il fonda à Genève l'Alliance (publique) de la démocratie socialiste. (...) Mais cette Alliance publique en cachait une autre qui, à son tour, était dirigée par l'Alliance encore plus secrète des frères internationaux, les Cent Gardes du dictateur Bakounine. » ([9] [2412])
Cependant, la première demande d'admission de l'Alliance fut refusée, pour cause de sa pratique organisationnelle non conformes aux statuts de l'Association.
« Le Conseil Général refusa d'admettre l'Alliance tant qu'elle conserverait son caractère international distinct ; il ne promit de l'admettre qu'à la condition qu'elle dissoudrait son organisation internationale particulière, que ses sections se convertiraient en simples sections de notre association et que le conseil serait informé du lieu et des effectifs numériques de chaque section nouvelle. ».([10] [2413]).
Le Conseil Général insistait particulièrement sur ce dernier point, afin d'empêcher l'Alliance d'infiltrer secrètement l'AIT, sous des noms différents.
L'Alliance répondit :
« La question de la dissolution est aujourd'hui prononcée. En notifiant cette décision aux différents groupes de l'Alliance, nous les avons invités à se constituer, à notre exemple, en sections de l'AIT, et à se faire reconnaître comme telles par vous ou par le Conseil Fédéral de l'Association dans leurs pays respectifs. » ([11] [2414]).
Mais l'Alliance ne fit rien de tel. Ses sections n'ont jamais déclaré leur siège ni leur force numérique, pas plus qu'elles n'ont posé leur candidature en leur propre nom.
« La section de Genève resta la seule qui demandait son affiliation. On n'entendit plus parler des autres prétendues sections de l'Alliance. Cependant, en dépit des intrigues continuelles des alliancistes tendant à imposer leur programme spécial à toute l'Internationale et à s'assurer le contrôle de notre association, il nous fallut croire que l'Alliance avait tenu parole et qu'elle s'était dissoute. Mais, au mois de mai dernier, le Conseil général reçut des indications assez précises, dont il dut conclure que l'Alliance n'avait pas même envisagé sa dissolution ; qu'en dépit de sa parole solennellement donnée, elle avait existé et existait toujours, sous forme de société secrète, et qu'elle usait de cette organisation clandestine pour poursuivre son but de toujours : s'assurer le contrôle complet de l'Internationale. » ([12] [2415]).
En fait, au moment où l'Alliance s'est déclarée dissoute, le Conseil Général ne disposait pas de preuves suffisantes pour justifier un refus de l'admettre dans l'Internationale. Il avait en outre été « induit en erreur par quelques signatures du programme qui laissaient supposer qu'elle était reconnue par le Comité fédéral romand. » ([13] [2416]).
Mais ce n'avait pas été le cas, puisque le Comité fédéral romand avaient de bonnes raisons de ne faire aucune confiance aux alliancistes.
« L'organisation secrète cachée derrière l'Alliance publique entra, dès ce moment, en action. Derrière la section de Genève de l'Internationale, il y avait le bureau central de l'Alliance secrète ; derrière les sections de Naples, de Barcelone, de Lyon et du Jura, les sections secrètes de l'Alliance. Appuyé sur cette franc-maçonnerie dont l'existence n'était pas même soupçonnée ni par la masse des Internationaux, ni par leurs centres administratifs, Bakounine espérait s'emparer de la direction de l'Internationale au congrès de Bâle, en septembre 1869. » ([14] [2417]).
A cette fin l'Alliance commença à mettre directement en oeuvre son appareil secret international.
« L'Alliance secrète envoya des instructions à ses adhérents dans tous les coins d'Europe, les enjoignant, qui à se faire élire comme délégués, qui à donner un mandat impératif s'ils ne pouvaient envoyer un de leurs propres hommes. Dans beaucoup d'endroits, les membres ont été très surpris de constater que, pour la première fois dans l'histoire de l'Internationale, la désignation des délégués ne se faisait pas de manière honnête, ouverte et transparente et le Conseil général reçut des lettres demandant s'il n'y avait pas quelque chose dans l'air. » ([15] [2418]). Au congrès de Bâle, l'Alliance échoua dans son objectif principal qui était de transférer le Conseil Général de Londres à Genève, où Bakounine comptait bien le dominer. L'Alliance ne renonça pas, elle changea de tactique.
« Constatons d'abord qu'il y a eu deux phases bien distinctes dans l'action de l'Alliance. Dans la première, elle croyait pouvoir s'emparer du Conseil général et, ce faisant, s'assurer la direction suprême de notre association. C'est alors qu'elle demanda à ses adhérents de soutenir la "forte organisation" de l'Internationale et surtout "le pouvoir du Conseil général et des conseil fédéraux et comités centraux". C'est dans ces conditions que les alliancistes ont demandé au Congrès de Bâle tous ces pouvoirs étendus pour le Conseil général, pouvoirs qu'ils ont plus tard repoussé avec tant d'horreur parce que autoritaires. » ([16] [2419]).
La bourgeoisie favorise le travail de sabotage de Bakounine
Dans la première partie de cet article, sur la préhistoire de la conspiration de Bakounine, nous avons déjà montré quelle était la nature de classe de sa société secrète. Même si la majorité de ses membres n'en avaient pas conscience, l'Alliance représentait rien moins qu'un cheval de Troie au moyen duquel la bourgeoisie a tenté de détruire l'AIT de l'intérieur.
Si Bakounine a pu tenter de prendre le contrôle de l'AIT dès le congrès de Bâle, moins d'un an après y être entré, c'est uniquement parce qu'il avait reçu l'aide de la bourgeoisie. Cette aide lui a fourni une base politique et organisationnelle, avant même qu'il n'ait rejoint l'AIT.
La première origine du pouvoir de Bakounine a été la société entièrement bourgeoise qu'était la Ligue de la Paix et la Liberté, constituée pour rivaliser avec l'AIT et s'opposer à elle. Comme le rappelait Outine, parlant de la structure de l'Alliance :
« Nous devons noter avant tout que les noms de Comité central permanent, Bureau central et Comités nationaux, existaient déjà dans la Ligue de la Paix et de la Liberté. En fait les règles secrètes (de l'Alliance) admettent sans gêne que le comité central permanent est composé de "tous les membres fondateurs de l'Alliance". Et ces fondateurs sont les "anciens membres du Congrès de Berne" (de la Ligue) appelés "la minorité socialiste". Ainsi ces fondateurs devaient élire parmi eux le Bureau central avec son siège à Genève. » ([17] [2420]).
L'historien anarchiste Nettlau mentionne les personnes suivantes qui quittèrent la Ligue pour se consacrer à pénétrer dans l'Internationale : Bakounine, Fanelli, Friscia, Tucci, Mroczkowski, Zagorski, Joukovski, Elisée Reclus, Aristide Rey, Charles Keller, Jaclard, J. Bedouche, A. Richard ([18] [2421]). Plusieurs de ces personnages étaient directement des agents de l'infiltration politique bourgeoise. Albert Richard, qui constitua l'Alliance en France, était un agent de la police politique bonapartiste, ainsi que son « compagnon d'armes » à Lyon, Gaspard Blanc. Saverio Friscia, selon un autre historien anarchiste, Woodcock, n'était pas seulement « un physicien homéopathique sicilien, mais aussi un membre de la Chambre des députés, et, plus important pour les Frères Internationaux, un franc-maçon du trente-troisième degré, avec une grande influence dans les loges du Sud de l'Italie. » ([19] [2422]). Fanelli a été longtemps membre du parlement italien et avait les plus intimes connexions avec de hauts représentants de la bourgeoisie italienne.
La seconde origine bourgeoise des appuis politiques de Bakounine était donc ses liens avec les « cercles influents » d'Italie. En octobre 1864, à Londres, Bakounine dit à Marx qu'il partait travailler pour l'AIT en Italie, et Marx écrivit à Engels combien il avait été impressionné par cette initiative. Mais Bakounine mentait.
« Par Dolfi, il s'était introduit dans la société des francs-maçons, où les libres penseurs italiens s'étaient regroupés », nous dit Richarda Huch, aristocrate allemande, admiratrice et biographe de Bakounine ([20] [2423]). Comme nous l'avons vu dans la première partie de cet article, Bakounine, qui quitta Londres pour l'Italie en 1864, tira avantage de l'absence de l'AIT dans ce pays pour y monter des sections, sous son propre contrôle et à sa propre image. Ceux qui, comme l'Allemand Cuno, qui fonda la section de Milan, se sont opposés à la domination par cette « confrérie » secrète, ont été fort à propos arrêtés ou déportés par la police dans les moments décisifs.
« L'Italie n'était devenue la terre promise de l'Alliance que par grâce particulière.(...) », déclare le rapport publié par le congrès de La Haye, citant une lettre de Bakounine à Mora, dans laquelle il explique : « Il y a en Italie ce qui manque aux autres pays : une jeunesse ardente, énergique, tout à fait déplacée, sans carrière, sans issue, et qui, malgré son origine bourgeoise, n'est point moralement et intellectuellement épuisée comme la jeunesse bourgeoise des autres pays. » En commentaire, le rapport ajoute : « Le Saint Père (le Pape Bakounine) a raison. L'Alliance en Italie n'est pas un "faisceau ouvrier", mais un ramassis de déclassés. Toutes les prétendues sections de l'Internationale en Italie sont conduites par des avocats sans cause, des médecins sans malades et sans science, des étudiants de billard, des commis voyageurs et autres employés de commerce, et principalement des journalistes de la petite presse d'une réputation plus ou moins douteuse. L'Italie est le seul pays où la presse de l'Internationale - ou soi-disant telle - ait revêtu les caractéristiques du Figaro. On n'a qu'à jeter un coup d'oeil sur l'écriture des secrétaires de ces prétendues sections, pour constater qu'il s'agit du travail de clercs ou de plumitifs professionnels. C'est en s'emparant ainsi de tous les postes officiels des sections que l'Alliance parvint à forcer les ouvriers italiens, pour entrer en communication entre eux ou avec les autres conseils de l'Internationale, de passer par les mains des déclassés alliancistes qui, dans l'Internationale, retrouvaient une "carrière" et une "issue". » ([21] [2424])
C'est grâce à cette infrastructure issue de la Ligue, cet organe de la bourgeoisie européenne occidentale influencé par la diplomatie secrète du Tsar de Russie, et nourrie du vivier de bourgeois déclassés italiens, « libres-penseurs » et « francs-maçons », que Bakounine put lancer sa violente attaque contre l'Internationale.
C'est donc après le Congrès de Berne de la Ligue de la Paix (septembre 1868) que le déjà mentionné Fanelli, membre italien du Parlement et membre fondateur de l'Alliance, a été envoyé en Espagne, « muni d'une recommandation de Bakounine pour Garrido, député aux Cortes, qui le mit en contact avec les cercles républicains, tant bourgeois qu'ouvriers », afin d'installer l'Alliance sur la péninsule ibérique ([22] [2425]). Ici nous voyons les méthodes typiques des anarchistes « abstentionnistes » qui refusent énergiquement de faire de la « politique ». C'est avec de telles méthodes que l'Alliance s'est étendue dans les parties de l'Europe où le prolétariat industriel était encore extrêmement sous-développé : l'Italie et l'Espagne, le Sud de la France, le Jura suisse. C'est ainsi qu'au congrès de Bâle, « grâce aux moyens déloyaux dont elle s'était servie, l'Alliance se trouva représentée par au moins dix délégués, parmi lesquels se trouvaient le fameux Albert Richard et Bakounine lui-même ».([23] [2426]).
Mais toutes ces sections bakouniniennes, secrètement dominées par l'Alliance, n'étaient pas en elles-mêmes suffisantes. Afin de mettre la main sur l'AIT, il était nécessaire pour Bakounine et ses partisans d'être acceptés par une des sections existantes de l'Association, parmi les plus anciennes et les plus importantes, et d'en prendre le contrôle. Venu de l'extérieur, Bakounine comprit le besoin de se servir de l'autorité d'une telle section, déjà largement reconnue à l'intérieur de l'AIT. C'est pourquoi Bakounine partit dès le début pour Genève, où il fonda sa « Section de Genève de l'Alliance de la démocratie socialiste ». Avant même que le conflit ouvert avec le Conseil général ne soit apparu, c'est là qu'a commencé la première résistance décisive de l'AIT contre le sabotage de Bakounine.
La lutte pour le contrôle de la fédération suisse romande
« Mais, en décembre 1868, l'Alliance de la démocratie socialiste s'était juste formée à Genève et s'était déclarée comme section de l'AIT. Cette nouvelle section demanda trois fois en quinze mois son admission au groupe des sections de Genève, et trois fois celle-ci lui a été refusée, d'abord par le Conseil central de toutes les sections de Genève et ensuite par le Comité fédéral romand. En septembre 1869, Bakounine, le fondateur de l'Alliance, fut battu à Genève, lorsqu'il posa sa candidature pour la délégation au Congrès de Bâle et que celle-ci fut rejetée, les membres de Genève ayant nommé Grosselin délégué. Les pressions commencèrent alors (...) de la part des supporters de Bakounine, conduits par lui-même, pour contraindre Grosselin à renoncer et à laisser sa place à Bakounine. Ces discussions ont dû convaincre Bakounine que Genève n'était pas un endroit favorable à ses machinations. Ses coups de gueule retentissants n'ont rencontré dans les réunions des ouvriers genevois que désintérêt et mépris. Ce fait, ajouté aux autres affaires russes, fournit à Bakounine le motif pour quitter de lui-même Genève. » ([24] [2427]).
Au moment où, à Londres, le Conseil général agissait encore avec beaucoup d'hésitations et où il admettait l'Alliance contre sa propre conviction, les sections ouvrières en Suisse résistaient déjà ouvertement aux tentatives de Bakounine d'imposer sa volonté en violation des statuts. Alors que les historiens bourgeois, fidèles à leur vision de l'histoire déterminée par de « grandes personnalités », présentent le combat dans l'AIT comme un conflit « entre Marx et Bakounine », et tandis que les anarchistes font de Bakounine l'innocente victime de Marx, cette toute première bataille contre les bakouniniens en Suisse révèle immédiatement qu'il s'agissait d'une lutte de toute l'organisation pour sa propre défense.
Cependant, cette résistance prolétarienne aux tentatives ouvertes de Bakounine de prendre le pouvoir n'a pu l'empêcher de faire éclater les sections suisses. Ceci vient de ce que, derrière la scène, Bakounine avait déjà commencé à se faire des adeptes dans le pays. Il les avaient gagnés principalement par des moyens de persuasion non politiques, en particulier le charisme de sa personnalité, grâce auquel il fit la conquête de la section internationaliste du Locle, dans la région horlogère du Jura. Le Locle a été un centre de résistance à la politique Lassalienne de soutien aux conservateurs contre les radicaux bourgeois menée par le docteur Coullery, le pionnier opportuniste de l'Internationale en Suisse. Bien que Marx et Engels ait été les opposants les plus déterminés à Lassale en Allemagne, Bakounine dit aux artisans du Locle que la politique corrompue de Coullery était le résultat de l'autoritarisme de Marx dans l'AIT, si bien qu'il était nécessaire de « révolutionner » l'Association par le biais d'une société secrète. La branche locale de l'Alliance secrète, conduite par J. Guillaume, devint le centre de la conspiration, à partir duquel la lutte contre les Internationaux suisses était organisée.
Les partisans de Bakounine, peu représentés dans les villes industrielles, mais fortement présents parmi les artisans du Jura, provoquèrent alors la scission dans le Congrès de la Fédération romande tenu à la Chaux-de-Fonds, en s'efforçant d'obliger la section de Genève à reconnaître l'Alliance et de transporter le Comité fédéral et son organe de presse de Genève à Neuchâtel, pour les mettre dans les mains du bras droit de Bakounine, Guillaume. Les bakouniniens sabotèrent complètement l'ordre du jour du Congrès, n'acceptant la discussion sur aucun point, sinon celui de la reconnaissance de l'Alliance. Incapables d'imposer leur volonté, les alliancistes quittèrent le Congrès pour se réunir dans un café voisin, où ils s'auto-proclamèrent aussitôt « Congrès de la Fédération romande » et nommèrent leur propre « Comité fédéral romand », en violation flagrante des articles 53, 54 et 55 des statuts de la fédération.
Face à cela, la délégation de Genève déclara qu' « il s'agissait de décider si l'Association voulait rester une fédération de sociétés ouvrières, visant l'émancipation des travailleurs par les travailleurs eux-mêmes ou si elle souhaitait abandonner son programme devant un complot fomenté par une poignée de bourgeois, dans le but évident de s'emparer de la direction de l'Association au moyen de ses organes publics et de ses conspirations secrètes. » ([25] [2428]).
Ce faisant, la délégation de Genève avait immédiatement saisi l'entièreté de ce qui était en jeu. De fait, la scission que la bourgeoisie désirait tant, avait eu lieu.
« Quiconque connaît un tant soit peu l'histoire et le développement de notre Association sait bien qu'avant le Congrès romand de la Chaux-de-Fonds en avril 1870, il n'y avait pas de scission dans notre Association et ni la presse bourgeoise, ni le monde bourgeois n'avait jamais pu se réjouir publiquement de nos désaccords.
En Allemagne, il y eut la lutte entre les vrais Internationalistes et les partisans aveugles de Schweitzer, mais cette lutte n'a pas dépassé les frontières de l'Allemagne, et les membres de l'Internationale dans tous les pays ont rapidement condamné cet agent du gouvernement prussien, même si au début il était bien camouflé et semblait être un grand révolutionnaire.
En Belgique, une tentative d'abuser et d'exploiter notre Association eut lieu de la part d'un certain Mr Coudray, qui lui aussi semblait au début être un membre influent, tout dévoué à notre cause, mais qui s'avéra finalement n'être qu'un intrigant, dont le Conseil fédéral et les sections belges se sont chargés, malgré le rôle important qu'il avait réussi à avoir.
A l'exception de cet incident passager, l'Internationale se développait comme une véritable unité fraternelle, animée par le même effort combattant et n'ayant pas de temps à perdre dans de vaines disputes personnelles.
Tout d'un coup, un appel à la guerre intestine surgit au sein de l'Internationale elle-même ; cet appel fut lancé par le premier numéro de La Solidarité (journal bakouninien). Il était accompagné des plus graves accusations publiques contre les sections de Genève et leur Comité fédéral, qui était accusé de s'être vendu à un membre qui était peu connu jusqu'alors (...)
Dans le même numéro, La Solidarité prédisait qu'il y aurait bientôt une profonde scission entre les réactionnaires (les délégués genevois au Congrès de la Chaux-de-Fonds) et plusieurs membres de la section des ouvriers du bâtiment de Genève. Au même moment, des affiches parurent sur les murs de Genève, signées par Chevalley, Cagnon, Heng et Charles Perron (bakouniniens bien connus) annonçant que les signataires avaient été délégués par Neuchâtel pour révéler aux membres genevois de l'Internationale la vérité sur le Congrès de la Chaux-de-Fonds. Cela revenait logiquement à une accusation publique contre tous les délégués de Genève, qui étaient ainsi traités de menteurs cachant la vérité aux membres de l'Internationale.
Les journaux bourgeois de Suisse annoncèrent alors au monde qu'il y avait eu une scission dans l'Internationale. » ([26] [2429]).
Les enjeux de cette grande bataille étaient énormes pour l'AIT, mais aussi pour l'Alliance dans la mesure où le refus de Genève de l'admettre « prouverait à tous les membres de l'Internationale ailleurs qu'il se passait quelque chose d'anormal autour de l'Alliance » (...) « et ceci aurait naturellement sapé, paralysé, le "prestige" que les fondateurs de l'Alliance avaient rêvé d'avoir depuis sa création et l'influence qu'elle voulait exercer, surtout en dehors de Genève. » (...)
« D'un autre côté, s'il elle avait été un noyau reconnu et accepté par les groupes genevois et romand, l'Alliance aurait pu, selon les plans de ses fondateurs, usurper le droit de parler au nom de toute la Fédération romande, ce qui lui aurait nécessairement donné un grand poids en dehors de la Suisse » (...)
« Tout comme le choix de Genève comme centre des opérations ouvertes de l'Alliance, ceci venait de ce que Bakounine pensait qu'il jouirait d'une plus grande sécurité en Suisse que nulle part ailleurs, et qu'en général Genève, tout comme Bruxelles, avait acquis la réputation d'un des principaux centres de l'Internationale sur le continent. »
Dans cette situation, Bakounine resta fidèle à son principe destructeur : ce qu'on ne peut pas contrôler, il faut le faire éclater. « Cependant, l'Alliance continuait à insister pour rejoindre la Fédération romande qui a alors été contrainte de décider l'expulsion de Bakounine et des autres meneurs. Il y eut ainsi deux Comités fédéraux romands, un à Genève, l'autre à la Chaux-de-Fonds. La grande majorité des sections restèrent loyales au premier, tandis que le second n'avait l'appui que de quinze sections, dont un grand nombre (...) cessèrent d'exister l'une après l'autre. »
L'Alliance en appela alors au Conseil général pour décider lequel des deux devait être considéré comme le véritable organe central, espérant profiter du nom de Bakounine et de l'ignorance des affaires suisses censée régner à Londres. Mais, dès que le Conseil général se fut prononcé en faveur de la fédération originale de Genève et appela le groupe de la Chaux-de-Fonds à se transformer en section locale, elle dénonça immédiatement « l'autoritarisme » de Londres, qui s'immisçait dans les affaires de la Suisse.
La Conférence de Londres de 1871
Pendant la guerre franco-prussienne de 1870, les luttes de classe en France puis la Commune de Paris, la lutte organisationnelle au sein de l'Internationale passa au second plan, sans pour autant disparaître complètement. Avec la défaite de la Commune et face à la nouvelle ampleur des attaques de la bourgeoisie, il fallut bientôt redoubler d'énergie pour défendre l'organisation révolutionnaire. Au moment de la Conférence de Londres, en septembre 1871, il était clair que l'AIT était attaquée d'une manière coordonnée, tant de l'extérieur que de l'intérieur, et que le véritable coordinateur en était la bourgeoisie.
A peine quelques mois avant, c'était beaucoup moins clair. « Quand le matériel des organisations de Bakounine tomba dans les mains de la police parisienne avec les arrestations de mai 1871 et que le ministère public annonça dans la presse qu'existait, derrière l'Internationale officielle, une société secrète de conspirateurs, Marx crut que c'était une de ces coutumières "découvertes" policières. "C'est une niaiserie", écrivit-il à Engels. "A la fin, la police ne saura plus à quel saint se vouer". » ([27] [2430]).
Mais, en septembre 1871, la Conférence de Londres, prise dans l'étau de la répression internationale et des calomnies, est à la hauteur de la tâche. Pour la première fois, les questions organisationnelles internationales internes dominèrent une réunion internationale de l'Association. La conférence adopta la proposition de Vaillant, affirmant que les questions sociales et politiques sont deux aspects de la même tâche du prolétariat pour détruire la société de classes. Les documents, et en particulier la résolution « Sur l'action politique de la classe ouvrière », tirant les leçons de la Commune, montrant la nécessité de la dictature du prolétariat et d'un parti politique distinct de la classe ouvrière, était un coup porté contre les abstentionnistes politiques, « ces alliés de la bourgeoisie, qu'ils en soient conscients ou pas » ([28] [2431]).
Au niveau organisationnel, ce combat s'est concrétisé par le renforcement des responsabilités du Conseil général, qui obtint le pouvoir, si nécessaire, de suspendre des sections entre les congrès internationaux. Elle s'est aussi concrétisée par la résolution contre les activités de Netchaiev, collaborateur de Bakounine en Russie. Le russe Outine, qui avait pu lire tous les documents des bakouniniens en Russie, fut chargé par la conférence de rédiger un rapport sur cette dernière question. Dans la mesure où ce rapport menaçait de mettre en lumière toute la conspiration bakouninienne, tout fut fait pour l'empêcher de le rédiger. Après que les autorités suisses, qui cherchaient à expulser Outine, aient été contraintes de renoncer face à une campagne publique massive de l'AIT, une tentative d'assassinat contre Outine (qui a bien failli réussir) fut perpétrée par les bakouniniens.
Main dans la main avec cette répression bourgeoise, la circulaire de Sonvillier de la fédération bakouninienne du Jura s'attaqua à la Conférence de Londres. Cette attaque ouverte était devenue une absolue nécessité pour l'Alliance, depuis qu'à la Conférence de Londres, les manipulations des partisans de Bakounine en Espagne avaient été mises au jour.
« Même les membres les plus dévoués de l'Internationale en Espagne furent amenés à croire que le programme de l'Alliance était identique à celui de l'Internationale, que l'organisation secrète existait partout et que c'était presque un devoir d'y entrer. Cette illusion fut détruite par la Conférence de Londres où le délégué espagnol - lui même membre du comité central de l'Alliance de son pays - put se convaincre du contraire, ainsi que par la circulaire du Jura elle-même, dont les attaques violentes et les calomnies contre la Conférence et contre le Conseil général avaient immédiatement été reproduites par tous les organes de l'Alliance. La première conséquence de la circulaire jurassienne en Espagne fut donc de créer une scission au sein même de l'Alliance espagnole entre ceux qui étaient avant tout des membres de l'Internationale et ceux qui ne voulaient de l'Internationale qu'à condition qu'elle fût sous le contrôle de l'Alliance » ([29] [2432]).
L'Alliance en Russie : une provocation dans l'intérêt de la réaction
« L'affaire Netchaiev » dont se préoccupa la Conférence de Londres, risquait de discréditer totalement l'AIT et menaçait donc son existence même. Lors du premier procès politique public dans l'histoire russe, en juillet 1871, 80 hommes et femmes furent accusés d'appartenir à une société secrète qui avait usurpé le nom de l'AIT. Netchaiev qui prétendait être l' émissaire d'un soi-disant Comité révolutionnaire international oeuvrant pour l'AIT, poussa la jeunesse russe à s'engager dans une série d'escroqueries et contraint certains d'entre eux à assister à l'assassinat d'un de leurs membres qui avait commis le crime de mettre en doute l'existence du tout puissant « comité » de Netchaiev. Cet individu, qui s'échappa de Russie, en laissant ces jeunes révolutionnaires à leur sort, pour venir en Suisse, où il se lança encore dans le chantage et tenta de monter un gang visant à dépouiller les touristes étrangers, était un collaborateur direct de Bakounine. Dans le dos de l'Association, Bakounine avait muni Netchaiev, non seulement d'un « mandat » pour agir au nom de l'Association en Russie, mais aussi d'une justification idéologique. C'était le « catéchisme révolutionnaire », basé sur la morale jésuite tant admirée par Bakounine, selon laquelle la fin justifie tous les moyens, y compris le mensonge, le meurtre, l'extorsion, le chantage, l'élimination des camarades qui « sortent du droit chemin », etc.
De fait, les activités de Netchaiev et de Bakounine conduisirent à l'arrestation de tant de jeunes révolutionnaires inexpérimentés qu'elles firent écrire par le Tagwacht de Zürich, en réponse à Bakounine : « le fait est que, même si vous n'êtes pas un agent rétribué, aucun agent provocateur rémunéré n'aurait pu réussir à faire autant de mal que ce que vous avez fait. »
Quant à la pratique d'envoyer par la poste en Russie des proclamations ultra-radicales, y compris à des gens non politisés, Outine écrivait : « Puisque les lettres étaient ouvertes par la police secrète en Russie, comment Bakounine et Netchaiev pouvaient-ils sérieusement supposer que des proclamations pouvaient être envoyées en Russie dans des enveloppes à des personnes, connues ou inconnues, sans d'une part compromettre ces personnes, et d'autre part, sans prendre le risque de tomber sur un espion ? » ([30] [2433]).
Nous considérons l'explication que donne le rapport d'Outine de ces faits comme la plus vraisemblable :
« Je maintiens donc que Bakounine cherchait à n'importe quel prix à faire croire en Europe que le mouvement révolutionnaire produit par son organisation était réellement gigantesque. Plus gigantesque est le mouvement, et plus géante encore est son accoucheuse. Dans ce but, il publia dans La Marseillaise et ailleurs des articles dignes de la plume d'un agent provocateur. Tandis que des jeunes gens étaient arrêtés, il donnait des assurances comme quoi tout était prêt en Russie pour le cataclysme pan-destructeur, pour la formidable explosion de sa grande révolution des moujiks, que les phalanges de la jeunesses étaient prêtes, disciplinées et aguerries, que tous ceux qui avaient été arrêtés étaient en fait de grands révolutionnaires (...) Il savait pertinemment que tout cela n'était que mensonges. Il mentait quand il spéculait sur la bonne foi des journaux radicaux et quand il se posait en grand Pape-accoucheur de toute cette jeunesse qui payait en prison la foi qu'elle avait dans le nom de l'Association internationale des travailleurs. »
Puisque, comme Marx et Engels l'ont souvent souligné, la police politique russe sur place, et sa « confrérie » d'agents en missions, était la plus formidable du monde à cette époque, avec des agents dans chaque mouvement politique radical dans toute l'Europe, on peut présumer que ce prétendu « troisième département » avait connaissance des plans de Bakounine et les tolérait.
Conclusion
La construction d'une organisation prolétarienne révolutionnaire n'est pas un processus paisible. C'est une lutte permanente devant faire face, non seulement à l'intrusion des attitudes petites-bourgeoises et autres influences déclassées et intermédiaires, mais au sabotage planifié organisé par la classe ennemie. Le combat de la Première Internationale contre ce sabotage mené par l'Alliance est une des plus importantes luttes organisationnelles de l'histoire du mouvement ouvrier. Ce combat est riche de leçons pour aujourd'hui. L'assimilation de ces leçons est actuellement plus essentielle que jamais pour défendre le milieu révolutionnaire et préparer le parti de classe. Ces leçons sont d'autant plus significatives et riches, qu'elles ont été formulées de la manière la plus concrète et avec la participation directe des fondateurs du socialisme scientifique, Marx et Engels. Le combat contre Bakounine est une exemplaire leçon d'application de la méthode marxiste dans la défense et la construction de l'organisation communiste. C'est en assimilant cet exemple laissé par nos grands prédécesseurs que l'actuelle génération de révolutionnaires, qui souffre encore de la rupture de continuité organique avec le mouvement ouvrier du passé causée par la contre-révolution stalinienne, pourra se placer plus fermement dans la tradition de cette grande lutte organisationnelle. Les leçons de tous ces combats, menés par l'AIT, par les bolcheviks, par la gauche italienne, sont une arme essentielle dans l'actuelle lutte du marxisme contre l'esprit de cercle, le liquidationnisme et le parasitisme politique. C'est pourquoi nous pensons qu'il est nécessaire d'entrer dans les détails les plus concrets, pour mettre en évidence toute la réalité de ce combat dans l'histoire du mouvement ouvrier.
KR.
[29] [2462] Rapport sur l'Alliance, M & D, p. 356-356 ; en français Edition Maspéro, p. 69-70.
[30] [2463] M & D, p. 416.
Conscience et organisation:
- La première Internationale [1847]
Approfondir:
- Questions d'organisation [2321]
Heritage de la Gauche Communiste:
Le communisme n'est pas un bel idéal mais une nécessité matérielle [13° partie]
- 5261 reads
LA TRANSFORMATION DES RAPPORTS SOCIAUX SELON LES REVOLUTIONNAIRES DE LA FIN DU 19e SIECLE
Dans le dernier article de cette série, nous avons montré, à l'encontre des doutes soulevés par beaucoup de « communistes » autoproclamés, que l'objectif fondamental des partis socialistes à la fin du 19e siècle était vraiment le socialisme - une société sans rapports marchands, sans classes ou sans Etat. Dans cette suite, nous allons examiner comment les socialistes authentiques de cette époque envisageaient la façon dont la future société communiste s'attaquerait à certains des problèmes sociaux les plus pressants de l'humanité : les rapports entre hommes et femmes, et entre l’humanité et la nature dont elle a surgi. Ici, en défendant les communistes de la 2e Internationale, nous défendons une fois de plus le marxisme contre certains de ses « critiques » plus récents, en particulier le radicalisme petit-bourgeois à l'origine du féminisme et de l'écologie qui sont maintenant devenus des instruments à part entière de l'idéologie dominante.
Bebel et la « question de la femme » ou le marxisme contre le féminisme
Nous avons déjà mentionné que la grande popularité du livre de Bebel La femme et le socialisme résidait, dans une grande mesure, dans le fait qu'il prenait la « question de la femme » comme point de départ d'un voyage théorique vers une société socialiste dont la géographie devait être décrite en partie en détail. C'est avant tout comme guide dans ce paysage socialiste que le livre a eu un impact si puissant sur le mouvement ouvrier de l'époque. Mais cela ne veut pas dire que la question de l'oppression des femmes n'était qu'un hameçon ou un artifice commode. Au contraire, c'était une préoccupation réelle et croissante du mouvement prolétarien de cette époque : ce n'est pas par hasard si le livre de Bebel a été terminé plus ou moins en même temps que celui d’Engels sur L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'Etat ([1] [2464]).
Il est nécessaire d'insister là-dessus car, pour certaines versions grossières du féminisme - en particulier celle qui a fleurit parmi l'intelligentsia radicale aux Etats Unis - le marxisme lui-même n'est qu'une autre variante de l'idéologie patriarcale, une invention de ces «foutus chauvin-mâles » blancs, et il n'aurait rien à dire sur l'oppression de la femme. Les plus conséquentes de ces féministes-féministes défendent même qu'il faut immédiatement rejeter le marxisme parce que Marx lui-même était un mari et un père victorien qui a procréé en secret un enfant illégitime avec sa bonne:
Nous ne perdrons pas de temps ici à réfuter ce dernier argument puisqu'il révèle amplement par lui-même sa propre banalité. Mais l'idée que le marxisme n'a rien à dire sur la « question de la femme » nécessite qu'on la traite, également parce qu'elle a été appuyée par les interprétations économistes et mécanistes du marxisme lui-même.
Nous avons mis la formulation « question de la femme » entre guillemets jusqu'ici, non pas parce que la question n'existe pas pour le marxisme, mais parce qu'elle ne peut être posée que comme un problème de l’humanité, comme problème du rapport entre les hommes et les femmes, et non comme une question à part. Dès le début de son œuvre en tant que communiste, légitimement inspiré par le point de vue de Fourier, Marx posait ainsi la question:
« Le rapport immédiat, naturel, nécessaire de l'homme à l'homme est le rapport de l'homme à la femme. Dans le rapport naturel des sexes, le rapport de l'homme à la nature est immédiatement son rapport à l'homme; de même, celui-ci est son rapport immédiat à la nature, sa propre vocation naturelle. Il est la manifestation sensible, la démonstration concrète du degré jusqu'où l'essence humaine est devenue la nature, ou celle-ci l'essence de celle-là. Il permet de juger de tout le degré du développement humain. Du caractère de ce rapport, on peut conclure jusqu'à quel point l'homme est devenu pour lui-même un être générique, humain et conscient de l'être devenu. » ([2] [2465])
Ici, le rapport homme-femme est placé dans son cadre naturel et historique fondamental. Le passage était écrit contre les notions erronées du communisme qui défendaient (ou accusaient les communistes de défendre) la « communauté des femmes », la subordination totale des femmes à la lubricité des hommes. Au contraire, il ne sera possible d'accéder à une vie véritablement humaine que lorsque les rapports entre les hommes et les femmes seront libérés de toute souillure de domination et d'oppression - et ceci n'est possible que dans une société communiste.
Ce thème a été sans cesse repris par la suite, dans l'évolution de la pensée marxiste. Depuis la dénonciation dans le Manifeste communiste du jargon hypocrite bourgeois sur les valeurs éternelles de la famille -valeurs que l'exploitation capitaliste elle-même sapait sans cesse - jusqu'à l'analyse historique de la transformation des structures familiales en système social différent, contenue dans le livre d’Engels L'origine de la famille, le marxisme a cherché à expliquer non seulement que l'oppression particulière des femmes était une réalité, mais aussi à situer ses origines matérielles et sociales afin de montrer la voie de son dépassement ([3] [2466]) . Dans la période de la 2e Internationale, ces préoccupations furent reprises par les semblables d' Eléonore Marx, Clara Zetkin, Alexandra Kollontai et Lénine. Contre le féminisme bourgeois qui, tout comme dans ses incarnations récentes, voulait dissoudre les antagonismes de classe dans le concept vaporeux de « femmessoeurs », les partis socialistes de cette époque reconnaissaient aussi la nécessité de faire un effort particulier pour attirer les femmes prolétaires qui étaient coupées du travail productif et associé, dans la lutte pour la révolution sociale.
Dans ce contexte, le livre de Bebel La femme et le socialisme constituait un repère bien net de la démarche marxiste envers le problème de l'oppression de la femme. Le rapport de première main qui suit, illustre de façon vivante l'impact qu'a eu le livre en défiant la rigidité de la division sexuelle du travail à l'époque « victorienne » -rigidité qui existait et opérait aussi dans le mouvement ouvrier lui-même :
« Bien que je ne fusse pas social-démocrate , j'avais des amis qui appartenaient au parti. Par eux, j'ai eu le précieux travail. Je l'ai lu d'affilée pendant des nuits. C'était mon propre destin et celui de milliers de mes sœurs. Ni dans la famille, ni dans la vie publique, je n'avais jamais entendu toute la souffrance que la femme doit endurer. On ignorait sa vie. Le livre de Bebel rompait courageusement le vieux secret -je n'ai pas lu ce livre une fois mais dix. Parce que tout était si nouveau, il m'a fallu un effort considérable pour assimiler le point de vue de Bebel. Je devais rompre avec tant de choses que j'avais considérées comme correctes auparavant. » ([4] [2467])
Baader a rejoint le parti; ce qui a son importance : en mettant à nu les origines réelles de leur oppression, le livre de Bebel avait pour effet d'amener des femmes (et des hommes) prolétaires à la lutte de leur classe, la lutte pour le socialisme. L'immense impact qu'a eu le livre à son époque, se mesure au nombre d'éditions qui en a été fait: 50 entre 1879 et 1910, y compris un certain nombre de corrections et de traductions.
Dans les éditions plus développées, le livre se divise en trois parties - la femme dans le passé, dans le présent et dans l'avenir - traduisant par là la force essentielle de la méthode marxiste : sa capacité à situer toutes les questions qu'elle examine dans un cadre historique large qui met aussi en lumière la résolution future des conflits et contradictions existants.
La première partie, « la femme dans le passé » n'ajoute pas grand-chose à ce qu'Engels a mis en avant dans L'origine de la famille. En fait, c'est la publication du travail d’Engels qui a amené Bebel à réviser sa première version qui tendait plutôt vers l'idée que les femmes avaient été « autant » opprimées dans toutes les sociétés passées. Engels, à la suite de Morgan, a démontré que cette oppression s'était développée de manière qualitative avec l'émergence de la propriété privée et des divisions de classe. Aussi l'édition révisée de Bebel a-t-elle été capable de montrer le lien entre la montée de la famille patriarcale et celle de la propriété privée:
«.Avec la dissolution de la vieille société gentilice, l'influence et la position de la femme se sont rapidement affaiblies. Le droit maternel a disparu ; le droit paternel a pris sa place. L'homme est devenu un propriétaire privé : il avait un intérêt dans les enfants qu'il pouvait considérer comme légitimes et dont il a fait les héritiers de sa propriété : de ce fait, il a obligé la femme à l'abstinence de rapports avec d'autres hommes. » ([5] [2468])
Les parties les plus importantes du livre sont les deux suivantes, la troisième comme nous l'avons vu ([6] [2469]), parce qu'elle élargissait le problème à une vision générale de la société socialiste future ; la seconde parce que, sur la base de recherches approfondies, elle avait pour but de prouver concrètement comment la société bourgeoise existante, malgré toutes ses prétentions à la liberté et à l'égalité, assurait la perpétuation de la subordination de la femme. Bebel le démontrait non seulement par rapport à la sphère politique immédiate - les femmes n'avaient pas le droit de vote même dans la majorité des pays « démocratiques » de l'époque, sans parler de l'Allemagne dominée par les Junkers - mais aussi par rapport à la sphère sociale, en particulier celle du mariage au sein duquel la femme était subordonnée à 1’homme dans tous les domaines - financier, légal et sexuel. Cette inégalité s'appliquait à toutes les classes mais touchait les femmes prolétaires avec plus de force puisque qu'en plus de toutes les pressions de la pauvreté, elles subissaient fréquemment aussi la double obligation du travail salarié quotidien et des nécessités sans fin du travail domestique et de l'éducation des enfants. La description détaillée de Bebel sur la façon dont les stress combinés du travail salarié et du travail domestique sapent la possibilité de rapports harmonieux entre hommes et femmes, exprime une sensation remarquablement contemporaine, même à notre époque des soi-disant femmes « libérées » et « hommes nouveaux ».
Bebel montre aussi que « si le mariage représente l'un des côtés de la vie sexuelle du monde bourgeois, la prostitution en représente l'autre. Le premier est la face de la médaille, la seconde en est le revers. » ([7] [2470])
Bebel dénonce avec colère l'attitude hypocrite de cette société envers la prostitution ; non seulement parce que le mariage bourgeois dans lequel la femme - surtout dans les classes supérieures - est en réalité achetée et propriété du mari, est lui-même du même ordre qu'une forme légalisée de prostitution, mais aussi parce que la majorité des prostituées sont des femmes prolétaires forcées à s'abaisser hors de leur classe par les contraintes économiques du capitalisme, par la pauvreté et le chômage. Et pas seulement: la société bourgeoise respectable qui est en premier lieu celle qui amène les femmes à cet état, punit sans faille les prostituées et protège les « clients », en particulier s'ils appartiennent aux sommets de la société. Particulièrement odieuses étaient les vérifications d' « hygiène » sur les prostituées par la police, dont non seulement les examens humiliaient les femmes mais qui, de surcroît, ne se prenaient pas la peine d'arrêter l'extension des maladies vénériennes.
Entre le mariage et la prostitution, la société bourgeoise était complètement incapable de fournir aux être humains les bases d'un accomplissement sexuel. Sans aucun doute, certaines positions de Bebel sur le comportement sexuel reflètent-elles les préjugés de son époque, mais leur dynamique de fond est définitivement tournée vers le futur. Anticipant Freud, il développait avec force que la répression sexuelle conduit à la névrose :
« Il est une loi que l'homme est obligé de s'appliquer rigoureusement à soi-même s'il veut se développer d'une façon saine et normale, c'est qu'il ne doit négliger d'exercer aucun membre de son corps, ni refuser d'obéir à aucune impulsion naturelle. II faut que chaque membre remplisse les fonctions auxquelles la nature l'a destiné, sous peine de voir dépérir et s'endommager tout l'organisme. Les lois du développement physique de l'homme doivent être étudiées et suivies avec autant de soin que son développement intellectuel. Son activité morale est l'expression de la perfection physique de ses organes. La pleine santé de la première est une conséquence intime du bon état de la seconde. Une altération de l'une trouble nécessairement l'autre. Les passions dites animales n'ont pas une racine plus profonde que les passions dites intellectuelles. » ([8] [2471])
Freud devait évidemment développer un tel point de vue à un niveau bien plus profond ([9] [2472]). Mais la force particulière du marxisme est que, sur la base de telles observations scientifiques des besoins humains, il est capable de montrer qu'un être véritablement humain ne peut exister que dans une société saine et que le véritable traitement de la névrose réside dans le domaine social plutôt que dans le domaine purement individuel.
Dans la sphère plus directement « économique », Bebel montre que malgré toutes les réformes réalisées par le mouvement ouvrier, malgré tous les acquis dans l'élimination des premiers excès dans le travail des femmes et des enfants, les femmes ouvrières continuent de souffrir d'épreuves particulières: précarité de l'emploi, travail malsain et métiers dangereux... Comme Engels, Bebel reconnaissait que l'extension et l'industrialisation du travail des femmes jouait un rôle progressiste dans la libération des femmes de la stérilité et de l'isolement des travaux domestiques, créant les bases de l'unité prolétarienne dans la lutte de classe. mais il montrait aussi le côté négatif de ce processus - l'exploitation particulièrement impitoyable du travail des femmes et la difficulté croissante pour les familles ouvrières à assurer l'entretien et l'éducation de leurs enfants.
Evidemment, pour Bebel, pour Engels, bref pour le marxisme, il y a véritablement une « question de la femme » et le capitalisme est incapable d'y fournir une réponse. Le sérieux avec lequel la question était traitée par ces marxistes, démontre amplement à quel point l'idée féministe grossière selon laquelle le marxisme n'a rien à dire sur ces sujets, est creuse. Mais il existe des versions bien plus sophistiquées de féminisme. Les «féministes socialistes » dont la principale mission fut d'amener le « mouvement de libération de la femme » des armées 1960 dans l'orbite du gauchisme établi, sont tout à fait capables de « reconnaître la contribution du marxisme » au problème de la libération de la femme - rien que pour prouver l'existence de fossés, de défauts et d'erreurs dans la démarche marxiste classique, requérant donc la subtile addition du féminisme pour arriver à la « critique totale ».
Les critiques telles qu'en firent les «féministes socialistes » au travail de Bebel sont assez parlantes de cette démarche. Dans Women's Estate, Juliet Mitchell, ayant reconnu que Bebel avait fait avancer la compréhension de Marx et Engels sur le rôle des femmes en mettant en évidence que leur fonction maternelle avait servi à les placer dans une situation de dépendance, se plaint ensuite que « Bebel lui-aussi a été incapable défaire plus qu'établir que l'égalité sexuelle était impossible sans le socialisme. Sa vision du futur est une vague rêverie, tout à fait déconnectée de sa description du passé. L'absence de préoccupation stratégique l'a amené à un optimisme volontariste divorcé de la réalité. » ([10] [2473])
Une accusation similaire est portée dans le livre de Lise Vogel Marxism and the oppression of women, tentative certainement parmi les plus sophistiquées de trouver une justification « marxiste » au féminisme: la vision du futur de Bebel « reflète une vision socialiste utopique, réminiscence de Fourier et d'autres socialistes du début du 19e siècle » ; sa démarche stratégique est contradiction de sorte que Bebel ne pouvait « malgré ses meilleures intentions socialistes, suffisamment spécifier le rapport entre la libération des femmes dans le futur communiste et la lutte pour l'égalité dans le présent! capitaliste. » Non seulement il n'y a pas de rapport entre aujourd'hui et demain: même la vision du futur est fausse puisque « le socialisme est largement décrit en terme de redistribution de biens et des services déjà accessibles dans la société capitaliste à des individus indépendants, plutôt qu'en termes de réorganisation systématique de la production et des rapports sociaux. » Cette idée que « même le socialisme » ne va pas assez loin dans la direction de la libération des femmes constitue le refrain commun des féministes: Mitchell par exemple cite Engels sur la nécessité pour la société de collectiviser le travail domestique (par la fourniture de facilités communales pour cuisiner, nettoyer, s'occuper des enfants, etc. ) et conclut que Marx et Engels insistaient tous deux « trop sur l'économique » quand ce qui est en cause est fondamentalement une question de rapports sociaux et de leur transformation.
Nous dirons quelque chose sur la question de l’« utopisme » de la période de la 2e Internationale. Mais laissons parfaitement clair qu'une telle accusation est inadmissible de la part des féministes. S'il existe un problème d'utopisme dans le mouvement ouvrier de cette époque, c'est à cause des difficultés à faire le lien entre le mouvement immédiat, défensif de la classe ouvrière et le but communiste futur. Mais pour les féministes, ce lien n'est pas fourni du tout par le mouvement du prolétariat, par un mouvement de classe, mais par un « mouvement autonome des femmes » qui proclame traverser les divisions de classe et fournir le chaînon stratégique manquant entre la lutte contre l'inégalité des femmes aujourd'hui et la construction de nouveaux rapports sociaux demain. C'est l'« ingrédient secret » le plus important que toutes les féministes socialistes veulent ajouter au marxisme. Malheureusement, c'est un ingrédient qui ne peut que gâter le plat.
Le mouvement de la classe ouvrière du 19e siècle n'a pas pris et ne pouvait pas prendre exactement la même forme qu'il a prise au 20e. Opérant au sein d'une société capitaliste qui pouvait encore accorder des réformes significatives, il était légitime pour les partis sociaux-démocrates de mettre en avant un programme minimum contenant des revendications pour des améliorations économiques, légales et politiques pour les femmes ouvrières, y compris l'octroi du droit de vote. Il est vrai que le mouvement social-démocrate n'était pas toujours précis dans la distinction entre buts immédiats et objectifs finaux. A cet égard, il existe des formulations ambiguës à la fois dans L'origine de la famille et dans La femme et le socialisme et une vraie «féministe socialiste » telle que Vogel n’hésite pas à le mettre en évidence. Mais fondamentalement, les marxistes de l'époque comprenaient que la véritable signification de la lutte pour des réformes était qu'elle unissait et renforçait la classe ouvrière et l'instruisait ainsi dans la lutte historique pour une nouvelle société. C'est avant tout pour cette raison que le mouvement prolétarien s'est toujours opposé au féminisme bourgeois : pas seulement à cause de ses buts limités aux horizons de la société présente, mais parce que loin d'aider à l'unification de la classe ouvrière, il aiguisait les divisions en son sein et l'amenait en même temps hors de son propre terrain de classe.
C'est plus vrai que jamais dans la période de décadence du capitalisme où les mouvements réformistes bourgeois n'ont plus du tout de contenu progressiste. Dans cette période, le programme minimum ne s'applique plus. La seule véritable question « stratégique » c'est comment forger l'unité du mouvement de classe contre toutes les institutions de la société capitaliste afin de se préparer pour son renversement. Les divisions sexuelles au sein de la classe, comme toutes les autres (raciales, religieuses, etc.) affaiblissent évidemment le mouvement et doivent être combattues à tous les niveaux, mais elles ne peuvent être combattues qu'avec les méthodes de la lutte de classe - à travers l'unité de sa lutte et de son organisation. La revendication des féministes d'un mouvement autonome des femmes ne peut être qu'une attaque directe contre ces méthodes ; tout comme le nationalisme noir et d'autres soi-disant « mouvements d'opprimés », elle est devenue un instrument de la société capitaliste pour exacerber les divisions au sein du prolétariat.
La perspective d'un mouvement séparé des femmes, vu comme la seule garantie à un futur « non sexiste », tourne en fait le dos au futur et finit par se fixer sur des questions « de femmes » les plus immédiates et particulières, telles que la maternité et l'éducation des enfants - qui n'ont en fait de véritable futur que lorsqu'elles sont posées en termes de classe (par exemple la revendication des ouvriers polonais en 1980). Elle est donc fondamentalement réformiste. Il en va de même pour cette autre critique féministe « radicale » du marxisme: le fait que le marxisme insiste sur la nécessité de transférer les (travaux) domestiques et l'éducation des enfants de toutes sortes de l'individu à la sphère communale serait « trop économiste ».
Dans ces articles, nous avons attaqué l'idée que le communisme soit autre chose que la transformation totale des rapports sociaux. La vision féministe selon laquelle le communisme ne va pas assez loin, ne voit pas plus loin que la politique et l'économique pour arriver au véritable dépassement de l'aliénation, n'est pas simplement fausse : c'est une adjonction directe au programme gauchiste de capitalisme d'Etat puisque les féministes montrent systématiquement les modèles « socialistes » existants (Chine, Cuba, auparavant l'URSS) pour prouver que les changements économiques et politiques ne sont pas suffisants sans la lutte consciente pour la libération des femmes. Bref: les féministes s'érigent elles-mêmes en groupe de pression pour le capitalisme d'Etat, se faisant sa conscience « antisexiste ». Le rapport symbiotique entre le féminisme et la gauche capitaliste « dominée par les mâles » le prouve suffisamment.
Cependant, pour le marxisme, tout comme la prise du pouvoir par la classe ouvrière ne constitue que le premier pas vers l'inauguration d'une société communiste, la destruction des rapports marchands et la collectivisation de la production et de la consommation, bref le contenu « économique » de la révolution ne fait que fournir la base matérielle pour la création de rapports qualitativement nouveaux entre les êtres humains.
Dans ses Commentaires sur les Manuscrits de 1844, Bordiga explique de façon éloquente pourquoi ce doit être le cas dans une société qui a réalisé l'aliénation des rapports humains jusque dans les rapports sexuels en les subordonnant tous à la domination du marché :
« Le rapport des sexes dans la société bourgeoise oblige la femme, à faire d'une position passive un calcul économique chaque fois qu'elle accède à l'amour. Le mâle fait ce calcul de façon active en inscrivant au bilan une somme allouée à un besoin satisfait. Ainsi dans la société bourgeoise, non seulement tous les besoins sont traduits en argent - ainsi pour le besoin d'amour chez le mâle - mais, pour la femme, le besoin d'argent tue le besoin d'amour. » ([11] [2474])
Il ne peut y avoir dépassement de cette aliénation sans l'abolition de l'économie marchande et de l'insécurité matérielle qui va avec (insécurité ressentie d'abord et avant tout par les femmes). Mais cela requiert aussi l'élimination de toutes les structures économiques et sociales qui reflètent et reproduisent les rapports de marché, en particulier la famille atomisée qui devient une barrière à l'accomplissement réel de l'amour entre les sexes :
« Dans le communisme non monétaire, l'amour aura, en tant que besoin, le même poids et le même sens pour les deux sexes et l'acte qui le consacre, réalisera la formule sociale que le besoin de l'autre homme est mon besoin d'homme, dans la mesure où le besoin d'un sexe se réalise comme un besoin de l'autre sexe. On ne peut pas proposer cela uniquement en tant que rapport moral fondé sur un certain mode de rapport physique parce que le passage à une forme supérieure de société s'effectue dans le domaine économique : les enfants et leur charge ne concernent plus les deux parents qui s'unissent, mais la communauté. »
Contre ce programme matérialiste pour l'humanisation authentique des rapports sexuels, qu'offrent les féministes avec leur proclamation que le marxisme ne va pas assez loin ? En niant la question de la révolution - de la nécessité absolue du renversement économique et politique du capital - le féminisme « au mieux » ne peut rien offrir de plus qu'« un rapport moral fondé sur une certaine connexion physique », bref des sermons moralistes contre des attitudes sexistes ou des expériences utopiques de nouveaux rapports au sein de la prison de la société bourgeoise. La vraie pauvreté de la critique féministe est probablement le mieux résumée dans les atrocités du politically correct où l'obsession de changer les mots a épuisé toute passion pour changer le monde. Le féminisme se révèle ainsi comme un autre obstacle au développement d'une conscience et d'une action véritablement radicaux.
Le paysage du futur
Le faux radicalisme en vert
Le féminisme n'est pas seul à « découvrir » l'échec du marxisme à aller à la racine des choses. Son proche cousin, le mouvement « écologiste », proclame la même chose. Nous avons déjà résumé la critique « verte » du marxisme dans un précédent article de cette revue ([12] [2475]) : posé simplement, l'argument est que le marxisme ne serait, à l'instar du capitalisme, qu'une autre idéologie de croissance, exprimant une vision « productionniste » de l’homme et aliénée de la nature.
Ce tour de passe-passe est habituellement réalisé
par l'assimilation du marxisme au stalinisme : l'état hideux de l'environnement
dans les anciens pays « communistes » est présenté comme un véritable legs
de Marx et Engels. Cependant, il existe des versions plus sophistiquées de ce
tour. Des conseillistes, des bordiguistes et des gens désenchantés qui flirtent
maintenant avec le primitivisme et autres « verdures »,
savent que les régimes staliniens étaient du capitalisme et pas du
communisme ; ils connaissent également le point de vue profond sur les rapports
entre l'homme et la nature contenu dans les écrits de Marx, en particulier dans
les Manuscrits de 1844. De tels
courants concentrent donc leur feu sur la période de la 2e Internationale,
période durant laquelle la vision dialectique de Marx a été soi-disant effacée
sans laisser de trace pour être remplacée
par un démarche mécaniste qui adorait passivement la science et la technologie
bourgeoises, et plaçait l'abstrait « développement
des forces productives » au-dessus de tout programme réel de libération
humaine. Les intellectuels snobs de Aufheben sont spécialisés dans
l'élaboration de ce point de vue, en particulier dans leur longue série qui
attaque la notion de décadence capitaliste. Kautsky et Lénine sont souvent
cités comme les contrevenants en chef, mais Engels lui-même n'échappe pas au
bâton.
La dialectique universelle
Ce n'est pas ici le lieu de traiter ces arguments en détail, en particulier parce que nous voulons nous centrer dans cet article non sur les questions philosophiques mais sur ce que les socialistes de la seconde internationale disaient sur socialisme et de la nouvelle société pour laquelle ils luttaient. Néanmoins, quelques observations sur la « philosophie », sur la vision mondiale générale du marxisme ne sera pas hors sujet puisque celle-ci est liée à la façon dont le mouvement ouvrier a traité de la question plus concrète de l'environnement naturel dans une société socialiste.
Dans de précédents articles de cette série, nous avons déjà posé la question de la façon dont Marx envisageait le problème, dans ses premiers travaux et par la suite ([13] [2476]). Dans la vision dialectique, l’homme fait partie de la nature, il n'est pas quelqu' « être établi hors du monde ». La nature, comme le dit Marx, est le corps de l’homme et il ne peut pas plus vivre sans elle qu'une tête sans un corps. Mais l'homme n'est pas « seulement » un autre animal, un produit passif de la nature. Il est un être qui, de façon unique, est actif, créateur, qui, seul parmi les animaux, est capable de transformer le monde autour de lui en accord avec ses besoins et ses désirs.
II est vrai que la vision dialectique n'a pas toujours été bien comprise par les successeurs de Marx et que, comme diverses idéologies bourgeoises infestaient les partis de la 2e Internationale, ces virus s'exprimaient aussi sur le terrain « philosophique ». A une époque où la bourgeoisie avançait triomphalement, la notion que la science et la technologie contenaient en elles-mêmes la réponse à tous les problèmes de 1ltumanité est devenue un accessoire du développement de théories réformistes et révisionnistes au sein du mouvement. Mais même les plus « orthodoxes » des marxistes n'étaient pas immunisés : certains travaux de Kautsky, par exemple, tendent à réduire l’histoire de l'homme à un processus scientifique purement naturel dans lequel la victoire du socialisme serait automatique. De même Pannekoek a montré que certaines conceptions philosophiques de Lénine reflétaient le matérialisme mécanique de la bourgeoisie.
Mais comme font montré les camarades de la Gauche communiste de France dans leur série d'articles sur Lénine philosophe de Pannekoek ([14] [2477]), même si Pannekoek a porté des critiques pertinentes aux idées de Lénine sur les rapports entre la conscience humaine et le monde naturel, sa méthode de base était imparfaite parce que lui-même faisait un lien mécanique entre les erreurs philosophiques de Lénine et la nature de classe du bolchevisme. La même chose s'applique à la 2e Internationale en général. Ceux qui défendent que c'était un mouvement bourgeois parce qu'il était influencé par l'idéologie dominante, ne comprennent pas le mouvement ouvrier en général, son combat incessant contre la pénétration des idées de la classe dominante dans ses rangs, ni les conditions particulières dans lesquelles les partis de la 2e Internationale eux-mêmes menaient cette lutte. Les partis social-démocrates étaient prolétariens malgré les influences bourgeoise et petite-bourgeoise qui les affectaient, dans une mesure plus ou moins grande, à différents moments de leur histoire.
Nous avons déjà montré, dans le précédent article de cette série, qu'Engels était certainement l'interprète et le défenseur le plus en vue de la vision prolétarienne du socialisme dans les premières années de la social-démocratie, et que cette vision était défendue par d'autres camarades contre les déviations qui se sont développées ultérieurement dans cette période. La même chose s'applique à la question plus abstraite du rapport de l’homme à la nature. Du début des années 1870 jusqu'à la fin de sa vie, Engels a travaillé sur La dialectique de la nature, ouvrage où il a essayé de résumer la démarche marxiste sur cette question. La thèse essentielle de ce travail vaste et incomplet est qu'à la fois le monde naturel et le monde de la pensée humaine suivent un mouvement dialectique. Loin de mettre l’humanité hors ou au-dessus de la nature, Engels affirme que :
« A chaque pas nouveau, nous sommes ainsi amenés à penser que nous ne dominons nullement la nature, à l'instar du conquérant d'un peuple étranger, comme si nous étions placés en dehors de la nature - mais qu'au contraire nous lui appartenons tout entier par la chair, le sang, le cerveau et en faisons partie, et que toute la souveraineté que nous exerçons sur elle, se résume à la connaissance de ses lois et à leur juste application qui sont notre seule supériorité sur toutes les autres créatures. » ([15] [2478])
Cependant pour toute une série de « marxistes » académiques (les soi-disant marxistes occidentaux qui sont les véritables mentors de Aufheben et ses semblables), La dialectique de la nature est la source théorique de tout mal, la justification scientifique du matérialisme mécanique et du réformisme de la 2e Internationale. Dans un précédent article de la série ([16] [2479]), nous avons déjà donné des éléments de réponse à ces accusations, celle de réformisme en particulier a été plus longuement traitée dans l'article sur le centenaire de la mort d'Engels dans la Revue internationale n° 83 ([17] [2480]). Mais pour nous limiter au terrain de la « philosophie », ça vaut le coup de noter que, pour les « marxistes occidentaux » comme Alfred Schmidt, l'argument d'Engels selon lequel la dialectique « cosmique » et la dialectique « humaine » sont au fond une et identique, serait une espèce non seulement de matérialisme mécanique mais même de « panthéisme » et de « mysticisme »([18] [2481]).Schmidt suit ici l'exemple de Lukacs qui argumentait aussi que la dialectique se limitait au « royaume de l’histoire et de la société » et critiquait le fait qu'« Engels - suivant la mauvaise direction d’Hegel - étendait la méthode pour l'appliquer aussi à la nature. » ([19] [2482])
En fait, cette accusation de « mysticisme » est sans fondement. Il est vrai, et Engels le reconnaît lui-même dans La dialectique de la nature, que certaines visions du monde préscientifiques telles que le bouddhisme, avaient développé des points de vue authentiques sur le mouvement dialectique à la fois de la nature et de la psyché humaine. Hegel lui-même avait été fortement influencé par de telles approches. Mais alors que tous ces systèmes restaient mystiques dans le sens où ils ne pouvaient aller au-delà d'une vision passive de l'unité entre l'homme et la nature, la vision d'Engels, vision du prolétariat, est active est créatrice. L'homme est un produit du mouvement cosmique, mais comme le passage précédent de « La part jouée par le travail... » le souligne, il a la capacité -et ceci d'autant plus comme espèce et pas simplement comme individu illuminé - de maîtriser les lois de ce mouvement et de les utiliser pour les changer et les diriger.
A ce niveau, Lukacs et les « marxistes occidentaux » ont tort d'opposer Engels à Marx puisque ces derniers sont tous les deux d'accord avec Hegel que le principe dialectique « est valable pour l'histoire comme pour les sciences naturelles. »
De plus, l'incohérence de la critique de Lukacs peut se voir dans le fait que dans le même ouvrage, il cite en l'approuvant deux clés de Hegel quand il dit que « la vérité doit être comprise et exprimée pas seulement comme substance mais aussi comme sujet » et que « la vérité n'est pas de traiter les objets comme étrangers. » ([20] [2483])
Ce que Lukacs ne réussit pas à voir, c'est que ces formules clarifient la véritable relation entre l’homme et la nature. Tandis que le panthéisme mystique et le matérialisme mécanique tendent tous deux à voir la conscience humaine comme le reflet passif du monde naturel, Marx et Engels saisissent que c'est en fait - par dessus tout dans sa forme réalisée en tant qu'auto-conscience de l’humanité sociale - le sujet dynamique du mouvement naturel. Un tel point de vue présage du futur communiste où l’homme ne traitera plus ni le monde social ni le monde naturel comme une série d'objets étrangers et hostiles. Nous ne pouvons qu'ajouter que les développement des sciences naturelles depuis l'époque d’Engels - en particulier dans le champ de la physique quantique - ont ajouté un poids considérable à la notion de dialectique de la nature.
La civilisation mais pas telle qu'on la connaît.
En tant que bons idéalistes, les « verts » expliquent souvent la propension du capitalisme à détruire l'environnement naturel comme l'issue logique de la vision aliénée de la bourgeoisie sur la nature; pour les marxistes, c'est fondamentalement le produit du mode capitaliste de production lui-même. Aussi la bataille pour « sauver la planète » des conséquences désastreuses de cette civilisation se situe d'abord et avant tout, non au niveau de la philosophie, mais à celui de la politique, et requiert un programme pratique pour la réorganisation de la société. Et même si au 19e siècle, la destruction de l'environnement n'avait pas encore atteint les proportions catastrophiques qu'elle connaît dans la dernière partie du 20e siècle, le mouvement marxiste a néanmoins reconnu dès sa naissance que la révolution communiste impliquait une refonte très radicale du paysage naturel et humain pour compenser les dommages infligés aux deux par le massacre sans limite de l'accumulation capitaliste. Depuis le Manifeste communiste jusqu’'aux derniers écrits d'Engels et dans La femme et le socialisme de Bebel, une formule résume cette reconnaissance : abolition de la séparation entre la ville et la campagne. Engels dont le premier livre majeur Les conditions de la classe ouvrière en Angleterre s'était élevé contre les conditions d'existence empoisonnées que l'industrie et le logement capitalistes imposaient au prolétariat, revient sur cette question dans l’AntiDuhring :
« La suppression de l'opposition de la ville et de la campagne n'est donc pas seulement possible. Elle est devenue une nécessité directe de la production industrielle elle-même, comme elle est également devenue une nécessité de la production agricole, et, par-dessus le marché, de l'hygiène publique. Ce n'est que par la fusion de la ville et de la campagne que l'on peut éliminer l'intoxication actuelle de l'air, de l'eau et du sol ; elle seule peut amener les masses qui aujourd'hui languissent dans les villes au point où leur fumier servira à produire des plantes, au lieu de produire des maladies... Certes, la civilisation nous a laissé, avec les grandes villes, un héritage qu'il faudra beaucoup de temps et de peine pour éliminer. Mais il faudra les éliminer et elles le seront, même si c'est un processus de longue durée. Quelles que soient les destinées réservées à l'Empire allemand de la nation prussienne, Bismarck peut descendre au cercueil avec la fière conscience que son souhait le plus cher sera sûrement exaucé : le déclin des grandes villes. » ([21] [2484])
La dernière remarque n'a évidemment pas pour intention de réconforter les réactionnaires qui rêvent d'un retour aux « simplicités de la vie de village » ou plutôt aux certitudes de l'exploitation féodale, ni à leur incarnation « verte » de la période présente dont le modèle d'une société écologiquement harmonieuse est fondé sur les fantaisies proudhoniennes de communes locales liées par des rapports. d'échange. Engels dit clairement que le démantèlement des gigantesques villes n'est possible que sur la base d'une communauté globalement planifiée:
« Seule une société qui engrène harmonieusement ses forces productives lune dans l'autre selon les lignes grandioses d’un plan unique peut permettre à l'industrie de s'installer à travers tout le pays, avec cette dispersion qui est la plus convenable à son propre développement. » ([22] [2485])
De plus, cette « décentralisation centralisée » n'est possible que parce que « l'industrie capitaliste s'est déjà rendue relativement indépendante des barrières locales que constituaient les lieux de production de ses matières premières. (..)
La société libérée des barrières de la production capitaliste peut aller bien plus loin encore. En produisant une race de producteurs développés dans tous les sens, qui comprendront les bases scientifiques de l'ensemble de la production industrielle, et dont chacun aura parcouru dans la pratique toute une série de branches de production d'un bout à l'autre, elle créera une nouvelle force productive compensant très largement le travail de transport des matières premières ou des combustibles tirés de grande distance. » ([23] [2486])
Aussi, l'élimination des grandes villes n'est pas la fin de la civilisation, à moins d'identifier cette dernière à la division de la société en classes. Si le marxisme reconnaît que les populations du monde futur s'éloigneront des vieux centres urbains, ce n'est pas pour se retirer dans le « crétinisme rural », dans l'isolement inchangé et le philistinisme de la vie paysanne. Comme le dit Bebel :
« Aussitôt que la population urbaine aura la possibilité de transporter à la campagne toutes les choses nécessaires à l'état de civilisation auquel elle sera habituée, et d’y retrouver ses musées, ses théâtres, ses salles de concert, ses cabinets de lecture, ses bibliothèques, ses lieux de réunion, ses établissements d'instruction, etc... elle commencera sans retard son émigration. La vie à la campagne aura tous les avantages jusque-là réservés aux grandes villes, sans en avoir les inconvénients. Les habitations y seront plus saines, plus agréables. La population agricole s'intéressera aux choses de l'industrie, la population industrielle à l'agriculture. » ([24] [2487])
Sans mettre en question la compréhension que cette nouvelle société sera basée sur les développements technologiques les plus avancés, Bebel anticipe aussi :
« Chaque commune formera en quelque sorte une zone de culture dans laquelle elle produira elle-même la plus grande partie de ce qui sera nécessaire à son existence. Le jardinage, en particulier, la plus agréable de presque toutes les occupations pratiques, atteindra sa plus florissante prospérité. La culture des fleurs, des plantes d'ornement, des légumes, des fruits, offre un champ presqu'inépuisable à l'activité humaine ; elle constitue tout particulièrement un travail de détail qui exclut l'emploi de grandes machines. » ([25] [2488])
Ainsi Bebel voit une société hautement productive mais qui produit au rythme humain :
« Le bruit énervant de la foule courant à ses affaires dans nos grands centres commerciaux, avec leurs milliers de véhicules de tout genre, tout cela sera profondément modifié et prendra un tout autre caractère. » ([26] [2489])
Ici, la description du futur par Bebel est très similaire à celle que fait William Morris qui utilisait aussi l'image du jardin et a donné à son roman futuriste Nouvelles de nulle part le titre alternatif Une époque de repos. Dans son style direct caractéristique, Morris explique que tous les « désavantages » des villes modernes, leur saleté, leur course folle et leur apparence hideuse sont le produit direct de l'accumulation capitaliste et ne peuvent être éliminés qu'en éliminant le capital :
« A nouveau, l'agrégation de population qui a servi le but de donner aux gens des opportunités de communiquer et que les ouvriers se sentent solidaires, arrivera aussi à sa fin ; et les immenses quartiers ouvriers se désagrégeront et la nature cicatrisera les horribles plaies que l'imprudence, l'avidité et la terreur stupide de l'homme ont faites ; car ce ne sera plus une affreuse nécessité que le tissu de coton soit un tout petit peu meilleur marché cette année que l'année dernière. » ([27] [2490])
Nous pouvons ajouter qu'en tant qu'artiste, Morris avait la préoccupation particulière de dépasser la laideur pure et simple de l'environnement capitaliste et de le refondre selon les canons de la créativité artistique. Voilà comment il pose la question dans un discours sur l' « Art sous la Ploutocratie » :
« Et d'abord, je dois vous demander d'étendre le terme d'art au-delà des sujets qui sont consciemment des œuvres d'art, de ne pas le prendre pour la peinture et la sculpture, et l'architecture, mais de l'étendre aux formes et aux couleurs de tous les objets domestiques, et même à l'arrangement des champs de culture et de pâturage, à celui des villes et des routes de toutes sortes ; en un mot, de l'étendre à tous les aspects externes de notre vie. Car je dois vous demander de croire que chacune des choses qui font l'entourage dans lequel nous vivons, doit être pour celui qui doit le faire, ou belle ou laide, ou élevante ou dégradante, ou un tourment et un poids ou bien un plaisir et un ensoleillement. Comment faire donc avec ce qui nous entoure aujourd'hui ? Quelles sortes de comptes rendrons-nous à ceux qui viennent après nous sur la façon dont nous avons traité la terre, que nos aïeux nous ont laissée encore si belle, malgré des milliers d'années de conflits, de négligence et d'égoïsme ? » ([28] [2491])
Ici Morris pose la question
de la seule façon dont un marxiste peut la poser: du point de vue du
communisme, du futur communiste: l'apparence externe dégradante de la
civilisation bourgeoise ne peut être jugée qu'avec la plus grande sévérité par
un monde dans lequel chaque aspect de la production, depuis le plus petit objet
de maison jusqu'au dessin et à la maquette du paysage, est fait comme le dit
Marx dans les Manuscrits de 1844 « en
accord avec la loi de la beauté » . Dans cette vision, les
producteurs associés sont devenus des artistes associés, créant un
environnement physique qui répond au besoin profond de l'humanité de beauté et
d'harmonie.
La perversion stalinienne
Nous avons mentionné que la « critique » des écologistes du marxisme se base sur la fausse identification entre stalinisme et communisme. Le stalinisme incarne la destruction capitaliste de la nature et la justifie par une rhétorique marxiste. Mais le stalinisme n'a jamais été capable de laisser intacts les fondements de la théorie marxiste - il a commencé par réviser le concept marxiste d'internationalisme et il est arrivé à attaquer chaque autre principe fondamental du prolétariat, plus ou moins explicitement. C'est la même chose pour la revendication d'abolition de l'opposition entre ville et campagne. L'écrivain stalinien qui introduit en 1971 l'édition de Moscou de « La société du futur », extrait de La femme et le socialisme de Bebel, explique comment Bebel (et donc Marx et Engels) se sont trompés sur ce point :
« L'expérience de la construction socialiste ne confirme pas non plus la position de Bebel selon laquelle, avec l'abolition de l'opposition entre la ville et la campagne, la population quittera les grandes villes. L'abolition de cette opposition implique qu'en dernière instance il n y ait ni ville, ni campagne dans le sens moderne du terme. En même temps, il faut s'attendre à ce que les grandes villes, même si leur nature change dans la société communiste développée, garderont leur importance en tant que centres culturels historiquement évolués. » ([29] [2492])
L'expérience de la « construction du socialisme » dans les régimes staliniens ne fait que confirmer que c'est la tendance de la civilisation bourgeoise, surtout dans son époque de déclin, d'entasser de plus en plus d'êtres humains dans des villes qui ont gonflé au-delà de toute proportion humaine, dépassant de loin les pires cauchemars des fondateurs de la théorie marxiste qui trouvaient déjà que lès villes de leur époque étaient catastrophiques. Les staliniens ont mis le marxisme sur la tête comme partout ailleurs : ainsi le despote Ceaucescu en Roumanie a proclamé que l'élimination par bulldozer des anciens villages et leur remplacement par de gigantesques tours « ouvrières » constituaient l'abolition de l'opposition entre ville et campagne. La réponse la plus pertinente à ces perversions est fournie par Bordiga dans son Espace contre ciment, écrit au début des années 1950. Ce texte est une dénonciation passionnée des conditions de boîtes de sardines imposées à la majorité de l’humanité par l'urbanisme capitaliste et une claire réaffirmation de la position marxiste d'origine sur cette question :
« Quand après avoir écrasé par la force cette dictature chaque jour plus obscène, il sera possible de subordonner chaque solution et chaque plan à l'amélioration des conditions de travail... alors le verticalisme brut des monstres de ciment sera ridiculisé, et supprimé, et dans les immenses étendues d'espace horizontal, les villes géantes une fois dégonflées, la force et l'intelligence de l'animal homme tendront progressivement à rendre uniformes sur les terres habitables la densité de la vie et celle du travail ; et ces forces seront désormais en harmonie, et non plus farouchement ennemies comme dans la civilisation difforme d'aujourd'hui où elles ne sont réunies que par le spectre de la servitude et de la faim. » ([30] [2493])
Cette transformation vraiment radicale de l'environnement est plus que jamais nécessaire dans la période présente de décomposition capitaliste où les cités géantes sont devenues non seulement de plus en plus enflées et invivables, mais sont devenues aussi le point nodal de la menace capitaliste sur l'ensemble de la vie planétaire. Le programme communiste, ici comme dans tous les autres domaines, constitue la meilleure réfutation du stalinisme. Et c'est aussi une gifle au visage du pseudo-radicalisme des « verts » qui ne peuvent jamais dépasser leur danse incessante entre deux fausses solutions: d'un côté, le rêve nostalgique d'un vol en arrière dans le passé qui trouve son expression la plus logique dans les apocalypses des « anarchistes verts » et des primitivistes dont le « retour à la nature » ne peut que se fonder sur l'extermination de la majorité du genre humain; et, d'un autre côté, les « réformes » de rafistolage à petite échelle et les expériences de l'aile écologiste plus respectable (soutenues de toutes façons par les primitivistes par tactique) qui cherchent simplement des solutions par petits bouts à tous les problèmes particuliers de la vie de cité moderne - le bruit, le stress, la pollution, le surpeuplement, les embouteillages et le reste. Mais si les êtres humains sont dominés par les machines, les systèmes de transport et les immeubles qu'ils ont eux-mêmes construits, c'est parce qu'ils sont emprisonnés dans une société où le travail mort domine le travail vivant à chaque tournant. Seulement quand l'humanité reprendra le contrôle de sa propre activité productrice, elle pourra créer un environnement compatible avec ses besoins ; mais la prémisse en est le renversement forcé de la « dictature de plus en plus obscène »du capitalisme, bref, la révolution prolétarienne.
CDW.
Dans le prochain article de cette série, nous examinerons comment les révolutionnaires de la fin du 19e siècle prévoyaient la plus cruciale de toutes les transformations - la transformation du « travail inutile » en « travail utile », c'est-à-dire le dépassement pratique du travail aliéné. Nous reviendrons alors sur l'accusation qui a été portée à ces visions du socialisme - qu'elles représenteraient une rechute dans à l’utopisme pré marxiste. Ceci nous amènera à la question qui devait devenir la préoccupation majeure du mouvement révolutionnaire dans la première décennie de ce siècle: pas tant le but ultime du mouvement, mais les moyens d'y parvenir.
[1] [2494] Voir l'article de cette série dans la Revue internationale n°81.
[2] [2495] Manuscrits parisiens, 1844, Editions La Pléiade, Tome II, page 79.
[3] [2496] Voir la Revue internationale n° 81.
[4] [2497] Ottilie Baader, citée dans Vogel, Marxism and the oppresion of wornen, Pluto Press 1983, traduit de l'anglais par nous.
[5] [2498] Traduit de l'anglais par nous.
[6] [2499] Voir la Revue internationale n° 84.
[7] [2500] La femme dans le passé, le présent et l'avenir, Edition Ressources, page 128.
[8] [2501] Ibid., page 60
[9] [2502] Dans ce passage de Bebel, le rapport entre les états mentaux et physiologiques sont présentés d'une façon un peu mécanique. Freud a mené l'exploration de la névrose à un niveau nouveau en montrant que l'être humain ne peut être compris comme une unité mentale et physique fermée, mais s'étant au champ de la réalité sociale. Mais il faut rappeler que Freud lui-même avait commencé par un modèle hautement mécanique de la psyché et que ce n'est qu'après qu'il a développé vers une vision plus sociale, plus dialectique du développement mental de l'homme.
[10] [2503] Penguin Books, 1971, traduit de l'anglais par nous.
[11] [2504] Bordiga, La passion du communisme, Ed. Spartaeus 1972
[12] [2505] « C'est le capitalisme qui empoisonne la terre »,.Revue internationale n° 63.
[13] [2506] Voir Revue internationale n° 70, 71 et 75.
[14] [2507] Voir Revue internationale n° 25, 27, 28, 30
[15] [2508] La dialectique de la nature, Ed. M.Rivière & Cie 1950, « La part du travail dans la transition de l’homme au singe».
[16] [2509] Voir Revue internationale n° 81.
[17] [2510] Voir aussi le rejet par la Conununist Workers’Organisation de la notion d'une scission entre Marx et Engels dans Revolutionary Perspectives n° 1 série 3.
[18] [2511] Cf. Le concept de nature chez Marx, 1962.
[19] [2512] Dans Histoire et conscience de classe, Lukacs.
[20] [2513] Ibid.
[21] [2514] L'anti-Düring, Editions sociales 1977, pages 333 et 334.
[22] [2515] Ibid., page 333.
[23] [2516] Ibid., page 334.
[24] [2517] La femme dans le passé..., op cit, page 296.
[25] [2518] Ibid., page 297.
[26] [2519] Ibid., page 281.
[27] [2520] Ecrits politiques de William Morris,« La-société du futur
[28] [2521] Ibid.
[29] [2522] Traduit par nous.
[30] [2523] Espèce humaine et croûte terrestre
Approfondir:
Questions théoriques:
- Communisme [492]
Heritage de la Gauche Communiste:
Revue Internationale no 86 - 3e trimestre 1996
- 3068 reads
Lutte de classe : le prolétariat ne doit pas sous-estimer son ennemi de classe
- 3254 reads
Avec l'effondrement des régimes staliniens d'Europe de l'est à la fin des années 1980 et toutes les campagnes médiatiques qui se sont déchaînées sur la « mort du communisme », la « fin de la lutte de classe », voire la « disparition de la classe ouvrière », le prolétariat mondial a subi une défaite idéologique massive, une défaite aggravée par les événements qui ont suivi, notamment la guerre du Golfe en 1991, et qui ont encore amplifié son sentiment d'impuissance. Depuis, notamment à partir des grands mouvements de l'automne 1992 en Italie, le prolétariat a retrouvé le chemin des combats de classe, avec de nombreuses difficultés mais de façon indiscutable. L'aliment essentiel de cette reprise des combats prolétariens est constitué par les attaques incessantes et de plus en plus brutales que la bourgeoisie de tous les pays est conduite à déchaîner en même temps que son système économique s'enfonce dans une crise sans issue. La classe dominante sait parfaitement qu'elle ne pourra faire passer ces attaques et empêcher qu'elles ne conduisent à une radicalisation des luttes ouvrières que si elle met en place tout un arsenal politique destiné à dévoyer ces dernières, à les conduire dans des impasses, à les stériliser et les défaire. Et pour ce faire, elle doit pouvoir compter sur l'efficacité de ces organes de l'Etat bourgeois en milieu ouvrier que sont les syndicats. En d'autres termes, la capacité de la bourgeoisie à imposer sa loi à la classe exploitée dépend et dépendra du crédit que les syndicats et le syndicalisme seront capables d'établir auprès de cette dernière. C'est justement ce que les grèves de la fin 1995 en France et en Belgique ont démontré de façon très claire. C'est ce que montre à l'heure actuelle l'agitation syndicale dans le principal pays européen : l'Allemagne.
Dans nos deux précédents numéros de la Revue internationale, nous avons examiné les moyens employés par la bourgeoisie, lors du mouvement de grève qui a touché la France à la fin de l'année 1995, pour prendre les devants face à la perspective du resurgissement des luttes ouvrières. L'analyse que nous avons développée sur ces événements peut se résumer dans les extraits suivants de l'article que nous avions publié dans le n° 84 de la Revue alors que le mouvement n'était pas encore achevé :
« En réalité, le prolétariat en France est la cible d'une manoeuvre d'ampleur destinée à l'affaiblir dans sa conscience et dans sa combativité, une manoeuvre qui s'adresse également à la classe ouvrière des autres pays afin de lui faire tirer de fausses leçons des événements en France. » (Revue internationale n° 84, « Lutter derrière les syndicats mène à la défaite »)
Et la principale fausse leçon que la bourgeoisie se proposait de faire tirer à la classe ouvrière c'est que les syndicats constituent de véritables organes de la lutte prolétarienne :
« Cette recrédibilisation des syndicats constituait pour la bourgeoisie un objectif fondamental, un préalable indispensable avant de porter les attaques à venir qui seront encore bien plus brutales que celles d'aujourd'hui. C'est à cette condition seulement qu'elle peut espérer saboter les luttes qui ne manqueront pas de surgir au moment de ces attaques. » (Ibid.)
Dans le n° 85 de la Revue nous avons indiqué comment, presqu'en même temps que la manoeuvre de la bourgeoisie française, la bourgeoisie belge, tirant profit de cette dernière, en avait déployé une copie conforme incorporant tous ses principaux ingrédients :
- série d'attaques capitalistes touchant tous les secteurs de la classe ouvrière (en l'occurrence contre la sécurité sociale) mais particulièrement provocatrices pour un secteur particulier (en France, les travailleurs des chemins de fer et des transports parisiens ; en Belgique, les travailleurs des chemins de fer et de la compagnie aérienne nationale) ; la « méthode Juppé », concentrant sur un court espace de temps une avalanche d'attaques, mise en oeuvre avec arrogance et cynisme, fait partie de la manoeuvre : il faut faire exploser le mécontentement ;
- appels très radicaux des syndicats à l'extension de la riposte ouvrière en mettant en avant l'exemple du secteur « d'avant garde » choisi par la bourgeoisie ;
- recul de la bourgeoisie sur les mesures spécifiques les plus provocatrices : les syndicats crient à la victoire de la « mobilisation » qu'ils ont organisée, les secteurs « en pointe » reprennent le travail ce qui conduit à la démobilisation des autres secteurs.
Le résultat de ces manoeuvres a été que la bourgeoisie a réussi à faire passer les mesures de portée plus générale, celles qui touchent l'ensemble de la classe ouvrière, tout en ayant l'air de reculer face aux luttes ce qui a accrédité l'idée que celles-ci, sous la conduite des syndicats, avaient été victorieuses. C'était tout bénéfice aussi bien pour le gouvernement et les patrons que pour les syndicats. Ce qui apparaissait ainsi pour beaucoup d'ouvriers comme une « victoire », ou une demi-victoire (il n'était pas difficile pour la grande masse des travailleurs de constater que sur des questions essentielles, comme la protection sociale, le gouvernement n'avait pas reculé) était, en réalité, une défaite, une défaite au plan matériel, évidemment, mais surtout une défaite politique puisque le principal ennemi de la classe ouvrière, le plus dangereux parce ce qu'il se présente comme son allié, l'appareil syndical, a augmenté son emprise et son pouvoir de mystification parmi les ouvriers.
Les analyses des groupes communistes
Les analyses des mouvements sociaux de la fin 1995 présentées par le CCI, aussi bien dans la Revue internationale que dans sa presse territoriale et ses réunions publiques, ont rencontré majoritairement parmi ses lecteurs et ceux qui assistaient à ces dernières, intérêt et approbation. En revanche, elles n'ont pas été partagées par la plupart des autres organisations du milieu politique prolétarien. Dans le précédent numéro de la Revue, nous avons mis en évidence comment les deux organisations qui composent le BIPR, le CWO et Battaglia Comunista, s'étaient laissé piéger par la manoeuvre de la bourgeoisie en étant justement incapables d'identifier cette manoeuvre. Ces camarades, par exemple, ont reproché à notre analyse de conduire à l'idée que les ouvriers sont des imbéciles puisqu'ils se seraient laissé mystifier par les manoeuvres bourgeoises. Plus généralement, ils considèrent que, avec notre vision, la révolution prolétarienne serait impossible puisque les ouvriers seraient toujours les victimes des mystifications mises en oeuvre par la bourgeoisie. Rien n'est plus faux.
En premier lieu, le fait qu'aujourd'hui les ouvriers puissent se laisser piéger par des manoeuvres bourgeoises ne signifie pas qu'il en sera toujours ainsi. L'histoire du mouvement ouvrier est pleine d'exemples où les mêmes ouvriers qui se laissaient embrigader derrière des drapeaux bourgeois ont été capables, par la suite, de mener des combats exemplaires, voire révolutionnaires. Ce sont les mêmes ouvriers russes et allemands qui, derrière leurs drapeaux nationaux s'étaient étripés les uns les autres à partir de 1914, se sont ensuite lancés dans la révolution prolétarienne en 1917, et avec succès, pour les premiers, et en 1918 pour les seconds, imposant à la bourgeoisie la fin de la boucherie impérialiste. L'histoire nous a appris, plus généralement, que la classe ouvrière est capable de tirer des enseignements de ses défaites, de déjouer les pièges dans lesquels elle était tombée antérieurement.
Et il revient justement aux minorités révolutionnaires, aux organisations communistes, de contribuer activement à cette prise de conscience de la classe, et en particulier de dénoncer de façon claire et déterminée les pièges tendus par la bourgeoisie.
C'est ainsi que, en juillet 1917, la bourgeoisie russe, a tenté de provoquer une insurrection prématurée du prolétariat de la capitale. La fraction la plus avancée de la classe ouvrière, le parti bolchevik, a identifié le piège et il est clair que, sans son attitude clairvoyante visant à empêcher les ouvriers de Petrograd de se lancer dans l'aventure, ces derniers auraient subi une défaite sanglante ce qui aurait coupé l'élan qui les a conduits à l'insurrection victorieuse d'Octobre. En janvier 1919 (voir nos articles sur la révolution allemande dans la Revue), la bourgeoise allemande a réédité la même manoeuvre. Cette fois-ci, elle a réussi son coup : le prolétariat de Berlin, isolé, a été écrasé par les corps francs, ce qui a porté un coup décisif à la révolution en Allemagne et au niveau mondial. La grande révolutionnaire Rosa Luxemburg a été capable, avec la majorité de la direction du parti communiste nouvellement fondé, de comprendre la nature du piège tendu par la bourgeoisie. En revanche, son camarade Karl Liebknecht, pourtant aguerri par des années de militantisme révolutionnaire, notamment au cours de la guerre impérialiste, s'y est laissé prendre. Ce faisant, il a participé, grâce à son prestige, et malgré lui, à une défaite tragique de la classe ouvrière, qui lui a d'ailleurs coûté la vie comme à beaucoup de ses compagnons, y compris Rosa Luxemburg elle-même. Mais même si cette dernière a tout fait pour mettre en garde le prolétariat et ses propres camarades contre le piège bourgeois, elle n'a jamais pensé que ceux qui s'y étaient laissé prendre étaient des « idiots ». Au contraire, son dernier article, écrit à la veille de sa mort, « L'ordre règne à Berlin » insiste sur une idée essentielle : le prolétariat doit apprendre de ses défaites. De même, en affirmant que les ouvriers de France ou de Belgique ont été victimes d'un piège tendu par la bourgeoisie, à la fin de l'année 1995, le CCI n'a jamais laissé entendre, ou pensé, que les ouvriers seraient des « idiots ». En réalité, c'est tout le contraire qui est vrai.
En effet, si la bourgeoisie s'est donnée la peine d'élaborer un piège particulièrement sophistiqué contre la classe ouvrière, un piège auquel ont contribué toutes les forces du capital, le gouvernement, les patrons, les syndicats et même les groupes gauchistes, c'est justement parce qu'elle ne sous-estime pas la classe ouvrière. Elle sait parfaitement que le prolétariat d'aujourd'hui n'est pas celui des années 1930, que contrairement à ce dernier, la crise économique, loin de l'enfoncer encore dans la démoralisation, ne peut que le conduire à des combats de plus en plus puissants et conscients. En fait, pour comprendre la nature et la portée de la manoeuvre bourgeoise de la fin 1995 contre la classe ouvrière, il est nécessaire, au préalable, d'avoir reconnu que nous ne sommes pas à l'heure actuelle dans un cours historique dominé par la contre-révolution, dans lequel la crise mortelle du capitalisme ne peut aboutir qu'à la guerre impérialiste mondiale, mais dans un cours aux affrontements de classe. Une des meilleures preuves de cette réalité se trouve dans la nature des thèmes et des méthodes mis en avant par les syndicats dans cette récente manoeuvre. Au cours des années 1930, les campagnes idéologiques de la gauche et des syndicats dominées par l'antifascisme, la « défense de la démocratie » et le nationalisme, c'est-à-dire des thèmes parfaitement bourgeois, ont réussi à dévoyer la combativité du prolétariat dans des impasses tragiques et à l'embrigader, ouvrant la porte à la boucherie impérialiste (le meilleur exemple en est donné par les grèves de juin 1936 en France et par la guerre civile en Espagne). Si, à la fin 1995, les syndicats ont été très discrets sur ce genre de thèmes, s'ils ont adopté au contraire un langage « ouvrier », proposant eux-mêmes des revendications et des « méthodes de lutte » classiques de la classe ouvrière, c'est qu'ils savaient parfaitement qu'ils ne pouvaient pas réussir une mobilisation massive derrière eux, redorer leur blason aux yeux des travailleurs, en se contentant de mettre en avant leurs discours habituels sur « l'intérêt national » et autres mystifications bourgeoises. Là où le drapeau national ou la défense de la démocratie pouvaient être efficaces dans l'entre-deux guerres pour mystifier les ouvriers, il faut maintenant des appels à « l'extension », à « l'unité de tous les secteurs de la classe ouvrière », à la tenue d'assemblées générales souveraines. Mais il faut bien constater que si les récents discours syndicaux ont réussi à tromper la grande majorité de la classe ouvrière, ils ont réussi également à tromper des organisations qui se revendiquent de la Gauche communiste. Le meilleur exemple nous en est probablement donné par les articles publiés dans n° 435 du journal Le Prolétaire, organe du Parti communiste international (PCI) qui publie en Italien Il Comunista, c'est-à-dire un des nombreux PCI de la mouvance bordiguiste.
Les divagations du Prolétaire
Ce numéro du Prolétaire consacre plus de 4 pages sur 10 aux grèves de la fin 1995 en France. On y donne beaucoup de détails sur les événements, et même des détails faux qui prouvent, soit que l'auteur était encore mal informé, soit, ce qui est plus probable, qu'il a pris ses désirs pour la réalité [1] [2524]. Mais le plus frappant dans ce numéro du Prolétaire c'est l'article de deux pages intitulé « Le CCI contre les grèves ». Ce titre, déjà, en dit long sur la tonalité de l'ensemble de l'article. En effet, nous y apprenons, par exemple, que :
- le CCI serait l'émule de Thorez, le dirigeant stalinien français, qui déclarait au lendemain de la seconde guerre que « la grève est l'arme des trusts » ;
- qu'il s'exprime comme « n'importe quel jaune » ;
- que nous sommes des « proudhoniens modernes » et des « déserteurs (souligné par Le Prolétaire) de la lutte prolétarienne ».
Evidemment, le milieu parasitaire pour qui tout est bon pour dénigrer le CCI s'est immédiatement réjoui de cet article. En ce sens, Le Prolétaire apporte aujourd'hui sa petite contribution (volontaire ? involontaire ?) aux attaques actuelles de ce milieu contre notre organisation. Evidemment, et nous l'avons toujours démontré dans notre presse, nous ne sommes pas contre les polémiques entre les organisations du milieu révolutionnaire. Mais la polémique, aussi véhémente soit-elle, veut dire que nous nous situons dans le même camp de la guerre de classe. Par exemple, nous ne polémiquons pas avec les organisations gauchistes ; nous les dénonçons comme des organes de la classe capitaliste, ce que le Prolétaire est incapable de faire puisqu'il définit un groupe comme Lutte Ouvrière, fleuron du trotskisme en France, comme « centriste ». Ses pointes les plus acérées, Le Prolétaire les réserve aux organisations de la Gauche Communiste comme le CCI : si nous sommes des « déserteurs », c'est que nous avons trahi notre classe ; merci de nous l'apprendre. Merci également de la part des groupes parasites dont le leitmotiv est que le CCI serait passé au stalinisme et autres turpitudes. Il faudra quand même qu'un jour, le PCI sache dans quel camp il se trouve : dans celui des organisations sérieuses de la Gauche communiste, ou bien dans celui des parasites qui n'ont de raison d'être que de les discréditer au seul avantage de la classe bourgeoise.
Cela dit, si Le Prolétaire se propose de nous faire la leçon concernant nos analyses des grèves de la fin 1995, ce que démontre avant tout son article c'est :
- son manque de clarté, pour ne pas dire son opportunisme, sur la question, essentielle pour la classe ouvrière, de la nature du syndicalisme ;
- son ignorance crasse de l'histoire du mouvement ouvrier conduisant à une incroyable sous-estimation de la classe ennemie.
La question syndicale, talon d'Achille du PCI et du bordiguisme
Pour bien charger la barque, Le Prolétaire parle de « l'anti-syndicalisme de principe » du CCI. Ce faisant, il démontre que, pour le PCI, la question syndicale n'est pas une question « de principe ». Le Prolétaire veut se montrer très radical en affirmant :
« Les appareils syndicaux sont devenus, à l'issue d'un processus dégénératif accéléré par la victoire internationale de la contre-révolution, des instruments de la collaboration de classe » ; et encore plus : « si les grandes organisations syndicales se refusent obstinément à utiliser ces armes [les moyens de lutte authentiquement prolétarien], ce n'est pas simplement à cause d'une mauvaise direction qu'il suffirait de remplacer : des décennies de dégénérescence et de domestication par la bourgeoisie ont vidé ces grands appareils syndicaux des derniers restes classistes et les ont transformé en organes de la collaboration des classes, marchandant les revendications prolétariennes contre le maintien de la paix sociale... Ce fait suffit à montrer la fausseté de la perspective trotskiste traditionnelle de conquérir ou de reconquérir à la lutte prolétarienne ces appareils d'agents professionnels de la conciliation des intérêts ouvriers avec les exigences du capitalisme. Par contre mille exemples sont là pour démontrer qu'il est tout à fait possible de transformer un trotskiste en bonze... »
En réalité, ce que le PCI met en évidence c'est son manque de clarté et de fermeté sur la nature du syndicalisme. Ce n'est pas ce dernier qu'il dénonce comme arme de la classe bourgeoise, mais tout simplement les « appareils syndicaux ». Ce faisant, il ne réussit pas, malgré ses dires, à se dégager de la vision trotskiste : on peut maintenant trouver dans la presse d'un groupe comme Lutte Ouvrière le même type d'affirmations. Ce que Le Prolétaire, se croyant fidèle à la tradition de la Gauche communiste italienne, refuse d'admettre c'est que toute forme syndicale, qu'elle soit petite ou grande, légale et bien introduite dans les hautes sphères de l'Etat capitaliste ou bien illégale (c'était le cas de Solinarnosc pendant plusieurs années en Pologne, des Commissions Ouvrières en Espagne sous le régime franquiste) ne peut être autre chose qu'un organe de défense du capitalisme. Le Prolétaire accuse le CCI d'être hostile « à toute organisation de défense immédiate du prolétariat ». Ce faisant, il révèle soit son ignorance de notre position, soit, plus probablement, sa mauvaise foi. Nous n'avons jamais dit que la classe ouvrière ne devait pas s'organiser pour mener ses luttes. Ce que nous affirmons, à la suite du courant de la Gauche communiste que le bordiguisme couvre de son mépris, la Gauche allemande, c'est que, dans la période historique actuelle, cette organisation est constituée par les assemblées générales des ouvriers en lutte, des comités de grève désignés par ces assemblées et révocables par elles, des comités centraux de grève composés de délégués des différents comités de grève. Par nature, ces organisations existent par et pour la lutte et sont destinées à disparaître une fois que la lutte est achevée. Leur principale différence avec les syndicats c'est justement qu'elles ne sont pas permanentes et qu'elles n'ont pas l'occasion, de ce fait, d'être absorbées par l'Etat capitaliste. C'est justement la leçon que le bordiguisme n'a jamais voulu tirer après des décennies de « trahison » de tous les syndicats, quelle que soit leur forme, leurs objectifs initiaux, les positions politiques de leurs fondateurs, qu'ils se disent « réformistes » ou bien « de lutte de classe », voire « révolutionnaires ». Dans le capitalisme décadent, où l'Etat tend à absorber toutes les structures de la société, où le système est incapable d'accorder la moindre amélioration durable des conditions de vie de la classe ouvrière, toute organisation permanente qui se propose comme objectif la défense de celles-ci est destinée à s'intégrer dans l'Etat, à devenir un de ses rouages. Citer, comme le fait Le Prolétaire en espérant nous clouer le bec, ce que disait Marx des syndicats au siècle dernier est loin de suffire pour s'auto-accorder un brevet de « marxisme ». Après tout, les trotskistes ne manquent pas de ressortir d'autres citations de Marx et d'Engels contre les anarchistes de leur époque pour attaquer la position que les bordiguistes partagent aujourd'hui avec l'ensemble de la Gauche communiste : le refus de participer au jeu électoral. Cette façon de faire du Prolétaire ne démontre qu'une chose, c'est qu'il n'a pas compris un aspect essentiel du marxisme dont il se revendique : celui-ci est une pensée vivante et dialectique. Ce qui était vrai hier, dans la phase ascendante du capitalisme : la nécessité pour la classe ouvrière de former des syndicats, comme de participer aux élections ou bien de soutenir certaines luttes de libération nationale, ne l'est plus aujourd'hui, dans le capitalisme décadent. Prendre à la lettre des citations de Marx en tournant le dos aux conditions auxquelles elles s'adressent, en refusant d'appliquer la méthode de ce grand révolutionnaire, ne démontre que l'indigence de sa propre pensée.
Mais le pire n'est pas cette indigence en elle-même, c'est qu'elle conduit à semer dans la classe des illusions sur la possibilité d'un « véritable syndicalisme », c'est qu'elle conduit tout droit à l'opportunisme. Et cet opportunisme, nous en trouvons des expressions dans les articles du Prolétaire lorsqu'il affiche la plus grande timidité pour dénoncer le jeu des syndicats :
« Ce que l'on peut et que l'on doit reprocher aux syndicats actuels... » Les révolutionnaires ne reprochent rien aux syndicats, comme ils ne reprochent pas aux bourgeois d'exploiter les ouvriers, aux flics de réprimer leurs luttes : ils les dénoncent.
« ... les organisations à la tête du mouvement, la CGT et FO, qui selon toute vraisemblance avaient négocié dans la coulisse avec le gouvernement pour en finir... » Les dirigeants syndicaux ne « négocient » pas avec le gouvernement comme s'ils avaient des intérêts différents, ils marchent la main dans la main avec lui contre la classe ouvrière. Et ce n'est pas « selon toute vraisemblance » : c'est sûr ! Voila ce qu'il est indispensable que sachent les ouvriers et que Le Prolétaire est incapable de leur dire.
Le danger de la position opportuniste du Prolétaire sur la question syndicale éclate enfin lorsqu'il écrit : « Mais si nous écartons la reconquête des appareils syndicaux, nous n'en tirons pas la conclusion qu'il faut rejeter le travail dans ces mêmes syndicats, pourvu que ce travail se fasse à la base, au contact des travailleurs du rang et non dans les instances hiérarchiques, et sur des bases classistes ». En d'autres termes, lorsque de façon absolument saine et nécessaire des ouvriers écoeurés par les magouilles syndicales auront envie de déchirer leur carte, il se trouvera un militant du PCI pour accompagner le discours du trotskiste de service : « Ne faites pas cela, camarades, il faut rester dans les syndicats pour y faire un travail ». Quel travail, sinon que celui de redorer un peu, à la base, le blason de ces organismes ennemis de la classe ouvrière ?
Car il n'y a pas d'autre choix :
- ou bien on veut réellement mener une activité militante « sur des bases classistes », et alors un des points essentiels qu'il faut défendre est la nature anti-ouvrière des syndicats, pas seulement de leur hiérarchie, mais comme un tout ; quelle clarté le militant du PCI va-t-il apporter à ses camarades de travail en leur disant : « les syndicats sont nos ennemis, il faut lutter en dehors et contre eux mais je reste dedans » ? [2] [2525]
- ou bien on veut rester « en contact » avec la « base » syndicale, « se faire comprendre » par les travailleurs qui la composent, et alors on oppose « base » et « hiérarchie pourrie », c'est-à-dire la position classique du trotskisme ; certes on fait alors « un travail », mais pas « sur des bases classistes » puisqu'on maintient encore l'illusion que certaines structures du syndicat, la section d'entreprise par exemple, peuvent être des organes de la lutte ouvrière.
Nous voulons bien croire que le militant du PCI, contrairement à son collègue trotskiste, n'aspire pas à devenir un bonze. Il n'en aura pas moins fait le même « travail » anti-ouvrier de mystification sur la nature des syndicats.
Ainsi, l'application de la position du PCI sur la question syndicale a apporté, une nouvelle fois, sa petite contribution à la démobilisation des ouvriers face au danger que représentent les syndicats. Mais cette action de démobilisation face à l'ennemi ne s'arrête pas là. Elle éclate une nouvelle fois au grand jour quand le PCI se livre à une sous-estimation en règle de la capacité de la bourgeoisie à élaborer des manoeuvres contre la classe ouvrière.
La sous-estimation de l'ennemi de classe
Dans un autre article du Prolétaire,« Après les grèves de cet hiver, Préparons les luttes à venir » on peut lire ce qui suit :
« Le mouvement de cet hiver montre justement que si, dans ces circonstances, les syndicats ont fait preuve d'une souplesse inhabituelle et ont laissé s'exprimer la spontanéité des grévistes les plus combatifs plutôt que de s'y opposer comme à leur habitude, cette tolérance leur a permis de conserver sans grandes difficultés la direction de la lutte, et donc de décider dans une très grande mesure de son orientation, de son déroulement et de son issue. Lorsqu'ils ont jugé que le moment était venu, ils ont pu donner le signal de la reprise, abandonnant en un clin d'oeil la revendication centrale du mouvement, sans que les grévistes ne puissent opposer aucune alternative. L'apparence démocratique et basiste de la conduite de la lutte a même été utilisée contre les besoins objectifs du mouvement : ce ne sont pas les milliers d'AG quotidiennes des grévistes qui à elles seules pouvaient donner à la lutte la centralisation et la direction dont elle avait besoin, même si elles ont permis la compacité et la participation massive des travailleurs. Seules les organisations syndicales pouvaient pallier à cette carence et la lutte était donc suspendue aux mots d'ordre et aux initiatives lancées centralement par les organisations syndicales et répercutées par leur appareil dans toutes les AG. Le climat d'unité régnant dans le mouvement était tel que la masse des travailleurs non seulement n'a pas senti ni exprimé de désaccords avec l'orientation des syndicats (mis à part bien sûr les orientations de la CFDT) et leur direction de la lutte, mais a même considéré leur action comme l'un des facteurs les plus importants pour la victoire. »
Ici Le Prolétaire nous livre le secret de l'attitude des syndicats dans les grèves de la fin 1995. Peut être est-ce le résultat de sa lecture de ce que le CCI avait déjà écrit auparavant. Le problème, c'est que lorsqu'il faut tirer les enseignements de cette réalité évidente, Le Prolétaire, dans le même article, nous dit que ce mouvement est « le plus important du prolétariat français depuis la grève générale de mai-juin 68 », qu'il salue sa « force » qui a imposé « un recul partiel du gouvernement ». Décidément, la cohérence de la pensée n'est pas le fort du Prolétaire. Faut-il rappeler que l'opportunisme aussi la fuit comme la peste, lui qui essaye en permanence de concilier l'inconciliable ?
Pour notre part, nous avons conclu que ce mouvement qui n'a pu empêcher le gouvernement de faire passer ses principales mesures anti-ouvrières et qui a aussi bien réussi à redorer le blason des syndicats, comme le montre très clairement Le Prolétaire, ne s'est pas fait contre la volonté des syndicats ou du gouvernement, mais qu'il a été voulu par eux justement pour atteindre ces objectifs. Le Prolétaire nous dit que le trait de ce mouvement qui « doit devenir un acquis pour les luttes futures, a été la tendance générale à s'affranchir des barrières corporatistes et des limites d'entreprises ou d'administrations et à s'étendre à tous les secteurs ». C'est tout à fait vrai. Mais le seul fait que se soit avec la bénédiction, ou plutôt, bien souvent, sous l'impulsion directe des syndicats, que les ouvriers aient reconquis des méthodes vraiment prolétariennes de lutte, ne constitue nullement une avancée pour la classe ouvrière à partir du moment où cette conquête est associée pour la majorité des ouvriers à l'action des syndicats. Ces méthodes de lutte, la classe ouvrière était, tôt ou tard destinée à les redécouvrir, au long de toute une série d'expériences. Mais si cette découverte s'était faite à travers la confrontation ouverte contre les syndicats, cela aurait porté un coup mortel à ces derniers alors qu'ils étaient déjà fortement discrédités et cela aurait privé la bourgeoisie d'une de ses armes essentielles pour saboter les luttes ouvrières. Aussi, il était préférable, pour la bourgeoisie, que cette redécouverte, quitte à ce qu'elle intervienne plus vite, soit empoisonnée et stérilisée par les illusions syndicalistes.
Le fait que la bourgeoisie ait pu manoeuvrer d'une telle façon dépasse l'entendement du Prolétaire :
« A en croire le CCI "on" (sans doute TOUTE LA BOURGEOISIE) est extraordinairement rusé : pousser "les ouvriers" (c'est ainsi que le CCI baptise tous les salariés qui ont fait grève) à entrer en lutte contre les décisions gouvernementales afin de contrôler leur lutte, de leur infliger une défaite et de faire passer plus tard des mesures encore plus dures, voilà une manoeuvre qui aurait sans doute stupéfié Machiavel lui-même.
Les proudhoniens modernes du CCI vont plus loin que leur ancêtre puisqu'ils accusent les bourgeois de provoquer la lutte ouvrière et de lui faire remporter la victoire pour détourner les ouvriers des vrais solutions : ils se frapperaient eux-mêmes pour éviter d'être frappés. Attendons encore un peu et nous verrons dans la lanterne magique du CCI les bourgeois organiser eux-mêmes la révolution prolétarienne et la disparition du capitalisme dans le seul but d'empêcher les prolétaires de la faire. » [3] [2526]
Le Prolétaire se donne sûrement l'illusion d'être très spirituel. Grand bien lui fasse ! Le problème c'est que ses tirades dénotent avant tout la totale vacuité de son entendement politique. Alors, pour sa gouverne, et pour qu'il ne meure pas complètement idiot, nous nous permettons de rappeler quelques banalités :
- Il n'est pas nécessaire que toute la bourgeoisie soit « extraordinairement rusée » pour que ses intérêts soient bien défendus. Pour exercer cette défense, la classe bourgeoise dispose d'un gouvernement et d'un Etat (mais peut être que Le Prolétaire ne le sait pas) qui définit sa politique en s'appuyant sur les avis d'une armée de spécialistes (historiens, sociologues, politologues, ... et dirigeants syndicaux). Qu'il existe encore aujourd'hui des patrons qui pensent que les syndicats sont les ennemis de la bourgeoisie, cela ne change rien à la chose : ce ne sont pas eux qui sont chargés d'élaborer la stratégie de leur classe comme ce ne sont pas les adjudants qui conduisent les guerres.
- Justement, entre la bourgeoisie et la classe ouvrière il existe une guerre, une guerre de classe. Sans qu'il soit nécessaire d'être un spécialiste des questions militaires, n'importe quel être doté d'une intelligence moyenne et d'un peu d'instruction (mais est-ce le cas des rédacteurs du Prolétaire ?) sait que la ruse est une arme essentielle des armées. Pour battre l'ennemi, il est en général nécessaire de le tromper (sauf à disposer d'une supériorité matérielle écrasante).
- L'arme principale de la bourgeoisie contre le prolétariat, ce n'est pas la puissance matérielle de ses forces de répression, c'est justement la ruse, les mystifications qu'elle est capable d'entretenir dans les rangs ouvriers.
- Même si Machiavel a, en son temps, jeté les bases de la stratégie bourgeoise pour la conquête et l'exercice du pouvoir aussi bien que dans l'art de la guerre, les dirigeants de la classe dominante, après des siècles d'expérience, en savent maintenant beaucoup plus que lui. Peut-être les rédacteurs du Prolétaire pensent ils que c'est le contraire. En tout cas, ils feraient bien de se plonger un tout petit peu dans les livres d'histoire, particulièrement celle des guerres récentes et surtout celle du mouvement ouvrier. Ils y découvriraient que le machiavélisme que les stratèges militaires sont capables de mettre en oeuvre dans les conflits entre fractions nationales de la même classe bourgeoise n'est encore rien à côté de celui que celle-ci, comme un tout, est capable de déployer contre son ennemi mortel, le prolétariat.
- En particulier, ils découvriraient deux choses élémentaires : que provoquer des combats prématurés est une des armes classiques de la bourgeoisie contre le prolétariat et que dans une guerre, les généraux n'ont jamais hésité à sacrifier une partie de leurs troupes ou de leurs positions pour mieux piéger l'ennemi, en lui donnant, éventuellement, un sentiment illusoire de victoire. La bourgeoisie ne fera pas la révolution prolétarienne à la place du prolétariat pour l'empêcher de la faire. En revanche, pour l'éviter, elle est prête à des prétendus « reculs », à des apparentes « victoires » des ouvriers.
- Et si les rédacteurs du Prolétaire se donnaient la peine de lire les analyses classiques de la Gauche communiste, ils apprendraient enfin qu'un des principaux moyens avec lesquels la bourgeoisie a infligé au prolétariat la plus terrible contre-révolution de son histoire a été justement de lui présenter comme des « victoires » ses plus grandes défaites : la « construction du socialisme en URSS », les « Front populaires », la « victoire contre le fascisme ».
Alors on ne peut dire qu'une chose aux rédacteurs du Prolétaire : il faut recommencer votre copie. Et avant, il faut essayer de réfléchir un peu et de surmonter votre ignorance affligeante. Les phrases bien tournées et les mots d'esprit ne suffisent pas pour défendre correctement les positions et les intérêts de la classe ouvrière. Et nous pouvons leur donner un dernier conseil : soyez à l'écoute de ce qui se passe réellement dans le monde et essayez de comprendre, par exemple, ce qui vient de se passer en Allemagne.
Les manoeuvres syndicales en Allemagne, nouvel exemple de la stratégie de la bourgeoisie
S'il faut une nouvelle preuve que la manoeuvre concoctée par toutes les forces de la bourgeoisie à la fin de 1995 en France avait une portée internationale, la récente agitation syndicale en Allemagne l'apporte de façon éclatante. Dans ce pays, en effet, on vient de vivre, avec les spécificités locales évidemment, un « remake » du scénario « à la française ».
Au départ, pourtant, la situation semble fort différente. Juste après que les syndicats français se soient donnés une image de radicalisme, « d'organes intransigeants du combat de classe », ceux d'Allemagne, fidèles à leur tradition de négociateurs et d'agents du « consensus social », signent avec le patronat et le gouvernement, le 23 janvier, un « pacte pour l'emploi » qui comporte, entre autres, des baisses de salaires pouvant aller jusqu'à 20% dans les industries les plus menacées. Au sortir de cette négociation, Kohl déclare qu'il faut « tout faire pour éviter un scénario à la française ». Il n'est alors pas contredit par les syndicats qui, quelques semaines auparavant, avaient pourtant salué les grèves en France : la DGB « assure de sa sympathie les grévistes qui se défendent contre une grande attaque au droit social » ; IG-Metall affirme que « la lutte des Français est un exemple de résistance contre les coups portés aux droits sociaux et politiques ».
Mais, en réalité, le salut des syndicats allemands aux grèves en France n'était pas platonique, il s'inscrivait déjà dans la perspective de leurs manoeuvres futures. Ces manoeuvres, on allait en découvrir l'ampleur au mois d'avril. C'est le moment que choisit Kohl pour annoncer un plan d'austérité sans précédent : gel des salaires dans la fonction publique, baisse des indemnités de chômage et des prestations de sécurité sociale, allongement du temps de travail, recul de l'âge de la retraite, abandon du principe de l'indemnisation à 100% des absences pour maladie. Et ce qui est le plus frappant, c'est la façon dont ce plan est annoncé. Comme l'écrit le journal français Le Monde (20 juin 1996) : « En imposant autoritairement son plan d'économies de 50 milliards de marks à la fin du mois d'avril, le chancelier Kohl a quitté les habits du modérateur – qu'il affectionne tant – pour prendre ceux du décideur... Pour la première fois, la "méthode Kohl" commence à ressembler à la "méthode Juppé". »
Pour les syndicats, c'est une véritable provocation à laquelle il faut répondre avec de nouvelles méthodes d'action : « Nous avons quitté le consensus pour entrer dans la confrontation » (Dieter Schulte, président du DGB). Le scénario « à la française », dans sa variante allemande, se met en place. On assiste alors à un crescendo de radicalisme dans l'attitude des syndicats : « grèves d'avertissement » et manifestations dans le secteur public (comme au début de l'automne 1995 en France) : les crèches, les transports en commun, les postes, les services de nettoiement sont touchés. Comme en France, les médias font grand tapage autour de ces mouvements, donnant l'image d'un pays paralysé, et ne ménagent pas leur sympathie à leur égard. La référence aux grèves de la fin 1995 sont de plus en plus présentes et les syndicats font même agiter des drapeaux français dans les manifestations. Schulte, invoquant « l'automne chaud » français, promet, dans le secteur industriel, un « été chaud ». C'est alors que commence la préparation de la grande manifestation du 15 juin qui est annoncée à l'avance comme devant être « la plus massive depuis 1945 ».[4] [2527] Schulte prévient qu'elle ne sera « que le début d'âpres conflits sociaux qui pourrait conduire à des conditions à la française ». De même, alors qu'il avait affirmé quelques semaines auparavant qu'il « ne saurait être question d'appeler à une grève générale face à un gouvernement démocratiquement élu », il déclare le 10 juin que « même la grève générale n'est plus exclue ». Quelques jours avant la « marche » sur Bonn, les négociations du secteur public accouchent d'un accord qui concède finalement de maigres augmentations de salaire et la promesse de ne pas remettre en cause les indemnités de maladie, ce qui permet aux syndicats de faire apparaître ce « recul » comme résultant de l'efficacité de leurs actions, tout comme ce fut le cas en France quand le gouvernement avait « reculé » sur le Contrat de plan dans les chemins de fer et sur la retraite des fonctionnaires.
Finalement, l'immense succès du « tous à Bonn » (350 000 manifestants) obtenu grâce à un battage médiatique sans précédent et aux énormes moyens mis en oeuvre pas les syndicats (des milliers de cars et près de 100 trains spéciaux) apparaît comme une manifestation de force sans précédent de ces derniers en même temps qu'elle a permis de faire passer au second plan le fait que le gouvernement n'avait pas cédé sur l'essentiel de son plan d'austérité.
Le caractère mondial des manoeuvres de la bourgeoisie
Ainsi, à quelques mois d'intervalle, dans les deux principaux pays d'Europe continentale, la bourgeoisie a développé deux manoeuvres très semblables destinées non seulement à faire passer un train d'attaques brutales mais aussi à donner une nouvelle image des syndicats. Certes il y a des différences dans l'objectif visé par chacune des deux bourgeoisies nationales. Pour ce qui concerne la France, il fallait redorer aux yeux des ouvriers le blason des syndicats, un blason notablement terni par leur soutien aux politiques menées par la Gauche quand elle était au gouvernement, ce qui les avait contraints de laisser le devant de la scène aux coordinations dans la tâche de sabotage des luttes lors de la grève des chemins de fer en 1986 et des hôpitaux en 1988. Pour ce qui concerne l'Allemagne, il n'y avait pas un problème de discrédit des syndicats. Dans l'ensemble, ces organes de l'Etat bourgeois jouissaient d'une forte assise en milieu ouvrier. En revanche, l'image qu'ils avaient auprès de la classe ouvrière était celle de spécialistes avisés de la négociation, réussissant, à travers toutes les « tables rondes » auxquelles ils participaient, à préserver quelque peu les acquis de « l'Etat social », ce qui était évidemment facilité par la plus grande résistance du capital allemand à la crise mondiale. Mais avec la montée des difficultés économiques de ce dernier (récession en 1995, niveau de chômage record, explosion des déficits de l'Etat) cette image ne pouvait perdurer bien longtemps. A la table de négociation, le gouvernement et le patronat ne pourront proposer que des attaques de plus en plus brutales du niveau de vie de la classe ouvrière et le démantèlement de « l'Etat social ». La perspective d'explosions de la colère ouvrière est inéluctable et il importait donc que les syndicats, pour être en mesure de saboter et dévoyer la combativité, troquent leurs habits de « négociateurs » pour ceux d'organes de la lutte ouvrière.
Mais au-delà des différences dans la situation sociale des deux pays, il importe que tous les points communs existant entre ces deux épisodes ouvrent les yeux de ceux qui pensent encore que les grèves de la fin 1995 en France étaient « spontanées », qu'elles ont « surpris la bourgeoisie », qu'elles n'ont pas été voulues et provoquées par celle-ci afin de mener à bien sa politique.
En outre, de même que la manoeuvre bourgeoise de la fin 1995 en France avait une portée internationale, ce n'est pas uniquement à usage interne que les différentes forces de la bourgeoisie allemande ont déployé leur manoeuvre du printemps 1996. Par exemple, en Belgique, si la bourgeoisie avait organisé au cours de l'hiver une copie conforme du scénario français, elle a fait preuve de son mimétisme en reprenant à son compte le « scénario allemand ». En effet, peu après la signature du « pacte pour l'emploi » en Allemagne, un « contrat d'avenir pour l'emploi » était signé en Belgique entre les syndicats, le patronat et le gouvernement qui prévoyait, là aussi, des baisses de salaire contre des promesses d'emplois. Puis les syndicats se sont offerts un virage à 180° en dénonçant brusquement cet accord « après consultation de leur base ». Ce revirement spectaculaire et, comme toujours, fortement médiatisé, leur a permis de s'offrir une image « démocratique », de « véritables interprètes de la volonté des ouvriers », tout en se blanchissant de toute responsabilité dans les plans d'attaque contre la classe ouvrière préparés par le gouvernement (dans lequel participe le Parti socialiste, allié traditionnel du syndicat le plus « combatif », la FGTB).
Mais si la dimension internationale des manoeuvres de la bourgeoisie française de la fin 1995 ne s'est pas arrêtée à la Belgique, comme on vient de le voir avec les manoeuvres de la bourgeoisie allemande du printemps, la portée de ces dernières ne se limite pas non plus à ce petit pays. En réalité, l'agitation syndicale en Allemagne, amplement répercutée par les télévisions dans de nombreux pays a un rôle similaire aux grèves en France. Encore une fois, il s'agit de renforcer les illusions sur les syndicats. L'image de marque « combative » des syndicats français, grâce à leur couverture médiatique mondiale, a pu rejaillir sur leurs congénères des autres pays. De même, la radicalisation des syndicats allemands, leurs menaces appuyées d'un « été chaud » et les commentaires alarmistes des médias des autres pays sur « la fin du consensus à l'allemande » viennent à leur tour relayer l'idée que les syndicats sont capables, même là où ils ont une tradition de concertation et de négociation, d'être d'authentiques « organes de lutte » pour la classe ouvrière et même des organes de lutte efficaces, capables d'imposer, contre l'austérité gouvernementale et patronale, la défense des intérêts ouvriers.
oOo
Ainsi, c'est bien à l'échelle mondiale que la bourgeoisie met en oeuvre sa stratégie face à la classe ouvrière. L'histoire nous a appris que toutes les oppositions d'intérêt entre les bourgeoisies nationales, les rivalités commerciales, les antagonismes impérialistes pouvant conduire à la guerre, s'effacent lorsqu'il s'agit d'affronter la seule force de la société qui représente un danger mortel pour la classe dominante, le prolétariat. C'est de façon coordonnée, concertée que les bourgeoisies élaborent leurs plans contre celui-ci.
Aujourd'hui, face aux combats ouvriers qui se préparent, la classe dominante devra déployer mille pièges pour tenter de les saboter, les épuiser et les défaire, pour faire en sorte qu'ils ne permettent pas une prise de conscience par le prolétariat des perspectives ultimes de ces combats, la révolution communiste. Rien ne serait plus tragique pour la classe ouvrière que de sous-estimer la force de son ennemi, sa capacité à mettre en oeuvre de tels pièges, à s'organiser à l'échelle mondiale pour les rendre plus efficaces. Il appartient aux communistes de savoir les débusquer et de les dénoncer aux yeux de leur classe. S'ils ne savent pas le faire, ils ne méritent pas ce nom.
FM, 24 juin 1996.
[1] [2528]. Un des exemples frappants de cette réécriture des faits est la
façon dont est rapportée la reprise du travail à la fin de la grève :
celle-ci n'aurait commencé que près d'une semaine après l'annonce du
« recul » du gouvernement, ce qui est faux.
[2] [2529]. C'est vrai que les bordiguistes ne sont pas à une contradiction près : vers la fin des années 1970, alors que s'était développée en France une agitation parmi les ouvriers immigrés, il était courant de voir des militants du PCI expliquer aux immigrés éberlués qu'ils devaient revendiquer le droit de vote afin de pouvoir... s'abstenir. Plus ridicule qu'un bordiguiste, tu meurs ! C'est vrai aussi que lorsque des militants du CCI ont essayé d'intervenir dans un rassemblement d'immigrés pour y défendre la nécessité de ne pas se laisser enfermer dans des revendications bourgeoisies, ceux du PCI ont prêté main forte aux maoïstes pour les en chasser...
[3] [2530]. Il faut noter que le n° 3 de L'esclave salarié (ES), bâtard parasitaire de l'ex-Ferment Ouvrier
Révolutionnaire, nous donne une interprétation originale de l'analyse du CCI
sur la manoeuvre de la bourgeoisie :
« Nous tenons à féliciter le cci [ES trouve très spirituel d'écrire en
minuscules les initiales de notre organisation] pour sa remarquable analyse qui nous laisse béats d'admiration et nous
nous demandons comment cette élite pensante fait pour infiltrer la classe
bourgeoise et en retirer de telles informations sur ses plans et ses pièges.
C'est à se demander si le cci n'est pas invité aux rendez-vous de la
bourgeoisie et à l'étude de ses menées anti-ouvrières concoctées dans le secret
et les rites de la franc-maçonnerie. » Marx n'était pas franc-maçon et
il n'était pas invité aux rendez-vous de la bourgeoisie mais il a consacré une
grande partie de son activité militante à étudier, élucider et dénoncer les
plans et les pièges de la bourgeoisie. Il faut croire que les rédacteurs de
l'ES n'ont jamais lu Les luttes de classe
en France ou La guerre civile en
France. Ce serait logique de la part de gens qui méprisent la pensée,
laquelle n'est pas le monopole d'une « élite ». Franchement, il
n'était pas nécessaire d'être franc-maçon pour découvrir que les grèves de la
fin 1995 en France résultaient d'une manoeuvre bourgeoise : il suffisait
d'observer de quelle façon elles étaient présentées et encensées par les médias
dans tous les pays d'Europe et d'Amérique, et jusqu'en Inde, en Australie et au
Japon. C'est vrai que la présence dans ces pays de sections ou de sympathisants
du CCI lui a facilité son travail, mais la véritable cause de l'indigence
politique de ES ne réside pas dans sa faible extension géographique. Ce qui est
provincial, chez lui, c'est avant tout son intelligence politique,
provinciale... et « minuscule ».
Géographique:
- Europe [95]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [143]
Questions théoriques:
- Décadence [32]
- Le cours historique [17]
12e Congrès de RI : la défense de l'organisation
- 2723 reads
Courant avril 1996 s'est tenu le 12e congrès de la section en France du Courant Communiste International. Ce congrès était celui d'une section territoriale de notre organisation internationale, mais le CCI a décidé de lui donner une valeur dépassant le simple cadre territorial pour en faire une sorte de congrès international extraordinaire.
Le congrès s'est tenu quelques mois après que nous ayons assisté en France à des événements de première grandeur concernant la lutte entre prolétariat et bourgeoisie : les grèves du secteur public de la fin de l'année 1995, lesquelles résultaient d'une manoeuvre de la bourgeoisie à l'échelle internationale dirigée contre le prolétariat de l'ensemble des pays industrialisés [1] [2532]. Mais ces événements ne constituaient qu'un aspect d'une offensive générale que mène aujourd'hui la bourgeoisie contre la classe ouvrière et ses organisations. Et c'est justement en tant que moment privilégié de l'armement de l'organisation communiste contre les différents aspects de cette offensive que le 12e congrès de la section en France prenait toute son importance.
Une attaque sans précédent de la classe bourgeoise contre le prolétariat
La bourgeoisie est en effet obligée d'accompagner son attaque économique contre la classe ouvrière d'une attaque politique. Cette attaque vise évidemment, comme on a pu le voir dans les manoeuvres de la bourgeoisie de la fin 1995, le court terme et le moyen terme : elle vise à affaiblir le prolétariat en prévision des combats qu'il devra mener dans les années qui viennent. Cependant, ce serait dangereusement sous-estimer la classe dominante que de considérer qu'elle ne voit pas plus loin. Ses secteurs les plus lucides savaient bien que l'impact des immenses campagnes sur « la mort du communisme » et la « victoire définitive du capitalisme » ne pourrait durer éternellement, qu'il serait nécessairement battu en brêche par l'aggravation de la crise du capitalisme et la nécessaire reprise des luttes ouvrières. C'est pour cela qu'il fallait prendre rapidement les devants : « ... il faut souligner le changement récent dans un certain nombre de discours de la classe dominante. Alors que les premières années après l'effondrement du bloc de l'Est ont été dominées par les campagnes sur le thème de "la mort du communisme", "l'impossibilité de la révolution", on assiste aujourd'hui à un certain retour à la mode de discours favorables au "marxisme", à la "révolution", au "communisme" de la part des gauchistes, évidemment, mais même au-delà d'eux. » Avant qu'un nombre croissant d'ouvriers ne reconnaisse dans le marxisme la théorie de la lutte du prolétariat pour son émancipation, il s'agit d'élaborer et de diffuser un faux marxisme destiné à polluer et dévoyer le processus de prise de conscience de la classe ouvrière.
Mais cette offensive ne s'arrête pas là. Il s'agit aussi de discréditer le courant de la Gauche communiste, celui qui a représenté, au moment de la dégénérescence et de la mort de l'Internationale Communiste, le véritable défenseur des principes communistes qui avaient présidé à la révolution d'octobre 1917. C'est ainsi que, à l'occasion de la publication des archives de Vercesi, principal animateur de la Fraction de Gauche italienne, des universitaires de Bruxelles présentent ce courant comme anti-fasciste, c'est-à-dire l'anti-thèse même de ce qui fut son essence. Ce dont il s'agit fondamentalement c'est de compromettre l'avenir du courant de la Gauche communiste, c'est-à-dire le seul qui travaille à la fondation du parti communiste dont aura besoin le prolétariat pour mener à bien sa révolution.
Et cette attaque contre la Gauche communiste ne se cantonne pas au niveau universitaire. Les « spécialistes » de la classe dominante savent parfaitement le danger que représentent pour cette dernière les groupes du milieu politique prolétarien qui se réclament justement de la Gauche communiste. Evidemment, ce danger n'est pas immédiat. Continuant à subir les séquelles de la terrible contre-révolution qui s'est abattue sur le prolétariat à partir de la fin des années 1920 et qui a sévit jusqu'au milieu des années 1960, la Gauche communiste se distingue encore par sa faiblesse tant numérique qu'au niveau de son impact sur l'ensemble de la classe ouvrière. Une faiblesse qui est encore aggravée par la dispersion entre plusieurs courants (CCI, BIPR, multiples « Partis » du courant bordiguiste).
Et justement, il faudrait être singulièrement naïf pour croire que la classe dominante, et ses institutions spécialisées, n'emploient pas dès à présent tous les moyens possibles pour empêcher ce courant de se renforcer à mesure que se développera la prise de conscience du prolétariat, pour le liquider. Parmi ces moyens, il y a évidemment la répression policière. Mais dans le cadre des « démocraties » qui gouvernent les pays industrialisés, c'est un instrument que la bourgeoisie utilise encore assez peu pour ne pas trop se démasquer. Il y a aussi l'infiltration par des organismes spécialisés de l'Etat capitaliste visant à informer ces derniers et surtout à détruire de l'intérieur les organisations communistes. C'est ainsi qu'en 1981, le CCI avait démasqué l'individu Chénier dont les agissements avaient contribué à aggraver la crise qu'avait connue le CCI à l'époque et à provoquer la perte de nombreux militants.
Enfin, et surtout, notre organisation a mis en évidence le rôle particulier que joue aujourd'hui le milieu parasitaire comme instrument de l'attaque de la bourgeoisie contre le milieu politique prolétarien.
L'attaque du parasitisme contre le milieu politique prolétarien et contre le CCI
Ce n'est pas une préoccupation nouvelle de notre organisation. Ainsi, au lendemain de notre 11e congrès international, il y a un an, nous pouvions déjà écrire :
« Il est préférable pour la bourgeoisie de faire un mur de silence autour des positions et de l'existence des organisations révolutionnaires. C'est pour cela que le travail de dénigrement de celles-ci et de sabotage de leur intervention est pris en charge par toute une série de groupes et d'éléments parasitaires dont la fonction est d'éloigner des positions de classe les éléments qui s'approchent de celles-ci, de les dégouter de toute participation au travail difficile de développement d'un milieu politique prolétarien.
L'ensemble des groupes communistes a été confronté aux méfaits du parasitisme, mais il revient au CCI, parce que c'est aujourd'hui l'organisation la plus importante du milieu prolétarien, de faire l'objet d'une attention toute particulière de la part de la mouvance parasitaire. » (Revue internationale n° 82)
Et sur la base de la convergence de toute une série d'attaques de la part du parasitisme contre le milieu politique prolétarien et le CCI en particulier le congrès a discuté et adopté une résolution dont nous donnons ici quelques extraits :
« La notion de parasitisme politique n'est pas une innovation du CCI. Elle appartient à l'histoire du mouvement ouvrier. Ainsi, dans le combat du Conseil Général dans l'AIT, Marx qualifiait la politique de l'Alliance de Bakounine de 'parasitisme.
Les groupes parasites n'appartiennent pas au milieu politique prolétarien. En aucune façon, il ne sont l'expression de l'effort de prise de conscience de la classe. Au contraire, ils constituent une tentative de faire avorter cet effort. En ce sens, leur activité vient compléter le travail des forces de la bourgeoisie pour saboter l'intervention des organisations révolutionnaires au sein de la classe.
Ce qui anime l'activité et détermine l'existence des groupes parasites ce n'est nullement la défense des principes de classes du prolétariat, la clarification de positions politiques, mais au mieux l'esprit de chapelle ou de "cercles d'amis", l'affirmation de l'individualisme et son individualité vis-à-vis du MPP. C'est pour cela que le point de départ d'une démarche parasitaire pouvant conduire à la fondation d'un groupe parasite est basé sur des griefs personnels, des ressentiments, des frustrations et autres préoccupations mesquines, relents de l'idéologie de la petite-bourgeoisie décomposée et sans avenir.
En ce sens, ce qui caractérise un groupe parasite, ce n'est pas la défense d'une plateforme programmatique mais essentiellement une attitude politique face aux organisations révolutionnaires, et plus particulièrement face au principal pôle de regroupement, le CCI. (...)
Le parasitisme à ainsi pour fonction :
- de renforcer la confusion dans la classe... ;
- de développer les attaques contre les organisations marxistes en vue de la destruction du MPP ;
- d'alimenter les campagnes de la bourgeoisie contre le communisme en colportant l'idée que toute organisation marxiste se réclamant du combat de Lénine pour la construction du Parti est, par nature, vouée à la dégénérescence stalinienne ;
- de ridiculiser les principes organisationnels du prolétariat en inoculant l'idée que la défense instransigeante de ces principes ne mène qu'au sectarisme.
Tous ces thèmes développés dans l'offensive du parasitisme contre le CCI [sont] une confirmation de la contribution active des groupes parasites à l'offensive de l'Etat bourgeois contre le marxisme depuis l'effondrement du bloc de l'Est. Ils constituent un sabotage des efforts du prolétariat pour retrouver sa perspective révolutionnaire.
En ce sens, les groupes parasites sont le terrain de prédilection des manipulations de l'Etat. »
Cela ne signifie pas que les groupes parasites soient de simples organes de l'Etat capitaliste, comme peuvent l'être, par exemple, les groupes gauchistes lesquels défendent un programme capitaliste. De même, il est sûr que, pour la plupart, les éléments du milieu parasitaire, qu'il soit organisé ou informel, n'ont aucun lien direct avec les organismes de l'Etat. Mais, compte tenu de la démarche qui anime ce milieu, du laxisme politique et organisationnel qui le caractérise, des réseaux de copinages qui le traversent, de sa prédilection pour les commérages de toutes sortes, rien n'est plus facile pour quelques spécialistes de l'infiltrer et de l'orienter dans des directions qui favorisent encore mieux l'action de la bourgeoisie contre les organisations communistes.
L'armement organisationnel du CCI
Le 12e Congrès de la section en France se devait également de faire un bilan, un an après le congrès international, de sa capacité à faire vivre les perspectives dégagées par celui-ci. Nous serons brefs sur ce point car, malgré toute son importance, il était secondaire par rapport au point qui vient d'être évoqué et lui était, en bonne partie, subordonné.
La résolution adoptée par
ce congrès disait :
« ... le 11e Congrès constate donc
que le CCI est aujourd'hui bien plus fort qu'il n'était au précédent congrès,
qu'il est incomparablement mieux armé pour affronter ses responsabilités face
aux futurs surgissements de la classe, même si, évidemment, il est encore en
convalescence »
(point 11)
« Cela ne signifie pas que le combat que nous avons mené soit appelé à cesser. (...) Le CCI devra le poursuivre à travers une vigilance de chaque instant, la détermination d'identifier chaque faiblesse et de l'affronter sans attendre. (...) En réalité, l'histoire du mouvement ouvrier, y compris celle du CCI, nous enseigne, et le débat nous l'a amplement confirmé, que le combat pour la défense de l'organisation est permanent, sans répit. » (point 13)
Tout cela, l'année écoulée l'a pleinement confirmé pour la section en France. C'est ainsi que celle-ci, face à un événement aussi important que les grèves de la fin 1995, a réussi à la fois à identifier immédiatement le piège que la bourgeoisie était en train de tendre à la classe ouvrière et à intervenir activement dans la classe.
Le 12e congrès de la section en France a illustré et mis en évidence une fois de plus combien le combat pour la construction et la défense de l'organisation est un combat de longue durée, permanent, qui ne tolère aucun relâchement. Mais pour les révolutionnaires, la difficulté n'est pas un facteur de démoralisation. Au contraire. Avant garde d'une classe qui puise des luttes quotidiennes qu'elle mène contre l'ennemi capitaliste la force qui lui permettra de transformer le monde, les communistes renforcent leur propre conviction, leur propre détermination, par la lutte contre les attaques de la classe ennemie, comme celle que nous connaissons aujourd'hui aussi bien que des difficultés que rencontre leur activité.
Vie du CCI:
- Défense de l'organisation [2052]
Heritage de la Gauche Communiste:
12e congrès de RI : résolution sur la situation internationale
- 2722 reads
1) Au cours de l'année écoulée depuis le 11e congrès du CCI la situation de l'économie mondiale a pleinement confirmé la perspective dégagée lors de ce congrès : la « reprise » dont se flattait alors la bourgeoisie ne recouvrait nullement une quelconque « sortie du tunnel » pour l'économie capitaliste mais n'était qu'un moment de l'enfoncement de celle-ci dans une crise sans issue. Le 11e congrès soulignait qu'un des principaux aliments de cette « reprise », que nous avions d'ailleurs qualifiée alors de « reprise sans emplois », résidait dans une fuite en avant dans l'endettement généralisé qui ne pourrait aboutir à terme qu'à de nouvelles convulsions dans la sphère financière et à une plongée dans une nouvelle récession ouverte. Ces convulsions financières, avec des difficultés dramatiques du système bancaire et une chute spectaculaire de la monnaie reine, le dollar, ont affecté le capitalisme dès le début de l'automne 1995 et n'ont fait que précéder une nouvelle chute des taux de croissance de la plupart des pays industrialisés au début de l'hiver, avec des prévisions encore plus sombres pour l'année 1996.
2) Une des illustrations les plus probantes de cette aggravation de la situation de l'économie mondiale est constituée par les difficultés qu'affronte à l'heure actuelle la première puissance du continent européen, l'Allemagne. Ainsi, ce pays se trouve aujourd'hui confronté à un niveau de chômage sans précédent depuis la seconde guerre mondiale, 4 millions de sans emploi, qui affecte non seulement sa partie orientale mais s'étend massivement dans les régions les plus « prospères » de la partie occidentale. Symbole de ces difficultés sans précédent de l'économie allemande, un de ses fleurons, le groupe Daimler, vient d'annoncer qu'il ne distribuerait pas de dividendes à ses actionnaires : pour la première fois depuis la guerre, cette entreprise vient d'enregistrer des pertes, et d'un montant considérable. Ainsi s'écroule un des mythes complaisamment promu par la classe bourgeoise (et auquel avaient cru certains groupes du milieu prolétarien) au lendemain de l'effondrement du bloc de l'Est et de la réunification allemande : le mythe de la relance de la croissance par la reconstruction des économies sinistrées des zones dominées par ce bloc. Comme le CCI l'avait souligné immédiatement face à l'euphorie quasi générale, la sortie des pays de l'Est de la forme stalinienne du capitalisme d'Etat ne pouvait en aucune façon constituer un poumon pour l'économie mondiale. Plus précisément, la reconstruction de la partie Est de l'Allemagne qui nécessitait un montant colossal de capitaux, s'il a permis pendant quelques années à l'économie allemande de connaître des taux de croissance relativement élevés, portait avec elle un endettement colossal, un endettement qui ne pouvait déboucher que sur son brutal ralentissement, et cela à l'image de l'ensemble du capitalisme.
3) La plongée dans la récession ouverte du modèle allemand, symbole de « vertu économique », est d'autant plus significative du degré atteint aujourd'hui par la crise qu'il fait suite à l'effondrement d'un autre « modèle », celui du dynamisme et des taux de croissance record, le modèle japonais. En effet, alors que l'économie nippone affichait avec arrogance, tout au long des années 1980, des taux de croissance de 4 à 5 %, elle n'a pas dépassé le chiffre de 1 % depuis 1992. La mise en oeuvre de 5 plans de relance gouvernementaux n'y ont rien fait : les taux n'ont fait que se réduire pour atteindre 0,3 % en 1995. Non seulement ces plans de « relance » n'ont nullement réussi à redresser la situation, mais l'endettement sur lequel ils se basaient n'a fait que l'aggraver : comme nous l'avons depuis longtemps mis en avant, les « remèdes » que s'applique l'économie capitaliste ne peuvent à terme que faire empirer le mal et à tuer encore plus le malade. En particulier, l'économie japonaise doit faire face dès à présent à une montagne de 460 milliards de dollars de dettes insolvables, une situation résultant notamment de la spéculation effrénée qui avait sévi à la fin des années 1980 et au début des années 1990. Cela est d'autant plus catastrophique, non seulement pour la 2e puissance économique de la terre, mais pour l'ensemble de l'économie mondiale, que le Japon constitue la caisse d'épargne de la planète, assurant à lui seul 50 % des financements des pays de l'OCDE.
4) Quant à la première puissance mondiale, dont les résultats de cette dernière année ont été moins sombres que ceux de ses suivants immédiats, elle aborde l'année 1996 avec des perspectives de croissance de 2 %, en net recul par rapport à 1995. Par exemple, les 40 000 licenciements annoncés chez ATT, c'est-à-dire le symbole d'un des secteurs de pointe de l'économie d'aujourd'hui, celui des télécommunications, sont significatifs de l'aggravation de la situation de l'économie américaine. Et si cette dernière s'en sort à l'heure actuelle un peu mieux que ses rivales, elle le doit à des attaques d'une brutalité sans précédent contre les ouvriers qu'elle exploite (dont beaucoup sont contraints d'occuper plusieurs emplois pour survivre) et aussi à la mise en oeuvre de tous les moyens que lui donne son statut de superpuissance, les pressions financières, monétaires, diplomatiques et militaires au service de la guerre commerciale qu'elle livre à ses concurrentes. Concrètement, dans un monde capitaliste étouffé par la surproduction généralisée, la maigre respiration du plus fort ne peut se faire qu'au moyen de l'asphyxie de ses rivaux : la bourgeoisie allemande et japonaise sont les premières à la constater amèrement aujourd'hui. Et cette guerre commerciale est maintenant d'autant plus exacerbée qu'avec l'effondrement du bloc de l'Est, et la disparition du bloc occidental qui l'a suivie nécessairement, la coordination mise en oeuvre par ce dernier pendant des décennies entre les économies des pays qui le composaient laisse de plus en plus la place au « chacun pour soi » généralisé, ce qui ne peut qu'aggraver la brutalité des convulsions du capitalisme.
5) Le domaine où ce « chacun pour soi » revêt sa forme la plus spectaculaire est celui des antagonismes impérialistes. Au moment même où s'effondrait le bloc de l'est, face aux prophéties bourgeoises sur le « nouvel ordre mondial » fait de paix et de prospérité, le CCI avait dénoncé de tels mensonges. La division du monde en deux blocs n'était pas la cause des antagonismes impérialistes mais la conséquence de ces derniers, un des moyens que se donnaient les différents pays de la planète pour y faire face. La disparition du système des blocs sortis de la 2e guerre mondiale, loin de faire disparaître les antagonismes entre Etats et les affrontements guerriers, ne pouvait que lâcher la bride à des antagonismes que l'organisation en blocs avait contenus dans certaines limites. Si elle mettait à l'ordre du jour de l'histoire la reconstitution de nouveaux blocs impérialistes, perspective qui ne pouvait se réaliser immédiatement du fait du retard militaire considérable du leader potentiel d'un nouveau bloc, l'Allemagne, par rapport à la première puissance mondiale, elle débouchait immédiatement sur une explosion du « chacun pour soi », un paysage impérialiste marqué par un bouleversement des alliances sans précédent depuis le début du siècle. Depuis, la situation mondiale n'a fait que confirmer cette perspective. Et si la tendance vers la reconstitution des nouveaux blocs s'était nettement affirmée au tout début des années 1990, elle a, depuis, été supplantée par le « chacun pour soi », une des manifestations les plus significatives de la décomposition générale de le société capitaliste.
6) Le 11e congrès du CCI avait fait ressortir que le déchaînement du chacun pour soi aboutissait à « un affaiblissement considérable, voire à une crise du leadership américain » sur la planète en soulignant notamment qu'une telle situation trouvait son expression la plus spectaculaire avec la brouille entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, les deux alliés les plus fidèles de la planète depuis le début du siècle, et avec le fait que la première puissance mondiale était pratiquement absente de la zone du conflit impérialiste le plus important du moment, l'ex-Yougoslavie. Depuis, si la brouille entre les deux puissances anglo-saxonnes ne s'est pas dissipée, loin de là, les Etats-Unis ont réussi, en revanche, à redresser de façon spectaculaire leur position dans cette zone. Depuis l'été dernier, avec comme première étape le soutien des Etats-Unis à l'offensive croate dans la Krajina, cette puissance a réussi à retourner radicalement la situation. Grâce à la supériorité de ses armes, moyen principal de son action à l'échelle internationale, elle a éclipsé totalement la prééminence de la Grande-Bretagne et de la France dans l'ex-Yougoslavie, une prééminence exercée pendant plusieurs années grâce à la FORPRONU et que ces pays se proposaient de renforcer avec la création de la FRR. Le retour en force des Etats-Unis ne se limite pas à une simple réplique à la FRR. En fait, alors que le tandem franco-britannique avait sur place comme seul allié la Serbie, les Etats-Unis, aujourd'hui, ont réussi à mettre de leur côté, de gré ou de force, non seulement leurs alliés du premier jour, les musulmans, mais aussi les « amis » de l'Allemagne, les croates et les « ennemis » d'hier, les serbes de Belgrade, grâce notamment, à un divorce de ces derniers d'avec ceux de Pale.
7) La reprise de l'initiative par les Etats-Unis ne se limite pas à la situation dans l'ex-Yougoslavie mais s'étend aussi bien à ses zones d'hégémonie traditionnelles – comme le Moyen-Orient – qu'à l'Extrême-Orient. C'est ainsi que le sommet de Charm-el-Cheik sur le terrorisme en Israël a permis à l'Oncle Sam de rappeler QUI était le parrain de la région de la même façon que son attitude très ferme en défense de Taiwan, confrontée aux gesticulations de la Chine continentale, constituait un avertissement très clair face aux ambitions impérialistes de celle-ci et, au-delà, à celles du Japon, deux puissances dont la résolution du 11e Congrès international soulignait déjà les efforts d'armement. Dans ce contexte de retour en force de la puissance américaine, les seconds couteaux que sont la Grande-Bretagne et la France n'ont eu d'autre possibilité que d'adopter un profil bas. C'est en traînant les souliers qu'elles se sont rendues au « Clinton show » de Charm-el-Cheik. C'est pour sauver les meubles et ne pas se retrouver totalement en dehors du coup, que ces pays ont réaffecté les troupes qu'ils avaient auparavant fournies à la FORPRONU, à l'IFOR, créature des Etats-Unis et dirigée par eux, de la même façon que la France, fondamentalement opposée à l'opération « tempête du désert », en 1990-91, s'était vue contrainte d'y participer. De même, le rapprochement ponctuel réalisé autour de la question Yougoslave entre la première puissance mondiale et sa principale rivale, l'Allemagne, s'est opéré au bénéfice essentiel de la première. Même ce qui pourrait apparaître comme un succès pour l'Allemagne, la conquête par son alliée, la Croatie, des positions qu'elle convoitait depuis l'accession à son indépendance, elle le doit principalement à l'action des Etats-Unis, ce qui constitue une position bien inconfortable pour une puissance impérialiste, surtout lorsqu'elle se pose en candidate à la direction d'un nouveau bloc. Ainsi, tout comme la France et la Grande-Bretagne, cette puissance, notamment dans sa participation à l'IFOR, se retrouve dans la situation de devoir se soumettre aux conditions des Etats-Unis.
8) Le retour en force de la première puissance mondiale ne signifie nullement qu'elle ait définitivement surmonté les menaces qui pèsent sur son leadership. Ces menaces proviennent fondamentalement, comme nous l'avons souligné au dernier congrès international, du chacun pour soi, du fait qu'il manque aujourd'hui ce qui constitue la condition principale d'une réelle solidité et pérennité des alliances entre Etats bourgeois dans l'arène impérialiste : l'existence d'un ennemi commun menaçant leur sécurité. Les différentes puissances de l'ex-bloc occidental peuvent, au coup par coup, être obligées de se soumettre aux diktats de Washington, mais il est hors de question pour elles de maintenir une quelconque fidélité durable. Bien au contraire, toutes les occasions sont bonnes pour saboter, dès qu'elles le peuvent, les orientations et les dispositions imposées par les Etats-Unis. C'est ainsi que la mise au pas de la Grande-Bretagne dans l'ex-Yougoslavie n'a nullement rétabli son allégeance au grand frère d'outre Atlantique. C'est pour cela que ce dernier a repris sa pression sur la question irlandaise, notamment en faisant porter à Londres la responsabilité de la reprise des attentats de l'IRA (derrière lesquels il se trouve bien probablement). C'est ainsi que la France essaye maintenant, avec le récent voyage de Chirac à Beyrouth, de revenir braconner sur les chasses gardées américaines du Moyen-Orient après qu'elle ait animé le sommet de Barcelone destiné à damer le pion US en Méditerranée. En fait ce que met une nouvelle fois en évidence l'évolution récente des rapports impérialistes, c'est le bouleversement radical des alliances, et l'éminente instabilité de celles-ci, sur lequel a débouché la fin du système des blocs de la guerre froide. Des « amitiés » vieilles de 80 ans ou de 40 ans se brisent. Entre Washington et Londres, le divorce est profond. De même, chaque jour qui passe voit s'aggraver le différent entre la France et l'Allemagne, c'est-à-dire les deux chefs de file de la construction de l'édifice européen.
9) Concernant ces derniers aspects, il importe de souligner quels sont les ressorts de cette nouvelle configuration des alliances impérialistes. La nouvelle « Entente cordiale » entre la France et la Grande-Bretagne ne peut se baser que sur la brouille entre Londres et Washington d'un côté, entre Paris et Berlin de l'autre. Le fait que la France et la Grande-Bretagne soient toutes les deux des puissances moyennes historiquement déclinantes de forces sensiblement égales, confrontées à la pression des deux « grands », les Etats-Unis et l'Allemagne, confèrent une certaine solidité à cette nouvelle « Entente cordiale ». Et ce d'autant plus qu'il existe en Europe un antagonisme de fond, insurmontable, entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne, alors qu'à côté de trois guerres il y a eu la place pour de longues périodes « d'amitié » entre ce dernier pays et la France, dont certains secteurs de la bourgeoisie se sont ralliés à l'alliance allemande même au cours de la seconde guerre mondiale. Cependant, la montée en force de l'impérialisme allemand au cours de ces dernières années ne peut que raviver les vieilles craintes de la bourgeoisie française face à son trop puissant voisin. Tout ceci conduit, même s'il n'y a pas une rupture totale entre Paris et Berlin, à une profonde dégradation des rapports franco-allemands. Ainsi, et même si un pays comme la France aimerait bien pouvoir jouer les arbitres entre ses deux grands voisins, une quelconque alliance à trois est tout à fait impossible. En ce sens, la perspective d'une réelle construction de l'Europe politique est du domaine de l'utopie et ne peut être autre chose qu'un thème de mystification. Ainsi, l'impuissance des institutions européennes qui s'est illustrée dans la question de l'ex-Yougoslavie, et sur laquelle ont joué les Etats-Unis pour revenir en force dans cette région, continuera à se manifester par le futur. Sur cette base, la puissance américaine n'aura de cesse de donner des coups de pieds dans la fourmilière, comme elle l'a fait dans les Balkans, afin d'empêcher tout rassemblement ou toute concomitance des mécontentements à son égard. Plus généralement, la scène impérialiste mondiale ne peut connaître d'autre perspective, comme le CCI l'a depuis longtemps mis en évidence, qu'une instabilité croissante, avec des avancées, et aussi des reculs de la puissance américaine, et, surtout, la poursuite, sinon l'aggravation, de l'emploi de la force brute, du fracas des armes et l'horreur des massacres.
10) Comme l'exprimait la résolution du dernier congrès international : « Plus que jamais, la lutte du prolétariat représente le seul espoir d'avenir pour la société humaine » (point 14). Et cette dernière année a tout à fait illustré ce que contenait cette résolution : « [les luttes ouvrières] ont témoigné, particulièrement depuis 1992, de la capacité du prolétariat à reprendre le chemin du combat de classe, confirmant ainsi que le cours historique n'avait pas été renversé. Elles ont témoigné aussi des énormes difficultés qu'il rencontre sur ce chemin, du fait de la profondeur et de l'extension de son recul [suite à l'effondrement des régimes staliniens, les campagnes idéologiques qui l'ont accompagné et l'ensemble des événements qui l'ont suivi]. C'est de façon sinueuse, avec des avancées et des reculs, dans un mouvement en dents de scie, que se développent les luttes ouvrières » (Ibid.) « Ces obstacles ont favorisé la reprise en main par les syndicats de la combativité ouvrière, la canalisant dans des "actions" qu'ils contrôlent entièrement. Cependant, les manoeuvres présentes des syndicats ont aussi, et surtout, un but préventif : il s'agit pour eux de renforcer leur emprise sur les ouvriers avant que ne se déploie beaucoup plus leur combativité, combativité qui résultera nécessairement de leur colère croissante face aux attaques de plus en plus brutales de la crise. » (point 17). Les grèves de la fin de l'automne 1995 en France ont magistralement confirmé cette perspective : « ... pour empêcher que la classe ouvrière n'entre dans le combat avec ses propres armes, la bourgeoisie a pris les devants et elle l'a poussée à partir prématurément en lutte sous le contrôle total des syndicats. Elle n'a pas laissé aux ouvriers le temps de se mobiliser à leur rythme et avec leurs moyens. (...) Cette recrédibilisation des syndicats constituait pour la bourgeoisie un objectif fondamental, un préalable indispensable avant de porter les attaques à venir qui seront encore bien plus brutales que celles d'aujourd'hui. C'est à cette condition seulement qu'elle peut espérer saboter les luttes qui ne manqueront pas de surgir au moment de ces attaques. » (Revue internationale n° 84) Elles ont également confirmé que c'est bien à l'échelle internationale, comme nous l'avions déjà souvent mis en évidence, que la bourgeoisie mène et organise son action contre la classe ouvrière :
- à travers la couverture médiatique sans précédent de ces grèves (alors que, à d'autres moments, les mouvements sociaux qui inquiétaient vraiment la classe dominante faisaient l'objet d'un « black-out » total dans les autres pays) ; une couverture médiatique essayant notamment d'exploiter la référence à mai 1968, tant pour focaliser l'attention des prolétaires sur les événements en France que pour les dénaturer à leurs yeux tout en dénaturant ceux de 1968 eux-mêmes ;
- avec l'exécution par la bourgeoisie belge, avec le même succès, d'une copie conforme de la manoeuvre qui a piégé les ouvriers en France et en s'appuyant sur cette campagne médiatique.
11) Le retour en force et la recrédibilisation des appareils syndicaux, qui ont singularisent les mouvements sociaux de la fin 1995 en France, ne constituent pas un phénomène nouveau, ni dans ce pays, ni au niveau international. Ce fait avait déjà été relevé il y a un an par le dernier congrès du CCI : « ... il importe de mettre en évidence que la tendance vers le débordement des syndicats qui s'était exprimée en 1992 en Italie ne s'est pas confirmée, bien au contraire, en 1994 où la manifestation "monstre" de Rome était un chef d'oeuvre de contrôle syndical. De même, la tendance à l'unification spontanée, dans la rue, qui était apparue (bien que de façon embryonnaire) à l'automne 1993 dans la Ruhr en Allemagne a, depuis, laissé la place à des manoeuvres syndicales de grande envergure, telle la "grève" de la métallurgie du début 1995, parfaitement maîtrisées par la bourgeoisie. » (point 15) Cette recrédibilisation des syndicats était contenue dans les caractéristiques de l'effondrement du bloc de l'Est, à la fin des années 1980 : « l'idéologie réformiste pèsera très fortement sur les luttes dans la période qui vient, favorisant grandement l'action des syndicats » (« Thèses sur la crise économique et politique en URSS et dans les pays de l'Est », septembre 1989). Cela découlait du fait, non pas que les ouvriers se faisaient encore des illusions sur « le paradis socialiste », mais que l'existence d'un type de société présenté comme « non capitaliste » semblait signifier qu'il pouvait exister autre chose sur terre que le capitalisme. La fin de ces régimes a été présentée comme « la fin de l'histoire ». Dans la mesure où le terrain par excellence des syndicats et du syndicalisme est l'aménagement des conditions de vie du prolétariat dans le capitalisme, les événements de 1989, aggravés par toute la succession de coups portés à la classe ouvrière depuis (du fait de la guerre du Golfe, de l'explosion de l'URSS, de la guerre dans l'ex-Yougoslavie), ne pouvaient aboutir qu'au retour en force des syndicats qu'on constate aujourd'hui dans tous les pays et que les événements en France de la fin 1995 ont particulièrement souligné. Un retour en force qui ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais qui résulte de tout un processus dans lequel les formes « radicales » du syndicalisme (COBAS et autres en Italie, SUD et FSU en France, etc.) ont renforcé l'idéologie syndicaliste avant que de laisser le devant de la scène aux centrales traditionnelles.
12) De ce fait, dans les principaux pays du capitalisme, la classe ouvrière se retrouve ramenée à une situation comparable à celle des années 1970 en ce qui concerne ses rapports aux syndicats et au syndicalisme : une situation où la classe, globalement, luttait derrière les syndicats, suivait leurs consignes et leurs mots d'ordre et, en fin de compte, s'en remettait à eux. En ce sens, la bourgeoisie a momentanément réussi à effacer des consciences ouvrières les leçons acquise au cours des années 1980, suite aux expériences répétées de confrontation aux syndicats. La classe dominante va tirer profit le plus longtemps possible de ce renforcement des syndicats et du syndicalisme contraignant la classe ouvrière à une longue période de confrontation avec ces derniers (comme elle l'a fait depuis les années 1970 jusqu'à la fin des années 1980, même si cette période ne dure pas aussi longtemps) avant qu'elle ne soit de nouveau en mesure de se dégager de leur emprise. Elle devra déjouer en même temps les thèmes idéologiques développés autour des campagnes sur la « mondialisation de l'économie » avec lesquelles la bourgeoisie essaie de masquer la cause véritable des attaques qu'elle déchaîne contre le prolétariat : la crise sans issue du système capitaliste, campagnes face auxquelles les syndicats se proposent d'entraîner les ouvriers sur le terrain pourri du nationalisme, de la concurrence avec leurs frères de classe des autres pays.
13) C'est donc encore un long chemin qui attend la classe ouvrière. Mais les difficultés et les obstacles qu'elle rencontre ne doivent pas être un facteur de démoralisation, et il appartient aux révolutionnaires de combattre résolument une telle démoralisation. La bourgeoisie, pour sa part, sait parfaitement quelles sont les potentialités que porte en lui le prolétariat. C'est pour cela qu'elle organise des manoeuvres comme celles de la fin 1995. Comme les révolutionnaires l'ont toujours mis en évidence, et comme nous le confirme la bourgeoisie elle-même, la crise de l'économie capitaliste constitue le meilleur allié du prolétariat, celui qui devra lui ouvrir les yeux sur l'impasse du monde actuel et lui fournir la volonté de le détruire malgré les multiples obstacles que tous les secteurs de la classe dominante ne manqueront pas de semer sur son chemin.
Avril 1996.
Vie du CCI:
- Résolutions de Congrès [131]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [143]
Questions théoriques:
- Impérialisme [321]
Révolution allemande (V) : du travail de fraction à la fondation du K.P.D
- 4114 reads
Dans l'article précédent, nous avons montré comment les révolutionnaires en Allemagne ont été confrontés à la question de la construction de l'organisation face à la trahison de la social-démocratie : d'abord mener jusqu'au bout la lutte dans l'ancien parti, accomplir un dur travail de fraction et ensuite, quand ce travail n'est plus possible, préparer la construction d'un nouveau parti.. C'est la démarche responsable qu'adoptèrent les Spartakistes par rapport au SPD et qui les amena ensuite à adhérer majoritairement à l'USPD centriste qui venait de se constituer, au contraire de la Gauche de Brême qui réclame la fondation immédiate du parti. Dans cet article nous traitons de la fondation du KPD et des difficultés organisationnelles dans la construction de ce nouveau parti.
L'échec de la tentative de fondation du parti par les Linksradikale
Le 5 mai 1917, les Radicaux de Gauche de Brême et de Hambourg reprochent aux Spartakistes d'avoir renoncé à leur indépendance organisationnelle par leur entrée dans l'USPD ; ils sont d'avis que « les temps sont venus pour la fondation d'une organisation de la gauche radicale dans le Parti Socialiste International d'Allemagne. (Internationale Sozialistische Partei Deutschlands). »
Au cours de l'été ils organisent des rencontres préparatoires à la fondation d'un nouveau parti. La conférence de fondation est fixée au 25 août et doit se tenir à Berlin. Treize délégués seulement parviennent à destination dont cinq sont de Berlin. La police n'a aucun mal à disperser la conférence! Cela démontre que la volonté seule ne suffit pas mais qu'il faut aussi disposer de ressources organisationnelles suffisantes. « Cela ne suffit justement pas d'arborer "l'étendard de la pureté", le devoir est de le porter aux masses, afin de les gagner. » déclare Rosa Luxemburg dans Der Kampf de Duisburg.
Le 2 septembre une nouvelle tentative est entreprise. Cette fois l'organisation prend le nom d' « Internationaler Sozialisticher Arbeiterbund ». Ses statuts prévoient que chaque section dispose de son autonomie. Elle avance que « la division en organisations politiques et économiques est historiquement dépassée. » Encore un indice de sa grande confusion en matière de questions organisationnelles. C'est travestir la vérité que d'affirmer que la Gauche de Brême aurait alors été le groupe le plus clair sur le plan politique et pratique lors des mouvements révolutionnaires en Allemagne.
Le groupe de Dresde autour d'O. Rühle ainsi que d'autres courants commencent à développer leurs conceptions hostiles à l'organisation politique. Le futur communisme de conseils continue à mûrir. Bien que les communistes de conseils ne se dotent pas eux-mêmes de formes d'organisation politiques, leur voix n'en a pas moins une grande portée dans la classe.
Si les Spartakistes rencontrent un écho de plus en plus grand, en revanche la Gauche de Brême et les ISD ne parviennent jamais à dépasser le stade de cercle restreint. Même si le bilan d'un an et demi de travail de la Ligue Spartakiste dans l'USPD n'a pas donné les fruits escomptés, celle-ci, contrairement à ce qu'affirmait l'ISD au départ, n'a jamais sacrifié son indépendance. Elle a développé une intervention active dans les rangs de l'USPD sans jamais se laisser museler. Que ce soit au cours des polémiques autour des négociations de Brest-Litovsk à partir de décembre 1917, ou lors de la gigantesque vague de grèves de janvier 1918 où un million d'ouvriers cessent le travail et où les conseils ouvriers font leur apparition en Allemagne, la Ligue Spartakiste se trouve de plus en plus au premier plan.
C'est précisément au moment où le Capital allemand se cabre encore et est prêt à envoyer au feu encore plus de chair à canon [1] [2534] que la Ligue Spartakiste se renforce organisationnellement. Elle édite huit publications à un tirage variant de 25 000 à 100 000 exemplaires; et tout cela à un moment où la quasi-totalité de sa direction se trouve en prison. [2] [2535]
Même quand la Gauche de Brême se lance dans la fondation d'un parti indépendant, la Ligue Spartakiste refuse d'avoir une attitude sectaire et continue à travailler au regroupement, au rassemblement des forces révolutionnaires en Allemagne.
Le 7 octobre 1918, le groupe Spartakus convoque une conférence nationale à laquelle participent des délégués de plusieurs groupes locaux des Linksradikale. Une collaboration entre les Spartakistes et les Radicaux est décidée sans que ces derniers ne soient contraints de rejoindre l'USPD. Cependant, malgré le contexte de développement du combat révolutionnaire dans la classe ouvrière en Allemagne, la conférence ne met toujours pas en avant, comme priorité de son travail, la nécessité de la fondation du parti. Lénine souligne d'ailleurs l'extrême importance de cette question : "Le plus grand malheur pour l'Europe, le plus grand danger pour elle, c'est qu'il n'y existe pas de parti révolutionnaire. (...) Certes, un puissant mouvement révolutionnaire des masses peut corriger ce défaut mais ce fait demeure un grand malheur et un grand danger." (20)
L'intervention des Spartakistes dans les luttes révolutionnaires
Lorsque les luttes révolutionnaires éclatent en novembre 1918, les Spartakistes y accomplissent un travail héroïque et leur intervention a un contenu de très haute qualité. Ils mettent d'abord en avant la nécessité de jeter un pont vers la classe ouvrière de Russie. Ils démasquent sans hésitation les manoeuvres et le travail de sabotage de la bourgeoisie. Ils reconnaissent le rôle des conseils ouvriers et soulignent la nécessité, suite à la fin de la guerre, que le mouvement se porte à un autre niveau dans lequel il puisse se renforcer grâce à la pression exercée à partir des usines.
Pour des raisons de place nous ne pouvons pas aborder plus en détails leur intervention. Malgré leur force au plan du contenu politique, les Spartakistes ne disposent cependant pas dans les luttes d'une influence déterminante dans la classe ouvrière. Pour être un véritable parti, il ne suffit pas d'avoir des positions justes sur le plan politique, mais il faut également avoir une influence correspondante au sein de la classe ouvrière. Il faut être en mesure de diriger le mouvement, comme l'homme de barre son bateau, afin que celui-ci s'engage dans la bonne direction.
Alors que les Spartakistes, au cours du conflit, ont effectué un éminent travail de propagande, ils ne forment au moment où éclatent les luttes qu'un rassemblement lâche. Une trame organisationnelle étroitement tissée leur fait défaut.
Il faut signaler, comme facteur de difficulté supplémentaire, qu'ils appartiennent encore à l'USPD et que de nombreux ouvriers ne voient pas encore suffisamment clairement la différence entre les Centristes et les Spartakistes. Le SPD, lui-même, tire profit de cette situation confuse pour mettre en avant, à son propre bénéfice, l'indispensable « unité » entre les partis ouvriers.
Le développement organisationnel ne s'accélère qu'après l'éclatement des luttes. Le 11 novembre 1918, le « Groupe Spartakus » se transforme en « Ligue de Spartakus » et une Centrale de douze membres est formée.
Contrairement au SPD, qui à lui seul dispose de plus de cent journaux et qui peut s'appuyer, dans ses activités contre-révolutionnaires, sur un large appareil de fonctionnaires et sur les syndicats, au cours de la semaine décisive du 11 au 18 novembre 1918, les Spartakistes se retrouvent sans presse ; Die Rote Fahne ne peut pas paraître. Ils sont contraints d'occuper les locaux d'un journal bourgeois. Le SPD met alors tout en oeuvre pour rendre impossible l'impression de Die Rote Fahne dans l'imprimerie occupée. Ce n'est qu'après l'occupation d'une autre imprimerie que Die Rote Fahne peut reprendre sa parution.
Après avoir revendiqué la convocation d'un congrès extraordinaire de l'USPD, revendication qui n'a pas obtenu la majorité, les Spartakistes décident la fondation d'un parti indépendant. L'ISD qui, entre-temps, a transformé son nom en IKD, tient le 24 décembre une conférence nationale à Berlin, à laquelle participent des délégués de la Wasserkante, de Rhénanie, de Saxe, de Bavière, du Wurtemberg et de Berlin. Lors de cette conférence, Radek pousse à la fusion de l'IKD et des Spartakistes. Le 30 décembre 1918 et le 1er janvier 1919 le KPD est fondé à partir du regroupement de l'IKD et des Spartakistes.
La fondation du KPD
Comme premier point à l'ordre du jour se trouve le bilan du travail effectué au sein de l'USPD. Le 29 novembre 1918, Rosa Luxemburg avait déjà tiré la conclusion que dans une période de montée de la lutte de classe « il n'y a plus de place dans la révolution pour un parti de l'ambiguïté et de la demi-mesure. » [3] [2536] Dans les situations révolutionnaires les partis centristes comme l'USPD doivent éclater.
« Nous avons appartenu à l'USPD pour en faire sortir ce qui peut en sortir, pour faire avancer les éléments précieux de l'USPD et les radicaliser, pour, de cette façon, atteindre le but par un processus de dissociation et par la poursuite de celui-ci, de parvenir à gagner les forces révolutionnaires les plus fortes possibles afin de les rassembler dans un Parti prolétarien révolutionnaire uni et unitaire. (...) Le résultat obtenu fut extraordinairement mince. (...) (Depuis, l'USPD) sert de feuille de vigne aux Ebert-Scheidemann. Ils ont sans détours effacé dans les masses le sentiment de différence entre la politique de l'USPD et celle des socialistes majoritaires. (...) Maintenant l'heure a sonné où tous les éléments prolétariens révolutionnaires doivent tourner le dos à l'USPD pour constituer un nouveau parti, autonome, muni d'un programme clair, aux buts fermes, doté d'une tactique unitaire, animé d'une détermination et d'une résolution révolutionnaires les plus élevées, et conçu comme l'instrument puissant pour l'accomplissement de la révolution sociale qui commence. » [4] [2537]
La tâche de l'heure est au regroupement des forces révolutionnaires dans le KPD et à la délimitation la plus claire par rapport aux centristes.
Dans l'analyse de l'état des luttes révolutionnaires, Rosa Luxemburg, dans son « Rapport sur le programme et la situation politique », fait preuve de la plus grande clarté et met en garde contre la sous-estimation des difficultés du moment :
« Tel que je vous le dépeins, tout ce processus a l'air plus lent que l'on ne se serait porté à se le représenter au premier moment. Je crois qu'il est bon pour nous de nous faire passer sous les yeux en pleine clarté, toutes les difficultés, toutes les complications de cette révolution. Car, j'espère bien que, de même que sur moi, sur personne de vous, le tableau des grandes difficultés, des besognes ainsi dressées devant nous, n'a pour effet de paralyser ni votre ardeur, ni votre énergie. »
Par ailleurs, elle souligne avec force l'importance du rôle du parti dans le mouvement qui se développe :
« La révolution actuelle, qui se trouve seulement au stade de son commencement, qui a de vastes perspectives devant elle ainsi que des problèmes de dimension historique et universelle à dompter, doit posséder une boussole sûre capable à chaque nouveau stade de la lutte, dans chaque victoire comme dans chaque défaite, de lui indiquer sans erreur la direction du même but suprême, celle de la révolution socialiste mondiale, celle de la lutte impitoyable pour le pouvoir du prolétariat pour la libération de l'humanité du joug du Capital. Etre cette boussole indicatrice de la direction à suivre, être ce coin qui s'enfonce vers l'avant, être ce levain prolétarien socialiste de la révolution, voilà la tâche spécifique de la Ligue de Spartakus dans l'affrontement actuel de deux mondes. » [5] [2538]
« Nous devons apprendre aux masses que le Conseil ouvrier et de soldats doit être dans toutes les directions le levier du renversement de la machinerie de l'État, qu'il doit assumer toutes les forces d'action et les diriger dans le sillage de la transformation socialiste. Même les masses ouvrières déjà organisées en conseils ouvriers et de soldats sont à mille lieues de ces devoirs à remplir – sauf naturellement quelques petites minorités de prolétaires qui en ont claire conscience. » [6] [2539]
Lénine considère le programme des Spartakistes (« Que veut la Ligue de Spartakus ? »), qu'il reçoit fin décembre, comme une pierre angulaire pour la fondation de l'Internationale Communiste.
« Dans cette perpective on doit : a) formuler les points des principes pour la plate-forme. (Je pense qu'on peut a) reprendre la théorie et la pratique du Bolchevisme ; b) et plus largement "Que veut la Ligue de Spartakus" ?) Avec a + b les principes fondamentaux pour la plate-forme ressortent suffisamment clairement. » [7] [2540]
La question organisationnelle au congrès
La composition des délégués, au nombre de 83, représentant 46 sections, dont la grande majorité ne dispose d'aucun véritable mandat, reflète toute l'immaturité de l'organisation. Aux côtés de la vieille génération d'ouvriers révolutionnaires du Parti qui ont appartenu avant la guerre à l'opposition de la gauche radicale autour de Rosa Luxemburg se trouvent désormais de jeunes ouvriers qui se sont faits, au cours de la guerre, les porteurs de la propagande et de l'action révolutionnaires mais qui ne possèdent que très peu d'expérience politique ainsi que des soldats, marqués par les souffrances et les privations de la guerre. Ils sont rejoints par des pacifistes qui ont courageusement combattu la guerre et qui, poussés vers la gauche par la répression, voient dans le mouvement ouvrier radical un terrain favorable à leur action, ainsi que des artistes et des intellectuels emportés par le flot de la révolution, bref des éléments comme toute révolution en met soudainement en mouvement.
La lutte contre la guerre a réuni différentes forces dans un même front. Mais, dans le même temps, la répression a jeté de nombreux dirigeants en prison; de nombreux ouvriers, membres expérimentés du parti, ont disparu et de nombreux jeunes éléments radicalisés ne disposant quasiment d'aucune expérience organisationnelle sont maintenant présents. Cela montre que la guerre ne fournit pas forcement les conditions les plus favorables pour la construction du parti.
Concernant la question organisationnelle, on retrouve, dans le KPD, une aile marxiste représentée par R. Luxemburg et L. Jogisches, une aile hostile à l'organisation qui va par la suite accoucher du courant communiste de conseils et enfin une aile activiste, indécise sur le plan organisationnel, incarnée par K. Liebknecht.
Le congrès montre qu'il y a un abîme entre la clarté programmatique (au delà des divergences importantes qui peuvent exister) telle que R. Luxemburg l'exprime dans son discours sur le programme d'une part et les faiblesses en matière de conceptions organisationnelles d'autre part.
Les faiblesses sur les questions organisationnelles
D'abord les questions organisationnelles n'occupent au congrès de fondation qu'une part réduite de ses travaux ; de plus, au moment de la discussion, certains délégués se sont déjà retirés. Le rapport pour le congrès lui-même, rédigé par Eberlein, est un miroir des faiblesses du KPD sur cette question. En premier lieu Eberlein tire le bilan du travail effectué jusqu'alors par les révolutionnaires :
« Les anciennes organisations étaient déjà de par leur nom et de par toutes leurs activités, des "associations électorales" (Wahlvereine). La nouvelle organisation ne doit pas être un club électoral, mais une organisation politique de combat. (...) Les organisations social-démocrates étaient des Wahlvereine. Toute leur organisation reposait sur la préparation et l'agitation pour les élections, et en réalité il n'y avait un peu de vie dans l'organisation que lorsqu'on se trouvait en période de préparation des élections ou durant celles-ci. Le reste du temps, l'organisation était désertée et éteinte. » [8] [2541]
Cette appréciation de la vie politique au sein du SPD d'avant-guerre reflète l'extinction de la vie politique causée par la gangrène du réformisme. L'orientation exclusive vers les élections parlementaires vidait les organisations locales de toute vie politique. L'activité privilégiée envers le Parlement, le crétinisme parlementaire ainsi que l'attachement à la démocratie bourgeoise qui en découle a fait naître la dangereuse illusion que l'axe essentiel du combat du parti est l'activité au Parlement. Ce n'est qu'au commencement de la guerre, après la trahison de la fraction parlementaire au Reichstag qu'une réflexion se produit dans de nombreuses organisations locales.
Pendant la guerre, cependant, « (...) nous avons dû mener une activité illégale, et à cause de cette activité illégale il n'était pas possible de construire une forme d'organisation solide. » (27) En effet, Liebknecht, par exemple, a été, de l'été 1915 à octobre 1918, soit incorporé dans l'armée soit mis en prison se voyant ainsi interdire toute « libre expression d'opinion » et tout contact avec les autres camarades. R. Luxemburg fut incarcérée durant trois ans et quatre mois ; L. Jogisches s'est retrouvé dans la même situation à partir de 1918. La majorité des membres de la Centrale formée en 1916 est derrière les barreaux à partir de 1917. Nombre d'entre eux n'en sortiront qu'à la veille de l'explosion des luttes révolutionnaires de la fin 1918.
Si la bourgeoisie n'a pu faire taire Spartakus, elle a néanmoins porté un coup sévère à la construction du parti en privant un mouvement organisationnellement inachevé de sa direction.
Mais si les conditions objectives de l'illégalité et de la répression constituent de lourdes entraves pour la formation d'un parti révolutionnaire, elles ne doivent cependant pas occulter le fait qu'il existe au sein des forces révolutionnaires une sous-estimation grave de la nécessité de construire une nouvelle organisation. Eberlein révèle cette faiblesse en affirmant :
« Vous savez tous que nous sommes optimistes sur le fait que les semaines et les mois à venir vont nous confronter à une situation qui rendra superflues les discussions sur tout cela. Donc étant donné le peu de temps que nous avons à notre disposition aujourd'hui, je ne veux pas vous retenir plus longtemps. (...) Nous nous trouvons actuellement en pleine lutte politique, c'est pourquoi nous n'avons pas de temps à perdre à des tracasseries sur des paragraphes. (...) Durant ces jours, nous ne devons pas et nous ne pouvons pas mettre notre insistance sur ces petites questions organisationnelles. Dans la mesure du possible, nous voulons vous laisser traiter tout cela dans les sections locales dans les prochaines semaines et les prochains mois. (...) (En comptant plus de membres convaincus) qui soient prêts à se lancer dans l'action dans les jours à venir, et qui orientent tout leur esprit sur l'action de la prochaine période, alors nous surmonterons facilement les petits problèmes d'organisation et de forme d'organisation. » [9] [2542]
Naturellement tout est urgent, tout est pressant dans le feu du brasier révolutionnaire, le facteur temps joue un rôle essentiel. Voila pourquoi il est souhaitable et même nécessaire que la clarification des questions organisationnelles soit un acquis préalable. Si l'ensemble des délégués se préparent à une accélération du combat révolutionnaire pour les semaines qui suivent, nombre d'entre eux qui développent une méfiance vis-à-vis de l'organisation ont à l'esprit que le parti sera, par la force des choses, superflu.
Dans le même sens les déclarations d'Eberlein n'expriment pas seulement une impatience mais aussi une sous-estimation dramatique de la question organisationnelle :
« Pendant ces quatre années, nous n'avons pas eu le temps de penser à la façon dont nous voulons nous organiser. Dans ces quatre années passées, nous étions, jour après jour, confrontés à des faits nouveaux et devions prendre des décisions en fonction, sans que nous nous demandions si nous serions capables d'élaborer des statuts organisationnels. » [10] [2543]
Il est sans doute vrai, que les Spartakistes ont, comme Lénine le souligne, « accompli un travail systématique de propagande révolutionnaire dans les conditions les plus difficiles », mais il est cependant clair qu'il y a un danger qu'ils n'ont pas su éviter. Une organisation révolutionnaire ne doit pas se « sacrifier » pour son intervention dans la classe, c'est-à-dire que cette intervention aussi nécessaire soit-elle ne doit pas la conduire à la paralysie de ses activités organisationnelles elles-mêmes. Un groupe révolutionnaire peut, dans une situation aussi dramatique que la guerre, intervenir intensivement et héroïquement. Mais, si lors de la montée des luttes ouvrières il ne dispose pas d'un tissu organisationnel solide c'est-à-dire si aucune organisation politique ne se trouve aux côtés du prolétariat, le travail effectué précédemment sera perdu. La construction d'une trame organisationnelle, la clarification de la fonction et du fonctionnement, l'élaboration de règles organisationnelles (les statuts) constituent les indispensables pierres angulaires pour l'existence, le fonctionnement et l'intervention de l'organisation. Ce travail de construction ne doit pas être entravé par l'intervention dans la classe. Celle-ci ne peut réellement porter ses fruits que si elle ne s'effectue pas au détriment de la construction de l'organisation.
La défense et la construction de l'organisation est une responsabilité permanente des révolutionnaires que ce soit en période du plus profond reflux de la lutte de classe ou au contraire lors de son plein déferlement.
Par ailleurs, dans le KPD, il existe une réaction de chat échaudé par l'expérience vécue au sein du SPD. Celui-ci, en effet, avait développé un appareil bureaucratique tentaculaire qui avait permis que, dans le processus de dégénérescence opportuniste, la direction du parti entrave les initiatives locales. Ainsi, par peur d'être étouffée par une nouvelle Centrale, une partie du KPD se fait le porte-parole du fédéralisme. Eberlein se joint manifestement à ce choeur :
« Il serait nécessaire dans cette forme d'organisation de laisser de la part de l'ensemble de l'organisation la plus grande liberté possible aux différentes sections, qu'on ne donne pas d'instructions schématiques d'en haut. (...) Nous pensons aussi que le vieux système de subordination des organisations locales à la Centrale doit être abandonné, que les différentes organisations locales, les différentes organisations d'usine doivent avoir une totale autonomie. (...) Elles doivent avoir la possibilité de passer à l'action sans que la Centrale puisse donner ses instructions. » [11] [2544]
L'apparition d'une aile hostile à la centralisation, qui donnera naissance au courant communiste de conseils, va provoquer un recul dans l'histoire organisationnelle du mouvement révolutionnaire.
Il va en être de même
vis-à-vis de la presse :
« Nous pensons aussi que la question
de la presse ne peut être réglée au niveau central, nous pensons que les
organisations locales doivent partout avoir la possibilité de créer leur propre
journal (...). Quelques camarades nous (la Centrale) ont attaqués et nous ont dit :
"Vous sortez un journal, que devons nous en faire ? Nous ne pouvons
pas l'utiliser, nous sortirons nous mêmes notre journal". » [12] [2545]
Ce manque de confiance dans l'organisation et surtout dans la centralisation apparaît surtout chez les anciens Linksradikale de Brême. [13] [2546] Partant de la compréhension juste que le KPD ne peut pas être une simple continuité sans rupture avec l'ancien SPD, ils développent cependant en même temps des tendances à tomber dans l'autre extrême, à nier toute continuité : « Nous n'avons nullement besoin de nous replonger dans les anciens statuts organisationnels pour en sélectionner ce qui pourrait être repris par nous. » [14] [2547]
Les déclarations d'Eberlein font apparaître l'hétérogénéité du KPD, récemment fondé, sur la question organisationnelle.
L'aile marxiste en minorité sur la question organisationnelle
Seule l'aile regroupée autour de R. Luxemburg et de L. Jogisches intervient résolument de façon marxiste lors du Congrès. Comme pôle opposé direct se trouve l'aile des communistes de conseils hostile à l'organisation qui sous-estime fondamentalement le rôle des organisations politiques dans la classe, rejetant surtout la centralisation par méfiance vis-à-vis de l'organisation, et qui pousse à instituer une autonomie complète pour les sections locales. Rühle en est le principal représentant. [15] [2548] Une autre aile, sans alternative organisationnelle claire, est celle regroupée autour de K. Liebknecht. Cette aile se distingue par sa très grande combativité. Mais pour agir en tant que parti la volonté de participer aux luttes ouvrières est largement insuffisante ; par contre la clarté programmatique et la solidité du corps de l'organisation sont indispensables. Liebknecht et ceux qui le suivent orientent leurs activités quasi exclusivement sur l'intervention dans la classe. Cela apparaît clairement lorsque le 23 octobre 1918 il est relâché de prison. Environ 20 000 ouvriers viennent l'accueillir à son arrivée à la gare de Anhalt à Berlin. Ses toutes premières activités sont de se rendre immédiatement à la porte des usines pour faire de l'agitation parmi les ouvriers. Pourtant, lorsqu'en octobre 1918 la température dans la classe ouvrière monte, le devoir le plus pressant des révolutionnaires n'est pas seulement de faire de l'agitation dans la classe mais d'engager toutes leurs forces dans la construction de l'organisation, d'autant plus que les Spartakistes ne forment encore qu'une organisation lâche, sans structures solides. Cette attitude de Liebknecht vis-à-vis de l'organisation se distingue nettement de celle de Lénine. Lorsque Lénine arrive à la gare de Pétrograd en avril 1917 où il est accueilli triomphalement, il fait aussitôt connaître ses Thèses d'avril et fait tout pour que le Parti bolchevik sorte de la crise où il se trouve et se munisse d'un programme clair grâce à la convocation d'un Congrès extraordinaire. Le premier souci de Liebknecht en revanche ne concerne pas vraiment l'organisation et sa construction. Par ailleurs, il semble développer une conception de l'organisation dans laquelle le militant révolutionnaire doit être obligatoirement un héros, une individualité prééminente au lieu de voir qu'une organisation politique prolétarienne vit avant tout de sa force collective. Le fait qu'il ne va cesser, par la suite, de pousser à des actions le plus souvent de son propre chef est la preuve de sa vision erronée de l'organisation. R. Luxemburg se plaint souvent de son attitude :
« Karl est toujours par monts et par vaux, en train de courir d'une allocution aux ouvriers à une autre, il ne vient souvent qu'aux réunions de la rédaction de Die Rote Fahne ; autrement c'est difficile de l'amener aux réunions de l'organisation. » C'est l'image du combattant solitaire que donne Liebknecht. Il ne parvient pas à comprendre que sa principale contribution consiste à participer au renforcement de l'organisation.
Le poids du passé
Le SPD avait été pendant des années rongé par la tradition parlementaire. Les illusions crées par la prédominance de l'activité parlementaire-réformiste ont impulsé l'idée que la lutte dans le cadre du parlement bourgeois était l'arme principale de la classe ouvrière au lieu de la considérer comme un outil transitoire pour mettre à profit les contradictions entre les différentes fractions de la classe dominante, comme une possibilité d'obtenir momentanément des concessions de la part du Capital. « Dorloté » par le parlementarisme, on inclinait à mesurer la force de la lutte à l'aune des voix obtenues par le SPD au parlement bourgeois. C'est une des principales différences entre les conditions de lutte des Bolcheviks et de la Gauche en Allemagne. Les Bolcheviks disposent de l'expérience de 1905 et interviennent dans les conditions de la répression et de l'illégalité mais aussi au parlement russe à travers un groupe beaucoup plus restreint de députés, leur centre de gravité ne se trouve pas dans la lutte parlementaire et syndicale. Alors que le SPD était devenu un puissant parti de masse rongé par l'opportunisme, le Parti Bolchevik est un parti relativement réduit qui a mieux résisté à l'opportunisme malgré les crises qu'il a dû aussi traverser. Et ce n'est pas par hasard si, dans le KPD, l'aile marxiste en matière d'organisation, avec R. Luxemburg et L. Jogisches, est issue du parti polono-lithuanien de la SDKPiL, c'est-à-dire une fraction du mouvement révolutionnaire possédant une expérience directe dans les luttes de 1905 et n'ayant pas connu l'embourbement du marais parlementaire.
La construction du parti ne peut réussir qu'internationalement
Le Congrès de fondation du KPD exprime une autre faiblesse du mouvement révolutionnaire. Alors que la bourgeoisie en Allemagne obtient immédiatement l'aide des bourgeoisies des pays avec lesquels elle était en guerre auparavant, alors que le Capital s'unit à un niveau international dans sa lutte contre la classe ouvrière révolutionnaire (contre le jeune pouvoir ouvrier en Russie ce sont les armées blanches de vingt et un pays qui s'unissent pour mener la guerre civile) les révolutionnaires sont à la traîne pour ce qui concerne leur unification organisationnelle. Pour une partie, cela est le fait de conceptions héritées de la 2e Internationale. Les partis de la 2e Internationale étaient bâtis sur un mode fédéraliste. La conception fédéraliste qui développe des tendances au « chacun pour soi » dans l'organisation empêche de poser la question de l'organisation à un niveau international et de façon centralisée. Les composantes de l'aile gauche ont ainsi combattu séparément les unes des autres dans les différents partis de la 2e Internationale.
« Ce travail fractionnel de Lénine s'effectua uniquement au sein du parti russe, sans qu'il essayât de la porter à l'échelle internationale. Il suffit pour s'en convaincre de lire ses interventions aux différents congrès et l'on peut affirmer que ce travail resta complètement inconnu en dehors des sphères russes. » [16] [2549]
C'est ainsi que K. Radek est le seul délégué étranger présent au Congrès de fondation. Ce n'est que grâce à beaucoup d'adresse et de chance qu'il parvient à passer au travers des mailles du filet des contrôles établis par le gouvernement allemand dirigé par le SPD. Quel destin diffèrent aurait eu ce Congrès si des dirigeants considérés du mouvement révolutionnaire autres que Radek, tels Lénine et Trotsky venant de Russie, Bordiga d'Italie ou Gorter et Pannekoek de Hollande, y avaient participer.
Nous pouvons aujourd'hui tirer la leçon qu'il ne peut y avoir de construction du parti dans un pays si les révolutionnaires n'entreprennent pas cette même tâche simultanément au niveau international et de façon centralisée.
Le parallèle avec la tâche de la classe ouvrière est clair : le communisme ne peut pas lui aussi être construit isolément dans un seul pays. Les conséquences s'imposent d'elles mêmes : la construction du Parti exige qu'elle soit entreprise sur le plan international.
Avec le KPD naît un nouveau parti très hétérogène dans sa composition, divisé sur le plan programmatique et dont l'aile marxiste en matière d'organisation se trouve en minorité. La méfiance envers l'organisation et en particulier envers la centralisation est déjà largement répandue parmi de nombreux délégués. Le KPD ne dispose pas encore d'un rayonnement et d'une influence suffisants pour marquer de façon décisive le mouvement de son sceau.
L'expérience du KPD montre que le parti doit être construit sur une solide armature organisationnelle. L'élaboration de principes organisationnels, le fonctionnement selon l'esprit de parti ne se créent pas sur une simple proclamation ou par décret mais sont le résultat d'années de pratique basée sur ces principes. La construction de l'organisation demande beaucoup de temps et de persévérance. Il est évident que les révolutionnaires d'aujourd'hui doivent tirer les leçons des faiblesses des révolutionnaires en Allemagne. C'est ce que nous aborderons dans le prochain article.
DV.
[1] [2550] De mars à novembre 1918, l'Allemagne perd sur le front de l'Ouest
environ 200 000 tués, 450 000 disparus ou prisonniers et 860 000
blessés.
[2] [2551] Après l'arrestation de K. Liebknecht au début de l'été 1916, une conférence de l'aile gauche de la social-démocratie se tient le 4 juin 1916. Pour reconstituer les liens entre groupes révolutionnaires rompus par la répression, un comité d'action de cinq membres est formé, comprenant entre autres Duncker, Meyer, Mehring. Otto Rühle en est élu président ! Le fait qu'un camarade tel que O. Rühle qui rejette la centralisation et la construction de l'organisation se voit confier la responsabilité de la présidence montre dans quelle situation embarrassante la répression pousse les Spartakistes.
[3] [2552] Rosa Luxemburg, « Le Congrès du Parti Socialiste Indépendant », Die Rote Fahne n° 14.
[4] [2553] K. Liebknecht, Procès-verbal du congrès de fondation du KPD, p. 84 et 92.
[5] [2554] Rosa Luxemburg, La
conférence nationale de la Ligue
de Spartakus, Die Rote Fahne n° 43 du 29 décembre 1918.
[2555]
[6] [2555] Rosa Luxemburg, Discours sur le programme et la situation politique, 30 décembre 1918.
[7] [2556] Lénine, décembre 1918, Correspondance, T. 5, p. 221.
[8] [2557] Rapport d'Eberlein sur la question de l'organisation au congrès de fondation du KPD.
[9] [2558] Idem.
[10] [2559] Idem.
[11] [2560] Idem.
[12] [2561] Idem.
[13] [2562] P. Frölich, pendant la guerre membre de la gauche de Brême, élu à la Centrale par le congrès de fondation pense que : « Dans toutes leurs actions, les organisations locales doivent disposer d'un droit à l'autodétermination complet, il s'en suit également le droit à l'autodétermination pour le reste du travail du parti dans le cadre du programme et des résolutions adoptées par le congrès. » (11 janvier 1919, Der Kommunist) J. Knief, membre de la gauche de Brême défend la conception suivante : « Sans nier la nécessité d'une Centrale, les communistes (de l'IKD) exigent, conformément à la situation révolutionnaire actuelle, la plus grande autonomie et liberté de mouvement pour les organisations locales et régionales. » (Arbeiterpolitik n° 10, 1917).
[14] [2563] Idem.
[15] [2564] J. Borchardt proclame dès 1917 : « Ce qui nous importe, c'est l'abolition de toute forme de direction dans le mouvement ouvrier. Ce dont nous avons besoin pour parvenir au socialisme, c'est de la démocratie pure entre les camarades, c'est-à-dire l'égalité des droits et l'autonomie, libre arbitre et moyens en vue de l'action personnelle pour chaque individu. Ce ne sont pas des chefs que nous devons avoir, mais seulement des organes d'exécution, qui, au lieu d'imposer leur volonté aux camarades, agissent au contraire seulement comme leurs mandataires. » (Arbeiterpolitik n° 10, 1917).
[16] [2565] G. Mammone, Bilan n° 24, p. 814, La fraction dans les partis socialistes de la seconde Internationale.
Géographique:
- Allemagne [98]
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Allemande [1955]
Approfondir:
- Révolution Allemande [1957]
Questions théoriques:
- Parti et Fraction [67]
Heritage de la Gauche Communiste:
- La Révolution prolétarienne [1149]
Polémique : derrière la « mondialisation » de l'économie l'aggravation de la crise du capitalisme
- 4665 reads
- Hommes politiques, économistes et médias nous ont habitués aux plus stupéfiantes théories dans leur tentative désespérée d'occulter la faillite absolue du système capitaliste, et pour justifier l'interminable escalade d'attaques contre les conditions de vie de la classe ouvrière.
- Il y a maintenant 25 ans, un Président américain porte-parole du conservatisme le plus radical, Nixon, proclamait aux quatre vents : « nous sommes tous keynésiens ». En ce temps-là, face à l'aggravation de la crise, la bourgeoisie avançait « l'intervention de l'Etat », le développement de « l'Etat social et égalitaire », comme potion magique pour soigner tous les maux. C'est au nom de cette politique qu'il était demandé aux ouvriers de consentir des sacrifices pour « sortir du tunnel ».
- Pendant les années 1980, face à l'évidence du marasme économique, la bourgeoisie dut changer de monture. C'est l'Etat qui était alors devenu le responsable de tous les maux et l'universelle panacée fut : « moins d'Etat ». Ce furent les années dorées des « reaganomics », qui provoquèrent dans le monde entier la plus formidable vague de licenciements depuis les années 1930, et qui fut organisée par l'Etat.
- Aujourd'hui, la crise du capitalisme a atteint un tel niveau de gravité que tous les Etats industrialisés ont dû mettre à l'ordre du jour la liquidation pure et simple des minimums sociaux garantis (allocations chômage, retraites, santé, éducation ; mais aussi les indemnités de licenciement, la durée de la journée de travail, la sécurité, etc.) dont jouissent encore les travailleurs sous le masque de l' « Etat providence ».
- Cette attaque impitoyable, ce saut qualitatif dans la tendance annoncée par Karl Marx à la paupérisation absolue de la classe ouvrière, se justifie et s'accompagne d'une nouvelle idéologie : « la mondialisation de l'économie mondiale ».
Les serviteurs du capital ont découvert... la lune ! Ils vendent avec cent cinquante ans de retard une soi-disant « grande nouveauté de la fin du siècle », qu'Engels constatait déjà dans les Principes du communisme, écrits en 1847 : « Les choses sont arrivées à un tel point qu'une nouvelle machine qui s'invente aujourd'hui en Angleterre pourra, en l'espace d'une année, condamner des millions d'ouvriers en Chine à la famine. Ainsi, la grande industrie a lié les uns aux autres tous les peuples de la Terre, a uni en un seul marché mondial tous les marchés locaux, a préparé partout le terrain pour la civilisation et le progrès, et elle l'a fait de telle façon que tout ce qui se réalise dans les pays civilisés se répercute nécessairement dans tous les autres. »
Le capitalisme a besoin de s'étendre à l'échelle mondiale, imposant son système d'exploitation salariée à tous les recoins de la planète. L'intégration dans le marché mondial, au début de ce siècle, de tous les territoires significatifs de la planète et la difficulté pour en trouver de nouveaux, capables de satisfaire les besoins toujours croissants de l'expansion du capitalisme, marquent précisément la décadence de l'ordre bourgeois, comme le soutiennent les révolutionnaires depuis 80 ans.
Dans ce cadre de saturation chronique du marché mondial, le 20e siècle est le témoin d'un approfondissement sans précédent de la concurrence entre les divers capitaux nationaux. Face à des besoins croissants de réalisation de la plus-value, les marchés rétrécissent toujours plus. Ceci impose un double mouvement à chaque capital national : d'un côté, protéger par un ensemble de mesures (monétaires, législatives, etc.) ses produits propres face aux assauts des capitaux concurrents, et d'un autre tenter de convaincre ces derniers d'ouvrir leurs portes à ses marchandises (traités commerciaux, accords bilatéraux, etc.).
Quand les économistes bourgeois parlent de « mondialisation », ils laissent entendre que le capitalisme peut s'administrer de façon consciente et unifiée par le biais des règles données par le marché mondial. C'est exactement le contraire qui est vrai : les réalités du marché mondial imposent leurs lois, mais dans un cadre dominé par les tentatives désespérées de chaque capital national de leur échapper et de faire en sorte que ce soient les rivaux qui supportent ce joug.. Le marché mondial actuel « mondialisé » ne crée pas un cadre de progrès ni d'unification, mais au contraire l'anarchie et la désagrégation. La tendance du capitalisme décadent est à la désarticulation du marché mondial, soumis à la puissante force centrifuge d'économies nationales structurées par des Etats hypertrophiés qui tentent par tous les moyens (y compris militaires) de protéger le produit de l'exploitation de leurs travailleurs respectifs contre les assauts des concurrents. Alors que la concurrence entre nations contribuait au siècle dernier à la formation et à l'unification du marché mondial, la concurrence organisée de chaque Etat national au 20e siècle tend précisément à l'inverse : la désagrégation et la décomposition du marché mondial.
C'est exactement pour cette raison que la « mondialisation » ne peut s'imposer que par la force. Dans le monde issu de Yalta, les Etats-Unis et l'URSS profitèrent des avantages donnés par la discipline de bloc impérialiste pour créer des organismes très structurés pour réglementer (à leur avantage bien sûr) le commerce mondial : le GATT, le FMI, le Marché commun, le Comecon dans le bloc russe, etc. Expressions de la force militaire et économique des têtes de bloc, ces organismes ne parvinrent jamais malgré tout à supprimer les tendances à l'anarchie et à organiser un marché mondial harmonieux et unifié. La disparition des deux grands blocs impérialistes après 1989 [1] [2566] a considérablement accéléré la concurrence et le chaos dans le marché mondial.
La « mondialisation » va-t-elle en finir avec cette tendance ? A en croire ses apôtres, la « mondialisation » part d'un marché mondial « déjà unifié » qui va avoir un « effet salutaire » sur toutes les économies et va permettre au monde entier de sortir de la crise en le débarrassant « des égoïsmes nationaux ». Si nous examinons chacun des traits qui, selon les économistes, caractérisent la « mondialisation », nous constatons qu'aucun d'entre eux ne suppose un « dépassement » du chaos dans lequel se débat le marché mondial, pas plus que de la crise qui ne fait que s'aggraver. Pour commencer, les « transactions électroniques via Internet » supposent une accentuation considérable des risques d'impayés, déjà très élevé, contribuant ainsi de fait à augmenter le fardeau toujours plus insupportable de l'endettement. Quant à la « mondialisation » des marchés monétaires et financiers, nous avions déjà analysé ce qu'elle vaut : « Un krach financier est inévitable. Sous certains aspects, il est même déjà en cours. Même du point de vue du capitalisme, une forte "purge" de la "bulle spéculative" est indispensable. (...) Aujourd'hui, la bulle spéculative et, surtout, l'endettement des Etats ont augmenté de façon inouïe. Dans ces circonstances, nul ne peut prévoir où s'arrêtera la violence d'une telle purge. Mais, en tout état de cause, elle se traduira par une destruction massive de capital fictif qui jettera dans la ruine des pans entiers du capital mondial. » [2] [2567]
Ce à quoi prétend la « mondialisation » est en réalité assez différent des musiques célestes que tentent de nous vendre ses chantres. Il tente de répondre aux problèmes urgents posés par l'état actuel de la crise du capitalisme : la baisse des coûts de production ; la destruction des barrières protectionnistes pour que les capitalismes les plus compétitifs puissent profiter des marchés toujours plus réduits.
Par rapport à la baisse des coûts de production, nous avions déjà noté que : « L'intensification de la concurrence entre capitalistes, exacerbée par la crise de surproduction et la rareté des marchés solvables, pousse ceux-ci à une modernisation à outrance des processus de production, remplaçant des hommes par des machines, dans une course effrénée à la "baisse des coûts". Cette même course les conduit à déplacer une partie de la production vers des pays où la main d'oeuvre est meilleur marché (Chine et Sud-Est asiatique actuellement par exemple). » [3] [2568]
Ce second aspect de la réduction des coûts (transfert de certaines parties de la production vers des pays aux coûts salariaux moins élevés) s'est accéléré durant les années 1990. Nous voyons à présent comment les capitalistes « démocratiques » ont recours aux bons services du régime stalinien chinois pour produire à des coûts dérisoires des compacts, des chaussures de sport, des disques durs, des modems, etc. Le décollage des fameux « dragons asiatiques » est basé sur le fait que la fabrication d'ordinateurs, d'aciers ordinaires, de composants électroniques, de tissus, etc., a été déplacée vers ces paradis aux « coûts salariaux infimes ». Le capitalisme aux abois sous les coups de la crise doit profiter à fond des différences de coûts salariaux : « les coûts salariaux totaux (charges comprises) dans l'industrie des différents pays en voie de développement qui produisent et exportent des produits manufacturés mais aussi des services, varient de 3 % (Madagascar, Viet Nam) à 40 % par rapport à la moyenne des pays plus riches d'Europe. La Chine se trouve à environ 5 à16 %, et l'Inde vers 5 %. Avec l'effondrement du bloc soviétique, il existe à présent aux portes de l'Union européenne une réserve de main d'oeuvre dont le coût ne dépassera pas 5 % (Roumanie) ou 20 % (Pologne, Hongrie) par rapport aux coûts en Allemagne. » [4] [2569]
Voilà quel est le premier aspect de la « mondialisation ». Ses conséquences sont la baisse du salaire moyen mondial, mais aussi les licenciements massifs dans les grands centres industriels sans que cette réduction de postes de travail soit compensée par la création dans des proportions identiques dans les nouvelles usines ultra automatisées. Enfin, loin de remédier à la maladie chronique du capitalisme (la saturation des marchés), elle ne peut que l'aggraver en contribuant à réduire la demande dans les grands pays industrialisés sans la compenser par une croissance parallèle de la consommation dans les économies émergentes. [5] [2570]
Pour ce qui est de la destruction des barrières douanières, il est certain que la pression des « grands » a eu comme résultat que des pays comme l'Inde, le Mexique ou le Brésil révisent leurs taxes à la baisse au prix d'un endettement considérable (ces mêmes formules furent utilisées au cours des années 1970 et conduisirent à la catastrophe de la crise de l'endettement en 1982), mais le soulagement apporté à l'ensemble du capital mondial est totalement illusoire : « ... le récent effondrement financier d'un autre pays "exemplaire", le Mexique, dont la monnaie a perdu la moitié de sa valeur du jour au lendemain, qui a nécessité l'injection urgente de près de 50 millions de dollars de crédits (de très loin la plus grande opération de "sauvetage" de l'histoire du capitalisme) résume la réalité du mirage que constitue "l'émergence" de certains pays du tiers-monde. » [6] [2571]
Nous n'assistons pas, sous les effluves de l'actuelle « mondialisation », à une diminution du protectionnisme ou de l'interventionnisme de l'Etat par rapport aux échanges commerciaux, mais bien au contraire à leur amplification, tant par les moyens traditionnels que par des trouvailles récentes :
- Clinton lui-même qui, en 1995, parvint à faire en sorte que le Japon ouvre ses frontières aux produits américains, qui, sans relâche, demande à ses « associés » la « liberté de commerce », donna l'exemple dès son élection, par l'augmentation des taxes sur les avions, l'acier et les produits agricoles, limitant en outre les achats de produits étrangers aux agences étatiques ;
- le célèbre Uruguay Round, qui donna lieu à la substitution de l'ancien GATT par la nouvelle Organisation mondiale du commerce (OMC), n'a obtenu qu'un accord totalement illusoire : les taxes n'ont été éliminées que dans 10 secteurs industriels, et dans 8 autres elles ont été réduites de 30 %, mais le tout étalé sur dix ans !
- une expression massive du neo-protectionnisme se trouve dans les normes écologiques, sanitaires et même de « bien-être » ; les pays les plus industrialisés imposent des barèmes impossibles pour leurs concurrents : « ... dans la nouvelle OMC, les groupes industriels, les organisations syndicales et les militants verts luttent pour que les biens collectifs que sont le milieu ambiant, le bien-être social, etc., ainsi que leurs normes, ne soient pas régulées par le marché mais par la souveraineté nationale qui ne peut se copartager sur ce terrain. » [7] [2572].
La formation de « zones régionales » (Union européenne, accords du Sud-est asiatique, Traité de libre commerce en Amérique du Nord, etc.) ne contredit pas cette tendance, dans la mesure où elle obéit aux besoins de groupes de nations capitalistes de créer des zones protégées à partir desquelles elles peuvent affronter des rivaux plus puissants. Les USA répliquent à l'Union européenne par le Traité de libre commerce et le Japon quant à lui se fait le promoteur d'un accord des « dragons » asiatiques. Ces « groupes régionaux » tentent de se protéger de la concurrence tout en étant eux-mêmes de véritables nids de vipères où se multiplient quotidiennement les affrontements commerciaux entre partenaires. Il suffit pour s'en convaincre d'admirer le spectacle édifiant de « l'harmonieuse » Union européenne, en permanence perturbée par les sempiternels litiges entre les Quinze.
Ne nous leurrons pas, les tendances les plus aberrantes qui expriment la décomposition du marché mondial ne cessent de s'affirmer : « Aujourd'hui, l'insécurité monétaire au niveau international est devenue telle qu'on voit de plus en plus resurgir cette forme archaïque de l'échange que constitue le troc, c'est-à-dire l'échange de marchandises directement sans recours à l'intermédiaire de l'argent. » [8] [2573] Un autre type de combine auquel ont recours les Etats, y compris les plus riches, est celui de la dévaluation de la monnaie qui permet de vendre automatiquement moins cher ses propres marchandises, tout en augmentant le prix de celles des rivaux. Toutes les tentatives pour empêcher ces pratiques généralisées se sont soldées par des échecs catastrophiques comme en fait foi l'effondrement du Système monétaire européen.
La « mondialisation », une attaque idéologique contre la classe ouvrière
Nous voyons donc que le « mondialisme » est un rideau de fumée idéologique qui tente d'occulter la réalité de l'effondrement du capitalisme dans la crise généralisée et le désordre croissant qui en découle au niveau du marché mondial.
Le « mondialisme » se veut cependant plus ambitieux. Il prétend dépasser et même « détruire » (ce sont les propres mots des « mondialistes » les plus osés) l'Etat nation, rien de moins ! C'est ainsi qu'un de ses chantres prestigieux, le japonais Kenichi Ohmae, nous dit que : « ... en quelques mots, en termes de flux réel d'activité économique, les Etats-nations ont déjà perdu leur rôle d'unités significatives de participation dans l'économie sans frontières du monde actuel. » [9] [2574] Il n'hésite pas à qualifier les Etat-nations de « filtres brutaux » et nous promet le paradis de l'économie « globale » : « Au fur et à mesure qu'augmente le nombre d'individus traversant le filtre brutal qui sépare les géographies, anciennes coutumes de l'économie mondiale, le pouvoir sur l'activité économique passera inévitablement des mains des gouvernements centraux des Etats-nations vers celles des réseaux sans frontières des innombrables décisions individuelles, basées sur le marché. » [10] [2575]
Jusqu'à présent, seul le prolétariat combattait l'Etat-nation. Mais comme on le voit, l'audace des idéologues bourgeois n'a pas de limites : les voilà prétendant s'ériger en militants de la « lutte contre l'intérêt national ». Au paroxysme de l'exaltation, deux de ces représentants, adeptes de la « mondialisation », MM. Alexander King et Bertrand Schneider, intitulent leur livre « La Première révolution mondiale ».
Cependant, c'est dans le cadre de l'offensive idéologique de la bourgeoisie contre l'ensemble du prolétariat que cette « phobie » anti-nations joue son rôle le plus néfaste. Un des aspects de cette offensive est de piéger le prolétariat dans un faux dilemme :
- d'un côté, les forces politiques qui défendent de façon décidée le « mondialisme » (en Europe ce sont les partisans de Maastricht) soulignent la nécessité de « dépasser les égoïsmes nationaux rétrogrades » pour s'intégrer dans de « vastes ensembles mondiaux » permettant de sortir de la crise ;
- de l'autre, les partis de gauche (surtout quand ils sont dans l'opposition) et les syndicats cherchent à lier la défense des intérêts ouvriers à celle de l'intérêt national soi-disant piétiné par les gouvernements « traîtres à la patrie ».
Les tenants de la « mondialisation », soi-disant pourfendeurs de l'intérêt national, fulminent contre ce qu'ils appellent le « minimum social garanti », c'est-à-dire la sécurité sociale, les indemnisations de licenciement, les allocations de chômage ou de retraite, les aides à l'éducation ou au logement, le code du travail qui limite la durée de la journée de travail, les cadences, l'âge de l'embauche, etc. Voilà, selon eux, les « horribles » entraves que porte en lui l'Etat-nation, prisonnier de ces « affreux » groupes de pression constitués par les travailleurs.
Nous voici donc enfin arrivés au coeur du « mondialisme », à ce qu'il reste de lui une fois qu'on l'a dépouillé de ses oripeaux (qu'ils se nomment « dépassement de la crise » ou « internationalisme des individus libres dans un marché libre »). Il ne prétend en fin de comptes qu'à être le nouvel alibi de l'attaque qu'impose la crise du capital à tous les Etats-nations : en finir avec le « minimum social garanti », cet ensemble de prestations sociales et de législation du travail qui, avec le développement de la crise, sont devenus insupportables.
Ici intervient l'autre aspect de l'attaque idéologique de la bourgeoisie, celui qui est porté par les syndicats et la gauche. Ces dernières cinquante années, le « minimum social garanti » a été le phare de ce qu'il a été convenu d'appeler le Welfare State, qui était la façade « sociale » du capitalisme d'Etat. Face aux ouvriers, cet « Etat social » était présenté comme la manifestation de la capacité de l'exploitation capitaliste à s'adoucir, comme « la preuve » concrète qu'au sein de l'Etat national pouvaient se concilier les classes et que leurs intérêts respectifs pouvaient être pris en comptes.
Les syndicats et la gauche (en particulier quand ils sont dans l'opposition) s'affichent comme les grands défenseurs de cet « Etat social ». Ils mettent en avant le conflit entre « l'intérêt national » qui permettrait le maintien d'un « minimum social » et le « cosmopolitisme apatride » des gouvernements. C'est un des aspects qui a d'ailleurs eu un impact non négligeable dans la manoeuvre de la bourgeoisie en France pendant les luttes de l'automne 1995. Il s'agissait de présenter le mouvement comme une manifestation anti-Maastricht, une sorte de ras-le-bol général de la population contre les pénibles exigences des « critères de convergence » et ce sont les syndicats qui canalisaient ce « mouvement ».
Les contradictions de Battaglia Comunista face à la « mondialisation »
La tâche des groupes de la Gauche communiste (base du futur parti mondial du prolétariat) est de dénoncer sans concessions ce venin idéologique. Face à ces nouvelles attaques, la classe ouvrière n'a pas à choisir entre « l'intérêt national » et « le mondialisme ». Ses revendications ne se situent pas dans le camp de la défense du Welfare State, mais dans la défense intransigeante de ses intérêts de classe. La perspective de ses luttes ne se situe pas dans le faux dilemme entre le « social-patriotisme » et le « mondialisme », mais dans la destruction de l'Etat capitaliste dans tous les pays.
La question de la « mondialisation » a été traitée à maintes reprises par Battaglia Comunista (BC) qui lui a dédié plusieurs articles dans Prometeo, sa revue théorique semestrielle. BC défend avec une grande fermeté une série de positions de la Gauche communiste que nous voulons souligner :
- il dénonce sans concession la « mondialisation » comme étant une puissante attaque contre la classe ouvrière, faisant remarquer qu'elle se base « sur l'appauvrissement progressif du prolétariat mondial et le développement de la forme la plus violente de surexploitation » ; [11] [2576]
- il rejette l'idée qui affirme que la « mondialisation » est un dépassement des contradictions du capitalisme : « Il est important de souligner que les modifications les plus récentes intervenues dans le système économique mondial sont entièrement reconductibles dans le cadre du processus de concentration-centralisation, marquant certainement une nouvelle étape mais en aucun cas le dépassement des contradictions immanentes au processus d'accumulation du capital » [12] [2577] ;
- il reconnaît que les restructurations et les « innovations technologiques » introduites par le capitalisme dans les années 1980 et 1990 n'ont pas signifié une amplification du marché mondial : « (...) contrairement aux espérances, la restructuration basée sur l'introduction de technologies se substituant à la main d' oeuvre sans donner lieu à l'apparition de nouvelles activités productives compensatoires, interrompt au lieu de relancer ce que l'on appelle le "cercle vicieux" qui a été la base du puissant développement de l'économie mondiale pendant la première phase du capitalisme monopoliste. Pour la première fois, les investissements supplémentaires ont déterminé une réduction tant absolue que relative de la force de travail engagée dans le processus productif, au lieu de l'augmenter » [13] [2578] ;
- il rejette toute illusion tendant à voir la « mondialisation » comme une forme harmonieuse et ordonnée de la production mondiale, affirmant sans la moindre équivoque que « nous assistons au paradoxe d'un système qui recherche un maximum de rationalité à travers le monopole et ne parvient qu'à l'irrationalité la plus extrême : tous contre tous, chaque capital contre tous les capitaux ; le capital contre le capital » [14] [2579] ;
- il rappelle que « l'effondrement (du système capitaliste) n'est pas le résultat mathématique des contradictions du monde de l'économie, mais l'oeuvre du prolétariat qui a pris conscience que ce monde n'est pas le meilleur des mondes » [15] [2580].
Nous soutenons ces positions et partant de cet accord, nous voulons combattre quelques confusions et contradictions dont souffrent à notre avis BC. Cette polémique n'est bien sûr pas gratuite, elle a un objectif militant clair : face à l'aggravation de la crise, il est vital de dénoncer les théories fumeuses du genre « mondialisation », dont l'objectif n'est que d'embrumer la prise de conscience du fait que le capitalisme est aujourd'hui le « pire des mondes possibles » et doit être en conséquence détruit sur toute la planète.
Ce qui nous surprend tout d'abord, c'est que BC pense que « grâce aux progrès de la micro-électronique, tant en ce qui concerne les télécommunications qu'en ce qui concerne l'organisation du cycle de production, la planète s'est unifiée de fait. » [16] [2581] Les camarades se font avoir par les âneries répétées par la bourgeoisie sur le « miracle unificateur » que supposeraient les télécommunications et Internet, oubliant que « (...) d'un côté, la formation d'un marché mondial internationalise la vie économique, marquant profondément la vie de tous les peuples ; mais d'un autre côté se produit la nationalisation, toujours plus accentuée, des intérêts capitalistes, ce qui traduit de façon plus évidente l'anarchie de la concurrence capitaliste dans le cadre de l'économie mondiale et qui conduit à de violentes convulsions et catastrophes, à une immense perte d'énergie, posant ainsi impérativement le problème de l'organisation de nouvelles formes de vie sociale. » [17] [2582]
Une autre faiblesse d'analyse de BC réside dans l'étrange découverte qu'il fait selon laquelle « quand l'ancien Président des Etats-Unis, Nixon, assume la décision historique de dénoncer les accords de Bretton Woods et déclare la non-convertibilité du dollar, il était loin d'imaginer qu'il ouvrait le cours à un des plus gigantesques processus de transformation qu'ait connu le mode de production capitaliste au long de son histoire... S'ouvrait alors une période d'altérations profondes qui a changé la face du monde en moins de 20 ans et a poussé les rapports de domination impérialistes à leurs plus extrêmes conséquences. » [18] [2583]
On ne peut analyser comme cause (la fameuse décision de 1971 de déclarer la non-convertibilité du dollar) ce qui n'est qu'un effet de l'aggravation de la crise capitaliste et qui de toute façons n'a pas eu le moins du monde comme conséquence d'altérer les « rapports de domination impérialistes ». L'économisme de BC, que nous avons déjà eu l'occasion de critiquer, les pousse à attribuer des effets à un évènement qui n'a eu aucune conséquence dans la confrontation entre les blocs impérialistes existant alors (soviétique et occidental).
Cependant, le principal danger est qu'il ouvre la porte à la mystification bourgeoise selon laquelle le capitalisme actuel est à même de « changer et de se transformer ». Par le passé, BC a eu tendance à être déconcerté par chaque « transformation importante » que la bourgeoisie fait miroiter devant notre nez. Il s'est déjà laissé séduire par les « nouveautés » de la « révolution technologique », puis par le mirage des soi-disant fabuleux marchés ouverts par la « libération » des pays de l'Est. Aujourd'hui il prend pour argent comptant certaines mystifications contenues dans le vacarme sur la « mondialisation » : « L'avancée dans la centralisation de la gestion des variables économiques sur une base continentale ou par zones monétaires implique forcément une distribution différente du capital dans les divers secteurs productifs et parmi eux le secteur financier. Non seulement la petite et la moyenne entreprise, mais également les groupes de dimensions importantes risquent d'être marginalisés ou absorbés par d'autres avec toutes les conséquences que cela comporte sur le déclin de leurs positions relatives de pouvoir. Pour beaucoup de pays, cela peut comporter le risque de fracture de l'unité nationale même, comme nous le montrent les événements en Yougoslavie ou dans l'ex-bloc soviétique. Les rapports de force entre les différentes fractions de la bourgeoisie mondiale vont subir de profondes mutations et générer pour longtemps un accroissement des tensions et des conflits, avec les répercussions que cela entraîne forcément dans le processus de mondialisation de l'économie, qui pourra se voir ralenti et même bloqué. » [19] [2584].
Nous découvrons avec effarement que les tensions impérialistes, l'effondrement de nations, le conflit en Yougoslavie, ne s'expliqueraient pas par la décadence et la décomposition du capitalisme, par l'aggravation de la crise historique du système, mais qu'ils seraient des phénomènes au sein du processus de « mondialisation » ! BC glisse ici du cadre d'analyse propre à la Gauche communiste (décadence et crise historique du capitalisme) vers le cadre mystificateur de la bourgeoisie basé sur des sornettes quant à la « mondialisation ».
Il est essentiel que les groupes de la Gauche communiste ne cèdent pas à ces mystifications et maintiennent fermement la position révolutionnaire, qui affirme que dans la décadence, et plus concrètement dans la période de crise ouverte depuis la fin des années 1960, les diverses tentatives du capitalisme pour freiner son effondrement n'ont produit aucun changement réel, mais uniquement et exclusivement une aggravation et une accélération de celui-ci [20] [2585]. Dans notre réponse au BIPR dans la Revue internationale n° 82, nous affirmions clairement qu'il ne s'agit pas d'ignorer ces tentatives mais qu'il s'agit de les analyser dans le cadre des positions de la Gauche communiste et non en mordant à l'hameçon que nous tend la bourgeoisie.
La « mondialisation » et l'Etat national
C'est cependant dans sa position par rapport au rôle des Etats nationaux que les contradictions de BC ont les conséquences les plus graves. BC pense que la fameuse « mondialisation » altérerait profondément le rôle de l'Etat national et supposerait un affaiblissement de celui-ci. Il ne prétend certainement pas, bien sûr, à l'instar du samouraï Kenichi Ohmae, que l'Etat national aurait du plomb dans l'aile et il reconnaît plusieurs points que nous partageons :
- l'Etat national garde la même nature de classe ;
- l'Etat national est un facteur actif des « changements » qui interviennent sur le capitalisme actuel ;
- l'Etat national n'est pas en crise.
Cependant, il nous dit : « (...) Un des aspects certainement les plus intéressants de la mondialisation de l'économie est donné par l'intégration transversale et transnationale des grandes concentrations industrielles et financières qui, par leurs dimensions et leur pouvoir, dépassent de loin ceux des Etats nationaux. » [21] [2586]
Ce qu'on peut déduire de ces « aspects intéressants », c'est qu'il existerait dans le capitalisme des entités supérieures à l'Etat national, les fameux monopoles « transnationaux ». Ceci revient à défendre une thèse révisionniste qui nie le principe marxiste selon lequel l'unité suprême du capitalisme est l'Etat, le capital national. Le capitalisme ne peut jamais réellement dépasser le cadre de la nation, et encore moins être internationaliste. Son « internationalisme », comme nous l'avons vu, se résume à la prétention de dominer les nations rivales ou à conquérir la plus grande part possible du marché mondial.
Dans l'éditorial de Prometeo n° 9 se confirme cette révision du marxisme : « Les multinationales productives et/ou financières dépassent par leur puissance et par les intérêts économiques qui sont en jeu les diverses formations étatiques qu'elles traversent. Le fait que les banques centrales des divers Etats soient incapables de régir ou de tenir tête à la vague spéculative qu'une poignée de monstrueux groupes financiers déchaînent quotidiennement en dit long sur la profonde transformation des relations entres Etats. »
Faut-il rappeler que ces pauvres Etats impuissants sont précisément ceux qui possèdent (ou pour le moins contrôlent étroitement) ces mastodontes de la finance ? Est-il nécessaire de révéler à BC que cette « poignée de monstres » est constituée par de « respectables » institutions bancaires et d'épargne dont les responsables sont directement ou indirectement nommés par leurs états nationaux respectifs ?
Non seulement BC mord à l'hameçon de cette prétendue opposition entre Etats et multinationales, mais il va plus loin et découvre que « pour ces raisons, des capitaux toujours plus énormes... ont donné naissance à des colosses qui contrôlent toute l'économie mondiale. Il suffit de penser qu'alors que des années 30 aux années 70 les Big Three étaient trois fabriquants d'automobiles (General Motors, Chrysler et Ford), ce sont aujourd'hui trois Fonds d'investissements également américains : Fidelity Investments, Vanguard Group, Capital Research & Management. Le pouvoir accumulé par ces sociétés financières est immense et dépasse de loin celui des Etats qui, de fait, ont perdu ces dix dernières années toute capacité de contrôle sur l'économie mondiale. » [22] [2587]
Rappelons que pendant les années 1970, le mythe des fameuses multinationales du pétrole était très à la mode. Les gauchistes nous répétaient alors que le capital était « transnational », et c'est pourquoi la « grande revendication » des ouvriers devait être de défendre les intérêts nationaux contre cette « poignée d'apatrides ».
Il est certain que BC rejette avec force cette mystification, mais il admet cependant sa justification « théorique », c'est-à-dire qu'il reconnaît la possibilité d'une opposition ou, du moins, de divergences d'intérêts fondamentaux entre l'Etat et les monopoles « transversaux aux Etats nationaux » (c'est sa définition).
Les multinationales sont des instruments de leurs Etats nationaux. IBM, General Motors, Exxon, etc., sont tenues par toute une série de réseaux par l'Etat américain : un pourcentage important de leur production (40 % pour IBM) est acheté directement par celui-ci, qui influe directement ou indirectement dans la nomination des directeurs [23] [2588]. Une copie de chaque nouveau produit informatique est obligatoirement transmise au Pentagone.
C'est incroyable que BC avale le mensonge du super-pouvoir mondial qui serait constitué par... les trois Fonds d'investissements ! Premièrement les sociétés de fonds d'investissements ne disposent pas réellement d'une autonomie, elles ne sont que des instruments des banques, des caisses d'épargne ou d'institutions étatiques telles que les syndicats, les mutuelles, etc. Leur chef direct ou indirect est leur Etat national respectif. Deuxièmement ils sont soumis à une stricte réglementation de la part de l'Etat qui leur fixe les pourcentages qu'ils doivent investir en actions, obligations, bons du Trésor, à l'étranger, etc.
« Mondialisation » et capitalisme d'Etat
Ceci nous amène à une question essentielle, celle du capitalisme d'Etat. Un des traits essentiels du capitalisme décadent réside dans la concentration nationale du capital entre les mains de l'Etat qui devient l'entité autour de laquelle chaque capital national organise son combat, tant contre le prolétariat que contre les autres capitaux nationaux.
Les Etats ne sont pas des instruments des entreprises, aussi grandes soient-elles ; c'est exactement le contraire qui se vérifie dans le capitalisme décadent : les grands monopoles les banques, etc., se soumettent aux diktats de l'Etat et servent le plus fidèlement possible ses orientations. L'existence dans le capitalisme de pouvoirs supranationaux qui « traversent » les Etats et leur dictent la politique à suivre est impossible. Bien au contraire les multinationales sont utilisées par leur Etat respectif comme instrument au service de ses intérêts commerciaux et impérialistes.
Nous ne voulons pas le moins du monde dire que les grandes entreprises, du genre Ford ou Exxon, ne sont que de simples marionnettes de leur Etat respectif. Elles tentent bien sûr de défendre leurs propres intérêts particuliers qui, parfois, entrent en contradiction avec celui de leur Etat national. Cependant une réelle fusion entre le capital privé et l'Etat se réalise dans le capitalisme d'Etat « à l'occidentale », de sorte que globalement, au-delà des conflits et contradictions qui surgissent, ils agissent en cohérence dans la défense de l'intérêt national du capital et sous l'égide totalitaire de leur Etat.
BC objecte qu'il est difficile de savoir à quel Etat appartient Shell, par exemple (au capital anglo-hollandais) ou d'autres multinationales dont l'actionnariat est multiple. Outre qu'il ne s'agit là que d'exemples exceptionnels, nullement significatifs de la réalité mondiale du capital, il faut ajouter que les titres de propriété ne déterminent pas la véritable propriété d'une entreprise. Dans le capitalisme d'Etat, c'est l'Etat qui dirige et détermine le fonctionnement des entreprises, même quand il n'en détient aucune action. C'est lui qui réglemente les prix, les conventions collectives, les taux d'exportation, les taux de production, etc. C'est lui qui conditionne les ventes de l'entreprise en étant, dans la majorité des secteurs productifs, le principal client. C'est lui qui, à travers la politique fiscale, monétaire, de crédit, affiche clairement sa poigne et régit l'évolution du « libre marché ». BC ne prend pas en compte cet aspect essentiel de l'analyse révolutionnaire sur la décadence du capitalisme. Il préfère rester fidèle à un aspect partiel de l'effort de Lénine et des révolutionnaires de cette époque pour comprendre toute l'ampleur de la question de l'impérialisme : la théorie de Lénine sur le capital financier, reprise de Hilferding. Dans son livre sur l'impérialisme, Lénine voit clairement celui-ci comme la période décadente du capitalisme qui met à l'ordre du jour la nécessité de la révolution prolétarienne. Mais il lie cette époque au développement du capital financier comme monstre parasite émergeant du processus de concentration du capital, comme nouvelle phase du développement des monopoles.
Cependant, « (...) de nombreux aspects de la définition de Lénine de l'impérialisme sont inadéquats aujourd'hui, et même au temps où il les avait élaborés. C'est ainsi que la période où le capital semblait être dominé par une oligarchie du "capital financier" et par des "groupements de monopoles internationaux" ouvrait déjà la voie à une nouvelle phase pendant la première guerre mondiale, l'ère du capitalisme d'Etat, de l'économie de guerre permanente. A l'époque des rivalités inter-impérialistes chroniques sur le marché mondial, le capital tout entier tend à se concentrer autour de l'appareil d'Etat qui subordonne et discipline toutes les fractions particulières du capital aux besoins de survie militaire/économique. » [24] [2589].
Ce qui chez Lénine était une erreur liée au difficile processus de compréhension de l'impérialisme devient une dangereuse aberration entre les mains de BC. Premièrement, la théorie de la « concentration en super monopoles transnationaux » ferme la porte à la position marxiste sur la concentration nationale du capital au sein de l'Etat, la tendance au capitalisme d'Etat, à laquelle participent toutes les fractions de la bourgeoisie quels que soient les liens et ramifications à l'échelle internationale. Deuxièmement cette théorie entrouvre la porte à la théorie kautskiste du « super-impérialisme ». Il est surprenant que BC critique cette théorie simplement sur l'impossibilité de dépasser l'anarchie du capital sans la critiquer sur l'essentiel : une illusoire possibilité du capital de s'unir par dessus les frontières nationales. Et cette difficulté provient du fait que BC, s'il rejette avec raison la thèse extrême de la « fusion de nations », admet cependant à tort l'existence d'unités supranationales. Troisièmement BC développe des spéculations selon lesquelles l'Etat, dans le cadre de la « mondialisation » aurait deux dimensions, l'une au service des intérêts multi-nationaux et l'autre, qui lui est subordonnée, au service d'intérêts nationaux : « Il se précise de façon toujours plus évidente un Etat dont l'intervention s'articule dans le monde de l'économie à deux niveaux : un qui offre au centre supranational la gestion centralisée de la masse monétaire et la détermination des variables macro-économiques par zone monétaire de référence, et un autre qui contrôle localement la compatibilité de celui-ci avec les variables nationales. » [25] [2590] BC met le monde à l'envers ! La simple observation de l'évolution de l'Union européenne démontre tout le contraire : l'Etat national gère les intérêts du capital national et n'est en aucune façon une sorte de « délégation » de l'intérêt « européen » comme le laissent entendre les ambiguïtés de BC. Chevauchant la théorie de la spéculation sur les intérêts « transnationaux », il est amené à tirer des conclusions incroyables : les conflits impérialistes n'auraient pas dégénéré en guerre impérialiste généralisée parce que, « (...) une fois disparue la confrontation entre bloc de l'Ouest et bloc de l'Est par implosion de ce dernier, les fondements d'une nouvelle confrontation stratégique ne se sont pas précisés avec clarté. Les intérêts stratégiques des grands et véritables centres du pouvoir économique ne se sont jusqu'à présent pas exprimés en confrontation stratégique entre Etats, parce qu'ils agissent transversalement à ceux-ci. » [26] [2591]
Ceci est une confusion très grave. La guerre impérialiste ne serait plus la confrontation entre capitaux nationaux armés jusqu'aux dents (comme le définissait Lénine), mais le résultat de confrontations entre groupes transnationaux qui utiliseraient les Etats nationaux. Ceux-ci ne seraient plus le centre et les responsables de la guerre mais de simples agents des monstres transnationaux qui « les traverseraient ». Heureusement, BC ne tire pas toutes les conclusions de cette aberration. Heureusement, parce que cela le conduirait à dire que la lutte du prolétariat contre la guerre impérialiste ne serait plus la lutte contre les Etats nationaux mais la lutte pour « libérer » ces derniers de l'emprise des intérêts transnationaux. En d'autres termes, on en viendrait aux vulgaires mystifications gauchistes. Il faut être sérieux, BC doit être cohérent avec les positions de la Gauche communiste. Il doit faire la critique systématique de ses spéculations sur les monopoles et les monstres financiers. Il doit radicalement éliminer de ses mots d'ordre des aberrations telles que « une nouvelle ère caractérisée par la dictature du marché financier s'inaugure » (Prometeo n° 9). Ces faiblesses prêtent le flanc à la pénétration des mystifications bourgeoises telles que la « mondialisation » ainsi que les prétendues oppositions entre intérêts nationaux et intérêts transnationaux, entre Maastricht et intérêts populaires, entre le Traité de libre commerce et les intérêts des peuples opprimés.
Cela peut conduire BC à défendre certaines thèses et mystifications de la classe dominante, donc à participer à l'affaiblissement de la conscience et du combat de la classe ouvrière. Ce n'est sûrement pas le rôle que doit jouer une organisation révolutionnaire du prolétariat.
Adalen, 5 juin 1996.
[2] [2593] « Tourmente financière : la folie ? », Revue internationale n° 81, 2e trim.1995.
[3] [2594] « Le cynisme de la bourgeoisie décadente », Revue internationale n° 78, 3e trim.1994.
[4] [2595] Annuaire du Monde 1996, « Resituation, emploi et inégalité ».
[5] [2596] « Ce développement économique ne peut qu'affecter à terme la production des pays les plus industrialisés, dont les Etats s'indignent des pratiques commerciales "déloyales" de ces économies émergentes » (« Résolution sur la situation internationale », Revue internationale n° 82, 3e trim.1995).
[6] [2597] Idem.
[7] [2598] Annuaire du Monde 1996, « Ce qui va changer avec l'OMC ».
[8] [2599] « Une économie rongée par la décomposition », Revue internationale n° 75, 4e trim.1993.
[9] [2600] K. Ohmae, « Le Déploiement des économies régionales ».
[10] [2601] Idem.
[11] [2602] Prometeo, n° 9, « Le capital contre le capital ».
[12] [2603] Idem.
[13] [2604] Idem.
[14] [2605] Idem.
[15] [2606] Idem.
[16] [2607] Idem.
[17] [2608] Boukharine, « L'Economie mondiale et l'impérialisme ».
[18] [2609] Prometeo, no 9, « Le capital contre le capital ».
[19] [2610] Prometeo no 10, « L'Etat à deux dimensions : la mondialisation de l'économie et l'Etat ».
[20] [2611] L'incohérence navrante de BC apparaît au grand jour quand il nous dit que « (...) en réalité, le capitalisme est toujours égal à lui-même et il ne fait rien d'autre que de se réorganiser par auto-conservation selon la ligne du développement de la loi de la baisse tendancielle du taux de profit. » (Prometeo, n° 9)
[21] [2612] Prometeo n° 10, « L'Etat à deux dimensions : la mondialisation de l'économie et l'Etat ».
[22] [2613] Idem.
[23] [2614] Beaucoup d'hommes politiques américains, après avoir occupé divers postes au Sénat ou dans l'administration, deviennent dirigeants de grandes multinationales ; c'est devenu une pratique courante, qui se vérifie aussi en Europe.
[25] [2616] Prometeo n° 10, « L'Etat à deux dimensions : la mondialisation de l'économie et l'Etat ».
Récent et en cours:
- Crise économique [28]
Courants politiques:
- Battaglia Comunista [66]
Le communisme n'est pas un bel idéal mais une nécessité matérielle [14° partie]
- 4491 reads
LA TRANSFORMATION DU TRAVAIL
SELON LES REVOLUTIONNAIRES DE LA FIN DU 19e SIECLE
Dans le dernier article de cette série, nous avons montré comment les socialistes authentiques de la fin du 19e siècle envisageaient la façon dont la future société communiste s'attaquerait à certains des problèmes sociaux les plus pressants de l'humanité : les rapports entre hommes et femmes, et entre l'humanité et la nature dont elle a surgi. Dans ce numéro, nous examinons comment les révolutionnaires de la fin du 19e siècle prévoyaient la plus cruciale de toutes les transformations, la transformation du « travail inutile » en « travail utile » c'est-à-dire le dépassement pratique du travail aliéné. Ce faisant nous répondons à l'accusation que ces visions du socialisme représentaient une rechute dans l'utopisme pré-marxiste.
Dans un Londres du futur, bien des choses ont été démantelées puis rétablies ailleurs: on peut aller de Kensington à Trafalgar Square par un chemin boisé. Mais certains édifices familiers sont toujours là : les vieilles Houses of Parliament, principalement utilisées aujourd'hui pour engranger du fumier, et le British Museum qui conserve encore la plupart de ses anciennes fonctions. C'est là que William Guest, voyageur dans le temps du 19e siècle, a rencontré le vieux Hammond, un ancien bibliothécaire ayant une connaissance approfondie de l'histoire et donc bien placé pour expliquer le fonctionnement d'une société communiste instaurée depuis plusieurs siècles. Après avoir discuté plusieurs aspects de « l'administration des choses », ils en arrivent à la question du travail :
« "L'homme du 19e siècle dirait qu'il existe un désir naturel de procréer et d'avoir des enfants, et un désir naturel de ne pas travailler. "
"Oui, oui" dit Hammond'je connais ces vieilles platitudes - totalement fausses ; et qui n'ont en fait aucun sens pour nous. Fourier dont tout le monde se moquait, comprenait bien mieux la question. "
'Pourquoi cela n’ a-t-il aucun sens pour vous ?"demandais-je.
II répondit: 'parce que cela implique que tout travail est souffrance, et nous sommes si loin de le penser, comme tu l'as peut-être remarqué, que, comme nous ne sommes pas à court de richesses, il y a une sorte de peur qui se développe chez nous d'être un jour à court de travail. C'est un plaisir que nous avons peur de perdre, pas un fardeau. "
"Oui", dis-je, j'ai noté cela et je voulais te poser des questions là-dessus aussi. Mais auparavant, que veux-tu dire en positif quand tu affirmes la notion de plaisir dans le travail chez vous ?"
"Ceci que tout travail est maintenant un plaisir; soit à cause de l'espoir dans lequel il est accompli, de gagner en honneur et en richesses, ce qui provoque une excitation agréable même si le travail lui-même ne l'est pas ; soit parce qu'il est devenu une habitude plaisante comme c'est le cas avec ce que tu peux appeler le travail mécanique ; et finalement (et la plus grande partie de notre travail est dans ce cas) parce qu'il y a un plaisir sensuel conscient dans le travail lui-même ; c'est à dire qu'il est fait par des artistes. "
"Je vois", dis-je. 'Peux-tu maintenant nie dire comment vous êtes arrivés à cette condition heureuse ? Car, pour parler simplement, ce changement par rapport aux conditions du vieux monde me semble bien plus grand et bien plus important que tous les autres changements dont tu mas parlé concernant le crime, la politique, la propriété, le mariage. "
"Tu as raison" , me dit-il. "En fait on peut même dire que c'est ce changement qui a rendu possible tous les autres. Quel est l'objet de la révolution ? Certainement le bonheur des gens. La révolution ayant opéré son changement, comment peut-on empêcher la contre-révolution de s'établir sinon e» rendant les gens heureux ? Quoi ! Attendrons-nous la paix et la stabilité du malheur ?... Et le bonheur sans travail quotidien heureux est impossible. " u
C'est ainsi que William Morris, dans son roman visionnaire Nouvelles de nulle part ([1] [2618]), cherche à décrire l'attitude qui pourrait exister envers le travail dans me société communiste développée. La forme poétique de sa description ne doit pas nous aveugler car il ne fait que défendre ici un postulat fondamental du marxisme. Comme on l'a montré dans de précédents articles de cette série ([2] [2619]), le marxisme commence par la compréhension que le travail est » l'acte d'autogenèse de l’homme » comme l'écrit Marx dans les Manuscrits économiques et philosophiques où il porte cette découverte au crédit de Hegel, même si ce dernier l'a faite de façon formelle et abstraite. En 1876, Engels utilisait les découvertes les plus récentes en anthropologie et confirmait que « le travail a créé l’homme lui-même » ([3] [2620]). La puissance du cerveau humain, la dextérité de la main humaine, le langage, et la conscience spécifiquement humaine de soi et du monde sont nés du processus de fabrication des outils et de transformation de l'environnement extérieur ; bref, du travail qui constitue l'acte d'un être social travaillant collectivement. Cette approche dialectique des origines humaines que seule une classe travailleuse peut défendre de façon cohérente, s'oppose à la fois à la vision idéaliste (l'humanité en tant que produit d'un être supranaturel extérieur, ou de ses propres pouvoirs intellectuels conçus séparément de sa pratique), et à la vision matérialiste vulgaire qui réduit l'intelligence humaine à des facteurs purement mécaniques (la taille du cerveau par exemple).
Mais Marx a aussi critiqué Hegel parce qu' « il ne voit que le côté positif du travail, non son côté négatif. Le travail est le devenir pour soi de l’homme à l'intérieur de l'aliénation, ou bien en tant qu'être aliéné » ([4] [2621]). Dans des conditions de pénurie matérielle, et en particulier de domination de classe, le travail qui crée et reproduit l'homme, a aussi eu pour résultat que les pouvoirs propres de l'homme échappent à son contrôle et le dominent. Engels confirme encore ce point de vue dans « La part jouée par le travail », montrant que, malgré la capacité, unique, de l'homme à donner un but à son action et la planifier, les conditions matérielles dans lesquelles il a travaillé jusqu’ici, ont amené à des résultats très différents de ce qu'il prévoyait. Dans ce texte, Engels traite la dimension de l'aliénation quand il se réfère aux catastrophes écologiques des civilisations passées mais aussi à l'émergence de la religion, « ce reflet fantastique des choses humaines dans l'esprit humain ».
L'aliénation de l’homme envers lui-même se situe d'abord et avant tout dans la sphère où il se crée lui-même, la sphère du travail. Le dépassement de l'aliénation du travail constitue donc la clé du dépassement de toutes les aliénations qui tourmentent l'humanité, et il ne peut y avoir de transformation réelle des rapports sociaux - que ce soit la création de nouveaux rapports entre les sexes, ou une nouvelle dynamique entre 1’homme et la nature - sans transformation du travail aliéné en une activité créative agréable. Le vieil Hammond se situe donc aux côtés de Marx -qui lui aussi défendait Fourier sur cette question - quand il insiste sur le fait qu'il n'y a pas de bonheur possible sans travail quotidien heureux.
Le communisme n'est pas l’ « anti-travail »
Certaines sectes modernistes, comme le Groupe Communiste Internationaliste qui aime étaler sa connaissance de Marx, ont utilisé la critique du travail aliéné pour en déduire que le communisme signifie non seulement l'abolition du travail salarié - dernière forme du travail aliéné dans l'histoire - mais aussi celle du travail tout court. De telles attitudes envers le travail sont typiques de la petite-bourgeoise qui se désintègre et des éléments déclassés qui considèrent les ouvriers comme de simples esclaves et pensent que le « refus » individuel « du travail » constitue un acte révolutionnaire. De tels points de vue ont en fait toujours été utilisés pour discréditer le communisme. Bebel a répondu à cette accusation dans La femme et le socialisme quand il souligne que le véritable point de départ de la transformation socialiste n'est pas l'abolition immédiate du travail, mais l'obligation universelle de travailler :
« La société une fois en possession de tous les moyens de production, niais la satisfaction des besoins n'étant possible qu'avec l'apport d'un travail correspondant, et nul être valide et capable de travailler n'avant le droit de demander qu'un autre travaille pour lui, la première loi, la loi fondamentale de la société socialisée, est que l'égalité dans le travail doit s'imposer à tous, sans distinction de sexe. L'allégation de certains de nos adversaires malveillants qui prétendent que les socialistes ne veulent pas travailler et cherchent même autant que possible à supprimer le travail - ce qui est un non-sens -, se retourne contre eux-mêmes. Il ne peut y avoir de paresseux que là où d'autres travaillent pour eux. Ce bel état de choses existe à l’ heure actuelle, et même presque exclusivement, au profit des adversaires les plus acharnés des socialistes. Ces derniers posent en principe : "Qui ne travaille pas ne doit pas manger". Mais le travail ne doit pas être du travail seul, c'est-à dire de la simple dépense d'activité : il doit être aussi du travail utile et productif. La société nouvelle demande donc que chacun prenne une fonction donnée, industrielle, professionnelle ou agricole, qui lui permette d'aider à créer la quantité de produits nécessaires à la satisfaction des besoins courants. Pas de jouissance sans travail, pas de travail sans jouissance. » ([5] [2622])
De ce que dit Bebel, il découle que, dans les premières étapes de la révolution, l'obligation universelle du travail contient un élément de contrainte. Le prolétariat au pouvoir comptera certainement d'abord et avant tout sur l'enthousiasme et la participation active de la masse de la classe ouvrière qui sera la première à voir qu'elle ne peut se débarrasser de l'esclavage salarié que si elle est prête à travailler en commun pour produire et distribuer les biens vitaux. Dans cette phase du processus révolutionnaire, le travail trouve déjà sa contrepartie en ce qu'il est immédiatement vu comme socialement utile - du travail pour un bienfait commun réel et observable et non pour les besoins inhumains du marché et du profit. Dans ces circonstances, même le travail le plus dur prend un caractère libérateur et humain puisque « dans l'utilisation et la jouissance que tu as de mon produit, j'aurais la satisfaction immédiate et la connaissance que par mon travail, j'ai gratifié un besoin humain... Dans 1’ expression individuelle de nia propre vie, j'aurais provoqué l'expression immédiate de ta vie, et ainsi, dans mon activité individuelle, j'aurais directement confirmé et réalisé ma nature authentique, ma nature humaine, communautaire. » ([6] [2623])
Néanmoins, ce soulèvement politique et social gigantesque requerra inévitablement d'abord de très grands sacrifices, et les seuls sentiments ne suffiront pas à convaincre ceux qui sont habitués à l'oisiveté et à vivre du labeur des autres, de se soumettre volontairement à la rigueur et à la discipline du travail associé. L'utilisation de la contrainte économique - celui qui ne travaille pas, ne mange pas - constitue donc une arme nécessaire de la dictature du prolétariat. Ce n'est que dans une société socialiste plus développée qu'il deviendra clair et évident pour tout le monde que c'est dans l'intérêt de chaque individu de prendre pleinement sa pari à la production sociale.
En même temps, ce n'est pas du tout le but du mouvement communiste d'en rester à un stade où la seule contrepartie du travail est qu'il bénéficie à quelqu'un d'autre. S'il ne devient pas un plaisir en lui-même, la contre-révolution s'établira, et les sacrifices volontaires du prolétariat à la cause commune, deviendront des sacrifices pour une cause étrangère - comme en témoigne la tragédie de la défaite de la révolution russe. C'est pourquoi Bebel ajoute, immédiatement après le passage cité ci-dessus :
« Mais, dès lors que tous sont astreints au travail, toits ont aussi le même intérêt à réaliser dans celui-ci trois conditions : I ° qu'il soit modéré, ne surmène personne et ne s'étende pas trop en durée ; 2° qu'il soit aussi agréable et aussi varié que possible ; 3° qu'il soit rémunérateur autant qu'il se pourra, car de là dépend la mesure du bienêtre. » ([7] [2624])
William Morris donne une définition à trois volets très similaire quand il fait la distinction entre le « travail utile « et le « labeur inutile »:
« Alors quelle est la différence entre eux ? Celle-ci : l’une contient l'espoir, l'autre non... Quelle est pour Pions la nature de l'espoir qui fait, lorsqu'il est présent dans le travail, que ce dernier en vaut la peine ?
Je pense qu'il contient trois aspects : l'espoir de repos, l'espoir du produit, l'espoir du plaisir dans le travail lui-même ; et aussi l'espoir de tout ça avec une certaine abondance et de bonne qualité ; assez de repos et un produit assez bon pour que ça vaille le coup de l'avoir; un produit qui vaut la peine pour quelqu'un qui n'est ni un fou, ni un ascète ; assez de plaisir pour que chacun le ressente en travaillant. » ([8] [2625])
L'espoir de repos
Dans la définition par Morris du travail utile qu'on vient de citer et dans les trois conditions de Bebel pour que le travail soit agréable, l'élément de repos, de loisir et de détente, est élaboré très concrètement : ils insistent sur la possibilité de réduire la journée de travail à une fraction de ce qu'elle était alors (et est toujours). C'est parce que, face à une société capitaliste qui vole les meilleures heures, les meilleurs jours et les meilleures années de la vie de l'ouvrier, les révolutionnaires ont le devoir élémentaire de démontrer que le développement même de la machine capitaliste a rendu ce vol historiquement injustifiable. C'est aussi le thème de la brochure sardonique de Paul Lafargue Le droit à la paresse, publiée en 1883. A l'époque, il était déjà plus qu'évident qu'une des contradictions les plus frappantes dans le développement de la technologie du capitalisme, c'était que tout en créant la possibilité de libérer l'ouvrier des pénibles labeurs, il ne semblait être utilisé que pour l'exploiter plus intensivement que jamais. La raison en était simple : sous le capitalisme, la technologie n'est pas développée au bénéfice de l’humanité, mais pour les besoins du capital :
«Notre époque a inventé des machines qui seraient apparues comme des rêves fous aux hommes des temps passés, et de ces machines, nous n’avons pas encore fait usage.
Elles s’appellent des machines qui "économisent du travail" - une formule communément utilisée et qui indique ce qu'on attend d'elles ; mais nous n'obtenons pas ce que trous attendons. Ce qu'elles font véritablement, c'est de ramener le travailleur qualifié au rang d'ouvrier non qualifié, d'accroître la masse de "l'armée de réserve du travail" - c'est-à-dire d'accroître la précarité de la vie des ouvriers et d'intensifier le travail de ceux qui servent les machines (comme les esclaves servent leurs maîtres). C'est ça qu'elles font en fait, tout en accumulant les profits des employeurs du travail, ou en forçant ceux-ci à dépenser ces profits dans une guerre commerciale féroce entre eux. Dans une vraie société, ces miracles d'ingéniosité seraient utilisés pour la première fois pour diminuer le temps passé dans un travail déplaisant qui pourrait, grâce à eux, être si réduit qu'il pèse à peine sur chaque individu. De plus, toutes ces machines seraient certainement très améliorées une fois que la question ne serait plus que les améliorations 'paient" l'individu, mais bénéficient à la communauté. » ([9] [2626])
Dans le même ordre d'idées, Bebel cite les calculs des scientifiques bourgeois contemporains qui montrent qu'avec la technologie existant déjà à son époque, la journée de travail pouvait être réduite à une heure et demie par jour! Bebel était particulièrement optimiste sur les possibilités qu'ouvrait le développement de la technologie dans cette période d’expansion capitaliste sensationnelle. Mais cet optimisme n'était pas une apologie en blanc du progrès capitaliste. Ecrivant sur l'énorme potentiel contenu dans l'application de l'électricité, il défendait aussi que « cette force naturelle n'atteindra son maximum d'utilisation et d'application que dans la société socialisée » ([10] [2627]). Même si aujourd'hui le capitalisme a « électrifié » la plus grande part (bien que pas la totalité) de la planète, on saisit la pleine signification de l'application de Bebel quand un peu plus loin, il remarque que « tous nos cours d'eau, le flux et le reflux de la mer, le vent, la lumière du soleil, convenablement utilisés fournissent d'innombrables chevaux-vapeurs» ([11] [2628]). Les méthodes que le capitalisme a adoptées pour fournir l'électricité -brûler du pétrole et l'énergie nucléaire ont amené de nombreux effets secondaires nuisibles, notamment sous forme de pollution, tandis que les besoins du profit ont amené à négliger le « nettoyage » ainsi que des sources plus abondantes telles que le vent, les marées et le soleil.
Mais pour ces socialistes, la réduction du temps de travail n'était pas seulement le résultat de l'utilisation rationnelle des machines. Elle était également rendue possible par l'élimination du gigantesque gaspillage de force de travail, inhérent au mode de production capitaliste. Dès 1845, Engels dans l'un des ses « Discours d'Eberfeld » a attiré l'attention là-dessus, montrant la façon dont le capitalisme ne pouvait éviter de gaspiller les ressources humaines puisqu'il emploie des hommes d'affaires et des intermédiaires financiers, des policiers, des gardiens de prison pour s'occuper des crimes qu'il engendre inévitablement chez les pauvres, des soldats et des marins pour mener ses guerres, et par dessus tout par le chômage forcé de millions de travailleurs à qui l'accès à tout travail productif est fermé à cause des mécanismes de la crise économique. Les socialistes de la fin du 19e siècle n'étaient pas moins frappés par ce gaspillage et montraient le lien entre le dépassement de celui-ci et la fin de l'exploitation du prolétariat:
« Telles que sont les choses aujourd'hui, entre le gaspillage de force de travail dans la simple oisiveté, et son gaspillage dans le travail improductif, il est clair que le monde civilisé n'est pris en charge que par une petite partie de sa population ; si tout le monde travaillait pour lui, la part de travail que chacun devrait accomplir, serait bien plus petite avec un niveau de vie sur le pied de ce que les gens bien et raffinés pensent aujourd'hui désirable. » ([12] [2629])
De tels sentiments sont plus vrais que jamais aujourd'hui, dans un capitalisme décadent où la production improductive (armement, bureaucratie, publicité, spéculation, drogue, etc.) a atteint des proportions sans précédent et où le chômage massif est devenu un fait permanent de la vie, tandis que la journée de travail est, pour la majorité des ouvriers actifs, plus longue qu'elle ne l'était pour leurs ancêtres victoriens. De telles contradictions offrent la preuve la plus frappante de l'absurdité qu'est devenu le capitalisme et donc de la nécessité de la révolution communiste.
L'espoir de plaisir dans le travail lui-même
Décrivant les plaisirs du travail à son visiteur du 19e siècle, le vieil Hammond n'a pas beaucoup insisté sur le besoin de repos et de loisir, et pourtant le sous-titre du roman est « Une époque de repos ». Evidemment, après plusieurs générations, la séparation rigide entre « le temps libre » et « le temps de travail » a été dépassée comme Marx l'a prévu. Car le but de la révolution n'est pas seulement de libérer les êtres humains du travail désagréable: « le travail doit aussi être rendu agréable » comme le dit Bebel. Il élabore alors certaines conditions pour que ce soit le cas, et sur chaque point Morris s'en fait l'écho.
La première condition est que le travail se déroule dans un environnement agréable:
« Pour cela, il faut construire de beaux ateliers, installés d'une façon pratique, mettre le plus possible d’ ouvrier à l’abri de tout danger, supprimer les odeurs désagréables, les vapeurs, la fumée, en un mot tout ce qui peut causer du malaise ou de la fatigue.
Au début, la société nouvelle produira avec ses anciennes ressources et le vieil outillage dont elle aura pris possession. Mais, si perfectionnés qu'ils paraissent , ceux-ci seront insuffisants pour le nouvel ordre de choses. Un grand nombre d'ateliers, de machines, d'outils disséminés et à tous égards insuffisants, depuis les plus primitifs jusqu'aux plus perfectionnés, ne seront plus en rapport ni avec le nombre des individus qui demanderont du travail, ni avec ce qu'ils exigeront d'agrément et de commodité.
Ce qui s'impose donc de la manière la plus urgente, c'est la création d'un grand nombre d'ateliers vastes, bien éclairés, bien aérés, installés de la façon la plus parfaite, et bien décorés. L'art, la science, l'imagination, l'habileté manuelle trouveront ainsi un vaste champ ouvert à leur activité. Tous les métiers qui ont trait à la construction des machines, à la fabrication des outils, à l'architecture, tous ceux qui touchent à l'aménagement intérieur pourront se donner largement carrière. » ([13] [2630])
Pour Morris, l'activité productive pourrait avoir lieu dans toutes sortes d'environnement, mais il défend qu'une certaine sorte de système d'usine « offrirait des occasions à une vie sociale pleine et ardente entourée de beaucoup de plaisirs. Les usines pourraient aussi être (les centres d'activité intellectuelle » où « le travail pourrait varier de la culture de lu campagne environnante pour la nourriture jusqu'à l'étude et à la pratique de l art et de la science ». Naturellement, Morris se préoccupe aussi du fait que ces usines du futur ne soient pas seulement propres et non polluées, mais également des constructions esthétiques en elles-mêmes : « en commençant parfaire de leurs usines des constructions et des ateliers décents et convenables comme leurs maisons, ils arriveront infailliblement à en faire non pas quelque chose de négativement bien, de simplement inoffensif mais quelque chose de beau, de sorte que le glorieux art de l'architecture, aujourd'hui anéanti par l'avidité commerciale, renaîtra et fleurira. » ([14] [2631])
L'usine est souvent décrite dans la tradition marxiste connue un véritable enfer sur terre. Et ceci n'est pas seulement vrai de celles qu'il est respectable d'abhorrer - celles des jours sombres et lointains de la « révolution industrielle » dont les excès sont admis - mais également de l'usine moderne à l'époque de la démocratie et de l’Etat-providence. Mais pour le marxisme, l'usine est plus que cela : c'est le lieu où les travailleurs associés se retrouvent, travaillent ensemble, luttent ensemble, et elle constitue donc une indication sur les possibilités de l'association communiste du futur. En conséquence, à l'encontre du préjugé anarchiste contre l'usine en tant que telle, les marxistes de la fin du 19e siècle avaient tout-à-fait raison d'envisager une usine du futur, transformée en centre l’apprentissage, d'expérimentation et de création.
Pour que ce soit possible, il est évident que l’ancienne division capitaliste du travail, sa manière de réduire quasiment tous les travaux à une routine répétitive qui engourdit l'esprit, doivent être supprimées aussi vite que possible. « Contraindre un homme à accomplir, jour après jour, la même tâche, sans aucun espoir d y échapper ou de changer, ne signifie rien d'autre que de faire de sa vie une prison de tourment. » ([15] [2632]) Aussi nos écrivains socialistes, suivant une fois encore Marx, insistent sur le fait que le travail soit varié, qu'il change et ne soit plus paralysé par la séparation rigide entre l'activité mentale et l'activité physique. Mais la variété qu'ils proposaient - basée sur l'acquisition de différentes qualifications, sur un équilibre approprié entre l'activité intellectuelle et l'exercice physique - constituait bien plus qu'une simple négation de la sur spécialisation capitaliste, plus qu'une simple distraction vis-à-vis de l'ennui de cette dernière. Elle voulait dire le développement d'une nouvelle sorte d'activité humaine dans le sens plein, qui soit en fin de compte conforme aux besoins les plus profonds du genre humain:
« Le besoin de liberté dans le choix et le changement d'occupation est profondément enraciné dans la nature humaine. Il en est d'un travail donné, tournant chaque jour dans le même cercle, comme d'un mets dont le retour constant, régulier, sans changement, finit par le faire paraître répugnant ; l'activité s'émousse et s'endort. L'homme accomplit machinalement sa tâche, sans entrain et sans goût. Et pourtant il existe chez tout homme une foule d'aptitudes et d'instincts qu'il suffit d'éveiller et de développer pour produire les plus beaux résultats et pour faire de lui un homme vraiment complet. La socialisation de la société fournit largement l'occasion de satisfaire ce besoin de variété dans le travail. » ([16] [2633])
Cette variété n'a rien de commun avec la recherche frénétique de l'innovation pour elle-même qui est de plus en plus devenue le sceau de la culture capitaliste décadente. Elle est fondée sur le rythme humain de la vie où le temps disponible est devenu la mesure de la richesse: « nous avons maintenant trouvé ce que nous voulons, de sorte que nous ne faisons pas plus que ce que nous voulons ; et comme nous n avons plus un tas de choses inutiles à faire, nous avons le temps et les moyens de prendre plaisir en les faisant. »([17] [2634])
Travailler avec entrain et dans la joie ; le réveil des aptitudes et des désirs réprimés. Bref, comme le dit Morris, le travail connue activité consciemment sensuelle.
Morris n'avait pas lu les Manuscrits économiques et philosophiques de Marx, mais la façon dont il utilise cette formule montre que le mouvement révolutionnaire de la fin du 19e siècle était familier de la conception de l'activité humaine libre que Marx avait développée dans ses premiers écrits. Il connaissait par exemple le fait que Marx avait soutenu l'insistance de Fourier selon laquelle le travail, pour être digne des êtres humains, devait se baser sur une « attirance passionnelle », ce qui est certainement une autre façon de parler de l' « Eros » que Freud a ultérieurement approfondi.
Freud a une fois remarqué que l'homme primitif « rendait son travail agréable en le traitant, pour ainsi dire, comme un équivalent et un substitut des activités sexuelles. » ([18] [2635]) En d'autres termes, dans les premières formes de communisme primitif, le travail n'était pas encore devenu ce qu’Hegel a défini dans La phénoménologie de l'esprit comme « le désir réprimé et contenu ». En termes marxistes, l'aliénation du travail ne commence pas vraiment avant l'avènement de la société de classe. Le communisme du futur réalise donc un retour généralisé à des tonnes érotiques, sensuelles du travail qui, dans les sociétés de classe, ont généralement constitué le privilège de l'élite artistique.
En même temps, dans les Grundrisse, Marx critique l'idée de Fourier selon laquelle le travail puisse devenir un jeu, dans le sens d'un « simple plaisir et d'un simple amusement » . C'est parce que le communisme scientifique a compris que l’utopisme est toujours dominé par une fixation sur le passé. Un homme ne peut pas redevenir un enfant comme le note Marx dans le même écrit. Mais il poursuit en soulignant que l’homme peut et doit retrouver la spontanéité de l'enfance ; l'adulte qui travaille et prévoit le futur, doit apprendre à réintégrer le lien érotique de l'enfant au monde. L'éveil des sens, décrit dans les Manuscrits économiques et politiques, nécessite un retour au royaume perdu du jeu, mais celui qui y retourne ne s'y perd plus connue le font les enfants, car il a maintenant acquis la maîtrise consciente de l'être humain social pleinement développé.
Un point de vue utopique ?
On ne peut aller plus loin dans l'examen de la vision du socialisme élaborée à la fin du 19e siècle par les révolutionnaires sans poser la question : leur travail acharné pour décrire la société du futur n'était-elle pas simplement une nouvelle variété d'utopisme, une sorte de réalisation de désirs sans lien avec le mouvement réel de l'histoire ?
Dans le précédent article de cette série, nous avons examiné l'accusation portée contre Bebel par les féministes - selon laquelle sa démarche était vraiment utopique car elle ne réussissait pas à faire le lien entre le futur socialiste où l'oppression des femmes a disparu ainsi que toutes les autres formes d'oppression et d'exploitation, avec la lutte contre cette oppression dans la société actuelle. Nous ne pouvons pas non plus ignorer que le sous-titre des Nouvelles de nulle part de Morris est « une romance utopique ». Néanmoins, nous avons rejeté cette accusation, au moins sous la forme où les féministes la formulent. La plupart des formes de gauchisme qui sont toujours occupées à dissimuler le fait que leur vision du socialisme n'est pas autre chose qu'une resucée de l'exploitation d'aujourd'hui, partagent l'idée que toute tentative de décrire autrement le communisme qu'en ternies négatifs relève de l’utopisme. Evidemment, il est vrai que les communistes ne doivent pas répéter l'erreur de Fourier qui établissait pour chaque jour et même heure après heure des prescriptions sur ce que serait la société du futur et la vie future. Mais, comme Bordiga l’a fait remarquer, la véritable différence entre le socialisme utopique et le socialisme scientifique ne réside pas tant dans le refus de ce dernier de décrire et de définir le communisme, mais dans sa reconnaissance que la nouvelle société ne peut venir que du développement d'un mouvement réel, d'une lutte sociale réelle qui a déjà lieu au cœur de la société bourgeoise. Alors que les utopistes rêvaient à « des recettes pour les marmites de l'avenir » et faisaient appel à des philanthropes bénévoles pour qu'ils fournissent la cuisine et les cuisiniers, les communistes révolutionnaires avaient identifié dans le prolétariat la seule force capable de faire éclore la nouvelle société en menant sa lutte inévitable contre l'exploitation capitaliste à ses conclusions logiques.
De toutes façons, les féministes n'ont pas le droit de juger les socialistes du 19e siècle car pour elles, « le mouvement réel » qui conduit à la transformation révolutionnaire n'est pas du tout un mouvement de classe, mais une alliance amorphe et interclassiste qui ne peut que servir à éloigner le prolétariat de son propre terrain de lutte. En ce sens, il n'y a pas du tout d'utopisme chez Morris ou chez Bebel, ni dans les partis social-démocrates en général, parce qu'ils basaient tout leur travail sur la claire reconnaissance que ce serait la classe ouvrière et aucune autre force sociale qui serait contrainte, par sa propre nature historique, à renverser les rapports capitalistes de production.
Et pourtant le problème subsiste car, dans cette période d'apogée du développement capitaliste, de sonnet qui précédait la descente, les contours de ce renversement révolutionnaire commençaient à s'estomper. Les socialistes de la fin du 19e siècle étaient certainement capables de voir les potentialités communistes que révélait la gigantesque croissance du capitalisme, mais comme cette croissance repoussait de l'horizon visible l'action révolutionnaire de la classe, il devenait de plus en plus difficile de voir continent les luttes défensives existantes de la classe pourraient mûrir en un assaut à vaste échelle contre le capital.
Il est vrai que la Commune de Paris n'était pas très loin derrière et les partis socialistes continuaient à la commémorer chaque année. Les formes organisationnelles que Bebel envisageait pour la société nouvelle étaient certainement influencées par l'expérience de la Commune et quand Morris, dans Nouvelles de nulle part, décrit la transition de la vieille société à la nouvelle, il n’hésite pas à la dépeindre comme le résultat d'une guerre civile, violente. Le fait reste cependant que les leçons de la Commune s'estompèrent vite, et que tout en contenant beaucoup d'élaborations sur le futur socialiste, le grand livre de Bebel apporte peu de clarifications sur la façon dont la classe ouvrière prendrait le pouvoir, ni sur les phases initiales de la confrontation révolutionnaire avec le capital. Comme l'a noté Victor Serge, durant cette période, une vision « idyllique » de la révolution socialiste a commencé à avoir prise sur le mouvement ouvrier:
« On pouvait, à la fin du siècle dernier, cultiver le grand rêve d'une transformation sociale idyllique. De généreux esprits s'y adonnèrent, dédaignant ou déformant la science de Marx. La révolution sociale, ils la rêvèrent comme l'expropriation à peu près indolore d'une infime minorité de ploutocrates. Et pourquoi le prolétariat magnanime, brisant les vieux glaives et les fusils modernes, n'accorderait-il pas une indemnité à ses exploiteurs de la veille dépossédés ? Les derniers riches s'éteindraient paisiblement, oisifs, entourés d'un mépris railleur. L'expropriation des trésors accumulés par le capitalisme, jointe à la réorganisation rationnelle de la production, procurerait sur l'heure à la société entière l'aisance et la sécurité. Toutes les idéologies ouvrières d'avant-guerre sont plus ou moins pénétrées de ces idées fausses. Le mythe radical du progrès les domine. Les impérialismes cependant mettaient au point leurs artilleries. Dans la 2e Internationale, une poignée de marxistes révolutionnaires discernaient seuls les grandes lignes du développement historique... »([19] [2636])
Cette vision trop optimiste a pris différentes tonnes. En Allemagne où le parti social-démocrate est devenu un parti de masse avec une présence aux commandes non seulement des syndicats, mais aussi du parlement et des conseils locaux, cette notion du pouvoir tombant tel un fruit mûr dans les mains d'un mouvement qui avait déjà établi ses bases organisationnelles au sein de l'ancien système, a de plus en plus prévalu. On voyait de moins en moins la révolution comme la vieille taupe qui surgit à la surface, l'acte d'une classe hors-la-loi qui doit abattre toutes les institutions existantes et créer une nouvelle forme de pouvoir, et on la concevait de plus en plus contrite la culmination d'un patient travail de construction, de consolidation et de démarchage électoral au sein des institutions politiques et sociales existantes. Et comme nous le verrous quand nous examinerons l'évolution de cette conception dans les travaux de Karl Kautsky, il n'y avait pas un mur de Chine s'élevant entre cette vision « orthodoxe » et la vision ouvertement révisionniste de Bernstein et de ses adeptes, puisque, si le communisme pouvait advenir à travers l'accumulation graduelle de forces dans le cadre du capitalisme, il pouvait ne pas y avoir besoin de renversement révolutionnaire final.
En Grande-Bretagne, où le réformisme à tout crin, « rien que » du syndicalisme et du crétinisme parlementaire, avait, de toutes façons, été plus endémique dans le mouvement ouvrier, la réaction de révolutionnaires tels que Morris était plutôt de se retirer dans un sectarisme puriste considérant avec dédain la lutte pour les « palliatifs » et insistant à tout moment sur le fait que le socialisme constituait la seule réponse aux problèmes du prolétariat. Mais puisqu'ils rejetaient la lutte défensive, tout ce qui restait à faire, c'était de prêcher le socialisme : « Je dis que pour nous, faire des socialistes constitue la tâche du jour, et aujourd7tui, je ne pense pas que noms puissions faire quoi que ce soit d'autre qui soit utile » ([20] [2637]) comme si la conscience révolutionnaire allait se développer dans la société simplement par le fait que la logique des arguments socialistes gagnerait de plus en plus d'individus. En fait, vers la fin de sa vie, Morris commença à repenser ses réserves concernant la lutte pour des réformes, car l'incapacité de sa Ligue socialiste à traiter de cette question avait joué un rôle dans sa disparition, mais la vision sectaire continua de peser lourdement sur le mouvement révolutionnaire en Grande Bretagne. Le parti socialiste de Grande Bretagne, stérile depuis sa naissance même, en 1903, est une incarnation classique de cette tendance.
L'utopisme surgit dans le mouvement ouvrier quand le lien entre les luttes quotidiennes de la classe et la société communiste future disparaît de la vue. Mais nous ne pouvons pas le reprocher trop durement aux révolutionnaires de cette époque. C'étaient avant tout les conditions objectives de la fin du 19e siècle qui interféraient dans leur vision. Dans la période qui a suivi, période où le capitalisme a commencé sa descente, les changements de ces conditions objectives et, surtout, des méthodes et des formes de la lutte de classe, ont permis aux meilleurs éléments du mouvement social-démocrate de voir plus clairement la perspective. Dans les prochains articles de cette série, nous examinerons donc les débats qui ont animé les partis social-démocrates dans les années 1900, et en particulier après la révolution russe de 1905 - débats qui ne devaient pas tant se centrer sur le but ultime à obtenir, que sur les moyens d'y parvenir.
CDW.
WILLIAM MORRIS MILITANT REVOLUTIONNAIRE
William Morris avait beaucoup de faiblesses politiques. Son rejet du Parlement contrite moyen de la révolution socialiste était aussi accompagné d'un refus d'appliquer une quelconque tactique d'intervention dans l'arène parlementaire, ce qui était encore à l'ordre du jour à l'époque pour les partis ouvriers. En effet, le manque de clarté de la Ligue socialiste sur le problème des luttes immédiates de la classe ouvrière amena celle-ci dans une impasse sectaire, qui la rendit complètement vulnérable aux intrigues destructrices des anarchistes qui y entrèrent et bientôt l'enterrèrent, plus qu'aidés en cela par l'Etat bourgeois.
Néanmoins, quand la Ligue s'était constituée, résultat d'une scission avec la Fédération social-démocrate menée par le pseudo-socialiste Hyndmann, elle avait été soutenue par Engels comme un pas en avant dans le développement d'un courant marxiste sérieux en Grande-Bretagne, et aussi comme un moment dans la formation d'un parti de classe. Et c'est cet aspect du socialisme de Morris que la bourgeoisie s'efforce le plus de cacher. Là il est évident que la tentative de réduire Morris à un « artiste socialiste », un promoteur inoffensif de fart dans les masses, est elle-même loin d'être inoffensive. Car Morris le socialiste n'était pas un rêveur isolé, mais un militant qui rompit courageusement avec ses origines de classe et donna volontairement les dix dernières armées de sa vie au travail difficile de construire une organisation révolutionnaire dans le prolétariat britannique. Et pas seulement en Grande-Bretagne, la Ligue socialiste se considérait elle-même comme une partie d'un mouvement prolétarien international qui donna naissance à la 2e Internationale en 1889.
En son temps, le dévouement de Morris à la cause du socialisme a été ridiculisé par la bourgeoisie qui le traitait d’hypocrite, d'idiot et de traître. Aujourd'hui la classe dominante est encore plus déterminée à prouver que l'engagement de sa vie pour la révolution communiste est pure folie. Mais les révolutionnaires « idiots », les organisations communistes «folles », sont les seuls qui peuvent défendre, et ont le droit de critiquer l'héritage politique de William Morris.
Amos,.
Extrait de World Révolution n°195.
[1] [2638] Citations traduites de l'anglais par nous. A propos de William Morris, voir l'encart à la fin de cet article.
[2] [2639] Voir Revue Internationale n° 70 et 75
[3] [2640] « La part jouée par le travail dans la transition du singe à l'homme ».
[4] [2641] Manuscrits économiques et philosophiques, Ed. La Pléiade, Tome II, page 126.
[5] [2642] La femme dans le passé, le présent et l'avenir, Collection Ressources, page 254.
[6] [2643] Extraits de Elements of political economy de James Mill, par Marx. Traduit de l'anglais par nous
[7] [2644] Ibid. note 5.
[8] [2645] Ibid. note 1
[9] [2646] Nous citons ce passage en partie pour réfuter l'accusation souvent reprise selon laquelleMorris était « contre la technologie »,ce qui fut soulevé dès 1902 par Kautsky dans son livre La révolution sociale. Morris pensait certainement que la société socialiste verrait un retour à beaucoup de caractéristiques et de plaisirs de la production artisanale, mais c'était pour lui un choix rendu possible du fait que les machines avancées libéreraient substantiellement les producteurs des formes répétitives et inattractives du travail.
[10] [2647] Ibid note 5, page 267.
[11] [2648] Ibid.
[12] [2649] Ibid note 9.
[13] [2650] Ibid note 5, page 262.
[14] [2651] Ibid note 9.
[15] [2652] Ibid.
[16] [2653] Ibid note 5, page 268.
[17] [2654] Ibid note 1
[18] [2655] Introduction à la psychanalyse
[19] [2656] Ce que tout révolutionnaire doit savoir de /arépression, Petite collection Maspéro, page 96
[20] [2657] Where as we now »Commonweal, 15 novembre 1890. traduit de l'anglais par nous.
Approfondir:
Questions théoriques:
- Communisme [492]
Heritage de la Gauche Communiste:
Revue Internationale no 87 - 4e trimestre 1996
- 3107 reads
Conflits imperialistes : triomphe " du chacun pour soi " et crise du leadership americain
- 2730 reads
Depuis les événements du Sud Liban du printemps dernier, les tensions inter-impérialistes n'ont cessé de s'accumuler au Moyen‑Orient. Ainsi, une nouvelle fois, tous les discours des « batteurs d'estrade » de la bourgeoisie quant au prétendu avènement d'une « ère de paix » dans cette région qui est l'une des principales poudrières impérialistes de la planète sont démentis. Cette zone, qui fut un enjeu majeur des affrontements entre les deux blocs pendant 40 ans, est au centre de la lutte acharnée que se livrent aujourd'hui les grandes puissances impérialistes qui composaient l'ex-bloc de l'Ouest. Derrière cet actuel regain de tensions impérialistes, il y a fondamentalement la contestation grandissante envers la première puissance mondiale dans l'une de ses principales chasses gardées, contestation gagnant même ses alliés et lieutenants les plus proches.
La première puissance mondiale contestée dans son fief
La politique musclée mise en place par les Etats-Unis, depuis plusieurs années, pour renforcer leur domination sur tout le Moyen-Orient et en tenir à l'écart tous leurs rivaux, a connu un sérieux dérapage avec l'arrivée au pouvoir de Néthanyaou en Israël ; et cela alors que Washington n'avait cessé d'affirmer un soutien très appuyé au candidat travailliste, Shimon Peres (Clinton s'était engagé personnellement dans ces élections comme jamais aucun président américain ne l'avait fait avant lui). Les conséquences de ce couac électoral n'ont pas tardé à se faire sentir. Contrairement à Peres qui tenait en mains solidement le parti travailliste, Néthanyaou ne parvient manifestement pas à contrôler son propre parti, le Likoud. Cela s'est illustré à travers la pagaille qui a présidé à la formation de son gouvernement mais aussi à travers la mise en quarantaine à laquelle a été soumis D. Lévy, responsable des affaires étrangères. En fait Néthanyaou est soumis à la pression des fractions les plus dures et archaïques du Likoud dont le chef de file est A. Sharon. C'est celui-là même qui avait violemment dénoncé les ingérences américaines dans les élections israéliennes, ingérences qui, selon lui, réduisent « Israël au rang de simple république bananière ». Il affirmait ainsi ouvertement la volonté de certains secteurs de la bourgeoisie israélienne à une plus grande autonomie vis à vis du pesant tuteur américain. Or, ces fractions, aujourd'hui, poussent à la « politique du pire » en remettant en cause l'ensemble du « processus de paix » imposé par le grand parrain américain avec l'accord du tandem Rabin/Peres, que ce soit envers les palestiniens (de nouvelles colonies de peuplement qui avaient été gelées par le gouvernement travailliste se mettent en place actuellement) ou vis à vis de la Syrie à travers la question du Golan. Et ce sont ces fractions qui ont tout fait pour retarder la rencontre, pourtant prévue de longue date, entre Arafat et Néthanyaou et qui, lorsque cette dernière a finalement lieu, s'activent pour la vider de tout contenu. Cette politique ne peut que mettre rapidement en porte-à-faux l'homme-lige des Etats-Unis qu'est Arafat, au point que ce dernier ne pourra pas longtemps conserver le contrôle de ses troupes sauf à hausser nettement le ton (ce qu'il a déjà commencé à faire) et ainsi s'acheminer vers un nouvel état de belligérance avec Israël. De même, tous les efforts déployés par les Etats-Unis, alternant la carotte et le bâton pour que la Syrie s'inscrive clairement dans son « processus de paix », efforts qui commençaient à porter leurs fruits, se trouvent aujourd'hui remis en cause par la nouvelle intransigeance israélienne.
Cette arrivée au pouvoir du Likoud a aussi des conséquences sur l'autre grand allié des Etats-Unis dans la région, sur le pays qui, après Israël, est le principal bénéficiaire de l'aide américaine au Moyen Orient, à savoir l'Egypte ; et cela, alors même que cet état clef « du monde arabe » est, depuis un certain temps déjà, l'objet de tentatives de débauchage de la part des rivaux européens de la première puissance mondiale. ([1] [2658]) Depuis l'invasion israélienne du Sud Liban, l'Egypte tend à se démarquer de plus en plus de la politique américaine en renforçant ses liens avec la France et l'Allemagne et en dénonçant de plus en plus violemment la nouvelle politique d'Israël auquel elle est pourtant liée par un accord de paix.
Mais ce qui est sans doute l'un des symptômes les plus spectaculaires de la nouvelle donne impérialiste qui est en train de se créer dans la région, c'est l'évolution de la politique de l'Etat saoudien (qui a servi de Q.G. à l'armée américaine pendant la guerre du Golfe) à l'égard de son tuteur américain. Quels que soient les véritables commanditaires, l'attentat perpétré à Dahran contre les troupes US visait directement la présence militaire américaine et exprimait déjà un net affaiblissement de l'emprise de la première puissance mondiale dans l'une de ses principales places fortes au Moyen-Orient. Mais si l'on ajoute à cela l'accueil particulièrement chaleureux réservé à la visite de Chirac, chef d'un état qui est à la pointe de la contestation envers le leadership américain, on mesure l'importance de la dégradation des positions américaines dans ce qui était encore, il y a peu, un Etat soumis pieds et poings liés aux diktats de Washington. Manifestement la pesante domination de « l'Oncle Sam » est de plus en plus mal supportée par certaines fractions de la classe dominante saoudienne lesquelles cherchent, en se rapprochant de certains pays européens, à s'en délester quelque peu. Que le prince Abdallah, successeur désigné au trône, soit à la tête de ses fractions montre la force de la tendance anti-américaine qui est en train de se développer.
Que des alliés aussi soumis et dépendants des Etats-Unis, tels Israël et l'Arabie Saoudite, puissent manifester des réticences à suivre en tous points les diktats de « l'Oncle Sam », qu'ils n'hésitent pas à nouer des relations plus étroites avec les principaux contestataires de « l'ordre américain » que sont la France, la Grande‑Bretagne et l'Allemagne ([2] [2659]), cela signifie clairement que les rapports de force inter impérialistes dans ce qui était encore, il y a peu, une chasse gardée exclusive de la première puissance mondiale connaissent une modification importante. En 1995, si les Etats-Unis étaient confrontés à une situation difficile dans ex-Yougoslavie, en revanche ils régnaient en maîtres absolus sur le Moyen‑Orient. Ils avaient alors, en effet, suite à la guerre du Golfe, réussi à évincer totalement de la région les puissances européennes. La France voyait sa présence au Liban réduite à néant et perdait en même temps son influence en Irak. La Grande-Bretagne, quant à elle, n'était nullement récompensée de sa fidélité et de sa participation très active durant la guerre du Golfe, Washington ne lui ayant octroyé que quelques miettes dérisoires lors de la reconstruction du Koweït. L'Europe, lors des négociations israélo-palestiniennes, s'étaient vus offrir un misérable strapontin tandis que les Etats-Unis jouaient le rôle du chef d'orchestre disposant de toutes les cartes dans leur jeu. Cette situation a globalement perduré jusqu'au show de Clinton lors du sommet de Charm El Cheikh. Mais, depuis lors, l'Europe est parvenue à faire une nouvelle percée dans la région, d'abord discrètement puis plus franchement et fortement profitant du fiasco qu'a été l'opération israélienne au Sud‑Liban et exploitant habilement les difficultés de la première puissance mondiale. Celle-ci, en effet, avait de plus en plus de mal à faire pression non seulement sur les classiques récalcitrants de « l'ordre américain » comme la Syrie mais aussi sur certains de ses alliés les plus solides comme par exemple l'Arabie Saoudite. Le fait que cela se produise dans une chasse gardée aussi essentielle que le Moyen‑Orient pour le maintien du leadership de la superpuissance américaine est à lui seul un symptôme clair des sérieuses difficultés éprouvées par cette dernière pour préserver son statut sur l'arène impérialiste mondiale. Que l'Europe parvienne à se réintroduire dans le jeu moyen-oriental, à défier ainsi les Etats-Unis dans une des zones du monde qu'ils contrôlent le plus fortement, exprime un affaiblissement incontestable de la première puissance mondiale.
Le leadership des Etats-Unis malmené sur la scène mondiale
Le revers subi au Moyen‑Orient par le gendarme américain doit d'autant plus être souligné qu'il intervient seulement quelques mois après la victorieuse contre‑offensive qu'il avaient réussi à mener dans l'ex‑Yougoslavie. Offensive qui était destinée avant tout à remettre sérieusement au pas ses ex‑alliés européens qui étaient passés à la rébellion ouverte. Le N° 85 de la présente revue, tout en soulignant, le recul subi en particulier à cette occasion par le tandem franco-britannique, notait en même temps les limites de ce succès américain en mettant en avant que les bourgeoisies européennes, contraintes de reculer dans l'ex‑Yougoslavie, chercheraient un autre terrain pour riposter à l'impérialisme américain. Ce pronostic s'est clairement vérifié avec les événements de ces derniers mois au Moyen‑Orient. Si les Etats-Unis conservent globalement le contrôle de la situation dans l'ex‑Yougoslavie -cela n'empêche que, là aussi, ils doivent toujours se confronter aux manoeuvres en sous-main des européens- on voit actuellement au Moyen-Orient que la domination qu'ils y exerçaient, jusque là sans partage, est de plus en plus remise en cause.
Mais la première puissance mondiale n'est pas seulement confrontée à la contestation de son leadership au Moyen‑Orient et ses difficultés ne se résument pas à cette seule partie du monde. On peut dire que dans la terrible foire d'empoigne que se livrent notamment les grandes puissances impérialistes, foire d'empoigne qui est la principale manifestation d'un système moribond, c'est pratiquement sur l'ensemble de la planète que les Etats-Unis sont confrontés à des tentatives plus ou moins ouvertes de remise en cause de leur leadership
Au Maghreb, leurs tentatives pour évincer ou, du moins, pour fortement amoindrir l'influence de l'impérialisme français se heurtent à de très sérieuses difficultés et tournent pour le moment plutôt à l'échec. En Algérie, la mouvance islamiste, largement utilisée par les Etats-Unis pour déstabiliser et porter de rudes coups au pouvoir en place et à l'impérialisme français, est en crise ouverte. Les récents attentats du GIA sont à considérer plus comme des actes de désespoir d'un mouvement en train d'éclater que la manifestation d'une force réelle. Le fait que le principal bailleur de fonds des fractions islamistes, l'Arabie saoudite, soit de plus en plus réticent à continuer à les financer, affaiblit d'autant les moyens de pression américains. Si la situation est loin d'être stabilisée en Algérie, la fraction qui est au pouvoir avec l'appui de l'armée et du parrain français a nettement renforcé ses positions depuis la réélection du sinistre Zéroual. Dans le même temps, la France est parvenue à resserrer ses liens avec la Tunisie et le Maroc alors que ce dernier notamment avait été très sensible, ces dernières années, au chant des sirènes américaines.
En Afrique noire, après le succès qu'ils ont remporté au Rwanda en parvenant à chasser la clique liée à la France, les Etats-Unis sont aujourd'hui confrontés à une situation beaucoup plus difficile. Si l'impérialisme français a renforcé sa crédibilité en intervenant de façon musclée en Centre‑Afrique, l'impérialisme américain, par contre, subit un revers au Liberia où il doit se résoudre à abandonner ses protégés. Les Etats-Unis ont tenté de reprendre l'initiative au Burundi en cherchant à réitérer ce qu'ils avaient réussi à faire au Rwanda ; mais là également ils se sont heurtés à une vigoureuse riposte de la France qui a fomenté, avec l'appui de la Belgique, le coup d'état du major Bouyaya, rendant caduque « la force d'interposition africaine » que les Etats-Unis tentaient de mettre sur pieds sous leur contrôle. Il faut souligner que, pour une large part, ces succès remportés par l'impérialisme français -lequel, il y a peu, était aux abois face à la pression américaine- sont dus pour une très grande part à l'efficacité de son étroite collaboration avec l'autre ancienne grande puissance coloniale africaine qu'est la Grande‑Bretagne. Les Etats-Unis ont non seulement perdu l'appui de cette dernière mais ils la retrouvent aujourd'hui contre eux.
Concernant un autre enjeu important de la bataille qui se mène entre les grandes puissances européennes et la première puissance mondiale, à savoir la Turquie, là aussi cette dernière est en difficulté. Cet état a une importance stratégique cruciale au carrefour entre l'Europe, le Caucase et le Moyen‑Orient C'est un allié historique de l'Allemagne mais il a de solides liens avec les Etats-Unis notamment à travers son armée qui a été largement formée par ces derniers lorsque le bloc américain existait. Pour Washington faire basculer la Turquie dans son camp et l'éloigner de Bonn représenterait donc une victoire particulièrement importante. Si la récente alliance militaire nouée par la Turquie avec Israël peut sembler correspondre aux intérêts américains, les principales orientations du nouveau gouvernement turc -à savoir une coalition entre les islamistes et l'ex premier ministre T. Ciller- marquent au contraire une nette distanciation d'avec la politique américaine. Non seulement la Turquie continue à soutenir la rébellion tchétchène contre la Russie, alliée des Etats-Unis, ce qui fait le jeu de l'Allemagne ([3] [2660]), mais elle vient de faire un véritable pied de nez à Washington en signant d'importants accords avec deux états particulièrement exposés à la vindicte américaine : l'Iran et l'Irak !
En Asie, le leadership de la première puissance mondiale est aussi contrarié. La Chine ne manque aucune occasion pour affirmer ses propres prérogatives impérialistes même si celles‑ci sont antagoniques à celles des Etats-Unis ; tandis que le Japon manifeste lui aussi des velléités à une plus grande autonomie vis à vis de Washington. De nouvelles manifestations contre la présence des bases militaires américaines se déroulent à intervalles réguliers et le gouvernement nippon déclare vouloir nouer des relations politiques plus étroites avec l'Europe. Un pays comme la Thaïlande qui était un véritable bastion de l'impérialisme américain tend, lui aussi, à prendre ses distances en cessant de soutenir les Khmers rouges qui étaient les mercenaires des Etats-Unis, facilitant ainsi d'autant les tentatives de la France de retrouver une influence au Cambodge.
Très significatives également d'un leadership contesté sont les incursions que font aujourd'hui les européens et les japonais dans ce qui est la chasse gardée par excellence des Etats-Unis : leur arrière-cour sud‑américaine. Même si ces incursions ne mettent pas fondamentalement en danger les intérêts américains dans cette zone et ne peuvent être mises sur le même plan que les manoeuvres de déstabilisation, souvent réussies, qui sont menées dans d'autres régions du monde contre eux, il est significatif que ce sanctuaire des Etats-Unis, jusque‑là inviolé, soit à son tour l'objet de la convoitise de ses concurrents impérialistes. Cela marque une rupture historique dans la domination absolue qu'exerçait la première puissance mondiale sur l'Amérique Latine depuis la mise en avant de « la doctrine Monroe ». Alors que l'accord de l'ALENA, au‑delà de ses aspects économiques, visait avant tout à tenir fermement rassemblé sous la houlette de Washington l'ensemble du continent américain, des pays comme le Mexique, le Pérou ou la Colombie auxquels il faut ajouter le Canada, n'hésitent plus à contester certaines décisions des Etats-Unis contraires à leurs intérêts. Récemment le Mexique est parvenu à entraîner pratiquement tous les états sud‑américains dans une croisade contre la loi Helms-Burton promulguée par les Etats-Unis pour renforcer l'embargo économique contre Cuba et sanctionner toute entreprise qui passerait outre cet embargo. L'Europe et le Japon se sont empressés d'exploiter à leur avantage ces tensions occasionnées par la lourde pénalisation occasionnée par cette loi et que subissent de nombreux états d'Amérique Latine. L'excellent accueil réservé au président colombien Samper lors de son voyage en Europe, alors que les Etats-Unis font tout pour l'évincer, en constitue une nouvelle illustration. Ainsi le journal français Le Monde peut écrire dans son édition du 4 septembre 1996 : « Alors que jusqu'ici, les Etats-Unis ignoraient calmement le Groupe de Rio (association regroupant presque tous les pays du sud du continent), la présence à Cochabamba (lieu où se réunissait ce groupe) de M. Albright, ambassadrice des Etats-Unis à l'ONU, est particulièrement remarquée. Selon certains observateurs, c'est le dialogue politique instauré entre les pays du Groupe de Rio avec l'Union Européenne, puis avec le Japon, qui explique le changement d'attitude des Etats-Unis..... »
Disparition des blocs impérialistes, triomphe du « chacun pour soi »
Comment expliquer cet affaiblissement de la superpuissance américaine et les remises en question de son leadership alors qu'elle reste la première puissance économique de la planète et, plus encore, dispose d'une supériorité militaire absolue sur tous ses rivaux impérialistes. A la différence de l'URSS, les Etats-Unis ne se sont pas effondrés lors de la disparition des blocs qui avaient régenté la planète depuis Yalta. Mais cette nouvelle situation a néanmoins profondément affecté la seule superpuissance mondiale restante. Nous en donnions d'ailleurs déjà les raisons dans la « Résolution sur la situation internationale » du 12e congrès de RI publiée dans la Revue Internationale n° 86.
Soulignant que le retour en force des Etats-Unis, suite à leur succès yougoslave, ne signifiait nullement qu'ils aient définitivement surmonté les menaces pesant sur leur leadership, nous écrivions : « Ces menaces proviennent fondamentalement...... du chacun pour soi, du fait qu'il manque aujourd'hui ce qui constitue la condition principale d'une réelle solidité et pérennité des alliances entre Etats bourgeois dans l'arène impérialiste : l'existence d'un ennemi commun menaçant leur sécurité. Les différentes puissances de l'ex‑bloc occidental peuvent, au coup par coup, être obligées de se soumettre aux diktats de Washington, mais il est hors de question pour elles de maintenir une quelconque fidélité durable. Bien au contraire, toutes les occasions sont bonnes pour saboter, dès qu'elles le peuvent, les orientations et dispositions imposées par les Etats Unis. »
L'ensemble des coups de boutoirs portés ces derniers mois au leadership de Washington s'inscrit totalement dans ce cadre, l'absence d'ennemi commun fait que les démonstrations de force américaine voient leur efficacité se réduire de plus en plus. Ainsi, « la Tempête du Désert », malgré les moyens politiques, diplomatiques et militaires considérables mis en oeuvre par les Etats-Unis pour imposer leur « nouvel ordre », n'était parvenue à freiner les velléités d'indépendance des « alliés » des Etats-Unis que pendant un an. Le déclenchement de la guerre en Yougoslavie durant l'été 1992 signait, en effet, l'échec de « l'ordre américain ». Même le succès remporté par les Etats-Unis, fin 1995, dans l'ex‑Yougoslavie n'a pu empêcher que la rébellion ne s'étende dès le printemps 1996 ! D'une certaine façon, plus les Etats-Unis font étalage de leur force, plus ils tendent à raffermir la détermination des contestataires de « l'ordre américain » qui entraînent dans leur sillage d'autres Etats jusque là plus dociles aux diktats venant de Washington. Ainsi lorsque Clinton veut entraîner l'Europe dans une croisade contre l'Iran au nom de l'anti-terrorisme, la France, la Grande Bretagne et l'Allemagne lui répondent par une fin de non-recevoir. De même ses prétentions de vouloir punir des Etats commerçant avec Cuba, l'Iran ou la Libye n'ont pour seul résultat que de provoquer, comme on l'a vu jusqu'en Amérique latine, une levée de boucliers contre les Etats-Unis. Cette attitude agressive a aussi une incidence sur un pays de l'importance de l'Italie dont « le coeur balance » entre les Etats-Unis et l'Europe. Les sanctions infligées par Washington à de grandes entreprises transalpines pour leurs relations étroites avec la Libye ne peuvent que renforcer les tendances pro-européennes de celui-ci.
Cette situation traduit l'impasse dans laquelle se trouve la première puissance mondiale :
- soit elle ne fait rien, renonce à utiliser la force (qui est son seul moyen de pression aujourd'hui) et cela reviendrait à laisser le champ libre à ses concurrents,
- soit elle tente d'affirmer sa supériorité pour s'imposer comme le gendarme du monde par une politique agressive (ce qu'elle tend à faire de plus en plus) et cela se retourne rapidement contre elle en l'isolant davantage et en renforçant la hargne anti-américaine un peu partout dans le monde.
Cependant conformément à l'irrationalité foncière des rapports inter impérialistes dans la phase de décadence du système capitaliste, caractéristique qui est exacerbée dans la phase actuelle de décomposition accélérée, les Etats-Unis ne peuvent qu'utiliser la force pour tenter de préserver leur statut sur l'arène impérialiste. Ainsi on les voit de plus en plus recourir à la guerre commerciale qui n'est plus seulement l'expression de la féroce concurrence économique qui déchire un monde capitaliste plongé dans l'enfer sans fin de sa crise mais une arme pour défendre leurs prérogatives impérialistes face à tous ceux qui contestent leur leadership. Mais face à une contestation d'une telle ampleur la guerre commerciale ne peut suffire et la première puissance du monde est contrainte de faire à nouveau parler les armes comme en témoigne sa dernière intervention en Irak.
En lançant plusieurs dizaines de missiles de croisière sur l'Irak, en réponse à l'incursion des troupes de Saddam Hussein au Kurdistan, les Etats-Unis montrent leur détermination à défendre leurs positions au Moyen-Orient et plus largement à rappeler qu'ils entendent préserver leur leadership dans le monde. Mais les limites de cette nouvelle démonstration de force apparaissent d'emblée :
- au niveau des moyens mis en oeuvre qui ne sont qu'une pâle réplique de ceux de la « Tempête du désert » ;
- mais aussi à travers le fait que cette nouvelle « punition » que les Etats-Unis cherchent à infliger à l'Irak ne bénéficie que de très peu d'appuis dans la région et dans le monde.
Le gouvernement turc a refusé que les Etats-Unis utilisent les forces qui sont basées dans son pays, tandis que l'Arabie Saoudite n'a pas laissé les avions américains décoller de son territoire pour aller bombarder l'Irak et a même appelé Washington à cesser son opération. Les pays arabes dans leur majorité ont critiqué ouvertement cette intervention militaire. Moscou et Pékin ont clairement condamnée l'initiative américaine alors que la France, suivie par l'Espagne et l'Italie, a nettement marquée sa désapprobation. On voit à quel point on est loin de l'unanimité que les Etats-Unis avaient réussie à imposer lors de la guerre du Golfe. Une telle situation est révélatrice de l'affaiblissement subi par le leadership de Washington depuis cette époque. La bourgeoisie américaine aurait, sans aucun doute, souhaitée faire une démonstration de force beaucoup plus éclatante ; et pas seulement en Irak mais aussi, par exemple, contre le pouvoir en place à Téhéran. Mais faute de soutien et de points d'appui suffisants, y compris dans la région, ils sont contraints de faire parler la poudre sur un registre mineure et avec un impact forcément réduit.
Cependant si cette opération en Irak est de portée limitée, on ne doit pas pour autant en sous-estimer les bénéfices qu'en tirent les Etats-Unis. A côté de la réaffirmation à peu de frais de leur supériorité absolue sur le plan militaire, notamment dans cette chasse gardée que représente pour eux le Moyen-Orient, ils sont surtout parvenus à semer la division chez leurs principaux rivaux d'Europe. Ceux-ci étaient encore récemment parvenus à opposer un front commun face à Clinton et ses diktats concernant la politique à mener vis à vis de l'Iran, la Libye ou Cuba. Que la Grande Bretagne se rallie bruyamment à l'intervention menée en Irak, au point que Major « salue le courage des Etats-Unis », que l'Allemagne semble partager cette position alors que la France soutenue par Rome et Madrid conteste le bien fondé de ses bombardements, c'est à l'évidence un beau pavé lancé dans la mare de l'Union Européenne ! Que Bonn et Paris ne soit pas, encore une fois, sur la même longueur d'onde n'est pas nouveau. Les divergences entre les deux cotés du Rhin n'ont cessé de s'accumuler depuis 1995. Il n'en va pas de même quant au coin enfoncé à cette occasion entre l'impérialisme français et britannique. Depuis la guerre en ex-Yougoslavie, la France et la Grande-Bretagne n'ont cessé de renforcer leur coopération (ils ont signé dernièrement un accord militaire de grande importance, auquel s'est associé l'Allemagne, pour la construction commune de missiles de croisière) et leur « amitié » au point que l'aviation anglaise a participé au défilé du dernier 14 Juillet à Paris. A travers ce projet Londres exprimait, on ne peut plus clairement, sa volonté de rompre avec une longue tradition de coopération et de dépendance militaire vis à vis de Washington. Est ce que le soutien apporté par Londres à l'intervention américaine en Irak signifie que « la perfide Albion » cède enfin aux multiples pressions exercés par les Etats-Unis à son encontre pour la ramener dans leur giron et qu'elle va désormais redevenir le fidèle lieutenant de « l'Oncle Sam » ? Non car cet appui ne représente pas un acte d'allégeance au parrain d'outre-Atlantique mais la défense des intérêts particuliers de l'impérialisme anglais au Moyen-Orient et en particulier en Irak. Après avoir été un protectorat britannique, ce pays a progressivement échappé à l'influence de Londres notamment depuis l'arrivée de Saddam Hussein. La France, par contre, y acquérait de solides positions ; positions qui ont été réduites à la portion congrue suite à la guerre du Golfe mais qu'elle est en train de regagner grâce à l'affaiblissement du leadership US sur le Moyen-Orient. Dans ses conditions le seul espoir pour la Grande-Bretagne de retrouver une influence dans cette zone réside dans le renversement du boucher de Bagdad. C'est aussi la raison pour laquelle Londres s'est toujours retrouvée sur la même ligne dure que Washington concernant les résolutions de l'ONU à propos de l'Irak, tandis que Paris, au contraire, n'a cessé de plaider pour un adoucissement de l'embargo pesant sur l'Irak imposé par le gendarme américain.
Si « le chacun pour soi » est une tendance générale qui sape le leadership américain elle se manifeste aussi chez ses contestataires et fragilise toutes les alliances impérialistes qui, quelque soit leur relative solidité, à l'image de celle entre Londres et Paris, sont beaucoup plus à géométrie variable que celles qui prévalaient à l'époque où la présence d'un ennemi commun permettait l'existence des blocs. Les Etats-Unis même s'ils sont les principales victimes de cette nouvelle situation historique générée par la décomposition du système ne peuvent que chercher à exploiter à leur avantage « le chacun pour soi » qui régit l'ensemble des rapports inter impérialistes. Ils l'ont déjà fait dans l'ex-Yougoslavie en n'hésitant pas à nouer une alliance tactique avec leur rival le plus dangereux, l'Allemagne, et ils tentent aujourd'hui la même manoeuvre par rapport au tandem franco-britannique. Malgré ses limites, le coup ainsi porté à « l'unité » franco-britannique représente un succès indéniable pour Clinton et la classe politique américaine ne s'y est pas trompée en apportant un soutien unanime à l'opération en Irak.
Cependant ce succès américain a une portée très limitée et ne peut véritablement endiguer le déchaînement du « chacun pour soi » qui mine en profondeur le leadership de la première puissance mondiale, ni résoudre l'impasse dans laquelle se retrouvent les Etats-Unis. A certains égards, même si les Etats-Unis conservent grâce à leur puissance économique et financière, une force que n'a jamais eu le leader du bloc de l'Est, on peut cependant faire un parallèle entre la situation actuelle des Etats-Unis et celle de la défunte URSS du temps du bloc de l'Est. Comme elle, fondamentalement ils ne disposent, pour préserver leur domination, que de l'usage répété de la force brute et cela exprime toujours une faiblesse historique. Cette exacerbation « du chacun pour soi » et l'impasse dans laquelle se trouve « le gendarme du monde » ne font que traduire l'impasse historique du mode de production capitaliste. Dans ce cadre les tensions impérialistes entre les grandes puissances ne peuvent qu'aller crescendo, porter la destruction et la mort sur des zones toujours plus étendues de la planète et aggraver encore l'effroyable chaos qui est déjà le lot de continents entiers. Une seule force est en mesure de s'opposer à cette sinistre extension de la barbarie en développant ses luttes et en remettant en cause le système capitaliste mondial jusque dans ses fondements : le prolétariat.
RN, 9 septembre 1996
Géographique:
- Moyen Orient [132]
Questions théoriques:
- Impérialisme [321]
Crise economique : une economie de casino
- 4314 reads
- Le 26 mai 1996, la bourse de New York était dans l'euphorie du centenaire de la naissance de son plus ancien indicateur, l'indice Dow Jones. Gagnant 620 % durant ces 14 dernières années, l'évolution de l'indice dépassait de loin tous ses précédents records : celui des années 1920 (468 %)... menant au krach boursier d'octobre 1929, prémisse de la grande crise des années 1930 et celui des années de « prospérité » d'après-guerre (487 % entre 1949 et 1966)... aboutissant à la stagnation des 16 années de « gestion keynésienne de la crise ». « Plus cette folie spéculative va durer, plus le prix à payer ensuite sera élevé » prévenait l'analyste B.M. Biggs, considérant que « les cours des entreprises américaines ne correspondent plus du tout à leur valeur réelle » (Le Monde du 27 mai 1996). Un mois plus tard à peine, Wall Street s'effondrait brutalement pour la troisième fois en huit jours entraînant dans son sillage toutes les Bourses européennes. Ces nouvelles secousses financières viennent remettre tous les discours actuels sur la « reprise américaine » et « la future prospérité européenne grâce à la monnaie unique » à leur juste place dans le rayon des accessoires destinés à tromper le « peuple » sur les enjeux et la gravité de la crise du capitalisme. A intervalles réguliers ces secousses rappellent et confirment la pertinence de l'analyse marxiste sur la crise historique du système capitaliste et mettent plus particulièrement en évidence le caractère explosif des tensions qui sont en train de s'accumuler. Et pour cause ! Confronté à son inéluctable crise de surproduction qui réapparaît ouvertement à la fin des années 1960, le capitalisme survit depuis lors essentiellement grâce à une injection massive de crédits. C'est cet endettement massif qui explique l'instabilité croissante du système économique et financier et qui engendre la spéculation effrénée et les scandales financiers à répétition : quand le profit tiré de l'activité productive se fait maigre le « profit financier facile » prend le relais.
Ainsi, pour les marxistes, cette nouvelle secousse financière était inscrite dans la situation. Dans notre résolution sur la situation internationale d'avril 96, nous écrivions ceci : « Le 11e congrès soulignait qu'un des principaux aliments de cette 'reprise', que nous avions qualifiée alors de 'reprise sans emplois', résidait dans une fuite en avant dans l'endettement généralisé qui ne pourrait aboutir à terme qu'à de nouvelles convulsions dans la sphère financière et à une nouvelle plongée dans une récession ouverte » (Revue Internationale n °86). Essoufflement de la croissance, enfoncement dans la récession, fuite en avant dans l'endettement croissant, déstabilisation financière et spéculation, développement de la paupérisation, attaque massive contre les conditions de vie du prolétariat au niveau mondial, tels sont les ingrédients connus d'une situation de crise qui atteint des proportions explosives.
Une situation économique de plus en plus dégradée
La croissance actuelle des pays industrialisés vivote péniblement autour de 2 %, contrastant nettement avec les 5 % des années d'après-guerre (1950-70). Elle poursuit son irrémédiable déclin depuis la fin des années 1960 : 3,6 % entre 1970-80 et 2,9 % entre 1980-93. A l'exception de quelques pays du sud-est asiatique, dont la surchauffe économique préfigure de nouveaux crashs à la mexicaine, cette tendance au déclin du taux de croissance est continue et généralisée à l'échelle mondiale. Longtemps l'endettement massif a pu masquer ce fait et maintenir à intervalles réguliers la fiction d'une possible sortie du tunnel. Ce furent les « reprises » successives de la fin des années 1970 et 1980 dans les pays industrialisés, les espoirs mis dans le « développement du tiers-monde et des pays de l'Est » au cours de la seconde moitié des années 1970 puis, plus récemment, les illusions répandues autour de l'ouverture et de la « reconstruction » des pays de l'ex-bloc soviétique. Mais aujourd'hui, les derniers pans de cette fiction s'effondrent. Après l'insolvabilité et la faillite du tiers-monde ainsi que le plongeon des pays de l'Est dans le marasme, ce sont les deux derniers « pays modèles » qui s'écroulent : l'Allemagne et le Japon. Longtemps présentés comme un modèle de « vertu économique » pour le premier et comme un exemple de dynamisme pour le second, l'actuelle récession qui les lamine vient remettre les pendules à l'heure. L'Allemagne, dopée pendant un certain temps par le financement de sa réunification, ne fait aujourd'hui que rétrograder dans le peloton des pays développés. L'illusion d'un retour de la croissance par la reconstruction de sa partie orientale a donc été de courte durée. Ainsi se clôture définitivement le mythe de la relance par la reconstruction des économies sinistrées des pays de l'Est (voir Revue Internationale n°73 et n°86).
Comme nous l'avions depuis longtemps mis en avant, les « remèdes » que s'applique l'économie capitaliste ne peuvent à terme que faire empirer le mal et tuer encore plus le malade.
Le cas du Japon est significatif en la matière. Seconde puissance économique de la planète, son économie représente un sixième (17 %) du produit mondial. Pays en excédent dans ses échanges extérieurs, le Japon est devenu le banquier international avec des avoirs extérieurs de plus de 1 000 milliards de dollars. Erigées en modèle et montrées en exemple à travers le monde, les méthodes japonaises d'organisation du travail représentaient, aux dires de nouveaux théoriciens, un nouveau mode de régulation qui aurait permis une sortie de l'état de crise grâce à une « formidable relance de la productivité du travail ». Ces « recettes » japonaises ont en fait partout servi à faire passer une série de mesures d'austérité comme la flexibilité accrue du travail (introduction du just in time, de la qualité totale, etc.) et du poison idéologique pernicieux comme le corporatisme d'entreprise, le nationalisme dans la défense de l'économie, etc.
Jusque tout récemment en effet, ce pays semblait encore échapper comme par miracle à la crise économique. Après avoir caracolé autour de 10 % de croissance entre 1960-70, il affichait encore des taux appréciables de l'ordre de 5 % au cours des années 1970 et de 3,5 % pendant les années 1980. Depuis 1992 cependant, la croissance n'a pas dépassé le chiffre de 1 %. Ainsi, tout comme l'Allemagne, le Japon a rejoint le peloton des croissances poussives des principales économies développées. Il n'y avait que les sots ou les pires suppôts idéologiques du système capitaliste pour croire ou faire croire à la singularité du Japon. Les performances de ce dernier s'expliquent aisément. Certes quelques facteurs internes spécifiques ont bien pu intervenir, mais plus fondamentalement ce pays a bénéficié d'une conjonction particulièrement favorable au sortir de la seconde guerre mondiale et surtout, plus encore que pour d'autres pays, il a largement utilisé et abusé du crédit. Pion central dans le dispositif contre l'expansionnisme du bloc de l'Est en Asie, le Japon a bénéficié d'un soutien politique et économique exceptionnel de la part des Etats-Unis (réformes institutionnelles mises en place par les américains, crédits à faibles taux, ouverture du marché américain aux produits japonais, etc.). Et, élément trop rarement souligné, c'est très certainement l'un des pays les plus endettés de la planète. A l'heure actuelle, la dette cumulée des agents non financiers (ménages, entreprises et Etat) s'élève à 260 % du PNB. et atteindra les 400 % dans une dizaine d'années (cf. tableau ci-dessous). Autrement dit, c'est une avance de deux ans et demi sur la production et bientôt de quatre ans que le capital japonais s'est octroyé pour maintenir sa machine à flot.
Cette montagne de dettes représente un véritable baril de poudre dont la mèche se consume déjà lentement. Cela est d'autant plus catastrophique, non seulement pour le pays lui-même mais pour l'ensemble de l'économie mondiale, que le Japon constitue la caisse d'épargne de la planète, assurant à lui seul 50 % des financements des pays de l'OCDE. Tout ceci vient relativiser l'annonce au Japon des quelques frémissements de croissance à la hausse après ces quatre années de stagnation. Nouvelle apaisante pour les médias bourgeois, elle n'illustre en fait que l'extrême gravité de la crise. Et pour cause, ce résultat n'a péniblement été atteint qu'à la suite d'une injection de doses massives de liquidités financières à travers la mise en oeuvre de cinq plans de relance. Cette expansion budgétaire, dans la plus pure tradition keynésienne, a bien fini par porter quelques fruits... mais au prix de déficits encore plus colossaux que ceux dont les conséquences avaient déterminé l'entrée du Japon dans la phase récessive. Ceci explique que cette « reprise » demeure on ne peut plus fragile et est vouée à terme à retomber comme un soufflé. L'ampleur de la dette publique japonaise, qui représente 60 % du PIB, dépasse aujourd'hui celle des Etats-Unis. Compte tenu des crédits déjà engagés et de l'effet boule de neige, cette dette atteindra dans dix ans 200 % du PIB, ou encore l'équivalent de deux ans de salaire moyen pour chaque japonais. Quand au déficit budgétaire courant il s'élevait à 7,6 % du PIB en 1995, très loin des critères de convergences « jugés acceptables » de Maastricht et des 2,8 % des Etats-Unis la même année. Tout cela sans compter que les conséquences de l'éclatement de la bulle spéculative immobilière de la fin des années 1980 n'ont pas encore produit tous leurs effets et ceci dans le contexte d'un système bancaire très fragilisé. En effet, ce dernier peine à éponger ses pertes massives ; de nombreuses institutions financières ont fait faillite ou sont sur le point de déposer leur bilan. Rien que dans ce domaine, l'économie japonaise doit faire face dès à présent à une montagne de 460 milliards de dollars de dettes insolvables. Un indice de l'extrême fragilité de ce secteur est donné par le classement effectué en octobre 1995 par la firme américaine Moody's, spécialisée en analyse de risques. Elle attribuait un « D » au Japon, ce qui en faisait le seul membre de l'OCDE à se retrouver en compagnie de la Chine, du Mexique et du Brésil. Sur les onze banques commerciales classées par Moody's, cinq seulement disposaient d'actifs supérieurs à leurs créances douteuses. Parmi les 100 premières banques au niveau mondial, 29 sont japonaises (dont les 10 premières), alors que les Etats-Unis n'en placent que neuf et dont la première est à la 26e place. Si l'on cumule les dettes des organismes financiers évoquées ici, aux dettes des autres agents économiques (cf. ci-dessus), on engendre un monstre à côté duquel les reptiles de l'ère secondaire font office d'animaux de compagnie.
Un capitalisme drogué qui engendre une économie de casino
Contrairement à une légende savamment entretenue pour justifier les multiples plans d'austérité, le capitalisme n'est pas en train de s'assainir. La bourgeoisie veut nous faire croire qu'il faut aujourd'hui payer pour les folies des années 1970 afin de repartir sur des bases assainies. Rien n'est plus faux, l'endettement est encore le seul moyen dont dispose le capitalisme pour repousser les échéances de l'explosion de ses propres contradictions... et il ne s'en prive pas, contraint qu'il est de poursuivre sa fuite en avant. En effet, la croissance de l'endettement est là pour pallier à une demande devenue historiquement insuffisante depuis la première guerre mondiale. La conquête entière de la planète au tournant de ce siècle représente le moment à partir duquel le système capitaliste est en permanence confronté à une insuffisance de débouchés solvables pour assurer son « bon » fonctionnement. Régulièrement confronté à l'incapacité d'écouler sa production, le capitalisme s'auto-détruit dans des conflits généralisés. Ainsi, le capitalisme survit dans une spirale infernale et grandissante de crises (1912-1914 ; 1929-1939 ; 1968-aujourd'hui), guerres (1914-1918 ; 1939-1945) et reconstructions (1920-1928 ; 1946-1968).
Aujourd'hui, la baisse du taux de profit et la concurrence effrénée que se livrent les principales puissances économiques poussent à une productivité accrue qui ne fait qu'accroître la masse de produits à réaliser sur le marché. Cependant, ces derniers ne peuvent être considérés comme marchandises représentant une certaine valeur que s'il y a eu vente. Or, le capitalisme ne crée pas ses propres débouchés spontanément, il ne suffit pas de produire pour pouvoir vendre. Tant que les produits ne sont pas vendus, le travail reste incorporé à ces derniers ; ce n'est que lorsque la production a socialement été reconnue utile par la vente que les produits peuvent être considérés comme des marchandises et que le travail qu'ils incorporent se transforme en valeur.
L'endettement n'est donc pas un choix, une politique économique que les dirigeants de ce monde pourraient suivre ou non. C'est une contrainte, une nécessité inscrite dans le fonctionnement et les contradictions même du système capitaliste (lire notre brochure sur La Décadence du capitalisme). Voilà pourquoi l'endettement de tous les agents économiques n'a fait que se développer au cours du temps et particulièrement ces dernières années.
Dettes des agents non financiers (*) rapportées au PIB pour les cinq principaux pays développés
|
|
Ménages
|
Entreprises
|
Etats
|
Total
|
||||
|
|
1980
|
1992
|
1980
|
1992
|
1980
|
1994
|
1980
|
1992-94
|
|
USA
|
49 %
|
68 %
|
52 %
|
60 %
|
38 %
|
64 %
|
139 %
|
192 %
|
|
G.B.
|
38 %
|
82 %
|
94 %
|
180 %
|
-
|
50 %
|
-
|
312 %
|
|
Japon
|
42 %
|
62 %
|
89 %
|
136 %
|
52 %
|
79 %
|
183 %
|
277 %
|
|
France
|
45 %
|
52 %
|
56 %
|
71 %
|
-
|
48 %
|
-
|
171 %
|
|
Allemagne
|
50 %
|
51 %
|
64 %
|
72 %
|
-
|
54 %
|
-
|
177 %
|
(*) Pour être
complet, il faudrait encore ajouter à ces statistiques les données, plus
difficilement disponibles,
de la dette contractée par les organismes financiers.
Ce colossal endettement du système capitaliste qui s'élève à des montants et des taux jamais atteints dans toute son histoire est la véritable source de l'instabilité croissante du système financier mondial. Il est d'ailleurs significatif de constater que, depuis un petit temps déjà, la Bourse semble intégrer dans son fonctionnement le déclin irréversible de l'économie capitaliste ; c'est dire le haut degré de confiance qui règne encore dans la classe capitaliste sur l'avenir de son propre système ! Alors qu'en temps normal les valeurs des actifs boursiers (actions, etc.) s'élèvent lorsque la santé et les perspectives des entreprises sont positives et diminuent dans le cas contraire, aujourd'hui l'évolution est à la hausse à l'annonce de mauvaises nouvelles et à la baisse lorsque les perspectives sont positives. Ainsi le fameux Dow Jones a gagné 70 points en une seule journée à l'annonce du chiffre de chômage américain en hausse au mois de juillet 1996. De même, les actions d'ATT se sont envolées à l'annonce de 40 000 licenciements et les actions de Moulinex en France ont grimpé de 20 % au moment de la décision du licenciement de 2 600 personnes, etc. Inversement, lors de la publication de chiffres officiels du chômage en baisse, le cours des actions s'oriente à la baisse ! Signe des temps, les bénéfices actuels sont escomptés non plus sur la croissance du capitalisme mais sur la rationalisation.
« Si un homme comme moi peut casser une monnaie, c'est qu'il y a quelque chose de pervers dans le système », a récemment déclaré George Soros, qui, en 1992, gagna 5 milliards de francs français en spéculant contre la livre sterling. Mais cette perversion du système n'est pas le produit de « l'incivisme » ou de la trop grande avidité de certains spéculateurs, des nouvelles libertés de circulation des capitaux au niveau international ou des progrès de l'informatique et des moyens de communication, comme se plaisent à nous le seriner les médias bourgeois au chevet du capitalisme. Les croissances poussives et la mévente généralisée se traduisent par un excédent de capitaux qui ne trouvent plus à s'investir productivement. La crise s'exprime donc aussi par le fait que les profits tirés de la production ne trouvent plus de débouchés suffisants dans des investissements rentables susceptibles de développer les capacités de production. La « gestion de la crise » consiste alors à trouver d'autres débouchés à cet excédent de capitaux flottants de manière à éviter leur dévalorisation brutale. Etats et institutions internationales s'emploient à accompagner les conditions rendant cette politique possible. Là résident les raisons des nouvelles politiques financières mises en place et la « liberté » retrouvée pour les capitaux.
A cette raison fondamentale vient s'ajouter la politique américaine de défense de son statut de première puissance économique internationale qui n'a fait qu'amplifier le processus. La stabilité antérieure du système financier et des taux de change était la conséquence de la domination américaine sans partage au lendemain de la seconde guerre mondiale qui se traduisait par la « faim de dollars ». A l'issue de la reconstruction compétitive de l'Europe et du Japon, un des moyens pour les Etats-Unis de prolonger artificiellement leur domination et de garantir l'achat des marchandises américaines a été de dévaluer leur monnaie et d'inonder l'économie en dollars. Cette dévaluation et cet excès de dollars sur le marché n'ont fait qu'amplifier la surproduction de capitaux résultant de la crise des investissements productifs. Des masses de capitaux ont ainsi flotté ne sachant plus très bien où aller s'investir. La libéralisation progressive des opérations financières, conjuguée avec le passage forcé aux changes flottants, a permis que cette masse gigantesque de capitaux trouve divers « débouchés » dans la spéculation, les opérations financières et les prêts internationaux douteux. On sait qu'aujourd'hui, face à un commerce mondial de l'ordre de 3 000 milliards de dollars, les mouvements de capitaux internationaux sont estimés être de l'ordre de 100 000 milliards (30 fois plus !). Sans l'ouverture des frontières et les changes flottants, le poids mort représentant cette masse eût encore plus intensément aggravé la crise.
Le capitalisme dans l'impasse
Les idéologues du capital ne voient la crise au niveau de la spéculation que pour mieux la cacher au niveau réel. Ils croient et font croire que les difficultés au niveau de la production (chômage, surproduction, endettement, etc.) sont le produit des excès spéculatifs alors qu'en dernière instance, s'il y a « folie spéculative », « déstabilisation financière », c'est parce qu'il y avait déjà des difficultés réelles. La « folie » que les différents « observateurs critiques » constatent au niveau financier mondial n'est pas le produit de quelques dérapages de spéculateurs avides de profits immédiats. Cette folie n'est que la manifestation d'une réalité beaucoup plus profonde et tragique : la décadence avancée, la décomposition du mode de production capitaliste, incapable de dépasser ses contradictions fondamentales et empoisonné par l'utilisation de plus en plus massive de manipulations de ses propres lois depuis bientôt près de trois décennies.
Le capitalisme n'est plus un système conquérant, s'étendant inexorablement, pénétrant tous les secteurs des sociétés et toutes les régions de la planète. Le capitalisme a perdu la légitimité qu'il avait pu acquérir en apparaissant comme un facteur de progrès universel. Aujourd'hui, son triomphe apparent, repose sur un déni de progrès pour l'ensemble de l'humanité. Le système capitaliste est de plus en plus brutalement confronté à ses propres contradictions insurmontables. Pour paraphraser Marx, les forces matérielles engendrées par le capitalisme – marchandises et forces de travail –, parce qu'appropriées privativement, se dressent et se rebellent contre lui. La véritable folie ce n'est pas la spéculation mais le maintien du mode de production capitaliste. L'issue pour la classe ouvrière, et pour l'humanité ne réside pas dans une quelconque politique contre la spéculation ou le contrôle des opérations financières mais dans la destruction du capitalisme lui-même.
C. Mcl
Sources
- Les données concernant l'endettement des ménages et des entreprises sont tirées du livre de Michel Aglietta, Macroéconomie financière, Ed. La Découverte, collection Repères n° 166. Sa source est l'OCDE sur la base des comptes nationaux.
- Les données concernant l'endettement des Etats sont tirées du livre publié annuellement L'état du monde 1996, Ed. La Découverte.
- Les données citées dans le texte sont issues des journaux Le Monde et Le Monde Diplomatique.
Récent et en cours:
- Crise économique [28]
Mouvement ouvrier : le marxisme contre la franc-maçonnerie
- 17746 reads
C'est suite à l'exclusion d'un de ses militants ([1] [2664]) que le CCI a été amené à approfondir ce quel furent les positions des révolutionnaires face à l'infiltration de la franc-maçonnerie au sein du mouvement ouvrier. En effet, pour justifier la fondation d’un réseau d' « initiés » au sein de l’organisation, cet ex-militant distillait l'idée selon laquelle sa passion pour les idéologies ésotériques et les « connaissances secrètes » permettait une meilleure compréhension de l'histoire, allant « au-delà » du marxisme. Il affirmait également que de grands révolutionnaires comme Marx et Rosa Luxemburg connaissaient l'idéologie franc-maçonne, ce qui est vrai, mais il laissait entendre qu’eux-mêmes étaient peut-être aussi franc-maçons. Face à ce type de falsifications éhontées visant à dénaturer le marxisme, il est nécessaire de rappeler le combat sans merci mené depuis plus d'un siècle par les révolutionnaires contre la franc-maçonnerie et les sociétés secrètes qu'ils considéraient comme des instruments au service de la classe bourgeoise. C'est l'objet de cet article.
A l’opposé de l’indifférentisme politique anarchiste, les marxistes ont toujours défendu que le prolétariat, pour pouvoir accomplir sa mission historique, devait comprendre tous les aspects essentiels du fonctionnement de son ennemi de classe. Comme classe exploiteuse, ces ennemis du prolétariat enploient nécessairement le secret et la tromperie dans leurs luttes entre eux et contre la classe ouvrière. C’est pourquoi Marx et Engels, dans toute une série d’écrits importants, ont dénoncé face à la classe ouvrière les structures et activités secrètes de la classe dominante.
Ainsi, dans ses « Révélations de l’histoire diplomatique du 18e siècle », basées sur une étude exhaustive des manuscrits diplomatiques du British Museum, Marx dénonça la collaboration secrète des ministères britannique et russe depuis l’époque de Pierre le Grand. Dans ses écrits contre Lord Palmerston, Marx révéla que la poursuite de cette alliance secrète était essentiellement dirigée contre les mouvements révolutionnaires à travers l’Europe. En fait, au cours des deux premiers tiers du 19e siècle, la diplomatie russe, bastion de la contre-révolution à l’époque, était impliquée dans « tous les soulèvements et conspirations » du moment, y compris les sociétés secrètes insurrectionnelles telles que les Carbonari, essayant de les manipuler à ses propres fins. ([2] [2665])
Dans sa brochure contre « Monsieur Vogt » Marx mit en lumière comment Bismarck, Palmerston et le Tsar soutenaient les agents du Bonapartisme sous Napoléon III en France en infiltrant et dénigrant le mouvement ouvrier. Les moments marquants du combat du mouvement ouvrier contre ces manoeuvres cachées furent la lutte des marxistes contre Bakounine dans la 1re Internationale et des « Eisenachiens » contre l’utilisation des « Lassaliens » par Bismarck en Allemagne.
En combattant la bourgeoisie avec sa fascination du caché et du mystère, Marx et Engels montrèrent que le prolétariat est l’ennemi de toute politique de secret et de mystification quelle qu’elle soit. A l’opposé du travailliste britannique Urquhart – dont la lutte pendant près de 50 ans contre les politiques secrètes de la Russie dégénéra en une « doctrine ésotérique secrète » d’une diplomatie russe « toute puissante » comme le « seul facteur actif de l’histoire moderne » (Engels) –, le travail des fondateurs du marxisme sur cette question fut toujours basé sur une approche matérialiste, scientifique et historique. Cette méthode démasqua l’ « ordre jésuite » caché de la Russie et de la diplomatie occidentale et démontra que les sociétés secrètes des classes dominantes étaient le produit de l’absolutisme et des « lumières » du 18e siècle, pendant lequel la royauté imposa une collaboration entre la noblesse déclinante et la bourgeoisie ascendante. L’ « internationale artistocratique-bourgeoise des lumières » à laquelle se référait Engels dans ses articles sur la politique étrangère tsariste, fournit aussi la base sociale pour la franc-maçonnerie qui surgit en Grande-Bretagne, le pays classique du compromis entre l’artistocratie et la bourgeoisie. Alors que l’aspect bourgeois de la franc-maçonnerie attira beaucoup de révolutionnaires bourgeois au 18e et au début du 19e siècle, particulièrement en France et aux Etats-Unis, son caractère profondément réactionnaire en fit très tôt une arme surtout dirigée contre la classe ouvrière. Ce fut le cas après le soulèvement socialiste de la classe ouvrière qui poussa rapidement la bourgeoisie à abandonner l’athéisme matérialiste de sa propre jeunesse révolutionnaire. Dans la seconde moitié du 19e siècle, la franc-maçonnerie européenne, qui avait été surtout jusque là le divertissement d’une aristocratie qui s’ennuyait parce qu’elle avait perdu sa fonction sociale, devint de plus en plus un bastion du nouvel athéisme anti-matérialiste de la bourgeoisie dirigé essentiellement contre le mouvement ouvrier. Au sein du mouvement maçonnique, toute une série d’idéologies se développèrent contre le marxisme, idéologies qui devaient devenir plus tard le dénominateur commun des mouvements contre-révolutionnaires du 20e siècle. Selon une de ces idéologies, le marxisme lui-même était une création de l’aile « illuminée » de la franc-maçonnerie allemande contre laquelle les « vrais » franc-maçons devaient se mobiliser. Bakounine, lui-même franc-maçon actif, fut le père d’une autre de ces allégations que le marxisme était une « conspiration juive » : « Tout ce monde juif, comprenant une seule secte dominante, une espèce de gens suceurs de sang, une sorte de parasite collectif, destructif, organique, qui va au-delà non seulement des frontières des Etats mais aussi des opinions politiques, ce monde est maintenant, au moins pour sa plus grande partie, à la disposition de Marx d’un côté, et de Rotschild de l’autre (...) Ceci peut paraître étrange. Que peut-il y avoir de commun entre le socialisme et une grande banque ? Le point est que le socialisme autoritaire, le communisme marxiste, exige une forte centralisation de l’Etat. Et là où il y a centralisation de l’Etat, il doit nécessairement y avoir une banque centrale, et là où existe une telle banque on trouvera la nation juive parasite spéculant avec le Travail du peuple. » ([3] [2666])
Au contraire de la vigilance des 1re, 2e et 3e Internationales sur ces questions, une partie importante du milieu révolutionnaire actuel se contente d’ignorer ce danger ou de railler la prétendue vision « machiavélique » de l’histoire du CCI. Cette sous-estimation, liée à une ignorance évidente d’une partie importante de l’histoire du mouvement ouvrier, est le résultat de 50 ans de contre-révolution, qui ont interrompu la transmission de l’expérience organisationnelle marxiste d’une génération à l’autre.
Cette faiblesse est d’autant plus dangereuse que l’utilisation au cours de ce siècle des sectes et idéologies mystiques a atteint des dimensions allant beaucoup plus loin que la simple question de la franc-maçonnerie posée dans la phase ascendante du capitalisme. Ainsi, la majorité des sociétés secrètes anti-communistes, qui furent créées entre 1918 et 1923 contre la révolution allemande, n’avaient pas toute leur origine dans la franc-maçonnerie mais furent montées de toutes pièces par l’armée, sous le contrôle d’officiers démobilisés. En tant qu’instruments directs de l’Etat capitaliste contre la révolution communiste, elles furent démantelées dès que le prolétariat fut défait. De même, depuis la fin de la contre-révolution à la fin des années 1960, la franc-maçonnerie classique n’est qu’un aspect de tout un dispositif de sectes religieuses, ésotériques, racistes, aux idéologies, qui déclarent la guerre au matérialisme et au concept de progrès historique, avec une influence considérable dans les pays industrialisés. Ce dispositif constitue une arme supplémentaire de la bourgeoisie contre la classe ouvrière.
La Première Internationale contre les sociétés secrètes
Déjà la Première Internationale a été la cible d'attaques enragées de la part de l'occultisme. Les adeptes du mysticisme catholique des carbonaristes et du mazzinisme étaient des adversaires déclarés de l'Internationale. A New York, les adeptes de l'occultisme de Virginia Woodhull essayèrent d'introduire le féminisme, l' « amour libre » et les « expériences parapsychologiques » dans les sections américaines. En Grande-Bretagne et en France, les loges maçonniques de l'aile gauche de la bourgeoisie, appuyées par les agents bonapartistes, organisèrent une série de provocations visant à discréditer l'Internationale et à permettre l'arrestation de ses membres, ce qui obligea le Conseil Général à exclure Pyat et ses partisans, et à les dénoncer publiquement. Mais le plus grand danger est venu de l'Alliance de Bakounine, une organisation secrète dans l'Internationale qui, avec les différents niveaux d' « initiation » de ses membres « aux secrets » et avec ses méthodes de manipulation (le Catéchisme révolutionnaire de Bakounine) reproduisait exactement l'exemple de la franc-maçonnerie.
On connaît bien l'énorme engagement que Marx et Engels ont manifesté pour repousser ces attaques, pour démasquer Pyat et ses partisans bonapartistes, pour combattre Mazzini et les actions de Woodhull, et par-dessus tout pour mettre à nu le complot de l'Alliance de Bakounine contre l'Internationale (voir la Revue Internationale n °84 et 85). La pleine conscience qu'ils avaient de la menace que constitue l'occultisme se retrouve dans la résolution proposée par Marx lui-même, adoptée par le Conseil général, sur la nécessité de combattre les sociétés secrètes. A la conférence de Londres de L'AIT, en septembre 1871, Marx insistait sur le fait que « ce type d'organisation se trouve en contradiction avec le développement du mouvement prolétarien, à partir du moment où ces sociétés, au lieu d'éduquer les ouvriers, les soumettent à leur lois autoritaires et mystiques qui entravent leur indépendance et entraînent leur conscience dans une fausse direction. » (Marx-Engels, Oeuvres)
La bourgeoisie aussi a essayé de discréditer le prolétariat à travers les allégations des médias suivant lesquelles l'Internationale et la Commune de Paris auraient toutes deux été organisées par une direction secrète de type maçonnique. Dans une interview au journal The New York World, qui suggérait que les ouvriers étaient les instruments d'un « conclave » d'audacieux conspirateurs présents au sein de la Commune de Paris, Marx déclarait : « Cher monsieur, il n'y a pas de secret à éclaircir... à moins que ce ne soit le secret de la stupidité humaine de ceux qui ignorent obstinément le fait que notre Association agit en public, et que des rapports développés de nos activités sont publiés pour tous ceux qui veulent les lire. » La Commune de Paris, selon la logique du World, « pourrait également avoir été une conspiration des francs-maçons car leur contribution n'a pas été petite. Je ne serais vraiment pas étonné si le pape venait à leur attribuer toute la responsabilité de l'insurrection. Mais envisageons une autre explication. L'insurrection de Paris a été faite par les ouvriers parisiens. »
Le combat contre le mysticisme dans la Deuxième Internationale
Avec la défaite de la Commune de Paris et la mort de l'Internationale, Marx et Engels ont appuyé le combat pour soustraire de l'influence de la franc-maçonnerie des organisations ouvrières dans des pays comme l'Italie, l'Espagne ou les Etats-Unis (les « Chevaliers du Travail »). La Deuxième Internationale, fondée en 1889, était, au début, moins vulnérable que la précédente à l'infiltration occultiste, car elle avait exclu les anarchistes. L'ouverture même du programme de la Première Internationale avait permis à des « éléments déclassés de s'y faufiler et d'établir, en son coeur même, une société secrète dont les efforts, au lieu d'être dirigés contre la bourgeoisie et les gouvernements existants, l'étaient contre l'Internationale elle-même. » (Rapport sur l'Alliance au congrès de La Haye, 1872)
Alors que la Deuxième Internationale était moins perméable sur ce plan, les attaques ésotériques commencèrent, non pas au moyen d'une infiltration organisationnelle, mais à travers une offensive idéologique contre le marxisme. A la fin du 19e siècle, la franc-maçonnerie allemande et autrichienne se vantait d'avoir réussi à libérer les universités et les cercles scientifiques du « fléau du matérialisme ». Avec le développement des illusions réformistes et de l'opportunisme dans le mouvement ouvrier, au début du siècle, c'est à partir de ces scientifiques d'Europe centrale que le mouvement bernsteinien adopta « la découverte » du « dépassement du marxisme » par l'idéalisme et l'agnosticisme néo-kantien. Dans le contexte de la défaite du mouvement prolétarien en Russie après 1905, la maladie de la « construction de Dieu » pénétra jusque dans les rangs du bolchevisme, d'où elle fut néanmoins rapidement éradiquée. Au sein de l'Internationale comme un tout, la gauche marxiste développa une défense héroïque et brillante du socialisme scientifique, sans pour autant être capable de stopper l'avancée de l'idéalisme, si bien que la franc-maçonnerie commença à gagner des adeptes dans les rangs des partis ouvriers. Jaurès, le fameux leader ouvrier français, défendait ouvertement l'idéologie de la franc-maçonnerie contre ce qu'il appelait « l'interprétation économiste pauvre et étroitement matérialiste de la pensée humaine » du révolutionnaire marxiste Franz Mehring. Dans le même temps, le développement de l'anarcho-syndicalisme en réaction au réformisme ouvrit un nouveau champ pour le développement d'idées réactionnaires, parfois mystiques, basées sur les écrits de philosophes comme Bergson, Nietzsche (celui-ci s'étant qualifié lui-même de « philosophe de l'ésotérisme ») ou Sorel. Cela, en retour, affecta des éléments anarchistes au sein de l'Internationale comme Hervé en France ou Mussolini en Italie qui, à l'éclatement de la guerre, s'en allèrent rejoindre les organisations de l'extrême-droite de la bourgeoisie.
Les marxistes tentèrent en vain d'imposer une lutte contre la franc-maçonnerie dans le parti français, ou d'interdire aux membres du parti en Allemagne une « seconde loyauté » pour ce type d'organisations. Mais, dans la période d'avant 1914, ils ne furent pas assez forts pour imposer des mesures organisationnelles semblables à celles que Marx et Engels avaient fait adopter dans l'AIT.
La Troisième Internationale contre la franc-maçonnerie
Déterminé à surmonter les faiblesses organisationnelles de la deuxième internationale qui favorisèrent sa faillite en 1914, le Komintern a lutté pour l'élimination totale des éléments « ésotériques » de ses rangs. En 1922, face à la l'infiltration au sein du Parti communiste français d'éléments appartenant à la franc-maçonnerie et qui ont gangréné le parti dès sa fondation au congrès de Tours, le 4e congrès de l'Internationale Communiste, dans sa « Résolution sur la question française » devait réaffirmer les principes de classe dans les termes suivants :
« L'incompatibilité de la franc-maçonnerie et du socialisme était considérée comme évidente dans la plupart des partis de la Deuxième Internationale (...) Si le deuxième Congrès de l'Internationale Communiste n'a pas formulé, dans les conditions d'adhésion à l'Internationale, de point spécial sur l'incompatibilité du communisme et de la franc-maçonnerie, c'est parce que ce principe a trouvé sa place dans une résolution séparée votée à l'unanimité du Congrès.
Le fait, qui s'est révélé d'une façon inattendue au 4e Congrès de l'Internationale Communiste, de l'appartenance d'un nombre considérable de communistes français aux loges maçonniques est, aux yeux de l'Internationale Communiste, le témoignage le plus manifeste et en même temps le plus pitoyable que notre Parti français a conservé, non seulement l'héritage psychologique de l'époque du réformisme, du parlementarisme et du patriotisme, mais aussi des liaisons tout à fait concrètes, extrêmement compromettantes pour la tête du Parti, avec les institutions secrètes, politiques et carriéristes de la bourgeoisie radicale (...)
L'Internationale considère comme indispensable de mettre fin, une fois pour toutes, à ces liaisons compromettantes et démoralisatrices de la tête du Parti Communiste avec les organisations politiques de la bourgeoisie. L'honneur du prolétariat de France exige qu'il épure toutes ses organisations de classe des éléments qui veulent appartenir à la fois aux deux camps en lutte.
Le Congrès charge le Comité Directeur du Parti Communiste français de liquider avant le 1er janvier 1923 toutes les liaisons du Parti, en la personne de certains de ses membres et de ses groupes, avec la franc-maçonnerie. Celui qui, avant le 1er janvier, n'aura pas déclaré ouvertement à son organisation et rendu publique par la presse du Parti sa rupture complète avec la franc-maçonnerie est, par là-même, automatiquement exclu du Parti communiste sans droit d'y jamais adhérer à nouveau, à quelque moment que ce soit. La dissimulation par quiconque de son appartenance à la franc-maçonnerie sera considérée comme pénétration dans le Parti d'un agent de l'ennemi et flétrira l'individu en cause d'une tache d'ignominie devant tout le prolétariat. »
Au nom de l'internationale, Trotsky dénonça l'existence de liens entre la « franc-maçonnerie et les institutions du parti, le comité de rédaction, le comité central » en France.
« La ligue des droits de l'homme et la franc-maçonnerie sont des instruments de la bourgeoisie qui font diversion à la conscience des représentants du prolétariat français. Nous déclarons une guerre sans pitié à ces méthodes car elles constituent une arme secrète et insidieuse de l'arsenal bourgeois. On doit libérer le parti de ces éléments. » (Trotsky, La voix de l'Internationale : le mouvement communiste en France)
De façon similaire, le délégué du Parti communiste allemand (KPD) au 3e congrès du Parti Communiste italien à Rome, en se référant aux thèses sur la tactique communiste soumises par Bordiga et Terracini, affirmait : « Le caractère irréconciliable évident entre l'appartenance simultanée au Parti Communiste et à un autre Parti, s'applique, en dehors de la pratique politique, aussi à ces mouvements qui, en dépit de leur caractère politique, n'ont pas le nom ni l'organisation d'un parti (...) on trouve ici en particulier la franc-maçonnerie. » (« Les thèses italiennes », Paul Butcher dans L'Internationale, 1922)
Le développement vertigineux des sociétés secrètes dans la décadence capitaliste
L'entrée du capitalisme dans sa phase de décadence depuis la première guerre mondiale a entraîné un gigantesque développement de l'Etat capitaliste et en particulier de ses appareils militaires et répressifs (espionnage, police secrète, etc.). Cela implique-t-il que la bourgeoisie n'avait plus besoin de ses sociétés secrètes « traditionnelles » ? Ce fut en partie le cas. Là où le totalitarisme de l'Etat capitaliste décadent a pris une forme brutale et non dissimulée comme dans l'Allemagne hitlérienne, l'Italie de Mussolini ou la Russie de Staline, les loges maçonniques ou autres, ou les regroupements secrets furent également interdits.
Cependant, même ces formes brutales de capitalisme ne peuvent complètement se dispenser d'un appareil parallèle, sans existence officielle, secret ou illégal. Le totalitarisme du capitalisme d'Etat implique le contrôle dictatorial de l'Etat bourgeois, pas seulement sur toute l'économie, mais sur l'ensemble des aspects de la vie sociale. Ainsi, dans les régimes staliniens, la mafia constitue une partie indispensable de l'Etat, dans la mesure où elle contrôle la seule partie de l'appareil de distribution qui fonctionne réellement, mais qui officiellement est supposée ne pas exister : le marché noir. Dans les pays de l'ouest, la criminalité organisée est une partie du régime de capitalisme d'Etat non moins indispensable.
Mais sous cette forme de capitalisme d'Etat prétendument démocratique, les appareils de repression et d'infiltration tant officiels que non officiels ont connu un développement pharamineux.
Sous son maquillage démocratique, l'Etat impose sa politique sur les membres de sa propre classe et combat les organisations de ses rivaux impérialistes et celles de son ennemi de classe prolétarien d'une manière pas moins totalitaire que sous le nazisme ou le stalinisme. Sa police politique officielle et son appareil d'informateurs est tout aussi omniprésent que dans n'importe quel autre Etat. Mais alors que l'idéologie « démocratique » ne permet pas à cet appareil d'agir aussi ouvertement que la Gestapo en Allemagne ou la Guépéou en Russie, la bourgeoisie occidentale est amenée à développer et à s'appuyer à nouveau sur ses anciennes traditions de franc-maçonnerie ou de mafia politique, mais cette fois sous le contrôle direct de l'Etat. Ce que la bourgeoisie occidentale ne fait pas ouvertement et légalement, elle le fait dans l'illégalité et secrètement.
Ainsi, quand l'armée américaine envahit l'Italie de Mussolini en 1943, elle n'amena pas avec elle que la Mafia.
« Dans le sillage des divisions motorisées américaines progressant vers le Nord, les loges maçonniques se développèrent comme des champignons après la pluie. Ce n'était pas seulement une réaction au fait que précédemment elles avaient été interdites par Mussolini qui avait persécuté leurs membres. Les puissants regroupements maçonniques américains participèrent à ce développement, en prenant immédiatement sous leur coupe leurs frères italiens. » ([4] [2667])
Ici se trouve l'origine de l'une des plus fameuses parmi les innombrables organisations parallèles de la bourgeoisie occidentale, la Loge de la Propagande Due (Loge P2) en Italie. Ces structures non officielles coordonnèrent la lutte des différentes bourgeoisies nationales et du bloc américain contre l'influence du bloc soviétiques rival, dans tous les aspects de la vie sociale. De telles loges recrutent aussi parmi les leaders de l'aile gauche de l'Etat capitaliste, dans les partis staliniens et gauchistes, dans les syndicats.
Une série de scandales et révélations (liés à l'éclatement du bloc de l'est après 1989) ont fait apparaître au grand jour le travail qu'assumaient de tels regroupements, au profit de l'Etat, dans la lutte contre l'ennemi impérialiste. Mais un secret de la bourgeoisie demeure soigneusement dissimulé encore : c'est le fait que, dans la décadence, sa vieille tradition d'infiltration maçonnique des organisations ouvrières a aussi fait partie du répertoire de l'appareil d'Etat du totalitarisme démocratique. Cela fut le cas à chaque fois que le prolétariat a sérieusement menacé la bourgeoisie : tout au long de la vague révolutionnaire de 1917-23, mais aussi depuis 1968 avec la fin de la contre-révolution qui a suivi la défaite de cette vague.
Un appareil contre-révolutionnaire parallèle
Comme Lénine l'a souligné, la révolution prolétarienne en Europe occidentale à la fin de la première guerre mondiale était confrontée à une classe dominante plus puissante et plus intelligente qu'en Russie. Comme en Russie, la bourgeoisie occidentale, face à la vague révolutionnaire, a joué immédiatement la carte démocratique en mettant au pouvoir la gauche, c’est-à-dire les anciens partis ouvriers, en annonçant la tenue d'élections ainsi que des projets pour la « démocratie industrielle » et pour « intégrer » les conseils ouvriers dans la constitution et l'Etat.
Mais la bourgeoisie occidentale est allée au delà de ce qu'a fait l'Etat russe après février 1917. Elle a commencé immédiatement à construire un gigantesque appareil contre-révolutionnaire parallèle à ses structures officielles.
A cette fin, elle a mis à profit l'expérience politique et organisationnelle des loges maçonniques et des ordres de la droite populaire qui s'étaient spécialisés dans le combat contre le mouvement socialiste avant la guerre mondiale, achevant ainsi leur intégration dans l'Etat. Une organisation de ce type, l' « Ordre Germanique » et « la Ligue du Marteau », fut fondée en 1912 en réponse à l'imminence de la guerre et à la victoire électorale du parti socialiste. Elle affirmait dans son journal son but « d'organiser la contre-révolution ». « La sainte vendetta liquidera les leaders révolutionnaires au tout début de l'insurrection, sans hésiter à lutter contre les masses criminelles avec leurs propres armes. » ([5] [2668])
Victor Serge fait référence aux services secrets de l' « Action Française » et des « cahiers de l'anti-France » qui renseignaient sur les mouvements d'avant-garde en France déjà pendant la guerre ; il parle des informateurs et services de provocateurs des partis fascistes en Italie et des agences de détectives privés aux Etats-Unis qui « fournissent à volonté aux capitalistes des mouchards discrets, des provocateurs experts, des tireurs d'élite, des gardes, des contremaîtres et aussi des militants syndicaux corrompus à souhait » (édition française). Et la compagnie Pinkerton est supposée employer 135 000 personnes.
« En Allemagne, les forces vitales de la réaction se concentrent, depuis le désarmement officiel du pays, dans les organisations plus qu'à demi secrètes. La réaction a compris que même aux partis secondés par l'Etat, la clandestinité est une ressource précieuse. Contre le prolétariat, il va de soi que toutes ces organisations assument plus ou moins les fonctions d'une police occulte. » ([6] [2669])
Afin de ne pas affaiblir le mythe de la démocratie, ces organisations contre-révolutionnaires en Allemagne et dans d'autres pays n'appartenaient pas officiellement à l'Etat. Elles avaient des sources de financement privées. Certaines étaient même déclarées illégales, se présentaient elles-mêmes comme ennemies de la démocratie et allaient jusqu'à assassiner des leaders « démocrates » bourgeois comme Rathenau et Erzberger, et commettre des putschs de droite (Putsch de Kapp en 1920, d'Hitler en 1923). Elles purent ainsi jouer un rôle primordial de mystification du prolétariat en le précipitant dans la défense de la contre-révolutionnaire « démocratie » de Weimar.
Le réseau contre la révolution prolétarienne
C'est à travers l'expérience en Allemagne, qui était le principal centre hors de Russie de la vague révolutionnaire de 1917-23, qu'on peut le mieux appréhender l'ampleur des opérations contre-révolutionnaires que mène la bourgeoisie lorqu'elle sent sa domination de classe menacée. Un gigantesque réseau de défense de l'Etat bourgeois fut mis en place. Ce réseau utilisa la provocation, l'infiltration et le meurtre politique pour soutenir tant les polices contre-révolutionnaires du SPD et des syndicats que la Reichswehr et la non officielle « armée blanche » des corps-francs. L'exemple le plus connu est celui du NSDAP (le parti nazi) qui fut fondé à Munich en 1919 sous le nom de « Parti des travailleurs allemands » pour lutter contre la révolution. Hitler, Göring, Röhm et les autres leaders nazis ont débuté leur carrière politique en tant qu'informateurs et agents contre les conseils ouvriers de Bavière.
Ces centres « illégaux » de la contre-révolution faisaient, en réalité, partie intégrante de l'Etat. Bien que ces spécialistes de l'assassinat, tels les meurtriers de Liebknecht et Luxemburg, et les tortionnaires de centaines de dirigeants communistes, aient été passés en jugement, soit ils furent déclarés non coupable, soit ils obtinrent des peines symboliques, soit ils purent s'échapper. Bien que leurs caches d'armes aient été découvertes par la police, l'armée réclama les armes sous prétexte qu'elles lui avaient été volées.
L’organisation Escherish (« Orgesh »), la plus importante et la plus dangereuse des armées anti-prolétariennes après le putsch de Kapp, ayant pour but déclaré de « liquider le Bolchevisme », « avait près d’un million de membres armés, possédant d’innombrables dépôts d’armes cachés, et travaillant avec les méthodes des services secrets. A cette fin, l’Orgesch a maintenu une agence de renseignement » ([7] [2670]). Et le « Teno », soi-disant un service technique intervenant en cas de catastrophe publique, était en réalité une troupe de 170 000 hommes utilisée essentiellement pour briser les grèves.
La Ligue Anti-bolchevique, fondée le 1er décembre 1918 par des industriels, orientait sa propagande en direction des ouvriers. « Elle suivit attentivement le développement du KPD (Parti communiste allemand) et essaya de l’infiltrer au moyen de ses informateurs. C’est à cette fin qu’elle mit en place un réseau d’informateurs camouflé derrière le nom de quatrième département. Elle maintint des liens avec la police politique et des unités de l’armée. » ([8] [2671])
A Munich l’occulte société de Thulé, liée à l’Ordre Germanique d’avant-guerre cité précédemment, créa l’armée blanche de la bourgeoisie bavaroise, les corps-francs Oberland, coordonna la lutte contre la république des conseils en 1919, et prit en charge le meurtre de Eisner, un dirigeant de l’USPD, dans le but de provoquer un insurrection prématurée. « Son deuxième département était son service de renseignement, avec une activité organisée et étendue d’infiltration, d’information et de sabotage. Selon Sebottendorff, chaque membre de la ligue de combat avait rapidement et sous un autre nom une carte de membre du groupe Spartacus. Les informateurs de la Ligue de Combat siégeaient également dans les comités du gouvernement des conseils et de l’armée rouge, et rapportaient chaque soir au centre de la société de Thulé les plans de l’ennemi. » ([9] [2672])
L'arme principale de la bourgeoisie contre la révolution prolétarienne n'est ni la répression ni la subversion mais l'influence idéologique et organisationnelle de ses organisations de « gauche » dans les rangs du prolétariat. C'est ce rôle essentiel qu'ont joué la social-démocratie et les syndicats. Mais le poids du soutien qu'ont représenté l'infiltration et la provocation aux efforts de la gauche du capital contre le combat des ouvriers fut particulièrement révélé par le « National-Bolchévisme » durant la révolution allemande. Influencée par le pseudo anti-capitalisme, le nationalisme extrémiste, l'antisémitisme et l'anti-libéralisme des organisations parallèles de la bourgeoisie, avec lesquelles elle tenait des réunions secrètes, la prétendue « gauche » de Hambourg autour de Laufenberg et Wollfheim a développé une version contre-révolutionnaire du « communisme de gauche » qui a contribué de façon décisive à diviser le tout nouveau KPD en 1919, et à le discréditer en 1920.
Le travail d'infiltration bourgeoise au sein de la section de Hambourg du KPD commença déjà à être découvert par le parti en 1919 quand furent démasqués environ 20 agents de la police directement en lien avec le GKSD, un régiment contre-révolutionnaire de Berlin. « A partir de là eurent lieu des tentatives répétées pour pousser les ouvriers de Hambourg à se lancer dans des attaques armées de prisons ou dans d'autres actions aventuristes. » ([10] [2673])
L'organisateur de ce travail de sape contre les communistes de Hambourg, Von Killinger, devint peu de temps après un dirigeant de l' « Organisation Consul », une organisation secrète terroriste et criminelle financée par les junkers, dont le but était l'infiltration des organisations communistes et l'unification de la lutte de tous les autres groupes de droite contre le communisme.
La défense de l'organisation révolutionnaire
Au début de cet article, nous avons vu comment les communistes internationalistes tirèrent les leçons de l'incapacité qu'avait eue la deuxième Internationale à mener un combat plus rigoureux au niveau organisationnel contre la franc-maçonnerie et les sociétés secrètes.
Déjà, le deuxième congrès mondial de l'Internationale communiste, en 1920, avait adopté une motion du parti italien contre les francs-maçons, motion qui officiellement ne faisait pas partie des « 21 conditions » pour adhérer à l'internationale mais qui officieusement était connue comme la 22e condition. En fait, les fameuses 21 conditions d'août 1920 obligèrent toutes les sections de l'Internationale à organiser des structures clandestines pour protéger l'organisation face à l'infiltration, pour faire des investigations en direction des activités de l'appareil illégal contre-révolutionnaire de la bourgeoisie. Elles les amenèrent également à soutenir le travail centralisé internationalement qui était dirigé contre les actions politiques et répressives du capital.
Le troisième congrès en juin 1921 adopta des principes destinés à mieux protéger l'Internationale contre les informateurs et agents provocateurs, par l'observation systématique des activités, officielles et secrètes, de la police, de l'appareil paramilitaire, des francs-maçons, etc. Un comité spécial, l'OMS, fut créé pour coordonner internationalement ce travail.
Le KPD, par exemple, publiait régulièrement des listes d'agents provocateurs et d'informateurs de la police exclus de ses rangs, avec leur photo et la description de leur méthodes. « D'août 1921 à août 1922 le département d'information démasqua 124 informateurs, agents provocateurs et escrocs. Soit ils avaient été envoyés dans le KPD par la police ou des organisations de droite, soit ils avaient espéré exploiter financièrement le KPD pour leur propre compte. » (4)
Des brochures furent préparées sur cette question. Le KPD découvrit aussi qui avait tué Liebknecht et Luxemburg, publia les photos des assassins et demanda l'aide de la population pour les pourchasser. Une organisation spéciale fut créée pour défendre le parti contre les sociétés secrètes et les organisations paramilitaires de la bourgeoisie. Ce travail incluait des actions spectaculaires. Ainsi, en 1921, des membres du KPD, déguisés en policiers, perquisitionnèrent les locaux d'un bureau de l'armée blanche russe à Berlin et confisquèrent les papiers. Des attaques surprises furent menées contre les bureaux secrets de la criminelle « Organisation Consul ».
Et surtout, le Kominterm alimentait régulièrement toutes les organisations ouvrières en avertissements concrets et en informations sur les experts du bras occulte de la bourgeoisie afin de l'anéantir.
Après 1968 : la renaissance des manipulations occultes contre le prolétariat
Avec la défaite de la révolution communiste après 1923, le réseau secret anti-prolétarien de la bourgeoisie fut soit dissout soit affecté à d'autres tâches par l'Etat. En Allemagne, beaucoup de ces éléments furent plus tard intégrés dans le mouvement nazi.
Mais quand les luttes ouvrières massives de 1968 en France mirent fin à 50 ans de contre-révolution et ouvrirent une nouvelle période de développement de la lutte de classe, la bourgeoisie commença à réactiver son appareil caché anti-prolétarien. En mai 1968 en France, « le Grand Orient salua avec enthousiasme le magnifique mouvement des étudiants et des ouvriers et envoya de la nourriture et des médicaments à la Sorbonne occupée. » ([11] [2674])
Ce « salut » n'était qu'hypocrisie. Dès après 1968, en France, la bourgeoisie va mettre en branle ses sectes « néo-templières », « rosicruciennes » et « martinistes » dans le but d'infiltrer les groupes gauchistes et autres, en collaboration avec les structures du SAC (le Service d'Action Civique, créé par les hommes de main de De Gaulle). Par exemple, Luc Jouret, le gourou du « Temple solaire », a commencé sa carrière d'agent d'officines parallèles semi-légales en infiltrant des groupes maoïstes ([12] [2675]), avant de se retrouver en 1978 comme médecin parmi les parachutistes belges et français qui sautèrent sur Kolwesi au Zaïre.
En fait, les années suivantes apparurent des organisations du type de celles utilisées contre la révolution prolétarienne dans les années 1920. A l'extrême-droite, le Front Européen de Libération a fait renaître la tradition du National-Bolchevisme. En Allemagne, le front Ouvrier Social Révolutionnaire, suivant sa devise : « la frontière n'est pas entre la gauche et la droite, mais entre au-dessus et en dessous », se spécialise dans l'infiltration de différentes organisations de gauche. La Loge de Thulé a également été refondée comme société secrète contre-révolutionnaire. ([13] [2676])
Parmi les services de renseignement privés de la droite moderne on trouve ceux de la Ligue Mondiale Anticommuniste, ceux du Comité du Travail ou encore ceux du Parti Européen du Travail dont le leader Larouche est décrit par un membre du Conseil National de Sécurité des Etats Unis comme ayant « le meilleur service privé de renseignement du monde. » ([14] [2677]) En Europe, certaines sectes rosicruciennes sont d'obédience américaine, d'autres d'obédience européenne telle que l' « Association Synarchique d'Empire » dirigée par la famille des Habsbourg qui a régné sur l'Europe à travers l'empire austro-hongrois.
Des versions de gauche de telles organisations contre-révolutionnaires ne sont pas moins actives. En France, par exemple, des sectes se sont constituées dans la tradition « martiniste », une variante de la franc-maçonnerie qui, dans l'histoire, s'est spécialisée dans les missions secrètes d'agents d'influence complétant le travail des services secrets officiels ou dans l'infiltration et la destruction des organisations ouvrières. De tels groupes propagent l'idée que le communisme soit n'explique pas tout et doit être enrichi ([15] [2678]), soit qu'il peut être instauré plus sûrement par les manipulations d'une minorité éclairée. Comme d'autres sectes, ils sont spécialisés dans l'art de la manipulation des personnes, pas seulement leur comportement individuel mais surtout leur action politique.
Plus généralement, le développement de sectes occultes et de regroupements ésotériques dans les dernières années n'est pas seulement l'expression du désespoir et de l'hystérie de la petite-bourgeoisie face à la situation historique mais est encouragé et organisé par l'Etat. Le rôle de ces sectes dans les rivalités impérialistes est connu (cf. l'utilisation de l'Eglise de Scientologie par la bourgeoisie américaine contre l'Allemagne). Mais tout ce mouvement « ésotérique » fait également partie de l'attaque idéologique de la bourgeoisie contre le marxisme, particulièrement depuis 1989 avec la prétendue « mort du communisme ». Historiquement, c'est face au développement du mouvement socialiste que la bourgeoisie européenne commença à s'identifier avec l'idéologie mystique de la franc-maçonnerie, particulièrement après la révolution de 1848. Aujourd'hui la haine profonde de l'ésotérisme envers le matérialisme et le marxisme, aussi bien qu'envers les masses prolétariennes considérées comme « matérialistes » et « stupides », n'est rien d'autre que la haine que concentrent la bourgeoisie et la petite-bourgeoisie face au prolétariat non vaincu. Incapable elle-même d'offrir aucune alternative historique, la bourgeoisie oppose au marxisme le mensonge selon lequel le stalinisme était du communisme mais aussi la vision mystique suivant laquelle le monde ne pourra être « sauvé » que lorsque la conscience et la rationalité auront été remplacées par les rituels, l'intuition et les supercheries.
Aujourd'hui, face au développement du mysticisme et à la prolifération des sectes occultes dans la société capitaliste en décomposition, les révolutionnaires doivent tirer les leçons de l'expérience du mouvement ouvrier contre ce que Lénine appelait « le mysticisme, ce cloaque pour les modes contre-révolutionnaires. » Ils doivent se réapproprier cette lutte implacable menée par les marxistes contre l'idéologie franc-maçonne. Ils doivent « rendre la honte plus honteuse encore en la livrant à la publicité » (comme le disait Marx) en dénonçant fermement ce type d'idéologie réactionnaire.
Au même titre que la religion, qualifiée par Marx au siècle dernier, d' « opium du peuple » les thèmes idéologiques de la franc-maçonnerie moderne sont un poison distillé par l'Etat bourgeois pour détruire la conscience de classe du prolétariat.
Le fait que le mouvement ouvrier du passé ait dû mener un combat permanent contre l'occultisme est assez peu connu aujourd'hui. En réalité, l'idéologie et les méthodes d'infiltration secrète de la franc-maçonnerie ont toujours été un des fers de lance des tentatives de la bourgeoisie pour détruire, de l'intérieur, les organisations communistes. Si le CCI, comme beaucoup d'organisations révolutionnaires du passé, a subi la pénétration en son sein de ce type d'idéologie, il est de son devoir et de sa responsabilité de communiquer à l'ensemble du milieu politique prolétarien les leçons du combat qu'il a mené pour la défense du marxisme, de contribuer à la réappropriation de la vigilance du mouvement ouvrier du passé face à la politique d'infiltration et de manipulation par l'appareil occulte de la bourgeoisie.
Kr.
Heritage de la Gauche Communiste:
Questions d'organisation, III : le congres de La Haye de 1872 : la lutte contre le parasitisme politique.
- 4337 reads
Dans les deux premiers articles de cette série, nous avons montré quelles étaient les origines de l'Alliance de Bakounine, comment elle s'est développée et de quelle façon la bourgeoisie avait soutenu et manipulé cette machine de guerre contre la Première Internationale. Nous avons vu la priorité absolue qu'ont donné à la défense des principes prolétariens de fonctionnement dans la lutte contre l'anarchisme organisationnel, Marx, Engels et tous les éléments prolétariens sains de l'Internationale. Dans cet article, nous tirerons les leçons du Congrès de La Haye qui a constitué l'un des moments les plus importants de la lutte du marxisme contre le parasitisme politique. Les sectes socialistes qui ne trouvaient désormais plus leur place dans le jeune mouvement prolétarien en plein développement, ont alors orienté le principal de leur activité à lutter non contre la bourgeoisie mais contre les organisations révolutionnaires elles-mêmes. Tous ces éléments parasites, malgré les divergences politiques existant entre eux, se sont ralliés aux tentatives de Bakounine pour détruire l'Internationale.
Les leçons de la lutte contre le parasitisme au Congrès de La Haye sont particulièrement valables aujourd'hui. A cause de la rupture de la continuité organique avec le mouvement ouvrier du passé, on peut faire bien des parallèles entre le développement du milieu révolutionnaire après 1968 et celui des débuts du mouvement ouvrier ; en particulier il existe non une identité mais une forte similarité entre le rôle du parasitisme politique à l'époque de Bakounine et celui qu'il joue aujourd'hui.
La tâche des révolutionnaires après la Commune de Paris
Le Congrès de La Haye de la Première Internationale en 1872 est l'un des Congrès les plus célèbres du mouvement ouvrier. C'est à ce Congrès qu'a eu lieu la « confrontation » historique entre le marxisme et l'anarchisme. Ce Congrès a accompli un pas décisif dans le dépassement de la phase sectaire qui avait marqué les premières années du mouvement ouvrier. A La Haye, le Congrès a jeté les bases pour le dépassement de la séparation entre les organisations socialistes d'un côté et les mouvements de masse de la lutte de classe de l'autre. Le Congrès a fermement condamné le « rejet » petit-bourgeois de « la politique » par les anarchistes ainsi que leurs « réserves » vis-à-vis des luttes défensives de la classe. Surtout, il a déclaré que l'émancipation du prolétariat nécessitait qu'il s'organise en parti politique autonome, en opposition à tous les partis des classes possédantes (« Résolution sur les statuts », Congrès de La Haye).
Ce n'est pas un hasard si c'est à ce moment-là que furent traitées ces questions. Le Congrès de La Haye était le premier congrès international à se tenir après la défaite de la Commune de Paris. Il a eu lieu pendant la vague internationale de terreur réactionnaire qui s'est abattue sur le mouvement ouvrier au lendemain de cette défaite. La Commune de Paris avait montré le caractère politique de la lutte de classe prolétarienne. Elle avait montré la nécessité et la capacité de la classe révolutionnaire à organiser la confrontation avec l'Etat bourgeois, sa tendance historique à détruire cet Etat et à le remplacer par la dictature du prolétariat, pré-condition du socialisme. Elle avait montré à la classe ouvrière qu'elle ne pouvait mettre en oeuvre le socialisme par des expériences coopératives de type proudhonien, ni par des pactes avec la classe dominante tels que les proposaient les lassalliens, ni, non plus, grâce à l'action audacieuse d'une minorité décidée comme Blanqui le défendait. Par dessus tout, la Commune de Paris a montré à tous les authentiques révolutionnaires prolétariens que la révolution socialiste n'est en aucune façon une orgie d'anarchie et de destruction, mais un processus organisé et centralisé ; et que l'insurrection ouvrière n'amène pas à l'« abolition » immédiate des classes, de l'Etat et de l'« autorité » mais requiert, de façon impérieuse, l'autorité de la dictature du prolétariat. En d'autres termes, la Commune de Paris a totalement prouvé la position du marxisme et complètement évincé les « théories » des bakouninistes.
En fait, au moment du Congrès de La Haye, les meilleurs représentants du mouvement ouvrier prenaient conscience du poids qu'avaient eu dans la direction de l'insurrection, les proudhoniens, les blanquistes, les bakouninistes et autres sectaires ; ce poids avait constitué la faiblesse principale de la Commune. Il était lié à l'incapacité de l'Internationale à avoir une influence dans les événements de Paris de la façon centralisée et coordonnée d'un parti de classe.
Aussi, après la chute de la Commune de Paris, la priorité absolue pour le mouvement ouvrier a été de secouer le joug de son propre passé sectaire, de surmonter l'influence du socialisme petit-bourgeois.
Tel est le cadre politique qui explique le fait que la question centrale traitée au Congrès de La Haye n'a pas été la Commune de Paris elle-même mais la défense des statuts de l'Internationale contre les complots de Bakounine et de ses adeptes. Les historiens bourgeois que cela déconcerte en ont conclu que ce Congrès était lui-même l'expression du sectarisme puisque l'Internationale avait « préféré » traiter d'elle-même plutôt que des résultats d'un événement de la lutte de classe d'une importance historique. Ce que ne peut pas comprendre la bourgeoisie, c'est que la défense des principes politiques et organisationnels du prolétariat, l'élimination des théories et des attitudes organisationnelles petites-bourgeoises de ses rangs constituaient la réponse nécessaire des révolutionnaires à la Commune de Paris.
Aussi les délégués se rendirent-ils à La Haye non seulement pour répondre à la répression internationale et aux calomnies contre l'Association mais aussi et surtout pour combattre l'attaque contre l'organisation qui venait de l'intérieur. Bakounine avait mené ces attaques internes et réclamait maintenant ouvertement l'abolition de la centralisation organisationnelle, le non respect des statuts, le non paiement des cotisations des membres au Conseil Général et le rejet de la lutte politique. Surtout, il était contre toutes les décisions de la Conférence de Londres de 1871 qui, tirant les leçons de la Commune de Paris, défendait la nécessité que l'Internationale joue le rôle de parti de classe. Sur le plan organisationnel, cette Conférence avait appelé le Conseil général à prendre sans hésitation en charge sa fonction de centralisation pour incarner l'unité de l'organisation entre deux congrès. Et elle condamna l'existence de sociétés secrètes dans l'Internationale, ordonnant la préparation d'un rapport sur les scandaleuses activités de Bakounine et de Netchaiev en Russie, menées au nom de l'Internationale. Avec impudence, Bakounine prenait les devants car ses activités contre l'Internationale étaient en train d'être découvertes. Mais c'était surtout un calcul stratégique. L'Alliance comptait exploiter l'affaiblissement et la désorientation de beaucoup de parties de l'Internationale, après la défaite de la Commune de Paris, dans le but de ruiner celle-ci lors de son Congrès même sous les yeux du monde entier. Bakounine avait attaqué la « dictature du Conseil général » dans « la circulaire de Sonvilliers » de novembre 1871, qui avait été envoyée à toutes les sections. Celle-ci visait habilement tous les éléments petits-bourgeois qui se sentaient menacés par la prolétarisation des méthodes organisationnelles de l'Internationale, méthodes défendues par les organes centraux. De longs extraits de la « circulaire de Sonvilliers » furent diffusés par la presse bourgeoise (« Le monstre de l'Internationale se dévore lui-même »). « En France où tout ce qui était lié d'une façon ou d'une autre à l'Internationale donnait lieu à des persécutions, elle fut postée aux domiciles. »
La complicité du parasitisme et de la classe dominante
Plus généralement, non seulement la Commune de Paris mais aussi la fondation de l'Internationale elle-même ont toutes deux constitué des manifestations d'un seul et même processus. L'essence de celui-ci, c'était la maturation de la lutte d'émancipation du prolétariat. Depuis le milieu des années 1860, le mouvement ouvrier avait commencé à dépasser les « désordres de l'enfance ». Ayant tiré les leçons des révolutions de 1848, le prolétariat n'acceptait plus d'être dirigé par l'aile radicale de la bourgeoisie et luttait à présent pour établir sa propre autonomie de classe. Mais celle-ci requérait qu'au sein même de ses rangs le prolétariat surmontât les conceptions et les théories organisationnelles de la petite-bourgeoisie, de la bohème et des éléments déclassés qui y subsistaient et avaient encore une influence importante.
Aussi, ce n'est pas seulement vers l'extérieur, contre la bourgeoisie, mais dans l'Internationale elle-même que devait se mener la bataille pour imposer une démarche prolétarienne à ses propres organisations qui atteignaient, au lendemain de la Commune de Paris, une nouvelle étape. C'est dans ses rangs que les éléments petits-bourgeois et déclassés menèrent une lutte féroce contre l'établissement des principes politiques et organisationnels du prolétariat car cela voulait dire l'élimination de leur propre influence dans l'organisation ouvrière.
De ce fait, « ces sectes, leviers du mouvement à leur origine, lui font obstacle dès qu'il les dépasse ; alors, elles deviennent réactionnaires. » ([1] [2694])
Le Congrès de La Haye se donna donc pour objectif d'éliminer le sabotage par les sectaires de la maturation et de l'autonomisation de la classe ouvrière. Un mois avant le Congrès, dans une Circulaire à tous les membres de l'Internationale, le Conseil Général déclarait qu'il était largement temps d'en finir une fois pour toutes avec les luttes internes causées par la « présence d'un corps parasitaire ». Et il ajoutait : « En paralysant l'activité de l'Internationale contre les ennemis de la classe ouvrière, l'Alliance sert magnifiquement la bourgeoisie et ses gouvernements. »
Le Congrès de La Haye a révélé que les sectaires qui ne constituaient plus, désormais, un levier du mouvement, mais étaient devenus des parasites vivant sur le dos des organisations prolétariennes, avaient organisé et coordonné internationalement leur guerre contre l'Internationale. Ils préféraient détruire le parti ouvrier plutôt que d'accepter que les ouvriers s'émancipent de leur influence. Il a révélé que le parasitisme politique était prêt à s'allier à la bourgeoisie pour empêcher sa chute dans les fameuses poubelles de l'histoire auxquelles il était destiné. Derrière une telle alliance se trouvait la haine commune à l'égard du prolétariat même si elle n'avait pas les mêmes causes. C'est l'un des accomplissements majeurs du Congrès de La Haye que d'avoir su mettre à nu l'essence de ce parasitisme politique : faire le travail de la bourgeoisie et participer à la guerre des classes possédantes contre les organisations communistes.
Les délégués contre Bakounine
Les déclarations écrites envoyées à La Haye par les sections, en particulier celles qui provenaient de France où l'Association menait clandestinement ses activités et dont beaucoup de délégués ne pouvaient assister au Congrès, témoignent de l'état d'esprit qui régnait dans l'Internationale à la veille de celui-ci. Les principaux points mis en avant étaient la proposition d'étendre les pouvoirs du Conseil Général, l'orientation vers un parti politique de classe et la confrontation à l'Alliance de Bakounine ainsi qu'à d'autres cas de violation flagrante des statuts.
Un des principaux signes que l'organisation était bien déterminée à démasquer les différents complots qui se développaient en son sein (et qui se concentraient tous autour de l'Alliance de Bakounine) en vue d'en finir avec eux fut la décision de Marx d'assister personnellement au Congrès. L'Alliance, qui existait en tant qu'organisation cachée dans l'organisation, était une société secrète établie selon le modèle de la franc-maçonnerie. Les délégués étaient d'ailleurs tout-à-fait conscients que derrière les manoeuvres sectaires autour de Bakounine se trouvait la classe dominante :
« ... Citoyens, jamais Congrès ne fut plus solennel et plus important que celui dont les séances vous réunissent à La Haye. Ce qui va en effet s'agiter, ce n'est pas telle ou telle insignifiante question de forme, tel ou tel banal article de règlement, c'est la vie même de l'Association.
Des mains impures et souillées de sang républicain cherchent depuis longtemps à jeter parmi nous une désunion dont profiterait seul le plus criminel des monstres, Louis Bonaparte ; des intrigants honteusement expulsés de notre sein, des Bakounine, des Malon, des Gaspard Blanc et des Richard essayent de fonder nous ne savons quelle ridicule fédération qui, dans leurs projets ambitieux, doit écraser l'Association. Eh bien, citoyens, c'est ce germe de discorde, grotesque par ses visées orgueilleuses mais dangereux par ses manoeuvres audacieuses, c'est ce germe qu'il faut anéantir à tout prix. Sa vie est incompatible avec la nôtre et nous comptons sur votre impitoyable énergie pour remporter un décisif et éclatant succès. Soyez sans pitié, frappez sans hésitations, car si vous reculiez, si même vous faiblissiez, vous seriez responsables non seulement du désastre essuyé par l'Association mais encore des terribles conséquences qui en résulteraient pour la cause du prolétariat. » (Les membres parisiens de l'AIT, section Ferré, aux délégués du Congrès de La Haye, 23/08/1872) ([2] [2695])
Et contre la revendication des bakouninistes qui réclamaient l'autonomie des sections et la quasi-abolition du Conseil Général, organe central représentant l'unité de l'organisation :
« Si vous prétendez que le Conseil est un agent inutile, que les fédérations peuvent s'en passer en correspondant entre elles... alors l'Association internationale est disloquée... Eh bien, nous vous déclarons, nous Parisiens, que nous n'avons pas à chaque génération, versé notre sang à flots pour la satisfaction des intérêts de clocher. Nous vous déclarons que vous n'avez rien compris du caractère et de la mission de l'Association Internationale. » (Déclaration de sections parisiennes aux délégués de l'Association internationale réunis en Congrès, lue à la douzième séance du Congrès le 7 septembre 1872) (2)
Les sections déclaraient encore :
« Nous ne voulons pas nous transformer en société secrète, nous ne voulons pas non plus tomber dans le marais de l'évolution purement économique. Parce que la société secrète aboutit à des aventures où le peuple est toujours victime... » (2)
La question des mandats
Ce que peut concrètement signifier l'infiltration du parasitisme politique dans les organisations prolétariennes est illustré par le fait que, des six jours prévus pour le Congrès de La Haye (du 2 au 7 septembre 1872), deux jours entiers durent être consacrés à la vérification des mandats. En d'autres termes, il a été nécessaire de vérifier quels étaient les délégués qui disposaient réellement de mandats et qui les mandataient. Ces questions étaient loin d'être toujours très claires. Dans certains cas, on ne savait même pas si les délégués étaient membres de l'organisation ou si les sections qui les avaient envoyés existaient vraiment.
Ainsi Serraillier, le correspondant pour la France au Conseil Général, n'avait jamais entendu parler d'une section à Marseille qui mandatait un membre de l'Alliance, pas plus qu'il n'avait reçu ses cotisations. « Il prouvera plus tard que des sections se sont formées en vue de ce Congrès. » ([3] [2696])
Le Congrès a dû se prononcer et voter sur l'existence ou non de certaines sections !
Se trouvant minoritaires au Congrès, les supporters de Bakounine ont, à leur tour, cherché à contester les différents mandats, ce qui a aussi fait perdre du temps.
Le membre de l'Alliance, Alerini, déclare que les auteurs des Prétendues scissions dans l'Internationale (c'est-à-dire le Conseil général) devraient être exclus. En fait leur seul crime était de défendre les statuts de l'organisation. L'Alliance cherchait aussi à violer les règles de vote existantes en voulant interdire aux membres du Conseil général de voter au même titre que les délégués mandatés par les sections.
Un autre ennemi des organes centraux, « Mottershead... trouve étonnant qu'un citoyen (Barry) qui n'est pas regardé à Londres comme un représentant de la classe ouvrière représente ici une section allemande. » Marx lui répondit que c'était à mettre au crédit de Barry que de ne pas « représenter ici une clique de meneurs anglais plus ou moins vendus à Dilke et consorts » et qu'il avait été expulsé du Conseil fédéral anglais du fait de « son refus de servir les intrigues de Mr. Hales. » (3) Hales et Mottershead soutenaient effectivement la tendance anti-organisationnelle en Grande-Bretagne.
Ne détenant pas la majorité, l'Alliance a tenté, en plein congrès, un putsch contre les règles de l'Internationale, ce qui correspondait à sa « conception » des règles, c.a.d valables pour les autres mais pas pour l'élite bakouniniste.
Dans la proposition 4 au Congrès, les membres espagnols de l'Alliance ont cherché à faire passer l'idée que les seuls votes qui devaient être pris en compte étaient ceux des délégués disposant d'un « mandat impératif » de leurs sections. Les votes des autres délégués ne devaient ainsi, selon eux, être comptabilisés qu'après que leurs sections aient discuté et voté les motions du Congrès. Le résultat de cette proposition aurait été que la mise en application des résolutions n'aurait pu avoir lieu que deux mois après le Congrès. Elle n'avait d'autre but que de déconsidérer le Congrès, que de le présenter comme n'étant plus l'instance suprême de l'organisation.
Morago annonça alors « que les délégués espagnols ont le mandat de s'abstenir jusqu'au moment de l'abolition du mode de votation » et qu'« il n'est pas juste que le mandat d'un grand nombre n'ait pas plus de poids que celui d'un petit nombre. » (3)
Dans les notes de Joukowski, on trouve la réponse suivante : « Lafargue déclare qu'il a un mandat contraire à celui des autres délégués de l'Espagne. » (3)
Cela révélait la réalité du fonctionnement des délégués appartenant à l'Alliance : ceux qui prétendaient avoir un « mandat impératif » de leurs sections obéissaient en réalité aux instructions secrètes de l'Alliance, direction alternative cachée, opposée au Conseil Général et aux statuts.
Pour renforcer leur stratégie les membres de l'Alliance firent un chantage au Congrès. Le bras droit de Bakounine, Guillaume, face au refus du Congrès de violer ses propres règles pour faire plaisir aux bakouninistes espagnols, « proteste en disant que les Jurassiens vont aussi s'abstenir. » (3) Ils n'en restèrent pas là et menacèrent de quitter le Congrès.
En réponse à ce chantage, « le président répond que leur conduite est inconcevable, car ce qu'ils se font un jeu d'attaquer n'est ni l'oeuvre du Conseil général, ni celle du présent Congrès, mais les statuts de l'Association Internationale des Travailleurs. » (3)
Comme Engels le souligna : « Ce n'est pas notre faute si les espagnols sont dans la triste position où ils ne peuvent voter, ce n'est pas non plus la faute des ouvriers espagnols mais celle du Conseil fédéral espagnol qui est composé de membres de l'Alliance. » ([4] [2697])
Face au congrès, Engels formula ainsi l'alternative :
« Nous devons décider si l'AIT doit continuer à fonctionner sur une base démocratique ou être dominée par une clique (cris et protestations au mot clique) secrètement organisée en violation des statuts. » ([5] [2698])
« Ranvier proteste contre les menaces de quitter la salle proférées par Splingard, Guillaume et d'autres qui ne font que prouver que ce sont EUX et pas nous qui se sont prononcés A L'AVANCE sur les questions en discussion ; il espère que tous les agents de la police du monde démissionneront ainsi. » (4)
« Morago parle de la tyrannie du Conseil, mais n'est-ce pas ce Morago lui-même qui vient imposer la tyrannie de son mandat au Congrès. » (3) (Intervention de Lafargue)
Le Congrès répondit aussi sur la question des mandats impératifs : une telle procédure voulait dire que le Congrès n'était qu'une chambre d'enregistrement de votes présentés par les délégations et déjà adoptés. Il n'était plus ainsi l'instance suprême de l'organisation qui prend les décisions en tant que corps souverain.
« Serrailler dit qu'il n'a pas les mains liées comme Guillaume et ses camarades qui se sont déjà fait à l'avance une idée sur tout puisqu'ils ont accepté des mandats impératifs qui les obligent à voter d'une certaine façon ou à se retirer. » (4)
Dans son article « Le mandat impératif et le Congrès de La Haye », Engels révèle la véritable fonction du « mandat impératif » dans la stratégie de l'Alliance : « Pourquoi les alliancistes, ennemis dans la chair et le sang de tout principe autoritaire, insistent-ils avec tant de roublardise sur l'autorité des mandats impératifs ? Parce que pour une société secrète telle que la leur, existant à l'intérieur d'une société publique telle que l'Internationale, il n'y a rien de plus confortable qu'un mandat impératif. Les mandats de leurs alliés seront tous identiques. Ceux des sections qui ne sont pas sous l'influence de l'Alliance ou qui se rebellent contre elle, se contrediront entre eux, de sorte que la société secrète aura souvent la majorité absolue et toujours la majorité relative, tandis qu'à un congrès sans mandat impératif, le sens commun de délégués indépendants les unira rapidement à un parti commun contre le parti de la société secrète. Le mandat impératif est un moyen de domination extrêmement efficace, et c'est pourquoi l'Alliance, malgré son anarchisme, soutient son autorité. » ([6] [2699]
La question des finances :le « nerf de la guerre »
Comme les finances, en tant que base matérielle du travail politique, sont vitales pour la construction et la défense de l'organisation révolutionnaire, il était inévitable que le parasitisme politique s'y attaquât ; c'était un des principaux moyens de saper l'Internationale.
Avant le Congrès de La Haye, il y eut des tentatives de boycotter ou de saboter le paiement des cotisations au Conseil général tel qu'il était prévu par les statuts. Parlant de la politique de ceux qui, dans les sections américaines, s'étaient révoltés contre le Conseil général, Marx déclarait :
« Le refus de paiement des cotisations et même d'objets demandés par la section au Conseil général, correspondait à un avis de la Fédération jurassienne disant que si l'Amérique refusait les cotisations ainsi que l'Europe, le Conseil général tomberait de lui même. » (3)
A propos de la deuxième section « rebelle » de New-York, « Ranvier trouve qu'on joue avec les règlements. La section 2 s'est séparée du Conseil fédéral, s'est endormie et, à l'approche du Congrès universel, a voulu y être représentée et y protester contre ceux qui ont agi. Comment d'ailleurs cette section s'est-elle mise en règle avec le Conseil général ? C'est seulement le 26 août qu'elle a payé ses cotisations. Une pareille conduite frise la comédie et ne peut être tolérée. Ces petites coteries, ces églises, ces groupes indépendants les uns des autres sans lien commun ressemblent à de la franc-maçonnerie et ne peuvent être tolérés dans l'Internationale. » (3)
Le Congrès décida, avec raison, que seules les délégations ayant payé leurs cotisations pourraient y participer. Voici comment Farga Pellicer a « expliqué » l'absence des cotisations des alliancistes espagnols : « Quant aux cotisations, il s'expliquera :... la situation était difficile, ils ont eu à lutter contre la bourgeoisie, et presque tous les ouvriers appartiennent à des trade-unions. Ils tendent à unir tous les travailleurs contre le capital. L'Internationale fait de grands progrès en Espagne, mais la lutte est coûteuse. Ils n'ont pas payé leurs cotisations, mais ils le feront. » (3)
En d'autres termes, ils gardaient pour eux l'argent de l'organisation. Telle fut la réponse du trésorier de l'Internationale :
« Engels, secrétaire pour l'Espagne, trouve étrange que les délégués arrivent avec l'argent dans leurs poches et n'aient pas encore payé. A la Conférence de Londres, tous les délégués s'étaient immédiatement acquittés, et les espagnols devaient en faire de même ici car c'était indispensable pour la validation des mandats. » (3)
Deux pages plus loin, on lit dans le procès-verbal : « Farga Pellicer remet les cotisations, moins le dernier trimestre qui n'est pas rentré » (3), c'est-à-dire l'argent que, soi-disant, il n'avait pas !
Il n'était pas surprenant qu'ensuite, l'Alliance et ses supporters aient proposé de diminuer les cotisations des membres en vue d'affaiblir l'organisation. Le Congrès, quant à lui, proposait de les augmenter.
« Brismée est pour la diminution des cotisations car les travailleurs ont à payer à la section, au Conseil fédéral et que c'est une grande charge pour lui de donner dix centimes par an au Conseil général. » (3)
Frankel y répondit en défense de l'organisation :
« Frankel est ouvrier salarié et justement il pense que dans l'intérêt de l'Internationale il faut absolument augmenter les cotisations. Il y a des fédérations qui ne paient qu'au dernier moment et le moins possible. Le Conseil n'a pas le sou en caisse (...) Frankel croit qu'avec les moyens de propagande que permettra l'augmentation des cotisations (...) les divisions cesseraient dans l'Internationale et elles n'existeraient pas aujourd'hui si le Conseil général avait pu envoyer des émissaires dans les différents pays où elles se sont manifestées. » (3)
Sur cette question, l'Alliance obtint une victoire partielle : les cotisations furent maintenues au niveau précédent.
Finalement, le Congrès rejeta fermement les calomnies de l'Alliance et de la presse bourgeoise à ce sujet :
« Marx observe que tandis que les membres du Conseil avançaient leur argent pour payer les frais de l'Internationale, des calomniateurs dont la Fédération jurassienne a été l'un des organes, ont accusé ces mêmes membres de vivre du Conseil. Lafargue dit que la Fédération jurassienne a été l'un des organes de ces calomnies. » (3)
La défense du Conseil général au coeur de la défense de l'Internationale
« Le Conseil général... met à l'ordre du jour en tant que question la plus importante à discuter au Congrès de la Haye la révision des statuts et règlements généraux. » (Résolution du Conseil général sur l'ordre du jour du Congrès de La Haye)
Sur le plan du fonctionnement, la question centrale portait sur la modification suivante des règles générales :
« Article 2. Le Conseil général est tenu d'exécuter les résolutions du Congrès et de veiller dans chaque pays à la stricte observation des principes fondamentaux et des Statuts et règlements généraux de l'Internationale.
Article 6. Le Conseil général a également le droit de suspendre des branches, sections, conseils ou comités fédéraux et fédérations de l'Internationale jusqu'au prochain Congrès. » (Résolution relative aux règles administratives)
A l'inverse, les ennemis du développement de l'Internationale cherchaient à détruire son unité centralisée. Il est manifeste que « l'opposition de principe à la centralisation » ne constituait qu'un prétexte pour l'Alliance dont les statuts secrets convertissaient la « centralisation » en une dictature personnelle d'un seul homme, celle du « Citoyen B. » (Bakounine). Derrière l'amour des bakouninistes pour le fédéralisme résidait, en fait, la conscience que la centralisation constituait l'un des principaux moyens de résistance de l'Internationale à la destruction, l'empêchant d'être démantelée morceau par morceau. Pour réaliser cette « sainte destruction » les bakouninistes exploitèrent les préjugés fédéralistes des éléments petit-bourgeois dans l'organisation :
« Brismée veut qu'on révise d'abord les Statuts, ce qui pourrait bien amener la suppression du Conseil général, ce qui a déjà été proposé par les belges à leur Congrès et n'a été remis qu'à la condition de couper ongles et crocs au Conseil. » (3)
Quant à Sauva (Etats-Unis), « ses mandataires à lui veulent le maintien du Conseil mais ils veulent d'abord qu'il n'ait aucun droit et que ce souverain n'ait pas le droit de donner des ordres à ses domestiques (rires). » (3)
Le Congrès rejeta ces tentatives de destruction de l'unité de l'organisation en adoptant le renforcement du Conseil général, transmettant ainsi un message que les marxistes ont suivi jusqu'à nos jours. Comme Hepner l'a déclaré au cours du débat :
« Hier soir, deux grandes idées ont été mentionnées : centralisation et fédéralisme. Cette dernière s'est exprimée dans l'abstentionnisme ; mais cette abstention de toute activité politique mène au poste de police. » ([7] [2700])
Et Marx de rajouter : « Sauva a changé d'opinion depuis Londres. Quant à l'autorité, à Londres il était pour l'autorité du Conseil général et contre celle des Conseils fédéraux ; ici il a défendu le contraire. » (...) « Par pouvoir du Conseil on ne parle pas de celui qui a existé, ce n'est donc pas pour nous mais pour l'institution. »
« Marx a déclaré qu'il voterait plutôt pour l'abolition que pour un Conseil boîte à lettre » (3)
Contre l'exploitation par les bakouninistes de la peur petite bourgeoise de la « dictature », Marx argumentait :
« Mais que nous attribuions au Conseil général les droits d'un prince nègre ou d'un tsar russe, son pouvoir est illusoire si le Conseil général cesse d'exprimer la volonté de la majorité de l'AIT. » (4)
« Le Conseil général n'a ni armée, ni budget, il n'a que sa force morale et si vous lui retiriez ses pouvoirs, vous ne seriez qu'une force factice. » (3)
Le Congrès fit également le lien entre la question des principes prolétariens de fonctionnement et celle de la nécessité d'un parti politique de classe (autre changement majeur qu'il adopta dans ses statuts). Ce lien s'illustrait dans la lutte contre « l'anti-autoritarisme » qui constituait une arme contre le parti et contre la discipline de parti.
« Ici nous entendons des discours contre l'autorité. Nous sommes également contre les excès de toutes sortes mais une certaine autorité, un certain prestige seront toujours nécessaires pour permettre la cohésion du parti. Il est logique que les antiautoritaires doivent aussi abolir les conseils fédéraux, les fédérations, les comités et même les sections puisque de l'autorité y est exercée à un degré plus ou moins grand ; ils doivent partout établir l'anarchie absolue, c.a.d transformer l'Internationale combattante en parti petit bourgeois en robe de chambre et en pantoufles. Comment peut-on s'opposer à l'autorité après la Commune ? Nous, ouvriers allemands, sommes pour le moins convaincus que la Commune a failli en grande partie parce qu'elle n'a pas exercé assez d'autorité ! » ([8] [2701])
L'enquête sur l'Alliance
Durant le dernier jour du Congrès, le rapport de la commission d'enquête sur l'Alliance fut présenté et discuté.
Cuno déclarait : « Il est absolument sûr qu'il y a eu des intrigues dans l'Association ; des mensonges, des calomnies et des tricheries ont été prouvées. La commission a fait un travail de surhomme, elle a siégé pendant 13 heures aujourd'hui. Maintenant, elle demande un vote de confiance pour l'acceptation des demandes mises en avant dans le rapport. » (4)
En fait, le travail de la commission d'enquête pendant le Congrès fut phénoménal. Une montagne de documents fut examinée. Une série de témoins furent appelés pour rendre compte de différents aspects de la question. Engels lut le rapport du Conseil général sur l'Alliance. Il est significatif que l'un des documents présentés par le Conseil général à la commission ait été : « Les statuts généraux de l'Association Internationale des Travailleurs après le Congrès de Genève, 1866 ». Cela illustre le fait que ce qui menaçait l'Internationale n'était pas les divergences politiques qui peuvent être traitées normalement dans le cadre prévu par les statuts mais la violation systématique des statuts eux-mêmes. Bafouer les principes organisationnels de classe du prolétariat constitue toujours un danger mortel pour l'existence et la réputation des organisations communistes. La présentation des statuts secrets de l'Alliance par le Conseil général prouvait suffisamment que c'était le cas ici.
La commission, élue par le Congrès, ne prit pas sa tâche à la légère. La documentation fournie par son travail est aussi longue que tous les autres documents du Congrès pris ensemble. Le texte le plus long, le rapport d'Outine, demandé par la Conférence de Londres l'année précédente, fait presque 100 pages. A la fin, le Congrès de La Haye demanda la publication d'un document encore plus long, le fameux texte « L'Alliance de la Démocratie Socialiste et l'Association Internationale des Travailleurs ». Les organisations révolutionnaires n'ayant rien à cacher au prolétariat ont toujours voulu informer celui-ci sur ces questions dans la mesure où le permettait la sécurité de l'organisation.
La commission a établi, sans aucun doute possible, le fait que Bakounine avait dissout puis refondé l'Alliance au moins trois fois pour tromper l'Internationale ; qu'il s'agissait d'une organisation secrète au sein de l'Association agissant contre les statuts dans le dos de l'organisation, dans le but de s'en emparer ou de la détruire.
La commission reconnut également le caractère irrationnel, ésotérique de cette formation :
« Il est évident que dans toute cette organisation il existe trois degrés différents dont certains mènent les autres par le bout du nez. Toute l'affaire paraît si exaltée et excentrique que la commission se tord de rire sans arrêt. Ce genre de mysticisme est généralement considéré comme une maladie mentale. Dans toute l'organisation se manifeste le plus grand absolutisme. » (Procès-verbal de la commission d'enquête sur l'Alliance) (4)
Le travail de la commission fut entravé par plusieurs facteurs. L'un d'entre eux fut l'absence de Bakounine au Congrès. Après avoir proclamé, à sa façon grande gueule, qu'il viendrait défendre son honneur au Congrès, il préféra laisser ses disciples le faire. Mais il proposa une stratégie ayant pour but de saboter l'enquête. D'abord, ses adeptes refusèrent de divulguer quoi que ce soit sur l'Alliance ou sur les sociétés secrètes en général pour « des raisons de sécurité », comme si leurs activités avaient visé la bourgeoisie et non l'AIT. Guillaume répéta ce qu'il avait déjà défendu au Congrès suisse romand :
« Chaque membre de l'Internationale garde la liberté pleine et entière de s'affilier à n'importe quelle société secrète, fût-ce même à la franc-maçonnerie ; une enquête sur une société secrète, ce serait simplement une dénonciation à la police. » ([9] [2702])
De plus, le mandat impératif rédigé pour les délégués du Jura au Congrès stipulait :
« Les délégués du Jura élimineront toute question personnelle et ne mèneront des discussions sur ce sujet que s'ils y sont forcés ; ils proposeront au Congrès qu'il oublie le passé et, pour le futur, la nomination d'un jury d'honneur qui devra prendre une décision chaque fois qu'une accusation sera portée contre un membre de l'Internationale. » (4)
C'est un document d'esquive politique. La question de clarifier le rôle joué par Bakounine comme leader d'un complot contre l'Internationale est posée comme étant une « question personnelle » et non une question politique. Les investigations doivent être réservées « pour le futur » et prendre la forme d'une institution permanente pour régler les disputes comme le ferait un tribunal bourgeois. C'est une façon d'émasculer totalement toute commission d'enquête ou tout jury d'honneur prolétarien.
Enfin, l'Alliance se posait comme « victime » de l'organisation. Guillaume contestait « le pouvoir du Conseil général à mener une enquête sur l'Internationale. » ([10] [2703]). Il affirmait que « tout le procès, c'est d'eliminer la soi-disant minorité, en réalité la majorité... c'est le principe fédéraliste qu'on condamne ici. » ([11] [2704])
« Alerini pense que la commission n'a que des convictions morales et pas de preuves matérielles ; il a appartenu à l'Alliance et il en est fier (...) » Il accusa : « mais vous êtes la sainte inquisition ; nous demandons une enquête publique avec des preuves concluantes et tangibles. » ([12] [2705])
Le Congrès alla jusqu'à nommer un sympathisant de Bakounine, Splingard, à la commission. Celui-ci dut admettre que l'Alliance avait existé comme société secrète dans l'Internationale bien qu'il ne comprît pas la fonction de la commission. Il y voyait son rôle comme celui d'un « avocat défendant Bakounine » (qui, de toutes façons, était assez grand pour se défendre lui-même) et non comme partie d'un corps collectif d'investigation.
« Marx dit que Splingard s'est conduit dans la commission comme un avocat de l'Alliance, pas comme un juge impartial. » ([13] [2706])
L'autre accusation était qu'il n'y avait « pas de preuves ». Marx et Lucain y répondirent.
« Splingard sait très bien que Marx a donné tous ces documents à Engels. Le Conseil fédéral espagnol lui-même a fourni des preuves et il (marx) en a ajouté de Russie mais ne peut divulguer le nom de celui qui les a envoyées ; sur ce sujet en général, la commission a donné sa parole d'honneur de ne rien divulguer de ce qu'elle a traité, en particulier aucun nom, sa décision à ce sujet est irrévocable. » ([14] [2707])
Lucain déclara : « Je demande si on doit attendre que l'Alliance ait perturbé et désorganisé toute l'Internationale, puis apporter des preuves. Mais nous refusons d'attendre aussi longtemps. Nous attaquons le mal là où nous le voyons car c'est notre devoir. » ([15] [2708])
Le Congrès, sauf la minorité bakouniniste, soutint les conclusions de la commission. En réalité, la commission ne proposa que 3 exclusions : celles de Bakounine, Guillaume et Schwitzguébel. Seules les deux premières furent adoptées par le Congrès. Voila ce que vaut la légende selon laquelle l'Internationale voulait éliminer une minorité gênante par des moyens disciplinaires ! Contrairement à ce qu'anarchistes et conseillistes proclament, les organisations prolétariennes n'ont pas besoin de telles mesures, elles n'ont pas peur d'une clarification politique totale à travers le débat, mais y sont, au contraire, très attachées. Et elles n'excluent des membres que dans des cas, totalement exceptionnels, d'indiscipline ou de déloyauté graves.
Comme l'a dit Johannard à La Haye : « L'exclusion de l'AIT constitue la sentence la pire et la plus déshonorante qui puisse être portée contre un homme ; un tel homme ne pourra plus jamais faire partie d'une société honorable. » (4)
Le front parasitaire contre l'Internationale
Nous ne traiterons pas ici de l'autre décision grave du Congrès, c'est-à-dire le transfert du Conseil général de Londres à New York. La raison de cette proposition c'est que, malgré la défaite des bakouninistes, le Conseil général à Londres pouvait tomber entre les mains d'une autre secte, les blanquistes. Ces derniers, refusant de voir le recul internationale de la lutte de classe causé par la défaite de la Commune de Paris, risquaient de détruire le mouvement ouvrier par une série de luttes de barricades sans raison d'être. En fait, alors qu'à l'époque Marx et Engels espéraient pouvoir ramener plus tard le Conseil général en Europe, la défaite de Paris avait marqué le début de la fin de la première Internationale. ([16] [2709])
Par contre, ce sur quoi nous conclurons cet article, c'est sur l'une des plus grandes réalisations historiques accomplies par le Congrès de La Haye. Cette réalisation que la postérité a fondamentalement ignorée ou complètement incomprise (comme Franz Mehring par exemple, dans sa biographie de Marx), c'est d'avoir su identifier l'existence du parasitisme politique contre les organisations ouvrières.
Le Congrès de La Haye montra que l'Alliance de Bakounine n'avait pas agi toute seule mais qu'elle était le centre coordinateur d'une opposition parasitaire au mouvement ouvrier soutenue par la bourgeoisie.
L'un des principaux alliés de l'Alliance dans sa lutte contre l'Internationale était constitué par le groupe autour de Woodhull et West en Amérique qu'on ne pouvait même pas qualifier d'« anarchiste ». « Le mandat de West est signé par Victoria Woodhull qui a mené des intrigues pendant des années pour accéder à la présidence des Etats-Unis ; elle est présidente des spiritualistes, prêche l'amour libre, fait des affaires bancaires, etc. » Elle publia, comme l'a rappelé Marx, le « célèbre appel aux citoyens de langue anglaise des Etats Unis dans lequel toute une série de non-sens sont attribués à l'AIT et sur la base duquel plusieurs sections furent formées dans le pays. Entre autres choses, l'appel mentionnait la liberté personnelle, la liberté sociale (l'amour libre), la façon de s'habiller, le droit de vote des femmes, un langage universel, etc. (Ces gens) posaient la question des femmes avant celle de la classe ouvrière et refusaient de reconnaître l'AIT comme organisation ouvrière. » (Intervention de Marx) ([17] [2710])
Sorge révéla le lien de ces éléments avec le parasitisme international :
« Ils (la section 12) ont reçu les communications des intrigants contre l'Association avec zèle et ardeur. A l'insu du Comité central, des autres sections, etc., ils demandaient au Conseil général la domination de l'organisation en Amérique, intriguant ainsi contre leurs compagnons qui avaient le malheur d'être nés dans une autre partie du globe... Dans leurs conseils, ils ont souvent parlé avec dédain des Communards français et des athées allemands dont ils voulaient se débarrasser ; et ces déclarations ont été publiées avec leur consentement.
Nous demandons la discipline ; nous demandons la soumission, non pas à une personne, un comité ou un conseil quelconque mais au principe, à l'organisation.
La classe ouvrière en Amérique se compose d'abord d'irlandais, puis d'allemands, puis de nègres et en quatrième lieu d'américains nés (...). Il nous faut donc des irlandais pour créer une bonne organisation ; et les irlandais nous ont déclaré et nous déclarent toujours que leurs compatriotes ne s'affilieront jamais à notre Association tant que Woodhull, Claflin et ses adhérents y jouent un rôle. »
La discussion mit à jour ensuite la coordination internationale des attaques contre l'AIT avec les bakouninistes en leur centre.
« Le Moussu vit dans la Fédération jurassienne la reproduction d'une lettre que lui adressait le Conseil de Spring Street en réponse à l'ordre de suspension de la section 12 (...) concluant à la formation d'une nouvelle Association au moyen des éléments dissidents d'Espagne, de Suisse et ceux de Londres. Ainsi, non contents de méconnaître l'autorité que le Conseil général tient d'un Congrès, et de réserver leurs griefs jusqu'à ce jour, ainsi que le commandent les statuts, ces individus, prétendant fonder une société nouvelle, se mettent en rupture ouverte avec l'Internationale. »
Le Moussu « appelle surtout l'attention du Congrès sur la coïncidence des attaques dont le Conseil général et ses membres sont l'objet de la part de la Fédération jurassienne et de sa soeur la Fédération des sieurs Vésinier et Landeck, cette dernière déclarée policière et ses rédacteurs expulsés comme policiers par la Société des Réfugiés de la Commune à Londres.
La falsification commise a pour effet de représenter les communalistes siégeant au Conseil général comme des admirateurs du régime bonapartiste, les autres membres étant des bismarckiens, ces misérables ne cessent de l'insinuer... Comme si les véritables bismarckiens et les bonapartistes n'étaient pas ceux qui, comme ces écrivassiers de toutes les fédérations, se traînent à la remorque des limiers de tous les gouvernements pour insulter les vrais soutiens du prolétariat... Je leur dis donc, à ces vils insulteurs : vous êtes les dignes auxiliaires des polices bismarckienne, bonapartiste et thiériste. Vous êtes des faussaires ! »
Sur le lien entre l'Alliance et la police : « Dereure informe le Congrès qu'il y a une heure à peine Alerini lui a dit avoir été l'ami intime de Landeck, espion de la police à Londres. » ([18] [2711])
Le parasitisme allemand, sous la forme des lassalliens expulsés de l'« Association éducative des ouvriers allemands » à Londres, était également lié à ce réseau parasitaire international via le Conseil fédéraliste universel de Londres mentionné plus haut, au sein duquel il collaborait avec d'autres ennemis du mouvement ouvrier tels que des francs-maçons radicaux français et les mazzinistes italiens.
« Le parti bakouniniste en Allemagne était l'Association générale des ouvriers allemands dirigée par Schweitzer et ce dernier fut finalement démasqué comme agent de la police. » (Intervention d'Hepner)
Le Congrès mit aussi en évidence la collaboration entre les bakouninistes suisses et les réformistes britanniques de la Fédération anglaise de Hales.
En réalité, en plus d'infiltrer et de manipuler des sectes dégénérées qui avaient appartenu dans le passé au mouvement ouvrier, la bourgeoisie a également créé ses propres organisations en vue de contrer l'Internationale. Les philadelphiens et les mazzinistes de Londres tentèrent de s'emparer directement du Conseil général mais ils échouèrent avec l'éviction de leurs membres du sous-comité du Conseil général en septembre 1865.
« Le principal ennemi des philadelphiens, l'homme qui a empêché qu'ils fassent de l'Internationale le théâtre de leurs activités, était Karl Marx. »
Le lien direct entre ce milieu et les bakouninistes que fait Nicolaïevski est plus que probable étant donnée leur identification ouverte avec les méthodes et les organisations de la franc-maçonnerie.
Les activités destructrices de ce milieu furent prolongées par les provocations terroristes de la société secrète de Félix Pyat, « la Commune révolutionnaire républicaine ». Ce groupe, ayant été exclu et condamné publiquement par l'Internationale, continua d'opérer en son nom, attaquant sans cesse le Conseil général.
En Italie par exemple, la bourgeoisie monta une « Societa universale dei razionalisti » (Société universelle des rationalistes), sous la direction de Stefanoni, pour combattre l'Internationale dans ce pays. Son journal publiait les mensonges de Vogt et des lassalliens allemands sur Marx et défendait ardemment l'Alliance de Bakounine. Le but de ce réseau de pseudo-révolutionnaires était de « calomnier à faire rougir les journaux bourgeois, dont ils sont les infâmes inspirateurs, contre les internationaux », et ils appelaient cela « grouper les ouvriers » (Intervention de Duval)
C'est pourquoi, au coeur des interventions de Marx au Congrès de La Haye, il y avait la nécessité vitale de défendre l'organisation contre toutes ces attaques. Sa vigilance et sa détermination doivent nous guider aujourd'hui face à des attaques similaires.
« Quiconque sourit avec scepticisme à la mention de sections formées par la police doit savoir que de telles sections ont existé en France, en Autriche et ailleurs ; et le Conseil général a reçu la requête de ne reconnaître aucune section qui ne soit fondée par des délégués du Conseil général ou de l'organisation là-bas. Vésinier et ses camarades, que les réfugiés français ont récemment expulsés, sont naturellement de la Fédération jurassienne... Des individus comme Vésinier, Landeck et d'autres, à mon avis, forment d'abord un conseil fédéral puis une fédération et des sections ; les agents de Bismarck peuvent faire la même chose, donc le Conseil général doit avoir le droit de dissoudre ou de suspendre un conseil fédéral ou une fédération... En Autriche, les braillards, l'ultramontagne, les radicaux et les provocateurs forment des sections afin de discréditer l'AIT ; en France, un commissaire de police a formé une section. » (4)
« Le cas de suspendre un Conseil fédéral s'est présenté à New York ; il se peut que dans d'autres pays des sociétés secrètes veuillent s'emparer des Conseils fédéraux, il faut les suspendre. Quant à la faculté de former librement des fédérations, ainsi que Vésinier, Landeck et un mouchard allemand, elle ne peut être.
Monsieur Thiers se fait le domestique de tous les gouvernements contre l'Internationale et il faut au Conseil le pouvoir d'éloigner les éléments dissolvants. (...) Vos anxiétés sont des subterfuges car vous appartenez aux sociétés qui se cachent et sont les plus autoritaires. »
Dans la quatrième et dernière partie de cette série d'articles, nous traiterons de Bakounine, l'aventurier politique et nous tirerons des leçons générales de l'histoire du mouvement ouvrier sur cette question de l'aventurisme.
Kr.
[3] [2714]. Le Congrès de la Haye de la Première Internationale, Procès-verbaux, Editions du Progrès, Moscou 1972.
Les citations du procès-verbal du Congrès de La Haye du présent article sont soit reprises du Procès-verbal du Congrès pris en français par Benjamin Le Moussu (proscrit de La Commune et membre du Conseil général dès le 5 septembre 1871), retraduites du russe, soit traduites par nous de l'anglais.
[5] [2716]. Traduit du PV en anglais par nous.
Dans le PV français, on trouve : « La question est importante : nous allons voter si l'Internationale doit obéir à une coterie en société secrète. »
[7] [2718]. Traduit de l'anglais par nous.
Dans le PV en français on trouve : « Hepner dit que l'abstention a eu un triste succès en Allemagne - ils en ont assez - le parti étant des lassalliens mêlés de policiers. »
[8] [2719] Traduit de l'anglais par nous.
Dans le PV français on trouve : « (Hepner) n'aime pas l'autorité inutile ni le culte des personnes, mais elle est nécessaire en ce moment pour unir les forces révolutionnaires. - Il demande aux Communalistes présent si c'est l'autorité qui les a perdus ou bien le contraire. »
[10] [2721]. Traduit de l'anglais par nous.
Dans le PV français on trouve : « Guillaume proteste contre l'enquête du Congrès sur une société secrète. »
[11] [2722]. Traduit de l'anglais par nous.
Dans le PV français, on trouve : « C'est un procès de tendance que vous faites(...) On a voulu condamner nos doctrines fédéralistes. »
[12] [2723]. Traduit de l'anglais par nous.
Dans le PV français, on trouve : « Alerini... Vous n'avez pas de preuves morales. Il a appartenu à l'Alliance. C'est elle qui a fait l'Internationale espagnole... Vous n'avez pas le droit de m'empêcher de faire partie des sociétés secrètes. Si vous le faites, je dirai que c'est une coterie, une église, une sainte inquisition. »
[13] [2724]. Traduit de l'anglais par nous.
Dans le PV français, on trouve : « Marx voit que Splingard parle comme l'avocat des accusés et non comme un juge d'instruction. »
[14] [2725]. Traduit de l'anglais par nous.
Dans le PV français, on trouve : Marx « en appelle à la commission pour prouver qu'il a apporté des pièces et qu'il est faux de dire qu'il n'a apporté que des affirmations - J'ai encore prouvé l'existence de l'Alliance, etc, etc.
Quant aux papiers secrets, nous ne les avons pas demandés – ils existent – les documents que j'ai communiqués n'étaient pas des choses secrètes. J'ai encore fait une allusion au procès Netchaiev. »
[15] [2726]. Traduit de l'anglais par nous.
Dans le PV français, on trouve : Lucain « Ce n'est pas assez de fonder une société qui tend à désorganiser l'Association et les auteurs de pareils projets -quand même ils ne réussiraient pas à les faire triompher- ne méritent-ils pas d'être expulsés de l'Internationale ? »
[17] [2728]. Traduit de l'anglais par nous.
Dans le P.V. en français, on trouve : « Le second motif de son retrait (de la section 2 de New York), ce sont les intrigues politiques tendant à porter Mme Woodhull à la présidence des Etats Unis. » (Sauva)
« La section 12 veut l'émancipation des hommes et des femmes - elle s'occupe de la question politique pour atteindre ce but. L'homme et la femme sont esclaves l'un de l'autre, et si West pratique l'amour libre, cela le regarde seul. Il y a des spiritualistes parmi eux. Ils veulent en finir avec le mariage. » (West)
[18] [2729]. Traduit de l'anglais par nous.
Dans le P.V. en français de Le Moussu, on trouve : « Alerini dit que Landeck est un honnête homme. »
Conscience et organisation:
- La première Internationale [1847]
Courants politiques:
Approfondir:
- Questions d'organisation [2321]
Réponse à la Communist Workers Organisation - Une politique de regroupement sans boussole
- 3672 reads
La lettre qui suit a été envoyée au CCI ainsi qu'à d'autres groupes et éléments isolés comme réponse à une polémique publiée dans le journal du CCI en Grande-Bretagne et intitulée « Le CWO victime du parasitisme politique ». Cette polémique estimait que l'arrêt de la publication de Workers Voice, journal de la CWO, son apparent regroupement avec le CBG et son refus d'aider à la défense d'une réunion publique du CCI à Manchester contre des attaques, constituaient des concessions au parasitisme. De telle concessions trouvent une explication dans des conceptions erronées concernant le milieu politique prolétarien et qui se trouvaient déjà dans les bases de la formation de la CWO ainsi que de son regroupement avec Battaglia Comunista pour constituer le « Bureau International Pour le Parti Révolutionnaire » (BIPR).
Lettre de la CWO à World Revolution
C'est avec une certaine stupéfaction que nous avons lu votre attaque contre nous dans World Révolution n°190. La férocité de la polémique n'était pas une surprise et nous ne discuterons pas de l'importance de la question en jeu (l'organisation révolutionnaire), mais du fait que cette polémique est entièrement fondée sur une série d'erreurs factuelles qui auraient pu aisément être évitées en nous demandant tout simplement ce qu'il en était. Lorsque nous avons lu le compte-rendu très déroutant de votre 11e congrès, nous ne nous sommes pas lancés dans une polémique sur les dernières scissions dans le CCI sur la base de son stalinisme supposé. Au contraire, le BIPR a discuté de ce rapport avec les camarades de RI à Paris en juin dernier et a été rassuré par eux sur le fait que le CCI ne faisait que garantir un fonctionnement interne futur en accord avec les normes d'une politique principielle prolétarienne. Nous sommes entièrement d'accord que l'existence de «clans» (fondés sur des loyautés personnelles), contrairement à l'existence de tendances (basées sur des divergences politiques concernant des questions nouvelles) sont quelque chose qu'une organisation saine doit éviter. Cependant, nous pensons que la manière dont vous avez ensuite traité cette question vous a conduits à une vision caricaturale de la question de l'organisation politique à l'heure actuelle. Nous aborderons cela dans un prochain article de notre presse. Pour le moment, nous aimerions que vous publiez cette lettre, en guise de correctif, pour permettre à vos lecteurs de juger par eux-mêmes.
- Nous allons écrire une histoire de la CWO pour nos propres membres et sympathisants mais nous pouvons assurer à vos lecteurs que, bien longtemps avant que la CWO ou le CCI n'ait vu le jour, la question des droits fédéralistes avait été tranchée en faveur d'une organisation internationale centralisée. La demande de «droits fédéralistes» à laquelle FS fait référence est une simple lettre écrite avant que ni la CWO ni le CCI n'existent, lorsque RP (Revolutionnary Perspectives) se réduisait à un seul individu !
- En septembre 1975, c'était une condition d'admission dans la CWO que de reconnaître la révolution russe d'Octobre 1917 comme prolétarienne et comme l'étant restée durant les 3 ans et demi qui ont suivi.
- La réévaluation par la CWO de la contribution des gauches allemande et italienne à l'actuelle clarté de la Gauche communiste internationale ne s'est pas faite du jour au lendemain. Elle a pris cinq années de débat, souvent difficile et quelquefois douloureux, avec des changements constants dans les positions en présence à mesure que les questions étaient approfondies. On peut trouver les textes de la CWO sur ce débat dans Revolutionnary Perspectives n°18, 19 et 20. Nos discussions avec Il Partito Comunista Intemazionalista (Battaglia Comunista) ont commencé lorsqu'il a fraternellement critiqué notre plate-forme en septembre 1975 et nous n'avons pas formé le Bureau avant 1984. Ce n'était certainement pas un arrangement opportuniste précipité !
- Les «maoïstes» iraniens dont vous parlez étaient les «Student Supporters of thé Unity of Communist Militants» (Partisans étudiants de l'unité des combattants communistes). Ils ne pouvaient pas être maoïstes sinon le CCI n'aurait pas mené (à notre insu à l'époque) des discussions secrètes avec eux, des mois avant que nous ne les rencontrions. Ils ne pouvaient pas être maoïstes puisqu'ils ont accepté tous les critères fixés comme critères prolétariens de base par les Conférences Internationales de la Gauche Communiste. Leur évolution ultérieure les a conduits dans le parti communiste d'Iran qui s'était formé sur des principes contre-révolutionnaires. Notre critique de cette organisation peut être trouvée dans la Communist Review n°1.
- Le «Communist Bulletin Group» n'était pas seulement constitué d'ex-membres de la CWO, comme tous vos articles essayent de le maintenir. Il comprenait également des gens qui n'ont jamais été à la CWO, y compris un membre fondateur de World Revolution (qui venait, comme tous les autres fondateurs, du groupe Solidarity). Il peut également avoir échappé à vos lecteurs que le CBG n'existe plus, excepté dans les pages de WR.
- La CWO ne participe à aucun regroupement, formel ou informel, avec l'ex-CBG ni avec aucun de ses membres individuellement. En fait, à part l'accusé de réception à l'annonce de sa disparition, nous n'avons eu aucun contact direct avec le CBG depuis que nous lui avons envoyé un texte sur l'organisation en juin 1993. Ceci semble avoir précipité sa crise finale.
- Des membres de la CWO ont effectivement participé au cercle d'études de Sheffield, qui incluait au départ des anarchistes, des personnes non affiliés se réclamant de la Gauche communiste, Subversion et un membre de l'ex-CBG. Cependant, comme des membres du CCI de Londres y ont également assisté (après avoir demandé leurs invitations aux anarchistes plutôt qu'à nous !), nous n'étions pas trop inquiets sur le risque d'être happés par les parasites. Ceci s'est terminé au printemps 1995, lorsqu'il fut clair que seule la CWO était intéressée à poursuivre le travail d'approfondissement. Le cercle de Sheffield a depuis été remplacé par des «réunions de formation» de la CWO qui sont ouvertes à tous ceux qui sympathisent avec les positions de la Gauche communiste et sont prêts à approfondir sur les thèmes de chaque réunion. Jusque là, personne d'aucune autre organisation n'y a participé.
- Nous n'avons jamais exclu le CCI d'aucune de nos initiatives. Lorsque nous l'avons invité à prendre part aux réunions communes de tous les groupes de la Gauche Communiste, il a refusé sur la base qu'il «ne voulait pas partager une plate-forme avec les parasites» (mais il était quand même présent à la réunion). Loin de redouter la confrontation politique avec le CCI, c'est nous qui avons initié la série de débats qui se sont tenus à Londres à la fin des années 70 et au début des années 80. Par le passé, nous avons été présents à une douzaine de réunions publiques du CCI à Londres et Manchester, malgré les problèmes géographiques. En 15 ans, le CCI n'a assisté qu'à une seule de nos réunions à Sheffield (et uniquement pour vendre WR).
- En réalité, il n'y avait aucun membre de la CWO à la réunion de Manchester autour de laquelle votre attaque fait tant de tapage. Un sympathisant de la CWO constituait tout le public jusqu'à ce que les deux autres individus arrivent. Pratiquement chacun de vos mots sur la réunion est une grossière exagération. Notre sympathisant s'est comporté d'une manière absolument correcte durant la réunion. Il s'est explicitement dissocié de toutes les accusations de «stalinisme» faites au CCI, mais a attendu que le reste du « public » soit parti avant de critiquer le comportement du présidium (...).
- Nous n'avons pas liquidé notre journal mais adopté une nouvelle stratégie de publication qui, pensons-nous, nous permettra de toucher plus de communistes potentiels. La CWO n'a pas abandonné toute existence organisationnelle, ni «apparemment» ni autrement. Au contraire, le début de 1996 a marqué notre renforcement organisationnel. Vue la condition actuelle de World Révolution, rendue évidente par sa polémique d'un sectarisme sans précédent, il est plus nécessaire que jamais que nous poursuivions notre tâche pour l'émancipation de notre classe. Ce qui inclut naturellement des débats sérieux parmi les révolutionnaires.
CWO.
Réponse à la CWO
Pour répondre à la lettre de la CWO et rendre nos désaccords mutuels intelligibles pour le milieu politique prolétarien, nous devons aller au delà d'une réplique au coup par coup aux «rectifications» ci-dessus. Nous ne pensons pas que notre polémique était basée sur des erreurs factuelles, comme nous allons le montrer. Nous pensons que les «démentis factuels» de la CWO ne font qu'obscurcir les questions sur lesquelles portent nos désaccords. Ils tendent à donner l'impression que les débats entre organisations révolutionnaires sont de vulgaires querelles de chapelles et font de ce fait, le jeu des parasites qui prétendent qu'une confrontation organisée des divergences est inutile.
Nous avons donné comme argument dans notre polémique que la faiblesse de la CWO envers le parasitisme était basée sur une difficulté fondamentale à définir le milieu politique prolétarien, le processus de regroupement qui doit prendre place au sein de celui-ci et même à clarifier les bases de sa propre existence comme organisation séparée dans le milieu. Ces confusions organisationnelles se sont illustrées dans les événements entourant la naissance de la CWO et dans son attitude politique avec Battaglia Comunista lors des Conférences des groupes de la Gauche Communiste (1977-1980). Malheureusement, dans sa lettre, la CWO n'évoque pas ces arguments (qui ne sont pas nouveaux et qui ont été développés dans la Revue Internationale au cours des 20 dernières années), préférant se cacher derrière le rideau de fumée de ses accusations à propos de nos «erreurs factuelles».
La fondation incomplète de la CWO
La CWO a été formée sur la base des positions programmatiques et du cadre théorique développés par la Gauche Communiste. C'était de ce fait une expression véritable du développement de la conscience de classe dans la période qui suit la fin de la contre-révolution. Mais la CWO a été formée en 1975, en même temps qu'une autre organisation - avec laquelle elle avait été en discussion jusqu'alors - était créée sur la base des mêmes positions de classe et du même cadre principiel : le Courant Communiste International. Pourquoi la création par la CWO d'une organisation séparée avec les mêmes positions politiques ? Comment justifier une telle division des forces révolutionnaires alors que leur unité et leur regroupement sont d'une importance fondamentale pour l'accomplissement de leur rôle d'avant-garde dans la classe ouvrière ? Pour le CCI, le processus de regroupement devait se poursuivre en dépit des difficultés. Pour la CWO, une politique de développement séparé était nécessaire à cause de certaines divergences avec le CCI qui, sans être négligeables, étaient secondaires. La CWO avait une interprétation différente de celle du CCI sur QUAND s'était achevée la dégénérescence de la Révolution russe. Ces camarades considéraient que, du fait de ces divergences, le CCI n'était pas un groupe communiste mais un groupe contre-révolutionnaire.
Une telle confusion à propos des bases sur lesquelles il fallait créer une organisation séparée et sur lesquelles il fallait établir des relations avec d'autres organisations, a renforcé inévitablement l'esprit de chapelle qui était si prégnant lors de la réémergence des forces communistes depuis 1968. Une des illustrations de cet esprit sectaire était la requête de la part du noyau qui allait constituer la CWO en faveur de droits fédéraux au sein du CCI.
Dans leur lettre les camarades de la CWO affirment leur accord pour la centralisation internationale et leur rejet du fédéralisme. C'est évidemment très louable mais ne répond pas à la question : une telle requête (qui n'est pas démentie par les camarades) était-elle ou non une expression de mentalité sectaire ? N’était-ce pas une tentative de préserver artificiellement l'identité du groupe en dépit de son accord avec le CCI sur les principes fondamentaux du marxisme ? La véritable erreur de la requête n'était pas dans ses concessions au fédéralisme comme tel mais dans la tentative de maintenir en vie la mentalité de boutiquier. Néanmoins, nous pouvons voir qu'un tel esprit sectaire peut conduire à l'affaiblissement de certains principes que l'organisation peut par ailleurs s'efforcer de défendre. Malgré la ferme conviction de la CWO en faveur de l'organisation internationale centralisée, son regroupement avec Battaglia Comunista en 1984 conduisant à la formation du BIPR (c'est-à-dire au moins 9 ans après que la question des droits fédéralistes ait été apparemment tranchée par la CWO) l'autorise à conserver une plate-forme séparée, tant la plate-forme de Battaglia que celle du BIPR, à conserver son propre nom et à décider de sa propre activité nationale.
La question ici n'est pas si la CWO croit à l'esprit de centralisation internationale mais que la confusion sur les problèmes organisationnels du regroupement rend la chair faible.
C'est vrai que la proposition de «droits fédéraux» n'était probablement pas le signe le plus important de la confusion sur les problèmes du regroupement. Mais nous pensons que la CWO a tort d'en nier complètement l'importance. Si le CCI n'avait pas fermement rejeté cette proposition, il apparaît bien probable, à en juger par le caractère fédéraliste du regroupement avec Battaglia Comunista, que cette demande de droits fédéralistes n'en serait pas restée à un peu d'encre jetée sur du papier.
Il est stupide que les camarades protestent que la lettre avait été écrite avant que la CWO et le CCI ne se constituent et que, de ce fait, elle n'était pas significative. Une telle lettre n'aurait pu être écrite après la formation de la CWO, puisqu'une des bases de cette dernière était que le CCI était passé dans le camp du capital !
Dans une autre «rectification» de notre polémique initiale, les camarades de la CWO insistent sur le fait que la reconnaissance de la nature prolétarienne de la Révolution d'Octobre 1917 était une condition d'admission à la CWO depuis septembre 1975. Nous l'accordons volontiers aux camarades et nous n'avons pas défendu le contraire dans notre polémique. Les camarades qui ont fondé le CCI se souviennent bien des longues discussions qu'ils ont dû mener à partir de 1972-74 pour convaincre ceux qui allaient fonder la CWO de la nature prolétarienne d'Octobre1. Nous avons mentionné, dans notre polémique, que le groupe Workers Voice de Liverpool, à qui Revolutionnary Perspectives s'est joint en 1975 pour former la CWO, n'était pas homogène sur cette question vitale, pour ensuite illustrer le fait que ce regroupement était, au mieux, contradictoire. Cela semble s'être confirmé avec la séparation, un an plus tard, entre les deux parties constitutives de la CWO suivie d'une nouvelle séparation en deux, peu après. Non seulement la CWO avait élevé des questions secondaires au niveau de frontières de classe, mais elle avait aussi minimisé des questions fondamentales.
La CWO, les Conférences internationales et le BIPR
Les problèmes de compréhension de ce qu'est le milieu politique prolétarien et de comment il peut être unifié, ont également été rencontrés lors des Conférences internationale. L'appel à ce type de rencontre par Battaglia Comunista et les réponses positives données par le CCI, la CWO et d'autres groupes exprimaient indiscutablement la volonté d'éliminer les fausses divisions dans le mouvement révolutionnaire. Malheureusement, la tentative est finalement tombée par terre après trois conférences. La principale raison de cet échec résidait dans des erreurs politiques sérieuses concernant les conditions et le processus du regroupement des révolutionnaires.
Les critères d'invitation par BC à la première conférence n'étaient pas clairs puisque des groupes gauchistes de l'époque, comme Combat Communiste et Union Ouvrière faisaient partie de la liste. Des organisations faisant partie du camp révolutionnaire, comme Programma Comunista, n'en faisaient pas partie. En outre, il n'était pas clair pour quelle raison la rencontre des groupes communistes devait avoir lieu. Dans son document d'invitation initial, BC considérait que c'était à cause de la social-démocratisation des PC européens.
Depuis le début, le CCI insistait pour une claire délimitation des groupes pouvant participer à de telles conférences. A cette époque, la Revue internationale n°11 avait publié une Résolution sur les groupes politiques prolétariens adoptée au 2e Congrès du CCI. Dans la Revue internationale n° 17 a été publiée une Résolution sur le processus de regroupement qu'il avait soumise à la 2e Conférence. Une idée claire de qui appartenait au milieu révolutionnaire était nécessaire pour poursuivre le processus de regroupement. Le CCI insistait également pour que les discussions des conférences soient dédiées à l'examen des divergences politiques fondamentales existant entre les groupes et à l'élimination progressive des fausses divisions, particulièrement celles créées par le sectarisme.
Une illustration des différentes conceptions sur ce que devraient être les conférences est donnée à travers la discussion d'ouverture à la 2e Conférence (novembre 1978). Le CCI avait proposé une résolution incluant une critique des groupes comme Programma et le FOR qui avaient refusé, de façon sectaire, de participer. Cette résolution fut rejetée à la fois par BC et la CWO, cette dernière répondant :
«Nous pouvons regretter que certains de ces groupes aient jugé sans intérêt de participer. Cependant, certains de ces groupes vont changer de position dans le futur. De plus, la CWO est en train de discuter avec certains d'entre eux, et il ne serait guère diplomatique de faire une telle résolution» (Brochure sur la 2e Conférence des groupes de la Gauche communiste, Vol.2).
Là résidait le problème des conférences. Pour le CCI, elles devaient continuer, en se basant sur des principes organisationnels clairs au centre du processus de regroupement. Pour la CWO et BC ce processus était une question de... diplomatie, même si seule la CWO était assez maladroite pour le dire ouvertement.2
Initialement, la CWO et BC n'étaient pas clairs sur qui devrait participer aux conférences. Ultérieurement, ces organisations sont passées à une bien plus grande restriction dans les critères, restriction sur laquelle elles ont insisté soudainement à la fin de la 3e conférence. Le débat sur le rôle du parti, qui demeurait une question essentielle en discussion entre les différents groupes, a été clos. Le CCI, qui n'était pas d'accord avec la position adoptée par BC et la CWO, a été exclu des conférences.
Le caractère erroné de cette démarche s'est révélé quand, à la 4e conférence, la CWO et BC ont relâché les critères afin de permettre que la place du CCI soit prise par le SUCM (Student supports of the Unity of Communist Militants) dont la rupture avec le gauchisme iranien n'était qu'apparente. Cependant, d'après la lettre de la CWO, le SUCM n'était pas maoïste puisque le CCI avait discuté avec lui «secrètement» et puisqu'il avait accepté les critères de participation aux conférences. La CWO semble ici adopter un «argument» assez malencontreux - nos fautes ont été aussi vos fautes - qui relève d'une méthode bien peu appropriée pour traiter des faits. Nous reviendrons sur cet «argument» plus loin.
«1.1 La domination du révisionnisme sur le parti communiste de Russie a abouti à la défaite et au recul de la classe ouvrière mondiale dans une des ses principales places fortes»3. Par révisionnisme, ces maoïstes iraniens, comme ils l'expliquent ailleurs dans leur programme, entendaient la révision «Kroutchévienne» du «Marxisme-Léninisme», c'est-à-dire du stalinisme. Selon eux, le prolétariat a été définitivement défait, non pas lorsque Staline a annoncé la construction du socialisme dans un seul pays, mais au contraire après la mort de Staline, c'est-à-dire bien après l'écrasement de la classe ouvrière russe dans les goulags et sur les champs de bataille impérialistes, la destruction du parti bolchevik, l'écrasement de la classe ouvrière allemande, espagnole, chinoise, bien après l'envoi de 20 millions d'être humains dans l'abattoir de la seconde guerre mondiale...
A ses débuts, la CWO taxait le CCI de contre-révolutionnaire parce que ce dernier considérait que la dégénérescence de la révolution d'Octobre n'était pas achevée en 1921. Sept ans plus tard, la CWO tenait des discussions fraternelles en vue de former le futur parti avec une organisation qui considérait la révolution comme ayant pris fin en ... 1956 !
Selon le SUCM, ce n'était pas la révolution socialiste qui était à l'ordre du jour en Iran comme partout ailleurs mais la «révolution démocratique», supposée en être une étape.
Niant la nature impérialiste de la guerre Iran-Irak, le SUCM avançait les arguments les plus sophistiqués pour appeler au sacrifice du prolétariat sur l'autel de la défense nationale. Le SUCM semblait être d'accord avec BC et la CWO sur le rôle du parti mais le «rôle organisateur» du parti qu'il avait à l'esprit c'était la mobilisation des masses derrière sa tentative de prise du pouvoir bourgeois.
A la 4e Conférence, la CWO avait pourtant fait preuve d'une timide clairvoyance sur la nature réelle du SUCM :
«Notre réelle objection concerne cependant la théorie de l'aristocratie ouvrière. Nous pensons que ce sont les derniers germes du populisme de l’UCM et que son origine est dans le maoïsme.»4
«La théorie de la révolution paysanne [du SUCM] est une réminiscence du maoïsme, chose que nous rejetons totalement»5
Voilà pour l'organisation dont la CWO dit maintenant qu'elle «ne pouvait pas être maoïste».
Le grand intérêt et l'apparente fraternité dont faisait montre le SUCM à l'égard du milieu politique prolétarien en Grande-Bretagne ainsi que la dissimulation de son stalinisme derrière un écran de radicalisme verbal, donnent probablement un début d'explication au fait que la CWO et BC ont pu se laisser rouler. C'est vrai que la section du CCI en Grande-Bretagne, World Revolution, avait initialement pensé que le SUCM pouvait être une expression de la vague de luttes ouvrières en Iran à l'époque (1980), avant de réaliser la nature contre-révolutionnaire du SUCM. Mais ceci ne suffit pas à fournir une explication satisfaisante de l'auto-mystification de la CWO dans la mesure, en particulier, où WR l'avait mise en garde sur la nature du SUCM et avait critiqué le laxisme de sa propre appréciation initiale. WR avait également tenté de dénoncer cette organisation à une conférence de la CWO mais avait été interrompu par les huées de la CWO avant d'avoir pu terminer son intervention.6
Le débat entre révolutionnaires ne peut être basé sur la moralité philistine des «torts partagés». Il y a erreur et erreur. World Revolution a réussi à ne pas tomber dans des erreurs majeures et en a tiré les leçons. La CWO et BC ont commis une faute tragique, dont les effets négatifs sur le milieu politique prolétarien se font encore sentir aujourd'hui. La farce de la 4e Conférence donna le coup de grâce aux Conférences en tant que pôle de référence pour l'émergence des forces révolutionnaires. Et la CWO refuse toujours aujourd'hui de reconnaître le désastre et les origines de celui-ci. Ces origines résident dans la cécité concernant la nature du milieu politique prolétarien et qui a conduit à une politique de regroupement basée sur la diplomatie.
La formation du BIPR
Dans la polémique de WR nous avançons que le regroupement entre la CWO et BC a souffert du même type de faiblesses que les Conférences internationales. En particulier, ce regroupement n'est pas intervenu comme résultat d'une claire résolution des divergences qui séparaient les groupes de la Gauche communiste, ni de celles entre BC et la CWO.
D'une part, le BIPR affirmait qu'il n'était pas une organisation unifiée puisque chaque groupe avait sa propre plate-forme. Le BIPR a pas mal de plates-formes : celle de BC, celle de la CWO et celle du BIPR qui est un agrégat des deux premières moins leurs désaccords. En plus, la CWO a une plate-forme pour les groupes de chômeurs et une plate-forme pour les groupes d'usine. Il s'était également engagé dans le processus d'écriture d'une «plate-forme populaire» avec le Communist Bulletin Group, comme nous le verrons plus loin. Si elle continue comme cela, la CWO aura bientôt plus de plates-formes que de militants... Le BIPR est «pour le parti» mais comporte déjà une organisation, BC, qui prétend être le parti : le «Partito Comunista Internazionalista».
D'un autre côté, nous n'avons jamais vu dans la presse de ces organisations ou dans leur presse commune le moindre débat sur leurs désaccords. Et il subsiste des divergences sur la possibilité du «parlementarisme révolutionnaire», sur les syndicats et sur la question nationale. De ce point de vue, le BIPR présente un contraste saisissant avec le CCI, lequel est une organisation internationale unifiée, centralisée et qui, en accord avec la tradition du mouvement ouvrier, ouvre ses débats internes en direction de l'extérieur.
Sur la question de son rapprochement avec BC, la lettre de la CWO fait valoir que le regroupement du BIPR n'a pas eu lieu du jour au lendemain et que, de ce fait, il ne peut être considéré comme un «rapide arrangement opportuniste». Cependant, notre polémique ne mentionne pas la rapidité avec laquelle ce regroupement a eu lieu mais critique la solidité de ses bases politiques et organisationnelles. Le BIPR était basé sur une sélection auto-décidée des forces qui devraient conduire le futur parti. Pourtant, durant les 12 années qui se sont écoulées entre la formation du BIPR et aujourd'hui, celui-ci n'a même pas réussi à unifier ses deux organisations fondatrices.
La tentative de regroupement de la CWO avec le CBG
La politique de la CWO concernant le regroupement - caractérisée par l'absence de critères sérieux définissant le milieu politique prolétarien et ses ennemis - a une nouvelle fois conduit à des difficultés potentiellement catastrophiques au début des années 90. Les leçons de l'aventure malheureuse avec les gauchistes iraniens n'avaient pas été tirées. La CWO s'est laissé aller à un rapprochement avec les groupes parasites, le CBG et la FECCI, annonçant un possible «nouveau départ» à l'intérieur du milieu révolutionnaire en Grande-Bretagne. La lettre de la CWO nous dit cependant qu'il n'y a pas de regroupement avec le CBG et qu'elle n'a pas eu de contact avec ce groupe depuis 1993. Nous sommes heureux de l'apprendre. Mais quand la polémique dans WR n°190 a été écrite, cette information n'avait pas été rendue publique et, de ce fait, nous nous sommes basés sur les informations les plus récentes de Workers Voice sur ce sujet :
«Etant donnée la récente coopération pratique entre membres de la CWO et du CBG dans la campagne de fermeture des mines, les deux groupes se sont rencontrés à Edimbourg en décembre pour discuter des implications de cette coopération. Politiquement le CBG a accepté que la plate-forme du BIPR ne ferait pas obstacle au travail politique si la CWO clarifie ce qu'elle entend par une organisation centralisée dans la période actuelle. Un grand nombre d'incompréhensions ont été éclaircies des deux côtés. Il a donc été décidé de rendre la coopération pratique plus formelle. Un accord a été rédigé, que la CWO comme un tout aura à ratifier en janvier (après quoi un rapport plus complet sera publié) et qui comprend les points suivants :
-
le CBG fera régulièrement des contributions dans Workers Voice et recevra tous les rapports rédactionnels (de même pour les tracts, etc.) ;
-
les réunions trimestrielles de la CWO seront ouvertes aux membres du CBG après janvier ;
-
les deux groupes doivent discuter d'un projet de "plate-forme populaire" préparé par un camarade de la CWO en tant qu'outil d'intervention. Le CBG doit donner une réponse écrite avant une réunion qui se tiendra en juin pour évaluer les progrès du travail commun ;
-
Les camarades de Leeds des deux organisations doivent préparer cette réunion.
-
Les réunions publiques communes doivent se poursuivre auxquelles tous les autres groupes de la Gauche Communiste basés en Grande-Bretagne seront invités à se joindre.
-
Cet accord sera, au moins brièvement, rapporté dans le prochain numéro de WV.».7
Dans la mesure où aucun accord (ou désaccord) ne fut rapporté dans le WV suivant, brièvement ou pas, ni dans aucun de ceux qui ont suivi, et puisqu'une activité commune s'était déjà mise en place, il était assurément valable de supposer qu'un certain type de regroupement s'était poursuivi entre la CWO et le CBG. La rectification de la CWO donne l'impression, à tort, que ce regroupement est une pure invention de notre part. De même que la CWO a cru qu'il était possible de transformer une organisation maoïste en avant-garde prolétarienne, elle a pensé qu'elle pourrait transformer des parasites en communistes militants. De même qu'elle a pris pour argent comptant l'acceptation par le SUCM des «critères prolétariens de base», elle a cru sur parole le CBG lorsqu'il a accepté la plate-forme du BIPR. La CWO a cru qu'elle avait clarifié la conception de «l'organisation centralisée» avec un groupe qui a contribué à former une tendance secrète au sein du CCI dans le but de transformer son organe central en «boîte à lettres» (exactement comme l'Alliance de Bakounine avait essayé de le faire avec le Conseil Général de la Première Internationale). Elle a estimé qu'elle pouvait faire confiance à des éléments qui avaient volé du matériel au CCI et l'avaient ensuite menacé d'appeler la police s'il venait le récupérer !
L'initiative de la CWO avec les parasites, qui sont clairement des ennemis des organisations révolutionnaires, a eu pour effet de donner une dignité aux groupes parasitaires, en les faisant passer pour d'authentiques membres de la Gauche Communiste et ainsi que de légitimer les calomnies contre les organisations de ce milieu.
Les dégâts causés par la tentative de regroupement de la CWO avec le CBG incluent aussi ceux faits à sa propre organisation. Nous en sommes particulièrement convaincus pour les raisons suivantes :
-
Premièrement, le parasitisme n'est pas un courant politique au sens prolétarien. Il ne se définit pas comme une organisation cohérente autour d'un programme politique. Au contraire son objectif même est de détruire une telle cohérence au nom de l'anti-sectarisme et de la «liberté de pensée». Son travail de dénigrement des organisations révolutionnaires et d'encouragement de la désorganisation et de la confusion peut être poursuivi informellement par d'ex-membres, même après qu'ils aient laissé tomber leur prétention à une existence formelle - comme dans le cas du CBG.
-
Deuxièmement, le parasitisme, s'il est accepté comme faisant partie du milieu révolutionnaire, ramollit la colonne vertébrale des organisations existantes, réduisant leur capacité à se définir elles-mêmes (et les autres) de façon rigoureuse. Les résultats en sont catastrophiques, même si cela peut conduire temporairement à un accroissement numérique.
Même si le regroupement avec le CBG a avorté, il reste cependant des questions graves pour la CWO. Pourquoi a-t-elle développé des relations avec un tel groupe alors que ce dernier n'avait pas d'autre raison d'exister que de dénigrer les organisations du milieu politique prolétarien ? Pourquoi, au lieu de garder le silence, n'a-t-elle pas mis en évidence sincèrement et ouvertement les faiblesses et incompréhensions qui avaient conduit à une telle erreur politique ?
Les conséquence de l'aventure avec le CBG
La polémique de WR avec la CWO avait été écrite en tant que réponse directe et immédiate essayant d'expliquer deux inquiétants événements récents : l'incapacité à défendre une réunion publique de WR contre le sabotage par un groupe parasite, Subversion, et la liquidation du journal Workers Voice. Cela indiquait, de notre point de vue, un aveuglement dangereux envers les ennemis du milieu politique prolétarien et même une tendance à reprendre à son compte certaines des activités du parasitisme politique au détriment du militantisme communiste. Malheureusement, la lettre de la CWO ne prend pas en considération les arguments de la polémique sur cette question pas plus que sur les autres.
En ce qui concerne la réunion publique, il n'y a rien à répondre, selon la CWO, parce que le récit du CCI à ce sujet est une «exagération grossière».
La question fondamentale à laquelle la CWO évite de répondre est la suivante : la réunion a-t-elle été sabotée par les parasites, oui ou non ? Le CCI a apporté la démonstration de ce sabotage dans deux numéros de son journal mensuel en Grande-Bretagne, World Revolution. Il consistait à interrompre la réunion, à répéter des provocations verbales et physiques contre les militants du CCI, incluant toutes les calomnies typiquement parasitaires nous taxant de stalinisme, d'autoritarisme, etc., à créer un climat rendant toute discussion impossible et finalement à amener la réunion à prendre fin prématurément. Le sympathisant de la CWO n'a pas bougé pour combattre le sabotage de la réunion et, au lieu de cela, a réservé ses critiques au CCI et à sa défense de la réunion. La CWO aurait fait pareil, comme sa lettre le montre. Elle refuse d'admettre et nie qu'un tel sabotage ait eu lieu - encore moins le dénonce-t-elle - et réprimande le CCI pour ses prétendues «grossières exagérations».
Même chose concernant Workers Voice. Mais la lettre nous dit que la CWO n'a pas liquidé son journal mais a adopté une nouvelle stratégie de publication avec Revolutionnary Perspectives. La CWO a bel et bien stoppé la publication du journal Workers Voice et l'a remplacé par une revue théorique Revolutionnary Perspectives.
La lettre de la CWO ne répond pas à notre argument disant que derrière cette «nouvelle stratégie», il y a une concession sérieuse au parasitisme politique. La CWO déclarait que Revolutionnary Perspectives était «pour la reconstitution du prolétariat». Elle suggérait également, sans entrer dans les détails, que «l'effondrement de l'URSS avait créé tout un nouvel ensemble de tâches théoriques».
Au moment même où il est important d'insister sur le fait que la théorie révolutionnaire ne peut se développer que dans le contexte d'une intervention militante dans la lutte de classe, la CWO fait des concessions aux idées colportées par certains groupes parasites de la tendance académiste, qui habillent leur impuissance et leur absence de volonté militante avec la prétention de se plonger dans les «nouvelles questions théoriques». Certes la CWO n'en est pas là, mais puisque c'est un groupe du milieu politique prolétarien, ses faiblesses risquent de servir de feuille de vigne aux groupes qui parasitent ce milieu. Il faut d'ailleurs noter que la grande préoccupation de la CWO sur la «reconstitution du prolétariat» a un petit air de famille avec le dada de la FECCI sur le même thème, dada que cette dernière est allé récupérer chez des docteurs en sociologie comme Alain Bihr, porte-parole subtil - et appointé par les médias bourgeoises - de l'idée que le prolétariat n'existe plus ou qu'il n'est plus la classe révolutionnaire8. Le propos de telles remises en cause de la part des parasites est bien sûr non d'aboutir à une claire orientation pour la classe ouvrière mais de dénigrer l'approche organisationnelle militante de la théorie marxiste et de détruire ses fondements. Ce n'est pas ce que veut la CWO, mais l'abandon de son journal et la restriction de son intervention à la seule publication d'une revue théorique n'est certainement pas en cohérence avec le besoin criant pour la presse révolutionnaire d'être un «propagandiste collectif», un «agitateur collectif» et un «organisateur collectif» ?
Dans sa nouvelle publication, la CWO n'a pas été capable, jusqu'au n°3, de publier ses principes de bases ni de donner la moindre idée de son existence en tant qu'organisation. Ce n'est pas un accident, cela représente encore un affaiblissement de sa présence politique dans la classe ouvrière.
La CWO et le CCI
Les faiblesses de la CWO sur la question du milieu politique prolétarien l'a conduite à une aventure dangereuse avec des ennemis de ce milieu, tant les gauchistes que les parasites. D'un autre côté, elles ont abouti à une politique, également nocive, d'hostilité sectaire envers le CCI. En Grande-Bretagne, elle a essayé d'éviter toute confrontation systématique des divergences politiques avec World Revolution et de poursuivre une politique de «développement séparé» particulièrement à travers les groupes de discussion dont les critères de participation sont extrêmement peu clairs sauf sur la question de l'exclusion du CCI. Selon sa lettre, la CWO a «participé» au «Groupe d'études de Sheffield» avec des anarchistes, des communistes de gauche, des parasites comme Subversion et un ex-membre du CBG. Récemment, ce groupe d'études a été remplacé par les «réunions de formation» de la CWO.
Non, la CWO a organisé ce cercle d'études de Sheffield comme un club sans aucun critère politique clair quant à la participation ou aux objectifs.
La «réunion de formation» de la CWO ne semble pas y avoir changé grand chose : est-ce qu'elle exclut désormais les anarchistes et parasites ou bien uniquement ceux qui ne veulent pas approfondir ? Par contre, la non présence du CCI continue d'être une condition de son existence. A la dernière réunion, apparemment sur la question de la Gauche russe, le CCI comme organisation était explicitement non invité même si une camarade du CCI l'était mais uniquement sur la base du fait qu'elle était la compagne d'un des participants privilégiés ! Naturellement, puisque les membres du CCI sont des militants responsables devant l'organisation et non des francs tireurs, cette gracieuse invitation fut déclinée.
Le CCI n'a toujours pas été informé de la tenue d'autres réunions de formation malgré ce qui est dit dans la lettre de la CWO et jusqu'à ce que nous le soyons, nous jugerons qu'elles se veulent, non un lieu de référence pour la confrontation politique et théorique au sein du milieu politique prolétarien, mais un rassemblement sectaire où la discussion est alimentée plus par les besoins de la diplomatie que par des principes clairs.
C'est vrai que la CWO n'a jamais admis sa politique de développement séparé en ce qui concerne les réunions politiques et proclame, contre toute évidence, qu'elle a maintenu une ouverture envers le CCI uniquement restreinte par des «difficultés» géographiques ou autres contingences.
En plus de 20 ans depuis la formation d'un courant de la Gauche communiste en Grande-Bretagne, la CWO est peut-être venue à une douzaine de réunions publiques du CCI. Mais durant cette même période, c'est plus d'une centaine de réunions que nous avons tenues.
Depuis que la CWO nous a écrit sa lettre, le CCI a tenu deux réunions publiques à Londres et une à Manchester sur l'Irlande et sur les grèves en France à la fin de l'année dernière, deux sujets sur lesquels la CWO a écrit de courtes polémiques dans sa presse. Mais elle n'est pas venue défendre son point de vue à ces réunions ! La CWO ne s'est pas dérangée non plus pour la réunion du CCI à Londres en janvier sur la question vitale de la défense des organisations révolutionnaires. Durant la même période, la CWO a tenu une réunion ouverte à Sheffield sur «Racisme, sexisme et communisme», annoncée dans RP n°3, qui est arrivée aux librairies et à la boîte postale de WR une semaine environ après que la réunion ait eu lieu.
L'attitude sectaire de la CWO à l'égard du CCI s'explique difficilement par des difficultés géographiques à moins que nous puissions croire que des internationalistes comme les camarades de la CWO sont incapables de surmonter régulièrement les problèmes géographiques d'un trajet de 37 miles de Sheffield à Manchester, ou de 169 miles jusqu'à Londres.
Voici la véritable raison, selon la CWO :
«Le débat est impossible avec le CCI, comme la CWO s'en est rendu compte lors d'une récente réunion publique à Manchester, parce que les camarades sont incapables de comprendre le moindre fait, argument ou point de vue politique s'il ne rentre pas dans leur "cadre". Mais ce cadre est un cadre idéaliste et, comme le disait un de nos camarades à la même réunion, il se ramène aux quatre murs d'un asile de fous.» 9
Ainsi, «le débat est impossible avec le CCI» - mais possible avec des gauchistes, des anarchistes, le SPGB (Socialist Party of Great-Britain) et les parasites ?
Il est temps que la CWO reconsidère sa politique sans boussole à l'égard du regroupement des révolutionnaires.
D'après la CWO, la polémique du CCI est «d'un sectarisme sans précédent». Mais une critique profonde et sérieuse d'une organisation révolutionnaire par une autre, y compris en mettant en cause ses fondements même, ce n'est pas du sectarisme. Les organisations révolutionnaires ont le devoir de confronter leurs divergences afin d'éliminer le plus possible la confusion et la dispersion dans le camp révolutionnaire et de hâter l'unification des forces révolutionnaires dans le futur unique parti mondial du prolétariat.
Le sectarisme se caractérise au contraire par l'esquive de telles confrontations, soit en se réfugiant dans un superbe isolement, soit par des manœuvres opportunistes, dans le but de préserver à tout prix l'existence de son groupe séparé.
Michael, août 1996.
1 C'est vrai qu'au cours de la même période, les camarades qui allaient publier World Revolution et qui ont constitué la section du CCI en Grande-Bretagne (et qui provenaient en bonne partie du groupe conseilliste Solidarity, tout comme le groupe Revolutionnary Perspectives) n'étaient pas encore clairs sur la nature de la Révolution russe. Mais les autres groupes constitutifs du CCI, notamment Révolution Internationale, avaient défendu très clairement sa nature prolétarienne tout au long des conférences et discussions qui se sont tenues alors.
2 La lettre de la CWO donne l'impression que le CCI aurait forcé la dose afin de pouvoir l'attaquer. Mais il n'est nullement nécessaire d'alimenter nos critiques de la CWO avec des mensonges, même si nous le voulions, car au cours des années elle a exprimé ses confusions organisationnelles et politiques de façon vraiment transparente.
3 «Programme du parti communiste», adopté par l'«Unité des Combattants Communistes». Ce programme, que l'UCM a adopté avec Komala (une organisation de guérilla liée au Parti démocratique kurde) a été publié en mai 1982, 5 mois avant la 4e conférence. Il était, pour sa part, basé sur celui de l'UCM publié en mars 1981, et il a été présenté comme une contribution à la discussion pour la 4e conférence.
4 4e conférence des groupes de la gauche communiste. Septembre 1982. p.18.
5 Ibid. p.22.
6 Voir World Revolution n°60. Mai 1983.
7 Workers Voice n°64, Janvier-Février 1993. p.6.
8 Voir Revue Internationale n°74, «Le prolétariat est toujours la classe révolutionnaire».
9 WV n°59. Hiver 1991-92.
Courants politiques:
- Gauche Communiste [49]
- TCI / BIPR [137]
- Communist Workers Organisation [138]
Approfondir:
Heritage de la Gauche Communiste:
Revue Int. 1997 - 88 à 91
- 4088 reads
Revue Internationale no 88 - 1e trimestre 1997
- 3110 reads
Lutte de classe : La bourgeoisie multiplie les obstacles
- 2651 reads
Dans notre article « Le prolétariat ne doit pas sous-estimer son ennemi de classe », paru dans la Revue internationale n° 86, nous affirmions en conclusion :
« Ainsi, c'est bien à l'échelle mondiale que la bourgeoisie met en oeuvre sa stratégie face à la classe ouvrière. L'histoire nous a appris que toutes les oppositions d'intérêts entre les bourgeoisies nationales, les rivalités commerciales, les antagonismes impérialistes pouvant conduire à la guerre, s'effacent lorsqu'il s'agit d'affronter la seule force de la société qui représente un danger mortel pour la classe dominante, le prolétariat. C'est de façon coordonnée, concertée que les bourgeoisies élaborent leurs plans contre celui-ci.
Aujourd'hui, face aux combats ouvriers qui se préparent, la classe dominante devra déployer mille pièges pour tenter de les saboter, de les épuiser et les défaire, pour faire en sorte qu'ils ne permettent pas une prise de conscience par le prolétariat des perspectives ultimes de ces combats, la révolution communiste. »
C'est d'abord, en effet, dans le cadre d'un cours à des affrontements de classes décisifs persistant qu'il faut inscrire et comprendre la situation actuelle de la lutte de classe. Malgré le recul profond qu'il a subi suite à l'effondrement du stalinisme en 1989 et au battage idéologique intense sur la « mort du communisme » orchestré mondialement par la bourgeoisie, malgré les nombreuses campagnes qui ont suivi visant à lui inspirer un sentiment d'impuissance, le prolétariat a certes cédé du terrain mais n'a pas été battu. Il l'a prouvé en reprenant le chemin des luttes, dès 1992 en Italie, pour défendre ses conditions d'existence contre les attaques redoublées que, partout, la classe dominante continuait de lui assener.
La stratégie de la bourgeoisiepour contrer la reprise des luttes ouvrières
C'est dans le but de faire face à cette réalité menaçante, grosse de périls pour elle et son système, que la bourgeoisie, notamment celle des principaux pays d'Europe, n'a cessé de multiplier les manoeuvres pour saboter la reprise des luttes et que, parallèlement, elle s'est évertuée à renforcer ses principales armes anti-ouvrières.
Cette reprise des luttes a d'autant plus alerté la classe dominante qu'elle a fait resurgir, dans un premier temps, des démons que celle-ci croyait avoir enterrés après 1989. Ainsi, les ouvriers en Italie ont exprimé avec force en 1992, dans des manifestations de masse, leur défiance persistante vis-à-vis des syndicats et rappelé à l'ensemble de leur classe ce qu'elle avait réussi, notamment durant les années 1980, à inscrire de plus en plus clairement dans sa conscience, c'est-à-dire que ces organisations ne sont pas les siennes et que, derrière leur masque et leur langage « prolétariens », elles ne sont que des défenseurs acharnés des intérêts du capital. De plus, en 1993, lors des grèves dans les mines qui ont secoué la Ruhr, les ouvriers allemands ont non seulement ignoré et même rejeté les consignes syndicales (attitude à laquelle ils ne nous avaient pas habitués jusque là) mais aussi ont exprimé, dans leurs manifestations de rue, leur unité au delà du secteur, de la corporation ou de l'entreprise, joignant à eux leurs frères de classe au chômage.
Ainsi, deux tendances fondamentales qui s'étaient manifestées et développées dans les luttes ouvrières durant les années 1980 :
– la méfiance croissante des ouvriers vis à vis des syndicats qui les poussait à se dégager progressivement de leur emprise ;
– la dynamique vers l'unité la plus large, significative de la confiance de la classe ouvrière en elle-même et de ses capacités grandissantes à assumer ses propres luttes ;
se sont à nouveau exprimées dès que le prolétariat a repris le chemin des luttes et cela malgré l'important recul qu'il venait de subir.
Voila pourquoi, depuis, la bourgeoisie, au niveau international, a développé toute une stratégie dont l'objectif central était de recrédibiliser les syndicats et dont le point d'orgue a été la manoeuvre d'ampleur qu'elle a manigancée en France, à la fin de 1995, à travers les « grèves » dans le secteur public.
Cette stratégie visant à redonner une image positive de ses officines d'encadrement de la classe ouvrière ne devait pas seulement stopper le processus d'usure que celles-ci connaissaient depuis plus de deux décennies, et qui continuait à se vérifier encore dans les premières luttes de la reprise ouvrière, mais aussi de pousser les prolétaires à leur faire confiance à nouveau. Ce résultat a commencé à se concrétiser dès l'année 1994, en Allemagne et en Italie notamment, avec une reprise en main des luttes de la part des syndicats et a connu une pleine réussite en France à la fin de l'année suivante. Les syndicats, pourtant particulièrement discrédités dans ce pays, ont réussi – à travers « le puissant mouvement » dans le secteur public qui a été provoqué, encouragé et manipulé – à se reforger une image « ouvrière ». Et cela, pas seulement parce qu'ils ont pu adopter, à bon compte, une attitude « radicale » et « combative » mais aussi parce que, profitant de la faiblesse momentanée des ouvriers, ils ont réussi à faire croire qu'ils étaient capables de mettre en oeuvre les véritables besoins de la lutte ouvrière qu'ils avaient pourtant si longtemps contrariés et sabotés : les assemblées générales souveraines, les comités de grève élus et révocables, l'extension de la lutte par l'envoi de délégations massives, etc. A travers ce « mouvement » qui a été présenté dans le monde entier comme « exemplaire », qui a bloqué le pays pendant près d'un mois et qui a soi-disant fait reculer le gouvernement, la bourgeoisie a, de plus, réussi à faire croire aux ouvriers qu'ils avaient retrouvé toute leur force, leurs capacités de lutte et leur confiance... grâce aux syndicats.
Par cette manoeuvre qui remettait pleinement en selle les syndicats, la classe dominante apportait la réponse d'une part à ce qui s'était manifesté violemment en Italie (le débordement et le rejet des organes d'encadrement bourgeois par les ouvriers) et d'autre part à ce que la classe ouvrière avait exprimé dans la lutte des mineurs de la Ruhr (la tendance à l'unification qui est significative de sa capacité à se concevoir en tant que classe, à assumer ses luttes de façon autonome, mais également significative de la confiance qu'elle a en elle-même). L'année 1995 se terminait ainsi par une victoire incontestable de la bourgeoisie sur le prolétariat, victoire qui lui a permis d'effacer momentanément de la conscience ouvrière les principales leçons héritées des combats menés lors des années 1980 notamment.
Cette victoire, la bourgeoisie va tout faire pour l'étendre à d'autres pays, à d'autres fractions du prolétariat. Dans un premier temps et presque de façon simultanée, elle a reproduit strictement la même manoeuvre en Belgique avec d'un côté un gouvernement qui adoptait la « méthode Juppé », portant avec brutalité et arrogance des attaques particulièrement violentes voire provocatrices contre les conditions de vie de la classe ouvrière et de l'autre des syndicats qui retrouvaient leur « combativité », appelant à une riposte massive, « unitaire » et embarquant les ouvriers de plusieurs entreprises du secteur public derrière eux. Comme en France, un pseudo recul du gouvernement venait achever la manoeuvre et sanctionner la victoire de la bourgeoisie dont les syndicats étaient les principaux bénéficiaires.
Au printemps 1996, c'était au tour de la classe dominante allemande de reprendre le flambeau et d'attaquer pratiquement de la même façon les prolétaires autochtones pour renforcer ses syndicats. La différence avec ce qui a prévalu en France et en Belgique notamment se situait au niveau du problème à résoudre. En Allemagne, en effet, la bourgeoisie n'avait pas tant comme but de faire retrouver à ses syndicats un crédit perdu auprès des ouvriers que de leur permettre d'améliorer leur image : face à la perspective inévitable d'un développement des luttes ouvrières, celle qu'ils avaient traditionnellement de syndicats de « consensus », spécialistes de la négociation « à froid », ne suffisait plus ; un ravalement était nécessaire pour leur permettre d'apparaître comme des syndicats de « lutte ». C'est ce qu'ils avaient commencé à faire quand leurs principaux dirigeants avaient « assuré de leur sympathie les grévistes français » en décembre 1995, c'est ce qu'ils ont développé quand, dans les luttes et manifestations qu'ils ont appelées et organisées au printemps 1996, ils se sont montrés « de la plus grande intransigeance » dans la défense des intérêts ouvriers, et c'est cette même image qu'ils n'ont cessé de peaufiner depuis au travers des différentes « mobilisations » qu'ils ont orchestrées.
Durant la plus grande partie de cette année, dans la plupart des pays d'Europe, la bourgeoisie a tout fait pour se préparer à des affrontements futurs inévitables avec le prolétariat ; elle a ainsi multiplié les « mobilisations » pour renforcer ses syndicats et même pour élargir l'assise du syndicalisme en milieu ouvrier. Le retour en force des grandes centrales syndicales s'est accompagné, notamment dans certains pays comme la France et l'Italie, d'un développement des organisations syndicalistes de base (SUD, FSU, Cobas, etc.), animées par les gauchistes, dont le rôle essentiel est d'être un appoint, certes critique vis-à-vis des centrales, mais un appoint indispensable pour couvrir tout le terrain de la lutte ouvrière, pour contrôler les ouvriers qui tendraient à déborder les syndicats classiques et, en fin de compte s'arranger pour les rabattre vers ces mêmes syndicats. La classe ouvrière s'est déjà confrontée, dans les années 1980, à des organisations de ce type mises en place par la bourgeoisie : les coordinations. Mais alors que celles-ci se présentaient comme « anti-syndicales » et avaient pour tâche de faire le sale boulot que les syndicats avaient de plus en plus de mal à assumer du fait du profond discrédit qu'ils connaissaient auprès des ouvriers, les syndicats de « base » ou de « combat » actuels, qui ne sont que des émanations directes (souvent à travers des "scissions") des grandes centrales, ont pour but essentiel de renforcer et élargir l'influence du syndicalisme et non de « s'opposer » à ces dernières (ce n'est pas une nécessité à l'heure actuelle).
Malgré la multiplication des obstacles, la reprise des luttes ouvrières se confirme
Parallèlement aux manoeuvres qu'elle n'a cessé de développer, depuis plus d'un an, sur le terrain des luttes, la bourgeoisie a déployé toute une série de campagnes idéologiques contre la classe ouvrière. S'attaquer à la conscience du prolétariat est un objectif premier et constant pour la classe dominante.
Ces dernières années, elle n'a pas ménagé ses efforts sur ce plan. Nous avons abondamment développé dans nos colonnes cette question, en particulier sur les campagnes idéologiques massives visant à faire passer l'effondrement du stalinisme pour « la mort du communisme » voire « la fin de la lutte de classe ». Parallèlement, la bourgeoisie n'a cessé de claironner « la victoire historique du capitalisme » même si elle a plus de mal à faire passer ce deuxième mensonge du fait de son incapacité à masquer la réalité barbare quotidienne de son système. C'est dans ce cadre que, depuis plus d'un an, un peu partout, elle multiplie des campagnes poussant à « la défense de la démocratie ».
C'est ce qu'elle fait quand, à grand renfort médiatique, elle cherche à mobiliser contre le prétendu danger d'une « montée du fascisme » en Europe. C'est ce qu'elle fait aussi, ces derniers mois, via sa croisade contre le « négationnisme » à travers laquelle, d'une part, elle essaie de dédouaner le « camp démocratique » des monstrueux massacres qu'il a, comme le « camp fasciste », perpétrés durant la deuxième guerre mondiale et, d'autre part, elle s'attaque aux seuls et véritables défenseurs de l'internationalisme prolétarien, les groupes révolutionnaires issus de la Gauche communiste, cherchant à en faire des complices masqués de l'extrême-droite du capital. C'est ce qu'elle fait enfin en suscitant et en orchestrant des mobilisations d'ampleur pour « améliorer le système démocratique », « le rendre plus humain » et lutter contre « ses défaillances ». Voila ce à quoi viennent d'avoir droit les prolétaires en Belgique quand, à travers la campagne assourdissante développée suite à l'affaire Dutroux, ils ont été poussés à revendiquer « une justice propre », « une justice pour le peuple » dans des manifestations monstres (300 000 participants à Bruxelles le 20 octobre dernier), au coude à coude avec des démocrates bourgeois de tous acabits. Depuis quelques années, les ouvriers en Italie subissent un traitement similaire avec la campagne « mains propres ».
En multipliant ainsi les battages idéologiques, la bourgeoisie cherche évidemment à dévoyer la réflexion de la classe ouvrière, à l'écarter de ses préoccupations de classe. Cela s'est particulièrement illustré en Belgique où le tapage autour de l'affaire Dutroux a permis, en grande partie, de détourner les ouvriers des mesures d'austérité draconiennes annoncées par le gouvernement pour 1997. En attendant, cela bénéficie à la bourgeoisie qui arrive à faire passer ses attaques anti-ouvrières, à repousser les échéances d'affrontements avec le prolétariat et à gagner ainsi du temps pour mieux s'y préparer en échafaudant de nouveaux obstacles, de nouveaux pièges.
Mais cette expérience que vient de faire la classe dominante en Belgique, avec des grèves et débrayages dans plusieurs entreprises – suscités par les syndicats et les gauchistes – où les revendications ouvrières passaient derrière celle pour « une justice propre », visait, à l'évidence, un autre objectif : celui d'amener le prolétariat en lutte sur son terrain à elle. Ce n'est pas seulement la conscience des ouvriers qu'elle cherche à dévoyer mais aussi leur combativité montante.
Cette évolution dans l'attitude de la bourgeoisie est riche d'enseignements et nous permet de comprendre :
– d'abord que la combativité ouvrière est en train de se développer et s'étendre contrairement à la situation qui prévalait à la fin de 1995 et au début de 1996. C'est, en effet, la faiblesse relative des ouvriers à ce niveau que la classe dominante avait exploitée en engageant et en réussissant sa manoeuvre préventive. C'est cette faiblesse qui avait permis aux syndicats de revenir en force et d'organiser, sans risquer d'être débordés, ses « grandes luttes unitaires » ;
– ensuite que la manoeuvre, initiée en France et reprise dans plusieurs pays d'Europe, malgré sa réussite sur certains plans (notamment au niveau du renforcement des syndicats), révèle ses propres limites. Si elle a occasionné un certain épuisement des ouvriers, en France particulièrement où elle a pris le plus d'ampleur, elle n'a pu reporter les échéances durablement, empêcher que le mécontentement s'approfondisse et recommence à s'exprimer. De même les fameux « reculs » des gouvernements Juppé et autres se révèlent aujourd'hui pour ce qu'ils sont : des mystifications. Pour l'essentiel, les mesures anti-ouvrières contre lesquelles les prolétaires ont été amenés à se battre sont passés. Quant à la prétendue « victoire » obtenue grâce aux syndicats, elle tend à n'être plus qu'un souvenir douloureux pour les ouvriers qui gardent un goût amer et le sentiment diffus de s'être fait avoir.
Parce qu'elle est consciente de cette situation, la bourgeoisie a quelque peu modifié sa stratégie :
D'une part, ses syndicats tendent de plus en plus à limiter l'ampleur de leurs « mobilisations » quand elles se situent sur le terrain de la lutte revendicative, comme on l'a vu en France le 17 octobre dernier et plus encore lors de la « semaine d'action » du 12 au 16 novembre ; et à « l'unité syndicale » dont les grandes centrales se glorifiaient hier, succède aujourd'hui une politique de division entre les différentes officines afin d'émietter une colère et une combativité qui mûrissent dangereusement.
Dans le cas de l'Espagne, pour prendre un autre exemple, la tactique de division des syndicats ne passe pas pour l'heure à travers les querelles entre différentes centrales. Dans ce pays, la presque totalité des syndicats, à l'exception de la « radicale » CNT, appellent ensemble à une « campagne de mobilisation » (« marche sur Madrid » le 23 novembre, grève générale de la fonction publique le 11 décembre) contre le blocage des salaires des fonctionnaires annoncé pour 1997 par le gouvernement de droite (alors qu'ils n'avaient rien fait depuis 1994 quand cette politique était régulièrement appliquée par le PS). Ici, « l'unité » que proclament les syndicats, et qui est nécessaire à leur crédibilisation, ne fait que recouvrir la division mise en avant entre travailleurs du secteur public et ceux du privé, division qui a été complétée par des débrayages partiels, à des dates différentes, au niveau de chacune des provinces et des communautés régionales, afin de renforcer les mystifications régionalistes.
D'autre part, la bourgeoisie n'utilise plus seulement ses campagnes idéologiques permanentes pour brouiller la conscience ouvrière. Elle cherche, à travers elles, à détourner les prolétaires de leur terrain de classe, à les amener à défouler leur combativité montante (qu'elle n'a pas réussi à étouffer) sur des revendications bourgeoises et dans des mobilisations interclassistes. C'est ce qu'elle a fait en Belgique et en Italie à propos de la revendication d'une « justice propre ». C'est aussi ce qu'elle a fait, entre autres, en Espagne en appelant les ouvriers à se mobiliser contre les attentats de l'ETA.
***
Contrairement à ce que prétendent certains esprits-chagrins, plus ou moins bien intentionnés, le CCI ne sous-estime en aucune manière et encore moins ne méprise les efforts actuels que fait la classe ouvrière pour développer son combat de résistance contre les attaques répétées, de plus en plus violentes et massives que lui porte la classe dominante. Bien plus, notre insistance dans la mise en évidence des nombreux pièges que met en avant la bourgeoisie, au delà du fait qu'il s'agit d'une responsabilité fondamentale pour des révolutionnaires dignes de ce nom, s'appuie, avant tout, sur une analyse de la période actuelle marquée, depuis 1992, par une reprise des luttes ouvrières. Pour nous, la manoeuvre de 1995-96, orchestrée au niveau international, n'est qu'une entreprise de la classe dominante visant à riposter à celle-ci. Et sa politique actuelle qui s'évertue à multiplier les obstacles est la preuve que, pour elle, le danger prolétarien est bien présent et même qu'il continue à s'accroître. Quand nous mettons en avant cette réalité, nous le faisons sans céder à l'euphorie (le contraire serait stupide et désarmant), sans sous-estimer l'ennemi, sans nier les difficultés et même les défaites ou reculs partiels de notre classe.
Elfe, 16 décembre 1996Récent et en cours:
- Luttes de classe [143]
Heritage de la Gauche Communiste:
- La question syndicale [2290]
Campagnes contre le « negationnisme » : l'antifascisme justifie la barbarie
- 2659 reads
Parmi les armes qu'elle déploie à l'heure actuelle contre le développement des combats et de la conscience de la classe ouvrière, la bourgeoisie de certains pays, notamment en France, utilise le thème du « négationnisme », c'est-à-dire de la remise en cause par un certain nombre de publicistes de la réalité des chambres à gaz dans les camps de concentration nazis. Nous reviendrons plus en détail, dans un prochain numéro de la Revue internationale, sur cette question. Nous nous contenterons ici de donner quelques éléments sur cette campagne afin de souligner l'intérêt de l'article que nos camarades de la Gauche Communiste de France (GCF) avaient publié en 1945 dans L'Etincelle sur le même sujet.
La thèse de la non-existence des chambres à gaz, et donc de la volonté d'extermination par le régime nazi de certaines populations européennes, notamment des populations juives, a été particulièrement diffusée par le groupe de la « Vieille Taupe » qui se réclamait de « l'ultra-gauche » (qu'il ne faut pas confondre avec la Gauche communiste à laquelle ce courant avait fait un certain nombre d'emprunts). Pour la « Vieille Taupe » et d'autres groupes de la même mouvance, l'existence des chambres à gaz était un pur mensonge des bourgeoisies alliées destiné à renforcer leurs campagnes antifascistes au lendemain de la seconde guerre mondiale. Ces groupes se donnaient comme mission, en dénonçant ce qu'ils considéraient comme un mensonge, de démasquer le rôle anti-ouvrier de l'idéologie antifasciste. Mais entraînés par leur passion « négationniste » (ou par d'autres forces ?) certains éléments, parmi eux, en sont venus à collaborer avec des parties de l'extrême droite antisémite. Celles-ci également considéraient que les chambres à gaz étaient une invention, mais une invention du « lobby juif international ». C'était évidemment pain béni pour les secteurs « démocratiques » et « antifasciste » de la bourgeoisie qui ont donné une publicité considérable aux thèses « négationnistes » afin de renforcer leurs propres campagnes en stigmatisant cette tentative de « réhabilitation du régime nazi ». Mais ces secteurs ne se sont pas arrêtés là. Les références faites par les « négationnistes de gauche » aux positions de la Gauche communiste dénonçant l'idéologie antifasciste, et particulièrement au texte tout à fait valable publié au début des années 1960 par le « Parti Communiste International », Auschwitz ou le Grand Alibi, ont servi récemment de prétexte aux souteneurs de la « démocratie bourgeoise » (y compris certains trotskistes) pour déclencher une campagne de dénonciation du courant de la Gauche communiste : « Ultra-Gauche et Ultra-Droite, même combat ! », « Comme toujours, les extrêmes se rejoignent ».
Pour sa part, le CCI, comme tous les véritables groupes de la Gauche communiste, a toujours refusé de marcher dans les élucubrations « négationnistes ». Vouloir amoindrir la barbarie du régime nazi, même au nom de la dénonciation de la mystification antifasciste, revient en fin de compte à amoindrir la barbarie du système capitaliste décadent, dont ce régime n'est qu'une des expressions. Cela nous permet de dénoncer d'autant plus fermement les campagnes actuelles visant à discréditer aux yeux de la classe ouvrière la Gauche communiste, le seul courant politique qui défend réellement ses intérêts et sa perspective révolutionnaire. Cela nous permet de mener avec la plus grande énergie le combat contre les mystifications antifascistes qui prennent appui sur la barbarie nazie pour mieux enchaîner les prolétaires au système qui l'a enfantée et qui n'en finira jamais d'engendrer la barbarie : le capitalisme. C'est le même combat que menaient nos camarades de la GCF en publiant l'article qu'on trouvera ci-dessous. Lorsque l'article a été écrit, en juin 1945, la bourgeoisie alliée n'avait pas eu encore l'occasion de déployer complètement sa propagande à propos des « camps de la mort ». En particulier, le camp d'Auschwitz, qui se trouvait dans la zone sous contrôle russe n'avait pas encore la sinistre célébrité qu'il a connue par la suite. De même, les bombes atomiques « démocratiques » et « au service de la civilisation » n'avaient pas encore rasé Hiroshima et Nagazaki. Cela n'a pas empêché nos camarades de faire une dénonciation particulièrement percutante de l'utilisation idéologique contre le prolétariat des crimes nazis par les criminels alliés.
CCI.
L'ETINCELLE n°6, juin 1945
BUCHENWALD, MAIDANECK, DEMAGOGIE MACABRE
Le rôle joué par les SS, les nazis et leur camp d'industrialisation de la mort, fut celui d'exterminer en général tous ceux qui s'opposèrent au régime fasciste et surtout les militants révolutionnaires qui ont toujours été à la pointe du combats contre la bourgeoisie capitaliste, quelque forme qu'elle prenne : autocratique, monarchique ou "démocratique", quel que soit leur chef : Hitler, Mussolini, Staline, Léopold III, George V, Victor-Emmanuel, Churchill, Roosevelt, Daladier ou De Gaulle.
La bourgeoisie internationale qui, lorsque la révolution russe d'octobre éclata en 1917, chercha tous les moyens possibles et imaginables pour l'écraser, qui brisa la révolution allemande en 1919 par une répression d'une sauvagerie inouïe, qui noya dans le sang l'insurrection chinoise prolétarienne ; la même bourgeoisie finança en Italie la propagande fasciste puis en Allemagne celle de Hitler ; la même bourgeoisie mit au pouvoir en Allemagne celui qu'elle avait désigné comme devant être pour son compte le gendarme de l'Europe ; la même bourgeoisie aujourd'hui enfin dépense des millions "pour financer le montage d'une exposition sur les crimes hitlériens", les prises de vues et la présentation au public de films sur les "atrocités allemandes" pendant que les victimes de ces atrocités continuent à mourir souvent sans soins et que les rescapés qui rentrent n'ont pas les moyens de vivre.
Cette même bourgeoisie, c'est elle qui d'un côté a payé le réarmement de l'Allemagne et de l'autre a bafoué le prolétariat en l'entraînant dans la guerre avec l'idéologie anti-fasciste, c'est elle qui, de cette façon, ayant favorisé la venue de Hitler au pouvoir, s'est servie jusqu'au bout de lui pour écraser le prolétariat allemand et l'entrainer dans la plus sanglante des guerres, dans la boucherie la plus immonde que l'on puisse concevoir.
C'est toujours cette même bourgeoisie qui envoie des représentants avec des gerbes de fleurs s'incliner hypocritement sur les tombes des morts qu'elle a elle-même engendrés parce qu'elle est incapable de diriger la société et que la guerre est sa seule forme de vie.
C'EST ELLE QUE NOUS ACCUSONS !
C'est elle que nous accusons car les millions de morts qu'elle a perpétrés ne sont qu'une addition à une liste déjà bien trop longue, hélas, des martyrs de la "civilisation", de la société capitaliste en décomposition.
Les responsables des crimes hitlériens ne sont pas les allemands qui ont les premiers, en 1934, payé par 450.000 vies humaines la répression bourgeoise hitlérienne et qui ont continué à subir cette impitoyable répression quand celle-ci se portait en même temps à l'étranger. Pas plus les français, les anglais, les américains, les russes, les chinois ne sont responsables des horreurs de la guerre qu'ils n'ont pas voulues mais que leurs bourgeoisies leur ont imposées.
Par contre, les millions d'hommes et de femmes qui sont morts à petit feu dans les camps de concentration nazis, qui ont été sauvagement torturés et dont les corps pourrissent quelque part, qui ont été frappés pendant cette guerre en combattant ou surpris dans un bombardement "libérateur", les millions de cadavres mutilés, amputés, déchiquetés, défigurés, enfouis sous terre ou pourrissant au soleil, les millions de corps de soldats, femmes, vieillards, enfants.
Ces millions de morts réclament vengeance. Et ils réclament vengeance non sur le peuple allemand qui lui continue à payer mais sur cette infâme bourgeoisie, hypocrite et sans scrupule, qui elle n'a pas payé mais profité et qui continue à narguer les esclaves qui ont faim, avec leurs mines de porcs nourris à l'engrais.
La seule position pour le prolétariat n'est pas de répondre aux appels démagogiques tendant à continuer et à accentuer le chauvinisme au travers des comités anti-fascistes, mais la lutte directe de classe pour la défense de leurs intérêts, leur droit à la vie, lutte de chaque jour, de chaque instant jusqu'à la destruction du régime monstrueux, du capitalisme.
Courants politiques:
Questions théoriques:
- Décomposition [3]
Rivalites imperialistes : l' « humanitaire » au service de la guerre
- 2627 reads
- Durant ces dernières semaines, l'intense va-et-vient diplomatique et les déclarations contradictoires qui se sont multipliées à propos de la « force d'aide aux réfugiés » de la région des Grands Lacs, ont tourné à la farce macabre : se déploiera-t-elle ? Effectuera-t-elle des largages de vivres ? Subsiste-t-il encore des réfugiés ? En réalité, ce vaudeville hypocrite et répugnant sur « l'aide humanitaire » ne sert, une fois de plus, que d'écran de fumée pour masquer les interventions des grandes puissances visant à défendre leurs sordides intérêts impérialistes et à régler leurs comptes sur le dos des populations locales. Les atrocités dans l'est du Zaïre n'ont rien « d'exotique », elles ne sont en rien liées à de quelconques moeurs tribales, tout comme les bombardements et les massacres récurrents au Moyen-Orient ne sont nullement une « spécificité » de la région. Ils ne sont rien d'autre qu'une illustration de plus d'un monde capitaliste qui craque de partout. Du Moyen-Orient à l'Afrique, de l'ex-Yougoslavie à l'ex-URSS, le « nouvel ordre mondial », tant vanté il y a près de six ans par les « grands », n'est que le champ de manoeuvre de la lutte à mort entre puissances impérialistes et un gigantesque charnier pour des parties de plus en plus larges de la population mondiale.
Plusieurs articles dans la Revue Internationale (voir par exemple les n° 85 et 87) ont déjà largement décrit le triomphe croissant du « chacun pour soi », tout en soulignant les tentatives de plus en plus brutales du parrain US pour préserver sa domination et redresser la situation là où elle est compromise. Le cadre adéquat pour appréhender l'explosion des rivalités entre requins impérialistes et la crise inéluctable du leadership américain, quels que puissent être les sursauts du gendarme mondial, est rappelé par la résolution sur la situation internationale du 12e congrès de Révolution Internationale : « Ces menaces [pesant sur le leadership US] proviennent fondamentalement (...) du chacun pour soi, du fait qu'il manque aujourd'hui ce qui constitue la condition principale d'une réelle solidité et pérennité des alliances entre Etats bourgeois dans l'arène impérialiste : l'existence d'un ennemi commun menaçant leur sécurité. Les différentes puissances de l'ex-bloc occidental peuvent, au coup par coup, être obligées de se soumettre aux diktats de Washington, mais il est hors de question pour elles de maintenir une quelconque fidélité durable. Bien au contraire, toutes les occasions sont bonnes pour saboter, dès qu'elles le peuvent, les orientations et dispositions imposées par les Etats-Unis. » (Revue Internationale n° 86)
De l'interminable guerre civile entre factions Afghanes « sponsorisées » par les diverses puissances impérialistes jusqu'aux sourdes tensions qui s'intensifient en ex-Yougoslavie malgré la « pax americana » de Dayton, les récents événements confirment pleinement la validité de ce cadre de compréhension. Nous développerons plus spécifiquement ici la situation au Moyen-Orient et celle dans la région des Grands Lacs dans la mesure où elles illustrent de façon particulièrement éloquente comment ces rivalités provoquent une extension terrifiante de la décomposition et du chaos dans des zones de plus en plus larges de la planète.
Moyen-Orient : poussée du « chacun pour soi » et crise du leadership américain
L'élection de Netanyahou avait déjà constitué un sérieux revers pour les Etats-Unis dans une région de la plus haute importance stratégique et depuis des années « chasse gardée » des Etats-Unis. Elle soulignait combien, même dans un pays aussi dépendant des Etats-Unis qu'Israël, les forces centrifuges et les velléités d'une politique indépendante prennent aujourd'hui le dessus sur toute politique de stabilisation régionale, même sous la houlette du gendarme mondial.
Depuis lors, les provocations du gouvernement Netanyahou, débouchant sur des affrontements entre colons juifs et forces policières de la nouvelle « autorité palestinienne » ainsi que sur des dizaines de morts à Gaza et en Cisjordanie, ont permis de justifier le brutal durcissement de la position israélienne dans toutes les négociations, débouchant même, au nom de menaces pour la sécurité d'Israël, sur une remise en cause des maigres accords signés par Peres et Arafat à Oslo. En face, la même tendance au « chacun pour soi » triomphait dans les capitales arabes régionales : les « ennemis héréditaires » d'Israël, syriens et palestiniens en tête, se sont réconciliés, tandis que l'Egypte et l'Arabie Saoudite, pourtant jusqu'alors alliées solides de Washington, accélèrent leur politique de contestation ouverte de l'impérialisme américain. Que l'Egypte, partenaire de l'accord historique de Camp David, ait refusé net de participer au sommet de Washington que Clinton avait convoqué pour tenter de limiter les dégâts, en dit long sur la perte accélérée de contrôle de la situation du Moyen-Orient par les Etats-Unis. A travers ces événements, c'est la mainmise de ces derniers sur toute la région, patiemment développée depuis près de vingt ans, qui est menacée de voler en éclats.
Le déclin de l'influence des Etats-Unis aujourd'hui ne peut qu'aller de pair avec la montée en puissance de l'influence de ses rivaux impérialistes dont les ambitions augmentent en proportion inverse des revers américains. Ainsi, le grand bénéficiaire des récents événements au Proche-Orient est sans conteste la France qui a entrepris immédiatement de rassembler derrière elle tous les mécontents de la région en se posant comme porte-parole de toutes les contestations anti-américaines et anti-israéliennes, comme en a témoigné la spectaculaire tournée de Chirac dans la région en octobre. Partout, celui-ci s'est fait le promoteur d'un « coparrainage du processus de paix », signifiant clairement l'intention française de jeter de l'huile sur le feu et de saboter par tous les moyens la politique de Washington. En fait de « paix », c'est un encouragement ouvert à l'union sacrée des Etats arabes contre l'ennemi commun israélien et ... américain, un encouragement à la guerre et au chaos !
Le première puissance militaire du monde, dont le leadership est malmené sur la scène internationale par cette explosion du « chacun pour soi », ne peut que riposter face à ces menaces contre son leadership ; et ces ripostes sont de moins en moins « pacifiques », comme l'avait déjà montré le coup de semonce qu'avait représenté le largage de missiles sur l'Irak (voir Revue Internationale n° 87). De fait, les Etats-Unis entendent à la fois montrer leur détermination à conserver leur position de maître militaire du monde et semer la zizanie parmi les puissances européennes en jouant sur leurs divergences d'intérêt. Dans ce cadre, il n'est nullement surprenant que ses coups visent aujourd'hui en premier lieu l'impérialisme français qui prétend s'imposer à la tête d'une croisade anti-américaine. ([1] [2730]) Que pour ce faire, il leur faille de plus en plus recourir à la force brutale et étendre la barbarie et le chaos pour des effets de plus en plus limités et temporaires ne fait que donner la mesure de leur déclin historique.
Zaïre : offensive américaine contre l'impérialisme français en Afrique
L'enjeu véritable des massacres dans la région des Grands Lacs n'est pas, contrairement à ce que les médias étalent, la lutte pour le pouvoir entre Hutus et Tutsis mais celle entre les Etats-Unis et la France pour le contrôle de cette région. Ici, c'est la bourgeoisie américaine qui mène la danse et elle a réussi, dès à présent, à affaiblir puissamment la position de sa rivale française en Afrique par une habile stratégie de déstabilisation.
Après avoir porté la clique pro-américaine du Front Populaire Rwandais (FPR) au pouvoir à Kigali en 1994, les Etats-Unis ont continué à avancer leurs pions dans la région des Grands Lacs. Tout d'abord ils ont consolidé le FPR grâce à un soutien économique et militaire accentué. Ensuite, ils ont achevé leur tactique d'encerclement des positions françaises en exerçant une pression maximum sur le Burundi avec l'embargo imposé à celui-ci par tous ses voisins anglophones pro-américains, suite au coup d'État pro-français de Buyoya. Cette tactique a d'ailleurs porté ses fruits car le gouvernement burundais s'est associé sans états d'âme à l'alliance anti-française avec le Rwanda et l'Ouganda dès les premiers affrontements au Kivu. Enfin, prétextant des escarmouches provoquées par les anciennes Forces Armées Rwandaises regroupées sournoisement par la France dans les camps de réfugiés à la frontière zaïro-rwandaise, les Etats-Unis ont porté plus loin la guerre au Zaïre en fomentant la « révolte » des Banyamulenge du Kivu, avec la réussite actuelle que l'on connaît.
L'offensive de Washington a effectivement réussi à isoler de plus en plus l'impérialisme français et à le mettre en position de faiblesse grandissante. Le Zaïre de Mobutu sur lequel est contraint de s'appuyer ce dernier est une véritable ruine sur les plans politique, économique et militaire. Maillon clé dans le dispositif de défense antisoviétique du bloc occidental à l'époque de la confrontation Est-Ouest, le Zaïre constitue à présent une des zones stratégiques du monde les plus fragiles et un foyer de décomposition parmi les plus avancés. Et les Etats-Unis ont précisément exploité le marasme qui y règne, aggravé par la maladie de Mobutu et les luttes intestines qui en découlent, avec une armée en déliquescence, pour mieux peaufiner son opération stratégique actuelle dans la région. Ainsi, ils ont pu prendre de court l'impérialisme français qui avait l'intention, lors du sommet franco-africain de Ouagadougou où l'Ouganda et la Tanzanie avaient été conviés pour la première fois, de mettre la pression sur le Rwanda à travers sa proposition de conférence sur la région des Grands Lacs.
Mais les difficultés de la bourgeoisie française ne s'arrêtent pas là car sa rivale américaine est en passe de gagner sur différents tableaux. D'abord, Clinton rabaisse brutalement les prétentions de la France à se porter à la tête d'une croisade anti-américaine et réduit son crédit auprès des grandes puissances. Les appels désespérés de l'impérialisme français, repris avec force par son candidat à l'ONU, Boutros-Ghali, en direction de ses « alliés » européens et même de ses traditionnels alliés africains à intervenir « de façon urgente » se sont vus opposer des réponses évasives. En premier lieu parce que tous ces grands défenseurs de « l'humanitaire » n'ont aucune envie de s'enfermer dans ce véritable bourbier pour les beaux yeux de la France, mais aussi parce cette pression américaine en Afrique est un message et une menace adressés à l'ensemble des pays du monde. Mis à part l'Espagne qui a exprimé un soutien moins réservé aux demandes françaises, l'Italie, la Belgique et l'Allemagne ont trouvé des prétextes divers pour s'abstenir. Mais c'est surtout l'attitude de Londres qui est caractéristique et significative de l'affaiblissement de l'alliance franco-anglaise en Afrique, alliance qui, pourtant, semblait se renforcer ces derniers mois. D'accord « en principe » pour l'intervention, le gouvernement Major a maintenu le plus grand flou sur ses engagements concrets, ce qui exprimait implicitement une fin de non-recevoir envers Paris qui se retrouve ici tout particulièrement seul face à une superpuissance américaine qui a les meilleures cartes en mains.
Rejetée et dénoncée par le Rwanda et les « rebelles zaïrois », victimes de ses menées impérialistes, la France a dû se résoudre à en appeler à une intervention américaine au sein de laquelle elle viendrait occuper sa place sur le terrain. La bourgeoisie américaine ne s'est pas privée d'exploiter cette situation de force pour faire passer la France sous ses fourches caudines. Elle atermoie à dessein, affirmant d'une part bien vouloir intervenir, à l'unique condition qu'il s'agisse d'une opération « humanitaire » et non pas militaire, qu'on ne se mêle pas d'un conflit local (avec d'autant moins d'états d'âme que ce sont ses hommes de main qui tiennent le haut du pavé), signifiant cyniquement de l'autre que « les Etats-Unis ne sont pas l'Armée du Salut » ! De plus, la Maison Blanche se paie le luxe de pointer du doigt l'impérialisme français comme responsable au premier chef du chaos régnant dans la région des Grands Lacs. La campagne qui s'est développée sur les ventes d'armes de plusieurs pays au Rwanda pendant le génocide de 1994, impliquant surtout l'Etat français, est venue braquer les projecteurs sur le rôle sordide qu'a pu y jouer la France. Le Big Boss a ainsi mis en lumière la mesquinerie et la rapacité d'un gouvernement français qui « soutenait des régimes décadents » et « n'était plus capable de s'imposer » en Afrique (déclarations de Daniel Simpson, ambassadeur américain à Kinshasa), qui n'appelle la « communauté internationale » à la rescousse que pour défendre ses intérêts impérialistes particuliers.
L'impérialisme français a donc perdu des positions face à une offensive minutieusement programmée par les stratèges du Pentagone. Il se voit évincé de l'Afrique de l'Est et repoussé plus loin vers l'Ouest, dans une position de plus en plus faible avec un « pré carré » gravement amenuisé. Cette situation ne peut qu'attiser les rivalités, dans la mesure où la France cherchera à réagir comme le montre déjà sa tentative de « récupération » du Burundi lors du sommet franco-africain en plaidant pour la levée de l'embargo à son égard, tandis que le chaos qui régnait dans la région des Grands Lacs se propage dès à présent vers un Zaïre déjà largement gangrené par la décomposition générale. Sa situation géographique centrale en Afrique, sa taille gigantesque, de même aussi que ses richesses minières, en font une cible de choix pour les appétits impérialistes. La perspective de son effondrement accéléré et de sa dislocation, conséquence de l'élargissement actuel à ce pays des tensions guerrières, contient la menace d'une nouvelle explosion du chaos, non seulement dans ce pays mais aussi chez ses voisins, particulièrement ceux du nord (Congo, République centrafricaine, Soudan) ainsi que dans des pays proches comme le Gabon et le Cameroun qui tous appartiennent au « pré carré » de la France, ce qui donne la mesure de l'inquiétude qui habite aujourd'hui la bourgeoisie de ce pays au sujet de la pérennité de ses prébendes africaines. Et cette nouvelle avancée du chaos impérialiste ne pourra qu'aggraver et élargir encore la misère effrayante et la barbarie qui règnent déjà dans la majeure partie du continent africain.
Il ressort donc de façon éclatante que l'hypocrisie de « l'aide humanitaire » et des « discours de paix » ne servent aux requins impérialistes qu'à couvrir de nouvelles équipées guerrières et donc à accentuer le chaos et la barbarie. C'est avec un cynisme monstrueux que toute les bourgeoisies nationales versent des larmes de crocodile sur le sort tragique réservé aux populations locales ou réfugiées, alors que ces dernières, réduites à l'état d'otages impuissants, sont froidement utilisées comme arme de guerre dans les rivalités impérialistes entre les grandes puissances. Cette vaste mise en scène est déployée avec la complicité – consciente ou non – des associations humanitaires, ces « ONG » qui ont elles-mêmes appelé les gouvernements à la rescousse, réclamant à corps et à cris leur intervention militaire.
Ce constat n'est pas nouveau. Souvenons-nous de toutes les « interventions pour la paix » précédentes ! En 1992, en Somalie, l'opération « humanitaire » n'a mis un terme ni à la famine chronique ni aux guerres claniques. En Bosnie, l'envoi entre 1993 et 1994 de tous ces « soldats de la paix », français, anglais ou américains sous la bannière de l'ONU ou de l'OTAN n'a servi qu'à justifier cyniquement la présence militaire des puissances impérialistes sur le terrain et à « protéger » ainsi, chacun en soutenant des fractions particulières, les exactions des belligérants. En 1994, au Rwanda, les grandes puissances étaient déjà directement les responsables du déclenchement des massacres. Avec l'alibi d'une intervention militaire pour « arrêter le génocide », elles ont provoqué un exode massif de populations et suscité la création de camps précaires de réfugiés. Ensuite, elles ont misé sur le pourrissement de la situation, présentée aujourd'hui comme un produit de la fatalité, pour ourdir leurs nouvelles intrigues meurtrières.
Dans l'escalade de leurs rivalités et l'accomplissement de leurs basses besognes pour préserver ou prendre des positions sur le terrain, tous ces gangsters impérialistes, loin de « rétablir l'ordre et la paix » ne font qu'accentuer le chaos. Expression d'un capitalisme agonisant, ils ne peuvent que précipiter dans leur barbarie guerrière des zones de plus en plus vastes de la planète et entraîner toujours davantage de populations vers la mort à travers des massacres, des exodes, des famines, des épidémies nées des charniers.
Jos, 12 décembre 1996.
[1] [2731]. Dans de nombreux textes nous avons mis en évidence le fait que, en dernière instance, le principal rival impérialiste des Etats-Unis est l'Allemagne, la seule puissance qui puisse prendre la tête d'un éventuel nouveau bloc opposé à celui dirigé par la première puissnce mondiale. Cependant, et c'est là une des caractéristiques du chaos actuel, nous sommes encore bien loin d'une telle "organisation" des antagonismes impérialistes ce qui laisse la place à toutes sortes de situations où des "seconds couteaux" comme la France essayent de jouer leur propre jeu.
Questions théoriques:
- Guerre [129]
Crise economique : Pays de l'Est : des nouveaux marchés morts-nés
- 3648 reads
Au lendemain de l'effondrement des régimes staliniens, la bourgeoisie, dans sa vaste campagne idéologique contre la classe ouvrière sur « la supériorité du capitalisme » et « l'impossibilité du communisme », annonçait l'avènement d'un « nouvel ordre mondial » : la fin des blocs militaires, la réduction des budgets d'armement et l'ouverture de « nouveaux marchés » à l'Est allaient déboucher sur une ère de paix et de prospérité. Depuis, les fameux « dividendes de la paix » se sont mués en massacres et conflits tous plus meurtriers les uns que les autres et la perspective de « prospérité » s'est transformée en une aggravation de la crise et une austérité redoublée. Quant à « l'ouverture de nouveaux marchés » dans les pays de l'Est, la réalité s'est chargée là aussi d'en balayer le mensonge : l'effondrement économique et social de ces pays au cours des années 1990 est venu donner un démenti cinglant à toute la campagne de la bourgeoisie.
C'est la raison pour laquelle nous assistons à une multiplication de rapports d' « experts » et d'articles dans les médias aux ordres qui viennent à la rescousse pour tenter de raviver quelque peu la flamme vacillante des illusions. Voilà pourquoi on nous laisse entendre aujourd'hui qu' « une nécessaire période difficile s'imposait pour assainir la situation », l'ampleur de la transition étant le reflet « des lourds héritages du passé », etc. A les entendre, « les lendemains de la nouvelle économie de marché vont commencer à chanter » : les pays de l'ex-bloc de l'Est seraient sur la voie de la stabilisation et du redressement économique. De –10 % en 1994 à –2,1 % en 1995, le taux de croissance passerait à +2,6 % pour l'ensemble de la zone. A l'exception de certaines provinces de l'ex-URSS, le retour à des taux positifs serait général en 1996. « Après la pluie le beau temps », voilà l'actuel message mensonger que la bourgeoisie et ses médias essaient de faire passer, complétant utilement celui déversé depuis 1989 à propos de la « victoire du capitalisme sur le communisme ».
L'écroulement du stalinisme : expression de la faillite historique du capitalisme
Démocrates et staliniens se sont toujours retrouvés pour identifier stalinisme et communisme afin de faire croire à la classe ouvrière que c'était ce dernier qui régnait à l'Est. Ceci a permis d'associer l'effondrement de ce régime à la mort du communisme, à la faillite du marxisme. En réalité, le communisme signifie la fin de l'exploitation de l'homme par l'homme, la fin de la division en classes antagoniques et du salariat ; c'est le règne de l'abondance où « le gouvernement des hommes cède la place à celui de l'administration des choses » et cela à la seule échelle possible, l'échelle internationale. L'Etat totalitaire, la pénurie généralisée, le règne de la marchandise et du salariat et les nombreuses révoltes ouvrières qui en découlaient, attestaient du caractère foncièrement capitaliste et exploiteur des régimes de ces pays. En fait, la forme stalinienne du capitalisme d'Etat hérité, non de la révolution d'octobre 1917, mais de la contre-révolution qui l'a tuée dans le sang, a sombré avec la ruine complète des formes de l'économie capitaliste qu'elle a engendrées dans ces ex-pays soi-disant « socialistes ». Ce n'est pas le communisme qui s'est effondré à l'Est mais une variante particulièrement fragile et militarisée du capitalisme d'Etat.
Qu'une constellation impérialiste s'écroule de l'intérieur, sans combat, sous le poids de la crise et de ses propres contradictions, est une situation totalement inédite dans l'histoire du capitalisme. Si aujourd'hui c'est la crise qui est à l'origine de la disparition d'un bloc impérialiste et non, comme toujours dans le passé, une défaite militaire ou une révolution, c'est du fait de l'entrée du système capitaliste dans sa phase terminale : sa phase de décomposition. Cette phase se caractérise par une situation où les deux classes fondamentales et antagoniques de la société s'affrontent sans parvenir à imposer leur propre réponse aux contradictions insurmontables du capitalisme : la guerre généralisée pour la bourgeoisie, le développement d'une dynamique vers la révolution pour le prolétariat. Alors que les contradictions du capitalisme en crise ne font que s'aggraver, l'incapacité de la bourgeoisie à offrir la moindre perspective pour l'ensemble de la société et les difficultés du prolétariat à affirmer ouvertement la sienne dans l'immédiat ne peuvent que déboucher sur un phénomène de décomposition généralisée, de pourrissement sur pied de la société. Ce sont ces conditions historiques nouvelles, inédites – la situation d'impasse momentanée de la société – qui expliquent pourquoi la crise du capitalisme a pu (et va encore) exercer ses effets dévastateurs avec une telle ampleur, profondeur et gravité.
En effet, la chute de la production dans les pays de l'Est après 1989 fut la plus importante jamais enregistrée dans toute l'histoire du capitalisme, bien plus grave que lors de la grande crise des années 1930 ou que l'entrée en guerre lors du second conflit impérialiste mondial. Dans la plupart de ces pays la production a en effet chuté au-delà des 30 % qu'ont connu les Etats-Unis entre 1929 et 1933. Après 1989, l'effondrement de la production atteint 40 % en Russie et près de 60 % dans ses anciennes Républiques comme l'Ukraine, le Kazakhstan ou la Lituanie, reculs bien supérieurs à la déroute soviétique au moment de l'invasion allemande en 1942 (25 %). La production en Roumanie a reculé de 30 %, celles de la Hongrie et de la Pologne de 20 %. Cette gigantesque destruction de forces productives, cette brutale et soudaine dégradation des conditions de vie de pans entiers de la population mondiale sont d'abord et avant tout le produit de la crise mondiale et historique du système capitaliste. De tels phénomènes, analogues par leur signification et ampleur aux décadences des modes de production antérieurs, n'ont cependant pas d'égal quant à leur violence. Ils sont à l'image de ce qu'un système arrivé à son stade final peut engendrer : jeter dans la misère quasi absolue, et cela du jour au lendemain, des dizaines, voire des centaines de millions d'êtres humains.
Vers la tiers-mondisation ou des lendemains qui chantent ?
Après une telle chute dans la production, après une telle dégradation des conditions de vie de toute une partie de la planète, il est quelque peu indécent de parler de taux de croissance positifs. Partant de zéro, mathématiquement la croissance est infinie ! En effet, le taux de croissance est d'autant plus élevé que la base de départ est faible : augmenter d'une seule unité (produire un camion en plus par exemple) au départ de deux correspond à un taux de croissance important de 50 %, par contre augmenter de 10 unités au départ de 100 correspond à un taux de croissance plus faible de 10 %. Toute proportion gardée, dans un tel contexte, les taux positifs de croissance annoncés n'ont que peu de signification.
D'ailleurs, parler de « retour à des lendemains qui chantent » est une sinistre escroquerie. Tant sur le plan de l'évolution de la production, des revenus que de la dynamique générale du système capitaliste, tout concoure à la poursuite de l'impasse actuelle vers une tiers-mondisation croissante de toutes ces régions. Le recours massif aux crédits et aux déficits budgétaires, comme dans le cas de la réunification allemande, ou l'appauvrissement brutal et généralisé dans les autres pays n'offrent aucune base solide pour envisager une amélioration quelconque de la situation économique et sociale.
L'exemple de la réunification allemande est illustrative à bien des égards. Politiquement contrainte d'assumer une réunification qui s'imposait à elle, la bourgeoisie allemande à dû recourir à des moyens exceptionnels pour éviter d'être submergée par un exode de population et une puissante vague de mécontentements sociaux. En effet, cette réunification n'a été possible que grâce à un transfert massif de capitaux de l'Ouest vers l'Est pour financer investissements et programmes sociaux : 200 milliards de marks par an environ, soit l'équivalent de 7 % du PIB de l'Ouest mais 60 % de celui de l'Est. Cette réintégration de l'ex-RDA dans la grande famille allemande nous est présentée comme l'exemple de la transition réussie : le taux de croissance dans l'ex-RDA en 1994 était remonté à près de 20 % !
Mais « les faits sont têtus » disait Lénine : l'ex-RDA a produit 382 milliards de marks de richesses en 1995 ... avec 83 milliards d'exportations et 311 milliards d'importations, soit un déficit commercial de 228 milliards, équivalent à 60 % du PIB de la partie Est du pays ! Voilà comment s'expliquent les taux de croissance « faramineux » que l'on nous présente. Et pour cause, ce formidable soutien de l'activité économique à l'Est s'est réalisé en tirant des traites sur l'avenir, il n'a pu être possible que par une formidable augmentation de la dette publique qui est passée de 43 % du PIB en 1989 à 55 % en 1994, soit une augmentation de 12 % en cinq ans. Cette stratégie de développement de la dette publique pour soutenir l'activité a momentanément permis de repousser les problèmes : une certaine activité a pu être maintenue dans la partie Est, les infrastructures renouvelées, les transferts de revenus ont soutenu les achats de biens dans les entreprises de l'Ouest. Cependant, ce maintien des activités à l'Est s'est essentiellement réalisé autour du secteur du bâtiment et des travaux publics visant à une remise en état des infrastructures, objectif stratégique essentiel pour la bourgeoisie allemande. Mais en réalité ce secteur ne pourra servir de décollage durable à l'activité est-allemande. Les lampions du septième anniversaire de la réunification à peine éteints, une sombre perspective se présente avec l'épuisement prochain du gisement d'activités du secteur du bâtiment et des travaux publics, la baisse progressive des transferts massifs vers l'ex-RDA et une austérité croissante et quelques nouvelles activités balbutiantes qui auront du mal à décoller compte tenu de la période de récession générale et de saturation des marchés au niveau mondial. Depuis 1993 d'ailleurs, l'Etat allemand présente la facture de la réunification à la classe ouvrière, d'abord par une importante augmentation des impôts puis par une austérité implacable : allongement de la durée du travail dans le secteur public, fermeture d'équipements, hausses brutales des tarifs publics, réductions massives d'effectifs dans les administrations.
Si la situation dans l'ex-RDA peut encore faire illusion compte tenu de l'importance de l'enjeu géostratégique pour l'Allemagne d'arriver à une certaine stabilisation dans cette partie du pays, pour qui porte son regard un peu au-delà des discours mystificateurs, la situation économique et sociale dans tous les autres pays reste catastrophique. A l'exception de la Croatie, la Slovénie et la Tchéquie, les pays qui ont déjà passé le cap des croissances positives – et nous avons vu ce qu'il fallait en penser ci-dessus – stagnent ou rechutent ; le soufflé retombe déjà : le taux de croissance de l'Albanie est retombé à 6 % en 1995 après être monté à 11 % en 1993, ceux de la Bulgarie (3 %) et de l'Arménie (7 %) plafonnent depuis l'année passée, le taux de la Hongrie est passé de 2,5 % en 1994 à 2 % en 1996, celui de la Pologne de 7 % en 1995 à 6 % en 1996, celui de la Slovaquie de 7 % en 1995 à 6 % en 1996, celui de la Roumanie de 7 % en 1995 à 4 % en 1996 et celui des pays Baltes de 5 % en 1994 à 3,2 % en 1996. Les autres indicateurs économiques ne sont pas plus brillants. Certes l'hyperinflation a été jugulée mais avec des potions dignes de celles administrées aux pays du tiers-monde. Des plans drastiques d'austérité, de licenciements et de coupes claires dans les budgets sociaux de l'Etat ont ramené les taux d'inflation à des niveaux plus « acceptables » mais toujours très élevés et, pour la plupart des pays, encore supérieurs à ce qu'ils étaient cinq ans auparavant :
Inflation (%)
|
|
Pays
|
1990
|
1995
|
|
|
Bulgarie
|
22
|
62
|
|
|
Tchéquie
|
11
|
9
|
|
|
Hongrie
|
29
|
28
|
|
|
Pologne
|
586
|
28
|
|
|
Roumanie
|
5
|
32
|
|
|
Slovaquie
|
11
|
10
|
|
|
Russie
|
6
|
190
|
|
|
Ukraine
|
4
|
375
|
De nombreux autres comportements économiques, significatifs d'une tiers-mondisation croissante de ces régions, se font de plus en plus jour. La quasi totalité des activités est orientée vers le profit à court terme, les capitaux sont soit placés à l'étranger, soit prioritairement engagés dans des activités spéculatives et ne sont que marginalement injectés dans le secteur productif. Quand le profit « officiel », « légal », est insuffisant, tant la situation économique est dégradée, les revenus criminels se développent. Largement sous-estimés, ils représenteraient déjà 5 % du PIB en Russie, sont en forte augmentation (1 % en 1993) et se situent au-delà du double de la moyenne mondiale (2 %).
Vers la paupérisation absolue
Egalement typique des pays sous-développés est la spectaculaire croissance de l'économie informelle et de l'auto-consommation pour compenser quelque peu la chute drastique des revenus officiels. Ceci se constate par le découplage entre la chute des revenus salariaux, qui est énorme, et celle, moindre, de la consommation. En fait, cette dernière est, d'une part, soutenue par une minorité de 5 % à 15 % de la population qui tire avantage de la « transition » et, d'autre part, elle est de plus en plus composée de biens d'origine non monétaire (activités agricoles privées). Ainsi en Bulgarie, où les salaires réels ont diminué de 42 % en 1991 et de 15 % en 1993, nous voyons la part des revenus officiels diminuer de 10 % en 2 ans dans le total des revenus familiaux (44,8 % en 1990 à 35,3 % en 1992) mais la part des revenus agricoles non monétaires augmenter de 16 % (21,3 % à 37,3 %). Pour survivre, les travailleurs de ces pays doivent rechercher des revenus supplémentaires pour compenser des salaires de plus en plus maigres, reçus en contrepartie d'un travail de plus en plus pénible et se déroulant dans des conditions de plus en plus mauvaises. Résultat de tout cela, une explosion de la paupérisation pour l'immense majorité de la population. L'Unicef a établi un seuil de pauvreté correspondant à un niveau de 40 % à 50 % en deçà du revenu réel moyen de 1989 (avant les « réformes »). Les données se passent de commentaires ! Multiplication par deux jusqu'à six du nombre de ménages vivant en deçà du seuil de pauvreté. En Bulgarie plus de la moitié des ménages du pays vivent en deçà de ce seuil, 44 % en Roumanie et un tiers en Slovaquie et en Pologne.
Pourcentage de ménages vivant en dessous du seuil de pauvreté
(estimation)
|
Pays
|
1989
|
1990
|
1992
|
1993
|
|
Bulgarie
|
-
|
13,8
|
|
57
|
|
Tchéquie
|
4,2
|
|
25,3
|
|
|
Hongrie*
|
14,5
|
|
19,4
|
|
|
Pologne
|
22,9
|
|
35,7
|
|
|
Roumanie
|
30
|
|
44,3
|
|
|
Slovaquie
|
5,7
|
|
|
34,5
|
* en pourcentage de la population.
Source : Unicef, Crisis in Mortality, Health and Nutrition, MONEE Database, août 1994, p. 2.
Le tableau ci-dessous illustre ce ravalement des ex-pays de l'Est au niveau du tiers-monde et permet d'évaluer la dégradation du niveau de vie de la population dans ces pays : la deuxième colonne de chiffres indique le niveau du pouvoir d'achat moyen en 1994 relativement à celui des Etats-Unis (=100) et la troisième exprime ce niveau comparativement à 1987. Ce calcul sous-estime encore la réalité de la détérioration des conditions de vie de la classe ouvrière puisqu'il mesure l'évolution d'un pouvoir d'achat moyen. Cependant, il donne une première idée de l'ampleur de la chute, chute d'autant plus douloureusement ressentie que le niveau de départ était déjà très bas : un niveau de vie trois fois moins élevé pour les habitants d'un bon nombre d'ex-républiques de l'URSS, un niveau presque deux fois moindre en Russie et une diminution moyenne de 30 % dans les autres pays. En comparant le niveau des actuels pays de l'Est avec d'autres nous constatons qu'ils font pleinement partie du tiers-monde : la Russie (17,8) a été ravalée au rang d'un pays comme la Tunisie (19,4) ou l'Algérie, en-dessous même du Brésil (21), la plupart des ex-républiques de l'URSS sont à la hauteur de la Bolivie (9,3) et, pour les moins mal lotis, au rang du Mexique (27,2) ; c'est dire toute la vanité des discours sur les perspectives de développement et « lendemains qui chantent ».
Estimation du P.N.B. par habitant en parité de pouvoir d'achat
(Etats-Unis = 100)
|
Pays
|
1987
|
1994
|
94/87
|
|
Tadjikistan
|
12,1
|
3,7
|
31 %
|
|
Azerbaïdjan
|
21,7
|
5,8
|
27 %
|
|
Rép.Kirghize
|
13,5
|
6,7
|
50 %
|
|
Arménie
|
26,5
|
8,3
|
31 %
|
|
Ouzbékistan
|
12,5
|
9,2
|
74 %
|
|
Bolivie
|
|
9,3
|
|
|
Ukraine
|
20,4
|
10,1
|
50 %
|
|
Kazakhstan
|
24,2
|
10,9
|
45 %
|
|
Lettonie
|
24,1
|
12,4
|
51 %
|
|
Lituanie
|
33,8
|
12,7
|
38 %
|
|
Roumanie
|
22,7
|
15,8
|
70 %
|
|
Bielorussie
|
25,1
|
16,7
|
67 %
|
|
Bulgarie
|
23,5
|
16,9
|
72 %
|
|
Estonie
|
29,9
|
17,4
|
58 %
|
|
Russie
|
30,6
|
17,8
|
58 %
|
|
Tunisie
|
|
19,4
|
|
|
Hongrie
|
28,9
|
23,5
|
81 %
|
|
Slovénie
|
33,3
|
24,1
|
72 %
|
|
Mexique
|
|
27,2
|
|
|
Tchéquie
|
44,1
|
34,4
|
78 %
|
Au fur et à mesure que la réalité est mieux connue, les derniers espoirs et toutes les théories sur une possible amélioration de la situation volent en éclats. Les faits parlent d'eux-mêmes : il est impossible de relever l'économie de ces pays. Il n'y a pas plus d'espoir pour les ex-pays de l'Est qu'il n'y en a eu depuis plus de 100 ans pour les pays du tiers-monde. Ni l'ancien ordre réformé, ni la variante « libérale » du capitalisme occidental, qui n'est pas moins du capitalisme d'Etat, mais sous une forme beaucoup plus sophistiquée, ne peuvent constituer une solution de rechange. C'est le système capitaliste comme un tout au niveau mondial qui est en crise. Le manque de marchés, l'austérité, etc. ne sont pas l'apanage des pays de l'Est ruinés ou du tiers-monde à l'agonie, ces mécanismes sont au coeur du capitalisme le plus développé et frappent tous les pays du monde.
C.Mcl
Sources :
- L'économie mondiale en 1997, CEPII, Ed. La découverte, collection Repères n° 200.
- « Transition économique à l'Est », La documentation française n° 5023.
- Rapport sur le développement dans le monde 1996 : « De l'économie planifiée à l'économie de marché », Banque mondiale.
- Divers numéros du Monde Diplomatique.
Récent et en cours:
- Crise économique [28]
Revolution allemande (VI) : L'échec de la construction de l'organisation
- 3622 reads
Nous avons vu dans le précédent article que le KPD est fondé en Allemagne fin décembre 1918 dans le feu des luttes. Bien que les Spartakistes aient accompli un excellent travail de propagande contre la guerre et soient intervenus de façon décidée et avec grande clarté dans le mouvement révolutionnaire lui-même, le KPD n'est pas encore un parti solide. La construction de l'organisation vient juste de commencer, son tissu organisationnel ne possède qu'une trame encore très lâche. Lors de son congrès de fondation, le parti est marqué par une grande hétérogénéité. Différentes positions s'affrontent, non seulement sur la question du travail au sein des syndicats et celle de la participation au parlement mais, plus grave encore, il y a, sur la question organisationnelle, de grandes divergences. Sur cette question, l'aile marxiste autour de R. Luxemburg et de L. Jogiches, se trouve en minorité.
L'expérience de ce parti « non achevé » montre qu'il ne suffit pas de proclamer le parti pour que celui-ci existe et agisse en tant que tel. Un parti digne de ce nom doit disposer d'une structure organisationnelle solide qui doit s'appuyer sur une même conception de l'unité de l'organisation quant à sa fonction et à son fonctionnement.
L'immaturité du KPD à ce niveau a conduit à ce qu'il ne puisse pas véritablement remplir son rôle vis-à-vis de la classe ouvrière.
C'est une tragédie pour la classe ouvrière en Allemagne (et par voie de conséquence pour le prolétariat mondial) que, durant cette phase aussi décisive de l'après-guerre, elle n'ait pas bénéficié, dans son combat, d'une contribution efficace du parti.
1919 : suite à la répression, le KPD absent des luttes
Une semaine après le congrès de fondation du KPD, la bourgeoisie allemande, début 1919, manigance le soulèvement de janvier (Voir Revue Internationale n° 83). Le KPD met immédiatement en garde contre cette insurrection prématurée. Sa Centrale souligne que le moment de l'assaut contre l'Etat bourgeois n'est pas encore venu.
Alors que la bourgeoisie entreprend une provocation contre les ouvriers, que la colère et l'envie d'en découdre se répandent au sein de la classe ouvrière, l'une des figures éminentes du KPD , Karl Liebknecht, se jette dans les luttes aux côtés des « hommes de confiance révolutionnaires », à l'encontre des décisions et mises en garde du parti.
Non seulement une tragique défaite est infligée à la classe ouvrière dans son ensemble, mais les coups de la répression touchent particulièrement durement les militants révolutionnaires. En plus de R. Luxemburg et de K. Liebknecht, nombre d'entre eux sont passés par les armes comme L. Jogiches assassiné en mars 1919. Le KPD se retrouve ainsi décapité.
Ce n'est pas un hasard si c'est justement l'aile marxiste autour de R. Luxemburg et L. Jogiches qui est la cible de la répression. Cette aile, qui a toujours veillé à la cohésion du parti, est constamment apparue comme le défenseur le plus résolu de l'organisation.
Le KPD est ensuite contraint, pendant des mois entrecoupés de quelques interruptions, à l'illégalité. Il est impossible à Die Rote Fahne de paraître de janvier à mars, puis de mai à décembre 1919. Ainsi, dans les vagues de grèves de février à avril (Voir Revue Internationale n° 83), il ne peut jouer le rôle déterminant qui lui incombe. Sa voix est quasiment étouffée par le capital.
Si le KPD avait été un parti suffisamment fort, discipliné et influent pour démasquer effectivement la provocation de la bourgeoisie, lors de la semaine de janvier, et pour empêcher que les ouvriers ne tombent dans ce piège, le mouvement aurait sûrement connu une tout autre issue.
La classe ouvrière paie ainsi au prix fort les faiblesses organisationnelles du parti qui devient la cible de la répression la plus brutale. Partout on fait la chasse aux communistes. Les communications entre ce qui reste de la Centrale et les districts du parti sont plusieurs fois rompues. Lors de la conférence nationale du 29 mars 1919 on fait le constat que « les organisations locales sont submergées d'agents-provocateurs ».
« Pour ce qui est de la question syndicale, la conférence pense que le mot d'ordre "Hors des syndicats !" est pour l'instant déplacé. (...) L'agitation syndicaliste productrice de confusion doit être combattue non par des mesures de coercition mais par la clarification systématique des divergences de conception et de tactique. » (Centrale du KPD, conférence nationale du 29 mars 1919). Sur les questions programmatiques, il s'agit, à juste raison, dans un premier temps, d'aller au fond des divergences par la discussion.
Lors d'une conférence nationale tenue les 14 et 15 juin 1919 à Berlin, le KPD adopte des statuts qui affirment la nécessité d'un parti strictement centralisé. Et, bien que le parti prenne position clairement contre le syndicalisme, il est recommandé qu'aucune mesure ne soit prise à l'encontre des membres qui appartiennent à des syndicats.
Lors de la conférence d'août 1919, il est convenu de nommer un délégué par district du parti (il y en a 22), sans tenir compte de la taille de ceux-ci. Par contre chaque membre de la Centrale obtient une voix. Lors du congrès de fondation de fin décembre 1918, aucun mode de nomination des délégués n'avait été établi et la question de la centralisation n'avait pas été non plus précisée. En août 1919, la Centrale est sur-représentée en voix alors que la place et l'opinion des sections locales se trouvent restreintes. Il existe ainsi un danger d'une tendance à l'autonomisation de la Centrale, ce qui renforce la méfiance déjà existante vis-à-vis de celle-ci. Cependant le point de vue de la Centrale et de Levi (qui a entretemps été élu à sa tête) défendant la nécessité de poursuivre le travail dans les syndicats et au parlement n'arrive pas à s'imposer dans la mesure où la majorité des délégués penche vers les positions de la Gauche.
Comme nous l'avons montré dans la Revue Internationale n° 83, les nombreuses vagues de luttes qui ébranlent toute l'Allemagne dans la première moitié de l'année 1919 et dans lesquelles la voix du KPD est à peine perceptible, jettent des flots d'ouvriers hors des syndicats. Les ouvriers sentent que les syndicats comme organes classiques de revendication ne peuvent plus remplir leur fonction de défense des intérêts ouvriers depuis qu'au cours de la guerre mondiale ils ont, aux côtés de la bourgeoisie, imposé l'Union Sacrée et qu'à nouveau, dans cette situation révolutionnaire, ils se trouvent du côté de celle-ci. En même temps, il n'y a plus la même ébullition qu'aux mois de novembre et décembre 1918 lorsque les ouvriers s'étaient unifiés dans les conseils ouvriers et avaient mis en cause l'Etat bourgeois. Dans cette situation, de nombreux ouvriers créent des « organisations d'usines » devant regrouper tous les ouvriers combatifs dans des « Unions ». Ces dernières se donnent des plates-formes en partie politiques visant au renversement du système capitaliste. De nombreux ouvriers pensent alors que les Unions doivent être le lieu exclusif du rassemblement des forces prolétariennes et que le parti doit se dissoudre en leur sein. C'est la période au cours de laquelle les conceptions anarcho-syndicalistes, ainsi que les idées du communisme de conseils rencontrent un large écho. Plus de 100 000 ouvriers s'unifient dans les Unions. En août 1919 l'Allgemeine Arbeiter Union (AAU, Union Générale des Ouvriers) est fondée à Essen.
Simultanément, l'après-guerre amène une détérioration rapide des conditions de vie de la classe ouvrière. Alors que durant la guerre elle avait dû verser son sang et subir la famine, que l'hiver 1918-19 l'avait complètement épuisée, la classe ouvrière doit maintenant encore payer le prix de la défaite de l'impérialisme allemand dans la guerre. En effet, durant l'été 1919, le Traité de Versailles est signé et impose au Capital allemand – et surtout à la classe ouvrière du pays – la charge du paiement des réparations de guerre.
Dans cette situation, la bourgeoisie allemande, qui a intérêt à réduire autant que possible le poids du châtiment, tente de faire du prolétariat son allié face aux « exigences » des impérialismes vainqueurs. Ainsi, elle soutient toutes les voix qui s'élèvent dans ce sens et en particulier celles de certains dirigeants du parti à Hambourg. Des fractions au sein de l'armée se mettent en contact avec Wolffheim et Laufenberg qui, à partir de l'hiver 1919-20, vont défendre la « guerre populaire nationale » dans laquelle la classe ouvrière se doit de faire cause commune avec la classe dominante allemande et se doit de « lutter contre l'oppression nationale ».
Le 2e congrès du KPD d'octobre 1919 :de la confusion politique à la dispersion organisationnelle
C'est dans le contexte du reflux des luttes ouvrières, suite aux défaites subies lors de la première moitié de 1919, que se déroule du 20 au 24 octobre le 2e congrès du KPD à Heidelberg. La situation politique et le rapport d'administration forment les premiers points à l'ordre du jour. Concernant l'analyse de la situation politique sont principalement abordés les plans économique et impérialiste et, en particulier, la position de l'Allemagne. Presque rien n'est dit sur le rapport de force entre les classes au niveau international. L'affaiblissement et la crise du parti semblent avoir supplanté l'analyse de l'état de la lutte des classes au niveau international. Par ailleurs, alors qu'il s'agit, en priorité, de tout faire pour tendre à regrouper l'ensemble des forces révolutionnaires, d'entrée de jeu la Centrale met en avant ses « Thèses sur les principes communistes et la tactique » – dont certains aspects vont avoir de lourdes conséquences pour le parti et ouvrir la porte à de nombreuses scissions – et cherche à les imposer.
Les thèses soulignent que « la révolution est une lutte politique des masses prolétaires pour le pouvoir politique. Cette lutte est menée par tous les moyens politiques et économiques. (...) Le KPD ne peut renoncer par principe à aucun moyen politique au service de la préparation de ces grandes luttes. La participation aux élections doit entrer en ligne de compte comme l'un de ces moyens. » Plus loin elles abordent la question du travail des communistes dans les syndicats afin de « ne pas s'isoler des masses ».
Ce travail dans les syndicats et dans le parlement n'est pas posé comme une question de principe mais comme une question de tactique.
Sur le plan organisationnel, les thèses rejettent, à juste raison, le fédéralisme et soulignent la nécessité de la centralisation la plus rigoureuse.
Mais le dernier point ferme la porte à toute discussion en affirmant que « les membres du KPD qui ne partagent pas ces conceptions sur la nature, l'organisation et l'action du parti doivent se séparer du parti. »
Certes, depuis le début, les divergences au sein du KPD concernant les questions fondamentales du travail dans les syndicats et la participation aux élections au parlement étaient profondes. Au congrès de fondation du parti, la première Centrale élue défendait une position minoritaire sur ces questions et ne cherchait pas à l'imposer. Cela reflétait une compréhension juste de la question de l'organisation en particulier chez les membres de la direction qui n'ont pas quitté le parti sur la base de cette divergence mais concevaient celle-ci comme un point qu'il fallait clarifier dans toutes ses conséquences au cours des discussions ultérieures. ([1] [2732])
Il faut prendre en considération le fait que la classe ouvrière, notamment depuis le début de la première guerre mondiale, s'est acquis une expérience importante pour commencer à dégager un point de vue clair contre les syndicats et contre les élections parlementaires bourgeoises. Malgré cette clarification, les positions sur ces questions ne constituent pas encore alors des frontières de classe ni une raison pour scissionner. Aucune composante du mouvement révolutionnaire n'a encore réussi à tirer, de façon globale et cohérente, les conséquences du changement de période historique qui est en train de se produire, c'est-à-dire l'entrée du capitalisme dans sa phase de décadence. Il règne encore, parmi les communistes, une grande hétérogénéité ; et dans la plupart des pays il y a des divergences sur ces questions. C'est aux communistes d'Allemagne que revient le mérite d'avoir ouvert la voie à la clarification, formulé les premiers les positions de classe sur ces questions. Au niveau international, ils sont d'ailleurs en minorité à ce moment-là. En mettant l'accent sur les conseils ouvriers comme seule arme du combat révolutionnaire, lors de son congrès de fondation en mars 1919, l'Internationale Communiste montre que toute son orientation va dans le sens de rejeter les syndicats et le parlement. Mais elle n'a pas encore de position fondée théoriquement et tranchée pour définir clairement son attitude. A son congrès de fondation, le KPD a adopté une position juste mais sans que ses fondements théoriques n'aient été encore suffisamment développés. Tout cela reflète l'hétérogénéité et surtout l'immaturité de l'ensemble du mouvement révolutionnaire à ce moment-là. Il se trouve confronté à une situation objective qui a fondamentalement changé avec un retard au niveau de sa conscience et de l'élaboration théorique de ses positions. En tous cas il est clair que le débat sur ces questions est indispensable, qu'il doit être impulsé et qu'il est impossible de l'éviter. Pour toutes ces raisons, les divergences programmatiques sur la question syndicale et sur la participation aux élections ne peuvent pas constituer, à ce moment-là, un motif d'exclusion du parti ou de scission de la part des tenants de l'une ou l'autre des positions en présence. Adopter l'attitude opposée aurait entraîné l'exclusion de R. Luxemburg et K. Liebknecht qui, au congrès de fondation, sont élus, sans conteste, à la Centrale mais appartiennent à la minorité sur la question syndicale et sur la participation aux élections.
Mais c'est sur la question organisationnelle que le KPD est le plus profondément divisé. Lors de son congrès de fondation, il n'est qu'un rassemblement, situé à la gauche de l'USPD, qui se divise en plusieurs ailes en particulier sur la question de l'organisation. L'aile marxiste autour de R. Luxemburg et L. Jogiches, qui défend de la façon la plus déterminée l'organisation, son unité et sa centralisation, fait face à tous ceux qui ou bien sous-estiment la nécessité de l'organisation ou bien considèrent celle-ci avec méfiance, voire même avec hostilité.
Voila pourquoi le premier défi que doit relever le 2e congrès du parti est celui de prendre à bras le corps la défense et la construction de l'organisation.
Mais déjà les conditions objectives ne lui sont pas très favorables. En effet :
– La vie de l'organisation est très sévèrement mise à mal par les agissements de la bourgeoisie. La répression et les conditions d'illégalité qu'elle subit ne lui permettent pas de mener une vaste discussion dans les sections locales sur les questions programmatiques et organisationnelles. Dans cette mesure, lors du congrès, la discussion ne bénéficie pas de la meilleure préparation.
– La Centrale élue lors du congrès de fondation se trouve largement décimée : trois des neuf membres (R. Luxemburg, K. Liebknecht, L. Jogiches) ont été assassinés ; F. Mehring est décédé et trois autres ne peuvent pas participer aux travaux du congrès à cause des poursuites dont ils font l'objet. Ne restent que P. Levi, Pieck, Thalheimer et Lange.
Dans le même temps, les idées conseillistes et anarcho-syndicalistes prennent leur essor. Les partisans des Unions plaident pour la dissolution du parti dans les Unions, d'autres poussent à adopter une attitude de retrait dans les luttes revendicatives. Les concepts de « parti des chefs », de la « dictature des chefs » commencent à se répandre montrant que les tendances anti-organisationnelles gagnent du terrain.
Au cours de ce congrès, les conceptions organisationnelles erronées qui le traversent vont être la cause d'un véritable désastre. Déjà, pour la nomination des délégués, Levi s'arrange pour que le partage des voix s'établisse en faveur de la Centrale. Il jette ainsi par dessus bord les principes politiques qui avaient prévalu lors du congrès de fondation (même si celui-ci n'avait pas réussi à définir des statuts ni décider de la répartition précise des délégations). Au lieu d'être soucieux de la représentativité des délégués locaux qui expriment un état des positions politiques dans les sections aussi hétérogène soit-il, il pousse, comme en août 1919 à Francfort, à ce que la position de la Centrale soit toujours majoritaire.
Dés le départ donc, l'attitude de la Centrale accentue les divisions et prépare l'exclusion de la véritable majorité.
Par ailleurs, à l'instar des débats se déroulant dans presque tous les partis communistes sur la question du parlement et des syndicats, la Centrale aurait dû présenter ses thèses comme contribution à la discussion, comme moyen de poursuivre la clarification et non comme le moyen de l'étouffer et d'expulser du parti les tenants de la position adverse. Le dernier point des thèses, qui prévoit l'exclusion de tous ceux qui ont des divergences, reflète une conception organisationnelle fausse, celle du monolithisme, en contradiction avec la conception marxiste de l'aile qui s'était regroupée autour de R. Luxemburg et L. Jogiches qui a toujours préconisé la discussion la plus large possible dans l'ensemble de l'organisation.
Alors qu'au congrès de fondation, la Centrale élue adopte le point de vue politique juste de ne pas considérer les divergences existantes même sur des questions fondamentales comme les syndicats et la participation aux élections comme des motifs de scission ou d'exclusion, celle qui est en place lors du 2e congrès, s'appuyant sur une conception fausse de l'organisation, contribue à la désagrégation fatale du parti.
Les délégués qui représentent la position majoritaire issue du congrès de fondation, conscients de ce danger, réclament la possibilité de consulter leurs sections respectives et de « ne pas précipiter la décision de scission ».
Mais la Centrale du parti exige une décision immédiate. Trente et un des participants disposant d'une voix délibérative votent pour les thèses, 18 contre. Ces 18 délégués, qui représentent pour la plupart les districts du parti les plus importants numériquement et qui sont presque tous délégués des anciens ISD/IKD, sont dès lors considérés comme exclus.
Toute rupture ne peut avoir lieu que sur les bases les plus claires
Pour traiter avec responsabilité une discussion dans une situation de divergence, il est nécessaire que chaque position puisse être présentée et débattue largement et sans restriction. De plus, dans son attaque contre l'aile marxiste, Levi amalgame toutes les divergences et utilise l'arme de la déformation pure et simple.
Car il existe, en effet, dans ce congrès les divergences les plus diverses. Otto Rühle, par exemple, prend position le plus ouvertement contre le travail au parlement et dans les syndicats, mais sur la base d'une argumentation conseilliste. Il tire à boulets rouges sur la « politique des chefs ».
Les camarades de Brême, également adversaires résolus de tout travail au sein du parlement et des syndicats, ne rejettent pas le parti, au contraire. Cependant au congrès, ils ne défendent ni énergiquement ni clairement leur point de vue laissant le terrain libre aux agissements destructeurs d'aventuriers comme Wolffheim et Laufenberg ainsi qu'aux fédéralistes et aux unionistes.
Il règne ainsi une confusion générale. Les différents points de vue n'apparaissent pas clairement. En particulier sur la question organisationnelle, où une séparation claire entre les partisans et les adversaires du parti se doit d'être effectuée, tout est mélangé.
La position de rejet des syndicats et des élections parlementaires n'est pas à mettre sur le même plan et sur un pied d'égalité avec celle qui rejette par principe le parti. C'est malheureusement le contraire que fait Lévi quand il caractérise tous les adversaires du travail dans les syndicats et au parlement comme des ennemis du parti. Il accomplit ainsi une totale déformation des positions et fausse complètement l'enjeu posé.
Face à cette façon de procéder de la Centrale il y a différentes réactions. Seuls Laufenberg et Wolffheim, ainsi que deux autres délégués, considèrent la scission comme inévitable et la sanctionnent en proclamant le soir même la fondation d'un nouveau parti. Auparavant ces deux individus ont répandu la méfiance et retiré la confiance dans la Centrale sous prétexte de l'existence de certaines lacunes dans le rapport sur les finances. Dans une manoeuvre trouble, ils cherchent même à éviter tout débat ouvert sur la question de l'organisation.
Les délégués de Brême adoptent en revanche une attitude responsable. Ils ne veulent pas se laisser expulser. Ils reviennent le lendemain afin de poursuivre leur activité de délégués. Mais la Centrale fait déplacer la réunion dans un lieu tenu secret refusant ainsi la présence de cette minorité. Elle se débarrasse ainsi d'une importante partie de l'organisation non seulement en utilisant des ficelles dans le mode de désignation des délégués mais aussi en l'excluant de force du congrès.
Le congrès est imprégné de fausses visions de l'organisation. La Centrale de Levi a une conception monolithique de l'organisation selon laquelle il n'y a pas de place pour les positions minoritaires dans le parti. A l'exception des camarades de Brême qui, malgré leurs divergences, combattent pour rester dans l'organisation, l'opposition, elle-même, partage cette conception monolithique dans la mesure où elle excluerait bien la Centrale si elle le pouvait. De part et d'autre, on se précipite vers la scission sur les bases les plus confuses. L'aile qui représente le marxisme sur les questions organisationnelles n'est pas parvenue à imposer son point de vue.
C'est ainsi que s'installe parmi les communistes en Allemagne une tradition qui va par la suite constamment répéter le même schéma : chaque divergence aboutit à une scission.
Les positions programmatiques fausses ouvrent la porte à l'opportunisme
Comme nous l'avons déjà évoqué plus haut, les thèses, qui ne considèrent encore le travail au sein du parlement et des syndicats que d'un point de vue essentiellement tactique, expriment une difficulté répandue alors dans l'ensemble du mouvement communiste : celle de tirer les leçons de la décadence et de reconnaître que celle-ci a fait surgir avec elle de nouvelles conditions rendant inadéquats certains anciens moyens de lutte.
Le parlement et les syndicats sont devenus des rouages de l'appareil d'Etat. La Gauche a perçu ce processus bien plus qu'elle ne l'a compris théoriquement.
Par contre, l'orientation tactique prise par la direction du KPD, reposant sur une vision confuse de ces questions, va participer de la dérive opportuniste dans laquelle s'engage le parti et qui, sous prétexte de « ne pas se couper des masses », le pousse à faire de plus en plus de concessions à ceux qui ont trahi le prolétariat. Cette dérive va également s'illustrer par la tendance à rechercher une entente avec l'USPD centriste afin de devenir « un parti de masse ». Malheureusement, en excluant massivement tous ceux qui ont des divergences avec l'orientation de la direction, le KPD élimine de ses rangs un nombre important de militants fidèles au parti et se prive ainsi de l'indispensable oxygène de la critique seul capable de freiner cette gangrène opportuniste.
Ce qui est fondamentalement à la base de cette tragédie c'est l'absence de compréhension de la question organisationnelle et de son importance. Une leçon essentielle que nous devons tirer aujourd'hui est que toute exclusion ou scission est un acte trop sérieux et trop lourd de conséquences pour être pris à la légère. Une telle décision n'est possible qu'au terme d'une clarification préalable en profondeur et concluante. C'est pourquoi cette compréhension politique fondamentale se doit de figurer dans les statuts de toute organisation avec toute la clarté requise.
L'Internationale Communiste elle-même, qui d'un côté soutient la position de Levi sur la question syndicale et parlementaire, insiste de l'autre sur la nécessité de continuer à mener le débat de fond et refuse toute rupture causée par ces divergences. Lors du congrès de Heidelberg la direction du KPD a agi de sa propre autorité sans tenir compte de l'avis de l'Internationale.
En réaction à leur exclusion du parti, les militants de Brême créent un « Bureau d'information » pour l'ensemble de l'opposition afin de maintenir les contacts entre les communistes de gauche en Allemagne. Ils ont une compréhension juste du travail de fraction. Par souci d'éviter l'éclatement du parti et par des tentatives de compromis sur les points en litige les plus importants de la politique de l'organisation (les questions syndicale et parlementaire) ils luttent pour maintenir l'unité du KPD. C'est dans ce but que le 23 décembre 1919 le « Bureau d'information » lance l'appel suivant :
« 1. Convocation d'une nouvelle conférence nationale fin janvier.
2. Admission de tous les districts qui appartenaient au KPD avant la troisième conférence nationale, qu'ils reconnaissent les Thèses ou pas.
3. Mise à la discussion immédiate des Thèses et des propositions en vue de la conférence nationale.
4. La Centrale est tenue, jusqu'à la convocation de la nouvelle conférence, de cesser toute activité scissionniste. » (Kommunistische Arbeiter Zeitung, n° 197)
En proposant, pour le 3e congrès, des amendements aux thèses et en revendiquant leur réintégration dans le parti, les militants de Brême assument un véritable travail de fraction. Sur le plan organisationnel, leurs propositions d'amendements visent au renforcement de la position des groupes locaux du parti vis-à-vis de la Centrale tandis que sur les questions des syndicats et du parlementarisme ils font des concessions aux thèses de la Centrale. Par contre, cette dernière, dans les districts d'où proviennent les délégués exclus (Hambourg, Brême, Hanovre, Berlin et Dresde) poursuit sa politique scissionniste et met en place de nouveaux groupes locaux.
Lors du 3e congrès qui se tient les 25 et 26 février 1920, la saignée apparaît clairement. Alors qu'en octobre 1919 le KPD possédait encore plus de 100 000 membres, il n'en compte désormais que 40 000 environ. De plus, la décision du congrès d'octobre 1919 a produit un tel manque de clarté qu'au congrès de février règne la confusion sur l'appartenance ou non des militants de Brême au KPD. Ce n'est qu'au 3e congrès qu'est prise la décision définitive d'exclusion bien qu'elle fût déjà entrée en vigueur en octobre 1919.
La bourgeoisie favorise l'éclatement du parti
Suite au putsch de Kapp qui vient juste d'être déclenché, lors d'une conférence nationale de l'opposition tenue le 14 mars 1920, le « Bureau d'information » de Brême déclare qu'il ne peut prendre la responsabilité de créer un nouveau parti communiste et se dissout. Fin mars, après le 3e congrès, les militants de Brême retournent dans le KPD.
Par contre, aussitôt après leur exclusion les délégués de Hambourg, Laufenberg et Wolffheim, avaient annoncé la fondation d'un nouveau parti. Cette démarche ne correspond en rien à celle du marxisme vis-à-vis de la question organisationnelle. Toute leur attitude, après leur exclusion, révèle des agissements destructeurs intentionnels vis-à-vis des organisations révolutionnaires. En effet, dès ce moment-là, ils développent ouvertement et frénétiquement leur position « nationale-bolchévik ». Déjà au cours de la guerre ils avaient fait de la propagande pour la « guerre populaire révolutionnaire ». Contrairement aux Spartakistes ils n'ont pas adopté une position internationaliste mais ont appelé à la subordination de la classe ouvrière à l'armée « afin de mettre un terme à la domination du capital anglo-américain ». Ils ont même accusé les Spartakistes d'avoir poussé à la désagrégation de l'armée et ainsi d'avoir « poignardé celle-ci dans le dos ». Ces accusations se sont trouvées en parfaite unisson avec les attaques de l'extrême-droite après la signature du Traité de Versailles. Alors qu'au cours de l'année 1919 Laufenberg et Wolffheim se couvraient d'un masque radical par leur agitation contre les syndicats, après leur exclusion du KPD ils mettent au premier plan leur « attitude nationale-bolchévique ». Auprès des ouvriers de Hambourg, leur politique ne rencontre aucun écho important. Mais ces deux individus manoeuvrent adroitement et publient leur point de vue comme supplément au Kommunistische Arbeiter Zeitung sans l'accord du parti. Plus ils seront isolés dans le KPD et plus ils lanceront des attaques antisémites ouvertes contre le dirigeant du KPD, le taxant de « juif » et « d'agent anglais ». Il se révèlera plus tard que Wolffheim était le secrétaire de l'officier Lettow-Vorbeck et il sera dénoncé en tant qu'agent provocateur de la police. Il n'agit donc pas de sa propre initiative et son action vise, consciemment et systématiquement, avec le soutien de « cercles » opérant dans l'ombre, à la destruction du parti.
Le drame de l'opposition est de ne pas avoir su se démarquer de ces gens-là à temps et avec suffisamment de détermination. La conséquence en est que de plus en plus de militants sont dégoûtés par les activités de Laufenberg et Wolffheim et nombre d'entre eux ne se rendent plus aux réunions du Parti et se retirent. (Voir le procès-verbal du 3e congrès du KPD, p. 23)
Par ailleurs, cherchant à tirer profit de la série de défaites qu'elle lui a infligée durant l'année 1919, la bourgeoisie va développer une offensive contre le prolétariat au printemps 1920. Le 13 mars les troupes de Kapp et de Lüttwitz lancent une attaque militaire pour ramener l'ordre. Ce putsch vise clairement la classe ouvrière même si c'est le gouvernement SPD qui est en apparence « frappé ». Confrontés à l'alternative ou bien de riposter aux offensives de l'armée, ou bien de subir la répression sanglante, dans presque toutes les villes les ouvriers se soulèvent pour résister. Ils n'ont pas d'autre alternative que de se défendre. C'est dans la Ruhr où une « Armée Rouge » est créée que le mouvement de riposte est le plus fort.
Face à cette action de l'armée, la Centrale du KPD est complètement désorientée. Alors qu'au départ elle soutient la riposte du prolétariat, lorsque des forces du Capital vont proposer un gouvernement SPD-USPD « pour sauver la démocratie », elle va considérer celui-ci comme « un moindre mal » et même lui offrir « son opposition loyale ».
Cette situation d'ébullition dans la classe ouvrière ainsi que l'attitude du KPD vont fournir à tous ceux qui ont été exclus de ce dernier le prétexte pour fonder un nouveau parti.
DV.
[1] [2733]. « Avant tout, pour ce qui concerne la question de la non-participation aux élections, tu surestimes énormément la portée de cette décision. Notre "défaite" [c'est à dire la défaite dans les votes au congrès de la future Centrale sur cette question] n'a été que la victoire d'un extrémisme un peu puéril, en pleine fermentation, sans nuances. (...) N'oublie pas que les Spartakistes sont, pour une bonne part, une génération neuve sur laquelle ne pèsent pas les traditions abrutissantes du "vieux" parti et il faut accepter la chose avec ses lumières et ses ombres. Nous avons tous unanimement décidé de ne pas en faire une affaire d'Etat et de ne pas le prendre au tragique. » (Rosa Luxemburg, Lettre à Clara Zetkin, 11 janvier 1919).
Géographique:
- Allemagne [98]
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Allemande [1955]
Approfondir:
- Révolution Allemande [1957]
Heritage de la Gauche Communiste:
- La Révolution prolétarienne [1149]
Questions d'organisation, IV : la lutte du marxisme contre l'aventurisme politique
- 3956 reads
Dans les trois premiers articles de cette série, nous avons vu comment, appuyé et manipulé par les classes dominantes et par tout un réseau de parasites politiques, Bakounine avait mené une lutte secrète contre la 1re Internationale. Cette lutte était dirigée plus particulièrement contre l'établissement de véritables règles et principes prolétariens de fonctionnement au sein de l'Internationale. Alors que les statuts de l'Association Internationale des Travailleurs (AIT) défendaient un mode de fonctionnement unitaire, collectif, centralisé, transparent et discipliné, et représentaient un pas qualitatif par rapport à la phase antérieure du mouvement ouvrier qui était sectaire, hiérarchique et conspiratrice, l'Alliance de Bakounine a mobilisé tous les éléments non-prolétariens qui ne voulaient pas accepter ce grand pas en avant. Avec la défaite de la Commune de Paris et le reflux international de la lutte de classe après 1871, la bourgeoisie redoubla d'efforts pour détruire l'Internationale et surtout pour discréditer la vision marxiste du parti ouvrier et les principes organisationnels qui s'établissaient dans ses rangs de façon croissante. Donc, avant de se disperser, l'Internationale organisa une confrontation ouverte et décisive avec le bakouninisme lors de son congrès de La Haye en 1872. Tout en réalisant qu'une Internationale ne peut pas continuer à exister face à une défaite majeure du prolétariat mondial, les marxistes au congrès de La Haye eurent une préoccupation centrale : que les principes politiques et organisationnels qu'ils avaient défendus contre le bakouninisme puissent être transmis aux futures générations de révolutionnaires et servir de base pour les futures Internationales. C'est aussi la raison pour laquelle les révélations du congrès de La Haye sur la conspiration de Bakounine au sein et contre l'Internationale furent publiées et mises ainsi à la disposition de l'ensemble de la classe ouvrière.
Peut-être que la leçon la plus importante que la 1re Internationale nous a transmise de sa lutte contre l'Alliance de Bakounine, porte sur le danger que les éléments déclassés en général et l'aventurisme politique en particulier représentent pour les organisations communistes. C'est précisément cette leçon qui a été le plus complètement ignorée ou sous-estimée par beaucoup de groupes du milieu révolutionnaire actuel. C'est pour cela que la dernière partie de notre série sur la lutte contre le bakouninisme est consacrée à cette question.
L'importance historique de l'analyse de la 1re Internationale sur Bakounine
Pourquoi la 1re Internationale n'a-t-elle pas décidé de traiter sa lutte contre le bakouninisme comme une affaire purement interne, sans intérêt pour ceux qui sont en-dehors de l'organisation ? Pourquoi a-t-elle insisté autant pour que les leçons de cette lutte soient transmises pour le futur ? A la base de la conception marxiste de l'organisation se trouve la conviction que les organisations communistes révolutionnaires sont un produit du prolétariat. En termes historiques, elles ont reçu un mandat de la classe ouvrière. Comme telles, elles ont la responsabilité de justifier leurs actions devant l'ensemble de leur classe, en particulier face aux autres organisations et expressions politiques prolétariennes, face au milieu prolétarien. C'est un mandat non seulement pour le présent mais aussi devant l'histoire elle-même. De la même manière, il est de la responsabilité des futures générations de révolutionnaires d'accepter ce mandat légué par l'histoire, d'apprendre et de juger des combats de leurs prédécesseurs.
C'est pour cela que la dernière grande bataille de la 1re Internationale fut consacrée à révéler au prolétariat mondial et à l'histoire le complot organisé par Bakounine et ses partisans contre le parti ouvrier. Et c'est pour cela qu'il est, aujourd'hui, de la responsabilité des organisations marxistes de tirer ces leçons du passé afin d'être armées dans la lutte contre le bakouninisme contemporain, contre l'aventurisme politique actuel.
Consciente du danger historique que les leçons tirées par la 1re Internationale représentaient pour ses propres intérêts de classe, la bourgeoisie, en réponse aux révélations du congrès de La Haye, fit tout ce qui était en son pouvoir pour discréditer cet effort. La presse et les politiciens bourgeois déclarèrent que le combat contre le bakouninisme n'était pas une lutte pour des principes mais une lutte sordide pour le pouvoir au sein de l'Internationale. Ainsi, Marx était censé avoir éliminé son rival Bakounine au travers d'une campagne de mensonges. En d'autres termes, la bourgeoisie essaya de convaincre la classe ouvrière que ses organisations utilisaient les mêmes méthodes fonctionnaient exactement de la même manière que celles des exploiteurs et donc n'étaient pas meilleures. Le fait qu'une grande majorité de l'Internationale appuya Marx fut rabaissé au « triomphe de l'esprit de l'autoritarisme » dans ses rangs et à la prétendue tendance paranoïa de ses membres à voir des ennemis de l'Association cachés partout. Les bakouninistes et les lassalliens firent même courir des rumeurs selon lesquelles Marx était un agent de Bismarck.
Comme on le sait, ce sont exactement les mêmes accusations qui sont portées par la bourgeoisie et par le parasitisme politique contre le CCI aujourd'hui.
De tels dénigrements, lancés par la bourgeoisie et répandus par le parasitisme politique, accompagnent inévitablement chaque combat organisationnel du prolétariat. Cela est beaucoup plus sérieux et dangereux quand ils trouvent un certain écho au sein du camp révolutionnaire lui-même. Ce fut le cas avec la biographie de Marx par Franz Mehring. Dans ce livre, Mehring, qui fit partie du courant de la gauche de la 2e Internationale, déclare que la brochure du congrès de La Haye sur l'Alliance était « inexcusable » et « indigne de l'Internationale ». Dans ce livre, Mehring défend non seulement Bakounine mais aussi Lassalle et Schweitzer contre les accusations faites par Marx et les marxistes. La principale accusation portée par Mehring contre Marx est que celui-ci aurait abandonné la méthode marxiste dans ses écrits contre Bakounine. Tandis que, dans tous ses autres travaux, Marx est toujours parti d'une vision matérialiste de classe des événements, dans son analyse sur l'Alliance de Bakounine, selon Mehring, il essaya d'expliquer le problème par la personnalité et les actions d'un petit nombre d'individus : les dirigeants de l'Alliance. En d'autres termes, au lieu d'une analyse de classe, il accuse Marx d'être tombé dans une vision personnalisée et conspiratrice au lieu de faire une analyse de classe. Toujours selon Mehring, prisonnier de cette vision, Marx était obligé d'exagérer fortement les fautes et le travail de sabotage de Bakounine de même que pour les dirigeants du lassallisme en Allemagne. ([1] [2734])
En fait, Mehring refuse « par principe » d'examiner le matériel fourni par Marx et Engels sur Bakounine quand il déclare : « Ce qui a conféré une attraction particulière et une valeur durable à leurs autres écrits polémiques, la recherche de points de vue nouveaux mis en lumière par la critique négative, manque complètement dans ce travail. » ([2] [2735])
Là encore, c'est la même critique qui est faite aujourd'hui, dans le milieu révolutionnaire, contre le CCI. En répondant à ces critiques, nous allons maintenant démontrer que la position de Marx contre Bakounine était vraiment basée sur une analyse matérialiste de classe, une analyse de l'aventurisme politique et du rôle des déclassés. C'est ce point de vue d'une importance cruciale, qui n'est pas « nouveau », que Mehring ([3] [2736]) et, avec lui, la majorité des groupes révolutionnaires actuels, ont complètement oublié ou mal compris.
Les déclassés : des ennemis des organisations prolétariennes
Contrairement à ce que Mehring pensait, la 1re Internationale a vraiment fourni une analyse de classe sur les origines et la base sociale de l'Alliance de Bakounine.
« Ses fondateurs, et les représentants des organisations ouvrières des deux mondes qui, dans les congrès internationaux, ont sanctionné les statuts généraux de l'Association, oubliaient que la largeur même de son programme permettrait aux déclassés de s'y glisser et de fonder, dans son sein, des organisations secrètes dont les efforts, au lieu d'être dirigés contre la bourgeoisie et les gouvernements existants, se tourneraient contre l'Internationale elle-même. Tel a été le cas avec l'Alliance de la démocratie socialiste. » ([4] [2737])
La conclusion de ce même document résume les aspects principaux du programme politique de Bakounine en quatre points dont deux insistent de nouveau sur le rôle décisif des déclassés : « 1. Toutes les turpitudes, dans lesquelles se meut fatalement la vie des déclassés sortis des couches sociales supérieures, sont proclamées autant de vertus ultra-révolutionnaires (...) 4. La lutte économique et politique des ouvriers pour leur émancipation est remplacée par les actes pandestructifs du gibier de bagne, dernière incarnation de la révolution. En un mot, il faut lancer le voyou, supprimé par les travailleurs eux-mêmes dans "les révolutions sur le modèle classique de l'Occident", et mettre ainsi gratuitement à la disposition des réactionnaires une bande bien disciplinée d'agents provocateurs. » ([5] [2738])
Et la conclusion d'ajouter : « Les résolutions prises par le Congrès de La Haye contre l'Alliance étaient donc de devoir strict ; il ne pouvait laisser tomber l'Internationale, cette grande création du prolétariat, dans le piège tendu par le rebut des classes exploitantes. » ([6] [2739])
En d'autres termes, la base sociale de l'Alliance était constituée par la canaille des classes dominantes, les déclassés, essayant de mobiliser la canaille de la classe ouvrière, le des éléments du lumpen-prolétariat pour ses intrigues contre les organisations communistes.
Bakounine lui-même était l'incarnation de l'aristocrate déclassé : « ... ayant acquis dans sa jeunesse tous les vices des officiers impériaux du passé (il était officier), il appliqua à la révolution tous les mauvais instincts de ses origines tartares et aristocratiques. Ce type de noble tartare est bien connu. C'était un véritable déchaînement de mauvaises passions : les paris, le fouet et la torture pour les serfs, le viol des femmes, la saoulerie jour après jour, inventant avec le raffinement le plus barbare toutes les formes de la profanation la plus abjecte de la nature et de la dignité humaines, telle était la vie agitée et révolutionnaire de ces nobles. Le noble tartare Horostratus, n'a-t-il pas appliqué à la révolution, par manque de serfs féodaux, toutes les mauvaises passions de ses frères ? » ([7] [2740])
C'est cette attraction de la lie des classes de la société, la plus haute et la plus basse, l'une pour l'autre mutuelle entre les canailles des différentes classes de la société qui explique la fascination de Bakounine, l'aristocrate déclassé, pour le milieu criminel et le lumpen-prolétariat. Le « théoricien » Bakounine a besoin des énergies criminelles de la pègre, du lumpen-prolétariat, pour accomplir son programme. Ce rôle a été assumé par Netchaïev en Russie qui a mis en pratique ce que Bakounine prêchait, manipulant et faisant chanter les membres de son comité et exécutant ceux qui essayaient de le quitter. Bakounine n'hésita pas à théoriser cette alliance des « grands hommes » déclassés avec les criminels : « Le brigandage est une des formes les plus honorables de la vie populaire russe. Le brigand, c'est le héros, c'est le défenseur, c'est le vengeur populaire, l'ennemi irréconciliable de l'Etat et de tout ordre social et civil établi par l'Etat, le lutteur à la vie et à la mort contre toute cette civilisation de fonctionnaires, de nobles, de prêtres et de la couronne... Celui qui ne comprend pas le brigandage ne comprendra rien dans l'histoire populaire russe. Celui qui ne lui est pas sympathique, ne peut sympathiser avec la vie populaire et n'a pas de coeur pour les souffrances séculaires et démesurées du peuple ; il appartient au camp des ennemis, des partisans de l'Etat. » ([8] [2741])
Les déclassés en politique : un terrain fertile pour la provocation
La motivation principale de tels éléments déclassés, en entrant en politique, n'est pas l'identification avec la cause de la classe ouvrière ou une passion pour son but, le communisme, mais une haine brûlante et l'esprit de revanche du déraciné contre la société. Dans son Catéchisme Révolutionnaire, Bakounine déclare ainsi : « Il n'est pas un révolutionnaire s'il tient à quoi que ce soit en ce monde. Il ne doit pas hésiter devant la destruction d'une position quelconque, d'un lien ou d'un homme appartenant à ce monde. Il doit haïr tout et tous également. » ([9] [2742])
N'ayant de lien de loyauté à l'égard d'aucune classe de la société et ne croyant en aucune perspective sociale sinon en son propre avancement, le pseudo-révolutionnaire déclassé n'est pas animé par l'objectif d'un futur, d'une forme plus progressive de la société mais par un désir nihiliste de destruction : « N'admettant aucune autre activité que celle de la destruction, nous reconnaissons que les formes dans lesquelles doit s'exprimer cette activité peuvent être extrêmement variées : poison, poignard, noeud coulant, etc. La révolution sanctifie tout sans distinction. » ([10] [2743])
Il devrait aller sans dire Est-il nécessaire de démontrer qu'une telle mentalité et un tel environnement social représentent un terrain véritablement très favorable à la provocation politique ? Si les provocateurs, les informateurs de police et les aventuriers politiques (ces ennemis les plus dangereux des organisations révolutionnaires) sont employés par les classes dominantes, ils n'en sont pas moins produits spontanément par le processus constant de déclassement, surtout dans le capitalisme. Quelques brefs extraits du Catéchisme Révolutionnaire de Bakounine suffiront à illustrer ce point.
L'article 10 conseille au « véritable militant » d'exploiter ses camarades : « Chaque compagnon doit avoir sous la main plusieurs révolutionnaires de second et de troisième ordre, c'est-à-dire de ceux qui ne sont pas encore complètement initiés. Il doit les considérer comme une partie du capital révolutionnaire général, mis à sa disposition. Il doit dépenser économiquement sa part du capital, tâcher d'en tirer le plus grand profit possible. »
L'article 18 met en avant comment vivre aux crochets des riches : « Il faut les exploiter de toutes les manières possibles, les circonvenir, les dérouter, et, nous emparant de leurs sales secrets, en faire nos esclaves. De cette manière, leur puissance, leurs relations, leur influence et leurs richesses deviendront un trésor inépuisable et un secours précieux dans diverses entreprises. »
L'article 19 propose l'infiltration des libéraux et des autres partis : « Avec eux on peut conspirer d'après leur propre programme, faisant semblant de les suivre aveuglément. Il faut les prendre dans nos mains, se saisir de leurs secrets, les compromettre complètement, de manière à ce que la retraite leur devienne impossible, se servir d'eux pour amener des perturbations dans l'Etat. »
L'article 20 parle de lui-même : « La cinquième catégorie est formée de doctrinaires, de conspirateurs, de révolutionnaires, de tous ceux qui bavardent dans les réunions et sur le papier. Il faut les pousser et les entraîner sans cesse à des manifestations pratiques et périlleuses qui auront pour résultat d'en faire disparaître la majorité, en faisant de quelques-uns d'entre eux de véritables révolutionnaires. »
L'article 21 : « La sixième catégorie est très importante ; ce sont les femmes qui doivent être divisées en trois classes : les unes, les femmes futiles, sans esprit et sans coeur, dont il faut user de la même manière que de la troisième et quatrième catégorie d'hommes ; les secondes, les femmes ardentes, dévouées et capables, mais qui ne sont pas des nôtres parce qu'elles ne sont pas encore parvenues à l'entendement révolutionnaire pratique et sans phrases ; il faut les employer comme les hommes de la cinquième catégorie ; enfin les femmes qui sont entièrement à nous, c'est-à-dire complètement initiées et ayant accepté notre programme entier. Nous devons les considérer comme le plus précieux de nos trésors, sans le secours duquel nous ne pouvons rien faire. » ([11] [2744])
Ce qui est frappant, c'est la similarité entre les méthodes exposées par Bakounine et celles employées par les sectes religieuses d'aujourd'hui qui, bien que dominées par l'Etat, sont généralement fondées autour d'aventuriers déclassés. Comme nous l'avons vu dans les précédents articles, le modèle organisationnel de Bakounine était la franc-maçonnerie, le précurseur du phénomène moderne des sectes religieuses.
Les aventuriers : une arme terrible contre le mouvement ouvrier
Les activités des aventuriers politiques déclassés sont particulièrement dangereuses pour le mouvement ouvrier. Les organisations révolutionnaires prolétariennes ne peuvent exister et fonctionner correctement que sur la base d'une confiance mutuelle profonde entre les militants et entre les groupes du milieu communiste. Le succès du parasitisme politique en général, et des aventuriers en particulier, dépend au contraire précisément de la capacité à saper la confiance mutuelle, en détruisant les principes politiques de comportement des militants sur lesquels les organisations de la classe sont basées.
Dans une lettre à Netchaïev datée de juin 1870, Bakounine révèle clairement ses intentions envers l'Internationale : « Nous devons faire en sorte que ces sociétés, dont les buts sont proches des nôtres, s'unissent à nous ou, au moins, se soumettent sans même s'en apercevoir. En faisant cela, les éléments sur qui on ne peut compter devront être écartés. Les sociétés qui nous sont hostiles ou nuisibles, devront être détruites. Pour finir, le gouvernement devra être renversé. Tout ça ne peut être réalisé par la seule vérité. Cela ne fonctionnera pas sans tromperies, intelligence et mensonges. » ([12] [2745])
Une des « tromperies » classiques consiste à accuser l'organisation des travailleurs d'employer les mêmes méthodes que celles de l'aventurier lui-même. Ainsi, dans sa Lettre aux frères d'Espagne, Bakounine affirme que la résolution de la conférence de Londres de 1872 contre les sociétés secrètes, dirigée en particulier contre l'Alliance, n'a été adoptée par l'Internationale que « pour ouvrir la voie à leur propre conspiration pour la société secrète qui existe depuis 1848 sous la direction de Marx, qui a été fondée par Marx, Engels et Wolff maintenant décédé, et qui n'est rien d'autre qu'une société quasiment exclusivement allemande de communistes autoritaires. (...) Il faut reconnaître que la lutte qui s'est engagée dans l'Internationale n'est rien d'autre qu'une lutte entre deux sociétés secrètes. » ([13] [2746])
Dans l'édition allemande, il y a une note de bas de page de l'historien anarchiste Max Nettlau, un admirateur passionné de Bakounine, qui admet que ces accusations contre Marx sont complètement fausses ([14] [2747]). Rappelons aussi l'écrit antisémite de Bakounine, Les rapports personnels avec Marx, où le marxisme est présenté comme faisant partie d'un complot juif supposé lié à la famille Rothschild et auquel nous nous sommes référés dans notre article sur « Le marxisme contre la Franc-maçonnerie » dans la Revue Internationale n° 87.
Le projet du bakouninisme est Bakounine lui-même
Les méthodes employées par Bakounine étaient celles d'un agitateur déclassé. Mais quel objectif servaient-elles ?
La seule préoccupation politique de Bakounine était Bakounine lui-même. Il entra dans le mouvement ouvrier à la recherche de son propre projet.
L'Internationale était très claire là-dessus. Le premier texte important du Conseil Général sur l'Alliance, la circulaire interne sur Les prétendues scissions dans l'Internationale déclare déjà que le but de Bakounine est de « remplacer le Conseil Général par sa propre dictature personnelle. » Le rapport du congrès sur l'Alliance développe sur ce thème : « L'Internationale était déjà fortement établie quand M.Bakounine se mit en tête de jouer un rôle comme émancipateur du prolétariat. (...) Pour se faire reconnaître comme chef de l'Internationale, il fallait se présenter comme chef d'une autre armée dont le dévouement absolu envers sa personne lui devait être assuré par une organisation secrète. Après avoir ouvertement implanté sa société dans l'Internationale, il comptait en étendre les ramifications dans toutes les sections et en accaparer par ce moyen la direction absolue. »
Ce projet personnel existait bien avant que Bakounine pense à rejoindre l'Internationale. Quand Bakounine s'échappe de Sibérie et arrive à Londres en 1861, il tire un bilan négatif de sa première tentative pour s'établir lui-même dans les cercles révolutionnaires d'Europe de l'Ouest durant les révolutions de 1848-49.
« Il n'est pas bon d'exercer son activité en pays étranger. J'en ai fait l'expérience dans les années révolutionnaires : ni en France, ni en Allemagne je n'ai pu prendre pied. Aussi, tout en conservant dans le mouvement progressif du monde entier toute ma chaleureuse sympathie d'autrefois, afin de ne pas dépenser dans le vide le reste de ma vie, je dois dorénavant limiter mon activité directe à la Russie, à la Pologne, aux Slaves. » ([15] [2748])
Là, le motif de Bakounine pour son changement d'orientation n'est pas les besoins de la cause mais clairement la question de « prendre pied » : c'est la première caractéristique des aventuriers politiques.
Bakounine cherche à gagner les classes dominantes à ses propres ambitions
Ce texte est aussi connu comme Manifeste Panslave de Bakounine. « On dit que, peu de temps avant sa mort, l'empereur Nicolas lui-même, se préparant à déclarer la guerre à l'Autriche, conçut l'idée de faire appel à tous les slaves autrichiens et turcs, aux hongrois et aux italiens, afin de les exciter à une insurrection générale. Il avait soulevé contre lui la guerre d'orient, et pour se défendre, il voulut se transformer d'empereur despote en empereur révolutionnaire. » ([16] [2749])
Dans sa brochure La cause des peuples de 1862, Bakounine déclare sur le rôle du tsar contemporain Alexandre II de Russie que « c'est lui, lui uniquement qui pourrait accomplir en Russie la plus grave et la plus bienfaisante révolution sans verser une goutte de sang. Il le peut encore maintenant (...). Arrêter le mouvement du peuple qui se réveille, après un sommeil de mille ans, est impossible. Mais si le tsar se mettait fermement et hardiment à la tête du mouvement, sa puissance pour le bien et pour la gloire de la Russie n'aurait pas de bornes. » ([17] [2750])
Continuant dans cette veine, Bakounine appelle le tsar à envahir l'Europe de l'Ouest : « Il est temps que les allemands s'en aillent en Allemagne. Si le tsar avait compris que dorénavant il devait être, non le chef d'une centralisation forcée, mais celui d'une fédération libre de peuples libres, s'appuyant sur une force solide et régénérée, s'alliant la Pologne et l'Ukraine, rompant toutes les alliances allemandes tant détestées, levant audacieusement le drapeau panslave, il deviendrait le sauveur du monde slave. »
Voici les commentaires de l'Internationale là-dessus. « Le panslavisme est une invention du cabinet de Saint-Pétersbourg et n'a d'autre but que d'étendre les frontières européennes de la Russie vers l'ouest et le sud. Mais, comme on n'ose pas annoncer aux slaves autrichiens, prussiens et turcs que leur destinée est d'être fondus dans le grand empire russe, on leur présente la Russie comme la puissance qui les délivrera du joug étranger et qui les réunira dans une grande fédération libre. » ([18] [2751])
Mais, à part sa haine bien connue pour les allemands, qu'est-ce qui poussait Bakounine à appuyer si ouvertement le bastion principal de la contre-révolution en Europe, l'autocratie moscovite ? En réalité, il essayait de gagner l'appui du tsar pour ses propres ambitions politiques en Europe de l'Ouest. Le milieu politique radical occidental grouillait d'agents tsaristes, de groupes et de publications défendant le panslavisme et d'autres causes pseudo-révolutionnaires. La cour russe avait ses agents et ses sympathisants aux places d'influence les plus importantes comme l'illustre l'exemple de Lord Palmerston, le politicien britannique le plus important de cette époque. Il est clair que la protection de Moscou aurait été inestimable pour la réalisation des ambitions personnelles de Bakounine.
Bakounine espérait persuader le tsar de donner à sa politique intérieure une teinte révolutionnaire-démocratique en convoquant une assemblée nationale. Cela aurait permis à Bakounine d'organiser le mouvement polonais et les mouvements d'émigrés et autres radicaux à l'Ouest comme le cheval de Troie ultra-gauche de Russie en Europe occidentale : « Malheureusement, le tsar ne jugea pas à propos de convoquer l'Assemblée nationale à laquelle, dans cette brochure, Bakounine posait sa candidature. Il en fut pour ses frais de manifeste électoral et pour ses génuflexions devant Romanov. Indignement trompé dans sa candide confiance, il ne lui restait plus qu'à se lancer à corps perdu dans l'anarchie pandestructive. » ([19] [2752])
Ayant été déçu par le tsarisme mais inébranlable dans sa quête d'un rôle personnel dirigeant sur les mouvements révolutionnaires européens, Bakounine se mit à graviter autour de la franc-maçonnerie au milieu des années 1860 en Italie, fondant lui-même différentes sociétés secrètes (voir le premier article de cette série). Utilisant ces méthodes, Bakounine infiltra d'abord la bourgeoise « Ligue pour la Paix » qu'il essaya d'unir à l'Internationale « sur un pied d'égalité » et le tout sous sa propre direction (voir le deuxième article de cette série). Quand cela aussi échoua, il infiltra et essaya de prendre l'Internationale elle-même, surtout au moyen de son Alliance secrète. Pour ce projet comportant la destruction de l'organisation politique mondiale de la classe ouvrière, Bakounine réussit finalement à gagner l'appui chaleureux des classes dominantes.
« Toute la presse libérale et celle de la police se trouva ouvertement à ses côtés (de l'Alliance) ; dans sa diffamation personnelle du Conseil général, elle fut soutenue par les soi-disant réformateurs de tous les pays. » ([20] [2753])
La déloyauté envers toutes les classes haïes de la société
Bien que cherchant leur appui, Bakounine n'a jamais été simplement un agent du tsarisme, de la franc-maçonnerie, de la « Ligue pour la Paix », de la presse ou de la police occidentales. Comme tous les déclassés, il n'avait pas plus de loyauté envers les classes dominantes qu'envers les classes exploitées de la société. Au contraire, son ambition était de manipuler et de tromper pareillement la classe ouvrière et la classe dominante afin de réaliser ses ambitions personnelles et prendre sa revanche sur la société comme un tout. C'est pour cela que les classes dominantes, parfaitement au courant de ce fait, utilisèrent Bakounine chaque fois qu'il leur convenait mais ne lui firent jamais confiance, et furent ravies de l'abandonner à son sort aussitôt qu'il devint inutile. Ainsi, dès qu'il fut démasqué publiquement par l'Internationale, sa carrière politique s'acheva.
Bakounine avait une véritable et violente haine contre les classes dominantes féodale et capitaliste. Mais, comme il haïssait encore plus la classe ouvrière, et globalement méprisait les exploités, il voyait la révolution et le changement social comme la tâche d'une petite élite déterminée de déclassés sans scrupule sous sa propre direction personnelle. Cette vision de la transformation sociale était nécessairement une absurdité fantaisiste et mystique puisqu'elle n'émanait d'aucune classe solidement enracinée dans la réalité sociale mais seulement des fantasmes vengeurs d'un élément étranger au prolétariat.
Surtout, comme tous les aventuriers politiques, Bakounine pensait changer la société non pas par la lutte de classe mais par l'habileté manipulatrice de la fraternité révolutionnaire : « ...pour la vraie révolution, il faut non des individus placés à la tête de la foule et qui la commandent, mais des hommes cachés invisiblement au milieu d'elle, reliant invisiblement par eux-mêmes une foule avec l'autre, et donnant ainsi invisiblement une seule et même direction, un seul et même esprit et caractère au mouvement. L'organisation secrète préparatoire n'a que ce sens là, et ce n'est que pour cela qu'elle est nécessaire. » ([21] [2754])
Une telle vision n'était pas nouvelle mais avait été développée, depuis la révolution française, au sein de la branche maçonnique des « Illuminés » qui devint par la suite spécialisée dans l'infiltration du mouvement ouvrier. Bakounine partageait la même idée aventurière de la politique et surtout de la « libération » personnelle, anarchique et totale, au moyen de la politique machiavélique de l'infiltration dans laquelle les différentes classes de la société sont jouées les unes contre les autres.
C'est pour cela que le projet politique de l'Alliance était d'infiltrer et de prendre le pouvoir non seulement dans l'Internationale mais aussi dans les organisations de la classe dominante.
Ainsi, dans le paragraphe 14 de son Catéchisme révolutionnaire, Bakounine nous dit : « Un révolutionnaire doit pénétrer partout, dans la haute classe comme dans la moyenne, dans la boutique du marchand, dans l'église, dans le palais aristocratique, dans le monde bureaucratique, militaire et littéraire, dans la troisième section (police secrète), et même dans le palais impérial. »
Les statuts secrets de l'Alliance déclarent : « Tous les frères internationaux se connaissent. Il ne doit jamais exister de secret politique entre eux. Aucun ne pourra faire partie d'une société secrète quelconque sans le consentement positif de son comité, et au besoin, quand celui-ci l'exige, sans celui du comité central. Et il ne pourra en faire partie que sous la condition de leur découvrir tous les secrets qui pourraient les intéresser soit directement soit indirectement. »
Le rapport de la Commission du congrès de La Haye commente ce passage comme suit : « Les Pietri et les Stieber n'emploient comme mouchards que des gens inférieurs et perdus ; en envoyant ses faux frères dans les sociétés secrètes, pour en trahir les secrets, l'Alliance impose le rôle d'espion aux hommes-mêmes qui, dans son plan, doivent prendre la direction de la "révolution universelle". »
L'essence de l'aventurisme politique
Tout au long de son histoire, le mouvement ouvrier a été affaibli par les réformistes et les opportunistes petits-bourgeois et parfois par des carriéristes effrontés qui ne croyaient pas à l'importance ou au futur du mouvement ouvrier et qui ne s'en souciaient pas. L'aventurier politique, au contraire, est convaincu que le mouvement ouvrier est d'importance historique. Sur ce point, il reprend à son compte cette idée essentiel du marxisme révolutionnaire. C'est pour cette raison qu'il rejoint le mouvement ouvrier. Un aventurier n'est attiré ni par la monotonie grise du réformisme ni par la médiocrité d'un bon boulot. Il est, au contraire, quelqu'un de déterminé à jouer un rôle historique. Cette grande ambition distingue l'aventurier du petit-bourgeois carriériste et opportuniste.
Alors que le révolutionnaire rejoint le mouvement ouvrier afin de l'aider à réaliser sa mission historique, l'aventurier le rejoint pour que celui-ci serve sa propre mission « historique ». C'est ce qui distingue nettement l'aventurier du révolutionnaire prolétarien. L'aventurier n'est pas plus révolutionnaire que le carriériste ou le réformiste petit-bourgeois. La différence est que l'aventurier a une vision de l'importance historique du mouvement ouvrier. Mais il s'y rattache d'une manière complètement parasitaire.
L'aventurier est en général un déclassé. Il y a de nombreux individus de ce type au sein de la société bourgeoise, avec de grandes ambitions et avec une très haute opinion de leurs propres capacités, mais qui sont incapables de réaliser leurs hautes ambitions au sein de la classe dominante. Pleins d'amertume et de cynisme, de telles personnes glissent souvent vers le lumpen-prolétariat menant une existence de criminel ou de bohème. D'autres se révèlent comme une force de travail idéale pour l'Etat comme informateur ou agent provocateur. Mais, au sein de ce magma de déclassés, il y a quelques individus d'exception ayant le talent politique pour reconnaître que le mouvement ouvrier peut leur donner une seconde chance. Ils peuvent essayer de s'en servir comme tremplin pour obtenir renommée et importance et prendre ainsi une revanche sur la classe dominante qui est, en réalité, l'objet de leurs efforts et de leurs ambitions. De telles personnes sont constamment pleines de ressentiments face au manque de reconnaissance, par la société en général, de leur supposé génie. En même temps, elles sont fascinées, non pas par le marxisme ou le mouvement ouvrier mais par le pouvoir de la classe dominante et ses méthodes de manipulation.
Le comportement de l'aventurier est conditionné par le fait qu'il ne partage pas le but du mouvement qu'il a rejoint. Evidemment, il doit cacher son projet personnel réel au mouvement comme un tout. Seuls ses plus proches disciples peuvent être amenés à avoir une idée de son attitude réelle envers le mouvement.
Comme nous l'avons vu dans le cas de Bakounine, il y a une tendance inhérente chez les aventuriers politiques à collaborer en secret avec les classes dominantes. En réalité, une telle collaboration appartient à l'essence même de l'aventurisme. Sinon, comment l'aventurier est-il supposé accomplir son « rôle historique » ? Sinon, comment peut-il s'affirmer vis à vis de la classe dont il se sent rejeté ou ignoré ? En fait, c'est seulement la bourgeoisie qui peut accorder l'admiration et la reconnaissance que recherche l'aventurier et que la classe ouvrière ne va pas lui donner.
Certains des aventuriers les plus connus dans le mouvement ouvrier étaient aussi, comme Malinovsky, des agents de la police. Mais en général, les aventuriers ne travaillent pas directement pour l'Etat mais pour eux-mêmes. Quand les bolchéviks ouvrirent les archives de la police politique russe, l'Okhrana, ils trouvèrent les preuves que Malinosky était un agent de la police. Mais aucune preuve n'a été trouvée pour ce qui est de Bakounine. Marx et Engels n'ont jamais accusé Bakounine ou Lassalle d'être des agents appointés de l'Etat. Et même jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune preuve qu'ils l'aient été.
Mais, comme Marx et Engels l'ont mis en évidence, l'aventurier politique n'est pas moins mais plus dangereux pour les organisations prolétariennes que le commun des agents de la police. C'est la raison pour laquelle les agents découverts au sein de l'Internationale furent rapidement exclus et dénoncés sans grande incidence pour le travail de celle-ci, alors que la découverte des activités de Bakounine a duré plusieurs années et a menacé l'existence même de l'organisation. Il n'est pas difficile, pour des communistes, de comprendre qu'un informateur de la police est leur ennemi. L'aventurier, au contraire, dans la mesure où il a travaillé pour son propre compte, sera toujours défendu par le sentimentalisme petit-bourgeois, comme le montre le triste exemple de Mehring.
L'histoire montre à quel point ce sentimentalisme est dangereux. Tandis que Bakounine et Lassalle (deux cas semblables) ou les « national-bolchéviks » autour de Laufenberg et Wollfheim, à la fin de la 1re guerre mondiale à Hambourg, passèrent des accords secrets avec la classe dominante contre le mouvement ouvrier, plusieurs autres « grands » aventuriers rejoignirent carrément les rangs de la bourgeoisie : Parvus, Mussolini, Pilsudski, Staline et d'autres.
L'aventurier et le mouvement marxiste
Bien avant la fondation de la 1re Internationale, le mouvement marxiste avait développé un tableau complet de l'aventurisme politique comme phénomène au sein de la classe dominante. Cette analyse fut faite surtout en relation avec Louis Bonaparte, « Empereur » de France de 1852 à 1870. Dans la lutte contre Bakounine, le marxisme a développé tous les éléments essentiels d'un tel phénomène dans le mouvement ouvrier, cependant sans en utiliser la terminologie. Dans le mouvement ouvrier allemand, le concept de l'aventurisme fut développé dans la lutte contre le dirigeant lassallien Schweitzer qui, en collaboration avec Bismarck, travailla au maintien de la scission au sein du parti ouvrier. Dans les années 1880, Engels et d'autres marxistes dénoncèrent l'aventurisme politique des dirigeants de la « Social Democratic federation » en Grande-Bretagne et comparèrent leur comportement à celui des bakouninistes. A partir de là, le mouvement ouvrier dans son ensemble commença à s'approprier cette notion malgré l'existence d'une résistance opportuniste. Dans le mouvement trotskiste d'avant la seconde guerre mondiale, elle s'avéra être une nouvelle fois une arme importante pour la défense de l'organisation, trouvant une claire illustration dans les cas de Molinier et autres.
Aujourd'hui, dans le cadre de la phase de décomposition du capitalisme avec l'accélération sans précédent du processus de déclassement et de lumpenisation qui touche la société, face à l'offensive que mène la bourgeoisie contre le milieu révolutionnaire, en particulier par l'utilisation du parasitisme, il est vital, pour les organisations politiques du prolétariat, de se réapproprier la conception marxiste de l'aventurisme afin d'être le mieux armé pour le démasquer et le combattre.
Kr.
[21] [2775]. Les principes de la révolution, cité dans le rapport du Congrès de La Haye, ibid.
Conscience et organisation:
- La première Internationale [1847]
Approfondir:
- Questions d'organisation [2321]
Heritage de la Gauche Communiste:
Le communisme n'est pas un bel idéal mais une nécessité matérielle [15° partie]
- 3960 reads
1895-1905: LA PERSPECTIVE
REVOLUTIONNAIRE OBSCURCIE PAR LES ILLUSIONS PARLEMENTAIRES
A la fin du dernier article de cette série, nous avons examiné le principal danger posé aux partis sociaux-démocrates agissant au zénith du développement historique du capitalisme: le divorce entre la lutte pour des réformes immédiates et le but général du communisme. Le succès grandissant de ces partis, à la fois en gagnant à leur cause un nombre sans cesse croissant d'ouvriers et en arrachant des concessions à la bourgeoisie à travers les luttes parlementaires et syndicales, était accompagné, et de fait contribua pour une part au développement des idéologies du réformisme - qui réduit le rôle du parti des ouvriers à la défense et l'amélioration immédiate de leurs conditions de vie - et du gradualisme selon lequel le capitalisme peut être aboli par un processus entièrement pacifique de l'évolution de la société. D'un autre côté, la réaction contre la menace réformiste de la part de certains courants révolutionnaires représentait un recul vers des visions fausses, sectaires ou utopiques qui n'avaient que peu ou pas du tout à voir avec la lutte défensive de la classe ouvrière et ses buts révolutionnaires ultimes.
Le présent article, qui conclut une première partie sur le développement du programme communiste dans la période d’ascendance du capitalisme, examine de façon plus détaillée comment la perspective de la révolution communiste fut obscurcie pendant cette période par la polarisation sur la question-clé de la conquête du pouvoir par le prolétariat et sur le pays-phare qu'était l'Allemagne dont le mouvement ouvrier était fier d’y avoir le plus grand parti social-démocrate au monde.
Nous avons montré à plusieurs reprises dans cette série d’articles que le combat contre cette forme d’opportunisme qu'est le réformisme était un élément constant de la lutte marxiste pour un programme révolutionnaire et une organisation chargée de le défendre. C'était notamment le cas avec le parti allemand fondé en 1875 et produit de la fusion entre les fractions lassallienne et marxiste du mouvement ouvrier. La même année, Marx avait écrit la Critique du Programme de Gotha ([1] [2776]) afin de combattre les concessions faites par les marxistes aux lassalliens.
En rédigeant la Critique du Programme de Gotha, Marx s’appuyait sur l'expérience de la Commune de Paris qui avait très clairement montré la manière dont le prolétariat devait assumer le pouvoir politique: non à travers une conquête pacifique de l'ancien Etat mais par sa destruction et l'établissement de nouveaux organes de pouvoir directement contrôlés par les ouvriers en armes.
Ceci ne signifiait pas que, depuis 1871, le courant marxiste avait atteint une clarté définitive sur cette question. Dès l'origine, la lutte pour le suffrage universel et celle pour la représentation de la classe ouvrière su parlement avaient été des questions-clé du mouvement ouvrier organisé. Ces luttes représentaient le but premier des Chartistes, en Grande-Bretagne, que Marx considérait comme le premier parti politique de la classe ouvrière. On peut aisément comprendre que, ayant longtemps mené le combat pour le suffrage universel contre la résistance de la bourgeoisie - qui, à l'époque, le considérait comme une menace à son ordre - les révolutionnaires eux-mêmes aient pensé que la classe ouvrière, représentant la majorité de la population, était capable d’arriver au pouvoir à travers les institutions parlementaires. Ainsi, au Congrès de l’Internationale à la Haye en 1872, Marx fit un discours dans lequel il était encore prêt à estimer possible, dans les pays ayant une constitution plus démocratique comme la Grande-Bretagne, l’Amérique et la Hollande, que la classe ouvrière « puisse atteindre son but par des mayens pacifiques. »
Néanmoins, Marx ajouta tout de suite que « dans la plupart des pays continentaux le levier de la révolution devra être la force ; un recours à la force sera nécessaire un jour pour établir l'autorité des ouvriers. » De plus, comme Engels l’a argumenté dans son introduction du premier volume du Capital, même si les ouvriers parvenaient au pouvoir au moyen du parlement, ils auraient certainement à faire face à une « rébellion pro-esclavagiste » qui nécessiterait à nouveau le « levier de la force ». En Allemagne, pendant la période des lois antisocialistes introduites par Bismarck en 1878, la vision révolutionnaire de la conquête du pouvoir l'emportait sur les charmes du pacifisme social. Nous avons déjà amplement démontré la conception radicale du socialisme contenue dans le livre de Bebel La femme et le socialisme ([2] [2777]). En 1881, dans un article du Der Sozialdemokrat du 6 avril 1881, Karl Kautsky défendait la nécessité de « détruire 1‘Etat bourgeois » et de « créer un nouvel Etat » ([3] [2778]). Dix ans plus tard, en 1891, Engels écrivait son introduction à La Guerre Civile en France qui s'achevait par un message sans ambiguïté adressé à tous les éléments non révolutionnaires qui avaient commencé d'infiltrer le parti :
« Le philistin social-démocrate a été récemment saisi d'une terreur salutaire en entendant prononcer le mot de dictature du prolétariat. Eh bien, messieurs, voulez-vous savoir de quoi cette dictature a l'air ? Regardez la Commune de Paris. C'était la dictature du prolétariat. » La même année, il provoque un chahut dans le SPD en publiant finalement la Critique du Programme de Gotha, que Marx et lui-même avaient décidé de ne pas publier en 1875. Le parti était sur le point d’adopter un nouveau programme (qui allait être connu sous le nom du Programme d’Erfurt) et Engels voulait être sûr que le nouveau document serait enfin débarrassé de toute influence lassallienne. ([4] [2779])
L'hydre réformiste relève la tête
Le souci d’Engels en 1891 était de montrer qu'une aile opportuniste « philistine » était déjà en train de prendre pied dans le parti (en fait elle était présente depuis le début).
Mais, si le courant révolutionnaire et les conditions d'illégalité imposées par les lois antisocialistes, avaient tenu cette aile à distance pendant les années 1880, celle-ci allait devenir de plus en plus influente et hardie dans la décennie qui suivit. La première expression majeure de cela fut la campagne, au début da années 1890, menée par Vollmar et la branche bavaroise du SPD, qui réclamait une politique « pratique » sur l'agriculture, une politique de « socialisme d’Etat », et lançait un appel à l’Etat des Junkers pour introduire une législation au profit de la paysannerie. Son appel en faveur de la paysannerie mettait en cause le caractère de classe prolétarien du parti. Cette « rébellion de la droite » fut vaincue entre autres grâce à la polémique vigoureuse menée par Karl Kautsky. Mais en 1896, Edouard Bernstein publia ses thèses « révisionnistes »rejetant ouvertement la théorie marxiste des crises, appelant le parti à abandonner ses prétentions et à se déclarer » le parti démocratique de la réforme sociale ». Ses articles ont d'abord été publiés dans Die Neue Zeit, la revue théorique du parti ; plus tard ils furent publiées dans un livre dont le titre anglais est Evolutionary Socialism. Pour Bernstein, la société capitaliste pouvait se développer pacifiquement et graduellement vers le socialisme. De ce fait, nul besoin de perturbations révolutionnaires violentes et d'un parti défenseur de l'intensification de la lutte de classe !
Peu après, survint le cas Millerand en France: pour la première fois, un député socialiste faisait son entrée dans un cabinet capitaliste.
Ce n'est pas le lieu ici d'entreprendre une analyse en profondeur des raisons qui ont permis le développement du réformisme pendant cette période. Plusieurs facteurs agissaient simultanément :
- L'abrogation des lois antisocialistes qui a permis au SPD d'entrer dans l'arène légale et de se développer rapidement en nombre et influence ; mais son action dans le cadre des normes de la légalité bourgeoise a nourri des illusions sur les possibilités de la classe ouvrière d'utiliser ces normes à son avantage.
- Cette période a aussi vu un afflux, dans le parti, d'intellectuels petit-bourgeois qui avaient une certaine inclination « naturelle » envers des idées de réconciliation entre les classes antagoniques de la société capitaliste.
- Nous pouvons aussi évoquer les limites « nationales » d'un mouvement révolutionnaire qui, bien que fondé sur les principes de l'internationalisme prolétarien, était encore largement organisé en partis nationaux ; c'était une porte ouverte à l'adaptation opportuniste aux besoins de l’Etat-nation.
- Enfin, la mort d’Engels, en 1895, a enhardi ceux qui voulaient édulcorer l'essence révolutionnaire du marxisme, notamment Bernstein qui avait été un des collaborateurs les plus proches de celui-ci.
Tous ces facteurs ont joué leur rôle mais, fondamentalement, le réformisme était le produit des pressions émanant de la société bourgeoise dans une période de croissance et de prospérité économiques impressionnantes au sein de laquelle la perspective d'un effondrement capitaliste et celle de la révolution prolétarienne semblaient s'évanouir dans un horizon lointain. En somme, d'organisation essentiellement orientée vers un futur révolutionnaire, la social-démocratie se transformait graduellement en une organisation fixée sur le présent et sur l'obtention d'améliorations immédiates des conditions de vie de la classe ouvrière. Le fait que de telles améliorations étaient encore possibles faisait qu'il semblait de plus en plus raisonnable de penser que le socialisme pouvait être atteint subrepticement par l'accumulation de ces améliorations et la démocratisation graduelle de la société bourgeoise.
Bernstein n'avait pas tout à fait tort quand il disait que ses idées n'étaient que l'émanation de ce que le parti était réellement. Mais il avait tort en pensant que c'était tout le parti qui était ou pouvait être réformiste. La preuve en est que sa tentative d'éliminer le marxisme a été vigoureusement combattue par les courants révolutionnaires. Ceux-ci ont eu la force d'imposer le fait qu'un parti révolutionnaire, quel que soit le niveau de sa lutte pour la défense immédiate des intérêts de la classe ouvrière, ne pouvait garder son caractère prolétarien que s'il poursuivait activement la destinée révolutionnaire de cette classe. La réponse de Luxemburg à Bernstein (Réforme ou Révolution) est à juste titre reconnue comme la plus percutante contre cette attaque au marxisme. Mais à ce stade, elle n'était sûrement pas la seule: toutes les figures majeures dans le parti, entre autres Kautsky et Bebel, apportèrent leurs propres contributions dans le combat pour préserver le parti du danger révisionniste.
A priori, ces réponses mirent les révisionnistes en déroute: le rejet des thèses de Bernstein fut confirmé par tout le parti à la Conférence de Dresde en 1903. Mais, comme l'histoire allait le montrer si tragiquement en 1914, les pressions réformistes agissant sur la social-démocratie furent plus fortes que les plus claires résolutions de congrès. Les révolutionnaires eux-mêmes, jusqu'aux plus clairs d'entre eux, ne furent pas immunisés contre les illusions démocratiques propagées par les réformistes. Dans les réponses à ces dentiers, les marxistes ont fait beaucoup d'erreurs qui allaient être autant de fissures dans la cuirasse du parti prolétarien, fissures à travers lesquelles l'opportunisme a pu répandre son influence insidieuse.
Les erreurs d'Engels et la critique de Luxemburg
En 1895, Engels publia, dans le journal du SPD Vorwarts, une introduction su livre de Marx Les luttes de classes en France, ce dernier développant l'analyse des événements de 1848. Dans son article, Engels argumente tout à fait correctement que l'époque où les révolutions pouvaient être accomplies par des minorités de la classe exploitée, en utilisant seulement les méthodes des batailles de rue et des barricades, était terminée et que la future conquête du pouvoir ne pouvait être que l’œuvre d'une classe ouvrière consciente et organisée massivement. Cela ne voulait pas dire qu’Engels rejetait les combats de rue et les barricades et qu'il ne les considérait pas comme faisant partie d'une stratégie révolutionnaire plus large. Mais, ces précisions furent supprimées par l'éditeur du Vorwarts. Engels protesta vivement dans une lettre adressée à Kautsky : « A ma grande surprise, je lis aujourd’hui dans le Vorwarts un extrait tiré de mon "Introduction", imprimée à mon insu et arrangée de telle sorte qu'on me fait apparaître comme un adorateur pacifique à tout prix de la légalité. » ([5] [2780])
Le coup monté vis-à-vis d’Engels fonctionna parfaitement : sa lettre de protestation ne fut pas publiée (elle ne l’a été qu'en 1924) et, durant ce laps de temps, les opportunistes ont pu utiliser pleinement son « Introduction » pour faire de lui leur mentor politique. D'autres, qui en général aiment à se présenter comme des révolutionnaires enragés, ont utilisé le même article pour justifier leur thèse selon laquelle Engels est devenu un vieux réformiste à la fin de sa vie et qu'il existe un vrai gouffre entre les visions de Marx et d'Engels sur ce point comme sur beaucoup d'autres.
Mais au delà du tripatouillage du texte par les opportunistes, un problème persistait. II fut mis en évidence par Rosa Luxemburg dans son dernier discours-lors du congrès de fondation du KPD en 1918. II est vrai qu'à ce moment-là, Luxemburg ne savait pas que les opportunistes avaient dénaturé les mots d'Engels. Mais ceci dit, elle trouva des faiblesses importantes dans certains articles qu'elle n’hésita pas, avec son style caractéristique, à soumettre à une critique marxiste rigoureuse.
Le problème posé à Rosa Luxemburg était le suivant : le nouveau parti communiste était en tain de se constituer. La révolution était dans les rues, l'année se désintégrait, les conseils d'ouvriers et de soldats se multipliaient à travers le pays et le marxisme « officiel » du parti social-démocrate - qui avait encore une énorme influence au sein de la classe en dépit du rôle que sa direction opportuniste avait joué durant la guerre - en appelait à l'autorité d’Engels pour justifier l'utilisation contre-révolutionnaire de la démocratie parlementaire comme antidote à la dictature du prolétariat.
Comme nous l'avons dit, Engels n'avait pas eu tort de mettre en avant que la vieille tactique de « 48 » du combat de rue plus ou moins désorganisé ne pouvait plus désormais être la méthode pour la prise de pouvoir par le prolétariat. Il a montré qu'il était impossible pour une minorité déterminée de prolétaires de s'attaquer aux armées modernes de la classe dominante. En effet, la bourgeoisie était tout à fait prête à provoquer de telles escarmouches afin de justifier une répression massive contre l'ensemble de la classe ouvrière (en fait, ce fut précisément la tactique qu'elle utilisa contre la révolution allemande quelques semaines après le congrès du KPD, en poussant les ouvriers de Berlin dans un soulèvement prématuré qui conduisit à la décapitation des forces révolutionnaires, y inclus Luxemburg elle-même). En conséquence, il soutint: «Un combat de rue ne peut donc à l'avenir être victorieux que si cette infériorité de situation est compensée par d'autres facteurs. Aussi se produira-t-il plus rarement au début d'une gronde révolution qu'au cours du développement de celle-ci, et il faudra l'entreprendre avec des forces plus grandes. Mais alors, celles-ci, comme dans l'ensemble de la grande Révolution française, le 4 septembre et le 31 octobre 1870 à Paris, préféreront sans doute l'attaque ouverte à la tactique passive de la barricade. » ([6] [2781]) En un sens, c'est précisément ce que la révolution russe a accompli. En se constituant lui-même en tant que force irrésistible organisée, le prolétariat y a été capable de renverser l’Etat bourgeois dans une insurrection bien planifiée et relativement sans effusion de sang en octobre 1917.
Le vrai problème est la façon avec laquelle Engels envisageait ce processus. Rosa Luxemburg avait devant les yeux l'exemple vivant de la révolution russe et son équivalent en Allemagne, où le prolétariat avait développé son auto-organisation à travers le processus de la grève de masse et la formation des soviets. Ces derniers étaient les formes d'action et d'organisation qui non seulement correspondaient à la nouvelle époque des guerres et des révolutions mais aussi, dans un sens plus profond, exprimaient la nature fondamentale du prolétariat comme classe qui ne peut affamer son pouvoir révolutionnaire qu'en faisant éclater en morceaux les règles et les institutions de la société de classes. La faiblesse fatale de l'argumentation d’Engels, en 1895, était d'insister sur le fait que le prolétariat devait construire ses forces à travers l'utilisation des institutions parlementaires, c'est-à-dire à travers des organismes spécifiques de cette même société bourgeoise qu'il avait à détruire. Là, Luxemburg part de ce qu’Engels a vraiment dit et elle critique ses véritables insuffisances.
« Ensuite il expose comment la situation a évoluée depuis, et en arrive à la question pratique des tâches du Parti en Allemagne. "La guerre de 1870-71 et la défaite de la Commune ont transporté momentanément le centre de gravité du mouvement ouvrier de la France vers l'Allemagne, comme Marx l’a prédit. A la France, il fallait naturellement des années pour se remettre de la saignée du mois de mai 1871. En Allemagne cependant, où l'avalanche des milliards français fit croître l'industrie comme dans l'atmosphère d'une serre chaude, la social-démocratie se développa bien plus vite et d'une manière plus tenace que le capitalisme lui-même. L'intelligence avec laquelle les ouvriers allemands utilisèrent le suffrage universel, introduit en 1866, a porté rapidement ses fruits. Tout le monde peut constater le développement extraordinaire du parti par des chiffres indiscutables."
Vient ensuite la fameuse énumération marquant l'accroissement des voix social-démocrates, d'une élection au Reichstag à l'autre, jusqu'à en compter des millions ; et voici ce qu'en conclut Engels : "Cette bonne utilisation du suffrage universel entraîna un tout nouveau mode de lutte du prolétariat, mode qui se développa rapidement. On s'aperçut que les administrations d’Etat dans lesquelles s'organise le pouvoir de la bourgeoisie offrent à la classe ouvrière d'autres moyens de combattre ces mêmes organisations d’Etat. On participa aux élections des parlements provinciaux, des conseils municipaux, des conseils de prud'hommes, on disputa à la bourgeoisie chaque poste. En toutes ces occasions, une bonne partie du prolétariat dit son mot. Et ainsi la bourgeoisie et le gouvernement en vinrent à craindre bien plus faction légale que faction illégale du parti ouvrier, bien plus les résultats de l'élection que ceux de la révolte". » ([7] [2782])
Luxemburg, tout en comprenant le rejet d’Engels de la vieille tactique du combat de rue, n'a pas hésité à mettre en avant les dangers inhérents à cette approche.
« Cette conception eut deux conséquences :
1°La lutte parlementaire, antithèse de l'action révolutionnaire directe du prolétariat, fut considérée comme seul moyen de la lutte de classe. C'était la chute dans le parlementarisme pur et simple.
2° L'organisation la plus puissante de l’Etat, son instrument le plus effectif resta complètement hors de cause. On prétendit conquérir le parlement, le faire servir à des fins prolétariennes, et l'armée, la masse des prolétaires en uniforme, fut supposée parfaitement inattaquable, comme si celui qui est soldat devait être dans tous les cas, et rester une fois pour toutes, le défenseur inébranlable de la classe dominante. Cette erreur jugée, du point de vue de nos expériences d'aujourd'hui, serait incompréhensible de la part d'un homme ayant une responsabilité à la tête de notre mouvement, si l'on ne savait pas dans quelles circonstances défait ce document historique a été rédigé. » ([8] [2783])
L'expérience de la vague révolutionnaire avait définitivement réfuté le scénario d’Engels. Loin d'être alarmée de l'utilisation de faction « constitutionnelle » par le prolétariat, la bourgeoisie avait compris que la démocratie parlementaire était son rempart le plus fiable contre le pouvoir des conseils ouvriers. Toute faction de la social-démocratie (conduite par d'éminents parlementaires parmi les plus réceptifs aux influences bourgeoises) n'avait pour but que de persuader les ouvriers d'inféoder leurs propres organes de classe, les conseils, à l’assemblée nationale supposée plus « représentative N. Par ailleurs, la révolution en Russie et en Allemagne avait clairement révélé la capacité de la classe ouvrière, à travers son action et sa propagande révolutionnaires, à désintégrer les armées de la bourgeoisie et à gagner la masse des soldats à la cause de la révolution.
Ainsi Luxemburg n'a pas hésité à qualifier l'approche d’Engels de « bévue ». Mais elle n'a pas conclu de cela qu’Engels avait cessé d'être un révolutionnaire. Elle était convaincue qu'il aurait reconnu son erreur à la lumière de l'expérience la plus récente: « Tous ceux qui connaissent les travaux de Marx et d’Engels, tous ceux qui sont bien instruits de leur authentique esprit révolutionnaire qui a inspiré tous leurs enseignements et tous leur écrits, seront absolument sûrs qu'Engels aurait été le premier à protester contre la débauche de parlementarisme, contre le gaspillage des énergies du mouvement ouvrier, qui était caractéristique en Allemagne durant les décennies précédant la guerre. »
Luxemburg poursuivit en fournissant un cadre pour comprendre l'erreur faite par Engels : « Il y a soixante dix ans, lorsqu'on révisa les erreurs, les illusions de 1848, on croyait que le prolétariat avait un chemin infiniment long à parcourir jusqu'à ce que le socialisme puisse, devenir une réalité, c'est ce qui ressort de chaque ligne de la préface en question, qu'Engels a écrite en 1895. » En d'autres termes, Engels écrivait dans une période où la lutte directe pour la révolution n'était pas encore à l'ordre du jour ; l’effondrement de la société capitaliste n'était pas encore devenue une réalité tangible comme ce sera le cas en 1917. Dans de telles circonstances, il n'était pas possible pour le mouvement ouvrier de développer une vision totalement lucide de sa route vers le pouvoir. En particulier, la distinction nécessaire, conservée dans le Programme d’Erfurt, entre le programme minimum des réformes économiques et politiques et le programme maximum du socialisme, contenait le danger que ce dernier soit subordonné au premier; il en était de même pour l'utilisation du parlement qui avait représenté une tactique valable dans la lutte pour des réformes mais risquait de devenir une fin en soi.
Luxemburg a montré que même Engels n'avait pas été immunisé contre une certaine confusion sur ce point. Mais elle reconnaissait également que le vrai problème résidait dans les courants politiques qui incarnaient activement les dangers rencontrés par les partis sociaux-démocrates de cette période, c'est-à-dire les opportunistes et ceux qui les couvraient à la direction du parti. C'était en particulier ces derniers qui avaient consciemment manipulé Engels aboutissant à un résultat très éloigné de ses intentions : «Je dois vous rappeler le fait bien connu que la préface en question a été écrite par Engels sous une forte pression de la part du groupe parlementaire. A cette époque en Allemagne, au début des années quatre vingt dix après l'abrogation des lois antisocialistes, il se produisit un fort mouvement vers la gauche, le mouvement de ceux qui voulaient empêcher le parti d'être complètement absorbé dans la lutte parlementaire. Bebel et ses fidèles cherchaient des arguments convaincants, soutenus par la grande autorité d’Engels ; ils souhaitaient une formulation qui les aiderait à maintenir une main ferme sur les éléments révolutionnaires. » ([9] [2784]) Comme nous l'avons dit au début, le combat pour un programme révolutionnaire est toujours un combat contre l'opportunisme dans les rangs du prolétariat ; de même, l'opportunisme est toujours prêt à s'emparer de la moindre défaillance dans la vigilance et la concentration des révolutionnaires et utiliser leurs erreurs à ses propres fins.
Kautsky : l'erreur devient l'orthodoxie
« Entre les mains d'un Kautsky le "marxisme" servit à dénoncer et à briser toute résistance contre le parlementarisme... Toute résistance de cette sorte était excommuniée comme anarchisme, comme anarcho-syndicalisme, ou antimarxisme. Le marxisme officiel servit de couverture à toutes les déviations et à tous les abandons de la véritable lutte de classe révolutionnaire, à toute cette politique de semi position qui condamnait la social-démocratie allemande, et le mouvement ouvrier en général, y compris le mouvement syndical, à s'emprisonner volontairement dans les cadres et sur le terrain de la société capitaliste, sans volonté sérieuse de l'ébranler et de la faire sortir de ses gonds ». ([10] [2785]).
Nous ne faisons pas partie de cette école moderniste de pensée qui aime à présenter Karl Kautsky comme la source de tout ce qui était mauvais dans les partis sociaux-démocrates. Il est vrai que son nom est souvent associé à de profondes erreurs théoriques - telle sa théorie de la conscience socialiste comme produit des intellectuels, ou son concept d'ultra-impérialisme. Et de fait, Kautsky devint au bout du compte un renégat du marxisme, pour employer le propre terme de Lénine, surtout à cause de son rejet de la révolution d'Octobre. De telles erreurs font qu'il est souvent difficile de se rappeler que Kautsky était véritablement un marxiste avant de devenir un renégat. Tout comme Bebel, il avait défendu la continuité du marxisme à de nombreux moments cruciaux de la vie du parti. Mais comme Bebel, ainsi que beaucoup d'autres de sa génération, sa compréhension du marxisme révéla plus tard qu'elle souffrait d'un nombre significatif de faiblesses ; celles-ci, en retour, reflétaient des faiblesses plus répandues, des faiblesses du mouvement en général. Dans le cas de Kautsky, c'était avant tout son « destin » de devenir le champion d'une approche qui, au lieu de soumettre à la critique les erreurs contingentes du mouvement révolutionnaire du passé du fait des conditions matérielles changeantes, figea ces erreurs en une « orthodoxie »non contestable.
Comme nous l'avons vu, Kautsky ferrailla souvent contre les révisionnistes de droite dans le parti, d'où sa réputation de pilier du marxisme « orthodoxe ». Mais si nous regardons un peu plus profondément la façon dont il mena la bataille contre le révisionnisme, nous voyons aussi pourquoi cette orthodoxie était en réalité une forme de centrisme, une manière de concilier avec l'opportunisme ; et c'était le cas bien avant que Kautsky, qui se voulait à mi-chemin entre les « excès de droite et de gauche », ne revendique ouvertement le label de centriste. Les hésitations de Kautsky pour mener une lutte intransigeante contre le révisionnisme se sont révélées dès la parution des articles de Bernstein, quand son amitié personnelle avec ce dernier le fit hésiter quelques temps avant de lui répondre politiquement. Mais la tendance de Kautsky à concilier avec le réformisme est allée plus loin que cela comme le notait Lénine dans L Etat et la Révolution :
« Chose infiniment plus grave encore (que les hésitations de Kautsky dans sa lutte contre Bernstein) jusque dans sa polémique avec les opportunistes, dans sa manière de poser et de traiter le problème nous constatons maintenant, en étudiant l'histoire de la récente trahison de Kautsky envers le marxisme, une déviation constante vers l'opportunisme, précisément dans la question de 1’ Etat. » ([11] [2786]) Un des travaux que Lénine choisit pour illustrer cette déviation fut celui dont la forme est celle d'une réfutation en règle du révisionnisme mais dont le véritable contenu révèle sa tendance croissante à s'en accommoder. Il s'agit de son livre La révolution sociale, publié en 1902.
Dans ce livre, Kautsky nous fournit quelques arguments marxistes très solides contre les principales « révisions » mises en avant par Bernstein et ses adeptes. Contre leur argumentation (qui nous est si familière aujourd’hui) - selon laquelle le développement des classes moyennes mène à une atténuation des antagonismes de classe, ce qui revient à dire que le conflit entre la bourgeoisie et le prolétariat peut se résoudre dans le cadre de la société capitaliste - Kautsky répondit en insistant, comme Marx l'avait fait, sur le fait que l'exploitation de la classe ouvrière augmentait en intensité, que l’Etat capitaliste devenait plus et non pas moins oppressif et que cela exacerbait plutôt que cela n'atténuait les antagonismes de classe : « plus... la classe dominante les soutient avec l'appareil d’Etat et l'emploie abusivement pour les desseins de l'exploitation et de l'oppression, plus l'animosité du prolétariat contre elles grandit, la haine de classe croît, et les efforts pour conquérir la machine d'Etat augmente en intensité. » ([12] [2787])
De même, Kautsky réfuta l'argumentation selon laquelle le développement des institutions rendait la révolution sociale superflue et que « par l'exercice des droits démocratiques dans la situation présente la société capitaliste s'avance graduellement et sans aucun heurt vers le socialisme. Par conséquent, la conquête révolutionnaire du pouvoir politique par le prolétariat n'est pas nécessaire, et les efforts vers elle sont directement nuisibles, puisqu'il suffit qu'ils interfèrent lentement mais sûrement dans ce processus en cours .» ([13] [2788]) Kautsky affirma que ceci était une illusion parce que, s'il est vrai que le nombre des élus socialistes étaient en augmentation, « simultanément avec cela, la démocratie bourgeoise part en morceaux » ([14] [2789]) ; « le Parlement qui autrefois était un moyen défaire pression sur le gouvernement sur la route du progrès, devient de plus en plus le moyen d'annuler les petits progrès que /es conditions contraignent le gouvernement à faire. Dans la mesure où la classe qui domine à travers le parlementarisme est devenue superflue et même nuisible, la machine parlementaire perd toute signification .» ([15] [2790]) Cela montrait une grande perspicacité vis-à-vis des conditions qui se développeraient de plus en plus à mesure que le capitalisme approcherait de son époque de décadence qui mettraient en évidence le déclin du parlement même en tant que tribune de conflits inter-bourgeois (que le parti ouvrier pouvait parfois exploiter à son profit), sa transformation en une simple feuille de vigne masquant un appareil d’Etat de plus en plus bureaucratique et militariste. Kautsky reconnaissait même que, étant donné la vacuité des organes « démocratiques » de la bourgeoisie, l'arme de la grève - y inclus- la grève politique de masse dont les contours étaient déjà apparus en France et en Belgique - «jouera un grand rôle dans les combats révolutionnaires du futur. » ([16] [2791])
Cependant, Kautsky ne fut jamais capable de pousser ces arguments jusqu'à leur conclusion logique. Si le parlementarisme bourgeois était en déclin, si les ouvriers étaient en train de développer de nouvelles formes d'action comme la grève de masse, tous ces éléments étaient des signes de l'approche d'une nouvelle époque révolutionnaire dans laquelle l'axe central de la lutte de classe était en train de s'éloigner de façon définitive de l'arène parlementaire et de se placer sur le terrain de classe spécifique au prolétariat, dans les usines et la rue. En effet, loin de voir les implications du déclin du parlementarisme, Kautsky tira de cela la plus réactionnaire des conclusions, que la mission du prolétariat était de sauver et ranimer cette démocratie bourgeoise moribonde :
« Le parlementarisme... devient toujours plus sénile et impuissant, et ne peut retrouver une nouvelle jeunesse et force que lorsque, à l'instar de tout le pouvoir gouvernemental dans son ensemble, il sera conquis par le prolétariat renaissant et mis au service de son but. Le parlementarisme, loin de rendre la révolution inutilisable et superflue, a besoin d'une révolution pour être revivifier. » ([17] [2792])
Ces visions n'étaient pas, comme dans le cas d’Engels, en contradiction avec les nombreux autres arguments bien plus clairs. Ils constituaient un fil rouge dans la pensée de Kautsky, renvoyant en partie à ses commentaires sur le Programme d’Erfurt au début des années 1890 et anticipant son œuvre bien connue Le chemin du pouvoir en 1910. Cette dernière œuvre scandalisa les réformistes déclarés avec son affirmation audacieuse selon laquelle « l'ère révolutionnaire a commencé », mais elle maintenait la même vision conservatrice sur la prise du pouvoir. Commentant ces deux travaux dans L'Etat et la Révolution,Lénine était particulièrement frappé par le fait que, nulle part dans ces livres, Kautsky ne défendait la
position classique du marxisme sur la nécessité de détruire l'appareil d`Etat bourgeois et de le remplacer par un Etat-Commune :
« Dans cette brochure (La Révolution Sociale), il est partout question de la conquête du pouvoir d’Etat, sans plus ; c'est-à dire que l'auteur a choisi une formule qui est une concession aux opportunistes, puisqu'elle admet la conquête du pouvoir sans la destruction de la machine d’Etat. Kautsky ressuscite en 1902 précisément ce qu'en 1872 Marx déclarait "périmé" dons le programme du Manifeste communiste. »
Avec Kautsky, et avec le marxisme officiel de la deuxième Internationale, le parlementarisme était devenu un dogme immuable.
La conquête de l'économie capitaliste
La tendance croissante du parti social-démocrate à se présenter comme candidat au gouvernement, à vouloir prendre les rênes de l’Etat bourgeois, allait avoir des implications profondes également sur son programme économique. En toute logique, ce dernier apparaissait de plus en plus non comme un programme de destruction du capital, visant à saper les fondations de la production capitaliste, mais comme une série de propositions « réalistes » pour s'emparer de l’économie bourgeoise et la gérer « au nom du prolétariat ». Ce n'était pas un hasard si le développement de cette vision, qui contraste fortement avec les idées de la transformation socialiste défendues dans les décennies précédentes par les Engels, Bebel et Morris ([18] [2793]), coïncidait avec les premières expressions du capitalisme d’Etat qui accompagnaient la montée de l'impérialisme et du militarisme. II est vrai que Kautsky a critiqué la déviation du « socialisme d’Etat » revendiquée par des gens comme Vollmar mais ses critiques n'allèrent pas à la racine de la question. La polémique de Kautsky s'opposait aux programmes qui en appelaient aux gouvernements existants, bourgeois ou absolutistes, pour qu'ils introduisent des mesures « socialistes » telles que la nationalisation de la terre. Mais il ne voyait pas qu'un programme d'étatisation défendu par un gouvernement démocratique resterait également à l'intérieur des limites du capitalisme. Ainsi, dans La révolution sociale, il nous dit que « la domination politique du prolétariat et la perpétuation du système capitaliste de production sont irréconciliables. » ([19] [2794]) Mais les passages qui suivent cette affirmation hardie donnent le vrai sens de la vision de Kautsky sur la « transformation socialiste » : « La question, alors, surgit de savoir quels sont les acheteurs qui sont à la disposition des capitalistes quand ils veulent vendre leurs entreprises. Une partie des usines, des mines etc., pourrait être vendue directement aux ouvriers qui y travaillent et ainsi pourrait fonctionner de façon coopérative ; une autre partie pourrait être vendue à des coopératives de distribution, et une autre encore à des communautés ou des Etats. II est clair cependant, que le capital trouverait ses acheteurs les plus nombreux et généreux dans les Etats ou municipalités, et pour cette raison la majorité des industries deviendrait la propriété des Etats et des municipalités. Que les sociaux-démocrates quand ils arriveraient au pouvoir s'efforceraient consciemment de pousser à cette solution est bien connu. » ([20] [2795]) Kautsky poursuit ensuite en expliquant que les industries les plus mûres pour la nationalisation sont celles où les trusts sont les plus développés et que « la socialisation (qui désigne en raccourci le transfert à la propriété nationale, municipale et coopérative) ira de pair avec la socialisation de la majeure partie du capital argent. Quand une usine ou une part de propriété terrienne est nationalisée, ses dettes sont aussi nationalisées, et les dettes privées deviennent des dettes publiques. Dans le cas d'une corporation, les actionnaires deviendront des porteurs de parts des obligations du gouvernement. » ([21] [2796])
A partir de passages comme ceux-là, on peut voir que, dans la « transformation socialiste » de Kautsky, toutes les catégories essentielles du capital demeurent: les moyens de production sont « vendus » aux ouvriers ou à l’Etat, le capital argent est centralisé dans les mains du gouvernement, les trusts « privés » laissent la place à des trusts nationaux ou municipaux etc. Ailleurs dans le même livre, Kautsky affirme explicitement le maintien des relations salariales dans un régime prolétarien :
« Je parle ici des salaires du travail. Quoi, va-t-on dire, il y aura des salaires dans la nouvelle société ? N'aurons-nous pas aboli le salariat et l'argent ? Ces objections seraient valables si la révolution sociale proposait d'abolir immédiatement l'argent. Je maintiens que ce sera impossible. L'argent est le moyen le plus simple connu jusqu'à présent qui assure, dans un mécanisme compliqué comme le processus productif moderne, avec sa division du travail énorme d'une portée considérable, la circulation des produits et leur distribution aux individus de la société. C'est le moyen qui permet à chacun de satisfaire ses besoins selon ses inclinations individuelles... En tant que moyen d'une telle circulation, l'argent sera indispensable en attendant quelque chose de mieux. » ([22] [2797])
Evidemment, il est vrai que le salariat ne peut être aboli en un jour. Mais il est par contre faux d'affirmer, comme Kautsky le fait dans ces passages cités, que les salaires et l'argent sont des formes neutres qu'on peut garder dans le « socialisme » jusqu'à ce que l'augmentation de la production mène à l'abondance pour tous Sur la base du salariat et de la production de marchandises, la production croissante est un euphémisme , pour l’accumulation du capital Cette accumulation du capital. qu'elle soit dirigée par l’Etat ou par des intérêts privés, signifie nécessairement la dépossession et l’exploitation des producteurs C'est pourquoi Marx, dans sa Critique du Programme de Gotha, affirme que la dictature prolétarienne aura à faire immédiatement des incursions dans la logique de l'accumulation en remplaçant les salaires et l'argent par un système de bons du travail.
Ailleurs, Kautsky insiste sur le fait que ces salaires « socialistes » sont fondamentalement différents des salaires capitalistes parce que, dans le nouveau système, la force de travail n'est plus une marchandise - sa thèse étant qu'il n'y a plus de marché pour la force de travail une fois que les moyens de production sont devenus propriété de l’Etat. Cet argument (qui était souvent utilisé, par les divers apologistes du modèle stalinien, pour prouver que l’URSS et ses rejetons ne pouvaient être capitalistes) a une tare fondamentale: il ignore la réalité du marché mondial qui fait de chaque économie nationale une unité capitaliste concurrentielle, quel que soit le niveau de suppression des mécanismes du marché à l'intérieur de cette unité.
Il est vrai, comme nous l'avons noté précédemment dans cette série d'articles, que Marx lui-même a écrit des textes qui induisent que la production socialiste pouvait exister à l'intérieur des frontières d'un Etat-nation. Le problème est que les propositions développées par la social-démocratie « officielle » au tout début du 20e siècle, en contradiction avec la démarche résolument internationaliste de Marx, étaient de plus en plus considérées comme faisant partie d'un programme « concret » applicable à chaque nation prise séparément. Cette vision « nationale » du socialisme commença même à être intégrée dans les programmes. On trouve ainsi la formulation suivante dans un autre travail de Kautsky à la même période, The Socialist republic ([23] [2798]) :
« ...une communauté capable de satisfaire ses besoins et rassemblant toutes ses industries nécessaires, doit avoir des dimensions très différentes de celles des colonies socialistes qui avaient été planifiées au début de notre siècle. Parmi les organisations sociales existantes aujourd'hui, il n y en a qu'une qui a les dimensions requises, qui peut être utilisée comme champ approprié pour l'établissement et le développement du Commonwealth socialiste ou coopératif: la Nation »
Mais la chose qui est peut-être la plus significative de la vision de Kautsky au sujet de la transformation socialiste, c'est la façon dont tout se passe d'une façon légale et ordonnée. Il passe plusieurs pages de sa brochure The Social Révolution à affirmer qu'il sera beaucoup mieux de dédommager les capitalistes, pour se les acheter, que de simplement les exproprier. Bien que ses écrits sur le processus révolutionnaire abordent l'utilisation des grèves et autres actions des ouvriers, son souci premier semble être que la révolution ne doit pas trop effrayer les capitalistes. Un des opposants réformistes de Kautsky au Congrès de Dresde de 1903, Kollo, a mis le doigt sur le problème de façon tout à fait pertinente quand il observait que Kautsky voulait une révolution sociale... sans violence. Mais ni le renversement du pouvoir politique de la classe capitaliste, ni l'expropriation économique des expropriateurs, peuvent se produire sans l'irruption impétueuse, violente mais extraordinairement créative des masses sur la scène de l'histoire.
Nous répétons qu'il n'est pas question de diaboliser Kautsky. Il était l'expression d'un processus plus profond: la gangrène opportuniste des partis sociaux-démocrates, leur incorporation graduelle dans la société bourgeoise et les difficultés que les marxistes avaient à comprendre et combattre ce danger. Sur le problème du parlementarisme, il est certain que, nulle part, une clarté parfaite ne pouvait être trouvée dans la période que nous avons étudiée. Dans Réforme ou révolution par exemple, Luxemburg a mené une attaque très édifiante sur les illusions parlementaires de Bernstein. Cependant, elle laisse subsister certaines lacunes sur la question, en particulier quand elle ne réussit pas à reconnaître la « bévue » dans l'introduction à Les luttes de classes en France d'Engels qu'elle fustigera en 1918. Un autre cas instructif est celui de William Morris: Dans les années 1880, Morris fit un certain nombre de mises en garde pertinentes contre le pouvoir corrupteur du parlement mais ses intuitions furent sapées par sa tendance au purisme ainsi qu'une incapacité à comprendre la nécessite, pour les socialistes, d'intervenir dans le combat quotidien de la classe et, à cette époque, d'utiliser les élections et le parlement comme des éléments centraux de cette lutte. Comme la plupart de ceux qui étaient très critiques avec le parlementarisme à cette époque, Morris était très perméable aux positions antiparlementaires atemporelles des anarchistes. Et, vers la fin de sa vie, en réaction aux ravages que l'anarchisme avait provoqués sur ses efforts de construire une organisation révolutionnaire,
Morris lui-même tomba dans l'emballement croissant pour la voie parlementaire vers le pouvoir.
Ce qui « manquait », durant ces années, c'était le véritable mouvement de la classe. Ce fut surtout le séisme de 1905 en Russie qui permit aux meilleurs éléments du mouvement ouvrier de discerner les vrais contours de la révolution prolétarienne et de dépasser les conceptions périmées et erronées qui avaient jusque-là obscurci leur vision. Le véritable crime de Kautsky a été de combattre bec et ongles contre ces clarifications, se présentant lui-même de plus en plus ouvertement comme un « centriste » dont la vraie bête noire n'était pas la droite révisionniste mais la gauche révolutionnaire telle qu'elle était incarnée par des figures comme Luxemburg et Pannekoek. Mais c'est une autre partie de l'histoire.
CDW.
[1] [2799] Voir Revue Internationale n° 79. Un thème central de la Critique du Programme de Gotha portait sur la défense du concept de dictature du prolétariat contre l'idée lassallienne de l' « Etat populaire » qui tendait à masquer son adaptation à l’Etat bismarckien existant.
[2] [2800] Voir Revue Internationale n° 83, 85 et 86.
[3] [2801] Cité dans Massimo Salvadori, Karl Kautsky and the Socialist Revolution, 1880- 1938, London 1979, p. 22.
[4] [2802] On doit dite que les efforts d’Engels pour pallier aux faiblesses du programme d’Erfurt ne furent pas globalement un succès. Engels reconnut clairement que le danger opportuniste avait été codifié en son sein : sa critique sur le projet de programme (lettre à Kautsky, le 29 juin 1891) contient la définition la plus claire de l'opportunisme qu'on puisse trouver dam les écrits d’Engels et Marx et son souci central était le fait que le programme, bien que contenant une bonne introduction générale marxiste sur la crise inévitable du capitalisme et la nécessite du socialisme, restait très flou sur les moyens pour le prolétariat d'arriver au pouvoir. II est particulièrement critique sur le fait que les ouvriers allemands puissent utiliser la version « prussienne » du parlement (« une feuille de vigne de l'absolutisme ») afin de prendre le pouvoir pacifiquement. D'un autre côté, dans le même texte, Engels reprend la vision selon laquelle, dans les pays les plus démocratiques, le prolétariat pourrait arriver au pouvoir à travers le processus électoral; et il ne fait pas une claire distinction entre la république démocratique et l’Etat Commune. A la fin, le document d'Erfurt,au lieu de montrer le lien entre les programmes minimum et maximum, fait apparaître un gouffre entre les deux. C'est pourquoi Luxemburg, dans son discours au Congrès de fondation du KPD en 1918, parle du programme de Spartakus comme étant « délibérément opposé »au programme d'Erfurt et non comme cherchant simplement à le remplacer.
[5] [2803] Engels, Selected Correspondence, p. 461
[6] [2804] Introduction à Les luttes de classes en France.
[7] [2805] Luxemburg, « Discours sur le Programme du Congrès de fondation du KPD. »
[8] [2806] Ibid.
[9] [2807] Traduit de l'anglais par nous.
[10] [2808] Luxemburg, « Discours sur le Programme du Congrès de fondation du KPD »
[11] [2809] Chapitre VI, 2, « Polémique de Kautsky avec les opportunistes ».
[12] [2810] The Social Revolution, Chicago, 1916, p. 36-7, traduit de l'anglais par nous.
[13] [2811] Ibid. p. 66.
[14] [2812] Ibid. p. 75.
[15] [2813] Ibid. p. 78-79.
[16] [2814] Ibid. p. 90.
[17] [2815] Ibid. p. 79-80.
[18] [2816] Voir Revue Internationale n° 83, 85 et 86.
[19] [2817] The Social Revolution, Chicago, 1916, p. 113, traduit de l'anglais par nous.
[20] [2818] Ibid., p. 113-114.
[21] [2819] Ibid., p. 116-117.
[22] [2820] Ibid., p. 129.
[23] [2821] Ce passage est tiré d'une version anglaise « traduite et adaptée pour l’Amérique »par Daniel De Leon (New-York, 1900); aussi nous ne sommes pas sûrs que les éléments repris ici soient totalement fidèles à l'original de Kautsky. Néanmoins la citation nous donne un avant-goût des conceptions développées dans le mouvement international de l'époque.
Conscience et organisation:
- La Seconde Internationale [1848]
Approfondir:
Questions théoriques:
- Communisme [492]
Heritage de la Gauche Communiste:
Revue Internationale no 89 - 2e trimestre 1997
- 3097 reads
Tensions imperialistes : la montee de l'imperialisme allemand
- 6748 reads
Aucun événement récent n'illustre de façon plus significative l'exacerbation des tensions impérialistes que l'arrivée de 3 000 soldats allemands en Bosnie. Sous prétexte de participer au « maintien de la paix » imposée par les Etats-Unis à Dayton, des troupes allemandes, rejoignant celles des rivaux français, anglais ou américains, ont été envoyées dans la zone de crise pour défendre les intérêts impérialistes de leur bourgeoisie nationale.
Aucun autre événement ne confirme plus clairement la montée de l'impérialisme de l'Allemagne depuis sa réunification nationale. Pour la première fois depuis la deuxième guerre mondiale, la bourgeoisie allemande envoie ses forces armées à l'extérieur avec pour mandat de faire la guerre. Pendant un demi-siècle, la bourgeoisie des deux Etats allemands créés après 1945 n'avait pas eu le droit d'intervenir militairement à l'étranger pour défendre ses intérêts impérialistes. Toute exception à cette règle générale, imposée par l'OTAN pour l'Ouest et par le Pacte de Varsovie pour l'Est, devait être décidée non à Bonn ou à Berlin Est mais à Washington ou à Moscou. En réalité, la seule implication de troupes allemandes dans des actions militaires à l'extérieur, pendant toute la période d'après 1945, a été celle des troupes de l'Allemagne de l'Est, au sein de celles du Pacte de Varsovie, dans l'occupation de la Tchécoslovaquie en 1968.
Aujourd'hui, l'Allemagne est unifiée et s'affirme comme la puissance dominante en Europe. Les blocs de l'ouest et de l'est n'existent plus. Dans un monde déchiré, non seulement par les tensions militaires mais par le chaos global et la lutte de chacun contre tous, l'impérialisme allemand n'a plus besoin de permission pour soutenir sa politique étrangère par la force des armes. Aujourd'hui, le gouvernement allemand est capable d'imposer sa présence militaire dans les Balkans, que cela plaise ou non aux autres grandes puissances. Cette capacité croissante fait surtout ressortir le déclin de l'hégémonie de la seule superpuissance qui reste dans le monde, les Etats-Unis. La capacité de cette dernière à imposer sa loi au gouvernement de Bonn, qui était la clé de voûte de sa domination sur les deux tiers du globe après la deuxième guerre mondiale, est largement remise en cause et la présence même de la Bundeswehr en Bosnie, aujourd'hui, démontre au monde entier à quel point cette domination américaine a été sapée.
L'Allemagne sape les accords de Dayton et défie les Etats-Unis
La participation de Bonn aux missions de l'IFOR 2 de l'OTAN en Bosnie, où elle contrôle une des trois zones d'application avec la France, n'est pas qu'un défi aux Etats-Unis et aux puissances européennes au niveau global et historique. C'est aussi une initiative indispensable à la défense concrète des intérêts cruciaux de l'impérialisme allemand dans la région même. L'enjeu est l'acquisition, à long terme, de bases navales en Méditerranée à travers les ports de son allié historique, la Croatie. C'est le gouvernement Kohl qui a déclenché le processus qui a mené à l'explosion de la Yougoslavie avec son lot de conflits sanglants en poussant de façon agressive à l'indépendance de la Croatie et de la Slovénie au début des années 1990. Bien que Bonn, grâce à des fournitures massives d'armes à la Croatie, ait réussi à développer sa politique, un tiers du territoire de ses alliés croates est resté occupé par les forces serbes, coupant pratiquement le nord du pays des ports stratégiques de la Dalmatie dans le sud. Au début de la guerre des Balkans, l'Allemagne pouvait encore faire de grandes avancées, par un soutien logistique à la Croatie, sans avoir à engager ses propres troupes. Mais quand la guerre a éclaté dans la Bosnie voisine, les principaux rivaux européens de l'Allemagne (l'Angleterre et la France en particulier sous le couvert des Nations Unies et surtout les Etats-Unis sous le parapluie de l'OTAN) ont commencé à défendre leurs intérêts par une présence militaire directe. Cette présence pouvait être d'autant plus efficace que l'Allemagne elle-même n'était prête ni militairement ni politiquement à suivre. Mais c'est par dessus tout l'engagement militaire des Etats-Unis qui a entamé, ces deux dernières années, la position de l'Allemagne. Les victoires militaires de la Croatie contre les serbes pro-français et pro-anglais en Krajina et en Bosnie, qui ont mis fin à la division de ce pays en reliant les ports dalmates à la capitale Zagreb, ont été acquises grâce au soutien non pas de l'Allemagne mais des Etats-Unis. Les accords de Dayton, imposés par les Etats-Unis dans le sillage de ses attaques militaires en Bosnie, ont ensuite confirmé la nécessité impérieuse pour l'Allemagne de défendre à son tour ses intérêts dans la région avec ses propres forces armées. Le stationnement de forces sanitaires et logistiques en Bosnie l'année dernière, hors de la zone de bataille et sans mandat de combattre, a été un premier pas vers la force actuelle de « maintien de la paix » en Bosnie même. A leur arrivée en Bosnie, ces unités allemandes, fortement armées et équipées, avec cette fois-ci un mandat leur permettant de combattre, ont été ouvertement accueillies comme des alliées par les croates de Bosnie qui ont immédiatement adopté une attitude plus agressive vis-à-vis des musulmans, rendant la vie difficile aux troupes françaises et espagnoles dans la ville divisée de Mostar. Le gouvernement croate a récompensé Bonn de l'arrivée de la Bundeswehr en décidant de remplacer les vieux Boeings de sa flotte aérienne par des avions Airbus construits en grande partie en Allemagne. Le ministre croate des affaires étrangères, en justifiant cette décision, déclarait : « Nous devons notre indépendance nationale à l'Amérique mais notre avenir réside en Europe, sur la base de notre amitié avec les gouvernements allemands et bavarois. »
En réalité, la bourgeoisie croate attendait depuis longtemps et avec impatience l'arrivée des troupes allemandes pour pouvoir se dégager du leadership des Etats-Unis. Washington a, en effet, fait payer cher son soutien à la Croatie. Ce sont les Etats-Unis qui, au dernier moment de la guerre en Bosnie avant Dayton, ont empêché les forces bosniaques et surtout croates de s'emparer de Banja Luca, et donc de chasser les serbes de l'est de la Bosnie. Par dessus tout, ce sont les Etats-Unis qui ont obligé les croates bosniaques à s'allier aux musulmans, en contradiction complète avec tous leurs objectifs guerriers en Bosnie. Pour la bourgeoisie croate, son principal ennemi en Bosnie n'est pas serbe mais musulman; son but est le partage de ce territoire avec les serbes aux dépens de la bourgeoisie musulmane. Les intérêts de la Croatie en Bosnie coïncident parfaitement avec ceux de l'Allemagne dans le sens de s'assurer l'accès aux ports dalmates.
Malgré sa collaboration tactique avec les Etats-Unis contre les serbes ces deux dernières années, Zagreb a des intérêts communs avec Bonn qui s'opposent non seulement à ceux des puissances de l'Europe de l'ouest et de la Russie pro-serbes mais aussi à ceux des Etats-Unis.
L'offensive allemande dans les Balkans
Nous assistons actuellement à une contre-offensive de l'Allemagne dans l'ex-Yougoslavie et les Balkans visant à compenser son recul dû aux accords de Dayton. Elle cherche à profiter des difficultés américaines au Moyen-Orient pour étendre son influence en Europe du sud-est et en Asie centrale. L'arrivée de troupes allemandes en Bosnie, loin d'être un événement isolé de « maintien de la paix », fait partie d'une poussée impérialiste extrêmement agressive vers la Méditerranée, le Moyen-Orient et le Caucase. Le pivot central de cette politique est la collaboration avec la Turquie. La défaite de l'impérialisme russe en Tchétchénie, l'affaiblissement de ses positions dans l'ensemble du Caucase, n'est rien de moins que le fruit de cette collaboration turco-allemande. Aujourd'hui, l'Allemagne soutient vigoureusement la politique de rapprochement du gouvernement Erbakan à Ankara avec l'Iran, un autre allié traditionnel de l'Allemagne. Celle-ci a clairement pris le parti de la Turquie dans son conflit avec la Grèce. Le ministre des affaires étrangères, Kinkel, a dit à la presse le 7 décembre 1996 à Bonn : « La Turquie est pour l'Allemagne un pays clé dans nos relations avec le monde islamique. Comment peut-on blâmer la Turquie de pencher plus fortement du côté de ses voisins islamiques, quand la Turquie n'a même pas gagné un sou dans l'union douanière avec l'Union Européenne du fait de la politique de blocage de la Grèce ? » C'est pour répondre à cette entente germano-turque que la Russie a promis de livrer des roquettes aux chypriotes grecs, sans rencontrer de désapprobation sérieuse de la part de Washington. Dans cette zone située entre l'Europe et l'Asie, il y a une accumulation massive d'armes et une montée des tensions guerrières.
En même temps, les grandes puissances, notamment l'Allemagne, déstabilisent les politiques intérieures de tous les pays des Balkans. En Turquie, Bonn soutient le premier ministre « islamiste » Erbakan dans sa lutte acharnée pour le pouvoir contre l'aile pro-américaine de l'armée malgré le danger d'un putsch militaire ou d'une guerre civile. Récemment, un tribunal allemand a officiellement accusé la famille de la rivale d'Erbakan, le ministre des affaires étrangères Ciller, de jouer un rôle clé dans le marché international des stupéfiants. Si en Serbie l'Allemagne a soutenu, aux côtés des américains, l'opposition « démocratique », y compris les Draskovic et Djinjic qui sont violemment anti-allemands, c'est uniquement dans le but de déstabiliser le régime de Milosevic. En Bulgarie, Macédoine et Albanie, l'Allemagne et les autres grandes puissances sont impliquées dans les luttes pour le pouvoir qui sont souvent sanglantes. Mais l'exemple le plus spectaculaire de cette politique de déstabilisation est donné par l'Autriche qui se baptisait elle même, jusqu'à il y a peu, « l'île de la tranquillité ». Ce pays a été le seul à reconnaître l'indépendance de la Croatie et de la Slovénie en même temps que Bonn. La plupart des fractions de la bourgeoisie autrichienne sont plus ou moins pro-allemandes. Mais cela ne suffit pas à l'impérialisme allemand. Comme l'Autriche est la porte des Balkans, Bonn essaie de faire de ce pays une quasi-colonie allemande, achetant ses banques et son industrie, poussant l'armée autrichienne à acheter des armes allemandes et soutenant ouvertement le ministre autrichien des affaires étrangères, le chrétien-démocrate Schüssel, qui consulte fidèlement Kohl avant de prendre toute décision sérieuse. Cette situation a d'ailleurs provoqué plusieurs crises dans la coalition au pouvoir à Vienne, notamment à travers une « résistance » de la social démocratie, le parti classique de la bourgeoisie autrichienne qui a obtenu le remplacement de Vranitsky le « conciliateur » par un nouveau premier ministre, Viktor Klima, un opposant plus déclaré à la « prise de possession » de l'Allemagne.
Les enjeux stratégiques de ces conflits
Avec l'effondrement du bloc de l'Est en 1989, les « vieux » enjeux stratégiques, qui ont divisé les puissances occidentales et qui ont débouché sur les deux guerres mondiales de ce siècle, sont de retour. Les ambitions « historiques », qui se réveillent chez l'impérialisme allemand moderne, incluent la domination de l'Autriche et de la Hongrie en tant qu'ouvertures vers les Balkans, de la Turquie en tant que porte vers l'Asie et le Moyen-Orient, mais aussi le démantèlement de la Yougoslavie et le soutien à la Croatie pour un accès à la Méditerranée. Déjà avant et pendant la première guerre mondiale, les fameux géostratèges du « pangermanisme » avaient élaboré les grands principes de la politique étrangère ; aujourd'hui, avec l'effondrement de l'ordre mondial issu de Yalta, ces principes orientent de nouveau la politique étrangère de l'Allemagne. Ernst Jaeckh a écrit en 1916 : « l'Allemagne est encerclée par des peuples déjà établis et de plus en plus hostiles. A l'Ouest, la France qui conserve son inimitié revancharde ; la Russie qui s'oppose à nous à l'Est ; au Nord, l'Angleterre opposée au monde entier. Il n'y a qu'au sud-ouest, derrière nos alliés autrichiens et hongrois, que Bismarck a déjà gagnés contre la Russie, qu'il y a une route ouverte vers des peuples qui n'ont pas achevé leur formation en Etat et qui ne nous sont pas encore hostiles dans les régions du monde voisines de l'Europe centrale vers la Méditerranée et l'Océan Indien. La voie terrestre via la "Mitteleuropa" [l'Europe centrale] devient donc notre détour pour accéder aux mers extérieures ». Jaeckh ajoutait que « l'Allemagne et la Turquie sont la pierre angulaire d'un édifice réunissant l'Autriche, la Hongrie et la Bulgarie. »
La même année, Friedrich Naumann, un autre théoricien fameux de l'impérialisme allemand écrivait : « L'Allemagne doit mettre tout son poids pour s'assurer cette voie dont dépendent ses liens avec la Turquie. Nous avons fait l'expérience pendant la guerre des dégâts qui peuvent être causés quand les Serbes ont acquis une partie de cette route. Ce fut la raison pour laquelle l'armée de Mackensen a traversé le Danube. Tout ce qui se trouve sur la ligne ferroviaire de Bagdad, se trouve sur la route Hambourg-Suez qu'on ne doit permettre à personne de bloquer. A quoi bon les chemins de fer de Bagdad ou anatoliens si nous ne pouvons les utiliser sans la permission de l'Angleterre ? »
Dans le même sens, Paul Rohrbach, dont Rosa Luxemburg disait qu'il est « un porte-parole semi-officiel très ouvert et honnête de l'impérialisme allemand », parlait constamment de « la nécessité d'éliminer le verrou serbe qui sépare l'Europe centrale de l'Orient. » ([1] [2822])
Si les Balkans ont été le point de départ de la première guerre mondiale et un des principaux champs de bataille du second conflit mondial, cette région est aujourd'hui encore plongée dans la barbarie par la montée de l'impérialisme allemand et des efforts de ses grands rivaux pour la contrecarrer.
La rivalité germano-américaine en Europe de l'Est
Bien que les Etats-Unis et l'Allemagne, par pions bosniaques et croates interposés en Yougoslavie, aient récemment fait une alliance tactique pour repousser les serbes et bien qu'ils aient travaillé ensemble pour limiter le développement du chaos en Russie, ils sont devenus les principaux rivaux dans la lutte pour la domination de l'Europe de l'Est. Depuis l'effondrement de l'URSS, l'impérialisme russe a rapidement perdu jusqu'aux derniers restes de son influence antérieure sur les pays du Pacte de Varsovie. Quoique l'extension vers l'est de l'OTAN et de l'Union Européenne soit justifiée par les medias bourgeois occidentaux par le besoin de protéger l'Europe de l'Est d'une possible agression russe, cela fait en réalité partie de la course de vitesse qui existe aujourd'hui entre l'Allemagne, à travers l'Union Européenne, et les Etats-Unis à travers l'OTAN, pour prendre la place de Moscou. Pendant la première moitié des années 1990, l'Allemagne a eu la capacité d'acquérir une influence plus ou moins importante dans tous les pays de l'ex-Pacte de Varsovie, excepté dans la République tchèque. Au centre de cette expansion de l'Allemagne, il y a eu son alliance avec la Pologne qui représente une composante militaire forte. En fait, sous prétexte d'aider à fermer la frontière orientale de la Pologne aux immigrants illégaux en route pour l'Allemagne, Bonn a commencé à équiper et même à financer des parties importantes de l'appareil militaire polonais. Le gouvernement polonais a d'ailleurs chaleureusement accueilli le déploiement des troupes allemandes en Bosnie et a promis de participer avec la Bundeswehr aux futures opérations à l'extérieur. Le fait qu'un pays comme la Pologne s'allie avec le géant économique allemand plutôt qu'avec la superpuissance militaire américaine en dit long sur le peu de crainte qu'a Varsovie d'une invasion militaire russe. En réalité, la bourgeoisie polonaise, loin d'être sur la défensive, compte tirer profit de l'expansion allemande vers l'est aux dépens de la Russie. C'est précisément parce que les Etats-Unis ont perdu beaucoup de terrain en Europe de l'est au profit de l'Allemagne ces dernières années qu'ils font maintenant pression, avec une certaine impatience, pour étendre l'OTAN à l'est. Mais en faisant cela, ils mettent en péril leurs relations privilégiées avec la Russie, relations qui sont tellement importantes pour Washington justement parce que l'ours russe même épuisé, est le seul autre pays qui possède un arsenal nucléaire gigantesque. Actuellement, la diplomatie allemande fait tout ce qu'elle peut pour élargir la brèche entre russes et américains en faisant une série de concessions à Moscou. Une de ces concessions est que les troupes de l'OTAN (c'est-à-dire les Etats-Unis) ou les armes nucléaires ne puissent pas être stationnées dans les pays de la nouvelle OTAN. Le ministre allemand de la défense, Rühe, a même proposé d'inclure le territoire de l'ex-Allemagne de l'Est dans cette catégorie. Cela reviendrait à créer, pour la première fois depuis 1945, une aire interdite aux troupes américaines dans la République Fédérale Allemande : un premier pas possible vers le retrait de l'ensemble des forces nord-américaines. On comprend la rage de l'appareil politique à Washington qui a commencé à faire publier des rapports sur les droits de l'homme qui mettent l'Allemagne au même niveau que l'Iran ou la Corée du Nord à cause de la manière dont elle traite la secte de L'Eglise de Scientologie américaine.
La montée de l'Allemagne et la crise de la politique européenne de la France
La montée de l'Allemagne en tant que nouvelle puissance dominante en l'Europe n'en est qu'à ses débuts. Mais aujourd'hui déjà, l'impérialisme allemand bénéficie de la remise en question générale du leadership américain. Quoique l'Allemagne soit encore bien trop faible, par rapport aux Etats-Unis, pour être à même de constituer son propre bloc impérialiste, sa montée menace déjà sérieusement les intérêts de ses principaux rivaux européens, y compris la France. Après l'effondrement du bloc de l'Est, la France a d'abord recherché une alliance avec l'Allemagne contre les Etats-Unis. Cependant, le renforcement de son voisin de l'est, et surtout la marche de Bonn vers la Méditerranée dans les guerres yougoslaves, ont conduit la France à s'en éloigner et à se rapprocher de la Grande-Bretagne, d'autant plus que cette dernière était engagée dans une rupture de son alliance de toujours avec les Etats-Unis.([2] [2823]) Ces derniers mois, Bonn et Paris se sont à nouveau rapprochés. L'exemple le plus frappant est donné par leur collaboration militaire en Bosnie. Est-ce une renaissance de l'alliance franco-allemande ?
Plusieurs raisons expliquent le relâchement récent des relations entre Paris et Londres. Il y a d'abord la menace de représailles de la part des Etats-Unis, surtout contre Londres. Il y a ensuite, du point de vue des intérêts français, le fait que l'alliance avec la Grande-Bretagne a échoué par rapport à un de ses objectifs les plus importants : empêcher l'avancée de l'Allemagne. Les troupes allemandes dans les Balkans, l'entente allemande avec la Pologne, traditionnellement alliée de la France, en sont les meilleures preuves. Il y a enfin la pression exercée sur la France par l'Allemagne qui ne voit pas d'un bon oeil le rapprochement de ses principaux rivaux européens. En réaction, Paris ne se réaligne pas pour autant sur la politique de Bonn mais change en fait de tactique pour la combattre. Cette nouvelle tactique, celle d'étreindre son ennemi pour l'empêcher de bouger, se vérifie en Bosnie où les forces allemandes, si elles ne peuvent en être exclues, sont au moins sous direction française. Cette tactique peut marcher un temps car l'Allemagne n'est pas encore prête à jouer un rôle militaire plus indépendant. Mais, à long terme, elle est aussi vouée à l'échec.
L'exacerbation des tensions militaires
Tout ce que l'on vient de développer révèle la logique sanglante du militarisme dans ce siècle, dans la phase décadente du capitalisme. Avec la chute du bloc de l'est, l'Allemagne, grâce à sa force économique et politique et à sa situation géographique, est devenue la puissance dominante de l'Europe quasiment en une nuit. Mais même une telle puissance ne peut défendre efficacement ses intérêts que si elle est capable de les défendre militairement. Comme le capitalisme ne peut plus conquérir des marchés suffisants pour réellement étendre son système, toute puissance impérialiste ne peut que s'affirmer aux dépens des autres. Dans ce cadre, qui est celui qui a déjà provoqué les deux guerres mondiales de ce siècle, c'est la force brute qui décide, en dernière instance, du statut des Etats bourgeois. Les événements en Yougoslavie nous confirment cette leçon. S'il n'a pas de troupes dans la région, l'impérialisme allemand perdra, quelle que soit sa force par ailleurs. C'est cette contrainte d'un système en décadence qui fait monter aujourd'hui les tensions militaires dans le monde entier, imposant une politique de militarisation à l'Allemagne et à tous les autres Etats bourgeois.
Cependant cette course sanglante, avec tout ce que cela impose d'appauvrissement et de souffrances à la classe ouvrière, avec la lumière qu'elle jette sur la réalité barbare du système capitaliste, va, à long terme, exacerber la lutte de classe entre bourgeoisie et prolétariat. Au niveau historique, le développement de l'expansion impérialiste de l'Allemagne peut être un facteur considérable du retour du prolétariat allemand à la tête de la lutte de classe révolutionnaire du prolétariat international.
DK.
[2] [2825] Sur la rupture historique de l'alliance de la Grande-Bretagne avec les Etats-Unis, voir en particulier la « Résolution sur la situation internationale », Revue internationale n° 86.
Géographique:
- Allemagne [98]
Questions théoriques:
- Impérialisme [321]
Crise economique : les « dragons » asiatiques s'essoufflent
- 10305 reads
Les récentes grèves ainsi que les difficultés économiques en Corée du Sud viennent ébranler un des arguments favoris utilisés par la bourgeoisie dans ses campagnes idéologiques de réfutation du marxisme. Déçue par la fin du « miracle » japonais, la bourgeoisie s'était rabattue sur les taux de croissance appréciables des « dragons asiatiques » (Corée du Sud, Taiwan, Hongkong, Singapour) puis sur la montée en puissance des nouveaux « tigres » (Thaïlande, Indonésie, Malaisie) : leur prospérité n'était-elle pas la « preuve » que des pays sous-développés peuvent rapidement émerger de la misère et que c'est le capitalisme avec ses lois du marché qui mérite de s'arroger ces réussites ? Et combien de fois ne nous a-t-on pas montré des ouvriers en grève poursuivant leur travail tout en portant un brassard pour marquer leur mécontentement ? Le « dévouement aux intérêts de l'entreprise » et « la discipline légendaire » des travailleurs de l'Asie du sud-est nous étaient ainsi présentés par la bourgeoisie et ses médias aux ordres comme un des secrets de la réussite économique de ces pays et comme la preuve vivante de l'inanité de la thèse marxiste sur les irréductibles oppositions de classe.
Avec l'effondrement du bloc de l'Est et la faillite du stalinisme, présentée fallacieusement comme celle du communisme, toute la bourgeoisie annonçait le triomphe de « l'économie de marché » et promettait une nouvelle ère de prospérité. Mais les réalités brutales de la crise, les mesures d'austérité et les licenciements massifs, sans précédents depuis 25 ans, sont venus contredire ces discours triomphants et dissiper les brumes des mensonges idéologiques de cet avenir de « prospérité ». Plus que jamais, la bourgeoisie a un besoin urgent de modèles de réussite pour entretenir ses mythes afin de masquer la faillite historique de son système. Il lui faut empêcher au maximum que le prolétariat, son ennemi mortel, ne prenne conscience des véritables racines de la crise, ne comprenne que le capitalisme n'a d'autre avenir que d'enfoncer l'humanité dans une misère accrue et dans une multiplication de conflits de plus en plus meurtriers. C'est pourquoi, après la déconfiture de plus en plus patente des « modèles » allemand et japonais, les suppôts idéologiques de la bourgeoisie en sont venus à la promotion d'exemples asiatiques définis comme « nouveaux pôles de croissance . Tel est un des nouveaux discours mystificateurs en vogue aujourd'hui.
Le « tiers-monde » dans la décadence du capitalisme
Seul le cadre global d'analyse de la décadence du capitalisme permet de comprendre la place et l'importance du relatif développement économique des « dragons » asiatiques et l' « exception » qu'ils constituent à la règle de la désindustrialisation massive du « tiers-monde » et à l'incapacité générale du mode de production capitaliste à développer les forces productives. Les chiffres sont éloquents, le « tiers-monde » ne retrouve son niveau d'industrialisation par habitant de 1750 que près de deux siècles plus tard, en 1960. Malgré tous les discours triomphants de la bourgeoisie sur le dynamisme du Sud-est asiatique et le développement dans le « tiers-monde », l'écart n'a fait que se creuser au cours de la décadence entre les pays industrialisés et le reste du monde : il a plus que doublé passant de 1 à 3,4 en 1913 à 1 à 8,2 en 1990. Alors qu'en phase ascendante la population intégrée au processus productif croissait plus rapidement que la population elle-même, aujourd'hui c'est au rejet d'une masse grandissante de travailleurs en dehors du système auquel nous assistons. Le capitalisme a achevé son rôle progressif notamment au travers de la fin du développement d'une des principales forces productives : la force de travail. La petite poussée d'industrialisation qu'a connu le « tiers-monde » au cours d'une période à cheval entre les années 1960-70, vigoureuse en terme de taux de croissance n'a en rien infléchi les grandes évolutions rappelées ci-dessus. Elle fut limitée dans le temps et l'espace, dépendante et fonction du mode d'accumulation dans les pays développés, et finalement très coûteuse et pernicieuse pour le « tiers-monde ». Mis à part quelques exceptions, localisées pour l'essentiel dans le Sud-est asiatique, tous les essais de constitution d'une véritable assise industrielle performante ont échoué. Et pour cause, les puissances industrielles en place ne pouvaient permettre la généralisation d'un pôle concurrent. ([1] [2826])
Sans s'étendre sur une question sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir, nous devons cependant rappeler que l'essentiel de l'industrialisation dans le « tiers-monde » s'est concentré dans cinq pays seulement : le Brésil et les quatre « dragons » ([2] [2827]). Ensemble, ces cinq pays qui fournissent près de 80 % des exportations de produits manufacturés du « tiers-monde » ne concernent que 6 % de la population de ce même « tiers-monde ». A considérer les seuls quatre « dragons », le déséquilibre est encore plus grand : en 1990 ils fournissent les deux tiers de l'ensemble des exportations de produits manufacturés de tout le « tiers-monde » mais n'en représentent que 3 % en terme de population. Limité dans l'espace, ce « développement » le fut également dans le temps. La brève inversion de dynamique au cours des années 1967-77 (cf. tableau ci-dessous) fait à nouveau place à l'augmentation de l'écart relatif : la croissance de la production dans le « tiers-monde » en revient à un rythme inférieur à celui des pays industrialisés. Des zones entières ont même cessé de croître, puisque le produit par tête y a tout simplement reculé. Les années 1980, véritable décennie perdue pour le « tiers-monde », sont venues mettre définitivement fin aux illusions. Les quelques exceptions qui échappent à cette évolution générale ne sauraient infirmer la tendance globale. La décennie 1980 s'illustre par une quasi stagnation du produit par tête (0,7 %) pour les pays du Sud :
PIB par habitant
|
|
|
Nord
|
Sud
|
|
|
1960-67
|
4,0 %
|
2,5 %
|
|
|
1967-77
|
3,0 %
|
4,3 %
|
|
|
1977-90
|
2,2 %
|
0,7 %
|
Source : P.N.U.D., Rapport 1992
Pourquoi le développement du Sud-est asiatique après la seconde guerre mondiale
C'est seulement dans le cadre du contexte général rappelé ci-dessus que l'on peut aborder la question du pourquoi, de l'ampleur et de la nature de la croissance dans le Sud-est asiatique. Tout d'abord, il faut écarter l'inclusion du Japon dans les performances chiffrées de cette région du monde. le Japon est le seul pays de la région à avoir connu la révolution industrielle au 19e siècle et à s'être dégagé de toute domination coloniale importante directe ou même indirecte. Ce pays, qui a réalisé sa mutation capitaliste à travers la « révolution Meiji » de 1867, est incontestablement à considérer parmi toutes les puissances économiques ayant émergées pendant la phase ascendante du capitalisme.
L'exception du Sud-est asiatique ne peut se comprendre que dans le cadre de la lutte à mort que se sont livrés les deux nouveaux blocs militaires (OTAN et Pacte de Varsovie) à l'issue du second conflit inter-impérialiste. Contenue en Europe dans l'immédiat après-guerre, l'expansion du bloc de l'Est se déporte vers l'Asie. Le soutien soviétique accordé à la fraction bourgeoise maoïste qui arrive au pouvoir en 1949, conjugué à la guerre de Corée, déterminent les Etats-Unis à développer des politiques pour endiguer au maximum les percées de son ennemi impérialiste dans cette partie du monde. Sachant que la misère économique et sociale est le principal argument sur lequel s'appuient les fractions nationalistes pro-soviétiques pour arriver au pouvoir dans certains pays d'Asie, les Etats-Unis vont faire des zones qui se situent au voisinage immédiat de la Chine (Taiwan, Hongkong, Corée du Sud et Japon), les avant-postes de la « prospérité occidentale ». La priorité pour les Etats-Unis sera d'établir un cordon sanitaire par rapport à l'avancée du bloc soviétique en Asie. Contrairement à sa politique menée dans le reste du monde, les Etats-Unis vont déployer un arsenal impressionnant de mesures pour saper les bases objectives du mécontentement social dans ces pays. Ainsi, alors que la puissance américaine s'est, quasiment partout dans le monde, violemment opposée aux réformes agraires et institutionnelles et a soutenu les fractions bourgeoises les plus rétrogrades en place, elle va promouvoir des politiques économico-sociales « révolutionnaires » dans les quatre pays asiatiques cités. Ces politiques n'ont d'autres raisons que celles géostratégiques propres à cette partie du monde. La Corée du Sud, par exemple, ne disposait d'aucun atout particulier. Dépourvu de matières premières et dont l'essentiel de l'appareil industriel se localisait au Nord, ce pays se retrouvait exsangue au lendemain de la guerre : la baisse de la production atteint 44 % et celle de l'emploi 59 %, les capitaux, les moyens de production intermédiaires, les compétences techniques et les capacités de gestion étaient quasi inexistants. Seuls les impératifs de la guerre froide ont poussé les Etats-Unis à soutenir la Corée du Sud à bout de bras. Contrairement aux stupides assertions sur le formidable auto-développement du Sud-est asiatique, la croissance des quatre « dragons » est le pur produit d'une volonté américaine dans le contexte exacerbé de la guerre froide. Il n'y a guère de doute que sans l'aide massive apportée par les Etats-Unis dès le début et pendant de longues années, ces pays, et particulièrement la Corée du Sud et Taiwan, n'auraient pas pu survivre en tant qu'Etats nationaux :
1) L'appui militaire et économique des Etats-Unis, de par son ampleur, a constitué l'équivalent d'un plan Marshall pour l'Asie. La croissance dans les années 1950-70 a été soutenue par l'aide extérieure américaine qui crevait tous les plafonds imaginables (elle n'est dépassée, en terme relatifs, que par l'aide reçue par Israël, pour des raisons stratégiques analogues). De 1945 à 1978, la Corée du Sud a reçu quelques 13 milliards de dollars, soit 600 par tête, et Taiwan 5,6 milliards, soit 425 par tête. Entre 1953 et 1960, l'aide étrangère contribue pour environ 90 % à la formation du capital fixe de la Corée du Sud. L'aide fournie par les Etats-Unis atteignait 14 % du PNB. en 1957. A Taiwan entre 1951 et 1965, l'aide « civile » américaine s'élevait à 6 % du PNB. et l'aide militaire à 10 %. Dans les années 1950, plus de 80 % des importations coréennes et 95 % du déficit commercial de Taiwan étaient financés par l'assistance économique américaine. Cette aide a cessé en 1964 pour Taiwan et en 1980 seulement pour la Corée du Sud. Mais même ainsi l'aide en nature a continué. Des céréales et d'autres fournitures ont été données à la Corée en contrepartie de restrictions « volontaires » de ses exportations de textiles. Les surplus alimentaires américains ont servi à maintenir de bas salaires dans les deux pays. En Asie du Sud-est l'aide a été relayée dans le courant des années 1970 par l'investissement direct d'outre-mer (essentiellement américain puis japonais) et surtout par l'endettement extérieur (cf. tableau ci-dessous) ; en outre, pour la Corée et Taiwan, c'est également l'exportation industrielle qui a pu prendre le relais.
2) De même qu'ils l'ont fait au Japon, des réformes agraires ont été imposées à l'initiative des gouvernements militaires américains, lesquelles ont eu de profondes conséquences sur la structure de classe des différents pays et sur l'autonomisation relative des Etats. Ainsi en Corée, l'année 1945 a marqué le début de la réforme agraire avec la décision du gouvernement militaire américain de redistribuer aux anciens fermiers et cultivateurs coréens les terres jusque-là contrôlées par les japonais. La réforme agraire a donc contribué à instaurer une stabilité politique en supprimant toute éventualité d'émeutes paysannes. A Taiwan les américains exigent la réforme agraire conçue par la commission sino-américaine de reconstruction rurale (JCRR). Celle-ci est dotée de pouvoirs exceptionnels et son budget pris en charge par les Etats-Unis.
3) De nombreuses réformes institutionnelles et sociales ont été entreprises pour saper les bases de l'ancien régime et dynamiser la société. Contrairement au soutien systématique apporté à la bourgeoisie foncière dans les autres pays du « tiers-monde », et notamment en Amériques centrale et du Sud, la politique américaine en Asie a contribué à la déstructurer, faisant ainsi sauter un obstacle économique et politique à l'industrialisation. Ainsi, dès 1959, le démembrement des grandes propriétés terriennes et la répartition des parcelles agricoles, sans véritable indemnisation, étaient relativement équitables ([3] [2828]) en Corée du Sud contribuant à la destruction d'un système de classes héréditaire (Yangban) fondé sur la propriété du sol ([4] [2829]).
4) Mais les Etats-Unis ne se sont pas bornés à fournir aide et soutien militaires, aide financière et assistance technique ; ils ont en fait pris en charge dans les différents pays toute la direction de l'Etat et de l'économie. En l'absence de véritables bourgeoisies nationales, le seul corps social pouvant prendre la tête de l'entreprise de modernisation voulue par les Etats-Unis était représenté par les armées. Un capitalisme d'Etat particulièrement efficace sera instauré dans chacun de ces pays. La croissance économique sera aiguillonnée par un système qui alliera étroitement le secteur public et privé, par une centralisation quasi militaire mais avec la sanction du marché. Contrairement à la variante est-européenne de capitalisme d'Etat qui engendrera des caricatures de dérives bureaucratiques, ces pays ont allié la centralisation et la puissance étatique avec la sanction de la loi de la valeur. De nombreuses politiques interventionnistes ont été mises en place : la formation de conglomérats industriels, le vote de lois de protection du marché intérieur, le contrôle commercial aux frontières, la mise en place d'une planification tantôt impérative, tantôt incitative, une gestion étatique de l'attribution des crédits, une orientation des capitaux et ressources des différents pays vers les secteurs porteurs, l'octroi de licences exclusives, de monopoles de gestion, etc. Ainsi en Corée du Sud, c'est grâce à la relation unique tissée avec les « chaebols » (équivalents des « zaibatsus » japonais), grands conglomérats industriels souvent fondés à l'initiative ou avec l'aide de l'Etat ([5] [2830]), que les pouvoirs publics sud-coréens ont orienté le développement économique. A Taiwan, les entreprises publiques fournissaient 80 % de la production industrielle dans les années 1950... Voilà un taux qui n'a rien à envier aux ex-pays de l'Est ! Après une baisse dans les années 1960 cette proportion augmente à nouveau dans les années 1970 quand l'Etat prend en charge le programme d'édification d'industries lourdes.
Loin de constituer un contre-exemple, le Sud-est asiatique est en réalité une magistrale illustration d'une des caractéristiques fondamentales de la décadence d'un mode de production : l'incapacité d'un développement spontané d'une bourgeoisie nationale autonome. A une époque où la bourgeoisie a terminé son rôle historiquement progressif, c'est à l'Etat, et qui plus est aux mains de l'armée – la seule structure offrant encore force et cohérence dans le « tiers-monde » –, que revient le rôle de tuteur de la société, tuteur mis en place, formé et financé par la première puissance mondiale dans le contexte particulier de la configuration inter-impérialiste d'après 1945. S'il n'y avait pas eu cet ensemble de circonstances, on peut aisément imaginer, et plus particulièrement pour la Corée du Sud et Taiwan, qu'après leur longue décadence sous les Yin et les Mandchous, ces pays auraient été conduits dans l'impasse comme le reste du « tiers-monde ». Voilà qui fait des quatre « dragons » (et du Japon) des exemples non reproductibles. Voilà qui remet à sa place les ridicules assertions de PI sur « les capacités d'émergence de bourgeoisies locales périphériques pouvant s'industrialiser et rivaliser avec les anciens pays industriels. »
5) Pour assurer le succès économique de ces pays d'Asie, les Etats-Unis ont garanti l'ouverture de leur marché. La Corée du Sud mais surtout Taiwan, ont également bénéficié de la compétition économique nippo-américaine qui s'est développée au cours du temps, notamment par les privilèges douaniers accordés par le paragraphe 807 du code des douanes américain pour la réexportation aux Etats-Unis de composants assemblés ou retravaillés à l'étranger. C'est pourquoi de nombreuses firmes américaines ont délocalisé leurs opérations d'assemblage à l'étranger pour bénéficier des bas salaires locaux et ainsi endiguer le flot d'importations japonaises à bon marché aux Etats-Unis. Ainsi, vers la fin des années 1960, la moitié des importations américaines se faisaient sous le couvert de ce paragraphe 807 et, pour la plus grande part, elles provenaient d'entreprises américaines du Mexique ou de Taiwan. Mais les japonais ont riposté en faisant de même à Taiwan. Par ailleurs, le soutien américain s'est étendu jusqu'à la tolérance à l'égard de mesures protectionnistes que la Corée du Sud et Taiwan prenaient pour protéger leurs industries de substitution aux importations, en dépit des avis contraires du FMI, de la Banque Mondiale ou du GATT. Bien plus tard, quand ces pays sont passés à des industries orientées vers l'exportation, ce sont les Etats-Unis qui ont dirigé et organisé ce tournant en dictant pratiquement l'ensemble des réformes nécessaires.
6) Enfin, soulignons-le, cette croissance économique est avant tout le produit d'une exploitation féroce de la classe ouvrière du Sud-est asiatique et d'une militarisation à outrance de toute la vie sociale : bas salaires, temps de travail harassant, flexibilité intense, contrôle social permanent par le rattachement complet du salarié à l'entreprise, occupation militaire des usines à chaque conflit social, etc. C'est incontestablement une des fractions du prolétariat mondial les plus sauvagement exploités et dont les ouvriers ont payé le plus durement le « miracle économique » dans leur chair. Ainsi, la Corée du Sud est le pays qui détient les plus hauts taux d'accidents du travail et de maladies professionnelles dans le monde. Les ouvrières sud-coréennes, dont les salaires n'atteignent même pas la moitié des salaires masculins, ont longtemps constitué le groupe de travailleurs préféré des patrons, essentiellement les jeunes femmes célibataires ayant au moins terminé l'école moyenne. Ces données expliquent le faible taux de croissance démographique, 1,4 % par an, dont la source réside dans l'exploitation des femmes, et non, comme on le prétend, dans le « haut niveau de développement ». Contrairement aux autres pays du « tiers-monde », les « dragons » n'ont pas eu à souffrir d'une explosion démographique freinant la croissance économique (4 % de croissance, avec une démographie de 3 %, assure 1 % de croissance par habitant seulement). De surcroît, les trente années de croissance dans ces pays ont engendré un véritable désastre écologique qui vient s'ajouter aux conditions de vie épouvantables.
Loin des grands poncifs de la propagande bourgeoise sur le dynamisme du capitalisme et sur « la possibilité pour de nouveaux arrivants sur le marché mondial de s'industrialiser et rivaliser avec les anciens », le développement du Sud-est asiatique ne procède d'aucun mystère. Le Japon et les quatre « dragons » étaient désignés par les Etats-Unis pour revitaliser l'Asie orientale et faire barrage contre les « ennemis » chinois et soviétique. Ces Etats militaires ou à parti unique ont joui dans l'après-seconde guerre mondiale d'un espace de respiration dont bien peu d'autres ont pu bénéficier. Cette « parenthèse développementiste » dans l'espace et dans le temps confirme au contraire la thèse que toute la décadence du mode de production capitaliste est déterminée par les conflits inter-impérialistes, par une lutte économique à mort sur un marché mondial sursaturé et donc par le poids surdéterminant du militarisme et de l'économie de guerre.
Les difficultés actuelles dans le Sud Est asiatique
Certes, cette parenthèse a connu un certain succès, très certainement au-delà des prévisions américaines d'après-guerre ; elle s'est même partiellement retournée contre son initiateur sur le plan économique. Cependant cette situation ne peut qu'être temporaire. Avec un temps de retard, tout comme pour le Japon à l'heure actuelle, ces îlots de « prospérité » dans le Sud-est asiatique, emprunteront le chemin de la récession. Les difficultés actuelles dans ces pays montrent que cette région du monde ne fait pas exception. Ils entrent progressivement dans une zone de turbulences économiques et de difficultés croissantes. Les récents problèmes économiques et conflits sociaux sont triplement illustratifs. D'une part, que la crise économique du capitalisme est bien mondiale, et que, si elle a pu relativement épargner quelques zones géographiques pour un temps, elle touche tous les pays du monde même si c'est encore à des degrés divers. Les exceptions se font de plus en plus rares et les grands déterminants de la crise mondiale homogénéisent les situations. Ceci vient apporter un premier coup au mythe du soi-disant « modèle Sud-est asiatique ». D'autre part, les grèves en Corée apportent un cinglant démenti à tous les discours intégrateurs visant à diviser le prolétariat mondial. Elles montrent l'unité internationale d'intérêt de la classe ouvrière, contre les mythes d'une classe ouvrière asiatique soumise et soucieuse de « l'intérêt national supérieur ». Enfin, la crise et les conflits sociaux viennent démentir un autre mythe, le mythe d'une issue économique possible au sein du capitalisme.
A l'heure actuelle, avec la saturation du marché mondial et les difficultés économiques au coeur même des Etats-Unis, la période où les « dragons » profitaient de l'ouverture du marché américain se clôture. La « conquête » tolérée du marché américain par les « dragons » asiatiques dans l'après-guerre a implique en retour une dépendance croissante à l'égard de la politique américaine. Ainsi la Corée du Sud – et la situation est analogue pour Taiwan – est un pays très extraverti et donc très dépendant du marché mondial (en 1987, ses exportations équivalaient à 40 % du PNB), surtout américain (la même année le marché américain absorbait 40 % des exportations sud-coréennes). Du jour au lendemain, l'économie coréenne peut entrer violemment en récession suite à un ralentissement du commerce mondial, une modification notable des taux de change ou à des mesures protectionnistes. Cette dépendance est d'autant plus grande, et économiquement vouée à l'échec, que ce sont les excédents commerciaux déclinant avec les Etats-Unis, qui doivent financer les déficits commerciaux croissant en biens d'équipements et en technologie avec le Japon ; biens nécessaires pour assurer le maintien de la compétitivité coréenne. Ici, un nouvel obstacle s'ajoute, le succès des « dragons » s'étant appuyé sur des technologies éprouvées mais produites à plus faible coût, ces pays, pour négocier le tournant d'une production à plus haute valeur ajoutée, doivent s'endetter à outrance et tomber sous la dépendance technologique d'un Japon qui contrôle de plus en plus l'économie de toute la région.
D'ailleurs, la poursuite du succès des deux premières décennies d'après-guerre s'est prolongé en grande partie grâce aux vieilles recettes des déficits publics et de l'endettement (cf. tableau ci-dessous) qui ont puissamment alimenté l'inflation.
Endettement extérieur en % du P.N.B.
|
|
1970
|
1980
|
1985
|
1994
|
|
Chine
|
-
|
2,2
|
-
|
19
|
|
Inde
|
15
|
12
|
15
|
34
|
|
Indonésie
|
30
|
28
|
37
|
57
|
|
Thaïlande
|
11
|
26
|
36
|
43
|
|
Philippines
|
21
|
54
|
52
|
60
|
|
Malaisie
|
11
|
28
|
-
|
37
|
|
Corée du Sud
|
23
|
48
|
43
|
15
|
Inflation
|
|
1980-90
|
1990-94
|
|
Chine
|
5,8
|
10,8
|
|
Inde
|
8
|
10,1
|
|
Indonésie
|
8,5
|
7,4
|
|
Thaïlande
|
3,9
|
4,4
|
|
Philippines
|
14,9
|
9,6
|
|
Malaisie
|
1,7
|
3,7
|
|
Corée du Sud
|
5,9
|
6,3
|
Source : Banque Mondiale
Comme dans les précédentes « success story » du « tiers-monde », la croissance depuis le début de la crise est une bulle gonflée par l'endettement qui peut éclater à tout moment. Les grands investisseurs en sont bien conscients : « Parmi les raisons qui ont rendu les pays industriels les plus riches si soucieux de doubler (!) la ligne des crédits de secours du FMI jusqu'à 850 milliards, il y a celle qu'une nouvelle crise du style Mexique est à craindre, cette fois dans le Sud Est asiatique. Le développement des économies dans le Pacifique a favorisé un flux énorme de capital dans le secteur privé, qui a remplacé l'épargne intérieure, conduisant à une situation financière instable. La question est de savoir quel sera le premier des dragons d'Asie à tomber » (Guardian, 16 octobre 1996). Chaque fois qu'un mythe s'écroule et menace de dévoiler la faillite de tout le système capitaliste, la bourgeoisie en invoque de nouveaux. Il y a quelques années, c'étaient les miracles allemand et japonais ; ensuite, après l'effondrement du bloc de l'Est, ce fut les promesses de « lendemains qui chantent » grâce à l'ouverture de « nouveaux marchés » ; aujourd'hui se sont les « dragons » qui sont à l'honneur. Mais les récentes et futures difficultés dans la région montrent et montreront à la classe ouvrière que les petits empereurs sont également nus, déchirant un peu plus le voile que tend la bourgeoisie pour masquer la faillite du mode de production capitaliste.
C.Mcl.
Sources : Aseniero Georges, « Le contexte transnational du développement de la Corée du Sud et de Taiwan », article publié dans « Mondialisation et accumulation », L'Harmattan, 1993. Bairoch Paul, « Le Tiers-Monde dans l'impasse », Gallimard, 1992 ; « Mythes et paradoxes de l'histoire économique », La découverte, 1994. Banque mondiale, « Rapport sur le développement dans le monde », annuel. Coutrot & Husson, « Les destins du Tiers-Monde », Nathan, 1993. Chung H. Lee, « La transformation économique de la Corée du Sud », OCDE, 1995. Dumont & Paquet, « Taiwan le prix de la réussite », La découverte, 1987. Lorot & Schwob, « Singapour, Taiwan, Hongkong, Corée du Sud, les nouveaux conquérants ? », Hatier, 1987. P.N.U.D., « Rapport mondial sur le développement humain », Economica, 1992.
[5] [2835]. La première et la plus importante source de financement a été l'acquisition par les « chaebols » des biens assignés, à des prix nettement sous-évalués. Au lendemain de la guerre ils représentaient 30 % du patrimoine sud-coréen anciennement détenu par les japonais. Initialement placés sous la tutelle de l'Office américain des biens assignés, ils ont été distribués par l'Office lui-même et par le gouvernement ensuite.
Géographique:
- Asie [2836]
Récent et en cours:
- Crise économique [28]
Campagnes contre le « negationnisme » : la co-responsabilite des « allies » et des « nazis » dans l' « holocauste »
- 3903 reads
La campagne idéologique qui vise aujourd'hui à assimiler les positions politiques de la Gauche communiste face à la 2e guerre mondiale à du « négationnisme » ([1] [2837]), c'est-à-dire la remise en cause de l'extermination des juifs par les nazis, a deux objectifs. Le premier est de salir et de discréditer aux yeux de la classe ouvrière, le seul courant politique, la Gauche communiste, qui refusa de céder à l'Union sacrée face à la seconde guerre mondiale. En effet seule la Gauche communiste dénonça la guerre – comme l'avaient fait avant elle, Lénine, Trotsky et Rosa Luxemburg à propos de la première guerre mondiale – comme une guerre inter-impérialiste de même nature que celle de 1914-18, en démontrant que la prétendue spécificité de cette guerre, celle d'une lutte entre deux systèmes, la « démocratie » et le « fascisme », n'était qu'un pur mensonge destiné à embrigader les prolétaires dans une gigantesque boucherie. Le second objectif s'inscrit dans l'offensive idéologique qui veut faire croire aux prolétaires que la démocratie bourgeoise serait, malgré ses imperfections, le seul système possible et qu'il leur faut donc se mobiliser pour la défendre ; c'est ce qu'on leur demande aujourd'hui par le matraquage de diverses campagnes politico-médiatiques, de l'opération « mains propres » en Italie à « l'affaire Dutroux » en Belgique, en passant par le battage « anti-Le Pen » en France. Et dans cette offensive, le rôle dévolu à la campagne « anti-négationniste » est de présenter le fascisme comme « le mal absolu » et ce faisant de dédouaner le capitalisme comme un tout de sa responsabilité dans l'holocauste.
Encore une fois, nous voulons réaffirmer avec force que la Gauche communiste n'a aucune espèce de parenté, même lointaine, avec la mouvance « négationniste » rassemblant l'extrême-droite traditionnelle et « l'ultra-gauche », concept étranger à la Gauche communiste (1). Pour nous, il n'a jamais été question de nier ou de chercher à atténuer la terrifiante réalité des camps d'extermination nazis. Comme nous l'avons dit dans le numéro précédent de cette revue : « Vouloir amoindrir la barbarie du régime nazi, même au nom de la dénonciation de la mystification antifasciste, revient à amoindrir la barbarie du système capitaliste décadent, dont ce régime n'est qu'une des expressions. » Aussi, la dénonciation de l'antifascisme comme instrument de l'embrigadement du prolétariat dans le pire carnage inter-impérialiste de l'histoire et comme moyen de dissimuler quel est le vrai responsable de toutes ces horreurs, à savoir le capitalisme comme un tout, n'a jamais signifié la moindre complaisance dans la dénonciation du camp fasciste dont les premières victimes furent les militants prolétariens. L'essence de l'internationalisme prolétarien, dont la Gauche communiste s'est toujours faite le défenseur intransigeant – dans la droite ligne de la vraie tradition marxiste et donc à l'encontre de tous ceux qui l'ont bafouée et trahie, trotskistes en tête – a toujours consisté à dénoncer tous les camps en présence et à démontrer qu'ils sont tous également responsables des horreurs et des souffrances indicibles que toutes les guerres inter-impérialistes infligent à l'humanité.
Nous avons montré dans des numéros précédents de cette revue que la barbarie dont a fait preuve le « camp démocratique » durant la seconde boucherie mondiale n'avait rien à envier à celle du camp fasciste, dans l'horreur comme dans le cynisme avec lequel furent perpétrés ces crimes contre l'humanité que furent les bombardements de Dresde et de Hambourg ou encore le feu nucléaire s'abattant sur un Japon déjà vaincu ([2] [2838]). Nous nous attacherons dans cet article à montrer de quelle complicité consciente ont fait preuve les Alliés, en gardant soigneusement le silence jusqu'à la fin de la guerre sur les génocides auxquels se livrait le régime nazi, et ce alors que le « camp de la démocratie » n'ignorait rien de la réalité des camps de concentration et de leur fonction.
Le fascisme a été voulu et soutenu par la bourgeoisie
Avant de démonter la complicité des Alliés par rapport aux crimes perpétrés par les nazis dans les camps, il est bon de rappeler que l'avènement du fascisme – lequel, de la droite classique à la gauche et jusqu'à l'extrême gauche du capital, est toujours présenté comme un monstrueux accident de l'histoire, comme une pure aberration surgie du cerveau malade d'un Hitler ou d'un Mussolini – est au contraire bel et bien le produit organique du capitalisme dans sa phase de décadence, le résultat de la défaite subie par le prolétariat dans la vague révolutionnaire qui a fait suite à la première guerre mondiale.
Le mensonge selon lequel la classe dominante ne savait pas quels étaient les vrais projets du parti nazi, en d'autres termes qu'elle se serait fait piéger, ne tient pas un seul instant face à l'évidence des faits historiques. L'origine du parti nazi plonge ses racines dans deux facteurs qui vont déterminer toute l'histoire des années 1930 : d'une part l'écrasement de la révolution allemande ouvrant la porte au triomphe de la contre-révolution à l'échelle mondiale et d'autre part la défaite essuyée par l'impérialisme allemand à l'issue de la première boucherie mondiale. Dès le départ, les objectifs du parti fasciste naissant sont, sur la base de la terrible saignée infligée à la classe ouvrière en Allemagne par le Parti social-démocrate, le SPD des Noske et Scheidemann, de parachever l'écrasement du prolétariat afin de reconstituer les forces militaires de l'impérialisme allemand. Ces objectifs étaient partagés par l'ensemble de la bourgeoisie allemande, au-delà des divergences réelles tant sur les moyens à employer que sur le moment le plus opportun pour les mettre en oeuvre. Les SA, milices sur lesquelles s'appuie Hitler dans sa marche vers le pouvoir, sont les héritiers directs des corps francs qui ont assassiné Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht ainsi que des milliers de communistes et de militants ouvriers. La plupart des dirigeants SA ont commencé leur carrière de bouchers dans ces mêmes corps francs. Ils ont été « la garde blanche » utilisée par le SPD au pouvoir pour écraser dans la sang la révolution, et cela avec l'appui des très démocratiques puissances victorieuses. Celles-ci d'ailleurs, tout en désarmant l'armée allemande, ont toujours veillé à ce que ces milices contre-révolutionnaires disposent des armes suffisantes pour accomplir leur sale besogne. Le fascisme n'a pu se développer et prospérer que sur la base de la défaite physique et idéologique infligée au prolétariat par la gauche du capital, laquelle était seule en mesure d'endiguer puis de vaincre la vague révolutionnaire qui submergea l'Allemagne en 1918-19. C'est ce qu'avait compris parfaitement l'état-major de l'armée allemande en donnant carte blanche au SPD afin de porter un coup décisif au mouvement révolutionnaire qui se développait en janvier 1919. Et si Hitler ne fut pas suivi dans sa tentative de putsch à Munich en 1923, c'est parce que l'avènement du fascisme était jugé encore prématuré par les secteurs les plus lucides de la classe dominante. Il fallait, au préalable, parachever la défaite du prolétariat en utilisant jusqu'au bout la carte de la mystification démocratique. Celle-ci était loin d'être usée et bénéficiait encore, au travers de la République de Weimar (bien que présidée par le junker Hindenburg), d'un vernis radical grâce à la participation régulière, dans ses gouvernements successifs, de ministres venant du soi-disant parti « socialiste ».
Mais dès que la menace prolétarienne fut définitivement conjurée, la classe dominante, sous sa forme – soulignons le – la plus classique, au travers des fleurons du capitalisme allemand tels Krupp, Thyssen, AG Farben, n'aura de cesse de soutenir de toutes ses forces le parti nazi et sa marche victorieuse vers le pouvoir. C'est que, désormais, la volonté de Hitler de réunir toutes les forces nécessaires à la restauration de la puissance militaire de l'impérialisme allemand, correspondait parfaitement aux besoins du capital national. Ce dernier, vaincu et spolié par ses rivaux impérialistes suite à la première guerre mondiale, ne pouvait que chercher à reconquérir le terrain perdu en s'engageant dans une nouvelle guerre. Loin d'être le produit d'une prétendue agressivité congénitale germanique qui aurait enfin trouvé dans le fascisme le moyen de se déchaîner, cette volonté n'était que la stricte expression des lois de l'impérialisme dans la décadence du système capitaliste comme un tout. Face à un marché mondial entièrement partagé, ces lois ne laissent aucune autre solution aux puissances impérialistes lésées dans le partage du « gâteau impérialiste » que celle d'essayer, en engageant une nouvelle guerre, d'en arracher une plus grosse part. La défaite physique du prolétariat allemand d'une part, et le statut de puissance impérialiste spoliée dévolu à l'Allemagne suite à sa défaite en 1918 d'autre part, firent du fascisme – contrairement aux pays vainqueurs où la classe ouvrière n'avait pas été physiquement écrasée – le moyen le plus adéquat pour que le capitalisme allemand puisse se préparer à la seconde boucherie mondiale. Le fascisme n'était qu'une forme brutale du capitalisme d'Etat qui était en train de se renforcer partout, y compris dans les Etats dits « démocratiques ». Il était l'instrument de la centralisation et de la concentration de tout le capital dans les mains de l'Etat face à la crise économique, pour orienter l'ensemble de l'économie en vue de la préparation à la guerre. C'est donc le plus démocratiquement du monde, c'est-à-dire avec l'aval total de la bourgeoisie allemande, qu'Hitler arriva au pouvoir. En effet, une fois la menace prolétarienne définitivement écartée, la classe dominante n'avait plus à se préoccuper de maintenir tout l'arsenal démocratique, suivant en cela le processus alors déjà à l'oeuvre en Italie.
Le capitalisme décadent exacerbe le racisme
« Oui, peut-être... » nous dira-t-on, « mais ne faites-vous pas abstraction de l'un des traits qui distinguent le fascisme de tous les autres partis et fractions de la bourgeoisie, à savoir, son antisémitisme viscéral, alors que c'est justement cette caractéristique particulière qui a provoqué l'holocauste ? » C'est cette idée que défendent en particulier les trotskistes. Ceux-ci, en effet, ne reconnaissent formellement la responsabilité du capitalisme et de la bourgeoisie en général dans la genèse du fascisme que pour ajouter aussitôt que ce dernier est malgré tout bien pire que la démocratie bourgeoise, comme en témoigne l'holocauste. Selon eux donc, devant cette idéologie du génocide, il n'y a pas à hésiter un seul instant : il faut choisir son camp, celui de l'antifascisme, celui des Alliés. Et c'est cet argument, avec celui de la défense de l'URSS, qui leur a servi à justifier leur trahison de l'internationalisme prolétarien et leur passage dans le camp de la bourgeoisie durant la seconde guerre mondiale. Il est donc parfaitement logique de retrouver aujourd'hui en France par exemple, les groupes trotskistes – la Ligue Communiste Révolutionnaire et son leader Krivine avec le soutien discret, mais bien réel, de Lutte Ouvrière – en tête de la croisade antifasciste et « anti-négationniste », défendant la vision selon laquelle le fascisme est le « mal absolu » et, de ce fait, qualitativement différent de toutes les autres expressions de la barbarie capitaliste ; ceci impliquant que face à lui, la classe ouvrière devrait se porter à l'avant-garde du combat et défendre voire revitaliser la démocratie.
Que l'extrême droite (le nazisme en particulier) soit profondément raciste, cela n'a jamais été contesté par la Gauche communiste pas plus d'ailleurs que la réalité effrayante des camps de la mort. La vraie question est ailleurs. Elle consiste à savoir si ce racisme et la répugnante désignation des juifs comme boucs-émissaires, responsables de tous les maux, ne serait que l'expression de la nature particulière du fascisme, le produit maléfique de cerveaux malades ou s'il n'est pas plutôt le sinistre produit du mode de production capitaliste confronté à la crise historique de son système, un rejeton monstrueux mais naturel de l'idéologie nationaliste défendue et propagée par la classe dominante toutes fractions confondues. Le racisme n'est pas un attribut éternel de la nature humaine. Si l'entrée en décadence du capitalisme a exacerbé le racisme à un degré jamais atteint auparavant dans toute l'histoire de l'humanité, si le 20e siècle est un siècle où les génocides ne sont plus l'exception mais la règle, cela n'est pas dû à on ne sait quelle perversion de la nature humaine. C'est le résultat du fait que, face à la guerre désormais permanente que doit mener chaque Etat dans le cadre d'un marché mondial sursaturé, la bourgeoisie, pour être à même de supporter et de justifier cette guerre permanente, se doit, dans tous les pays, de renforcer le nationalisme par tous les moyens. Quoi de plus propice, en effet, à l'épanouissement du racisme que cette atmosphère si bien décrite par Rosa Luxemburg au début de sa brochure de dénonciation du premier carnage mondial : « (...) la population de toute une ville changée en populace, prête à dénoncer n'importe qui, à molester les femmes, à crier : hourrah, et à atteindre au paroxysme du délire en lançant elle-même des rumeurs folles ; un climat de crime rituel, une atmosphère de pogrom, où le seul représentant de la dignité humaine était l'agent de police au coin de la rue. » Et elle poursuit en disant : « Souillée, déshonorée, pataugeant dans le sang, couverte de crasse, voilà comment se présente la société bourgeoise, voilà ce qu'elle est... » (La crise de la Social-démocratie). On pourrait reprendre exactement les mêmes termes pour décrire les multiples scènes d'horreur en Allemagne durant les années 1930 (pillages des magasins juifs, lynchages, enfants séparés de leurs parents) ou évoquer, entre autres, l'atmosphère de pogrom qui régnait en France en 1945 quand le journal stalinien du PCF titrait odieusement : « A chacun son boche ! ». Non, le racisme n'est pas l'apanage exclusif du fascisme, pas plus que sa forme antisémite. Le célèbre Patton, général de la très « démocratique » Amérique, celle-là même qui était censée libérer l'humanité de « la bête immonde », ne déclarait-il pas, lors de la libération des camps : « Les juifs sont pires que des animaux » ; tandis que l'autre grand « libérateur », Staline, organisa lui-même des séries de pogroms contre les juifs, les tziganes, les tchétchènes, etc. Le racisme est le produit de la nature foncièrement nationaliste de la bourgeoisie, quelle que soit la forme de sa domination, « totalitaire » ou « démocratique ». Son nationalisme atteint son point culminant avec la décadence de son système.
La seule force en mesure de s'opposer à ce nationalisme qui suintait par tous les pores de la société bourgeoise pourrissante, à savoir le prolétariat, était vaincue, défaite physiquement et idéologiquement. De ce fait le nazisme, avec l'assentiment de l'ensemble de sa classe, put s'appuyer notamment sur le racisme latent de la petite-bourgeoisie pour en faire, sous sa forme antisémite, l'idéologie officielle du régime. Encore une fois, aussi irrationnel et monstrueux que soit l'antisémitisme professé puis mis en pratique par le régime nazi, il ne saurait s'expliquer par la seule folie et perversité, par ailleurs bien réelles, des dirigeants nazis. Comme le souligne très justement la brochure publiée par le Parti Communiste International, Auschwitz ou le grand alibi, l'extermination des juifs « ... a eu lieu, non pas à un moment quelconque, mais en pleine crise et guerre impérialistes. C'est donc à l'intérieur de cette gigantesque entreprise de destruction qu'il faut l'expliquer. Le problème se trouve de ce fait éclairci : nous n'avons plus à expliquer le "nihilisme destructeur" des nazis, mais pourquoi la destruction s'est concentrée en partie sur les juifs. »
Pour expliquer pourquoi la population juive, même si elle ne fut pas la seule, fut désignée tout d'abord à la vindicte générale, puis exterminée en masse par le nazisme, il faut prendre en compte deux facteurs : les besoins de l'effort de guerre allemand et le rôle joué dans cette sinistre période par la petite bourgeoisie. Cette dernière fut réduite à la ruine par la violence de la crise économique en Allemagne et sombra massivement dans une situation de lumpen prolétarisation. Dès lors, désespérée et en l'absence d'un prolétariat pouvant jouer le rôle de contrepoison, elle donna libre cours à tous les préjugés les plus réactionnaires, caractéristiques de cette classe sans avenir, et se jeta, telle une bête furieuse, encouragée par les formations fascistes, dans le racisme et l'antisémitisme. Le « juif » était supposé représenter la figure par excellence de « l'apatride » qui « suce le sang du peuple » ; il était désigné comme le responsable de la misère à laquelle était réduite la petite-bourgeoisie. Voila pourquoi les premières troupes de choc utilisées par les nazis étaient issues des rangs d'une petite-bourgeoisie en train de sombrer. Et cette désignation du « juif » comme l'ennemi par excellence aura aussi comme fonction de permettre à l'Etat allemand, grâce à la confiscation des biens des juifs, de ramasser des fonds destinés à contribuer à son réarmement militaire. Au début, il dut le faire discrètement pour ne pas attirer l'attention de ses vainqueurs de la première guerre mondiale. Les camps de déportation, au départ, eurent la fonction de fournir à la bourgeoisie une main d'oeuvre gratuite, toute entière dédiée à la préparation de la guerre.
Le silence complice des Alliés sur l'existence des camps de la mort
Alors que, de 1945 à aujourd'hui, la bourgeoisie n'a eu de cesse de nous exhiber, de façon obscène, les montagnes de squelettes trouvés dans les camps d'extermination nazis et les corps affreusement décharnés des survivants de cet enfer, elle fut très discrète sur ces mêmes camps pendant la guerre elle-même, au point que ce thème fut absent de la propagande guerrière du « camp démocratique ». La fable que nous ressert régulièrement la bourgeoisie selon laquelle ce n'est qu'avec la libération des camps en 1945 que les Alliés se seraient véritablement rendus compte de ce qui se passait à Dachau, Auschwitz ou Treblinka, ne résiste pas à la moindre étude historique. Les services de renseignement existaient déjà et étaient très actifs et efficaces comme l'attestent des centaines d'épisodes de la guerre où ils jouèrent un rôle déterminant ; et l'existence des camps de la mort ne pouvait échapper à leur investigation. Cela est confirmé par toute une série de travaux d'historiens de la seconde guerre mondiale. Ainsi le journal français Le Monde, par ailleurs très actif dans la campagne « anti-négationniste », écrit dans son édition du 27 septembre 1996 : « Un massacre [celui perpétré dans les camps] dont un rapport du parti social-démocrate juif, le Bund polonais, avait, dès le printemps 1942, révélé l'ampleur et le caractère systématique fut officiellement confirmé aux officiels américains par le fameux télégramme du 8 août 1942, émis par G. Riegner, représentant du Congrès Juif mondial à Genève, sur la base d'informations fournies par un industriel allemand de Leipzig du nom d'Edouard Scholte. A cette époque on le sait, une grande partie des juifs européens promis à la destruction étaient encore en vie. » On voit donc que les gouvernements Alliés au travers de multiples canaux, étaient parfaitement au courant des génocides en cours dès 1942. Pourtant les dirigeants du « camp démocratique », les Roosevelt, Churchill et consorts, firent tout pour que ces révélations, pourtant incontestables, ne fassent l'objet d'aucune publicité et donnèrent à la presse de l'époque des consignes d'extrême discrétion sur ce sujet. En fait ils ne levèrent pas le moindre petit doigt pour tenter de sauver la vie de ces millions de condamnés à mort. C'est ce que confirme ce même article du journal Le Monde : « (...) l'Américain D. Wyman a montré, au milieu des années 1980, dans son livre Abandon des juifs (Calmann-Lévy), que quelques centaines de milliers d'existences auraient pu être épargnées sans l'apathie, voir l'obstruction, de certains organes de l'administration américaine (comme le Département d'Etat) et des Alliés en général. » Ces extraits de ce très bourgeois et démocratique journal ne font que confirmer ce qu'a toujours affirmé à ce propos la Gauche communiste, en particulier dans la brochure Auschwitz ou le grand alibi. Et c'est ce texte qui est aujourd'hui désigné à la vindicte comme étant, ce qui est un mensonge infâme, à l'origine des thèses « négationnistes ». Le silence de la coalition impérialiste opposée à l'Allemagne hitlérienne montre déjà ce que valent ces vertueuses et tonitruantes proclamations d'indignation devant l'horreur des camps après 1945.
Ce silence s'expliquerait-il par l'antisémitisme latent de certains dirigeants Alliés comme l'ont soutenu des historiens israéliens après la guerre ? Que l'antisémitisme ne soit pas l'apanage des tenants des régimes fascistes est, comme nous l'avons évoqué plus haut, une chose certaine. Mais ce n'est pas là la véritable explication du silence des Alliés dont d'ailleurs certains des dirigeants étaient juifs ou très proches des organisations juives, comme Roosevelt par exemple. Non, là encore, l'origine de cette remarquable discrétion réside dans les lois qui régissent le système capitaliste, quels que soient les oripeaux, démocratiques ou totalitaires, dont il drape sa domination. Comme pour l'autre camp, toutes les ressources du camp Allié étaient mobilisées au service de la guerre. Pas de bouches inutiles, tout le monde doit être occupé, soit au front, soit dans la production d'armements. L'arrivée en masse des populations en provenance des camps, des enfants et des vieillards qu'on ne pouvait pas envoyer au front ou à l'usine, des hommes et des femmes malades et épuisés qu'on ne pouvait immédiatement intégrer dans l'effort de guerre, aurait désorganisé ce dernier. Dès lors on ferme les frontières et on empêche par tous les moyens une telle immigration. Le ministre de sa très gracieuse et très démocratique majesté britannique, A. Eden décida en 1943 (c'est-à-dire à une période où la bourgeoisie anglo-saxonne n'ignorait rien de la réalité des camps), à la demande de Churchill, « qu'aucun navire des Nations unies ne peut être habilité à effectuer le transfert des réfugiés d'Europe. » Et Roosevelt ajoutait que « transporter tant de monde désorganiserait l'effort de guerre » (Churchill, Mémoires, T.10). Voilà les sordides raisons qui conduisirent ces « grands démocrates » et « antifascistes » patentés à garder le silence sur ce qui se passait à Dachau, Buchenwald et autres lieux de sinistre mémoire ! Les considérations humanitaires qui étaient censées les animer n'avaient pas leur place devant leurs sordides intérêts capitalistes et les besoins de l'effort de guerre.
La complicité directe du « camp démocratique » dans l'holocauste
Les Alliés ne se contentèrent pas d'entretenir soigneusement le silence durant toute la guerre sur les génocides perpétrés dans les camps ; ils allèrent beaucoup plus loin dans le cynisme et l'abjection. Si d'un côté ils n'ont jamais hésité à faire tomber un déluge de bombes sur les populations allemandes, pour l'essentiel ouvrières, de l'autre ils se sont refusés à tenter la moindre opération militaire en direction des camps de la mort. Ainsi, alors que dès le début 1944 ils pouvaient sans difficultés bombarder les voies ferrées menant à Auschwitz, ils se sont volontairement abstenus. Non seulement cet objectif était à ce moment-là à portée de leur aviation mais deux évadés du camp leur avaient décrit en détail le fonctionnement de celui-ci et la topographie des lieux.
Dans l'article cité plus haut, Le Monde rapporte : « des dirigeants juifs hongrois et slovaques supplient les Alliés de passer à l'action, alors que les déportations des juifs de Hongrie ont commencé. Ils désignent même un objectif : le carrefour ferroviaire de Kosice-Pressow. Les allemands pouvaient, il est vrai, assez rapidement réparer les voies. Mais cet argument ne vaut pas pour la destruction des crématoires de Birkenau, qui aurait incontestablement désorganisé la machine d'extermination. Rien ne sera fait. En définitive, il est difficile de ne pas reconnaître que même le minimum n'a pas été tenté, noyé qu'il a été par la mauvaise volonté des états-majors et des diplomates. »
Mais contrairement à ce que déplore ce journal bourgeois, ce n'est pas par une simple « mauvaise volonté » ou « lourdeur bureaucratique » que le « camp démocrate » fut complice de l'holocauste. Cette complicité fut, comme on va le voir, totalement consciente. Les camps de déportation furent au début essentiellement des camps de travail où la bourgeoisie allemande pouvait bénéficier à moindre coût d'une main d'oeuvre réduite à l'esclavage, toute entière consacrée à l'effort de guerre. Même si déjà à l'époque il existait des camps d'extermination, ils étaient jusqu'en 1942 plus l'exception que la règle. Mais à partir des premiers revers militaires sérieux subis par l'impérialisme allemand, en particulier face au formidable rouleau compresseur mis en place par les Etats-Unis, le régime nazi ne pouvait déjà plus nourrir convenablement la population et les troupes allemandes. Il décida de se débarrasser de la population excédentaire enfermée dans les camps, et dès lors, les fours crématoires se répandirent un peu partout et accomplirent leur sinistre besogne. L'horreur indicible de ce qui se perpétrait dans les camps pour alimenter la machine de guerre allemande était le fait d'un impérialisme aux abois qui reculait sur tous les fronts. Cependant bien que l'holocauste fut perpétré sans le moindre état d'âme par le régime nazi et ses sbires, il ne rapportait pas grand chose au capitalisme allemand qui était, comme on l'a vu, lancé dans une course désespérée pour réunir les moyens nécessaires à une résistance efficace face à une avancée de plus en plus irrésistible des Alliés. C'est dans ce contexte que plusieurs négociations furent tentées par l'Etat allemand, en général directement par les SS, auprès des Alliés dans le but de chercher à se débarrasser, avec profit, de plusieurs centaines de milliers, voir de millions de prisonniers.
L'épisode le plus célèbre de ce sinistre marchandage fut celui qui a concerné Joël Brand, le dirigeant d'une organisation semi-clandestine de juifs hongrois. Ce dernier, comme l'a raconté A. Weissberg dans son livre L'histoire de J. Brand et comme cela a été repris dans la brochure Auschwitz ou le grand alibi, fut convoqué à Budapest pour y rencontrer le chef des SS chargé de la question juive, A. Eichmann. Celui-ci le chargea de négocier auprès des gouvernements anglo-américains la libération d'un million de juifs en échange de 10 000 camions. Eichmann était prêt à réduire ses prétentions, voire à accepter d'autres types de marchandises. Les SS, pour preuve de leur bonne foi et du caractère on ne peut plus sérieux de leur offre, se déclarèrent prêts à libérer sans contrepartie 100 000 juifs dès qu'un accord de principe serait obtenu par J. Brand. Dans un premier temps, celui-ci connut les pires difficultés (jusqu'à subir une incarcération dans des prisons anglaises du Proche-Orient) pour rencontrer des représentants des gouvernements Alliés. Ces difficultés n'étaient pas le fruit du hasard : à l'évidence, une rencontre officielle avec cet « empêcheur de tourner en rond » était à éviter.
Quand il put enfin discuter des propositions allemandes avec Lord Moyne, le responsable du gouvernement britannique pour le Proche-Orient, celui-ci lui opposa un refus catégorique qui n'avait rien de personnel (il ne faisait qu'appliquer les consignes du gouvernement britannique) et qui était encore moins l'expression d'un « refus moral face à un odieux chantage ». Aucun doute n'est en effet possible à la lecture du compte rendu que fit Brand de cette discussion : « Il le supplie de donner au moins un accord écrit, quitte à ne pas le tenir, ça ferait toujours 100 000 vies sauvées, Moyne lui demande alors quel serait le nombre total ? Eichmann a parlé d'un million. Comment imaginez-vous une chose pareille, mister Brand ? Que ferais-je de ce million de juifs ? Où les mettrai-je ? Qui les accueillera ? Si la terre n'a plus de place pour nous, il ne nous reste plus qu'à nous laisser exterminer dit Brand désespéré. » Comme le souligne très justement Auschwitz ou le grand alibi à propos de ce glorieux épisode de la seconde boucherie mondiale : « Malheureusement si l'offre existait, il n'y avait pas de demande ! Non seulement les juifs mais aussi les SS s'étaient laissés prendre à la propagande humanitaire des alliés Les alliés n'en voulaient pas de ce million de juifs ! Pas pour 10 000 camions, pas pour 5 000, même pas pour rien. »
Une certaine historiographie récente tente de montrer que ce refus était avant tout dû au veto opposé par Staline face à ce type de marchandage. Ce n'est là qu'une tentative de plus pour chercher à masquer et à atténuer la responsabilité des « grandes démocraties » et leur complicité directe dans l'holocauste. C'est ce que révèle la mésaventure survenue au naïf J. Brand dont on ne peut sérieusement contester le témoignage. De plus, durant toute la guerre, ni Roosevelt ni Churchill n'ont eu pour habitude de se laisser dicter leur conduite par Staline. Avec le « petit père des peuples », ils étaient plutôt au diapason, faisant preuve du même cynisme et de la même brutalité. Le très « humaniste » Roosevelt opposera d'ailleurs le même refus à d'autres tentatives ultérieures des nazis, en particulier lorsque, fin 1944, ils essayèrent encore de vendre des juifs à l' « Organisation des Juifs Américains », transférant pour preuve de leur bonne volonté près de 2 000 juifs en Suisse, comme le raconte dans le détail Y. Bauer dans un livre intitulé Juifs à vendre (Editions Liana Levi).
Tout ceci n'est ni une bavure ni le fait de dirigeants devenus « insensibles » à cause des terribles sacrifices qu'exigeait la conduite de la guerre contre la féroce dictature fasciste comme veut le faire croire la bourgeoisie. L'antifascisme n'a jamais exprimé un réel antagonisme entre d'un côté un camp défendant la démocratie et ses valeurs, et de l'autre un camp totalitaire. Il n'a été dès le départ qu'un « chiffon rouge » agité devant les yeux des prolétaires pour justifier la guerre à venir en masquant son caractère classiquement inter-impérialiste pour le repartage du monde entre les grands requins capitalistes (c'est ce que l'Internationale Communiste avait mis en avant dès la signature du Traité de Versailles et qu'il fallait absolument gommer de la mémoire ouvrière). Il a été surtout le moyen de les embrigader dans la plus gigantesque boucherie de l'histoire. Si, pendant la guerre, il fallait faire le silence sur les camps et fermer soigneusement les frontières à tous ceux qui tentaient d'échapper à l'enfer nazi pour « ne pas désorganiser l'effort de guerre », après la fin de la guerre il en a été tout autrement. L'immense publicité faite soudain, à partir de 1945, aux camps de la mort représentait une formidable aubaine pour la bourgeoisie. Braquer tous les projecteurs sur la réalité monstrueuse des camps de la mort permettait en effet aux Alliés de masquer les crimes innombrables qu'ils avaient eux-mêmes perpétrés. Ce battage assourdissant permettait aussi d'enchaîner solidement une classe ouvrière (qui risquait de renâcler contre les immenses sacrifices et la misère noire qu'elle continuait de subir même après la « Libération ») au char de la démocratie. Celle-ci était présentée par tous les partis bourgeois, de la droite aux staliniens, comme une valeur commune aux bourgeois et aux ouvriers, valeur qu'il fallait absolument défendre pour éviter, à l'avenir, de nouveaux holocaustes.
En attaquant la Gauche communiste aujourd'hui, la bourgeoisie, en fidèle adepte de Goebbels, met en pratique son célèbre adage selon lequel plus un mensonge est gros plus il a de chances d'être cru. Elle cherche en effet à la présenter comme l'ancêtre du « négationnisme ». La classe ouvrière doit rejeter une telle calomnie et se souvenir qui a fait fi du terrible sort réservé aux déportés dans les camps, qui a utilisé cyniquement ces même déportés pour en faire le symbole de la supériorité intangible de la démocratie bourgeoise et justifier ainsi le système d'exploitation et de mort qu'est le capitalisme. Aujourd'hui face à tous les efforts de la classe dominante pour raviver la mystification démocratique notamment au moyen de l'antifascisme, la classe ouvrière doit se souvenir ce qui lui est advenu, durant les années 1930-40, quand elle s'est faite piéger par ce même antifascisme et qu'elle a finalement servi de chair à canon au nom de « la défense de la démocratie ».
RN.
Evènements historiques:
- Deuxième guerre mondiale [1286]
Courants politiques:
Questions théoriques:
- Décomposition [3]
Revolution allemande (VII) : la fondation du K.A.P.D
- 4830 reads
Nous avons vu dans l'article précédent comment le KPD, privé de ses meilleurs éléments assassinés, soumis à la répression, ne parvient pas à jouer le rôle qui lui incombe, et comment les conceptions organisationnelles erronées vont mener au désastre, jusqu'à l'exclusion de la majorité des membres du parti ! Et c'est dans la confusion politique et dans une situation générale d'ébullition que va se constituer le KAPD.
Les 4 et 5 avril 1920, trois semaines après le début du putsch de Kapp et la vague de luttes de riposte que celui-ci a soulevé dans toute l'Allemagne, des délégués de l'opposition se réunissent pour porter un nouveau parti sur les fonds baptismaux : le Parti Communiste Ouvrier d'Allemagne (Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands, KAPD).
Il s'agit de fonder enfin un « parti de l'action révolutionnaire » et disposer d'une force qui s'oppose au cours opportuniste du KPD.
Aussi lourdes de conséquences que soient les erreurs du KPD durant le putsch de Kapp, elles ne peuvent en aucune façon justifier la fondation d'un nouveau parti. Sans avoir auparavant épuisé toutes les possibilités du travail de fraction, on fonde à la hâte, dans une complète précipitation un nouveau parti, en partie par « frustration », presque sur un coup de colère. Les délégués sont issus pour l'essentiel de Berlin et de quelques autres villes. Ils représentent environ 20 000 membres.
Tout comme le KPD lors de son congrès de fondation, le tout nouveau KAPD est de composition très hétérogène. Il représente plutôt un rassemblement des opposants et des exclus du KPD. ([1] [2841])
Il est formé de trois tendances :
- La tendance de Berlin est dirigée par des intellectuels comme Schröder, Schwab et Reichenbach, tous issus du milieu des Etudiants Socialistes, ainsi que par des ouvriers comme Emil Sachs, Adam Scharrer et Jan Appel, excellents organisateurs. Leur point de vue est que les Unions ne sont qu'une branche dépendante du parti; ils rejettent toute forme de syndicalisme révolutionnaire et de fédéralisme anarchisant. Cette tendance représente l'aile marxiste au sein du KAPD.
- La tendance « anti-parti », dont le principal porte-parole est Otto Rühle, forme, comme telle, un regroupement plutôt hétéroclite. Concentrer toutes ses forces sur les Unions est la seule orientation qui l'unit. C'est une tendance syndicaliste-révolutionnaire.
- La tendance nationale-bolchevik, autour de Wolffheim et de Laufenberg, est principalement implantée à Hambourg. Même si Wolffheim et Laufenberg ne participent pas directement à la création du KAPD, ils y adhèrent en vue de l'infiltrer.
Très vite le KAPD va connaître une affluence de jeunes ouvriers radicalisés qui ne possèdent que peu d'expérience organisationnelle mais sont portés par un énorme enthousiasme. De nombreux membres de la section de Berlin n'ont que peu de liens avec le mouvement ouvrier d'avant-guerre. De plus la première guerre mondiale a engendré une radicalisation chez de nombreux artistes et intellectuels (F. Jung, poète; H. Vogeler, membre d'une communauté; F. Pfemfert, O. Kanehl, artiste, etc.) qui sont massivement attirés par le KPD puis par le KAPD. La plupart d'entre eux y joueront un rôle désastreux. Tout comme les intellectuels bourgeois avec leur influence après 1968, ils défendent des visions individualistes et propagent largement l'hostilité envers l'organisation, la méfiance envers la centralisation, le fédéralisme. Ce milieu est facilement contaminé par l'idéologie et les comportements petits-bourgeois et s'en fait le porteur. Il ne s'agit pas de donner d'emblée une image négative du KAPD, contrairement à ceux qui le taxent, à la légère, de « petit-bourgeois ». Mais l'influence de ce milieu va peser et fortement marquer le parti. Ces cercles intellectuels contribuent à l'apparition d'une idéologie encore inédite dans le mouvement ouvrier, celle du « Proletkult » (« culte du prolétaire »), tout en étant les adversaires de tout approfondissement théorique. L'aile marxiste du KAPD, dés le début, se démarque de ces éléments hostiles à l'organisation.
Les faiblesses sur la question organisationnelle conduisent à la disparition de l'organisation
L'objectif de cet article n'est pas d'examiner de très près les positions du KAPD (pour cela se reporter à de notre livre La Gauche hollandaise). Celui-ci, malgré toutes ses faiblesses théoriques, fournit une contribution historiquement précieuse sur les questions syndicale et parlementaire. Il a accompli un travail de pionnier dans l'approfondissement de la compréhension des raisons qui rendent impossible tout travail au sein des syndicats dans le capitalisme en décadence, qui font que ceux-ci se sont transformés en organes de l'Etat bourgeois ; il en a fait de même concernant l'impossibilité d'utiliser le parlement au profit des intérêts ouvriers, celui-ci n'étant plus qu'une arme contre le prolétariat.
Concernant le rôle du parti, le KAPD est le premier à développer un point de vue clair sur la question du substitutionisme. Contrairement à la majorité de l'IC, il reconnaît que dans cette nouvelle période, celle de la décadence du capitalisme, les partis de masses ne sont plus possibles :
« 7. La forme historique pour le rassemblement des combattants prolétariens les plus conscients, les plus clairs, les plus disposés à l'action est le Parti. (...) Le Parti communiste doit être une totalité élaborée programmatiquement, organisée et disciplinée dans une volonté unitaire. Il doit être la tête et l'arme de la révolution. (...)
9. (...) En particulier, il ne devra jamais accroître l'effectif de ses membres plus rapidement que ne le permet la force d'intégration du noyau communiste solide. »
(Thèses sur le rôle du parti dans la révolution prolétarienne, Thèses du KAPD, Proletarier n° 7, juillet 1921)
Si nous faisons ressortir en premier lieu les apports programmatiques du KAPD, c'est pour souligner qu'en dépit des faiblesses fatales de celui-ci, que nous allons aborder, la Gauche communiste doit s'en réclamer. Mais le KAPD va démontrer par la suite qu'il ne suffit pas d'être clair « programmatiquement sur des questions-clés ». Tant que l'on n'a pas une compréhension suffisamment claire de la question organisationnelle, la clarté programmatique ne présente aucune garantie pour la survie de l'organisation. Ce qui est déterminant ce n'est pas seulement la capacité de se doter de bases programmatiques solides mais c'est surtout celle de construire l'organisation, de la défendre et de lui donner la force de remplir son rôle historique. Sinon, il y a le danger qu'elle ne se déchire sous l'action de fausses conceptions organisationnelles et qu'elle ne résiste pas aux vicissitudes de la lutte de classes.
Dans l'un de ses premiers points à l'ordre du jour, lors de son congrès de fondation, le KAPD déclare son rattachement immédiat à l'Internationale Communiste sans avoir préalablement demandé son admission à celle-ci. Alors que, dès le départ, son but est de rejoindre le mouvement international, le souci central exprimé dans la discussion va être de mener « le combat contre le Spartakusbund au sein de la 3e Internationale. »
Dans une discussion avec des représentants du KPD, il déclare : « Nous considérons la tactique réformiste du Spartakusbund en contradiction avec les principes de la 3e Internationale, nous allons oeuvrer à l'exclusion du Spartakusbund hors de la 3e Internationale. » (Procès-verbal du congrès de fondation du parti, cité par Bock). Au cours de cette discussion c'est toujours la même idée qui resurgit comme leitmotiv :
« Nous refusons la fusion avec le Spartakusbund et nous le combattrons avec acharnement. (...) Notre position vis-à-vis du Spartakusbund est claire et simple à préciser : nous pensons que les chefs compromis doivent être exclus du front de la lutte prolétarien et nous aurons la voie libre pour que les masses marchent ensembles selon le programme maximaliste. Il est décidé qu'une délégation de deux camarades sera formée pour présenter un rapport oral au Comité Exécutif de la 3e Internationale. » (Idem)
Si la lutte politique contre les positions opportunistes du Spartakusbund est indispensable, cette attitude hostile envers le KPD reflète une complète distorsion des priorités. Au lieu d'impulser une clarification envers le KPD avec l'objectif d'établir les conditions pour l'unification, c'est une attitude sectaire, irresponsable et destructrice pour chaque organisation qui prédomine. Cette attitude est surtout impulsée par la tendance nationale-bolchevik de Hambourg.
Que le KAPD, lors de sa fondation, ait accepté la tendance nationale-bolchevik dans ses rangs est une catastrophe. Ce courant est anti-prolétarien. A elle seule sa présence au sein du KAPD fait d'emblée lourdement chuter la crédibilité de celui-ci aux yeux de l'Internationale communiste. ([2] [2842])
Jan Appel et Franz Jung sont nommés délégués au deuxième congrès de l'IC siégeant en juillet 1920. ([3] [2843])
Dans les discussions avec le Comité exécutif de l'IC (CEIC) où ils représentent le point de vue du KAPD, ils assurent que le courant national-bolchevik autour de Wolffheim et Laufenberg, tout comme la tendance « anti-parti » de Rühle seront exclus du KAPD. Sur la question syndicale et parlementaire, les points de vue du CEIC et du KAPD s'affrontent violemment. Lénine vient juste de terminer sa brochure Le gauchisme, maladie infantile du communisme. En Allemagne, le parti, ne recevant plus aucune nouvelle de ses délégués à cause du blocus militaire, décide l'envoi d'une seconde délégation composée de O. Rühle et de Merges. Il ne pouvait faire pire.
Rühle est, en effet, le représentant de la minorité fédéraliste qui souhaite dissoudre le parti communiste pour le fondre dans le système des Unions. Refusant toute centralisation, cette minorité rejette également implicitement l'existence d'une Internationale. Après leur voyage à travers la Russie au cours duquel les deux délégués sont choqués par les conséquences de la guerre civile (21 armées se sont portées à l'assaut de la Russie) et ne voient qu'un « régime en état de siège », ils décident, sans en référer au parti, de repartir convaincus que « la dictature du parti bolchevik est le tremplin pour l'apparition d'une nouvelle bourgeoisie soviétique. » Malgré la demande pressante de Lénine, Zinoviev, Radek et Boukharine qui leur accordent des voix consultatives et les poussent à participer aux travaux du congrès, ils renoncent à toute participation. Le CEIC va jusqu'à leur accorder des voix délibératives et non plus consultatives. « Alors que nous étions déjà à Pétrograd sur le chemin du retour, l'Exécutif nous envoya une nouvelle invitation au Congrès, avec la déclaration qu'au KAPD serait garanti pendant ce congrès d'avoir le droit de disposer de voix délibératives, bien qu'il ne remplisse aucune des conditions draconiennes de la Lettre ouverte au KAPD ou n'ait promis de les remplir. »
Le résultat est que le deuxième congrès de l'IC se déroule sans que la voix critique des délégués du KAPD ne se fasse entendre. L'influence néfaste de l'opportunisme au sein de l'IC peut ainsi plus facilement se déployer. Le travail dans les syndicats est inscrit dans les 21 conditions d'admission dans l'IC comme condition impérative sans que la résistance du KAPD contre ce tournant opportuniste ne se fasse sentir lors de ce congrès.
De plus, il n'est pas possible que les différentes voix critiques vis-à-vis de cette évolution de l'IC se trouvent réunies lors du congrès. Par cette attitude dommageable des délégués du KAPD, il n'y a pas de concertation internationale ni d'action commune. L'opportunité d'un travail de fraction international fructueux vient d'être sacrifié.
Après le retour des délégués, le courant regroupé autour de Rühle est exclu du KAPD à cause de ses conceptions et de ses comportements hostiles à l'organisation. Les « conseillistes » ne rejettent pas seulement l'organisation politique du prolétariat, niant de ce fait le rôle particulier que doit jouer le parti dans le processus de développement de la conscience de classe du prolétariat (Voir à ce sujet les Thèses sur le parti du KAPD), ils joignent leur voix au choeur de la bourgeoisie pour défigurer l'expérience de la révolution russe. Au lieu de tirer les leçons des difficultés de la révolution russe, ils rejettent celle-ci et la caractérisent de révolution double (à la fois prolétarienne et bourgeoise ou bien petite-bourgeoise). Ce faisant ils se donnent eux mêmes le coup de grâce politique. Les « conseillistes » ne causent pas seulement des dégâts en niant le rôle du parti dans le développement de la conscience de classe mais ils contribuent activement à la dissolution du camp révolutionnaire et renforcent l'hostilité générale envers l'organisation. Après leur désintégration et leur dispersion, ils ne pourront accomplir aucune contribution politique. Ce courant existe encore aujourd'hui et se maintient principalement aux Pays-Bas (bien que son idéologie soit largement répandue au delà de ce pays).
Le Comité central du KAPD décide, lors du premier congrès ordinaire du parti en août 1920, qu'il ne s'agit pas de combattre la 3e Internationale mais de lutter en son sein jusqu'au triomphe des vues du KAPD. Cette attitude se différencie à peine de celle de la Gauche italienne mais se modifiera par la suite. La vision selon laquelle il faut former une « opposition » au sein de l'IC et non pas une fraction internationale ne donne pas la possibilité de développer une plateforme internationale de la Gauche communiste.
En novembre 1920, après le deuxième congrès du KAPD, une troisième délégation (dont font partie Gorter, Schröder et Rasch) part pour Moscou. L'IC reproche au KAPD d'être responsable de l'existence, dans le même pays, de deux organisations communistes (KPD et KAPD) et lui demande de mettre un terme à cette anomalie. Pour l'IC, l'exclusion de Rühle et des nationaux-bolcheviks autour de Wolffheim et Laufenberg ouvre la voie à la réunification des deux courants et doit permettre le regroupement avec l'aile gauche de l'USPD. Alors que le KPD et le KAPD prennent respectivement position, avec véhémence contre la fusion de leurs deux partis, le KAPD rejette par principe tout regroupement avec l'aile gauche de l'USPD. Malgré ce refus de la position de l'IC, le KAPD reçoit le statut de parti sympathisant de la 3e Internationale avec voix consultative.
Malgré cela, lors du troisième congrès de l'IC (du 26 juillet au 13 août 1921) la délégation du KAPD exprime à nouveau sa critique des positions de l'IC. Dans de nombreuses interventions elle affronte avec courage et détermination l'évolution opportuniste de l'IC. Mais la tentative d'ériger une fraction de gauche au cours du congrès échoue car parmi les différentes voix critiques provenant du Mexique, de Grande-Bretagne, de Belgique, d'Italie et des Etats-Unis, personne n'est prêt à effectuer ce travail de fraction international. Seul le KAP hollandais et les militants de Bulgarie rejoignent la position du KAPD. Pour finir la délégation se trouve confrontée à un ultimatum de la part de l'IC : dans les trois mois le KAPD doit fusionner avec le VKPD sinon il sera exclu de l'Internationale.
Par son ultimatum, l'IC commet une erreur lourde de conséquences, à l'instar du KPD qui, une année auparavant lors du congrès d'Heidelberg, avait réduit au silence les voix critiques qui existaient dans ses propres rangs. L'opportunisme, dans l'IC, a ainsi un obstacle de moins sur son chemin.
La délégation du KAPD refuse de prendre une décision immédiate sans en référer préalablement aux instances du parti. Le KAPD se trouve devant un choix difficile et douloureux (celui-ci se pose également pour l'ensemble du courant communiste de gauche) :
- soit il fusionne avec le VKPD, prêtant ainsi main forte au développement de l'opportunisme ;
- soit il se constitue en fraction externe de l'Internationale avec la volonté de reconquérir l'IC et même le parti allemand VKPD, en espérant que d'autres fractions significatives se forment simultanément ;
- soit il oeuvre dans la perspective que soient posées les conditions pour la formation d'une nouvelle internationale ;
- soit il proclame de façon totalement artificielle, la naissance d'une 4e Internationale.
A partir de juillet 1921, la direction du KAPD se laisse entraîner dans des décisions précipitées. Malgré l'opposition des représentants de la Saxe orientale et de Hanovre, malgré l'abstention du district le plus important de l'organisation (celui du Grand Berlin), la direction du parti fait accepter une résolution proclamant la rupture avec la 3e Internationale. Plus grave encore que cette décision, qui est prise en dehors du cadre d'un congrès du parti, est celle d'oeuvrer à la « construction d'une Internationale communiste ouvrière ».
Le congrès extraordinaire du KAPD du 11 au 14 septembre 1921 proclame, à l'unanimité, sa sortie immédiate de la 3e Internationale comme parti sympathisant.
En même temps, il considère toutes les sections de l'IC comme définitivement perdues. D'après lui, il ne peut plus surgir de fractions révolutionnaires du sein de l'Internationale. Déformant la réalité, il voit les différents partis de l'IC comme « des groupes auxiliaires politiques » au service du « capital russe ». Par emballement le KAPD, non seulement sous-estime le potentiel d'opposition internationale au développement de l'opportunisme dans l'IC, mais aussi porte atteinte aux principes régissant les rapports entre partis révolutionnaires. Cette attitude sectaire est un avant-goût de celle que vont adopter par la suite d'autres organisations prolétariennes. L'ennemi ne semble plus être le Capital mais les autres groupes auxquels l'on dénie la qualité de révolutionnaires.
Le drame de l'automutilation
Une fois exclu de l'IC, une autre faiblesse du KAPD va peser de tout son poids. Non seulement, lors de ses conférences, il n'y a quasiment pas d'évaluation globale du rapport de forces entre les classes au niveau international, mais il se borne plus ou moins à l'analyse de la situation en Allemagne et à souligner la responsabilité particulière de la classe ouvrière dans ce pays. Nul n'y est disposé à admettre que la vague révolutionnaire internationale est sur le reflux. De cette façon, au lieu de tirer les leçons de ce reflux et de redéfinir les nouvelles tâches de l'heure, il est affirmé que la « situation est archi-mûre pour la révolution ». Malgré cela, une majorité de membres s'éloigne du parti, surtout les jeunes qui ont rejoint le mouvement après la guerre, constatant que le moment des grandes luttes révolutionnaires est dépassé. En réaction à ce fait, il y a des tentatives, comme nous le montreront dans un autre article, d'affronter artificiellement la situation avec le développement d'une large tendance au putschisme et aux actions individuelles.
Au lieu de reconnaître le reflux de la lutte de classe, au lieu de mettre en oeuvre un patient travail de fraction à l'extérieur de l'Internationale, on aspire à la fondation d'une Internationale Communiste Ouvrière (KAI). Les sections de Berlin et de Bremerhaven s'élèvent contre ce projet mais restent minoritaires.
Simultanément, au cours de l'hiver 1921-22, l'aile regroupée autour de Schröder commence à rejeter la nécessité des luttes revendicatives. Selon elle, celles-ci sont, dans la période « de la crise mortelle du capitalisme », opportunistes ; et seules les luttes politiques posant la question du pouvoir doivent être soutenues. En d'autres termes, le parti ne peut remplir sa fonction que dans les périodes de luttes révolutionnaires. Il s'agit là d'une nouvelle variante de la conception « conseilliste » !
En mars 1922, Schröder obtient, grâce à la manipulation de la procédure des votes, une majorité pour sa tendance, ce qui ne reflète pas la réalité des rapports de forces dans le parti. En réaction le district du Grand Berlin, le plus important numériquement, exclut Sachs, Schröder et Goldstein du parti du fait de leur « comportement portant atteinte au Parti et de leur ambition personnelle démesurée. » Schröder, qui appartient à la majorité « officielle », réplique par l'exclusion du district de Berlin et va s'installer à Essen où il forme la « tendance d'Essen ». Il y a désormais deux KAPD et deux journaux portant le même nom. C'est alors que commence la période des accusations personnelles et des calomnies.
Au lieu de chercher à tirer les leçons de la rupture avec le KPD lors du congrès d'Heidelberg en octobre 1919 et celles de l'exclusion de l'IC, tout se passe, au contraire, comme si l'on voulait maintenir une continuité dans la série des fiascos ! Le concept de parti n'est plus qu'une simple étiquette dont s'affuble chacune des scissions qui se réduisent à quelques centaines de membres si ce n'est moins.
Le sommet du suicide organisationnel est atteint avec la fondation, par la tendance d'Essen, de l'Internationale Communiste Ouvrière (KAI) entre le 2 et le 6 avril 1922.
Après la naissance dans la précipitation du KAPD lui-même en avril 1920, sans qu'auparavant toute possibilité d'un travail de fraction de l'extérieur du KPD ne soit épuisée, il est décidé maintenant – juste après avoir quitté l'IC et après qu'une scission irresponsable ait provoqué l'apparition de deux tendances, celle d'Essen et celle de Berlin – de fonder précipitamment et ex-nihilo une nouvelle internationale ! Une création purement artificielle, comme si la fondation d'une organisation n'est qu'une question de volontarisme ! Il s'agit là d'une attitude complètement irresponsable qui entraîne un nouveau fiasco.
La tendance d'Essen se scinde à son tour en novembre 1923 pour donner le « Kommunitischer Rätebund » (Union Communiste des Conseils) ; une partie de cette tendance (Schröder, Reichenbach) retourne en 1925 dans le SPD et une autre se retire complètement de la politique.
Quant à la tendance de Berlin, elle parvient à se maintenir en vie un peu plus longtemps. A partir de 1926 elle se tourne vers l'aile gauche du KPD. A ce moment-là, elle compte encore environ 1 500 à 2 000 membres et la majorité de ses groupes locaux (surtout dans la Ruhr) a disparu. Elle connaît cependant un nouvel accroissement numérique (atteignant environ 6 000 membres) en se regroupant avec « Entschiedene Linke » (la « Gauche déterminée » qui a été exclue du KPD). Après une nouvelle scission en 1928, le KAPD. devient de plus en plus insignifiant.
Toute cette trajectoire nous le montre : les communistes de gauche en Allemagne ont, sur le plan organisationnel, des conceptions fausses qui leur sont fatales. Leur démarche organisationnelle est une catastrophe pour la classe ouvrière.
Après leur exclusion de l'IC et la farce de la création de la KAI, ils sont incapables d'accomplir un travail de fraction international conséquent. Cette tâche fondamentale sera prise en charge par la Gauche italienne. Il n'était possible de tirer les leçons de la vague révolutionnaire et de les défendre qu'à la condition de se maintenir en vie comme organisation. Et c'est précisément leurs faiblesses et leurs conceptions profondément erronées sur la question organisationnelle qui les a conduit à l'échec et à la disparition. Il est vrai que la bourgeoisie a, dés le début, tout fait, par la répression (d'abord avec la Social-démocratie, puis avec les staliniens et les fascistes), pour anéantir physiquement les communistes de gauche. Mais c'est leur incapacité à construire et à défendre l'organisation qui a fondamentalement contribué à leur mort politique et à leur destruction. L'héritage révolutionnaire en Allemagne est, abstraction faite de quelques rares cas, complètement réduit à néant. La contre-révolution a totalement triomphé. C'est pourquoi tirer les leçons léguées par l'expérience organisationnelle de la « Gauche allemande » et les assimiler constitue, pour les révolutionnaires d'aujourd'hui, une tâche fondamentale afin d'empêcher que le fiasco d'alors ne se répète.
Les conceptions organisationnelles fausses du KPD accélèrent sa trajectoire vers l'opportunisme
Le KPD, ayant exclu après 1919 l'opposition, se trouve pris dans le tourbillon dévastateur de l'opportunisme.
En particulier, il commence à entreprendre un travail dans les syndicats et au sein du Parlement. Alors qu'il s'agissait d'une question « purement tactique » lors de son deuxième congrès en octobre 1919, cette tache se transforme rapidement en « stratégie ».
Constatant que la vague révolutionnaire ne s'étend plus et même recule, le KPD cherche à « aller » vers les ouvriers « retardataires » et « bercés d'illusions » qui se trouvent dans les syndicats en construisant des « fronts unis » dans les entreprises. De plus, en décembre 1920, l'unification avec l'USPD centriste se réalise avec l'espoir d'avoir plus d'influence grâce à la création d'un parti de masse. Grâce à quelques succès lors des élections parlementaires, le KPD s'enfonce dans ses propres illusions en croyant que « plus on obtient de voix aux élections, plus on gagne de l'influence dans la classe ouvrière. » En fin de compte il va obliger ses militants à devenir membres des syndicats.
Sa trajectoire opportuniste s'accélère encore lorsqu'il ouvre la porte au nationalisme. Alors qu'il veut, à juste raison, exclure les nationaux-bolcheviks en 1919, à partir de 1920-21 il laisse entrer des éléments nationalistes par la petite porte.
Vis à vis du KAPD, il adopte une attitude de rejet inflexible. Lorsque l'Internationale admet ce dernier avec voix consultative en novembre 1920, il pousse au contraire à son exclusion.
Après les luttes de 1923, avec la montée en force du stalinisme en Russie, le processus qui fait du KPD le porte-parole de l'Etat russe s'accélère. Au cours des années 1920, le KPD devient l'un des appendices les plus fidèles de Moscou. Si d'un côté la majorité du KAPD rejette l'ensemble de l'expérience russe, de l'autre le KPD perd complètement tout sens critique ! Les conceptions organisationnelles fausses ont affaibli, en son sein, de façon définitive, les forces d'opposition au développement de l'opportunisme.
« La révolution allemande » : histoire de la faiblesse du parti
Il est clair qu'il a manqué, à la classe ouvrière en Allemagne, un parti suffisamment fort à ses côtés. On peut comprendre que l'influence des Spartakistes, dans la première phase des luttes en novembre et décembre 1918, soit relativement faible et c'est un véritable drame que le KPD fraîchement fondé ne puisse empêcher la provocation de la bourgeoisie. Pendant toute l'année 1919, la classe ouvrière paie le prix des faiblesses du parti. Dans la vague de luttes qui se déroule après dans les différents endroits d'Allemagne, le KPD ne dispose pas d'une influence déterminante. Cette influence diminue encore après octobre 1919 avec les scissions dans le parti. Lorsqu'ensuite se produit, en mars 1920, la réaction massive de la classe ouvrière contre le putsch de Kapp, de nouveau il n'est pas à la hauteur.
Après avoir souligné la tragédie qu'a été, pour la classe ouvrière la faiblesse du parti, on pourrait se dire qu'on a enfin trouvé la cause de la défaite de la révolution en Allemagne. Il est certain que cette faiblesse ainsi que les erreurs faites par les révolutionnaires, notamment sur le plan organisationnel, ne doivent pas se répéter. Cependant, elles ne suffisent pas, à elles seules, à expliquer l'échec de la révolution en Allemagne.
Il a souvent été souligné que le Parti bolchevik autour de Lénine fournit l'exemple de la façon dont la révolution peut être conduite à la victoire, alors que l'Allemagne fournit le contre-exemple par la faiblesse des révolutionnaires. Mais cela n'explique pas tout.. Lénine et les bolcheviks sont les premiers à souligner que : « S'il a été si facile de venir à bout de la clique de dégénérés, tels que Romanov et Raspoutine, il est infiniment plus difficile de lutter contre la bande puissante et organisée des impérialistes allemands, couronnés ou non. » (Lénine, Discours au premier congrès de la marine de guerre de Russie, 22 novembre 1917, Oeuvres, tome 26) « Pour nous, il était plus facile de commencer la révolution, mais il est extrêmement difficile pour nous de la poursuivre et de l'accomplir. Et la révolution a des difficultés énormes pour aboutir dans un pays aussi industrialisé que l'Allemagne, dans un pays avec une bourgeoisie aussi bien organisée. » (Lénine, Discours à la conférence de Moscou des comités d'usine, 23 juillet 1918, Oeuvres, tome 27)
En particulier, en mettant un terme à la guerre sous la pression de la classe ouvrière, la bourgeoisie a éliminé un ressort important pour la radicalisation des luttes. Une fois la guerre terminée, malgré la formidable combativité des prolétaires, leur pression croissante à partir des usines, leur initiative et leur organisation au sein des conseils ouvriers, ils se sont heurtés au travail de sabotage particulièrement élaboré des forces contre-révolutionnaires, au centre desquelles se trouvaient le SPD et les syndicats.
La leçon pour aujourd'hui va de soi : face à une bourgeoisie aussi habile que l'était alors celle d'Allemagne – et dans la prochaine révolution l'ensemble de la bourgeoisie fera preuve, pour le moins, de mêmes capacités et sera unie pour combattre la classe ouvrière par tous les moyens – les organisations révolutionnaires ne pourront remplir leur devoir qu'en étant elles-mêmes solides et organisées internationalement.
Le parti ne peut se construire qu'en s'appuyant sur une clarification programmatique préalable de longue haleine et surtout sur l'élaboration de principes organisationnels solides. L'expérience en Allemagne le montre : l'absence de clarté sur le mode de fonctionnement marxiste de l'organisation condamne immanquablement celle-ci à la disparition.
La défaillance des révolutionnaires en Allemagne à l'époque de la première guerre mondiale pour véritablement construire le parti a eu des conséquences catastrophiques. Non seulement le parti lui-même s'est effondré et s'est désagrégé, mais au cours de la contre-révolution et dés la fin des années 1920, il n'y a quasiment plus de révolutionnaires organisés pour faire entendre leur voix. Il va régner pendant plus de 50 ans un silence de mort en Allemagne. Lorsque le prolétariat relève la tête en 1968, il lui manque cette voix révolutionnaire. C'est l'une des tâches les plus importantes dans la préparation de la future révolution prolétarienne que de mener à bien la construction de l'organisation. Si cela ne se fait pas, il est sûr que la révolution ne se produira pas et que son échec est d'ores et déjà annoncé.
C'est pourquoi la lutte pour la construction de l'organisation se trouve au coeur de la préparation de la révolution de demain.
DV.
Géographique:
- Allemagne [98]
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Allemande [1955]
Approfondir:
- Révolution Allemande [1957]
Heritage de la Gauche Communiste:
- La Révolution prolétarienne [1149]
Polémique : nous sommes-nous trompés dans les années 1980 ?
- 4329 reads
La C.W.O et le cours historique, une accumulation de contradictions
Dans le n° 5 de Revolutionary Perspectives, organe de la Communist Workers Organisation (CWO), on peut lire un article intitulé « Sectes, mensonges et la perspective perdue du CCI » qui se veut une réponse à celui que nous avons publié dans la Revue Internationale n° 87, « Une politique de regroupement sans boussole » (ce texte étant lui-même une réponse à une lettre de la CWO publiée dans la même Revue). Il aborde beaucoup de questions, notamment sur la méthode de construction des organisations communistes, sur lesquelles nous reviendrons dans d'autres numéros de la Revue Internationale. Dans l'article qui suit nous nous contenterons de traiter principalement d'un des aspects de la polémique de la CWO : l'idée suivant laquelle le CCI serait en crise du fait de ses erreurs dans l'analyse de la perspective historique.
Dans plusieurs textes publiés dans la Revue Internationale ainsi que dans notre presse territoriale ([1] [2847]), nous avons rendu compte de la crise qu'a dû affronter notre organisation dans la dernière période et qui s'est traduite notamment, comme le signale l'article de la CWO, par un nombre important de démissions dans sa section en France. Le CCI a identifié les causes de ses difficultés organisationnelles : la persistance en son sein du poids de l'esprit de cercle résultant des conditions historiques dans lesquelles notre organisation s'était formée après la plus longue et profonde période de contre-révolution de l'histoire du mouvement ouvrier. Le maintien de cet esprit de cercle avait notamment conduit à la formation de clans au sein de l'organisation qui avaient gravement miné le tissu organisationnel. Dès l'automne 1993, l'ensemble du CCI avait engagé le combat contre ces faiblesses et son 11e Congrès, tenu au printemps 1995, avait pu conclure qu'elles avaient, pour l'essentiel, été surmontées ([2] [2848]).
Pour sa part, la CWO donne des difficultés organisationnelles du CCI une explication différente :
« (...) la crise actuelle du CCI... est le résultat ... d'une démoralisation politique. La véritable raison en est que les perspectives sur lesquelles le CCI a été fondé se sont finalement effondrées face à la réalité que le CCI a tenté pendant des années d'ignorer. En fait, ce que nous disions à propos de la précédente scission de 1981 s'applique à la crise présente.
"Les causes de la crise présente se sont développées pendant plusieurs années et peuvent être trouvées dans les positions de base du groupe. Le CCI affirme que la crise économique "est là" dans toutes ses contradictions est qu'il en a été ainsi depuis plus de 12 ans. Il considère que la conscience révolutionnaire surgit directement et spontanément chez les ouvriers en lutte contre les effets de cette crise. De ce fait, il n'est pas surprenant, alors que la crise a été loin de provoquer le niveau de lutte de classe prédit par le CCI, que cela conduise à des scissions dans l'organisation." (Workers' Voice n° 5)
Depuis lors, la situation de la classe ouvrière a empiré et celle-ci a été acculée à la défensive. Au lieu de le reconnaître, le CCI a proclamé tout au long des années 80 que nous étions dans les "années de vérité" conduisant à des confrontations de classe encore plus grandes. (...) Les contradictions évidentes entre les perspectives du CCI et la réalité capitaliste auraient provoqué plus tôt la crise actuelle s'il n'y avait pas eu l'effondrement du stalinisme. Ce seul phénomène historique a complètement escamoté le débat sur le cours historique dans la mesure où la pause faisant suite à un bouleversement d'une telle ampleur a repoussé pour un temps le cours de la bourgeoise vers la guerre et a permis également à la classe ouvrière de disposer de plus de temps pour se regrouper avant que les nouvelles attaques du capital ne rendent à nouveau nécessaires des conflits sociaux à grande échelle au niveau international. Il a permis au CCI d'échapper par des contorsions aux conséquences de la perspective des "années de vérité". Pour lui, mai 1968 a mis fin à la contre-révolution et a ouvert la période où la classe ouvrière pourrait jouer son rôle historique. Presque trente ans après (c'est-à-dire plus d'une génération !) qu'en est-il de cette confrontation de classe ? C'est la question que nous avons posée au CCI en 1981 et c'est encore aujourd'hui là où le bât blesse.
Le CCI sait cela, et c'est dans le but de prévenir une nouvelle démoralisation qu'il s'est tourné vers un vieux truc, la recherche d'un bouc émissaire. Le CCI se refuse à affronter sa crise actuelle en tant que résultat de ses erreurs politiques. Au lieu de cela, il a essayé – et ce n'est pas la première fois – de renverser la réalité dans sa tête et insiste sur le fait que les problèmes qu'il rencontre sont dus à des éléments "parasites" extérieurs qui le minent sur le plan organisationnel. »
Evidemment, n'importe quel lecteur de notre presse aura pu constater que jamais le CCI n'a attribué ses difficultés organisationnelles internes à l'action des éléments parasites. Ou bien la CWO ment délibérément (et dans ce cas, nous lui demandons dans quel but elle fait cela) ou bien elle a très mal lu ce que nous avons écrit (et nous conseillons à ses militants d'acheter des lunettes ou d'en changer). En tout état de cause une telle affirmation fait preuve d'une accablante absence de sérieux qui est absolument regrettable dans le débat politique. C'est pour cela que nous n'allons pas nous y attarder préférant traiter le fond des désaccords qui existent entre le CCI et la CWO (et le Bureau International pour le Parti Révolutionnaire, BIPR, dont elle est un des constituants). Plus particulièrement nous allons aborder dans cet article l'idée suivant laquelle les perspectives mises en avant par le CCI concernant la lutte de classe auraient fait faillite ([3] [2849]).
La perspective du CCI a-t-elle fait faillite ?
Pour évaluer la validité ou non de la perspective que nous avions tracée, il est nécessaire de revenir sur ce que nous écrivions à la veille des années 1980.
« (...) tant que pouvait subsister l'apparence qu'il y avait des solutions à la crise, elle [la bourgeoisie] a bercé les exploités de promesses illusoires : "acceptez l'austérité aujourd'hui et ça ira mieux demain" (...)
Aujourd'hui ce langage ne prend plus (...) Puisque promettre des "lendemains qui chantent" ne trompe plus personne, la classe dominante a changé de registre. C'est le contraire que l'on commence à promettre maintenant en disant bien fort que le pire est devant nous mais qu'elle n'y est pour rien, que "c'est la faute des autres", qu'il n'y a pas d'autre issue... Ainsi la bourgeoisie, en même temps qu'elle perd ses propres illusions, est obligée de parler clair à la classe ouvrière quant à l'avenir qu'elle lui réserve.
(...) Si la bourgeoisie n'a pas d'autre avenir à proposer à l'humanité que la guerre généralisée, les combats qui se développent aujourd'hui démontrent que le prolétariat n'est pas prêt à lui laisser les mains libres et que LUI a un autre avenir à proposer, un avenir où il n'y aura plus de guerre ni d'exploitation : le communisme.
Dans la décennie qui commence, c'est donc cette alternative qui va se décider : ou bien le prolétariat poursuit son offensive, continue de paralyser le bras meurtrier du capitalisme aux abois et ramasse ses forces pour son renversement, ou bien il se laisse piéger, fatiguer et démoraliser par ses discours et sa répression et, alors, la voie est ouverte à un nouvel holocauste qui risque d'anéantir la société humaine. Si les années 1970 furent, tant pour la bourgeoisie que pour le prolétariat, les années d'illusion, les années 1980, parce que la réalité du monde actuel s'y révélera dans toute sa nudité, et parce que s'y décidera pour bonne part l'avenir de l'humanité, seront les années de la vérité. » ([4] [2850])
Comme le dit la CWO, nous avons maintenu cette analyse tout au long des années 1980. En particulier, chacun des congrès internationaux que nous avons tenus dans cette période a été l'occasion pour le CCI de réaffirmer sa validité.
« A l'aube des années 1980, nous avons analysé la décennie qui commençait comme "les années de vérité" (...) A la fin du premier tiers de cette période, on peut constater que cette analyse s'est pleinement confirmée : jamais depuis les années 1930, l'impasse totale dans laquelle se trouve l'économie capitaliste ne s'était révélée avec une telle évidence ; jamais, depuis la dernière guerre mondiale, la bourgeoisie n'avait déployé de tels arsenaux militaires, n'avait mobilisé de tels efforts en vue de la production de moyens de destruction ; jamais depuis les années 1920, le prolétariat n'avait mené des combats de l'ampleur de ceux qui ont secoué la Pologne et l'ensemble de la classe régnante en 1980-81. (...) » ([5] [2851])
Cependant, lors de ce congrès, nous relevions le fait que le prolétariat mondial venait de subir une défaite très sérieuse qui s'était notamment concrétisée par l'instauration de l'état de guerre en Pologne :
« Alors que les années 1978-79-80 avaient été marquées par une reprise mondiale des luttes ouvrières (grève des mineurs américains, des dockers de Rotterdam, des ouvriers de la sidérurgie en Grande-Bretagne, des ouvriers de la métallurgie en Allemagne et au Brésil, affrontements de Longwy-Denain en France, grèves de masse en Pologne), les années 1981 et 1982 se sont distinguées par un net reflux de ces luttes ; ce phénomène étant particulièrement évident dans le plus "classique" des pays capitalistes, la Grande-Bretagne, où l'année 1981 connaissait le nombre le plus faible de grèves depuis la seconde guerre mondiale alors qu'en 1979 celles-ci avaient atteint leur niveau quantitatif le plus élevé de l'histoire avec 29 millions de jours d'arrêt de travail. Ainsi, l'instauration de l'état de guerre en Pologne et la violente répression qui s'est abattue sur les ouvriers de ce pays n'arrivaient pas comme un éclair dans un ciel bleu. Point le plus marquant de la défaite ouvrière après les formidables combats de l'été 1980, le coup de force de décembre 1981 participait d'une défaite de tout le prolétariat. (...)
Quelle que soit la gravité de la défaite enregistrée ces dernières années par la classe ouvrière, elle ne remet pas en cause le cours historique dans la mesure où :
- ce ne sont pas les bataillons décisifs du prolétariat mondial qui se sont trouvés en première ligne de l'affrontement ;
- la crise qui maintenant atteint de plein fouet les métropoles du capitalisme obligera le prolétariat de ces métropoles à exprimer ses réserves de combativité qui n'ont pas été jusqu'à présent entamées de façon décisive. »
Il n'a pas fallu attendre plus de trois mois pour que se confirme cette prévision. Dès septembre 1983 en Belgique et peu après aux Pays-Bas, les travailleurs du secteur public entraient massivement dans la lutte ([6] [2852]). Ces mouvements n'étaient nullement isolés. En fait, en quelques mois, les mouvements sociaux touchent la plupart des pays avancés : Allemagne, Grande-Bretagne, France, Etats-Unis, Suède, Espagne, Italie, Japon ([7] [2853]). Rarement on n'avait connu une telle simultanéité internationale dans les affrontements de classe, en même temps que la bourgeoisie de tous les pays organisait un black-out presque total sur ces mouvements. Evidemment, la bourgeoisie n'est pas restée les bras croisés et a organisé toute une série de campagnes et de manoeuvres, principalement de la part des syndicats, destinées à écoeurer les ouvriers, à éparpiller leurs luttes, à les enfermer dans des impasses corporatistes ou sectorielles. Cela conduit, au cours de l'année 1985, à une certaine accalmie des luttes ouvrières dans les principaux pays européens, notamment ceux qui avaient connu les mouvements les plus importants au cours des années précédentes. En même temps, ces manoeuvres n'ont pu qu'accentuer un peu plus le discrédit qui, dans la plupart des pays avancés, frappait les syndicats ce qui constituait un élément très important dans la prise de conscience de la classe ouvrière puisque ces organes sont ses principaux ennemis, ceux qui ont comme fonction de saboter de l'intérieur ses luttes.
« C'est pour cet ensemble de raisons que le développement actuel de la méfiance à l'égard des syndicats constitue une donnée essentielle du rapport de forces entre les classes et donc de toute la situation historique. Cependant, cette méfiance elle-même est en partie responsable, de façon immédiate, de la réduction du nombre de luttes dans différents pays et plus particulièrement là où justement le discrédit des syndicats est le plus fort (comme en France, suite à l'arrivée accidentelle de la gauche au pouvoir en 1981). Lorsque pendant des décennies les ouvriers ont eu l'illusion qu'ils ne pouvaient mener des combats que dans le cadre des syndicats et avec l'appui de ceux-ci, la perte de confiance en ces organes s'accompagne de façon momentanée d'une perte de confiance en leur propre force et les conduit à opposer la passivité à tous les soi-disant "appels à la lutte" qui en émanent. » ([8] [2854]) Les luttes très importantes qui allaient se dérouler peu après dans deux grands pays marqués par une faible combativité en 1985, la France (notamment la grève des chemins de fer en décembre 1986) et l'Italie en 1987 (notamment dans le secteur de l'éducation, mais aussi dans les transports) faisaient la preuve que la vague de luttes débutée en septembre 1983, en Belgique, se poursuivait. Cette réalité était également illustrée, et de quelle manière, justement dans ce dernier pays, par un mouvement de luttes de six semaines (avril-mai 86), le plus important depuis la seconde guerre mondiale, englobant le secteur public, le secteur privé et les chômeurs, qui paralysait pratiquement la vie économique et contraignait le gouvernement à reculer sur toute une série d'attaques qu'il avait préparées. Au cours de la même période (1986-87), se déroulaient d'autres mouvements d'ampleur dans les pays scandinaves (Finlande et Norvège début 1986, Suède à l'automne 1986), aux Etats-Unis (été 1986), au Brésil (un million et demi de grévistes en octobre 1986, luttes massives en avril-mai 1987), en Grèce (2 millions de grévistes en janvier 1987), en Yougoslavie (printemps 1987), en Espagne (printemps 1987), au Mexique, en Afrique du Sud, etc. Il faut relever également la grève spontanée, en dehors des syndicats, des 140 000 travailleurs de British Telecom fin janvier 1987.
Evidemment, la bourgeoisie réagissait à cette combativité en mettant en oeuvre de nouvelles manoeuvres de grande envergure. Il s'agissait de créer des diversions avec des campagnes idéologiques amplement médiatisées sur le « terrorisme islamique », sur la « paix » entre les grandes puissances (signature des accords de réduction des armements nucléaires), sur l'aspiration des peuples à la « liberté » et à la « démocratie » (mise en scène internationale de la « glasnost » de Gorbatchev), sur l'écologie, sur les interventions « humanitaires » dans le tiers-monde, etc. ([9] [2855]) Il s'agissait surtout de pallier au discrédit croissant qui affectait les syndicats classiques en promouvant de nouvelles formes de syndicalisme (de « combat », de « base », etc.). La manifestation le plus marquante de cette manoeuvre bourgeoise (souvent prise en charge par les organisations gauchistes, mais également par des syndicalistes et des partis de gauche traditionnels, staliniens ou socio-démocrates) a été la constitution de « coordinations » dans les deux pays où le syndicalisme classique était le plus discrédité, l'Italie (particulièrement dans les transports) et la France (en premier lieu dans l'importante grève des hôpitaux à l'automne 1988) ([10] [2856]). Une des fonctions de ces organes, qui se présentaient comme « émanation de la base » et « anti-syndicaux », était d'introduire le poison corporatiste dans les rangs prolétariens avec l'argument que les syndicats ne défendaient pas les intérêts ouvriers parce qu'ils étaient organisés par branches et non par métiers.
Ces manoeuvres ont eu un certain impact que nous avons relevé à l'époque : « Cette capacité de manoeuvre de la bourgeoisie est parvenue jusqu'à présent à entraver le processus d'extension et d'unification dont est porteuse la vague présente de lutte de classe. » ([11] [2857]) En outre, parmi les autres causes des difficultés éprouvées par la classe ouvrière, nous relevions : « le poids de la décomposition idéologique environnante sur laquelle s'appuie et s'appuieront de plus en plus les manoeuvres bourgeoises visant à renforcer l'atomisation, le "chacun pour soi", et à saper la confiance croissante de la classe ouvrière en sa propre force et en l'avenir que porte son combat. » (Ibidem)
Cependant nous notions également que si « le phénomène de la décomposition pèse à l'heure actuelle et pour toute une période d'un poids considérable » et si « il constitue un danger très important auquel la classe doit s'affronter (...) ce constat ne doit être nullement une source de démoralisation ou de scepticisme » puisque « tout au long des années 1980, c'est malgré ce poids négatif de la décomposition, systématiquement exploité par la bourgeoisie, que le prolétariat a été en mesure de développer ses luttes face aux conséquences de l'aggravation de la crise... ». ([12] [2858]).
Voici donc l'analyse que nous faisions de l'état de la lutte de classe quelques mois avant un des événements les plus considérables de l'après-guerre, l'effondrement des régimes staliniens d'Europe et de l'URSS.
Le CCI n'avait pas prévu cet événement (pas plus que les autres organisations du milieu prolétarien ou que les « experts » de la bourgeoisie). Il fut cependant, dès septembre 1989, deux mois avant la chute du mur de Berlin, parmi les premiers à l'identifier ([13] [2859]). Dès ce moment-là nous avons qualifié l'effondrement du bloc de l'est comme la manifestation majeure jusqu'à ce jour de la décomposition de la société capitaliste. Et en ce sens, nous avons immédiatement annoncé que cet événement allait provoquer « Des difficultés accrues pour le prolétariat » ([14] [2860]). Ainsi, en cohérence avec nos précédentes analyses, nous écrivions : « L'identification systématiquement établie entre communisme et stalinisme, le mensonge mille fois répété, et encore plus martelé aujourd'hui qu'auparavant, suivant lequel la révolution prolétarienne ne peut conduire qu'à la faillite, vont trouver avec l'effondrement du stalinisme, et pendant toute une période, un impact accru dans les rangs de la classe ouvrière. C'est donc à un recul momentané de la conscience du prolétariat... qu'il faut s'attendre. (...) En particulier, l'idéologie réformiste pèsera très fortement sur les luttes de la période qui vient, favorisant grandement l'action des syndicats. Compte tenu de l'importance historique des faits qui le déterminent, le recul actuel du prolétariat, bien qu'il ne remette pas en cause le cours historique, la perspective générale aux affrontements de classes, se présente comme bien plus profond que celui qui avait accompagné la défaite de 1981 en Pologne. » ([15] [2861])
C'est avec beaucoup de légèreté que la CWO affirme que l'effondrement du stalinisme « a permis au CCI d'échapper par des contorsions aux conséquences de la perspective des "années de vérité" ». Ce n'est pas pour « écraser le coup » et tenter de masquer la faillite de notre perspective sur le développement des luttes au cours des années 1980 que nous avons annoncé que les événements de la fin 1989 allaient provoquer un recul de la classe ouvrière. Comme on l'a vu plus haut, nous n'avons pas sorti cette thèse comme on tire un lapin d'un chapeau, mais elle était en complète cohérence avec notre cadre d'analyse. Si les années 1980 se terminaient donc avec un recul très important de la classe ouvrière, cela ne signifiait nullement que l'analyse du CCI de la période historique était erronée, comme le prétend la CWO.
En premier lieu, on ne peut, pour affirmer une telle idée, se baser sur le surgissement d'un phénomène qui n'avait été prévu par personne (même si, après coup, le marxisme permet de l'expliquer). Après tout, les révolutionnaires du 19e siècle avaient-ils prévu un des événements les plus considérables de ce siècle, la Commune de Paris ? Lénine avait-il prévu ce qui allait se passer quelques semaines plus tard, la révolution de février 1917 en Russie, prélude de l'Octobre rouge, lorsqu'il disait aux jeunes ouvriers suisses : « Nous les vieux, nous ne verrons peut être pas les luttes décisives de la révolution imminente. » (« Rapport sur la révolution de 1905 », janvier 1917) ? En tout état de cause, il appartient aux marxistes de savoir réagir rapidement face aux événements imprévus et de savoir en tirer immédiatement les conséquences et les leçons. C'est ce que Marx avait fait avec la Commune avant même qu'elle ne soit écrasée (La guerre civile en France). C'est ce que Lénine a su faire dès l'annonce de la révolution de février (Lettres de loin et Thèses d'avril). Pour notre part, nous avons dès la fin de l'été 1989 mis en évidence les bouleversements que les événements de l'Est allaient provoquer, tant du point de vue des antagonismes impérialistes que du développement de la lutte de classe.
Cela dit, même ces bouleversements imprévisibles n'ont pas remis en cause notre analyse de fin 1979 : « Les années 1980, (...) parce que s'y décidera pour bonne part l'avenir de l'humanité, seront les années de la vérité. »
Effectivement, c'est bien au cours de cette période que s'est jouée pour une part la perspective historique. Au début des années 1980, la bourgeoisie, particulièrement celle d'Occident, avait lancé, en même temps qu'elle développait de façon massive ses armements, de vastes campagnes visant à soumettre les prolétaires à la botte du capital afin de pouvoir les embrigader dans une nouvelle guerre mondiale. Pour ce faire, elle avait essayé de mettre à profit la défaite et l'écrasement des ouvriers de Pologne en 1981 qui, outre qu'il avait provoqué une grande désorientation parmi les ouvriers d'Occident, lui donnait le prétexte de stigmatiser « L'Empire du Mal » (suivant les termes de Reagan). La vague de luttes qui a commencé en 1983 a déjoué cet objectif. Pas plus que dans les années 1970, la classe ouvrière des pays centraux n'était prête à se laisser embrigader pour une nouvelle guerre généralisée.
De plus, le fait que la bourgeoisie n'ait pu donner sa propre réponse à la crise de son système, la guerre impérialiste, en même temps que le prolétariat n'était pas encore en mesure de mettre en avant sa propre perspective révolutionnaire, a précipité la société capitaliste dans sa phase de décomposition ([16] [2862]) dont une des manifestations majeures a été justement l'effondrement des régimes staliniens ce qui a repoussé dans la futur la possibilité d'une nouvelle guerre mondiale.
Enfin, d'une façon inattendue, les années 1980 ont abouti, avec l'effondrement du bloc de l'Est et toutes ses conséquences, sur une mise en évidence sans précédent de la vérité du capitalisme décadent : celle d'un chaos indescriptible, d'une barbarie sans nom qui ne font que s'aggraver chaque jour plus.
L'aveuglement de la CWO et du BIPR
Ainsi, comme on peut le voir, la thèse de la CWO sur « la faillite de la perspective du CCI » ne résiste pas au rappel des faits et de nos propres analyses. Et si une organisation a été réellement aveugle à ce qui se passait au cours des années 1980, ce n'est pas le CCI mais la CWO (et le BIPR) elle-même. Une organisation qui décrit les luttes de classe de cette période dans les termes suivants :
« (...) à partir de 1976, la classe dominante, en utilisant principalement les syndicats et la social démocratie, a été capable de restaurer une nouvelle fois la paix sociale. Ce fut une paix sociale ponctuée par de grandes luttes de la classe ouvrière (Pologne 1980-81, les dockers belges en 1983 et la grève des mineurs britanniques en 1984-85). Cependant, il n'y a pas eu de vague internationale de grèves comme en 1968-74, et tous ces mouvements se sont achevés par un recul encore plus grand face aux attaques capitalistes. » ([17] [2863])
On reste sidéré devant une telle affirmation. Pour ne prendre que quelques exemples, la CWO n'a retenu des luttes en Belgique de 1983 que celle des dockers en faisant l'impasse sur celle de l'ensemble du secteur public. Pour elle, les luttes du printemps 1986 dans ce pays, encore plus importantes (1 million de travailleurs mobilisés pendant plus d'un mois dans un pays comptant moins de 10 millions d'habitants), n'ont pas existé. De même, les luttes dans le secteur public aux Pays-Bas à l'automne 1983, les plus importantes depuis le début du siècle, lui sont passées complètement inaperçues. Peut être peut-on penser que cette cécité de la CWO provient du fait qu'elle-même, ou l'autre organisation du BIPR, Battaglia Comunista, n'est pas présente dans ces pays et qu'elle a été, comme la grande majorité du prolétariat mondial, victime du black-out international organisé par les médias bourgeoises pour occulter les mouvements sociaux qui s'y sont déroulés. Même si c'est le cas, ce n'est pas une excuse : une organisation révolutionnaire ne peut se contenter, pour analyser la situation de la lutte de classe, des informations répercutées par les journaux des pays où elle est présente. Elle peut éventuellement s'appuyer sur ce que rapporte la presse d'autres organisations révolutionnaires, notamment la nôtre qui a amplement rendu compte de ces événements. Mais c'est justement là où se trouve le problème : ce n'est pas le CCI qui a été confronté à des « contradictions évidentes entre [ses] perspectives et la réalité capitaliste », ce n'est pas lui qui « a tenté pendant des années d'ignorer la réalité » pour se masquer ses erreurs sur la perspective, comme le prétend la CWO, c'est la CWO elle-même. La meilleure preuve de cela : lorsque la CWO évoque « les grandes luttes de la classe ouvrière » qui « ont ponctué la paix sociale » dans le pays où elle est implantée, la Grande-Bretagne, elle ne fait référence qu'à la grève des mineurs de 1984-85 en ignorant totalement les formidables mobilisations de 1979, les plus importantes depuis plus d'un demi-siècle. De même, elle ne fait nullement référence au mouvement très important de 1987 en Italie, dans le secteur de l'école, alors que son organisation soeur, Battaglia Comunista, s'y trouvait en première ligne.
A quoi faut-il attribuer la cécité de la CWO, son incapacité à voir, ou plutôt à chercher à voir la réalité ? La CWO nous donne la réponse (en attribuant cette démarche au CCI) : parce que cette réalité a démenti ses propres perspectives. En particulier, la CWO, comme le BIPR n'a jamais compris la question du cours historique.
Le BIPR et le cours historique
Le CCI, et la Revue Internationale notamment, a déjà consacré de nombreuses polémiques avec le BIPR sur la question du cours historique ([18] [2864]). Nous n'allons pas revenir sur tout ce que nous avons écrit à ces occasions et qui constitue une critique de l'absence de méthode avec laquelle le BIPR aborde la question de la phase historique dans laquelle prennent place les luttes ouvrières de notre temps. En quelques mots, disons que le BIPR rejette la notion même de cours historique telle qu'elle avait été notamment développée au cours des années 1930 par la Fraction de Gauche du Parti communiste d'Italie. C'est parce qu'elle avait compris que le cours à la guerre et le cours aux affrontements de classe ne sont pas parallèles mais s'excluent mutuellement que la fraction avait été capable de prévoir, dans une période de profonde contre-révolution, l'inéluctabilité de la seconde guerre mondiale dès lors que le capitalisme, depuis 1929, connaissait une nouvelle crise ouverte de son économie.
Pour le BIPR : « le cycle d'accumulation qui a commencé après la seconde guerre mondiale approche de sa fin. Le boom d'après guerre a depuis longtemps laissé la place à la crise économique globale. Une nouvelle fois la question de la guerre impérialiste ou de la révolution prolétarienne est placée à l'ordre du jour de l'histoire. » (Plate forme du BIPR de 1994) En même temps, il reconnaît aujourd'hui (ce n'était pas le cas à l'époque) qu'il y a eu une « réponse ouvrière massive à l'échelle internationale aux attaques de la crise capitaliste, à la fin des années 60 et au début des années 70 » (« Perspectives de la CWO », Revolutionary Perspectives n° 5). Cependant, le BIPR s'est toujours refusé à admettre que si le capitalisme n'avait pas été précipité vers une nouvelle guerre mondiale à partir de la fin des années 1960, cela était dû essentiellement au fait que la réponse apportée par la classe ouvrière dès les premières attaques de la crise faisaient la preuve que celle-ci n'était pas prête, contrairement aux années 1930 à se laisser embrigader dans un nouvel holocauste. Ainsi, pour répondre à la question « pourquoi la guerre mondiale n'a-t-elle pas encore éclaté » alors que « au niveau objectif sont présentes toutes les raisons pour le déclenchement d'une nouvelle guerre généralisée », la revue théorique de Battaglia Comunista, Prometeo n° 11 (décembre 1987) commence par affirmer que « il est clair qu'aucune guerre ne pourra jamais être menée sans la disponibilité (au combat et dans la production de guerre) du prolétariat et de toutes les classes laborieuses. Il est évident que, sans un prolétariat consentant et embrigadé, aucune guerre ne serait possible. Il est évident, de même, qu'un prolétariat en pleine phase de reprise de la lutte de classe serait la démonstration du surgissement d'une contre-tendance précise, celle de l'antithèse à la guerre, celle de la marche vers la révolution socialiste. » C'est exactement de cette façon que le CCI pose le problème, mais c'est justement cette méthode qui était critiquée dans un autre article publié dans Battaglia Comunista n° 83 (mars 1987), et repris en anglais dans l'organe du BIPR Communist Review n° 5, intitulé « Le CCI et le cours historique : une méthode erronée ». Dans cet article on peut lire, entre autres choses, « la forme de la guerre, ses moyens techniques, son rythme, ses caractéristiques par rapport à l'ensemble de la population, ont beaucoup changé depuis 1939. Plus précisément, la guerre aujourd'hui nécessite moins de consensus ou de passivité de la part de la classe ouvrière que les guerres d'hier... l'engagement dans des actions de guerre est possible sans l'accord du prolétariat ». Comprenne qui pourra. Ou plutôt on comprend que le BIPR ne comprend pas très bien de quoi il parle. La cohérence, en tout cas, n'est pas sa préoccupation première.
On peut d'ailleurs trouver une preuve de ce manque de cohérence dans la façon dont le BIPR a réagi à la crise qui allait aboutir à la guerre du Golfe, début 1991. Dans la version en anglais d'un appel adopté à cette occasion par le BIPR (la version en italien est différente !) on peut lire : « Nous devons combattre ses plans et préparatifs de guerre [de notre Etat]... Toutes les tentatives d'envoyer de nouvelles forces doivent être combattues par des grèves aux ports et aux aéroports par exemple... nous appelons les ouvriers britanniques du pétrole de la mer du Nord à développer leur lutte et à empêcher les patrons d'augmenter la production. Cette grève doit être étendue afin d'inclure tous les ouvriers du pétrole et tous les autres ouvriers. » (Workers Voice n° 53) Si « l'engagement dans des actions de guerre est possible sans l'accord du prolétariat », à quoi rime ce type d'appel ? La CWO pourrait-il nous l'expliquer ?
Pour revenir à l'article de Prometeo n° 11, celui qui commence par poser la question dans les mêmes termes que le CCI, nous pouvons y lire : « La tendance à la guerre avance d'un pas rapide mais le niveau de l'affrontement de classe, par contre, est absolument en dessous de ce qui serait nécessaire pour repousser les pesantes attaques lancées contre le prolétariat international ». Donc, pour le BIPR, ce n'est pas la lutte de classe qui permet de répondre à la question qu'il posait lui-même : « pourquoi la guerre mondiale n'a-t-elle pas encore éclaté ? ». Les réponses qu'il donne sont au nombre de deux :
- les alliances militaires ne sont pas encore suffisamment constituées et stabilisées ;
- les armements atomiques constituent un facteur de dissuasion pour la bourgeoisie du fait de la menace qu'ils représentent pour la survie de l'humanité ([19] [2865]).
Dans la Revue Internationale n° 54, nous avons longuement répondu à ces « arguments ». Nous nous contenterons ici de rappeler que le deuxième constitue une concession incroyable pour des marxistes aux campagnes de la bourgeoisie sur le thème de l'armement atomique comme garant de la paix mondiale. Quant au premier, il a été réfuté par le BIPR lui même lorsqu'il a écrit, au moment de l'éclatement de la guerre du Golfe : « la troisième guerre mondiale a commencé le 17 janvier » (BC de janvier 1991) alors que les alliances militaires qui avaient dominé la planète pendant près d'un demi-siècle venaient juste de disparaître. Il faut signaler que, par la suite, le BIPR est revenu sur cette analyse de l'imminence de la guerre. Par exemple, les perspectives de la CWO nous disent aujourd'hui que « une guerre à grande échelle entre les puissances impérialistes dominantes a été repoussée dans le temps ». Le problème, c'est que le BIPR a la fâcheuse habitude d'aligner les analyses contradictoires. Ce faisant, il peut ainsi se mettre hors de portée de la critique qu'il fait au CCI d'avoir maintenu la même analyse tout au long des années 1980. Mais cela n'est sûrement pas un signe de la supériorité de la méthode ou des perspectives du BIPR sur celles de notre organisation.
La CWO va probablement nous accuser encore de dire des mensonges, comme elle le fait abondamment dans son article de polémique. Elle va peut être ouvrir le grand parapluis de la « dialectique » pour affirmer que tout ce qu'elle dit (ou le BIPR) n'est nullement contradictoire. Avec le BIPR, la « dialectique » a bon dos : dans la méthode marxiste, elle n'a jamais signifié qu'on peut dire une chose et son contraire.
« Falsification ! » va crier la CWO. Alors, nous donnerons encore un autre exemple, non pas sur une question de second plan ou circonstancielle (pour laquelle les contradictions sont plus facilement pardonnables) mais sur une question essentielle : la contre-révolution qui s'est abattue sur la classe ouvrière à la suite de l'échec de la vague révolutionnaire du premier après guerre est-elle terminée ?
On peut supposer que même si le BIPR n'est pas capable de donner une réponse claire et cohérente sur la question du cours historique – puisque la compréhension de cette question est apparamment au-dessus de ses forces ([20] [2866]) – il peut quand même répondre à celle que nous venons de formuler.
Une telle réponse, pourtant essentielle, nous ne la trouvons ni dans la plate forme du BIPR de 1994 ni dans les « Perspectives » de la CWO de décembre 1996 où pourtant il serait essentiel qu'elle trouve place. Ceci-dit on trouve quand même des réponses dans d'autres textes :
- dans l'article de Revolutionary Perspectives n° 5 cité plus haut, la CWO semble dire que la contre-révolution n'est pas encore terminée puisqu'elle rejette l'idée du CCI suivant laquelle : « mai 1968 a mis fin à la contre-révolution » ;
- cette affirmation semble être dans la continuité des thèses adoptées par le 5e congrès de Battaglia Comunista" de 1982 (voir Prometeo n° 7), même si les choses ne sont pas dites avec autant de clarté : « si le prolétariat aujourd'hui, confronté à la gravité de la crise et subissant les coups répétés des attaques bourgeoises, ne s'est pas encore montré capable de riposter, cela signifie simplement que le long travail de la contre-révolution mondiale est encore actif dans les consciences ouvrières. »
Si on s'en tient à ces deux textes, on pourrait dire qu'il existe une certaine constance dans la vision du BIPR : le prolétariat n'est pas sorti de la contre-révolution. Le problème c'est qu'en 1987 on pouvait lire dans « Le CCI et le cours historique : une méthode erronée » (Communist Review n° 5) : « la période contre-révolutionnaire qui a suivi la défaite de la révolution d'octobre a pris fin » et « il ne manque pas de signes d'une reprise de la lutte de classe et on ne manque pas de les signaler. »
Ainsi, même sur une question aussi simple, il n'existe pas une position du BIPR mais plusieurs positions. Si on essaye de résumer ce qui ressort des différents textes publiés par les organisations constituant le BIPR, nous pouvons formuler ainsi son analyse :
- « les mouvements qui se sont développés en 68 en France, en 69 en Italie puis dans bien d'autres pays, sont essentiellement des révoltes de la petite-bourgeoisie » (position de Battaglia Comunista à cette époque) mais ils constituent néanmoins « une réponse ouvrière massive à l'échelle internationale aux attaques de la crise capitaliste » (CWO en décembre 1996) ;
- « le long travail de la contre-révolution est encore actif dans les consciences ouvrières » (BC en 1982), cependant « la période contre-révolutionnaire qui a suivi la défaite de la révolution d'octobre a pris fin » (BC en 1987), ce qui n'empêche pas que la période actuelle est sans conteste « une continuation de la domination capitaliste qui a régné, en étant seulement sporadiquement contestée, depuis la fin de la vague révolutionnaire qui a suivi la première guerre mondiale » (CWO en 1988 dans une lettre envoyée au CBG publiée dans le n° 13 de son Bulletin) ;
- « à partir de 1976 [et jusqu'à aujourd'hui] la classe dominante... a été capable de restaurer une nouvelle fois la paix sociale » (CWO, décembre 1996) bien que « ces luttes [le mouvement des Cobas en 1987 dans l'éducation en Italie et les grèves en Grande-Bretagne de la même année] confirment le commencement d'une période marquée par l'accentuation des conflits de classe. » (BC n° 3 de mars 1988)
Evidemment, nous pourrions considérer que ces différentes positions contradictoires correspondent à des divergences existant entre la CWO et Battaglia Comunista. Mais il ne faut surtout pas dire une telle chose car c'est « une calomnie » du CCI qui est invité à « la fermer » lorsqu'il avance cette idée (« Sectes, mensonges et la perspective perdue du CCI », note n° 1). Puisqu'il n'existe pas de désaccord entre les deux organisations, il faut alors en conclure que c'est dans la tête de chaque militant du BIPR que cohabitent des positions contradictoires. Nous nous en doutions un peu, mais la CWO a l'obligeance de nous le confirmer.
Sérieusement, est-ce que toutes ces contradictions ne font pas réfléchir les militants du BIPR ? Ces camarades sont par ailleurs capables d'avoir une pensée cohérente. Comment se fait-il que lorsqu'ils essaient de développer leurs analyses de la période on arrive à une telle bouillie ? N'est-ce pas justement parce le cadre qu'ils se sont donnés n'est pas adéquat, qu'il prend des distances, au nom de la « dialectique », avec la rigueur marxiste pour sombrer dans l'empirisme et l'immédiatisme, comme nous l'avons déjà mis en évidence dans d'autres articles de polémique ?
Aux difficultés qu'éprouve le BIPR pour apréhender de façon claire et cohérente l'état actuel de la lutte de classe, il existe une autre cause : une analyse confuse de la question syndicale, qui ne lui permet pas de comprendre, par exemple, toute l'importance du phénomène qu'on a connu tout au long des années 1980 de discrédit croissant des syndicats. Nous reviendrons sur cette question dans un prochain article.
Pour le moment, nous pouvons déjà répondre à la CWO : ce n'est pas à cause de ses analyses sur la période historique actuelle et sur le niveau de la lutte de classe que le CCI a connu la crise dont nous avons parlé dans notre presse. Pour une organisation révolutionnaire, il peut exister, contrairement à ce que pense la CWO qui fait toujours le même diagnostic depuis 1981, d'autres facteurs de crise, et particulièrement les questions organisationnelles. C'est bien ce que nous a montré, parmi beaucoup d'autres exemples, la crise qu'a connu le POSDR à la suite de son 2e Congrès de 1903. Cependant, nous nous permettrons de mettre fraternellement en garde la CWO (et le BIPR) : si une analyse erronée de la situation historique constitue pour elle le seul, ou même le principal, facteur de crise (peut-être est-ce le cas dans sa propres expérience), alors il convient qu'elle soit particulièrement vigilante car avec la montagne d'incohérences que contient sa propre analyse, elle court un grand danger.
Ce n'est certainement pas notre souhait. Notre souhait le plus sincère serait que la CWO et le BIPR rompent une fois pour toutes avec leur empirisme et leur immédiatisme et reprennent à leur compte les meilleures traditions de la Gauche communiste et du marxisme.
Fabienne
[20] [2886]. C'est bien le constat qu'il fait dans l'article « Le CCI et le cours historique : une méthode erronée » en rejetant toute possibilité de définir le cours historique : « En ce qui concerne le problème que le CCI nous pose, de devenir les prophètes exacts du futur, la difficulté est que la subjectivité ne suit pas mécaniquement les mouvements objectifs... Personne ne peut croire que la maturaton de la conscience... puisse être déterminée de manière rigide à partir de données observables et mises dans un rapport rationnel ». Evidemment, nous ne demandons pas que les révolutionnaires soient des « prophètes exacts du futur » ou qu'ils « déterminent la conscience de manière rigide », mais tout simplement qu'ils répondent à la question : « les luttes qui se sont développées depuis 1968 étaient-elles ou non un signe que le prolétariat n'était pas prêt à se laisser enrôler dans une troisième guerre mondiale ? » En altérant la formulation de la question, le BIPR démontre soit qu'il ne l'a pas comprise, soit qu'il n'est pas capable d'y répondre.
Courants politiques:
Approfondir:
Questions théoriques:
- Le cours historique [17]
Heritage de la Gauche Communiste:
Revue Internationale no 90 - 3e trimestre 1997
- 3037 reads
12e congrès du CCI : Après quatre ans de combat pour la défense de l'organisation : le renforcement politique du CCI
- 2645 reads
Le 12e congrès du CCI qui s'est tenu en avril 1997 a marqué une étape fondamentale dans la vie de l'organisation internationale qu'est le CCI. Ce congrès a conclu une période de près de quatre ans de débat sur la question du fonctionnement de l'organisation et de combat pour la reconstitution de son unité et de sa cohésion, par l'adoption de perspectives mettant en avant que : « le CCI en a fini avec la convalescence et peut, à ce 12e congrès international, se donner des perspectives d'un "retour à un équilibre de l'ensemble de nos activités", une prise en charge de l'ensemble des tâches pour lesquelles le prolétariat l'a fait surgir en son sein, dans le milieu politique prolétarien. »([1] [2888])
Depuis fin 1993 en effet le CCI, tout en maintenant ses activités régulières d'analyse de la situation internationale et d'intervention par voie de presse, s'est consacré prioritairement à la tâche de la défense de l'organisation face à des attaques à son intégrité organisationnelle menées de l'intérieur et contre une offensive sans précédent du parasitisme politique de l'extérieur.
Ce combat, qui n'a rien à voir avec une soudaine « paranoïa » qui se serait emparée du CCI, comme en ont répandu le bruit avec complaisance les adeptes de ce même parasitisme politique, mais également certains groupes et éléments du milieu politique prolétarien, a été marqué par plusieurs phases.
Il a d'abord consisté en l'examen critique et sans concessions de tous les aspects de la vie organisationnelle qui pouvaient manifester une assimilation insuffisante de la conception marxiste de l'organisation révolutionnaire et en même temps une pénétration de comportements étrangers à celle-ci. Dans cette phase, le CCI a été amené à mettre en évidence le rôle néfaste de « clans » dans l'organisation. Héritage des conditions dans lesquelles le CCI s'est formé et a grandi, à partir de cercles et de groupes, ces regroupements informels de militants sur des bases afinitaires, au lieu de se fondre dans l'ensemble de l'organisation conçue comme unité internationale centralisée, avaient subsisté, avec leur propre dynamique, jusqu'à constituer insidieusement un fonctionnement parallèle au sein de l'organisation. Dans le cadre général d'une compréhension de la nécessité d'une lutte permanente contre l'esprit de cercle et pour l'instauration d'un esprit de parti dans l'organisation, le 11e congrès international, en 1995, avait mis en évidence le rôle dévastateur d'un clan en particulier, qui avait étendu son influence dans beaucoup de sections territoriales et sur l'organe central international. Il avait, au terme d'une longue enquête interne, démasqué le principal inspirateur de ce clan, l'individu JJ qui avait mené une politique systématique de sabotage, par de multiples manoeuvres cachées, jusqu'à la constitution d'un réseau d' « initiés » à l'ésotérisme au sein de l'organisation. Le 11e congrès devait ainsi prononcer à l'unanimité des délégations et des participants l'exclusion de cet individu.
Le 11e congrès international avait permis de faire la lumière sur les dysfonctionnements internes de l'organisation. Par une politique de discussion systématique de tous les mécanismes de ceux-ci et la mise en lumière des différentes responsabilités dans les comportements anti-organisationnels, par un réexamen critique de l'histoire du CCI, mais également par une réappropriation des leçons de l'histoire du mouvement ouvrier en matière d'organisation, le CCI pouvait considérer avoir écarté la principale menace qui pesait sur son existence, et avoir restauré en son sein les principes marxistes en matière d'organisation.
L'heure n'était pourtant pas encore à la fin du débat et du combat sur la question organisationnelle. C'est pourquoi le rapport d'activités du 12e congrès international devait soumettre à l'organisation le bilan de la « convalescence » de l'organisation. Après le 11e congrès en effet, le CCI devait prendre la mesure des attaques dont il était la cible. D'une part l'individu JJ devait, dès le lendemain du 11e congrès, passer à une nouvelle offensive, en exerçant une pression considérable sur ses « amis » restés dans l'organisation et sur des militants encore indécis sur la validité de la politique du CCI ; d'autre part et conjointement « cette nouvelle offensive était immédiatement relayée au plan externe par les attaques redoublées du parasitisme à l'échelle internationale contre le CCI (...). » (Ibid.) Le CCI se trouvait ainsi confronté à une deuxième phase de son combat sur la question d'organisation : il ne s'agissait plus seulement de régler des problèmes de fonctionnement interne, il s'agissait de «passer du combat de défense de l'organisation à l'intérieur à celui de sa défense vers l'extérieur (...) en répondant contre tous les volets d'une attaque concertée de la bourgeoisie visant le CCI et la Gauche communiste dans son ensemble. » (Ibid.)
Le 12e congrès a tiré un bilan positif de cette phase. Contrairement aux dénigrements et rumeurs persistantes sur la «crise » et 1'« hémorragie » de militants que connaîtrait le CCI, cette politique a non seulement permis de consolider les bases retrouvées d'un fonctionnement interne collectif sain et efficace de l'organisation et de procéder à de nouvelles intégrations sur ces bases, mais elle a également été un facteur considérable de resserrement des liens de l'organisation avec des éléments en recherche, contacts et sympathisants, qui se rapprochent des positions révolutionnaires.
Il peut sembler surprenant qu'une organisation révolutionnaire internationale, qui a déjà plus de vingt ans d'existence, en soit arrivée à devoir consacrer autant de temps prioritairement à la question de la défense de l'organisation. Mais cela n'est étonnant que pour ceux qui croient que cette question est secondaire ou découle mécaniquement des positions politiques programmatiques. En réalité, la question de l'organisation est non seulement une question politique à part entière, mais elle est en plus celle qui, plus que toute autre, conditionne l'existence même de l'organisation, dans l'accomplissement de toutes les tâches au quotidien. Elle exige de la part des révolutionnaires une vigilance permanente et un combat contre tous les aspects de la répression directe ou de la pression indirecte de l'idéologie et du pouvoir de la bourgeoisie. Ce combat pour la défense de l'organisation révolutionnaire contre la bourgeoisie est une constante de toute l'histoire du mouvement ouvrier. Il a été mené par Marx et Engels au sein de la lre Internationale contre les influences de la petite-bourgeoisie portées par l'anarchisme et contre les intrigues du bakouninisme ; par Rosa Luxemburg contre l'embourgeoisement de la Social-démocratie allemande et le réformisme au sein de la 2e Internationale ; par Lénine contre la conception des cercles qui régnait au sein du Parti ouvrier social-démocrate russe et pour une conception d'un parti organisé, discipliné et centralisé ; par la Gauche communiste contre la dégénérescence de la 3e Internationale, en particulier dans sa défense du travail de Fraction par la Gauche communiste d'Italie.
Ce combat, le CCI l'a mené depuis les débuts de sa constitution au cours des années 1970, en combattant pour le regroupement des révolutionnaires, en défendant la conception d'une organisation internationale, unie et centralisée, contre les conceptions anti-organisationnelles qui prévalaient dans le mouvement de resurgissement de la lutte de classe et des positions révolutionnaires à cette époque. Dans les années 1980, le CCI a encore eu à combattre contre des conceptions académiques et l'influence du « conseillisme ». Dans la période où nous vivons aujourd'hui, toute l'idéologie de la bourgeoisie et de la petite-bourgeoisie en décomposition fait régner une ambiance générale de dénigrement et de dénonciation du communisme et des notions mêmes d'organisation révolutionnaire et de militantisme. Et cette même bourgeoisie ne cesse de ressasser par des campagnes idéologiques à répétition la «faillite du communisme » et même d'attaquer directement l'héritage de la Gauche communiste, en s'efforçant de présenter ce courant comme une sorte d'extrémisme de type «fasciste », comme une constellation de petites sectes d'illuminés. C'est pourquoi la défense de la conception marxiste de l'organisation communiste est un combat qui doit être une préoccupation constante des organisations de la Gauche communiste.
« Le CCI a gagné une bataille, il a gagné non sans mal le combat qui l'a opposé à une tendance à la destruction de l'organisation de l'intérieur. Cependant, il n'a pas gagné la guerre. Car notre guerre, c'est la guerre des classes, celle qui oppose le prolétariat à la bourgeoisie, une lutte à mort qui ne laissera pas de répit à la faible avant-garde communiste dont le CCI est aujourd'hui la principale composante. Dans ce sens, les perspectives, si elles doivent se mesurer à l'aune de ce que l'organisation a été capable d'accomplir au cours des dernières deux années - et plus largement depuis les débuts de sa constitution- pour savoir mesurer quels sont les acquis de son combat et l'état de ses forces réelles, elles doivent aussi être déterminées par les enjeux de la lutte générale de la classe ouvrière, et en son sein par la nécessité de la construction d'un parti mondial, arme indispensable de sa lutte révolutionnaire. » (Ibid.)
Le milieu politique prolétarien
Le 12e congrès a ainsi réaffirmé la conception de toujours du CCI de l'existence d'un « milieu politique prolétarien ». Contrairement à des conceptions qui existent encore dans ce même milieu, principalement les héritiers « bordiguistes » du courant de la Gauche communiste d'Italie, le CCI ne se considère pas comme la seule organisation communiste, encore moins comme « le parti ». Mais le CCI défend l'absolue nécessité de la construction d'un parti mondial indispensable à la lutte révolutionnaire du prolétariat, en tant qu'expression la plus avancée et facteur actif de sa prise de conscience. Pour le CCI, c'est à partir des organisations de la période historique actuelle, les organisations survivantes des anciens courants de la gauche de la 3e Internationale et les nouveaux groupes qui peuvent surgir sur des positions de classe dans le feu de la lutte du prolétariat, qu'il faut s'atteler à la tâche à long terme de la construction du parti. Cette construction ne sera pas le produit spontané du «mouvement» de la classe venant s'agréger automatiquement au « parti historique » de la conception bordiguiste, par la « reconnaissance » de son « programme invariant ». Elle ne sera pas non plus le produit d'un rassemblement sans principes fait de concessions mutuelles et d'opportunisme entre différentes organisations prêtes à brader leurs positions. Elle sera le résultat de toute une activité consciente des organisations révolutionnaires qui doit se faire dès aujourd'hui à partir de la conception que le « milieu politique prolétarien » (ou ce que le PC Internazionalista appelle le « camp internationaliste ») « est une expression de la vie de la classe, du processus de sa prise de conscience. » ([2] [2889])
Le 12e congrès a donc réaffirmé que la politique du CCI de confrontation systématique avec les positions des autres organisations du milieu prolétarien ne doit jamais perdre de vue que l'objectif n'est pas en soi la dénonciation des erreurs mais fondamentalement la clarification face à la classe ouvrière.
« Notre but ultime est d'aller vers l'unification politique de notre classe et des révolutionnaires, unification qui s'exprime dans la construction du Parti et dans le développement de la conscience de la classe ouvrière. Dans ce processus, la clarification politique est l'élément central et c'est ce qui a toujours guidé la politique du CCI dans le milieu politique prolétarien. Même lorsque dans un groupe du milieu politique prolétarien, la scission devient inévitable du fait de son envahissement par des courants bourgeois, il convient qu'elle soit le fruit d'une telle clarification pour servir réellement les intérêts de la classe ouvrière et non ceux de la bourgeoisie. » (Ibid.)
Le 12e congrès est également revenu sur la notion de « parasitisme » approfondie au cours de ces dernières années. Il a insisté sur la nécessité d'une nette démarcation du milieu politique prolétarien de cette nébuleuse de groupes, publications et individus, qui, tout en se réclamant plus ou moins d'une parenté avec le milieu révolutionnaire, par leurs positions politiques ou par leur activité envers ce milieu, ont pour fonction de répandre la confusion, et en dernière analyse de faire le jeu de la bourgeoisie contre le milieu politique prolétarien.
« Le parasitisme ne fait pas partie du milieu politique prolétarien. La notion de parasitisme politique n'est pas une innovation du CCI. Elle appartient à l'histoire du mouvement ouvrier. En aucun cas le parasitisme n'est l'expression de l'effort de prise de conscience de la classe. Au contraire il constitue une tentative de faire avorter cet effort. En ce sens, son activité vient compléter le travail des forces de la bourgeoisie pour saboter l'intervention des organisations révolutionnaires au sein de la classe.
Ce qui anime l'activité et détermine l'existence des individus ou des groupes parasites, ce n'est nullement la défense des principes de classe du prolétariat, la clarification des positions politiques, mais au mieux, l'esprit de chapelle ou de "cercles d'amis", l'affirmation de l'individualisme et son individualité vis-à-vis du milieu politique prolétarien. En ce sens, ce qui caractérise le parasitisme moderne, ce n'est pas la défense d'une plate-forme programmatique mais essentiellement une attitude politique face aux organisations révolutionnaires. » (Ibid.)
C'est dans ce sens que le 12e congrès a défini qu'une des priorités dans ses activités est « la défense du milieu politique prolétarien contre l'offensive destructrice de la bourgeoisie et les agissements du parasitisme » et «faire vivre le milieu politique prolétarien dans son ensemble -qui comprend nos contacts et sympathisants », comme « une expression de la vie de la classe, du processus de sa prise de conscience. » (Ibid.)
La situation internationale et les perspectives de la lutte de classe
Le 12e congrès a également longuement débattu de la situation internationale, sur l'accélération de la crise économique, l'aggravation des tensions impérialistes et le développement de la lutte de classe. Cette discussion a revêtu un caractère particulièrement important du fait du chaos qui se développe aujourd'hui dans tous les domaines sous le poids de la décomposition de l'ensemble de la société capitaliste et de la confusion qu'entretient la bourgeoisie pour masquer la faillite de son système, confusion qui atteint même les capacités des groupes révolutionnaires à défendre un cadre marxiste d'analyse et à dégager des perspectives pour le développement de la lutte de classe.
Sur le plan de la crise économique, le 12e congrès a réaffirmé la nécessité de s'appuyer sur les acquis fondamentaux du marxisme pour pouvoir faire face efficacement à tous les discours mystificateurs que la bourgeoisie distille. Il ne faut pas se limiter à l’examen empirique des « indicateurs économiques » de plus en plus falsifiés par les « spécialistes » de l'économie bourgeoise, mais toujours resituer cet examen de la situation actuelle dans le cadre de la théorie marxiste de l'effondrement du capitalisme. «Les révolutionnaires, les marxistes, ne peuvent pas prévoir les formes précises ni le rythme de l'effondrement croissant du mode de production capitaliste. Mais il leur revient de proclamer et de démontrer l'impasse absolue dans laquelle se trouve ce système, de dénoncer tous les mensonges sur une mythique 'sortie du tunnel' de celui-ci. » ([3] [2890])
Sur le plan des tensions impérialistes, le 12e congrès s'est attaché à analyser et préciser les caractéristiques du chaos actuel, une foire d'empoigne entre les grandes puissances impérialistes, cachée derrière le prétexte d'interventions « humanitaires » ou de « maintien de la paix », et qui entraîne un déferlement de la barbarie guerrière dans un nombre grandissant de régions de la planète. « La tendance au "chacun pour soi" a pris le dessus sur la tendance à la reconstitution d'alliances stables préfigurant de futurs blocs impérialistes ce qui a contribué à multiplier et aggraver les affrontements militaires. » (Ibid.)
Enfin ce sont surtout les perspectives de la lutte de classe qui ont fait l'objet de la discussion la plus importante au cours de ce congrès. En effet, la classe ouvrière est aujourd'hui dans une situation difficile, où elle subit de plein fouet des attaques extrêmement brutales de ces conditions d'existence dans le contexte d'un déboussolement idéologique dont elle n'est pas encore sortie et que la bourgeoisie s'efforce d'entretenir par la répétition de campagnes médiatiques et de manoeuvres de toutes sortes. « Il s'agit pour la classe dominante, pleinement conscience du fait que ses attaques croissantes contre la classe ouvrière vont provoquer de la part de cette dernière des ripostes de grande envergure, de prendre les devants à un moment où la combativité n'est encore qu'embryonnaire, où pèsent encore fortement sur la conscience les séquelles de l'effondrement des prétendus régimes "socialistes", afin de "mouiller la poudre" et de renforcer au maximum son arsenal de mystifications syndicalistes et démocratiques. » (Ibid.)
Cette situation a des implications importantes pour l'intervention de l'organisation. Dans l'estimation de la situation, il s'agit déjà de ne pas se tromper. Les obstacles importants que monte la bourgeoisie face au développement de la lutte de classe ne signifient pas que le prolétariat se trouve dans une situation de défaite similaire à celle des années 1930.
« Les campagnes des années 1930 :
-se situaient dans un contexte de défaite historique du prolétariat, de victoire sans partage de la contre-révolution ;
-avaient comme objectif d'embrigader les prolétaires dans la guerre mondiale qui se préparait ;
-disposaient d'un faire valoir, les régimes fascistes en Italie, Allemagne et Espagne, bien réel, massif, durable et ciblé.
En revanche, les campagnes actuelles :
-se situent dans un contexte où le prolétariat a surmonté la contre-révolution, où il n'a pas subi de défaite décisive remettant en cause le cours historique aux affrontements de classe ;
-ont comme objectif de saboter un cours montant de la combativité et de la conscience dans la classe ouvrière ;
-ne disposent pas d'un faire valoir unique et ciblé mais sont obligées de faire appel à des thèmes disparates et quelque fois circonstanciels (terrorisme, "danger fasciste", réseaux de pédophilie, corruption de la justice, etc.), ce qui tend à limiter leur portée internationale et dans le temps. » (Ibid.)
Il ne s'agit pas non plus de tomber dans l'euphorie du type de celle qui s'est développée suite au « mouvement » de grèves en France en décembre 1995. Cette manoeuvre préventive de la bourgeoisie a fait croire à plus d'un que la route vers de nouvelles mobilisations ouvrières significatives était largement ouverte et leur a fait grandement sous-estimer les difficultés actuelles de la classe ouvrière. « Seule une avancée significative de la conscience dans la classe ouvrière permettra à celle-ci de repousser ce type de mystifications. Et cette avancée ne pourra résulter que d'un développement massif des luttes ouvrières remettant en cause, comme elle avait commencé à le faire au milieu des années 1980, les instruments les plus importants de la bourgeoisie en milieu ouvrier, les syndicats et le syndicalisme. » (Ibid.)
Dans ce contexte, le 12e congrès s'est donné comme une des priorités des activités de l'organisation « l'intervention dans le développement de la lutte de classe. (...)
Les perspectives de notre intervention ne seront pas de façon générale celles d'une participation active, directe et d'agitation visant à s'inscrire dans une tendance à la montée d'une lutte de classe qui se dégage clairement de l'emprise syndicale pour s'affirmer sur son propre terrain, et se donnant pour tâche d'impulser l'extension et la prise en mains de la lutte par la classe elle-même.
De façon générale notre intervention dans la lutte de classe, tout en poursuivant la mise en avant de la perspective historique du prolétariat (défense du communisme contre les campagnes de la bourgeoisie), aura pour tâche principale le travail patient et opiniâtre de dénonciation et d'explication des manoeuvres de la bourgeoisie, des syndicats et du syndicalisme de base contre le mécontentement et la combativité montante dans la classe ouvrière, une intervention pour beaucoup "à contre-courant" de la tendance à se laisser encore enfermer dans les pièges de la division et du radicalisme corporatiste du syndicalisme. ».
C'est un travail important dont nous n'avons pu donner ici qu'un rapide aperçu qu'a accompli ce 12e congrès du CCI pour tracer les perspectives des années qui viennent. Ces perspectives, nos lecteurs et sympathisants pourront les trouver dans la résolution sur la situation internationale publiée intégralement ci-dessous et leurs implications dans notre presse et dans nos interventions à venir.
CCI.
RESOLUTION SUR LA SITUATION INTERNATIONALE
l) Les mensonges abondamment assénés lors de l'effondrement des régimes staliniens, au tournant des années 1980 et 1990, à propos de la «faillite définitive du marxisme » ne sont pas nouveaux. Déjà, il y a exactement un siècle, la gauche de la 2e Internationale, avec à sa tête Rosa Luxemburg, avait eu à combattre les thèses révisionnistes qui affirmaient que Marx s'était lourdement trompé en annonçant que le capitalisme allait à la faillite. Les décennies suivantes, avec la première guerre mondiale, puis la grande dépression des années 1930 faisant suite à une courte période de reconstruction, ont laissé peu de marge à la bourgeoisie pour enfoncer un tel clou. En revanche, les deux décennies de « prospérité » du deuxième après guerre ont permis une nouvelle floraison, y compris dans les milieux «radicaux », de « théories » enterrant « définitivement » le marxisme et ses prévisions de l'effondrement du capitalisme. Ces concerts d'autosatisfaction ont évidemment été battus en brèche par le retour de la crise ouverte du capitalisme à la fin des années 1960 mais le rythme lent de celle-ci, avec des périodes de « reprise » comme celle que connaît aujourd'hui le capital américain et britannique, a permis à la propagande bourgeoise de masquer aux yeux de la grande majorité des prolétaires la réalité et l'ampleur de l'impasse où se trouve aujourd'hui le mode de production capitaliste. C'est pour cette raison qu'il appartient aux révolutionnaires, aux marxistes, de dénoncer en permanence les mensonges bourgeois sur les prétendues possibilités du capitalisme de « sortir de la crise » et, en particulier, de faire justice des « arguments » qui sont tour à tour employés pour tenter de « démontrer » de telles possibilités.
2) Dès le milieu des années 1970, face à l'évidence de la crise, les « experts » ont commencé à rechercher toutes les explications possibles permettant à la bourgeoisie de se rassurer à bon compte sur les perspectives de son système. Incapable d'envisager la faillite définitive de celui-ci, la classe dominante avait besoin, non seulement dans un but de mystification des exploités, mais également pour son propre usage, d'expliquer les difficultés croissantes de l'économie mondiale à partir de causes circonstancielles tournant évidemment le dos aux causes véritables. Tour à tour, les explications suivantes ont connu leur heure de gloire :
- la « crise du pétrole » faisant suite à la guerre du Kippour de 1973 (c'était oublier que la crise ouverte remontait à 6 ans auparavant, les hausses des cours pétroliers n'ayant fait qu'accentuer une dégradation qui s'était déjà manifestée avec les récessions de 1967 et 1971);
- les excès des politiques néo-keynésiennes suivies depuis la fin de la guerre qui maintenant provoquaient une inflation galopante : il fallait « moins d'Etat » ;
- les excès des « reaganomics » des années 1980 qui avaient provoqué une hausse sans précédent du chômage dans les principaux pays.
Fondamentalement, il fallait se cramponner à l'idée qu'il existait des portes de sortie, qu'avec une « bonne gestion », l'économie mondiale pourrait revenir à sa splendeur des « trente glorieuses ». D fallait retrouver le secret perdu de la « prospérité ».
3) Pendant longtemps, les performances économiques du Japon et de l'Allemagne, alors que les autres pays étaient confrontés au marasme, étaient supposées démontrer la capacité du capitalisme à « surmonter sa crise » : « il faut que chaque pays soit aussi "vertueux" que les deux grands vaincus de la deuxième guerre mondiale, et tout le monde se portera bien » : tel était le credo de beaucoup d'apologistes appointés du capitalisme. Aujourd'hui, le Japon et l'Allemagne font figure « d'homme malade ». Alors qu'il éprouve les plus grandes difficultés à relancer une « croissance » qui fit sa gloire passée, le premier vient d'être classé en catégorie D (à côté du Brésil et du Mexique) dans l'indice des pays à risque tant sont menaçantes les dettes qu'ont accumulées l'Etat, les entreprises et les particuliers (représentant plus de deux ans et demi de la production nationale). Quant au second pays, il connaît maintenant un des taux de chômage les plus élevés de l’Union européenne et il ne parvient pas lui-même à satisfaire aux « critères de Maastricht » indispensables pour mettre en place la « monnaie unique ». En fin de compte, on se rend compte que la prétendue « vertu » passée de ces pays ne faisait que masquer la même fuite en avant dans l'endettement qui caractérise l'ensemble du capitalisme depuis des décennies En réalité, les difficultés présentes des deux « premiers de la classe » des années 1970 et 1980 constituent une illustration de l'impossibilité pour le capitalisme de poursuivre indéfiniment la tricherie sur lequel il a basé principalement la reconstruction du deuxième après guerre et qui lui a permis jusqu'à présent d'éviter un effondrement semblable à celui des années 1930 : l'utilisation systématique du crédit.
4) Déjà quand elle dénonçait les « théories » des révisionnistes, Rosa Luxemburg avait été conduite à démolir l'idée qui leur était chère suivant laquelle le crédit devrait permettre au capitalisme de surmonter ses crises. S'il a été un stimulant indiscutable du développement de ce système, tant du point de vue de la concentration du capital que de sa circulation, le crédit n'a jamais pu se substituer au marché réel lui-même comme aliment de l'expansion capitaliste. Les traites sur l'avenir permettent d'accélérer la production et la commercialisation des marchandises mais elles doivent être remboursées un jour ou l'autre. Et ce remboursement n'est possible que si ces dernières ont trouvé à s'échanger sur le marché lequel ne découle pas automatiquement de la production, comme Marx l'a systématiquement démontré contre les économistes bourgeois. En fin de compte, loin de permettre de surmonter les crises, le crédit ne fait qu'en étendre la portée et la gravité comme le montre, en s'appuyant sur le marxisme, Rosa Luxemburg. Aujourd'hui, les thèses de la gauche marxiste contre le révisionnisme, à la fin du siècle dernier, restent fondamentalement valables. Pas plus qu'alors, le crédit ne peut à l'heure actuelle élargir les marchés solvables. Cependant, confrontée à une saturation définitive de ces derniers (alors qu'au siècle dernier, il existait la possibilité d'en conquérir de nouveaux), le crédit est devenu la condition indispensable à l'écoulement des marchandises produites, se substituant au marché réel.
5) Cette réalité s'est déjà illustrée au lendemain de la seconde guerre mondiale lorsque le plan Marshall, outre sa fonction stratégique dans la constitution du bloc américain, a permis aux Etats-Unis de créer un débouché pour la production de leur industrie. La reconstruction qu'il a permise des économies européenne et japonaise a fait de celles-ci, au cours des années 1960, des concurrents de l'économie américaine ce qui a donné le signal du retour de la crise ouverte du capitalisme mondial. Depuis lors, c'est principalement en utilisant le moyen du crédit, d'un endettement toujours plus grand, que l'économie mondiale a réussi à s'éviter une dépression brutale comme celle des années 1930. C'est ainsi que la récession de 1974 a été surmontée jusqu'au début des années 1980 grâce au formidable endettement des pays du tiers monde lequel a conduit à la crise de la dette du début des années 1980 qui a coïncidé avec une nouvelle récession encore plus importante que celle de 1974. Cette nouvelle récession mondiale n'a pu être surmontée à son tour que par des déficits commerciaux faramineux des Etats-Unis dont le montant de l'endettement extérieur est venu concurrencer celui du tiers-monde. Parallèlement, les déficits des budgets des pays avancés ont explosé ce qui a permis de soutenir la demande mais a conduit à une véritable situation de faillite pour les Etats (dont l'endettement représente entre 50 % et 130 % de la production annuelle suivant les pays). C'est d'ailleurs pour cette raison que la récession ouverte, celle qui s'exprime par des chiffres négatifs dans les taux de croissance de la production d'un pays, est loin de constituer le seul indicateur de la gravité de la crise. Dans presque tous les pays, le seul déficit annuel du budget des Etats (sans compter celui des administrations locales) est supérieur à la croissance de la production ; cela signifie que si ces budgets étaient équilibrés (le seul moyen de stabiliser l'endettement cumulé des Etats) tous ces pays seraient en récession ouverte.
La plus grosse partie de cet endettement n'est évidemment pas remboursable, il s'accompagne de krachs financiers périodiques de plus en plus graves qui sont de véritables séismes pour l'économie mondiale (1980, 1989) et qui demeurent plus que jamais à l'ordre du jour.
6) Le rappel de ces faits permet de remettre à leur place les discours sur la « santé » actuelle des économies britannique et américaine qui tranche avec l'apathie de celles de leurs concurrents. En premier lieu, il convient de relativiser l'importance de ces « succès ». Ainsi, la baisse très sensible du taux de chômage en Grande-Bretagne doit beaucoup, de l'aveu même de la Banque d'Angleterre, à la suppression dans les statistiques (dont le mode de calcul a été modifié 33 fois depuis 1979) des chômeurs ayant renoncé à chercher un travail. Cela dit, ces « succès » s'appuient en bonne partie sur une amélioration de la compétitivité de ces économies sur l'arène internationale (basée notamment sur la faiblesse de leur monnaie, le maintien de la Livre hors du serpent monétaire s'étant révélé, jusqu'à présent, comme une bonne opération), c'est-à-dire sur une plus grande dégradation des économies concurrentes. C'est un fait que la synchronisation mondiale des périodes de récession et celles de « reprise » qu'on avait connues jusque là avait partiellement masqué : la relative amélioration de l'économie d'un pays ne passe pas par l'amélioration de celle de ses « partenaires » mais, fondamentalement, par une dégradation de celle-ci puisque les « partenaires » sont avant tout des concurrents. Avec la disparition du bloc américain faisant suite à celle du bloc russe, à la fin des années 1980, la coordination qui existait par le passé entre les principaux pays occidentaux (par exemple via le G7) de leurs politiques économiques (ce qui constituait un facteur non négligeable de ralentissement du rythme de la crise) a laissé la place à un « chacun pour soi » de plus en plus effréné. Dans une telle situation, il revient à la première puissance mondiale le privilège d'imposer ses diktats dans l'arène commerciale au bénéfice de sa propre économie nationale. C'est ce qui explique en bonne partie les « succès » actuels du capital américain.
Cela dit, même si les performances actuelles des économies anglo-saxonnes ne sont nullement significatives d'une possible amélioration de l'ensemble de l'économie mondiale, elles-mêmes ne sont pas destinées à durer. Tributaires du marché mondial, lequel ne pourra surmonter sa totale saturation, elles f vont nécessairement se heurter à cette saturation. Surtout, aucun pays n'a résolu le problème de l'endettement généralisé (même f si les déficits budgétaires des Etats-Unis ont été quelque peu réduits ces dernières années). La meilleure preuve de cela est la hantise qui habite les principaux responsables économiques (tel le président de la Banque fédérale américaine) que la « croissance » actuelle n'aboutisse à la « surchauffe » et à un retour de l'inflation. En réalité, derrière cette crainte de la surchauffe il y a fondamentalement le constat que la « croissance » actuelle est basée sur un endettement exorbitant qui nécessairement produira un retour de balancier catastrophique. L'extrême fragilité des bases sur lesquelles s'appuient les « succès » présents de l'économie américaine nous a été une nouvelle fois confirmée par le début d'affolement de Wall Street ainsi que des autres Bourses lorsque la FED a annoncé fin mars 1997 un relèvement minime de ses taux d'intérêt.
7) Parmi les mensonges abondamment diffusés par la classe dominante pour faire croire à la viabilité, malgré tout, de son système, une place de choix est également réservée à l'exemple des pays d'Asie du sud-est, les « dragons » (Corée du Sud, Taiwan, Hongkong et Singapour) et les « tigres » (Thaïlande, Indonésie, Malaisie) dont les taux de croissance actuels (quelques fois à deux chiffres) font baver d'envie les bourgeois occidentaux. Ces exemples seraient sensés démontrer qu'il est possible au capitalisme actuel aussi bien de développer les pays arriérés que d'échapper à la fatalité de la chute ou de la stagnation de la croissance. En réalité, le « miracle économique » de la plupart de ces pays (particulièrement la Corée et Taiwan) n'est nullement fortuit : il est la conséquence de l'équivalent du plan Marshall mis en oeuvre au cours de la guerre froide par les Etats-Unis afin de contenir l'avancée du bloc russe dans la région (injection massive de capitaux représentant jusqu'à 15 % du PNB, prise en charge directe de l'économie nationale, en s'appuyant notamment sur l'appareil militaire, afin de suppléer à une bourgeoisie nationale presque inexistante et surmonter les résistances des secteurs féodaux, etc.). Comme tels, ces exemples ne sont nullement généralisables à l'ensemble du tiers-monde, lequel continue pour sa plus grande partie à sombrer dans une catastrophe sans nom. Par ailleurs, l'endettement de la plupart de ces pays, tant extérieur qu'au niveau de leurs Etats, atteint des niveaux considérables ce qui les soumet aux mêmes menaces que tous les autres pays. Enfin, si leur prix très bas de la force de travail a constitué un attrait pour nombre d'entreprises occidentales, le fait qu'ils deviennent des rivaux commerciaux pour les pays avancés les soumet au risque de la mise en place d'entraves croissantes à leurs exportations de la part de ces derniers. En réalité, faisant jusqu'à présent figure d'exception, comme ce fut le cas de leur grand voisin japonais, ils ne pourront pas échapper indéfiniment aux contradictions de l'économie mondiale qui ont transformé en cauchemar d'autres « success stories » qui ont précédé la leur, telle celle du Mexique. C'est pour l'ensemble de ces raisons que, à côté des discours dithyrambiques, les experts internationaux et les institutions financières prennent dès à présent des dispositions pour limiter les risques financiers qu'ils présentent. Et les mesures destinées à rendre plus «flexible » la force de travail qui se trouvaient à l'origine des récentes grèves en Corée démontrent que la bourgeoisie autochtone elle-même est consciente du fait qu'elle a mangé son pain blanc. Comme l'écrit le Guardian du 16 octobre 1996 : «La question est de savoir quel sera le premier des tigres d'Asie à tomber. »
8) Le cas de la Chine, que certain présente comme la future grande puissance du siècle prochain, n'échappe pas non plus à la règle.
La bourgeoisie de ce pays a réussi jusqu'à présent à opérer avec succès la transition vers les formes classiques du capitalisme, contrairement à celles des pays d'Europe de l'Est dont le marasme total (à quelques exceptions près) apporte un cinglant démenti à tous les discours sur les prétendues « grandes perspectives » qui s'offraient à eux avec leur rejet des régimes staliniens. Cela dit, l'arriération de ce pays reste considérable, la plus grande partie de l'économie, comme dans tous les régimes staliniens, étouffe sous le poids de la bureaucratie et des dépenses militaires. De l'aveu même des autorités le secteur public est globalement déficitaire et des centaines de milliers d'ouvriers sont payés avec des mois de retard. Et même si le secteur privé est plus dynamique, il ne peut surmonter les pesanteurs du secteur étatique de même qu'il reste particulièrement tributaire des fluctuations du marché mondial. Enfin, le « formidable dynamisme » de l'économie chinoise ne saurait cacher que, même dans l'hypothèse du maintien de sa croissance actuelle, ce ne sont pas moins de 250 millions de chômeurs qu'elle comptera à la fin du siècle.
9) De quelque côté qu'on se tourne, pour peu qu'on soit capable de résister aux sirènes des apologistes du mode de production capitaliste et de s'appuyer sur les enseignements du marxisme, la perspective de l'économie mondiale ne peut être que celle d'une catastrophe croissante. Les prétendus « succès » présents de certaines économies (pays anglo-saxons ou d'Asie du sud-est) ne représentent nullement l'avenir de l'ensemble du capitalisme. Ils ne sont qu'un trompe l'oeil mystificateur qui ne pourra pas masquer longtemps cette catastrophe. De même, les discours sur la « mondialisation » sensée ouvrir une ère de liberté et d'expansion du commerce ne font que masquer une intensification sans précédent de la guerre commerciale dans la quelle les assemblages de pays comme l’Union Européenne n'ont d'autre signification que l'établissement d'une forteresse contre la concurrence d'autres pays. Ainsi, une économie mondiale en équilibre instable sur une montagne de dettes qui ne seront jamais remboursées sera de plus en plus confrontée aux convulsions du « chacun pour soi », phénomène qui a toujours caractérisé le capitalisme mais qui revêt, dans la période actuelle de décomposition, une qua lité nouvelle. Les révolutionnaires, les marxistes, ne peuvent pas prévoir les formes précises ni le rythme de l'effondrement croissant du mode de production capitaliste. Mais il leur revient de proclamer et de dé montrer l'impasse absolue dans laquelle se trouve ce système, de dénoncer tous les mensonges sur une mythique «sortie du tunnel » de celui-ci.
10) Plus encore que dans le domaine économique, le chaos propre à la période de décomposition exerce ses effets dans celui des relations politiques entre Etats. Au moment de l'effondrement du bloc de l'Est conduisant à la disparition du système d'alliances issu de la seconde guerre mondiale, le CCI avait mis en évidence :
- que cette situation mettait à l'ordre du jour, sans que cela soit immédiatement réalisable, la reconstitution de nouveaux blocs, l'un étant dirigé par les Etats-Unis et l'autre par l'Allemagne ;
- que, de façon immédiate, elle allait déboucher sur un déferlement d'affrontements ouverts que « l'ordre de Yalta » avait réussi auparavant à maintenir dans un cadre « acceptable » pour les deux gendarmes du monde.
Dans un premier temps, la tendance à la constitution d'un nouveau bloc autour de l'Allemagne; dans la dynamique de la réunification de ce pays, a accompli des pas significatifs. Mais assez rapidement, la tendance au « chacun pour soi » a pris le dessus sur la tendance à la reconstitution d'alliances stables préfigurant de futurs blocs impérialistes ce qui a contribué à multiplier et aggraver les affrontements militaires. L'exemple le plus significatif a été celui de la Yougoslavie dont l'éclatement a été favorisé par les intérêts impérialistes antagoniques des grands Etats européens, Allemagne, Grande-Bretagne et France. Les affrontements dans l'ex-Yougoslavie ont créé un fossé entre les deux grands alliés de la Communauté européenne, l'Allemagne et la France, provoqué un rapprochement spectaculaire entre ce dernier pays et la Grande-Bretagne et la fin de l'alliance de celle-ci et des Etats-Unis, la plus solide et durable du 20e siècle. Depuis, cette tendance au « chacun pour soi », au chaos dans les relations entre Etats, avec son cortège d'alliances de circonstances et éphémères, n'a nullement été remise en cause, bien au contraire.
11) Ainsi, la dernière période a vu s'opérer un certain nombre de modifications sensibles dans les alliances qui s'étaient formées dans la période précédente : -relâchement important des liens entre la France et la Grande-Bretagne illustré notamment par l'absence de soutien de cette dernière aux revendications de la première comme la réélection de Boutros-Ghali à la tête de l'ONU ou le commandement par un européen du versant sud du dispositif de l'OTAN en Europe ;
- nouveau rapprochement entre la France et l'Allemagne qui s'est concrétisé en particulier par le soutien de cette dernière à ces mêmes revendications de la France ;
-mise en veilleuse des conflits entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne qui s'est exprimée, entre autres, par le soutien de cette dernière à l'Oncle Sam sur ces mêmes questions.
En fait, une des caractéristiques de cette évolution des alliances est liée au fait que seuls les Etats-Unis et l'Allemagne ont, et peuvent avoir, une politique cohérente à long terme, le premier de préservation de son leadership, la seconde de développement de son propre leadership sur une partie du monde, les autres puissances étant confinées à des politiques plus circonstancielles visant, en bonne partie, à contrecarrer celle des premières. En particulier, la première puissance mondiale est confrontée, depuis qu'a disparu la division du monde en deux blocs, à une contestation permanente de son autorité de la part de ses anciens alliés.
12) La manifestation la plus spectaculaire de cette crise de l'autorité du gendarme mondial a été la rupture de son alliance historique avec la Grande-Bretagne, à l'initiative de cette dernière, à partir de 1994. Elle s'est également concrétisée par la longue impuissance des Etats-Unis, jusqu'à l'été 1995, sur un des terrains majeurs des affrontements impérialistes, l'ex-Yougoslavie. Elle s'est exprimée plus récemment, en septembre 1996, par les réactions presque unanimes d'hostilité envers les bombardements de l'Irak par 44 missiles de croisière alors qu'en 1990-91 les Etats-Unis avaient réussi à obtenir le soutien des mêmes pays pour l'opération « tempête du désert ». En particulier, concernant les Etats de la région, la con damnation très ferme de ces bombardements par l'Egypte et l'Arabie Saoudite tranche avec le soutien total qu'elles avaient apporté à l'Oncle Sam lors de la guerre du Golfe. Parmi les autres exemples de la contestation du leadership américain il faut encore relever:
- la protestation générale contre la loi Helms-Burton renforçant l'embargo contre Cuba dont le « lider maximo » a été reçu par la suite en grande pompe, et pour la première fois, par le Vatican ;
-la venue au pouvoir en Israël, contre la volonté affichée des Etats-Unis, de la droite, laquelle a tout fait depuis pour saboter le processus de paix avec les palestiniens qui constituait un des plus beaux succès de la diplomatie US ;
-plus généralement, la perte du monopole du contrôle de la situation au Moyen-Orient, zone cruciale s'il en est, notamment illustrée par le retour en force de la France qui s'est imposée comme co-parrain du règlement du conflit entre Israël et le Liban, fin 1995 et qui a confirmé son succès dans la région avec l'accueil chaleureux réservé à Chirac par l'Arabie Saoudite en octobre 1996;
- l'invitation récente de plusieurs dirigeants européens (dont le même Chirac qui a lancé des appels à l'indépendance envers les Etats-Unis) par un certain nombre d'Etats d'Amérique du sud confirmant la fin du contrôle sans partage de cette zone par les Etats-Unis.
13) Cela dit, la dernière période a été marquée, comme l'avait déjà constaté il y a un an le 12e Congrès de la section en France, par une contre-offensive massive des Etats- Unis. Cette contre-offensive s'est concrétisée en particulier par un retour en force de cette puissance dans l'ex-Yougoslavie à partir de l'été 1995 sous couvert de 1’IFOR devant prendre la succession de la FORPRONU, laquelle avait constitué pendant plusieurs années l'instrument de la présence prépondérante du tandem franco-britannique. La meilleure preuve du succès américain a été la signature à Dayton, aux Etats-Unis, des accords de paix sur la Bosnie. Depuis, la nouvelle avancée de la puissance US ne s'est pas démentie. En particulier, elle a réussi à infliger au pays qui l'avait défiée le plus ouvertement, la France, un très sérieux revers dans ce qui constitue son « pré carré », l'Afrique. Après l'élimination de l'influence française au Rwanda, c'est maintenant la principale position de la France sur ce continent, le Zaïre qui est en train de lui échapper avec l'effondrement du régime de Mobutu sous les coups de la « rébellion » de Kabila massivement soutenue par le Rwanda et l'Ouganda, c'est-à-dire, par les Etats-Unis. C'est une punition particulièrement sévère que cette puissance est en train d'infliger à la France et qui se veut exemplaire à l'adresse de tous les autres pays qui voudraient l'imiter dans sa politique de défi permanent. C'est une punition qui vient couronner les autres revers infligés récemment par les Etats-Unis à ce pays sur la question du successeur de Boutros-Ghali et sur la question du commandement du flanc sud de l'OTAN.
14) C'est en grande partie parce qu'elle avait justement compris les risques qu'elle courrait en emboîtant le pas à la politique aventuriste de la France (qui de façon régulière se fixe des objectifs dépassant ses capacités réelles), que la bourgeoisie britannique à pris dernièrement ses distances avec sa consoeur d'outre-Manche. Cette brouille a été grandement favorisée par l'action des Etats-Unis et de l'Allemagne qui ne pouvaient voir que d'un mauvais oeil l'alliance contractée par la France et la Grande-Bretagne à partir de la question Yougoslave. C'est ainsi que les bombardements américains de l'Irak, en septembre 1996, avaient comme immense avantage d'enfoncer un coin entre les diplomaties française et britannique, la première soutenant du mieux qu'elle peut Saddam Hussein, la seconde misant, comme celle des Etats-Unis, sur le renversement de son régime. De même, l'Allemagne n'a pas manqué de saper la solidarité franco-britannique sur les questions qui lui font mal comme notamment celle de l'Union Européenne et de la monnaie unique (3 sommets franco-allemands en deux semaines sur cette question, en décembre 1996). C'est donc dans ce cadre qu'on peut comprendre la nouvelle évolution des alliances au cours de la dernière période qui était signalée plus haut. En fait, l'attitude de l'Allemagne et surtout des Etats-Unis confirme ce que nous disions au précédent congrès du CCI : « Dans une telle situation d'instabilité, il est plus facile pour chaque puissance de créer des troubles chez ses adversaires, de saboter les alliances qui lui portent ombrage, que de développer pour sa part des alliances solides et s'assurer une stabilité sur ses terres. » {Résolution sur la situation internationale, point 11). Cependant, il convient de mettre en évidence des différences importantes aussi bien dans les méthodes que dans le résultat de la politique suivie par ces deux puissances.
15) Le résultat de la politique internationale de l'Allemagne ne se limite pas, loin de là, à détacher la France de la Grande-Bretagne et obtenir de la première qu'elle renoue leur alliance passée, ce qui s'est concrétisé notamment, au cours de la dernière période, par des accords militaires de première importance, aussi bien sur le terrain, en Bosnie (mise en place d'une brigade conjointe) qu'au niveau des accords de coopération militaires (signature le 9 décembre 1996 d'un accord pour « un concept commun en matière de sécurité et de défense »). En réalité, on assiste à l'heure actuelle à une avancée très significative de l'impérialisme allemand qui se concrétise notamment par :
-le fait qu'au sein de la nouvelle alliance entre la France et l'Allemagne, cette dernière se trouve dans un rapport de forces beaucoup plus favorable que dans la période 1990-94 (la France ayant été contrainte en bonne partie de retourner à ses anciennes amours du fait de la défection de la Grande-Bretagne) ; -une extension de sa zone traditionnelle d'influence vers les pays de l'Est, et tout particulièrement par le développement d'une alliance avec la Pologne ;
- un renforcement de son influence en Turquie (dont le nouveau gouvernement dirigé par l'islamiste Erbakan est plus favorable à l'alliance allemande que le précédent) qui lui sert de relais en direction du Caucase (où elle soutient les mouvements nationalistes qui s'opposent à la Russie) et de l'Iran avec qui la Turquie a signé d'importants accords ;
- l'envoi, pour la première fois depuis la seconde guerre mondiale, d'unités combattantes en dehors des frontières, et justement dans la zone particulièrement critique des Balkans avec le corps expéditionnaire présent en Bosnie dans le cadre de 1’IFOR (ce qui permet au ministre de la défense de déclarer que « L'Allemagne jouera un rôle important dans la nouvelle société »).
Par ailleurs, l'Allemagne, en compagnie de la France, a engagé un forcing diplomatique en direction de la Russie dont elle est le premier créancier et qui n'a pas tiré d'avantages décisif de son alliance avec les Etats-Unis.
16) Ainsi, dès à présent, l'Allemagne est en train de s'installer dans son rôle de principal rival impérialiste des Etats-Unis. Cependant, il faut noter qu'elle a réussi jusqu'à aujourd'hui à avancer ses pions sans s'exposer à des représailles du mastodonte américain, en particulier en évitant systématiquement de le défier de façon ouverte comme le fait la France. La politique de l'aigle allemand (qui pour le moment réussit à masquer ses griffes) se révèle en fin de compte bien plus efficace que celle du coq gaulois. C'est à la fois la conséquence des limites que son statut de vaincu de la deuxième guerre mondiale continue de lui imposer (bien que justement sa politique actuelle vise à dépasser ce statut) et de son assurance en tant que seule puissance ayant éventuellement la possibilité, à terme, de prendre la direction d'un nouveau bloc impérialiste. C'est aussi le résultat du fait que, jusqu'à présent, l'Allemagne a pu avancer ses positions sans faire étalage direct de sa force militaire (même si, évidemment, elle a apporté un soutien très important à son allié Croate dans sa guerre contre la Serbie). Mais la première historique que constitue la présence de son corps expéditionnaire en Bosnie non seulement a brisé un tabou mais indique la direction dans laquelle elle devra s'orienter de plus en plus pour tenir son rang. Ainsi, à terme, ce ne sera plus seulement par délégation (comme ce fut le cas en Croatie, et dans une moindre mesure dans le Caucase) que l'impérialisme allemand apportera sa contribution aux conflits sanglants et aux massacres dans lesquels s'enfonce le monde actuel, mais de façon bien plus directe.
17) Pour ce qui concerne la politique internationale des Etats-Unis, l'étalage et l'emploi de la force armée non seulement fait partie depuis longtemps de ses méthodes, mais elle constitue maintenant le principal instruments de défense de ses intérêts impérialistes, comme le CCI l'a mis en évidence depuis 1990, avant même la guerre du Golfe. Face à un monde dominé par le «chacun pour soi », où notamment les anciens vassaux du gendarme américain aspirent à se dégager le plus possible de la pesante tutelle de ce gendarme qu'ils avaient dû supporter face à la menace du bloc adverse, le seul moyen décisif pour les Etats-Unis d'imposer leur autorité est de s'appuyer sur l'instrument pour lesquels ils disposent d'une supériorité écrasante sur tous les autres Etats : la force militaire. Ce faisant, les Etats-Unis sont pris dans une contradiction :
- d'une part, s'ils renoncent à la mise en oeuvre ou à l'étalage de leur supériorité militaire, cela ne peut qu'encourager les pays qui contestent leur autorité à aller encore plus loin dans cette contestation,
- d'autre part, lorsqu'ils font usage de la force brute, même, et surtout, quand ce moyen aboutit momentanément à faire ravaler les velléités de leurs opposants, cela ne peut que pousser ces derniers à saisir la moindre occasion pour prendre leur revanche et tenter de se dégager de l'emprise américaine.
En fait, l'affirmation de la supériorité militaire par la superpuissance agit en sens contraire suivant que le monde est divisé en blocs, comme avant 1989, ou que les blocs n'existent plus. Dans le premier cas, l'affirmation de cette supériorité tend à renforcer la confiance des vassaux envers le leader quant à sa capacité à les défendre efficacement et constitue donc un facteur de cohésion autour de lui. Dans le second cas, les démonstrations de force de la seule superpuissance qui ait survécu ont au contraire comme résultat ultime d'aggraver encore plus le « chacun pour soi » tant que n'existe pas une puissance qui puisse lui faire concurrence à son niveau. C'est pour cela que les succès de la contre-offensive actuelle des Etats-Unis ne sauraient être considérés comme définitifs, comme un dépassement de la crise de leur leadership. La force brute, les manoeuvres visant à déstabiliser leurs concurrents (comme aujourd'hui au Zaïre), avec tout leur cortège de conséquences tragiques n'ont donc pas fini d'être employés par cette puissance, bien au contraire, contribuant à accentuer le chaos sanglant dans lequel s'enfonce le capitalisme.
18) C'est un chaos qui a encore relativement épargné l'extrême Orient et l'Asie du Sud Est. Mais il importe de souligner l'accumulation de charges explosives qui s'y déroule à l'heure actuelle :
- intensification des efforts d'armement des deux principales puissances, Chine et Japon ;
- volonté de ce dernier pays de se dégager le plus possible du contrôle américain hérité de la seconde guerre mondiale;
- politique plus ouvertement « contestataire » de la Chine (ce dernier pays tenant un peu la place de la France en occident alors que le Japon a une diplomatie beaucoup plus semblable à celle de l'Allemagne);
- menace de déstabilisation politique en Chine (particulièrement après la mort de Deng) ;
- existence d'une multitude de « contentieux » entre Etats (Taiwan et Chine, les deux Corées, Vietnam et Chine, Inde et Pakistan, etc.).
Pas plus qu'elle ne pourra échapper à la crise économique, cette région ne pourra échapper aux convulsions impérialistes qui assaillent le monde aujourd'hui, contribuant à accentuer le chaos général dans lequel s'enfonce la société capitaliste.
19) Ce chaos général, avec son cortège de conflits sanglants, de massacres, de famines, et plus généralement, la décomposition qui envahit tout les domaines de la société et qui risque, à terme, de l'anéantir, trouve son aliment principal dans l'impasse totale dans laquelle se trouve l'économie capitaliste. Mais en même temps, cette impasse, avec les attaques permanentes et de plus en plus brutales qu'elle provoque nécessairement contre la classe productrice de l'essentiel de la richesse sociale, le prolétariat, porte avec elle la riposte de ce dernier et la perspective de son surgissement révolutionnaire. Depuis la fin des années 1960, le prolétariat mondial a fait la preuve qu'il n'était pas disposé à subir passivement les attaques capitalistes et les luttes qu'il a menées dès les premières atteintes de la crise ont démontré qu'il était sorti de la terrible contre-révolution qui s'était abattue sur lui après la vague révolutionnaire des années 1917-23. Cependant, ce n'est pas de façon continue qu'il a développé ses luttes mais de façon heurtée, avec des avancées et des reculs. C'est ainsi que, entre 1968 et 1989, la lutte de classe a connu trois vagues de combats successifs (1968-74, 1978-81, 1983-89) au cours desquelles les masses ouvrières, malgré des défaites, des hésitations, des retours en arrière, ont acquis une expérience croissante qui les a conduites, notamment, à rejeter de plus en plus l'encadrement syndical. Cependant, cette avancée progressive de la classe ouvrière vers une prise de conscience des buts et des moyens de son combat a été brutalement interrompue à la fin des années 1980 :
« Cette lutte, qui avait resurgi avec puissance à la fin des années 1960, mettant un terme à la plus terrible contre-révolution qu'ait connue la classe ouvrière, a subi un recul considérable avec l'effondrement des régimes staliniens, les campagnes idéologiques qui l'ont accompagné et l'ensemble des événements (guerre du Golfe, guerre en Yougoslavie, etc.) qui l'ont suivi. C'est sur les deux plans de sa combativité et de sa conscience que la classe ouvrière a subie, de façon massive, ce recul, sans que cela remette en cause toutefois, comme le CCI l'avait déjà affirmé à ce moment-là, le cours historique vers les affrontements de classe. » (Résolution sur la situation internationale du 11e congrès du CCI, point 14)
20) A partir de l'automne 1992, avec les grandes mobilisations ouvrières en Italie, le prolétariat a repris le chemin des luttes. Mais c'est un chemin semé d'embûches et de difficultés. Lors de l'effondrement des régimes staliniens, à l'automne 1989, en même temps qu'il annonçait le recul de la conscience provoqué par cet événement, le CCI avait précisé que : « l'idéologie réformiste pèsera très fortement sur les luttes dans la période qui vient, favorisant grandement l'action des syndicats » (« Thèses sur la crise économique et politique en URSS et dans les pays de l'Est », Revue Internationale n° 60) Et, effectivement, nous avons assisté, au cours de la dernière période, à un retour en force des syndicats résultant d'une stratégie très élaborée de la part de toutes les forces de la bourgeoisie. Cette stratégie avait comme premier objectif de mettre à profit le désarroi provoqué dans la classe ouvrière par les événements de 1989-91 pour recrédibiliser le plus possible à ses yeux les appareils syndicaux dont le discrédit acquis dans beaucoup de pays tout au long des années 80 continuait à se faire sentir. L'illustration la plus claire de cette offensive politique de la bourgeoisie nous a été donnée par la manoeuvre développée par les différents secteurs de la bourgeoisie, à l'automne 1995 en France. Grâce à un habile partage des tâches entre la droite au pouvoir, déchaînant de façon particulièrement provocante toute une avalanche d'attaques contre le niveau de vie de la classe ouvrière, et les syndicats, se présentant comme les meilleurs défenseurs de celle-ci, mettant eux-mêmes en avant les méthodes prolétariennes de lutte, l'extension au delà des secteurs et la conduite du mouvement par les assemblées générales, l'ensemble de la classe bourgeoise a redonné aux appareils syndicaux une popularité qu'ils n'avaient pas connue depuis plus d'une décennie. Le caractère prémédité, systématique et international de la manoeuvre s'est révélé avec l'immense publicité faite aux grèves de la fin 1995 dans tous les pays alors que la plupart des mouvements des années 1980 avaient été l'objet d'un black-out total. D s'est encore confirmé avec la manoeuvre développée en Belgique, à la même période, qui constituait une copie conforme de la première. De même, la référence aux grèves de l'automne 1995 en France a été largement employée lors de la manoeuvre mise en place au printemps 1996 en Allemagne et qui devait culminer avec l'immense marche sur Bonn du 10 juin. Cette manoeuvre était destinée à donner aux syndicats, perçus comme des spécialistes de la négociation et de la concertation avec le patronat, une image beaucoup plus combative afin qu'ils soient capables dans l'avenir de contrôler les luttes sociales qui ne manqueront pas de surgir face à une intensification sans précédent des attaques économiques contre la classe ouvrière. Ainsi se confirmait clairement l'analyse que le CCI avait mise en avant à son 11e Congrès : « les manoeuvres présentes des syndicats ont aussi, et surtout, un but préventif: il s'agit pour eux de renforcer leur emprise sur les ouvriers avant que ne se déploie beaucoup plus leur combativité, combativité qui résultera nécessairement de leur colère croissante face aux attaques de plus en plus brutales de la crise. » (Résolution sur la situation internationale, point 17) Et le résultat de ces manoeuvres venant compléter le désarroi provoqué par les événements de 1989-91 pouvait nous faire dire, lors du 12e Congrès de notre section en France : «... dans les principaux pays du capitalisme, la classe ouvrière se retrouve ramenée à une situation comparable à celle des années 1970 en ce qui concerne ses rapports aux syndicats et au syndicalisme : une situation où la classe, globalement, luttait derrière les syndicats, suivait leurs consignes et leurs mots d'ordre et, enfin de compte, s'en remettait à eux. En ce sens, la bourgeoisie a momentanément réussi à effacer des consciences ouvrières les leçons acquises au cours des années 1980, suite aux expériences répétées de confrontation aux syndicats. » (Résolution sur la situation internationale, point 12)
21) L'offensive politique de la bourgeoisie contre la classe ouvrière ne se limite pas, loin de là, à la crédibilisation des appareils syndicaux. La classe dominante utilise les différentes manifestations de la décomposition de la société (montée de la xénophobie, conflits entre cliques bourgeoises, etc.) pour les retourner contre la classe ouvrière. C'est ainsi qu'on a assisté dans plusieurs pays d'Europe à des campagnes destinées à créer des diversions auprès des ouvriers, voire à dévoyer leur colère et leur combativité sur un terrain totalement étranger à celui du prolétariat :
-mise à profit des sentiments xénophobes exploités par l'extrême droite (Le Pen en France, Heider en Autriche) pour monter des campagnes sur le « danger de fascisme » ;
-en Espagne, campagnes contre le terrorisme de l'ETA dans lesquelles les ouvriers sont invités à se solidariser de leurs patrons ;
- utilisation des règlements de compte entre secteurs de l'appareil policier et judiciaire pour mettre sur pieds des campagnes pour un Etat et une justice « propres » dans des pays comme l'Italie (opération « mains propres ») et particulièrement en Belgique (affaire Dutroux).
Ce dernier pays a constitué au cours de la dernière période une sorte de « laboratoire » pour tout l'éventail de mystifications mises en oeuvre contre la classe ouvrière par la bourgeoisie. Celle-ci, a successivement :
- réalisé une copie conforme de la manoeuvre de la bourgeoisie française de l'automne 1995 ;
- puis développé une manoeuvre semblable à celle de la bourgeoisie allemande du printemps 1996;
-monté en épingle, à partir de l'été 1996, l'affaire Dutroux laquelle a été opportunément « découverte » au « bon moment » (alors que tous les éléments étaient déjà connus par la justice depuis longtemps) afin de créer, grâce à un battage médiatique sans précédent, une véritable psychose dans les familles ouvrières, en même temps que pleuvaient les attaques, et défouler la colère sur le terrain interclassiste d'une «justice au service du peuple », particulièrement lors de la « marche blanche » du 20 octobre ;
- relancé, avec la « marche multicolore » du 2 février organisée à l'occasion de la fermeture des Forges de Clabecq, la mystification interclassiste d'une «justice populaire » et d'une « économie au service du citoyen », mystification renforcée par la promotion du syndicalisme « de combat » et « de base » autour du très médiatique D'Orazio ;
- ajouté une nouvelle couche de mensonges démocratiques suite à l'annonce début mars de la fermeture de l'usine Renault de Vilvorde (fermeture qui a été condamnée par les tribunaux) en même temps qu'on faisait la promotion d'une « Europe sociale », opposée à « l'Europe des capitalistes ».
L'immense médiatisation internationale de toutes ces manoeuvres a une nouvelle fois fait la preuve qu'elles n'étaient pas uniquement à usage interne mais faisaient partie d'un plan élaborée de façon concertée par la bourgeoisie de tous les pays. Il s'agit pour la classe dominante, pleinement conscience du fait que ses attaques croissantes contre la classe ouvrière vont provoquer de la part de cette dernière des ripostes de grande envergure, de prendre les devants à un moment où la combativité n'est encore qu'embryonnaire, où pèsent encore fortement sur la conscience les séquelles de l'effondrement des prétendus régimes « socialistes », afin de « mouiller la poudre » et de renforcer au maximum son arsenal de mystifications syndicalistes et démocratiques.
22) Le désarroi incontestable dans lequel se trouve à l'heure actuelle la classe ouvrière a donné à la bourgeoisie une certaine marge de manoeuvre quant à ses jeux politiques internes. Comme l'avait établi le CCI début 1990: «C'est pour cette raison (...) qu'il convient aujourd'hui de mettre à jour l'analyse développée par le CCI sur la "gauche dans l'opposition". Cette carte était nécessaire à la bourgeoisie depuis la fin des années 1970 et tout au long des années 1980 du fait de la dynamique générale de la classe vers des combats de plus en plus déterminés et conscients, de son rejet croissant des mystifications démocratiques, électorales et syndicales. Les difficultés rencontrées dans certains pays (par exemple la France) pour la mettre en place dans les meilleures conditions ne retiraient rien au fait qu'elle constituait l'axe central de la stratégie de la bourgeoisie contre la classe ouvrière, ce qui a été illustré par la permanence de gouvernements de droite dans des pays aussi importants que les Etats-Unis, la RFA et la Grande-Bretagne. En revanche, le recul actuel de la classe n'impose plus à la bourgeoisie, pour un certain temps, l'utilisation prioritaire de cette stratégie. Cela ne veut pas dire que dans ces derniers pays on verra nécessairement la gauche retourner au gouvernement : nous avons, à plusieurs reprises (...) mis en évidence qu'une telle formule n'est indispensable que dans les périodes révolutionnaires ou de guerre impérialiste. Par contre, il ne faut pas être surpris s'il advient un tel événement, ou bien considérer qu'il s'agit d'un "accident" ou l'expression d'une faiblesse particulière de la bourgeoisie de ces pays. » (Revue Internationale n° 61) C'est pour cette raison que la bourgeoisie italienne a pu, en grande partie pour des raisons de politique internationale, faire appel au printemps 1996 à une équipe de centre gauche où domine l'ancien parti communiste (PSD) et soutenue pendant un bon moment par l'extrême gauche de « Rifondazione Comunista ». C'est aussi pour cette raison que la probable victoire des travaillistes en Grande-Bretagne, en mai 1997, ne devra pas être vue comme une source de difficultés pour la bourgeoisie de ce pays (qui a d'ailleurs pris le soin de mettre fin au lien organique entre le parti et l'appareil syndical afin de permettre à ce dernier de s'opposer au gouvernement, si nécessaire). Cela dit, il importe de souligner, le fait que la classe dominante ne va revenir aux thèmes des années 1970 où « l'alternative de gauche » avec son programme de mesures « sociales », voire de nationalisations, avait comme objectif de briser l'élan de la vague de luttes initiée en 1968 en dévoyant le mécontentement et la combativité vers l'impasse électorale. Si des partis de gauche (dont le programme économique se distingue d'ailleurs de moins en; moins de ceux de droite) parviennent au gouvernement, ce sera essentiellement « par défaut » du fait des difficultés de la droite, et non comme moyen de mobilisation des ouvriers dont la crise a aujourd'hui ôté les illusions qu'ils pouvaient avoir dans les années 1970.
23) Dans cet ordre d'idées, il convient aussi d'établir une différence très nette entre les campagnes idéologiques qui se déploient aujourd'hui et celles qui avaient été employées contre la classe ouvrière au cours des années 1930. Entre ces deux types de campagnes, il existe un point commun : elles se déploient toutes sur le thème de la « défense de la Démocratie ». Cependant, les campagnes des années 1930 :
- se situaient dans un contexte de défaite historique du prolétariat, de victoire sans partage de la contre-révolution ;
-avaient comme objectif d'embrigader les prolétaires dans la guerre mondiale qui se préparait ;
-disposaient d'un faire valoir, les régimes fascistes en Italie, Allemagne et Espagne, bien réel, massif, durable et ciblé.
En revanche, les campagnes actuelles :
- se situent dans un contexte où le prolétariat à surmonté la contre-révolution, où il n'a pas subi de défaite décisive remettant en cause le cours historique aux affrontements de classe ;
-ont comme objectif de saboter un cours montant de la combativité et de la conscience dans la classe ouvrière ;
- ne disposent pas d'un faire valoir unique et ciblé mais sont obligées de faire appel à des thèmes disparates et quelques fois circonstanciels (terrorisme, « danger fasciste », réseaux de pédophilie, corruption de la justice, etc.) ce qui tend à limiter leur portée internationale et dans le temps.
C'est pour ces raisons que si les campagnes de la fin des années 1930 avaient réussi à mobiliser les masses ouvrières derrière elles de façon permanente, celles d'aujourd'hui :
- soit réussissent à entraîner massivement les ouvriers (cas de la « Marche blanche » du 20 octobre 1996 à Bruxelles) mais elles ne peuvent le faire que dans une durée limitée (c'est pour cela que la bourgeoisie belge a mis en place d'autres manoeuvres par la suite) ;
- soit se déploient de façon permanente (^cas des campagnes anti-Front National en France), mais ne réussissent pas à embrigader les ouvriers, jouant essentiellement un rôle de diversion.
Cela dit, il importe de ne pas sous-estimer le danger de ce type de campagnes dans la mesure où les effets de la décomposition générale et croissante de la société bourgeoise pourront leur fournir de nouveaux thèmes en permanence. Seule une avancée significative de la conscience dans la classe ouvrière permettra à celle-ci de repousser ce type de mystifications. Et cette avancée ne pourra résulter que d'un développement massif des luttes ouvrières remettant en cause, comme elle avait commencé à le faire au milieu des années 1980, les instruments les plus importants de la bourgeoisie en milieu ouvrier, les syndicats et le syndicalisme.
24) Cette remise en cause, qui s'accompagne de la prise en main directe des luttes et de leur extension par les assemblées générales et les comités de grève élus et révocables, passe nécessairement par tout un processus de confrontation avec le sabotage des syndicats. C'est un processus qui va nécessairement se développer dans l'avenir du fait de l'accroissement de la combativité ouvrière en réponse aux attaques de plus en plus brutales que déchaînera le capitalisme. Déjà, la tendance à un développement de la combativité ne permet plus aujourd'hui à la bourgeoisie, devant la menace d'un débordement, de renouveler les grandes manoeuvres « à la française » de 1995-96 destinées à recrédibiliser massivement les syndicats. Cependant, ces derniers n'ont pas eu encore l'occasion de se démasquer réellement même si, au cours de la dernière période, ils ont commencé à employer plus fréquemment leurs méthodes d'action « classiques » comme la division entre secteur public et secteur privé (manifestation du 11 décembre 1996 en Espagne, par exemple) ou la mise en avant du corporatisme. L'exemple le plus spectaculaire de cette tactique est la grève déclenchée à l'annonce de la fermeture de l'usine Renault de Vilvorde où l'on a pu voir les syndicats des différents pays où se trouvent des usines de cette entreprise promouvoir une mobilisation « européenne » des « Renault ». Mais le fait que cette manoeuvre crapuleuse des syndicats soit passée inaperçue, qu'elle leur ait même permis d'augmenter quelque peu leur prestige tout en diffusant la mystification d'une « Europe sociale », fait la preuve que nous sommes aujourd'hui dans une étape charnière entre celle de la recrédibilisation des syndicats et celle où ils devront se découvrir et se déconsidérer de plus en plus. Une des caractéristiques de cette période consiste dans le début d'une mise en avant des thèmes du syndicalisme « de combat » suivant lesquels « la base » serait capable de « pousser » les directions syndicales à se radicaliser (exemples des Forges de Clabecq ou des mineurs en mars dernier en Allemagne) où qu'il peut exister une "base syndicale" capable de défendre vraiment les intérêts ouvriers en dépit des trahisons des appareils (exemple, notamment, de la grève des dockers en Grande-Bretagne).
25) Ainsi, c'est encore un long chemin qui attend la classe ouvrière sur la voie de son émancipation, un chemin que la bourgeoisie va systématiquement miner par toutes sortes de pièges, comme on l'a déjà vu au cours de la dernière période. L'ampleur des manoeuvres mises en place par la bourgeoisie démontre qu'elle est consciente des dangers que recèle pour elle la situation actuelle du capitalisme mondial. Si Engels avait pu écrire que la classe ouvrière mène son combat sur trois plans, économique, politique et idéologique, la stratégie actuelle de la bourgeoisie qui se déploie également contre les organisations révolutionnaires (campagne sur le prétendu « négationnisme » de la Gauche communiste) fait la preuve qu'elle le sait parfaitement. Il appartient aux révolutionnaires, non seulement de débusquer et de dénoncer systématiquement les pièges semées par la classe dominante, et l'ensemble de ses organes, notamment les syndicats, mais de mettre en avant, contre toutes les falsifications qui se sont développées au cours de la dernière période, la véritable perspective de la révolution communiste comme but ultime des combats présents du prolétariat. C'est uniquement si la minorité communiste joue pleinement son rôle que la classe ouvrière pourra développer ses forces et sa conscience pour atteindre ce but.
Vie du CCI:
- Résolutions de Congrès [131]
- Défense de l'organisation [2052]
Révolution allemande (VIII) : le putsch de Kapp
- 5716 reads
L'extrême-droite passe à l'offensive, la démocratie inflige la défaite à la classe ouvrière
Dans la Revue Internationale n° 83, nous avons montré qu'en 1919 la classe ouvrière, suite à l'échec du soulèvement de janvier, a subi de lourdes défaites du fait de l'éparpillement de ses luttes. La classe dominante en Allemagne a déchaîné la plus violente des répressions contre les ouvriers.
1919 a connu l'apogée de la vague révolutionnaire mondiale. Tandis que la classe ouvrière en Russie reste isolée face à l'assaut organisé par les Etats démocratiques, la bourgeoisie allemande passe à l'offensive contre un prolétariat terriblement atteint par ses récentes défaites afin de le terrasser.
La classe ouvrière supporte le coût de la défaite de l'impérialisme allemand
Après le désastre de la guerre, alors que l'économie est en lambeaux,
la classe dominante cherche à exploiter la situation en faisant peser tout le
poids de sa défaite sur les reins de la classe ouvrière. En Allemagne, entre
1913 et 1920, les productions agricole et industrielle ont baissé de plus de 50
%. De plus, un tiers de la production restante doit être livré aux pays
vainqueurs. Dans de nombreuses branches de l'économie la production continue de
s'effondrer. Les prix augmentent de façon vertigineuse et le coût de la vie
passe de l'indice 100 en 1913 à l'indice 1100 en 1920. Après les privations
subies par la classe ouvrière pendant la guerre, c'est la famine « en temps de paix » qui est au programme.
La sous-alimentation continue à se répandre. Le chaos et l'anarchie de la
production capitaliste, la paupérisation et la faim parmi les ouvriers règnent
partout.
La bourgeoisie utilise le Traité de Versailles pour diviser la classe ouvrière
Simultanément, les puissances victorieuses de l'Ouest font payer au prix fort la bourgeoisie allemande vaincue. Il existe cependant de grandes oppositions d'intérêts entre les puissances victorieuses. Alors que les Etats-Unis trouvent un intérêt à ce que l'Allemagne serve de contrepoids à l'Angleterre et, pour cette raison, s'élèvent contre toute mise en pièces de l'Allemagne, la France souhaite un affaiblissement territorial, militaire et économique aussi durable que possible, et même un démembrement de l'Allemagne. Le Traité de Versailles du 28 juin 1919 stipule que l'armée en Allemagne sera réduite par étapes à 400 000 hommes au 10 avril 1920, puis à 200 000 hommes le 20 juillet 1920. La nouvelle armée républicaine, la Reichswehr, ne peut reprendre dans ses rangs que 4000 officiers sur les 24 000 existants. Elle considère ces décisions comme une menace de mort planant sur elle ; aussi s'y oppose-t-elle par tous les moyens. Tous les partis bourgeois - du SPD au Centre en passant par l'extrême-droite -se retrouvent unis dans l'intérêt du capital national unis pour rejeter le Traité de Versailles. Ce n'est que sous la contrainte exercée par les puissances victorieuses qu'ils s'inclinent. Cependant la bourgeoisie mondiale tire profit du Traité de Versailles pour approfondir la division qui existait déjà pendant la guerre entre les ouvriers des puissances victorieuses et ceux des puissances vaincues.
Par ailleurs, une fraction importante de l'armée, se sentant menacée par le Traité, cherche immédiatement à organiser la résistance contre son application. Elle aspire à une nouvelle confrontation avec les puissances victorieuses. Pour envisager cette perspective, il faut que la bourgeoisie impose très rapidement une nouvelle défaite décisive à la classe ouvrière.
Mais, pour l'instant, il n'est pas question, pour les principaux tenants du capital allemand, que l'armée arrive au pouvoir. A la tête de l'Etat bourgeois, le SPD fait en effet la preuve de ses grandes capacités. Depuis 1914, il a réussi à museler le prolétariat. Et, au cours de l'hiver 1918-19, il a organisé avec une grande efficacité le sabotage et la répression des luttes révolutionnaires. Le capital allemand n'a donc pas besoin de l'armée pour maintenir sa domination. Il dispose de la dictature de la République de Weimar et s'appuie sur elle. C'est ainsi que les troupes de police, sous les ordres du SPD, tirent sur une manifestation massive rassemblée devant le Reichstag le 13 janvier 1920. Quarante-deux morts restent sur le pavé. Au cours de la vague de grèves dans la Ruhr à la fin février le « gouvernement démocratique » menace les révolutionnaires de la peine de mort.
C'est pourquoi lorsqu'en février 1920 des parties de l'armée mettent en pratique leurs aspirations putschistes, elles ne sont soutenues que par des fractions minoritaires du capital. Ce sont surtout celles de l'Est agraire qui forment leur point d'appui, celles qui sont particulièrement intéressées à la reconquête des régions orientales perdues au cours de la guerre.
Le putsch de Kapp : l'extrême-droite passe à l'offensive...
La préparation de ce putsch est un secret de polichinelle au sein de la bourgeoisie. D'ailleurs dans un premier temps, le gouvernement SPD n'entreprend rien contre les putschistes. Le 13 mars 1920 une brigade de la Marine sous le commandement du général von Lûttwitz entre à Berlin, cerne le siège du gouvernement Ebert et proclame sa destitution. Quand Ebert rassemble autour de lui les généraux von Seekt et Schleicher pour riposter à ce putsch de l'extrême-droite, l'armée hésite car, comme le déclare alors le Haut-Commandant de l’Etat-major : « La Reichswehr ne peut admettre aucune "guerre fratricide" Reichswehr contre Reichswehr. »
Le gouvernement prend alors la fuite, d'abord à Dresde puis vers Stuttgart. Kapp déclare alors le gouvernement social-démocrate démis de ses fonctions mais ne fait procéder à aucune arrestation. Avant sa fuite vers Stuttgart le gouvernement, soutenu par les syndicats, parvient à lancer un appel à la grève et montre une nouvelle fois la perfidie avec laquelle il est capable d'agir contre la classe ouvrière.
« Luttez par tous les moyens pour le maintien de la République. Abandonnez tous vos différends. Il n'existe qu'un seul moyen contre la dictature de Guillaume II :
- la paralysie totale de toute l'économie ;
- tous les bras doivent être croisés ;
- aucun prolétaire ne doit prêter son concours à la dictature militaire ;
- grève générale sur toute la ligne. Prolétaires, unissez-vous. A bas la contre-révolution. »
Les membres sociaux-démocrates du gouvernement : Ebert, Bauer, Noske Le Comité directeur du SPD - O. Wels
Les syndicats et le SPD interviennent ainsi immédiatement pour protéger la république bourgeoise - même s'ils utilisent à cette occasion un langage en apparence favorable aux ouvriers ([1] [2894]). Kapp proclame la dissolution de l'Assemblée Nationale, annonce des élections et menace tout ouvrier en grève de la peine de mort.
La riposte armée de la classe ouvrière
L'indignation parmi les ouvriers est gigantesque. Immédiatement ils comprennent clairement qu'il s'agit d'une attaque directe contre leur classe. Partout se développe la riposte la plus violente. Naturellement, il ne s'agit pas de prendre la défense du gouvernement haï de Scheidemann.
De la Wasserkante à la Prusse Orientale, en passant par l'Allemagne centrale, Berlin, le Bade-Wtlrtemberg, la Bavière et la Ruhr, dans toutes les grandes villes se développent des manifestations ; dans tous centres industriels les ouvriers entrent en grève et cherchent à prendre d'assaut les postes de police pour s'armer ; dans les usines se tiennent des assemblées générales pour décider du combat à mener. Dans la plupart des grandes villes les troupes putschistes commencent à ouvrir le feu sur les ouvriers en manifestation. Des dizaines d'ouvriers tombent les 13 et 14 mars 1920.
Dans les centres industriels des comités d'action, des conseils ouvriers et des conseils exécutifs sont formés. Les masses ouvrières affluent dans les rues. Depuis novembre 1918, jamais la mobilisation ouvrière n'avait été aussi importante. Partout la colère ouvrière explose contre les militaires.
Le 13 mars, jour de l'entrée des troupes de Kapp dans Berlin, la Centrale du KPD réagit d'abord par l'expectative. Dans une première prise de position elle déconseille la grève générale : « Le prolétariat ne lèvera pas le petit doigt pour la République démocratique. (...) La classe ouvrière, hier encore mise aux fers par les Ebert et Noske, et désarmée, (...) est en ce moment incapable d'agir. La classe ouvrière entreprendra la lutte contre la dictature militaire dans les circonstances et avec les moyens qui lui paraîtront propices. Ces circonstances ne sont pas encore réunies. »
La Centrale du KPD se trompe cependant. Les ouvriers eux-mêmes ne veulent pas attendre. Au contraire, en l'espace de quelques jours ils sont de plus en plus nombreux à se joindre au mouvement. Partout s'élèvent les mots d'ordre : « Armement des ouvriers », « A bas les putschistes ».
Alors qu'en 1919, dans toute l'Allemagne, la classe ouvrière avait lutté dans l'éparpillement, le putsch provoque sa mobilisation simultanée en de nombreux lieux à la fois. Cependant, hormis dans la Ruhr, il ne se produit quasiment aucune prise de contact entre les différents foyers de lutte. Dans tout le pays la riposte se fait spontanément mais sans la moindre organisation capable de lui donner une centralisation.
La Ruhr, la plus importante concentration de la classe ouvrière, est la cible principale des « Kappistes ». C'est pourquoi elle est le centre de la riposte ouvrière. A partir de Munster, les « Kappistes » tentent d'encercler les ouvriers de la Ruhr. Ceux-ci sont les seuls à unir leurs luttes à l'échelle de plusieurs villes et à donner une direction centralisée à la grève Partout des comités d'action sont formes. Des unités d'ouvriers en armes (80 000 environ) sont mises sur pieds Cela constitue la plus importante mobilisation militaire de l'histoire du mouvement ouvrier, après la Russie
Bien que cette résistance sur le plan militaire ne soit pas centralisée à l'échelle du pays, les ouvriers en armes parviennent à stopper l'avance des troupes de Kapp. Les putschistes sont défaits ville après ville La classe ouvrière n'était pas parvenue à enregistrer de tels succès en 1919, au cours des différents soulèvements révolutionnaires Le 20 mars 1920, l'armée est contrainte de se retirer complètement de la Ruhr. Dés le 17 mars, Kapp doit déjà se démettre sans conditions, son putsch ayant à peine duré 100 heures. C'est la puissante riposte de la classe ouvrière qui est la cause de sa chute
Comme lors des événements de l'année précédente, les principaux foyers de la résistance ouvrière se trouvent en Saxe, à Hambourg, à Francfort et à Munich ([2] [2895]). Mais la réaction la plus puissante a lieu dans la Ruhr.
Alors que dans l'ensemble de l'Allemagne le mouvement reflue fortement après la départ de Kapp et l'échec du putsch, dans la Ruhr cette situation ne met pas fin au mouvement. De nombreux ouvriers pensent, en effet, qu'il y a là une opportunité pour développer le combat.
Les limites de la riposte ouvrière
Si un large front de riposte de la part de la classe ouvrière s'est développé à la vitesse de l'éclair contre les putschistes sanguinaires, il est cependant évident que la question du renversement de la bourgeoisie n'est pas vraiment à l'ordre du jour ; il ne s'agit, pour la majorité des ouvriers, que de repousser une agression armée.
La suite à donner à ce succès est, à ce moment-là, une question obscure. Hormis les ouvriers de la Ruhr, ceux des autres régions ne formulent quasiment pas de revendications pouvant conférer une plus grande dimension au mouvement de la classe. Tant que la pression ouvrière était dirigée contre le putsch il y avait une orientation homogène parmi les prolétaires. Mais une fois les troupes putschistes battues, le mouvement marque le pas et se retrouve sans objectif clair. Repousser une attaque militaire dans une région ne crée pas forcément les conditions pour un renversement de la classe capitaliste.
En différents endroits, il y a, de la part des anarcho-syndicalistes, des tentatives de mise en train de mesures de socialisation de la production. Celles-ci expriment l'illusion que l'expulsion des extrémistes de droite suffit à ouvrir les portes du socialisme. Toute une série de « commissions » sont créées, ici et là, par les ouvriers qui veulent, par ce moyen, adresser leurs exigences à l'Etat bourgeois. Tout ceci est présenté comme les premières mesures prises par les ouvriers sur le chemin du socialisme, comme les tout premiers petits pas vers le double pouvoir. Mais en réalité ces conceptions ne sont que des signes d'impatience qui détournent l'attention des ouvriers des tâches les plus urgentes à accomplir. Avoir de telles illusions qu'après s'être seulement assuré d'un rapport de forces favorable à un niveau LOCAL constitue un grave danger pour la classe ouvrière, parce que la question du pouvoir ne peut se poser d'abord qu'à l'échelle d'un pays, et en réalité seulement à l'échelle internationale. C'est pourquoi les signes d'impatience petite-bourgeoise et le « tout, tout de suite » doivent être fermement combattus.
Si les ouvriers se sont immédiatement mobilisés militairement contre le putsch, l'impulsion et la force de leur mouvement ne provient pas fondamentalement des usines. Sans cela, c'est-à-dire sans l'initiative des masses qui exercent leur pression dans la rue et qui s'expriment dans les assemblées ouvrières - au sein desquelles la situation est discutée et les décisions prises collectivement - le mouvement ne peut réellement aller de l'avant. Ce processus implique la prise en mains la plus large possible, la tendance à l'extension et à l'unification du mouvement mais également un développement en profondeur de la conscience qui permet notamment de démasquer les ennemis du prolétariat.
C'est pourquoi l'armement des ouvriers et leur riposte militaire déterminée ne suffisent pas. La classe ouvrière doit mettre en oeuvre ce qui est sa principale force : le développement de sa conscience et de son organisation. Dans cette perspective, les conseils ouvriers occupent la place centrale. Les conseils ouvriers et les comités d'action qui sont réapparus spontanément dans ce dernier mouvement, sont cependant encore trop faiblement développés pour servir de point de ralliement et de fer de lance pour le combat
De plus, dés le départ, le SPD entreprend toute une série de manoeuvres pour exercer son rôle de sabotage contre les conseils. Alors que le KPD concentre toute son intervention sur la réélection des conseils ouvriers, cherchant ainsi à renforcer l'initiative ouvrière, le SPD parvient à bloquer ces tentatives
Le SPD et les syndicats : fer de lance de la défaite de la classe ouvrière
Dans la Ruhr de nombreux représentants du SPD siègent dans les comités d'action et dans le comité de grève central. Tout comme entre novembre 1918 et fin 1919, ce parti sabote le mouvement aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur ; et une fois les ouvriers affaiblis de façon déterminante, il pourra abattre sur eux tous les moyens de répression.
Suite à la démission de Kapp le 17 mars, au retrait des troupes hors de la Ruhr le 20 mars et à la reprise en main des affaires par le gouvernement SPD Ebert-Bauer de retour d'« exil », ce dernier avec l'armée sont en mesure de réorganiser les forces bourgeoises.
Une nouvelle fois les syndicats et le SPD se ruent au secours du Capital. S'appuyant sur la pire démagogie et sur des menaces à peine voilées, Ebert et Scheidemann appellent immédiatement à la reprise du travail : « Kapp et Liittwitz sont hors d'état de nuire, mais la sédition des Junkers continue de menacer l'Etat Populaire allemand. C'est eux que concerne la poursuite du combat, jusqu'à temps qu'eux aussi se soumettent sans conditions. Pour ce grand but, il faut resserrer encore plus solidement et plus profondément le front républicain. La grève générale, à plus longue échéance, porte atteinte non seulement à ceux qui se sont rendus coupables de haute trahison, mais aussi à notre propre front. Nous avons besoin de charbon et de pain pour poursuivre le combat contre les anciennes puissances, c'est pourquoi il faut cesser la grève du peuple, mais tout en restant en état d'alerte permanent. »
En même temps, le SPD fait mine de faire des concessions politiques pour atteindre le mouvement à travers sa partie la plus combative et la plus consciente. C'est ainsi qu'il promet « plus de démocratie » dans les usines, « une influence déterminante dans l'élaboration de la nouvelle réglementation de la constitution économique et sociale », l'épuration de l'administration des forces ayant des sympathies envers les putschistes. Mais surtout, les syndicats font tout pour qu'un accord soit signé. L'accord de Bielefeld fait la promesse de concessions qui, en réalité, permet de mettre un frein au mouvement pour ensuite organiser la répression.
Au même moment la menace d'une « intervention étrangère » est une nouvelle fois agitée : un élargissement des luttes ouvrières permettrait une attaque des troupes étrangères, surtout celles des Etats-Unis, contre l'Allemagne ; de même les livraisons de ravitaillement en provenance de Hollande à destination de la population affamée seraient interrompues.
Ainsi les syndicats et le SPD préparent les conditions et mettent en place tous les moyens de la répression contre la classe ouvrière. Le même SPD, dont les ministres quelques jours auparavant, le 13 mars, appelaient encore les ouvriers à la grève générale contre les putschistes, prennent à nouveau les rênes en main pour mener la répression. Alors que les négociations en vue d'un cessez-le-feu sont en train de se dérouler et qu'en apparence le gouvernement fait des « concessions » à la classe ouvrière, la mobilisation générale de la Reichswehr est déjà en route. Un grand nombre d'ouvriers ont l'illusion fatale que les troupes gouvernementales envoyées par « l'Etat démocratique » de la République de Weimar contre les putschistes ne peuvent entreprendre aucune action de combat contre les ouvriers. C'est ainsi que le Comité de Défense de Berlin-Kôpenick appelle les milices ouvrières à cesser le combat. Dès l'entrée dans Berlin des troupes fidèles au gouvernement, des conseils de guerre sont immédiatement mis sur pieds, conseils dont la férocité ne va rien envier à celle des Corps-Francs une année auparavant. Quiconque est pris en possession d'une arme est immédiatement exécuté. Des ouvriers par milliers sont soumis à la torture, fusillés ; d'innombrables femmes sont violées. On estime à plus de 1 000 les ouvriers assassinés pour la seule région de la Ruhr.
Ce que les sbires de Kapp n'ont pas réussi à faire contre les ouvriers, les bourreaux de l'Etat démocratique vont y parvenir.
Depuis la première guerre mondiale tous les partis bourgeois sont réactionnaires et des ennemis de la classe ouvrière.
Depuis que le système capitaliste est entré dans sa période de décadence, le prolétariat a constamment dû se réapproprier le fait qu'il n'existe aucune fraction de la classe dominante moins réactionnaire que les autres ou dans une disposition de moindre hostilité par rapport à la classe ouvrière. Au contraire, les forces de gauche du capital, comme l'exemple du SPD en a apporté la preuve, sont encore plus sournoises et plus dangereuses dans leurs attaques contre la classe ouvrière.
Dans le capitalisme décadent il n'y a aucune fraction de la bourgeoisie qui soit, d'une manière ou d'une autre, encore progressiste et que la classe ouvrière doive soutenir. Le prolétariat paie très cher ses illusions vis à vis de la social-démocratie. Avec l'écrasement de la riposte ouvrière contre le putsch de Kapp, le SPD montre derechef toute sa sournoiserie et fait la preuve qu'il agit au service du Capital.
D'abord il se présente comme « le représentant le plus radical des ouvriers ». Non seulement il parvient à mystifier les ouvriers mais aussi leurs partis politiques. Bien que, à un niveau général, le KPD mette en garde haut et fort la classe ouvrière contre le SPD et dénonce sans restriction le caractère bourgeois de sa politique, il est souvent lui-même, à un niveau local, victime de ses sournoiseries. C'est ainsi que, dans différentes villes, le KPD signe des appels à la grève générale communs avec le SPD.
Par exemple à Francfort le SPD, 1’USPD et le KPD déclarent ensemble : « Il faut entrer en lutte maintenant, non pas pour protéger la République bourgeoise, mais pour établir le pouvoir du prolétariat. Quittez immédiatement les usines et les bureaux ! »
A Wuppertal les directions des districts des trois partis publient cet appel : « La lutte unitaire doit être menée avec pour objectifs:
1° La conquête du pouvoir politique par la dictature du prolétariat jusqu'à la consolidation du socialisme sur la base du pur système des conseils.
2° La socialisation immédiate des entreprises économiques suffisamment mûres pour cette fin.
Pour atteindre ces objectifs, les partis signataires (USPD, KPD, SPD) appellent à entrer avec détermination en grève générale le lundi 15 mars. »
Le fait que le KPD et 1’USPD ne dénoncent pas le véritable rôle du SPD mais prêtent leur concours à l'illusion de la possibilité d'un front uni avec ce parti traître à la classe ouvrière et dont les mains sont couvertes du sang ouvrier va avoir des conséquences dévastatrices.
A nouveau, le SPD tire toutes les ficelles et prépare la répression contre la classe ouvrière. Après la défaite des putschistes, avec Ebert à la tête du gouvernement, il dote la Reichswehr d'un nouveau chef - von Seekt - militaire chevronné qui s'est déjà taillé une solide réputation en tant que bourreau de la classe ouvrière. D'emblée, l'armée excite la haine contre les ouvriers : « Alors que le putschisme de droite doit quitter la scène battu, le putschisme de gauche relève à nouveau la tête. (...) Nous portons les armes contre toutes les variétés de putschs ». Ainsi les ouvriers qui ont combattu les putschistes sont dénoncés comme les véritables putschistes. « Ne vous laissez pas induire en erreur par les mensonges bolchevistes et spartakistes. Restez unis et forts. Faites front contre le bolchevisme qui veut tout anéantir. » (Au nom du gouvernement du Reich : von Seekt et Schiffer)
C'est un véritable bain de sang qu'accomplit la Reichswehr sous le commandement du SPD. C'est l'armée « démocratique » qui marche contre la classe ouvrière, alors que les « Kappistes » ont depuis longtemps pris la fuite !
Les faiblesses des
révolutionnaires sont fatales à toute la classe ouvrière
Alors que la classe ouvrière s'oppose avec un courage héroïque aux attaques de l'armée et cherche à donner une orientation à leurs luttes, les révolutionnaires sont à la traîne par rapport au mouvement. L'absence d'un parti communiste fort constitue l'une des causes décisives de ce nouveau revers que subit la révolution prolétarienne en Allemagne.
Comme nous l'avons montré dans les articles précédents, le KPD s'est trouvé gravement affaibli par l'exclusion de l'opposition lors du Congrès de Heidelberg ; en mars 1920 le KPD ne compte que quelques centaines de militants à Berlin, la majorité des membres ayant été exclue.
De plus pèse sur le parti le traumatisme de sa terrible faiblesse, lors de la semaine sanglante de janvier 1919, lorsqu'il n'est pas arrivé à dénoncer de façon unie le piège tendu par la bourgeoisie à la classe ouvrière et qu'il n'est pas parvenu à empêcher celle-ci de s'y engouffrer.
Voila pourquoi le 13 mars 1920 le KPD développe une analyse fausse du rapport de forces entre les classes, pensant qu'il est trop tôt pour frapper en retour. Il est évident que la classe ouvrière se trouve confrontée à l'offensive de la bourgeoisie et n'a pas le choix du moment du combat. De plus sa détermination à riposter est importante. Face à cette situation le parti a parfaitement raison de donner l'orientation suivante :
« Rassemblement immédiat dans toutes les usines pour élire des conseils ouvriers. Réunion immédiate des conseils en assemblées générales qui se doivent de prendre en charge la direction de la lutte et d'arrêter les prochaines mesures à prendre. Réunion immédiate des conseils en un Congrès Central des conseils. Au sein des conseils ouvriers les Communistes luttent pour la dictature du prolétariat, pour la République des conseils... » (15 mars 1920)
Mais après la reprise en main par le SPD des rênes des affaires gouvernementales, la Centrale du KPD déclare le 21 mars 1920 :
« Pour la conquête ultérieure des masses prolétariennes à la cause du communisme, un état de choses dans lequel la liberté politique pourrait être mise à profit sans limite et où la démocratie bourgeoise n'apparaîtrait pas comme la dictature du Capital, est de la plus haute importance pour le développement en direction de la dictature du prolétariat.
Le KPD voit dans la constitution d'un gouvernement socialiste excluant tout parti bourgeois capitaliste, des conditions favorables à l'action des masses prolétariennes et à leur processus de maturation nécessaire à l'exercice de la dictature du prolétariat.
Il adoptera vis à vis du gouvernement une attitude d'opposition loyale tant que celui-ci n'attentera pas aux garanties qui assurent à la classe ouvrière sa liberté d'action politique et tant qu'il combattra la contre-révolution bourgeoise par tous les moyens à sa disposition et qu'il n'empêchera pas le renforcement social et organisationnel de la classe ouvrière. »
En promettant au SPD son « opposition loyale » qu'espère le KPD ? N'est-ce pas le même SPD qui, au cours de la guerre et au début de la vague révolutionnaire, a tout entrepris pour mystifier la classe ouvrière, l'attacher au char de l'Etat et qui a froidement organisé sa répression !
En adoptant cette attitude la Centrale du KPD se laisse abuser par les manoeuvres du SPD. Lorsque l'avant-garde des révolutionnaires se laisse autant induire en erreur, il n'est dés lors pas étonnant que dans les masses les illusions au sujet du SPD se trouvent renforcées ! La politique catastrophique du front uni « à la base » appliqué en mars 1920 par la Centrale du KPD, va malheureusement être reprise immédiatement par l'Internationale Communiste. Le KPD a ainsi accompli un tragique premier pas. Pour les militants exclus du KPD en octobre 1919, cette nouvelle erreur de la Centrale est le motif qui les poussent à fonder le KAPD à Berlin très peu de temps après, au début avril 1920.
Encore une fois la classe ouvrière en Allemagne s'est héroïquement battue contre le Capital. Et cela alors que la vague de luttes au niveau international est en plein reflux. Mais une fois encore elle a dû agir en étant privée de l'action déterminante du parti. Les hésitations et les erreurs politiques des révolutionnaires en Allemagne mettent clairement en évidence combien pèsent lourdement dans la balance le manque de clarté et la défaillance de l'organisation politique du prolétariat.
Cet affrontement provoqué par la bourgeoisie à partir du putsch de Kapp s'est malheureusement conclu par une nouvelle et grave défaite du prolétariat en Allemagne. Malgré le formidable courage et la détermination avec lesquelles ils se sont jetés dans la bataille, les ouvriers ont encore une fois payé au prix fort leurs illusions persistantes vis à vis du SPD et de la démocratie bourgeoise. Handicapés politiquement par la faiblesse chronique de ses organisations révolutionnaires, abusés par la politique et les discours sournois de la social-démocratie, ils sont défaits et finalement livrés non pas aux balles des putschistes d'extrême-droite mais à celles de la très « démocratique » Reichswehr sous les ordres du gouvernement SPD.
Mais cette nouvelle défaite du prolétariat en Allemagne est surtout un coup d'arrêt pour la vague révolutionnaire mondiale et la Russie des soviets est de plus en plus isolée.
DV.
[1] [2896] Aujourd'hui encore la question, s'il s'agissait on non d'une provocation visant un but précis, avec un accord entre l'armée et le gouvernement, n'est pas clarifiée. On ne peut en aucune manière considérer comme exclue l'hypothèse selon laquelle la classe dominante avait un plan utilisant les putschistes comme facteur de provocation suivant le concept suivant : les extrémistes de droite attirent les ouvriers dans le piège, la dictature démocratique frappant ensuite de toutes ses forces !
[2] [2897] En Allemagne Centrale Max Hôlz fait pour la première fois son apparition. En organisant des groupes de combat d'ouvriers armés, il livre de nombreux combats à la police et à l'armée. Au cours d'actions contre les magasins il s'empare des marchandises pour les distribuer aux chômeurs. Nous reviendrons sur lui dans un prochain article.
Géographique:
- Allemagne [98]
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Allemande [1955]
Conscience et organisation:
Approfondir:
- Révolution Allemande [1957]
Heritage de la Gauche Communiste:
- La Révolution prolétarienne [1149]
Le communisme n'est pas un bel idéal, il est à l'ordre du jour de l'histoire [1° partie]
- 3824 reads
Le communisme n'est pas un bel idéal
Dès le début de la première série de ces articles, « Le communisme n'est pas un bel idéal, niais une nécessité matérielle », nous avons combattu le cliché qui prétend que o le communisme est un bel idéal, mais qui ne marchera jamais », en affirmant, avec Marx, que le communisme ne se ramène absolument pas à « un bel idéal u, mais est contenu organiquement dans la lutte de classe du prolétariat. Le communisme n'est pas une utopie abstraite imaginée par une poignée de visionnaires bien intentionnés; c'est un mouvement qui prend naissance dans les conditions mêmes de la société actuelle. Et pourtant, cette première série d'articles s'est beaucoup consacrée à l'étude des idées des communistes durant la période ascendante du capitalisme, à l'examen de la manière dont leur conception de la société future et des moyens d'y parvenir s'est développée au cours du 19e siècle, c'est-à-dire bien avant que la révolution communiste ne soit à l'ordre du jour de l’histoire.
Le communisme est le mouvement de l'ensemble du prolétariat, de la classe ouvrière en tant que force sociale historique et internationale. Mais son histoire est aussi l'histoire de ses organisations; et la clarification des buts du mouvement est la tâche spécifique de ses minorités politiques, ses partis et fractions. Contrairement aux chimères des conseillistes et des anarchistes, il n'y a pas de mouvement communiste sans organisations communistes ; pas plus qu'il n'existe de conflits d'intérêts entre les deux. A travers la première série d'articles, nous avons montré comment le travail de clarification des moyens et des buts du mouvement a été réalisé par les marxistes de la Ligue Communiste et des Première et Deuxième Internationales; mais ce travail a toujours été réalisé en liaison la plus étroite avec le mouvement des masses, en participant et en tirant les leçons d'événements historiques tels que les révolutions de 1848 ou la Commune de Paris en 1871.
Dans cette seconde série, nous examinerons l'évolution du projet communiste dans la période de la décadence du capitalisme, c'est-à-dire la période où le communisme n'est plus seulement la perspective générale des luttes ouvrières ; c'est la période où il est devenu une véritable nécessité du fait que les rapports de production capitalistes sont entrés définitivement en conflit permanent avec les forces productives qu'ils ont mises en mouvement. Plus simplement, la décadence du capitalisme a placé 1’humanité devant le choix : communisme ou barbarie. Nous aurons l'occasion de revenir plus profondément sur la signification de cette alternative tout au long de cette série. Pour le moment nous voulons simplement dire que, pas plus que dans la première série, les articles consacrés à la période de décadence du capitalisme ne peuvent prétendre fournir une « histoire » de tous les événements majeurs du 20e siècle qui ont contribué à l'élucidation des moyens et des buts du communisme. Peut-être plus que dans la première série nous aurons à nous restreindre à la manière dont les communistes ont analysé et compris ces événements.
II suffit de considérer la révolution russe de 1917 pour réaliser pourquoi il doit en être ainsi : écrire une nouvelle histoire, même consacrée aux seuls premiers mois de cet événement, serait complètement au dessus de nos moyens. Mais cela ne doit en aucune manière diminuer l'importance de notre étude. Au contraire, nous allons découvrir que quasiment toutes les avancées que le mouvement révolutionnaire du 20e siècle a réalisées dans sa compréhension de la voie vers le communisme découlent pour l'essentiel de cette expérience irremplaçable de la classe ouvrière. Même si la Revue Internationale du CCI a déjà dédié de nombreuses pages aux leçons de la révolution russe et de la vague révolutionnaire internationale qu'elle a initiée, il y a encore beaucoup à dire sur la manière dont ses leçons ont été tirées et élaborées par les organisations communistes de cette époque.
1905: LA GREVE DE MASSE OUVRE LA VOIE A LA REVOLUTION PROLETARIENNE
Les marxistes considèrent généralement que le début de l'époque de décadence capitaliste commence avec l'éclatement de la première guerre impérialiste mondiale en 1914. Cependant, nous avons terminé la première série, et nous commençons la seconde, avec la « première » révolution russe, avec les événements de 1905 qui ont eu lieu dans ce qu'on peut considérer comme une période charnière entre les deux époques. Comme nous le verrons, la nature équivoque de cette période a conduit à de nombreuses ambiguïtés dans le mouvement ouvrier sur la signification de ces événements. Mais ce qui a été perçu le plus clairement, parmi les fractions les plus lucides du mouvement, c'est que 1905 en Russie marquait l'émergence de nouvelles formes de lutte et d'organisation qui correspondaient aux besoins de la nouvelle période de déclin capitaliste. Si, comme nous l'avons montré dans le dernier article de la première série, la précédente décennie avait témoigné d'une forte tendance dans le mouvement ouvrier à perdre de vue la perspective du communisme - en particulier à travers le poids croissant des illusions réformistes et parlementaires -, 1905 a été l'éclair qui a illuminé la route pour tous ceux qui voulaient la voir.
Rosa Luxemburg et le débat sur la grève de masse
A première vue, la révolution de 1905 en Russie fut un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Les idées réformistes s'étaient emparées du mouvement ouvrier tandis que le capitalisme semblait connaître des jours enchanteurs dans lesquels la situation ne pouvait que s'améliorer pour les ouvriers tant que ceux-ci s'en tenaient aux méthodes légales du syndicalisme et du parlementarisme. Les temps de l’héroïsme révolutionnaire, des combats de rue et des barricades semblaient appartenir au passé, et même ceux qui professaient « l'orthodoxie » marxiste, tel Karl Kautsky, répétaient que le meilleur moyen pour les ouvriers de faire la révolution était de gagner une majorité parlementaire. Soudain, en janvier 1905, la répression sanglante d'une manifestation pacifique conduite par le prêtre et agent de l’Etat Gapone, allumait la mèche d'une vague de grèves massives à travers l'immense empire du Tsar et initiait une année entière d'effervescence sociale qui allait culminer dans de nouvelles grèves de masse en octobre et donner naissance au Soviet de St Petersburg puis à l’insurrection armée de décembre.
En vérité, ces événements n'ont pas surgi du néant. Les misérables conditions de travail et d'existence des ouvriers russes, qui étaient à l'origine de leur humble pétition au Tsar en ce premier dimanche de janvier, avaient été rendues encore plus intolérables par la guerre russo-japonaise de 1904. Cette guerre avait été la pleine expression de l'aiguisement des tensions inter-impérialistes globales qui devaient atteindre leur paroxysme en 1914. De plus, la magnifique combativité des ouvriers russes n'était pas non plus un phénomène isolé, tant historiquement que géographiquement. Les mouvements de grève en Russie s'étaient accumulés depuis les années 1890, tandis que le spectre de la grève de masse avait déjà dressé la tête en Europe occidentale même: en Belgique et en Suède en 1902, en Hollande en 1903 et en Italie en 1904.
Avant même 1905, le mouvement ouvrier avait été traversé par un débat animé sur la a grève générale ». Dans la Deuxième Internationale, les marxistes avaient combattu la mythologie anarchiste et syndicaliste qui présentait la grève générale comme un événement apocalyptique qui pourrait être engagé à tout moment et qui permettrait de se débarrasser du capitalisme sans que la classe ouvrière ait besoin de conquérir le pouvoir politique. Mais l'expérience pratique de la classe détourna le débat de ces abstractions pour l'orienter vers la question concrète de la grève de masse, c'est-à-dire un mouvement de grèves réel et en évolution par opposition à l'arrêt du travail universel décrété à l'avance et une fois pour toute. Dès lors, les protagonistes du débat changèrent. La question de la grève de masse allait devenir une des principales pommes de discorde entre la droite réformiste et la gauche révolutionnaire au sein du mouvement ouvrier et des partis social-démocrates en particulier. Et, comme lors du précédent round de ce débat (sur les théories révisionnistes de Bernstein à la fin des années 1890), c'est le mouvement ouvrier en Allemagne qui allait être au centre de la controverse.
Les réformistes, en particulier les dirigeants syndicalistes, ne voyaient dans la grève de masse qu'une force de l'anarchie menaçant de ruiner les années de patient travail au cours desquelles les syndicats avaient acquis leurs effectifs d'adhérents et leurs fonds de soutien et pour le parti une substantielle représentation parlementaire. Les bureaucrates syndicaux, spécialistes dans la négociation avec la bourgeoisie, craignaient que des explosions massives et spontanées, comme celles qui avaient eu lieu en Russie, ne débouchent sur une répression massive et la perte de tous les gains péniblement acquis dans les décennies précédentes. Prudemment, ils évitèrent de dénoncer ouvertement le mouvement en Russie. Par contre, ils cherchèrent à limiter son champ d'application. Ils acceptèrent la grève de masse comme le produit de l'arriération de la Russie et de son régime despotique. Elle ne pouvait donc pas être appliquée à un pays comme l'Allemagne où les syndicats et les partis ouvriers avaient une existence légale reconnue. Et si une espèce de grève générale s'avérait nécessaire en Europe occidentale, il ne pourrait s'agir que d'une opération défensive limitée visant à préserver les droits démocratiques existants contre un assaut de la réaction. Mais surtout, une telle opération devait être préparée à l'avance et contrôlée de près par les organisations ouvrières existantes de manière à contenir toute menace « d'anarchie ».
Officiellement, la direction du SPD avait pris ses distances par rapport à ses tendances conservatrices. Au congrès d’Iena de 1905, Bebel présenta une résolution qui semblait marquer une victoire de la gauche contre les réformistes puisqu'elle saluait l'importance de la grève de masse. En fait, la résolution de Bebel était une expression typique du centrisme puisqu'elle réduisait la grève de masse à la sphère purement défensive. La direction révélera sa duplicité quelques mois plus tard, en février 1906, lorsqu'elle passera un accord secret avec les syndicats pour bloquer toute propagande effective pour la grève de masse en Allemagne.
Pour la gauche, par contre, le mouvement en Russie avait une signification universelle et historique. II apportait un souffle d'air frais dans l'atmosphère renfermée du syndicalisme et du parlementarisme qui avait dominé le parti depuis si longtemps. Les efforts de la gauche pour comprendre les implications des grèves de masse en Russie se sont cristallisés surtout dans les écrits de Rosa Luxemburg qui avait déjà mené le combat contre le révisionnisme de Bernstein et qui avait été directement impliquée dans les événements de 1905 à travers son appartenance au Parti social-démocrate de Pologne ; ce pays faisait alors partie de l'empire russe. Dans sa brochure, célèbre à juste titre, Grève de masses, parti et syndicat, elle fit montre d'une profonde maîtrise de la méthode marxiste qui, du fait de son cadre historique et théorique global, est capable de discerner les floraisons de l'avenir dans les germes du présent. De même que Marx avait été capable de prédire le futur général du capitalisme mondial en étudiant ses formes pionnières en Angleterre, ou de proclamer les potentialités révolutionnaires du prolétariat en observant un mouvement aussi faible d'apparence que celui des tisserands de Silésie, Luxemburg fut capable de montrer que le mouvement prolétarien dans la Russie « arriérée » de 1905 révélait les caractéristiques essentielles de la lutte de classes dans une période qui commençait seulement à s'ouvrir: celle du déclin du capitalisme mondial.
Les opportunistes retranchés dans la bureaucratie syndicale et leurs partisans plus ou moins ouverts dans le parti ne tardèrent pas à attaquer ces marxistes, qui cherchaient à tirer les implications réelles du mouvement de grève de masse en Russie, en les taxant de « romantiques de la révolution » et surtout d'anarchistes cherchant à ressusciter la vieille vision millénariste de la grève générale. II est vrai qu'il y avait des semi-anarchistes dans le SPD - en particulier ceux qui se faisaient appeler les « lokalisten » et qui appelaient à une « grève sociale générale » - et que, comme Luxemburg l’a écrit elle-même, les grèves de masse en Russie semblaient, à première vue, « être devenues le champ d'expérimentation pour les exploits de l'anarchisme. » ([1] [2898]) Mais, en réalité, Luxemburg a montré, outre que les anarchistes ont été presque complètement absents du mouvement, que les méthodes et les buts de ce dernier ont constitué « la liquidation historique de l'anarchisme ». Et cela pas uniquement parce que les ouvriers russes ont prouvé, contrairement à l'apolitisme plaidé par les anarchistes, que la grève de masse pouvait être aussi un instrument politique dans la lutte pour les droits démocratiques (cette lutte touchait à sa fin en tant que composante réalisable du combat du mouvement ouvrier). Mais d'abord et avant tout parce que la forme et la dynamique de la grève de masse a porté un coup décisif aux visions des anarchistes et à celles des bureaucrates syndicaux qui, au delà de toutes leurs différences, partageaient la notion fausse que la grève générale pouvait être déclenchée et arrêtée à volonté, indépendamment des conditions historiques et de l'évolution réelle de la lutte de classe. Contre ces visions, Luxemburg montrera que la grève de masse est « un produit historique et non pas artificiel », qu'elle n'est « ni 'fabriquée" artificiellement ni "décidée" ou "propagée" dans un éther immatériel et abstrait mais qu'elle est un phénomène historique résultant à un certain moment d'une situation sociale à partir d'une nécessité historique. Ce n’ est donc pas par des spéculations abstraites sur la possibilité ou l'impossibilité, sur l'utilité ou le danger de la grève de masse, c'est par l'étude des facteurs et de /a situation sociale qui provoquent la grève de masse dans /a phase actuelle de la lutte de classe, qu'on résoudra le problème ; ce problème, on ne le comprendra pas et on ne pourra pas le discuter à partir d'une appréciation subjective de la grève de masse en considérant ce qui est souhaitable ou non, mais à partir d'un examen objectif des origines de la grève de masse en partant du point de vue de ce qui est historiquement inévitable. » (Ibid.)
Et, lorsque Luxemburg évoque « la phase actuelle de la lutte de classe », elle ne se réfère pas à un moment passager mais bien à une nouvelle période historique. Avec une saisissante clairvoyance, elle avance que « la révolution russe actuelle éclate à un point de l évolution historique situé déjà sur l'autre versant de la montagne, au-delà de l'apogée de la société capitaliste » (Ibid.). En d'autres termes, la grève de masse en Russie présageait les conditions qui allaient devenir universelles dans l'époque imminente de la décadence capitaliste. Le fait qu'elle soit apparue avec une telle acuité dans la Russie « arriérée » renforçait plutôt qu'elle n'affaiblissait cette thèse, puisque le développement tardif mais très rapide du capitalisme en Russie avait donné naissance à un prolétariat hautement concentré faisant face à un appareil policier omniprésent qui lui interdisait virtuellement toute organisation et ne lui laissait d'autre choix que de s'organiser dans et à travers la lutte. Cette réalité va s'imposer à tous les ouvriers dans la période de décadence, période dans laquelle l’Etat capitaliste, ne pouvant plus tolérer l'existence d'organisations de masse permanentes, va détruire ou récupérer systématiquement à son profit tous les efforts précédents de la classe pour s'organiser à cette échelle.
La période de décadence du capitalisme est celle de la révolution prolétarienne. En conséquence, la révolution de 1905 en Russie « apparaît moins comme l'héritière des vieilles révolutions bourgeoises que comme le précurseur dune nouvelle série de révolutions prolétariennes. Le pays le plus arriéré, précisément parce qu'il a mis un retard impardonnable à accomplir sa révolution bourgeoise, montre au prolétariat d’Allemagne et des pays capitalistes les plus avancés, les voies et les méthodes de la lutte de classe à venir. » (Ibid.) Ces « voies et méthodes » sont précisément celles de la grève de masse qui, comme le dit Luxemburg, est « la mise en mouvement même de la masse prolétarienne, la force de manifestation de la lutte prolétarienne dans la révolution. » (Ibid.) En somme, le mouvement en Russie montrait aux ouvriers du monde entier le chemin de la révolution.
Les caractéristiques de la lutte de classe dans la nouvelle période
Quelle était précisément cette « méthode de mise en mouvement » de la lutte de classe dans la nouvelle période ?
D'abord, la tendance de la lutte à éclater spontanément, sans planification, sans collecte préalable de fonds destinés à soutenir un long siège contre les patrons. Luxemburg rappelle les motifs « minimes » qui, aux ateliers Poutilov, furent à l'origine de la grève de janvier ; dans son 1905, Trotsky évoque comment la grève d'octobre avait démarré parmi les typographes de Moscou pour une simple question de rétribution des ponctuations. Il en est ainsi parce que les causes immédiates de la grève de masse sont complètement secondaires au regard de ce qui est sous-jacent: la profonde accumulation de mécontentement dans le prolétariat face à un régime capitaliste de moins en moins capable de faire la moindre concession et contraint de rogner toujours plus ce qui avait été arraché au capital par les ouvriers.
Les bureaucrates syndicaux, bien sûr, pouvaient difficilement imaginer une lutte ouvrière à large échelle qui ne soit pas planifiée et contrôlée depuis leurs confortables bureaux-, et si des mouvements spontanés éclataient sous leurs yeux, ils ne pouvaient les considérer que comme impuissants parce qu'inorganisés. Mais Luxemburg leur répondît qu'avec l'émergence des nouvelles conditions de la lutte de classe, la spontanéité, loin d'être la négation de l'organisation, en constituait le point de départ le plus vital: « La conception rigide et mécanique de la bureaucratie n'admet la lutte que comme résultat de l'organisation parvenue à un certain degré de sa force. L'évolution dialectique vivante, au contraire, fait naître l'organisation comme un produit de la lutte. Nous avons déjà vu un magnifique exemple de ce phénomène en Russie où un prolétariat quasi inorganisé a commencé à créer en un an et demi de luttes révolutionnaires tumultueuses un vaste réseau d'organisations. » (Ibid.)
N’en déplaise à beaucoup de critiques de Luxemburg, une telle vision n'est pas « spontanéiste » : les organisations auxquelles elle fait référence ici sont les organes unitaires immédiats des ouvriers et non pas le parti politique ou la fraction dont l'existence et le programme, au lieu d'être liés au mouvement immédiat de la classe, correspondent avant tout à sa dimension historique et en profondeur. Comme nous le verrons, Luxemburg n'a, en aucune manière, nié la nécessité pour le parti politique prolétarien d'intervenir dans la grève de masse. Mais sa vision exprime de manière extrêmement lucide la fin de toute une époque dans laquelle les organisations unitaires de la classe pouvaient exister sur une base permanente, en dehors des phases de combat ouvert contre le capital.
La nature explosive, spontanée de la lutte dans les nouvelles conditions est directement liée à l'essence même de la grève de masse : la tendance des luttes à s'étendre très rapidement à des couches de plus en plus larges d'ouvriers. Décrivant l'extension de la grève de janvier, elle écrivait: « on ne peut parler ni de plan préalable, ni d'action organisée, car l'appel des partis avait peine à suivre les soulèvements spontanés de la masse ; les dirigeants avaient à peine le temps de formuler des mots d'ordre, tandis que la masse des prolétaires allait à l'assaut. » (Ibid.) Alors que le mécontentent dans la classe est général, il devient éminemment possible pour le mouvement de s'étendre à travers faction directe des ouvriers en grève, en appelant leurs camarades des autres usines et secteurs autour de revendications qui reflètent leurs griefs communs.
Enfin, contre ceux qui, dans les syndicats et les partis, voulaient une « grève de masse purement politique », une grève de masse ramenée à une arme défensive de protestation contre les transgressions des droits démocratiques des ouvriers, Luxemburg a démontré l'interaction vivante entre les aspects économique et politique de la grève de masse :
« ( ..) Le mouvement dans son ensemble ne s'oriente pas uniquement dans le sens d'un passage de l'économique au politique, mais aussi dans le sens inverse. Chacune des grandes actions de masse politiques se transforme, après avoir atteint son apogée, en une foule de grèves économiques. Ceci ne vaut pas seulement pour chacune des grandes grèves, mais aussi pour la révolution dans son ensemble. Lorsque la lutte politique s'étend, se clarifie et s'intensifie, non seulement la lutte revendicative ne disparaît pas mais elle s'étend, s'organise, et s'intensifie parallèlement. II y a interaction complète entre les deux. (..) En un mot, la lutte économique présente une continuité, elle est le fil qui relie les différents nœuds politiques ; la lutte politique est une fécondation périodique préparant le sol aux luttes économiques. La cause et l'effet se succèdent et alternent sans cesse, et ainsi le facteur économique et le facteur politique, bien loin de se distinguer complètement ou de s'exclure réciproquement, comme le prétend le schéma pédant, constituent dans une période de grève de masse deux aspects complémentaires de la lutte de classe prolétarienne en Russie. C'est précisément la grève de masse qui constitue leur unité. » (Ibid.) Et ici, la dimension « politique » ne signifie pas simplement, pour Luxemburg, la défense des libertés démocratiques, mais surtout la lutte offensive pour le pouvoir, comme elle le précise dans le passage qui suit immédiatement : « la grève de masse est inséparable de la révolution. » Le capitalisme en décadence est devenu incapable d'apporter des améliorations durables dans les conditions de vie de la classe ouvrière et tout ce qu'il peut offrir, en fait, c'est la répression et la paupérisation. C'est pourquoi les conditions mêmes qui donnent naissance à la grève de masse, contraignent aussi les ouvriers à poser la question de la révolution. Plus encore, parce qu'elle forme la base de la polarisation de la société bourgeoise en deux camps fondamentaux, parce qu'elle pousse inévitablement les prolétaires à s'opposer de front à la force de l’Etat capitaliste, la grève de masse ne peut pas faire autrement que de développer la nécessité de renverser le vieux pouvoir d’Etat : « Aujourd'hui la classe ouvrière est obligée de s'éduquer, de se rassembler et de se diriger elle-même au cours de la lutte et ainsi la révolution est dirigée autant contre l'exploitation capitaliste que contre le régime d'Etat ancien ; si bien que la grève de masse apparaît comme le moyen naturel de recruter, d'organiser et de préparer à la révolution les couches prolétaires les plus larges, de même qu'elle est en même temps un moyen de miner et d'abattre l'Etat ancien ainsi que d'endiguer l'exploitation capitaliste. » (Ibid.)
Ici Luxemburg s'attaque au problème posé par les opportunistes dans le parti, qui basaient leur « parlementarisme sinon rien » sur l'observation juste que le pouvoir d'Etat moderne ne pouvait plus être renversé par la seule vieille tactique des barricades et des combats de rue (et, dans le dernier article de cette série nous avons vu comment même Engels avait apporté son soutien aux opportunistes sur ce point). Les opportunistes croyaient qu'il en résulterait que « la lutte de classe se limiterait exclusivement à la bataille parlementaire et que la révolution -au sens de combat de rue - serait tout simplement supprimée. » Mais Luxemburg répond: « l'histoire a résolu le problème à sa manière, qui est à la fois la plus profonde et la plus subtile : elle a fait surgir la grève de masse révolutionnaire qui, celles, ne remplace ni ne rend superflus les affrontements directs et brutaux dans la rue, mais les réduit à un simple moment de la longue période de luttes politiques... » (Ibid.) Ainsi donc l'insurrection armée se présente comme le point culminant de l’œuvre organisative et éducative de la grève de masse. Cette perspective sera amplement confirmée par les événements de février à octobre 1917.
Dans ce passage, Luxemburg s'attaque à David et à Bernstein en ce qu'ils sont les porte-parole de la tendance opportuniste dans le parti. Mais, en insistant sur le fait que la révolution ne se limite pas à un unique acte violent insurrectionnel, en affirmant que ce dernier est le couronnement du mouvement de masse sur le terrain spécifique du prolétariat - les lieux de production et la rue -, Luxemburg exprimait également, sur le fond, un rejet total des conceptions « orthodoxes » défendues par Kautsky qui, à ce moment-là, étaient considérées comme faisant partie de la gauche du parti mais pour lesquelles la notion de révolution, comme nous l'avons montré dans l'article de cette série paru dans la Revue internationale n° 88, était tout aussi prisonnière de la nasse parlementariste. Comme nous le verrons plus tard, l'opposition réelle de Kautsky à l'analyse révolutionnaire de Luxemburg sur la grève de masse allait se faire bien plus nette après la parution de sa brochure. Mais Luxemburg avait déjà tracé la voie pour le rejet du parlementarisme en montrant que la grève de masse constituait l'embryon de la révolution prolétarienne.
Nous avons dit que le travail de Luxemburg sur la grève de masse n'éliminait en aucune manière la nécessité du parti prolétarien. En fait, à l'époque de la révolution prolétarienne, le parti révolutionnaire devient encore plus crucial, comme les bolcheviks allaient le montrer en Russie. Mais au développement de nouvelles conditions et de nouvelles méthodes de la lutte de classe correspondaient un rôle nouveau pour l'avant-garde révolutionnaire et Luxemburg fut une des premières à l’affirmer. La conception du parti comme une organisation de masse qui regroupe, englobe et commande la classe, conception qui avait dominé de plus en plus au sein de la social-démocratie, a été historiquement enterrée par la grève de masse. L'expérience de cette dernière a montré que le parti ne peut pas regrouper la majorité de la classe, pas plus qu'il ne peut prendre en main les détails organisationnels d'un mouvement aussi gigantesque et mouvant qu'une grève de masse. D'où la conclusion de Luxemburg :
« Ainsi nous parvenons pour l’Allemagne aux mêmes conclusions en ce qui concerne le rôle propre de la "direction" de la social-démocratie par rapport aux grèves de masse que dans l'analyse des événements de Russie. En effet, laissons de côté la théorie pédante d'une grève de démonstration mise en scène artificiellement par le Parti et les syndicats et exécutée par une minorité organisée et considérons le vivant tableau d'un véritable mouvement populaire issu de l'exaspération des conflits de classe et de la situation politique (..) : alors la tâche de la social-démocratie consistera non pas dans la préparation ou la direction technique de la grève, mais dans la direction politique de l'ensemble du mouvement. » (Ibid.)
La profondeur de l'analyse de Luxemburg sur la grève de masse en Russie a fourni une réfutation complète contre tous ceux qui cherchaient à nier sa signification historique et internationale. Comme une révolutionnaire véritable, Luxemburg a montré que les tempêtes venues de l'est bouleversaient non seulement les vieilles conceptions de la lutte de classe en général, mais encore exigeaient un réexamen radical du rôle du parti lui même. Pas étonnant qu'elle ait empêché de dormir les conservateurs qui dominaient les bureaucraties des syndicats et du parti !
Les soviets, organes du pouvoir prolétarien
Le dogme bordiguiste selon lequel le programme révolutionnaire serait « invariant » depuis 1848 a trouvé un total démenti dans les événements de 1905. Les méthodes et les formes organisationnelles de la grève de masse - en particulier les soviets ou conseils ouvriers – ne furent pas le résultat de schémas préétablis mais surgirent de la créativité de la classe en mouvement. Les soviets ne sont pas des créations ex-nihilo, ce qui n'existe pas dans la nature. Ils furent les héritiers naturels des précédentes formes d'organisation de la classe ouvrière, et en particulier de la Commune de Paris. Mais ils ont aussi représenté une forme plus élevée d'organisation qui correspondait aux besoins de la lutte dans la nouvelle période.
Un autre facette de la thèse de » l'invariance » est également contredite par la réalité de 1905 : celle selon laquelle le «fil rouge » de la clarté révolutionnaire au 20e siècle passe par un seul courant du mouvement ouvrier (la gauche italienne). Comme nous allons le voir, la clarté qui a émergé parmi les révolutionnaires sur les événements de 1905 est indubitablement une synthèse des différentes contributions faites par les révolutionnaires de l'époque. Ainsi, alors que Luxemburg a fait preuve, sur la dynamique de la grève de masse et les caractéristiques générales de la lutte de classe dans la nouvelle période, d'une clairvoyance sans égal, son livre Grève de masses, pari et syndicat contient par contre une compréhension étonnamment limitée des acquis organisationnels essentiels du mouvement. Elle a certainement révélé une profonde vérité en montrant que, dans la grève de masse, les organisations étaient le produit du mouvement et non l'inverse, mais l'organe qui est, plus que toute autre chose, l'émanation de la grève de masse, le soviet, est à peine mentionné au passage. Quand elle évoque les nouvelles organisations nées de la lutte, elle fait référence d'abord et avant tout aux syndicats : « ...tandis que les gardiens jaloux des syndicats allemands craignent avant tout de voir se briser en mille morceaux ces organisations, comme de la porcelaine précieuse, au milieu du tourbillon révolutionnaire, la révolution russe nous présente un tableau tout différent: ce qui émerge des tourbillons et de la tempête, des flammes et du brasier des grèves de masse, telle Aphrodite surgissant de l'écume des mers, ce sont des syndicats neufs et jeunes, vigoureux et ardents. » (Ibid.)
Il est vrai que, à l'aube naissante de la nouvelle période, les syndicats n'avaient pas encore été pleinement intégrés à l’Etat bourgeois, même si la bureaucratie combattue par Luxemburg était déjà l'expression de cette tendance. Mais il n'en reste pas moins que l'émergence des soviets signait la mort de la forme syndicale d'organisation. En tant que méthode de défense des ouvriers, cette dernière était entièrement rattachée à la période précédente où il était effectivement possible, pour les luttes ouvrières, d'être planifiées à l'avance et menées sur une base sectorielle dans la mesure où les patrons ne s'étaient pas encore unifiés derrière l’Etat et où la pression des ouvriers au niveau d'une entreprise ou d'un secteur ne provoquait pas automatiquement la solidarité de classe de la classe dominante contre leur lutte. Désormais, les conditions pour « des syndicats neufs et jeunes, vigoureux et ardents »étaient en train de disparaître rapidement, tandis que les conditions nouvelles exigeaient de nouvelles formes d'organisation.
La signification révolutionnaire des soviets a été comprise beaucoup plus clairement par les révolutionnaires en Russie et surtout par Trotsky qui a joué un rôle central dans le soviet de St Petersburg. Dans son livre 1905, écrit aussitôt après les événements, Trotsky fournit une définition classique du soviet qui fait clairement le lien entre sa forme et sa fonction dans la lutte révolutionnaire :
« Qu'était-ce donc que le Soviet ? Le conseil des députés ouvriers fut formé pour répondre à un besoin pratique, suscité par les conjonctures d'alors.- il fallait avoir une organisation jouissant d'une autorité indiscutable, libre de toute tradition, qui grouperait du premier coup les multitudes disséminées et dépourvues de liaison ; cette organisation devait être un confluent pour tous les courants révolutionnaires à l'intérieur du prolétariat; elle devait être capable d'initiative et se contrôler elle-même de manière automatique ; l'essentiel enfin, c'était de pouvoir la faire surgir dans les vingt-quatre heures. ( ..) Pour avoir de l'autorité sur les niasses, le lendemain même de sa formation, elle devait être instituée sur la base d'une très large représentation. Quel principe devait-on adopter ? La réponse venait toute seule. Comme le seul lien qui existât entre les masses prolétaires, dépourvues d'organisation, était le processus de la production, il ne restait qu’ à attribuer le droit de représentations aux entreprises et aux usines. » ([2] [2899])
Ici Trotsky comble le vide laissé par Luxemburg en montrant que c'est le soviet, et non les syndicats, qui constitue la forme organisationnelle appropriée à la grève de masse, à l'essence de la lutte prolétarienne dans la nouvelle période révolutionnaire. Né spontanément de l'initiative créatrice des ouvriers en mouvement, il incarne le nécessaire passage de la spontanéité à l'auto-organisation. L'existence permanente et la forme corporatiste des syndicats étaient adaptées uniquement aux méthodes de lutte de la période précédente. La forme soviétique d'organisation, au contraire, exprimait parfaitement les besoins d'une situation où la lutte « tend à se développer non plus sur un plan vertical (métiers, branches d'industrie) mais sur un plan horizontal (géographique) en unifiant tous ses aspects - économiques et politiques, localisés et généralisés -, (et où) la farine d'organisation qu'elle engendre ne peut avoir pour fonction que d'unifier le prolétariat par delà les secteurs professionnels. » ([3] [2900]).
Comme nous l'avons déjà vu, la dimension politique de la grève de masse n'est pas limitée au niveau défensif mais implique inévitablement le passage à l'offensive, à la lutte prolétarienne pour le pouvoir. Ici encore, Trotsky a vu, plus clairement que personne, que la destinée ultime du soviet était d'être un organe direct du pouvoir révolutionnaire. A mesure que le mouvement de masse s'organise et s’unifie, il est inévitablement obligé d'aller au delà des tâches « négatives » de paralysie de l'appareil productif et d'assumer les tâches « positives » de prise en charge de la production et de la distribution des denrées essentielles, de diffusion d'informations et de propagande, de garantie d'un nouvel ordre révolutionnaire. Tout cela révélait la nature réelle du soviet comme un organe capable de réorganiser la société :
« Le Soviet organisait les masses ouvrières, dirigeait les grèves et les manifestations, armait les ouvriers, protégeait la population contre les pogroms. Mais d'autres organisations révolutionnaires remplirent la même tâche avant lui, à côté de lui et après lui : elles n'eurent pourtant pas l'influence dont jouissait le soviet. Le secret de cette influence réside en ceci que cette assemblée sortit organiquement du prolétariat au cours de la lutte directe, prédéterminée par les événements, que mena le monde ouvrier pour la conquête du pouvoir. Si les prolétaires d'une part et la presse réactionnaire de l'autre donnèrent au soviet le titre de "gouvernement prolétarien", c'est qu'en fait cette organisation n'était autre que l'embryon d'un gouvernement révolutionnaire. » ([4] [2901]). Cette conception de la signification réelle des soviets était, comme nous le verrons, intimement liée à la vision de Trotsky que c'était essentiellement la révolution prolétarienne qui était à l'ordre du jour de l'histoire en Russie.
Lénine, bien que forcé d'observer les phases initiales du mouvement depuis l’exil, saisit également le rôle clé des soviets. Trois ans seulement auparavant, en écrivant son Que Faire ? avec le but majeur d'insister sur le rôle indispensable du parti révolutionnaire, il avait mis en garde contre la manière dont le courant économiste fétichisait la spontanéité immédiate de la lutte. Mais désormais, dans la tourmente de la grève de masse, Lénine a dû lui-même corriger les « superléninistes » de son parti qui transformaient cette polémique en dogme rigide. Se méfiant du soviet parce qu'il n'était pas un organe du parti et qu'il avait effectivement surgi spontanément de la lutte, ces bolcheviks le mettait devant un ultimatum absurde : adopter le programme des bolcheviks ou se dissoudre. Marx avait mis en garde contre ce genre d'attitude (« Voici la vérité, mettez-vous à genoux. ») avant même que le Manifeste Communiste ait été écrit; et Lénine vit clairement que si les bolcheviks persistaient dans cette ligne, ils passeraient complètement à côté du mouvement réel. Voici ce que fut la réponse de Lénine : « II me semble que le camarade Radine a tort (..) quand il pose cette question : le Soviet des Députés Ouvriers ou le Parti. Je pense qu'on ne saurait poser ainsi la question ; qu'il faut aboutir absolument à cette solution : et le Soviet des Députés Ouvriers et le Parti. La question - très importante - est seulement de savoir comment partager et comment coordonner les tâches du Soviet et celles du Parti Ouvrier Social-Democrate de Russie. II me semble que le Soviet aurait tort de se joindre sans réserve à un parti quelconque (..)
Le Soviet des députés ouvriers est né de la grève générale, à l'occasion de la grève, au nom des objectifs de la grève. Qui a conduit et fait aboutir la grève ? Tout le prolétariat au sein duquel il existe aussi... des non social-démocrates... Faut-il que ce combat soit livré par les seuls social-démocrates ou uniquement sous le drapeau social-démocrate ? II me semble que non... en qualité d'organisation professionnelle, le soviet des députés ouvriers doit tendre à s'incorporer les députés de tous les ouvriers, employés, gens de service, salariés agricoles etc. Quant à nous, social-démocrates, nous tâcherons à notre tour ... de lutter en commun avec les camarades prolétaires, sans distinction d'opinions, pour développer une propagande inlassable, opiniâtre de la conception seule conséquente, seule réellement prolétarienne, du marxisme. Pour ce travail, pour cet effort de propagande et d'agitation, nous conserverons absolument, nous consoliderons et développerons notre parti de classe, tout à fait indépendant, fidèlement attaché aux principes, le parti du prolétariat conscient... » ([5] [2902])
Tout comme Trotsky, qui souligna également cette distinction entre le parti, en tant qu’organisation « à l'intérieur du prolétariat » et le Conseil, en tant qu'organisation « du prolétariat » (ibid.), Lénine fut capable de voir que le parti n'avait pas pour tâche de regrouper ou d'organiser l'ensemble du prolétariat mais d'intervenir dans la classe et ses organes unitaires pour lui donner une direction politique claire. Cette vision tend dès lors à converger avec la conception de Luxemburg esquissée précédemment. De plus, à la lumière de l'expérience de 1905 et des capacités révolutionnaires de la classe dont elle avait puissamment témoigné, Lénine allait « redresser la barre » et corriger certaines exagérations contenues dans Que faire ? : notamment la notion, initialement développée par Kautsky, selon laquelle la conscience de classe est « importée » dans le prolétariat par le parti, ou plutôt par les intellectuels socialistes. Mais cette réaffirmation de la thèse de Marx selon laquelle la conscience communiste émane nécessairement de la classe communiste, le prolétariat, ne diminua en rien la conviction de Lénine sur le rôle indispensable du parti. Etant donné que la classe comme un tout, même lorsqu'elle s'oriente dans une direction révolutionnaire, continue de se confronter à l'énorme puissance de l'idéologie bourgeoise, l'organisation des éléments prolétariens les plus conscients doit être présente dans les rangs prolétariens pour combattre toute les hésitations et illusions, pour clarifier les buts immédiats et à long terme du mouvement.
Nous ne pouvons approfondir davantage la question ici. Il faudrait consacrer toute une série d'articles pour exposer la théorie bolchevik de l'organisation et pour la défendre en particulier contre les calomnies, communes aux mencheviks, anarchistes, conseillistes et à d'innombrables parasites, selon lesquelles « l'étroitesse » de la conception du parti (la conception du parti « étroit ») chez Lénine serait un produit de l'arriération russe et un retour aux conceptions populistes et bakouninistes. Nous nous bornerons à dire ici que, tout comme la révolution de 1905 n'était pas la dernière d'une série de révolutions bourgeoises mais le signe avant-coureur des révolutions prolétariennes en gestation dans les entrailles du monde capitaliste, la conception bolchevik du parti de 1903 n'était pas enracinée dans le passé. Elle était en fait en rupture avec le passé, avec la conception légaliste et parlementariste du « parti de masse » qui était parvenue à dominer le mouvement social-démocrate. Les évènements de 1917 allaient confirmer de la manière la plus concrète que le « parti d'un nouveau type » de Lénine était précisément le type de parti qui correspondait aux besoins de la lutte de classe à l'époque de la révolution prolétarienne.
S'il y a eu des faiblesses dans la compréhension de Lénine du mouvement de 1905 elles résidaient essentiellement dans son approche du problème des perspectives. Pour être bref, la vision de Lénine, selon laquelle la révolution de 1905 était, à la base, une révolution bourgeoise dans laquelle le rôle dirigeant était échu au prolétariat, ne lui permit pas d'atteindre le même degré de clarté que Trotsky sur la signification historique des soviets. Sans doute, il sut voir qu'ils ne devaient pas être limités à des organes purement défensifs et qu'ils devraient se considérer eux-mêmes comme des organes du pouvoir révolutionnaire: « II me semble que, sous le rapport politique, le Soviet de députés ouvriers doit être envisagé comme un embryon du gouvernement révolutionnaire provisoire. Je pense que le Soviet doit se proclamer gouvernement révolutionnaire provisoire de toute la Russie. » (Lénine, Ibid.) Mais, dans sa conception de « la dictature démocratique des ouvriers et paysans », ce gouvernement n'était pas la dictature du prolétariat accomplissant la révolution socialiste. II accomplissait une révolution bourgeoise et, de ce fait, il devait incorporer toutes les classes et couches qui étaient impliquées dans le combat contre le tsarisme. Trotsky voyait la force du Soviet précisément dans le fait qu’« il ne laissait pas dissoudre sa nature de classe dans l'élément de la démocratie révolutionnaire ; il était et restait l'expression organisée de la volonté de classe du prolétariat » (Trotsky, Ibid.) Lénine, de son côté, appelait le soviet à diluer sa composition de classe en élargissant sa représentation aux soldats, aux paysans et à « l'intelligentsia révolutionnaire bourgeoise », et en assumant les tâches d'une révolution « démocratique ». Pour comprendre ces différences, il faut examiner de plus près la question qui se trouve derrière: celle de la nature de la révolution en Russie.
Nature et perspectives de la révolution
La scission de 1903 entre bolcheviks et mencheviks se cristallisa sur la question de l'organisation. Mais la révolution de 1905 montra que les divergences sur l'organisation étaient aussi liées à d'autres questions programmatiques plus générales: dans ce cas surtout, celle de la nature et des perspectives de la révolution en Russie.
Les mencheviks, qui prétendaient être les interprètes « orthodoxes » de Marx sur cette question, défendaient que la Russie attendait encore son 1789. Dans cette révolution bourgeoise tardive, inévitable si le capitalisme voulait briser les entraves absolutistes et construire les bases matérielles du socialisme, la tâche du prolétariat et de son parti était d'agir comme une force d'opposition indépendante, en soutenant la bourgeoisie contre le tsarisme mais en refusant de participer au gouvernement afin d'être libre de le critiquer sur sa gauche. Dans cette vision, la classe dirigeante de la révolution bourgeoise ne pouvait être que la bourgeoisie, du moins ses fractions les plus libérales et d'avant garde. -
Les bolcheviks, avec Lénine à leur tête, étaient d'accord que la révolution ne pourrait être qu'une révolution bourgeoise et rejetaient comme anarchiste l'idée qu'elle pourrait immédiatement revêtir un caractère socialiste. Mais, sur la base de l'analyse des conditions du développement du capitalisme en Russie (en particulier sa dépendance vis-à-vis des capitaux étrangers et de la bureaucratie d’Etat russe), ils étaient convaincus que la bourgeoisie russe était trop soumise à l'appareil tsariste, trop molle et trop indécise pour mener à bien sa propre révolution. En plus, l'expérience historique des révolutions de 1848 en Europe enseignait que cette indécision serait d'autant plus grande que la bourgeoisie craignait qu'un soulèvement révolutionnaire ne laisse libre cours à la « menace d'en bas », c'est-à-dire au mouvement du prolétariat. Dans ces conditions, les bolcheviks prédisaient que la bourgeoisie trahirait la lutte contre l'absolutisme et que celle-ci ne pourrait être menée jusqu'au bout qu'à travers une insurrection populaire armée dans laquelle le rôle dirigeant devait être joué par la classe ouvrière. Cette insurrection devait établir une a dictature démocratique du prolétariat et de la paysannerie » ; et, au grand scandale des mencheviks, les bolcheviks se déclaraient prêts à participer au gouvernement révolutionnaire provisoire qui serait l'instrument de cette « dictature démocratique », et à retourner dans l'opposition une fois que les principales tâches de la révolution bourgeoise auraient été acquises.
La troisième position, défendue par Trotsky, était celle de la « révolution permanente », selon une formule tirée des écrits de Marx sur les révolutions de 1848. Trotsky était d'accord avec les bolcheviks pour dire que la révolution avait encore des tâches démocratiques bourgeoises à accomplir et que la bourgeoisie serait incapable de mener à bien de telles tâches. Mais il rejetait l'idée que le prolétariat, une fois embarqué sur la voie révolutionnaire, veuille ou puisse imposer une « autolimitation » à son combat. Les intérêts de classe du prolétariat le pousseraient, non seulement à prendre le pouvoir lui-même, mais aussi à « télescoper » les tâches démocratiques bourgeoises en tâches prolétariennes et à initier des mesures politiques et économiques socialistes. Cependant cette dynamique ne pouvait être circonscrite à la seule arène nationale :
« Une "autolimitation" du gouvernement ouvrier n'aurait d'autre effet que de trahir les intérêts des sans-travail, des grévistes, et enfin de tout le prolétariat, pour réaliser la république. Le pouvoir révolutionnaire devra résoudre des problèmes socialistes absolument objectifs et, dans cette tâche, à un certain moment, il se heurtera à une grande difficulté : l'état arriéré des conditions économiques du pays. Dans les limites d'une révolution nationale, cette situation n'aurait pas d'issue.
La tâche du gouvernement ouvrier sera donc, dès le début, d'unir ses forces avec celles du prolétariat socialiste de l’ Europe occidentale. Ce n'est que dans cette voie que sa domination révolutionnaire temporaire deviendra le prologue d'une dictature socialiste. La révolution permanente sera donc de règle, pour le prolétariat de Russie, dans l'intérêt et pour la sauvegarde de cette classe. » ([6] [2903])
La notion de « révolution permanente », comme nous l'avons relevé précédemment dans cette série d'articles, n'est pas dépourvue d'ambiguïtés. Et celles-ci n'ont pas manqué d'être exploitées par ceux qui se sont appropriés le « copyright » de Trotsky, les trotskistes de la dernière heure. Mais au moment où elle a été développée, dans le but de comprendre la transition vers une nouvelle période dans l'histoire du capitalisme, la position de Trotsky avait un immense avantage sur les deux théories mentionnées précédemment: au lieu de partir du contexte russe, elle abordait le problème du point de vue international. En cela, Trotsky, et non les mencheviks, était l’héritier de Marx. En effet, ce dernier, en envisageant la possibilité que la « Russie puisse « s'épargner » l'étape capitaliste, avait également démontré que cela ne serait possible que dans le contexte d'une révolution socialiste internationale ([7] [2904]). L'évolution ultérieure des événements a montré que la Russie ne pouvait pas échapper à l'épreuve du capitalisme. Mais, contrairement aux dogmes schématiques des mencheviks, qui professaient doctement que chaque pays devait patiemment « construire les fondations du socialisme s dans ses propres limites nationales, Trotsky, l'internationaliste, s'orientait vers la compréhension que les conditions de la réalisation du socialisme, (c'est-à dire l'entrée en décadence d'un capitalisme plus que mûr) ne seraient données qu'en tant que réalité globale, bien avant que chaque pays ait pu passer par toutes les étapes du développement capitaliste. Les événements de 1905 avaient amplement démontré que le prolétariat urbain, hautement concentré et combatif était déjà la seule force réellement révolutionnaire dans la société russe. Et les événements de 1917 n'allaient pas tarder à confirmer qu'un prolétariat révolutionnaire ne peut s'embarquer que pour une révolution prolétarienne.
Le Lénine de 1917, comme nous l'avons souligné dans l'article sur les Thèses d'Avril dans la Revue internationale n° 89, se montra capable de se débarrasser du barda encombrant de la « dictature démocratique », même si de « vieux bolcheviks » s'y cramponnaient comme à leur propre vie. En ce sens, ce n'est certainement pas par hasard si, à l'époque de 1905, Lénine lui-même s'est également rapproché de la thèse de la « révolution permanente » en déclarant dans un article écrit en septembre 1905 : « Dès la révolution démocratique, selon le degré de »os forces, les forces du prolétariat organisé et conscient, nous devrons commencer à passer à la révolution socialiste. Nous représentons la révolution permanente. Nous ne devons pas nous arrêter à mi-chemin. » ([8] [2905]) Les traductions staliniennes ultérieures ont remplacé le mot « permanente » par « ininterrompue » pour prémunir Lénine contre tout virus trotskiste, mais le sens est clair. Si Lénine continuait à avoir des hésitations sur la position de Trotsky, cela venait des ambiguïtés de la période : jusqu'à la guerre de 1914, il n'était pas encore clair que le système comme un tout était entré dans sa période de décadence, mettant ainsi définitivement la révolution communiste mondiale à l'ordre du jour de l’histoire. La guerre, et le gigantesque mouvement du prolétariat qui commencera en février 1917, éliminera ses derniers doutes.
La position menchevik dévoilera, elle aussi, sa logique interne en 1917: à l'époque de la révolution prolétarienne, « l'opposition critique » à la bourgeoisie se transforme d'abord en capitulation devant la bourgeoisie, puis en enrôlement dans les forces contre-révolutionnaires. De fait, même la position des bolcheviks pour la « dictature démocratique »menaça de conduire le parti dans la même direction en 1917, et ce jusqu’au retour d'exil de Lénine et son combat victorieux pour le réarmement du parti. Mais les réflexions de Trotsky sur la révolution de 1905 ont également joué un rôle crucial dans ce combat. Sans elles, Lénine aurait pu ne pas être en mesure de forger les armes théoriques dont il a eu besoin pour élaborer les Thèses d'Avril et tracer la voie de l'insurrection d'Octobre.
Kautsky, Pannekoek et l'Etat
La révolution de 1905 s'est terminée par une défaite de la classe ouvrière. L'insurrection armée de décembre, isolée et écrasée, ne déboucha ni sur une dictature prolétarienne ni sur une république démocratique mais sur une décennie de réaction tsariste qui provoqua, pour un temps, la dispersion et la désorientation du mouvement ouvrier. Mais ce ne fut pas une défaite à l'échelle historique et mondiale. Au cours de la seconde décennie du nouveau siècle, apparurent les signes du resurgissement prolétarien y compris en Russie. Cependant, le centre du débat sur la grève de masse s'était à nouveau déplacé vers l'Allemagne. II y prit un caractère urgent et direct parce que la détérioration de la situation économique avait provoqué des mouvements de grève massifs pan-ni les ouvriers allemands, quelquefois autour de revendications économiques mais aussi, en Prusse, autour de la question de la réforme du suffrage électoral. La menace croissante de la guerre poussait aussi le mouvement ouvrier à considérer la grève de masse comme une forme d'action contre le militarisme. Ces événements ont donné lieu à une âpre polémique au sein du parti allemand qui opposa Kautsky, le «pape de l'orthodoxie marxiste » (en fait le dirigeant du courant centriste dans le parti), et les principaux théoriciens de la Gauche, d'abord Luxemburg, puis Pannekoek.
Avec la droite social-démocrate, qui montrait une opposition de plus en plus catégorique à toute action de masse de la classe ouvrière, Kautsky défendait que la grève de masse dans les pays avancés devait au mieux être limitée au terrain défensif et que la meilleure stratégie pour la classe ouvrière était celle d'une « guerre d'usure » graduelle, essentiellement légaliste, au moyen du Parlement et des élections en tant qu'instruments clés du transfert du pouvoir su prolétariat. Mais cela ne faisait qu'apporter la preuve que le prétendu « centrisme » de sa position était en réalité une couverture pour l'aile clairement opportuniste du parti. Répondant dans deux articles publiés dans la Neue Zeit en 1910 (« Usure ou lutte ? » et « Théorie et pratique »), Luxemburg développa de nouveau les arguments qu'elle avait défendus dans Grève de masses, rejeta la vision de Kautsky selon laquelle la grève de masse en Russie serait un produit de l’arriération russe et s'opposa à la stratégie « d'usure » en montrant les liens intimes et inévitables entre la grève de masse et la révolution.
Mais, comme le souligne l'ouvrage que nous avons publié, La Gauche hollandaise, l'argumentation de Luxemburg comportait une faiblesse importante: « En réalité, bien souvent dans ce débat, Rosa Luxemburg restait sur le terrain choisi par Kautsky et la direction du SPD. Elle appelait à inaugurer les manifestations et grèves pour le suffrage universel par une grève de masse et proposait comme mot d'ordre "transitoire" mobilisateur celui de la lutte 'pour la République". Sur ce terrain Kautsky pouvait lui répliquer que "vouloir inaugurer une lutte électorale par une grève de masse c'est une absurdité". » Comme le livre le montre, c'est au marxiste hollandais Anton Pannekcek, qui vivait en Allemagne à cette époque, qu'il reviendra de faire avancer le débat d'un pas décisif.
Déjà en 1909, dans son texte sur « Les divergences tactiques dans le mouvement ouvrier » dirigé contre les déviations révisionnistes et anarchistes, Pannekoek avait fait preuve d'une profonde maîtrise de la méthode marxiste dans la défense de ses positions, qui contenaient les germes des principes du rejet du parlementarisme et du syndicalisme élaborés par la Gauche communiste germano-hollandaise après la guerre, tout en se démarquant clairement de la position anarchiste, moraliste et intemporelle, sur un tel rejet. Dans sa polémique contre Kautsky, conduite dans le Neue Zeit en 1912 au travers des articles « Action de masse et révolution » et « Théorie marxiste et tactiques révolutionnaires », Pannekoek poussera plus loin ce point de vue. Parmi les contributions les plus importantes contenues dans ces textes, on trouve le diagnostic que fait Pannekoek du centrisme de Kautsky (qu'il attribue à un « radicalisme passif » dans son second texte), sa défense de la grève de masse comme une forme de la lutte de classe appropriée à l'époque de l'impérialisme, son insistance sur la capacité du prolétariat à développer de nouvelles formes d'organisation unitaires au cours de la lutte ([9] [2906]), et sa vision du parti comme une minorité active dont les tâches sont de fournir une direction politique et programmatique au mouvement plutôt que de l'organiser ou de le contrôler d'en haut. Mais le plus important fût son argumentation concernant la direction ultime que la grève de masse doit assumer, ce qui l’a conduit à réaffirmer contre le légalisme et le fétichisme parlementaire de Kautsky, la thèse marxiste fondamentale sur l'attitude du prolétariat envers l’Etat bourgeois dans la confrontation révolutionnaire. Dans un passage cité et soutenu par Lénine dans L'Etat et la Révolution, Pannekcek écrit :
« La lutte du prolétariat n'est pas simplement une lutte contre la bourgeoisie pour le pouvoir d’Etat ; c'est aussi une lutte contre le pouvoir d’Etat... La révolution prolétarienne consiste à anéantir et à dissoudre les instruments de la force de 1’ Etat par les instruments de la force du prolétariat... La lutte ne cesse qu'au moment où le résultat final est atteint, au moment où l'organisation d'Etat est complètement détruite. L'organisation de la majorité prouve sa supériorité en anéantissant l'organisation de la minorité dominante. »([10] [2907])
Et Lénine, bien qu'il ait noté certains défauts dans la formulation de Pannekcek, la défend ardemment comme fondée sur le marxisme contre les attaques de Kautsky qui l'accuse de retomber dans l'anarchisme: « Dans cette discussion, c'est Pannekoek qui représente le marxisme contre Kautsky; car Marx a précisément enseigné que le prolétariat ne peut pas se contenter de conquérir le pouvoir d'Etat (en ce sens que le vieil appareil d’Etat ne doit pas simplement passer en d'autres mains), mais qu'il doit briser, démolir cet appareil et !e remplacer par un nouveau. » ([11] [2908])
Pour nous, les défauts de la présentation de Pannekcek étaient de deux ordres. D'abord, il n'a pas suffisamment fondé son argumentation sur les écrits de Marx et Engels sur la question de l’Etat et, en particulier, sur leurs conclusions concernant la Commune de Paris. Dans ces conditions, il était facile pour Kautsky de calomnier sa position en la taxant d'anarchiste. Deuxièmement, Pannekoek reste vague sur la forme que prendront les nouveaux organes du pouvoir prolétarien ; comme Luxemburg, il n'avait pas encore saisi la signification historique de la forme soviet, chose qu'il allait largement rattraper dans la période qui suivra la révolution russe ! Mais ceci ne fait qu'apporter une preuve supplémentaire que la clarification du programme communiste est un processus qui intègre et synthétise les meilleures contributions du mouvement prolétarien international. L'analyse de Luxemburg sur la grève de masse a été « couronnée » par l'appréciation que fit Trotsky des soviets et par la perspective révolutionnaire qu'il tira des événements de 1905. La pertinence de Pannekcek sur la question de 1’Etat fut reprise à son compte en 1917 par Lénine qui a été capable de montrer non seulement que la révolution prolétarienne doit effectivement détruire l’Etat capitaliste existant mais que les organes spécifiques de l'accomplissement de cette tâche, la «forme enfin trouvée de la dictature du prolétariat », étaient les soviets ou conseils ouvriers. Les apports de Lénine dans ce domaine, largement exposés dans son livre L'Etat et la Révolution feront l'objet du prochain article de cette série.
CDW
[1] [2909] Rosa Luxemburg, Grève de masses, parti et syndicat.
[2] [2910] 1905, «Le Soviet de Députés Ouvriers », Trotsky, Ed. de Minuit.
[3] [2911] K Révolution de 1905: enseignements fondamentaux pour le prolétariat », Revue Internationale n° 43, automne 1985.
[4] [2912] Ibid., Trotsky, x Conclusions ».
[5] [2913] Lénine, K Nos tâches et le soviet des députés ouvriers H. Oeuvres Complètes, vol 10.
[6] [2914] Trotsky, 1905, K Nos différends s, Ed. de Minuit.
[7] [2915] Voir la Revue internationale n° 81 « Communisme du passé, communisme de l'avenir ».
[8] [2916] Lénine,, x L'attitude de la social-démocratie envers le mouvement paysan. », Oeuvres Complètes, vol 8, traduit de l'anglais par nous.
[9] [2917] Pannekoek en reste au niveau des généralités lorsqu'il décrit ces formes d’organisations. Mais le mouvement réel commençait à apporter ses propres concrétisations: en 1913, des grèves antisyndicales éclatèrent dans les chantiers navals du nord de l'Allemagne et donnèrent naissance à des comités de grève autonomes. Pannekoek n’hésita pas à défendre ces nouvelles formes de lutte et d'organisation contre les syndicats bureaucratiques qui délaient pas loin d'achever leur intégration finale dans l'état capitaliste. Voir Bricianer, Pannekoek et les conseils ouvriers, Paris 1969.
[10] [2918] Lénine, Oeuvres complètes, Vol. 25. Dans l'édition française, le passage cité par L.énine est tiré de « L'action de masse et la révolution ».
[11] [2919] Lénine, L Etat et la Révolution, Oeuvres complètes, Vol. 25.
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Russe [2920]
Approfondir:
Questions théoriques:
- Communisme [492]
Heritage de la Gauche Communiste:
Polémique : à l'origine du CCI et du BIPR, I - La fraction italienne et la gauche communiste de France
- 3846 reads
Dans le précédent numéro de notre Revue nous avons publié une polémique en réponse à celle de Revolutionary Perspectives n°5 (publication de la Communist workers' organisation, CWO) « Sectes, mensonges et la perspective perdue du CCI ». Ne pouvant, faute de place, traiter de tous les aspects abordés par la CWO, nous nous sommes cantonnés à répondre à une seule des questions : l'idée suivant laquelle la perspective dégagée par le CCI pour la présente période historique aurait totalement fait faillite. Nous avons mis en évidence que les affirmations de la CWO se basaient essentiellement sur une profonde incompréhension de nos propres positions et surtout sur une totale absence de sa part de cadre d'analyse de la période présente. Une absence de cadre qui est d'ailleurs fièrement revendiquée par la CWO, et le BIPR (Bureau International pour le Parti Révolutionnaire) auquel elle est affiliée, lorsqu'elle considère qu'il est impossible pour les organisations révolutionnaires d'identifier la tendance dominante dans le rapport de forces entre prolétariat et bourgeoisie, cours vers des affrontements de classe croissants ou bien cours vers la guerre impérialiste. En réalité, le refus du BIPR de considérer qu'il est possible, et nécessaire, pour les révolutionnaires d'identifier la nature du cours historique tire ses origines des conditions mêmes dans lesquelles s'est constituée, à la fin de la seconde guerre mondiale, l'autre organisation du BIPR et inspiratrice de ses positions politiques, le Partito Comunista Internaziona-lista (PCInt). Justement, dans le n°15 de la revue théorique en langue anglaise du BIPR, Internationalist Communist (IC), cette organisation revient, dans une nouvelle polémique avec le CCI, « Les racines politiques du malaise or-ganisationnel du CCI », sur la question des origines du PCInt et de celles du CCI. C'est essentiellement cette question que nous traiterons ici en réponse à cette polémique.
La polémique du BIPR traite du même thème que l'article de RP n° 5 : les causes des difficultés organisationnelles que le CCI a affrontées au cours de la dernière période. La grande faiblesse des deux textes, c'est qu'ils ne mentionnent nullement l'analyse que le CCI a faite pour sa part de ces difficultés ([1] [2922]) : aux yeux du BIPR celles-ci ne peuvent surgir que de faiblesses d'ordre programmatique ou dans l'appréciation de la situation mondiale actuelle. Incontestablement, ces questions peuvent être source de difficultés pour une organisation communiste. Mais toute l'histoire du mouvement ouvrier nous démontre que les questions liées à la structure et au fonctionnement de l'organisation sont des questions politiques à part entière et que des faiblesses dans ce domaine, plus encore que sur d'autre points programmatiques ou d'analyse, ont des conséquences de premier plan, et souvent dramatiques, sur la vie des formations révolutionnaires. Faut-il rappeler aux camarades du BIPR, qui pourtant se revendiquent des positions de Lénine, l'exemple du 2e Congrès du Parti Ouvrier Social Démocrate de Russie, en 1903, où c'est justement sur la question d'organisation (et nullement sur des points programmatiques ou d'analyse de la période) que s'est fait le clivage entre bolcheviks et mencheviks ? En fait, à y regarder de plus près, l'incapacité actuelle du BIPR à fournir une analyse sur la nature du cours historique trouve en bonne partie ses origines dans des erreurs politiques concernant la question d'organisation, et plus particulièrement sur la question des rapports entre fraction et parti. Et c'est justement ce que met en évidence une nouvelle fois l'article de IC. Afin que les camarades du BIPR ne puissent pas nous accuser de falsifier leur position nous donnons ci-dessous une longue citation de leur article :
« Le CCI a été formé en 1975 mais son histoire remonte à la Gauche Communiste de France (GCF), un groupe minuscule qui avait été formé au cours de la seconde guerre mondiale par le même élément ("Marc") qui allait fonder le CCI dans les années 70. La GCF était fondamentalement basée sur le rejet de la formation du Parti Communiste Internationaliste en Italie après 1942 par les ancêtres du BIPR.
La GCF affirmait que le Parti Communiste Internationaliste ne constituait pas une avancée par rapport à la vieille Fraction de la Gauche Communiste qui été allée en exil en France durant la dictature de Mussolini. La GCF avait appelé les membres de la Fraction à ne pas rejoindre le nouveau Parti qui avait été formé par des révolutionnaires comme Onorato Damen, relâché de prison avec l'effondrement du régime de Mussolini. Il donnait comme argument que la contre-révolution qui s'était abattue sur les ouvriers depuis leurs défaites dans les années 20 continuait encore et que, de ce fait, il n'y avait pas la possibilité de créer un parti révolutionnaire dans les années 40. Après que le fascisme italien se soit effondré et que l'Etat italien soit devenu un champ de bataille entre les deux fronts impérialistes la grande majorité de la fraction italienne en exil a rejoint le Parti Communiste Internationaliste (PCInt) en misant sur le fait que la combativité ouvrière ne resterait pas limitée au nord de l'Italie alors que la guerre approchait de sa fin. L'opposition de la GCF n'eut aucun impact à cette époque mais c'était le premier exemple des conséquences des raisonnements abstraits qui constituent un des traits méthodologiques du CCI aujourd'hui. Aujourd'hui le CCI va dire qu'il ne sortit aucune révolution de la seconde guerre mondiale et que c'est bien la preuve que la GCF avait raison. Mais cela ignore le fait que le PCInt était la création de la classe ouvrière révolutionnaire ayant eu le plus de réussite depuis la Révolution russe et que, malgré un demi siècle de domination capitaliste par la suite, elle continue à exister et s'accroît aujourd'hui.
La GCF, d'un autre côté, a poussé ses abstractions "logiques" un cran plus loin. Elle a considéré que puisque la contre-révolution était toujours dominante la révolution prolétarienne n'était pas à l'ordre du jour. Et si cela était le cas, une nouvelle guerre impérialiste devait advenir ! Le résultat en fut que la direction s'en alla en Amérique du Sud et la GCF disparut durant la guerre de Corée. Le CCI a toujours été quelque peu embarrassé par la révélation des capacités de compréhension du "cours historiques" par ses ancêtres. Toutefois sa réponse a toujours été de le prendre de haut. Quand l'ancienne GCF est revenue dans une Europe remarquablement préservée, au milieu des années 60, au lieu de reconnaître que le PCInt avait toujours eu raison quant a ses perspectives et à sa conception de l'organisation, elle a cherché à dénigrer le PCInt en affirmant qu'il était "sclérosé" et "opportuniste" et a dit au monde qu'il était "bordiguiste" (... Une accusation qu'elle a été obligée de retirer par la suite). Cependant, même après qu'elle ait été contrainte à cette rétractation, elle n'en avait pas fini avec sa politique de dénigrement des possibles "rivaux" (pour reprendre les termes du CCI lui-même) et maintenant le CCI essayait de soutenir que le PCInt avait "travaillé dans les partisans" (c'est-à-dire avait appuyé les forces bourgeoises qui cherchaient à établir un Etat démocratique italien). C'était une calomnie lâche et écoeurante. En fait des militants du PCInt avaient été assassinés sous les ordres directs de Palmiro Togliatti (Secrétaire général du Parti Communiste Italien) pour avoir essayé de combattre le contrôle des staliniens sur la classe ouvrière en gagnant une audience auprès des partisans. »
Ce passage, qui aborde les histoires respectives du CCI et du BIPR, mérite qu'on y réponde sur le fond, notamment en apportant des éléments historiques. Cependant, pour la clarté du débat, il nous faut commencer par rectifier certains propos qui dénotent soit la mauvaise foi, soit une ignorance affligeante de la part du rédacteur de l'article.
Quelques rectifications et précisions
En premier lieu, la question des partisans qui provoque une telle indignation chez les camarades du BIPR au point qu'ils ne peuvent se retenir de nous traiter de « calomniateurs » et de « lâches ». Effectivement nous avons dit que le PCInt avait « travaillé dans les partisans ». Mais ce n'est nullement une calomnie, c'est la stricte vérité. Oui ou non le PCInt a-t-il envoyé certains de ses militants et cadres dans les rangs des partisans ? C'est une chose qu'on ne peut cacher. Plus, le PCInt se revendique de cette politique, à moins qu'il n'ait changé de position depuis que le camarade Damen écrivait, au nom de l'Exécutif du PCInt, à l'automne 1976, que son Parti pouvait «se présenter avec toutes ses cartes en règle » en évoquant « ces militants révolutionnaires qui faisaient un travail de pénétration dans les rangs des partisans pour y diffuser les principes et la tactique du mouvement révolutionnaire et qui, pour cet engagement, sont même allés jusqu'à payer de leur vie. » ([2] [2923]) En revanche, nous n'avons jamais prétendu que cette politique consistait à « appuyer les forces qui cherchaient à établir un Etat démocratique italien ». Nous avons abordé à plusieurs reprises cette question dans notre presse ([3] [2924]), et nous y reviendrons dans la seconde partie de cet article, mais si nous avons critiqué impitoyablement les fautes commises par le PCInt lors de sa constitution, nous ne l'avons jamais confondu avec les organisations trotskistes, encore moins staliniennes. Plutôt que de pousser de hauts cris, les camarades du BIPR auraient mieux fait de donner les citations qui provoquent leur colère. En attendant qu'ils le fassent, nous pensons qu'il est préférable qu'ils remettent leur indignation dans leur poche, et leurs insultes avec.
Un autre point sur lequel il nous faut apporter une rectification et une précision concerne l'analyse de la période historique faite par la GCF au début des années 1950 et qui a motivé le départ d'Europe d'un certain nombre de ses membres. Le BIPR se trompe lorsqu'il prétend que le CCI est embarrassé par cette question et qu'il y répond « en le prenant de haut ». Ainsi, dans l'article consacré à la mémoire de notre camarade Marc (Revue Internationale n° 66) nous écrivions : « Cette analyse, on la trouve notamment dans l'article "L'évolution du capitalisme et la nouvelle perspective" publiée dans Internationalisme n° 46 (...). Ce texte rédigé en mai 1952 par Marc, constitue, en quelque sorte, le testament politique de la GCF. En effet, Marc quitte la France pour le Venezuela en juin 1952. Ce départ correspond à une décision collective de la GCF qui, face à la guerre de Corée, estime qu'une troisième guerre mondiale entre le bloc américain et le bloc russe est devenue inévitable à brève échéance (comme il est dit dans le texte en question). Une telle guerre, qui ravagerait principalement l'Europe, risquerait de détruire complètement les quelques groupes communistes, et notamment la GCF, qui ont survécu à la précédente. La "mise à l'abri" en dehors d'Europe d'un certain nombre de militants ne correspond dons pas au souci de leur sécurité personnelle (...) mais au souci de préserver la survie de l'organisation elle-même. Cependant, le départ sur un autre continent de son élément le plus expérimenté et formé va porter un coup fatal à la GCF dont les éléments qui sont restés en France, malgré la correspondance suivie que Marc entretient avec eux, ne parviennent pas, dans une période de profonde contre-révolution, à maintenir en vie l'organisation. Pour des raisons sur lesquelles on ne peut revenir ici, la troisième guerre mondiale n'a pas eu lieu. Il est clair que cette erreur d'analyse a coûté la vie de la GCF (et c'est probablement l'erreur, parmi celles commises par notre camarade tout au long de sa vie militante, qui a eu les conséquences les plus graves). »
Par ailleurs, lorsque nous avons republié le texte évoqué plus haut (dès 1974 dans le n° 8 du Bulletin d'étude et de discussion de RI, ancêtre de la Revue internationale) nous avons bien précisé : «Internationalisme avait raison d'analyser la période qui a suivi la 2e guerre mondiale comme une continuation de la période de réaction et de reflux de la lutte de classe du prolétariat (..). Elle avait encore raison d'affirmer qu'avec la fin de la guerre le capitalisme ne sort pas de sa période de décadence, que toutes les contradictions qui ont amené le capitalisme à la guerre subsistaient et poussaient inexorablement le monde vers de nouvelles guerre. Mais Internationalisme n'a pas perçu ou pas suffisamment mis en évidence la phase de "reconstruction" possible dans le cycle : crise-guerre-reconstruction-crise. C'est pour cette raison et dans le contexte de la lourde atmosphère de la guerre froide USA-URSS de l'époque qu'Internationalisme ne voyait la possibilité d'un resurgissement du prolétariat que dans et à la suite d'une 3e guerre.»
Comme on peut le voir, le CCI n'a jamais « pris de haut » cette question et n'a jamais été « embarrassé » pour évoquer les erreurs de la GCF (même à une époque où le BIPR n'était pas encore là pour les lui rappeler). Cela dit, le BIPR nous fait une nouvelle fois la preuve qu'il n'a pas compris notre analyse du cours historique. L'erreur de la GCF ne consiste pas en une évaluation incorrecte du rapport de forces entre classes mais dans une sous-estimation du répit que la reconstruction avait donné à l'économie capitaliste lui permettant pendant deux décennies d'échapper à la crise ouverte et donc d'atténuer quelque peu l'ampleur des tensions impérialistes entre blocs. Celles-ci pouvaient alors rester contenues dans le cadre de guerres locales (Corée, Moyen-Orient, Vietnam, etc.). Si à cette époque la guerre mondiale n'a pas eu lieu ce n'est pas grâce au prolétariat (lequel était paralysé et embrigadé par les forces de gauche du capital) mais parce qu'elle ne s'imposait pas encore au capitalisme.
Après avoir fait ces mises au point, il nous faut revenir sur un « argument » qui semble tenir à coeur au BIPR (puisqu'il l'employait déjà dans l'article de polémique de RP n° 5) : celui concernant la taille « minuscule » de la GCF. En réalité, la référence au caractère « minuscule » de la GCF renvoie à la « création de la classe ouvrière révolutionnaire ayant eu le plus de réussite depuis la Révolution russe », à savoir le PCInt qui, à l'époque, comptait plusieurs milliers de membres. Le BIPR veut-il par là nous démontrer que la raison de la plus « grande réussite » du PCInt était que ses positions étaient plus correctes que celles de la GCF ?
Si tel est le cas l'argument est bien maigre. Cependant, au delà de la pauvreté de cet argument, la démarche du BIPR touche à des questions de fond où se situent justement certaines des divergences fondamentales entre nos deux organisations. Pour être en mesure d'aborder ces questions de fond, il nous faut revenir sur l'histoire de la Gauche communiste d'Italie. Car la GCF n'était pas qu'un groupe « minuscule », c'était aussi le véritable continuateur politique de ce courant historique dont se réclament également le PCInt et le BIPR.
Quelques éléments d'histoire de la Gauche italienne
Le CCI a publié un livre, La Gauche communiste d'Italie, qui présente l'histoire de ce courant. Nous ne ferons ici qu'esquisser quelques aspects importants de cette histoire.
Le courant de la Gauche italienne, qui s'était dégagé autour d'Amadeo Bordiga et de la fédération de Naples comme Fraction « abstentionniste » au sein du PSI, a été à l'origine de la fondation du PC d'Italie en 1921 au Congrès de Livourne et a assumé la direction de ce parti jusqu'en 1925. En même temps que d'autres courants de gauche dans l'Internationale Communiste (comme la Gauche allemande ou la Gauche hollandaise), il s'est dressé, bien avant l'Opposition de gauche de Trotsky, contre la dérive opportuniste de l'Internationale. En particulier, contrairement au trotskisme qui se réclamait intégralement des 4 premiers congrès de lie, la Gauche italienne rejetait certaines des positions adoptées lors des 3e et 4e Congrès, et tout particulièrement la tactique de « Front Unique ». Sur bien des aspects, notamment sur la nature capitaliste de 1’URSS ou sur la nature définitivement bourgeoise des syndicats, les positions de la Gauche germano-hollandaise étaient au départ beaucoup plus justes que celles de la gauche italienne. Cependant, la contribution au mouvement ouvrier de la Gauche communiste d'Italie s'est révélée plus féconde que celle des autres courants de la Gauche communiste dans la mesure où elle avait été capable de mieux comprendre deux questions essentielles :
- le repli et la défaite de la vague révolutionnaire ;
- la nature des tâches des organisations révolutionnaires dans une telle situation.
En particulier, tout en étant consciente de la nécessité d'une remise en cause des positions politiques qui avaient été invalidées par l'expérience historique, la Gauche italienne avait le souci d'avancer avec une très grande prudence, ce qui lui a évité de «jeter le bébé avec l'eau du bain » contrairement à la Gauche hollandaise qui a fini par considérer octobre 1917 comme une révolution bourgeoise et à rejeter la nécessité d'un parti révolutionnaire. Cela n'a pas empêché la Gauche italienne de reprendre à son compte certaines des positions qui avaient été élaborées antérieurement par la Gauche germano-hollandaise.
La répression croissante du régime mussolinien, notamment à partir des lois d'exception de 1926, a contraint la plupart des militants de la Gauche communiste d'Italie à s'exiler. C'est donc à l'étranger, principalement en France et en Belgique, que ce courant a poursuivi une activité organisée. En février 1928 a été fondée à Pantin, près de Paris, la Fraction de Gauche du Parti communiste d'Italie. Celle-ci a essayé de participer à l'effort de discussion et de regroupement des différents courants de Gauche qui avaient été exclus de 1’IC dégénérescente et dont la figure la plus connue était Trotsky. En particulier, la Fraction avait comme objectif de publier une revue de discussion commune à ces différents courants. Cependant, ayant été exclue de l'Opposition de Gauche internationale, elle s'était résolue à partir de 1933 à publier pour son propre compte la revue Bilan en langue française en même temps qu'elle poursuivait la publication de Prometeo en langue italienne.
Nous n'allons pas ici passer en revue ni les positions de la Fraction ni l'évolution de celles-ci. Nous nous contenterons de rappeler une de ses positions essentielles qui fondaient son existence : les rapports entre parti et fraction.
Cette position a été progressivement élaborée par la Fraction à la fin des années 1920 et au début des années 1930 quand il s'agissait de définir quelle politique il convenait de développer vis-à-vis des partis communistes en voie de dégénérescence.
A grands traits, on peut résumer ainsi cette position. La Fraction de Gauche se forme à un moment où le parti du prolétariat tend à dégénérer victime de l'opportunisme, c'est-à-dire de la pénétration en son sein de l'idéologie bourgeoise. C'est la responsabilité de la minorité qui maintient le programme révolutionnaire que de lutter de façon organisée pour faire triompher celui-ci au sein du parti. Soit la Fraction réussit à faire triompher ses principes et à sauver le parti, soit ce dernier poursuit son cours dégénérescent et il finit alors par passer avec armes et bagages dans le camp de la bourgeoisie. Le moment du passage du parti prolétarien dans le camp bourgeois n'est pas facile à déterminer. Cependant, un des indices les plus significatifs de ce passage est le fait qu'il ne puisse plus apparaître de vie politique prolétarienne au sein du parti. La fraction de Gauche a la responsabilité de mener le combat au sein du parti tant que subsiste un espoir qu'il puisse être redressé : c'est pour cela que dans les années 1920 et au début des années 1930, ce ne sont pas les courants de gauche qui ont quitté les partis de 1’IC mais ils ont été exclus, souvent par des manoeuvres sordides. Cela dit, une fois qu'un parti du prolétariat est passé dans le camp de la bourgeoisie, il n'y a pas de retour possible. Nécessairement, le prolétariat devra faire surgir un nouveau parti pour reprendre son chemin vers la révolution et le rôle de la Fraction est alors de constituer un « pont » entre l'ancien parti passé à l'ennemi et le futur parti dont elle devra élaborer les bases programmatiques et constituer l'ossature. Le fait qu'après le passage du parti dans le camp bourgeois il ne puisse exister de vie prolétarienne en son sein signifie aussi qu'il est tout à fait vain, et dangereux, pour les révolutionnaires de pratiquer « l'entrisme » qui constituait une des « tactiques » du trotskisme et que la Fraction a toujours rejeté. Vouloir entretenir une vie prolétarienne dans un parti bourgeois, et donc stérile pour les positions de classe, n'a jamais eu comme autre résultat que d'accélérer la dégénérescence opportuniste des organisations qui s'y sont essayées et non de redresser en quoi que ce soit ce parti. Quant au « recrutement » que ces méthodes ont permis, il était particulièrement confus, gangrené par l'opportunisme et n'a jamais pu constituer une avant-garde pour la classe ouvrière.
En fait, une des différences fondamentales entre la Fraction italienne et le trotskisme réside dans le fait que la Fraction, dans la politique de regroupement des forces révolutionnaires, mettait toujours en avant la nécessité de la plus grande clarté, de la plus grande rigueur programmatique, même si elle était ouverte à la discussion avec tous les autres courants qui avaient engagé le combat contre la dégénérescence de 11C. En revanche, le courant trotskiste a essayé de constituer des organisations de façon précipitée, sans une discussion sérieuse et une décantation préalables des positions politiques, misant essentiellement sur des accords entre « personnalités » et sur l'autorité acquise par Trotsky comme un des principaux dirigeants de la révolution de 1917 et de 11C à son origine.
Une autre question qui a opposé le trotskisme à la Fraction italienne était celle du moment où il fallait former un nouveau parti. Pour Trotsky et ses camarades, la question de la fondation du nouveau parti était immédiatement à l'ordre du jour dès lors que les anciens partis avaient été perdus pour le prolétariat. Pour la Fraction, la question était très claire : « La transformation de la fraction en Parti est conditionnée par deux éléments intimement liés ([4] [2925]):
/. L'élaboration, par la fraction, de nouvelles positions politiques capables de donner un cadre solide aux luttes du prolétariat pour la Révolution dans sa nouvelle phase plus avancée (...).
2. Le renversement des rapports de classe du système actuel (...) avec l'éclatement de mouvements révolutionnaires qui pourront permettre à la Fraction de reprendre la direction des luttes en vue de l'insurrection. » (« Vers l'Internationale 2 et 3/4 ? », Bilan n°l, 1933)
Pour que les révolutionnaires soient capables d'établir de façon correcte quelle est leur responsabilité à un moment donné, il est indispensable qu'ils identifient de façon claire le rapport de forces entre les classes et le sens de l'évolution de ce rapport de forces. Un des grands mérites de la Fraction est justement d'avoir su identifier la nature du cours historique au cours des années 1930 : de la crise générale du capitalisme, du fait de la contre-révolution qui pesait sur la classe ouvrière, il ne pouvait sortir qu'une nouvelle guerre mondiale.
Cette analyse a fait la preuve de toute son importance au moment de la guerre d'Espagne. Alors que la plupart des organisations se réclamant de la gauche des partis communistes ont vu dans les événements d'Espagne une reprise révolutionnaire du prolétariat mondial, la Fraction avait compris que malgré toute la combativité et le courage du prolétariat d'Espagne, il était piégé par l'idéologie antifasciste promue par toutes les organisations ayant une influence en son sein (la CNT anarchiste, 1’UGT socialiste ainsi que les partis communiste, socialiste et le POUM, un parti socialiste de gauche participant au gouvernement bourgeois de la « Generalitat ») et qu'il était destiné à servir de chair à canon dans un affrontement entre secteurs de la bourgeoisie (la « démocratique » contre la «fasciste ») préludant à la guerre mondiale qui devait survenir inévitablement. A cette occasion, il s'est formé dans la fraction une minorité qui pensait qu'en Espagne la situation restait « objectivement révolutionnaire » et qui, au mépris de toute discipline organisationnelle et refusant le débat que lui proposait la majorité, s'est enrôlée dans les brigades antifascistes du POUM ([5] [2926]) et s'est même exprimée dans les colonnes du journal de ce parti. La Fraction est obligée de prendre acte de la scission de la minorité qui, à son retour d'Espagne, fin 1936 ([6] [2927]), va intégrer les rangs de l'Union Communiste, un groupe ayant rompu sur la gauche, au début des années 1930, avec le trotskisme mais qui rejoint ce courant pour qualifier de « révolutionnaires » les événements d'Espagne et promouvoir un « antifasciste critique ».
Ainsi, en compagnie d'un certain nombre de communistes de gauche hollandais, la Fraction italienne est la seule organisation qui ait maintenu une position de classe intransigeante face à la guerre impérialiste qui se développait en Espagne ([7] [2928]). Malheureusement, à la fin de 1937, Vercesi qui est le principal théoricien et animateur de la Fraction commence à élaborer une théorie suivant laquelle les différents affrontements militaires qui se sont produits dans la seconde partie des années 1930 ne constituent pas les préparatifs vers une nouvelle boucherie impérialiste généralisée mais des « guerres locales » destinées à prévenir par des massacres d'ouvriers la menace prolétarienne qui se ferait jour. D'après cette « théorie » le monde se trouvait donc à la veille d'une nouvelle vague révolutionnaire et la guerre mondiale n'était plus à l'ordre du jour dans la mesure, notamment, où l'économie de guerre était sensée, par elle-même, surmonter la crise capitaliste. Seule une minorité de la Fraction, dont notre camarade Marc, est alors capable de ne pas se laisser entraîner dans cette dérive qui représentait une sorte de revanche posthume de la minorité de 1936. La majorité décide d'interrompre la publication de la revue Bilan et de la remplacer par Octobre (dont le nom est conforme à la « nouvelle perspective »), organe du Bureau International des Fractions de Gauche (italienne et belge), qu'elle veut publier en 3 langues. En fait, au lieu de «faire plus » comme la supposée « nouvelle perspective » l'exigeait, la Fraction est incapable de maintenir son travail d'auparavant : Octobre, contrairement à Bilan, paraîtra de façon irrégulière et uniquement en français ; de nombreux militants, déboussolés par cette remise en cause des positions de la Fraction tombent dans la démoralisation ou démissionnent.
La Gauche italienne durant la seconde guerre mondiale et la formation de la GCF
Lorsque la guerre mondiale éclate, la Fraction est désarticulée. Plus encore que la répression policière, de la part de la police « démocratique », puis de la Gestapo (plusieurs militants, dont Mitchell, principal animateur de la Fraction belge, sont déportés et meurent), c'est la désorientation politique et l'impréparation face à une guerre mondiale sensée ne pas advenir qui sont responsables de cette débandade. Pour sa part, Vercesi proclame qu'avec la guerre le prolétariat est devenu « socialement inexistant », que tout travail de fraction est devenu inutile et qu'il convient donc de dissoudre les fractions (décision qui est prise par le Bureau International des fractions) ce qui contribue encore à la paralysie de la Fraction. Cependant le noyau de Marseille, constitué de militants qui s'étaient opposés aux conceptions révisionnistes de Vercesi avant la guerre, poursuit un travail patient pour reconstituer la Fraction, un travail particulièrement difficile du fait de la répression et de l'absence de moyens matériels. Des sections sont rétablies à Lyon, Toulon et Paris. Des contacts sont pris avec la Belgique. A partir de 1941 la Fraction italienne « reconstituée » tient des conférences annuelles, nomme une Commission Executive et publie un Bulletin international de discussion. Parallèlement se constitue en 1942, sur les positions de la Fraction italienne, le Noyau français de la Gauche communiste auquel participe Marc, membre de la CE de la FI et qui se donne comme perspective de constituer la Fraction française.
Lorsqu'en 1942-43 se développent dans le Nord de l'Italie de grandes grèves ouvrières conduisant à la chute de Mussolini et à son remplacement par l'amiral pro-allié Badoglio (grèves qui se répercutent en Allemagne parmi les ouvriers italiens soutenues par des grèves d'ouvriers allemands), la Fraction estime que, conformément à sa position de toujours, « le cours de la transformation de la Fraction en parti en Italie est ouvert » Sa Conférence d'août 1943 décide de reprendre le contact avec l'Italie et demande aux militants de se préparer à y retourner dès que possible. Cependant ce retour ne fut pas possible en partie pour des raisons matérielles et en partie pour des raisons politiques du fait que Vercesi et une partie de la Fraction belge y étaient hostiles considérant que les événements d'Italie ne remettaient pas en cause « l'inexistence sociale du prolétariat ». A sa conférence de mai 1944, la Fraction condamne les théories de Vercesi ([8] [2929]). Cependant ce dernier n'est pas arrivé au bout de sa dérive. En septembre 1944 il participe, au nom de la Fraction (et en compagnie d'un autre membre de celle-ci, Pieri) à la constitution de la « Coalizione antifa-scista » de Bruxelles aux côtés des partis démocrate chrétien, « communiste », républicain, socialiste et libéral et qui publie le journal L'Italia di Domani dans les colonnes duquel on trouve des appels à la souscription financière pour soutenir l'effort de guerre allié. Ayant pris connaissance de ces faits, la CE de la Fraction a exclu Vercesi le 20 janvier 1945. Cela n'a pas empêché ce dernier de poursuivre encore plusieurs mois son activité dans la « Coalizione » et comme président de la « Croce Rossa » ([9] [2930]).
Pour sa part, la Fraction maintenue poursuivait un travail difficile de propagande contre l'hystérie antifasciste et de dénonciation de la guerre impérialiste. Elle avait maintenant à ses côtés le Noyau français de la Gauche communiste qui s'est constitué en Fraction française de la Gauche communiste et qui a tenu son premier congrès en décembre 1944. Les deux fractions distribuent des tracts et collent des affiches appelant à la fraternisation entre les prolétaires en uniforme des deux camps impérialistes. Cependant, à la conférence de mai 1945, ayant appris la constitution en Italie du Partito comunista internazionalista avec les figures prestigieuses de Onorato Damen et Amadeo Bordiga, la majorité de la Fraction décide la dissolution de celle-ci et l'entrée individuelle de ses membres dans le PCInt. C'était là une remise en cause radicale de toute la démarche de la Fraction depuis sa constitution en 1928. Marc, membre de la CE de la Fraction, et qui avait été le principal animateur de son travail durant la guerre, s'oppose àcette décision. Il ne s'agissait pas d'une démarche formaliste mais politique : il estimait que la Fraction devait se maintenir tant qu'elle ne s'était pas assurée des positions du nouveau parti qui étaient mal connues et vérifier si elles étaient bien conformes à celles de la Fraction ([10] [2931]). Pour ne pas être complice du suicide de la Fraction, il démissionne de sa CE et quitte la conférence après avoir fait une déclaration expliquant son attitude. La Fraction (qui pourtant n'est plus sensée exister) l'exclue pour « indignité politique » et refuse de reconnaître la FFGC dont il était le principal animateur. Quelques mois après, deux membres de la FFGC qui avaient rencontré Vercesi, lequel s'était prononcé pour la constitution du PCInt, scissionnent et constituent une FFGC-bis avec le soutien de cette organisation. Pour éviter toute confusion, la FFGC prend le nom de Gauche Communiste de France (GCF) tout en se réclamant de la continuité politique de la Fraction. Pour sa part, la FFGC-bis se voit « renforcée » par l'entrée dans ses rangs des membres de la minorité exclue de la Fraction en 1936 et du principal animateur de l'Union Communiste, Chazé. Cela n'empêche pas le PCInt et la Fraction belge de la reconnaître comme « seul représentant en France de la Gauche communiste ».
La « minuscule » GCF a arrêté en 1946 la publication de son journal d'agitation, L'Etincelle, estimant que la perspective d'une reprise historique des combats de classe, telle qu'elle avait été mise en avant en 1943, ne s'était pas vérifiée. En revanche, elle a publié, entre 1945 et 1952, 46 numéros de sa revue théorique Internationalisme, abordant l'ensemble des questions qui se posaient au mouvement ouvrier au lendemain de la seconde guerre mondiale et précisant les bases programmatiques sur lesquelles allaient se constituer Internacionalismo en 1964 au Venezuela, Révolution Internationale en 1968 en France et le Courant Communiste International en 1975.
Dans la seconde partie de cet article, nous allons revenir sur la fondation du Partito Comunista Internazionalista, inspirateur du BIPR et « création de la classe ouvrière révolutionnaire ayant eu le plus de réussite depuis la Révolution russe » aux dires de celui-ci.
Fabienne.
Rectificatif
Le BIPR nous a demandé de rectifier la phrase suivante de notre article « Une politique de regroupement sans boussole » {Revue internationale n° 87, p. 22) : « A la 4e conférence [des groupes de la Gauche communiste], la CWO et BC ont relâché les critères afin de permettre que la place du CCI soit prise par le SUCM. » Le BIPR nous a dit qu'en réalité la 4e conférence s'est réunie sur les critères qui avaient été adoptés à la fin de la 3e, le SUCM ayant affirmé être d'accord avec ces critères. Nous prenons acte de ce fait. Nous sommes intéressés à ce que les polémiques entre le CCI et le BIPR, comme tous les débats entre révolutionnaires, s'appuient sur les questions de fond et non sur des malentendus ou des détails erronés.
[1] [2932] Voir l'article sur le 12e Congrès du CCI dans ce numéro.
[2] [2933] Lettre publiée dans la Revue Internationale n° 8 avec notre réponse : <r Les ambiguïtés sur les "partisans" dans la constitution du Parti Communiste Internationaliste en Italie ».
[3] [2934] Voir article de la Revue Internationale n° 8.
[4] [2935] Nous avons souvent abordé dans notre presse ce qui, conformément à la conception élaborée par la Gauche italienne, distingue la forme parti de la forme fraction (voir en particulier notre étude « Le rapport Fraction-Parti dans la tradition marxiste » dans la Revue Internationale n° 59, 61, 64 et 65). Pour la clarté de la question on peut rappeler ici les éléments suivants. La minorité communiste existe en permanence comme expression du devenir révolutionnaire du prolétariat. Cependant l'impact qu'elle peut avoir sur les luttes immédiates de la classe est étroitement conditionné par le niveau de celles-ci et du degré de conscience des masses ouvrières. Ce n'est que dans des périodes de luttes ouvertes et de plus en plus conscientes du prolétariat que cette minorité peut espérer avoir un impact sur ces luttes. Ce n'est que dans ces circonstances qu'on peut parler de cette minorité comme d'un parti. En revanche, dans les périodes de recul historique du prolétariat, de triomphe de la contre-révolution, il est vain d'espérer que les positions révolutionnaires puissent avoir un impact significatif et déterminant sur l'ensemble de la classe. Dans de telles périodes, le seul travail possible, et il est indispensable, est celui d'une fraction : préparer les conditions politiques de la formation du futur parti lorsque le rapport de forces entre les classes permettra à nouveau que les positions communistes aient un impact dans l'ensemble du prolétariat.
[5] [2936] Un membre de la minorité, Candiani, prend même le commandement de la colonne poumiste « Lenin » sur le front d'Aragon.
[6] [2937] Il faut noter que les événements d'Espagne ont provoqué des scissions dans d'autres organisations (l'Union Communiste en France, la Ligue des Communistes en Belgique, la Revolutionary Workers' League aux Etats-Unis, la Liga Comunista au Mexique) qui se retrouvent sur les positions de la Fraction italienne rejoignant ses rangs ou constituant, comme en Belgique, une nouvelle fraction de la Gauche Communiste internationale. C'est à cette époque que le camarade Marc quitte l'Union Communiste et rejoint la Fraction avec qui il était en contact depuis plusieurs années.
[7] [2938] La majorité de la Fraction, contrairement à la légende qu'a entretenue la minorité ainsi que d'autres groupes, ne s'est pas cantonnée à observer de loin les événements d'Espagne. Ses représentants sont restés jusqu'en mai 1937 en Espagne, non pour s'enrôler sur le front antifasciste mais pour poursuivre, dans la clandestinité face aux tueurs staliniens qui ont failli les assassiner, un travail de propagande pour essayer de soustraire quelques militants à la spirale de la guerre impérialiste.
[8] [2939] Durant cette période, la Fraction a publié de nombreux numéros de son bulletin de discussion ce qui lui a permis de développer toute une série d'analyses notamment sur la nature de l'URSS, sur la dégénérescence de la révolution russe et la question de l'Etat dans la période de transition, sur la théorie de l'économie de guerre développée par Vercesi et sur les causes économiques de la guerre impérialiste.
[9] [2940] A ce titre, il en est venu à remercier « son excellence le nonce apostolique > pour son « appui à cette oeuvre de solidarité et d'humanité » tout en se déclarant certain « qu'aucun italien ne se couvrirait de la honte de rester sourd à notre pressant appel » {L'Italia di Domani n°l 1, mars 1945)
[10] [2941] En ce sens, la raison pour laquelle Marc s'oppose à la décision de la Fraction, en mai 1945, n'est pas celle donnée par IC : « que la contre-révolution qui s'était abattue sur les ouvriers depuis leurs défaites dans les années 20 continuait encore et que, de ce fait, il n'y avait pas la possibilité de créer un parti révolutionnaire dans les années 40 » puisqu'à ce moment-là, tout en soulignant les difficultés grandissantes rencontrées par le prolétariat du fait de la politique systématique des Alliés visant à dévoyer sa combativité sur un terrain bourgeois, Marc n'avait pas encore remis en cause explicitement la position adoptée en 1943 sur la possibilité de former le parti.
Courants politiques:
- Gauche Communiste [49]
- TCI / BIPR [137]
Revue Internationale no 91 - 4e trimestre 1997
- 3024 reads
Afrique noire, Algérie, Moyen-Orient : les grandes puissances, principaux responsables des massacres
- 2931 reads
« Plus encore que dans le domaine économique, le chaos propre à la période de décomposition exerce ses effets dans celui des relations politiques entre Etats. Au moment de l'effondrement du bloc de l'Est, conduisant à la disparition du système d'alliances issu de la seconde guerre mondiale, le CCI avait mis en évidence :
-que cette situation mettait à l'ordre du jour, sans que cela soit immédiatement réalisable, la reconstitution de nouveaux blocs, l'un étant dirigé par les Etats-Unis et l'autre par l'Allemagne ;
-que, de façon immédiate, elle allait déboucher sur un déferlement d'affrontements ouverts que "l'ordre de
Yalta" avait réussi auparavant à maintenir dans un cadre "acceptable"pour les deux gendarmes du monde. » (...) « Depuis, cette tendance au "chacun pour soi", au chaos dans les relations entre Etats, avec son cortège d'alliances de circonstance et éphémères, n'a nullement été remise en cause, bien au contraire. »(...)
« ... assez rapidement la tendance au "chacun pour soi " a pris le dessus sur la tendance à la reconstitution d'alliances stables préfigurant de futurs blocs impérialistes ce qui a contribué à multiplier et aggraver les affrontements militaires. » (« Résolution sur la situation internationale » parue dans la Revue Internationale n° 90)
C'est ainsi que, lors de son 12e congrès, le CCI a défini sa vision de la situation mondiale sur le plan impérialiste, vision qui a été, ces derniers mois, illustrée et confirmée à de trop nombreuses reprises. L'instabilité grandissante que connaît le monde capitaliste se traduit notamment par une multiplication de conflits meurtriers aux quatre coins de la planète. Cette aggravation de la barbarie capitaliste est avant tout le fait des grandes puissances qui ne cessent de nous promettre « un monde de paix et de prospérité» mais dont les rivalités toujours plus aiguës et ouvertes coûtent de plus en plus cher à l'humanité en nombre de morts, en généralisation de la terreur et de la misère.
Parce que « la première puissance mondiale est confrontée, depuis qu'a disparu la division du monde en deux blocs, à une contestation permanente de son autorité de la part de ses anciens alliés » (Ibid.), elle a dû mener contre ces derniers et contre leurs intérêts impérialistes, dans la dernière période, « une contre-offensive massive » notamment dans l'ex-Yougoslavie et en Afrique. Malgré cela, les anciens alliés continuent de défier les Etats-Unis jusque dans ses chasses gardées comme l'Amérique latine ou le Moyen-Orient.
Nous ne pouvons traiter ici de toutes les parties du monde qui subissent les effets de la tendance « au chacun pour soi » et de l'exacerbation des rivalités impérialistes entre les grandes puissances. Nous n'aborderons donc que quelques situations qui illustrent parfaitement cette analyse et qui ont connu, ces derniers temps, des rebondissements significatifs.
Afrique noire : les intérêts français au plus mal
Dans la résolution citée plus haut nous affirmions aussi que la première puissance mondiale « a réussi à infliger au pays qui l'avait défiée le plus ouvertement, la France, un très sérieux revers dans ce qui constitue son "pré carré", l'Afrique. » L'évidence des faits à ce moment-là nous autorisait à dire que : «Après l'élimination de l'influence française au Rwanda, c'est maintenant la principale position de la France sur ce continent, le Zaïre qui est en train de lui échapper avec l'effondrement du régime de Mobutu sous les coups de la "rébellion" de Kabila massivement soutenue par le Rwanda et l'Ouganda, c'est-à-dire par les Etats-Unis. »
Depuis, les hordes de Kabila ont éjecté Mobutu et sa clique et pris le pouvoir à Kinshasa. Dans cette victoire et en particulier dans les massacres monstrueux des populations civiles qu'elle a occasionnés, le rôle direct et actif joué par l'Etat américain, notamment à travers les nombreux « conseillers » qu'il a mis à la disposition de Kabila, est aujourd'hui un secret de polichinelle. Hier, c'était l'impérialisme français qui armait et conseillait les bandes hutues, responsables des massacres au Rwanda, pour déstabiliser le régime pro-US de Kigali ; aujourd'hui, c'est Washington qui en fait de même, contre les intérêts français, avec les « rebelles » tutsis de Kabila.
Le Zaïre est ainsi passé sous la coupe exclusive des Etats-Unis. La France, quant à elle, a perdu un pion essentiel, ce qui signe son éviction complète de la « région des grands lacs ».
De plus, cette situation n'a pas tardé à provoquer une déstabilisation en chaîne des pays voisins qui sont encore sous l'influence française. L'autorité et la crédibilité du « parrain français » ont en effet pris un sacré coup dans la région, ce dont les Etats-Unis essaient de tirer profit au maximum. Ainsi, depuis quelques semaines, le Congo-Brazzaville est déchiré par la guerre que se livrent les deux derniers présidents qui sont pourtant tous les deux des « créatures » de la France. Les pressions et les nombreux efforts de médiation faits par Paris ne connaissent pour le moment aucun succès. En Centrafrique, pays qui est actuellement soumis à une situation de chaos sanglant, cette même impuissance se manifeste. Ainsi, malgré deux interventions militaires très musclées et la création d'une « force africaine d'interposition» à sa botte, l'impérialisme français n'arrive toujours pas à maintenir l'ordre sur place. Plus grave, le président centrafricain Ange Patassé, une autre « créature » de la France, menace maintenant de recourir à l'aide américaine signifiant ainsi sa défiance vis-à-vis de son parrain actuel. Cette perte de crédit tend aujourd'hui à se généraliser à travers toute l'Afrique noire jusqu'à commencer à atteindre les pions les plus fidèles de Paris. Plus généralement, l'influence française s'effrite sur l'ensemble du continent comme l'a clairement démontré, par exemple, le dernier sommet annuel de l'OUA où des « initiatives françaises » significatives ont été repoussées :
- l'une concernait la reconnaissance du nouveau pouvoir de Kinshasa que Paris voulait retarder et placer sous condition ; sous la pression des Etats-Unis et de ses alliés africains, Kabila a non seulement obtenu une reconnaissance immédiate mais également un soutien économique « pour reconstruire son pays » ;
-une autre concernait la nomination d'une nouvelle direction à la tête de l'organisme africain ; le « candidat » de la France, abandonné par ses «amis», a dû retirer sa candidature avant le vote.
L'impérialisme français subit actuellement sur le continent noir une série de revers graves sous les coups de boutoir de l'impérialisme américain, et il s'agit pour lui d'un déclin historique, essentiellement au profit de ce dernier, dans ce qui était, il n'y a pas si longtemps, son pré carré.
« C'est une punition particulièrement sévère que cette puissance (les Etats-Unis) est en train d'infliger à la France et qui se veut exemplaire à l'adresse de tous les autres pays qui voudraient l'imiter dans sa politique de défi permanent. » (Ibid.)
Cependant, malgré son déclin, l'impérialisme français a encore des arguments à faire valoir, des cartes à jouer pour défendre ses intérêts et riposter à l'offensive, pour le moment victorieuse, des américains. C'est notamment dans ce but qu'il a engagé tout un redéploiement stratégique de ses forces militaires en Afrique. Si, sur ce plan (et sur d'autres), Paris est loin de pouvoir rivaliser avec Washington, cela ne signifie nullement qu'elle va baisser les bras; et, pour le moins, il est sûr que, dès à présent, elle va mettre en oeuvre toutes ses capacités de nuisance pour mettre en difficulté la politique et les intérêts américains. Les populations africaines n'ont donc pas fini de subir dans leur chair la rivalité entre les grands gangsters capitalistes.
Derrière les massacres en Algérie, les mêmes intérêts sordides des « grands »
L'Algérie est un autre terrain qui subit de plein fouet les effets de la décomposition du capitalisme mondial et sur lequel s'exerce l'antagonisme féroce entre les « grands ». En effet, voilà près de cinq années que ce pays ne cesse de s'enfoncer dans un chaos toujours plus sanglant et barbare. Les règlements de compte en série, les incessants massacres en masse de populations civiles, les multiples attentats meurtriers perpétrés jusqu'au coeur de la capitale plongent ce pays dans l'horreur et la terreur quotidiennes. Depuis 1992, début de ce que les médias bourgeois appellent hypocritement « la crise algérienne », il ne fait aucun doute que le chiffre de 100 000 tués a été dépassé. S'il y a bien une population (et donc un prolétariat) qui est prise en otage dans une guerre entre fractions bourgeoises, c'est bien celle d'Algérie. Il est clair aujourd'hui que ceux qui assassinent quotidiennement, qui sont les responsables directs de la mort de ces milliers d'hommes, de femmes, d'enfants et de vieillards, ce sont des bandes armées à la solde des différents camps en présence :
- celui des islamistes dont la fraction la plus dure et la plus fanatique, le GIA, draine notamment une jeunesse décomposée, désoeuvrée, sans perspective (du fait de la situation économique dramatique de l'Algérie aujourd'hui qui jette la majorité de la population dans le chômage, la misère et la famine) sinon celle de plonger dans la plus profonde délinquance. Al Wasat, le journal de la bourgeoisie saoudienne qui paraît à Londres, reconnaît que « cette jeunesse a d'abord constitué un moteur dont le FIS s'est servi pour effrayer tous ceux qui se mettaient en travers de sa route vers le pouvoir » mais que celle-ci a tendu à lui échapper de plus en plus ;
- l'Etat algérien, lui-même, dont il apparaît aux yeux de tout le monde qu'il est impliqué directement dans de nombreux massacres qu'il a imputés aux « terroristes islamistes ». Les témoignages recueillis notamment sur la boucherie (entre 200 et 300 morts) qui a eu lieu dans la banlieue algéroise, à Raïs, à la fin du mois d'août dernier prouvent, s'il en était besoin, que le régime de Zéroual est loin d'être innocent : « Cela a duré de 22h 30 à 2h 30. Ils (les massacreurs) ont pris tout leur temps. (...) Aucun secours n'est arrivé. Les forces de sécurité sont pourtant toutes proches. Les premiers arrivés ce matin ont été les pompiers. » (témoignages cités dans le journal Le Monde) Il est clair aujourd'hui qu'une bonne partie des carnages perpétrés en Algérie sont l'oeuvre soit des services de sécurité de l'Etat soit des « milices d'autodéfense » armées et contrôlées par ce même Etat. Ces milices ne sont pas chargées, comme veut le faire croire le régime en place, « de veiller sur la sécurité des villages » ; elles sont pour l'Etat un moyen de quadrillage de la population, une arme redoutable pour éliminer ses opposants et imposer son ordre par la terreur.
Face à cette situation d'épouvante, « l'opinion mondiale », c'est-à-dire les grandes puissances occidentales surtout, a commencé à exprimer son « émotion ». Ainsi, quand le secrétaire général de l'ONU Kofi Annan cherche à encourager « la tolérance et le dialogue » et appelle à « une solution urgente », Washington, qui se dit « horrifiée », lui apporte immédiatement son soutien. L'Etat français, quant à lui, n'est pas en reste question compassion mais s'interdit de faire de « l'ingérence dans les affaires de l'Algérie ». L'hypocrisie dont font preuve tous ces « grands démocrates » est absolument effarante mais elle a de plus en plus de mal à masquer leurs responsabilités dans l'horreur que vit ce pays. Par fractions bourgeoises algériennes interposées, c'est une guerre sans merci que se livrent notamment la France et les Etats-Unis depuis la disparition des grands blocs impérialistes. L'enjeu de cette sordide rivalité est pour Paris de conserver l'Algérie dans son giron et pour Washington de la récupérer à son profit ou, pour le moins, de déstabiliser l'influence de sa rivale.
Dans cette bataille, le premier coup a été porté par l'impérialisme américain qui a soutenu, en sous main, le développement de la fraction intégriste du FIS (qui était à sa botte via le soutien de l'Arabie Saoudite) à tel point que celle-ci, en 1992, est arrivée aux portes du pouvoir. Et c'est un véritable coup d'Etat perpétré par le régime en place à Alger, avec le soutien du parrain français, qui a permis d'écarter le danger qui était imminent tant pour les fractions bourgeoises qui sont au pouvoir que pour les intérêts français. Depuis la politique menée par l'Etat algérien, notamment avec l'interdiction du FIS, la chasse et l'emprisonnement de nombre de ses dirigeants et militants, a permis de réduire l'influence de ce dernier dans le pays. Mais si cette politique, sur ce plan, a été globalement couronnée de succès, elle est, par contre, responsable de la situation de chaos actuelle. C'est elle qui a jeté des fractions du FIS dans l'illégalité, la guérilla et les actions terroristes. Aujourd'hui, les islamistes sont discrédités du fait notamment de leurs multiples et abominables exactions. On peut donc affirmer qu'avec le soutien de Paris le régime de Zéroual est pour l'instant parvenu à ses fins mais aussi que l'impérialisme français a réussi globalement à résister à l'offensive de la première puissance mondiale et à préserver ses intérêts en Algérie. Le prix de ce « succès », ce sont les populations qui le paient aujourd'hui et le paieront encore demain. En effet, quand récemment les Etats-Unis ont parlé d'apporter tout leur soutien « aux efforts personnels » de Kofi Annan, c'était pour signifier qu'il ne sont pas prêts à lâcher le morceau; ce à quoi Chirac leur a immédiatement répondu en dénonçant, à l'avance, toute politique « d'ingérence dans les affaires algériennes », laissant entendre par là qu'il défendra bec et ongles son pré carré.
Moyen-Orient : les difficultés grandissantes de la politique américaine
Si les seconds couteaux impérialistes, comme la France, ont du mal à conserver leur autorité dans leurs zones d'influence traditionnelles et y subissent même des reculs sous les coups de boutoir des Etats-Unis, ces derniers ne sont pas épargnés par les difficultés dans leur politique, difficultés qu'ils subissent jusque dans leurs chasses gardées comme le Moyen-Orient. Cette zone sur laquelle ils ont, depuis la guerre du Golfe, un contrôle quasi-exclusif est soumise à une instabilité grandissante qui remet en question leur « pax americana » et leur autorité. Dans notre résolution citée ci-dessus, nous avions déjà souligné un certain nombre d'exemples illustrant la contestation grandissante du leadership américain par un certain nombre de pays vassaux de cette région du monde. Notamment, à l'automne 1996, « les réactions presque unanimes d'hostilité envers les bombardements de l'Irak par 44 missiles de croisière », réactions auxquelles se sont joints des « fidèles » comme l'Egypte et l'Arabie Saoudite. Un autre exemple significatif a été celui de « la venue au pouvoir en Israël, contre la volonté affichée des Etats-Unis, de la droite, laquelle a tout fait depuis pour saboter le processus de paix avec les palestiniens qui constituait un des plus beaux succès de la diplomatie US ». La situation qui s'est développée depuis a confirmé de manière éclatante cette analyse.
Dès mars dernier, le « processus de paix » subissait un recul significatif avec l'arrêt des négociations israélo-palestinienne du fait de la politique cynique de colonisation des territoires occupés développée par le gouvernement Netanyahou. Depuis, la tension n'a cessé de monter dans la région. Elle s'est soldée notamment, durant cet été, par plusieurs attentats suicide meurtriers, attribués au Hamas, en plein Jérusalem ce qui a été l'occasion pour l'Etat hébreu d'accentuer sa répression contre les populations palestiniennes et d'imposer un «blocus des territoires libres». Par ailleurs, une série de raids de Tsahal, avec leur cortège de destruction et de morts, ont été lancés contre le Hezbollah au Sud-Liban. Face à ce dérapage accéléré de la situation, la Maison Blanche a dû dépêcher sur place, successivement, ses deux principaux émissaires, Dennis Ross et Madeleine Albright, sans grand succès. Cette dernière a même reconnu qu'elle n'avait pas trouvé « la meilleure méthode pour remettre le processus de paix sur les rails ». Et en effet, malgré les fortes pressions de Washington, Nétanyahou reste sourd et poursuit sa politique agressive contre les palestiniens mettant en danger l'autorité d'Arafat et donc ses capacités à contrôler les siens. Quant aux pays arabes, ils sont de plus en plus nombreux à exprimer leur mauvaise humeur vis-à-vis de la politique américaine qu'ils accusent de sacrifier leurs intérêts au profit de ceux d'Israël. Parmi ceux qui bravent l'autorité du parrain américain se trouve la Syrie qui, actuellement, est en train de développer des relations économiques et militaires avec Téhéran et s'est même permis de rouvrir ses frontières avec l'Irak. Par ailleurs, ce qui était proprement inconcevable il y a très peu de temps se produit aujourd'hui : l'Arabie Saoudite, « le plus fidèle allié » des américains mais aussi le pays qui était jusque là le plus opposé au « régime des mollahs », renoue des liens avec l'Iran. Ces attitudes nouvelles vis-à-vis de l'Iran et de l'Irak, deux des principales cibles de la politique US ces dernières années, ne peuvent être perçues par Washington que comme des bravades, voire des camouflets.
Dans ce contexte de difficultés aiguës pour leur rivale d'outre-Atlantique, les bourgeoisies européennes se font fort de jeter de l'huile sur le feu. D'ailleurs, notre résolution affirmait déjà cet aspect en soulignant que la contestation du leadership américain se confirme « plus généralement, (par) la perte du monopole du contrôle de la situation au Moyen-Orient, zone cruciale s'il en est, notamment illustrée par le retour en force de la France qui s'est imposée comme co-parrain du règlement du conflit entre Israël et le Liban... ». Ainsi, durant l'été, on a vu l'Union Européenne doubler Dennis Ross sur le poteau et enfoncer un coin dans les fissures du dispositif diplomatique américain, son « envoyé spécial » proposant la mise sur pied d'un « comité de sécurité permanent » pour permettre à Israël et à l'OLP de « collaborer de manière permanente et non pas intermittente ». Tout récemment encore, le ministre des affaires étrangères du gouvernement français, H.Védrine, soufflait un peu plus sur les braises en taxant la politique de Netanyahou de « catastrophique », dénonçant ainsi implicitement la politique américaine. De plus, il affirmait haut et fort que « le processus de paix » était « cassé » et qu'il n'a « plus de perspective ». Il s'agit là, pour le moins, d'un encouragement, adressé aux palestiniens et à tous les pays arabes, à se détourner des Etats-Unis et de leur « pax americana».
« C'est pour cela que les succès de la contre-offensive actuelle des Etats-Unis ne sauraient être considérés comme définitifs, comme un dépassement de la crise de leur leadership. » Et même si « la force brute, les manoeuvres visant à déstabiliser leurs concurrents (comme aujourd'hui au Zaïre), avec tout leur cortège de conséquences tragiques n'ont donc pas fini d'être employés par cette puissance » (Ibid.), ces mêmes concurrents, eux, n'ont pas non plus fini de mettre en oeuvre toutes leurs capacités de nuisance contre la politique à visée hégémonique de la première puissance mondiale.
Aujourd'hui, aucun impérialisme, pas même le plus fort, n'est à l'abri des menées déstabilisatrices de ses concurrents. Les prés carrés, les chasses gardées tendent à disparaître. Il n'y a plus sur la planète de zones « protégées ». Plus que jamais, le monde est livré à la concurrence débridée selon la règle du « chacun pour soi ». Et tout cela contribue à élargir et à accentuer le chaos sanglant dans lequel s'enfonce le capitalisme.
Elfe, 20 septembre 1997
Géographique:
- Afrique [2942]
- Moyen Orient [132]
Questions théoriques:
- Décomposition [3]
« L'Etat et la Révolution » (Lénine), une vérification éclatante du marxisme
- 4575 reads
Dans la lutte constante qu'ils mènent contre le marxisme, les professeurs bourgeois ont pour argument favori l'idée que ce dernier serait une pseudoscience, du même genre que la phrénologie ou d'autres charlataneries de ce style. On trouve la présentation la plus élaborée de cette thèse dans le livre de Karl Popper, The Open Society and it’s ennemies, qui est une justification classique du libéralisme et de... la « guerre froide ». Selon Popper, le marxisme n'est pas une science de la société car on ne peut ni vérifier ni réfuter ses propositions par l'expérience pratique condition sine qua non de toute véritable investigation scientifique.
En fait, le marxisme ne revendique pas d'être « une science » du même type que les sciences naturelles. II reconnaît que les rapports sociaux humains ne peuvent être soumis à un examen précis et contrôlé comme le sont les processus physiques, chimiques ou biologiques. Ce qu'il affirme par contre, c'est qu'en tant que vision mondiale d'une classe exploitée qui n'a aucun intérêt ni à occulter ni à travestir la réalité sociale, il est seul capable d'appliquer la méthode scientifique à l'étude de la société et de l'évolution historique. II est certain qu'on ne peut examiner l'histoire dans les conditions d'un laboratoire. On ne peut tester les prévisions d'une critique sociale révolutionnaire par des expérimentations répétées et soigneusement contrôlées. Mais même en tenant compte de cela, il est toujours possible d'extrapoler à partir du mouvement passé et présent des processus historiques, économiques et sociaux, et de dessiner à grands traits le mouvement à venir. Et ce qui est si frappant dans le gigantesque enchaînement des événements historiques inaugurés par la première guerre mondiale, c'est précisément à quel point il vérifie les prévisions du marxisme dans le laboratoire vivant de faction sociale.
Une prémisse fondamentale du matérialisme historique, c'est le fait que, comme toutes les précédentes sociétés de classes, le capitalisme atteindrait une phase où ses rapports de production, de conditions de développement des forces productives, se transformeraient en entraves, plongeant l'ensemble de la superstructure juridique et politique de la société dans la crise et ouvrant une époque de révolution sociale. Les fondateurs du marxisme ont donc analysé en profondeur les contradictions de la structure capitaliste, ses bases économiques, qui allaient entraîner le système dans sa crise historique. Cette analyse était inévitablement générale et ne pouvait parvenir à des prévisions précises. quant à la date de la crise révolutionnaire. Malgré cela, même Marx et Engels ont parfois été victimes de leur impatience révolutionnaire et ont annoncé de façon précipitée le déclin général du système et donc l'imminence de la révolution prolétarienne. La forme qu'allait prendre cette crise historique n'était pas non plus très claire. Prendrait-elle la forme de dépressions économiques cycliques comme celles qui avaient marqué la période ascendante ou sous une forme plus vaste et sans possibilité de renouveau? Là encore, on ne pouvait avancer qu'une perspective générale. Néanmoins, dès le Manifeste Communiste, le dilemme essentiel auquel était confrontée l'humanité était annoncé: socialisme ou retour à la barbarie; émergence d'une forme supérieure de rapports humains ou déchaînement de toutes les tendances destructrices inhérentes au capitalisme - ce que le Manifeste appelle «la ruine commune des classes en lutte ».
Cependant, vers la fin du 19e siècle, avec l'entrée du capitalisme dans sa phase impérialiste, une phase de militarisme débridé et de compétition aigüe pour la conquête des zones extra-capitalistes qui restaient sur la planète, le désastre où le capitalisme menait l'humanité a commencé à apparaître clairement, non sous la forme d'une vaste dépression économique mais sous celle d'une catastrophe militaire à grande échelle: la guerre globale en tant que compétition économique sous d'autres formes, mais développant de plus en plus sa propre dynamique malsaine, détruisant toute la civilisation sous ses roues meurtrières. D'où la remarquable « prophétie » d’Engels en 1887:
« Aucune guerre n'est désormais possible pour la Prusse allemande qu'une guerre mondiale, et une guerre mondiale d'une étendue et d'une violence inconnues jusqu’'ici. Huit ou dix millions de soldats se massacreront les uns les autres, et ce faisant, engloutiront toute l'Europe jusqu'à ce qu'ils l'aient dépouillée et mise à nu comme un essaim de sauterelles ne pourrait jamais le faire. Les dévastations de la guerre de Trente ans, comprimées sur trois ou quatre ans et étendues au continent tout entier; la famine, la peste, la chute générale dans la barbarie des armées et de la masse des populations ; le chaos sans espoir du système artificiel de commerce, d'industrie et de crédit, aboutissant à la banqueroute générale ; l'effondrement des vieux Etats et de la sagesse traditionnelle de leur élite au point que les couronnes tomberont par douzaine et qu'il n’y aura personne pour les ramasser; l'impossibilité absolue de prévoir comment tout cela finira et qui sortira vainqueur de la bataille ; un seul résultat est absolument certain : l'épuisement général et l'établissement des conditions de la victoire finale du prolétariat.
Telle est la perspective quand le système de surenchère mutuelle dans les armements, poussée à ses extrémités, finit par porter ses inévitables fruits. Voilà, mes seigneurs, princes, hommes d'Etat, voilà où, dans votre sagesse, vous avez conduit la vieille Europe. Et lorsqu'il ne vous restera plus rien à faire qu'à engager la dernière grande danse guerrière, cela nous ira très bien. La guerre peut nous repousser peut-être temporairement en arrière, elle peut nous arracher une position que nous avons déjà conquise. Mais quand des forces que vous ne pourrez plus contrôler seront lâchées, les choses iront comme elles iront; à la fin de la tragédie, vous serez ruinés et la victoire du prolétariat aura eu lieu ou sera en tous cas inévitable. » ([1] [2943])
Les fractions révolutionnaires qui, en 1914, ont maintenu les principes internationalistes face à la guerre, avaient de bonnes raisons de se rappeler ces paroles d’Engels. Dans la Brochure de Junius, Rosa Luxemburg n'a eu qu'à les remettre à jour:
« Friedrich Engels a dit un jour: "La société bourgeoise est placée devant un dilemme : ou bien passage au socialisme ou la rechute dans la barbarie". Mais que signifie donc une "rechute dans la barbarie" au degré de civilisation que nous connaissons en Europe aujourd'hui ? Jusqu'ici nous avons lu ces paroles sans y réfléchir et nous les avons répétées sans en pressentir la terrible gravité. Jetons un coup d'œil autour de nous en ce moment même et nous comprendrons ce que signifie une rechute de la société bourgeoise dans la barbarie. Le triomphe de l'impérialisme aboutit à l'anéantissement de la civilisation -sporadiquement pendant la durée d'une guerre moderne et définitivement si la période des guerres mondiales qui débute maintenant devait se poursuivre sans entraves jusque dans ses dernières conséquences. C'est exactement ce que Friedrich Engels avait prédit une génération avant nous voici quarante ans. Nous sommes placés aujourd'hui devant ce choix : ou bien triomphe de l'impérialisme et décadence de toute civilisation, avec pour conséquences, comme dans la Rome antique, le dépeuplement, la désolation, la dégénérescence, un grand cimetière ; ou bien victoire du socialisme, c'est-à-dire de la lutte consciente du prolétariat international contre l'impérialisme et contre sa méthode d'action : la guerre. C'est là un dilemme de l'histoire du monde, un "soit l'un, soit l'autre" encore indécis dont les plateaux balancent devant la décision du prolétariat conscient. (..) L'avenir de la civilisation et de l'humanité en dépend. »
Luxemburg, développant à partir des prévisions d’Engels, ajoute que si le prolétariat ne se débarrasse pas du capitalisme, la guerre impérialiste ne sera que la première d'une série de conflits globaux toujours plus dévastateurs qui finiront par menacer la survie même de l'humanité. Tel a été, en fait, le drame du 20e siècle, preuve la plus parlante du fait que, comme l'écrit Lénine, « le capitalisme a vécu. Il est devenu le frein le plus réactionnaire du progrès humain. » ([2] [2944])
Mais si la guerre de 1914 a confirmé cet aspect de l'alternative historique - la décadence du système capitaliste, son plongeon dans la régression - la révolution russe et la vague révolutionnaire internationale qui a suivi, ont confirmé, avec non moins de clarté, l'autre aspect : selon les termes du Manifeste du 1 er congrès de 17nternationale communiste en 1919, l'époque de la désintégration capitaliste est aussi l'époque de la révolution communiste ; et la classe ouvrière est la seule force sociale qui puisse mettre fin à la barbarie capitaliste et inaugurer la nouvelle société. Les terribles privations de la guerre impérialiste et la désintégration du régime tsariste ont entraîné toute la société russe dans un tourbillon social. Mais, au sein de la révolte d'une immense population composée en majorité d'ouvriers et de paysans en uniforme, c'est la classe ouvrière des centres urbains qui a créé les nouveaux organes révolutionnaires de lutte - les soviets, les comités d'usine, les gardes rouges - qui ont servi de modèle au reste de la population, qui ont fait les avancées les plus rapides au niveau de la conscience politique (ces avancées se sont exprimées à travers la croissance spectaculaire du parti bolchevik) et qui, à chaque étape du processus révolutionnaire, ont agi en déterminant le cours des événements : dans le renversement du régime tsariste en février, en déjouant les plans de la contre-révolution en septembre, en menant l'insurrection en octobre. De même, c'est la classe ouvrière en Allemagne, en Hongrie, en Italie et sur tout le globe qui, par ses grèves et ses luttes, a mis fin à la guerre et a menacé l'existence même du capital mondial.
Si les masses prolétariennes ont réalisé ces prouesses révolutionnaires, ce n'est pas parce qu'elles étaient intoxiquées par quelque vision millénariste, ni qu'elles avaient été dupées par une poignée de conspirateurs machiavéliques, mais parce qu'à travers leur lutte pratique, leurs débats et leurs discussions, elles ont vu que les slogans et le programme des marxistes révolutionnaires correspondaient à leurs propres intérêts et besoins de classe.
Trois ans après l'ouverture de l'époque de la révolution prolétarienne, la classe ouvrière a fait la révolution -elle a pris le pouvoir dans un pays et a défié l'ordre capitaliste dans le monde entier. Le spectre du « bolchevisme », du pouvoir soviétique, de la mutinerie contre la machine de guerre impérialiste a fait tomber des couronnes et a hanté partout la classe dominante. Pendant trois ans et plus, il semblait que la prévision d'Engels se confirmait dans tous ses aspects : la barbarie de la guerre assurait la victoire du prolétariat. Evidemment, comme les professeurs bourgeois n'ont de cesse de nous le rappeler : « ça a raté ». Et ils ajoutent que ça ne pouvait que rater car le projet grandiose de liquider le capitalisme et de créer une société humaine est tout simplement contraire à la « nature humaine ». Mais la classe dominante de l'époque ne s'est pas assise en attendant que la « nature humaine » suive son cours. Pour exorciser le spectre de la révolution mondiale, elle s'est donné la main sur toute la planète pour combiner ses forces contre-révolutionnaires, à travers l'intervention militaire contre la république soviétique, par la provocation et le massacre des ouvriers révolutionnaires, de Berlin à Shanghai. Et quasiment sans exception, ce sont les tenants du libéralisme et de la social-démocratie, c'est-à-dire les Kerensky, les Noske et les Woodrow Wilson, que la majorité des professeurs présentent comme l'incarnation d'une alternative plus rationnelle et plus réalisable face aux rêves impossibles du marxisme, qui furent les dirigeants et les organisateurs des forces de la contre-révolution.
La physique quantique du 20e siècle a reconnu comme une nécessité une prémisse fondamentale de la dialectique: on ne peut examiner la réalité de l'extérieur. L'observation influence le processus qu'on observe. Le marxisme n'a jamais revendiqué d'être une « science » neutre « de la société » car il prend parti de l'intérieur du processus et, ce faisant, se définit comme une force qui accélère et transforme le processus. Les académiciens bourgeois peuvent se dire impartiaux et neutres mais, quand ils commentent la réalité sociale, leur point de vue partisan apparaît clairement. La différence avec les marxistes c'est que ces derniers font partie du mouvement vers une société libre, tandis que les professeurs qui critiquent le marxisme, finissent toujours par faire l'apologie des forces les plus sanglantes de la réaction sociale et politique.
Le prolétariat au bord du pouvoir
D'historique et général qu'il était au 19e siècle, le programme communiste est devenu très précis. En 1917, la question brûlante était celle du pouvoir politique, de la dictature du prolétariat. Et c'est au prolétariat russe qu'a échu la résolution de ce problème, en théorie comme en pratique. L'Etat et la révolution de Lénine -La doctrine marxiste de l'Etat et les tâches du prolétariat dans la révolution - écrit en août-septembre 1917, a déjà été maintes fois mentionné dans ces articles puisque nous avons non seulement tenté de réexaminer beaucoup de ces questions mais surtout d'appliquer sa méthode. Si nous répétons des choses que nous avons déjà dites, tant pis: certaines choses valent la peine d'être répétées. Comme L'Etat et la révolution occupe une place très importante dans l'évolution de la théorie marxiste de l'Etat, nous ne nous excuserons pas d'en faire ici le principal sujet d'un article.
Comme nous l'avons montré dans l'article précédent (Revue Internationale n° 90), l'expérience directe de la classe ouvrière et l'analyse de cette expérience par les minorités marxistes avaient déjà, avant la guerre et la vague révolutionnaire, jeté les bases de travail essentielles pour résoudre le problème de l’Etat dans la révolution prolétarienne. La Commune de Paris de 1871 avait déjà mené Marx et Engels à la conclusion que le prolétariat ne pouvait « seulement s'emparer » de l'ancien Etat bourgeois mais devait le détruire et le remplacer par de nouveaux organes de pouvoir. Les grèves de masse de 1905 avaient démontré que les soviets des députés ouvriers constituaient la forme du pouvoir révolutionnaire la plus appropriée à la nouvelle époque historique qui s'ouvrait. Pannekcek dans sa polémique avec Kautsky avait réaffirmé que la révolution ne pouvait qu'être le résultat d'un mouvement de masse qui paralyse et désintègre le pouvoir d’Etat de la bourgeoisie.
Mais le poids de l'opportunisme dans le mouvement ouvrier avant la guerre était trop grand pour être dissipé, même par les polémiques les plus vives. Ce que la Commune avait enseigné avait été désappris durant les décennies de parlementarisme et de légalisme, de réformisme croissant dans le parti et les syndicats. De plus, l'abandon de la vision révolutionnaire de Marx et Engels ne se restreignait aucunement à des gens ouvertement révisionnistes tels que Bernstein. A travers le travail du courant autour de Kautsky, le fétichisme parlementaire et la théorisation d'une voie pacifique, «démocratique » au socialisme étaient en fin de compte présentés comme le fin mot du « marxisme orthodoxe ». Dans une telle situation, ce n'est que lorsque les positions de la gauche de la 2e Internationale ont fusionné avec le vaste mouvement des masses que l'amnésie prolétarienne sur sa propre histoire a pu être surmontée. Cela n'en diminue pas pour autant l'importance de l'intervention «théorique » des révolutionnaires sur cette question, au contraire. Quand la théorie révolutionnaire s'empare des masses et devient une force matérielle, sa clarification et sa dissémination deviennent plus urgentes et plus décisives que jamais.
Dans un article de la Revue Internationale n° 89, le CCI a rappelé l'importance vitale de l'intervention politique et théorique des Thèses d'avril de Lénine qui montraient au parti et à l'ensemble de la classe ouvrière comment sortir du brouillard de confusion créé par les mencheviks, les socialistes-révolutionnaires et toutes les forces de compromis et de trahison. Au cœur de la position de Lénine, en avril, se trouve l'insistance sur le fait que la révolution russe ne peut se concevoir que comme partie de la révolution socialiste mondiale. Qu'en conséquence, le prolétariat devait poursuivre sa lutte contre la république parlementaire - présentée par les opportunistes et les bourgeois de gauche comme le plus grand acquis de la révolution et que le prolétariat ne devait pas seulement lutter pour une république parlementaire mais pour le transfert du pouvoir aux soviets, pour la dictature du prolétariat en alliance avec les paysans pauvres.
Pour leur part, les opposants politiques de Lénine, surtout ceux qui se couvraient du voile de l'orthodoxie marxiste, ont immédiatement accusé Lénine d'anarchisme, de chercher à occuper le trône vacant de Bakounine. Cette offensive idéologique de l'opportunisme requerrait une réponse, une réaffirmation de l'alphabet marxiste, mais aussi un approfondissement théorique à la lumière de l'expérience historique récente. L'Etat et la révolution a répondu à ce besoin, fournissant en même temps l'une des plus remarquables démonstrations de la méthode marxiste, de la profonde interaction entre la théorie et la pratique. Lénine avait écrit, plus de 10 ans auparavant, qu'« il n y a pas de mouvement révolutionnaire sans théorie révolutionnaire ». Forcé à ce moment-là de rentrer dans la clandestinité et de se cacher dans le territoire finlandais à cause de la répression qui suivit les Journées de juillet (Revue Internationale n° 90), Lénine a reconnu la nécessité de se plonger à fond dans les classiques du marxisme, dans l'histoire du mouvement ouvrier afin de clarifier les buts immédiats d'un mouvement de masse immensément pratique.
L'Etat et la révolution constitue une continuation et une clarification de la théorie marxiste. Mais cela n'a pas empêché la bourgeoisie (à laquelle les anarchistes comme d'habitude faisaient souvent écho) de dire de ce livre qui insiste sur le pouvoir des soviets et la destruction de toute bureaucratie, qu'il était le produit d'une conversion temporaire de Lénine à l'anarchisme. Ils font fait selon différents angles. Un historien gauchiste « sympathique » comme Liebman par exemple (Leninism under Lenin, London 1975) parle de L'Etat et la révolution comme du travail d'un « Lénine libertaire », cherchant à faire croire que ce livre exprime un enthousiasme de courte durée de Lénine pour le potentiel créateur des masses en 1917-18, en opposition au Lénine « plus autoritaire » de 1902-1903, ce Lénine qui rejetait soi-disant la spontanéité des masses et défendait un parti de style jacobin formant l'état-major de celles-ci. Mais la capacité de Lénine à répondre au mouvement spontané, à la créativité des masses, même pour corriger à leur lumière ses propres exagérations et ses propres erreurs, ne se limite pas à 1917. Elle s'est déjà clairement manifestée en 1905 (voir l'article sur 1905 dans la Revue Internationale n° 90). En 1917, Lénine était convaincu que la révolution prolétarienne était à l'ordre du jour et n'était plus désormais limitée par la théorie de la « révolution démocratique » en Russie. C'est ce qui l’a conduit à compter encore plus sur la lutte autonome de la classe ouvrière; mais c'était le développement de ses positions précédentes, et non une soudaine conversion à l'anarchisme.
D'autres approches, plus ouvertement hostiles, du livre L'Etat et la révolution le considèrent comme faisant partie d'une ruse machiavélique pour que les masses s'alignent sur les projets des bolcheviks de faire un coup d’Etat et d'établir la dictature du parti. Les anarchistes et les conseillistes sont très friands d'arguments de cet acabit. On ne va pas les réfuter en détail ici. Cela fait partie de notre défense d'ensemble de la révolution russe et de l'insurrection d'Octobre, en particulier contre les campagnes de la bourgeoisie (Voir l'article sur l'insurrection d'octobre dans ce même numéro). Ce qu'on peut dire, c'est que la défense intransigeante par Lénine des principes marxistes sur la question de l’Etat, à partir du moment où il est rentré d'exil en avril, l’a mis en extrême minorité. Et il n'y avait aucune garantie que la position qu'il défendait, conquière les masses. En partant de cette, vision, le machiavélisme de Lénine devient carrément surhumain et nous quittons le monde de la réalité pour les divagations de la théorie conspiratrice. Une autre démarche, malheureusement contenue dans un article publié dans Internationalism, notre publication aux Etats-Unis, il y a plus de 20 ans lorsque l'idéologie conseilliste avait un poids considérable sur les nouveaux groupes révolutionnaires qui surgissaient, consiste à passer L’Etat et la révolution au peigne fin et à chercher la « preuve » que le livre de Lénine, à la différence des écrits de Marx sur la dictature du prolétariat, continue de contenir le point de vue d'un autoritaire qui ne peut envisager que les ouvriers se libèrent eux-mêmes par leurs propres forces (voir dans Internationalism n° 3, « La dictature du prolétariat : Marx contre Lénine »).
Nous ne chercherons pas à éviter de traiter les faiblesses qui existent réellement dans L'Etat et la révolution. Mais nous n'irons nulle part en créant une fausse opposition entre Marx et Lénine, pas plus qu'en considérant L'Etat et la révolution comme un point de jonction entre Lénine et Bakounine. Le livre de Lénine est en complète continuité avec Marx, Engels et toute la tradition marxiste avant lui ; et la tradition marxiste qui fa suivi a, à son tour, tiré beaucoup de force et de clarté de ce travail indispensable.
L'Etat, instrument de la domination de classe
La première tâche de L'Etat et la révolution a été de réfuter les conceptions des opportunistes sur la nature fondamentale de l’Etat. La tendance opportuniste dans le mouvement ouvrier, en particulier l'aile lassallienne de la social-démocratie allemande, s'est depuis longtemps basée sur l'idée que l’Etat est essentiellement un instrument neutre qui peut tout aussi bien être utilisé au bénéfice de la classe exploitée que pour défendre les privilèges des exploiteurs. Bien des combats théoriques menés par Marx et Engels vis-à-vis du parti allemand avaient pour but de démolir l'idée d'un « Etat populaire », en montrant que l’Etat, comme produit spécifique de la société de classe, est par essence un instrument de la domination d'une classe sur la société et sur la classe exploitée en particulier. Mais, comme nous l'avons vu, en 1917 l'idéologie de l’Etat comme instrument neutre que les ouvriers pouvaient s'approprier, avait pris un habit « marxiste », en particulier entre les mains des kautskystes. C'est pourquoi L'Etat et la révolution commence et finit par une attaque contre la distorsion opportuniste du marxisme; au début, par un passage célèbre à juste titre : « C'est sur cette façon d"accommoder" le marxisme que se rejoignent aujourd'hui la bourgeoisie et les opportunistes du mouvement ouvrier. On oublie, on refoule, on altère le côté révolutionnaire de la doctrine, son âme révolutionnaire. On met au premier plan, on exalte ce qui est ou parait être acceptable pour la bourgeoisie... Devant cette situation, devant cette diffusion inouïe des déformations du marxisme, notre tâche est tout d'abord de rétablir la doctrine de Marx sur l'Etat. » ([3] [2945])
A cette fin, Lénine procède en rappelant le travail des fondateurs du marxisme, d'Engels en particulier, en ce qui concerne les origines historiques de l’Etat. Mais bien que Lénine parle de son travail comme d'une excavation sous les décombres de l'opportunisme, sa recherche a plus qu'un intérêt archéologique. D’Engels (L'origine de la famille, de la propriété privée et de l’Etat), nous apprenons que l’Etat surgit comme produit des antagonismes de classe irréconciliables et sert à empêcher ces antagonismes de faire exploser la fabrique sociale. Mais de peur qu'on en conclue que l’Etat serait une sorte d'arbitre social, Lénine, à la suite d’Engels, a tôt fait d'ajouter que lorsque l'Etat maintient la cohésion, il le fait dans l'intérêt de la classe économiquement dominante. II apparaît donc comme un organe de répression et d'exploitation par excellence.
Dans le feu de la révolution russe, cette question « théorique » était d'une importance gigantesque. Les mencheviks et les SR opportunistes qui agissaient maintenant de plus en plus comme aile gauche de la bourgeoisie, présentaient l’Etat qui a succédé à la chute du Tsar en février 1917 comme une sorte d' « Etat populaire », comme une expression de la « démocratie révolutionnaire ». Les ouvriers devaient donc subordonner leurs intérêts de classe égoïstes à la défense de cet Etat qui, avec un peu de persuasion, pourrait sûrement s'adapter aux besoins de tous les opprimés. En démolissant les fondements de l'idée d'un « Etat neutre », Lénine préparait le terrain pour le renversement pratique de cet Etat. Pour étayer ses arguments contre les soi-disant « démocrates révolutionnaires», Lénine rappelle les paroles lourdes de sens d’Engels sur les limites du suffrage universel. «Il faut noter encore qu'Engels est tout à fait catégorique lorsqu'il qualifie le suffrage universel d'instrument de domination de la bourgeoisie. Le suffrage universel, dit-il, tenant manifestement compte de la longue expérience de la social-démocratie allemande, est : "... l'indice qui permet de mesurer la maturité de la classe ouvrière. Il ne peut être rien de plus, il ne sera jamais rien de plus dans l’Etat actuel. "
Les démocrates petit-bourgeois tels que nos socialistes-révolutionnaires et nos mencheviks... attendent précisément quelque chose "de plus" du suffrage universel. Ils partagent eux-mêmes et inculquent au peuple cette idée fausse que le suffrage universel, "dans l’Etat actuel", est capable de traduire réellement la volonté de la majorité des travailleurs et d'en assurer l'accomplissement. » ([4] [2946])
Ce rappel de la nature bourgeoise de la version la plus «démocratique» dans « l’Etat actuel » était vital en 1917, au moment où Lénine appelle à une forme de pouvoir révolutionnaire qui puisse réellement exprimer les besoins de la classe ouvrière. Mais au cours de ce siècle, les révolutionnaires ont dû faire le même rappel. Les héritiers les plus directs des réformistes social-démocrates, les partis travaillistes et socialistes d'aujourd'hui, ont construit l'ensemble de leur programme (en défense du capital) sur l'idée d'un Etat neutre, bénévole qui, en s'emparant des principales industries et des services sociaux, prendrait un caractère «public » ou même « socialiste ». Mais cette imposture est également ardemment colportée par ceux qui se disent être les héritiers de Lénine, les staliniens et les trotskistes qui n'ont jamais cessé de défendre l'idée que les nationalisations et les services de l’Etat providence seraient des conquêtes ouvrières et constitueraient autant d'étapes vers le socialisme, même dans « l’Etat actuel ». Ces soi-disant « léninistes » sont parmi les adversaires les plus acharnés de la « substance révolutionnaire » du travail de Lénine.
L'évolution de la théorie marxiste de l'Etat
Puisque l’Etat est un instrument de la domination de classe, un organe de violence dirigé contre la classe exploitée, le prolétariat ne peut pas compter sur lui pour défendre ses intérêts immédiats ni l'utiliser comme instrument de construction du socialisme. Lénine montre comment le concept marxiste de dépérissement de l’Etat a été distordu par l'opportunisme pour justifier l'idée que la nouvelle société pouvait naître graduellement, harmonieusement, au moyen de l’Etat existant qui se démocratiserait et s'approprierait les moyens de production, « dépérissant » au fur et à mesure que les bases matérielles du communisme s'établiraient. Retournant à nouveau à Engels, Lénine insiste sur le fait que ce qui « dépérit » n'est pas l’Etat bourgeois existant, mais l’Etat qui surgit de la révolution prolétarienne laquelle est nécessairement une révolution violente ayant pour tâche de «détruire » le vieil Etat bourgeois. Evidemment, Engels et Lénine rejettent tous deux l'idée anarchiste selon laquelle l’Etat peut simplement être aboli en une nuit: en tant que produit de la société de classe, la disparition finale de toute forme d’Etat ne peut avoir lieu qu'après une période plus ou moins longue de transition. Mais l’Etat de la période de transition n'est pas l'ancien Etat bourgeois. Celui-ci gît désormais en ruine, et ce qui prend sa place est une nouvelle forme d’Etat, un demi-Etat qui permet au prolétariat d'exercer sa domination sur la société, mais qui est déjà en processus « d'extinction ». Pour renforcer et approfondir cette position fondamentale du marxisme, Lénine continue en examinant l'expérience historique réelle de « l’Etat et la révolution » et le développement de la théorie marxiste en lien avec cette expérience. C'est ce que Pannekcek, malgré toutes ses capacités, a négligé de faire, se trouvant ainsi plus vulnérable face à l'accusation opportuniste d'« anarchisme».
Le point de départ de Lénine est constitué par les débuts du mouvement marxiste, c'est à-dire la période qui précède juste les révolutions de 1848. Ayant relu Le Manifeste Communiste et Misère de la philosophie, Lénine développe que dans ces livres les éléments clé par rapport à l’Etat sont :
- la nécessité pour le prolétariat de prendre le pouvoir politique, de se constituer en classe dominante, un acte qui est généralement décrit comme le résultat d'une «guerre civile plus ou moins larvée » et du « renversement violent de labourgeoisie « (Le Manifeste Communiste) ;
- l’Etat formé dans la révolution pour supprimer la bourgeoisie ouvrira le chemin d'une association sans classe dans laquelle il n'y aura plus besoin de pouvoir politique.
Concernant la nature de ce « renversement violent », du rapport exact entre le prolétariat révolutionnaire et l’Etat bourgeois existant, il n'était évidemment pas possible d'être précis étant donnée l'absence d'expérience historique concrète. Cependant, Lénine souligne que « si le prolétariat a besoin de l’Etat en tant qu'organisation spéciale de la violence contre la bourgeoisie, une question s'impose : une telle organisation est-elle concevable sans que soit au préalable détruite, démolie, la machine d'Etat que la bourgeoisie a créée pour elle-même? C'est à cette question que nous amène le Manifeste communiste et c'est d'elle que parle Marx quand il résume l'expérience de la révolution de 18481851. »([5] [2947])
Ensuite, Lénine continue en citant un passage clé du 18 Brumaire de Louis Bonaparte dans lequel Marx dénonce l’Etat comme un « effroyable corps parasite » et où il souligne qu'avant la révolution prolétarienne, «toutes les révolutions politiques n'ont fait que perfectionner cette machine au lieu de la briser. » ([6] [2948])
Comme nous l'avons mentionné dans notre article de la Revue Internationale n° 73, les révolutions de 1848, tout en posant pour la première fois la question de « détruire » 1’Etat, ont permis également à Marx d'avoir quelques aperçus sur la façon dont, au cours de la lutte, le prolétariat forme ses propres comités indépendants, de nouveaux organes de l'autorité révolutionnaire. Mais le contenu prolétarien des mouvements de 1848 était trop faible, trop immature pour répondre à la question: « Qu'est ce qui remplacera le vieil appareil d’Etat bourgeois? » Lénine continue donc sur la seule expérience précédente de prise de pouvoir par le prolétariat, la Commune de 1871. Il trace, très en détails, les principales leçons que Marx et Engels ont tirées de la Commune:
- D'abord et avant tout, comme l'expriment Marx et Engels dans leur introduction de 1872 au Manifeste communiste: «La Commune a notamment démontré que la classe ouvrière ne peut pas se contenter de prendre la machine de 1 ‘Etat toute prête et de la faire fonctionner pour son propre compte. » ([7] [2949]) Le mouvement révolutionnaire doit détruire l’Etat bourgeois existant et le remplacer par de nouveaux organes de pouvoir. Dans le bilan de la révolution de 1848, ce point de vue apparaît comme un éclair lumineux de compréhension. Dans leur analyse de la Commune de Paris, c'était devenu un principe programmatique. Pour Marx et Engels en 1872, une telle leçon était assez significative pour mériter une rectification du Manifeste Communiste.
- La Commune était la forme spécifique de ce « demi-Etat » révolutionnaire, une nouvelle forme de pouvoir politique qui était déjà dans un processus de dépérissement.
Ses caractéristiques les plus importantes étaient :
- L'abolition de l'armée permanente et l'armement du peuple. Sa suppression était nécessaire, mais elle devait être faite par la majorité contre l'ancienne minorité exploiteuse.
- Empêcher la montée d'une nouvelle bureaucratie, les fonctionnaires devant être élus et pouvant être révoqués immédiatement. Aucun fonctionnaire de l’Etat ne pouvait être payé d'un salaire supérieur à la moyenne du salaire ouvrier. Les masses devaient superviser les fonctions étatiques et y participer de façon constante à travers la démocratie directe.
- Dépasser le parlementarisme bourgeois, d'une part en remplaçant les représentants (des députés élus pour quatre ou cinq ans par des circonscriptions électorales amorphes) par des délégués (les députés à la Commune pouvaient être révoqués à tout moment par des assemblées mobilisées en permanence), et d'autre part par la fusion de l'exécutif et du législatif en un seul corps. Ici encore, Lénine a appliqué les leçons du passé aux luttes du présent : la critique du parlementarisme bourgeois, la défense d’une forme supérieure de démocratie directe constituaient aussi un point de polémique aiguisée contre les « parlementaires socialistes » de son époque, contre les opportunistes qui voulaient attacher les ouvriers à la défense de l’Etat existant.
- La Commune est une forme d'organisation centralisée. Contrairement à la vision anarchiste qui regarde en arrière et qui se revendique du modèle de la Commune, celle-ci ne défendait pas la dispersion de l'autorité en unités fédérales ou locales. Tout en permettant la plus grande initiative locale possible, la Commune était- la forme qui cimentait l'unité du prolétariat au niveau national et international.
Lénine n'a pas pu faire son tour d'horizon de l'histoire au-delà de l'expérience de la Commune. A l'origine, il avait l'intention d’écrire un septième chapitre de L’Etat et la révolution : « Nous verrons plus loin que les révolutions russes de 1905 et de 1917, dans un cadre différent, dans d'autres conditions, continuent l'œuvre de la Commune et confirment la géniale analyse historique de Marx. » ([8] [2950]) Mais l'accélération de l'histoire l’a privé de cette opportunité. « Je n'ai pas eu le temps d'écrire une seule ligne de ce chapitre, j'ai été "interrompu" par une crise politique, la veille de la révolution d'Octobre 1917. Une telle "interruption" ne pouvait qu'être la bienvenue ; mais la rédaction de la deuxième partie de la brochure (L'expérience des révolutions russe de 1905 et 1917) devra probablement être repoussée pour longtemps. II est plus agréable et plus utile de passer par "l'expérience de la révolution" que d'écrire à son sujet. » ([9] [2951])
En fait, la seconde partie ne fut jamais rédigée. Il est sûr que le septième chapitre aurait eu une immense valeur. Mais Lénine avait achevé l'essentiel. La réaffirmation des enseignements de Marx et Engels sur la question de l’Etat constituait une base suffisante pour un programme révolutionnaire dans la mesure où la question primordiale était la nécessité de détruire l’Etat bourgeois et d’établir la dictature du prolétariat. Mais de toutes façons, le travail de Lénine, comme nous l'avons déjà dit, ne fut jamais une simple répétition. En revenant au passé en profondeur et dans un but militant, les marxistes font aussi avancer leur vision théorique. De cette façon L'Etat et la révolution a permis deux importantes clarifications pour le programme communiste. D'abord, il a identifié les soviets comme successeurs naturels de la Commune même si ces organes ne sont mentionnés qu'en passant. Lénine n'a pas pu analyser en profondeur pourquoi les soviets constituaient une forme supérieure d'organisation révolutionnaire par rapport à la Commune. Peut-être aurait-il pu faire des développements à partir du point de vue de Trotsky, dans ses écrits sur 1905, où ce dernier souligne en particulier que les soviets de députés ouvriers, étant basés sur les assemblées sur les lieux de travail, sont une forme d'organisation mieux adaptée pour assurer l'autonomie de classe du prolétariat (la Commune était basée sur des unités territoriales et non de travail, reflétant une phase moins développée de la concentration prolétarienne). En effet, des écrits ultérieurs de Lénine montrent que c'était la compréhension à laquelle il était parvenu ({C}[10]{C} [2952]). Mais même si Lénine n'a pas pu examiner plus en détail les soviets dans L Etat et la révolution, il ne fait aucun doute qu'il les considérait comme les organes les plus appropriés pour détruire l’Etat bourgeois et former la dictature du prolétariat. A partir des Thèses d'avril, le slogan « Tout le pouvoir aux soviets » était avant tout celui de Lénine et du parti bolchevik reformé.
Deuxièmement, Lénine a été capable de faire de claires généralisations sur le problème de l’Etat et de sa destruction révolutionnaire. Dans la partie de son ouvrage qui traite des révolutions de 1848, Lénine avait posé la question: « on se demandera peut-être s'il est juste de généraliser l'expérience, les observations et les conclusions de Marx, et de les appliquer au-delà des limites de l'histoire de France de ces trois années : 1848-1851 ? s ([11] [2953])
La formule « concentration de toutes les forces » de la révolution prolétarienne sur la « destruction » de l'appareil d’Etat était-elle valable dans tous les pays ? La question avait toujours une importance extrême en 1917 parce que, malgré les leçons que Marx et Engels avaient tirées de la Commune de Paris, ils avaient quand même laissé beaucoup de place à l'ambiguïté sur la possibilité que le prolétariat gagne pacifiquement à travers le processus électoral dans certains pays, ceux qui avaient les institutions parlementaires les plus développées et l'appareil militaire le moins important. Comme Lénine le souligne, Marx mentionnait en particulier la Grande Bretagne mais aussi des pays tels que les Etats-Unis et la Hollande. Cependant, là-dessus, Lénine n'a pas eu peur de corriger Marx et d’aller au bout de sa pensée. Il l’a fait en utilisant la méthode de Marx, plaçant la question dans le contexte historique adapté. « Plus particulièrement, l'impérialisme - époque du capital bancaire, époque des gigantesques monopoles capitalistes, époque où le capitalisme monopoliste se transforme par voie de croissance en capitalisme monopoliste d'Etat- montre le renforcement extraordinaire de la "machine d’Etat", l'extension inouïe de son appareil bureaucratique et militaire en liaison avec une répression accrue du prolétariat, aussi bien dans les pays monarchiques que dans les républiques les plus libres. s ([12] [2954])
Et le résultat, c'est que: «Aujourd'hui, en 1917, à l'époque de la première grande guerre impérialiste, cette restriction de Marx ne joue plus. L’Angleterre comme l’Amérique, les plus grands et les derniers représentants de la "liberté" anglo-saxonne dans le monde entier (absence de militarisme et de bureaucratisme) ont glissé entièrement dans le marais européen, fangeux et sanglant, des institutions militaires et bureaucratiques qui se subordonnent tout et écrasent tout de leur poids. Maintenant, en Angleterre comme en Amérique, "la condition première de toute révolution populaire réelle", c'est la démolition, la destruction de la "machine de 1’ Etat toute prête". » ([13] [2955])
De ce fait, il ne devait plus y avoir d'exception.
La réfutation de l'anarchisme
La cible principale de L’Etat et la révolution était l'opportunisme qui, comme on l’a vu, n'a pas hésité à accuser Lénine d’anarchisme lorsque celui-ci s'est mis à insister sur la nécessité de détruire l'appareil d’Etat. Mais, comme Lénine l’a rétorqué, « la critique de l'anarchisme se réduit habituellement, pour les social-démocrates actuels, à cette pure banalité petite-bourgeoise : "Nous admettons 1’Etat, les anarchistes non!"... » ([14] [2956])
Tout en démolissant de telles stupidités, Lénine rappelle la véritable critique marxiste de l'anarchisme, en se basant en particulier sur ce qu'Engels disait pour répondre aux absurdités des « antiautoritaires » : une révolution est justement la chose la plus autoritaire qui puisse être. Rejeter toute autorité, toute utilisation du pouvoir politique, c'est renoncer à la révolution. Lénine fait soigneusement la distinction entre la position marxiste qui offre une solution historique réalisable au problème de la subordination, des divisions entre dirigeants et dirigés, entre Etat et société, et celle de l'anarchisme qui ne propose que les rêves apocalyptiques d'une dissolution immédiate de tous ces problèmes ; rêves qui ont, en fin de compte, le résultat le plus conservateur:
« Nous ne sommes pas des utopistes. Nous ne "rêvons "pas de nous passer d'emblée de toute administration, de toute subordination ; ces rêves anarchistes, fondés sur l'incompréhension des tâches qui incombent à la dictature du prolétariat, sont foncièrement étrangers au marxisme et ne servent en réalité qu'à différer la révolution socialiste jusqu'au jour où les hommes auront changé. Nous, nous voulons la révolution socialiste avec les hommes tels qu'ils sont aujourd'hui, et qui ne se passeront pas de subordination, de contrôle, de "surveillants et de comptables".
Mais c'est au prolétariat, avant-garde armée de tous les exploités et de tous les travailleurs, qu'il faut se subordonner. » ([15] [2957])
La base économique du dépérissement de l'Etat
Contrairement aux anarchistes qui voulaient que l'extinction de l’Etat soit le résultat d'un acte de volonté révolutionnaire, le marxisme reconnaît qu'une société sans Etat ne peut émerger que lorsque les racines économiques et sociales des divisions de classe ont été arrachées et que la voie vers l'éclosion d'une société d'abondance matérielle est ouverte. En soulignant la base économique du dépérissement de l’Etat, Lénine revient une fois de plus aux classiques, en particulier à la Critique du programme de Gotha de Marx d'où il tire les points suivants:
- la nécessité d'une période de transition durant laquelle le prolétariat exerce sa dictature tout en amenant, en même temps, la vaste majorité de la population à la direction politique et économique de la société.
- économiquement parlant, cette phase de transition peut être décrite comme la phase inférieure du communisme. C'est la société communiste telle qu'elle émerge du capitalisme, encore sévèrement marquée par bien des défauts de l'ordre ancien. Les forces productives sont devenues propriété commune mais les conditions de l'abondance matérielle n'existent pas encore. En conséquence, il y a encore inégalité dans la distribution. Le système des bons du travail défendu par Marx entame l’accumulation du capital, mais il reflète une situation d'inégalité, puisque certains peuvent plus travailler que d'autres, certains ont des qualifications que d'autres n'ont pas, certains ont des enfants, d'autres non, etc. En somme, il existe ce que Marx appelle le «droit bourgeois» en matière de distribution ; et pour protéger le droit bourgeois, il doit encore exister des vestiges de « loi bourgeoise ».
- le développement des forces productives permet de dépasser la division du travail et d'instaurer un système de libre distribution : «De chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins ». C'est la phase supérieure du communisme, une société de vraie liberté. L’Etat n'a désormais plus de raison d'être et dépérit ; l'extension radicale de la démocratie amène à l'extinction finale de la démocratie réelle, puisque la démocratie elle-même est une forme d’Etat. L'administration des gens est remplacée par l'administration des choses. Ce n'est pas une utopie. Même à un tel stade, pour une période indéterminée, les excès individuels peuvent continuer et devront être empêchés. « Mais, tout d'abord, point n'est besoin pour cela d'une machine spéciale, d'un appareil spécial de répression,- le peuple armé se chargera lui-même de cette besogne, aussi simplement, aussi facilement qu'une foule quelconque d'hommes civilisés, même dans la société actuelle, sépare des gens qui se battent ou ne permet pas qu'on rudoie une femme. » ({C}[16]{C} [2958]) Bref, « ...la nécessité d'observer les règles, simples mais essentielles, de toute société humaine deviendra très vite une habitude »([17] [2959])
Lorsque Lénine écrivait L'Etat et la révolution, le monde était au bord d'une révolution communiste. La défense des positions de Marx sur les transformations économiques n'était pas une abstraction. Elle se présentait comme une nécessité programmatique imminente. La classe ouvrière était poussée à la confrontation révolutionnaire par des besoins immédiats et brûlants : le besoin de pain et celui d'en finir avec le massacre impérialiste, etc. Mais l'avant-garde communiste ne doutait pas que la révolution puisse s'arrêter à la solution de ces questions immédiates. Celle-ci devrait aller jusqu'à sa conclusion historique ultime: l'inauguration d'une nouvelle phase de l’histoire de l'humanité.
Les limites de la vision de Lénine
Nous avons déjà signalé que L'Etat et la révolution est un travail incomplet. En particulier, Lénine n'a pas pu faire de développements sur le rôle des soviets comme « la forme enfin trouvée de la dictature du prolétariat ». Mais même si son œuvre n'avait pas été « interrompue » par l'insurrection d'octobre, elle ne pouvait exprimer que le plus haut point de clarté atteint avant l'expérience de la révolution. La révolution russe elle-même (et par dessus tout sa défaite) devait apporter beaucoup de leçons sur les problèmes de la période de transition; aussi nous ne pouvons reprocher à Lénine de n'avoir pas résolu ces questions avant que l'expérience réelle du prolétariat ne les pose. Nous reviendrons sur ces questions dans d'autres articles et sous différents angles mais il est utile d'esquisser les trois domaines principaux dans lesquels l'expérience qui a suivi devait révéler les inévitables faiblesses et lacunes de L'Etat et la révolution.
L'Etat et l'économie
Bien que Lénine ait clairement défendu la notion d'une transformation communiste de l'économie - notion que Marx a développée en opposition aux tendances « socialistes d’Etat » dans le mouvement ouvrier ([18] [2960]) son travail souffre encore de certaines ambiguïtés sur le rôle de l’Etat durant la transition économique. Nous avons vu que ces ambiguïtés existaient aussi dans le travail de Marx et Engels. Mais durant la période de la 2e Internationale, on pensait de plus en plus que la première étape sur la voie du communisme était l'étatisation de l'économie nationale, qu'une économie complètement nationalisée ne pouvait plus être une économie capitaliste. Dans plusieurs de ses écrits de l'époque, tout en dénonçant les « trusts capitalistes d’Etat » qui étaient devenus la forme de l'organisation capitaliste dans la guerre impérialiste, Lénine avait tendance à considérer ces trusts comme des instruments neutres, comme une sorte de marchepied vers le socialisme, comme une forme de centralisation économique dont le prolétariat victorieux pourrait simplement s'emparer en bloc. Dans un travail rédigé en septembre 1917, « Les bolcheviks garderont-ils le pouvoir ? », Lénine est plus explicite :
« Le capitalisme a créé des appareils de contrôle sous forme de banques, de cartels, service postal, coopératives de consommation, associations d'employés. Sans les grandes banques, le socialisme serait irréalisable.
Les grandes banques constituent 1"'appareil d'Etat" dont nous avons besoin pour réaliser le socialisme et que nous prenons tout prêt au capitalisme.. » ([19] [2961])
Dans L'Etat et la révolution, Lénine exprime une idée similaire quand il écrit:
« Tous les citoyens deviennent les employés et les ouvriers d'un seul "cartel" du peuple entier, de Mat. » ([20] [2962])
II est évidemment juste que la transformation communiste ne commence pas de zéro - son point de départ inévitable est constitué par les forces productives existantes, les réseaux de transport, de distribution existants, etc. Mais 1’histoire nous a enseigné qu'il fallait être extrêmement prudent vis-à-vis de l’idée de simplement s'emparer des organismes et des institutions économiques créés par le capital pour ses besoins propres, surtout quand ils sont des archétypes d'institutions tels que les grandes banques. Plus important encore, la révolution russe et, en particulier, la contre-révolution stalinienne ont montré que la simple transformation de l'appareil productif en une propriété d’Etat ne supprime pas l'exploitation de l'homme par 1’homme. C'est une erreur qui est nettement présente dans l’Etat et la révolution lorsque Lénine écrit que dans la première phase du communisme, « ... l'exploitation de l'homme par l'homme sera impossible, car on ne pourra s'emparer, à titre de propriété privée, des moyens de production, fabriques, machines, terre, etc. » ([21] [2963])
Cette faiblesse est aggravée par l'insistance de Lénine sur le fait qu'il y a une «distinction scientifique» à faire entre le socialisme et le communisme (le premier étant défini comme la phase inférieure du communisme). En fait, Marx et Engels n'ont pas véritablement théorisé une telle distinction, et ce n'est pas par hasard si, dans la Critique du programme de Gotha, Marx parle des phases inférieure et supérieure du communisme, car il voulait transmettre l'idée d'un mouvement dynamique entre le capitalisme et le communisme, non celle d'un « troisième» mode de production fixe défini par « la propriété publique». Pour finir et de façon plus significative, quand Lénine parle de la transition économique dans L’Etat et la révolution, il n'est pas explicite sur le fait que la dynamique vers le communisme ne peut se développer qu'à l'échelle internationale ; cela ouvre la porte à l'idée qu'au moins certaines étapes de la « construction socialiste » pourraient être réalisées dans un seul pays.
La tragédie de la révolution russe constitue un parfait témoignage du fait que même si on étatise l'ensemble de l'économie, même si on a le monopole du commerce extérieur, les lois du capital global continuent de s'imposer sur un bastion prolétarien isolé. En l'absence d'extension de la révolution mondiale, ces lois défieront toute tentative de jeter les fondements d'une quelconque « construction socialiste », transformant même l'ancien bastion du prolétariat en un nouveau et monstrueux « trust capitaliste d’Etat » en compétition sur le marché mondial. Une telle mutation ne peut que s'accompagner d'une contre-révolution politique ne laissant aucune trace de la dictature du prolétariat.
Parti et pouvoir
On a noté que Lénine ne disait pas grand chose du rôle du parti dans L'Etat et la révolution. Est-ce une preuve supplémentaire de la conversion temporaire de Lénine à l'anarchisme en 1917 ? Question idiote! La clarification théorique contenue dans l’Etat et la révolution constitue elle-même une préparation du parti bolchevik à son rôle de dirigeant direct dans l'insurrection d'octobre. Par sa rude polémique contre ceux qui injectent l'idéologie bourgeoise dans le prolétariat, c'est avant tout un document politique « de parti » ayant pour but d'éloigner les ouvriers de ces influences et de les gagner aux positions du parti révolutionnaire.
Cependant, la question subsiste: à la veille de la vague révolutionnaire mondiale, comment les révolutionnaires (et pas seulement les bolcheviks) envisagent-ils le rapport entre le parti et la dictature du prolétariat ? L'unique référence au parti dans L'Etat et la révolution ne nous donne pas de réponse claire puisqu'elle est formulée de façon ambiguë : « En éduquant le parti ouvrier, le marxisme éduque une avant-garde du prolétariat capable de prendre le pouvoir et de mener le peuple tout entier au socialisme, de diriger et d'organiser un régime nouveau, d'être l'éducateur, le guide et le chef de tous les travailleurs et exploités pour l'organisation de leur vie sociale, sans la bourgeoisie et contre la bourgeoisie. » ([22] [2964])
C'est ambigu parce qu'on ne sait pas si c'est le parti comme tel qui assume le pouvoir ou si c'est le prolétariat que Lénine définit souvent comme l'avant-garde de toute la population opprimée. La brochure « Les bolcheviks garderont-ils le pouvoir ? » est un meilleur guide pour appréhender le niveau de compréhension de la question. Dès le titre, on voit la confusion principale : les révolutionnaires de l'époque, malgré leur engagement envers le système de délégation des soviets qui avait rendu obsolète le vieux système de représentation parlementaire, étaient encore tirés en arrière par l'idéologie parlementaire au point qu'ils considéraient que c'était le parti ayant la majorité dans les soviets centraux, qui devait former le gouvernement et administrer l’Etat. Dans des articles ultérieurs, nous examinerons plus en détail comment cette conception a mené à un enchevêtrement fatal du parti avec l’Etat et créé une situation insupportable qui a vidé les soviets de leur vie prolétarienne, dressé le parti contre la classe et, surtout, transformé le parti, de fraction la plus radicale de la classe révolutionnaire en un instrument de conservation sociale.
Mais cette évolution n'a pas eu lieu de façon autonome. Elle a, avant tout, été déterminée par l'isolement de la révolution et le développement matériel d'une contre-révolution interne. En 1917, l'insistance dans tous les écrits de Lénine, que ce soit dans la brochure qu'on vient de mentionner ou dans L'Etat et la révolution, ne porte pas sur l'exercice de la dictature par le parti mais par l'ensemble du prolétariat (et de façon croissante par l'ensemble de la population) qui prend en charge ses affaires économiques et politiques, à travers sa propre expérience pratique, ses propres débats, ses propres organisations de masse. Aussi, lorsque Lénine répond par l’affirmative à la question: les bolcheviks garderont le pouvoir d’Etat ? c'est seulement parce qu'il s'appuie sur l'idée que quelques centaines de milliers de bolcheviks feront partie d'un effort bien plus grand, l'effort de millions d'ouvriers et de paysans pauvres qui, dès le premier jour, apprendront à diriger l’Etat en leur nom. Donc, le vrai pouvoir n'est pas aux mains du parti mais des masses. Si les premiers espoirs de la révolution avaient été réalisés, si la Russie n'avait pas sombré dans la guerre civile, la famine et le blocus international, les contradictions évidentes de cette position auraient pu être résolues dans la bonne direction, démontrant que dans un système authentique de délégués élus et révocables, cela n'a aucun sens de parler d'un parti qui détient le pouvoir.
Classe et Etat
Dans la Critique du programme de Gotha, Marx décrit l’Etat de transition comme «rien d'autre que la dictature du prolétariat ». Lénine reprend cette identification entre le pouvoir de la classe ouvrière et l’Etat de transition dans L’Etat et la révolution lorsqu'il parle d'un « Etat prolétarien » ou d'un « Etat des ouvriers en armes » et qu'il souligne théoriquement ces formulations en définissant l’Etat comme étant essentiellement composé de « corps d'hommes armés ». Bref, dans la période de transition, l’Etat ne représente pas plus que les ouvriers en armes, évinçant la bourgeoisie.
Comme on le verra dans de prochains articles, cette formulation s'est rapidement avérée inadéquate. Lénine lui-même a dit que le prolétariat avait besoin de l’Etat, non seulement pour supprimer la résistance des exploiteurs, mais aussi pour mener le reste de la population non exploiteuse dans la direction socialiste. Et cette dernière fonction, la nécessité d'intégrer la population largement paysanne dans le processus révolutionnaire, donna naissance à un Etat qui n'était pas seulement constitué des délégués ouvriers des soviets, mais aussi des soviets de soldats et de paysans. Avec l'ouverture de la guerre civile, les milices ouvrières armées, les Gardes rouges, n'étaient pas une force adéquate pour combattre la puissance de la contre-révolution. La principale force armée de l’Etat soviétique était désormais l’Armée rouge, elle aussi formée dans sa majorité de paysans. En même temps, la nécessité de combattre la subversion et le sabotage internes donna naissance à la Tchéka, force de police spéciale qui a de plus en plus échappé au contrôle des soviets. Dans les semaines de l'insurrection d'octobre, l’Etat-Commune était devenu quelque chose de plus que « les ouvriers en armes ». Par dessus tout, avec l'isolement croissant de la révolution, le nouvel Etat était de plus en plus infesté par la gangrène de la bureaucratie, répondant de moins en moins aux organes élus par le prolétariat et les paysans pauvres. Loin de commencer à dépérir, le nouvel Etat était en train d'envahir toute la société. Loin de se plier à la volonté de la classe révolutionnaire, il est devenu le point central d'une sorte de dégénérescence et de contre-révolution internes qu'on n'avait jamais vues auparavant.
Dans son bilan de la contre-révolution, la Gauche communiste italienne devait porter une attention particulière au problème de l’Etat de transition ; l’une des conclusions principales à laquelle sont parvenus Bilan et Internationalisme à la suite de la révolution russe, c'est qu'il n'était plus possible d'identifier la dictature du prolétariat avec l’Etat de transition. Nous reviendrons sur cette question dans d'autres articles. Pour le moment cependant, il est important de souligner que même si les formulations du mouvement marxiste avant la révolution russe souffraient de sérieuses faiblesses sur cette question, en même temps, cette idée de non identification entre le prolétariat et l’Etat de transition n'est pas tombée du ciel. Lénine était tout à fait conscient de la définition d'Engels sur l’Etat de transition comme n'étant rien d'autre qu'un « mal nécessaire ». Et dans son livre, il y a une forte insistance sur la nécessité que les ouvriers soumettent tous les fonctionnaires d’Etat à une supervision et à un contrôle constant, en particulier les éléments de l’Etat qui incarnent avec le plus d'évidence une certaine continuité avec l'ancien régime, tels les «experts » techniques et militaires que les soviets seront forcés d'utiliser.
Lénine développe aussi un fondement théorique pour cette attitude de méfiance saine du prolétariat envers le nouvel Etat. Dans la partie sur la transformation économique, il explique que, comme son rôle sera de sauvegarder la situation de « droit bourgeois », on peut définir 1’Etat de transition comme « l’Etat bourgeois, sans la bourgeoisie ! » Même si cette formulation représente plus une provocation et un appel à la réflexion qu'une claire définition de la nature de classe de l’Etat de transition, Lénine a saisi l'essentiel : puisque la tâche de 1’Etat est de sauvegarder un état de choses qui n'est pas encore communiste, 1’Etat-Commune révèle sa nature fondamentalement conservatrice et c'est ce qui le rend particulièrement vulnérable à la dynamique de la contre-révolution. Ces perceptions théoriques sur la nature de l’Etat devaient permettre à Lénine de développer certains points de vue importants sur la nature du processus de dégénérescence, même lorsque lui-même était partiellement pris dedans. Par exemple, sa position sur les syndicats dans le débat de 1921 quand il reconnaît la nécessité pour les ouvriers de maintenir des organes de défense même contre l’Etat de transition, ou ses avertissements sur la croissance de la bureaucratie d’Etat vers la fin de sa vie. Le parti bolchevik a pu succomber à une mort insidieuse, mais les fractions communistes de gauche se devaient de reprendre le flambeau de la clarification. Cependant, il ne fait aucun doute que les développements théoriques les plus importants qu'ont effectués ces dernières, ont pu être réalisés en prenant comme point de départ l'immense contribution de Lénine dans L'Etat et la révolution.
CDW
[1] [2965] Engels, 15 décembre 1887, traduit de l'anglais par nous.
[2] [2966] « Réponse aux questions d'un correspondant américain », 20 juillet 1919.
[3] [2967] L’Etat et la Révolution, in Oeuvres choisies de Lénine, Editions du Progrès, Moscou 1968, Tome II, chapitre 1, page 291.
[4] [2968] Ibid., page 298.
[5] [2969] Ibid., chapitre 2, page 307.
[6] [2970] 6. Ibid., page 308.
[7] [2971] Ibid., chapitre 3, page 315.
[8] [2972] Ibid., page 331.
[9] [2973] Post-scriptum à la première édition de L Etat et la révolution, traduit de l'anglais par nous.
[10] [2974] Voir en particulier les K Thèses et rapport sur la démocratie bourgeoise et la dictature du prolétariat v, écrites par Lénine et adoptées par l'Internationale communiste à son congrès de fondation en 1919. Parmi d'autres points qui seront examinés dans un prochain article, ce texte affirme que « le pouvoir des soviets, c'est-à-dire la dictature du prolétariat, est organisé de façon à rapprocher les masses laborieuses de l'appareil administratif. Tel est également le but de la réunion de l'exécutif et du législatif dans l'organisation soviétique de I’ Etat, et du remplacement des circonscriptions territoriales par des unités électorales fondées sur l'entreprise: usine, fabrique... » (thèse 16).
[11] [2975] Ibid. note 3, chapitre 2, page 311.
[12] [2976] Ibid., page 312.
[13] [2977] Ibid., chapitre 3, page 316.
[14] [2978] Ibid., chapitre 4, page 336.
[15] [2979] Ibid., chapitre 3, page 325.
[16] [2980] Ibid., chapitre S, page 358.
[17] [2981] Ibid., page 367.
[18] [2982] Lire « Le communisme contre le socialisme d'Etat » dans la Revue Internationale n°79.
[19] [2983] Oeuvres choisies, idem note 3, page 418.
[20] [2984] Idem note 3, chapitre 5, page 366.
[21] [2985] Ibid., page 359.
[22] [2986] Ibid., chapitre 2, page 307.
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Russe [2920]
Approfondir:
Questions théoriques:
- Communisme [492]
Le combat des Gauches dans l'Internationale communiste : la responsabilité des révolutionnaires face à la dégénérescence
- 3483 reads
S'il est un combat, dans le mouvement ouvrier, que les révolutionnaires marxistes dignes de ce nom ont toujours mené jusqu'au bout, même dans les pires conditions, c'est bien celui pour sauver leur organisation, Parti ou Internationale, des griffes de l'opportunisme et pour l'empêcher de sombrer dans la dégénérescence ou, encore pire, de trahir.
C'est cette attitude que Marx et Engels ont eue dans la première Internationale. Elle a été aussi celle des « gauches » de la deuxième Internationale. Rappelons nous combien Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht et les Spartakistes ([1] [2987]) ont mis de temps pour prendre la décision de rompre avec le vieux parti, que ce soit avec la Social-Démocratie allemande ou avec les Indépendants. Le but qu'ils recherchaient était, dans le meilleur des cas, de renverser la direction opportuniste en gagnant à eux la majorité du parti oui dans le pire, c'est-à-dire quand l'espoir d'un redressement n'existait plus, de ne quitter l'organisation qu'en ayant entraîné avec eux le maximum d'éléments sains. Ils se sont battus tant qu'ils estimaient qu'existait encore au sein du parti la plus petite étincelle de vie et qu'ils pouvaient gagner à eux les meilleurs éléments. Cette attitude a toujours été celle des marxistes, la seule méthode utilisée à toutes les époques par les révolutionnaires. De plus, l'expérience historique montre que, le plus souvent, les « gauches » ont lutté, résisté à un tel point que c'est le vieux parti qui les a exclues et non elles qui ont rompu ([2] [2988]). Trotsky par exemple a consacré plus de 6ans de sa vie à combattre au sein du parti bolchevik avant d'en être exclu.
Le combat des « gauches » de la troisième Internationale est, quant à lui, particulièrement éloquent dans la mesure où il a été mené pendant la pire période qu'ait connue le mouvement ouvrier : celle de la plus longue et terrible contre-révolution de l'histoire qui a commencé à la fin des années 1920. Et c'est pourtant dans cette situation contre-révolutionnaire, de recul dramatique du mouvement ouvrier, que les militants de la « gauche » de ÏÏC vont mener un combat mémorable et titanesque. Parmi eux, certains pensaient même que celui-ci était pratiquement perdu d'avance mais cela ne les empêchait pas de continuer car ce n'est ni le courage ni la volonté qui leur faisaient défaut ([3] [2989]). Ainsi, malgré tout, s'il restait encore une toute petite chance de redresser le parti et 1’IC, ils estimaient qu'il était de leur devoir de chercher à sauver ce qu'il était encore possible de sauver des griffes du stalinisme triomphant. Ce combat est aujourd'hui, très souvent, au mieux minimisé et, au pire, totalement oublié par tous ces éléments qui, dès leurs premières divergences, quittent l'organisation à cause de leur « honneur blessé ». Cette attitude est une offense à la classe ouvrière et exprime clairement le mépris des petits bourgeois pour le dur combat de générations d'ouvriers et de révolutionnaires qui y ont trop souvent laissé leur vie, combat que ces petits messieurs jugent peut être peu brillant ou indigne d'eux.
La Gauche italienne n'a pas seulement mis en pratique cette méthode, elle l'a enrichie politiquement et théoriquement. En s'appuyant sur son héritage, le CCI, à de très nombreuses reprises, a développé cette question et notamment il a amplement montré quand et comment un parti trahit ([4] [2990]). Ce sont les positions prises face aux deux événements majeurs que sont la guerre impérialiste et la révolution prolétarienne qui permettent de conclure, de façon irrévocable, si une organisation politique a trahi sa classe ou pas. Tant que cette trahison n'est pas avérée, tant que le parti n'est pas passé avec armes et bagages dans le camp ennemi, le rôle des véritables révolutionnaires est de se battre bec et ongles pour le conserver dans le camp du prolétariat. C'est ce qu'ont fait les « gauches » de 1’IC, et cela dans les conditions les plus dramatiques, celles d'un triomphe absolu de la contre-révolution.
Cette politique est toujours valable aujourd'hui. Et elle est d'autant plus aisée à assumer que nous sommes dans un cours à des affrontements de classes, dans une situation autrement plus favorable pour le combat du prolétariat et pour celui des révolutionnaires. Dans le contexte historique actuel, où la révolution n'est pas encore à l'ordre du jour non plus que la guerre mondiale, les conditions sont beaucoup moins propices à la trahison d'une organisation prolétarienne ([5] [2991]). C'est donc la même méthode que tout révolutionnaire conscient et conséquent se doit, a fortiori, d'appliquer s'il pense que son organisation est en train de dégénérer, ce qui signifie qu'il doit se battre en son sein pour la redresser. D ne s'agit sûrement pas d'adopter une attitude petite bourgeoise qui consiste à se sauver tout seul comme ont tendance à le faire certains « révolutionnaires en chambre », à tendance individualiste et contestataire ou qui baignent dans un esprit estudiantin de soixante-huitards attardés et qui sont aujourd'hui rapidement attirés par les sirènes du parasitisme. C'est pourquoi tous ceux qui quittent précipitamment leur organisation en l'accusant de tous les maux, sans avoir mené le combat en son sein jusqu'au bout, comme l'a fait RV par exemple ([6] [2992]), sont des irresponsables et méritent d'être combattus comme de pauvres petits bourgeois sans principes.
Le long combat des « gauches » de l’IC
La crise du mouvement communiste se manifeste au grand jour au cours de l'année 1923. Quelques faits l'attestent. Après le 3e congrès de 11C, qui révèle le poids grandissant de l'opportunisme, la répression s'abat en Russie sur Kronstadt et des grèves se développent notamment à Petrograd et à Moscou. Parallèlement se crée l'Opposition ouvrière au sein du Parti Communiste russe.
Trotsky exprime le sentiment général quand il affirme : « La cause fondamentale de la crise de la révolution d'octobre réside dans le retard de la révolution mondiale. » ([7] [2993]) Dès cette époque, en effet, le retard de la révolution mondiale pèse sur le mouvement ouvrier dans son ensemble. De surcroît, celui-ci est désorienté par les mesures de capitalisme d'Etat prises en URSS avec la NEP. Les derniers échecs subis par le prolétariat en Allemagne retardent d'autant l'espérance d'une extension de la révolution en Europe.
Le doute commence à travailler les révolutionnaires ; Lénine est du nombre ([8] [2994]). En 1923, la révolution russe est étranglée économiquement par le capitalisme qui domine la planète. Sur ce plan, la situation de l'URSS est catastrophique et le problème posé au sein des instances dirigeantes, à ce moment-là, est le suivant : la NEP doit-elle être intégralement maintenue ou être corrigée par une aide à l'industrie ?
Le début du combat de Trotsky
Trotsky commence son combat ([9] [2995]) au sein du bureau politique (BP) du PCUS où la majorité veut maintenir le statu quo. Il est en désaccord sur la question de la situation économique en Russie et sur la question organisationnelle dans le PCUS. Pour ne pas rompre l'unité du parti, ce désaccord reste interne au sein du BP. Il ne sera rendu public qu'à l'automne 1923, notamment dans son livre Cours nouveau ([10] [2996]).
D'autres manifestations d'opposition vont également s'exprimer à travers :
- Une lettre du 15 octobre 1923 adressée au Comité central du PCUS et signée par 46 personnalités connues, dont des communistes de gauche et de l'opposition (Piatakov, Préobrajenski mais aussi Ossinski, Sapronov, Smirnov, etc.). Ils réclament la convocation d'une conférence spéciale pour prendre des mesures commandées par les circonstances en attendant le congrès ;
- la création du groupe « Centralisme démocratique » avec Sapronov, Smirnov, etc. ;
- la réactivation de « l'Opposition ouvrière » avec Chliapnikov ;
- la création du « Groupe ouvrier » de Miasnikov, de Kuznezov, etc. ([11] [2997])
Parallèlement à ces événements, en février 1923, Bordiga, depuis la prison, porte ses premières graves critiques à l’IC, notamment sur la question du « front unique », dans son « Manifeste à tous les camarades du PCI » et, sur la base de ce désaccord de fond, il demande de pouvoir se démettre de ses fonctions de dirigeant du parti communiste italien (PCI) pour ne pas avoir à défendre des positions qu'il ne partage pas ([12] [2998]).
Pour développer un combat politique plus efficace, Bordiga adopte, comme Trotsky, une attitude de prudence. Et il donne, deux ans plus tard, la clé de sa méthode dans la lettre à Korsch du 26 octobre 1926 : « Zinoviev et surtout Trotsky sont des hommes qui ont un grand sens de la réalité ; ils ont compris qu'il faut encore encaisser des coups sans passer à l'offensive ouverte ». Voilà comment les révolutionnaires agissent : avec patience. Ils sont capables de mener un long combat pour arriver à leurs fins, ils savent encaisser des coups, avancer prudemment et surtout travailler, tirer des leçons pour les combats futurs de la classe ouvrière.
Cette attitude est à mille lieues de celle des « révolutionnaires du dimanche » excités et avides d'on ne sait quel succès immédiat ou encore de celle de notre « révolutionnaire en chambre », RV, seulement intéressé à sauver son « moi ». Il fuit ses responsabilités en ne cessant de se lamenter de ce que le CCI lui aurait fait subir au cours du dernier débat interne auquel il a participé et qui aurait été, selon ses dires, pire que ce que Staline a fait subir à l'opposition de gauche (sic!). Au delà de son caractère calomnieux, cette comparaison serait risible si ce n'était une question très sérieuse. Et personne ne connaissant un tant soi peu l'histoire de l'Opposition et de sa fin tragique, ne croira une telle fable.
La crise de 1925-26
La poursuite du combat de Trotsky et celui de la gauche italienne.
La période qui suit le 5e Congrès de 1’IC est caractérisée par :
- la poursuite de la « bolchévisation » des PC et de ce que l'on a appelé le « cours droitier » de 1’IC. Le but de Staline et de ses sbires était d'éliminer en particulier les directions des partis français et allemand, c'est-à-dire celle de Treint et celle de Ruth Fischer, qui avaient été le fer de lance de Zinoviev au 5e Congrès de l’IC et qui n'étaient pas disposées à faire un tournant adroite.
- la « stabilisation » du capitalisme, ce qui pour la direction de 11C voulait dire qu'il fallait prévoir « une adaptation». Il est dit dans le rapport d'activité politique du Comité central du 14e congrès du PCUS (décembre 1925): «Ce que nous avions pris à un certain moment pour une courte pause s'est transformée en toute une période».
En marge des débats du congrès, l'événement le plus important pour le mouvement ouvrier a été la désintégration, fin 1925, de la troïka Zinoviev, Kamenev, Staline, qui assurait la direction du PCUS et de L'Internationale depuis que Lénine avait été contraint de renoncer à son activité politique. Pourquoi cette désintégration? Son existence était liée au combat contre Trotsky. Quand celui-ci et la première opposition ont été muselés, Staline n'avait plus besoin des « vieux bolcheviks » autour de Zinoviev et de Kamenev pour prendre la direction de l'Etat, du parti russe et de 1’IC. La situation de « stabilisation » lui fournit l'occasion d'un changement de politique.
Zinoviev, tout en se heurtant à Staline sur la politique intérieure soviétique, s'exprime dans le même sens sur la politique mondiale : « La première difficulté réside dans l'ajournement de la révolution mondiale. Au début de la révolution d'octobre, nous étions persuadés que les ouvriers des autres pays viendraient à notre secours dans quelques mois ou, dans le pire des cas, dans quelques années. Aujourd'hui, malheureusement, l'ajournement de la révolution mondiale est un fait établi, il est certain que la stabilisation partielle du capitalisme représente toute une époque et qu'à cette stabilisation correspond tout un complexe nouveau et beaucoup plus grand de difficultés. »
Mais tandis que les directions du parti et de 1’IC reconnaissent cette « stabilisation », elles affirment en même temps que le 5e congrès avait vu juste et que sa politique était correcte. Cependant, elles opèrent un tournant politique sans le dire ouvertement.
Si, à ce moment-là, Trotsky reste silencieux, la « gauche italienne » adopte une attitude plus politique en poursuivant ouvertement le combat. Bordiga soulève la question russe en février 1925 ainsi que la «question Trotsky » dans un article de l'Unité.
La gauche du PCI pour s'opposer à la « bolchévisation » crée le « Comité d'Entente » (mars-avril 1925). Mais, pour ne pas être exclu du parti par la direction de Gramsci, Bordiga ne rejoint pas immédiatement ce comité. C'est seulement en juin qu'il se rallie aux vues de Damen, Fortichiari et Repossi. Ce comité n'est, toutefois, pas encore une véritable fraction, ce n'est qu'un moyen d'organisation. Finalement la « gauche » sera contrainte de dissoudre le Comité d'Entente pour ne pas être exclue du parti alors qu'elle est encore majoritaire en son sein.
En Russie, au printemps 1926, c'est la création de l'Opposition Unifiée autour de la première opposition de Trotsky qui a été rejoint par Zinoviev, Kamenev, Kroupskaïa, pour la préparation du 15e Congrès du PCUS.
La répression stalinienne se renforce et frappe cette fois-ci les nouveaux oppositionnels :
- Sérébriakov, Préobrajenski (13) sont exclus du parti ;
- d'autres sont mis en prison (Miasnikov du Groupe ouvrier) ou en passe de l'être comme Fichelev, le directeur de l'imprimerie nationale ;
-des protagonistes de premier plan de la guerre civile sont chassés de l'armée : Grunstein (directeur de l'école de l'air), l'ukrainien Okhotnikov ;
- un peu partout, dans l'Oural, à Leningrad, à Moscou..., la GPU a décapité les organisations locales de l'Opposition en faisant exclure ses responsables du parti.
Mais, en octobre 1927, Trotsky et Zinoviev sont exclus du Comité central du PCUS.
Après 1927, le combat continue
La capitulation des zinoviévistes n'empêche pas la gauche russe de continuer le combat. Rien n'arrête ces militants qui sont de véritables combattants de la classe ouvrière, ni les brimades, ni les menaces, ni l'exclusion.
«L'exclusion du parti nous enlève nos droits de membres du parti, elle ne peut nous relever des obligations contractées par chacun d'entre nous à son entrée dans le parti communiste. Exclus du parti nous resterons quand même fidèles à son programme, à ses traditions, à son drapeau. Nous continuerons à travailler au renforcement du parti communiste et de son influence sur la classe ouvrière. » ([13] [2999])
C'est une extraordinaire leçon de politique révolutionnaire que nous donne ainsi Rakovsky. Oui, c'est la méthode des marxistes, c'est notre méthode. Les révolutionnaires ne quittent jamais leurs organisations à moins d'en être exclus et même exclus ils continuent le combat pour leur redressement.
Au cours des années qui vont suivre, les oppositionnels vont tout faire pour revenir dans le parti. Ils sont d'ailleurs convaincus que leur exclusion n'est que temporaire.
Mais, très rapidement, en janvier 1928, commencent les déportations. Elles sont d'une extrême rigueur car aucun travail, aucun moyen de subsistance n'est garanti au déporté sur les lieux de résidence obligatoire. Les brimades pleuvent sur la famille qui perd son appartement à Moscou. Ainsi, Trotsky part pour Alma-Ata et 48 heures après, Rakovsky pour Astrakan. Le combat ne s'arrête toujours pas et l'Opposition en exil s'organise.
Bien que de nouveaux coups pleuvent, les oppositionnels et leur représentant le plus éminent, Rakovsky, poursuivent inlassablement le combat malgré les capitulations successives et l'expulsion de Trotsky d'URSS.
Durant cette période, des rumeurs circulent, distillées sournoisement par la GPU, selon lesquelles Staline va enfin appliquer la politique de l'Opposition. Immédiatement, c'est le déclenchement d'un début d'explosion de l'Opposition dans laquelle Radek semble avoir joué un rôle de provocateur ([14] [3000]). Cet épisode connaît la démobilisation des plus faibles ; il permet au pouvoir stalinien de repérer les éléments chancelants et d'évaluer le moment le plus favorable pour les frapper ou les amener à capituler.
Face à ces nouvelles difficultés, Rakovsky rédige une déclaration (août 1929) : « Nous faisons appel au comité central (...) en (lui) demandant de nous faciliter notre rentrée dans le parti, en relaxant les bolcheviks-léninistes (...) en rappelant d'exil L.D. Trotsky (...) Nous sommes entièrement disposés à renoncer aux méthodes fractionnelles de lutte et à nous soumettre aux statuts et à la discipline du parti qui garantissent à chacun de ses membres le droit de défendre ses opinions communistes. »
Cette déclaration n'a aucune chance d'être acceptée par le pouvoir d'abord à cause de la demande qui y est faite pour le retour d'exil de Trotsky, mais aussi parce qu'elle est rédigée de telle façon qu'elle cherche à faire la preuve de la duplicité de Staline et de sa responsabilité dans cette affaire. Elle atteint son but et enraie le vent de panique dans les rangs des oppositionnels. La vague de capitulation est stoppée.
Malgré les embûches, les brimades atroces, les assassinats, le combat de Rakovsky et du centre de l'opposition va se poursuivre, de façon organisée, en Russie jusqu'en février 1934. La plupart d'entre eux continuent encore à résister dans les camps. ([15] [3001])
L'abandon de Rakovsky n'est en aucune manière une capitulation honteuse comme l'a été, par exemple, celle des zinoviévistes. Dans un article de Bilan ([16] [3002]) il est d'ailleurs clairement affirmé : « Le camarade Trotsky (...) a publié une note dans laquelle, après avoir déclaré qu'il ne s'agit pas là d'une capitulation idéologique et politique, il écrit : "Nous avons maintes fois répété que la restauration du PC en URSS ne peut se faire que par la voie internationale. Le cas Rakovsky le confirme d'une manière négative, mais éclatante." Nous nous solidarisons avec l'appréciation (...) au sujet de Rakovsky, car son dernier geste n'a rien à voir avec les honteuses capitulations des Radek, Zinoviev, Kamenev... »
Un combat au niveau international
Le combat se déroule aussi au niveau mondial avec la création de l'opposition de gauche internationale après l'expulsion de Trotsky de l'URSS en 1929.
Au 6« Plénum de 1’IC (février-mars 1926), Bordiga participe pour la dernière fois à une réunion de l'Internationale. Dans son discours, il dit : « Il est désirable qu'il se forme une résistance de gauche ; je ne dis pas une fraction, mais une résistance de gauche sur le terrain international contre de pareils dangers de droite ; mais je dois dire tout à fait ouvertement que cette réaction saine, utile et nécessaire ne peut et ne doit pas se présenter sous l'aspect de la manoeuvre et de l'intrigue, sous la forme de bruits que l'on répand dans les coulisses et dans les couloirs. »
Et à partir de 1927, le combat de la « gauche italienne » (GI) se poursuit dans l'émigration en France et en Belgique. Les militants qui n'ont pu quitter l'Italie se retrouvent en prison ou, comme Bordiga, soumis à la résidence forcée dans les îles. La GI lutte au sein des partis communistes et de l’IC malgré le fait que beaucoup de ses membres en sont exclus. Son but essentiel est d'intervenir au sein de ces organisations afin de redresser leur cours dégénérescent qui n'est pas forcément fatal. « Les partis communistes (...) sont des organes où l'on doit travailler pour combattre l'opportunisme. Nous sommes convaincus que les situations imposeront aux dirigeants de nous réintégrer, en tant que fraction organisée (souligné par nous), à moins que les situations ne doivent voir l'éclipsé totale des partis communistes. Dans ce cas aussi, que nous jugeons fort improbable, nous nous trouverons dans la possibilité d'accomplir notre devoir communiste. » ( [17] [3003])
C'est à travers cette vision qu'apparaît toute la différence entre Trotsky et la GI. En avril 1928, cette dernière se constitue en fraction en réponse à la résolution du 9e plénum élargi de 11C (du 9 au 25 février 1928) qui décide que l'on ne peut être en même temps membre de 11C et soutenir les positions politiques de Trotsky. Dès cet instant, les membres de la GI, ne pouvant plus être membres de 11C, se trouvent contraints de se constituer en fraction.
Dans la résolution de fondation de la fraction, ils s'assignent les tâches suivantes : « 1) la réintégration de tous les expulsés de l'Internationale qui se réclament du Manifeste communiste et acceptent les thèses du 2e Congrès mondial.
2)la convocation du 6e Congrès mondial sous la présidence de Léon Trotsky.
3)mise à l'ordre du jour au 6e congrès mondial de l'expulsion de l'Internationale de tous les éléments qui se déclarent solidaires avec les résolutions du 15e congrès russe. » ([18] [3004])
Ainsi, quand l'Opposition russe demande sa réintégration dans le parti, la GI souhaite surtout se maintenir en tant que fraction au sein de 1’IC et des PC parce qu'elle pense que la régénérescence passe désormais par un travail de fraction. « Par fraction nous entendions l'organisme qui construit les cadres devant assurer la continuité de la lutte révolutionnaire, et qui est appelée à devenir le protagoniste de la victoire prolétarienne. Contre nous,... [l'Opposition] affirmait qu'il ne fallait pas proclamer la nécessité de la formation des cadres : la clé des événements se trouvant entre les mains du centrisme et non entre les mains des fractions. » (souligné par nous) ([19] [3005])
Aujourd'hui, cette politique qui consiste à répéter les demandes de réintégration à 1’IC (la GI l'a abandonnée seulement après 1928) peut paraître erronée puisqu'elle n'a pas réussi à enrayer la dégénérescence des partis communistes et de l'Internationale. Mais, sans elle, l'opposition se serait retrouvée à l'extérieur de 1’IC et aurait abouti à une situation d'isolement pire encore. Les oppositionnels se seraient retrouvés éloignés de la masse des militants communistes et n'auraient plus pu peser sur leur involution ([20] [3006]). C'est cette méthode, théorisée plus tard par la GI, qui a permis de maintenir le lien avec le mouvement ouvrier et qui lui a permis de transmettre ses acquis à la « gauche » communiste actuelle dont le CCI fait partie.
A contrario, la politique d'isolement du groupe Réveil communiste ([21] [3007]) par exemple, a été catastrophique. Ce groupe n'y a pas survécu. Il a été incapable de donner naissance à un courant organisé. Il a surtout confirmé la méthode et la thèse classique du mouvement ouvrier : on ne rompt pas à la légère d'une organisation du prolétariat ; on ne rompt pas sans avoir préalablement épuisé toutes les solutions, après avoir utilisé tous les moyens, d'une part, pour aboutir à une clarification politique des divergences et, d'autre part, pour convaincre le maximum d'éléments sains.
Les leçons tirées par la Gauche italienne
Nous n'avons pas dressé ce vaste panorama historique pour le plaisir de faire oeuvre d'historien mais pour en tirer les enseignements nécessaires pour le mouvement ouvrier et notre classe aujourd'hui. Effectivement ce long développement nous enseigne que « l'histoire du mouvement ouvrier est l'histoire de ses organisations » comme l'affirmait Lénine. Aujourd'hui il est de bon ton de se séparer, sans aucun principe, d'une organisation politique du prolétariat et cela pour un oui ou pour un non. Tout en ayant les mêmes bases programmatiques, on crée une nouvelle organisation, ou bien, sans avoir passé au crible de la critique le programme et la pratique d'une organisation, on décrète qu'elle dégénère. Le simple rappel de l'histoire de la 3e Internationale nous montre quelle doit être la véritable attitude des révolutionnaires, à moins de penser qu'il n'y a guère besoin des organisations révolutionnaires ou d'avoir la prétention de découvrir tout seul tout ce que nous ont légué les organisations du passé. Nous n'avons pas cette prétention. Sans le travail théorique et politique de la gauche italienne, ni le CCI ni les autres groupes de la gauche communiste (le BIPR et les divers PCI) existeraient aujourd'hui.
Il est bien évident que, si nous nous réclamons de l'attitude de l'Opposition et de la Gauche italienne, nous ne pouvons pas nous réclamer entièrement des conceptions de l'Opposition et de Trotsky.
Par contre, nous approuvons celle qui est mise en avant, au début des années 1930, dans Bilan :
« Il est parfaitement exact que le rôle des fractions est surtout un rôle d'éducation de cadres au travers des événements vécus, et grâce à la confrontation rigoureuse de la signification des événements. (...) Sans le travail des fractions, la révolution russe aurait été impossible. Sans les fractions, Lénine lui-même, serait resté un rat de bibliothèque et ne serait pas devenu un chef révolutionnaire.
Les fractions sont donc les seuls endroits historiques où le prolétariat continue son travail pour son organisation de classe. De 1928 jusque maintenant, le camarade Trotsky a totalement négligé ce travail de construction des fractions et, de ce fait, il n'a pas contribué à réaliser les conditions effectives pour le mouvement de masse. » ([22] [3008])
De même, nous reprenons à notre compte ce que la GI a mis en évidence concernant la perte des organisations politiques dans une période de recul historique du prolétariat, en l'occurrence dans un cours à la guerre (celui des années 1930) ce qui n'est, bien évidemment, pas le cas aujourd'hui :
«La mort de l'Internationale Communiste dérive de l'extinction de sa fonction : l'IC est morte de la victoire du fascisme en Allemagne ; cet événement a épuisé historiquement sa fonction et a manifesté le premier résultat définitif de la politique centriste.
Le fascisme, victorieux en Allemagne, a signifié que les événements empruntaient le chemin opposé à celui de la révolution mondiale pour prendre la voie qui conduit à la guerre.
Le parti ne cesse d'exister, même après la mort de l'Internationale, LE PARTI NE MEURT PAS, IL TRAHIT. ».
Tous ceux qui, aujourd'hui, se disent d'accord avec les positions et principes de la GI et qui accusent de dégénérescence une organisation, ont le devoir et la responsabilité de tout faire pour empêcher que cette dynamique ne se poursuive et mène à la trahison, comme l'ont fait avant eux les camarades de Bilan.
Mais la GI, en critiquant Trotsky, avait aussi stigmatisé l'existence de tous ces individus sans principes (ou qui ne veulent pas savoir dans quel cours historique ils se situent) qui ne pensent qu'à construire de nouvelles organisations en dehors de celles qui existent déjà ou, comme on le voit aujourd'hui avec le développement du parasitisme, qui ne pensent qu'à détruire celles qu'ils viennent de quitter :
« D'une façon analogue, pour ce qui concerne la fondation de nouveaux partis [ici la GI parlait de Trotsky qui en 1933 proposait la construction de nouveaux partis], les sportsmen du "grand faire", au lieu de construire l'organisme pour l'action politique (..) ont fait beaucoup de tapage sur la nécessité de ne pas perdre un seul instant pour se précipiter au travail. (...).
Il est bien évident que la démagogie et le succès éphémère sont du côté du sport et non de côté du travail révolutionnaire. ».
A tous ces petits messieurs, ces nouveaux « sportsmen », ces fondateurs irresponsables de nouvelles chapelles, ces redresseurs de torts et de partis qui se jettent dans la dénonciation tonitruante des organisations prolétariennes existantes, nous tenons à rappeler notamment le travail patient et révolutionnaire de l'Opposition et surtout celui de la Gauche italienne dans les années 1920 et 1930 pour sauver leurs organisations et enfin préparer les cadres du futur parti, au lieu de quitter leur organisation pour se « sauver » eux-mêmes.
OR.
[1] [3009] Voir les numéros de la Revue Internationale sur la révolution allemande
[2] [3010] Les révolutionnaires qui vont fonder le KAPD sont exclus du Parti communiste allemand (KPD), ils ne rompent pas avec lui
[3] [3011] Pierre Naville qui l’a rencontré à Moscou en 1927, a souligné que Rakovsky ne nourrissait aucune illusion à l'époque. Il ne prévoyait que des années de souffrance et de répression ce qui évidemment ne l'a pas arrêté dans sa détermination de véritable combattant de la classe ouvrière, cf. : p. 274, Rakovsky, ou la révolution dans tous les pays, Pierre Broué, Fayard et Trotsky vivant de Pierre Naville.
[4] [3012] Cf. nos textes sur la gauche italienne et la brochure sur La Gauche Communiste d'Italie
[5] [3013] Une telle trahison n'est jamais exclue, par exemple si une organisation prolétarienne, du fait de son manque de clarté sur la question des luttes de « libération nationale », se laisse entraîner sur le terrain du gauchisme, c'est-à-dire de la bourgeoisie, en soutenant un camp impérialiste contre un autre dans les conflits pouvant exister entre grandes puissances au nom des « luttes de libération nationale ». C'est ce qui est arrivé à certaines sections du Parti communiste international (bordiguiste) au début des années 1980.
[6] [3014] Voir notre brochure La prétendue paranoïa du CCI.
[7] [3015] L. Trotsky, L'Internationale Communiste après Lénine, PUF Paris 1979, p. 25.
[8] [3016] Philippe Robrieux, Histoire intérieure du parti communiste français, tome 1, pp. 122 et suivantes.
[9] [3017] Au début, ce combat devait être mené ensemble avec Lénine sur la question du régime intérieur du Parti et de la bureaucratie. Mais Lénine eut sa deuxième attaque et ne reviendra plus au travail ; cf. : A. Rosmer dans l'introduction à De la révolution, recueil d'articles et de textes de Trotsky, Editions de Minuit, pp. 21 et 22.
[10] [3018] Livre publié en décembre 1923.
[11] [3019] Cf. Manifeste du groupe ouvrier du PCUS, février 1923 in Invariance n°6, 1975.
[12] [3020] La « gauche » du PCI représente encore la majorité du parti.
[13] [3021] Anciens secrétaires du parti avant Staline.
[14] [3022] Rakovsky, ou la révolution dans tous les pays, Pierre Broué, Fayard.
[15] [3023] Ante Ciliga : 10 ans au pays du mensonge déconcertant, Champ libre, Paris, 1977, cf. : pp. 233 et suivantes.
[16] [3024] Bilan n°5,mars 1934.
[17] [3025] Réponse du 8/7/1928 de la GI à l'Opposition communiste de Paz, cf. : Contre le Courant n°13.
[18] [3026] Il s'agit notamment la résolution d'exclusion de tous ceux qui se solidarisaient avec Trotsky. Citation de Prometeo n°l, mai 1928.
[19] [3027] Bilan n° 1, novembre 1933, cf. : p. 26.
[20] [3028] Par exemple, H. Chazé est resté au sein du PCF jusqu'en 1931-32 où il était secrétaire du Rayon de Puteaux. Cf. : son livre Chronique de la révolution espagnole, Spartacus.
[21] [3029] Voir notre brochure sur La Gauche communiste d'Italie.
[22] [3030] Bilan n° 1, « Vers l'Internationale deux et trois quarts..? », 1933. Les trotskistes finiront par sombrer, après s'être lancés pendant les années 1930 à corps perdu dans toutes les aventures, dans tous les regroupements sans principe comme avec le PSOP (la Social-Démocratie de gauche), après avoir fait de l'entrisme dans la SFIO.
Conscience et organisation:
- Troisième Internationale [1881]
Courants politiques:
- Gauche Communiste [49]
Polémique : à l'origine du CCI et du BIPR, II : la formation du Partito Comunista Internazionalista
- 3548 reads
Dans le précédent numéro de la Revue Internationale, nous avons publié la première partie d'un article en réponse à la polémique « Les racines politiques du malaise organisationnel du CCI » parue dans le n° 15 de Internationalist Communiste la revue en langue anglaise du Bureau International pour le Parti Révolutionnaire (BIPR) constitué par la Communist Workers' Organisation (CWO) et le Partito Comunista Internazionalista (PCInt). Dans cette première partie, après avoir rectifié un certain nombre d'affirmations du BIPR qui témoignent d'une méconnaissance de nos propres positions, nous sommes revenus sur l'histoire de la Fraction italienne de la Gauche Communiste Internationale qui est le courant politique dont se réclament tant le BIPR que le CCI. En particulier, nous avons mis en évidence que l'ancêtre du CCI, la Gauche Communiste de France (GCF), était bien plus qu'un «groupe minuscule », comme la qualifie le BIPR ; c'était en réalité la véritable héritière politique de la Fraction italienne ayant basé sa constitution sur les acquis de cette dernière. Ce sont justement ces acquis que le PCInt a laissés de côté ou carrément rejetés lors de sa constitution en 1943 et plus encore lors de son premier congrès à la fin de 1945. C'est ce que nous allons mettre en évidence dans cette deuxième partie de l'article.
Pour les communistes l'étude de l'histoire du mouvement ouvrier et de ses organisations ne correspond nullement à une curiosité de type académique. C'est au contraire un moyen indispensable pour leur permettre de fonder solidement leur programme, de s'orienter dans la situation présente et d'établir de façon claire des perspectives d'avenir. En particulier, l'examen des expériences passées de la classe ouvrière doit permettre de vérifier la validité des positions qui ont été défendues alors par les organisations politiques et d'en tirer les leçons. Les révolutionnaires d'une époque ne s'instaurent pas comme juges de leurs aînés. Mais ils doivent être en mesure de mettre en évidence les positions justes comme les erreurs des organisations du passé, de même qu'ils doivent savoir reconnaître le moment où une position correcte dans un certain contexte historique devient caduque lorsque les conditions historiques changent. Faute de quoi, ils éprouvent les plus grandes difficultés à assumer leur responsabilité, condamnés qu'ils sont à répéter les erreurs du passé ou bien à maintenir une position anachronique.
Une telle approche est le B A BA pour une organisation révolutionnaire. Si on s'en rapporte à son article, le BIPR partage cette approche et nous considérons comme très positif que cette organisation y ait abordé, parmi d'autres aspects, la question de ses propres origines historiques (ou plutôt les origines du PCInt) comme la question de celles du CCI. Il nous semble que la compréhension des désaccords entre nos deux organisations doit partir de l'examen de leurs histoires respectives. C'est pour cela que notre réponse à la polémique du BIPR se concentre sur cet aspect. Nous avions commencé à le faire dans la première partie de cet article pour ce qui concerne la Fraction italienne et la GCF. Il s'agit maintenant de revenir sur l'histoire du PCInt.
En fait, un des points importants qu'il s'agit ici d'établir est le suivant : peut-on considérer, comme le dit le BIPR, que « le PCInt était la création de la classe ouvrière ayant eu le plus de réussite depuis la révolution russe » ([1] [3031]). Si tel est le cas, alors il faut considérer l'action du PCInt comme exemplaire et source d'inspiration pour les organisations communistes d'aujourd'hui et de demain. La question qui se pose est la suivante : à quoi peut-on mesurer le succès d'une organisation révolutionnaire ? La réponse s'impose d'elle-même : si elle s'acquitte correctement des tâches qui sont les siennes dans la période historique où elle agit. En ce sens, les critères de « réussite » qui seront sélectionnés sont en eux-mêmes significatifs de la façon dont on conçoit le rôle et la responsabilité de l'organisation d'avant-garde du prolétariat.
Les critères de « réussite » d'une organisation révolutionnaire
Une organisation révolutionnaire est l'expression, de même que facteur actif, du processus de prise de conscience qui doit conduire le prolétariat à assumer sa tâche historique de renversement du capitalisme et d'instauration du communisme. Une telle organisation est un instrument indispensable du prolétariat au moment du saut historique que représente sa révolution communiste. Lorsqu'une organisation révolutionnaire est confrontée à cette situation particulière, comme ce fut le cas des partis communistes à partir de 1917 et au début des années 1920, le critère décisif sur lequel doit être appréciée son action est sa capacité de rassembler autour d'elle, et du programme communiste qu'elle défend, les grandes masses ouvrières qui constituent le sujet de la révolution. En ce sens, on peut considérer que le parti bolchevik a pleinement accompli sa tâche en 1917 (non seulement, d'ailleurs vis-à-vis de la révolution en Russie, mais vis-à-vis de la révolution mondiale puisque c'est également lui qui a été le principal inspirateur de la constitution et du programme révolutionnaire de l'Internationale Communiste fondée en 1919). De février à octobre 1917, sa capacité à se lier aux masses en pleine effervescence révolutionnaire, à mettre en avant, à chaque moment du processus de maturation de la révolution, les mots d'ordre les plus adaptés tout en faisant preuve de la plus grande intransigeance face aux sirènes de l'opportunisme, a constitué un facteur incontestable de son «succès ».
Ceci dit, le rôle des organisations communistes ne se limite pas aux périodes révolutionnaires. Si c'était le cas, alors il n'aurait I existé de telles organisations que dans la I période qui va de 1917 à 1923 et on se demande quelle serait la signification de l'existence du BIPR et du CCI aujourd'hui. Il est clair qu'en dehors des périodes directement «révolutionnaires, les organisations communistes ont pour rôle de préparer la révolution, c'est-à-dire de contribuer du mieux possible au développement de la condition essentielle de celle-ci : la prise de conscience par l'ensemble du prolétariat de ses buts historiques et des moyens à employer pour y parvenir. Cela signifie, en premier lieu, que la fonction permanente des organisations communistes (qui est donc également la leur dans les périodes révolutionnaires) est de définir de la façon la plus claire et cohérente possible le programme du prolétariat. Cela signifie, en second lieu et en lien direct avec la première fonction, de préparer politiquement et organisationnellement le parti qui devra se trouver à la tête du prolétariat au moment de la révolution. Enfin, cela passe notamment par une intervention permanente dans la classe, en fonction des moyens de l'organisation, afin de gagner aux positions communistes les éléments qui tentent de rompre avec l'emprise idéologique de la bourgeoisie et de ses partis.
Pour en revenir à « la création de la classe ouvrière ayant eu le plus de réussite depuis la révolution russe », c'est-à-dire le PCInt (suivant l'affirmation du BIPR), on doit se poser la question : de quelle « réussite » s'agit-il ?
A-t-il joué un rôle décisif dans l'action du prolétariat au cours d'une période révolutionnaire ou d'activité intense du prolétariat ?
A-t-il apporté des contributions de premier plan à l'élaboration du programme communiste, à l'exemple, entre autres, de la Fraction italienne de la Gauche communiste, organisation dont il se réclame ?
A-t-il jeté des bases organisationnelles significatives et solides sur lesquelles pourra, s'appuyer la fondation du futur parti communiste mondial, avant-garde de la révolution prolétarienne à venir ?
Nous allons commencer par répondre à cette dernière question. Dans une lettre du 9 juin 1980 adressée par le CCI au PCInt, au lendemain de l'échec de la troisième conférence des groupes de la Gauche communiste, nous écrivions :
« Comment expliquez-vous (...) que votre organisation, qui était déjà développée au moment de la reprise de classe en 1968, n'ait pu mettre à profit cette reprise pour s'étendre au niveau international alors que la nôtre, pratiquement inexistante en 1968, ait, depuis cette date, décuplé ses forces et se soit implantée dans dix pays ? »
La question que nous posions alors reste d'actualité aujourd'hui. Depuis cette époque, le PCInt à réussi à élargir son extension internationale en constituant le BIPR en compagnie de la CWO (qui a repris, pour l'essentiel ses positions et analyses politiques) ([2] [3032]). Mais il faut bien reconnaître que le bilan du PCInt, après plus d'un demi siècle d'existence, est bien modeste. Le CCI a toujours mis en évidence et déploré l'extrême faiblesse numérique et l'impact très réduit des organisations communistes, dont la nôtre, dans la période présente. Nous ne sommes pas du genre à pratiquer le bluff où à nous décerner des galons pour nous faire reconnaître comme le « véritable état-major du prolétariat ». Nous laissons à d'autres groupes la manie de se prendre pour le « vrai Napoléon » et de le proclamer. Cela dit, en s'appuyant sur le critère de « réussite » qu'on examine ici, celle de la « minuscule GCF », bien qu'elle ait cessé d'exister depuis 1952, est incomparablement plus satisfaisante que celle du PCInt. Avec des sections ou des noyaux dans 13 pays, 11 publications territoriales régulières en 7 langues différentes (dont celles qui sont les plus répandues dans les pays industrialises : anglais, allemand, espagnol et français), une revue théorique trimestrielle en trois langues, le CCI, qui s'est constitué autour des positions et des analyses politiques de la GCF, est aujourd'hui l'organisation de la Gauche communiste non seulement la plus importante et étendue, mais aussi et surtout celle qui a connu la dynamique de développement la plus positive au cours du dernier quart de siècle. Le BIPR peut bien sûr considérer que la «réussite» actuelle des héritiers de la GCF, si on la compare à celle du PCInt, est justement la preuve de la faiblesse de la classe ouvrière. Lorsque celle-ci aura développé beaucoup plus ses combats et sa conscience, elle reconnaîtra la validité des positions et des mots d'ordre du BIPR et se regroupera beaucoup plus massivement qu'aujourd'hui autour de lui. On se console comme on peut.
Ainsi, lorsque le BIPR évoque au superlatif absolu la « réussite » du PCInt, il ne peut s'agir (à moins de se réfugier dans des spéculations sur ce que sera le BIPR dans l'avenir) de sa capacité à jeter les bases organisationnelles futures du parti mondial. Nous en sommes conduits à examiner un autre critère : le PCInt de 1945-46 (c'est-à-dire lorsqu'il adopte sa première plateforme) a-t-il apporté des contributions de premier plan à l'élaboration du programme communiste?
Nous n'allons pas passer en revue ici l'ensemble des positions contenues dans cette plate-forme qui contient effectivement d'excellentes choses. Nous n'allons évoquer que quelques points programmatiques, extrêmement importants déjà à cette époque, sur lesquels on ne trouve pas dans la plateforme une grande clarté. Il s'agit de la nature de l'URSS, de la nature des luttes dites de « libération nationale et coloniale » et de la question syndicale.
La plate-forme actuelle du BIPR est claire sur la nature capitaliste de la société ayant existé en Russie jusqu'en 1990, sur le rôle des syndicats comme instruments de la préservation de l'ordre bourgeois que le prolétariat ne peut en aucune façon « reconquérir » et sur la nature contre-révolutionnaire des luttes nationales. Cependant, cette clarté n'existait pas dans la plate-forme de 1945 où 1’URSS était encore considérée comme un « Etat prolétarien », où la classe ouvrière était appelée à soutenir certaines luttes nationales et coloniales et où les syndicats étaient encore considérés comme des organisations que le prolétariat pouvait « reconquérir », notamment grâce à la création, sous l'égide du PCInt, de minorités candidates à leur direction ([3] [3033]). A la même époque, la GCF avait déjà remis en cause la vieille analyse de la Gauche italienne sur la nature prolétarienne des syndicats et compris que la classe ouvrière ne pouvait plus, en aucune façon, reconquérir ces organes. De même, l'analyse sur la nature capitaliste de l'URSS avait déjà été élaborée au cours de la guerre par la Fraction italienne reconstituée autour du noyau de Marseille. Enfin, la nature contre-révolutionnaire des luttes nationales, le fait qu'elles constituaient de simples moments des affrontements impérialistes entre grandes puissances, avait déjà été établi par la Fraction au cours des années 1930. C'est pour cela que nous maintenons aujourd'hui ce que la GCF disait déjà du PCInt en 1946 et qui fâche le BIPR quand il se plaint que « la GCF affirmait que le PCInt ne constituait pas une avancée par rapport à la vieille Fraction de la Gauche communiste qui était allée en exil en France durant la dictature de Mussolini ». Sur le plan de la clarté programmatique, les faits parlent d'eux mêmes. ([4] [3034])
2)La lutte du parti ne peut viser directement à la scission des masses organisées dans les syndicats.
3)Le processus de reconstruction du syndicat, s'il ne peut se réaliser qu'à travers la conquête des organes dirigeants du syndicat, découle d'un programme d'encadrement des luttes de classe sous la direction du parti. »
Ainsi, on ne peut pas considérer que les positions programmatiques qui étaient celles du PCInt en 1945 fassent partie de sa «réussite» puisqu'une bonne parti d'entre elles a dû être révisée par la suite, notamment en 1952, lors du congrès qui a vu la scission de la tendance de Bordiga et encore ultérieurement. Si le BIPR nous permet de faire un peu d'ironie, nous pourrions dire que certaines de ses positions actuelles sont plus inspirées de celles de la GCF que de celles du PCInt de 1945. Alors où réside le « grand succès » de cette organisation ? Il ne reste plus que la force numérique et que l'impact qu'elle a eus à un moment donné de l'histoire.
Effectivement, le PCInt a compté, entre 1945 et 1947, près de 3000 membres et un nombre significatif d'ouvriers se reconnaissait en lui. Est-ce à dire que cette organisation a pu jouer un rôle significatif dans le cours des événements historiques et les infléchir dans le sens de la révolution prolétarienne, même si celle-ci n'a pas eu lieu finalement. Evidemment, il est hors de question de reprocher au PCInt d'avoir failli à sa responsabilité face à une situation révolutionnaire car une telle situation n'existait pas en 1945. Mais c'est justement là où le bât blesse. Comme le dit l'article du BIPR, le PCInt misait « sur le fait que la combativité ouvrière ne resterait pas limitée au nord de l'Italie alors que la guerre approchait de sa fin ». En fait, le PCInt s'était constitué en 1943 sur la base du resurgissement des combats de classe dans le nord de l'Italie en misant sur le fait que ces combats étaient les premiers d'une nouvelle vague révolutionnaire qui allait surgir de la guerre comme ce fut le cas au cours du premier conflit mondial. L'histoire s'est chargée par la suite de démentir une telle perspective. Mais en 1943, il était tout à fait légitime de la mettre en avant ([5] [3035]). Après tout, l'Internationale Communiste et la plupart des partis communistes, dont le parti italien, s'étaient formés alors que la vague révolutionnaire commencée en 1917 était déjà sur le déclin après le tragique écrasement du prolétariat allemand en janvier 1919. Mais les révolutionnaires de l'époque n'en avaient pas encore conscience (et c'est justement un des grands mérites de la Gauche italienne que d'avoir été un des premiers courants à constater cette inversion du rapport de forces entre bourgeoisie et prolétariat). Cependant, lorsque s'est tenue la conférence de fin 1945-début 1946, la guerre était déjà terminée et les réactions prolétariennes qu'elle avait engendrées dès 1943 avaient été étouffées dans l'oeuf grâce à une politique préventive systématique de la part de la bourgeoisie ([6] [3036]). Malgré cela, le PCInt n'a pas remis en cause sa politique antérieure (même si un certain nombre de voix se sont élevées dans la conférence pour constater le renforcement de l'emprise bourgeoise sur la classe ouvrière). Ce qui était une erreur tout à fait normale en 1943 l'était déjà beaucoup moins à la fin de 1945. Cependant, le PCInt a continué sur sa lancée et il ne remettra jamais plus en cause la validité de la formation du parti en 1943.
Mais le plus grave pour le PCInt n'est pas dans l'erreur d'appréciation de la période historique et dans la difficulté à reconnaître cette erreur. Bien plus catastrophique a été la façon dont le PCInt s'est développé et les positions qu'il a été amené à prendre pour cela, notamment du fait qu'il a essayé de « s'adapter » aux illusions croissantes d'une classe ouvrière en recul.
La constitution du PCInt
Lors de sa formation en 1943, le PCInt se réclamait des positions politiques élaborées par la Fraction italienne de la Gauche communiste. D'ailleurs, si son principal animateur, Onorato Damen, un des dirigeants de la Gauche dans les années 20, était resté en Italie depuis 1924 (la plupart du temps dans les prisons mussoliniennes d'où les bouleversements de 1942-43 l'avaient tiré) ([7] [3037]), il comptait dans ses rangs un certain nombre de militants de la Fraction qui étaient rentrés en Italie au début de la guerre. Et effectivement, dans les premiers numéros de Prometeo clandestin (qui reprend le nom traditionnel du journal de la Gauche, celui des années 1920 et celui de la Fraction italienne dans les années 1930) publiés à partir de novembre 1943, on trouve des dénonciations très claires de la guerre impérialiste, de l'antifascisme et des mouvements « partisans » ([8] [3038]). Cependant, à partir de 1944 le PCI s’oriente vers une politique d’agitation en direction des groupes de partisans et diffuse, en juin, un manifeste qui incite à la « transformation des formations de partisans là où elles sont composées d'éléments prolétariens de saine conscience de classe, en organes d'autodéfense prolétarienne, prêtes à intervenir dans la lutte révolutionnaire pour le pouvoir. » En août 1944, Prometeo n° 15 va plus loin dans les compromissions : « Les éléments communistes croient sincèrement à la nécessité de lutte contre le nazi-fascisme et pensent, qu'une fois cet obstacle abattu, ils pourront marcher vers la conquête du pouvoir, en battant le capitalisme. » C'est la remise en vigueur de l'idée sur laquelle se sont appuyés tous ceux qui, au cours de la guerre d'Espagne, comme les anarchistes et les trotskistes, avaient appelé les prolétaires à «d'abord remporter la victoire sur le fascisme, ensuite faire la révolution ». C'est l'argument de ceux qui trahissent la cause du prolétariat pour se ranger derrière le drapeau d'un des camps impérialistes. Ce n'était pas le cas du PCInt car il restait fortement imprégné de la tradition de la Gauche du parti communiste d'Italie qui s'était distinguée, face à la montée du fascisme au début des années 1920, par son intransigeance de classe. Cela dit, de tels arguments dans la presse du PCInt permettent de mesurer l'ampleur des dérapages. Par ailleurs, suivant l'exemple de la minorité de la Fraction de 1936 qui avait rejoint les unités antifascistes du POUM en Espagne, un certain nombre de militants et de cadres du PCInt s'enrôlent dans les groupes partisans. Mais si la minorité avait rompu la discipline organisationnelle, il n'en est rien pour ces militants du PCInt : ils ne font qu'appliquer les consignes du Parti. ([9] [3039])
De toute évidence, la volonté de regrouper un maximum d'ouvriers dans ses rangs et autour de lui, à un moment où ces derniers succombent massivement aux sirènes des « partisans », conduit le PCInt à prendre des distances avec l'intransigeance qu'il avait affichée au départ contre l'antifascisme et les «bandes partisanes». Ce n'est pas là une «calomnie» du CCI prenant le relaie des « calomnies » de la GCF. Ce penchant à recruter de nouveaux militants sans trop se préoccuper de la fermeté de leurs convictions internationalistes a été relevée par le camarade Danielis, responsable de la fédération de Turin en 1945 et ancien membre de la Fraction : « Une chose doit être claire pour tout le monde : le Parti a subi l'expérience grave d'un facile élargissement de son influence politique - non en profondeur (car difficile) mais en surface. Je dois faire part d'une expérience personnelle qui servira de mise en garde face au danger d'une facile influence du Parti sur certaines couches, de masses, conséquence automatique d'une non moins facile formation théorique des cadres... On devait donc penser qu'aucun inscrit au Parti n'aurait accepté les directives du »Comité de Libération Nationale ». Or, le 25 avril au matin [date de la "libération" de Turin] toute la Fédération de Turin était en armes pour participer au couronnement d'un massacre de 6 années, et quelques camarades de la province - encadrés militairement et disciplinés - entraient à Turin pour participer à la chasse à l'homme... Le Parti n'existait pas ; il s'était volatilisé. » (Procès verbal du Congrès de Florence du PCInt, 6-9 mai 1948) De toute évidence, Danielis était aussi un « calomniateur » !
Sérieusement, si les mots ont un sens, la politique du PCInt qui lui a permis ses « grands succès » de 1945, n'était rien moins qu'opportuniste. En faut-il d'autres exemples ? On pourrait citer cette lettre du 10 février 1945 adressée par le «Comité d'agitation » du PCInt « aux comités d'agitation des partis à direction prolétarienne et des mouvements syndicaux d'entreprise pour donner à la lutte révolutionnaire du prolétariat une unité de directives et d'organisation... Dans ce but, il est proposé un rassemblement de ces divers comités pour mettre au point un plan d'ensemble. » (Prometeo, avril 1945) ([10] [3040]). Les «partis à direction prolétarienne » dont il est question sont notamment le parti socialiste et le parti stalinien. Aussi surprenant que cela apparaisse aujourd'hui, c'est la stricte vérité. Lorsque nous avons rappelé ces faits dans la Revue Internationale n° 32, le PCInt nous avait répondu : « Le document "Appel du Comité d'agitation du PCInt" contenu dans le numéro d'avril 45 fut-il une erreur? D'accord. Ce fut la dernière tentative de la Gauche italienne d'appliquer la tactique de "front unique à la base" préconisée par le PC d'Italie dans sa polémique avec l'IC dans les années 21-23. En tant que telle, nous la cataloguons dans les "péchés véniels" parce que nos camarades ont su l'éliminer tant sur un plan politique que théorique, avec une clarté qui aujourd'hui nous rend sûrs de nous face à quiconque. » (Battaglia Comunista n° 3, février 1983) A cela nous répondions : « On ne peut que rester admiratif devant la délicatesse et l'habileté avec lesquelles BC ménage son amour-propre. Si une proposition de front unique avec les bouchers staliniens et sociaux-démocrates n'est qu'un simple "péché véniel", qu'aurait dû faire le PCInt pour qu'on puisse parler d'erreur... Entrer au gouvernement ? » (Revue internationale n°34) ([11] [3041]). En tout cas il est clair qu'en f!l944, la politique du PCInt représentait bien jun pas en arrière par rapport à celle de la l« vieille fraction ». Et quel pas ! La Fraction | avait depuis longtemps fait une critique en profondeur de la tactique du front unique et [elle ne se serait pas avisée, depuis 1935, de (qualifier le parti stalinien de « parti à direction prolétarienne»; sans parler de la social-démocratie dont la nature bourgeoise était reconnue depuis les années 1920.
Cette politique opportuniste du PCInt, nous la retrouvons dans « l'ouverture » et le manque de rigueur dont il fait preuve à la fin de la guerre afin de s'élargir. Les ambiguïtés du PCInt formé dans le Nord du pays ne sont encore que peu de choses à côté de celles des groupes du Sud qui sont admis dans le Parti à la fin de la guerre, telle la «Frazione di sinistra dei comunisti e socialisti » constituée à Naples, autour de Bordiga et Pistone, qui, jusqu'au début de 1945 pratique l'entrisme dans le PCI stalinien dans l'espoir de le redresser et qui est particulièrement floue concernant la question de l'URSS. Le PCInt ouvre également ses portes à des éléments du POC (Parti Ouvrier Communiste) qui avait constitué pendant un certain temps la section italienne de la 4e internationale trotskiste.
Il faut rappeler aussi que Vercesi, qui durant la guerre estimait qu'il n'y avait rien à faire et qui, à la fin de celle-ci, avait participé à la « Coalizione Antifascista » de Bruxelles ([12] [3042]), s'intègre également dans le nouveau parti sans que celui-ci lui demande ne serait-ce que de condamner sa dérive antifasciste. Sur cet épisode, O. Damen, pour le PCInt, avait écrit au CCI, à l'automne 1976 : « Le Comité antifasciste de Bruxelles dans la personne de Vercesi, qui au moment de la constitution du PCInt pense devoir y adhérer, maintient ses propres positions bâtardes jusqu'au moment où le parti, rendant le tribut nécessaire à la clarté, se sépare des branches mortes du bordiguisme. » A cela nous répondions : « Qu'en termes galants ces choses là sont dites ! Il - Vercesi - pense devoir y adhérer ?! Et le Parti, qu'en pense-t-il ? Ou est-ce que le Parti est une société de bridge où adhère qui veut bien y penser ? » (Revue internationale n° 8). Il faut noter que dans cette lettre O. Damen avait la franchise de reconnaître qu'en 1945 le parti n'avait pas encore « rendu le tribut nécessaire à la clarté » puisque ce n'est que plus tard (en fait en 1952) qu'il le fit. On peut prendre acte de cette affirmation qui contredit toutes les fables sur la prétendue « grande clarté » ayant présidé à la fondation du PCInt puisque celui-ci représentait, au dire du BIPR, « un pas en avant » par rapport à celle de la Fraction. ([13] [3043])
Le PCInt n'est pas non plus très regardant en ce qui concerne les membres de la minorité de la Fraction qui, en 1936, s'étaient enrôlés ans les milices antifascistes en Espagne et qui avaient rejoint l’Union Communiste([14] [3044]). Ces éléments peuvent intégrer le Parti sans faire la moindre critique de leurs errements passés. Sur cette question, O. Damen nous écrivait dans la même lettre : « En ce qui concerne les camarades qui pendant la période de la guerre d'Espagne décidèrent d'abandonner la Fraction de la Gauche italienne pour se lancer dans une aventure en dehors de toute position de classe, rappelons que les événements d'Espagne, qui ne faisaient que confirmer les positions de la Gauche, leur ont servi de leçon pour les faire rentrer de nouveau dans le sillon de la gauche révolutionnaire. » (Ibid.) A quoi nous répondions : « il n'a jamais plus été question de retour de ces militants à la Gauche Communiste, jusqu'au moment de la dissolution de la Fraction et l'intégration de ses militants dans le PCInt (fin 45). Il n'a jamais été question de "leçon ", ni de rejet de position, ni de condamnation de leur participation à la guerre antifasciste d'Espagne de la part de ces camarades. » Si le BIPR estime qu'il s'agit là d'une nouvelle «calomnie » du CCI, qu'il nous indique les documents qui le prouvent. Et nous poursuivions : « C'est tout simplement l'euphorie et la confusion de la constitution du Parti "avec Bordiga" qui ont incité ces camarades... à le rejoindre... Le Parti en Italie ne leur a pas demandé de comptes, non pas par ignorance... mais parce que le moment n'était pas à "de vieilles querelles" ; la reconstitution du Parti effaçait tout. Ce parti qui n'était pas trop regardant sur Vagissement des partisans présents dans ses propres militants ne pouvait se montrer rigoureux envers cette minorité pour son activité dans un passé déjà lointain et lui ouvrait "naturellement" ses portes... »
En fait, la seule organisation qui ne trouve pas grâce aux yeux du PCInt et avec qui elle ne veut pas avoir de rapports est la GCF, justement parce que celle-ci continue de s'appuyer sur la même rigueur et la même intransigeance qui avaient caractérisé la Fraction durant les années 1930. Et c'est vrai que la Fraction de cette période n'aurait pu que condamner le bric à brac sur lequel s'est constitué le PCInt, un bric à brac tout à fait semblable à celui pratiqué alors par le trotskisme et contre lequel la Fraction n'avait pas de mots assez durs.
Dans les années 1920, la Gauche communiste s'était opposée à l'orientation opportuniste prise par l'Internationale Communiste à partir de son troisième congrès consistant notamment à vouloir « aller aux masses », à un moment où la vague révolutionnaire refluait, en faisant entrer dans ses rangs les courants centristes issus des partis socialistes (les Indépendants en Allemagne, les « Terzini » en Italie, Cachin-Frossard en France, etc.) et en lançant la politique de « Front unique » avec les PS. A la méthode du « rassemblement large » employée par 1’IC pour constituer les partis communistes, Bordiga et la Gauche opposaient la méthode de la « sélection » basée sur la rigueur et [l'intransigeance dans la défense des principes. Cette politique de 11C avait eu des conséquences tragiques avec l'isolement, voire l'exclusion, de la Gauche et l'envahissement du parti par les éléments opportunistes qui allaient constituer les meilleurs vecteurs de la dégénérescence de 1’IC et de ses partis.
Au début des années 1930, la Gauche italienne, fidèle à sa politique des années 20, avait bataillé au sein de l'opposition de Gauche internationale pour imposer cette I même rigueur face à la politique opportuniste de Trotsky pour qui l'acceptation des quatre premiers congrès de l’IC et surtout de sa propre politique manoeuvrière étaient des critères bien plus importants de regroupement que les combats menés dans 1’IC contre sa dégénérescence. Avec cette politique, les éléments les plus sains qui tentaient de construire un courant international de la Gauche communiste avaient été soit corrompus, soit découragés, soit condamnés à l'isolement. Bâti sur des fondations aussi fragiles, le courant trotskiste avait connu crise sur crise avant que de passer avec armes et bagages dans le camp bourgeois au cours de la seconde guerre mondiale. La politique intransigeante de la Fraction lui avait valu, pour sa part, d'être exclue de l'Opposition internationale en 1933 alors que Trotsky s'appuyait sur une fantomatique « Nouvelle Opposition Italienne » constituée d'éléments qui, à la tête du PCI encore en 1930, avaient voté pour l'exclusion de Bordiga de celui-ci.
En 1945, soucieux de rassembler le maximum d'effectifs, le PCInt qui se réclame de la Gauche, reprend à son compte non pas la politique de cette dernière face à 1’IC et face au trotskisme mais la politique que la Gauche avait justement combattue : rassemblement « large » basé sur les ambiguïtés programmatiques, regroupement - sans leur demander de comptes - de militants et de «personnalités»([15] [3045]) qui avaient combattu les positions de la Fraction lors de la guerre d'Espagne ou au cours de la guerre mondiale, politique opportuniste flattant les illusions des ouvriers sur les partisans et sur les partis passés à l'ennemi, etc. Et pour que la ressemblance soit la plus complète possible, exclusion de la Gauche communiste internationale du courant, la GCF, qui revendiquait la plus grande fidélité au combat de la Fraction, en même temps qu'on ne voulait reconnaître comme seul groupe représentant la Gauche communiste en France que la FFGC-bis. Faut-il rappeler que celle-ci était constituée de trois jeunes éléments ayant scissionné de la GCF en mai 1945, de membres de l'ex-minorité de la Fraction exclue pendant la guerre d'Espagne et de membres de l'ex-Union Communiste qui s'était laissé aller à l'antifascisme au même moment ([16] [3046]) ? N'y a-t-il pas là une certaine similitude avec la politique de Trotsky à l'égard de la Fraction et de la NOI ?
Marx a écrit que « si l'histoire se répète, la première fois c'est comme tragédie et la deuxième fois comme farce ». Il y a un peu de cela dans l'épisode peu glorieux de la formation du PCInt. Malheureusement, la suite des événements allait montrer que cette répétition par le PCInt en 1945 de la politique combattue par la Gauche dans les années 1920 et dans les années 1930 a eu des conséquences assez dramatiques.
Les conséquences de la démarche opportuniste du PCInt
Lorsqu'on lit le procès verbal de la conférence du PCInt de la fin 1945-début 1946, on est frappé par l'hétérogénéité qui y règne.
Sur l'analyse de la période historique, qui constitue une question essentielle, les principaux dirigeants s'opposent. Damen continue de défendre la « position officielle » :
« Le nouveau cours de l'histoire de la lutte du prolétariat va s'ouvrir. Il revient à notre parti la tâche d'orienter cette lutte dans un sens qui permette, à la prochaine et inévitable crise, que la guerre et ses artisans soient détruits à temps et définitivement par la révolution prolétarienne » (« Rapport sur la situation générale et les perspectives », page 12)
Mais certaines voix constatent, sans le dire ouvertement, que les conditions ne sont pas propices à la formation du parti :
« ... ce qui domine aujourd'hui, c'est l'idéologie jusqu'au-boutiste du CLN et du mouvement partisan, et c'est pour cela même qu'il n'existe pas les conditions pour l'affirmation victorieuse de la classe prolétarienne. Par suite, on ne peut pas qualifier le moment actuel autrement que comme réactionnaire. » (Vercesi, « Le parti et les problèmes internationaux », page 14)
« En concluant ce bilan politique, il est nécessaire de se demander si nous devons aller de l'avant en suivant une politique d'élargissement de notre influence, ou bien si la situation nous impose avant tout (dans une atmosphère encore empoisonnée) de sauvegarder les bases fondamentales de notre délimitation politique et idéologique, de renforcer idéologiquement les cadres, de les immuniser contre les bacilles qu'on respire dans l'ambiance actuelle et de les préparer ainsi aux nouvelles positions politiques qui se présenteront demain. A mon avis, c'est dans cette dernière direction que l'activité du parti doit être orientée dans tous les domaines. » (Maffi, «Relation politique-organisationnelle pour l'Italie septentrionale », page 7)
En d'autres termes, Maffi préconise le développement d'un travail classique de fraction.
Sur la question parlementaire, on constate la même hétérogénéité :
« C'est pourquoi nous utiliserons, en régime démocratique, toutes les concessions que l'on nous fera, dans la mesure où cette utilisation ne lésera pas les intérêts de la lutte révolutionnaire. Nous restons irréductiblement antiparlementaires ; mais le sens du concret qui anime notre politique nous fera repousser toute position abstentionniste déterminée à priori. » (O. Damen, Ibid. page 12.)
« Maffi, reprenant les conclusions auxquelles le parti est arrivé, se demande si le problème de l'abstentionnisme électoral doit être posé dans son ancienne forme (participer ou non aux élections, selon que la situation va ou non vers l'explosion révolutionnaire) ou si, au contraire, dans une ambiance corrompue par les illusions électorales, il ne conviendrait pas de prendre une position nettement anti-électorale, même au prix de l'isolement. Ne pas s'accrocher aux concessions que nous fait la bourgeoisie (concessions qui ne sont pas un acte de faiblesse mais de force de sa part) mais au processus réel de la lutte de classe et à notre tradition de gauche. » (Ibid. page 12)
Faut-il rappeler ici que la Gauche de Bordiga dans le parti socialiste italien s'était fait connaître au cours de la première guerre mondiale comme «Fraction abstentionniste » ?
De même, sur la question syndicale le rapporteur, Luciano Stefanini, affirme, contre la position qui sera finalement adoptée :
« La ligne politique du Parti, face au problème syndical, n'est pas encore suffisamment claire. D'un côté on reconnaît la dépendance des syndicats vis-à-vis de l'Etat' capitaliste ; de l'autre côté, on invite les ouvriers à lutter dans leur sein et à les conquérir de l'intérieur pour les porter sur une position de classe. Mais cette possibilité est exclue par l'évolution capitaliste que nous avons mentionnée plus haut... le syndicat actuel ne pourra pas changer sa physionomie d'organe d'Etat... Le mot d'ordre de nouvelles organisations de masse n'est pas actuel, mais le Parti a le devoir de prévoir quel sera le cours des événements et d'indiquer à partir d'aujourd'hui aux travailleurs quels seront les organismes qui, surgissant de l'évolution des situations, s'imposeront comme le guide unitaire du prolétariat sous la direction du parti. La prétention d'obtenir des positions de commande dans les actuels organismes syndicaux en vue de les transformer doit être définitivement liquidée. » (pages 18-19)
Au lendemain de cette conférence, la GCF pouvait écrire :
« Le nouveau parti n'est pas une unité politique mais un conglomérat, une addition de courants et de tendances qui ne manqueront pas de se manifester et de se heurter. L'armistice actuel ne peut être que très provisoire. L'élimination de l'un ou de l'autre courant est inévitable. Tôt ou tard la définition politique et organisationnelle s'imposera. » {Internationalisme n° 7, février 1946)
Après une période de recrutement intense, cette délimitation commence à se produire. Dès la fin 1946, le trouble que provoque dans le PCInt sa participation aux élections (beaucoup de militants ont en tête la tradition abstentionniste de la Gauche) conduit la direction du Parti à faire dans la presse une mise au point intitulée « Notre force » et qui en appelle à la discipline. Après l'euphorie de la conférence de Turin, beaucoup de militants découragés quittent le Parti sur la pointe des pieds. Un certain nombre d'éléments rompt pour participer à la formation du POI trotskiste, preuve qu'il n'avait pas sa place dans une organisation de la Gauche communiste. Beaucoup de militants sont exclus sans que les divergences apparaissent clairement, du moins dans la presse publique du Parti. Une des principales fédérations fait scission pour constituer la « Fédération autonome de Turin ». En 1948, lors du Congrès de Florence, le Parti a déjà perdu la moitié de ses membres et sa presse la moitié de ses lecteurs. Quant à « l'armistice » de 1946, il s'est transformé en «paix armée» que les dirigeants essayent de ne pas troubler en escamotant les principales divergences. C'est ainsi que Maffi affirme qu'il s'est « abstenu de traiter tel problème » parce que «je savais que cette discussion aurait pu empoisonner le Parti ». Cela n'empêche pas, cependant, le Congrès de remettre radicalement en cause la position sur les syndicats adoptée deux ans et demi auparavant (pourtant la position de 1945 était sensée représenter la plus grande clarté !). Cette paix armée va finalement déboucher sur l'affrontement (notamment après l'entrée de Bordiga dans le Parti en 1949) qui conduira à la scission de 1952 entre la tendance animée par Damen et celle animée par Bordiga et Maffi laquelle sera à l'origine du courant « Programma Comunista».
Quand aux « organisations soeurs » sur lesquelles le PCInt comptait pour constituer un Bureau international de la Gauche communiste, leur sort est encore moins enviable : la Fraction belge cesse de publier L'Internationaliste en 1949 et disparaît peu après ; la Fraction française-bis connaît au même moment une éclipse de deux ans, avec le départ de la plupart de ses membres, avant de réapparaître comme Groupe français de la Gauche communiste internationale qui se rattachera au courant «bordiguiste »([17] [3047])
La «plus grande réussite depuis la révolution russe » a donc été de courte durée. Et lorsque le BIPR, pour appuyer son argumentation sur cette « réussite », nous dit que le PCInt « malgré un demi siècle de domination capitaliste par la suite, continue à exister et s'accroît aujourd'hui », il oublie de préciser que le PCInt actuel, en termes d'effectifs et d'audience dans la classe ouvrière, n'a plus grand chose à voir avec ce qu'il était au sortir de la dernière guerre. Sans s'appesantir sur des comparaisons, on peut considérer que l'importance actuelle de cette organisation est sensiblement la même que celle de l'héritière directe de la « minuscule GCF », la section en France du CCI. Et nous voulons bien croire que le PCInt « s'accroît aujourd'hui ». Le CCI a également constaté au cours de la dernière période un intérêt plus grand pour les positions de la Gauche communiste ce qui s'est traduit notamment par un certain nombre de nouvelles adhésions. Cela dit, nous ne pensons pas que l'accroissement actuel des forces du PCInt lui permettra de sitôt de retrouver ses effectifs de 1945-46.
Ainsi cette grande « réussite » s'est achevée de façon assez peu glorieuse en une organisation qui, tout en continuant à se dénommer « parti », est contrainte de jouer le rôle d'une fraction. Ce qui est plus grave, c'est qu'aujourd'hui le BIPR ne tire pas les enseignements de cette expérience et surtout ne remet pas en cause la méthode opportuniste qui était une des raisons des « glorieux succès » de 1945 préfigurant les «insuccès» qui allaient suivre ([18] [3048]).
Cette attitude non-critique envers les errements opportunistes du PCInt à ses origines peut nous faire craindre que le BIPR, lorsque le mouvement de la classe sera plus développé qu'aujourd'hui, soit tenté de recourir aux mêmes expédients opportunistes que nous avons signalés. Dès à présent, le fait que le BIPR retienne comme principal «critère de réussite » d'une organisation prolétarienne le nombre de membres et l'impact qu'elle a pu avoir à un moment donné, en laissant de côté sa rigueur programmatique et sa capacité à jeter les bases d'une travail au long terme met en évidence l'approche immédiatiste qui est le sienne sur la (question d'organisation. Et nous savons que l'immédiatisme constitue l'antichambre de l'opportunisme. On peut également signaler d'autres conséquences fâcheuses, plus immédiates encore, de l'incapacité du PCInt de faire la critique de ses origines.
En premier lieu, le fait que le PCInt ait maintenu après 1945-46 (quand il est devenu évident que la contre-révolution continuait à imposer sa chape de plomb) la thèse de la validité de la fondation du parti l'a conduit à réviser radicalement toute la conception de la Fraction italienne sur les rapports entre Parti et Fraction. Pour le PCInt, désormais, la formation du Parti peut intervenir à tout moment, indépendamment du rapport de forces entre prolétariat et bourgeoisie ([19] [3049]). C'est la position des trotskistes, pas de la Gauche italienne qui a toujours considéré que le Parti ne pourrait se former que lors d'une reprise historique des combats de classe. Mais en même temps, cette remise en cause s'accompagne de la remise en cause qu'il puisse exister des cours historiques déterminés et antagoniques : cours vers les affrontements de classe décisifs ou cours vers la guerre mondiale. Pour le BIPR ces deux cours peuvent être parallèles, ne pas s'exclure mutuellement ce qui l'a conduit à une incapacité notoire d'analyser la période historique présente comme on l'a vu dans notre article « La CWO et le cours historique, une accumulation de contradictions » paru dans la Revue Internationale n° 89. C'est pour cela que nous écrivions dans la première partie du présent article (Revue Internationale n° 90) : «... à y regarder de plus près, l'incapacité actuelle du BIPR à fournir une analyse sur le cours historique trouve en bonne partie ses origines dans des erreurs politiques concernant la question d'organisation, et plus particulièrement sur la question des rapports entre fraction et parti. »
A la question pourquoi les héritiers de la « minuscule GCF » ont-ils réussi là où ceux du glorieux parti de 1943-45 ont échoué, c'est-à-dire à constituer une véritable organisation internationale, nous proposons à la réflexion du BIPR la réponse suivante : parce la GCF, et le CCI à sa suite, sont restés fidèles à la démarche qui avait permis à la Fraction de constituer au moment de la débâcle de l’IC le principal courant, et le plus fécond, de la Gauche communiste :
- la rigueur programmatique comme fondement de la constitution d'une organisation rejetant tout opportunisme, toute précipitation, toute politique de « recrutement » sur des bases floues ;
- une claire vision de la notion de Fraction et des liens de cette dernière avec le Parti ;
- la capacité à identifier correctement la nature du cours historique.
Le plus grand succès depuis la mort de 1’IC (et non depuis la révolution russe) ce n'est pas le PCInt qui l'a remporté mais bien la Fraction. Non pas en termes numériques mais en termes de sa capacité de préparer, au delà de sa propre disparition, les bases sur lesquelles pourra demain se constituer le Parti mondial.
En principe le PCint (et à sa suite le BIPR) se présente comme héritier politique de la Fraction italienne. Nous avons mis en évidence dans cet article combien, lors de sa constitution, cette organisation s'était éloignée de la tradition et des positions de la Fraction. Depuis, le PCint a clarifié toute une série de questions programmatiques, ce que nous considérons comme extrêmement positif. Toutefois il nous semble que le PCint ne pourra apporter sa pleine contribution à la constitution du futur parti mondial que s'il met en accord ses déclarations et ses actes, c'est-à-dire s'il se réapproprie véritablement la tradition et la démarche politiques de la Fraction italienne. Et cela suppose en premier lieu qu'il soit capable de faire une critique sérieuse de l'expérience de la constitution du PCint en 1943-45 au lieu d'en faire le panégyrique et de la prendre comme exemple.
Fabienne
[1] [3050] Nous supposons que, emporté par son enthousiasme, l'auteur de l'article a été victime d'un glissement de plume et qu'il voulait dire « depuis la fin de la vague révolutionnaire du premier après guerre et de l'Internationale Communiste ». En revanche, si ce qui est écrit traduit bien sa pensée, on peut se poser des questions sur sa connaissance de l'histoire et sur son sens des réalités : n'a-t-il jamais entendu parler, entre autres exemples, du Parti Communiste d'Italie qui, au début des années 1920, avait un impact autrement plus important que celui du PCInt en 1945 en même temps qu'il se trouvait à l'avant-garde de l'ensemble de l'Internationale sur toute une série de questions politiques ? En tout cas, pour la suite de notre article, nous préférons nous baser sur la première hypothèse : polémiquer contre des absurdités n'est d'aucun intérêt.
[2] [3051] Notons qu'au cours de cette même période, le CCI s'est élargi de trois nouvelles sections territoriales : en Suisse et dans deux pays de la périphérie du capitalisme, le Mexique et l'Inde, qui font l'objet d'un intérêt tout particulier de la part du BIPR (voir notamment à ce sujet l'adoption par le 6e Congrès du PCInt, en avril 1997, de « Thèses sur la tactique communiste dans les pays de la périphérie capitaliste »).
[3] [3052] Voici comment était formulée la politique du PCInt à l'égard des syndicats : « Le contenu substantiel du point 12 delà plate-forme du parti peut être concrétisé dans les points suivants : 1) Le parti aspire à la reconstruction de la CGL au travers de la lutte directe du prolétariat contre le patronat dans des mouvements de classe partiels et généraux.
[4] [3053] Le PCInt d'aujourd'hui est bien embarrassé par cette plate-forme de 1945. Aussi quand il a republié, en 1974, ce document en même temps que le « Schéma de Programme » rédigé en 1944 par le groupe de Damen, a-t-il pris soin d'en faire une critique en règle en l'opposant au « Schéma de programme » pour lequel il n'a pas de mots assez élogieux. Dans la présentation on peut lire : « En 1945, le Comité Central reçoit un projet de Plate-forme politique du camarade Bordiga qui, nous le soulignons, n'était pas inscrit au parti. Le document dont l'acceptation fut demandée en termes d'ultimatum, est reconnu comme incompatible avec les fermes prises de position adoptées désormais par le Parti sur les problèmes les plus importants et, malgré les modifications apportées, le document a toujours été considéré comme une contribution au débat et non comme une plateforme défait (...) Le CC ne pouvait, comme on l'a vu, accepter le document que comme une contribution tout à fait personnelle pour le débat du congrès futur qui, reporté en 1948, mettra en évidence des positions très différentes. » Il aurait fallu préciser PAR QUI ce document était considéré comme « une contribution au débat ». Probablement par le camarade Damen et quelques autres militants. Mais ils ont conservé pour eux leurs impressions car la Conférence de 1945-46, c'est-à-dire la représentation de l'ensemble du Parti, a pris une tout autre position. Ce document a été adopté à l'unanimité comme plate-forme du PCInt, servant de base d'adhésion et de constitution d'un Bureau international de la Gauche communiste. En revanche, c'est le « Schéma de Programme » qui a été renvoyé à la discussion pour le prochain congrès. Et si les camarades du BIPR pensent encore une fois que nous « mentons » et que nous « calomnions », qu'ils se rapportent alors au procès verbal de la Conférence de Turin de la fin 1945. Sil y a mensonge, c'est dans la façon dont le PCInt présentait en 1974 sa « version » des choses. En fait, le PCInt est tellement peu fier de certains aspects de sa propre histoire qu'il éprouve le besoin de les enjoliver un peu. Cela dit, on peut se demander pourquoi le PCInt a accepté de se soumettre à un « ultimatum » de qui que ce soit, et particulièrement de quelqu'un qui n'était même pas membre du Parti.
[5] [3054] Comme on l'a vu dans la première partie de cet article, la Fraction italienne avait considéré, à sa conférence d'août 1943, qu' «avec le nouveau cours qui s'est ouvert avec les événements d'août en Italie, le cours de la transformation de la Fraction en parti s'est ouvert ». La GCF, à sa fondation en 1944, avait repris la même analyse.
[6] [3055] Nous avons à de nombreuses reprises mis en évidence dans notre presse en quoi consistait cette politique systématique de la bourgeoisie, comment cette classe, ayant tiré les leçons de la première guerre, s'est partagée systématiquement le travail, laissant le soin aux pays vaincus de faire le « sale travail » (répression anti-ouvrière dans le Nord de l'Italie, écrasement de l'insurrection de Varsovie, etc.) en même temps que les vainqueurs bombardaient systématiquement les concentrations ouvrières d'Allemagne, se chargeaient ensuite de faire la police chez les vaincus en occupant tout le pays et en gardant pendant plusieurs années les prisonniers de guerre.
[7] [3056] La GCF et le CCI ont souvent critiqué les positions programmatiques défendues par Damen ainsi que sa démarche politique. Cela ne retire rien à l'estime qu'on peut avoir pour la profondeur de ses convictions communistes, son énergie militante et son grand courage.
[8] [3057] .« Ouvriers ! Au mot d'ordre de guerre nationale, qui arme les prolétaires italiens contre des prolétaires allemands et anglais, opposez le mot d'ordre de la révolution communiste, qui unit par-delà les frontières les ouvriers du monde entier contre leur ennemi commun : le capitalisme. » {Prometeo n° 1, 1er novembre 1943) «A l'appel du centrisme [c'est ainsi que la Gauche italienne qualifiait le stalinisme] de rejoindre les bandes partisanes, on doit répondre par la présence dans les usines d'où sortira la violence de classe qui détruira les centres vitaux de l'Etat capitaliste » (Prometeo du 4 mars 1944)
[9] [3058] Pour plus d'éléments sur la question de l'attitude du PCInt envers les partisans voir <r Les ambiguïtés sur les "partisans" dans la constitution du Parti Communiste Internationaliste en Italie » dans la Revue Internationale n° 8.
[10] [3059] Nous avons publié dans la Revue internationale n°32 le texte complet de cet appel ainsi que nos commentaires à son propos.
[11] [3060] Il faut préciser que dans la lettre envoyée par le PCInt au PS en réponse à celle de ce dernier suite à l'appel, le PCInt s'adressait aux canailles social-démocrate en les appelant « chers camarades ». Ce n'était pas la meilleure façon de démasquer aux yeux des ouvriers les crimes commis contre le prolétariat par ces partis depuis la première guerre mondiale et la vague révolutionnaire qui l'a suivie. C'était par contre un excellent moyen de flatter les illusions des ouvriers qui les suivaient encore.
[12] [3061] Voir à ce propos la première partie de cet article dans la Revue Internationale n° 90.
[13] [3062] Sur ce sujet, il vaut la peine de donner d'autres citations du PCInt : « Les positions exprimées par le camarade Perrone (Vercesi) à la Conférence de Turin (1946) (...) étaient de libres manifestations d'une expérience toute personnelle et avec une perspective politique fantaisiste à laquelle il n'est pas licite de se référer pour formuler des critiques à la formation du PCInt » {Prometeo n° 18, 1972) L'ennui c'est que ces positions étaient exprimées dans le rapport sur « Le Parti et les problèmes internationaux » présenté à la Conférence par le Comité central dont Vercesi faisait partie. Le jugement des militants de 1972 est vraiment bien sévère pour leur Parti en 1945-46, un Parti dont l'Organe central présente un rapport dans lequel on peut dire n'importe quoi. Nous supposons qu'après cet article de 1972 son auteur s'est fait sérieusement réprimander pour avoir ainsi « calomnié » le PCInt de 1945 au lieu de reprendre la conclusion que O. Damen avait apportée à la discussion sur ce rapport : « // n'y a pas de divergences mais des sensibilités particulières qui permettent une clarification organique des problèmes » (Procès-verbal, page 16) Il est vrai que le même Damen a découvert plus tard que les « sensibilités particulières » étaient en fait des « positions bâtardes » et que la « clarification organique » consistait à « se séparer des branches mortes ». En tout cas, vive la clarté de 1945 !
[14] [3063] Sur la minorité de 1936 dans la Fraction, voir la première partie de cet article dans la Revue Internationale n° 90
[15] [3064] Il est clair que l'une des raisons pour laquelle le PCInt de 1945 accepte d'intégrer Vercesi sans lui demander de comptes et de se faire «forcer la main » par Bordiga sur la question de la plate-forme c'est qu'il compte sur le prestige de ces deux dirigeants « historiques » pour attirer à lui un maximum d'ouvriers et de militants. L'hostilité de Bordiga aurait privé le PCInt des groupes et éléments du Sud de l'Italie ; celle de Vercesi l'aurait coupé de la Fraction belge et de la FFGC-bis.
[16] [3065] Sur cet épisode, voir la première partie de notre article.
[17] [3066] On peut donc constater que la «minuscule GCF », qui avait été traitée par le mépris et tenue soigneusement à l'écart par les autres groupes, a survécu malgré tout plus longtemps que la Fraction belge et que la FFGC-bis. Jusqu'à sa disparition en 1952, elle publiera 46 numéros d'Internationalisme qui constituent un patrimoine inestimable sur lequel s'est bâti le CCI.
[18] [3067] C'est vrai que la méthode opportuniste n'est pas seule à expliquer l'impact qu'a pu avoir le PCInt en 1945. En fait, il existe à cet impact deux causes fondamentales :
- l'Italie est le seul pays où nous ayons assisté à un réel et puissant mouvement de la classe ouvrière au cours de la guerre impérialiste et contre elle ;
- la Gauche communiste, du fait qu'elle avait assumé la direction du Parti jusqu'en 1925, que Bordiga ait été le principal fondateur de ce parti, jouissait auprès des ouvriers d'Italie d'un prestige incomparablement plus important que dans les autres pays.
A contrario, une des causes de la faiblesse numérique de la GCF est justement le fait qu'il n'y avait pas en France de tradition de la Gauche communiste dans la classe ouvrière et que celle-ci avait été incapable de surgir au cours de la guerre mondiale. Il y a aussi le fait que la GCF s'est interdit toute attitude opportuniste à l'égard des illusions des ouvriers envers la « Libération » et les « partisans ». En cela elle a suivi l'exemple de la Fraction en 1936 face à la guerre d'Espagne ce qui a conduit celle-ci à l'isolement qu'elle même constatait dans Bilan n° 36.
[19] [3068] Sur cette question, voir notamment notre article « Le rapport Fraction-Parti dans la tradition marxiste », Revue Internationale n° 59.
Conscience et organisation:
Courants politiques:
- Gauche Communiste [49]
- TCI / BIPR [137]
Revue Int. 1998 - 92 à 95
- 4127 reads
Revue Internationale no92 - 1e trimestre 1998
- 2799 reads
Crise économique - De la crise des pays "emergents" asiatiques au nouvel effondrement de l'économie mondiale
- 3845 reads
Nous publions ici le rapport sur la crise adopté lors du 12e Congrès du C.C.I. Ce rapport avait été rédigé en janvier 1997 et sa discussion dans toute notre organisation a servi de base à l'adoption à ce même congrès de la résolution sur la situation internationale que nos lecteurs ont pu lire dans le n° 90 de cette revue. Depuis la rédaction de ces documents, le développement de la crise économique du capital a été dramatiquement illustré par les soubresauts financiers qui ont affecté d'abord les désormais ex-“ dragons ” asiatiques à partir de l'été 1997, pour finalement s'étendre à toutes les places financières du monde, de l'Amérique Latine aux pays d'Europe de l'est, du Brésil à la Russie, jusqu'aux grandes puissances industrielles : Etats-Unis, Europe occidentale et surtout Japon.
La théorie marxiste contre les mensonges et l'aveuglement des économistes bourgeois
Il est frappant de voir à quel point les deux documents sont capables d'annoncer la crise ouverte des pays asiatiques et surtout d'en expliquer les raisons fondamentales. Nous nous garderons bien de tirer gloriole de la réalisation de nos perspectives dans un laps de temps aussi court. Que ces prévisions se soient réalisées aussi rapidement n'est pas le plus important. Se seraient-elles réalisées plus tard, que la validité de l'analyse n'en aurait pas été amoindrie d'un iota. De même, il est aussi secondaire à nos yeux que nos prévisions se soient confirmées exactement dans les pays asiatiques. En effet, ces derniers ne font qu'exprimer une tendance générale qu'avait tout aussi bien illustré le Mexique en 1994-95, qu'illustrent le Brésil ou la Russie à l'heure même où nous écrivons. L'important est la réalisation, tôt au tard, d'une tendance que seul le marxisme est capable de comprendre et de prévoir. Quel que soit le lieu et la rapidité de sa concrétisation, elle vient confirmer la justesse, la validité, le sérieux et la supériorité de la théorie marxiste sur toutes les inepties, souvent incompréhensibles et toujours partiales, partielles et contradictoires, que nous fournissent les économistes, les journalistes spécialisés, et les hommes politiques de la bourgeoisie.
Pour quiconque se dégage un peu des thèmes successifs de propagande développés par les médias soit pour cacher la réalité de l'impasse économique soit pour donner des explications rassurantes aux crises ouvertes, on ne peut qu'être effaré par la multitude d'explications diverses et contradictoires données par la bourgeoisie à l'évolution économique catastrophique depuis la fin des années 1960, depuis la fin de la période de reconstruction d'après la seconde guerre mondiale.
Que reste-t-il des explications de la crise par “ l'excessive rigidité du système monétaire ” ([1] [3069]) lorsque l'anarchie des taux de change est devenue un élément de l'instabilité économique mondiale ? Que reste-t-il du bavardage sur les “ chocs pétroliers ” ([2] [3070]) lorsque les cours du pétrole se noient dans la surproduction ? Que reste-t-il des discours sur le “ libéralisme ” et les “ miracles de l'économie de marché ” ([3] [3071]) lorsque l'effondrement économique se fait dans la plus sauvage des guerres commerciales pour un marché mondial qui se rétrécit à vitesse accélérée ? Que valent les explications basées sur une découverte tardive des “ dangers de l'endettement ” lorsqu'on ignore que cet endettement suicidaire était le seul moyen de prolonger la survie d'une économie agonisante ? ([4] [3072])
Par comparaison, le marxisme a maintenu tout au long de ces années, et devant chaque nouvelle manifestation ouverte de la crise, la même explication tout en la développant et en la précisant quand nécessaire. Elle est encore présente dans le rapport qui suit. Elle a été à maintes fois reprise, défendue, développée et précisée dans la presse révolutionnaire et particulièrement dans nos publications. La compréhension marxiste est historique, continue et cohérente.
“ Le système bourgeois est devenu trop étroit pour contenir les richesses créées dans son sein. (...) Chaque crise détruit régulièrement non seulement une masse de produits déjà créés, mais encore une grande partie des forces productives déjà existantes elles-mêmes. Une épidémie qui à toute autre époque eût semblé une absurdité s'abat sur la société, – l'épidémie de la surproduction. (...) Comment la bourgeoisie surmonte-t-elle ces crises ? D'un côté, en détruisant par la violence une masse de forces productives ; de l'autre en conquérant de nouveaux marchés et en exploitant plus à fond les anciens. A quoi cela aboutit-il ? A préparer des crises plus générales et plus formidables et à diminuer les moyens de les prévenir. ” ([5] [3073])
Ces caractéristiques et ces tendances révélées par Marx et Engels se sont vérifiées tout au long de l'histoire du capitalisme. Elles se sont même renforcées avec la période de décadence. Celle-ci marque la fin de l'existence de “ nouveaux ” marchés et l'épuisement des anciens. Caractéristique dominante du capitalisme tout au long du 20e siècle, la tendance à la destruction massive de forces productives s'y exprime de manière permanente et chaque jour encore plus aggravée, en particulier dans les guerres mondiales. On y a vu le crédit devenir “ le moyen spécifique de faire éclater (...) la contradiction entre la capacité d'extension, la tendance à l'expansion de la production d'une part, et la capacité de consommation restreinte du marché d'autre part ”. Mais pour préparer “ les crises plus générales et plus formidables ” annoncées par Le Manifeste, le crédit “ en sa qualité de facteur de production, [contribue] à provoquer la surproduction ; et en sa qualité de facteur d'échange, il ne fait, pendant la crise, qu'aider à la destruction radicale des forces productives qu'il a lui-même mises en marche. ” ([6] [3074])
La chute des Bourses et des monnaies avec la banqueroute des pays asiatiques vient illustrer à la fois l'impasse historique du capitalisme – exprimée par la surproduction mentionnée dans Le Manifeste et par l'usage sans limite du crédit – et la chute sans fin dans la catastrophe économique et sociale dans laquelle est entraîné l'ensemble de la planète. Elle vient confirmer nos propos sur l'incapacité, pour ne pas dire l'insigne nullité, des propagandistes et des économistes bourgeois. Elle vient confirmer nos propos sur la clairvoyance et la profonde validité de la méthode marxiste d'analyse et de compréhension de la réalité sociale, dans le cas qui nous occupe ici, de la crise irréversible et insoluble du mode de production capitaliste. Un rappel, court et partiel, viendra illustrer notre condamnation sans appel des zélateurs du capitalisme.
La Thaïlande ? “ Un eldorado... un marché en effervescence ” ([7] [3075]). La Malaisie ? “ Une réussite insolente ” ([8] [3076]), “ une vraie locomotive [qui] fera bientôt partie des quinze premières puissances économique mondiales ” ([9] [3077]) ; le pays projette de “ devenir, comme Singapour, un paradis high tech ” ([10] [3078]) ; “ explosive Malaisie qui voit grand, vraiment grand (...) la place asiatique la plus heureuse ” ([11] [3079]). “ Le miracle asiatique n'est pas terminé ” insiste, en février 1997, un expert consultant... ([12] [3080])
Nous aurions pu aller chercher encore plus loin et trouver sans doute d'autres “ perles ” du même type ou encore plus croustillantes. Elles sont innombrables et leur teneur va toujours dans le même sens, nier ou cacher la réalité irréversible de la crise. On aurait pu penser que plus aucun Georges Bush ne viendrait nous promettre “ l'ère de paix et de prospérité ” que devait nous apporter la chute du bloc de l'est ; que plus aucun Jacques Chirac ne viendrait nous prédire “ la sortie du tunnel ” comme celui-ci l'avait fait en... 1976 ! Et pourtant, ils sont encore légion à nous assurer que les “ fondamentaux sont bons ” (Bill Clinton) et que “ la correction [la chute des bourses mondiales] était salutaire ” (Alan Greenspan, le président de la Réserve Fédérale américaine), ou encore, toujours du même, que “ les récentes perturbations sur les marchés financiers pourraient apporter des bénéfices à long terme pour l'économie américaine ” et que “ cela ne signifiait pas la fin du boom de la croissance de l'Asie ” ([13] [3081]). Pourtant, ce dernier commençait à corriger ses propos optimistes quinze jours plus tard devant l'évidence des faits et la multiplication des chutes et des faillites, en particulier celles touchant la Corée du Sud et le Japon : “ la crise asiatique aura des conséquences non négligeables ”. Certes, même si les propos tenus au plus fort de la chute des marchés boursiers ont pour objet immédiat de rassurer ces derniers et d'éviter la panique généralisée, il n'empêche qu'ils révèlent aussi l'aveuglement et l'impuissance de leurs auteurs.
Quel démenti, avec la banqueroute asiatique, à toutes les affirmations triomphantes sur le mode de production capitaliste ! Quel démenti aux déclarations tonitruantes sur la réussite de ces fameux et exemplaires “ pays émergents ” ! Quel démenti aux supposés mérites de la soumission, de la discipline, du sens du sacrifice sur l'autel de la défense de l'économie nationale, des bas salaires et de la “ flexibilité ” de la classe ouvrière de ces pays comme source de la prospérité et de réussite pour tous !
La banqueroute asiatique, produit de la crise historique du mode de production capitaliste
Depuis le mois de juillet, les “ tigres ” et les “ dragons ” asiatiques se sont effondrés. Au 27 octobre, en une semaine, la bourse de Hongkong avait perdu 18 %, celle de Kuala-lumpur (Malaisie) 12,9 %, celle de Singapour 11,5 %, celle de Manille (Philippines) 9,9 %, celle de Bangkok (Thaïlande) 6 %, Djakarta (Indonésie) 5,8 %, Séoul (Corée) 2,4 %, Tokyo 0,6 %. Depuis un an, en reprenant ces pays dans le même ordre, les plongeons sont respectivement de 22 %, 44 %, 26,9 %, 41,4 %, 41 %, 23 %, 18,5 %, 12 % ([14] [3082]). Depuis, et à la date d'aujourd'hui, la chute de ces places financières continue.
Dans la foulée, et démentant les propos lénifiants sur l'absence de conséquences pour l'économie mondiale, Wall Street et les Bourses européennes connaissaient à leur tour un krach des plus graves. Seuls l'intervention des gouvernements et des banques centrales, et les réglementations boursières – les coupe-circuit automatiques qui arrêtent les cotations quand les cours chutent trop vite – ont permis d'enrayer le mouvement de panique. Par contre, les pays sud-américains voyaient avec effroi leurs Bourses plonger aussi et leurs monnaies attaquées. Les inquiétudes principales se portaient sur le Brésil. Et puis, le même phénomène se produit maintenant dans les pays européens de l'ancien bloc de l'Est, autres “ pays émergents ” : Budapest plongeant de 16 %, Varsovie de 20 %, Moscou de 40 %. Ces plongeons boursiers s'accompagnent de l'affaiblissement des monnaies locales, tout comme en Asie et en Amérique latine.
“ Les experts craignent que l'Europe de l'Est ne connaisse une crise financière du même type que celle que traverse l'Asie [ce qui constituerait] une des principales menaces pour la reprise des économies de l'Union européenne. ” (16) Comme si la récession ne frappait pas l'ensemble du capitalisme depuis maintenant une décennie : “ Car, euphorie mondialisante mise à part, c'est bien la stagnation qui, depuis le krach de 1987, définit le mieux la situation de toutes les régions de la planète. ” ([15] [3083])
Et comme si la faillite du capitalisme trouvait son origine dans les pays de la périphérie et non dans le mode de production capitaliste lui-même. Comme si son épicentre ne se situait pas dans les pays centraux du capitalisme, dans les pays industrialisés. A la fin de la période de reconstruction de l'après-guerre, à la fin des années 1960, ce sont les grands centres industriels du monde qui sont touchés par le renouveau de la crise ouverte. La bourgeoisie de ces pays va utiliser alors à fond l'endettement interne et externe pour créer artificiellement les marchés qui lui font défaut. C'est donc à une explosion de l'endettement qu'on assiste à partir des années 1970 qui va déboucher d'abord sur la faillite des pays sud-américains, puis à l'écroulement des pays à capitalisme d'Etat stalinien de l'Europe de l'est. Maintenant c'est au tour de l'Asie. Repoussées dans un premier temps vers la périphérie du capitalisme, la faillite et la récession reviennent avec une force démultipliée vers les pays centraux alors que ces derniers ont eux aussi usé et abusé de l'endettement : les Etats-Unis sont surendettés et aucun pays d'Europe n'arrive à respecter les fameux critères de Maastricht.
Car les événements s'accélèrent au cours de cette crise financière. La Corée du Sud, 11e puissance économique mondiale est à son tour brutalement touchée. Son système bancaire est en complète banqueroute. Les fermetures de banques et d'entreprises se multiplient et les licenciements se comptent déjà par dizaines de milliers. Ce n'est qu'un début. Deuxième puissance économique mondiale, “ le Japon est devenu le pays faible de l'économie mondiale ” ([16] [3084]). Là aussi les fermetures d'entreprises commencent et les licenciements explosent. Quel démenti cruel aux déclarations triomphales, tonitruantes et définitives sur les “ modèles ” coréen et japonais !
Et quel démenti aussi aux pitoyables explications données face à l'avalanche de plongeons boursiers brutaux depuis l'été ! D'abord, la bourgeoisie a essayé d'expliquer que l'effondrement de la Thaïlande était un phénomène local... ce qui a été vite démenti dans les faits. Puis qu'il s'agissait d'une crise de croissance pour les pays asiatiques. Enfin, qu'il s'agissait d'un assainissement nécessaire de la bulle spéculative qui n'aurait aucune incidence sur l'économie réelle... affirmation aussitôt démentie par la faillite de centaines d'établissements financiers lourdement endettés, par la fermeture de multiples entreprises tout autant endettées, par l'adoption de plans d'austérité drastiques annonçant récession, licenciements par milliers et paupérisation accrue des populations.
L'endettement généralisé du capitalisme
Quels sont les mécanismes à la base de ces phénomènes ? L'économie mondiale, et particulièrement au cours des deux dernières décennies, fonctionne sur l'endettement et même le surendettement. En particulier, le développement des prétendues économies émergentes du sud-est asiatique, tout comme des pays sud-américains et d'Europe de l'est, reposent essentiellement sur les investissements de capitaux étrangers. Par exemple, la Corée a une dette de 160 milliards de dollars dont elle devrait rembourser pratiquement la moitié dans l'année qui vient alors que sa monnaie s'est effondrée de 20 %. Autant dire que cette dette gigantesque ne sera jamais remboursée. Nous n'avons pas la place ici de revenir sur l'état des endettements des pays asiatiques – endettements faramineux du même ordre que ceux des autres “ pays émergents ” du monde et dont les chiffres ne signifient plus grand chose – et dont les monnaies ont toutes tendance à chuter par rapport au dollar. Ces dettes non plus ne seront pour la plupart jamais remboursées. Ces créances pudiquement qualifiées de “ douteuses ” sont perdues pour les pays industrialisés, ce qui vient aggraver encore... leur propre endettement déjà gigantesque. ([17] [3085])
Quelle réponse apporte la bourgeoisie à ces faillites colossales qui risquent de provoquer la banqueroute brutale et généralisée du système financier mondial à cause de l'endettement généralisé ? Encore plus d'endettement ! Le FMI, la banque mondiale, les banques centrales des pays les plus riches se cotisent pour avancer 57 milliards de dollars à la Corée après avoir débloqué 17 milliards pour la Thaïlande et 23 pour l'Indonésie. Mais ces nouveaux prêts viennent s'ajouter aux précédents et “ déjà se profile le risque d'effondrement du système bancaire japonais, criblé de créances douteuses, voire irrécupérables : entre autres les 300 milliards de dollars de prêts octroyés à dix pays d'Asie du sud-est et à Hongkong. Et si le Japon lâche prise, les Etats-Unis et l'Europe se retrouveront en première ligne dans la tourmente. ” ([18] [3086])
En effet, le Japon se retrouve au centre de la crise financière. Il détient d'énormes créances non remboursables qui sont à peu près du même ordre de grandeur – 300 milliards de dollars – que ses avoirs en Bons du Trésor américain. Dans le même temps, l'aggravation du déficit de l'Etat, ces dernières années, a augmenté son endettement général. Inutile de dire ici que, malgré la “ politique keynésienne ” employée, c'est-à-dire l'augmentation considérable de l'endettement, il n'y a eu aucune relance de l'économie japonaise. Mais par contre, les faillites des plus grandes institutions financières japonaises lourdement endettées se multiplient. Pour éviter une banqueroute totale à la coréenne, l'Etat japonais met la main à la poche... aggravant encore plus son déficit et son endettement. Et si le Japon se retrouve à court de liquidités – ce qui est en train de se passer –, la bourgeoisie mondiale s'inquiète et commence à paniquer : “ Le premier créancier de la planète, celui qui finance sans compter depuis des années le déficit de la balance des paiements américaine, va-t-il pouvoir continuer à jouer ce rôle avec une économie malade, rongée par les mauvaises créances et un système financier exsangue ? Le scénario catastrophe serait que les institutions financières nippones procèdent à un retrait massif de leurs placements en obligations américaines. ” ([19] [3087]) Il provoquerait alors un arrêt du financement de l'économie américaine, c'est-à-dire une brutale récession ouverte. La crise économique exportée dans la périphérie du capitalisme dans les années 1970 par l'utilisation massive du crédit revient frapper les pays centraux avec des conséquences catastrophiques qui, pour l'essentiel, sont encore à venir.
Il est difficile de dire aujourd'hui si ces prêts supplémentaires vont réussir à calmer la tempête et à repousser la faillite généralisée à plus tard, ou bien si l'heure des comptes a sonné. Même si à l'heure où nous écrivons, il apparaît chaque jour plus probable que les 57 milliards de dollars réunis par le FMI pour la Corée sont insuffisants pour enrayer la déroute. Les appels au secours sont tels que les fonds du FMI, récemment augmentés par l'ensemble des grandes puissances, sont déjà insuffisants, et que celui-ci pense sérieusement à... emprunter à son tour ! Mais indépendamment de l'issue ponctuelle de cette crise financière, la tendance est toujours la même et ne fait que se renforcer dans la crise économique même. Au mieux, le problème n'est que reporté dans le temps, et avec des conséquences encore plus profondes et dramatiques.
La crise du capitalisme est irréversible
Cette utilisation massive et chaque fois plus importante du crédit illustre la saturation des marchés : l'activité économique se maintenant sur la base de l'endettement, cela veut dire qu'un marché est créé artificiellement. Aujourd'hui, la tricherie éclate. La saturation du marché mondial a empêché ces “ pays émergents ” de vendre comme ils en auraient eu besoin. La crise actuelle va faire chuter les ventes encore plus et aggraver la guerre commerciale. Un aperçu en est déjà donné par les pressions américaines sur le Japon pour qu'il ne laisse pas chuter le Yen et qu'il ouvre son marché intérieur, et par les conditions imposées à la Corée – tout comme aux autres pays “ aidés ” – par le FMI. La faillite de l'Asie et la récession qui va toucher ces pays, tout comme leur agressivité commerciale encore accrue, vont affecter tous les pays développés qui calculent déjà la chute de la croissance dont ils vont souffrir.
Là aussi, la bourgeoisie est obligée finalement de reconnaître les faits, et parfois de soulever un voile sur la réalité – dans ce cas la saturation des marchés – sans cesse affirmée par le marxisme : “ le Wall Street Journal a signalé, en août dernier, que de nombreux secteurs industriels étaient désormais confrontés à un risque oublié depuis longtemps : trop de production potentielle et pas assez d'acheteurs » alors que « à en croire un article publié le 1er octobre dans le New York Times, la surproduction guette aujourd'hui non seulement l'Amérique, mais le monde entier. Le global gut (la saturation globale) serait même l'origine profonde de la crise asiatique. ” ([20] [3088])
Le recours au crédit généralisé face à la surproduction et à la saturation des marchés, ne fait que repousser dans le temps les limites de ces dernières et devient à son tour un facteur aggravant de la surproduction et de la saturation des marchés comme l'a expliqué la théorie marxiste. Même si les crédits octroyés par le FMI, sans commune mesure avec ce qui avait pu se passer auparavant – plus de 100 milliards de dollars au total jusqu'à aujourd'hui – suffisaient à ramener le calme, la facture reste à payer, augmentée justement de ces nouveaux prêts. L'impasse économique du capitalisme reste. Et les conséquences pour l'ensemble de l'humanité sont catastrophiques. Avant même cette crise qui va jeter des millions d'ouvriers supplémentaires dans le chômage et la misère et aggraver encore les conditions de vie de milliards d'individus, l'Organisation International du Travail signalait que “ le chômage toucherait près d'un milliard de personnes dans le monde, soit près du tiers de la population active. ” ([21] [3089]) Toujours avant cette crise, l'UNICEF affirmait que 40 000 enfants meurent de faim chaque jour dans le monde. L'impasse économique, politique et historique du mode de production capitaliste impose chaque jour encore plus un enfer quotidien à des milliards d'hommes, enfer fait d'exploitation, de faim, de misère, de guerres et de massacres, de décomposition sociale généralisée. Et les derniers événements ne vont faire qu'accélérer cette chute dans la barbarie de tous les continents et de tous les pays, riches ou pauvres.
Ces événements dramatiques annoncent une aggravation brutale des conditions de vie de l'ensemble de la population mondiale. Ils signifient une détérioration encore décuplée de la situation déjà misérable de la classe ouvrière, qu'elle ait du travail ou qu'elle soit au chômage ; qu'elle soit des pays pauvres de la périphérie, d'Amérique latine, d'Europe de l'est ou d'Asie, ou qu'elle soit des pays industrialisés, qu'elle appartienne aux gros bastions du prolétariat mondial, du Japon, d'Amérique du Nord, ou d'Europe occidentale. La catastrophe qui se déroule sous nos yeux et dont les effets commencent tout juste à se manifester par les licenciements massifs dans plusieurs pays, dont la Corée et le Japon, appelle une réponse du prolétariat. Les “ modèles ” japonais et coréen qu'on a cités en exemple durant plus d'une décennie afin de justifier les attaques contre les conditions de vie et de travail, doivent être retournés et renvoyés par le prolétariat mondial à la face des Etats et de la classe dominante : les sacrifices et la soumission n'amènent pas la prospérité, mais toujours plus de sacrifices et de misère. Le monde capitaliste plonge l'humanité dans la catastrophe. Au prolétariat de répondre dans la lutte massive et unie contre les sacrifices et contre l'existence même du capitalisme.
RL, 7 décembre 1997.Questions théoriques:
- L'économie [86]
Heritage de la Gauche Communiste:
Perspective Internationaliste décroche un nouvel oscar du bétisier politique
- 2918 reads
Dans le n°28 de sa revue, datée de mai 1995, nous avions eu droit, de la part du « groupe » Perspective Internationaliste (PI), à un panégyrique des capacités décuplées du capitalisme depuis le début de ce siècle et plus particulièrement dans toute la région de l'Asie de l'est. Un tel discours laudatif, même le plus idéologique des rapports de la Banque Mondiale n'a pas encore osé l'énoncer : « le capitalisme a continué à développer les forces productives tout au long de la période de décadence – et qui plus est à un rythme extrêmement rapide – (...) les taux les plus prodigieux (sic !) de croissance de la production industrielle mondiale se sont produits depuis la fin des années 60 (...). Le CCI parle également d'un développement inégal dans l'espace : aucun pays nouvellement arrivé sur le marché mondial ne peut, selon sa conception de la décadence, s'industrialiser et rivaliser avec les anciens (...) Et pourtant, depuis la deuxième guerre mondiale, le Japon est devenu la seconde puissance économique mondiale ; la Chine est rapidement devenue une puissance économique majeure propre ; la Corée du Sud, Taiwan, Singapour, etc. ont récemment rejoint les rangs des pays industrialisés (...) En 1962, le Pacifique occidental n'intervenait qu'à raison de 9 % dans le PNB mondial ; en 1982, sa participation était de 15 % ; et à la fin de ce siècle, elle sera probablement de 25 % – une proportion plus grande que celle de l'Europe occidentale ou de l'Amérique du Nord. Une telle capitalisation de l'Extrême-Orient, l'entrée dans les rangs du monde industrialisé d'une région qui avant la deuxième guerre mondiale était totalement marginale du point de vue industriel, ne peuvent tout simplement pas être expliquées par le concept de décadence du CCI. » Au moment même où PI élucubrait sur les horizons radieux du capitalisme, nous diagnostiquions l'enfoncement de celui-ci dans des secousses financières de plus en plus fréquentes et profondes, consécutives au recours croissant à l'endettement afin de reporter les effets de sa crise dans le temps ([1] [3111]). Par la même occasion nous analysions de façon historique et approfondie la prétendue prospérité du sud-est asiatique en tordant le cou, au passage, à tous les poncifs répandus par la bourgeoisie à ce propos ([2] [3112]), poncifs repris, relayés et amplifiés par PI.
Il n'a pas fallu attendre plus de deux années pour que les faits prononcent leur verdict : l'Asie du sud-est est sous perfusion, le FMI a dû mobiliser toute son énergie pour imposer les mesures les plus drastiques jamais prises afin de tenter « d'assainir » une situation économiquement pourrie et dégradée. Et, pour accompagner ces mesures qui risquent d'aboutir à un effondrement économique majeur, il a dû débloquer le crédit le plus élevé de toute son histoire. Quant à l'autre bout de la planète, dans les pays occidentaux développés, ce sont seulement des manipulations au plus haut niveau entre les gouvernements et les grandes institutions financières qui ont pu limiter les dégâts.
Visiblement PI est plus préoccupé de prendre le contre-pied du CCI que celui de la bourgeoisie... Voilà où mène ce parasitisme de la pire espèce : à faire objectivement le jeu de l'ennemi de classe, à propager les pires âneries produites par les cercles de propagande idéologique de la bourgeoisie.
C'est avec une régularité de métronome que ce « groupe » nous livre ce genre « d'analyses » dignes de concourir au Mondial du bêtisier politique. D'où vient cette lamentable prétention politique ? Nous devons ici rappeler au lecteur que les membres de PI ont quitté le CCI en 1985 de façon totalement irresponsable, en désertant le combat militant, entraînés qu'ils étaient par des rancoeurs et récriminations personnelles ([3] [3113]). Depuis, ils accusent notre organisation de « trahir sa propre plate-forme », de « dégénérer de façon stalinienne », de « mépriser l'approfondissement de la théorie marxiste ». Leur credo fut de s'instituer en vrai défenseurs et continuateurs de notre plate-forme politique et de s'attaquer sérieusement à l'élaboration de la théorie communiste, tâches que nous aurions, semble-t-il, définitivement abandonnées. Qu'en est-il aujourd'hui ? PI a complètement rejeté la plate-forme qu'il était censé défendre bec et ongles et il s'essaie à en élaborer une nouvelle..., tâche entreprise depuis plusieurs années mais qui semble au-dessus de ses forces. En fait « d'approfondissement théorique fondamental », il est allé chercher chez Alain Bihr, « docteur en sociologie », collaborateur au Monde Diplomatique et grand animateur de la campagne anti-négationiste visant à discréditer la Gauche communiste, ses élucubrations sur la « recomposition du prolétariat ». De même, empruntant à Marx un schéma qui s'appliquait au siècle dernier avant l'apogée du mode de production capitaliste, PI a « découvert » que la Pérestroïka de Gorbatchev s'expliquait par le passage de l'économie russe de la « domination formelle » à la « domination réelle du capital ». Cette analyse « absolument cruciale pour expliquer l'évolution du monde aujourd'hui », disait-il, ne l'a pas empêché d'avoir besoin de deux années après 1990 pour comprendre ce que n'importe qui savait déjà, que le bloc de l'Est n'existait plus. Visiblement soucieux d'encore peaufiner son image de marque de « creuset de la théorie », de « pôle international de discussion permettant le développement d'un marxisme vivant », PI a entrepris de redéfinir le concept marxiste de décadence du capitalisme. En fait de redéfinition, c'est à une véritable liquidation de l'héritage théorique des groupes de la Gauche communiste et du marxisme tout court qu'il procède : le capitalisme serait, à l'heure actuelle, dans sa phase la plus dynamique et la plus prospère, en pleine « troisième révolution technologique » (dont le CCI sous-estimerait complètement les effets) offrant la possibilité, aux dires de PI, d'un réel développement national bourgeois dans la périphérie ([4] [3114]). PI souligne « les capacités d'émergence de bourgeoisies locales périphériques pouvant s'industrialiser et rivaliser avec les anciens pays industriels ».
Sur de nombreuses autres questions politiques, PI n'est pas en reste et il serait fastidieux d'en faire un recensement exhaustif. Il vaut cependant la peine d'épingler un autre de ses « exploits théoriques » au cours de cette dernière décennie.
Au moment du battage idéologique le plus assourdissant des campagnes de la bourgeoisie faisant suite à l'effondrement des régimes staliniens et visant à identifier Lénine avec Staline, la révolution russe avec le Goulag et le nazisme, PI apportait sa petite pierre à cet édifice. Dans l'éditorial de son n° 20 (été 1991), illustré par une figure de Lénine d'où sortent des petites têtes de Staline, on pouvait lire ceci : « Les révolutionnaires (...) doivent détruire leur propres icônes, les statues des "chefs glorieux" (...) (ils) doivent se débarrasser de la tendance à considérer la révolution bolchevique comme un modèle (...) » Voilà la contribution théorique fondamentale de PI pour déjouer les pièges de cette campagne idéologique dont l'objectif premier est d'éradiquer et d'écarter de la conscience de la classe ouvrière toute son histoire et sa perspective historique (voir article dans cette revue). Cette persévérance de PI dans les prises de position absurdes et néfastes pour la prise de conscience du prolétariat, sa constance à vouloir élaborer des « théories » aussi fumeuses qu'incohérentes et pédantes s'expliquent tout à fait par les origines et la nature même de ce groupe : une des expressions les plus concentrées du parasitisme politique.
C. Mcl
[4] [3118]. En toute logique PI devrait bientôt abandonner la position de la Gauche communiste, qui est encore officiellement la sienne, sur l'impossibilité de réelles luttes de libération nationale en décadence.
Courants politiques:
Heritage de la Gauche Communiste:
Rapport sur la crise économique au 12° congrès du C.C.I.
- 3454 reads
Depuis 1989, les proclamations de la bourgeoisie sur la fin du communisme n'ont cessé de faire grand bruit. On nous a dit et répété que l'effondrement des régimes « communistes » était la preuve de l'impossibilité de créer une forme de société supérieure au capitalisme. On nous pousse aussi à croire que les prédictions du marxisme sur la désintégration inévitable de l'économie capitaliste sont fausses et qu'elles ne sont justes que pour le marxisme lui même. Après tout, l'histoire n'a pas été témoin de l'effondrement du capitalisme mais de celui du socialisme !
Les marxistes ont le devoir de combattre ces campagnes idéologiques et il est bon de rappeler que de telles rengaines ne sont en aucune manière nouvelles. Il y a quasiment 100 ans, les « révisionnistes » dans la seconde Internationale, éblouis par les succès d'une société bourgeoise qui était à son apogée, essayaient de mettre en avant le fait que la théorie marxiste des crises était obsolète, écartant ainsi la nécessité d'un renversement révolutionnaire du capitalisme.
L'aile gauche de la social-démocratie, avec Rosa Luxemburg en première ligne, n'a pas eu peur de s'en tenir aux « vieux » principes du marxisme et de répondre aux révisionnistes en réaffirmant que le capitalisme ne pouvait échapper à la catastrophe; et ce qui s'est passé dans les trois premières décennies du vingtième siècle a prouvé, de façon spectaculaire, qu'elle avait raison. La guerre de 1914-18 a démontré la fausseté des théories sur la possibilité d'un capitalisme évoluant pacifiquement vers le socialisme ; la période de reconstruction qui a suivi la guerre a été de courte durée et, pour l'essentiel, n'a concerné que les Etats-Unis, donnant peu de temps à la classe dominante pour se féliciter des succès de son système. De même la crise de 1929 et la profonde dépression mondiale qui a suivi donnaient encore moins de bases à la bourgeoisie pour affirmer que les prédictions économiques de Marx étaient fausses ou, au mieux, valables seulement pour le 19e siècle.
Il en a été autrement pour la période de reconstruction qui a suivi la deuxième guerre mondiale. Les taux de croissance sans précédent observés pendant cette période ont permis le développement de toute une industrie, ce qui a conduit à monter en épingle toutes les théories sur l'embourgeoisement de la classe ouvrière, sur la société de consommation, la naissance d'un nouveau capitalisme « organisé » et la fin définitive de la tendance du système à entrer en crise. Une fois de plus, on a proclamé que le marxisme était dépassé avec encore plus d'aplomb.
La crise qui s'est ouverte à la fin des années 1960 a révélé, une nouvelle fois, la vacuité de toute cette propagande. Mais elle ne l'a pas révélé d'une manière évidente, d'une façon qui puisse être appréhendée immédiatement par le plus grand nombre de prolétaires. Le capitalisme, depuis le milieu des années 1930 et surtout depuis 1945, s'était, en effet, « organisé » dans le sens où le pouvoir d'Etat avait pris la responsabilité de prévenir ses tendances à l'effondrement. Et la formation des blocs impérialistes « permanents » rendait possible le « management » du système à l'échelle de la planète. Si les formes d'organisation capitalistes d'Etat facilitaient le boom de la reconstruction d'après guerre, elles permettaient aussi un certain ralentissement de la crise, de telle façon qu'au lieu d'assister à un plongeon spectaculaire comme dans les années 1930, nous avons connu, pendant près de trente ans, une chute irrégulière, ponctuée de nombreuses « reprises » et « récessions » qui ont servi à masquer la trajectoire sous-jacente de l'économie vers la faillite totale.
Au cours de cette période, la bourgeoisie s'est pleinement servi de l'évolution lente de la crise pour développer toutes sortes « d'explications » sur les difficultés de l'économie. Dans les années 1970, les tensions inflationnistes ont été mises sur le compte de la hausse du prix du pétrole et sur celui des revendications excessives de la classe ouvrière. Au début des années 1980, le triomphe du « monétarisme » et des Reaganomics ont rejeté la faute sur les dépenses d'Etat excessives des gouvernements de gauche qui avaient sévi dans la période précédente. Dans le même temps, la gauche pouvait se permettre de souligner l'explosion du chômage qui a accompagné les nouvelles politiques et accuser de mauvaise gestion les Thatcher, Reagan et compagnie. Les deux arguments se fondaient sur une certaine réalité : celle d'un capitalisme qui, pour autant qu'il puisse être géré, ne peut l'être que par l'appareil d'Etat. Ce que de tous côtés ils cachaient, c'est le fait que le « management » est pour l'essentiel un « management » de crise. Néanmoins, le fait est que pratiquement tous les « débats » économiques que nous offrait la classe dominante tournaient autour de la question de la gestion de l'économie; en d'autres termes, la réalité du capitalisme d'Etat a été utilisée pour cacher la réalité de la crise puisque la nature incontrôlable de la crise n'est jamais admise. Cette utilisation idéologique du capitalisme d'Etat a connu un nouveau tournant en 1989 quand l'effondrement du modèle stalinien de capitalisme d'Etat, comme nous l'avons déjà dit, a tenu lieu de preuve du fait que la principale crise de la société d'aujourd'hui n'était pas celle du capitalisme mais celle du... communisme.
L'effondrement du stalinisme et les campagnes sur la « fin du marxisme » ont aussi donné lieu aux plus extravagantes promesses d'une « nouvelle ère de paix et de prospérité » qui devait inévitablement s'ouvrir. Les sept années qui ont suivi ont battu en brèches toutes ces promesses, surtout celles qui concernaient la « paix ». Mais même si sur le plan économique, les marxistes peuvent largement mettre en évidence qu'elles ont été des années de vache maigre, ils ne doivent pas sous-estimer la capacité de la bourgeoisie à cacher la nature réellement catastrophique de la crise à la classe exploitée, et donc à empêcher celle ci de développer sa conscience de la nécessité de renverser le capitalisme.
C'est pourquoi, au 11e congrès du CCI, notre résolution sur la situation internationale était obligée de commencer sa partie sur la crise économique par une dénonciation des mensonges de la bourgeoisie selon lesquels le début d'une reprise économique était en vue, en particulier dans les pays anglo-saxons. Deux ans plus tard, la bourgeoisie parle toujours de la reprise, même si elle admet qu'il y a de nombreuses rechutes et exceptions. Ici, nous voulons donc éviter de faire l'erreur (que font souvent les révolutionnaires, du fait d'un enthousiasme compréhensible de voir l'avènement de la crise révolutionnaire) de tomber dans une évaluation immédiatiste des perspectives pour le capitalisme mondial. Mais en même temps, nous allons chercher à utiliser les outils les plus affûtés de la théorie marxiste pour montrer la futilité des affirmations de la bourgeoisie et pour souligner l'approfondissement significatif de la crise historique du système.
La fausse reprise
La résolution sur la situation internationale du 11e Congrès du CCI (avril 1995) analysait les raisons des taux de croissance plus élevés dans certains pays comme suit :
« Les discours officiels sur la "reprise" font grand cas de l'évolution des indices de la production industrielle ou du redressement des profits des entreprises. Si effectivement, en particulier dans les pays anglo-saxons, on a assisté récemment à de tels phénomènes, il importe de mettre en évidence les bases sur lesquelles ils se fondent :
– le retour des profits découle bien souvent, notamment pour beaucoup de grandes entreprises, des bénéfices spéculatifs ; il a comme contrepartie une nouvelle flambée des déficits publics ; il résulte enfin de l'élimination par les entreprises des "branches mortes", c'est-à-dire de leurs secteurs les moins productifs ;
– le progrès de la production industrielle résulte pour une bonne partie d'une augmentation très importante de la productivité du travail basée sur une utilisation massive de l'automatisation et de l'informatique.
C'est pour ces raisons qu'une des caractéristiques majeures de la "reprise" actuelle, c'est qu'elle n'a pas été capable de créer des emplois, de faire reculer le chômage de façon significative de même que le travail précaire qui, au contraire, n'a fait que s'étendre, car le capital veille en permanence à garder les mains libres pour pouvoir jeter à la rue, à tout instant, la force de travail excédentaire. »
La résolution continue en mettant l'accent sur « l'endettement dramatique des Etats qui a connu, au cours des dernières années, une nouvelle flambée » et sur le fait que « s'ils étaient soumis aux mêmes lois que les entreprises privées, ils seraient déjà déclarés officiellement en faillite. » Ce recours à l'endettement permet de mesurer la faillite réelle de l'économie capitaliste, et ne peut que laisser présager des convulsions catastrophiques de tout l'appareil financier. On en a eu une indication avec la crise du peso mexicain : alors que le Mexique était considéré comme un des modèles de la « croissance » du tiers monde, le début de l'effondrement de sa monnaie a nécessité une opération de secours massive de 50 milliards de dollars pour empêcher un véritable désastre sur les marchés monétaires mondiaux. Cet épisode ne révélait pas seulement la fragilité de la croissance tant vantée des économies du tiers monde (les « dragons » d'Asie étant les plus vantés) mais aussi la fragilité de l'économie mondiale toute entière.
Un an plus tard, la résolution sur la situation internationale du 12e Congrès de RI passait en revue les perspectives tracées au 11e Congrès du CCI pour l'économie mondiale. Ce dernier avait prévu de nouvelles convulsions financières et une nouvelle plongée dans la récession. La résolution du congrès de RI énumérait les facteurs qui confirmaient cette analyse globale : des problèmes dramatiques dans le secteur bancaire et une chute spectaculaire du dollar au niveau financier; et au niveau des tendances vers la récession, les difficultés croissantes des grands modèles de croissance économique, l'Allemagne et le Japon. Ces indications de la profondeur réelle de la crise du capitalisme sont devenues encore plus significatives au cours de l'année écoulée.
L'endettement et l'irrationalité capitaliste
En décembre 1996, Alan Greenspan, le patron de la banque centrale d'Amérique, s'est levé à la fin d'un dîner chic et a commencé à parler de « l'exubérance irrationnelle » des marchés financiers. Prenant cela pour le présage d'un krach financier, les investisseurs se sont mis à vendre dans la panique partout dans le monde et des milliards en actions (25 milliards rien qu'en Grande-Bretagne) ont été liquidés tout d'un coup entraînant une des plus fortes chutes des cours depuis 1987. Les marchés financiers se sont rapidement remis de ce mini krach mais cet épisode était très significatif de la fragilité de tout le système financier. En effet, Greenspan n'avait pas tort du tout de parler d'irrationalité. Les capitalistes eux-mêmes se rendent compte de l'absurdité d'une situation dans laquelle la bourse de Wall Street tend aujourd'hui à dégringoler dès que le taux de chômage devient trop faible, car cela ravive la peur d'une « surchauffe » de l'économie et de nouvelles tensions inflationnistes. Les commentateurs bourgeois peuvent même voir qu'il y a un divorce grandissant entre les investissements spéculatifs massifs réalisés sur tous les marchés financiers du monde et l'activité productive réelle mais aussi la vente et les achats « réels ». Comme nous l'avons pointé dans notre article « Une économie de casino » (Revue internationale n° 87) écrit juste avant le mini krach de décembre, le New York Stock Exchange a récemment fêté son centième anniversaire en annonçant que l'indice Dow Jones, avec un accroissement de 620 % pendant les 14 dernières années, avait battu tous les records précédents, y compris « l'exubérance irrationnelle » qui avait précédé la crise de 1929. Plusieurs experts capitalistes ont accueilli cette nouvelle en exprimant des craintes profondes : « les cours des entreprises américaines ne correspondent plus du tout à leur valeur réelle » disait Le Monde. « Plus longtemps durera cette folie spéculative, plus élevé sera le prix à payer ensuite » disait l'analyste B.M. Biggs (cité aussi dans la Revue internationale n° 87). Le même article de la Revue signalait aussi qu'alors que le marché mondial annuel tourne autour de 3 000 milliards de dollars, les mouvements internationaux de capitaux sont estimés à 100 000 milliards de dollars, c'est-à-dire 30 fois plus. En somme, il y a un divorce croissant entre les prix des actions sur le marché financier et leur valeur réelle, ce que la bourgeoisie sait et elle en est si profondément préoccupée que quelques allusions venant d'un gourou à la tête de l'économie américaine peuvent susciter une énorme crise de confiance sur les marchés financiers mondiaux.
Ce que les capitalistes ne comprendront jamais, bien sûr, c'est que la « folie spéculative » est justement un symptôme de l'impasse dans laquelle se trouve le mode de production capitaliste. L'instabilité sous-jacente de l'appareil financier capitaliste est fondée sur le fait que l'activité économique d'aujourd'hui, pour une grande part, n'est pas « réellement » rétribuée mais se maintient grâce à une montagne de plus en plus grande de dettes. Les rouages de l'industrie, et par là de toutes les branches de l'économie, fonctionnent grâce aux dettes qui ne seront jamais remboursées. Le recours au crédit a été un mécanisme fondamental, non seulement de la reconstruction d'après guerre, mais aussi de la « gestion » de la crise économique depuis les années 1960. C'est une drogue qui a maintenu le malade capitaliste en vie pendant des décennies, mais comme nous l'avons dit très souvent, la drogue est aussi en train de le tuer.
En effet, dans sa réponse aux révisionnistes en 1889, Rosa Luxemburg a expliqué avec une grande clarté pourquoi le recours au crédit, bien qu'il semble améliorer les choses pour le capital à court terme, ne peut qu'exacerber la crise du système à long terme. Il est bon de la citer entièrement sur ce point, parce que cela projette une vive lumière sur la situation à laquelle le capitalisme se trouve confronté aujourd'hui :
« Le crédit apparaît comme le moyen de fondre en un seul capital un grand nombre de capitaux privés – sociétés par actions – et d'assurer à un capitaliste la disposition de capitaux étrangers – crédit industriel. En qualité de crédit commercial, il accélère l'échange des marchandises, par conséquent, le reflux du capital dans la production, autrement dit tout le cycle du processus de la production. Il est facile de se rendre compte de l'influence qu'exercent ces deux fonctions principales du crédit sur la formation des crises. Si les crises naissent, comme l'on sait, comme conséquence de la contradiction existant entre la capacité d'extension, la tendance à l'extension de la production et la capacité de consommation restreinte du marché, le crédit est précisément, d'après ce qui a été dit plus haut, le moyen spécifique de faire éclater cette contradiction aussi souvent que possible. Avant tout, il accroît énormément la capacité d'extension de la production et constitue la force motrice interne qui la pousse constamment à dépasser les limites du marché. Mais il frappe des deux côtés. Après avoir, en tant que facteur du processus de la production, provoqué la surproduction, il n'en détruit pas moins sûrement pendant la crise, en tant que facteur de l'échange, les forces productives éveillées grâce à lui. Au premier symptôme de la crise, le crédit fond, abandonne l'échange, là où il serait, au contraire, indispensable, apparaît, là où il s'offre encore, comme sans effet et inutile, et réduit ainsi au minimum, pendant la crise, les capacités de consommation du marché.
Outre ces deux résultats principaux, le crédit agit encore diversement sur la formation des crises. Il ne constitue pas seulement le moyen technique de mettre à la disposition d'un capitaliste des capitaux étrangers, mais il est, en même temps pour lui, le stimulant pour l'utilisation hardie et sans scrupules de la propriété d'autrui, par conséquent, pour des spéculations hasardeuses. Il n'aggrave pas seulement la crise, en qualité de moyen dissimulé d'échange des marchandises, mais il facilite sa formation et son extension, en transformant tout l'échange en un mécanisme extrêmement complexe et artificiel, avec un minimum d'argent métallique comme base réelle, et provoque ainsi, à la moindre occasion, des troubles dans ce mécanisme.
C'est ainsi que le crédit, au lieu d'être un moyen de suppression ou d'atténuation des crises, n'est, tout au contraire, qu'un moyen particulièrement puissant de formation des crises. Et il ne peut d'ailleurs en être autrement. La fonction spécifique du crédit consiste, en fait, très généralement parlant, à éliminer ce qui reste de fixité en tous les rapports capitalistes, à introduire partout la plus grande élasticité possible et à rendre toutes les forces capitalistes au plus haut point extensibles, relatives et sensibles. Il est évident qu'il ne fait ainsi que faciliter et aggraver les crises, qui ne sont autre chose que le heurt périodique entre les forces contradictoires de l'économie capitaliste. » ([1] [3119])
Sous beaucoup d'aspects, Luxemburg prédit les conditions qui prévalent aujourd'hui : le crédit comme facteur qui semble atténuer la crise mais qui l'aggrave en réalité ; le crédit comme base de la spéculation ; le crédit en tant que base d'une transformation de l'échange en un processus « complexe et artificiel » se séparant toujours plus de toute valeur monétaire réelle. Mais bien que Luxemburg, en 1898, avait déjà posé les fondements de son explication de la crise historique du système capitaliste, c'était un moment dans lequel seuls les grands traits de la décadence du capitalisme pouvaient être esquissés. Dans le processus de conquête des dernières aires non capitalistes du globe en tant que terrain pour l'extension du marché mondial, le capitalisme fonctionnaient encore selon ses propres « statuts » internes et n'était pas devenu irrationnel et absurde comme il l'est aujourd'hui. Ceci s'applique aussi bien au crédit qu'à toute autre sphère. La « rationalité » du crédit pour le capital, c'est d'emprunter ou de prêter de l'argent étant entendu qu'il servira pour élargir la production et étendre le marché. Tant que le marché peut s'étendre, les dettes peuvent être remboursées. Le crédit « a un sens » dans un système qui a un avenir. Dans l'époque décadente du capitalisme cependant, le marché, d'un point de vue global, a atteint les limites de sa capacité à s'étendre et le crédit devient lui même le marché. C'est ainsi qu'au lieu de voir les plus grands capitaux prêter à des capitaux plus faibles dans l'optique de trouver de nouveaux marchés, faire des profits et récupérer leurs prêts avec les intérêts, ce que l'on voit ce sont les grands capitaux qui distribuent d'énormes masses d'argent à des capitaux plus petits de façon à pouvoir leur vendre leurs propres produits. C'est comme cela, grossièrement parlant, que les Etats-Unis ont financé la reconstruction d'après guerre : le Plan Marshall amenait les Etats-Unis à consentir d'énormes prêts à l'Europe et au Japon pour qu'ils puissent devenir un marché pour les marchandises américaines. Et dès que les principales nations industrialisées, surtout l'Allemagne et le Japon, sont devenues des rivaux économiques des Etats-Unis, la crise de surproduction a resurgi et s'est maintenue depuis.
Mais maintenant, contrairement à ce qui se passait au moment où écrivait Luxemburg, le crédit ne disparaît plus dans une crise en éliminant les capitaux les plus faibles à la bonne vieille manière darwinienne et en réduisant les prix en rapport avec la baisse de la demande. Au contraire, le crédit est devenu de plus en plus le seul mécanisme qui maintient le capitalisme hors de l'eau. Ainsi actuellement, nous avons cette situation inédite dans laquelle non seulement les grands capitaux prêtent aux plus petits pour qu'ils puissent leur acheter leurs marchandises mais les principaux créanciers du monde ont eux-mêmes été obligés de devenir débiteurs. La situation actuelle du Japon démontre cela très précisément. Comme nous l'avons signalé dans l'article « Une économie de casino » : « Pays en excédent dans ses échanges extérieurs, le Japon est devenu le banquier international avec des avoirs extérieurs de plus de 1000 milliards de dollars (...) Le Japon constitue la caisse d'épargne de la planète, assurant à lui seul 50 % des financements des pays de l'OCDE. » Mais dans le même article, on faisait ressortir que « le Japon est très certainement l'un des pays les plus endettés de la planète. A l'heure actuelle, la dette cumulée des agents non financiers (ménages, entreprises et Etat) s'élève à 260 % du PNB, et atteindra les 400 % dans une dizaine d'années ». Le déficit budgétaire du Japon s'élevait à 7,6 % pour 1995 alors qu'il est de 2,8 % aux Etats-Unis. Pour les institutions bancaires elles mêmes, « l'économie japonaise doit faire face, dès à présent, à une montagne de 460 milliards de dollars de dettes insolvables. » Tout cela a amené les spécialistes en analyse de risques (Moody's) à classer le Japon en catégorie D; en d'autres termes, il y a là un risque financier aussi grand que pour des pays comme la Chine, le Mexique et le Brésil.
Si le Japon est le créancier du monde, d'où tire-t-il ses crédits ? C'est un écheveau que pas même un samouraï-businessman japonais versé dans le zen ne pourrait démêler. On peut se poser la même question au sujet du capitalisme américain qui est aussi, en même temps, un banquier du globe et un débiteur du globe, même si ses gouvernants ont fait la fête à propos de la réduction du déficit US (en octobre 1996, le gouvernement et l'opposition se sont précipités pour réclamer du crédit puisque le déficit budgétaire US était le plus bas depuis 15 ans, à 1,9 % du PIB).
Le fait est que cette situation absurde démontre que, malgré tous les bavardages sur les économies saines et équilibrées auxquels le gouvernement tout autant que l'opposition aiment à se laisser aller, le capitalisme ne peut plus fonctionner selon ses propres lois. Contre les économistes bourgeois de son époque, Marx écrivait des pages entières pour montrer que le capitalisme ne pouvait créer un marché illimité pour ses propres marchandises ; la reproduction élargie du capital dépend de la capacité du système à étendre constamment le marché au delà de ses propres frontières. Rosa Luxemburg a mis en évidence les conditions historiques concrètes dans lesquelles cette extension du marché ne pouvait plus avoir lieu, plongeant ainsi le système dans un déclin irréversible. Mais le capitalisme, dans notre époque, a appris à survivre à son agonie mortelle, faisant fi sans scrupule de ses propres règles. Pas de nouveaux marchés, dites-vous ? Alors, nous allons les créer même si cela signifie la faillite, stricto sensu, pour chacun, y compris les plus riches Etats de la planète. De cette façon, le capitalisme a évité, depuis les années 1960, le type de krach brutal, déflationniste qu'il avait connu au 19e siècle et qui avait encore été la forme prise par la crise de 1929. Dans la période actuelle, les récessions périodiques et les ratées au niveau financier ont la fonction de laisser échapper un peu de la vapeur que l'endettement global produit dans la cocotte minute du capitalisme. Mais ils laissent aussi présager des explosions beaucoup plus sérieuses à venir. L'effondrement du bloc de l'Est devrait servir partout d'avertissement à la bourgeoisie ; elle ne peut tricher indéfiniment avec la loi de la valeur. Tôt ou tard, celle-ci va se réinstaurer d'elle même et plus on a triché avec elle, plus sa vengeance sera dévastatrice. En ce sens, comme Rosa Luxemburg l'avait souligné : « le crédit est loin d'être un moyen d'adaptation du capitalisme. C'est au contraire un moyen de destruction d'un effet des plus révolutionnaires. » (Idem)
Les limites de la croissance : la crise aux Etats-Unis, en Grande Bretagne, en Allemagne et au Japon
La résolution du 11e congrès du CCI était donc parfaitement correcte lorsqu'elle parlait de la perspective d'une instabilité financière croissante. Mais jusqu'à quel point s'est vérifiée la perspective d'un nouvelle plongée dans la récession ? Avant de regarder ce point en détail, nous devons nous rappeler qu'il y a un danger dans le fait de prendre pour argent comptant les analyses et la terminologie de la bourgeoisie. Evidemment, pour la classe dominante, il n'existe nullement une crise irréversible de son mode de production. Manquant de toute vision historique large, sa vision de l'économie, même quand elle parle de « macro-économie », est nécessairement immédiatiste. Quand elle parle de « croissance » ou de « récession », elle n'utilise que les indicateurs économiques les plus superficiels et ne se pose pas de questions sur les bases réelles des accès de croissance qu'elle constate, ni sur la signification réelle des moments qu'elle décrit comme de la récession. Comme nous avons eu l'occasion de le souligner précédemment, les périodes de croissance sont généralement des expressions d'une récession cachée et ne mettent en aucune façon en question la tendance générale de l'économie capitaliste à aller vers une impasse insoluble. Pour démontrer l'existence de la crise, il n'est pas nécessaire de montrer que chaque pays dans le monde a un taux de croissance négatif. De plus, les statistiques économiques bourgeoises nous renseignent très peu sur les effets réels de la crise sur des millions d'êtres humains. Le Bilan du monde du journal Le Monde pour 1995 nous dit, par exemple, que les pays d'Afrique avaient connu des taux de croissance de 3,5 % pour cette année là et qu'on s'attendait à ce qu'ils augmentent encore l'année suivante. De telles appréciations servent seulement à masquer le fait que dans des parties entières du continent africain, la société s'est effondrée dans un cauchemar de guerre, de maladie et de famine, toutes choses qui sont, au sens global, des effets de la crise économique dans les pays « sous-développés » mais qui n'entrent jamais dans les considérations des experts « économiques » de la bourgeoisie parce que ce sont des effets historiques et non immédiats.
Dans la situation actuelle, il est d'autant plus important de garder cela présent à l'esprit qu'un grand nombre d'éléments, en apparence contradictoires, apparaissent. La « reprise » centrée sur les pays « anglo-saxons » a un peu vacillé selon les propres termes de la bourgeoisie, tandis que la plupart de ses grands prêtres restent « sereinement optimistes » sur les perspectives de croissance. Par exemple, le Sunday Times du 29 décembre 1996 a fait un tour des prévisions que font les experts US pour l'économie américaine en 1997, sur la base des performances de 1996 : « Notre tour des pronostiqueurs américains commence avec la revue des 50 meilleurs pratiquants de cet art du Business Week. En moyenne, ces prophètes s'attendent à ce que 1997 soit une répétition de 1996. Il est prévu que le produit intérieur brut s'accroisse régulièrement au taux annuel de 2,1 % et que les prix à la consommation augmentent de 3 %... le taux de chômage devrait rester faible, à 5,4 % et le taux d'intérêt à trente ans devrait rester voisin du niveau actuel à 6,43 %. » En effet, le principal débat chez les économistes américains aujourd'hui est celui de savoir si la poursuite de la croissance va engendrer une inflation excessive ; c'est une question sur laquelle on reviendra plus tard.
La bourgeoisie anglaise, ou du moins son équipe gouvernementale ([2] [3120]), a troqué son style pour celui des américains et au lieu d'être prudemment optimiste, en rajoute en toute occasion. Selon le Chancelier de l'Echiquier, l'économie britannique est « au mieux de sa forme pour une génération ». Parlant le 20 décembre 1996, il a cité des tableaux de l'Office des Statistiques Nationales qui « prouvent » que le revenu réel disponible s'est accru de 4,6 % dans l'année ; les dépenses de consommation ont augmenté de 3,2 %; la croissance économique globale atteint 2,4 % alors que le déficit commercial a aussi diminué. Dans le même mois, le chômage officiel, en diminution générale depuis 1992, est passé au dessous de deux millions pour la première fois depuis 5 ans. En janvier, différents instituts de prévisions, tels que Cambridge Econometrics et Oxford Economic Forecasting ont prévu que 1997 serait plus ou moins semblable, avec des taux de croissance aux alentours de 3,3 %. En Grande-Bretagne aussi, la préoccupation des experts dont on parle le plus est qu'il va y avoir une « surchauffe » de l'économie qui pourrait provoquer une nouvelle poussée de l'inflation.
Comme nous l'avons vu, le CCI a déjà analysé les raisons de la bonne performance relative des pays anglo-saxons ces dernières années. A part les facteurs cités dans la résolution de notre 11e Congrès, nous avons aussi souligné, dans le cas des Etats-Unis, « des attaques d'une brutalité sans précédent contre les ouvriers qu'elle exploite (dont beaucoup sont contraints d'occuper plusieurs emplois pour survivre) et aussi à la mise en oeuvre de tous les moyens que lui donne son statut de superpuissance, les pressions financières, monétaires, diplomatiques et militaires au service de la guerre commerciale qu'elle livre à ses concurrents ». ([3] [3121]). Dans le cas de la Grande-Bretagne, le rapport pour le 12e Congrès de World Revolution (voir World Revolution n° 200) a confirmé à quel degré cette « reprise » a été fondée sur l'endettement, la spéculation, l'élimination des branches mortes et l'utilisation massive de l'automatisation et des technologies informatiques. Il souligne aussi les avantages spécifiques que la Grande-Bretagne a obtenus en se retirant du « serpent monétaire européen » en 1992 et de la dévaluation de la Livre qui s'en est suivi, ce qui a grandement augmenté ses exportations. Mais le rapport détaille aussi l'appauvrissement réel de la classe ouvrière sur lequel a été fondée cette « reprise » (taux d'exploitation accrus, déclin des services sociaux, augmentation des sans logis, etc.) tout en montrant les mensonges de la bourgeoisie sur la baisse du chômage : depuis 1979, la bourgeoisie britannique a modifié les critères de ses statistiques du chômage 33 fois. La définition actuelle, par exemple, ignore tous ceux qui sont devenus « économiquement inactifs », c'est-à-dire ceux qui ont finalement abandonné la recherche d'un travail. Cette fraude a même été confessée par la Banque d'Angleterre : « Presque toute l'amélioration au niveau des performances concernant le chômage dans les années 90 par rapport aux années 80 est à mettre sur le compte de la montée de l'inactivité. » ([4] [3122]) Idem pour « les plus hauts standards de vie depuis une génération » claironnés par Mr Clark.
Mais alors que les marxistes sont toujours obligés de montrer le coût réel de la croissance capitaliste pour la classe ouvrière, se contenter de souligner la misère des ouvriers ne suffit pas en soi à prouver que l'économie capitaliste est en mauvais état. Si c'était le cas, le capitalisme n'aurait alors jamais eu de phase ascendante, puisque l'exploitation des ouvriers au 19e siècle était, comme chacun le sait, absolument sans limite. Pour montrer que les prévisions optimistes de la bourgeoisie sont basées sur du sable, nous devons analyser les tendances plus profondes de l'économie mondiale. Et là, nous devons examiner ces pays dont les difficultés économiques indiquent le plus clairement où en sont les choses. Comme le faisait ressortir la résolution du 12e Congrès de RI, l'évolution la plus significative à ce niveau, dans les dernières années, a été le déclin de ces deux économies « locomotives » : l'Allemagne et le Japon.
La dernière conférence territoriale de Welt Revolution a identifié des éléments confirmant ce déclin en ce qui concerne l'Allemagne. Ceux-ci comprennent :
– Le rétrécissement du marché interne : pendant des décennies, l'économie allemande représentait un grand marché pour les européens et l'économie mondiale. Avec la paupérisation croissante de la classe ouvrière, cela a cessé d'être le cas. En 1994, par exemple, les dépenses pour la nourriture ont diminué de 6 % à 20 %. Plus généralement, les investissements intérieurs seront inférieurs de 8 % cette année ; les investissements dans la construction et les équipements sont quelques 30 % en dessous du pic de 1992. Le turnover réel a diminué de 2 % en 1995. Mais l'aspect le plus significatif à cet égard est certainement le fait que le chômage se situe maintenant bien au dessus des quatre millions : selon l'Office du Travail d'Allemagne, il pourrait atteindre les 4,5 millions dans les prochains mois. C'est la démonstration la plus claire de la paupérisation de la classe ouvrière allemande et de sa capacité déclinante à servir de marché pour le capital allemand et mondial.
– Le fardeau croissant de l'endettement : en 1995, le déficit d'Etat (fédéral, länder et municipalités) atteignait 1 446 milliards de DM ; avec en plus 529 autres milliards de DM « cachés », la dette avoisinait les 2000 milliards de DM, ce qui correspond à 57,6 % du PNB. En dix ans, la dette publique a augmenté de 162 %.
– Le coût croissant de l'entretien de la classe ouvrière : la croissance du chômage augmente encore l'insolvabilité de l'Etat qui est confronté à une classe ouvrière qui n'est pas battue et qui ne peut pas laisser simplement les chômeurs mourir de faim. En dépit de toutes les fameuses mesures d'austérité introduites par le gouvernement Kohl l'année dernière, l'Etat a encore une énorme note à payer pour soutenir les chômeurs, les vieux retraités, les malades. Quelques 150 milliards sur un budget fédéral de 448 milliards de DM sont dépensés en rétributions sociales à la classe ouvrière. L'Office Fédéral du Chômage a un budget de 104,9 milliards DM et se trouve déjà en faillite.
– L'échec de la bourgeoisie allemande dans la construction d'un « paysage industriel » à l'est : malgré les dépenses gigantesques à l'est après la réunification, l'économie n'y a pas décollé. Une grande partie de l'argent est allée aux infrastructures, télécommunications et habitations mais peu dans de nouvelles industries. Au contraire, toutes les anciennes usines, obsolètes, ont fait faillite; et quand il y en a de nouvelles (des usines modernisées ont été installées), elles absorbent moins de 10 % de l'ancienne force de travail. L'armée des chômeurs reste mais « bénéficie » de télécommunications sophistiquées et de belles nouvelles routes.
Tous ces facteurs entravent sérieusement la compétitivité de l'Allemagne sur le marché mondial et obligent la bourgeoisie à attaquer sauvagement tous les aspects des conditions de vie de la classe ouvrière : salaires, avantages sociaux et emplois. La fin de l'« Etat social » allemand est aussi la fin de beaucoup de mythes capitalistes : celui consistant à faire croire que travailler beaucoup et être socialement passif donne aux ouvriers des niveaux de vie élevés, celui de la nécessaire et profitable collaboration entre patrons et ouvriers et enfin celui d'un modèle allemand de prospérité censé montrer aux autres pays la marche à suivre. Mais c'est aussi la fin d'une réalité pour le capital mondial : la capacité de l'Allemagne d'agir comme une locomotive. Au contraire, c'est le déclin même du capital allemand, et non la « reprise » superficielle dont se vantent les bourgeoisies américaine et anglaise, qui montre ce qu'est la perspective réelle pour le système tout entier.
La fin du « miracle » économique japonais est tout aussi significative. C'était déjà devenu visible au début des années 1990 quand les taux de croissance – qui s'étaient élevés jusqu'à 10 % dans les années 1960 – se sont effondrés jusqu'à ne pas dépasser 1 %. Le Japon est maintenant « officiellement » en récession. Il y a eu une légère amélioration en 1995 et en 1996 qui a amené certains commentateurs à devenir enthousiastes à propos des perspectives pour l'année qui vient : un article publié dans The Observer en janvier 1996, soulignait les performances « impossibles à arrêter » de l'exportation japonaise (un accroissement de 10 % en 1994 qui signifiait que le Japon avait maintenant surpassé les Etats-Unis en tant que plus grand exportateur mondial de biens manufacturés). Il annonçait avec confiance que « le Japon était de nouveau aux commandes de l'économie mondiale ».
Notre récent article, « Une économie de casino » soufflait le froid sur de telles espérances. Nous avons déjà mentionné la montagne de dettes qui pèse sur l'économie japonaise. L'article poursuit en insistant sur le fait que « tout ceci vient relativiser l'annonce au Japon des quelques frémissements de croissance à la hausse après ces quatre années de stagnation. Nouvelle apaisante pour les médias bourgeois, elle n'illustre en fait que l'extrême gravité de la crise. Et pour cause, ce résultat n'a péniblement été atteint qu'à la suite d'une injection de doses massives de liquidités financières à travers la mise en oeuvre de cinq plans de relance. Cette expansion budgétaire, dans la plus pure tradition keynésienne, a bien fini par porter quelques fruits..., mais au prix de déficits encore plus colossaux que ceux dont les conséquences avaient déterminé l'entrée du Japon dans la phase récessive. Ceci explique que cette "reprise" demeure on ne peut plus fragile et est vouée à terme à retomber comme un soufflé. »
Le dernier rapport de l'OCDE sur le Japon (2 janvier 1997) confirme pleinement cette analyse. Bien que le rapport prédise une hausse des taux de croissance pour 1997 (autour de 1,7 %), il insiste lourdement sur la nécessité de s'attaquer à la question de la dette. « La conclusion du rapport est que, alors que le stimulus fiscal de la dernière année et demie était crucial pour compenser l'impact de la récession, le Japon doit à moyen terme contrôler son déficit budgétaire pour réduire la dette accumulée par le gouvernement. Cette dette représente 90 % du rendement annuel de l'économie. » ([5] [3123]). L'OCDE réclame une augmentation des taxes sur les ventes mais surtout des réductions drastiques des dépenses publiques. Elle affiche ouvertement sa préoccupation à propos de la santé économique du Japon à plus long terme. En bref, ce brain-trust dirigeant de la bourgeoisie ne fait aucun effort pour cacher la fragilité de toute « reprise » au Japon, et s'inquiète clairement de voir l'économie s'enfoncer dans des problèmes encore plus grands dans le futur.
Quand cela concerne des pays comme l'Allemagne et le Japon, les inquiétudes de la bourgeoisie sont très bien fondées. C'était avant tout la reconstruction de ces économies démolies par deux guerres qui a fourni le stimulant du grand boom des années 1950 et 1960 ; c'est l'achèvement de cette reconstruction dans ces deux pays qui a provoqué le retour de la crise ouverte de surproduction à la fin des années 1960. Aujourd'hui, l'échec de plus en plus évident de ces deux économies représente un rétrécissement significatif du marché mondial et c'est le signe que l'économie globale entre en chancelant dans une nouvelle étape de son déclin historique.
Les « Dragons » blessés
Déçue par les difficultés du Japon, la bourgeoisie et ses médias ont essayé de créer de nouveaux faux espoirs en faisant ressortir les performances des « dragons » de l'Asie du sud-est, c'est-à-dire des économies comme celles de la Thaïlande, de l'Indonésie et de la Corée du Sud, dont les taux de croissance vertigineux ont été pris comme emblème, de même que la Chine future qui est présentée comme étant sur la voie d'un statut de « superpuissance économique » à la place du Japon.
Le problème est que, comme dans les précédents « succès » de certains pays du tiers-monde comme le Brésil et le Mexique, la croissance des dragons d'Asie est une bulle gonflée par l'endettement qui peut éclater à tout moment. Les grands investisseurs occidentaux le savent :
« Parmi les raisons qui ont rendu les pays industriels les plus riches si soucieux de doubler la ligne des crédits de secours du FMI jusqu'à 850 milliards, il y a celle qu'une nouvelle crise du style Mexique est à craindre, cette fois dans le sud-est asiatique. Le développement des économies dans le Pacifique a favorisé un flux énorme de capital dans le secteur privé, qui a remplacé l'épargne intérieure, conduisant à une situation financière instable. La question a été de savoir quel serait le premier des dragons d'Asie à tomber.
Certes la situation en Thaïlande commence à paraître hasardeuse. Le ministre des finances, Bodi Chunnananda, a démissionné alors que les investisseurs perdaient confiance et que la demande dans des secteurs clefs, y compris la construction, le foncier et la finance, tous symboles d'une économie de bulle, se réduisait. De la même façon, on a focalisé sur une certaine incertitude récente en Indonésie, puisque la stabilité du régime Suharto et son respect des droits de l'homme sont devenus un problème. » ([6] [3124])
Le plus frappant, c'est la situation économique et sociale en Corée du Sud. La bourgeoisie ici, s'inspirant de ses consoeurs européennes, a certainement entraîné les ouvriers dans une manoeuvre à grande échelle : en décembre 1996, des dizaines de milliers d'ouvriers se sont mis en grève contre les nouvelles lois sur le travail qui ont été présentées comme étant surtout une attaque de la démocratie et des droits syndicaux, permettant ainsi aux syndicats et aux partis d'opposition de détourner les travailleurs de leur propre terrain. Mais derrière l'attaque provocatrice du gouvernement, il y a une réponse réelle à la crise à laquelle est confrontée l'économie de la Corée du Sud : l'aspect central de cette loi est qu'elle rend beaucoup plus facile aux entreprises les licenciements d'ouvriers et l'établissement des horaires de travail ; et c'est clairement compris par les ouvriers comme une préparation à des attaques contre leurs conditions d'existence.
En ce qui concerne le fait que la Chine serait en train de devenir une nouvelle génératrice de croissance économique, c'est plus que jamais une sinistre farce. C'est vrai que la capacité du régime stalinien dans ce pays à s'adapter et à survivre alors que tant d'autres se sont effondrés est remarquable en tant que telle. Mais ce n'est ni le niveau de libéralisation économique, ni « l'ouverture à l'ouest », ni l'exploitation de nouveaux débouchés qui lui seront offerts par la cession de Hongkong, qui transformeront les fondements de l'économie chinoise, qui reste désespérément arriérée dans l'industrie, l'agriculture et les transports et paralysée de façon chronique, comme tous les régimes staliniens, par le poids d'une bureaucratie boursouflée et du secteur militaire. Comme dans tous les régimes déstalinisés, la libéralisation a en effet gratifié la Chine d'exploits du même type qu'en Occident... tels que le chômage massif. Le 14 octobre, le China Daily, à la solde du gouvernement, admettait que le nombre de chômeurs pouvait augmenter de plus de la moitié du chiffre actuel jusqu'à atteindre 258 millions en quatre ans. Avec des millions de migrants des campagnes qui inondent les villes et des entreprises d'Etat en faillite qui cherchent désespérément à se débarrasser du « surplus » de travailleurs, la bourgeoisie chinoise est profondément inquiète du danger d'une explosion sociale. Selon les chiffres officiels, 43 % des entreprises d'Etat ont perdu de l'argent en 1995, alors que dans le premier trimestre 1996, le secteur d'Etat tout entier tournait à perte. Des centaines de milliers, si ce n'est des millions, d'ouvriers dans les entreprises d'Etat n'ont pas reçu de salaire depuis des mois ([7] [3125]). Il est vrai qu'une proportion croissante du revenu industriel de la Chine provient d'entreprises privées ou mixtes mais, même si ces secteurs montrent qu'ils sont plus dynamiques, ils peuvent difficilement compenser le poids énorme de la banqueroute dans le secteur directement étatique.
Chaque fois qu'un mythe s'écroule et menace de dévoiler la faillite de tout le système capitaliste, la bourgeoisie en propose de nouveaux. Il y a quelques années, c'étaient les miracles allemand et japonais ; puis, après l'effondrement du bloc de l'est, c'étaient les lendemains qui chantent grâce aux « nouveaux marchés » en Europe de l'Est et en Russie. Dès que ces mythes se sont écroulés ([8] [3126]), on s'est mis à nous parler des « dragons » du sud-est asiatique et de la Chine. Aujourd'hui, de plus en plus de ces petits « rois » font la preuve qu'ils sont nus. Peut-être que le nouveau grand espoir pour l'économie mondiale sera la performance de la livre sterling du Royaume-Uni. Après tout, ce pays n'était-il pas le laboratoire du monde capitaliste au siècle dernier ? John Bull n'est-il pas capable aujourd'hui de tout recommencer depuis le début ? C'est à ce point qu'en est la faillite non seulement du capitalisme mondial mais aussi des mythes qu'il utilise pour la cacher.
Perspectives
1. Une guerre commerciale plus aiguë
Un autre mythe utilisé pour répandre l'idée qu'il y a encore plein de vie dans le capitalisme, c'est la fable de la globalisation. Dans l'article « Derrière la "mondialisation" de l'économie, l'aggravation de la crise du capitalisme » (Revue Internationale n° 86), nous montrions, pour contrer quelques confusions qui affectent même le milieu révolutionnaire, que la mondialisation, malgré les beaux discours de la bourgeoisie, ne signifie en rien une nouvelle phase dans la vie du capitalisme, une ère de « liberté de commerce » dans laquelle l'Etat national aurait de moins en moins de rôle à jouer. Au contraire, l'idéologie de la mondialisation – mis à part son intérêt pour agiter la question du nationalisme dans la classe ouvrière – est en réalité une couverture pour une guerre commerciale qui s'approfondit. Nous donnions alors l'exemple de la nouvelle Organisation Mondiale du Commerce (OMC) pour montrer comment les économies les plus puissantes – les Etats-Unis en particulier – utilisent cette institution pour imposer des standards de santé et de bien-être que les économies plus faibles ne peuvent espérer atteindre, les handicapant ainsi en tant que rivales économiques potentielles. La rencontre ministérielle de décembre 1996 de l'OMC a continué dans la même veine. Là, les pays les plus développés ont semé la division chez les plus faibles pour saboter un plan visant à donner à quelques pays parmi les plus pauvres l'accès hors douane aux marchés occidentaux. Les américains ont fait des concessions sur les tarifs du Whisky et autres alcools de façon à réaliser quelque chose de beaucoup plus lucratif : l'ouverture des marchés européens et asiatiques aux produits de la technologie de l'information. C'est là une preuve éclatante que la « mondialisation », la nouvelle « liberté de commerce », veulent surtout dire « liberté » pour le capital américain de pénétrer sur les marchés mondiaux sans avoir l'inconvénient de voir leurs concurrents plus faibles protéger leurs propres marchés avec des barrières douanières. Notre article dans la Revue soulignait déjà que c'était surtout une « liberté » à sens unique : « Clinton lui même – qui, en 1995, parvint à faire en sorte que le Japon ouvre ses frontières aux produits américains et qui, sans relâche, demande à ses "associés" la "liberté de commerce" – donna l'exemple, dès son élection, par l'augmentation des taxes sur les avions, l'acier et les produits agricoles, limitant en outre les achats de produits étrangers aux agences étatiques. »
Nous avons déjà souligné que la capacité de l'Amérique à jouer les gros bras à l'échelle internationale a été un énorme facteur de la force relative de l'économie des Etats-Unis au cours des dernières années. Mais cela éclaire aussi une autre caractéristique de la situation actuelle : le lien de plus en plus grand entre guerre commerciale et compétition inter-impérialiste.
Evidemment, ce lien est un produit à la fois des conditions générales de la décadence, dans laquelle la concurrence économique est de plus en plus subordonnée aux rivalités militaires et stratégiques, et des conditions spécifiques prévalant depuis l'effondrement du vieux système des blocs. La période des blocs mettait en lumière la subordination des rivalités économiques aux rivalités militaires puisque les deux superpuissances n'étaient pas les principaux rivaux économiques. En contraste, les déchirures impérialistes qui se sont ouvertes depuis 1989 correspondent beaucoup plus étroitement à des rivalités économiques directes. Mais ceci n'a pas détrôné la domination des considérations stratégico-impérialistes. Au contraire, la guerre commerciale s'est avérée de plus en plus comme un instrument de ces dernières.
Cela a été très clair avec la loi Helms-Burton qu'ont édictée les Etats-Unis. Cette loi fait des incursions sans précédent dans « les droits commerciaux » des principaux rivaux impérialistes et économiques de l'Amérique, interdisant le commerce avec Cuba sous peine de sanctions. C'est très clairement une réponse provocatrice des Etats-Unis aux puissances européennes qui défient leur hégémonie mondiale, un défi lancé non seulement dans des pays « lointains » comme les Balkans et le Moyen-Orient mais aussi dans le « pré carré » américain, l'Amérique latine y inclus Cuba même.
Les puissances européennes ne sont pas restées les bras croisés face à cette provocation. L'Union Européenne a traîné les Etats-Unis devant le tribunal de la nouvelle Organisation Mondiale du Commerce à Genève, demandant le retrait de la loi Helms-Burton. Ceci confirme ce que nous disions dans notre article sur la mondialisation, que la formation de conglomérats commerciaux régionaux comme l'Union Européenne correspond aux « besoins de groupes de nations capitalistes de créer des zones protégées à partir desquelles elles peuvent affronter des rivaux plus puissants » ([9] [3127]). L'Union Européenne est donc un instrument de la guerre commerciale mondiale et les avancées actuelles vers une seule monnaie européenne ont été vues en fonction de cela. Mais elle a plus qu'une fonction purement « économique ». Comme nous l'avons vu au cours de la guerre en ex-Yougoslavie, elle peut servir comme un instrument plus direct de confrontation inter-impérialiste.
Naturellement, l'Union Européenne est elle-même gangrenée par des divisions national-impérialistes profondes, comme l'ont montré récemment les désaccords entre l'Allemagne et la France d'un côté et la Grande-Bretagne de l'autre, sur la monnaie unique. Dans le contexte général du « chacun pour soi », on peut s'attendre à voir les rivalités autant commerciales qu'impérialistes prendre de plus en plus une allure chaotique, aggravant l'instabilité de l'économie mondiale ; et, comme chaque nation est obligée de barricader son capital national, cela accélérera encore plus la contraction du marché mondial.
2. Inflation et dépression
Quel que soit le fil qu'essaie de tirer la bourgeoisie, le capitalisme mondial est ainsi à deux doigts de tomber dans de grandes convulsions économiques, à une échelle sans comparaison avec ce que nous avons vu dans les trente dernières années. C'est certain ! Ce qui ne peut pas être aussi clair pour les révolutionnaires, ce n'est pas seulement l'échéance exacte de telles convulsions (et on ne rentrera pas dans le jeu des prédictions ici), mais aussi la forme précise qu'elles prendront.
Après l'expérience des années 1970, l'inflation a été présentée par la bourgeoisie comme le monstre qu'il fallait éliminer à tout prix : les politiques massives de désindustrialisation et de coupes dans les dépenses publiques défendues par Thatcher, Reagan et les autres monétaristes étaient fondées sur l'argument que l'inflation était le danger numéro un pour l'économie. Au début des années 1990, l'inflation, au moins dans les principaux pays industriels, semblait avoir été domptée, au point que quelques économistes ont commencé à parler de la victoire historique sur l'inflation. On peut se demander si, en fait, nous n'assistons pas au retour, au moins en partie, à une crise de type déflationniste comme cela a été le cas au début des années 1930 : une crise « classique » de surproduction dans laquelle les prix s'effondrent avec la contraction brutale de la demande.
Par ailleurs, il faut noter que cette tendance a commencé à s'inverser après 1936, quand l'Etat est intervenu massivement dans l'économie : le développement de l'économie de guerre et la stimulation de la demande par les dépenses du gouvernement ont fait apparaître des pressions inflationnistes. Cette modification a été encore plus apparente lors de la crise qui s'est ouverte à la fin des années 1960. La première réponse de la bourgeoisie a été de continuer les politiques « keynésiennes » des décennies précédentes. Ceci a eu pour effet de ralentir le rythme de la crise mais a eu comme résultat des niveaux d'inflation dangereux.
Le monétarisme s'est présenté comme une alternative radicale au keynésiannisme, comme un retour aux valeurs sûres du capitalisme, c'est-à-dire de ne dépenser que l'argent qui a été réellement obtenu, de « vivre selon ses moyens », etc. Il prétendait démanteler l'appareil d'Etat hypertrophié et quelques révolutionnaires s'y sont même laissés prendre et ont parlé de « renversement » du capitalisme d'Etat. En réalité, le capitalisme ne peut plus retourner aux formes et aux méthodes qu'il avait dans sa jeunesse. Le capitalisme sénile ne peut plus se maintenir sans la béquille d'un appareil d'Etat hypertrophié ; et si les Thatcheriens ont fait des coupes claires dans les dépenses d'Etat, dans quelques secteurs et spécialement ceux qui avaient quelque chose à voir avec le salaire social, ils ont à peine touché à l'économie de guerre, à la bureaucratie ou à l'appareil de répression. Bien plus, la tendance à la désindustrialisation a fait croître le poids des secteurs improductifs sur l'économie prise comme un tout. En bref, les « nouvelles politiques » de la bourgeoisie n'ont pas pu éliminer les facteurs sous-jacents aux tendances inflationnistes du capitalisme décadent du fait de la nécessité de maintenir un énorme secteur improductif ([10] [3128]).
Un autre facteur de la plus grande importance dans cette équation est la dépendance de plus en plus grande du système vis-à-vis du crédit que nous avons déjà évoquée. Le niveau extrêmement élevé d'endettement des gouvernements montre comment la bourgeoisie a été peu capable de rompre avec les politiques « keynésiennes » du passé. En fait, c'est le manque de marchés solvables qui fait qu'il est impossible à la bourgeoisie, quel que soit le vernis idéologique de ses équipes gouvernementales, d'échapper à la nécessité de créer un marché artificiel. Aujourd'hui, la dette est devenue le principal marché artificiel pour le capitalisme, mais au départ les mesures proposées par Keynes amenaient tout droit dans cette direction.
Si nous gardons cela à l'esprit, cela jettera quelque lumière sur quelques uns des plus récents discours de la bourgeoisie. Il semble que sa confiance dans la « victoire historique » contre l'inflation ne soit pas si profonde puisque dès qu'elle détecte des signes d'un retour à la croissance dans des pays comme l'Angleterre et l'Amérique, elle recommence à parler du danger d'une nouvelle poussée de l'inflation. Les économistes ont des avis différents sur les causes : certains sont en faveur de la thèse de l'inflation par les coûts, avec une insistance particulière sur le danger que représentent des revendications de salaire irréalistes. L'idée est que si les ouvriers n'ont plus peur du chômage et voient des profits se réaliser, ils vont se mettre à réclamer plus d'argent et cela causera de l'inflation. L'autre thèse est que l'inflation est « tirée par la demande » : si l'économie croît trop vite, la demande va excéder l'offre et les prix vont augmenter. Nous ne répéterons pas les arguments que nous avons développés il y a 25 ans contre ces théories. Ce que nous dirons, c'est que le vrai danger de la « croissance » qui conduirait à l'inflation se situe ailleurs : dans le fait que toute croissance, toute prétendue reprise est basée sur une augmentation considérable de l'endettement, sur la stimulation artificielle de la demande, c'est-à-dire sur du capital fictif. C'est cela la matrice qui donne naissance à l'inflation parce qu'elle exprime une tendance profonde dans le capitalisme décadent : le divorce grandissant entre l'argent et la valeur, entre ce qui se passe dans le monde « réel » de la production des biens et un processus d'échanges qui est devenu « un mécanisme tellement complexe et artificiel » que même Rosa Luxemburg serait sidérée si elle pouvait voir cela aujourd'hui.
Si nous cherchions un modèle d'effondrement d'une économie qui a renversé la loi de la valeur, c'est-à-dire l'effondrement d'une économie capitaliste d'Etat, nous devrions regarder ce qui est en train d'arriver dans les pays de l'ex-bloc de l'est. Ce que nous y voyons ce n'est pas seulement un effondrement de la production à une échelle beaucoup plus grande que pendant la crise de 1929 mais aussi une tendance à l'inflation incontrôlable et la gangstérisation de l'économie. Est-ce la forme que cela prendra à l'ouest ?
CCI
[10] [3138] Voir à ce sujet « Surproduction et Inflation » dans World Revolution n° 2 et Révolution internationale n° 6, décembre 1973.
Questions théoriques:
- L'économie [86]
Heritage de la Gauche Communiste:
Les falsifications de la révolution de 1917 - Le mensonge communisme = stalinisme = nazisme
- 4431 reads
Après huit années d'une campagne de propagande intensive dédiée à la prétendue « mort du communisme », la bourgeoisie mondiale a répondu au 80e anniversaire de la révolution russe d'octobre 1917 en simulant une grande indifférence et un désintérêt pour les évènements révolutionnaires de l'époque. Dans la plupart des pays, y compris en Russie même, cet anniversaire a été relégué à la seconde ou à la troisième place des informations télévisées. Le lendemain, la presse commentait l'événement en déclarant que la révolution russe avait perdu toute valeur pour le monde actuel et ne comportait désormais d'intérêt que pour les historiens. Et les mouvements de protestation ouvriers qui avaient lieu à peu près au même moment fournissaient aux médias une occasion de souligner avec une satisfaction notable que la lutte de classe elle-même était maintenant « libérée de la confusion idéologique et de la poursuite de buts finaux dangereusement utopiques. » ([1] [3139])
En fait, cette indifférence feinte pour la révolution prolétarienne, qui n'aurait d'intérêt que pour la « science historique » bourgeoise « dépassionnée », représente une nouvelle étape, qualitativement supérieure de l'attaque capitaliste contre l'Octobre rouge. Sous couvert d'étudier les résultats des recherches de ses historiens, la classe dominante a lancé, à travers un « débat public », une nouvelle campagne à l'échelle mondiale contre « les crimes du communisme ». Ce « débat » fait porter à la révolution russe et au parti bolchevik non seulement la responsabilité des crimes de la contre-révolution capitaliste stalinienne mais également indirectement celle des crimes du nazisme puisque « la dimension et les techniques de la violence de masse ont été inaugurées par les communistes et que (...) les nazis s'en sont inspirés » ([2] [3140]). Pour les historiens bourgeois, le crime fondamental commis par la révolution russe, c'est d'avoir remplacé la « démocratie » par une idéologie « totalitaire » menant à l'extermination systématique de l'« ennemi de classe ». Le nazisme, nous dit-on, a surgi en s'inspirant de cette tradition non démocratique de la révolution russe : il n'a fait que remplacer la « guerre de classe » par la « guerre de races ». La leçon que la bourgeoisie tire de la barbarie de son propre système décadent, c'est que la démocratie bourgeoise, précisément parce qu'elle n'est pas un « système parfait » mais laisse une place à la « liberté individuelle », constitue ce qu'il y a de plus adapté à la nature humaine et que toute tentative de la mettre en question ne peut que mener à Auschwitz ou au Goulag.
Depuis 1989, l'efficacité de l'attaque de la bourgeoisie contre le communisme et la révolution russe s'appuyait principalement sur l'impact réel qu'avait eu l'effondrement des régimes staliniens à l'Est avec l'énorme propagande présentant cet effondrement comme celui du communisme. La bourgeoisie n'avait même pas à chercher des arguments historiques pour défendre ce mensonge. Aujourd'hui l'impact de ces campagnes s'est affaibli avec l'incapacité du capitalisme et de la démocratie bourgeoise « style occidental », prétendument victorieux, à mettre un terme au déclin économique et à la paupérisation de masse ni à l'est, ni à l'ouest. Bien que la combativité et surtout la conscience du prolétariat aient été sévèrement atteintes par les événements et la propagande qui ont suivi la chute du mur de Berlin, la classe ouvrière n'a pas adhéré massivement à la défense de la démocratie bourgeoise et reprend lentement le chemin de la lutte et de la combativité contre les attaques capitalistes. Au sein de petites minorités politisées dans le prolétariat se manifeste un renouveau d'intérêt pour l'histoire de la classe ouvrière en général et pour celle de la révolution russe et de la lutte des courants marxistes contre la dégénérescence de l'Internationale en particulier. Aussi, même si la bourgeoisie contrôle relativement facilement la situation sociale au niveau immédiat, ses inquiétudes face à l'effondrement progressif de son économie et face au potentiel de combativité et de réflexion toujours présent au sein du prolétariat l'obligent à intensifier ses manoeuvres et ses attaques idéologiques contre son ennemi de classe. C'est pourquoi la bourgeoisie a organisé des manoeuvres comme celle de la grève du secteur public en décembre 1995 en France ou celle de la grève d'UPS, la principale société de courrier privé aux Etats Unis en 1997, dans le but spécifique de renforcer l'autorité de son appareil de contrôle syndical. C'est aussi pourquoi la classe dominante a répondu au 80e anniversaire de la révolution d'octobre par un flot de livres et d'articles visant à la falsification de l'histoire et au discrédit de la lutte du prolétariat.
Loin de bannir ces questions des universités, ces « contributions » sont devenues le sujet de « débats publics » et de « controverses » intenses ayant pour but de détruire la mémoire de la classe ouvrière. En France, Le livre noir du communisme, qui assimile les victimes de la guerre civile post-révolutionnaire (imposée au prolétariat par l'invasion de la Russie par les armées blanches contre-révolutionnaires) à celles de la répression stalinienne (une contre-révolution capitaliste subie par le prolétariat et la paysannerie) dans une liste indifférenciée de 100 millions de « victimes des crimes du communisme », a même été discuté à l'Assemblée nationale ! En même temps que les mensonges habituels sur la révolution russe, comme celui d'un prétendu « putsch bolchevik », ce Livre noir a été utilisé pour lancer une calomnie qualitativement nouvelle avec pour la première fois un « débat » tapageur sur la question de savoir si oui ou non le « communisme » était pire que le fascisme. Les co-auteurs de ce livre pseudo-scientifique, pour la plupart des ex-staliniens, font tout un barouf sur le désaccord entre eux sur la question. Dans les pages du journal Le Monde ([3] [3141]), l'un d'entre eux, Courtois, accuse Lénine de crime contre l'humanité et déclare : « le génocide de "classe" rejoint le génocide de "race" : la mort par la famine de l'enfant d'un koulak ukrainien délibérément affamé par le régime stalinien "équivaut" à la mort de famine d'un enfant juif dans le ghetto de Varsovie sous le régime nazi ». D'un autre côté, certains de ses collaborateurs mais aussi le premier ministre français Jospin considèrent que Courtois va « trop loin » en mettant en question le « caractère unique » des crimes du nazisme. Au Parlement, Jospin a « défendu » l' « honneur du communisme » (identifié à l'honneur de ses collègues ministres du Parti communiste français stalinien), sur le thème que même si le « communisme » avait tué plus de gens que le fascisme, il était moins barbare car motivé par de « bonnes intentions ». Toutes les polémiques internationales provoquées par ce livre – depuis la question de savoir si ses auteurs exagéraient le nombre de victimes en « arrondissant » leur chiffre à 100 millions, jusqu'à la difficile question « éthique » de savoir si oui ou non Lénine était « aussi mauvais » qu'Hitler –, toutes servent à discréditer la révolution d'octobre 1917, l'expérience la plus importante sur le chemin de la libération du prolétariat et de l'humanité. Les protestations, à travers l'Europe, des vétérans staliniens de la Résistance en lutte contre l'Allemagne pendant la deuxième guerre mondiale ne servent pas d'autre but aujourd'hui que celui de renforcer le mensonge selon lequel la révolution russe aurait été responsable des crimes de son ennemi mortel, le stalinisme. Courtois le « radical » comme Jospin le « raisonnable », à l'image de l'ensemble de la bourgeoisie, ont en commun les mêmes mensonges capitalistes qui constituent le fondement du Livre noir. En font partie le mensonge, constamment asséné sans la moindre preuve, selon lequel Lénine serait responsable de la terreur stalinienne, et la mystification selon laquelle la « démocratie » constitue la seule « sauvegarde » contre la barbarie. En réalité, tout ce déploiement du pluralisme démocratique d'opinion et d'indignation humanitaire ne sert qu'à cacher la vérité historique : tous les grands crimes de ce siècle ont en commun la même nature bourgeoise de classe, pas seulement les crimes du fascisme et du stalinisme mais aussi ceux de la démocratie, depuis Hiroshima et le bombardement de Dresde ([4] [3142]) jusqu'aux famines infligées à un quart de l'humanité par le capitalisme « libéral » décadent. En réalité, tout ce débat moraliste pour savoir quels crimes du capitalisme sont les plus condamnables est en lui-même aussi barbare qu'il est hypocrite. Tous les participants à ce débat bourgeois truqué sont là pour prétendre démontrer la même chose : toute tentative d'abolir le capitalisme, de défier la démocratie bourgeoise, aussi « idéaliste » ou « bien intentionnée » soit-elle au départ, est vouée à finir dans la terreur sanglante.
En fait, selon Jospin et le chancelier docteur en histoire Helmut Kohl, les causes du « plus long et plus vaste règne de la terreur » et de la « tragédie paradoxale » du communisme résideraient dans la vision utopique de la révolution mondiale qu'avaient les bolcheviks de la période originelle de la révolution d'octobre. Dans la presse bourgeoise allemande, Le Livre Noir français a donné lieu à une défense du caractère responsable de l'antifascisme stalinien, en opposition à la « folle utopie marxiste » de la révolution d'octobre 1917 et de la révolution mondiale. Cette « folie » consistait à vouloir dépasser la contradiction capitaliste entre le travail internationalement associé sur un marché mondial unique et la concurrence mortelle des Etats nationaux bourgeois pour les produits du travail : tel serait le « péché originel » du marxisme, sa violation de la « nature humaine » dont la bourgeoisie se préoccupe tant.
La bourgeoisie ressort les vieux mensonges sur la révolution russe
Alors que pendant la « guerre froide », beaucoup d'historiens occidentaux réfutaient la continuité entre stalinisme et révolution d'octobre 1917 afin d'empêcher leur rival impérialiste oriental de profiter du prestige de ce grand événement, aujourd'hui, la cible de leur haine n'est plus le stalinisme mais le bolchevisme. Si la menace constituée par la rivalité impérialiste de l'URSS a disparu, ce n'est pas le cas pour la menace de la révolution prolétarienne. C'est contre cette menace que les historiens bourgeois raniment aujourd'hui tous les vieux mensonges inventés pendant la révolution elle-même par la bourgeoisie frappée de panique selon lesquels les bolcheviks étaient des « agents payés par les allemands », Octobre un « putsch bolchevik », etc. Ces mensonges développés à l'époque par les adeptes de Kautsky ([5] [3143]) pouvaient exploiter le black-out de la bourgeoisie sur ce qui se passait réellement en Russie. Aujourd'hui, alors qu'ils disposent plus que jamais de preuves documentaires, les plumitifs à la solde de la bourgeoisie déversent les mêmes calomnies que celles de la Terreur blanche.
Aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les ennemis ouverts de la révolution russe qui reproduisent ces mensonges mais aussi ses soi-disant défenseurs. Dans le cinquième numéro des Annales sur le communisme produit par l'historien stalinien Hermann Weber et dédié à la révolution d'Octobre ([6] [3144]), la vieille idée menchevique selon laquelle la révolution était prématurée est remise au gout du jour par Moshe Lewin qui vient de découvrir que la Russie en 1917 n'était pas mûre pour le socialisme, ni même pour la démocratie bourgeoise, à cause de l'arriération du capitalisme russe. Cette explication de la supposée arriération et de la barbarie du bolchevisme nous est également servie dans le nouveau livre A people's tragedy de l'« historien » Orlando Figes qui a provoqué un débordement d'enthousiasme bourgeois en Grande-Bretagne. Il y est affirmé qu'Octobre était fondamentalement l'oeuvre d'un seul et méchant homme, un acte dictatorial du parti bolchevik, lui-même sous la dictature personnelle du « tyran » Lénine et de son acolyte Trotsky : « Ce qui est remarquable dans l'insurrection bolchevique, c'est que quasiment aucun de ses dirigeants ne voulait qu'elle ait lieu quelques heures encore avant qu'elle ne commence » ([7] [3145]). Figes « découvre » que la base sociale de ce « coup d'Etat » n'était pas la classe ouvrière mais le lumpen prolétariat. Après des remarques préliminaires sur le bas niveau d'éducation des délégués bolcheviks des soviets (dont la connaissance de la révolution n'a pas été acquise, il faut bien l'admettre, à Oxford ou à Cambridge !), Figes conclut : « C'était plus le résultat de la dégénérescence de la révolution urbaine, et en particulier du mouvement ouvrier en tant que force constructive et organisée, avec le vandalisme, le crime, la violence généralisée, le pillage d'alcooliques comme expressions principales de cette rupture sociale. (...) Les participants à cette violence destructrice n'étaient pas la ’classe ouvrière‘ organisée, mais les victimes de l'éclatement de cette classe et de la dévastation des années de guerre : l'armée croissante des chômeurs urbains ; les réfugiés des régions occupées, les soldats et les marins qui s'aggloméraient dans les villes, les bandits et les criminels relâchés des prisons ; et les travailleurs non qualifiés de la campagne qui ont toujours été les plus enclins à des explosions de violence anarchique dans les villes. C'étaient des gens de type semi-paysans que Gorki a rendu responsables de la violence urbaine au printemps et au soutien desquelles il a attribué la fortune croissante des bolcheviks. » Voilà comment la bourgeoisie « réhabilite » la classe ouvrière et la lave de l'accusation d'avoir une histoire révolutionnaire. Par sa façon d'ignorer froidement les faits incontournables prouvant qu'Octobre 1917 a été le fait de millions d'ouvriers révolutionnaires organisés en conseils ouvriers, les fameux soviets, c'est la lutte de classe d'aujourd'hui et de demain qui est la cible des falsifications de la bourgeoisie.
Plus que jamais auparavant les dirigeants de la révolution d'Octobre sont devenus l'objet de la haine et des dénigrements de la classe dominante. La plupart des livres et des articles récemment parus sont avant tout des condamnations de Lénine et de Trotsky. L'historien allemand Helmut Altrichter par exemple commence son nouveau livre Russland 1917 par les mots suivants : « Au début n'était pas Lénine ». Tout son livre, tout en prétendant montrer que les masses et non les chefs font l'histoire, se présente comme une « défense passionnée » de l'initiative autonome des ouvriers russes, jusqu'à ce que, hélas, ils s'enthousiasment pour les mots d'ordre « fourbes » de Lénine et Trotsky qui rejetaient la démocratie dans ce qu'ils appelaient scandaleusement « les poubelles de l'histoire ».
Des milliers de pages sont remplies pour « prouver » que, bien qu'il ait dirigé la dernière grande lutte de son histoire contre Staline et la couche sociale des bureaucrates d'Etat qui soutenait ce dernier, appelant à sa destitution dans son fameux « testament », Lénine avait désigné Staline comme son « successeur ». Particulièrement frappante est l'insistance sur l'attitude « antidémocratique » de Trotsky. Alors que le mouvement trotskiste a rejoint les rangs de la bourgeoisie pendant la deuxième guerre mondiale, la figure historique de Trotsky est restée particulièrement dangereuse pour la classe dominante. Trotsky symbolise à la fois le plus grand « scandale » de l'histoire humaine : une classe exploitée qui renverse ses dirigeants en octobre 1917, qui tente d'étendre sa domination à travers le globe avec la fondation de l'Internationale Communiste, qui organise la défense militaire de cette domination avec l'Armée rouge pendant la guerre civile et qui entame la lutte marxiste contre la contre-révolution stalinienne bourgeoise. C'est ce que la bourgeoisie maudit plus que tout et qu'elle veut éradiquer à tout prix de la mémoire collective de la classe ouvrière :
– le fait que la classe ouvrière a renversé la bourgeoisie et est devenue la classe dominante en octobre 1917 ;
– le fait que le marxisme était le fer de lance de la lutte prolétarienne contre la contre-révolution stalinienne soutenue par la bourgeoisie mondiale.
C'est grâce aux efforts des contre-révolutionnaires occidentaux que la révolution allemande a fini par être vaincue en 1923 et grâce à leurs efforts combinés avec ceux des staliniens que le prolétariat a été écrasé en 1933. C'est grâce à eux que la grève générale en Grande-Bretagne en 1926, que la classe ouvrière chinoise en 1926-1927, que la classe ouvrière espagnole pendant la guerre civile des années 1930, ont été défaites. La bourgeoisie mondiale a soutenu la destruction par le stalinisme des vestiges de la domination prolétarienne en Russie et de ceux de l'Internationale Communiste. Aujourd'hui, la bourgeoisie cache le fait que les 100 millions de victimes, ce chiffre horrifiant compilé à la sauce de l'ouvrage capitaliste Le livre noir du communisme, ont été des victimes des crimes de la bourgeoisie, de la contre-révolution capitaliste dont fait partie intégrante le stalinisme, et que les véritables communistes internationalistes furent les premiers touchés par cette barbarie.
Les intellectuels démocrates bourgeois qui se sont maintenant portés à la pointe de l'attaque contre la révolution d'Octobre, à part faire avancer leur carrière et augmenter leurs revenus, ont un intérêt spécifique propre à faire table rase de l'histoire. C'est leur intérêt de cacher la servilité méprisable de l'intelligentsia bourgeoise aux pieds de Staline depuis les années 1930. Ce sont non seulement les écrivains staliniens comme Gorki, Feuchtwanger ou Brecht ([8] [3146]) mais également tout le gotha des historiens et des moralistes démocrates bourgeois, des Webbs jusqu'au « pacifiste » Romain Rolland, qui ont mis Staline sur un piedestal, défendu bec et ongles les procès de Moscou et soutenu la chasse aux sorcières contre Trotsky. ([9] [3147])
Une offensive contre la perspective de la lutte du prolétariat
La falsification de l'histoire révolutionnaire de la classe ouvrière est en réalité une attaque contre la lutte de classe actuelle. En tentant de détruire la perspective historique du mouvement du prolétariat, la bourgeoisie déclare la guerre au mouvement de classe lui-même. « Le but final socialiste est le seul moment décisif qui distingue le mouvement social-démocrate de la démocratie bourgeoise et du radicalisme bourgeois, transformant l'ensemble du mouvement ouvrier d'un futile travail de réparation pour le sauvetage de l'ordre capitaliste en une lutte de classe contre cet ordre, pour abolir cet ordre. » ([10] [3148])
Déjà la séparation, par Bernstein, du but et du mouvement de la lutte de la classe ouvrière au tournant du siècle avait constitué la première attaque à grande échelle pour liquider le caractère révolutionnaire de la lutte de classe prolétarienne. Dans l'histoire du rapport de forces entre bourgeoisie et prolétariat, les périodes de surgissement de la lutte et de développement de la conscience ont toujours été des périodes de clarification difficile mais réelle concernant le but final du mouvement ; les périodes de défaite ont été des moments d'abandon de ce but par les grandes masses.
La période présente qui s'est ouverte en 1968 a été caractérisée dès le début par l'apparition de débats sur le but final de la révolution prolétarienne. La vague internationale de luttes ouverte en mai-juin 1968 en France était caractérisée précisément par rien moins que la contestation, par une nouvelle génération d'ouvriers qui n'avaient pas connu la défaite et la guerre, à la fois de l'appareil de gauche du capital (syndicats et partis de « gauche ») et de la définition bourgeoise du socialisme donnée par cet appareil. La fin de 50 années de contre-révolution stalinienne était donc nécessairement et inévitablement marquée par l'apparition d'une nouvelle génération de minorités révolutionnaires. La campagne de propagande actuelle contre le communisme, contre la révolution d'Octobre, loin de constituer une question académique, est une question centrale de la lutte de classe en général aujourd'hui et qui requiert en particulier la réponse la plus déterminée des minorités révolutionnaires de la Gauche communiste dans le monde entier. Et cette question est d'autant plus importante dans la période actuelle de décomposition capitaliste qui se caractérise par le fait que, depuis 1968, aucune des classes décisives de la société n'a été capable de faire un pas décisif vers son but historique : pour la bourgeoisie vers la guerre mondiale, pour le prolétariat vers la révolution. Le résultat le plus spectaculaire et important de ce blocage historique, qui ouvre une phase d'effroyable pourrissement du système capitaliste, a été l'effondrement interne du bloc impérialiste de l'est dominé par le stalinisme. Cet événement, à son tour, a apporté à la bourgeoisie des « arguments » inattendus pour discréditer la perspective de la révolution communiste calomnieusement identifiée au stalinisme.
En 1980, dans le contexte d'un développement international de la combativité et de la conscience mené par le prolétariat occidental, les grèves de masse en Pologne avaient ouvert la perspective qui devait amener le prolétariat lui-même à s'affronter au stalinisme et balayer donc cet obstacle à la perspective de classe de la révolution communiste. Au contraire la chute des régimes staliniens dans la décomposition en 1989 a eu l'effet opposé : brouiller la mémoire historique et saper la perspective de classe : en minant la confiance en soi du prolétariat et en affaiblissant sa capacité à organiser sa propre lutte vers de réelles confrontations avec les organes de contrôle de la gauche du capital ; en affaiblissant l'impact immédiat de l'intervention révolutionnaire dans les luttes.
Ce recul a rendu la perspective révolutionnaire plus éloignée et plus difficile qu'elle ne l'était déjà, mais il ne l'a pas pour autant fait disparaître. La bourgeoisie n'a pas été capable de mobiliser la classe ouvrière dans la défense des intérêts et des objectifs de la classe capitaliste comme dans les années 1930. Le fait même qu'après huit années de célébration de la « mort du communisme », la bourgeoisie soit obligée d'intensifier sa campagne idéologique pour attaquer directement la révolution d'octobre 1917 en constitue une preuve a contrario. Le flot de publications sur la révolution russe, s'il représente d'abord et avant tout une mystification contre les ouvriers, est aussi une manière d'avertissement des idéologues bourgeois envers leur propre classe, l'avertissement de ne plus jamais sous-estimer l'ennemi de classe. Aujourd'hui, le capitalisme approche inexorablement de la plus grande crise économique et sociale de son histoire, en fait de l'histoire de l'humanité, et la classe ouvrière n'est pas défaite. Rien d'extraordinaire à ce que les publications bourgeoises érudites soient pleines du genre d'avertissement : « Jamais plus la classe ouvrière ne doit devenir la proie de dangereuses "utopies" révolutionnaires ! »
La perspective révolutionnaire reste à l'ordre du jour
L'impact idéologique des calomnies et des mensonges contre la révolution prolétarienne est important, il n'est pas définitif. Après des décennies de silence, la bourgeoisie est aujourd'hui obligée d'attaquer l'histoire du mouvement marxiste, et donc d'en admettre l'existence. Aujourd'hui, elle n'attaque pas seulement la révolution russe et les bolcheviks, elle n'attaque pas seulement Lénine et Trotsky, elle attaque aussi la Gauche communiste. Elle est obligée d'attaquer les internationalistes qui ont défendu le défaitisme révolutionnaire de Lénine pendant la 2e guerre mondiale. L'accusation que ces internationalistes ont été des apologues du fascisme ([11] [3149]) est un mensonge aussi monstrueux que ceux qu'elle répand sur la révolution russe. Le réveil actuel d'un intérêt militant pour la Gauche communiste ne concerne qu'une minuscule minorité de la classe. Mais le bolchevisme, ce « spectre qui hante » toujours l'Europe et le monde, n'était-il pas lui-même, pendant des années, qu'une infime minorité de la classe ?
Le prolétariat est une classe historique, sa conscience est une conscience historique. Son caractère révolutionnaire n'est pas une lubie momentanée comme celui de la bourgeoisie qui fut, par le passé, révolutionnaire par la place décisive qu'elle occupait dans le mode de production capitaliste face à la féodalité. Les décennies de luttes et de réflexion du prolétariat qui se profilent, précisément parce qu'elles vont être difficiles, seront des années de développement fluctuant mais réel de la culture politique du prolétariat. Poussée à avancer dans sa lutte face à des attaques économiques de plus en plus insupportables, la classe ouvrière sera forcée de se confronter à l'héritage de sa propre histoire et de se réapproprier la véritable théorie marxiste. L'offensive de la bourgeoisie contre la révolution russe et le communisme rend ce processus plus long et plus difficile. Mais en même temps, il rend ce travail de réacquisition d'autant plus important, en fait obligatoire, pour les secteurs avancés de la classe. La perspective ouverte en octobre 1917, celle de la révolution prolétarienne mondiale, n'est pas morte. C'est la reconnaissance de ce fait qui motive la campagne bourgeoise actuelle.
KR.
[11] [3160] Voir « Campagnes contre le négationnisme », « L'antifascisme justifie la barbarie » et « La co-responsabilité des "alliés" et des "nazis" dans l' "holocauste" »", Revue internationale n° 88 et 89.
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Russe [2920]
Heritage de la Gauche Communiste:
Conférence de Moscou - Les débuts d'un débat prolétarien en Russie
- 3147 reads
A la suite de l'effondrement des régimes staliniens en Europe de l'est s'est constitué un « Comité pour l'étude de l'héritage de Léon Trotsky » qui a tenu plusieurs conférences en Russie sur différents aspects du travail de ce grand révolutionnaire. Au cours de l'étude de la contribution de Trotsky, il est devenu clair non seulement que Trotsky lui-même n'avait pas été le seul représentant ni le plus radical et résolu de l'Opposition de gauche « trotskiste », mais encore qu'il y avait eu d'autres courants d'opposition, aussi bien en Russie qu'en dehors de ce pays, qui s'étaient situés bien plus à gauche. Il est apparu en particulier qu'une autre tradition de la lutte prolétarienne contre le stalinisme a existé, celle de la Gauche communiste dont il y a encore aujourd'hui des représentants.
A l'initiative de membres russes du Comité, notre organisation, le Courant Communiste International, a été invitée à Moscou en 1996 à la conférence dédiée à l'étude du livre de Trotsky La révolution trahie. Sur proposition du CCI, d'autres groupes de la Gauche communiste avaient aussi été invités à participer, mais soit ils ne purent pas venir, comme ce fut le cas du Bureau International pour le Parti Révolutionnaire (BIPR), soit ils refusèrent par sectarisme indécrottable, comme les « bordiguistes ».
Pour autant, l'intervention du CCI fut loin d'être la seule expression de vie prolétarienne à cette conférence. La critique du refus de Trotsky de reconnaître le caractère capitaliste d'Etat de la Russie stalinienne qui fut présentée à la Conférence par un membre russe du comité d'organisation, que nous publions ci-dessous, en est la preuve. Un an plus tard, la présence de groupes de la Gauche communiste à la Conférence de 1997 sur Trotsky et la révolution d'octobre 1917 a été renforcée par la participation, en même temps que celle du CCI, d'un autre représentant du milieu prolétarien : le BIPR.
L'héritage de Trotsky et les tâches de la période actuelle
Les Conférences sur l'héritage de Trotsky se sont tenues en réponse à des événements d'une importance historique mondiale : l'effondrement des régimes staliniens, du bloc de l'est (et donc de tout l'ancien ordre planétaire de l'après seconde guerre mondiale issu de Yalta) et de l'URSS elle-même. En identifiant stalinisme et communisme la bourgeoisie pousse des minorités prolétariennes en recherche qui rejettent l'équation stalinisme = communisme à poser les questions suivantes : quels courants politiques dans l'histoire de la classe ouvrière se sont opposés à la contre-révolution stalinienne au nom du communisme et quelle partie de cet héritage peut servir de base pour l'activité révolutionnaire aujourd'hui ?
La plupart des milliers d'éléments révolutionnaires qui ont surgi internationalement sous l'impulsion des luttes massives du prolétariat en 1968 et après, étaient imprégnés d'une impatience et d'une confiance unilatérale dans la « spontanéité » de la lutte de classe au détriment du travail théorique et organisationnel à long terme : nombre d'entre eux ont disparu sans laisser de trace, précisément parce qu'ils ont échoué à s'ancrer aux positions et à la tradition du mouvement ouvrier du passé. Bien que les conditions pour le développement de minorités révolutionnaires dans la phase de l'après 1989 soient en quelque sorte devenues beaucoup plus difficiles (en particulier parce qu'il n'y avait pas l'exemple immédiat de luttes massives du prolétariat comme celles qui inspirèrent la génération de l'après 1968), le fait que des éléments prolétariens en recherche se sentent aujourd'hui obligés de se rattacher par eux-mêmes aux traditions révolutionnaires passées pour être capables de s'opposer à la campagne de la bourgeoisie sur la « mort du communisme », ouvre la perspective d'une redécouverte plus large et plus profonde de l'héritage marxiste important de la Gauche communiste. En Russie même, le véritable centre de la contre-révolution stalinienne, là où le prolétariat en a subi les plus terribles effets, ce n'est qu'avec la fin de la domination du stalinisme qu'une nouvelle génération de révolutionnaires a pu commencer à émerger, plus de trente ans après que le même processus ait commencé à l'ouest. De plus, les effets dévastateurs à l'échelle internationale d'un long demi-siècle de contre-révolution (la destruction de la continuité organique avec les générations révolutionnaires du passé, l'ensevelissement de la véritable histoire de ce mouvement sous des montagnes de cadavres et de mensonges) ont plus que lourdement pesé dans le pays de la révolution d'Octobre. L'apparition en Russie d'éléments prolétariens qui se posent des questions aujourd'hui confirme que la reprise de la lutte de classe à la fin des années 1960, non seulement à l'ouest mais également en Pologne, en Roumanie, en Chine et même en Russie, démontrait déjà la fin de la contre-révolution stalinienne. Mais, si les conditions de la redécouverte de la véritable histoire du mouvement prolétarien sont particulièrement difficiles en Russie, il était aussi inévitable que, dans un pays où pratiquement chaque famille de la classe ouvrière a perdu un de ses membres sous la terreur stalinienne, la recherche de la vérité historique constitue le point de départ. Si depuis la Perestroïka, la question de la « réhabilitation » des victimes du stalinisme est devenue le slogan de l'opposition dissidente bourgeoise et petite-bourgeoise, pour les représentants du prolétariat c'est une tâche toute différente qui a surgi : la restauration de la tradition révolutionnaire des meilleurs éléments qui furent les ennemis jurés et les victimes du stalinisme. Ce n'est donc pas un hasard si les premières tentatives des révolutionnaires russes pour définir et débattre des intérêts de leur classe et pour établir un contact avec les organisations de la Gauche communiste à l'extérieur, ont surgi en rapport avec la question de l'héritage de la lutte prolétarienne contre le stalinisme en général et l'héritage de Trotsky en particulier. De tous les dirigeants de l'opposition contre la dégénérescence de la révolution russe et de l'Internationale communiste, Trotsky est de loin le plus connu. Son rôle dans la fondation de la 3e Internationale, dans la révolution d'Octobre elle-même et dans la guerre civile ensuite a été si important (comparable à celui de Lénine) que même en URSS la bourgeoisie stalinienne n'a jamais été capable d'effacer complètement son nom des livres d'histoire ou de la mémoire collective du prolétariat russe. Mais tout aussi inévitablement, l'héritage de Trotsky est devenu l'enjeu d'une lutte politique de classe. Cela s'explique parce que Trotsky, le défenseur courageux du marxisme, a été le fondateur d'un courant politique qui, après tout un processus de dégénérescence opportuniste, a finalement trahi la classe ouvrière en abandonnant l'internationalisme prolétarien de Lénine par sa participation active à la seconde guerre impérialiste mondiale. Le courant trotskiste issu de cette trahison est devenu une fraction de la bourgeoisie, avec un programme (étatique) pour le capital national clairement défini, avec une politique étrangère bourgeoise (généralement en soutien à l'impérialisme « soviétique » et au bloc de l'est) et avec la tâche spécifique de sabotage « radical » des luttes ouvrières et de la réflexion des éléments révolutionnaires qui surgissent. Derrière Trotsky il n'y a donc pas un seul héritage, mais deux : l'héritage prolétarien de Trotsky lui-même, et l'héritage bourgeois, « critiquement » stalinien qu'est le trotskisme.
Les antagonismes au sein des conférences sur l'héritage de Trotsky
Dès le tout début, le Comité, loin de constituer une unité réelle dans sa volonté et sa démarche, contient en son sein deux tendances contradictoires. La première, la tendance bourgeoise est représentée par des membres des organisations trotskistes ainsi que par quelques historiens dévoués à leur cause, venant principalement de l'Ouest avec pour objectif de prendre pied en Russie, allant jusqu'à envoyer des membres pour s'y installer. Tout en participant aux conférences et en prétendant servir la cause de la recherche scientifique, ces éléments n'ont comme préoccupation véritable que la falsification de l'histoire (une spécialité qui n'est pas le monopole du stalinisme). Leur but est de présenter l'Opposition de gauche comme le seul opposant prolétarien au stalinisme, Trotsky comme le seul représentant de l'Opposition de gauche et le trotskisme actuel comme l'héritier de Trotsky. A cette fin, ils sont obligés de faire le silence sur la plupart des contributions de la lutte prolétarienne contre le stalinisme, y compris beaucoup de celles de l'Opposition de gauche elle-même et quelques unes de Trotsky. Et ils sont obligés de falsifier l'héritage de Trotsky lui-même. Ils le font, comme les trotskistes bourgeois l'ont toujours fait, en transformant Trotsky en une icône inoffensive et ses erreurs politiques en un dogme indiscutable, tout en liquidant l'approche révolutionnaire, critique et dynamique, la loyauté au prolétariat qui était les caractéristiques du marxisme de Trotsky. En d'autres termes, ils « transforment » Trotsky de la même façon que les staliniens « transforment » Lénine. Il n'a pas suffi que les agents de Staline aient assassiné Trotsky au Mexique, les trotskistes ont poursuivi leur oeuvre en assassinant la tradition révolutionnaire à laquelle il était attaché.
La seconde tendance, à la fois dans le Comité et dans les Conférences, représentant les intérêts du prolétariat, s'est opposée rapidement aux falsifications trotskistes. Bien qu'incapable, du fait de la contre-révolution stalinienne, de partir en Russie même de positions programmatiques prolétariennes clairement définies, cette tendance a révélé sa préoccupation prolétarienne par sa détermination à faire complètement la lumière sans tabou ou compromis sur toute l'histoire du combat prolétarien contre le stalinisme et à présenter les différentes contributions sur la table pour un débat ouvert et critique. Ces éléments ont insisté en particulier sur le fait que la tâche des conférences n'était pas de propager le trotskisme en Russie mais de faire l'appréciation critique de l'héritage de Trotsky en rapport avec les autres contributions prolétariennes. Cette attitude prolétarienne au sein du Comité, en particulier de la part de l'auteur de la contribution publiée dans cette Revue internationale, a rencontré un soutien en Russie de deux côtés. D'un côté des jeunes éléments anarcho-syndicalistes, eux-mêmes engagés dans la recherche de l'héritage non seulement de l'anarchisme mais aussi du communisme de gauche. D'un autre côté de certains historiens russes qui, tout en n'étant pas engagés dans des activités politiques organisées aujourd'hui, restent fidèles aux meilleures traditions de loyauté envers le but de la vérité scientifique. Quelques unes des manoeuvres des trotskistes dans le Comité et dans les Conférences visant à faire taire la voix du prolétariat ont désagréablement rappelé à ces historiens le type de pression stalinienne dont ils avaient eux-mêmes souffert pendant si longtemps en URSS.
Le sabotage des premiers pas de la clarification prolétarienne en Russie et l'établissement d'une présence trotskiste pour empêcher la réappropriation des leçons de la lutte prolétarienne dans ce pays sont un objectif important de la bourgeoisie. Pour le trotskisme et la gauche du capital internationalement, qui ont défendu l'URSS pendant des décennies bien que leur presse n'ait jamais été autorisée dans ce pays, s'établir eux-mêmes en Russie et y entraver le débat prolétarien est indispensable pour leur propre image de « seuls véritables héritiers de la révolution d'octobre » ([1] [3161]).
Pendant la Perestroïka, le parti communiste stalinien avait commencé à permettre l'accès aux archives historiques du pays. Cette mesure, qui faisait partie de la politique de Gorbatchev pour mobiliser l'opinion publique contre la résistance à sa politique de « réformes » au sein de la bureaucratie d'Etat, s'est vite révélée être elle-même la manifestation d'une perte de contrôle et de la décomposition générale du régime stalinien. Une fois établi au pouvoir, le régime d'Eltsine a rapidement réinstauré un accès de plus en plus restrictif aux archives d'Etat, en particulier en ce qui concerne le communisme de gauche et l'Opposition à la gauche de Trotsky. Bien que ce soit le gouvernement Eltsine qui ait réintroduit la propriété capitaliste privée (tout en maintenant une partie de la propriété capitaliste d'Etat existante en Russie), il a beaucoup mieux compris que Gorbatchev que toute remise en question historique de ses prédécesseurs, de Staline à Brejnev, et toute réhabilitation de la lutte prolétarienne contre l'Etat russe, ne pourraient que saper sa propre autorité.
A l'opposé, des fractions de la bourgeoisie russe actuelle sympathisent avec l'idée d'exploiter une falsification embourgeoisée et « icônisée » de Trotsky, présenté comme le « soutien critique » à une Nomenklatura légèrement « démocratisée », pour blanchir leur propre image historique. Cette préoccupation s'est manifestée par la présence à la Conférence de dissidents du Parti stalinien, y inclus un ex-membre du Comité central de Zouganov. Alors qu'ils ont exprimé toute leur rage contre la Gauche communiste, les trotskistes n'ont pas été fâchés le moins du monde par la présence de ces staliniens.
La Conférence de 1996 sur La révolution trahie
La célèbre étude de Trotsky sur la nature de l'URSS sous Staline, dans laquelle il affirmait qu'il existait encore quelques « acquis de la révolution d'Octobre » en 1936, a été exploitée par les trotskistes à la Conférence de Moscou de 1996 pour « prouver » qu'il existait un « Etat ouvrier dégénéré » avec des « éléments d'économie socialiste » jusque... dans les années 1990 ! Au milieu des années 1930, Trotsky qui, malgré l'écrasement du prolétariat allemand en 1933, n'était pas parvenu à comprendre que la période était à la défaite et à la contre-révolution et qui surestimait complètement la force de l'Opposition à l'intérieur et à l'extérieur des partis communistes stalinisés, croyait que la révolution mondiale avait déjà commencé et voulait simplement restaurer le pouvoir de l'Opposition du Parti. Le dernier paragraphe de son livre affirme : « Plus que jamais, les destinées de la révolution d'Octobre sont aujourd'hui liées à celles de l'Europe et du monde. Les problèmes de l'U.R.S.S. se résolvent dans la péninsule ibérique, en France, en Belgique ». Et il conclut que la révolution dans ces pays "constitue la seule voie de salut pour le premier Etat ouvrier, pour l'avenir du socialisme". Bien que les événements en Espagne, en France et en Belgique aient abouti à la victoire complète de la contre-révolution et à la mobilisation du prolétariat d'Europe occidentale dans la guerre impérialiste mondiale, bien que cette guerre et la terreur qui l'avait précédée aient causé la liquidation physique définitive des derniers restes de l'opposition prolétarienne organisée en URSS et la victoire totale de la contre-révolution stalinienne, non seulement en URSS mais aussi en Chine et dans l'ensemble de l'Europe de l'Est, le trotskisme d'aujourd'hui transforme les erreurs de Trotsky en dogmes religieux : ils proclament que la prétendue "restauration du capitalisme" de Eltsine a complètement vérifié les prédictions du "prophète Trotsky" !
Contre la canonisation bourgeoise des erreurs de Trotsky, le CCI donna une citation du début de La révolution trahie : « Il n'y a plus lieu de discuter avec MM. les économistes bourgeois : le socialisme a démontré son droit à la victoire, non dans les pages du Capital, mais dans une arène économique qui couvre le sixième de la surface du globe ; non dans le langage de la dialectique, mais dans celui du fer, du ciment et de l'électricité. ». Si cela était vrai, la désintégration des économies staliniennes nous aurait obligé à admettre la supériorité du capitalisme sur le « socialisme », une « conclusion » que la bourgeoisie mondiale se délecte aujourd'hui de tirer. En fait, vers la fin de sa vie, enfermé désespérément dans sa propre définition incorrecte de l'URSS, Trotsky lui-même a commencé à prendre en considération l'hypothèse de « l'échec historique du socialisme ».
Ce n'est pas un hasard si une partie importante de La révolution trahie est dédiée à réfuter l'idée que la Russie de Staline est capitaliste d'Etat. Cette position était avancée constamment non seulement par le Communisme de gauche mais aussi au sein de l'Opposition de gauche elle-même, à la fois en Russie et à l'étranger. La contribution du camarade AG de Moscou, publiée ici, représente une réfutation fondamentale de la position de Trotsky sur l'URSS d'un point de vue marxiste révolutionnaire. Cette contribution ne démontre pas seulement la nature capitaliste d'Etat de la Russie stalinienne. Elle montre la faiblesse fondamentale de Trotsky dans sa compréhension de la dégénérescence de l'Octobre rouge. Alors que Trotsky attendait que la contre-révolution vienne de la paysannerie (c'est pour cette raison qu'il voyait les boukhariniens et non les staliniens comme le principal danger dans les années 1920 et qu'il a considéré la rupture de Staline avec Boukharine comme une évolution vers une politique révolutionnaire), il était aveugle envers le principal instrument de la contre-révolution : l'Etat « soviétique » qui avait liquidé les conseils ouvriers. En fait, le débat avec Lénine sur la question syndicale, dans lequel Lénine avait défendu et Trotsky rejeté le droit pour les ouvriers de faire grève contre « leur propre Etat », avait déjà révélé la faiblesse de Trotsky sur cette question. En opposition à la croyance acritique de Trotsky en « l'Etat ouvrier », Lénine avait montré, dès 1921, que l'Etat représentait aussi d'autres classes antagoniques au prolétariat et qu'il était « bureaucratiquement déformé ». A cela on peut ajouter une autre incompréhension importante de Trotsky : sa croyance dans les « acquis économiques » et dans la possibilité, au moins, d'un début de transformation socialiste dans un pays. Cette faiblesse participa à préparer la voie à la trahison du trotskisme à travers son soutien à l'impérialisme soviétique dans la 2e guerre mondiale.
Ce débat n'a pas été académique. Pendant la conférence, les trotskistes, en appelant à la défense des « acquis socialistes encore existant » dans une lutte contre le « capitalisme privé » qu'ils jugeaient « encore non tranchée », appelaient en fait les ouvriers russes à donner leur sang pour la défense des intérêts de cette partie de la Nomenklatura stalinienne qui avait été défaite avec l'effondrement de son régime. De plus, en présentant la guerre dans l'ex-Yougoslavie comme un moyen de « restaurer le capitalisme » dans ce pays, ils niaient la nature impérialiste de ce conflit, appelant les ouvriers à soutenir le soi-disant camp « anticapitaliste » (en général la fraction serbe pro-russe, qui est aussi soutenue par les impérialismes français et britannique). Pendant le débat ouvert à la fin de la conférence, le CCI est intervenu pour dénoncer le caractère impérialiste de l'URSS, des guerres en Yougoslavie et en Tchétchénie, ainsi que de la gauche du capital. Mais nous n'avons pas été la seule voix qui s'est élevée en défense de l'internationalisme prolétarien. Un des jeunes russes est aussi intervenu, d'abord pour dénoncer la politique manoeuvrière de collaboration avec l'autre gauche, puis les tendances de droite d'une branche russe de The Militant au sein du trotskisme. Surtout, ce camarade a dénoncé le caractère impérialiste de la 2e guerre mondiale ainsi que la participation de la Russie dans celle-ci. C'est probablement la première (et donc historique) déclaration publique internationaliste de cette sorte faite par un élément de la nouvelle génération de révolutionnaires en Russie.
La Conférence de 1997 sur Trotsky et la révolution russe
Cette conférence a été principalement dominée par une confrontation beaucoup plus directe entre les trotskistes et la Gauche communiste. L'impact de cette dernière a été grandement renforcé par la présence et les interventions courageuses du BIPR mais également par une autre contribution du camarade AG. Celle-ci a rappelé non seulement l'existence de courants de la Gauche communiste en Russie, tels que le Groupe ouvrier communiste de Miasnikov qui s'est opposé à la dégénérescence stalinienne beaucoup plus tôt et beaucoup plus résolument que Trotsky. Il a également démontré, sur la base de la recherche de documents historiques, l'existence au sein de l'Opposition de gauche d'une insatisfaction très répandue et même d'une hostilité ouverte envers la politique mitigée de Trotsky, appelant, contrairement à lui, à une révolution sociale pour renverser la bourgeoisie stalinienne.
Le BIPR et le CCI ont rappelé que l'Internationale communiste avait été fondée essentiellement par les bolcheviks et la Gauche communiste pour étendre la révolution. Les membres les plus connus de la Gauche communiste hollandaise, Pannekoek et Gorter, avaient été chargés du Bureau de l'Internationale pour l'Europe de l'ouest (à Amsterdam) par Lénine et Trotsky. Les principaux partis communistes avaient alors été fondés par les communistes de gauche : le KPD par les Spartakistes et la Gauche de Brême et le parti italien par les camarades autour de Bordiga. De plus, l'IC avait été fondée en 1919 sur les positions de la Gauche communiste. Le Manifeste du congrès de fondation, écrit par Trotsky, en est la plus claire expression, montrant que, dans l'époque du capitalisme d'Etat décadent, la lutte syndicale et parlementaire, la libération nationale et la défense de la démocratie bourgeoise ne sont plus possibles et que la Social-démocratie est devenue l'aile gauche de la bourgeoisie. Si, au contraire de la Gauche communiste, Lénine et Trotsky ne restèrent pas fidèles à ces positions, c'est principalement parce qu'ils sont devenus prisonniers de la défense des intérêts de l'Etat transitoire russe après 1917. C'est pourquoi la Gauche communiste est le vrai défenseur du grand héritage révolutionnaire de Lénine et Trotsky de 1905 et 1917. La preuve en est que la Gauche communiste est restée fidèle à la position internationaliste de Lénine pendant la 2e guerre mondiale alors que le trotskisme trahissait. Le BIPR et le CCI ont défendu l'immense contribution de Rosa Luxemburg au marxisme contre le neo-trotskiste britannique Hillel Ticktin qui, pour empêcher les militants russes d'étudier les travaux de celle-ci, affirma qu'elle était morte parce qu'elle n'avait « pas de conception du parti », ce qui signifie que c'était de sa faute si elle avait été assassinée par la contre-révolution social-démocrate ([2] [3162]).
Cette Conférence a révélé surtout aux camarades russes que le trotskisme ne peut pas tolérer la voix du prolétariat. Pendant la Conférence elle-même, les trotskistes ont multiplié les tentatives pour empêcher les présentations et les interventions du BIPR et du CCI. Après la Conférence, ils ont tenté d'exclure « les ennemis du trotskisme » des futures réunions et de remplacer les membres russes du bureau d'organisation du Comité qui défendaient la participation des courants politiques non trotskistes aux Conférences. Auparavant ils avaient aussi saboté la publication en russe des contributions du CCI à la Conférence de 1996 sous le prétexte qu'elles ne présentaient « pas d'intérêt scientifique ».
Perspectives
Il n'est pas nécessaire de traiter longuement de l'importance historique du développement des positions prolétariennes dans le pays de la révolution d'Octobre, même s'il est lent et difficile. Il est évident qu'un tel processus de clarification est confronté à d'énormes obstacles et dangers. Du fait en particulier de plus d'un demi-siècle de contre-révolution stalinienne centrée précisément dans ce pays et du fait des manifestations extrêmes de la crise capitaliste qui s'y produisent, les éléments prolétariens en recherche en Russie sont encore isolés et inexpérimentés ; ils continuent d'être coupés d'une grande partie de l'histoire réelle du prolétariat et du mouvement marxiste. Ils sont confrontés à d'énormes difficultés matérielles et au grand danger de l'impatience et de la démoralisation. A cela il faut ajouter le fait avéré que la gauche du capital continuera à saboter ce processus par tous les moyens.
Aujourd'hui, après les décennies de la plus terrible contre-révolution de l'histoire, qui n'a pas seulement fait disparaître deux générations de révolutionnaires prolétariens mais a également « volé » la véritable histoire de notre classe, la principale tâche des révolutionnaires en Russie est celle d'une clarification politique des positions. Le développement d'une perspective révolutionnaire pour la classe ouvrière aujourd'hui ne peut être qu'une tâche difficile et à très long terme. Le prolétariat n'a pas besoin de révolutionnaires qui disparaissent après un court moment mais d'organisations capables de développer une perspective et un travail historiques. C'est pourquoi il faut avant tout pour les révolutionnaires un maximum de clarté et de fermeté sur les positions prolétariennes et une capacité de défendre les véritables traditions de la classe ouvrière. Le CCI s'engage à continuer à soutenir tous les efforts dans cette direction. En particulier, nous encourageons les camarades russes à étudier les contributions de la Gauche communiste, qu'ils reconnaissent eux-mêmes comme une expression directe et importante de la lutte historique de notre classe.
Nous pensons que les conférences qui se sont tenues jusqu'à aujourd'hui ont été un moment important de débat et de confrontation. Ce faisant, elles ont donné naissance à un processus de décantation mettant en évidence ce qu'il n'est plus possible de poursuivre : la clarification en présence d'une sorte de sabotage et des falsifications tels que nous les avons rencontrés de la part des trotskistes. Cependant, le processus de clarification lui-même peut et doit continuer, et cela n'est possible que dans un cadre international.
Ce ne sont pas seulement les révolutionnaires russes mais le prolétariat international qui tirera le bénéfice de ce processus. Le texte publié ci-dessous donne une claire indication de la richesse que peut receler cette contribution. ([3] [3163])
KR.
[2] [3165] Le mensonge trotskiste (et stalinien), selon lequel la révolution allemande de 1918-23 a échoué à cause de la prétendue sous-estimation par Rosa Luxemburg du parti et sa négligence à le fonder à temps, n'était pas partagé par Trotsky qui a donné une explication marxiste au retard et à la faiblesse de l'avant-garde politique en Allemagne à l'époque. « L'histoire, une fois encore, a présenté au monde une de ses contradictions dialectiques : précisément parce la classe ouvrière allemande avait dépensé dans la période précédente la plus grande partie de son énergie à la construction d'une organisation indépendante, occupant la première place dans la deuxième internationale, comme parti et en tant qu'appareil syndical - précisément à cause de cela, dans une nouvelle époque, au moment de la transition vers la lutte révolutionnaire ouverte pour le pouvoir, la classe ouvrière allemande s'est révélée très vulnérable organisationnellement » (« Une révolution rampante », Les cinq premières années de l'Internationale communiste, vol. 1, p. 45). En réalité le travail de fraction mené par Luxemburg et le Spartakusbund à l'intérieur du parti social-démocrate allemand contre la trahison de sa direction, et dans le but de préparer le futur parti de classe, n'est pas seulement un des combats les plus audacieux et les plus résolus pour le parti de classe dans l'histoire, il se situe dans les meilleures traditions du travail de fraction effectué par Lénine.
[3] [3166] Nous sommes d'accord, dans l'ensemble, avec l'analyse et les principaux arguments développés dans ce document. Cela dit, nous n'en partageons pas intégralement toutes les formulations. Ainsi, l'idée suivant laquelle « la classe ouvrière [en Russie au début des années 1990] a contribué activement à l'abolition de la propriété nationalisée et de l'appareil d'Etat communiste » nous paraît fausse. En aucune façon la classe ouvrière, comme classe, n'a été acteur des bouleversements qui ont affecté les pays soi-disants socialistes dans cette période. Le fait qu'une majorité d'ouvriers, victimes des illusions démocratiques, ait été entraînée derrière les objectifs de la fraction « libérale » de la bourgeoisie contre la fraction stalinienne ne signifie nullement que c'était la classe ouvrière qui agissait. Les guerres impérialistes mondiales ont embrigadé des dizaines de millions d'ouvriers. Pour autant, cela ne signifie pas que la classe ouvrière ait contribué activement aux massacres. Quand celle-ci s'est manifestée en tant que classe, par exemple en 1917 en Russie et en 1918 en Allemagne, c'était pour combattre et mettre fin à la guerre. Cela dit, malgré quelques formulations malheureuses, ce texte nous apparaît comme excellent et nous le saluons comme tel.
Géographique:
Courants politiques:
Contribution de Russie - La classe non identifiée: la bureaucratie soviétique vue par Léon Trotsky
- 4955 reads
Quel était la nature du système ayant existé dans notre pays pendant la période « soviétique » ?
C'est certainement une des questions principales de l'histoire et, dans une certaine mesure, des autres sciences sociales. Et ce n'est pas seulement une question académique : elle est très liée à l’époque contemporaine car il est impossible de comprendre les réalités d'aujourd'hui sans connaître celles d'hier.
Cette question peut être résumée comme suit : quel était la nature du sujet central du système « soviétique » qui a déterminé la voie du développement du pays, c’est-à-dire la bureaucratie dirigeante ? Quels étaient ses rapports avec les autres groupes sociaux ? Quels motivations et besoins déterminaient son activité ?
Il est impossible d’étudier sérieusement ces problèmes sans connaître les œuvres de Léon Trotsky, un des premiers auteurs qui ait essayé de comprendre et d'analyser la nature du système « soviétique » et de sa couche dirigeante. Trotsky a consacré plusieurs ouvrages à ce problème, mais ses visions les plus générales, les plus concentrées de la bureaucratie sont exposées dans son livre La Révolution trahie publié il y a 60 ans.
La bureaucratie : caractéristiques principalesRappelons les caractéristiques principales de la bureaucratie données par Trotsky dans son livre.
1) Le niveau supérieur de la pyramide sociale en URSS est occupé par « la seule couche sociale privilégiée et dominante, au sens plein des termes », cette couche « qui, sans fournir un travail productif direct, commande, administre, dirige, distribue les châtiments et les récompenses ». D’après Trotsky, elle compte de 5 à 6 millions de personnes ([1] [3167]).
2) Cette couche qui dirige tout est hors de tout contrôle de la part des masses qui produisent les biens sociaux. La bureaucratie règne, les masses laborieuses « obéissent et se taisent » ([2] [3168]).
3) Cette couche maintient des rapports d'inégalité matérielle dans la société. « Des limousines pour 'les activistes', de bons parfums pour 'nos femmes', de la margarine pour les ouvriers, des magasins de luxe pour les privilégiés, la seule image des mets fins exposés à la vitrine pour la plèbe » ([3] [3169]). En général, les conditions de vie de la classe dirigeante sont analogues a celles de la bourgeoisie : elle « comprend tous les degrés, de la petite bourgeoisie la plus provinciale à la grande bourgeoisie des villes » ([4] [3170]).
4) Cette couche est dirigeante pas seulement objectivement ; subjectivement elle se considère comme le seul maître de la société. D’après Trotsky, elle a « une conscience spécifique de classe dirigeante » ([5] [3171]).
5) La domination de cette couche est maintenue par la répression, sa prospérité se base sur « l'appropriation masquée du travail d'autrui ». « La minorité privilégiée, note Trotsky, vit aux détriment de la majorité bernée » ([6] [3172]).
6) Il y a une lutte sociale latente entre cette couche dirigeante et la majorité opprimée des travailleurs ([7] [3173]).
Ainsi Trotsky décrit le tableau qui suit : il existe une couche sociale assez nombreuse qui contrôle la production, donc son produit, d'une manière monopolistique, qui s'approprie une grande part de ce produit (c’est-à-dire, exerce une fonction d'exploitation), qui est unie autour de la compréhension de ses intérêts matériels communs et qui est opposée à la classe des producteurs.
Comment les marxistes appellent-ils la couche sociale qui a toutes ces caractéristiques ? Il n'y a qu'une seule réponse : c'est la classe sociale dirigeante au sens plein du terme.
Trotsky conduit les lecteurs à une telle conclusion. Mais lui n'y parvient pas, bien qu'il note qu'en URSS la bureaucratie « est quelque chose de plus qu'une simple bureaucratie » ([8] [3174]). « Quelque chose de plus » mais quoi ? Trotsky ne le dit pas. De plus, il consacre un chapitre entier à réfuter l’idée d’une essence de classe de la bureaucratie. Après avoir dit « A », après avoir décrit un tableau de la classe dirigeante exploiteuse, Trotsky recule au dernier moment et refuse de dire « B ».
Le stalinisme et le capitalismeTrotsky fait preuve des mêmes réticences quand il traite une autre question, lorsqu'il compare le système bureaucratique stalinien et le système capitaliste. « Mutatis mutandis, le gouvernement soviétique s'est mis à l'égard de l'économie dans son ensemble dans la situation du capitaliste à l'égard d'une entreprise isolée », nous dit Trotsky dans le Chapitre II de La Révolution trahie ([9] [3175]).
Dans le Chapitre IX il écrit : « Le passage des usines à l'Etat n'a changé que la situation juridique [souligné par A.G.] de l'ouvrier ; en fait, il vit dans le besoin tout en travaillant un certain nombre d'heures pour un salaire donné (...) Les ouvriers ont perdu toute influence sur la direction des usines. Travaillant aux pièces, vivant dans une gêne profonde, privé de la liberté de se déplacer, subissant à l'usine même un terrible régime policier, l'ouvrier pourrait difficilement se sentir 'un travailleur libre'. Le fonctionnaire est pour lui un chef, l'Etat un maître. » ([10] [3176]).
Dans le même chapitre Trotsky note que la nationalisation de la propriété ne liquide pas la différence sociale entre les couches dirigeantes et les couches soumises : les unes jouissent de tous les bien possibles, les autres vivent dans la misère comme jadis et vendent leur main-d’œuvre. Dans le Chapitre IV il dit la même chose : « la propriété étatique des moyens de production ne transforme pas le fumier en or et n'entoure pas d'une auréole de sainteté le sweating system, le système de la sueur ». ([11] [3177])
Ces thèses semblent très clairement constater des phénomènes élémentaires du point de vue marxiste. Car Marx a toujours souligné que la caractéristique principale de tout système social n'était pas constituée par ses lois et « ses formes de propriété » dont l'analyse en tant qu'une chose en soi menait à une métaphysique stérile ([12] [3178]). Le facteur décisif est constitué par les rapports sociaux réels, principalement le comportement des groupes sociaux envers le surproduit social.
Un mode de production peut se fonder sur différentes formes de propriété. L'exemple du féodalisme le montre bien. Au Moyen Age, il s'est fondé sur la propriété féodale privée des terres dans les pays occidentaux et sur la propriété féodale d'Etat dans les pays orientaux. Néanmoins, dans les deux cas, les rapports sociaux étaient féodaux, ils s'appuyaient sur l'exploitation féodale que la classe des paysans producteurs subissait.
Dans le Livre III du Capital Marx définit comme caractéristique principale de toute société « la forme économique spécifique sous laquelle le travail gratuit est directement soutiré des producteurs. » Par conséquent, ce qui joue le rôle décisif ce sont les rapports entre ceux qui contrôlent le processus et les résultats de la production et ceux qui exercent cette dernière ; l'attitude des propriétaires des conditions de la production envers les producteurs eux-mêmes... : « C'est ici que nous découvrons le mystère le plus profond, la base cachée de toute la société. » ([13] [3179])
Nous avons déjà donné le tableau des rapports entre la couche dirigeante et les producteurs tel que le décrit Trotsky. D'un côté, « les propriétaires des conditions de la production » réels incarnés dans Etat (c’est-à-dire la bureaucratie organisée), de l'autre, les propriétaires « de-jure », en fait les travailleurs dépossédés des droits, les salariés dont « le travail gratuit est soutiré ». Il n'est possible d'en tirer qu'une seule conclusion logique : du point de vue de leur nature, il n'y a aucune différence fondamentale entre le système bureaucratique stalinien et celui du capitalisme « classique ».
Ici aussi, après avoir dit « A », après avoir démontré une identité fondamentale de ces deux systèmes, Trotsky ne dit pas « B ». Au contraire, il se dresse catégoriquement contre une identification de la société stalinienne à un capitalisme d'Etat et il avance la thèse qu'il existe en URSS une forme spécifique d'« Etat ouvrier » où le prolétariat demeure une classe dirigeante du point de vue économique et ne subit pas d'exploitation bien qu'il soit « politiquement exproprié ».
Pour soutenir cette thèse, Trotsky invoque la nationalisation des terres, des moyens de production, du transport et des échanges ainsi que le monopole du commerce extérieur, c’est-à-dire qu’il dresse le même argumentaire « juridique » qu'il a déjà réfuté d'une manière convaincante (voir les citations ci-dessus). A la page 72 [édition russe] de La Révolution trahie il nie que la propriété d'Etat puisse « transformer le fumier en or », mais à la page 206, au contraire, il déclare que le seul fait de la nationalisation suffit pour que les travailleurs opprimés deviennent la classe dirigeante.
Le schéma qui efface la réalitéComment peut-on expliquer cela ? Pourquoi Trotsky, le publiciste, le critique impitoyable du stalinisme qui cite les faits démontrant que la bureaucratie est une classe dirigeante et un exploiteur collectif, peut-il contredire Trotsky, le théoricien qui essaie d'analyser les faits exposés ?
Evidemment, on peut donner deux séries de causes principales qui ont empêché Trotsky de surmonter cette contradiction. Ce sont des causes de type théorique et des causes de type politique.
Dans La Révolution trahie, Trotsky essaie de réfuter en théorie la thèse de l'essence de classe de la bureaucratie en avançant des arguments assez faibles dont le fait qu’elle « n'a ni titres ni actions » ([14] [3180]). Mais pourquoi la classe dirigeante doit-elle obligatoirement les posséder ? Car il est bien évident que la possession « des actions et des obligations » elle-même n'a aucune importance : la chose importante consiste dans le fait que tel ou tel groupe social s’approprie ou non un surproduit du travail des producteurs directs. Si oui, la fonction d'exploitation existe indépendamment de la distribution d'un produit approprié soit en tant que profit sur des actions, soit en tant que traitements et privilèges de fonction. L'auteur de La Révolution trahie est aussi peu convaincant quand il dit que les représentants de la couche dirigeante ne peuvent pas laisser leur statut privilégié en héritage ([15] [3181]). Il est peu probable que Trotsky ait sérieusement envisagé que les fils de l’élite puissent devenir ouvriers ou paysans.
A notre avis, il ne faut pas chercher dans des explications superficielles de ce genre une cause vraiment fondamentale du refus de Trotsky de considérer la bureaucratie comme la classe sociale dirigeante. Il faut la chercher dans sa conviction profonde que la bureaucratie ne pouvait pas devenir l’élément central d'un système stable, qu'elle n’était capable que de « traduire » les intérêts d'autres classes, mais en les faussant.
Aux cours des années 20, cette conviction était déjà devenue la base du schéma des antagonismes sociaux de la société « soviétique » adopté par Trotsky pour qui le cadre de tous ces antagonismes était réduit à une dichotomie stricte : prolétariat-capital privé. Dans ce schéma, il ne reste aucune place pour une « troisième force ». L’ascension de la bureaucratie a été considérée comme le résultat d'une pression de la petite bourgeoisie rurale et urbaine sur le parti et l'Etat. La bureaucratie a été considérée comme un groupe balançant entre les intérêts des ouvriers et ceux des « nouveaux propriétaires », qui n’était capable de bien servir ni les uns, ni les autres. Indubitablement, après une première atteinte sérieuse sur sa stabilité, le régime de domination d'un pareil groupe instable « entre les classes » devrait tomber et ce groupe se scinder. C'est ce que Trotsky a prédit à la fin des années 20 ([16] [3182]).
Pourtant, dans la réalité, les événements se sont développés d'une autre manière. Après un conflit des plus violents avec la paysannerie et la petite bourgeoisie, la bureaucratie n'est pas tombée et ne s'est pas scindée. Après avoir facilement obtenu la capitulation de la « droite » peu nombreuse en son sein, elle a commencé à liquider la NEP, « les koulaks comme classe », a déployé une collectivisation et une industrialisation forcées. Tout cela a été complètement inattendu pour Trotsky et ses partisans, car ils étaient sûrs que les « apparatchiks » centristes n'en seraient pas capables du fait de leur nature ! Il n'est pas étonnant que l’échec des prévisions politiques de l'opposition trotskiste ait entraîné son déclin catastrophique. ([17] [3183])
En tentant en vain de trouver une issue, Trotsky a envoyé de son exil des lettres et des articles où il a démontré qu'il n'y avait là qu'un détour de l'appareil qui allait « inévitablement échouer bien avant qu'il n'obtienne le moindre résultat sérieux » ([18] [3184]). Même quand le leader de l'Opposition a constaté l’inconsistance pratique de ses conceptions à propos d'un rôle « dépendant » de la bureaucratie « centriste », il a continué obstinément à s'en tenir à un schéma en état de faillite. Ses réflexions théoriques de l’époque du « grand tournant » nous frappent par leur éloignement de la réalité. Par exemple, à la fin de 1928 il écrit : « Le centrisme est une ligne officielle de l'appareil. Le porteur de ce centrisme est le fonctionnaire du parti... Les fonctionnaires ne forment pas une classe. Quelle ligne de classe le centrisme représente-t-il ? » Car Trotsky niait la possibilité même d'une ligne propre de la bureaucratie ; il en était arrivé à la conclusion suivante : « Les propriétaires montants trouvent leur expression, même lâche, dans la fraction de droite. La ligne prolétarienne est représentée par l'opposition. Que reste-t-il au centrisme ? Après la déduction des sommes ci-dessus reste... le paysan moyen » ([19] [3185]). Et Trotsky écrit tout cela alors même que l'appareil stalinien conduit la campagne de violence contre la paysannerie moyenne et prépare la liquidation de sa formation économique !
Et par la suite, Trotsky a continué d'attendre une proche désintégration de la bureaucratie en éléments prolétariens, bourgeois et « ceux qui resteraient de côté ». Il a prédit la chute du pouvoir des « centristes » d'abord après l’échec d’une « collectivisation complète », puis comme résultat d'une crise économique à la fin du premier quinquennat. Dans son « Projet de plate-forme de l'opposition de gauche internationale sur la question russe » rédigé en 1931, il a même envisagé la possibilité d'une guerre civile quand les éléments de l'appareil d'Etat et du parti seraient divisés « des deux côtés de la barricade » ([20] [3186]).
Malgré toutes ces prévisions, le régime stalinien s'est maintenu, la bureaucratie non seulement s'est unifiée, mais elle a même renforcé son pouvoir totalitaire. Néanmoins, Trotsky a continué de considérer le système bureaucratique en URSS comme extrêmement précaire, et dans les années 30, il a cru que le pouvoir de la bureaucratie pouvait s'effondrer à tout moment. De ce fait, on ne peut pas considérer celle-ci comme une classe. Trotsky a le plus clairement exprimé cette pensée dans son article « L'URSS en guerre » (septembre 1939) : « Est-ce que nous ne nous tromperons pas si nous donnons le nom d'une nouvelle classe dirigeante à l'oligarchie bonapartiste quelques années ou même quelques mois avant sa chute honteuse ? » ([21] [3187]).
Ainsi, tous les pronostics sur le destin de la bureaucratie « soviétique » dirigeante faits par Trotsky ont été réfutés les uns après les autres par les événements eux-mêmes. Pourtant, malgré tout cela, il n'a pas voulu modifier ses opinions. Pour lui, l'attachement à un schéma théorique valait plus que tout le reste. Mais là ne se trouve pas la seule cause, car Trotsky fut plus homme politique que théoricien et il préféra généralement une approche « politique concrète » de divers problèmes à une approche « sociologique abstraite ». Et ici nous allons voir une autre cause importante de son refus obstiné de nommer les choses par leur propre nom.
La terminologie et la politiqueSi nous examinons l'histoire de l'opposition trotskiste dans les années 20 et au début des années 30, nous verrons que la base de toute sa stratégie politique était de miser sur une désintégration de l'appareil gouvernant en URSS. C’est l'alliance d'une « tendance de gauche » hypothétique avec l'Opposition que Trotsky considérait comme la condition nécessaire pour une réforme du parti et de l'Etat. « Le bloc avec les centristes [la partie stalinienne de l'appareil - A.G.] est admissible et possible en principe, écrit-il à la fin de 1928. De plus, seul un tel regroupement dans le parti peut sauver la révolution » ([22] [3188]). En comptant sur un tel bloc, les leaders de l'opposition tentaient de ne pas repousser les bureaucrates « progressistes ». En particulier, cette tactique explique une attitude plus qu’équivoque des leaders de l'Opposition envers la lutte de classe des travailleurs contre l'Etat, leur refus de créer leur propre parti, etc.
Même après son exil de l'URSS, Trotsky a continué de placer ses espoirs dans le rapprochement avec les « centristes ». Son aspiration à s'appuyer sur une partie de la bureaucratie dirigeante était si grande qu'il était prêt à transiger (sous certaines conditions) avec le secrétaire général du Comité Central du PC. L'histoire du mot d'ordre « Démettre Staline ! » en est un exemple frappant. En mars 1932, Trotsky a publié une lettre ouverte au Comité Exécutif Central de l'URSS ou il lance un appel : « Il faut réaliser enfin le dernier conseil insistant de Lénine : démettre Staline » ([23] [3189]). Mais quelques mois après, à l'automne de cette même année, il avait déjà reculé en l'expliquant ainsi : « Il ne s'agit pas de la personne de Staline, mais de sa fraction... Le mot d'ordre "A bas Staline !" peut être compris (et serait inévitablement compris) comme l'appel à un renversement de la fraction qui est aujourd'hui au pouvoir et, au sens plus large, de l'appareil. Nous ne voulons pas renverser le système, mais le réformer... » ([24] [3190]). Trotsky a mis tous les points sur « i » sur la question de l'attitude envers les staliniens dans son article-interview inédit écrit en décembre 1932 : « Aujourd'hui, comme jadis, nous sommes prêts à une coopération multiforme avec la fraction dirigeante actuelle. Question : en conséquence, êtes-vous prêts à coopérer avec Staline ? Réponse : Sans aucun doute » ([25] [3191]).
Au cours de cette période Trotsky liait la possibilité d'un tournant d'une partie de la bureaucratie stalinienne vers « la coopération multiforme » avec l'Opposition à une proche « catastrophe » du régime qu'il considérait comme inévitable, comme nous l'avons déjà vu plus haut, en raison de la « précarité » de la position sociale de la bureaucratie ([26] [3192]). En fonction de cette catastrophe, les leaders de l'Opposition considéraient l'alliance avec Staline comme le moyen de sauver le parti, la propriété nationalisée et l'« économie planifiée » de la contre-révolution bourgeoise.
Pourtant, la catastrophe n'a pas eu lieu : la bureaucratie était beaucoup plus consolidée et forte que ne le pensait Trotsky. Le Bureau Politique n'a rien répondu à ses appels en vue d’assurer « une coopération honnête des fractions historiques » dans le PC ([27] [3193]). Enfin, à l'automne 1933, après beaucoup d’hésitations, Trotsky a rejeté l’espoir tout utopique en des réformes du système bureaucratique avec la participation des staliniens et a appelé à faire « une révolution politique » en Union Soviétique.
Mais ce changement du mot d’ordre principal des trotskistes n'a nullement signifié la révision radicale de leurs points de vue sur la nature de la bureaucratie, du parti et de l'Etat, ni un refus définitif des espérances en faveur d’une alliance avec sa tendance « progressiste ». Quand Trotsky a écrit La Révolution trahie et après, il considérait en théorie la bureaucratie comme une formation précaire dévorée par des antagonismes croissants. Dans « Le Programme de transition » de la IVe Internationale (1938) il déclare que l'appareil gouvernant en URSS comprend toutes les tendances politiques, dont une « vraiment bolchevique ». Trotsky se représente cette dernière comme une minorité dans la bureaucratie, mais une minorité assez importante : il ne parle pas de quelques apparatchiks, mais de la fraction de la couche comptant de 5 a 6 millions de personnes. D’après Trotsky, cette fraction « vraiment bolchevique » constituait une réserve potentielle pour l'opposition de gauche. De plus, le leader de la IVe Internationale a cru admissible la formation d'un « front uni » avec la partie stalinienne de l'appareil en cas de tentatives de contre-révolution capitaliste auxquelles il fallait s'attendre « dans l’immédiat », comme il pensait en 1938 ([28] [3194]).
C'est avant tout cette orientation politique (à la fin des années 20 et au début des années 30) vers la coopération et vers le bloc avec les « centristes », c’est-à-dire avec la majorité de la bureaucratie « soviétique » dirigeante, puis (dès 1933) vers l'alliance avec sa minorité « vraiment bolchevique » et vers « un front uni » avec la fraction stalinienne dirigeante qu'il faut avoir en vue en examinant les idées de Trotsky sur la nature de l'oligarchie bureaucratique, et des rapports sociaux en URSS en général, exprimées le plus complètement dans La Révolution trahie.
Supposons que Trotsky ait reconnu dans la bureaucratie « soviétique » totalitaire une classe dirigeante exploiteuse ennemie acharné du prolétariat. Quelles en eussent été les conséquences politiques ? En premier lieu, il aurait fallu rejeter l’idée de s'unir avec une partie de cette classe - la thèse même de l'existence d'une pareille « fraction vraiment bolchevique » au sein de la classe bureaucratique exploiteuse aurait paru aussi absurde que la supposition de son existence au sein de la bourgeoisie, par exemple. En deuxième lieu, dans un tel cas, une supposée alliance avec les staliniens pour lutter contre « la contre-révolution capitaliste » serait devenue un « front populaire », politique désapprouvée catégoriquement par les trotskistes, puisqu’elle aurait consisté en un bloc entre classes ennemies, au lieu d'être un « front uni » au sein d'une classe, idée acceptable dans la tradition bolchevik-léniniste. Bref, constater l'essence de classe de la bureaucratie portait un coup très sérieux aux bases de la stratégie politique de Trotsky. Naturellement, il ne l'a pas voulu.
Ainsi, le problème de déterminer la nature de la bureaucratie qui peut à première vue sembler terminologique ou théorique, était beaucoup plus important.
Le destin de la bureaucratieIl faut rendre justice a Trotsky : à la fin de sa vie il a commencé à réviser ses visions de la bureaucratie stalinienne. On le voit dans son livre « Staline », la plus mûre de ses œuvres bien qu’inachevée. En examinant les événements décisifs au tournant des années 20-30, quand la bureaucratie a complètement monopolisé le pouvoir et la propriété, Trotsky considère déjà l'appareil d'Etat et du parti comme une des forces sociales principales qui luttaient pour disposer du « surplus de la production du travail national ». Cet appareil était mu par l'aspiration à contrôler de façon absolue ce surproduit et non par la « pression » venant du prolétariat ou bien par « la poussée de l'opposition » (ce que Trotsky avait jadis prétendu) qui avait obligé les apparatchiks à déclarer la guerre à outrance aux « éléments petit-bourgeois » ([29] [3195]). En conséquence, la bureaucratie « n'exprimait » pas les intérêts d'autrui et ne « balançait » pas entre deux pôles, mais se manifestait en tant que groupe social conscient avec ses propres intérêts. Elle l’a emporté dans la lutte pour le pouvoir et les profits après avoir abattu tous ses concurrents. Elle a monopolisé la disposition du surproduit (c’est-à-dire la fonction d'un propriétaire réel des moyens de production). Après l'avoir avoué, Trotsky ne peut plus négliger la question d'une essence de classe de la bureaucratie. En effet, quand il parle des années 20, il dit : « La substance du Thermidor [soviétique] ... se trouvait dans la cristallisation d'une nouvelle couche privilégiée, la création d'un nouveau substratum pour la classe économiquement dirigeante [souligné par A.G.]. Deux prétendants ambitionnaient ce rôle : la petite bourgeoisie et la bureaucratie elle-même » ([30] [3196]). Ainsi le substrat avait nourri deux prétendants pour jouer le rôle d'une classe dirigeante, il ne restait qu'à découvrir qui vaincrait - c'est la bureaucratie qui a vaincu. La conclusion en est bien claire : c'est la bureaucratie qui est devenue cette classe sociale dirigeante. A la vérité, après avoir préparé cette conclusion, Trotsky n'y parvient pas, préférant ne pas achever politiquement ses réflexions. Mais il a fait un grand pas en avant.
Dans son article « L'URSS dans la guerre » publié en 1939, Trotsky a fait encore un pas dans cette direction : il croit possible en théorie que « le régime stalinien [soit] la première étape d'une société d'exploitation nouvelle ». Certes, il a comme toujours souligné qu'il avait un autre point de vue sur cela : le système soviétique et la bureaucratie qui y gouvernait n’étaient qu'une « récidive épisodique » dans le processus de la transformation d'une société bourgeoise en société socialiste. Néanmoins il a déclaré sa bonne volonté de réviser ses opinions en certaines circonstances, au cas où le gouvernement bureaucratique en URSS survivrait à la guerre mondiale déjà commencée et se répandrait dans d’autres pays ([31] [3197]).
On sait que tout s’est passé comme cela. La bureaucratie qui, d'après Trotsky, est privée de toute mission historique, se trouve « entre les classes », est non autonome et précaire, constitue « une récidive épisodique », n'a pas fait autre chose que de changer radicalement la structure sociale de l'URSS par la prolétarisation de millions de paysans et de petits bourgeois, de réaliser une industrialisation fondée sur la surexploitation des travailleurs, de transformer le pays en grande puissance militaire, de survivre à la guerre la plus pénible, d’exporter les formes de sa domination en Europe Centrale et de l'Est et en Asie du Sud-Est. Est-ce qu'après cela Trotsky aurait changé ses visions de la bureaucratie ? C'est difficile à dire : il n'a pas survécu à la 2ème guerre mondiale et n’a pu voir la formation d'un « camp socialiste ». Mais pendant les dizaines d'années d’après-guerre, la plupart de ses adeptes politiques ont continué à répéter à la lettre les dogmes théoriques tirés de La Révolution trahie.
La marche de l'histoire a évidemment réfuté tous les points principaux de l'analyse trotskiste du système social en URSS. Pour le constater il ne suffit que d'un fait : aucune des « réalisations » de la bureaucratie citées ci-dessus ne se conforme au schéma théorique de Trotsky. Pourtant, même aujourd'hui, certains chercheurs (sans parler des représentants du mouvement trotskiste) continuent à prétendre que la conception de l'auteur de La Révolution trahie et ses pronostics concernant le destin d'une « caste » dirigeante ont été confirmés par l’échec du régime du PCUS et les événements qui ont suivi en URSS et dans les pays du « bloc soviétique ». Il s'agit de la prédiction de Trotsky d’après laquelle le pouvoir de la bureaucratie devait inévitablement tomber, soit comme résultat d’une « révolution politique » des masses des travailleurs, soit après un coup d'Etat social bourgeois contre-révolutionnaire ([32] [3198]). Par exemple, l'auteur de la série des livres apologétiques sur Trotsky et sur l'opposition trotskiste, V.Z. Rogovine ([33] [3199]), écrit que « la variante "contre-révolutionnaire" des pronostics de Trotsky a été réalisée avec un retard de 50 ans, mais de façon extrêmement précise. » ([34] [3200])
Où trouvons-nous cette précision, et surtout son caractère « extrême » ?
L'essence de la variante « contre-révolutionnaire » des pronostics de Trotsky a été avant tout dans ses prédictions de la chute de la bureaucratie en tant que couche dirigeante. « La bureaucratie est inséparablement liée à la classe dirigeante au sens économique [il s'agit du prolétariat - A.G.], nourrie de ses racines sociales, elle se tient et tombe avec lui [souligné par A.G.] » ([35] [3201]). En supposant, que dans les pays de l'ex-Union Soviétique a eu lieu la contre-révolution sociale et que la classe ouvrière a perdu son pouvoir économique et social, d'après Trotsky, la bureaucratie dirigeante aurait dû tomber avec lui.
Est-ce qu'elle est tombée en réalité, est-ce qu'elle a cédé la place à la bourgeoisie venue de quelque part ailleurs ? D’après l’Institut de Sociologie de l’Académie des Sciences de Russie, plus de 75 % de « l’élite politique » russe et plus de 61 % de « l’élite du business » sont originaires de la Nomenklatura de la période « soviétique » ([36] [3202]). Par conséquent, les mêmes mains tiennent les mêmes positions sociales, économiques et politiques dirigeantes dans la société. L'origine d’une autre partie de l’élite s’explique simplement. La sociologue O. Krychtanovskaya écrit : « Outre la privatisation directe... dont le sujet principal était la partie technocratique de la Nomenclatura (économistes, banquiers professionnels etc.), a eu lieu la création quasi spontanée des structures commerciales qui paraissaient n'avoir aucune relation avec la Nomenklatura. A la tête de telles structures se sont trouvés de jeunes gens dont l'étude des biographies n'a pas révélé de lien avec la Nomenklatura. Mais leurs grands succès financiers n'expliquent qu'une chose : n’étant pas partie de la Nomenklatura, ils étaient ses hommes de confiance, ses "agents de trust", autrement dit, plénipotentiaires [souligné par l'auteur - A. G.] » ([37] [3203]). Tout cela montre très clairement que ce n'était pas un quelconque « parti bourgeois » (d'où peut-il apparaître du fait de l'absence de la bourgeoisie sous le régime totalitaire ?) qui a pris le pouvoir et a réussi à utiliser quelques originaires de la « caste » gouvernante de jadis en tant que ses serviteurs - c'est la bureaucratie elle-même qui a transformé d'une manière organisée les formes économiques et politiques de sa domination, en restant le maître du système.
Ainsi, contrairement à la prévision de Trotsky, la bureaucratie n'est pas tombée. Avons-nous, pourtant, constaté la réalisation de l'autre aspect de ses pronostics, la prédiction d'une scission imminente de la « couche » sociale dirigeante en éléments prolétariens et bourgeois et de la formation en son sein d'une fraction « vraiment bolchevique » ? Effectivement, les leaders des partis « communistes », différentes formes des débris du PCUS, prétendent actuellement jouer le rôle des vrais bolcheviks, des défenseurs des intérêts de la classe ouvrière. Mais il est peu probable que Trotsky aurait reconnu « les éléments prolétariens » en Zouganov et en Ampilov ([38] [3204]) car le but de toute leur lutte « anticapitaliste » n'est pas autre chose que la restauration de l'ancien régime bureaucratique dans sa forme stalinienne classique ou « étatiste patriotique ».
Enfin, Trotsky avait vu la variante « contre-révolutionnaire » de la chute du pouvoir de la bureaucratie dans des couleurs presque apocalyptiques : « Le capitalisme ne pourrait (ce qui est douteux) être restauré en Russie qu'à la suite d'un coup d'Etat contre-révolutionnaire cruel qui conduirait à dix fois plus de victimes que la révolution d’Octobre et la guerre civile. En cas de chute des Soviets, leur place ne serait occupée que par le fascisme russe, par rapport auquel les cruautés des régimes de Mussolini et de Hitler apparaîtraient comme des institutions philanthropiques. » ([39] [3205]). Il ne faut pas considérer cette prédiction comme une exagération accidentelle, car elle résulte inévitablement de toutes les visions théoriques de Trotsky sur la nature de l'URSS, et avant tout de sa conviction profonde que le système bureaucratique « soviétique » servait à sa manière les masses des travailleurs, garantissant leurs « conquêtes sociales ». Cette vision admettait naturellement que la transition contre-révolutionnaire du stalinisme au capitalisme devrait être accompagnée de la levée des masses prolétariennes pour défendre l'Etat « ouvrier » et « leur » propriété nationalisée. Et seul un régime féroce du type fasciste pourrait sûrement abattre et écraser une résistance puissante des ouvriers contre « la restauration capitaliste ».
Bien sûr, Trotsky n'avait pu supposer qu'en 1989-1991 la classe ouvrière ne défendrait pas la nationalisation de la propriété et l'appareil d'Etat « communiste », et que, de plus, elle contribuerait activement à leur abolition. Car les travailleurs ne voyaient rien dans l'ancien système qui aurait justifié sa défense ; la transition à l’économie de marché et la dénationalisation de la propriété n'ont mené à aucune lutte de classe sanglante et aucun régime fasciste ou semi-fasciste n'a été nécessaire. Ainsi, dans ce domaine, il n'y a pas lieu de parler d'une réalisation des pronostics de Trotsky.
Si la bureaucratie « soviétique » n’était pas une classe dirigeante et, selon Trotsky, n’était que le « gendarme » du processus de distribution, la restauration du capitalisme en URSS demanderait une accumulation primitive du capital. En effet, les publicistes russes contemporains emploient souvent cette expression de « l'accumulation primitive du capital ». En l'utilisant, les auteurs la comprennent en général comme l'enrichissement de telle ou telle personne, l'accumulation de l'argent, des moyens de production et d'autres biens dans les mains de « nouveaux Russes ». Pourtant tout cela n'a aucun rapport avec la compréhension scientifique de l'accumulation primitive du capital découverte par Marx dans « Le Capital ». En analysant la genèse du capital, Marx a souligné que « son accumulation appelée 'primitive' n'est qu'un processus historique de séparation du producteur et des moyens de production » (40). La formation de l’armée des salariés par la confiscation de la propriété des producteurs est une des conditions principales de la formation d'une classe dirigeante. Est-ce qu'au cours de années 90 dans les pays de l'ex-URSS « les restaurateurs du capitalisme » ont eu besoin de former une classe de salariés par l'expropriation des producteurs ? Evidemment non : cette classe existait déjà, les producteurs ne contrôlaient les moyens de production en aucune manière - il n'y avait personne à exproprier. Par conséquent, le temps de l'accumulation primitive du capital était déjà passé.
Quand Trotsky a lié l'accumulation primitive à la dictature cruelle et à l'effusion de sang, il avait sans doute raison. Marx écrit aussi que « le capital [vient au monde] suant le sang et la boue par tous les pores » et à son premier stade a besoin d'une « discipline sanguinaire » (41). L’erreur de Trotsky ne se trouve que dans le fait qu'il liait l’accumulation primitive à une prochaine contre-révolution hypothétique et ne voulait pas voir comment elle (avec tous ses attributs nécessaires comme une tyrannie politique monstrueuse et des massacres en masse) se réalisait sous ses yeux. Les millions de paysans pillés, mourant de faim et de misère, les ouvriers privés de tous les droits et condamnés à travailler au-dessus de leurs forces, dont les tombeaux étaient les fondations permettant de bâtir les édifices prévus par les quinquennats staliniens, les innombrables prisonniers du GOULAG - voici les véritables victimes de l'accumulation primitive en URSS. Les possesseurs contemporains de la propriété n'ont pas besoin d'accumuler le capital, pour eux il suffit de le redistribuer entre eux-mêmes en le transformant de capital d'Etat en capital privé corporatif (42). Mais cette opération qui ne signifie pas un changement de société ni des classes dirigeantes, ne nécessite pas de grands cataclysmes sociaux. Si on ne le comprend pas, on ne peut comprendre ni l'histoire « soviétique », ni l’actualité russe.
Concluons. La conception trotskiste de la bureaucratie qui avait synthétisé la série des visions théoriques fondamentales et des perspectives politiques de Trotsky, n'a pas été capable d’expliquer ni les réalités du stalinisme ni la marche de son évolution. On peut dire la même chose d'autres postulats de l'analyse trotskiste du système social de l'URSS (l'Etat « ouvrier », le caractère « post-capitaliste » des relations sociales, le rôle « double » du stalinisme, etc.). Néanmoins, Trotsky a pourtant réussi à résoudre le problème dans un autre sens : ce publiciste remarquable a fait une critique foudroyante des thèses sur la construction du « socialisme » en Union Soviétique. Et c’était déjà pas mal pour son temps.
A.G.
40 Karl Marx, Le Capital, Livre I, Editions sociales, Paris 1976, p. 518.
41. Ibidem, p. 555 et 541.
42. En faisant une conclusion analogique après des études sociologique concrètes, O. Krychtanovskaya écrit : « Si on analyse attentivement la situation en Russie au cours des années 90 (...), on constate que seuls les physiciens maladroits qui ont décidé de devenir "brockers", ou les ingénieurs en technologie devenus propriétaires de kiosques ou de coopératives commerciales, faisaient de "l'accumulation primitive". Leur passage par cette accumulation a presque toujours fini par l'achat d’actions de "MMM" [une pyramide financière] (le résultat en est bien connu) et a rarement abouti à l'étape de "l'accumulation secondaire". » (Izvestia, 10 janvier 1996).
Courants politiques:
- Trotskysme [3245]
Heritage de la Gauche Communiste:
6° congrès du Partito Comunista Internazionalista - Un pas en avant pour la Gauche Communiste
- 2974 reads
Dans le n° 13 de Prometeo, le Partito Comunista Internazionalista – Battaglia Comunista (PCInt) a publié les documents élaborés pour son 6e congrès.
Le congrès est l'acte le plus important dans la vie d'une organisation révolutionnaire. C'est l'organe souverain qui décide collectivement des orientations, des analyses et des positions programmatiques et organisationnelles. Cela est en soi une raison suffisante pour se prononcer sur les décisions adoptées par le PCInt. Cependant, il existe une raison plus importante encore qui nous pousse à le faire : nous voulons souligner la prise de position globale du congrès qui montre une volonté de donner des réponses aux questions et enjeux posés au prolétariat et à son avant-garde par l'évolution de la situation historique : « Le congrès a servi substantiellement à fixer et intégrer dans le patrimoine 'historique' du parti ce que nous avions examiné et, dans les limites de nos forces, élaboré face aux changements répétés de la situation ; signaler le début de ce que nous inclinons à définir comme une nouvelle phase dans la vie politique du parti et plus généralement de la gauche communiste. » (Prometeo, n° 13)
Cette conscience d'une « nouvelle phase » dans la vie politique du PCint et de la Gauche communiste a poussé le PCInt à modifier certains éléments de la plate-forme programmatique et des critères de regroupement du BIPR ([1] [3246]) qui vont selon nous dans le sens d'une clarification pour l'ensemble du milieu révolutionnaire. C'est pourquoi nous pensons que le congrès a signifié un renforcement de l'ensemble de la Gauche communiste dans le combat pour sa défense et son développement.
Evidemment, le salut et l'appui à ces éléments positifs du congrès ne signifient en aucune manière que nous mettons de côté les divergences et la critique des documents du congrès quand nous sommes franchement en désaccord.. Dans le présent article nous allons signaler quelques-unes de ces divergences mais nous montrerons surtout ce que nous considérons comme une contribution pour l'ensemble de l'avant-garde communiste, comme un renforcement des positions communes de la Gauche communiste. C'est uniquement en partant de ce cadre que nous pourrons être amenés à développer ultérieurement des divergences et des critiques.
La dénonciation de la mystification démocratique
L'histoire du mouvement ouvrier au 20e siècle a montré clairement que la soi-disant « démocratie » est la principale arme de la bourgeoisie contre le prolétariat. La mascarade démocratique permet à l'Etat capitaliste de tromper, de diviser les ouvriers et de les dévoyer de leur terrain de classe ce qui lui permet, une fois ce travail accompli, d’organiser une répression implacable qui en général n'a rien à envier à celle exercée par les formes les plus crues de la dictature du capital (fascisme ou stalinisme).
Dans la situation actuelle, du fait de la désorientation dans laquelle se trouve la classe ouvrière (conséquence de l'effondrement des régimes faussement « communistes » et de toute la campagne anticommuniste qu'a organisée depuis la bourgeoisie mondiale), la mystification démocratique connaît un nouveau regain et c'est pour cela que nous assistons à un battage constant, mobilisant tous les moyens de l'Etat pour dévoyer les prolétaires vers le terrain pourri de la défense de la « démocratie ».
De ce point de vue, en ce qui concerne la dénonciation de la mystification démocratique, l'ancienne plate-forme du BIPR de 1984 ([2] [3247]) contenait des ambiguïtés et des lacunes. Ainsi le BIPR gardait le silence sur les élections et le parlementarisme. De plus, il affirmait que « la révolution démocratique n'est déjà plus une voie praticable. On doit la considérer (et cela depuis longtemps) comme définitivement fermée dans les citadelles impérialistes, impossibles à répéter dans d'autres lieux dans la période de décadence. » Nous sommes tout à fait d'accord avec cela, mais si la « révolution démocratique » était bien dénoncée comme quelque chose d'« impossible », le PCint ne se prononçait pas clairement sur la possibilité ou non de mener une lutte « tactique » pour « la démocratie » ([3] [3248]) alors que, par ailleurs, il parlait de « la prise en charge possible de la revendication de certaines libertés élémentaires dans l'agitation politique révolutionnaire. »
Dans la nouvelle version de la plate-forme, la clarification est importante :
– D'une part le BIPR ne se limite pas à dénoncer les « révolutions démocratiques » ; il attaque « la lutte pour la démocratie » :« l'ère de la lutte démocratique est terminée depuis longtemps et ne peut pas se poser dans l'ère impérialiste. »
– De plus, le BIPR a ajouté un paragraphe qui signifie un rejet explicite des élections : « La tactique du parti révolutionnaire se dirige vers la destruction de l'Etat et l'instauration de la dictature du prolétariat. Les communistes ne se font pas d'illusions sur le fait que la liberté des ouvriers puisse être conquise au travers des élections d'une majorité au Parlement. »
– De manière plus concrète, le BIPR a ajouté un autre paragraphe où il affirme que la « démocratie parlementaire est la feuille de vigne qui cache la honte de la dictature bourgeoise. Les véritables organes de pouvoir dans la société capitaliste résident en dehors du parlement. »
Le BIPR a repris les "Thèses sur la démocratie" du 1er congrès de l'Internationale communiste et s'y est rattaché avec profondeur dans ses analyses et perspectives. Il y manque cependant, à notre avis, une condamnation explicite de l'utilisation des élections. Par exemple, le BIPR ne dénonce pas la théorie du parlementarisme révolutionnaire défendue par l'IC. Cette théorie reconnaissait que le parlement est une feuille de vigne de la domination bourgeoise et qu'on ne pouvait prendre le pouvoir par la voie électorale et parlementaire. Cependant, elle préconisait l' « utilisation révolutionnaire » du parlement comme tribune d'agitation et moyen de dénonciation. Cette position, clairement erronée à l'époque, est aujourd'hui contre-révolutionnaire en étant utilisée par les trotskistes pour ramener les ouvriers dans le giron des élections.
D'autre part, le BIPR a conservé le paragraphe qui fait référence à la « revendication de certains éléments de liberté (comme partie) de la propagande révolutionnaire. » A quoi se réfère le BIPR ? Soutient-il, comme le faisait le FOR ([4] [3249]), que même s'il faut rejeter la démocratie parlementaire et les élections, il existerait certaine « libertés élémentaires » de réunion, d'association, etc. que la classe ouvrière devrait tenter de conquérir légalement comme premier pas dans sa lutte ? Défend-il, comme le font certains groupes trotskistes radicaux que ces « libertés minimales » sont un élément d'agitation qui, même si elle ne peuvent être obtenues dans le capitalisme, servent à sa défense pour « faire avancer la conscience » ? Il serait bien que le BIPR clarifie cette question.
La question syndicale
Le PCInt avait déjà défendu une position assez claire sur la question syndicale en ce qui concerne le rejet de la position bourgeoise traditionnelle selon laquelle les syndicats seraient en quelque sorte des organes « neutres » dont l'orientation vers le prolétariat ou vers la bourgeoisie dépendrait de ceux qui les dirigent. Cette position était clairement condamnée dans la plate-forme de 1984 : « Il est impossible de conquérir ou de changer les syndicats : la révolution prolétarienne devra nécessairement passer sur leur cadavre. »
Dans les positions adoptées au congrès de 1997, il y a eu des modifications qui paraissent assez minimes à première vue. Le BIPR a supprimé un paragraphe présent dans la plate-forme de 1984 qui invalidait dans la pratique la clarté affirmée théoriquement : « dans le cadre de ces principes (l'affirmation mentionnée plus haut niant toute possibilité de conquérir ou de changer les syndicats) la possibilité d'actions concrètes différentes en ce qui concerne l'utilisation du travail communiste dans les syndicats est une question qui relève de l'élaboration tactique du parti. » Il nous semble tout à fait valable d'avoir éliminé ce paragraphe parce que sa signification reléguait les affirmations de principe contre les syndicats au sanctuaire de la « stratégie » pour laisser les mains libres aux impératifs « tactiques » élastiques de « travail dans les syndicats ».
Egalement dans le même sens, le BIPR a modifié le paragraphe suivant de la plate-forme de 1984 : « le syndicat n'est pas et ne peut pas être l'organe de masse de la classe ouvrière en lutte » en supprimant le terme « en lutte » qui signifiait, sans le dire ouvertement, que le BIPR ne rejetait pas l'idée que les syndicats puissent être des organes de masse de la classe ouvrière quand celle-ci n'était pas en lutte. Cette correction est encore renforcée dans le document adopté au congrès de 1997 intitulé « Les syndicats aujourd'hui et l'action communiste » qui affirme : « on ne peut se doter d'une véritable défense des intérêts, même immédiats, des travailleurs autrement qu'en dehors et contre la ligne syndicale. » (Thèse 7, Prometeo n° 13). Avec cette précision le BIPR ferme la porte au mensonge trotskiste de la « double nature » des syndicats, supposés favorables aux travailleurs dans les moments de calme social et réactionnaires dans les moments de lutte et de montée révolutionnaire. C'est une argutie pour retourner à l'enfermement syndical à laquelle est sensible le courant bordiguiste. Nous pensons que l'élimination de ce terme « en lutte » par le BIPR condamne cette position, même si cela aurait pu être dit plus clairement.
De la même manière le BIPR, dans le document mentionné ci-dessus, se démarque aussi du syndicalisme de base, cette variante radicalisée du syndicalisme qui attaque de façon virulente les grandes centrales syndicales et ses dirigeants pour mieux défendre la prétendue « nature ouvrière » du syndicalisme. En effet il affirme que « les différentes tentatives de construire de nouveaux syndicats ont fait naufrage dans une kyrielle de sigles syndicalistes de base, dont beaucoup sont à la recherche légale de pouvoirs contractuels institutionnels, suivant en cela les syndicats officiels. » (Thèse 8).
Nous saluons également le fait que le BIPR ait remplacé le paragraphe suivant : « le syndicat est l'organe de médiation entre le travail et le capital », par la formulation beaucoup plus claire : « les syndicats sont nés comme instruments de négociation des conditions de la vente de la force de travail. » L'ancienne formulation était dangereuse pour deux raisons :
– D'un côté, elle concédait aux syndicats un caractère intemporel d'organes de médiation entre le travail et le capital, aussi bien dans la période ascendante que dans la période décadente du capitalisme, alors qu'il est dit maintenant qu'ils « sont nés comme instrument de négociation... », ce qui distingue la position du BIPR de la vision bordiguiste typique selon laquelle les syndicats n'ont jamais changé.
– D'un autre côté, l’idée même d' « organes de médiation entre le travail et le capital » est erronée car elle ouvre la porte à la vision des syndicats comme organes situés entre les deux classes antagoniques de la société. Dans la période ascendante du capitalisme les syndicats n'étaient pas des organes de médiation entre les classes mais des instruments du combat prolétarien, créés par la lutte des ouvriers et violemment persécutés par la bourgeoisie. Il est donc plus clair de parler d'organes « nés comme instrument de négociation des conditions de la vente de la force de travail » car c'était une de leurs fonctions dans cette période historique, dérivée de la possibilité d'obtenir des améliorations et des réformes en faveur des ouvriers. Le BIPR oublie cependant l'autre dimension qu'avaient les syndicats, une dimension soulignée par Marx, Engels et les autres révolutionnaires : celle d'être des « écoles du communisme », des instruments d'organisation et, dans un certain sens, également de clarification, des couches les plus importantes de la classe ouvrière.
Enfin, le BIPR a effectué une modification significative sur la question de l'intervention des communistes dans la lutte de classe. Il s'agit de la question des « groupes communistes d'usine ». La plate-forme de 1984 disait que « la possibilité de favoriser le développement des luttes du niveau immédiat auquel elles naissent à celui, plus général, de la lutte politique anticapitaliste, dépend de la présence et du caractère opérationnel des groupes communistes d'usine. », alors que la rédaction adoptée en 1997 est : « la possibilité que les luttes se développent du plan contingent à celui plus large de la lutte politique anticapitaliste est subordonnée, de fait, à la présence et l'opérativité des communistes à l'intérieur des lieux de travail pour fournir un stimulant aux ouvriers et indiquer la perspective à suivre. » Nous partageons pleinement la préoccupation du BIPR quant au développement des moyens d'intervention des révolutionnaires dans le processus concret de la lutte et de la politisation de la classe. Cependant, si la préoccupation est juste, la réponse donnée nous paraît demeurer restrictive.
D'un côté le BIPR a éliminé valablement l'idée selon laquelle la politisation de la lutte immédiate des ouvriers dépend de « la présence et l'opérativité des groupes communistes d'usine » ([5] [3250]), mais d'un autre côté il maintient que la politisation anticapitaliste des luttes ouvrières « est subordonnée à la présence et l'opérativité des communistes à l'intérieur des lieux de travail ».
La « possibilité que les luttes se développent du plan contingent à celui plus large de la lutte politique anticapitaliste » ne dépend pas seulement de la présence des communistes « sur les lieux de travail ». Les révolutionnaires doivent développer une présence politique dans les luttes de la classe à travers une intervention par la presse, les tracts, les prises de parole, dans les grèves et dans les manifestations, dans les assemblées et les réunions, bref, partout où cette intervention est possible, pas seulement sur les lieux de travail où préexiste une présence d'éléments révolutionnaires, comme le laisse à penser la formulation du BIPR.
Selon l'autre document, « Les syndicats aujourd'hui et l'action communiste », les communistes devraient constituer autour d'eux des « organismes d'intervention dans la classe » qui pourraient être « d'usine » ou « territoriaux ».
Là aussi, la formulation nous paraît assez vague. Suivant les différents moments du rapport de forces entre les classes, peuvent surgir différentes formes d'organismes au sein du prolétariat :
– dans les moments de développement des luttes, ce que nous appelons des comités de lutte qui sont des organismes au sein desquels se regroupent les éléments combatifs qui se donnent pour objectif de contribuer à l'extension des combats et à leur prise en charge par les ouvriers au travers des assemblées et des comités de délégués élus et révocables ; plus que « d'usine », ils regroupent ou tendent à regrouper des travailleurs de différents secteurs ;
– dans des moments moins cruciaux ou lors du recul après une période de lutte intense, des petites minorités créent des groupes ouvriers ou cercles de discussion, plus liés au besoin de tirer des leçons de la lutte et orientés vers les problèmes plus généraux de la lutte ouvrière.
Face à ces tendances de la classe, la position des révolutionnaires rejette le « spontanéisme » qui consiste à « attendre que la classe par elle-même et de façon isolée les crée ». Les révolutionnaires interviennent dans ces organismes et n'hésitent pas à proposer et susciter leur formation si les conditions sont adéquates pour leur apparition. Ces organismes ne sont pas pour autant des « organismes d'intervention des communistes », ils sont des organismes de la classe et dans la classe, dont l'intervention est distincte de celle de l'organisation politique communiste. C'est pourquoi nous pensons que la formulation du BIPR reste ambiguë et laisse entrouverte la porte à la conception d'organisations intermédiaires entre la classe ouvrière et les organisations communistes.
Le rôle du parti et la lutte pour sa constitution à notre époque
Le parti communiste mondial est un instrument indispensable pour le prolétariat. Comme le démontre l'expérience de la révolution d'octobre 1917, le prolétariat ne peut pas parvenir à la victoire du processus révolutionnaire et prendre le pouvoir sans constituer en son sein le parti qui intervient, dirige politiquement et impulse son action révolutionnaire.
Avec la défaite de la vague révolutionnaire mondiale de 1917-23 et la dégénérescence des partis communistes, les groupes de la Gauche communiste ont essayé de tirer les leçons concrètes que ces expériences ont apportées sur la question du parti :
– En premier lieu, ils se sont consacrés à la question programmatique : la critique et le dépassement des points faibles du programme de l'Internationale communiste qui ont contribué à sa dégénérescence, particulièrement sur les questions syndicale, parlementaire et la prétendue « libération nationale » des peuples.
– En second lieu, ils ont procédé au dépassement de la conception du parti de masse liée aux tâches que le prolétariat devait accomplir dans la période ascendante du capitalisme (organisation et éducation de la classe étant donné le poids de ses origines dans l'artisanat et la paysannerie ; participation dans le parlement, étant donné la possibilité de la lutte pour des améliorations et des réformes).
Cette ancienne conception a conduit à la vision que le parti représente, encadre la classe et prend le pouvoir en son nom, vision erronée qui s'est révélée dangereuse et néfaste dans la période révolutionnaire de 1917-23. Face à cela, les groupes les plus avancés de la Gauche communiste ont clarifié que le parti est indispensable pour la classe non comme organe de masse mais comme force minoritaire capable de se concentrer sur la tâche de développer sa conscience et sa détermination politique ([6] [3251]) ; non comme organe pour exercer le pouvoir au nom de la classe mais comme facteur le plus dynamique et le plus avancé qui contribue, par son intervention et sa clarté, à ce que la classe exerce collectivement et massivement le pouvoir au travers des conseils ouvriers.
La position adoptée par le BIPR dans sa plate-forme de 1984, si elle montre bien une clarification sur les questions programmatiques (qui, comme nous l'avons vu dans les parties précédentes de cet article, a été plus développée dans le congrès de 1997), exprimait aussi une position ambiguë, faite d'affirmations générales et vagues, sur la question cruciale du parti, ses relations avec la classe, sa forme d'organisation et le processus de sa construction. Par contre, les documents du récent congrès précisent ces questions et montrent une conception beaucoup plus claire sur le processus de construction du parti et sur les pas concrets que doivent faire les organisations communistes dans la période actuelle.
Dans la plate-forme de 1984, le BIPR disait : « Le parti de classe est l'organe spécifique et irremplaçable de la lutte révolutionnaire car il est l'organe politique de la classe. » Nous sommes d’accord avec l’idée que le parti est un organe spécifique (il ne peut pas se confondre ni se diluer dans l'ensemble de la classe) et qu’il est effectivement irremplaçable ([7] [3252]). Cependant la formule « il est l'organe politique de la classe » peut laisser entendre, sans aller jusqu'à l'affirmer ouvertement (comme le font les bordiguistes), que le parti est l'organe de la prise du pouvoir au nom de la classe.
La rédaction de 1997 donne une précision très importante qui va dans le sens de positions plus conséquentes de la Gauche communiste : « Le parti de classe, ou les organisations desquelles il naîtra, comprennent la partie la plus consciente du prolétariat qui s'organise pour défendre le programme révolutionnaire. » D'une part, même si ce passage le dit de façon indirecte et implicite ([8] [3253]), le BIPR rejette la vision bordiguiste selon laquelle le parti est auto-proclamé par une minorité, indépendamment de la situation historique et du rapport de forces entre les classes, devenant LE parti pour toujours. D'autre part, le BIPR a éliminé la formule « organe politique de la classe » et l'a remplacée par une autre beaucoup plus claire : « la partie la plus consciente qui s'organise pour défendre le programme révolutionnaire ».
Evidemment renoncer à la formulation de 1984 ne signifie pas nier le caractère politique du parti. Le rôle politique du parti prolétarien ne peut pas être le même que celui des partis bourgeois qui est d’exercer le pouvoir politique au nom de ceux qu'ils représentent. Le prolétariat, comme classe exploitée privée de tout pouvoir économique ne peut déléguer à aucune minorité, pour fidèle et claire qu'elle soit, l'exercice de son pouvoir politique.
D'un autre côté, le BIPR a introduit dans son corps programmatique des leçons de la révolution russe sur lesquelles il n’y avait rien dans ses documents de 1984 : « les leçons de la dernière vague révolutionnaire ne sont pas que la classe peut se passer d'une direction organisée, non plus que le parti dans son ensemble est la classe (selon l'abstraction métaphysique des bordiguistes de ces derniers temps) mais que la direction organisée sous la forme du parti est l'arme la plus puissante que peut se donner la classe. Son objectif sera de combattre pour une perspective socialiste dans laquelle les organismes de masse seront ceux qui précèdent la révolution (soviets ou conseils). Le parti, cependant, sera une minorité dans la classe ouvrière et ne pourra pas représenter un substitut à celle-ci. L'objectif de construire le socialisme incombe à toute la classe dans son ensemble et ne peut pas être délégué, même à la partie la plus consciente du prolétariat. »
Le BIPR a introduit explicitement cette leçon essentielle de la révolution russe (qui d'un autre côté n'a fait que confirmer la devise de la 1re internationale, « l'émancipation des travailleurs sera l'oeuvre des travailleurs eux-mêmes ») et, en même temps, amène une réflexion sur comment doit se développer la relation entre les révolutionnaires et la classe, quel est le rôle du parti, quels sont ses liens avec la classe.
Dans la plate-forme de 1997 on trouve : « l'expérience de la contre-révolution en Russie oblige les révolutionnaires à approfondir la compréhension des problèmes concernant la relation entre Etat, parti et classe. Le rôle joué par ce qui était originellement le parti révolutionnaire a conduit beaucoup de révolutionnaires potentiels à rejeter en bloc l'idée de parti de classe. » Au lieu d'éluder le problème avec des phrases déclamatoires sur l' « importance » du parti, le BIPR se montre capable de poser les choses en termes historiques : « Pendant la révolution le parti tendra à conquérir la direction politique du mouvement en diffusant et en soutenant son programme au sein des organes de masse de la classe ouvrière. De la même façon qu'il est impossible de penser à un processus de croissance de la conscience sans la présence d'un parti révolutionnaire, il est également impossible d'imaginer aussi que la partie la plus consciente du prolétariat puisse maintenir le contrôle des évènements indépendamment des soviets. Les soviets sont l'instrument à travers lequel se réalise la dictature du prolétariat et leur déclin et leur marginalisation de la scène politique russe ont contribué à l'effondrement de l'Etat soviétique et à la victoire de la contre-révolution. Les commissaires bolcheviks, en restant isolés d'une classe ouvrière épuisée et affamée, se sont vus forcés de gérer le pouvoir dans un Etat capitaliste et ont agi comme ceux qui gouvernent un Etat capitaliste. »
Le BIPR en tire une conclusion avec laquelle nous sommes tout autant d’accord : « Dans la future révolution mondiale, le parti révolutionnaire devra tenter de diriger le mouvement révolutionnaire uniquement au travers des organes de masse de la classe, lesquels pousseront à son surgissement. Même s'il n'existe pas de recette qui assure la garantie de la victoire, ni le parti ni les soviets par eux-mêmes ne représentent une défense sûre face à la contre-révolution, la seule garantie de victoire est une conscience vivante de classe de la masse ouvrière. »
Le débat et le regroupement des révolutionnaires
En continuation avec cette clarification le BIPR a ajouté une série de précisions, absentes de ses documents de 1984, sur le rapport entre les groupes révolutionnaires actuels et la façon concrète de contribuer, à notre époque, au processus qui mène à la constitution du parti révolutionnaire.
Face à l'offensive actuelle de la bourgeoisie contre la Gauche communiste qui s'est exprimée, par exemple, dans la campagne « anti-négationniste », les révolutionnaires doivent établir une ligne de défense commune. D'un autre côté, le développement, aux quatre coins du monde, de petites minorités de la classe qui sont à la recherche des positions révolutionnaires, exige que les groupes communistes abandonnent le sectarisme et l'isolement et proposent au contraire un cadre cohérent à ces éléments pour qu’ils puissent appréhender le patrimoine commun de la Gauche communiste ainsi que les divergences qui les séparent.
En répondant correctement à ces préoccupations, le BIPR a ajouté un complément aux critères des conférences internationales (qui se trouvent dans la plate-forme de 1984) qui affirme : « Nous considérons le Bureau comme une force qui se situe à l'intérieur du camp politique prolétarien, lequel comprend ceux qui se battent pour l'indépendance du prolétariat face au capital, qui n'ont rien à voir avec le nationalisme sous quelque forme que ce soit, qui ne voient rien de socialiste dans le stalinisme et l'ancienne URSS et qui, en même temps, reconnaissent Octobre 1917 comme le point de départ d'une révolution européenne plus vaste. »
Le PCint reconnaît qu’« entre les organisations qui font partie du dit camp il y a toujours des différences politiques importantes parmi lesquelles la question de la nature et de la fonction que doit avoir l'organisation révolutionnaire. » et qu’il est nécessaire d'engager une discussion sur celles-ci. C'est la méthode correcte et cela représente, sans aucun doute, un changement d'attitude important par rapport à la position du BIPR lors de la 3e conférence internationale de la Gauche communiste, qui était maintenue dans ses documents de 1984. Rappelons-nous que, soutenu par la CWO, le PCInt avait proposé lors de la dernière séance de cette conférence un critère supplémentaire sur le rôle de « direction politique » du parti qui nous paraissait n'avoir d'autre sens que d'exclure le CCI des conférences internationales, comme nous l'avons exposé ensuite ([9] [3254]), puisque le PCInt s'était refusé à discuter la contre-proposition à ce critère qu'avait présenté le CCI. Cette contre-proposition exposait le rôle de direction politique du parti mais dans le cadre de l'exercice du pouvoir par les conseils ouvriers. C’est une question que, heureusement, comme nous venons de le souligner, le BIPR a repris avec clarté dans sa plate-forme de 1997. De plus, et surtout, le PCInt rejeta un projet de résolution qui demandait une discussion large et approfondie sur la conception du parti, sa fonction, sa nature et ses rapports avec l'ensemble de la classe. Aujourd'hui avec ce complément, le BIPR propose une discussion systématique de la question, ce qui nous paraît être une ouverture sans équivoque à la clarification programmatique au sein de la Gauche communiste. Nous ne pouvons pas prendre position de façon approfondie dans le cadre de cet article sur les points énoncés par le BIPR. Nous voulons souligner cependant le point 2 (que nous partageons pleinement comme le point 6 que nous avons commenté) : « Le BIPR tend à la formation du Parti Communiste Mondial au moment où il existera un programme politique et la force suffisante pour sa constitution. Le Bureau est pour le Parti mais ne prétend pas être l'unique noyau d'origine. Le parti futur ne sera pas simplement le fruit de la croissance d'une seule organisation. »
De cette vision juste le BIPR dégage le point 3 qui est également juste : « avant de constituer le parti révolutionnaire tous les détails de son programme politique doivent être clarifiés au travers de discussions et de débats entre les parties qui vont le constituer. » ([10] [3255])
De cette affirmation se dégage l'engagement du BIPR à une discussion rigoureuse entre les groupes révolutionnaires en vue de la clarification de l'ensemble de la Gauche communiste et de la nouvelle génération des éléments sécrétés par la classe qui sont attirés par ses positions. Nous saluons cet engagement, nous incitons à le concrétiser et le développer par des attitudes et des pas pratiques. Pour notre part, nous allons contribuer de toutes nos forces à son développement.
Adalen, 16 novembre 1997.
[10] [3265]. Même si bien sûr cette vision globalement juste ne doit pas conduire à une interprétation schématique selon laquelle il faudrait retarder la fondation du parti jusqu'à “ la clarification de tous les détails ”. Par exemple en mars 1919, la fondation de la 3e Internationale (qui était déjà en retard) était urgente et a été formée suivant le point de vue de Lénine face à celui du délégué allemand qui, invoquant le fait réel qu'il restait des points à clarifier, voulait la retarder.
Courants politiques:
- Bordiguisme [1287]
Heritage de la Gauche Communiste:
Revue Internationale no93 - 2e trimestre 1998
- 3058 reads
Chômage: la bourgeoisie prend les devants face à la montée de la colère ouvrière
- 3692 reads
A plusieurs reprises, au cours de l'hiver, on a assisté dans les deux plus grands pays d'Europe occidentale à des mobilisations autour de la question du chômage. En France, c'est sur plusieurs mois que se sont succédées des manifestations de rue dans les principales villes du pays ainsi que des occupations de lieux publics (notamment les organismes chargés de verser les indemnités au chômeurs). En Allemagne, on a eu droit le 5 février à une série de manifestations dans tout le pays appelées par les organisatons de chômeurs et les syndicats. La mobilisation n'a pas connu la même envergure qu'en France mais elle a été abondamment rapportée par les médias. Faut-il voir dans ces mobilisations une manifestation authentique de la combativité ouvrière ? Nous verrons plus loin que ce n'est pas le cas. Cependant, la question du chômage est fondamentale pour la classe ouvrière puisque celui-ci constitue une des formes les plus importantes des attaques qu'elle subit du capital en crise. En même temps, la montée et la permanence du chômage constitue une des meilleures preuves de la faillite du système capitaliste. Et c'est justement l'importance de cette question qui se trouve en arrière plan des mobilisations que l'on connaît à l'heure actuelle.
Avant que de pouvoir analyser la signification de ces mobilisations, il nous faut situer l'importance du phénomène du chômage pour la classe ouvrière mondiale et les perspectives de ce phénomène.
Le chômage aujourd'hui et ses perspectives
Aujourd'hui, le chômage touche des secteurs énormes de la classe ouvrière dans la plupart des pays de la planète. Dans le tiers-monde, la proportion de la population sans emploi varie souvant entre 30 et 50 %. Et même dans un pays comme la Chine qui, au cours des dernières années était présenté par les « experts » comme un des grands champions de la croissance, il y aura au moins 200 millions de chômeurs dans deux ans ([1] [3266]). Dans les pays d'Europe de l'est appartenant à l'ancien bloc russe, l'effondrement économique a jeté à la rue des millions de travailleurs et si, dans quelques rares pays tel la Pologne, un taux de croissance assez soutenu permet, au prix de salaires misérables, de limiter les dégats, dans la majorité d'entre eux, et particulièrement en Russie, on assiste à une véritable clochardisation de masses énormes d'ouvriers contraints pour survivre d'exercer des « petits boulots » sordides comme de vendre des sacs en plastique dans les couloirs du métro. ([2] [3267])
Dans les pays les plus développés, même si la situation n'est pas aussi tragique que dans ceux qu'on vient d'évoquer, le chômage massif est devenu une plaie de la société. Ainsi, pour l'ensemble de la Communauté européenne, le taux officiel des « demandeurs d'emploi » par rapport à la population en âge de travailler est de l'ordre de 11% alors qu'il était de 8 % en 1990, c'est-à-dire au moment où le président américain Bush promettait, avec l'effondrement du bloc russe, une « ère de propérité ».
Les chiffres suivants donnent une idée de l'importance actuelle du fléau que constitue le chômage :
|
Pays
|
Taux de chômage fin 1996
|
Taux de chômage fin 1997
|
|
Allemagne
|
9,3
|
11,6
|
|
France
|
12,4
|
12,3
|
|
Italie
|
11,9
|
12,3
|
|
Royaume-Uni
|
7,5
|
5,0
|
|
Espagne
|
21,6
|
20,5
|
|
Pays-Bas
|
6,4
|
5,3
|
|
Belgique
|
9,5
|
|
|
Suède
|
10,6
|
8,4
|
|
Canada
|
9,7
|
9,2
|
|
Etats-Unis
|
5,3
|
4,6
|
Sources : OCDE et ONU.
Ces chiffres méritent cependant des commentaires.
En premier lieu, il s'agit de chiffres officiels calculés suivant des critères qui masquent une proportion considérable du chômage. Ainsi, ils ne prennent pas en compte (entre autres) :
– les jeunes qui poursuivent leur scolarité parce qu'ils ne réussissent pas à trouver un emploi ;
– les chômeurs qu'on oblige à accepter des emplois sous-payés sous peine de perdre leurs allocations ;
– ceux qui sont envoyés en formation ou en stage censés leur ouvrir le marché du travail mais qui ne servent en réalité à rien ;
– les travailleurs âgés qui ont été mis en pré-retraite avant l'âge légal de sortie de la vie active.
De même, ces chiffres ne tiennent pas compte du chômage partiel, c'est-à-dire de tous les travailleurs qui ne réussissent pas à trouver un emploi stable à plein temps (par exemple les intérimaires dont le nombre est en progression continue depuis plus de dix ans).
D'ailleurs, tous ces faits sont bien connus des « experts » de l'OCDE qui, dans leur revue pour spécialistes, sont obligés d'avouer que : « Le taux classique de chômage... ne mesure pas la totalité du sous-emploi. » ([3] [3268])
En second lieu, il importe de comprendre la signification des chiffres concernant les « premiers de la classe » que sont les Etats-Unis et la Grande-Bretagne. Pour beaucoup d'experts, ces chiffres seraient la preuve de la supériorité du « modèle anglo-saxon » par rapport aux autres modèles de politique économique. Ainsi on nous rebat les oreilles sur le fait qu'aux Etats-Unis le chômage atteint aujourd'hui les taux les plus bas depuis un quart de siècle. C'est vrai que l'économie américaine connaît actuellement un taux de croissance de la production supérieur à celui des autres pays développés et qu'elle a créé au cours des cinq dernières années 11 millions d'emplois. Cependant, il est nécessaire de préciser que la plupart de ces derniers sont des « emplois MacDonald », c'est-à-dire toutes sortes de petits boulots précaires et très mal payés qui font que la misère se maintient à des niveaux inconnus depuis les années 1930 avec, notamment, son cortège de centaines de milliers de sans abris et de millions de pauvres privés de toute couverture sociale.
Tout cela est clairement avoué par quelqu'un qu'on ne peut soupçonner de dénigrer les Etats-Unis puisqu'il s'agit du ministre du travail durant le premier mandat de Bill Clinton dont il est un ami personnel de longue date : « Depuis vingt ans, une grande partie de la population américaine connaît une stagnation ou une réduction des salaires réels, compte tenu de l'inflation. Pour la majorité des travailleurs, la baisse a continué malgré la reprise. En 1996, le salaire réel moyen se situait au dessous de son niveau de 1989, soit avant la dernière récession. Entre la mi-1996 et la mi-1997, il n'a augmenté que de 0,3 %, tandis que les plus bas revenus poursuivaient leur chute. La proportion d'Américains considérés comme pauvres, selon la définition et les statistiques officielles, est aujourd'hui supérieure à ce qu'elle était en 1989. » ([4] [3269])
Cela dit, ce que les laudateurs du « modèle » made in USA oublient aussi en général de préciser c'est que les 11 millions d'emplois nouveaux créés par l'économie américaine correspondaient à une augmentation de 9 millions de la population en âge de travailler. Ainsi, une très grande part des résultats « miraculeux » de cette économie dans le domaine du chômage résulte d'une mise en oeuvre à grande échelle des artifices, signalés plus haut, permettant de masquer celui-ci. D'ailleurs, aux Etats-Unis, le fait est reconnu aussi bien par les revues économiques les plus prestigieuses que par les autorités politiques elles-mêmes : « Le taux de chômage officiel aux Etats-Unis est devenu progressivement de moins en moins descriptif de la véritable situation prévalant sur le marché du travail ». ([5] [3270]) Cet article démontre que « dans la population masculine de 16 à 55 ans, le taux de chômage officiel ne réussit à saisir comme "chômeurs" que 37 % des sans emploi ; les 63% restant, bien qu'étant dans la force de l'âge, étant classé comme "non emploi", "hors de la population active". » ([6] [3271])
De même, la publication officielle du ministère du Travail américain expliquait : « Le taux de chômage officiel est commode et bien connu ; néanmoins, en nous concentrant trop sur cette seule mesure, nous pouvons obtenir une vision déformée de l'économie des autres pays, comparée à celle des Etats-Unis [...]. D'autres indicateurs sont nécessaires si l'on veut interpréter de manière intelligente les situations respectives sur les différents marchés du travail. » ([7] [3272])
En réalité, sur base d'études qui ne sont pas le fait d'abominables « subversifs », on peut considérer qu'aux Etas-Unis un taux du chômage de 13 % est beaucoup plus proche de la réalité que celui de moins de 5 % qui est agité partout comme la preuve du « miracle américain ». Peut-il en être autrement lorsque ne sont considérés comme chômeurs (suivant les critères du BIT, Bureau international du Travail) que ceux qui :
– ont travaillé moins d'une heure au cours de la semaine de référence ;
– ont recherché activement un emploi au cours de cette semaine ;
– sont immédiatement disponibles pour un emploi.
Ainsi, aux Etats-Unis, où la plupart des jeunes font des petits « jobs », ne sera pas considéré comme chômeur celui qui, pour quelques dollars, a tondu la pelouse de son voisin ou gardé ses enfants la semaine précédente. Il en sera de même de celui qui s'est découragé après des mois ou des années d'échecs auprès d'hypothétiques employeurs ou de la mère célibataire qui n'est pas « immédiatement disponible » puisqu'il n'existe pratiquement pas de crèches collectives.
La « succes story » de la bourgeoisie britannique est encore plus mensongère que celle de sa grande soeur d'outre-atlantique. L'observateur naïf est confronté à un paradoxe : entre 1990 et 1997, le niveau de l'emploi a décru de 4 % et, pourtant, durant la même période, le taux de chômage officiel est passé de 10 % à 5 %. En fait, comme le dit pudiquement une institution financière internationale des plus « sérieuses » : « le recul du chômage britannique semble dû en totalité à l'accroissement de la proportion des inactifs. » ([8] [3273])
Et pour comprendre le mystère de cette transformation des chômeurs en « inactifs », on peut lire ce qu'en dit un journaliste du Guardian, journal anglais qu'on aurait du mal à classer dans la presse révolutionnaire :
« Lorsque Mme Margaret Thatcher remporta sa première élection, en 1979, le Royaume-Uni comptait 1,3 million de chômeurs officiels. Si la méthode de calcul n'avait pas changé, il y en aurait actuellement un peu plus de 3 millions. Un rapport de la Middland's Bank, publié récemment, estimait même leur nombre à 4 millions, soit 14 % de la population active - plus qu'en France ou en Allemagne. »
« ... le gouvernement britannique ne comptabilise plus les sans-emploi, mais uniquement les bénéficiaires d'une allocation de chômage de plus en plus ciblée. Après avoir changé 32 fois la manière de recenser les chômeurs, il a décidé d'exclure des centaines de milliers d'entre eux des statistiques grâce à la nouvelle réglementation de l'indemnité chômage, qui supprime le droit à l'allocation après six mois au lieu de douze. »
« La majorité des emplois créés sont des emplois à temps partiel, dont, pour beaucoup, non choisi. Selon l'inspection du travail, 43 % des emplois créés entre l'hiver 1992-1993 et l'automne 1996 correspondaient à un temps partiel. Presque un quart des 28 millions de travailleurs sont embauchés pour un emploi de ce type. La proportion n'est que d'un travailleur sur six en France et en Allemagne. » ([9] [3274])
Les tricheries à grande échelle qui permettent à la bourgeoisie des deux « champions de l'emploi » anglo-saxons de plastronner bénéficient dans les autres pays d'un silence complaisant de la part de nombreux « spécialistes », économistes et politiciens de tous bords, et particulièrement de la part des médias de masse (ce n'est que dans des publications assez confidentielles que le pot aux roses est dévoilé). La raison en est simple : il faut ancrer l'idée que les politiques, pratiquées au cours de la dernière décennie dans ces pays avec une brutalité toute particulière, visant à réduire les salaires et la protection sociale, à développer la « flexibilité », sont efficaces pour limiter les dégats du chômage massif. En d'autres termes, il faut convaincre les ouvriers que les sacrifices sont « payants » et qu'ils ont tout intérêt à accepter les diktats du capital.
Et comme la bourgeoisie ne met pas tous ses oeufs dans le même panier, qu'elle veut quand même, afin de semer encore plus de confusion dans la tête des ouvriers, leur donner des consolations en leur affirmant qu'il peut exister un « capitalisme à visage humain », certains de ses hommes de confiance se revendiquent aujourd'hui de l'exemple néerlandais ([10] [3275]). Il est donc nécessaire de dire un mot du « bon élève » de la classe européenne, les Pays-Bas.
Là aussi, les chiffres officiels du chômage ne veulent rien dire. Comme en Grande-Bretagne, la baisse du taux de chômage est allée de pair avec une... baisse de l'emploi. Ainsi, le taux d'emploi (pourcentage de la population d'âge actif travaillant effectivement) est passé de 60 % en 1970 à 50,7 % en 1994.
Le mystère disparaît lorsque l'on constate que : « La part des postes à temps partiel dans le nombre total des emplois est passée, en vingt ans, de 15 % à 36 %. Et le phénomène s'accélère, puisque [...] les neuf dixièmes des emplois créés depuis dix ans totalisent entre 12 heures et 36 heures par semaine. » ([11] [3276]) Par ailleurs, une proportion considérable de la force de travail exédentaire est sortie des chiffres du chômage pour entrer dans ceux, plus élevés encore, de l'invalidité. C'est ce que constate l'OCDE lorsqu'elle écrit que : « Les estimations de cette composante "chômage déguisé" dans le nombre de personnes en invalidité varient grandement, allant d'un peu plus de 10 % à environ 50 %. » ([12] [3277])
Comme le dit l'article du Monde diplomatique cité plus haut : « A moins d'imaginer une faiblesse génétique frappant les gens d'ici, et eux seuls, comment expliquer autrement que le pays compte plus d'inaptes au travail que de chômeurs » Evidemment, une telle méthode qui permet aux patrons de « moderniser » à bon compte leur entreprise en se débarassant de leur personnel vieillissant et peu « malléable » n'a pu être appliquée que grâce à un système d'assurance sociale parmi les plus « généreux » du monde. Mais à l'heure où justement ce système est radicalement remis en cause (comme partout ailleurs dans les pays avancés), il sera de plus en plus difficile à la bourgeoisie de camouffler ainsi le chômage. D'ailleurs, les nouvelles lois exigent que ce soient les entreprises qui versent pendant cinq ans les pensions d'invalidité ce qui va les dissuader de déclarer « invalides » les travailleurs dont elles veulent se débarasser. En fait, dès à présent, le mythe du « paradis social » que représentaient les Pays-Bas est sérieusement égratigné quand on sait que, d'après une enquête européenne (citée par The Guardian du 28 avril 1997), 16 % des enfants néerlandais appartiennent à des familles pauvres, contre 12 % en France. Quant au Royaume-Uni, pays du « miracle », ce chiffre y est de 32 % !
Ainsi, il n'existe pas d'exception à la montée du chômage massif dans les pays les plus développés. Dès à présent, dans ces pays, le taux de chômage réel (qui doit notamment prendre en compte tous les temps partiels non souhaités ainsi que tous ceux qui ont renoncé à rechercher un emploi) va de 13 % à 30 % de la population active. Ce sont des chiffres qui s'approchent de plus en plus de ceux connus par les pays avancés lors de la grande « dépression » des années 1930. Au cours de cette période, les taux ont atteint les valeurs de 24 % aux Etats-Unis, 17,5 % en Allemagne et 15 % en Grande-Bretagne. A part le cas des Etats-Unis, on constate que les autres pays ne sont pas loin d'atteindre ces sinistres « records ». Dans certains pays, le chômage a même dépassé le niveau des années 1930. C'est le cas notamment de l'Espagne, de la Suède (8 % en 1933), de l'Italie (7 % en 1933) et de la France (5 % en 1936, ce qui est probablement tout de même un chiffre sous-estimé). ([13] [3278])
Enfin, il ne faut pas se laisser tromper par le léger recul des taux de chômage pour 1997 qui est aujourd'hui claironné par la bourgeoisie (et qui apparaît sur le tableau donné plus haut). Comme on l'a vu, les chiffres officiels ne signifient pas grand chose et surtout, ce recul qui est imputable à une « reprise » de la production mondiale au cours des dernières années va rapidement laisser la place à une nouvelle avancée dès lors que l'économie mondiale va de nouveau se confronter à une nouvelle récession ouverte comme celle que nous avons connue en 1974, en 1978, au début des années 1980 et au début des années 1990. Une récession ouverte qui est inévitable du fait que le mode de production capitaliste est absolument incapable de surmonter la cause de toutes les convulsions qu'il connaît depuis une trentaine d'années : la surproduction généralisée, son incapacité historique de trouver en quantité suffisante des marchés pour sa production. ([14] [3279])
D'ailleurs, l'ami de Clinton que nous avons cité plus haut est clair sur le sujet : « L'expansion est un phénomène temporaire. Les Etats-Unis bénéficient pour l'heure d'une croissance très élevée, qui entraîne avec elle une bonne partie de l'Europe. Mais les perturbations survenues en Asie, de même que l'endettement grandissant des consommateurs américains, laissent penser que la vitalité de cette phase du cycle pourraît ne pas durer très longtemps. »
Effectivement, ce « spécialiste » met le doigt, sans oser évidemment aller jusqu'au bout de son raisonnement, sur les éléments fondamentaux de la situation actuelle de l'économie mondiale :
– le capitalisme n'a pu poursuivre son « expansion » depuis trente ans qu'au prix d'un endettement de plus en plus astronomique de tous les acheteurs possibles (notamment les ménages et les entreprises ; les pays sous-développés au cours des années 1970 ; les Etats, et particulièrement celui des Etats-Unis, au cours des années 1980 ; les « pays émergents » d'Asie au début des années 1990…) ;
– la faillite de ces derniers, qu'on a connue depuis l'été 1997, a une portée qui dépasse amplement leurs frontières ; elle exprime celle de l'ensemble du système capitaliste qu'elle vient aggraver encore.
Ainsi, le chômage massif qui résulte directement de l'incapacité du capitalisme à surmonter les contradictions que lui imposent ses propres lois ne saurait disparaître, ni même reculer. Il ne peut que s'aggraver inexorablement, quels que soient les artifices que va déployer la bourgeoisie pour tenter de le masquer. Il va continuer à jeter des masses croissantes de prolétaires dans le misère et le dénuement le plus insupportable.
La classe ouvrière devant la question du chômage
Le chômage est un fléau pour l'ensemble de la classe ouvrière. Il ne frappe pas seulement ceux de ses membres qui se retrouvent sans emploi mais affecte tous les ouvriers. D'une part, il conduit à un appauvrissement radical des familles ouvrières – de plus en plus nombreuses – qui comptent un chômeur dans leurs rangs, voire plusieurs. D'autre part, il se répercute sous forme d'une augmentation des prélévements sur tous les salaires destinés à verser des indemnités aux sans emploi. Enfin, il est utlisé par les capitalistes pour exercer sur les ouvriers un chantage brutal au salaire et à leurs conditions de travail. En fait, tout au cours des dernières décennies, depuis que la crise ouverte a mis fin à la « prospérité » illusoire du capitalisme des « trente glorieuses », c'est principalement à travers le chômage que la bourgeoisie des pays les plus développés s'est attaquée aux conditions de vie des exploités. Elle savait pertinemment, depuis les grandes grèves qui ont secoué l'Europe et le monde à partir de 1968, que des réductions ouvertes du salaire direct ne pourrait que provoquer des réactions extrêment violentes et massives du prolétariat. Dès lors, elle a concentré ses attaques contre le salaire indirect versé par l'Etat du « welfare state » en réduisant de plus en plus toutes les prestations sociales, notamment au nom de la « solidarité avec les chômeurs », et elle a radicalement réduit la masse salariale en jetant à la rue des dizaines de millions d'ouvriers.
Mais le chômage n'est pas que le fer de lance des attaques que le capitalisme en crise est obligé de porter contre ceux qu'il exploite. Dès lors qu'il s'installe de façon massive et durable, que, sans retour, il rejette du salariat des proportions immenses de la classe ouvrière, il constitue le signe le plus évident de la faillite définitive, de l'impasse d'un mode de production dont la tâche historique avait été justement de transformer une masse croissante des habitants de la planète en salariés. En ce sens, bien qu'il représente pour des dizaines de millions de prolétaires une véritable tragédie, où la détresse économique est encore aggravée par la détresse morale, dans un monde où le travail constitue le principal moyen d'intégration et de reconnaissance sociale, il peut constituer un puissant facteur de prise de conscience pour la classe ouvrière de la nécessité de renverser le capitalisme. De même, si le chômage prive les prolétaires de la possibilité d'utiliser la grève comme moyen de lutte, il ne les condamne pas nécessairement à l'impuissance. La lutte de classe du prolétariat contre les attaques que lui porte le capitalisme en crise constitue le moyen essentiel lui permettant de regrouper ses forces et de prendre conscience en vue du renversement de ce système. Mais cette lutte de classe peut revêtir bien d'autres moyens que la grève. Les manifestations de rue où les prolétaires se retrouvent ensemble par dessus leurs entreprises et leurs divisions sectorielles en sont un autre des plus importants, et qui a été amplement employé dans les périodes révolutionnaires. Et là, les ouvriers au chômage peuvent prendre toute leur place. De même ces derniers, à condition qu'ils soient capables de se regrouper en dehors du contrôle des organes bourgeois destinés à les encadrer, peuvent se mobiliser dans la rue pour empêcher les expulsions ou les coupures d'électricité, pour occuper des mairies ou des lieux publics afin d'exiger le versement d'indemnités d'urgence. Comme nous l'avons souvent écrit, « en perdant l'usine les chômeurs gagnent la rue » ([15] [3280]), et ils peuvent, ce faisant, surmonter plus facilement les divisions catégorielles que la bourgeoisie entretient au sein de la classe ouvrière, notamment au moyen des syndicats. Il ne s'agit nullement ici d'hypothèses abstraites mais d'expériences déjà vécues par la classe ouvrière, notamment au cours des années 1930 aux Etats-Unis où s'étaient constitués de nombreux comités de chômeurs en dehors du contrôle syndical.
Cependant, malgré l'apparition d'un chômage massif au cours des années 1980, nous n'avons assisté nulle part à la constitution de comités de chômeurs significatifs (sinon à quelques tentatives embryonnaires rapidement vidées de leur contenu par les gauchistes et qui ont fait long feu) et encore moins à des mobilisations massives d'ouvriers au chômage. Pourtant, ces années étaient celles où se développaient d'importantes luttes ouvrières qui se rendaient de plus en plus capables de se dégager de l'emprise des syndicats. L'absence de véritable mobilisation des ouvriers au chômage jusqu'à présent, contrairement à ce qu'on avait vu au cours des années 1930, s'explique par plusieurs raisons.
D'une part, la montée du chômage à partir des années 1970 a été beaucoup plus progressive que lors de la « grande dépression ». A cette époque, on a assisté, avec la débandade qui caractérise les débuts de la crise, à une explosion sans égal du nombre des chômeurs (par exemple, aux Etats-Unis, le taux de chômage passe de 3 % en 1929 à 24 % en 1932). Dans la présente crise aiguë, même si on a assisté à de rapides progressions de ce fléau (particulièrement au milieu des années 1980 et au cours des dernières années), la capacité de la bourgeoisie à ralentir le rythme de l'effondrement de l'économie lui a permis d'étaler ses attaques contre le prolétariat, notamment sous la forme du chômage. D'autre part, dans les pays avancés, la bourgeoisie a appris à affronter le problème du chômage de façon beaucoup plus adroite que par le passé. Par exemple, en limitant les licenciements « secs », qui ont été remplacés par des « plans sociaux » envoyant pour un certain temps les ouvriers « en recyclage » avant qu'ils se retrouvent totalement à la rue, en leur attribuant des indemnités temporaires qui leur permettent de survivre dans un premier temps, la classe dominante a en bonne partie désamorçé la bombe du chômage. Aujourd'hui, dans la plupart des pays industriels, ce n'est souvent qu'au bout de six mois ou un an que l'ouvrier privé d'emploi se retrouve complètement privé de ressources. A ce moment là, après qu'il se soit enfoncé dans l'isolement et l'atomisation, il peut beaucoup plus difficilement se regrouper avec ses frères de classe pour mener des actions collectives. Enfin, l'incapacité des secteurs, pourtant massifs, de la classe ouvrière au chômage à se regrouper trouve son origine dans le contexte général de la décomposition de la société capitaliste qui encourage le « chacun pour soi » et le désespoir :
« Un des facteurs aggravants de cette situation est évidemment le fait qu'une proportion importante des jeunes générations ouvrières subit de plein fouet le fléau du chômage avant même qu'elle n'ait eu l'occasion, sur les lieux de travail et de lutte, de faire l'expérience d'une vie collective de classe. En fait, le chômage, qui résulte directement de la crise économique, s'il n'est pas en soi une manifestation de la décomposition, débouche, dans cette phase particulière de la décadence, sur des conséquences qui font de lui un élément singulier de cette décomposition. S'il peut en général contribuer à démasquer l'incapacité du capitalisme à assurer un futur aux prolétaires, il constitue également, aujourd'hui, un puissant facteur de "lumpénisation" de certains secteurs de la classe, notamment parmi les jeunes ouvriers, ce qui affaiblit d'autant les capacités politiques présentes et futures de celle-ci. Cette situation s'est traduite, tout au long des années 1980, qui ont connu une montée considérable du chômage, par l'absence de mouvements significatifs ou de tentative réelles d'organisation de la part des ouvriers sans emploi. » ([16] [3281])
Cela dit, le CCI n'a considéré à aucun moment que les chômeurs ne pourraient jamais s'intégrer dans le combat de leur classe. En réalité, comme nous l'écrivions déjà en 1993 :
« Le déploiement massif des combats ouvriers constituera un puissant antidote contre les effets délétères de la décomposition, permettant de surmonter progressivement, par la solidarité de classe que ces combats impliquent, l'atomisation, le "chacun pour soi" et toutes les divisions qui pèsent sur le prolétariat : entre catégories, branches d'industrie, entre immigrés et nationaux, entre chômeurs et ouvriers au travail. En particulier, si, du fait du poids de la décomposition, les chômeurs n'ont pu, au cours de la décennie passée, et contrairement aux années 1930, entrer dans la lutte (sinon de façon très ponctuelle), s'ils ne pourront jouer un rôle d'avant garde comparable à celui des soldats dans la Russie de 1917 comme on aurait pu le prévoir, le développement massif des luttes prolétariennes leur permettra, notamment dans les manifestations de rue, de rejoindre le combat général de leur classe, et cela d'autant plus que, parmi eux, la proportion de ceux qui ont déjà une expérience du travail associé et de la lutte sur le lieu de travail ne pourra aller qu'en croissant. Plus généralement, si le chômage n'est pas un problème spécifique des sans travail mais bien une question affectant et concernant toute la classe ouvrière, notamment en ce qu'il constitue une manifestation tragique et évidente de la faillite historique du capitalisme, c'est bien ces mêmes combats à venir qui permettront à l'ensemble du prolétariat d'en prendre pleinement conscience. » ([17] [3282])
Et c'est justement parce que la bourgeoisie a compris cette menace qu'elle fait aujourd'hui la promotion des mobilisations de chômeurs.
La signification véritable des « mouvements de chômeurs »
Pour comprendre la signification de ce qui s'est passé ces derniers mois, il importe de mettre en évidence un premier élément d'une importance capitale : ces « mouvements » n'étaient nullement une expression d'une véritable mobilisation du prolétariat sur son terrain de classe. Pour s'en convaincre, il suffit de constater que les médias bourgeois ont couvert ces mobilisations avec un maximum de moyens, allant même quelques fois jusqu'à en gonfler l'importance. Et cela non seulement au niveau des pays où ils se déroulaient, mais aussi à l'échelle internationale. Depuis le début des années 1980, notamment quand s'est amorcée une reprise des combats de classe avec la grève du secteur public en Belgique, à l'automne 1983, l'expérience a montré que lorsque la classe ouvrière engage des combats sur son propre terrain, des combats qui menacent réellement les intérêts de le bourgeoisie, cette dernière les recouvre d'un black-out médiatique complet. Quand on voit les journaux télévisés consacrer une part considérable de leur temps à couvrir des manifestations, quand la télévision allemande montre les chômeurs français en train de défiler et que sa consoeur d'outre-Rhin fait la même chose peu après pour les chômeurs allemands, on peut être sûr que la bourgeoisie a intérêt à donner le maximum de publicité à ces événements. En fait, nous avons assisté au cours de cet hiver à un petit « remake » de ce qui s'était passé à la fin de l'automne 1995 en France avec les grèves dans le secteur public qui, elles aussi, avaient été amplement médiatisées dans tous les coins du monde. Il s'agissait de mettre sur les rails une manœuvre à l'échelle internationale visant à crédibiliser les syndicats avant que ces derniers n'aient à intervenir comme « pompiers sociaux » quand se développeraient de nouveaux combats de classe massifs. La réalité de la manœuvre s'était manifestée rapidement avec la copie conforme des grèves de décembre 1995 en France que les syndicats belges avaient mise en place en se reférant ostensiblement à « l'exemple français ». Elle s'était confirmée quelques mois après, en mai-juin 1996 en Allemagne, où les dirigeants syndicalistes aussi en appelaient ouvertement, au moment où ils préparaient « la plus grande manifestation de l'après guerre » (le 15 juin 1996) à « faire comme en France » ([18] [3283]). Cette fois-ci encore, les syndicats et organisations de chômeurs d'Allemagne se sont appuyés explicitement sur « l'exemple français » en venant à la manifestation du 6 février avec… des drapeaux bleu-blanc-rouge.
La question qui se pose n'est donc pas si les mouvements de chômeurs qu'on a vus en France et en Allemagne correspondent à une réelle mobilisation de classe mais quel objectif vise la bourgeoisie en les organisant et en les popularisant.
Car c'est bien la bourgeoisie qui est derrière l'organisation de ces mouvements. Une preuve ? En France, un des principaux organisateurs des manifestations est la CGT, la centrale dirigée par le Parti « Communiste » qui a trois ministres au sein du gouvernement chargé de gérer et de défendre les intérêts du capital national. En Allemagne, les syndicats traditionnels, dont la collaboration avec le patronat est ouverte, étaient aussi de la partie. A leurs côtés, il y avait des organisations plus « radicales », par exemple, en France, le mouvement AC (Action contre le Chômage) patronné principalement par la Ligue Communiste Révolutionnaire, une organisation trotskiste qui se veut une sorte d'opposition « loyale » au gouvernement socialiste.
Quel était donc l'objectif de la classe dominante en promouvant ces mouvements ? S'agissait-il de prendre les devants face à une menace immédiate de véritable mobilisation des ouvriers au chômage ? En fait, comme on l'a vu, de telles mobilisations ne sont pas aujourd'hui à l'ordre du jour. En réalité, la bourgeoisie visait un double objectif.
D'une part, face aux ouvriers au travail dont le mécontement ne peut que se développer face aux attaques toujours plus brutales qu'ils subissent, il s'agissait de créer une diversion, visant notamment à les culpabiliser face aux ouvriers « qui n'ont pas la chance d'avoir un travail ». Dans le cas de la France, cette agitation sur la question du chômage était un excellent moyen pour tenter d'intéresser la classe ouvrière (qui se fait un peu prier) aux projets gouvernementaux d'introduction de la semaine de 35 heures supposés permettre la création de nombreux emplois (et qui permettront surtout de bloquer les salaires et d'augmenter l'intensité du travail).
D'autre part, il s'agissait pour la bourgeoisie, comme elle l'a déjà fait en 1995, de prendre les devants par rapport à une situation qu'elle devra affronter dans le futur. En effet, même si aujourd'hui on n'assiste pas, comme durant les années 1930, à des mobilisations et des luttes d'ouvriers au chômage, cela ne signifie pas que les conditions du combat prolétarien soient moins favorables qu'alors. Bien au contraire. Toute la combativité exprimée par la classe ouvrière dans les années 1930 (par exemple en mai-juin 1936 en France, en juillet 1936 en Espagne) ne pouvait rien pour soulever la chape de plomb de la contre-révolution qui s'était abattue sur le prolétariat mondial. Cette combativité était condamnée à être dévoyée sur le terrain de l'antifascisme et de la « défense de la démocratie » préparant la guerre impérialiste. Aujourd'hui, au contraire, le prolétariat mondial est sorti de la contre-révolution ([19] [3284]), et même s'il a subi, à la suite de l'effondrement des prétendus régimes « communistes », un recul politique sérieux, la bourgeoisie n'a pas réussi à lui infliger une défaite décisive remettant en cause le cours historique aux affrontements de classe.
Et cela, la classe dominante le sait pertinemment. Elle sait qu'elle devra faire face à de nouveaux combats de classe ripostant aux attaques de plus en plus brutales qu'elle devra asséner contre les exploités. Et elle sait que ces futurs combats que vont mener les ouvriers au travail risquent d'entraîner de plus en plus les ouvriers au chômage. Or, jusqu'à présent, ce secteur de la classe ouvrière est très faiblement encadré par les organisations de type syndical. Il importe à la bourgeoisie que lorsque ces secteurs vont s'engager, dans les sillage des secteurs au travail, dans les mouvements sociaux, ils n'échappent pas au contrôle des organes qui ont pour fonction d'encadrer la classe ouvrière et de saboter ses luttes : les syndicats de tout poil, y compris les plus « radicaux ». En particulier, il importe que le formidable potentiel de combativité porté par les secteurs au chômage de la classe ouvrière, le peu d'illusions qu'ils se font sur le capitalisme (et qui s'exprime pour le moment sous forme de désespoir) ne viennent « contaminer » les ouvriers au travail lorsqu'ils développerons leurs luttes. Avec les mobilisations de cet hiver, la bourgeoisie a commencé cette politique de développement de son contrôle sur les chômeurs au moyen des syndicats et des organisations qui s'y sont faites connaître.
Ainsi, mêmes s'ils résultent de manœuvres bourgeoises, ces mobilisations constituent un indice supplémentaire du fait, non seulement que la classe dominante elle-même ne se fait aucune illusion sur sa capacité à réduire le chômage, encore moins à surmonter sa crise, mais qu'elle s'attend à des combats de plus en plus puissants de la part de la classe ouvrière.
Fabienne
[19] [3303]. Voir l'article sur Mai 1968 dans ce numéro.
Récent et en cours:
- Crise économique [28]
Questions théoriques:
- Décadence [32]
Heritage de la Gauche Communiste:
- La lutte Proletarienne [169]
Irak : un revers des Etats-Unis qui relance les tensions guerrières
- 3167 reads
Le 23 février dernier, avec l'accord entre Saddam Hussein et le secrétaire général de l'ONU sur la poursuite de la mission de désarmement de l'Irak, se trouvait sanctionnée l'impasse dans laquelle les Etats-Unis s'étaient mis. Clinton était contraint de remettre l'opération « Tonnerre du désert » qui visait à déclencher de nouveaux bombardements massifs et meurtriers sur l'Irak. Cette opération militaire aurait dû réaffirmer le leadership américain aux yeux du monde entier, et particulièrement aux yeux des autres grandes puissances impérialistes telles que la France, la Russie, l'Allemagne, etc. Ce revers américain ne doit pas surprendre.
« Face à un monde dominé par le "chacun pour soi", où notamment les anciens vassaux du gendarme américain aspirent à se dégager le plus possible de la pesante tutelle de ce gendarme qu'ils avaient dû supporter face à la menace du bloc adverse [le bloc de l'Est mené par l'URSS], le seul moyen décisif pour les Etats-Unis d'imposer leur autorité est de s'appuyer sur l'instrument pour lequel ils disposent d'une supériorité écrasante sur les autres Etats : la force militaire. Ce faisant, les Etats-Unis sont pris dans une contradiction :
– d'une part, s'ils renoncent à la mise en oeuvre ou à l'étalage de leur supériorité militaire, cela ne peut qu'encourager les pays qui contestent leur autorité à aller encore plus loin dans cette contestation ;
– d'autre part, lorsqu'ils font usage de la force brutale, même, et surtout, quand ce moyen aboutit momentanément à faire ravaler les velléités de leurs opposants, cela ne peut que pousser ces derniers à saisir la moindre occasion pour prendre leur revanche et tenter de se dégager de l'emprise américaine. » ([1] [3304])
En s'embarquant dans un tentative de réédition de la guerre du Golfe de 1990-91, la bourgeoisie américaine s'est retrouvée isolée. Exceptée la Grande-Bretagne, aucune autre puissance significative n'est venue soutenir pleinement l'initiative des Etats-Unis ([2] [3305]). En 1990, l'invasion du Koweït avait fourni un argument imparable pour contraindre l'ensemble des pays à les soutenir dans la guerre. En 1996, les Etats-Unis avaient encore réussi à imposer le lancement de leurs missiles sur l'Irak malgré l'opposition de la majorité des autres puissances tout comme des principaux pays arabes. En 1998, la menace et les préparatifs de bombardements massifs apparaissaient complètement disproportionnés par rapport aux limites irakiennes aux visites des inspecteurs de l'ONU. Le prétexte était facilement « rejetable ». Mais en plus, l'équipe Clinton s'est liée les mains et a laissé cette fois-ci – contrairement à 1990 – une marge de manoeuvre considérable aussi bien à Saddam Hussein qu'aux impérialismes rivaux. Profitant de l'isolement américain, Hussein avait la possibilité d'accepter à l'heure et aux conditions qui lui convenaient la reprise de la mission de désarmement des inspecteurs des Nations Unies. Avant même la signature de l'accord entre l'ONU et l'Irak, des fractions significatives de la bourgeoisie américaine commençaient à prendre conscience du faux pas commis par Clinton. Comme l'a signalé la presse américaine après l'accord : « "le président Clinton n'avait pas véritablement le choix. » ([3] [3306])
Saddam Hussein n'a pas infligé tout seul ce revers aux Etats-Unis. Sans le soutien intéressé et les conseils prodigués à Hussein par la Russie et la France, sans l'attitude approbatrice de la plupart des pays européens, de la Chine et du Japon à la politique anti-américaine de ces deux puissances, la population irakienne – qui subit quotidiennement le terrible joug de Saddam, et dont un enfant meurt toutes les 6 minutes des effets de l'embargo économique ([4] [3307]) – aurait une nouvelle fois vécu la terreur des bombardements américains et britanniques.
Les réactions officielles et médiatiques ont été révélatrices du revers américain. Au lieu des proclamations exaltées sur la « sauvegarde de la paix » et de la « réussite du monde civilisé », nous avons entendu deux discours : l'un satisfait et victorieux, surtout de la part de la France et de la Russie, l'autre désappointé et revanchard de la part de la bourgeoisie américaine. A l'autosatisfaction de la bourgeoisie française, exprimée en termes diplomatiques par l'ex-ministre gaulliste Peyreffite, qui estime que la France « a contribué à aider [Clinton] à éviter un terrible faux pas en laissant ouverte l'option diplomatique » ([5] [3308]), ont répondu l'amertume et les menaces de la bourgeoisie américaine : « si l'accord a été un succès au point que les français en ont tiré les bénéfices, ces derniers auront une responsabilité particulière pour assurer qu'il soit strictement appliqué dans les semaines qui viennent. » (Ibid.)
Contrairement à la crise et la guerre du Golfe en 1990-91 où les Etats-Unis avaient réussi à imposer aux autres puissances leur propre autorité et la mobilisation de tous, contrairement à septembre 1996 où les Etats-Unis avaient encore réussi à imposer le lancement de leurs missiles sur l'Irak malgré l'opposition de la majorité des autres puissances tout comme des principaux pays arabes, cette fois-ci la bourgeoisie américaine a dû reculer et abandonner son « Tonnerre du désert » : « La négociation [avec le secrétaire de l'ONU, Kofi Annan] rend impossible pour Clinton de continuer par des bombardements. C'est pour cela que les Etats-Unis ne voulaient pas que K. Annan se rende [à Bagdad]. » ([6] [3309]) Et c'est pourquoi la Russie et la France ont poussé et parrainé ce voyage du secrétaire général de l'ONU. Plusieurs faits significatifs et hautement symboliques ont témoigné de cela : les voyages de Kofi Annan entre New York et Paris en Concorde français, entre Paris et Bagdad dans l'avion présidentiel de Chirac et surtout, à l'aller comme au retour, les entrevues « préférentielles » du secrétaire général de l'ONU avec ce dernier. Les conditions de ce périple ont constitué une gifle pour les Etats-Unis et l'accord obtenu est un échec pour la bourgeoisie américaine.
Cette situation ne peut qu'aggraver les antagonismes impérialistes et les tensions guerrières, car les Etats-Unis ne vont pas en rester là et laisser leur autorité bafouée sans réaction.
Ce qui vient de se produire est la dernière illustration de la tendance au « chacun pour soi » propre à la période historique actuelle du capitalisme décadent, sa période de décomposition. La capacité de Saddam Hussein à piéger les Etats-Unis, contrairement à 1990 et 1996, est due essentiellement à la difficulté accrue des Etats-Unis à maintenir leur autorité et une certaine discipline derrière leur politique impérialiste ; et cela, autant de la part des petits impérialismes locaux – dans ce cas les pays arabes (l'Arabie Saoudite, par exemple, a refusé aux troupes américaines l'utilisation de ses bases aériennes) ou Israël qui met en péril la Pax Americana au Proche-Orient – que de la part des grandes puissances rivales.
La bourgeoisie américaine ne peut laisser l'affront sans réponse. Il y va de l'affirmation de son hégémonie sur tous les continents, particulièrement au Proche-Orient dans le conflit israélo-palestinien. Déjà, elle se prépare à la « prochaine crise » en Irak : « Très peu croient à Washington que le dernier chapitre de l'histoire a été écrit. » ([7] [3310]) La rivalité entre impérialismes en Irak va se centrer sur la question des inspections de l'ONU, de leur contrôle, sur celle de la levée ou non de l'embargo économique contre l'Irak. Sur ce dernier aspect, la Russie et la France sont farouchement combattues par des Etats-Unis forts du maintien de leur armada militaire dans le Golfe persique, véritable canon pointé sur la tempe des irakiens.
La bourgeoisie américaine se prépare dès à présent à la « prochaine crise » en ex-Yougoslavie, au Moyen-Orient et en Afrique. Elle annonce clairement la poursuite de son offensive en Afrique, offensive qui met en cause la présence française au premier chef et l'influence européenne en général. Elle entend bien ne pas laisser les européens, surtout la France et l'Allemagne, s'immiscer encore plus dans les conflits au Proche-Orient. Elle entend bien maintenir sa présence militaire en Macédoine alors que les tensions guerrières s'accroissent au Kosovo voisin. Dans cette province, il est clair que les récents affrontements entre les populations albanaises et les forces de police serbes ont une portée qui dépasse largement les limites de la région. Derrière les cliques nationalistes albanaises on retrouve naturellement l'Albanie et, dans une certaine mesure, d'autres pays musulmans, telles la Bosnie et la Turquie, laquelle constitue un des points d'appui traditionnel de l'impérialisme allemand dans les Balkans. Derrière la soldatesque serbe on retrouve le « grand frère » russe et, plus discrètement, les alliés traditionnels de la Serbie que sont la France et la Grande-Bretagne, une Serbie solennellement mise en garde par le gendarme américain. Ainsi, malgré les accords de Dayton en 1995, la paix ne saurait être définitive dans les Balkans. Cette région demeure une poudrière dans laquelle les différents impérialismes, et notamment le plus puissant d'entre eux, n'auront de cesse de tenter de faire valoir leurs intérêts stratégiques comme on l'a vu entre 1991 et 1995.
Ainsi, le revers que viennent de subir les Etats-Unis en Irak constitue l'annonce d'une relance et d'une exacerbation des différents conflits impérialistes aux quatre coins de la planète.
Pour toutes ces zones, cela signifie la plongée irréversible dans la barbarie guerrière et, pour leurs populations, de nouveaux massacres et la terreur.
L'impasse historique du capitalisme est la cause des conflits sanglants qui se multiplient aujourd'hui, mais aussi du maintien et de l'approfondissement dramatique de ceux qui existaient déjà. Les grandes tirades sur la paix et les vertus de la démocratie visent à rassurer les populations et, plus particulièrement, à limiter au maximum toute prise de conscience dans le prolétariat international de la réalité guerrière du capitalisme. Cette réalité est que chaque impérialisme ne cesse de se préparer pour la prochaine crise qui ne manquera pas de surgir.
RL, 14 mars 1998
[7] [3317]. New York Times cité par l'International Herald Tribune du 25 février 1998.
Récent et en cours:
- Guerre en Irak [130]
Questions théoriques:
- Guerre [129]
Mai 1968 : le prolétariat revient à l'avant de la scène
- 7234 reads
Il y a 30 ans, s'est déroulé en France un grand mouvement de luttes dans lesquels étaient engagés, pendant près d'un mois, près de 10 millions d'ouvriers en grève. Il est très difficile pour les jeunes camarades qui s'approchent aujourd'hui des positions révolutionnaires de savoir ce qui s'est passé durant ce lointain mois de mai 1968. Et ce n'est pas leur faute. En réalité, la bourgeoisie a toujours déformé la signification profonde de ces événements et l'histoire bourgeoise (de droite et de gauche, sans distinction) les a toujours présentés comme une « révolte étudiante », alors qu'il s'agit de la phase la plus importante d'un mouvement qui a aussi eu lieu en Italie, aux Etats-Unis et un peu dans tous les pays industrialisés. Il n'est pas étonnant que la classe dominante cherche toujours à dissimuler aux yeux du prolétariat ses luttes passées. Et quand elle n'y parvient pas, elle fait tout pour les dénaturer, pour les présenter comme autre chose que des manifestations de l'antagonisme historique et irréductible entre la principale classe exploitée de notre époque et la classe dominante responsable de cette exploitation. Aujourd'hui la bourgeoisie poursuit son travail de mystification de l'histoire en cherchant à dénaturer la signification de la révolution d'Octobre, la présentant comme un coup d'Etat des bolcheviks assoiffés de sang et de pouvoir, contrairement à ce qu'elle fut réellement : la plus grandiose tentative de la part de la classe ouvrière de monter « à l'assaut du ciel », de prendre le pouvoir politique pour commencer à transformer la société dans un sens communiste, c'est-à-dire vers l'abolition de toute exploitation de l'homme par l'homme. Elle le fait pour exorciser le danger que constitue la mémoire historique comme arme pour le prolétariat. C'est justement parce que, pour la classe ouvrière, la connaissance de ses propres expériences passées est indispensable pour préparer les batailles d'aujourd'hui et de demain qu'il revient aux groupes révolutionnaires, à l'avant-garde politique de cette classe, de les lui rappeler sans cesse.
Les événements de Mai 68
Il y a 30 ans, le 3 mai, un meeting rassemblant quelques centaines d'étudiants, était organisé dans la cour intérieure de la Sorbonne, à Paris, par l'UNEF (syndicat étudiant) et le « Mouvement du 22 Mars » (formé à la Faculté de Nanterre en banlieue parisienne quelques semaines auparavant). Rien de très exaltant dans les discours théorisateurs des « leaders » gauchistes, mais une rumeur persistante : « Occident va attaquer ». Ce mouvement d'extrême-droite donnait ainsi le prétexte aux forces de police de « s'interposer » entre les manifestants. Il s'agissait surtout de briser l'agitation étudiante qui, depuis quelques semaines se poursuivait à Nanterre. Simple manifestation du ras-le-bol des étudiants, constitué par des mobiles aussi divers que la contestation du mandarinat universitaire ou la revendication d'une plus grande liberté individuelle et sexuelle dans la vie interne de l'Université.
Et pourtant, « l'impossible est advenu » ; pendant plusieurs jours, l'agitation va se poursuivre au Quartier latin. Elle va monter d'un cran tous les soirs : chaque manifestation, chaque meeting rassemblera un peu plus de monde que la veille : dix mille, trente mille, cinquante mille personnes. Les heurts avec les forces de l'ordre sont aussi de plus en plus violents. Dans la rue, de jeunes ouvriers se joignent au combat et, malgré l'hostilité ouvertement déclarée du PCF qui traîne dans la boue les « enragés » et « l'anarchiste allemand » Daniel Cohn-Bendit, la CGT (le syndicat d'obédience stalinienne) est contrainte, pour ne pas être complètement débordée, de « reconnaître » le mouvement de grèves ouvrières qui se déclenche spontanément et qui se généralise rapidement : dix millions de grévistes secouent la torpeur de la 5e République et marquent d'une manière exceptionnelle le réveil du prolétariat mondial.
En effet, la grève déclenchée le 14 mai à Sud-Aviation, qui s'est étendue spontanément, prend, dès le départ, un caractère radical par rapport à ce qu'avaient été jusque là les « actions » orchestrées par les syndicats. Dans les secteurs essentiels de la métallurgie et des transports, la grève est quasi générale. Les syndicats sont dépassés par une agitation qui se démarque de leur politique traditionnelle et sont débordés par un mouvement qui prend d'emblée un caractère extensif et souvent peu précis, inspiré, comme il l'était, par une inquiétude profonde même si peu « consciente ».
Dans les affrontements qui ont lieu, un rôle important est joué par les chômeurs, ce que la presse bourgeoise appelait les « déclassés ». Or, ces « déclassés », ces « dévoyés » sont de purs prolétaires. En effet, ne sont pas seulement prolétaires les ouvriers et les chômeurs ayant déjà travaillé, mais aussi ceux qui n'ont pas encore pu travailler et sont déjà au chômage. Ils sont les purs produits de l'époque de décadence du capitalisme : nous voyons dans le chômage massif des jeunes une des limites historiques du capitalisme qui, de par la surproduction généralisée, est devenu incapable d'intégrer les nouvelles générations dans le procès de production. Mais ce mouvement déclenché en dehors des syndicats, et dans une certaine mesure contre eux puisqu'il rompt avec les méthodes de lutte qu'ils préconisent en toute occasion, ceux-ci vont tout faire pour le reprendre en main.
Dès le vendredi 17 mai, la CGT diffuse partout un tract qui précise bien les limites qu'elle entend donner à son action : d'une part des revendications traditionnelles couplées à la conclusion d'accords du type de ceux de Matignon en juin 1936, garantissant l'existence des sections syndicales d'entreprise ; d'autre part l'appel à un changement de gouvernement, c'est-à-dire à des élections. Méfiants à l'égard des syndicats avant la grève, la déclenchant par dessus leur tête, l'étendant de leur propre initiative, les ouvriers ont pourtant agi, pendant la grève, comme s'ils trouvaient normal que ceux-ci se chargent de la conduire à son terme.
Contraint de suivre le mouvement pour ne pas en perdre le contrôle, le syndicat réussit finalement sa tentative et réalise un double travail avec l'aide précieuse du PCF : d'un côté, mener les négociations avec le gouvernement, de l'autre inviter les ouvriers au calme, à ne pas perturber le déroulement serein de nouvelles élections que le PCF et les socialistes réclament, faisant aussi discrètement circuler des rumeurs sur un coup d'Etat possible, sur des mouvements de troupes à la périphérie de la ville. En réalité, même si elle a été surprise et bien qu'elle soit effayée par la radicalité du mouvement, la bourgeoisie n'a aucunement l'intention de passer à la répression militaire. Elle sait bien que cela peut relancer le mouvement en mettant hors jeu les « conciliateurs » syndicaux et qu'un bain de sang est une réponse inappropriée qu'elle aurait payé par la suite. En réalité, ses forces de répression, la bourgeoisie les a déjà mises au travail. Ce ne sont pas tant les CRS (les forces de police spécialisées) – qui dispersent et attaquent les manifestations et les barricades –, mais les flics d'usines syndicaux bien plus habiles et dangereux parce qu'ils font leur sale travail de division dans les rangs ouvriers.
La première opération de police, les syndicats la réalisent en favorisant l'occupation des usines, réussissant par là à enfermer les ouvriers sur leur lieu de travail, leur enlevant la possibilité de se réunir, de discuter, de se confronter dans la rue.
Le 27 mai au matin, les syndicats se présentent devant les ouvriers, avec un compromis signé avec le gouvernement (les accords de Grenelle). A Renault, principale entreprise du pays, et « thermomètre » de la classe ouvrière, le secrétaire général de la CGT est hué par les ouvriers qui considèrent que leur combat a été vendu. Partout ailleurs les ouvriers adoptent la même attitude. Le nombre de grévistes augmente encore. Beaucoup d'ouvriers déchirent leur carte syndicale. C'est alors que les syndicats et le gouvernement se partagent le travail pour casser le mouvement. La CGT, qui a immédiatement désavoué les accords de Grenelle qu'elle avait pourtant signés, déclare qu'il faut « ouvrir des négociations branche par branche afin de les améliorer ». Le gouvernement et le patronat vont jouer le jeu, en faisant des concessions importantes dans quelques secteurs, ce qui permet d'amorcer un mouvement de reprise du travail. En même temps, le 30 mai, De Gaulle accède à la demande des partis de gauche : il dissout la Chambre des députés et convoque de nouvelles élections. Le même jour, plusieurs centaines de milliers de ses partisans défilent sur les Champs Elysées ; rassemblement hétéroclite de tous ceux qui ont une haine viscérale de la classe ouvrière et des « communistes » : habitants des beaux quartiers et militaires à la retraite, bonnes soeurs et concierges, petits commerçants et souteneurs, tout ce beau monde derrière les ministres de De Gaulle, André Malraux en tête (l'écrivain antifasciste bien connu après son engagement dans la guerre d'Espagne de 1936).
Les syndicats entre eux se partagent le travail : à la CFDT (syndicat chrétien) qui est minoritaire, il revient de prendre les habits « radicaux » afin de garder le contrôle sur les ouvriers les plus combatifs. Pour sa part, la CGT se distingue par son rôle de briseur de grève. Dans les assemblées, elle propose la fin de la grève en prétendant que les ouvriers des entreprises voisines ont déjà repris le travail, ce qui est un mensonge. Surtout, avec le PCF, elle appelle au « calme », à une « attitude responsable » (agitant même le spectre de la guerre civile et de la répression de l'armée), afin de ne pas perturber les élections qui doivent se tenir les 23 et 30 juin. Ces dernières se soldent par un raz de marée de la droite, ce qui vient écoeurer encore plus les ouvriers les plus combatifs qui avaient poursuivi leur grève jusqu'à ce moment-là.
La grève générale, malgré ses limites, a contribué par son immense élan à la reprise mondiale de la lutte de classe. Après une suite ininterrompue de reculs, depuis son écrasement après les événements révolutionnaires des années 1917-23, les évènements de mai-juin 1968 constituent un tournant décisif, non seulement en France, mais encore en Europe et dans le monde entier. Les grèves ont non seulement ébranlé le pouvoir en place mais aussi ce qui représente son rempart le plus efficace et le plus difficile à abattre : la gauche et les syndicats.
Un mouvement « étudiant » ?
Une fois sa surprise dépassée, la première panique écartée, la bourgeoisie s'est attelée à trouver des explications à ces événements qui remettent en cause sa tranquillité. Il n'est donc pas étonnant que la gauche utilise le phénomène de l'agitation étudiante pour exorciser le spectre réel qui se lève devant les yeux de la bourgeoisie apeurée – le prolétariat – et qu'elle limite les événements sociaux à une simple querelle idéologique entre générations. Mai 1968 est présenté comme étant le résultat du désoeuvrement de la jeunesse face aux inadaptations créées par le monde moderne.
Il est plus qu'évident que mai 1968 est effectivement marqué par une décomposition certaine des valeurs de l'idéologie dominante, mais cette révolte « culturelle » n'est pas la cause réelle du conflit. Marx a montré en effet, dans son avant-propos à la Critique de l'économie politique, que « le changement dans les fondations économiques s'accompagne d'un bouleversement plus ou moins rapide dans tout cet énorme édifice. Quand on considère ces bouleversements, il faut toujours distinguer deux ordres de choses. Il y a bouleversement matériel des conditions de production économiques. On doit le constater dans l'esprit de rigueur des sciences naturelles. Mais il y a aussi les formes juridiques, politiques, religieuses, bref les formes idéologiques dans lesquelles les hommes prennent conscience de ce conflit et le poussent jusqu'au bout. »
Toutes les manifestations de crise idéologique trouvent leurs racines dans la crise économique et non le contraire. C'est l'état de crise qui détermine le cours des choses. Le mouvement étudiant est donc bien une expression de la décomposition générale de l'idéologie bourgeoise. Il est l'annonciateur d'un mouvement social plus fondamental. Mais en raison même de la place de l'université dans le système de production, celle-ci n'a qu'exceptionnellement un lien avec la lutte de classe.
Mai 1968 n'est pas un mouvement des étudiants et des jeunes, il est avant tout un mouvement de la classe ouvrière qui resurgit après des décennies de contre-révolution. Le mouvement étudiant est poussé à la radicalisation par cette présence même de la classe ouvrière.
Les étudiants ne sont pas une classe et encore moins une couche sociale révolutionnaire. Au contraire, ils sont spécifiquement les véhicules de la pire idéologie bourgeoise. Si en 1968 des milliers de jeunes sont influencés par des idées révolutionnaires, c'est justement parce que l'unique classe révolutionnaire de notre époque, la classe ouvrière, est dans la rue.
Avec ce surgissement, la classe ouvrière fait également justice de toutes les théories qui avaient décrété sa « mort » par « embourgeoisement », par son « intégration » dans le système capitaliste. Comment expliquer autrement que toutes ces théories jusqu'alors amplement majoritaires précisément dans le milieu universitaire où elles étaient nées grâce à Marcuse, Adorno et Cie, aient si facilement fondu comme neige au soleil, et que les étudiants se tournent vers la classe ouvrière comme des « mouches du coche » ? Et comment expliquer que, dans les années suivantes, les étudiants, tout en continuant à s'agiter de la même façon, aient cessé de se proclamer révolutionnaires ?
Non, mai 1968 n'est pas une révolte de la jeunesse contre « les inadéquations du monde moderne », ce n'est pas la révolte des consciences, mais le premier symptôme de convulsions sociales qui ont des racines bien plus profondes que le monde de la superstructure, des racines qui s'enfoncent dans la crise du mode de production capitaliste. Loin de constituer un triomphe pour les théories de Marcuse, mai 1968 en a décrété la mort, l'ensevelissant dans le monde de fantaisie des idéologies dont elle est issue.
Non, le début de la reprise historique de la lutte de la classe ouvrière.
La grève générale de 10 millions d'ouvriers dans un pays du centre du capitalisme signifie la fin d'une période de contre-révolution qui s'était ouverte avec la défaite de la vague révolutionnaire des années 1920, et s'était poursuivie et approfondie avec l'action simultanée du fascisme et du stalinisme. Le milieu des années 1960 marque la fin de la période de reconstruction d'après la deuxième guerre mondiale, et le début d'une nouvelle crise ouverte du système capitaliste.
Les premiers coups de cette crise touchent une génération d'ouvriers qui n'a pas connu la démoralisation de la défaite des années 1920 et a grandi pendant le « boom économique ». La crise ne frappe alors que très légèrement, mais la classe ouvrière commence à sentir que quelque chose change :
« Un sentiment d'insécurité du lendemain se développe parmi les ouvriers et surtout parmi les jeunes. Ce sentiment est d'autant plus vif qu'il était pratiquement inconnu des ouvriers en France depuis la guerre.
(...) De plus en plus les masses sentent que c'en est fini de la belle prospérité. L'indifférence et le je-m'en-foutisme, si caractéristiques et tant décriés des ouvriers, au long des derniers 10-15 ans, cèdent la place à une inquiétude sourde et grandissante.
(...) Il faut bien admettre qu'une telle explosion repose sur une longue accumulation d'un mécontentement réel de leur situation économique et de travail directement sensible dans les masses, même si un observateur superficiel n'en a rien aperçu. » ([1] [3318])
Et en effet un observateur superficiel ne peut pas comprendre ce qui advient dans les profondeurs du monde capitaliste. Ce n'est pas par hasard qu'un groupe radical, sans base marxiste solide, comme l'Internationale situationniste, écrit, sur les événements de mai 1968 : « On ne pouvait observer aucune tendance à la crise économique (...) L'éruption révolutionnaire n'est pas venu d'une crise économique (...) Ce qui a été attaqué de front en Mai, c'est l'économie capitaliste fonctionnant bien. » ([2] [3319])
La réalité est bien différente et les ouvriers commencent à la ressentir dans leur chair.
Après 1945, l'aide des Etats-Unis va permettre la relance de la production de l'Europe qui paie en partie ses dettes en cédant ses entreprises aux compagnies américaines. Mais après 1955 les Etats-Unis cessent leur aide « gratuite ». La balance commerciale des Etats-Unis est excédentaire, alors que celle de la majorité des autres pays est déficitaire. Les capitaux américains continuent de s'investir plus rapidement en Europe que dans le reste du monde, ce qui équilibre la balance des paiements de ces pays, mais va bientôt déséquilibrer celle des Etats-Unis. Cette situation conduit à un endettement croissant du trésor américain, puisque les dollars émis et investis en Europe ou dans le reste du monde constituent une dette de celui-ci à l'égard des détenteurs de cette monnaie. A partir des années 1960, cette dette extérieure dépasse les réserves d'or du trésor américain, mais cette non couverture du dollar ne suffit pas encore à mettre les Etats-Unis en difficulté tant que les autres pays sont endettés vis-à-vis des Etats-Unis. Les Etats-Unis peuvent donc continuer a s'approprier le capital du reste du monde en payant avec du papier. Cette situation se renverse avec la fin de la reconstruction dans les pays européens. Celle-ci se manifeste par la capacité acquise par les économies européennes de lancer sur le marché international des produits concurrents aux produits américains : vers le milieu des années 1960, les balances commerciales de la plupart des anciens pays assistés deviennent positives alors que, après 1964, celle des Etats-Unis ne cesse de se détériorer. Dès lors que la reconstruction des pays européens est achevée, l'appareil productif s'avère pléthorique et trouve en face d'elle un marché sursaturé obligeant les bourgeoisies nationales à accroître les conditions d'exploitation de leur prolétariat pour faire face à l'exacerbation de la concurrence internationale.
La France n'échappe pas à cette situation et dans le courant de l'année 1967, la situation économique de la France doit faire face à l'inévitable restructuration capitaliste : rationalisation, productivité améliorée ne peuvent que provoquer un accroissement du chômage. Ainsi, au début de 1968, le nombre de chômeurs dépasse les 500 000. Le chômage partiel s'installe dans de nombreuses usines et provoque des réactions parmi les ouvriers. De nombreuses grèves éclatent, grèves limitées et encore encadrées par les syndicats mais qui manifestent un malaise certain. Car la baisse des emplois tombe d'autant plus mal que se présente sur le marché de l'emploi cette génération de l'explosion démographique qui a suivi la fin de la seconde guerre mondiale.
De façon générale, le patronat s'efforce d'abaisser le niveau de vie des ouvriers. Une attaque en règle contre les conditions de vie et de travail est menée par la bourgeoisie et son gouvernement. Dans tous les pays industriels, le chômage se développe sensiblement, les perspectives économiques s'assombrissent, la concurrence internationale se fait plus acharnée. La Grande-Bretagne procède, fin 1967, à une première dévaluation de la livre afin de rendre ses produits plus compétitifs. Mais cette mesure est annulée par la dévaluation qui lui fait suite des monnaies de toute une série d'autres pays. La politique d'austérité imposée par le gouvernement travailliste de l'époque est particulièrement sévère : réduction massive des dépenses publiques, retrait des troupes britanniques de l'Asie, blocage des salaires, premières mesures protectionnistes.
Les Etats-Unis, principale victime de l'offensive européenne, ne manquent pas de réagir sévèrement et, dès le début de janvier 1968, des mesures économiques sont annoncées par Johnson alors qu'en mars 1968, en réponse aux dévaluations de monnaies concurrentes, le dollar chute à son tour.
Telle est la toile de fond de la situation économique d'avant mai 1968.
Un mouvement revendicatif, mais pas seulement
C'est dans cette situation que se déroulent les événements de mai 1968 : une situation économique détériorée qui engendre une réaction dans la classe ouvrière.
Certes, d'autres facteurs contribuent à la radicalisation de la situation : la répression policière contre les étudiants et contre les manifestations ouvrières, la guerre du Viet Nam. Simultanément ce sont tous les mythes du capitalisme de l'après-guerre qui entrent en crise : les mythes de la démocratie, de la prospérité économique, de la paix. C'est cette situation qui créée une crise sociale à laquelle la classe ouvrière donne sa première réponse.
C'est une réponse sur le plan économique, mais pas seulement. Les autres éléments de la crise sociale, le discrédit des syndicats et des forces de gauche traditionnelles poussent des milliers de jeunes et d'ouvriers à poser des problèmes plus généraux, à chercher des réponses aux causes profondes de leur mécontentement et de leur désillusion.
C'est ainsi que se créée une nouvelle génération de militants qui s'approchent des positions révolutionnaires. Ils se mettent à relire Marx, Lénine, à étudier le mouvement ouvrier du passé. La classe ouvrière ne retrouve pas seulement sa dimension de lutte comme classe exploitée mais montre aussi sa nature révolutionnaire.
Ces nouveaux militants s'embarquent pour la plupart dans les fausses perspectives des différents groupes gauchistes et se perdront par la suite. En effet, si le syndicalisme constitue l'arme avec laquelle la bourgeoisie parvient à fourvoyer le mouvement de masse des ouvriers, le gauchisme est l'arme avec laquelle la plupart des militants formés dans la lutte, se brûlent.
Mais beaucoup d'autres parviennent à trouver les organisations authentiquement révolutionnaires, celles qui représentent la continuité historique avec le mouvement ouvrier du passé, les groupes de la Gauche communiste. Si aucun de ces derniers ne parvient à saisir pleinement la signification des événements, restant à leur marge (et laissant ainsi le champ libre aux gauchistes), d'autres petits noyaux sont par contre capables de rassembler ces nouvelles énergies révolutionnaires donnant lieu à des nouvelles organisations et à un nouveau travail de regroupement des révolutionnaires qui constituent aujourd'hui la base du futur parti révolutionnaire.
Une reprise historique longue et tortueuse
Les événements de mai 1968 constituent le début de la reprise historique de la lutte de classe, la rupture avec la période de contre-révolution et l'ouverture d'un nouveau cours historique vers l'affrontement décisif entre les classes antagoniques de notre époque : le prolétariat et la bourgeoisie.
Un début retentissant qui trouve la bourgeoisie momentanément impréparée, mais celle-ci va faire face par la suite à la réaction de cette dernière et à l'inexpérience de la nouvelle génération ouvrière qui s'est dressée sur la scène de l'histoire.
Ce nouveau cours historique se trouve confirmé par les événements internationaux qui suivent le Mai français.
En 1969, éclate le grand mouvement de grèves connu en Italie sous le nom de « l'automne chaud », une saison de lutte qui se poursuit pendant quelques années durant lesquelles les ouvriers tendent à démasquer les syndicats et à construire leurs organismes pour la direction de la lutte. Une vague de lutte dont la limite est de rester isolée dans les usines, et qui a l'illusion que la lutte « dure » dans les usines peut « faire céder les patrons ». Cette limite va permettre aux syndicats de reprendre leur place dans l'usine en se présentant sous les nouveaux habits d' « organismes de base » dans lesquels se hâtent d'affluer tous les éléments gauchistes qui, durant la phase ascendante du mouvement, ont joué aux révolutionnaires et qui, aujourd'hui, trouvent un emploi comme bonzes syndicaux.
Les années 1970 voient d'autres mouvements de lutte dans tout le monde industrialisé : en Italie (les cheminots, les hospitaliers), en France (LIP, Renault, les sidérurgistes de Longwy et Denain), en Espagne, au Portugal et ailleurs, les ouvriers règlent leur compte avec les syndicats qui, malgré leurs nouveaux habits, « plus proches de la base », continuent d'apparaître comme les défenseurs des intérêts capitalistes et les saboteurs des luttes prolétariennes.
En 1980 en Pologne, la classe ouvrière, mettant à profit l'expérience sanglante qu'elle avait faite dans les confrontations précédentes de 1970 et 1976, organise une grève de masse qui bloque tout le pays. Ce formidable mouvement des ouvriers de Pologne, qui montre aux yeux du monde entier la force du prolétariat, sa capacité à prendre ses luttes en mains, à s'organiser par lui-même à travers ses assemblées générales (les MKS) pour étendre la lutte dans tout le pays, constitue un encouragement pour la classe ouvrière de tous les pays. C'est le syndicat Solidarnosc, créé par la bourgeoisie (avec l'aide des syndicats occidentaux) pour encadrer, contrôler et dévoyer le mouvement qui finalement livre les ouvriers de Pologne pieds et poings liés à la répression du gouvernement Jaruzelski. Cette défaite provoque un profond désarroi dans les rangs du prolétariat mondial. Il lui faudra plus de deux ans pour digérer cette défaite.
Durant les années 1980, les ouvriers mettent à profit toute l'expérience de sabotage syndical de la décennie précédente. De nouvelles luttes éclatent dans les principaux pays et les travailleurs commencent à prendre leurs luttes en main, créant des organes spécifiques. Les cheminots en France, les travailleurs de l'école en Italie mènent des luttes qui se basent sur des organes contrôlés par les ouvriers, à travers les assemblées générales de grévistes.
Face à cette maturation de la lutte, la bourgeoisie est contrainte de renouveler ses propres armes syndicales : c'est dans ces années que se développe une nouvelle forme de syndicalisme « de base » (les coordinations en France, les COBAS en Italie), des syndicats masqués qui reprennent les formes des organes dont se sont dotés les ouvriers dans leurs luttes, afin de les ramener dans le giron syndical.
Nous n'avons fait qu'esquisser de ce qui s'est passé dans les deux décennies après le Mai français. Nous pensons que c'est suffisant pour démontrer que celui-ci n'a pas été un incident de l'histoire, spécifiquement français, mais véritablement le début d'une nouvelle phase historique durant laquelle la classe ouvrière a rompu avec la contre-révolution et s'est à nouveau présentée sur la scène de l'histoire pour entreprendre le long chemin de la confrontation avec le capital.
Une reprise historique difficile
Si les nouvelles générations de la classe ouvrière de l'après-guerre ont réussi à rompre avec la période de contre-révolution parce qu'elles n'ont pas directement connu la démoralisation de la défaite des années 1920, elle sont cependant inexpérimentées et cette reprise historique de la lutte va s'avérer longue et difficile. Nous avons déjà vu les difficultés à régler leur compte aux organismes syndicaux et à leur rôle de défenseur du capital. Mais un événement historique important et imprévu va rendre encore plus longue et difficile cette reprise : l'effondrement du bloc de l'Est.
Expression de l'érosion provoquée par la crise économique, cet effondrement va cependant entraîner un reflux de la conscience du prolétariat, un reflux amplement exploité par la bourgeoisie cherchant à regagner le terrain perdu dans les années précédentes.
Au moyen de l'identification du stalinisme au communisme, la bourgeoisie présente l'effondrement du stalinisme comme « la faillite du communisme », lançant à la classe ouvrière un message simple mais puissant : la lutte ouvrière n'a pas de perspective, car il n'existe pas d'alternative viable au capitalisme. Celui-ci serait un système plein de défauts, mais « le seul possible ».
Cette campagne provoque dans la conscience de la classe ouvrière un reflux bien plus important et profond que celui qui s'était manifesté entre les vagues de lutte précédentes. En effet, cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un mouvement qui finit mal, d'un sabotage syndical parvenu à freiner un mouvement de lutte. C'est la possibilité même d'une perspective à plus long terme qui est remise en question.
Cependant, la crise qui a été le détonateur de la reprise historique de la lutte de classe, est toujours là, avec les attaques toujours plus violentes contre le niveau de vie des ouvriers qui en résulte. C'est pourquoi en 1992, la classe ouvrière est contrainte de reprendre la lutte, avec le mouvement de grèves contre le gouvernement Amato en Italie, suivi par d'autres luttes en Belgique, Allemagne, France, etc. Une reprise de la combativité d'une classe ouvrière qui n'a cependant pas surmonté le recul de sa conscience. C'est pourquoi cette reprise ne réussit pas à rattraper le niveau atteint à la fin des années 1980.
Depuis, la bourgeoisie ne reste pas les bras croisés, elle ne laisse pas le prolétariat développer tout seul ses luttes et reprendre, à travers elles, confiance en lui-même. Avec encore plus de force et de capacité de manoeuvre, elle organise notamment la grève de la fonction publique de l'automne 1995 en France : à travers une grande campagne de presse au niveau international, cette grève est montrée du doigt comme l'expression de la capacité des syndicats à organiser la lutte ouvrière et à défendre les intérêts du prolétariat. Une manoeuvre similaire a lieu en Belgique et en Allemagne, avec pour résultat une recrédibilisation internationale des syndicats qui peuvent ainsi remplir leur rôle de saboteurs de la combativité ouvrière.
Mais la bourgeoisie ne manoeuvre pas seulement sur ce terrain. Elle lance aussi une série de campagnes qui a pour but de maintenir les ouvriers sur le terrain de la défense de la démocratie (et donc de l'Etat bourgeois) : Mani pulite en Italie, l'affaire Dutroux en Belgique, les campagnes antiracistes en France ; tous ces événements reçoivent un grand écho dans les médias afin de convaincre les travailleurs du monde entier que leurs problèmes ne sont pas que la défense de vulgaires intérêts économiques, qu'ils doivent se serrer la ceinture à l'intérieur de leurs Etats respectifs pour défendre la démocratie, la justice propre et autres idioties du même genre.
Mais, durant les deux dernières années, c'est la mémoire historique de la classe que la bourgeoisie cherchr à détruire, discréditant l'histoire de la lutte de classe et des organisations qui s'y réfèrent. C'est la Gauche communiste qui est attaquée, présentée comme la soi-disant première inspiratrice du « négationnisme ».
C'est aussi la dénaturation de la véritable signification profonde de la révolution d'Octobre, présentée comme un coup d'Etat des bolcheviks, cherchant à effacer ainsi la grandiose vague révolutionnaire des années 1920 où la classe ouvrière, bien que défaite, a démontré qu'elle était capable d'attaquer le capitalisme comme mode de production et pas seulement de se défendre contre son exploitation. Dans deux énormes livres écrits à l'origine en France et en Grande Bretagne, mais déjà traduits dans d'autres pays, on poursuit la mystification de l'identification du stalinisme au communisme, attribuant à ce dernier tous les crimes du stalinisme. ([3] [3320])
Mais l'avenir appartient toujours au prolétariat
Si la bourgeoisie se préoccupe tant de dévoyer la lutte de la classe ouvrière, d'en dénaturer l'histoire, de discréditer les organisations qui défendent la perspective révolutionnaire de la classe ouvrière, c'est parce qu'elle sait que le prolétariat n'est pas battu, que, malgré toutes les difficultés actuelles, la voie est toujours ouverte à des confrontations ouvertes dans lesquelles la classe ouvrière pourra de nouveau mettre en question le pouvoir bourgeois. Et la bourgeoisie sait aussi que l'aggravation de la crise et les sacrifices qu'elle impose aux ouvriers les contraindront à s'engager toujours plus dans la lutte. Et c'est dans cette lutte que les prolétaires retrouveront confiance en eux-mêmes, qu'ils sauront apprendre quelle est la nature des syndicats et s'organiser pour trouver des formes autonomes d'organisation.
Une nouvelle phase s'ouvre, une phase dans laquelle la classe ouvrière retrouvera le chemin ouvert il y a 30 ans par la grève générale grandiose du Mai français.
Helios
Géographique:
- France [1248]
Histoire du mouvement ouvrier:
- Mai 1968 [1249]
Approfondir:
- Mai 1968 [1250]
Heritage de la Gauche Communiste:
- La lutte Proletarienne [169]
1848 - Le manifeste communiste : une boussole indispensable pour l'avenir de l'humanité
- 3986 reads
Le Manifeste communiste a été écrit à un moment décisif dans l'histoire de la lutte de classe : la période où la classe représentant le projet communiste, le prolétariat, commençait à se constituer elle-même comme une classe indépendante dans la société. A partir du moment où le prolétariat développa sa propre lutte pour ses conditions d'existence, le communisme cessa d'être un idéal abstrait élaboré par des courants utopiques, pour devenir le mouvement social pratique menant à l'abolition de la société de classe et à la création d'une communauté humaine authentique. Comme telle, la principale tâche du Manifeste communiste a été l'élaboration de la vraie nature du but communiste de la lutte de classe ainsi que des principaux moyens pour atteindre ce but. C'est ce qui montre toute l'importance du Manifeste communiste aujourd'hui face aux falsifications bourgeoises du communisme et de la lutte de classe, son actualité que la bourgeoisie cherche à cacher. Nous avons déjà traité du Manifeste communiste à plusieurs reprises dans notre presse, récemment dans nos articles « 1848 : le communisme comme programme politique » ([1] [3324]) ou « Le Manifeste communiste de 1848, Arme fondamentale du combat de la classe ouvrière contre le capitalisme » ([2] [3325]). Dans cet article nous revenons plus particulièrement sur combien ce dernier contenait déjà la plupart les arguments de la dénonciation du stalinisme.
« Un spectre hante l'Europe : le spectre du communisme. Toutes les puissances de la vieille Europe se sont groupées en une sainte alliance pour traquer ce spectre : le Pape et le Tsar, Metternich et Guizot, les radicaux français et les policiers allemands. »
Ces lignes qui ouvrent le Manifeste communiste, écrit il y a exactement 150 ans, sont plus vraies aujourd'hui que jamais auparavant. Un siècle et demi après que la Ligue des communistes ait adopté la fameuse déclaration de guerre du prolétariat révolutionnaire contre le système capitaliste, la classe dominante est toujours extrêmement préoccupée par le spectre du communisme. Le pape, aux côtés de son ami stalinien Fidel Castro, est toujours en croisade pour la défense du droit accordé par Dieu à la classe dominante de vivre de l'exploitation du travail salarié. Le livre noir du communisme, dernière monstruosité produite par les « radicaux français », qui accuse de façon mensongère le marxisme des crimes de son ennemi stalinien, est en train d'être traduit en anglais, en allemand et en italien ([3] [3326]). Quant à la police allemande, mobilisée comme toujours contre les idées révolutionnaires, elle vient de se voir officiellement attribuer, grâce à un changement de la constitution démocratique bourgeoise, le droit de mener électroniquement des enquêtes et des écoutes contre le prolétariat n'importe où et n'importe quand ([4] [3327]).
1998, année du 150e anniversaire du Manifeste communiste, constitue en fait une nouvelle apogée dans la guerre historique que livrent les classes dominantes contre le communisme. Bénéficiant encore beaucoup de l'effondrement en 1989 des régimes staliniens européens qu'elle présente comme la « fin du communisme » et dans le sillage du 80e anniversaire de la révolution d'octobre 1917, la bourgeoisie atteint de nouveaux records de production dans sa propagande anti-communiste. On aurait pu imaginer que la question du Manifeste communiste offrirait une nouvelle occasion d'intensifier cette propagande.
C'est le contraire qui est vrai. Malgré la signification historique évidente de la date de janvier 1998 – le Manifeste communiste est avec la Bible le livre au 20e siècle le plus fréquemment publié au niveau mondial – la bourgeoisie a choisi de quasiment ignorer l'anniversaire du premier programme véritablement communiste révolutionnaire de son ennemi de classe. Quelle est la raison de ce soudain silence assourdissant ?
Le 10 janvier 1998, la bourgeoisie allemande a publié dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung une prise de position sur le Manifeste communiste. Après avoir proclamé que les ouvriers de l'Est « s'étaient débarrassés des chaînes du communisme » et que la « flexibilité dynamique » du capitalisme permettra de continuer à surmonter toutes les crises, donnant donc tort à Marx, la prise de position conclut : « Cent cinquante ans après l'apparition du Manifeste, nous n'avons plus à avoir peur d'aucun spectre. »
Cet article, relégué en page 13 du supplément économique et boursier, ne constitue pas une tentative très réussie de la classe dominante pour se recréditer. A côté, sur la même page, il y a un article sur la terrible crise économique en Asie, et un autre sur le nouveau record officiel du taux de chômage dans l'Allemagne d'après-guerre s'élevant à quasiment 4,5 millions. Les pages de la presse bourgeoise elles-mêmes démontrent quotidiennement la fausseté de sa prétendue réfutation du marxisme par l'histoire. En réalité, il n'existe pas aujourd'hui de document qui trouble plus profondément la bourgeoisie que le Manifeste communiste – pour deux raisons. La première parce que sa démonstration du caractère historique temporaire du mode de production capitaliste, de la nature insoluble de ses contradictions internes que confirme la réalité présente, continue à hanter la classe dominante. La seconde, parce que le Manifeste, déjà à l'époque, a été précisément écrit pour dissiper les confusions de la classe ouvrière sur la nature du communisme. D'un point de vue actuel, on peut le lire comme une dénonciation moderne du mensonge selon lequel le stalinisme aurait quelque chose à voir avec le socialisme. Et ce mensonge est aujourd'hui l'une des principales cartes idéologiques de la classe dominante contre le prolétariat.
Pour ces deux raisons, la bourgeoisie a un intérêt vital à éviter tout type de publicité qui pourrait trop attirer l'attention sur le Manifeste communiste et sur ce qui est véritablement écrit dans ce célèbre document. Elle veut notamment que rien ne soit fait ni dit qui puisse aiguiser la curiosité des ouvriers et les amener à le lire eux-mêmes. Se basant sur l'impact historique de l'effondrement du stalinisme, la bourgeoisie va continuer à proclamer que l'histoire a réfuté le marxisme. Mais elle évitera prudemment tout examen public du but communiste tel que l'a défini le marxisme, et de la méthode matérialiste historique utilisée à cette fin. Comme le Manifeste communiste réfute à l'avance l'idée du « socialisme en un seul pays » (inventée par Staline) et qu'a volé en éclats le prétendu dépassement de la crise du capitalisme qu'avait proclamé ce régime, la bourgeoisie continuera aussi longtemps que possible à ignorer la puissante argumentation de ce document. Elle se sentira plus sûre d'elle en combattant le « spectre » bourgeois du « socialisme en un seul pays » de Staline, présenté comme l'épouvantable mise en oeuvre du marxisme et de la révolution d'Octobre.
Pour le prolétariat au contraire, le Manifeste communiste est la boussole pour l'avenir de l'espèce humaine qui montre l'issue à l'impasse meurtrière dans laquelle le capitalisme décadent a piégé l'humanité.
Le « spectre du communisme » bourgeois
La référence au « spectre du communisme » au début du Manifeste du Parti communiste de 1848 est devenue l'une des expressions les plus célèbres de la littérature mondiale. Néanmoins, on ne sait généralement pas à quoi le Manifeste communiste faisait véritablement référence. Ce qu'il voulait dire c'est que l'attention du public à l'époque – comme aujourd'hui – ne se portait pas tant sur le communisme du prolétariat que sur le communisme faux et réactionnaire des autres couches sociales, et même de la classe dominante. Il voulait dire que la bourgeoisie, n'osant pas combattre ouvertement et donc reconnaître publiquement les tendances communistes déjà à l'oeuvre dans la lutte de classe prolétarienne, utilisait cette confusion pour lutter contre le développement d'une lutte ouvrière autonome. « Quel est le parti de l'opposition que ses adversaires au pouvoir n'ont pas exécré comme communiste ? » demande le Manifeste. « Quel parti de l'opposition n'a pas renvoyé l'accusation flétrissante de communisme à plus oppositionnel que soi, tout comme à ses adversaires réactionnaires ? »
Déjà en 1848, c'était dans une certaine mesure ce « spectre du communisme » imposteur au centre de la controverse publique qui rendait particulièrement difficile pour le jeune prolétariat la prise de conscience que le communisme, loin d'être quelque chose de séparé et d'opposé à la lutte de classe quotidienne, n'était rien d'autre que sa nature même, sa signification historique et le but final de cette lutte. C'est ce qui permettait de masquer que, comme le disait le Manifeste, « les conceptions théoriques des communistes (...) ne font qu'exprimer, en termes généraux, les conditions réelles d'une lutte de classes qui existe, d'un mouvement historique qui se déroule sous nos yeux. »
Là réside la dramatique actualité du Manifeste communiste. Il y a un siècle et demi, tout comme aujourd'hui, il montre la voie en refusant toutes les distorsions anti-prolétariennes du communisme. Face à un phénomène historique entièrement nouveau – le chômage massif et la paupérisation de masse dans l'Angleterre industrialisée, l'ébranlement de l'Europe encore à-demi féodale par des crises commerciales périodiques, l'extension internationale du mécontentement révolutionnaire de masse à la veille de 1848 –, les secteurs les plus conscients de la classe ouvrière cherchaient déjà à tâtons une compréhension plus claire du fait qu'en créant une classe de producteurs dépossédés, liés internationalement dans le travail associé par l'industrie moderne, le capitalisme avait créé son propre fossoyeur potentiel. Les premières grandes grèves ouvrières collectives en France et ailleurs, l'apparition du premier mouvement politique prolétarien de masse en Grande-Bretagne (le « chartisme »), et les efforts pour élaborer un programme socialiste par les organisations ouvrières, avant tout allemandes (de Weitling à la Ligue des communistes) exprimaient ces avancées. Mais pour que le prolétariat fonde sa lutte sur une base de classe solide, il fallait avant tout éclairer le but communiste de ce mouvement, et donc combattre consciemment le « socialisme » de toutes les autres classes. La clarification de cette question était urgente puisque l'Europe de 1848 était au bord de mouvements révolutionnaires qui devaient atteindre leur apogée en France avec le premier face à face de masse entre la bourgeoisie et le prolétariat en juin 1848.
C'est pourquoi le Manifeste Communiste dédie tout un chapitre à dénoncer le caractère réactionnaire du socialisme non prolétarien. Il y inclut notamment des expressions véritables de la classe dominante directement opposée à la classe ouvrière :
– le socialisme féodal ayant en partie pour but de mobiliser les ouvriers derrière la résistance réactionnaire de la noblesse contre la bourgeoisie ;
– le socialisme bourgeois, « une partie de la bourgeoisie (qui) cherche à pallier les tares sociales, afin de consolider la société bourgeoise. »
C'était d'abord et avant tout pour combattre ces « spectres du communisme » que le Manifeste communiste a été écrit. Comme il le déclare ensuite : « Il est grand temps que les communistes exposent publiquement, à la face du monde entier, leurs conceptions, leurs buts et leurs tendances ; qu'ils opposent à la légende du spectre un manifeste du parti. »
Les éléments essentiels de cet exposé étaient la conception matérialiste de l'histoire et de la société communiste sans classe destinée à remplacer le capitalisme. C'est la résolution brillante de cette tâche historique qui fait aujourd'hui du Manifeste communiste le point de départ indispensable de la lutte prolétarienne contre les absurdités idéologiques bourgeoises léguées par la contre-révolution stalinienne. Le Manifeste communiste, loin d'être un produit caduc du passé, était bien en avant de son époque en 1848. Au moment de sa publication, on pensait à tort être proche de la chute du capitalisme et de la victoire de la révolution prolétarienne, mais ce n'est qu'avec le 20e siècle que l'accomplissement de la vision révolutionnaire du marxisme a été mise à l'ordre du jour de l'histoire. En le lisant aujourd'hui, on a l'impression qu'il vient d'être écrit tant est précise sa formulation des contradictions de la société bourgeoise actuelle et de la nécessité de leur résolution par la lutte de classe du prolétariat. Cette actualité quasiment subjuguante du Manifeste est la preuve qu'il est l'émanation d'une classe authentiquement révolutionnaire détenant le sort de l'humanité entre ses mains, dotée d'une vision à long terme à la fois gigantesque et réaliste de l'histoire humaine.
Le Manifeste : une arme inestimable contre le stalinisme
Evidemment, ce serait une erreur de comparer le naïf « socialisme » bourgeois et féodal de 1848 à la contre-révolution stalinienne des années 1930, qui, au nom du marxisme, a détruit la première révolution prolétarienne victorieuse dans l'histoire, a physiquement liquidé l'avant-garde communiste de la classe ouvrière et soumis le prolétariat à l'exploitation capitaliste la plus barbare. Néanmoins, le Manifeste communiste avait déjà démasqué le commun dénominateur du « socialisme » des classes exploiteuses. Ce qu'ont écrit Marx et Engels sur le socialisme « conservateur ou bourgeois » de l'époque s'applique pleinement au stalinisme du 20e siècle.
« (...) Par transformation des conditions de vie matérielles, ce socialisme n'entend nullement l'abolition des rapports de production bourgeois, qui ne peut être atteinte que par des moyens révolutionnaires ; il entend par là uniquement des réformes administratives, qui s'accomplissent sur la base même de ces rapports de production sans affecter, par conséquent, les rapports du capital et du travail salarié, et qui, dans le meilleur des cas, permettent à la bourgeoisie de diminuer les frais de sa domination et d'alléger le budget de l'Etat. »
Le stalinisme a proclamé que malgré la persistance de ce qu'il a appelé un travail salarié « socialiste », le produit de son travail appartenait à la classe productrice puisque l'exploitation personnelle par des capitalistes individuels avait été remplacée par la propriété d'Etat. Comme en réponse à cela, le Manifeste communiste demande : « Est-ce que le travail salarié, le travail du prolétaire crée pour lui une propriété quelconque ?» et il répond : « En aucune manière. Il crée le capital, c'est-à-dire la propriété qui exploite le travail salarié et qui ne peut s'accroître qu'à la condition de produire un surcroît de travail salarié, afin de l'exploiter à nouveau. Dans sa forme actuelle la propriété évolue dans l'antagonisme du capital et du travail. (...) Etre capitaliste, c'est occuper dans la production non seulement une position personnelle, mais encore une position sociale. Le capital est le produit d'un travail collectif et ne peut être mis en mouvement que par l'activité commune d'un grand nombre de membres de la société, voire, en dernier résultat, de tous ses membres. Par conséquent, le capital n'est pas une puissance personnelle, c'est une puissance sociale. »
Cette compréhension fondamentale du Manifeste communiste, à savoir que le remplacement juridique des capitalistes individuels par la propriété d'Etat ne change en rien – contrairement au mensonge stalinien – la nature capitaliste de l'exploitation du travail salarié, est formulée encore plus explicitement dans l'Anti-Dühring de Engels.
« Mais ni la transformation en sociétés par actions, ni la transformation en propriété d'Etat ne supprime la qualité de capital des forces productives.(...) L'Etat moderne, quelle qu'en soit la forme, est une machine essentiellement capitaliste : l'Etat des capitalistes, le capitaliste collectif en idée. Plus il fait passer de forces productives dans sa propriété, plus il devient capitaliste collectif en fait, plus il exploite de citoyens. Les ouvriers restent des salariés, des prolétaires. Le rapport capitaliste n'est pas supprimé, il est au contraire poussé à son comble. »
Mais c'est avant tout en définissant la différence fondamentale entre le capitalisme et le communisme que le Manifeste communiste révèle clairement le caractère bourgeois des anciens pays staliniens.
« Dans la société bourgeoise, le travail vivant n'est qu'un moyen d'augmenter le travail accumulé. Dans la société communiste, le travail accumulé n'est qu'un moyen d'élargir, d'enrichir et de stimuler la vie des travailleurs. Dans la société bourgeoise, le passé domine donc le présent ; dans la société communiste, le présent domine le passé. »
C'est pourquoi les succès de l'industrialisation stalinienne dans la Russie des années 1930 aux dépens des conditions de vie des ouvriers et par la réduction drastique de celles-ci, constitue la meilleure preuve de la nature bourgeoise de ce régime. Le développement des forces productives au détriment de la consommation des producteurs constitue la tâche historique du capitalisme. L'humanité a dû passer par l'enfer de l'accumulation du capital afin que soient créées les préconditions matérielles à une société sans classe. Le socialisme, au contraire, et chaque pas, chaque étape vers ce but, est caractérisé d'abord et avant tout par une croissance quantitative et qualitative de la consommation, en particulier de la nourriture, de l'habillement et de l'habitat. C'est pourquoi le Manifeste a identifié la paupérisation relative et absolue du prolétariat comme caractéristique principale du capitalisme : « La bourgeoisie est incapable de demeurer la classe dirigeante et d'imposer à la société, comme loi suprême, les conditions de vie de sa classe. Elle ne peut régner, car elle ne peut plus assurer l'existence de l'esclave à l'intérieur même dans son esclavage : elle est forcée de le laisser déchoir si bas qu'elle doit le nourrir au lieu d'être nourrie par lui. La société ne peut plus vivre sous la bourgeoisie ; c'est-à-dire que l'existence de la bourgeoisie et l'existence de la société sont devenues incompatibles. »
Et cela veut dire deux choses : que l'appauvrissement amène le prolétariat à la révolution ; et que cet appauvrissement massif signifie que l'expansion des marchés capitalistes ne peut aller de pair avec l'extension de la production capitaliste. Résultat : le mode de production se rebelle contre le mode d'échange ; les forces productives se rebellent contre un mode de production qu'elles ont dépassé ; le prolétariat se rebelle contre la bourgeoisie ; le travail vivant contre la domination du travail mort. L'avenir de l'humanité s'affirme contre la domination du présent par le passé.
Le Manifeste : l'anéantissement du « socialisme en un seul pays » par le marxisme
En fait, le capitalisme a créé les pré-conditions d'une société sans classe qui peut donner à l'humanité, pour la première fois de son histoire, la possibilité de dépasser la lutte de l'homme contre l'homme pour la survie, en produisant une abondance de moyens fondamentaux de subsistance et de culture humaine. C'est pour cette unique raison que le Manifeste chante les louanges du rôle révolutionnaire de la société bourgeoise. Mais ces pré-conditions – en particulier le marché mondial et le prolétariat mondial lui-même – n'existent qu'à l'échelle mondiale. La plus haute forme de la concurrence capitaliste (qui n'est elle-même qu'une version moderne de la lutte de tous temps de l'homme contre l'homme dans des conditions de pénurie) est la lutte économique et militaire pour la survie, entre Etats nationaux. C'est pourquoi le dépassement de la concurrence capitaliste et l'établissement d'une société véritablement collective et humaine ne peut avoir lieu que par le dépassement de l'Etat national, à travers une révolution prolétarienne mondiale. Seul le prolétariat peut accomplir une telle tâche puisque, comme le dit le Manifeste, « les ouvriers n'ont pas de patrie ». La domination du prolétariat fera de plus en plus disparaître les démarcations et les antagonismes entre les peuples. « Une des premières conditions de son émancipation, c'est l'action unifiée, tout au moins des travailleurs des pays civilisés. »
Déjà avant le Manifeste communiste, dans les Principes du communisme, Engels avait répondu à la question « Cette révolution se fera-t-elle dans un seul pays ? » :
« Non. La grande industrie, en créant le marché mondial, a déjà rapproché si étroitement les uns des autres les peuples de la terre, et notamment les plus civilisés, que chaque peuple dépend de ce qui se passe chez les autres (...) La révolution communiste, par conséquent, ne sera pas une révolution purement nationale ; elle se produira en même temps dans tous les pays civilisés, c'est-à-dire tout au moins en Angleterre, en Amérique, en France et en Allemagne. »
Voici le dernier coup mortel du Manifeste communiste à l'idéologie bourgeoise de la contre-révolution stalinienne : la soi-disant théorie du socialisme en un seul pays. Le Manifeste communiste est la boussole qui a guidé la vague révolutionnaire mondiale de 1917-23. C'est le glorieux slogan « Travailleurs de tous les pays, unissez-vous ! » qui a guidé le prolétariat russe et les bolcheviks en 1917 dans leur lutte héroïque contre la guerre impérialiste de la patrie capitaliste, dans la prise du pouvoir par le prolétariat pour commencer la révolution mondiale. C'est le Manifeste communiste qui a servi de point de référence au fameux discours de Rosa Luxemburg sur le programme, au congrès de fondation du Parti communiste allemand (KPD), au coeur de la révolution allemande, et au congrès de fondation de l'Internationale Communiste en 1919. C'est également l'internationalisme prolétarien sans compromis du Manifeste, de l'ensemble de la tradition marxiste, qui a inspiré Trotsky dans sa lutte contre le « socialisme en un seul pays », qui a inspiré la Gauche communiste dans sa lutte de plus d'un demi siècle contre la contre-révolution stalinienne.
La Gauche communiste rend aujourd'hui hommage au Manifeste du Parti communiste de 1848, non comme un vestige d'un lointain passé, mais comme une arme puissante contre le mensonge du stalinisme comme socialisme, et comme guide indispensable pour le nécessaire avenir révolutionnaire de l'humanité.
Kr.
[4] [3331]. Ce qu'on appelle la « grosse Lauschangriff » (grande attaque des écoutes) de la bourgeoisie allemande, qui a soi-disant pour cible le crime organisé, mais qui spécifie 50 infractions différentes, y compris différentes formes de « subversion ».
Histoire du mouvement ouvrier:
- 1848 [1037]
Heritage de la Gauche Communiste:
- La lutte Proletarienne [169]
Le communisme n'est pas un bel idéal, il est à l'ordre du jour de l'histoire [3° partie]
- 3466 reads
1918 : le programme du Parti communiste allemand
La classe dominante ne peut pas enterrer complètement la révolution d'Octobre 1917 en Russie où, pour la première fois dans l'histoire, une classe exploitée a pris le pouvoir sur tout le territoire d'un immense pays. Au contraire, comme nous l'avons montré à de nombreuses occasions dans les pages de cette Revue internationale ([1] [3332]), elle a utilisé les énormes moyens dont elle dispose pour distordre le sens de cet événement qui a marqué ce siècle en répandant un épais brouillard de mensonges et de calomnies. Il en va différemment pour la révolution allemande de 1918-23. Là, elle a appliqué la politique du black-out historique. Ainsi, si l'on jette un coup d'oeil aux manuels scolaires d'histoire classiques, on verra que la révolution d'octobre est un tant soit peu traitée (avec une lourde insistance sur ses particularités russes). Par contre, la révolution allemande est en règle générale évoquée en quelques lignes, on parle des « émeutes de la faim » à la fin de la guerre ou, au mieux, des efforts d'un groupe obscur appelé les « Spartakistes » pour prendre le pouvoir ici et là. Ce silence sera probablement encore plus fort en cette année du 80e anniversaire de l'explosion de la révolution dans l'Allemagne du Kaiser. La majorité de la classe ouvrière mondiale n'a probablement jamais entendu parler d'une révolution en Allemagne au début du siècle et la bourgeoisie a de très bonnes raisons pour la maintenir dans l'ignorance. Par contre, les communistes, héritiers de ces « spartakistes fanatiques », n'hésitent pas à dire haut et fort que ces événements « inconnus » ont été si cruciaux qu'ils ont déterminé toute l'histoire du 20e siècle.
La révolution allemande éclipsée de l'histoire
Quand les bolcheviks ont poussé le prolétariat russe à prendre le pouvoir en octobre 1917, ils n'avaient pas du tout l'intention de faire une révolution purement « russe ». Ils avaient compris que si la révolution était possible en Russie, c'est seulement parce qu'elle était le produit d'un mouvement mondial de la classe ouvrière contre la guerre impérialiste qui avait ouvert l'époque de la révolution sociale ; et que l'insurrection en Russie ne pourrait l'emporter que si elle constituait le premier acte d'une révolution prolétarienne mondiale.
Loin d'être une vague perspective pour un futur lointain, la révolution mondiale était vue comme imminente, elle couvait de façon palpable à travers toute l'Europe laminée par la guerre. Et il était clair que l'Allemagne constituait la clé de son extension à partir de la Russie vers l'ouest industrialisé. L'Allemagne était la nation industrielle la plus puissante en Europe et avait le prolétariat le plus concentré ; les traditions politiques du mouvement ouvrier allemand étaient parmi les plus avancées du monde ; c'était aussi le pays où le prolétariat subissait, de la façon la plus abjecte, les effets de la guerre et, mis à part la Russie, il avait connu les mouvements de révolte prolétarienne les plus importants dès 1916. Aussi, pour les bolcheviks et les ouvriers russes, considérer la révolution allemande comme leur sauveur était bien autre chose qu'un voeu pieux. Quand la révolution allemande a véritablement commencé, en novembre 1918, par la mutinerie des marins de Kiel et la formation rapide de conseils d'ouvriers et de soldats dans de nombreuses villes, les ouvriers russes l'ont fêtée dans le plus grand enthousiasme, comprenant parfaitement que c'était la seule façon d'être libérés du terrible siège que le capitalisme mondial avait monté contre eux depuis qu'ils avaient pris le pouvoir.
Ainsi la révolution allemande était la preuve que la révolution était et ne pouvait être que mondiale. La classe dominante elle-même l'a très bien compris ; pour elle, si l'Allemagne tombait aux mains du « bolchevisme », la terrible maladie allait s'étendre rapidement à toute l'Europe. C'était la preuve que la lutte de la classe ouvrière ne connaît pas de frontière nationale mais constitue le seul antidote à la frénésie impérialiste et nationaliste de la bourgeoisie. La « moindre » de ses réalisations a été, en effet, de mettre fin au massacre de la première guerre mondiale car, dès qu'a éclaté le mouvement révolutionnaire, la bourgeoisie mondiale a immédiatement compris qu'il lui fallait mettre un terme à ses chamailleries et s'unir contre un ennemi bien plus dangereux, la classe ouvrière révolutionnaire. La guerre a été rapidement arrêtée et la bourgeoisie allemande – bien que quasiment dépouillée par les clauses du traité de paix – a obtenu des autres bourgeoisies tous les moyens dont elle avait besoin pour faire face à l'ennemi intérieur.
A contrario, la défaite de la révolution allemande a confirmé la thèse marxiste, défendue avec la plus grande lucidité par tous les communistes allemands tels que Rosa Luxemburg : en l'absence d'une alternative prolétarienne, le capitalisme décadent ne pouvait que plonger l'humanité dans la barbarie. Toutes les horreurs qui se sont abattues sur l'humanité, dans les décennies qui ont suivi, ont été le résultat direct de cette défaite. Isolé et de plus en plus étranglé par les forces combinées de la contre-révolution internationale, le bastion prolétarien en Russie a dégénéré de l'intérieur et été remplacé par un régime contre-révolutionnaire d'un type nouveau, celui qui a asséné le coup mortel à la révolution au nom de la révolution, celui qui a construit une économie de guerre capitaliste au nom du socialisme et qui a mené la guerre impérialiste au nom de l'internationalisme prolétarien. En Allemagne même, la férocité de la contre-révolution incarnée par la terreur nazie a été, comme le stalinisme en Russie, à la mesure de la menace révolutionnaire qui l'avait précédée. Et le stalinisme comme le nazisme, avec leur militarisation extrême de la vie sociale, ont été les expressions les plus évidentes du fait que la défaite du prolétariat ouvre la voie à la guerre impérialiste mondiale.
Le communisme était possible et nécessaire en 1917. Si le mouvement communiste avait été victorieux à ce moment-là, le prolétariat aurait sans aucun doute eu à faire face à des tâches gigantesques pour construire une nouvelle société. Sans aucun doute il aurait commis bien des erreurs que les générations suivantes d'ouvriers auraient évité grâce à son amère expérience. Mais en même temps, il n'aurait pas eu à se débarrasser des effets accumulés de la décadence capitaliste et son legs cauchemardesque de terreur et de destruction, d'empoisonnement matériel et idéologique. Une nouvelle société humaine aurait pu émerger sur les ruines de la première guerre mondiale.
Au contraire, la défaite de la révolution a engendré un siècle de cauchemars et de monstruosités. C'est en Allemagne qu'a eu lieu le tournant. Il y a 80 ans – un temps très court à l'échelle de l'histoire, juste le temps d'une vie humaine – les ouvriers en armes sont descendus dans les rues de Berlin, de Hambourg, de Brême, de Munich, ont proclamé leur solidarité avec la révolution russe et ont annoncé leur intention de suivre son exemple. Pendant quelques années, brèves mais glorieuses, la classe dominante a tremblé face au spectre du communisme. Pas besoin de se demander alors pourquoi la bourgeoisie d'aujourd'hui fait preuve de tant de zèle pour enterrer la mémoire de tout cela : elle a peur que les nouvelles générations de prolétaires parviennent à comprendre qu'ils font partie d'une classe internationale dont la lutte détermine le cours de l'histoire, que la révolution prolétarienne mondiale n'est pas une utopie mais une possibilité concrète mise à l'ordre du jour par la désintégration interne du mode de production capitaliste.
Le congrès de fondation du KPD : la révolution à l'ordre du jour, pas des réformes
La grandeur et la tragédie de la révolution allemande se trouvent sous bien des aspects résumés dans le discours de Rosa Luxemburg au congrès de fondation du Parti communiste d'Allemagne (KPD) à la fin décembre 1918.
Dans la série d'articles sur la révolution allemande déjà publiés dans cette Revue internationale ([2] [3333]), nous avons souligné l'importance de ce congrès du point de vue des questions organisationnelles auxquelles le nouveau parti était confronté – par dessus tout, la nécessité d'une organisation centralisée, capable de parler d'une seule voix en Allemagne. Nous avons aussi abordé certaines questions programmatiques générales qui ont été chaudement débattues à ce congrès, en particulier la question syndicale et celle du parlementarisme. Nous avons vu que, alors que Rosa Luxemburg et le groupe Spartacus – véritable noyau central du KPD – ne défendaient pas toujours les positions les plus claires sur les questions de ce type, ils tendaient vraiment à incarner la clarté marxiste sur le problème de l'organisation, contrairement à certaines tendances plus à gauche qui exprimaient souvent une méfiance envers la centralisation. Dans le discours sur l'adoption du programme du parti fait par Rosa Luxemburg, la même clarté transparaît malgré des faiblesses secondaires qu'on peut y trouver. Le contenu politique profond de ce discours était une expression de la force du prolétariat en Allemagne en tant qu'avant-garde du mouvement mondial de la classe. Cependant, le fait que ce discours imposant fût en même temps son dernier discours et que le jeune KPD fût rapidement décapité après l'échec du soulèvement de Berlin deux semaines après seulement, exprime aussi la tragédie du prolétariat allemand, son incapacité à assumer les tâches historiques gigantesques qui s'imposaient à lui.
Les raisons de cette tragédie ne sont pas le sujet de cet article. Notre but, dans cette série d'articles, est de montrer comment l'expérience historique de notre classe a approfondi sa compréhension de la nature de la société communiste et du chemin pour y parvenir. En d'autres termes, il s'agit de tracer l'histoire du programme communiste. Le programme du KPD, généralement connu sous le nom de « programme de Spartacus » puisqu'il a été publié à l'origine sous le titre « Ce que veut Spartacus » dans Die Rote Fahne du 4 décembre 1918 ([3] [3334]), constitue un jalon hautement significatif dans cette histoire et ce n'est certainement pas par hasard que fut confiée à Rosa Luxemburg la tâche de le présenter au congrès, vu son prestige sans égal en tant que théoricienne du marxisme. Ses paroles introductives affirment très nettement l'importance de l'adoption par le nouveau parti d'un programme révolutionnaire clair dans une conjoncture historique révolutionnaire :
« Si nous assumons, aujourd'hui, la tâche de discuter et d'adopter notre programme, ce n'est pas pour le motif purement formel que nous avons constitué hier un parti autonome et neuf, et qu'un nouveau parti est obligé de justifier officiellement son existence au moyen d'un nouveau programme. Cette élaboration d'un programme a sa nécessité dans de grands événements historiques : nous sommes arrivés à un moment où le programme du prolétariat, traditionnellement élevé sur la base social-démocrate, socialiste-réformiste, doit être édifié à nouveau dans son ensemble sur une base toute différente. »
Afin d'établir ce que devait être cette nouvelle base, Rosa Luxemburg passe alors en revue les efforts antérieurs du mouvement ouvrier pour formaliser son programme. Après avoir affirmé : « En agissant ainsi, nous revenons à la situation qu'occupaient Marx et Engels lorsqu'ils s'attaquèrent, voilà soixante-dix ans, à la rédaction du Manifeste communiste », elle rappelle qu'à cette époque les fondateurs du socialisme scientifique considéraient la révolution prolétarienne comme imminente. Mais le développement et l'expansion du capitalisme qui ont suivi ont montré qu'ils avaient eu tort. Cependant, parce que leur socialisme était scientifique, Marx et Engels ont pris conscience qu'une longue période d'organisation, d'éducation, de luttes pour des réformes, de construction de l'armée prolétarienne était nécessaire avant que la révolution communiste puisse être mise à l'ordre du jour de l'histoire. De cette prise de conscience est venue la période de la social-démocratie durant laquelle a été établie la distinction entre le programme maximum de la révolution sociale et le programme minimum de réformes à atteindre au sein de la société capitaliste. Mais, dans la mesure où la social-démocratie s'est graduellement accommodée de ce qui semblait être un développement éternel de la société bourgeoise, le programme minimum s'est d'abord détaché du programme maximum et l'a ensuite de plus en plus totalement remplacé. Ce divorce entre les buts historiques et les buts immédiats de la classe était déjà, dans une grande mesure, incarné dans le programme d'Erfurt de 1891. Mais, c'est précisément au moment où la possibilité matérielle d'obtenir du capitalisme des réformes durables commençait à s'amenuiser que les illusions réformistes de toutes sortes ont eu le plus d'emprise sur le parti des ouvriers. En fait, comme on l'a vu dans un précédent article de cette série ([4] [3335]), c'est dans ce discours-ci que Rosa Luxemburg démontre qu'Engels lui-même n'était pas immunisé contre la tentation croissante de croire qu'avec la conquête du suffrage universel, et à travers le processus électoral bourgeois, la classe ouvrière pouvait parvenir au pouvoir.
La guerre impérialiste et l'éclatement de la révolution prolétarienne en Russie et en Allemagne ont définitivement mis un terme à toutes les illusions sur une transition pacifique et graduelle au socialisme. Il s'agissait là des « grands mouvements historiques » qui exigeaient l'établissement du programme socialiste « sur une nouvelle base ». La roue avait fait un tour complet : « Ainsi, camarades, comme je vous l'ai déjà dit, nous sommes aujourd'hui – conduits par la dialectique de l'histoire et enrichis par l'expérience du développement capitaliste des soixante-dix dernières années – à la place même où étaient Marx et Engels en 1848 lorsqu'ils déroulèrent pour la première fois l'étendard du socialisme international. Autrefois, lorsqu'on crut devoir corriger leurs erreurs et les illusions de 1848, on s'imagina que le prolétariat avait encore devant lui une très longue période de temps avant de pouvoir réaliser le socialisme. Naturellement, jamais les théoriciens sérieux ne se sont laissés aller à présenter un terme quelconque pour l'effondrement du capitalisme comme fixe et obligatoire, mais on supposait vaguement que le chemin serait encore très long et c'est ce qui ressort à chaque ligne de la préface en question qu'Engels a écrite en 1895.
Or, nous pouvons, à présent, dresser le bilan. Est-ce que le temps n'a pas été très court en comparaison du développement des luttes de classes de jadis ? Soixante-dix ans de développement du grand capitalisme ont suffi pour que nous puissions songer sérieusement à balayer le capitalisme du monde. Et plus encore : non seulement nous sommes aujourd'hui en mesure de résoudre cette tâche, non seulement c'est notre devoir envers le prolétariat, mais c'est la seule manière de sauver la société humaine.
Car cette guerre n'a rien laissé subsister de la société bourgeoise qu'un énorme amas de décombres. Dans la forme, tous les moyens de production et la plus grande partie des moyens de domination sociale sont encore dans les mains des classes dirigeantes ; nous ne nous faisons pas d'illusions à ce sujet. Mais ce qu'elles peuvent en faire, à part leurs tentatives convulsives pour rétablir, par d'immenses massacres, le mécanisme d'exploitation, n'est que désordre et impuissance.
Historiquement, le dilemme devant lequel se trouve l'humanité d'aujourd'hui se pose de la façon suivante : chute dans la barbarie ou salut par le socialisme. Il est impossible que la guerre mondiale procure aux classes dirigeantes une nouvelle issue, car il n'en existe plus sur le terrain de la domination de classe et du capitalisme. Ainsi, nous vivons aujourd'hui la vérité que justement Marx et Engels ont formulée pour la première fois, comme base scientifique du socialisme, dans le grand document qu'est le Manifeste communiste : le socialisme est devenu une nécessité historique. Cette vérité nous la vivons dans le sens le plus strict du terme. Le socialisme est devenu une nécessité, non seulement parce que le prolétariat ne veut plus vivre dans les conditions matérielles que lui préparent les classes capitalistes, mais aussi parce que, si le prolétariat ne remplit pas son devoir de classe en réalisant le socialisme, l'abîme nous attend tous, autant que nous sommes. »
L'aube de la décadence capitaliste, marquée par la grande guerre impérialiste, et le soulèvement du prolétariat contre la guerre nécessitaient une rupture définitive avec le vieux programme social-démocrate. « Il [notre programme] se trouve en opposition consciente avec le point de vue défini dans le programme d'Erfurt : en opposition consciente avec toute séparation des exigences immédiates et du but final qui est le socialisme. En opposition consciente avec cette façon de voir, nous liquidons les résultats des soixante-dix dernières années et avant tout le résultat immédiat de la guerre mondiale en disant : il n'y a pas maintenant pour nous de programme minimum ni de programme maximum ; le socialisme est un et indivisible ; et c'est là le minimum que nous avons à réaliser aujourd'hui. »
Dans la dernière partie de son discours, Rosa Luxemburg n'est pas entrée dans le détail des mesures mises en avant dans le projet de programme. A la place, elle s'est concentrée sur la tâche de l'heure la plus urgente : l'analyse de la façon dont le prolétariat pouvait faire un pont entre sa révolte spontanée initiale contre les privations de la guerre et la mise en oeuvre consciente du programme communiste. Cela nécessitait avant tout une critique impitoyable des faiblesses du mouvement révolutionnaire de masse de novembre 1918.
Cette critique ne signifiait pas du tout le rejet des efforts héroïques des ouvriers et des soldats qui avaient paralysé la machine de guerre impérialiste. Rosa Luxemburg reconnaît l'importance cruciale de la formation des conseils d'ouvriers et de soldats à travers tout le pays en novembre 1918. « C'est là le mot d'ordre de ralliement de cette révolution qui a immédiatement imprimé à celle-ci le cachet spécial de la révolution socialiste prolétarienne. » Et puisque l'« alphabet » de cette révolution, l'appel à des conseils d'ouvriers et de soldats, avait été appris des russes, sa nature internationale et internationaliste était également établie du fait « que c'est la révolution russe qui a émis les premiers mots d'ordre de la révolution mondiale. » Mais contrairement à ce que disent nombre de ses critiques, même parmi certains de ses plus chers amis, Rosa Luxemburg était loin d'être une adoratrice de la spontanéité instinctive des masses. Pour elle, sans une conscience de classe claire, la première résistance spontanée des ouvriers ne peut que succomber aux ruses et aux manoeuvres de l'ennemi de classe. « C'est là un fait très caractéristique pour les contradictions dialectiques dans lesquelles se meut cette révolution, comme d'ailleurs toutes les révolutions : dès le 9 novembre, poussant son premier cri de naissance, pour ainsi dire, elle a trouvé le mot d'ordre qui nous conduira jusqu'au socialisme : conseils d'ouvriers et de soldats. C'est autour de cette parole que tout s'est regroupé. Il est remarquable que la révolution ait trouvé instinctivement cette formule des conseils pour liquider le joug bureaucratique et impérialiste de la guerre. Malheureusement, les conseils ont aussitôt laissé échapper, à cause du caractère arriéré, de la faiblesse, du manque d'initiative et de clarté qui se manifesta dans la révolution, la plus grosse part des positions révolutionnaires conquises le 9 novembre. »
Rosa Luxemburg dénonçait avant tout les illusions des ouvriers sur le slogan de « l'unité socialiste » – l'idée que le SPD, les Indépendants et le KPD devaient enterrer leurs divergences et travailler ensemble pour la cause commune. Cette idée cachait le fait que le SPD avait été mis au gouvernement par la bourgeoisie allemande précisément parce qu'il avait déjà démontré sa loyauté au capitalisme pendant la guerre et qu'il était en fait maintenant le seul parti capable de faire face au danger révolutionnaire ; elle cachait aussi la fourberie des Indépendants dont le rôle était principalement de fournir une couverture radicale au SPD et d'empêcher les masses de faire une rupture claire avec ce dernier. Le clair résultat de ces illusions a été que les conseils ont presque immédiatement été dirigés par leurs pires ennemis, les contre-révolutionnaires Ebert, Noske et Scheidemann qui s'étaient parés des robes rouges du socialisme et se prétendaient les défenseurs les plus sûrs des conseils.
La classe ouvrière se devait donc de se débarrasser de telles illusions et apprendre à distinguer sérieusement ses amis de ses ennemis. La politique de répression, de briseur de grèves du nouveau gouvernement « socialiste » l'éduquerait certainement à cet égard et ouvrirait la porte à un conflit ouvert entre la classe ouvrière et le pseudo-gouvernement ouvrier. Mais ce serait une autre illusion de penser que le simple renversement du gouvernement social-démocrate comme point central assurerait la victoire de la révolution socialiste. La classe ouvrière ne serait prête à prendre et à détenir le pouvoir politique qu'après avoir traversé un processus intense d'auto-éducation par sa propre expérience positive, à travers la défense tenace de ses intérêts économiques, à travers des mouvements de grève de masse, à travers la mobilisation des masses paysannes, à travers la régénération et l'extension des conseils ouvriers, à travers un combat patient et systématique pour les débarrasser de l'influence de la social-démocratie et les gagner à la compréhension qu'ils sont les véritables instruments du pouvoir prolétarien. Le développement de ce processus de maturation révolutionnaire serait tel que « si le gouvernement Ebert-Scheidemann ou n'importe quel gouvernement analogue est renversé, ce ne soit là que l'acte final. »
Cette partie de la perspective présentée par Rosa Luxemburg pour la révolution allemande a souvent été critiquée car faisant des concessions à l'économisme et au gradualisme. Ces accusations ne sont pas totalement sans fondement. L'économisme – c'est à dire la subordination des tâches politiques de la classe ouvrière à la lutte pour ses intérêts économiques immédiats – devait s'avérer une faiblesse réelle du mouvement communiste en Allemagne ([5] [3336]), et on peut déjà la discerner dans certains passages du discours de Rosa Luxemburg quand elle dit, par exemple, qu'avec le développement du mouvement révolutionnaire « non seulement les grèves s'étendront de plus en plus, mais elles seront le centre, le point de la révolution, refoulant les questions purement politiques. » Rosa Luxemburg avait évidemment raison de dire que la politisation immédiate de la lutte en novembre n'avait pas été une garantie de sa réelle maturité et que la lutte devait certainement revenir sur un terrain économique avant de pouvoir atteindre un niveau politique supérieur. Mais l'expérience russe avait aussi montré qu'à partir du moment où le mouvement a atteint le point où la question du pouvoir est réellement posée par les plus importants bataillons de la classe ouvrière, les grèves tendent alors à être « repoussées à l'arrière-plan » en faveur de « questions purement politiques ». Il apparaît là que Rosa Luxemburg avait oublié sa propre analyse de la dynamique de la grève de masse dans laquelle elle développe que le mouvement passe des questions économiques aux questions politiques et vice et versa dans un va-et-vient continu.
Plus sérieuse est l'accusation de gradualisme. Dans son texte « Allemagne de 1800 aux "années rouges" (1917-23) », paru en décembre 1997, Robert Camoin écrit que « le programme [du KPD] élude gravement la question de l'insurrection ; la destruction de l'Etat est formulée en termes localistes. La conquête du pouvoir est présentée comme une action graduelle, arrachant petit à petit des parcelles du pouvoir à l'Etat. » Et il cite à l'appui la partie du discours de Rosa Luxemburg qui défend : « car ici il s'agit de lutter pied à pied, épaule contre épaule dans chaque village, dans chaque commune, pour que tous les moyens d'action, qui devraont être arrachés à la bourgeoisie pièce à pièce, soient transférés aux conseils d'ouvrier et de soldats. »
On ne peut nier que ce soit une façon erronée de présenter la conquête du pouvoir. En effet, autant les conseils ouvriers dans la période pré-insurrectionnelle rivalisent pour l'influence et l'autorité avec les organes officiels de l'Etat, autant la véritable prise du pouvoir, elle, constitue vraiment un moment clé qui doit être planifié et organisé de façon centralisée ; et le démantèlement de l'Etat bourgeois ne peut précéder ce moment insurrectionnel crucial. Mais Camoin – comme le font d'autres critiques de Rosa Luxemburg – a tort de dire : « dans ce programme, le parti n'a aucune présence ; tout est conçu et se fonde sur le concept de la spontanéité des masses. » Si Rosa Luxemburg va trop loin quand elle insiste sur la révolution non comme acte unique mais comme l'ensemble d'un processus, son intention fondamentale reste parfaitement valable : insister sur le fait que c'est à travers le développement et la maturation du mouvement de la classe, à travers l'émergence d'un double pouvoir que la conscience de classe révolutionnaire peut se généraliser et que, sans une telle généralisation, le mouvement serait voué à l'échec. Là-dessus les événements devaient prouver tragiquement qu'elle avait raison puisque l'échec du soulèvement de Berlin – et sa propre mort – furent précisément le résultat de l'illusion qu'il suffirait de renverser le gouvernement dans la capitale, sans avoir auparavant construit la confiance, la conscience et l'auto-organisation des masses. Une illusion qui a puissamment affecté l'avant-garde communiste elle-même, en particulier un révolutionnaire comme Karl Liebknecht qui n'était pas des moindres et qui a foncé droit dans le piège tendu par la bourgeoisie en poussant à un soulèvement prématuré. Rosa Luxemburg s'était, dès le départ, opposée à cette aventure et ses critiques de Liebknecht n'avaient rien à voir avec le « spontanéisme ». Au contraire, elle avait déjà appris profondément de l'expérience du parti bolchevik qui avait montré, dans la pratique, le véritable rôle d'un parti communiste dans le processus révolutionnaire, c'est-à-dire être capable de faire une évaluation politique claire de toutes les étapes du mouvement, d'agir au sein des organes de masse de la classe dans le but de les gagner au programme révolutionnaire, de mettre en garde les ouvriers pour qu'ils ne tombent pas dans les provocations bourgeoises, d'identifier le moment où l'assaut insurrectionnel doit être fait. Au plus haut de la vague révolutionnaire, ce qui est apparu ce ne sont pas les différences mais la profonde convergence qui existait entre Rosa Luxemburg et Lénine.
Ce que voulait Spartacus
Un parti révolutionnaire a besoin d'un programme révolutionnaire. Un petit groupe ou une petite fraction communiste, qui n'a pas d'impact décisif sur la lutte de classe, peut se définir autour d'une plateforme de positions de classe générales. Mais si un parti a certainement besoin de ces principes de classe comme fondement de sa politique, il a également besoin d'un programme qui traduise ces principes généraux en propositions pratiques pour le renversement de la bourgeoisie, l'établissement de la dictature du prolétariat et les premiers pas vers une nouvelle société. Dans une situation révolutionnaire, les mesures immédiates pour l'établissement du pouvoir prolétarien prennent évidemment une importance primordiale. Comme l'a écrit Lénine dans son « Salut à la république soviétique de Bavière » en avril 1919 :
« Nous vous remercions de votre message de salutations et, à notre tour, nous saluons de tout coeur la République des Soviets de Bavière. Nous vous prions instamment de nous faire savoir plus souvent et plus concrètement quelles mesures vous avez prises pour lutter contre les bourreaux bourgeois que sont Scheidemann et Cie ; si vous avez créé des Soviets d'ouvriers et de gens de maison dans les quartiers de la ville ; si vous avez armé les ouvriers et désarmé la bourgeoisie ; si vous avez utilisé les dépôts de vêtements et d'autres articles pour assister immédiatement et largement les ouvriers, et surtout les journaliers et les petits paysans ; si vous avez exproprié les fabriques et les biens des capitalistes de Munich, ainsi ques les exploitations agricoles des capitalistes des environs ; si vous avez aboli les hypothèques et les fermages des petits paysans ; si vous avez doublé ou triplé le salaire des journaliers et des manoeuvres ; si vous avez confisqué tout le papier et toutes les imprimeries pour publier des tracts et des journaux de masse ; si vous avez institué la journée de travail de six heures avec deux ou trois heures consacrées à l'étude de l'art d'administrer l'Etat ; si vous avez tassé la bourgeoisie à Munich pour installer immédiatement les ouvriers dans les appartements riches ; si vous avez pris en mains toutes les banques ; si vous avez choisi des otages parmi la bourgeoisie ; si vous avez adopté une ration alimentaire plus élevée pour les ouvriers que pour les bourgeois ; si vous avez mobilisé la totalité des ouvriers à la fois pour la défense et pour la propagande idéologique dans les villages avoisinants. L'application la plus urgente et la plus large de ces mesures, ainsi que d'autres semblables, faite en s'appuyant sur l'initiative des Soviets d'ouvriers, de journaliers, et, séparément, de petits paysans, doit renforcer votre position. (...) »
Le document « Que veut Spartacus? » proposé comme projet de programme du nouveau KPD va dans la même direction que les recommandations de Lénine. Il est présenté par un préambule qui réaffirme l'analyse marxiste de la situation historique qu'affronte la classe ouvrière : la guerre impérialiste a mis l'humanité devant le choix entre la révolution prolétarienne mondiale, l'abolition du travail salarié et la création du nouvel ordre communiste, ou l'enfoncement dans le chaos et la barbarie. Le texte ne sous-estime pas l'ampleur de la tâche que doit accomplir le prolétariat : « La réalisation de l'ordre social communiste est la tâche la plus impérieuse qui soit jamais échue à une classe et à une révolution dans toute l'histoire du monde. Cette tâche implique un complet renversement de l'Etat, une subversion générale de toutes les bases économiques et sociales du monde actuel. » Ce changement ne peut être accompli par « des décrets d'une administration quelconque, d'une commission ou d'un parlement. » Les révolutions précédentes avaient pu être assumées par une minorité, tandis que « la révolution socialiste est la première qui ne puisse être menée à la victoire que dans l'intérêt de la grande majorité et par l'action de la grande majorité des travailleurs. » Les ouvriers, organisés en conseils, devaient prendre en main l'ensemble de cette immense transformation sociale, économique et politique.
De plus, tout en faisant appel à la « main de fer » d'une classe ouvrière auto-organisée et armée pour abattre les complots et la résistance de la contre-révolution, le préambule défend que la terreur est une méthode étrangère au prolétariat : « La révolution prolétarienne n'implique dans ses buts aucune terreur, elle hait et abhorre le meurtre. Elle n'a pas besoin de verser le sang, car elle ne s'attaque pas aux êtres humains mais aux institutions et aux choses. » Ce rejet de la « terreur rouge » a lui-même été très critiqué par d'autres communistes, à l'époque et aujourd'hui encore. Rosa Luxemburg, qui a écrit le projet et qui avait porté des critiques similaires à la terreur rouge en cours en Russie, a été accusée de pacifisme, de défendre une politique qui désarmait le prolétariat face à la contre-révolution. Mais le préambule ne révèle aucune illusion naïve sur la possibilité de faire la révolution sans rencontrer et donc supprimer la résistance féroce de l'ancienne classe dominante qui « transformera plutôt le pays en un tas de ruines fumantes qu'elle ne renoncera de bon gré à l'esclavage du salariat. » Ce que fait le projet de programme par contre, c'est nous permettre de comprendre la différence entre la violence de classe – basée sur l'auto-organisation massive du prolétariat – et la terreur d'Etat qui, elle, est nécessairement menée par un corps minoritaire spécialisé et qui présente toujours le danger de se retourner contre le prolétariat. Nous reviendrons plus tard sur cette question mais nous pouvons certainement dire ici, en cohérence avec les arguments développés dans notre texte « Terrorisme, terreur et violence de classe » ([6] [3337]), que l'expérience de la révolution russe a tout-à-fait confirmé la validité de cette distinction.
Les mesures immédiates qui suivent le préambule concrétisent la perspective générale. Nous les reproduisons ici intégralement :
« A) Mesures immédiates d'auto-protection de la révolution
- 1. Désarmement de toute la police, de tous les officiers et des soldats non-prolétariens. Désarmement de tous ceux qui s'apparentent aux classes dominantes.
- 2. Réquisition de tous les dépôts d'armes et de munitions ainsi que des entreprises d'approvisionnement par la main des conseils d'ouvriers et soldats.
- 3. Armement de toute la population prolétarienne mâle et adulte comme milice ouvrière. Formation d'une garde prolétarienne des conseils comme partie active de la milice chargée de défendre la révolution en permanence contre les coups de force et les traîtrises de la réaction.
- 4. Dans l'armée, suppression du pouvoir de commandement des officiers et sous-officiers. Les hommes de troupe leur substituent des chefs élus et constamment révocables. Suppression de l'obéissance militaire passive et de la justice militaire. Discipline librement consentie.
- 5. Exclusion des officiers et des capitulards hors de tous les conseils de soldats.
- 6. Suppression de tous les organes politiques et administratifs de l'ancien régime auxquels se substituent les hommes de confiance des conseils d'ouvriers et de soldats.
- 7. Création d'un tribunal révolutionnaire qui jugera en dernière instance les principaux responsables de la guerre et de sa prolongation, les deux Hohenzollern, Ludendorf, Hindenbourg, Tirpitz et leurs complices, de même que tous les conspirateurs de la contre-révolution.
- 8. Réquisition immédiate de tous les moyens de subsistance pour assurer l'alimentation du peuple.
B) Premières mesures sur le plan politique et social.
- 1. Liquidation des Etats isolés dans le Reich ; république socialiste une et indivisible.
- 2. Suppression de tous les parlements et de toutes les municipalités. Leurs fonctions seront assumées par les conseils d'ouvriers et de soldats et par les comités et organes qui en relèvent.
- 3. Elections des conseils d'ouvriers dans toute l'Allemagne, avec la participation de toute la population ouvrière des deux sexes, à la ville et à la campagne, sur la base de l'entreprise. De même, élections des conseils de soldats par les hommes de troupe, à l'exclusion des officiers et des capitulards. Droit pour les ouvriers et soldats de révoquer en tout temps leurs délégués.
- 4. Election par les délégués des conseils d'ouvriers et de soldats de toute l'Allemagne d'un conseil central des conseils, qui aura à nommer dans son sein une délégation exécutive comme instance suprême du pouvoir à la fois législatif et administratif.
- 5. Réunion du conseil central des conseils, au moins tous les trois mois pour commencer, avec chaque fois complète réelection des membres de façon à maintenir un contrôle permanent sur l'activité de l'exécutif et un contact vivant entre les masses des conseils d'ouvriers et de soldats dans le pays et le plus haut organe de leur pouvoir. Droit pour les conseils d'ouvriers et de soldats de révoquer et de remplacer à tout moment leurs représentants au conseil central au cas où ceux-ci ne se conduiraient pas dans le sens de leurs mandants. Droit pour l'exécutif de nommer et de révoquer les commissaires du peuple et toute l'administration centrale, sous le contrôle du conseil central.
- 6. Abolition de tous les privilèges, ordres et titres. Egalité complète des sexes devant la loi et devant la société.
- 7. Introduction des lois sociales décisives, raccourcissement de la journée de travail en vue de remédier au chômage et de tenir compte de l'affaiblissement corporel des ouvriers pendant la guerre mondiale. Journée de travail de six heures au maximum.
- 8. Transformation immédiate des conditions d'alimentation, d'habitation, d'hygiène et d'éducation dans le sens et l'esprit de la révolution prolétarienne.
C) Revendications économiques immédiates.
- 1. Confisquer toutes les fortunes et revenus dynastiques au profit de la collectivité.
- 2. Annuler toutes les dettes d'Etat et toutes les autres dettes publiques, de même que tous les emprunts de guerre, à l'exception des souscriptions inférieures à un certain niveau que fixera le conseil central des conseils d'ouvriers et de soldats.
- 3. Exproprier la propriété foncière de toutes les entreprises agraires grosses et moyennes ; former des coopératives agricoles socialistes avec une direction unifiée et centralisée pour tout le pays; les petites entreprises paysannes resteront entre les mains des exploitants jusqu'à ce que ceux-ci se rattachent volontairement aux coopératives socialistes.
- 4. Suppression de tous droits privés sur les banques, les mines et carrières, et toutes les autres entreprises importantes de l'industrie et du commerce, au profit de la république des conseils.
- 5. Exproprier toutes les fortunes à partir d'un certain niveau qui sera fixé par le conseil central des conseils d'ouvriers et de soldats.
- 6. La république des conseils s'empare de l'ensemble des transports publics.
- 7. Election dans chaque usine d'un conseil d'usine qui aura à régler les affaires intérieures en accord avec les conseils d'ouvriers, à fixer les conditions de travail, à contrôler la production, et finalement à se substituer complètement à la direction de l'entreprise.
- 8. Formation d'une commission centrale de grève, groupant les délégués des conseils d'usines engagés dans le mouvement gréviste à travers tout le pays. Cette commission aura à coordonner la direction des grèves en face de l'Etat et du capital, et à leur assurer le soutien extrêmement énergique de l'arme politique des conseils d'ouvriers et de soldats.
D) Tâches internationales.
Reprise immédiate des relations avec les prolétaires de l'étranger, pour poser la révolution socialiste sur une base internationale et pour imposer et maintenir la paix par la fraternisation et le soulèvement révolutionnaire du prolétariat dans chaque pays. »
Ces mesures, dans leur essence, restent des poteaux indicateurs valables pour la période révolutionnaire du futur quand le prolétariat sera une fois de plus au bord de la prise du pouvoir. Le programme a pleinement raison d'insister sur la priorité des tâches politiques de la révolution, et parmi elles, sur l'urgence absolue d'armer les ouvriers et de désarmer la contre-révolution. Tout aussi importante est l'insistance sur le rôle fondamental des conseils ouvriers en tant qu'organes du pouvoir politique prolétarien et sur le caractère centralisé de ce pouvoir. En appelant au pouvoir des conseils et au démantèlement de l'Etat bourgeois, ce programme était déjà le fruit de la gigantesque expérience prolétarienne en Russie. En même temps, sur la question du parlement et des conseils municipaux, le KPD a fait un pas de plus que les bolcheviks en 1917, quand il existait encore une confusion dans le parti sur la coexistence possible des soviets, de l'Assemblée constituante et des doumas municipales. Dans le programme du KPD, tous ces organes de l'Etat bourgeois doivent être démantelés sans délai. De même, le programme du KPD ne confère aucun rôle aux syndicats à côté des conseils ouvriers et des gardes rouges ; les comités d'usine sont les seuls autres organes ouvriers qu'il mentionne. Bien qu'il y ait eu des divergences dans le parti sur ces deux dernières questions, la clarté du programme de 1918 était l'expression directe de l'élan révolutionnaire qui animait le mouvement de la classe à cette époque.
Le programme est aussi étonnamment clair sur les mesures sociales et économiques immédiates d'un pouvoir prolétarien : expropriation de l'appareil de base de production, de distribution et de communication, organisation de l'approvisionnement de la population, réduction de la journée de travail, etc. Bien que ses premières tâches soient fondamentalement politiques, le prolétariat victorieux est immédiatement confronté à la nécessité d'oeuvrer aussi sur le terrain économique et social puisqu'il est seul capable de sauver la société de la désintégration et du chaos qui résulte de l'effondrement du capitalisme.
Inévitablement, certains éléments du programme étaient spécifiques à la forme prise par cet effondrement en 1918 : la guerre impérialiste et ses suites. D'où l'importance accordée aux questions des conseils de soldats, de la réorganisation de l'armée, questions qui n'auraient pas la même signification dans une période où la situation révolutionnaire est le résultat direct de la crise économique comme ce sera probablement le cas dans le futur. Plus important : il était inévitable qu'un programme formulé au commencement d'une grande expérience révolutionnaire contienne des faiblesses et des lacunes, précisément parce que tant de leçons cruciales ne pouvaient être apprises que dans la vie, à travers cette expérience même. Il est indispensable de noter que ces faiblesses étaient communes à l'ensemble du mouvement ouvrier international et n'étaient pas, contrairement à ce qui est si souvent proclamé, limitées au parti bolchevik qui, parce qu'il a été le seul à confronter les problèmes concrets de l'organisation de la dictature du prolétariat, a souffert le plus cruellement des conséquences de ces faiblesses.
Ainsi, si le programme parle de « nationalisation » et si Rosa Luxemburg dans son discours introductif semble supposer que les mesures économiques soulignées dans le Manifeste communiste restent un point de départ valable pour la transformation socialiste ([7] [3338]), c'est certainement parce que l'amère expérience de la révolution russe n'avait pas encore mis fin à l'illusion que le capitalisme d'Etat pouvait d'une façon ou d'une autre être transformé en socialisme. Le programme ne pouvait pas non plus résoudre le problème des rapports entre les conseils ouvriers et les organes étatiques de la période de transition. La nécessité de faire une distinction entre les deux n'a été mise en évidence que par les fractions de la Gauche communiste après une réflexion approfondie sur les leçons de la dégénérescence de la révolution. Il en est de même pour la question du parti. Contrairement à l'affirmation de Robert Camoin citée plus haut, le programme n'ignore nullement le rôle du parti. Pour commencer, sous l'aspect le plus positif, c'est un document de « parti politique » du début à la fin, exprimant une compréhension réelle, pratique, du rôle du parti dans la révolution. Sous l'aspect négatif, malgré toutes les insistances répétées du programme sur le fait que la dictature du prolétariat et la construction du socialisme ne peuvent être que l'oeuvre des masses ouvrières elles-mêmes, la partie finale du programme montre que le KPD, comme les bolcheviks, n'avait pas encore dépassé la notion parlementaire selon laquelle le parti prend le pouvoir au nom de la classe : « La Ligue Spartacus se refuse à participer au pouvoir gouvernemental côte à côte avec les hommes de paille de la bourgeoisie, les Ebert-Scheidemann. (...) La Ligue Spartacus se refusera de même à accéder au pouvoir à la place des dirigeants actuels, lorsque Scheidemann-Ebert auront fait leur temps et par la simple raison que les Indépendants, par leur politique de collaboration, se seraient perdu dans l'impasse. Il décline de devenir leur associé ou de leur succéder.
Si Spartacus s'empare du pouvoir, ce sera sous la forme de la volonté claire, indubitable de la grande majorité des masses prolétariennes dans toute l'Allemagne, et pas autrement que comme la force de leur consciente adhésion aux perspectives, aux buts et aux méthodes de lutte propagées par la Ligue Spartacus. » Ce passage contient le même esprit prolétarien qui traverse l'oeuvre de Lénine d'avril à octobre 1917 : le rejet du putschisme, l'insistance absolue sur le fait que le parti ne peut appeler à la prise du pouvoir tant que la masse du prolétariat n'a pas été gagnée à son programme. Mais, comme les bolcheviks, les spartakistes avaient l'idée que le parti qui a la majorité dans les conseils, devient alors le parti du gouvernement – conception qui devait avoir de très sérieuses conséquences une fois que l'élan révolutionnaire eût reflué. Mais ce qui paraît le plus étonnant, c'est la pauvreté de la partie traitant de la révolution internationale. La partie « Tâches internationales » donne, en effet, l'impression d'avoir été ajoutée après coup ; elle est extrêmement vague sur l'attitude du prolétariat envers la guerre impérialiste et l'extension internationale de la révolution, même s'il est clair que sans une telle extension tout soulèvement révolutionnaire dans un seul pays est condamné à l'échec. ([8] [3339])
Malgré leur importance, aucune de ces faiblesses n'était critique. Elles auraient pu être surmontées si la dynamique révolutionnaire s'était poursuivie. Ce qui était critique, c'était l'immaturité du prolétariat allemand, son défaut de la cuirasse qui l'a rendu vulnérable aux sirènes de la social-démocratie et a permis qu'il se fasse battre, paquet par paquet, dans une série de soulèvements isolés, alors qu'il aurait dû concentrer et centraliser ses forces pour mener l'assaut contre le pouvoir bourgeois. Mais c'est une question que nous avons déjà traitée par ailleurs.
Le prochain article de cette série nous amène à l'année 1919, le zénith de la révolution mondiale, et à l'examen de la plate-forme de l'Internationale Communiste, ainsi que de celle du Parti communiste de Russie où la dictature du prolétariat n'a pas été une simple revendication mais une réalité pratique.
CDW
[8] [3347]. Il vaut la peine de souligner que cette faiblesse, parmi d'autres, a été rectifiée de façon substantielle dans le programme du KADI de 1920 : la partie sur les mesures révolutionnaires commence par la proposition qu'une république des conseils en Allemagne fusionne immédiatement avec la Russie soviétique.
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Allemande [1955]
Conscience et organisation:
Approfondir:
Questions théoriques:
- Communisme [492]
Heritage de la Gauche Communiste:
Révolution allemande (IX) : L'action de mars 1921, le danger de l'impatience petite-bourgeoise
- 4631 reads
Dans l'article précédent concernant le putsch de Kapp en 1920, nous avons souligné qu'après avoir subi les défaites de 1919, la classe ouvrière se remet à l'offensive. Mais, au niveau international, la poussée révolutionnaire est en train de décliner.
L'arrêt de la guerre a déjà, dans un grand nombre de pays, calmé les ardeurs révolutionnaires et surtout permis à la bourgeoisie d'exploiter la division entre ouvriers des « pays vainqueurs » et ceux des « pays vaincus ». De plus, les forces du capital parviennent à isoler toujours plus le mouvement révolutionnaire en Russie. Les victoires de l'Armée rouge sur les armées blanches, puissamment soutenues par les démocraties bourgeoises, n'empêchent pas la classe dominante de poursuivre sa contre-offensive au niveau international.
En Russie même l'isolement de la révolution et l'intégration croissante du Parti bolchevik dans l'Etat russe font sentir leurs effets. En mars 1921 les ouvriers et les marins de Cronstadt se révoltent.
Sur cette toile de fond le prolétariat en Allemagne fait preuve d'une plus forte combativité que dans les autres pays. Partout les révolutionnaires se trouvent face à la question : comment réagir face à l'offensive de la bourgeoisie alors que la vague révolutionnaire mondiale est sur le reflux ?
Au sein de l'Internationale communiste (IC) s'opère un tournant politique. Les 21 conditions d'admission adoptées par le 2e Congrès de l'IC de l'été 1920 l'expriment clairement. En particulier celles-ci imposent le travail au sein des syndicats tout comme la participation aux élections parlementaires. L'IC effectue de ce fait un retour aux vieilles méthodes utilisées dans la période d'ascendance du capitalisme, avec l'espoir de toucher ainsi plus largement la classe ouvrière.
Ce tournant opportuniste trouve son expression en Allemagne notamment dans la Lettre ouverte adressée par le KPD, en janvier 1921, aux syndicats, au SPD comme à la FAU (anarcho-syndicaliste), au KAPD et à l'USPD proposant « à l'ensemble des partis socialistes et des organisations syndicales, de mener des actions communes pour imposer les revendications politiques et économiques les plus urgentes de la classe ouvrière ». Cet appel qui s'adresse plus particulièrement aux syndicats et au SPD, va engendrer le « front unique ouvrier dans les usines ». « Le VKPD veut mettre de côté le souvenir de la responsabilité sanglante des dirigeants sociaux-démocrates majoritaires. Il veut mettre de côté le souvenir des services rendus par la bureaucratie syndicale aux capitalistes pendant la guerre et au cours de la révolution. » (Offener Brief, Die Rote Fahne, 8 janvier 1921) Par des flatteries opportunistes, le parti communiste cherche à attirer de son côté des parties de la social-démocratie. Simultanément, il théorise, pour la première fois, la nécessité d'une offensive prolétarienne : « Si les partis et syndicats auxquels nous nous adressons devaient se refuser à entamer la lutte, le Parti communiste allemand unifié s'estimerait alors contraint de la mener seul, et il est convaincu que les masses le suivraient. » (Ibidem)
L'unification entre le KPD et l'USPD, réalisée en décembre 1920 et qui a permis la fondation du VKPD, a remis en selle la conception du parti de masse. Cela est renforcé par le fait que le parti compte désormais plus de 500 000 membres. C'est ainsi que le VKPD se laisse aveugler par le pourcentage de voix qu'il obtient lors des élections au Landtag de Prusse en février 1921 où il recueille pratiquement 30 % des suffrages. ([1] [3348])
Ainsi se répand, en son sein, l'idée qu'il a la capacité de « chauffer » la situation en Allemagne. Beaucoup se prennent à rêver d'un nouveau putsch d'extrême-droite, comme celui qui s'est produit un an auparavant, qui provoquerait un soulèvement ouvrier avec des perspectives de prise de pouvoir. De telles visions sont dues, pour l'essentiel, à l'influence renforcée de la petite bourgeoisie dans le parti depuis l'unification du KPD et de l'USPD. L'USPD, comme tout courant centriste au sein du mouvement ouvrier, est fortement influencé par les conceptions et les comportements de la petite-bourgeoisie. De plus, l'accroissement numérique du parti tend à accentuer le poids de l'opportunisme ainsi que celui de l'immédiatisme et de l'impatience petit-bourgeois.
C'est dans le contexte de reflux de la vague révolutionnaire au niveau international, s'accompagnant en Allemagne d'une profonde confusion au sein du mouvement révolutionnaire, que la bourgeoisie lance une nouvelle offensive contre le prolétariat en mars 1921. Ce sont les ouvriers de l'Allemagne centrale qui vont constituer la cible principale de cette attaque. Une grande concentration prolétarienne s'était constituée, au cours de la guerre, dans cette région autour des usines Leuna à Bitterfeld ainsi que dans le bassin de Mansfeld. La majorité des ouvriers y est relativement jeune et combative mais ne dispose d'aucune grande expérience d'organisation. A lui seul le VKPD y compte 66 000 membres, le KAPD 3 200. Dans les usines Leuna 2 000 des 20 000 ouvriers font partie des Unions Ouvrières.
Dans la mesure où, suite aux affrontements de 1919 et au putsch de Kapp, de nombreux ouvriers sont restés en possession de leurs armes, la bourgeoisie a la volonté de pacifier la région.
La bourgeoisie cherche à provoquer les ouvriers
Le 19 mars 1921, de fortes troupes de police investissent Mansfeld afin d'effectuer le désarmement des ouvriers.
Cet ordre ne provient pas de l'aile d'extrême-droite de la classe dominante (au sein de l'armée ou des partis de droite) mais du gouvernement démocratiquement élu. C'est encore une fois la démocratie qui joue le rôle de bourreau de la classe ouvrière cherchant à la terrasser par tous les moyens.
Il s'agit pour la bourgeoisie, à travers le désarmement et la défaite d'une fraction relativement jeune et très combative du prolétariat allemand, d'affaiblir et de démoraliser la classe ouvrière dans son ensemble. Plus particulièrement, la classe dominante poursuit l'objectif d'asséner un coup effroyable à l'avant-garde de la classe ouvrière, ses organisations révolutionnaires. Contraindre à une lutte décisive prématurée en Allemagne centrale doit fournir à l'État l'occasion d'isoler les communistes de l'ensemble de la classe ouvrière. Elle cherche à jeter le discrédit sur eux pour ensuite les soumettre à la répression. Il s'agit de retirer au VKPD fraîchement fondé toute possibilité de se consolider tout autant que d'anéantir le rapprochement en cours entre le VKPD et le KAPD. Le capital allemand agit de toutes façons au nom de la bourgeoisie mondiale pour accroître l'isolement de la révolution russe et affaiblir l'IC.
L'Internationale, au même moment, attend avec impatience des mouvements de lutte qui viendraient soutenir de l'extérieur la révolution russe. On attend, en quelque sorte, que se produise une offensive de la bourgeoisie pour que la classe ouvrière, mise en situation difficile, réagisse avec force. Des attentats, comme celui qui est perpétré par le KAPD contre la colonne de la Victoire à Berlin le 13 mars, ont manifestement pour objectif de provoquer un développement de la combativité.
Lévi rapporte ainsi l'intervention de l'envoyé de Moscou, Rakosi, au cours d'une séance de la Centrale : « Le camarade expliquait : la Russie se trouve dans une situation extraordinairement difficile. Il serait absolument nécessaire que la Russie soit soulagée par des mouvements en Occident et, sur cette base, le Parti allemand devrait immédiatement passer à l'action. Le VKPD comptait aujourd'hui 50 000 adhérents et, avec cela, on pouvait dresser 1 500 000 prolétaires, ce qui suffisait pour renverser le gouvernement. Il était donc pour engager immédiatement le combat avec le mot d'ordre de renversement du gouvernement. » (P. Lévi, Lettre à Lénine, 27 mars 1921)
« Le 17 mars se tint la séance du Comité central du KPD au cours de laquelle l'impulsion ou les directives du camarade envoyé de Moscou furent adoptées comme thèses d'orientation. Le 18 mars Die Rote Fahne s'aligne sur la nouvelle résolution et appelle à la lutte armée sans dire préalablement pour quels objectifs et conserve le même ton durant quelques jours. » (Ibidem)
L'offensive du gouvernement tant attendue s'ouvre en mars 1921 avec l'engagement des troupes de police en Allemagne centrale.
Forcer la révolution ?
Les forces de police envoyées le 19 mars en Allemagne centrale par le ministre social-démocrate Hörsing ont pour ordre d'entreprendre des perquisitions dans les domiciles afin de désarmer à tout prix les ouvriers. L'expérience du putsch de Kapp a dissuadé le gouvernement d'engager les soldats de la Reichswehr.
La même nuit la grève générale est décidée dans la région à partir du 21 mars. Le 23 mars, se produisent les premiers affrontements entre les troupes de la police de sécurité du Reich (SiPo) et les ouvriers. Le même jour, les ouvriers de l'usine Leuna de Merseburg proclament la grève générale. Le 24 mars le KAPD et le VKPD lancent un appel commun à la grève générale dans toute l'Allemagne. En réponse à celui-ci, des manifestations et des fusillades entre des grévistes et la police se produisent sporadiquement dans plusieurs villes d'Allemagne. 300 000 ouvriers environ participent à la grève dans tout le pays.
Le principal lieu d'affrontement reste cependant la région industrielle d'Allemagne centrale où prés de 40 000 ouvriers et 17 000 soldats de la Reichswehr et de la police se font face. Dans les usines Leuna, 17 centuries prolétariennes armées sont mises sur pied. Les troupes de police mettent tout en oeuvre pour les prendre d'assaut. Ce n'est qu'après plusieurs jours qu'elles réussissent à conquérir l'usine. Pour ce faire, le gouvernement a même recours à l'aviation qui bombarde l'usine. Tous les moyens sont bons contre la classe ouvrière.
A l'initiative du KAPD et du VKPD, des attentats à la dynamite sont commis à Dresde, Freiberg, Leipzig, Plauen et ailleurs. Les journaux Hallische Zeitung et Saale Zeitung qui agissent de façon particulièrement provocatrice contre les ouvriers sont réduits au silence à l'explosif.
Alors que la répression en Allemagne centrale entraîne spontanément les ouvriers à la résistance armée, ils ne parviennent cependant pas à opposer une riposte coordonnée aux sbires du gouvernement. Les organisations de combat mises sur pied par le VKPD et dirigées par H. Eberlein sont militairement et organisationnellement mal préparées. Max Hölz, à la tête d'une troupe de combat ouvrière forte de 2 500 hommes, réussit à parvenir à quelques kilomètres de l'usine Leuna assiégée par les troupes gouvernementales et tente de réorganiser les forces. Ses troupes sont exterminées le 1er avril, deux jours après la prise d'assaut des usines Leuna. Bien que la combativité, dans les autres villes, ne s'exprime pas, le VKPD et le KAPD appellent à la riposte armée immédiate contre les forces de police : « La classe ouvrière est conviée à entrer en lutte active pour les objectifs suivants :
1° le renversement du gouvernement (...),
2° le désarmement de la contre-révolution et l'armement des ouvriers. » (Appel du 17 mars 1921)
Dans un autre appel du 24 mars, la Centrale du VKPD lance aux ouvriers : « Pensez que l'année dernière vous avez vaincu en cinq jours les gardes blancs et la racaille des Corps Francs du Baltikum grâce à la grève générale et au soulèvement armé. Luttez avec nous comme l'année dernière au coude à coude pour abattre la contre-révolution ! Entrez partout en grève générale ! Brisez par la violence la violence de la contre-révolution ! Désarmement de la contre-révolution, armement et formation de milices locales à partir des cellules des ouvriers, des employés et des fonctionnaires organisés !
Formez immédiatement des milices locales prolétariennes ! Assurez vous du pouvoir dans les usines ! Organisez la production à travers les conseils d'usine et les syndicats ! Créez du travail pour les chômeurs ! »
Cependant, localement les organisations de combat du VKPD ainsi que les ouvriers qui se sont spontanément armés ne sont pas seulement mal préparés, mais les instances locales du parti sont aussi sans contact avec la Centrale. Les différents groupes de combat dont les plus connus sont ceux de Max Hölz et de Karl Plättner, combattent en différents lieux de la zone d'insurrection, isolés les uns des autres. Nulle part il n'y a des conseils ouvriers qui puissent coordonner leurs actions. En revanche, les troupes gouvernementales de la bourgeoisie se trouvent, elles, en contact étroit avec le grand quartier général qui les dirige !
Après la chute des usines Leuna, le VKPD retire son appel à la grève générale le 31 mars. Le 1er avril, les derniers groupes ouvriers armés d'Allemagne centrale se dissolvent.
L'ordre bourgeois règne à nouveau ! A nouveau la répression se déchaîne. A nouveau de nombreux ouvriers sont soumis aux brutalités de la police. Des centaines d'entre eux sont passés par les armes, plus de 6 000 sont arrêtés.
L'espoir de la grande majorité du VKPD et du KAPD, selon lequel une action provocatrice de la part de l'appareil de répression de l'Etat déclencherait une puissante dynamique de riposte dans les rangs ouvriers, s'est effondré. Les ouvriers d'Allemagne centrale sont restés isolés.
Le VKPD et le KAPD ont manifestement poussé au combat sans tenir compte de l'ensemble de la situation, de telle manière qu'ils se sont complètement éloignés des ouvriers hésitants, qui n'étaient pas prêts à entrer dans l'action, et ils ont créé une division au sein de la classe ouvrière en adoptant la devise « Qui n'est pas avec moi est contre moi. » (éditorial de Die Rote Fahne du 20 mars)
Au lieu de reconnaître que la situation n'était pas favorable, Die Rote Fahne écrit : « Ce n'est pas seulement sur la tête de vos dirigeants, mais c'est sur la tête de chacun d'entre vous que repose la responsabilité sanglante lorsque vous tolérez en silence ou en protestant sans agir que les Ebert, Severing, Hörsing abattent la terreur et la justice blanches contre les ouvriers. (...) Honte et ignominie à l'ouvrier qui reste à l'écart, honte et ignominie à l'ouvrier qui ne sait pas encore où est sa place. »
Afin de provoquer artificiellement la combativité, on a cherché à engager les chômeurs comme fer de lance. « Les chômeurs ont été envoyés en avant comme détachement d'assaut. Ils ont occupé les portes des usines. Ils les ont forcées pour entrer à l'intérieur, éteindre les feux ici ou là et tenter de faire sortir les ouvriers à coups de poing hors des usines. (...) Quel spectacle épouvantable de voir les chômeurs se faire éjecter des usines, pleurant bruyamment sous les coups reçus et fuir ensuite ceux qui les avaient envoyés là-bas. »
Que le VKPD, dès avant le début des luttes, ait eu une fausse appréciation du rapport de forces, et qu'après le déclenchement des luttes il n'ait pas été capable de réviser son analyse est déjà suffisamment tragique. Malheureusement, il fait pire en lançant le mot d'ordre : « A la vie ou à la mort » selon le faux principe que les communistes ne reculent jamais !
« En aucun cas un, communiste, même s'il se trouve en minorité, ne doit se rendre au travail. Les Communistes ont quitté les usines. Par groupes de 200, 300 hommes, parfois davantage, parfois moins, ils sont sortis des usines : l'usine a continué à fonctionner. Ils sont aujourd'hui chômeurs, les patrons ayant saisi l'occasion d'épurer les usines des communistes à un moment où ils avaient une grande partie des ouvriers de leur côté. » (Lévi, ibidem)
Quel bilan des luttes de mars ?
Alors que la classe ouvrière se voyait imposer cette lutte par la bourgeoisie, et qu'il lui était impossible de l'éviter, le VKPD « commit une série de fautes dont la principale consista en ce que, au lieu de faire clairement ressortir le caractère défensif de cette lutte, par son cri d'offensive, il fournit aux ennemis sans scrupule du prolétariat, à la bourgeoisie, au parti social-démocrate et au parti indépendant, un prétexte pour dénoncer le parti unifié comme un fauteur de putsch. Cette faute fut encore exagérée par un certain nombre de camarades du parti, présentant l'offensive comme la méthode de lutte essentielle du Parti communiste unifié d'Allemagne dans la situation actuelle. » (Thèse sur la tactique, 3e Congrès de l'IC, juin 1921, Manifestes, thèses et résolutions des quatre premiers congrès mondiaux de l'Internationale Communiste)
Que les communistes interviennent pour renforcer la combativité est le premier de leurs devoirs. Mais ils n'ont pas à le faire à n'importe quel prix.
« Pratiquement, les communistes sont donc la fraction la plus résolue des partis ouvriers de tous les pays, la fraction qui entraîne toutes les autres : théoriquement, ils ont sur le reste du prolétariat l'avantage d'une intelligence claire des conditions, de la marche et des fins générales du mouvement prolétarien. » (Marx-Engels, Le Manifeste du Parti communiste, 1848) C'est pourquoi les communistes doivent se caractériser vis-à-vis de la classe dans son ensemble par leur capacité à analyser correctement le rapport de forces entre les classes, à percer à jour la stratégie de l'ennemi de classe. Pousser une classe faible ou insuffisamment préparée à des combats décisifs comme la faire tomber dans les pièges tendus par la bourgeoisie, c'est ce que les révolutionnaires peuvent faire de plus irresponsable. Leur première responsabilité est de développer leur capacité d'analyse de l'état de la conscience et de la combativité au sein de la classe ainsi que de la stratégie adoptée par la classe dominante. Ce n'est qu'ainsi que les organisations révolutionnaires prennent véritablement en charge leur rôle dirigeant dans la classe.
Aussitôt après l'Action de mars, de violents débats se développent au sein du VKPD et du KAPD.
Les conceptions organisationnelles fausses : un obstacle à la capacité du Parti à faire son autocritique
Dans un article d'orientation du 4-6 avril 1921, Die Rote Fahne affirme que « Le VKPD a inauguré une offensive révolutionnaire » et que l'Action de mars constitue « le début, le premier épisode des luttes décisives pour le pouvoir. »
Les 7 et 8 avril, son Comité Central se réunit et au lieu de se livrer à une analyse critique de l'intervention, Heinrich Brandler cherche avant tout à justifier la politique du parti. Pour lui, la principale faiblesse réside dans un manque de discipline des militants locaux du VKPD et dans la défaillance de l'organisation militaire. Il déclare : « Nous n'avons souffert aucune défaite, c'était une offensive. »
Vis-à-vis de cette analyse Paul Lévi, s'élève comme le critique le plus virulent contre l'attitude du parti durant l'Action de mars.
Après avoir démissionné du Comité Central en février 1921 aux côtés de Clara Zetkin, à cause, entre autres, de divergences concernant la fondation du Parti Communiste d'Italie, il va, une fois encore, se révéler incapable de faire avancer l'organisation par la critique. Le plus tragique, « c'est que Lévi a au fond raison sur bien des points dans sa critique de l'Action de mars 1921 en Allemagne. » (Lénine, Lettre aux communistes allemands, 14 août 1921, Oeuvres, tome 32) Mais au lieu de faire sa critique dans le cadre de l'organisation, selon les règles et principes de celle-ci, il rédige les 3 et 4 avril une brochure qu'il publie à l'extérieur dès le 12 avril sans la soumettre préalablement au débat dans le parti. ([2] [3349])
Dans cette brochure, il ne se contente pas de bafouer la discipline organisationnelle, il expose aussi des détails concernant la vie interne du parti. Ce faisant, il brise un principe prolétarien, et même met en péril l'organisation en étalant publiquement son mode de fonctionnement. Il est exclu du parti le 15 avril pour comportement portant atteinte à sa sécurité. ([3] [3350])
Lévi qui inclinait, comme nous l'avons montré dans un article précédent sur le Congrès du KPD d'Heidelberg en octobre 1919, à concevoir toute critique comme une attaque contre l'organisation, mais aussi contre sa propre personne, sabote maintenant tout fonctionnement collectif. Son point de vue le manifeste : « Ou bien l'Action de mars était valable et alors ma place est d'être exclu (du Parti). Ou bien l'Action de mars était une erreur et alors ma brochure est justifiée. » (Lévi, Lettre à la Centrale du VKPD). Cette attitude dommageable pour l'organisation a été critiquée de façon répétée par Lénine. Après l'annonce de la démission de Lévi de la Centrale du VKPD en février, il écrit à ce sujet : « Et la démission du Comité central !!?? C'est là, en tout état de cause, la plus grande des erreurs. Si nous tolérons des façons de faire telles que les membres du Comité central en démissionnent dès qu'ils s'y trouvent en minorité, le développement et l'assainissement des partis communistes ne suivront jamais un cours normal. Au lieu de démissionner, il vaudrait mieux discuter à plusieurs reprises des questions litigieuses conjointement avec le Comité exécutif. (...) Il est indispensable de faire tout le possible et même l'impossible – mais, coûte que coûte, éviter les démissions et ne pas aggraver les divergences. » (Lénine, Lettre à Clara Zetkin et à Paul Lévi, le 16 avril 1921, Oeuvres, tome 45)
Les accusations, en partie exagérées, dont Lévi charge le VKPD (qui est pratiquement vu comme l'unique fautif, mettant de côté la responsabilité de la bourgeoisie dans la déclenchement des luttes de mars) s'appuient sur une vision quelque peu déformée de la réalité.
Après son exclusion du parti, Lévi édite pendant une courte période la revue Le Soviet qui devient le porte-parole de ceux qui s'opposent à la direction prise par le VKPD.
Lévi cherche à exposer sa critique à la tactique du VKPD devant le Comité central qui refuse de l'admettre à ses séances. C'est Clara Zetkin qui le fait à sa place. Il défend que « les communistes n'ont pas la possibilité (...) d'entreprendre des actions à la place du prolétariat, sans le prolétariat et à la fin, même, contre le prolétariat. » (Lévi, ibidem) Clara Zetkin propose alors une contre-résolution à la prise de position du parti. Mais la séance du Comité central rejette majoritairement la critique et souligne que « s'esquiver face à l'action (...) était impossible pour un Parti révolutionnaire et aurait constitué un renoncement pur et simple à sa vocation de diriger la révolution. » Le VKPD « doit, s'il veut remplir sa tâche historique, se tenir fermement à la ligne de l'offensive révolutionnaire, qui se trouve au fondement de l'Action de mars et marcher dans cette voie avec détermination et confiance. » (« Leitsätze über die Märzaktion », Die Internationale n°4, avril 1921)
La Centrale persiste dans la poursuite de la tactique de l'offensive dans laquelle elle s'est engagée et rejette toutes les critiques. Dans une proclamation du 6 avril 1921 le Comité exécutif de l'IC (CEIC) approuve l'attitude du KPD et lance : « L'Internationale Communiste vous dit : "Vous avez bien agi." (...) Préparez-vous à de nouveaux combats. » (publié dans Die Rote Fahne du 14 avril 1921)
C'est ainsi que lors du 3e Congrès mondial de l'IC, des désaccords sur l'analyse des événements en Allemagne s'expriment. En particulier le groupe autour de Zetkin dans le VKPD est fortement attaqué dans la première partie de la discussion. Ce sont les interventions et l'autorité de Lénine et Trotsky qui amènent un tournant dans les débats en refroidissant les têtes chaudes.
Lénine, absorbé par les événements de Cronstadt et la conduite des affaires de l'Etat, n'a pas eu le temps de suivre les événements d'Allemagne non plus que les débats sur le bilan à en tirer. Il commence à peine à s'y intéresser de près. D'un côté, il rejette la rupture de la discipline par Lévi avec la plus extrême fermeté, de l'autre, il annonce que l'Action de mars, du fait « de l'importance de sa signification internationale, doit être soumise au 3e Congrès de l'Internationale Communiste. » Que la discussion au sein du parti soit la plus large possible et sans entrave, tel est le souci de Lénine.
W. Koenen, le représentant du VKPD auprès du CEIC, est envoyé en Allemagne par celui-ci pour faire que le Comité central du parti ne prenne pas une décision définitive contre l'opposition. Dans la presse du Parti, les critiques de l'Action de mars retrouvent la possibilité de s'exprimer. La discussion sur la tactique se poursuit.
Cependant, la majorité de la Centrale continue à défendre la prise de position adoptée en mars. Arkady Maslow réclame une nouvelle approbation de l'Action de mars. Gouralski, un envoyé du CEIC déclare même : « Ne nous préoccupons pas du passé. Les prochaines luttes politiques du Parti sont la meilleure réponse aux attaques de la tendance Lévi. » A la séance du Comité central des 3 et 5 mai Thalheimer intervient pour que l'on reprenne l'unité d'action des ouvriers. F. Heckert plaide pour renforcer le travail dans les syndicats.
Le 13 mai, Die Rote Fahne publie des Thèses qui développent l'objectif d'accélérer artificiellement le processus révolutionnaire. L'Action de mars y est citée en exemple. Les communistes « doivent, dans des situations particulièrement graves où les intérêts essentiels du prolétariat se trouvent menacés, précéder d'un pas les masses et chercher de par leur initiative à les engager dans la lutte, même au risque de n'être suivi que par une partie de la classe ouvrière. » W. Pieck qui, en janvier 1919, s'était jeté dans l'insurrection avec K. Liebknecht en allant à l'encontre de la décision du Parti, pense que les affrontements au sein de la classe ouvrière « se produiront encore plus fréquemment. Les communistes doivent se tourner contre les ouvriers quand ceux-ci ne suivent pas nos appels. »
La réaction du KAPD
Si le VKPD et le KAPD ont fait un pas en avant en voulant pour la première fois entreprendre des actions communes, malheureusement celles-ci ont lieu dans des conditions défavorables. Le dénominateur commun de la démarche du VKPD et du KAPD dans l'Action de mars est de vouloir porter secours à la classe ouvrière en Russie. Le KAPD défend encore à cette époque la révolution en Russie. Les conseillistes, qui en seront issus, prendront une position opposée.
Cependant l'intervention du KAPD est sujette à des tiraillements. D'un côté la direction lance un appel commun à la grève générale avec le VKPD et envoie deux représentants de la Centrale en Allemagne centrale, F. Jung et F. Rasch, pour soutenir la coordination des actions de combat ; de l'autre, les dirigeants locaux du KAPD, Utzelmann et Prenzlow, sur la base de leur connaissance de la situation dans le bassin industriel de l'Allemagne centrale, tiennent toute tentative de soulèvement pour insensée et ne veulent pas aller plus loin que la grève générale. Ils sont d'ailleurs intervenus auprès des ouvriers de Leuna pour qu'ils demeurent sur le site de l'usine et se préparent à engager une lutte défensive. La direction du KAPD réagit sans concertation avec les instances du parti sur place.
Dès le mouvement terminé, le KAPD se livre à peine à un début d'analyse critique de sa propre intervention. De plus, il développe une analyse contradictoire des événements. Dans une réponse à la brochure de P. Lévi, il met en évidence la problématique fondamentalement erronée qui se trouve à la base de la démarche de la Centrale du VKPD. H. Gorter écrit :
« Le VKPD a, par l'action parlementaire – qui dans les conditions du capitalisme en banqueroute n'a plus d'autre signification que la mystification des masses – détourné le prolétariat de l'action révolutionnaire. Il a rassemblé des centaines de milliers de non-communistes en devenant un "parti de masse". Le VKPD a soutenu les syndicats par sa tactique de création de cellules en leur sein (...) lorsque la révolution allemande, de plus en plus impuissante, recula, lorsque les meilleurs éléments du VKPD de plus en plus insatisfaits eurent commencé à réclamer de passer à l'action – il se décida alors soudain à une grande tentative pour la conquête du pouvoir politique. Voici en quoi elle consista : avant la provocation d'Hörsing et de la SiPo, le VKPD décida une action artificielle d'en haut, sans impulsion spontanée des grandes masses; autrement dit, il adopta la tactique du putsch.
Le Comité exécutif et ses représentants en Allemagne avaient insisté depuis longtemps pour que le Parti frappe et démontre qu'il était un parti vraiment révolutionnaire. Comme si l'essentiel d'une tactique révolutionnaire consistait seulement à frapper de toutes ses forces ! Au contraire, quand au lieu d'affermir la force révolutionnaire du prolétariat, un parti mine cette même force et affaiblit le prolétariat par son soutien au parlement et aux syndicats et qu'après (de tels préparatifs !!), il se résout soudain à frapper en lançant une grande action offensive en faveur de ce même prolétariat qu'il vient ainsi d'affaiblir, il ne peut être question dans tout ceci que d'un putsch. C'est-à-dire d'une action décrétée d'en haut, n'ayant pas sa source dans les masses elles-mêmes, et par conséquent vouée à l'échec dès le départ. Et cette tentative de putsch n'est nullement révolutionnaire ; elle est opportuniste exactement au même titre que le parlementarisme ou la tactique des cellules syndicales. Oui, cette tactique est le revers inévitable du parlementarisme et de la tactique des cellules syndicales, du racolage d'éléments non-communistes, de la politique des chefs substituée à celle des masses, ou mieux encore, à la politique de classe. Cette tactique faible, intrinsèquement corrompue doit fatalement conduire à des putschs. » (Hermann Gorter, « Leçons de l'Action de mars », Postface à la lettre ouverte au camarade Lénine, Der Proletarier, mai 1921)
Ce texte du KAPD met le doigt avec justesse sur la contradiction entre la tactique du front unique qui renforce les illusions des ouvriers vis-à-vis des syndicats et de la social-démocratie, et l'appel simultané et soudain à l'assaut contre l'Etat. Mais, en même temps, dans sa propre analyse, on trouve des contradictions : tandis que, d'un côté, il parle d'une action défensive des ouvriers, de l'autre il caractérise l'Action de mars comme « la première offensive consciente des prolétaires révolutionnaires allemands contre le pouvoir d'Etat bourgeois. » (F. Kool, Die Linke gegen die Parteiherrschaft) A cet égard, le KAPD fait même le constat que « les larges masses ouvrières sont restées neutres, quand ce n'est pas hostiles, vis à vis de l'avant-garde combative. » Lors du congrès extraordinaire du KAPD en septembre 1921, les leçons de l'Action de mars ne sont pas examinées plus avant.
C'est sur cette toile de fond, avec des débats virulents au sein du VKPD et des analyses contradictoires de la part du KAPD, que se tient, à partir de fin juin 1921, le 3e Congrès mondial de l'Internationale Communiste.
L'attitude de l'Internationale face à l'Action de mars
Au sein de l'Internationale, le processus de formation de différentes tendances s'est mis en branle. Le CEIC lui-même n'a pas, vis-à-vis des événements en Allemagne, de position unitaire et ne parle pas d'une seule voix. Depuis longtemps le CEIC est divisé sur l'analyse de la situation en Allemagne. Radek développe envers les positions et le comportement de Lévi de nombreuses critiques dont se sont saisis d'autres membres de la Centrale. Au sein du VKPD, ces critiques ne sont cependant pas exprimées publiquement et ouvertement lors du congrès du parti ou ailleurs
Au lieu de débattre publiquement de l'analyse de la situation, Radek a provoqué ainsi de profonds dégâts dans le fonctionnement du parti. Souvent les critiques ne sont pas exposées fraternellement en toute netteté, mais sous une forme couverte. Souvent ce qui se retrouve au centre des débats, ce ne sont pas les erreurs politiques mais les individus qui en sont responsables. La tendance à la personnalisation des positions politiques s'impose. Au lieu de construire l'unité autour d'une position et d'une méthode, au lieu de lutter comme un corps fonctionnant collectivement, on détruit ainsi de façon complètement irresponsable le tissu organisationnel.
Plus largement les communistes en Allemagne sont eux-mêmes très profondément divisés. D'une part, à ce moment-là, les deux partis, le VKPD et le KAPD, qui font partie de l'IC, s'affrontent le plus violemment sur l'orientation que doit avoir l'organisation.
Vis-à-vis de l'IC, avant l'Action de mars, des parties du VKPD taisent certaines informations concernant la situation ; de même les divergences d'analyse ne sont pas portées à la connaissance de l'IC dans toute leur ampleur.
Au sein de l'IC même, il n'y a pas de réaction véritablement commune ni d'approche unitaire de cette situation. Le soulèvement de Cronstadt monopolise complètement l'attention de la direction du parti bolchevik, l'empêchant de suivre plus en détail la situation en Allemagne. De plus, la manière dont les décisions sont prises au sein du CEIC n'est souvent pas très claire et il en est de même pour les mandats qui sont donnés à des délégations. Justement, concernant l'Allemagne, les mandats de Radek et des autres délégués du CEIC ne semblent pas avoir été déterminés avec beaucoup de clarté. ([4] [3351])
Ainsi, dans cette situation de division croissante notamment au sein du VKPD, les membres du CEIC – en particulier Radek – sont entrés officieusement en contact avec des tendances au sein des deux partis, VKPD et KAPD, pour convenir, à l'insu des organes centraux des deux organisations, des préparatifs en vue de mesures putschistes. Au lieu de pousser les organisations à l'unité, à la mobilisation et à la clarification, on favorise ainsi leur division et on accélère, en leur sein, la tendance à prendre des décisions en dehors des instances responsables. Cette attitude, prise au nom du CEIC favorise ainsi au sein du KAPD et du VKPD le développement de comportements dommageables à l'organisation.
P. Lévi la critique ainsi : « Il était de plus en plus fréquent que les envoyés du CEIC outrepassent leurs pleins pouvoirs, et qu'il se révèle ultérieurement que ces envoyés, pour tel ou tel d'entre eux, n'avaient reçu aucun plein pouvoir. » (Lévi, Unser weg, wider den Putschismus, 3 avril 1921)
Les structures de fonctionnement et de décision définies dans les statuts, aussi bien au sein de l'IC que du VKPD et du KAPD, sont contournées. Lors de l'Action de mars, dans les deux partis, l'appel à la grève générale se fait sans que l'ensemble de l'organisation ne soit impliqué dans la réflexion et dans la décision. En réalité, ce sont les camarades du CEIC qui ont pris contact avec des éléments ou certaines tendances existant au sein de chaque organisation et qui ont poussé à passer à l'action. C'est le parti en tant que tel qui se trouve de cette façon « contourné » !
Ainsi, il est impossible de parvenir à une démarche unitaire de la part de chaque parti respectif et encore moins à une action commune des deux partis.
L'activisme et le putschisme ont en partie pris le dessus dans chacune des deux organisations, accompagnés de comportements individuels très destructeurs pour le parti et la classe dans son ensemble. Chaque tendance commence à mener sa propre politique et à créer ses propres canaux informels et parallèles. Le souci de l'unité du parti, d'un fonctionnement conforme à des statuts est en grande partie perdu.
Bien que l'IC se trouve affaiblie par l'identification croissante du parti bolchevik aux intérêts de l'Etat russe et par le tournant opportuniste de l'adoption de la tactique du Front unique, le 3e Congrès mondial va cependant constituer un moment de critique collective, prolétarienne de l'Action de mars.
Pour le Congrès, le CEIC, avec un souci politique juste sous l'impulsion de Lénine, impose la présence d'une délégation de représentants de l'opposition qui existe au sein du VKPD. Tandis que la délégation de la Centrale du VKPD cherche encore à museler toute critique adressée à l'Action de mars, le Bureau Politique du PCR(b), sur proposition de Lénine, décide : « Comme fondement à cette résolution il faut adopter l'état d'esprit de devoir d'autant plus précisément détailler, mettre en lumière les erreurs concrètes commises par le VKPD au cours de l'Action de mars et d'autant plus énergiquement mettre en garde contre leur répétition. »
Quelle attitude adopter ?
Dans le discours introductif à la discussion sur « La crise économique et les nouvelles tâches de l'Internationale Communiste » Trotsky souligne : « Aujourd'hui, pour la première fois, nous voyons et nous sentons que nous ne sommes pas si immédiatement près du but, la conquête du pouvoir, la révolution mondiale. En 1919, nous disions : "C'est une question de mois." Aujourd'hui, nous disons : "C'est peut-être une question d'années." (...) Le combat sera peut-être de longue durée, il ne progressera pas aussi fiévreusement qu'il serait souhaitable, il sera excessivement difficile et exigera de nombreux sacrifices. » (Trotsky, Procès-verbal du 3e Congrès)
Lénine : « C'est pourquoi le Congrès se devait de faire table rase des illusions de gauche selon lesquelles le développement de la révolution mondiale continuerait à folle allure selon son impétueux tempo de départ sans interruption, nous serions portés par une seconde vague révolutionnaire, et la victoire dépend seulement et uniquement de la volonté du Parti et de son action. » (C. Zetkin, Souvenirs sur Lénine)
La Centrale du VKPD sous la responsabilité de A. Thalheimer et de Bela Kun envoie, pour le Congrès, un projet de Thèses sur la tactique poussant l'IC à s'engager dans une nouvelle phase d'action. Dans une lettre à Zinoviev du 10 juin 1921, Lénine considère que : « Les thèses de Thalheimer et de Béla Kun sont sur le plan politique radicalement fausses. » (Lénine, Lettres, T. 7)
Les partis communistes n'ont nulle part conquis la majorité de la classe ouvrière, non seulement en tant qu'organisation , mais également au niveau des principes du Communisme. C'est pourquoi la tactique de l'IC est la suivante : « Il faut sans cesse et de façon systématique lutter pour gagner la majorité de la classe ouvrière, d'abord à l'intérieur des vieux syndicats. » (Ibidem)
Face au délégué Heckert, Lénine pense que : « La provocation était claire comme le jour. Et, au lieu de mobiliser dans un but défensif les masses ouvrières afin de repousser les attaques de la bourgeoisie et de prouver que vous aviez le droit pour vous, vous avez inventé votre "théorie de l'offensive", théorie absurde qui offre à toutes les autorités policières et réactionnaires la possibilité de vous présenter comme ceux qui ont pris l'initiative de l'agression contre laquelle il s'agissait de défendre le peuple ! » (Heckert, « Mes rencontres avec Lénine », Lénine tel qu'il fut, T. 2)
Bien qu'auparavant Radek ait soutenu l'Action de mars, dans son rapport présenté au nom du CEIC, il parle du caractère contradictoire de l'Action de mars : il loue l'héroïsme des ouvriers qui ont combattu et critique d'autre part la politique erronée de la Centrale du VKPD. Trotsky caractérise l'Action de mars comme une tentative tout à fait malencontreuse qui, « si elle devait se répéter, pourrait vraiment conduire ce bon parti à sa perte. » Il souligne que : « C'est de notre devoir de dire clairement aux ouvriers allemands que nous considérons cette philosophie de l'offensive comme le danger suprême, et que, dans son application pratique, elle constitue le pire crime politique. » (Procès-verbal du 3e congrès)
La délégation du VKPD et les délégués de l'opposition au sein du VKPD spécialement invités s'affrontent lors du Congrès.
Le Congrès est conscient des menaces qui pèsent sur l'unité de ce parti. C'est pourquoi il pousse à un compromis entre la direction et l'opposition du VKPD. L'arrangement suivant est obtenu : « Le Congrès estime que tout morcellement des forces au sein du Parti Communiste Unifié d'Allemagne, toute formation de fractions, sans parler même de scission, constitue le plus grand danger pour l'ensemble du mouvement. » En même temps, la résolution adoptée met en garde contre toute attitude revancharde : « Le Congrès attend de la Direction Centrale du Parti Communiste Unifié d'Allemagne une attitude tolérante à l'égard de l'ancienne opposition, pourvu qu'elle applique loyalement les décisions prises par le 3e Congrès (...). » (« Résolution sur l'Action de mars et sur le Parti Communiste Unifié d'Allemagne », 3e Congrès de l'IC, juin 1921, Manifestes, thèses et résolutions des quatre premiers congrès mondiaux de l'Internationale Communiste)
Au cours des débats du 3e Congrès, la délégation du KAPD exprime à peine une autocritique concernant l'Action de mars. Elle semble plutôt concentrer ses efforts sur les questions de principe concernant le travail dans les syndicats et au parlement.
Alors que le 3e Congrès parvient à être très autocritique face aux périls putschistes apparus lors de l'Action de mars, à mettre en garde contre ceux-ci et à éradiquer cet « activisme aveugle », il s'engage malheureusement dans la voie tragique et néfaste du Front unique. S'il repousse le danger du putschisme, le tournant opportuniste inauguré par l'adoption des 21 conditions d'admission se confirme et s'accélère. Les graves erreurs, mises en lumière par Gorter au nom du KAPD, à savoir le retour de l'IC au travail dans les syndicats et envers le parlement, ne sont pas corrigées.
Encouragé par les résultats du 3e Congrès, le VKPD s'engage dès l'automne 1921 dans la voie du Front unique. Dans le même temps, ce Congrès pose un ultimatum au KAPD : ou la fusion avec le VKPD ou bien l'exclusion de l'IC. En septembre 1921, le KAPD quitte l'IC. Une partie de celui-ci se précipite dans l'aventure de la fondation immédiate d'une Internationale Communiste Ouvrière. Et quelques mois plus tard se produit une scission en son sein.
Pour le KPD (qui a de nouveau changé de nom en août 1921), la porte vers un cours opportuniste s'ouvre encore plus largement. La bourgeoisie, quant à elle, a atteint ses objectifs : à nouveau grâce à l'Action de mars, elle est parvenue à poursuivre son offensive et à affaiblir encore plus la classe ouvrière.
Si les conséquences de cette attitude putschistes sont dévastatrices pour la classe ouvrières dans son ensemble, elles le sont encore plus pour les communistes : de nouveau ceux-ci sont les principales victimes de la répression. La chasse aux communistes se renforce encore. Une vague de démissions frappe le KPD. De nombreux militants sont profondément démoralisés suite à l'échec du soulèvement. Début 1921, le VKPD compte environ 350 000 à 400 000 membres, fin août il n'en compte plus que 160 000. En novembre il ne rassemble plus que 135 000 à 150 000 militants.
A nouveau la classe ouvrière a lutté en Allemagne sans avoir à ses côtés un parti fort et conséquent.
DV.
[3] [3354]. « Paul Lévi n'a pas informé la direction du Parti de son intention de publier une brochure ni porté à sa connaissance les principaux éléments de son contenu.
Il fait imprimer sa brochure le 3 avril à un moment où la lutte a encore lieu en de nombreux endroits du Reich et où des milliers d'ouvriers sont présentés aux tribunaux spéciaux que Lévi excite ainsi à prononcer les condamnations les plus sanglantes.
La Centrale reconnaît dans toute son étendue le droit de critique envers le Parti avant et après les actions qu'il conduit. La critique sur le terrain de la lutte et de la complète solidarité dans le combat est une nécessité vitale pour le Parti et le devoir révolutionnaire. L'attitude de Paul Lévi (...) ne va pas dans le sens du renforcement du Parti mais dans celui de sa dislocation et de sa destruction. » (Centrale du VKPD, le 16 avril 1921)
[4] [3355]. La délégation du CEIC est composée de B. Kun, Pogany et Guralski. Depuis la fondation du KPD K. Radek joue le rôle « d'homme de liaison » entre le KPD et l'IC. Sans toujours être muni d'un mandat clair, il pratique surtout la politique des canaux « informels » et parallèles.
Géographique:
- Allemagne [98]
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Allemande [1955]
Conscience et organisation:
Approfondir:
- Révolution Allemande [1957]
Heritage de la Gauche Communiste:
- La Révolution prolétarienne [1149]
Des débats entre groupes "bordiguistes" : une évolution significative du milieu politique prolétarien
- 3517 reads
L'offensive développée par la bourgeoisie contre le communisme et contre les minorités révolutionnaires dispersées qui existent aujourd'hui, est pour la classe dominante une question de vie ou de mort. La survivance de ce système en proie à des convulsions internes toujours plus profondes dépend de l'élimination de toute possibilité de maturation d'un mouvement révolutionnaire – dans la reprise de la lutte du prolétariat – qui vise à détruire ce système pour instaurer le communisme. Pour atteindre cet objectif, la bourgeoisie doit discréditer, isoler et donc anéantir politiquement, sinon physiquement, les avant-gardes révolutionnaires qui sont indispensables pour le succès de l'entreprise révolutionnaire du prolétariat.
Pour faire face à cette offensive et défendre la perspective révolutionnaire,
ce qui est requis, en retour, c'est un effort unitaire de toutes les composantes politiques qui se réclament authentiquement de la classe ouvrière. Dans l'histoire du mouvement ouvrier, l'existence de plusieurs partis révolutionnaires, y compris dans le même pays, n'est pas une nouveauté, mais aujourd'hui, les avant-gardes révolutionnaires se présentent au rendez-vous de l'histoire dans un état de dispersion organisationnelle particulièrement important qui n'est certainement pas à l'avantage de la perspective révolutionnaire, mais sert plutôt les intérêts de la bourgeoisie. Cette dispersion ne peut être surmontée de manière volontariste et opportuniste par de grands rassemblements dictés par la « nécessité de construire le parti ». L'unique possibilité, c'est qu'elle soit progressivement résorbée au travers d'une discussion ouverte entre les organisations révolutionnaires actuelles, débat qui permet de faire la clarté sur les différentes questions et d'arriver à une convergence croissante, d'abord politique et ensuite organisationnelle d'une grande partie des forces révolutionnaires qui existent aujourd'hui. Par ailleurs, l'existence d'un débat mené publiquement entre les organisations révolutionnaires, dans la presse ou même directement dans des réunions, représente un moyen incontournable pour l'orientation des nouvelles forces révolutionnaires qui surgissent dans cette période et renforce enfin l'image d'un camp révolutionnaire qui, par delà toutes les variétés possibles et imaginables, se présente aux prolétaires comme une force qui combat la bourgeoisie de façon solidaire.
Sur ce plan, il faut noter depuis plusieurs mois des avancées importantes et significatives effectuées par différentes formations politiques. Nous en citons seulement deux en guise d'exemple et dont nous avons déjà parlé dans notre presse :
– la dénonciation par toutes les composantes significatives du milieu prolétarien de la campagne de mystification de la bourgeoisie contre la brochure du Parti Communiste International Auschwitz ou le grand alibi, accusée de nier la réalité des chambres à gaz nazies alors que cette brochure dénonçait justement le nazisme et la démocratie comme les deux faces de la même pièce ([1] [3356]) ;
– la défense commune de la révolution russe et de ses leçons, dans la réunion publique tenue en commun par la CWO (Communist Workers Organisation) et le CCI à Londres en octobre 1997 ([2] [3357]).
Même si les groupes qui se réclament des enseignements d'Amadeo Bordiga et qui sont connus sous le qualificatif de bordiguistes ([3] [3358]) ne reconnaissent pas l'existence d'un milieu politique prolétarien – même s'ils le font parfois implicitement ([4] [3359]) –, ils en sont une composante importante du fait de leur tradition. Cette partie du camp révolutionnaire, la plus importante jusqu'au début des années 1980, a cependant été touchée en 1982 par une explosion tout-à-fait inédite dans l'histoire du mouvement ouvrier, donnant naissance, en plus des scissions bordiguistes qui existaient déjà, à de nouvelles formations qui sont encore d'inspiration bordiguiste et qui se réclament toutes de la souche d'origine et s'appellent pour la plupart Parti Communiste International. Cette homonymie, associée au fait que les différents groupes qui sont nés de l'explosion du vieux parti n'ont jamais produit un réexamen sérieux des causes de la crise de 1982, a constitué jusqu'à présent une faiblesse importante pour tout le milieu politique prolétarien.
Mais cela est en train de changer. Une ouverture nouvelle s'est manifestée dans le camp bordiguiste, différents articles ont été publiés dans la presse des groupes de cette mouvance en polémique avec d'autres groupes du milieu politique prolétarien, en particulier avec des groupes de la même tendance, sur les raisons de la crise explosive de 1982. C'est très important parce que cela rompt avec la tradition de fermeture sectaire typique du bordiguisme d'après-guerre selon laquelle il fallait adhérer par un acte de foi au « Parti », en ignorant toute autre formation prolétarienne. Le simple fait d'être aujourd'hui plusieurs « partis » ayant tous une « appellation d'origine contrôlée » a imposé à chacun d'entre eux de le démontrer dans les faits, d'où la nécessité de faire le bilan de l'histoire récente du bordiguisme et des positions défendues par les autres groupes de la même mouvance. Cela ne peut qu'être bénéfique pour les groupes eux-mêmes et pour tous les éléments à la recherche d'une référence politique qui se demandent depuis longtemps quelles peuvent bien être les différences entre Programma Comunista, Il Comunista-Le Prolétaire-Programme Communiste ou Il Partito Comunista (le parti dit de Florence), pour ne parler que des groupes les plus importants et qui font partie de la Gauche communiste. Aujourd'hui, le débat franc et ouvert, sévère et rigoureux quand il se réalise, est la seule voie qui pourra enfin permettre d'éliminer les erreurs du passé et de tracer des perspectives pour l'avenir.
Dans cet article, nous n'entrerons pas dans tous les éléments du débat qui s'annonce riche et intéressant, incluant même un groupe extérieur à la mouvance bordiguiste comme le Partito Comunista Internazionalista-Battaglia Comunista, dans la mesure où un tel débat remonte jusqu'à la formation d'origine dans les années 1943-45, c'est-à-dire avant la scission de 1952 entre l'aile bordiguiste proprement dite et le groupe qui, en suivant Onorato Damen, a conservé jusqu'à aujourd'hui le nom de Battaglia Comunista ([5] [3360]). Il est toutefois important de signaler quelques éléments qui confèrent toute sa valeur à ce débat.
Le premier aspect est que la question organisationnelle est au coeur de la discussion : si on lit les différents articles des groupes intéressés, on voit combien ceux-ci sont traversés par cette préoccupation. Au delà du fond de la polémique entre Il Comunista-Le Prolétaire et Programma Comunista, sur lequel honnêtement nous ne pouvons pas nous prononcer pour le moment de manière catégorique, les deux groupes, lorsqu'ils évoquent ce qui se passait dans le vieux Programme Communiste avant 1982 analysent tous deux une confrontation entre une composante immédiatiste et volontariste d'un côté ([6] [3361]), et une composante plus liée au long terme de la maturation de la lutte de classe de l'autre. Et tous les deux mettent également en évidence l'importance centrale de la question de l'organisation : l'organisation de type « partidiste » contre toute velléité « mouvementiste » selon laquelle le mouvement de la classe serait en soi nécessaire et suffisant pour que la révolution réussisse.
Programma Comunista, dans son numéro de janvier 1997, fait référence à la nécessité de comprendre l'importance de la patience, à ne pas être immédiatiste, ce qui ne peut être que partagé comme principe général.
Il Comunista-Le Prolétaire développe dans sa réponse :
« Le parti d'alors (...) a ouvert les portes aux gens pressés et aux impatients, en faisant naître des sections à partir de rien, en poussant les sections à construire partout des groupes communistes d'usine et des comités pour la défense du syndicat de classe, en cherchant et en acceptant l'accroissement numérique des sections avec un laxisme organisationnel, politique et théorique. » Il insiste aussi sur la nécessité de défendre l'organisation des révolutionnaires et le militantisme de chaque camarade, ce que nous ne pouvons que partager et sur lequel nous exprimons toute notre solidarité :
« A quoi sert, ex-camarades de parti, d'encenser autant une patience que vous n'avez jamais eue ? Quand c'était le moment de défendre politiquement, théoriquement et pratiquement le patrimoine des batailles de classe de la Gauche Communiste, quand c'était le moment de mener une bataille politique sur le terrain contre tous les liquidateurs les plus divers du parti en prenant la responsabilité de cette bataille et de représenter un pôle de référence pour un grand nombre de camarades désorientés et isolés à cause de l'explosion du parti, que ce soit en Italie, en France, en Grèce, en Espagne, en Amérique Latine, en Allemagne, en Afrique et au Moyen-Orient, où étiez vous ? Vous avez déserté, vous avez abandonné ce parti que vous vous flattez tant de représenter et dont vous vous êtes appropriés la gloire. Où était-elle votre patience absolument nécessaire pour continuer à intervenir à l'intérieur de l'organisation et pour expliquer sans relâche à la majorité des camarades quels étaient les dangers dans ces périodes de grande difficulté (...). » (Il Comunista n° 55, juin 1997)
Le second aspect qui donne de la valeur à ce débat est la tendance à enfin affronter la question des racines politiques de la crise :
« [il faut se mettre à travailler] sur le bilan de la crise du parti, et faire le bilan de toutes les questions que la dernière crise explosive en particulier, a laissées ouvertes : nous les recitons, la question syndicale, la question nationale, la question du parti et des rapports avec les autres regroupements politiques en plus de ceux avec la classe, la question de l'organisation interne du parti, la question du terrorisme, la question de la reprise de la lutte de classe et des organisations immédiates du prolétariat (...), celle du cours de l'impérialisme. » (Ibid.)
Sur ce plan, le groupe Le Prolétaire-Il Comunista, dans un article sur la question kurde publié dans la revue théorique en français Programme Communiste consacre une longue partie à la critique de Programma Comunista (le groupe italien) à propos d'un article écrit en 1994 sur cette question et dans lequel Programma soutient, bien sûr de façon critique, le PKK :
« Cette fantaisie rappelle les illusions dans lesquelles tombèrent de nombreux camarades, y compris du centre international du parti, à l'époque de l'invasion du Liban en 1982 et qui servirent de déclencheur à la crise qui fit voler en éclats notre organisation (...) Programma en arrive ainsi à retomber dans la même faute commise hier par les liquidateurs de notre parti, El Oumami ou Combat. Peut-être que s'il avait consenti à faire un bilan sérieux de la crise du parti et de ses causes, au lieu de se réfugier dans la croyance d'avoir toujours raison, Programma aurait pu avoir l'occasion historique de faire un saut qualitatif véritable: surmonter sa désorientation théorique, politique et pratique, pour retrouver l'orientation correcte et pareille mésaventure ne lui serait pas arrivée. » (Programme Communiste n° 95)
Cette polémique est particulièrement importante parce qu'au delà du fait qu'elle représente une position claire sur les luttes de libération nationale, il semble que soit enfin reconnu que cette question a été à la base de l'explosion de Programme Communiste en 1982 ([7] [3362]). Cette reconnaissance nous fait bien augurer du futur parce que, comme le met en évidence la nature du débat, il ne sera plus possible pour le bordiguisme de recommencer comme s'il ne s'était rien passé mais il faudra tirer les leçons du passé. Ce passé, on ne peut cependant pas le figer arbitrairement à une période donnée.
Nous avons déjà fait allusion au fait que, dans la polémique, les différents groupes sont revenus jusqu'à la constitution de la première organisation dans les années 1943-45. Ainsi, Programme Communiste n° 94 avait abordé la question : « le parti reconstitué (...) ne resta pas indemne de l’influence des positions de la Résistance antifasciste et d’un anti-stalinisme rebelle. (..) Ces faiblesses conduisirent à la scission de 1951-52 ; mais ce fut une crise bénéfique, de maturation politique et théorique ». On retrouve ce genre de critique par rapport au parti des années 1950 au sein de l’autre branche de la scission de l’époque, c’est-à-dire Battaglia Comunista (voir notre article sur l’histoire de Battaglia Comunista dans la Revue Internationale n° 91).
Dans le même numéro, Programme Communiste fait aussi référence aux difficultés rencontrées par ce groupe après mai 1968 : « Les effets négatifs de l’après 68 touchèrent notre parti (...) jusqu'à le faire éclater. (...) Le parti subissait l’agression de positions qui étaient un mélange d'ouvriérisme, de guerillérisme, de volontarisme, d’activisme. (...) L’illusion se répandit que le parti (après 1975 et la prévision de Bordiga d’une "crise révolutionnaire" pour l’année 1975) pouvait à brève échéance sortir de son isolement et acquérir une certaine influence. »
Programme Communiste n’en reste pas là, et dans un effort remarquable de réflexion sur ses difficultés passées, il revient dans un autre article ([8] [3363]) sur la même période qui mérite d’être réexaminée : « Plus le parti se trouvait face à des problèmes politiques et pratiques différents par leur nature, leur dimension ou leur urgence (comme la question féminine, du logement, des chômeurs, l’apparition de nouvelles organisations en dehors des grands syndicats traditionnels ou les problèmes soulevés par le poids de questions de type national dans certains pays), et plus se révélaient des tendances à se retrancher dans un cadre comme dans des déclarations de principe, dans un raidissement idéologique. »
Ce constat est à saluer, c’est le signe d’une vitalité politique et révolutionnaire qui cherche à apporter une réponse aux nouveaux problèmes de la lutte de classe. Cette réflexion sur le passé du vieux Parti Communiste International et notamment sur la question organisationnelle par les camarades qui ont poursuivi une activité après son éclatement dans les années 1980, est très importante pour la Gauche communiste.
Nous ne développons pas plus dans cet article. Nous voulons simplement saluer et souligner l'importance de ce débat qui se développe dans le camp bordiguiste. Dans de précédents articles nous avons cherché à analyser les origines des courants politiques qui constituent le milieu politique prolétarien actuel, en abordant deux questions politiques fondamentales qui sont « La Fraction italienne et la Gauche Communiste de France » (Revue Internationale n° 90) et « La formation du Partito Comunista Internazionalista » (Revue Internationale n° 91). Nous sommes convaincus que l'ensemble du milieu politique prolétarien doit aborder ces questions historiques et sortir du repli que la contre-révolution des années 1950 lui a imposé. L'avenir de la construction du parti de classe et de la révolution elle-même en dépend fortement.
Ezechiele
Il Partito Comunista Internazionale qui publie Il Partito Comunista en Italie.
[8] [3371]. Programme Communiste n° 94, « A la mémoire d’un camarade de la vieille garde : Riccardo Salvador ».
Courants politiques:
- Bordiguisme [1287]
Heritage de la Gauche Communiste:
Revue Internationale no94 - 3e trimestre 1998
- 2806 reads
Face à la misère et la barbarie, une seule réponse : la lutte internationale du prolétariat
- 2956 reads
La dynamique catastrophique dans laquelle s'enfonce le capitalisme mondial, et dans laquelle il entraîne toute l'humanité, vient encore de connaître une accélération depuis le début de l'année 1998. L'impasse historique du capitalisme s'est manifestée avec force sur tous les plans : multiplication des conflits inter-impérialistes, crise économique et sur le plan social un appauvrissement et une misère qui se généralisent à des milliards d'êtres humains.
L'aggravation des antagonismes impérialistes entre grandes puissances qui s'était exprimée lors de l'échec américain face à l'Irak en février dernier ([1] [3372]), s'affirme maintenant dans la course effrénée à l'arme atomique que se livrent l'Inde et le Pakistan. Cette course échappe à tout contrôle et en particulier à celui des grandes puissances – en premier lieu les Etats-Unis – qui n'ont pas su prévenir les essais indiens et empêcher la riposte pakistanaise. La dynamique au « chacun pour soi », caractéristique majeure de la période de décomposition du capitalisme au plan impérialiste, explose chaque jour un peu plus dans tous les recoins de la planète. La menace d'une guerre entre l'Inde et le Pakistan dans laquelle l'arme atomique serait utilisée, est tout à fait réelle et représente d'ores et déjà un facteur d'instabilité supplémentaire au plan mondial et au plan régional par le jeu même des relations et des oppositions impérialistes. Les bourgeoisies des plus grandes nations capitalistes s'inquiètent... et en même temps participent à l'aggravation des tensions en prenant position – plus ou moins ouvertement – derrière l'un ou l'autre pays. Dans la région, la Chine – présentée comme l'ennemi n°1 par le gouvernement indien – ne resterait pas, ne reste d'ores et déjà pas sans réaction ([2] [3373]). De même, cette accentuation des perpectives guerrières dans la région pose à la bourgeoisie japonaise, chaque jour avec plus d'acuité, la question de son propre armement nucléaire face à ses voisins ; ce qui à son tour vient accroître encore l'instabilité et les rivalités impérialistes mondiales. L'Asie du sud-est est une véritable poudrière – en grande partie atomique – et la situation créée par l'Inde et le Pakistan ne peut que renforcer encore la course aux armements de tout type que la région connaît depuis l'effondrement de l'URSS et du bloc de l'Est.
La période historique actuelle de décomposition du capitalisme se manifeste donc par l'augmentation dramatique des antagonismes et des conflits impérialistes. Des continents entiers sont la proie des guerres et des massacres. Et cette folle spirale se manifeste, à l'heure où nous écrivons, par l'éclatement de la guerre entre l'Erythrée et l'Ethiopie et les files de réfugiés du Kosovo dans l'ex-Yougoslavie qui fuient les nouveaux combats. Ces Etats font partie de l'interminable liste des pays qui ont connu les malheurs et les dévastations de la guerre. Ils ne connaîtront plus la « paix » sous le capitalisme, mais une barbarie dans laquelle les seigneurs locaux et leurs bandes armées vont perpétrer des massacres sans discontinuer, infligeant ainsi aux populations locales ce que les afghans, les tchétchènes, les populations d'Afrique, de l'ex-Yougoslavie et d'ailleurs endurent depuis plusieurs années, voire des décennies, et dont elles ne pourront s'échapper. Le capitalisme en putréfaction entraîne l'ensemble de l'humanité dans des guerres sans fin toujours plus effroyables et barbares.
L'aggravation brutale de la crise économique du capitalisme mondial vient frapper d'une manière particulièrement violente les populations d'Asie du sud-est qui, après avoir subi une exploitation féroce durant les années de « croissance et de succès » économiques, sont maintenant, et du jour au lendemain, rejetées sans travail, livrées à la hausse des prix, à la misère, à la faim et à la répression. Les premières conséquences de la crise dans les pays asiatiques sont d'ores et déjà dramatiques. Les faillites bancaires et d'entreprises, les fermetures d'usines ou les arrêts de production plus ou moins longs jettent des millions d'ouvriers dans le chômage. En Corée du sud, celui-ci a doublé en cinq mois ; un million et demi d'ouvriers sont sur le pavé alors que des centaines de milliers d'autres sont aujourd'hui touchés par le chômage partiel. Le chômage explose à Hongkong, à Singapour, en Malaisie, en Thaïlande, etc. Du jour au lendemain des millions d'ouvriers et leurs familles se retrouvent complètement démunis quand ils ne sont pas – parce que travailleurs immigrés – renvoyés manu-militari dans leur pays d'origine. La consommation s'effondre. Et comment pourrait-il en être autrement alors que, en plus des licenciements, l'inflation explose elle aussi en particulier à cause de l'effondrement des monnaies locales ?
« C'est une récession profonde qui semble se dessiner. En Malaisie, le produit intérieur brut (PIB) s'est contracté de 1,8 % au premier trimestre. A Hongkong, le PIB a baissé pour la première fois depuis treize ans, de 2 % au cours des trois premiers mois de l'année » ([3] [3374]) alors que la Corée du Sud « est confrontée à un "credit crunch" dramatique "menaçant de saper l'industrie et les exportations, dernier recours de la reprise économique" a déclaré, lundi, le ministre des finances [coréen]. Cet avertissement survient alors que la Corée du Sud a enregistré une croissance négative de 2,6 % en mai. » ([4] [3375])
Ainsi, la presse bourgeoise est aujourd'hui obligée de reconnaître qu'il ne s'agit pas seulement d'une « crise financière » qui touche les anciens « dragons » et autres « tigres » mais bien d'un effondrement économique global pour ces pays. Mais cette « reconnaissance » lui permet d'occulter une réalité beaucoup pus profonde et plus grave : c'est que la situation dramatique dans laquelle sombre cette région du monde n'est qu'une expression spectaculaire de la crise mortelle qui mine le capitalisme dans sa totalité ([5] [3376]). Cette situation devient même un facteur d'accélération de la crise générale. Les récents et violents soubresauts des Bourses de Hongkong, de Bangkok, de Djakarta, de Taiwan, de Singapour et Kuala-Lumpur de la fin mai ont largement débordé le cadre de l'Asie du sud-est. Au même moment, en effet, les Bourses de Moscou, de Varsovie et des pays d'Amérique latine chutaient de manière tout aussi considérable. De même les difficultés actuelles du Japon (chute de sa monnaie, le Yen ; faillites bancaires, baisse importante de la consommation interne, récession ouverte officiellement prévue malgré l'augmentation des déficits budgétaires) viennent à leur tour menacer ce qui reste de l'équilibre financier de la région et annoncent une relance exacerbée de la guerre commerciale. Une dévaluation du Yen ne pourrait qu'imposer une dévaluation de la monnaie chinoise – dont l'économie est déjà à bout de souffle – ce qui aurait des conséquences encore plus dramatiques pour toute la région. De même, d'un ordre différent bien sûr, les difficultés japonaises sont lourdes de conséquences pour l'ensemble de l'économie mondiale (4).
L'aggravation de la crise économique est mondiale et touche tous les pays. Tous les éléments qui ont vu l'explosion asiatique de la fin 1997, sont maintenant réunis dans le cas de la Russie. Celle-ci demande une aide d'urgence aux pays du G7, les sept pays les plus riches du monde, de plus de 10 milliards de dollars alors que les capitaux fuient le pays et que le rouble, la monnaie russe, chute malgré des taux d'intérêt de... 150 % ! La Russie se trouve dans la même situation que les pays asiatiques cet hiver, de la Corée en particulier, avec une dette à court terme de 33 milliards de dollars à payer en 1998 alors que ses réserves n'atteignent pas... 15 milliards et qu'elles ne permettent pas de payer les salaires ouvriers comme l'ont rappelé les mineurs de Sibérie ([6] [3377]). A la différence des pays asiatiques, cela fait maintenant dix ans que la Russie est en récession, que son économie s'enfonce dans le marasme, que le chaos et la décomposition sociale touchent tous les secteurs de la société dans une dynamique sans fin.
Voilà la seule perspective que peut offrir le capitalisme aujourd'hui pour l'immense majorité de la population mondiale. Une perspective de misère et de faim, de chômage ou de surexploitation croissante, de dégradation incessante des conditions de travail, de corruption généralisée, d'affrontements entre bandes mafieuses rivales, de drogue et d'alcoolisme, d'enfants abandonnés quand ils ne sont pas vendus comme esclaves, de vieillards réduits à la mendicité et à mourir dans la rue, et de guerres meurtrières et sanglantes, de chaos et de barbarie généralisée. Il ne s'agit pas là de mauvaise science-fiction, mais de la réalité quotidienne que connaît l'immense majorité de la population mondiale et qui existe déjà en Afrique, dans l'ex-URSS, dans nombre de pays d'Asie, en Amérique latine, et qui tend à s'accentuer, touchant maintenant certaines régions européennes comme le montre l'ex-Yougoslavie, l'Albanie, une partie des pays de l'ex-bloc de l'Est.
Quelle alternative à cette barbarie ?
Face à ce tableau catastrophique, largement incomplet, y-a-t-il une solution ou une alternative ? De solution dans le cadre du capitalisme, il n'y en a pas. Et les déclamations des hommes politiques, des économistes et des journalistes – pour ne citer que ceux-là – sur l'espérance d'un futur meilleur à condition d'accepter les sacrifices aujourd'hui, sont non seulement démenties par la faillite des pays asiatiques, Japon y compris, qui nous étaient présentés comme les exemples à suivre, mais aussi plus largement par les trente ans de crise économique ouverte depuis la fin des années 1960 qui ont débouché sur le sombre tableau que nous venons de présenter.
Existe-t-il une alternative en dehors du capitalisme ? Et si oui, quelle alternative ? Et surtout qui en est le porteur ? Les grandes masses qui se sont révoltées en Indonésie ?
La chute brutale des conditions d'existence en Indonésie, imposées par les grandes démocraties occidentales et le FMI du jour au lendemain, ne pouvait que provoquer des réactions populaires. En quelques mois, le PIB a baissé de 8,5 % au premier trimestre 1998, la roupie indonésienne a perdu 80 % de sa valeur depuis l'été 1997, le revenu moyen a chuté de 40 %, le taux de chômage est monté subitement à 17 % de la population active, l'inflation explose et devrait atteindre 50 % en 1998. « La vie est devenue presque impossible. Les prix n'arrêtent pas d'augmenter. Le riz est passé de 300 roupies avant la crise à 3000 aujourd'hui. Et ce sera bientôt pire. » ([7] [3378])
Dans ces conditions, la révolte de la population déjà misérable était prévisible. Les grandes puissances impérialistes et les grands organismes internationaux, tels le FMI ou la Banque Mondiale, qui ont imposé les mesures d'austérité à l'Indonésie, savaient ces réactions populaires inévitables et s'y sont préparés. Les jours du président Suharto étaient comptés dès lors que son autorité étaient atteinte. La dictature sanglante, mise en place par les Etats-Unis au temps de la guerre froide avec le bloc impérialiste de l'URSS, a permis de détourner la révolte et les manifestations sur le népotisme et la corruption du dictateur Suharto et de ses proches, évitant ainsi toute remise en cause du capitalisme. Ce détournement a été d'autant plus facile que le prolétariat indonésien, faible et sans expérience, n'a pu développer un quelconque mouvement sur son terrain de classe. Les quelques grèves ou manifestations ouvrières – telles qu'elles ont pu être relatées dans la presse bourgeoise – ont vite été abandonnées. Les ouvriers ont rapidement été noyés dans l'inter-classisme, soit dans les émeutes et le pillage des magasins aux côtés des grandes masses miséreuses lumpénisées qu'ils côtoient dans les bidonvilles, soit derrière les étudiants sur le terrain des « reformasi », c'est-à-dire sur le terrain démocratique contre la dictature Suharto. La répression sanglante (plus de 1000 morts à Djakarta, sans doute beaucoup plus en province) a permis de renforcer encore la mystification démocratique et a donné encore plus de poids à la « victoire » obtenue avec la démission de Suharto. Démission facilement organisée et obtenue... par les Etats-Unis.
D'une situation de faillite ouverte du capitalisme, les bourgeoisies des grandes puissances impérialistes, américaine au premier chef, ont réussi à retourner la situation en Indonésie – dont elles sont les premières responsables – au profit du capital et de la démocratie bourgeoise. Et cela a été d'autant plus facile que le prolétariat n'a pas réussi à lutter comme tel, sur son terrain, c'est-à-dire contre l'austérité, le chômage et la misère, que ce soit au moyen de grèves ou de manifestations massives.
L'alternative ne peut être que révolutionnaire, anti-capitaliste. Mais ce ne sont pas les grandes masses misérables sans travail qui s'entassent dans les immenses bidonvilles des métropoles des pays du « tiers-monde » qui peuvent en être porteuses. Seul le prolétariat international est le porteur de l'alternative qui comporte la destruction des Etats bourgeois, la disparition du mode de production capitaliste et l'avènement du communisme. Mais la réponse internationale prolétarienne n'est pas présente de façon égale partout dans le monde.
Certes, en Asie, toutes les fractions du prolétariat ne sont pas aussi faibles, ne manquent pas autant d'expérience qu'en Indonésie. La classe ouvrière en Corée par exemple, autrement plus concentrée, a une expérience de lutte plus importante et a mené, en particulier dans les années 1980 des luttes significatives ([8] [3379]). Mais là aussi, la bourgeoisie s'est préparée. La « démocratisation » récente des syndicats coréens et de l'Etat – l'élection présidentielle en décembre dernier au plus fort de la crise financière –, tout comme les dernières élections locales, ont renforcé la mystification démocratique et offert à la bourgeoisie une meilleure capacité pour affronter le prolétariat et l'enfermer dans de fausses alternatives. A l'heure où nous écrivons, l'Etat coréen, le nouveau président, Kim Dae Jung, ancien opposant longtemps emprisonné, les dirigeants des grands entreprises et les deux syndicats, y compris le nouveau « radical », réussissent à faire passer les millions de licenciements, le chômage partiel et les sacrifices au moyen du jeu démocratique.
La responsabilité historique internationale de la classe ouvrière des pays industrialisés
L'utilisation de la mystification démocratique qui vise à attacher les ouvriers à l'Etat national, ne pourra être complètement dépassée et anéantie que par le prolétariat des grandes puissances impérialistes « démocratiques ». De par sa concentration et son expérience historique dans la lutte contre la démocratie bourgeoise, la classe ouvrière d'Europe occidentale et d'Amérique du nord est la seule qui puisse donner au prolétariat mondial à la fois l'exemple et l'impulsion de la lutte révolutionnaire, et lui donner la capacité de s'affirmer partout comme la seule force déterminante et porteuse d'une perspective pour toutes les masses paupérisées de la société.
La bourgeoise sait cela. C'est la raison pour laquelle elle se retrouve unie pour développer les manoeuvres et les attaques – économiques et politiques – les plus sophistiquées contre la classe ouvrière. Nous l'avons vu en France en décembre 1995 et, à la suite, en Belgique et en Allemagne ([9] [3380]). Nous venons de le voir au Danemark.
Les 500 000 grévistes du secteur privé – pour un population active de 2 millions, cela signifie l'équivalent de 5 millions de grévistes pour des pays comme la Grande-Bretagne ou la France ! – qui ont bloqué ce petit pays durant quinze jours au mois de mai, sont l'illustration des potentialités de lutte, l'expression du lent développement du mécontentement et de la combativité ouvrière en Europe. Ce n'est pas pour rien que les médias ont présenté ce mouvement comme un anachronisme, comme « une grève de riches » (!), afin de limiter au maximum tout sentiment de solidarité, toute conscience de l'existence d'une seule et même lutte ouvrière.
En même temps, le soin politique qu'a porté la bourgeoisie danoise dans la « résolution » du conflit indique bien la réalité du danger prolétarien. L'utilisation du jeu démocratique entre le gouvernement social-démocrate, les patrons privés, la direction du syndicat LO et le syndicalisme de base, les « Tillidsmand », tout comme l'utilisation du référendum sur l'Europe pour décréter la fin de la grève, est la manifestation de l'armement politique sophistiqué de la bourgeoisie et de sa maîtrise. Armement politique de par l'utilisation de l'opposition entre la direction de LO et le syndicalisme de base pour s'assurer du contrôle des ouvriers. Maîtrise dans le « timing », dans la planification temporelle de la grève provoquée entre les négociations syndicales et la date du référendum sur l'Europe qui « autorisait » – du point de vue légal – le gouvernement social-démocrate à intervenir et à littéralement siffler la reprise du travail.
Malgré l'échec de la grève et les manoeuvres de la bourgeoisie, ce mouvement n'a pas exactement la même signification que celui de décembre 1995 en France. En particulier, alors que la reprise du travail s'était faite en France dans une certaine euphorie, avec un sentiment de victoire qui ne laissait pas de place à une remise en cause du syndicalisme, la fin de la grève danoise s'est faite avec un sentiment d'échec et peu d'illusion sur les syndicats. Cette fois, l'objectif de la bourgeoisie n'était pas de lancer une vaste opération de crédibilisation des syndicats au niveau international comme en 1995, mais de « mouiller la poudre », d'anticiper sur un mécontentement et une combativité croissante qui s'affirment petit à petit tant au Danemark que dans les autres pays d'Europe et ailleurs.
Les efforts et le soin qu'apportent les bourgeoisies, européennes particulièrement, à leur combat contre le prolétariat, tranchent clairement avec les méthodes « primaires » répressives et brutales de leurs consoeurs des pays de la périphérie du capitalisme. Le degré de sophistication, de machiavélisme, utilisé est une indication du danger historique que représente le prolétariat des pays les plus industrialisés pour la bourgeoisie. De ce point de vue, la grève danoise annonce la réponse de classe et la perspective de luttes massives que le prolétariat expérimenté des grandes concentrations d'Europe occidentale va offrir à ses frères de classe des autres continents. Elle annonce aussi la perspective révolutionnaire que le prolétariat international doit offrir à l'ensemble des masses pauvres et affamées qui représentent l'immense majorité de la population mondiale.
Voilà l'alternative au sombre tableau et à la sinistre perspective que nous offre le capitalisme en se décomposant : une seule et même lutte révolutionnaire du prolétariat international dont le signal et la dynamique seront donnés par les luttes des ouvriers des grandes concentrations industrielles d'Europe et d'Amérique du Nord.
RL, 7 juin 98
Questions théoriques:
- Décadence [32]
Heritage de la Gauche Communiste:
- La lutte Proletarienne [169]
Euro : l'aiguisement des rivalités capitalistes
- 3080 reads
La réunion au sommet des chefs d'Etat de l'Union Européenne début mai 1998 avait pour but de couronner dignement l'introduction de la monnaie commune, l'Euro. Ceux-ci étaient venus à Bruxelles pour célébrer leur victoire sur l'« égoïsme nationaliste ». Auparavant, le chancelier allemand Helmut Kohl nous avait assuré que la nouvelle monnaie incarne surtout la paix en Europe pour le prochain siècle et en particulier le dépassement de la rivalité historique meurtrière entre l'Allemagne et la France.
Mais les faits sont têtus et c'est souvent dans les moments les plus inattendus qu'ils font voler en éclats les idées fausses que les classes exploiteuses inventent pour s'illusionner elles-mêmes et surtout pour tromper ceux qu'elles exploitent. Au lieu d'être une démonstration de confiance mutuelle et de collaboration pacifique entre Etats européens, le sommet de Bruxelles et sa célébration de la naissance de l'Euro ont vite tourné au pugilat autour d'une question secondaire en apparence : à quel moment le français Trichet devrait remplacer le néerlandais Duisenberg comme président de la nouvelle Banque centrale européenne ; ceci d'ailleurs en violation du traité sur l'Euro solennellement adopté.
Une fois éteints les feux de la bataille, une fois que le président français Chirac eût terminé de vanter la façon dont il avait imposé le remplacement de Duisenberg par Trichet dans quatre ans et que le ministre allemand des finances Waigel eût cessé de lui riposter en déclarant que le néerlandais, favori de Bonn, pourrait rester huit ans « s'il le voulait », un silence embarrassant retomba sur les capitales de l'Europe. Comment expliquer cette soudaine rechute dans un état d'esprit nationaliste de « prestige », soi-disant anachronique ? Pourquoi Chirac a-t-il mis en danger la cérémonie d'introduction de la monnaie commune sans autre raison que celle d'avoir un de ses compatriotes à la tête d'une banque, qui plus est un compatriote qui a la réputation d'être un « clone » du président de la Bundesbank Tietmeyer ? Pourquoi Kohl a-t-il tant tardé pour faire la plus petite concession sur une telle question ? Pourquoi a-t-il été autant critiqué en Allemagne pour le compromis qu'il a accepté ? Et pourquoi les autres nations présentes, bien qu'elles aient soi-disant soutenu unanimement Duisenberg, se sont-elles résignées à cette bataille rangée ? Après s'être creusé la tête, la presse bourgeoise est parvenue à une explication ou plutôt à plusieurs explications différentes. En France la responsabilité du contretemps de Bruxelles a été rejetée sur l'arrogance des allemands ; en Allemagne sur l'ego national boursouflé des français ; en Grande-Bretagne sur la folie des continentaux qui ne sont pas capables de se contenter de leur bonne vieille monnaie nationale traditionnelle.
Ces excuses et « explications » ne sont-elles pas en elles-mêmes la preuve qu'un véritable conflit d'intérêts nationaux se jouait à ce sommet de Bruxelles ? Loin de limiter la concurrence économique entre les capitaux nationaux participants, l'introduction d'une monnaie unique signifie l'intensification des rivalités. Plus particulièrement, le conflit entre ces « grands amis » que sont Kohl et Chirac exprime surtout toute l'inquiétude de la bourgeoisie française face au renforcement économique et politique et face à l'agressivité de son compère allemand. Cette montée économique et impérialiste de l'Allemagne est une réalité brutale qui ne peut qu'alarmer le « partenaire » français malgré la prudence diplomatique de Kohl. Celui-ci, en effet, en prévision de sa probable « retraite » comme Chancelier, a récemment fait passer le message suivant à ses futurs successeurs : « L'expression "leadership allemand" en Europe devrait être évitée, car elle pourrait mener à l'accusation que nous essayons d'obtenir l'hégémonie. » ([1] [3390])
L'agressivité croissante du capitalisme allemand
En fait, mai 1998 a témoigné de deux développements importants concrétisant la volonté de l'Allemagne d'imposer des mesures économiques visant à assurer la position dominante du capitalisme allemand aux dépens de ses rivaux plus faibles.
Le premier est l'organisation de la monnaie européenne. L'Euro était à l'origine un projet français imposé à Kohl par Mitterrand en échange du consentement français à l'unification allemande. A l'époque, la bourgeoisie française craignait à juste titre que la Bundesbank de Francfort n'utilise le rôle dominant du Mark, par une politique des taux d'intérêt élevés, pour obliger toute l'Europe à participer au financement de l'unification de l'Allemagne. Mais, lorsque l'Allemagne mit finalement tout son poids dans ce projet (et sans ce poids l'Euro n'aurait jamais existé), ce qui a émergé c'est une monnaie européenne correspondant aux conceptions et aux intérêts de l'Allemagne et non à ceux de la France.
Comme l'écrivait le Frankfurter Allgemeine Zeitung, journal porte-parole de la bourgeoisie allemande, après le sommet de Bruxelles : « De l'indépendance de la Banque centrale européenne et sa localisation à Francfort, en passant par le pacte de stabilité en soutien à l'union monétaire, jusqu'au refus d'un "gouvernement économique" comme contrepoids politique à la Banque centrale, en dernière instance la France n'a pas été capable d'imposer une seule de ses exigences. Même le nom de la monnaie unique inscrit dans le Traité de Maastricht, l'Ecu – qui rappelle une monnaie historique française – a été abandonné sur le chemin de Bruxelles pour le plus neutre "Euro". (...) Aussi la France, en ce qui concerne ses conceptions et son prestige politiques, se retrouve les mains vides. Chirac a joué le méchant à Bruxelles pour effacer au moins partiellement cette impression. » (5 mai 1998)
La seconde manifestation importante récente de l'agressivité de l'expansion économique allemande est démontrée par les opérations internationales de rachat d'entreprises effectuées par les principaux constructeurs d'automobile allemands. La fusion de Daimler-Benz et Chrysler va constituer le troisième géant mondial de l'automobile. Incapable de survivre comme troisième constructeur américain indépendant face à General Motors et Ford, ayant déjà été sauvé de la faillite par l'Etat américain sous la présidence Carter, Chrysler n'avait pas d'autre choix que d'accepter l'offre allemande bien que cela donne à Daimler, déjà principale entreprise allemande de l'armement et de l'aéronautique, l'accès aux actions de Chrysler dans l'armement américain et dans les projets de la NASA. L'encre de la signature de cet accord n'avait pas encore séché que Daimler annonçait son intention de reprendre Nippon Trucks. Bien que Daimler soit le premier constructeur mondial de camions, il ne couvre que 8 % de l'important marché asiatique. Là encore, la bourgeoisie allemande est en position de force. En effet, même si le Japon sait que le géant de Stuttgart a l'intention d'utiliser ce rachat pour accroître sa part du marché asiatique des camions à hauteur de 25 % (aux dépens du Japon !), il lui est difficile d'empêcher cet accord à cause de la véritable faillite qui frappe ce qui fut l'orgueilleuse société Nippon Trucks.
Et, pour parachever ce tableau, la bagarre autour du rachat du britannique Rolls Royce de Vickers se déroule actuellement exclusivement entre deux entreprises allemandes, ce qui place les honorables actionnaires de Vickers face à un choix pénible au regard de l'histoire. Se vendre à BMW est quasiment un sacrilège par rapport au souvenir de la bataille d'Angleterre en 1940, où la Royal Air Force équipée de moteurs Rolls-Royce repoussa la Luftwaffe allemande dont le fournisseur était ce même BMW. « L'idée que BMW possède Rolls-Royce me brise le coeur » a déclaré un de ces vénérables gentlemen à la presse allemande. Malheureusement l'autre choix est celui de Volkswagen, entreprise créée par les nazis, ce qui contraindrait la Reine d'Angleterre à se déplacer dans la « voiture du peuple »...
Et ceci n'est que le début d'un processus qui ne sera pas limité à l'industrie automobile. Le gouvernement français et la Commission européenne de Bruxelles viennent juste de se mettre d'accord sur un plan pour sauver de la faillite le Crédit Lyonnais, une des premières banques françaises. Un des objectifs principaux de ce plan est d'empêcher que les parts les plus lucratives de cette banque ne tombent entre des mains allemandes. ([2] [3391])
Pendant la Guerre froide, l'Allemagne, nation capitaliste importante, était divisée, occupée militairement et jouissait d'une souveraineté étatique partielle. Elle n'avait pas la possibilité politique de développer une présence internationale de ses banques et de ses entreprises, une présence qui aurait correspondu à sa puissance industrielle. Avec l'effondrement en 1989 de l'ordre mondial issu de Yalta, la bourgeoisie allemande n'avait plus de raison de continuer à supporter cette situation au niveau des affaires. Les événements récents ont confirmé que les très démocrates successeurs d'Alfred Krupp et Adolf Hitler sont tout aussi capables que leurs prédécesseurs de bousculer et écarter leurs rivaux. Pas étonnant que leurs « amis » et « partenaires » capitalistes soient aussi en colère.
L'Euro : un instrument contre le « chacun pour soi »
Kohl a compris plus tôt que ses collègues allemands que l'effondrement des blocs impérialistes mais aussi l'inquiétude provoquée par l'unification allemande risquaient de provoquer une nouvelle vague de protectionnisme et de chacun pour soi économique, ce qui avait été jusque là mis en échec au sein de la discipline imposée par le bloc américain. Il était clair que l'Allemagne, la principale puissance industrielle d'Europe et le champion de l'exportation, risquait de devenir une des principales victimes d'un tel développement.
Ce qui rallia la majorité de la bourgeoisie allemande – qui était si fière du Deutsche Mark et si effrayée par l'inflation ([3] [3392]) – à la position de Kohl, a été la crise monétaire européenne d'août 1993 (qui avait en fait commencé un an auparavant lorsque la Grande-Bretagne et l'Italie avaient quitté le Système monétaire européen). La crise avait été provoquée par une spéculation internationale considérable sur les monnaies, elle-même expression de la crise de surproduction chronique et généralisée du capitalisme. Ceci amena presque à l'explosion du Système monétaire européen qui avait été mis en place par Helmut Schmidt et Giscard d'Estaing pour empêcher les fluctuations incontrôlées et imprévisibles des monnaies qui risquaient de paralyser le commerce au sein de l'Europe. Ce système se révélait maintenant lui-même complètement inadéquat face à l'avancée de la crise. De plus, en 1993, la bourgeoisie française – qui fait plus souvent preuve de détermination que de bon sens – proposa, dans le dos de l'Allemagne, de remplacer le Mark par le Franc français comme monnaie de référence de l'Europe. Cette proposition était indubitablement irréaliste et elle connut un rejet retentissant de la part des « partenaires », notamment de la part des Pays-Bas (Duisenberg !). Tout ce spectacle convainquit la bourgeoisie allemande du danger que contenait un chacun pour soi incontrôlé. C'est ce qui la fit se rallier à son Chancelier. La monnaie commune fut ainsi conçue pour rendre impossible les fluctuations monétaires entre les différents « partenaires commerciaux » européens et pour aussi contrecarrer une tendance potentielle existante vers le protectionnisme et l'effondrement du commerce mondial. Après tout, l'Europe est, avec les Etats-Unis, le principal centre du marché mondial. Mais au contraire de l'Amérique, l'Europe est divisée en de multiples capitaux nationaux. Comme tel, elle constitue un maillon faible potentiel dans la chaîne du commerce mondial. Aujourd'hui, même les meilleurs avocats de l'« Europe unie » comme la CDU et le SPD en Allemagne, admettent qu'il n'y a « pas d'alternative à une Europe des Patries » ([4] [3393]). Cependant, ils mettent en place l'Euro pour limiter les risques au niveau du commerce mondial. C'est pourquoi l'Euro est soutenu par la plupart des fractions de la bourgeoisie, et cela pas seulement en Europe mais aussi en Amérique.
Mais si ce soutien général pour l'Euro existe, en quoi exprime-t-il l'aiguisement de la concurrence capitaliste ? Où réside l'intérêt particulier de la bourgeoisie allemande ? Pourquoi la version allemande de l'Euro est-elle l'expression de son autodéfense agressive aux dépens de ses rivaux ? En d'autres termes, pourquoi contrarie-t-elle autant Chirac ?
Euro : les plus forts imposent leurs règles aux plus faibles
C'est un fait bien connu qu'au cours des trente dernières années la crise a affecté la périphérie du capitalisme plus rapidement et plus brutalement que le coeur du système. Cependant, il n'y a rien de naturel et d'automatique dans un tel cours des événements. L'accumulation la plus importante et la plus explosive des contradictions capitalistes se trouve précisément au centre du système. Dans ce sens, le fait qu'après 1929 les Etats-Unis et l'Allemagne, les deux pays capitalistes les plus développés, ont été les premières victimes et les plus brutalement affectés par la crise mondiale, correspondait beaucoup plus au cours spontané et naturel du capitalisme décadent. Au cours des décennies passées, au contraire, nous avons vu tour à tour l'effondrement économique de l'Afrique, de l'Amérique latine, de l'Europe de l'Est et de la Russie, et plus récemment du sud-est asiatique. Le Japon lui-même commence à vaciller. L'Amérique du nord et l'Europe de l'ouest, en particulier les Etats-Unis et l'Allemagne, ont malgré tout été les plus capables de résister. Ils l'ont été précisément parce qu'ils ont été capables d'empêcher, dans une certaine mesure, le chacun pour soi économique qui avait prévalu dans les années 1930. Ils ont mieux résisté parce qu'ils ont été capables d'imposer leur règles de conduite de la concurrence capitaliste. Ces règles sont là pour assurer la survie des plus forts. Dans le naufrage actuel du capitalisme, elles permettent que ce soient les « pirates » les plus faibles qui passent en premier par dessus bord. Alors que la bourgeoisie les présente comme la recette qui doit permettre de civiliser, de pacifier ou même d'éliminer la concurrence entre nations, ces règles sont en réalité les moyens les plus brutaux d'organiser la concurrence au bénéfice des plus forts. Tant que le bloc impérialiste occidental existait, les Etats-Unis seuls y imposaient ces règles. Aujourd'hui, si les Etats-Unis continuent de dominer économiquement au niveau mondial, au sein de l'Europe c'est l'Allemagne qui de plus en plus fait la loi, en s'imposant aux dépens de la France et des autres. A long terme cette situation mènera l'Allemagne à se retrouver directement face aux Etats-Unis eux-mêmes.
Le conflit européen sur l'Euro
Il est vrai que la monnaie commune européenne sert les intérêts de tous ses participants. Mais cela n'est qu'une partie de la réalité. Pour les pays plus faibles, la protection offerte par l'Euro est comparable à la protection généreuse que la Mafia offre à ses victimes. Face à la puissance d'exportation supérieure de l'Allemagne, la plupart de ses rivaux européens ont eu régulièrement recours au cours des trente dernières années à des dévaluations monétaires, comme ce fut le cas de l'Italie, de la Grande-Bretagne ou de la Suède, ou au moins à une politique de stimulation économique et de monnaie faible comme dans le cas de la France. A Paris, le concept de politique monétaire « au service de l'expansion économique » a été une doctrine d'Etat tout autant que celle du « monétarisme » de la Bundesbank. Au début des années 1930, de telles politiques, les dévaluations brutales en particulier, comptaient parmi les armes favorites des différentes nations européennes aux dépens de l'Allemagne. Sous la nouvelle loi germanique de l'Euro une telle politique n'est plus possible. Au coeur de ce système il y a un principe que la France a beaucoup de mal à digérer. C'est le principe de l'indépendance de la Banque Centrale Européenne, qui signifie la dépendance de celle-ci à la politique et au soutien de l'Allemagne.
Les pays plus faibles – l'Italie en est un exemple classique – ont peu de moyens de maintenir un minimum de stabilité en dehors de la zone Euro, sans l'accès au capital, aux marchés ou taux d'intérêts meilleur marché que le système offre. La Grande-Bretagne et la Suède, qui sont relativement plus compétitives que l'Italie, et moins dépendantes de l'économie allemande que la France ou les Pays-Bas, sont capables de se maintenir plus longtemps en dehors de l'Euro. Mais au sein des murs protecteurs de la zone Euro, les autres ont perdu quelques unes de leurs armes en faveur de l'Allemagne.
L'Allemagne pouvait se permettre de passer un compromis sur la question de Trichet et de la présidence de la Banque Centrale Européenne. Mais sur l'organisation de l'Euro, comme sur l'expansion internationale de ses banques et de son industrie, elle n'a accepté aucun compromis. Et il ne pouvait pas en être autrement. L'Allemagne est le moteur de l'économie européenne. Mais après trente ans de crise ouverte même l'Allemagne est devenu un « homme malade » de l'économie mondiale. Sa dépendance du marché mondial est énorme ([5] [3394]). La masse considérable de ses chômeurs approche les dimensions de celle des années 1930. Et elle se confronte à un problème supplémentaire extrêmement coûteux et encore non résolu : les coûts économiques et sociaux de la réunification. C'est la crise de surproduction irréversible du capitalisme décadent qui a frappé le coeur de l'économie allemande l'obligeant, comme les autres géants du capitalisme, à combattre impitoyablement pour sa propre survie.
Kr., 25 mai 1998
[4] [3398] La division du monde en capitaux nationaux concurrents ne peut être surmontée que par la révolution prolétarienne mondiale
[5] [3399] L'Allemagne a exporté pour 511 milliards de dollars en 1997, seulement second derrière les Etats-Unis (688 milliards), et beaucoup plus que le Japon avec 421 milliards de dollars (selon l'OCDE).
Géographique:
- Europe [95]
Heritage de la Gauche Communiste:
13° congrès de R.I. : résolution sur la situation internationale
- 2420 reads
Depuis un an l'évolution de la situation internationale a fondamentalement confirmé les analyses contenues dans la résolution adoptée par le 12e congrès du CCI, en avril 1997. En ce sens, la présente résolution constitue simplement un complément de la précédente, ne reprenant pas ses analyses mais vérifiant leur confirmation et apportant les actualisations que requiert la situation d'aujourd'hui.
Crise économique
1) Un des points de la précédente résolution qui s'est confirmé avec le plus de clarté est celui concernant la crise de l'économie capitaliste. Ainsi, en avril 1997 nous disions :
« Parmi les mensonges abondamment diffusés par la classe dominante pour faire croire à la viabilité, malgré tout, de son système, une place de choix est également réservée à l'exemple des pays d'Asie du sud-est, les "dragons" (Corée du Sud, Taiwan, Hongkong et Singapour) et les "tigres" (Thaïlande, Indonésie, Malaisie) dont les taux de croissance actuels (quelques fois à deux chiffres) font baver d'envie les bourgeois occidentaux…
…l'endettement de la plupart de ces pays, tant extérieur qu'au niveau de leurs Etats, atteint des niveaux considérables ce qui les soumet aux mêmes menaces que tous les autres pays. En réalité, faisant jusqu'à présent figure d'exception, comme ce fut le cas de leur grand voisin japonais, ils ne pourront pas échapper indéfiniment aux contradictions de l'économie mondiale qui ont transformé en cauchemar d'autres "success stories" qui ont précédé la leur, telle celle du Mexique. » (point 7)
Il n'a pas fallu quatre mois pour que les difficultés de la Thaïlande inaugurent la crise financière la plus importante qu'ait connu le capitalisme depuis les années 1930, une crise financière qui s'est étendue à l'ensemble des pays d'Asie du sud-est et qui a nécessité la mobilisation de plus de 120 milliards de dollars (bien plus du double de celle déjà exceptionnelle du Mexique en 1996) pour éviter qu'un grand nombre d'Etats de la région ne soient déclarés en faillite. Le cas le plus spectaculaire est évidemment celui de la Corée du Sud, onzième puissance économique mondiale, membre de l'OCDE (le club des « riches ») qui s'est retrouvée en cessation de paiements, avec une dette de près de 200 milliards de dollars. En même temps, cet effondrement financier a fait trembler le plus grand pays du monde, la Chine, dont on vantait également, il y a peu, le « miracle économique » et aussi la deuxième puissance économique de la planète, le Japon lui-même.
2) Les difficultés que rencontre à l'heure actuelle l'économie japonaise, le « bon élève de la classe » pendant plusieurs décennies, ne datent pas de la crise financière qui a déferlé sur l'Asie du sud-est tout au long de la seconde moitié de 1997. En fait, c'est depuis le début des années 1990 que le Japon fait figure d' « homme malade », notamment avec une récession larvée que n'ont pu surmonter de nombreux « plans de relance » (cinq plans depuis octobre 1997 qui faisaient suite à de nombreux autres) et qui aujourd'hui s'est convertie en une récession ouverte (la première depuis 23 ans). En même temps, le Yen qui avait été la monnaie vedette pendant de nombreuses années a affiché une perte de valeur par rapport au dollar de 40 % au cours des trois dernières années. Enfin, le système bancaire japonais révèle toujours plus sa fragilité avec une proportion énorme de créances douteuses, représentant 15 % du PIB annuel du Japon, alors que ce pays est la « caisse d'épargne du monde », notamment avec des centaines de milliards de dollars en bons du Trésor américains. En fait, le mauvais sang que se fait la bourgeoisie de tous les pays à propos du Japon est tout à fait justifié. Il est clair qu'un effondrement de l'économie japonaise constituerait un véritable cataclysme pour l'ensemble de l'économie mondiale. Mais en outre, le fait que l'économie la plus dynamique du deuxième après-guerre soit plongée depuis près de huit ans dans le marasme a une signification toute particulière ; il constitue un indice du degré de gravité atteint par la crise que subit le capitalisme depuis une trentaine d'années.
3) En fait, pour les marxistes, il importe d'aller au delà des discours des « experts » de la classe dominante. Si on s'en tenait à ces discours, il faudrait considérer que les choses vont dans la bonne direction pour le capitalisme puisqu'on annonce une reprise de l'économie mondiale et que les retombées de la crise financière d'Asie se révèlent moins destructrices que certains ne l'avaient craint il y a quelques mois. Aujourd'hui, on voit même les principales Bourses du monde, à commencer par celle de Wall Street, battre tous leurs records. En réalité, les événements récents ne contredisent aucunement l'analyse faite par les marxistes de la gravité et du caractère insoluble de la crise présente du capitalisme. En arrière plan de l'effondrement financier des « tigres » et des « dragons » comme de la maladie de langueur de l'économie japonaise réside l'endettement astronomique dans lequel s'enfonce jour après jour le monde capitaliste :
« En fin de compte, loin de permettre de surmonter les crises, le crédit ne fait qu'en étendre la portée et la gravité comme le montre, en s'appuyant sur le marxisme, Rosa Luxemburg. Aujourd'hui, les thèses de la gauche marxiste... à la fin du siècle dernier, restent fondamentalement valables. Pas plus qu'alors, le crédit ne peut à l'heure actuelle élargir les marchés solvables. Cependant, confrontée à une saturation définitive de ces derniers (...), le crédit est devenu la condition indispensable à l'écoulement des marchandises produites, se substituant au marché réel. » (point 4)
« ... C'est principalement en utilisant le moyen du crédit, d'un endettement toujours plus grand, que l'économie mondiale a réussi à s'éviter une dépression brutale comme celle des années 1930... »
4) En fait, la caractéristique la plus significative des convulsions économiques qui touchent aujourd'hui l'Asie ne consiste pas tant dans les retombées qu'elles vont provoquer sur les autres pays développés (environ moins 1 % de croissance) que dans le fait qu'elles révèlent l'impasse totale où se trouve le système capitaliste aujourd'hui, un système contraint à une perpétuelle fuite en avant dans l'endettement (un endettement que les prêts consentis aux « dragons » et aux « tigres » ne font qu'aggraver encore). D'autre part, ces convulsions qui viennent frapper de plein fouet les « champions de la croissance » font la preuve qu'il n'existe pas de formule ou de recette permettant à un quelconque groupe de pays d'échapper à la crise. Enfin, par leur ampleur bien plus grande encore que celle des soubresauts financiers des années passés, elles révèlent l'aggravation continuelle de l'état de l'économie capitaliste mondiale.
Face à la faillite des « dragons », la bourgeoisie, en mobilisant des moyens énormes avec la participation des principaux pays de chaque côté de l'Atlantique et du Pacifique, a fait la preuve que, malgré la guerre commerciale à laquelle se livrent ses différentes fractions nationales, elle était résolue à éviter que ne se développe une situation semblable à celle des années 1930. En ce sens, le « chacun pour soi » que porte avec lui l'enfoncement de la société capitaliste dans la décomposition trouve des limites dans la nécessité pour la classe dominante d'empêcher une débandade générale plongeant brutalement l'ensemble de l'économie mondiale dans un véritable cataclysme. Le capitalisme d'Etat qui s'est développé avec l'entrée du capitalisme dans sa phase de décadence, et qui s'est particulièrement développé à partir de la deuxième moitié des années 1930 avait pour but de garantir un minimum d'ordre entre les différentes fractions du capital à l'intérieur des frontières nationales. Après la disparition des blocs impérialistes faisant suite à l'effondrement du bloc russe, le maintien d'une coordination des politiques économiques entre les différents Etats permet de maintenir ce type d' « ordre » à l'échelle internationale ([1] [3400]). Cela ne remet pas en cause la poursuite et l'intensification de la guerre commerciale, mais permet que celle-ci puisse se mener avec certaines règles permettant au système de survivre.
En particulier, elle a permis aux pays les plus développés de repousser vers ceux de la périphérie (Afrique, Amérique latine, pays de l'Est) les manifestations les plus dramatiques d'une crise qui pourtant trouve son origine au coeur du système capitaliste (Europe occidentale, Etats-Unis, Japon). Elle permet également d'établir des zones de plus grande stabilité (toute relative) comme se propose de le faire l'instauration de l'Euro.
5) Cependant, la mise en oeuvre de toutes les mesures de capitalisme d'Etat, de coordination des politiques économiques entre les pays les plus développés, de tous les « plans de sauvetage » ne peuvent éviter au capitalisme une faillite croissante, même s'ils parviennent à ralentir le rythme de la catastrophe. Ce système pourra bénéficier de rémissions momentanées de sa maladie, comme ce fut déjà le cas par le passé, mais après la « reprise » il y aura de nouvelles récessions ouvertes et toujours plus de convulsions économiques et financières.
Au sein de l'histoire de la décadence du capitalisme, avec sa spirale crise-guerre-reconstruction-nouvelle crise ouverte, il existe une histoire de la crise qui débute à la fin des années 1960. Tout au long de cette période on assiste à une dégradation inéluctable de la situation du capitalisme mondial qui se manifeste notamment par :
– une baisse des taux de croissance moyens (pour les 24 pays de l'OCDE, période 1960-70 : 5,6 % ; 1970-80 : 4,1 % ; 1980-90 : 3,4 % ; 1990-95 : 2,4 %) ;
– un accroissement faramineux et général de l'endettement, particulièrement celui des Etats (représentant aujourd'hui pour les pays développés entre 50 et 130 % de toute la production annuelle) ;
– une fragilisation et une instabilité croissante des économies nationales avec des faillites de plus en plus brutales de secteurs industriels ou financiers ;
– l'éjection de secteurs toujours plus importants de la classe ouvrière en dehors du processus productif (pour l'OCDE, 30 millions de chômeurs en 1989, 35 millions en 1993, 38 millions en 1996).
Et ce processus est destiné à se poursuivre inéluctablement. En particulier, le chômage permanent, qui exprime la faillite historique d'un système dont la raison d'être était d'étendre le travail salarié, ne pourra que s'accroître, même si la bourgeoisie fait toutes les contorsions possibles pour le dissimuler et même si, pour l'instant elle semble l'avoir stabilisé. A côté de toutes sortes d'autres attaques sur les salaires, les prestations sociales, la santé, les conditions de travail, il va constituer de plus en plus le principal moyen par lequel la classe dominante fera payer à ses exploités le prix de la faillite de son système.
Affrontements impérialistes
6) Si les différents secteurs nationaux de la bourgeoisie, afin d'éviter une explosion du capitalisme mondial, parviennent à s'imposer un minimum de coordination de leurs politiques économiques, il en est tout autrement dans le domaine des rapports impérialistes. Les événements depuis un an ont confirmé pleinement la résolution du 12e Congrès du CCI :
« ... cette tendance au "chacun pour soi", au chaos dans les relations entre Etats, avec son cortège d'alliances de circonstances et éphémères, n'a nullement été remise en cause, bien au contraire. » (point 10)
« En particulier, la première puissance mondiale est confrontée, depuis qu'a disparu la division du monde en deux blocs, à une contestation permanente de son autorité de la part de ses anciens alliés. » (point 11)
C'est ainsi qu'on a pu voir se poursuivre et même s'aggraver l'indiscipline d'Israël vis-à-vis du parrain américain, indiscipline illustrée encore dernièrement par l'échec de la mission au Moyen-Orient du négociateur Dennis Ross qui n'est pas parvenu à rétablir le moins du monde le processus de paix d'Oslo pièce maîtresse de la « pax americana » au Moyen-Orient. La tendance déjà constatée les années passées s'est donc pleinement confirmée :
« Parmi les autres exemples de la contestations du leadership américain il faut encore relever... la perte du monopole du contrôle de la situation au Moyen-Orient, zone cruciale s'il en est... » (point 12)
De même, on a pu voir la Turquie prendre ses distances avec son « grand allié » allemand (à qui elle reproche de l'empêcher d'entrer dans l'Union européenne) en même temps qu'elle tentait d'établir, pour son propre compte une coopération militaire privilégiée avec Israël.
Enfin, on a assisté à la confirmation de ce que le 12e congrès constatait également déjà :
« ... l'Allemagne, en compagnie de la France, a engagé un forcing diplomatique en direction de la Russie dont elle est le premier créancier et qui n'a pas tiré d'avantages décisifs de son alliance avec les Etats-Unis. » (point 15)
Le récent sommet de Moscou entre Kohl, Chirac et Eltsine a scellé une « troïka » qui rassemble deux des principaux alliés des Etats-Unis du temps de la « guerre froide » et celui qui, au lendemain de l'effondrement du bloc de l'Est, avait manifesté plusieurs années durant son allégeance au grand gendarme. Bien que Kohl ait affirmé que cette alliance n'était dirigée contre personne, il est clair que c'est sur le dos des intérêts américains que se sont entendus les trois larrons.
7) La manifestation la plus criante de la contestation du leadership américain a été l'échec lamentable en février 1998 de l'opération « Tonnerre du désert » visant à infliger une nouvelle « punition » à l'Irak et, au delà de ce pays, aux puissances qui le soutiennent, notamment la France et la Russie. En 1990-91, les Etats-Unis avaient piégé l'Irak en le poussant à envahir un autre pays arabe, le Koweït. Au nom du « respect du droit international » ils avaient réussi à rassembler derrière eux, bon gré mal gré, la presque totalité des Etats arabes et la totalité des grandes puissances, y compris les plus réticentes comme la France. L'opération « Tempête du désert » avait permis d'affirmer le rôle de seul « gendarme du monde » de la puissance américaine ce qui lui avait ouvert la porte, malgré les embûches qu'elle n'allait pas tarder à rencontrer dans l'ex-Yougoslavie, au processus d'Oslo. En 1997-98, c'est l'Irak et ses « alliés » qui ont piégé les Etats-Unis. Les entraves de Saddam Hussein à la visite des « sites présidentiels » (qui ne contenaient aucune installation contrevenant aux résolutions des Nations-Unies, comme on vient de le constater) ont conduit la super puissance à une nouvelle tentative d'affirmer son autorité par la force des armes. Mais cette fois-ci, elle a dû renoncer à son entreprise face à l'opposition résolue de la presque totalité des Etats arabes, de la plupart des grandes puissances et au soutien (timide) de la seule Grande-Bretagne. Au bilan, le petit frère de la « Tempête du désert » a été bien loin de ressembler au « Tonnerre » qu'il voulait être. Il a pris l'allure d'un pétard mouillé qui n'a même pas épargné à la première puissance mondiale l'affront de voir le Secrétaire général des Nations-Unies se rendre à Bagdad dans l'avion personnel du président français et rencontrer ce dernier avant et après sa mission. Ce qui devait constituer une punition pour l'Irak et la France, notamment, s'est converti en une victoire diplomatique de ces deux pays. Le contraste entre le sort de la « Tempête du désert » et le « Tonnerre » du même nom permet de mesurer la crise actuelle du leadership des Etats-Unis, une crise que n'a pas démenti le demi échec de la tournée africaine de Clinton, fin mars, qui se proposait de consolider l'avancée opérée au détriment de la France avec le renversement du régime de Mobutu en 1996. Ce qu'a surtout révélé ce voyage, c'est que les Etats africains, et particulièrement le plus puissant d'entre eux, la République Sud-africaine, entendent de plus en plus jouer eux aussi leur propre jeu indépendamment de la tutelle des grandes puissances.
8) Ainsi, les derniers mois ont pleinement confirmé ce qui avait été relevé par le passé :
« Pour ce qui concerne la politique internationale des Etats-Unis, l'étalage et l'emploi de la force armée non seulement fait partie depuis longtemps de ses méthodes, mais elle constitue maintenant le principal instruments de défense de ses intérêts impérialistes, comme le CCI l'a mis en évidence depuis 1990, avant même la guerre du Golfe. Face à un monde dominé par le "chacun pour soi", où notamment les anciens vassaux du gendarme américain aspirent à se dégager le plus possible de la pesante tutelle de ce gendarme qu'ils avaient dû supporter face à la menace du bloc adverse, le seul moyen décisif pour les Etats-Unis d'imposer leur autorité est de s'appuyer sur l'instrument pour lesquels ils disposent d'une supériorité écrasante sur tous les autres Etats : la force militaire. Ce faisant, les Etats-Unis sont pris dans une contradiction :
– d'une part, s'ils renoncent à la mise en oeuvre ou à l'étalage de leur supériorité militaire, cela ne peut qu'encourager les pays qui contestent leur autorité à aller encore plus loin dans cette contestation ;
– d'autre part, lorsqu'ils font usage de la force brute, même et surtout quand ce moyen aboutit momentanément à faire ravaler les velléités de leurs opposants, cela ne peut que pousser ces derniers à saisir la moindre occasion pour prendre leur revanche et tenter de se dégager de l'emprise américaine. (...)
C'est pour cela que les succès de la contre-offensive actuelle des Etats-Unis ne sauraient être considérés comme définitifs, comme un dépassement de la crise de leur leadership. La force brute, les manoeuvres visant à déstabiliser leurs concurrents (comme aujourd'hui au Zaïre), avec tout leur cortège de conséquences tragiques n'ont donc pas fini d'être employés par cette puissance, bien au contraire, contribuant à accentuer le chaos sanglant dans lequel s'enfonce le capitalisme. » (point 17)
Si les Etats-Unis n'ont pas eu l'occasion, au cours de la dernière période, d'employer la force de leurs armes et de participer directement à ce « chaos sanglant », cela ne peut être que partie remise, dans la mesure, notamment, où ils ne pourront pas rester sur l'échec diplomatique essuyé en Irak.
Pour sa part, l'enfoncement du monde capitaliste, sur fond des antagonismes entre grandes puissances, dans la barbarie guerrière et les massacres s'est poursuivi, comme l'a illustré notamment la situation en Algérie et, tout récemment, les affrontements au Kosovo qui viennent rallumer le feu dans cette poudrière que constituent les Balkans. Dans cette partie du monde, les antagonismes entre, d'un côté l'Allemagne et de l'autre, la Russie, la France et la Grande-Bretagne, traditionnels alliés de la Serbie, ne pouvaient laisser un long répit à la paix de Dayton. Même si la crise du Kosovo ne dégénère pas immédiatement, elle est un indice probant qu'il n'y a pas de paix stable et solide aujourd'hui, en particulier dans cette région qui constitue une des principales poudrières du monde de par sa place en Europe.
Lutte de classe
9) « Ce chaos général, avec son cortège de conflits sanglants, de massacres, de famines, et plus généralement, la décomposition qui envahit tout les domaines de la société et qui risque, à terme, de l'anéantir, trouve son aliment principal dans l'impasse totale dans laquelle se trouve l'économie capitaliste. Mais en même temps, cette impasse, avec les attaques permanentes et de plus en plus brutales qu'elle provoque nécessairement contre la classe productrice de l'essentiel de la richesse sociale, le prolétariat, porte avec elle la riposte de ce dernier et la perspective de son surgissement révolutionnaire. » (point 19)
Provoquée par les premières manifestations de la crise ouverte de l'économie capitaliste, la reprise historique de la classe ouvrière à la fin des années 1960 avait mis fin à quatre décennies de contre-révolution et avait empêché le capitalisme d'apporter sa propre réponse à la crise : la guerre impérialiste généralisée. Malgré des moments de recul, les combats ouvriers s'étaient inscrits dans une tendance générale à se détacher de l'emprise des organes d'encadrement de l'Etat capitaliste, notamment les syndicats. Cette tendance a été brutalement stoppée avec les campagnes qui ont accompagné l'effondrement des prétendus « régimes socialistes » à la fin des années 1980. La classe ouvrière a subi un recul important, tant au niveau de sa combativité que de sa conscience : « dans les principaux pays du capitalisme, la classe ouvrière se retrouve ramenée à une situation comparable à celle des années 1970 en ce qui concerne ses rapports aux syndicats et au syndicalisme : une situation où la classe, globalement, luttait derrière les syndicats, suivait leurs consignes et leurs mots d'ordre et, en fin de compte, s'en remettait à eux. En ce sens, la bourgeoisie a momentanément réussi à effacer des consciences ouvrières les leçons acquises au cours des années 1980, suite aux expériences répétées de confrontation aux syndicats. » (« Résolution sur la situation internationale du 12e Congrès de la section en France », point 12)
Depuis 1992, le prolétariat a repris le chemin des combats de classe mais du fait de l'ampleur du recul qu'il a subi et du poids de la décomposition générale de la société bourgeoise qui entrave sa prise de conscience, le rythme de cette reprise se distingue par sa lenteur. Cependant, sa réalité se confirme totalement non pas tant par les luttes ouvrières qui, pour le moment sont encore très faibles, mais par toutes les manoeuvres que déploie depuis plusieurs années la bourgeoisie :
« Il s'agit pour la classe dominante, pleinement conscience du fait que ses attaques croissantes contre la classe ouvrière vont provoquer de la part de cette dernière des ripostes de grande envergure, de prendre les devants à un moment où la combativité n'est encore qu'embryonnaire, où pèsent encore fortement sur la conscience les séquelles de l'effondrement des prétendus régimes "socialistes", afin de "mouiller la poudre" et de renforcer au maximum son arsenal de mystifications syndicalistes et démocratiques. » (point 21)
Cette politique de la bourgeoisie s'est notamment illustrée une nouvelle fois, au cours de l'été 1997, avec la grève de UPS aux Etats-Unis qui s'est soldée par une « grande victoire » des... syndicats. Elle s'est confirmée avec les grandes manoeuvres qui, dans plusieurs pays européens, ont entouré et continuent d'entourer la question du chômage.
10) Une nouvelle fois, c'est de façon coordonnée entre différents pays que la classe dominante prend en charge la réponse politique au mécontentement croissant que provoque la montée inexorable du fléau du chômage. D'une part, dans des pays comme la France, la Belgique et l'Italie, on lance de grandes campagnes sur le thème des 35 heures de travail hebdomadaire censés permettre la création de centaines de milliers d'emplois. D'autre part, en France et en Allemagne, on voit se développer, sous l'égide des syndicats et de différents « comités » inspirés par les gauchistes, des mouvements de chômeurs, avec occupations de lieux publics et manifestations de rue. En réalité, ces deux politiques sont complémentaires. La campagne sur les 35 heures, et la mise en place effective de cette mesure comme le gouvernement de gauche l'a décidé en France, permet :
– de « démontrer » qu'on peut « faire quelque chose » pour créer des emplois ;
– de mettre en avant une revendication « anti-capitaliste », puisque les patrons se déclarent hostiles à cette mesure ;
– de justifier toute une série d'attaques contre la classe ouvrière qui seront la contrepartie de la réduction des horaires (intensification de la productivité et des rythmes de travail, blocage des salaires, plus grande « flexibilité » notamment avec l'annuarisation du temps de travail).
Pour sa part, la mobilisation des chômeurs par différentes forces de la bourgeoisie vise aussi plusieurs objectifs :
– à court terme, elle crée une diversion pour les secteurs de la classe ouvrière au travail et surtout, elle tente de les culpabiliser ;
– à plus long terme, et surtout, elle a pour objectif de développer des organes de contrôle des ouvriers au chômage qui, jusqu'ici, étaient relativement peu encadrés par les organes bourgeois spécialisés.
En fait, par ces manoeuvres amplement médiatisées, notamment à l'échelle internationale, la bourgeoisie fait la preuve qu'elle est consciente :
– de son incapacité à résoudre la question du chômage (ce qui veut dire qu'elle ne se fait pas beaucoup d'illusions sur la « sortie du tunnel » de la crise) ;
– que la situation actuelle de faible combativité des ouvriers au travail et de grande passivité des chômeurs ne va pas durer.
Le CCI a mis en évidence que, du fait du poids de la décomposition et des méthodes progressives avec lesquelles le capitalisme a mis des dizaines de millions d'ouvriers au chômage au cours des dernières décennies, les chômeurs n'ont pu s'organiser et participer au combat de classe (contrairement à ce qu'il firent dans certains pays au cours des années 1930). Cependant, nous avons mis en avant que, même s'ils ne pouvaient constituer une avant-garde dans les combats ouvriers, ils seraient conduits à rejoindre dans la rue les autres secteurs de la classe ouvrière quand ceux-ci se mobiliseraient massivement apportant au mouvement la forte combativité résultant de leur situation misérable, leur absence de préjugés corporatistes et d'illusions sur l'avenir de l'économie capitaliste. En ce sens, la manoeuvre actuelle de la bourgeoisie en direction des chômeurs signifie qu'elle s'attend à des combats de l'ensemble de la classe ouvrière et qu'elle se préoccupe que la participation des ouvriers sans travail à ces combats puisse être sabotée par des organes d'encadrement appropriés.
11) Dans cette manoeuvre, la classe dominante fait appel aux syndicats classiques mais aussi à des secteurs plus « à gauche » des appareils politiques bourgeois (anarcho-syndicalistes et trotskistes, « operaistes » et « autonomes ») car face aux chômeurs et à leur immense colère elle a besoin d'un langage plus « radical » que celui que tiennent traditionnellement les syndicats officiels. Ce fait illustre également un point figurant déjà dans la résolution adoptée par le 12e congrès du CCI : nous nous trouvons aujourd'hui dans un « moment charnière » entre deux étapes du processus de reprise de la lutte de la classe ouvrière, un moment où l'action du syndicalisme classique qui a tenu le haut du pavé au cours des années 1994-96 – et bien qu'il soit loin encore d'être discrédité – doit commencer à être complétée de façon préventive par celle du syndicalisme « radical », de « combat » ou « de base ».
12) Enfin, la poursuite par la bourgeoisie des campagnes idéologiques :
– sur le communisme, frauduleusement identifié au stalinisme (notamment le battage autour du Livre noir du communisme, traduit en plusieurs langues) et contre la Gauche communiste avec le battage anti-« négationniste » ;
– de défense de la démocratie comme unique « alternative » face aux manifestations de la décomposition et de la barbarie capitalistes ;
fait la preuve que la classe dominante, consciente des potentialités que recèle la situation actuelle et à venir, se préoccupe dès aujourd'hui de saboter les perspectives à long terme des combats prolétariens, le chemin vers la révolution communiste.
Face à cette situation, il appartient donc aux révolutionnaires :
– de mettre en avant la véritable perspective communiste contre toutes les falsifications abondamment diffusées par les défenseurs de l'ordre bourgeois ;
– de montrer le cynisme des manoeuvres de la bourgeoisie quie appellent le prolétariat à défendre la démocratie contre le danger « fasciste », « terroriste », etc. ;
– de dénoncer toutes les manoeuvres déployées dans le but de crédibiliser et renforcer les appareils de nature syndicale destinés à saboter les futures luttes ouvrières ;
– d'intervenir envers les petites minorités dans la classe qui expriment un questionnement en lien avec l'impasse historique du capitalisme et la perspective prolétarienne ;
– de renforcer l'intervention dans le développement inéluctable de la lutte de classe.
Vie du CCI:
- Résolutions de Congrès [131]
Questions théoriques:
- Décadence [32]
Chine : maillon de l'impérialisme mondial (III)
- 3975 reads
LE MAOISME, UN REJETON MONSTRUEUX DU CAPITALISME DECADENT
Après avoir ébauché l'histoire de la révolution prolétarienne en Chine (1919-1927) et l'avoir clairement distinguée de la période de contre-révolution et de guerre impérialiste qui lui succéda (1927-1949) [1] [3402], après avoir mis en évidence que la soi-disant « révolution populaire chinoise » construite sur la défaite de la classe ouvrière ne fut jamais qu'une mystification de la bourgeoisie pour embrigader les masses paysannes chinoises dans la guerre impérialiste, il nous reste à présent à mettre en évidence les aspects centraux de cette mystification : Mao Zedong lui-même en tant que « leader révolutionnaire » et le maoïsme en tant que théorie révolutionnaire qui, de plus, prétend être un « développement » du marxisme. Dans cet article, nous nous proposons de montrer ce que le maoïsme n'a jamais cessé d'être, c'est-à-dire un courant idéologique et politique bourgeois issu des entrailles du capitalisme décadent.
Contre-révolution et guerre impérialiste : les accoucheuses du maoïsme
Le courant politique de Mao Zedong au sein du Parti communiste de Chine (PCCh) n'apparaît que dans les années 1930, en pleine période de contre-révolution et alors que le PCCh a été d'abord défait, physiquement décimé puis devenu un organe du capital. Mao constitua une des nombreuses coteries qui pullulèrent alors pour se disputer le contrôle du parti et qui ne faisaient que révéler sa dégénérescence. C'est dire déjà que, dès ses origines, le maoïsme n'a rien à voir avec la révolution prolétarienne, si ce n'est qu'il a germé au coeur même de la contre-révolution qui écrasa celle-ci.
Par ailleurs, Mao Zedong ne prit le contrôle du PCCh qu'en 1945, date à partir de laquelle le « maoïsme » devint sa « doctrine » officielle, après avoir liquidé une autre coterie jusqu'alors dominante, celle de Wang Ming et alors que le PCCh participait pleinement aux sinistres jeux de la guerre mondiale impérialiste. Dans ce sens, l'ascension de la bande de Mao Zedong est le produit direct de sa complicité avec les grands brigands impérialistes.
Tout ceci semblera très surprenant à quelqu'un qui ne connaîtrait l'histoire de la Chine au 20e siècle qu'à travers les « oeuvres » de Mao ou qui n'aurait lu que les manuels d'histoire bourgeois. Il faut dire que Mao Zedong a poussé à un tel niveau l'art de falsifier l'histoire de la Chine et du PCCh (il a bénéficié de l'expérience du stalinisme et des bandes qui l'avaient précédé au pouvoir dès 1928) que le simple fait aujourd'hui d'exposer les événements tels qu'ils se sont déroulés semble être de l'affabulation.
Cette immense falsification se fonde sur le caractère bourgeois et profondément réactionnaire de l'idéologie de Mao Zedong. En réécrivant l'histoire afin d'apparaître aux yeux du monde comme le leader infaillible et éternel du PCCh, Mao Zedong était bien sûr motivé par l'ambition de renforcer son propre pouvoir politique ; mais les intérêts fondamentaux de la bourgeoisie s'y retrouvaient également dans la mesure où il était indispensable, à long terme, d'effacer pour toujours, si possible, les leçons historiques que le prolétariat avait pu tirer de son expérience au cours des années 1920, et parce qu'à court terme, il fallait à tout prix pousser les masses ouvrières et paysannes à participer à la boucherie impérialiste. Ces deux objectifs ont été parfaitement remplis par le maoïsme.
La participation de Mao Zedong à la liquidation du parti prolétarien
Le tissu de mensonges qui habille la légende de Mao Zedong commence déjà par le voile pudique jeté sur ses obscures origines politiques. Les historiens maoïstes ont beau répéter à satiété que Mao fut un des « fondateurs » du PCCh, ils n'en sont cependant pas moins extrêmement discrets sur son activité politique tout au long de la période ascendante des luttes de la classe ouvrière. Ils devraient avouer que Mao faisait partie de l'aile opportuniste du PCCh, celle qui suivait aveuglément toutes les orientations du Comité exécutif de l'Internationale communiste en pleine dégénérescence. Plus précisément, ils devraient aussi avouer que Mao faisait partie du groupe du PCCh qui entra au Comité exécutif du Guomindang, le Parti national populaire de la grande bourgeoisie chinoise, en 1924, sous le prétexte pour le moins fallacieux que celui-ci n'aurait pas été un parti bourgeois mais un « front de classe ».
En mars 1927, à la veille de l'écrasement sanglant de l'insurrection de Shangaï par les troupes du Guomindang, alors que l'aile révolutionnaire du PCCh exigeait désespérément la rupture de l'alliance avec ce dernier, Mao Zedong chantait à l'unisson avec le choeur des opportunistes les louanges du boucher Tchang kaï-chek et se revendiquait des actions du Guomindang [2] [3403].
Peu après, Qu Qiubai, un des compagnons au Guomindang de Mao Zedong, fut nommé dirigeant du PCCh sous la pression des sbires de Staline récemment dépêchés en Chine. Sa mission essentielle était de faire porter toute la responsabilité de l'écrasement de l'insurrection prolétarienne sur le dos de Chen Duxiu - qui allait sympathiser avec l'Opposition de gauche de Trotsky et symbolisait un des courants qui luttaient contre les décisions opportunistes de l'IC [3] [3404] en l'accusant d'avoir sombré dans l'opportunisme et sous-estimé le mouvement paysan ! Le corollaire de cette politique fut la série d'aventures désastreuses, à laquelle Mao Zedong participa activement tout au long de la seconde moitié de l'année 1927, qui ne fit qu'accélérer la dispersion et l'anéantissement du PCCh.
Si l'on en croit l'histoire revue et corrigée par Mao en 1945, il aurait critiqué la « dérive opportuniste de gauche » défendue par Qu Qiubai. La vérité est que Mao Zedong fut un des fidèles partisans de cette politique, comme le révèle son Rapport sur Hunan dans lequel il prédit sans sourciller « le soulèvement impétueux de centaines de millions de paysans ». Cette prédiction se concrétisa par la « Révolte de la récolte d'automne », un des fiascos les plus significatifs de la politique « insurrectionniste » de Qu Qiubai. La classe ouvrière avait été écrasée et, avec elle, avait disparu toute possibilité de révolution victorieuse ; dans ces conditions, toute tentative de soulever la paysannerie ne pouvait être que criminelle et n'aboutir qu'à de nouveaux massacres. C'est ainsi que le fameux « soulèvement impétueux de centaines de millions de paysans » à Hunan se réduisit en fait à la grotesque et sanglante aventure de quelques cinq mille paysans et lumpens dirigés par Mao, qui s'acheva par la débandade des survivants vers les montagnes et la mise à l'écart de leur chef du Bureau politique du Parti.
Voila comment, pendant la période de révolution prolétarienne, Mao Zedong participa à la politique de l'aile opportuniste du PCCh, contribuant activement à la défaite de la classe ouvrière et à l'anéantissement du Parti communiste en tant qu'organisation du prolétariat.
La conversion du PCCh en parti bourgeois et la création de la bande de Mao
Nous avons examiné dans les articles précédents comment le Parti communiste de Chine fut exterminé physiquement et politiquement par l'action conjuguée de la réaction chinoise et du stalinisme. A partir de 1928, les ouvriers cessèrent de militer en masse en son sein. Alors commença à se constituer la fameuse Armée rouge avec l'embrigadement croissant de la paysannerie et du lumpen-prolétariat, quand le parti n'avait plus de communiste que le nom. Dans le PCCh commencèrent alors à émerger les éléments qui, dès le début, avaient été les plus éloignés de la classe ouvrière et bien sûr les plus proches du Guomindang. Le parti grossissait de l'adhésion de toutes sortes de déchets réactionnaires qui allaient des staliniens endoctrinés en URSS jusqu'à des généraux du Guomindang, en passant par des seigneurs de la guerre en recherche de territoire, des intellectuels patriotes et même des féodaux « éclairés » et des grands bourgeois. Au sein de ce nouveau PCCh, cette pléthore de canailles se livra une guerre à mort pour prendre le contrôle du parti et de l'Armée rouge.
Comme pour tous les partis de l'Internationale communiste, la contre-révolution se manifesta par la dégénérescence du PCCh et sa conversion en instrument du capital. Elle fit en outre de ces partis une terrible source de mystification pour l'ensemble de la classe ouvrière et de dévoiement de questions fondamentales comme celle de l'organisation révolutionnaire, de sa fonction et de son fonctionnement interne. Les idéologues officiels de la bourgeoisie n'ont fait que répercuter et amplifier ce travail de mystification. C'est ainsi que les historiens officiels présentent le PCCh de 1928 à nos jours comme un modèle de parti communiste : pour les défenseurs de la démocratie occidentale, les guerres de cliques au sein du PCCh sont la preuve du comportement pour le moins douteux des communistes et de la non validité du marxisme ; pour les défenseurs inconditionnels du maoïsme ces mêmes guerres de cliques correspondent à des luttes pour la défense de « la ligne politiquement correcte du génial président Mao ». Ces deux catégories d'idéologues, apparemment opposés, se partagent en fait le travail pour pousser dans le même sens, à savoir l'identification fallacieuse des organisations révolutionnaires du prolétariat avec leur contraire absolu : les organisations bourgeoises enfantées par la décadence du capitalisme et la contre-révolution bourgeoise. Ce qui reste certain, c'est que Mao Zedong ne pouvait développer toutes ses « potentialités » que dans le cadre putréfié d'un PCCh devenu bourgeois. Déjà lors de sa retraite « mythique » dans les montagnes de Xikang _- fuite désastreuse s'il en fut -, Mao s'était essayé aux pratiques de gangsters qui allaient lui servir pour contrôler le parti et l'armée. Il commença par pactiser avec les chefs de bandes qui contrôlaient la région pour les éliminer ensuite et s'assurer le contrôle complet de celle-ci. C'est à cette époque que naquit la bande de Mao, par son alliance avec celui qui sera son inséparable compagnon, Zhu De, un général ennemi de Tchang kaï-chek. Mao savait ramper devant des rivaux mieux placés, du moins tant qu'il n'avait pu les supplanter dans la hiérarchie du parti. Lorsque Qu Qiubai fut remplacé par Li Lisan, Mao prit parti pour la « ligne politique » de ce dernier qui, en fait, n'était rien d'autre que la poursuite de la politique « putschiste » de son prédécesseur. L'histoire réécrite par Mao nous enseigne qu'il s'opposa à son tour rapidement à Li Lisan. En réalité, il participa pleinement à une des tentatives désastreuses impulsées par l'IC de la « troisième période », par Boukharine (Lettre de l'IC d'octobre 1929) et par Li Lisan dès 1930, de faire « prendre les villes » par les guérilleros paysans.
A partir de 1930, Mao Zedong changea à nouveau son fusil d'épaule quand la coterie menée par Wang Ming - qui s'appelait « les étudiants de retour » (de retour de Russie) ou les « 28 bolcheviks » et qui, pendant deux ans, avaient été formés à Moscou - commença un nettoyage dans le Parti pour en prendre les rênes et destitua Li Lisan. A cette époque eut lieu le très obscur « incident de Fujian » : Mao Zedong réalisa une expédition punitive de grande envergure contre les membres du PCCh qui contrôlaient la région de Fujian qui étaient accusés, selon les versions, tantôt d'être des laquais de Li Lisan, tantôt de faire partie d'une Ligue antibolchevique ou encore d'être membres du Parti socialiste. Les faits ne furent à peu près dévoilés que des années après la mort de Mao. En 1982, une revue chinoise faisait état du fait que « les purges dans le Fujian occidental, qui durèrent quatorze mois et se concrétisèrent par des massacres dans toute la zone soviétique, commencèrent en décembre 1930 avec les incidents de Fujian. Un grand nombre de dirigeants et de militants du Parti furent accusés d'être membres du Parti socialiste et exécutés. On estime à quatre ou cinq mille le nombre des victimes. De fait, il n'y avait pas trace d'un quelconque Parti social-démocrate dans cette région... » [4] [3405]
C'est au prix de cette purge que Mao Zedong parvint à revenir en partie dans les bonnes grâces de la bande des « étudiants de retour » car, bien qu'il ait lui-même été accusé d'avoir suivi la ligne de Li Lisan et d'avoir commis des excès à Fujian, il ne fut ni liquidé ni déporté comme bien d'autres. Et s'il fût déposé de son commandement militaire, il n'en devint pas moins en compensation « Président des soviets » au cours de ce qui fut pompeusement nommé le Premier congrès des soviets en Chine à la fin de 1931 ; c'était un rôle « administratif », à la botte de la bande de Wang Ming.
A partir de là, Mao va chercher à la fois à renforcer sa propre bande et à tenter de diviser la clique dominante des « étudiants de retour ». Mais il resta dans un premier temps à la botte de celle-ci comme le démontre le fait qu'en 1933 l'alliance qu'il proposa avec le « Gouvernement de Fujian » (composé de généraux qui s'étaient rebellés contre Tchang kaï-chek) fut rejetée par Wang Ming, qui ne voulait pas porter préjudice aux traités existants entre l'URSS et Tchang kaï-chek. Mao dut se rétracter publiquement et accuser ce « gouvernement » de « tromper le peuple » [5] [3406]. Cela démontre aussi le fait que, bien qu'il fut nommé Président en 1934, c'était en réalité Chang Wen-tian, membre de la bande des « étudiants de retour » et premier ministre des « soviets », qui était le véritable homme fort du parti.
Dans la Longue marche avec la bande stalinienne
La légende de la « Révolution populaire chinoise » a toujours présenté la Longue marche comme la plus grande épopée « anti-impérialiste » et « révolutionnaire » de l'histoire. Nous avons déjà souligné que le véritable objectif de celle-ci était de transformer les guérillas paysannes, éparpillées dans une dizaine de régions du pays et plutôt orientées vers la lutte contre les grands propriétaires, en armée régulière et centralisée capable de livrer une guerre de positions; et cela dans le but d'en faire un instrument de la politique impérialiste chinoise. La légende nous raconte aussi que la Longue marche fut inspirée et dirigée par le Président Mao. Ce n'est pas tout à fait exact. Tout d'abord, Mao Zedong était malade et isolé politiquement par la bande de Wang durant toute la période de préparation et de mise en place de la Longue marche, dans l'incapacité « d'inspirer » quoi que ce soit. Ensuite, elle ne put être « dirigée » par quiconque, pas même Mao, tout simplement parce qu'il n'existait pas alors d'état-major centralisé de l'« Armée rouge » (sa constitution était d'ailleurs le but poursuivi par cette campagne), qu'elle n'était alors constituée que d'une dizaine de régiments isolés les uns des autres, sous des commandements plus ou moins indépendants. A cette époque, le seul élément de cohésion du PCCh et de l'« Armée rouge » était donné par la politique impérialiste de l'URSS, représentée par les « étudiants de retour ». Ceux-ci n'avaient de force que celle que leur procurait l'appui politique, diplomatique et militaire du régime de Staline. Et la légende nous « apprend » enfin que ce fut pendant la Longue marche que la « ligne correcte » de Mao Zedong l'emporta sur les « lignes incorrectes » de Wang Ming et de Zhang Kouo-t'ao. La vérité est qu'à ce moment-là la concentration de forces militaires aiguisa les rivalités au sommet pour la conquête du commandement central de l'« Armée rouge ». Mais il faut dire aussi, dans le respect de cette vérité, que, si Mao monta de quelques échelons au cours de ces luttes sordides, il le fit à l'ombre de la bande de Wang. Il faut d'ailleurs signaler deux anecdotes à ce sujet.
La première concerne la réunion de Zunyi en janvier 1935. Les maoïstes n'hésitent pas à la qualifier d'« historique » parce qu'il paraîtrait que Mao y prit le commandement de l'« Armée rouge ». Cette réunion ne fut en réalité qu'une conspiration (montée par les diverses bandes du détachement dans lequel voyageait Mao) au cours de laquelle Chang Wentian (un des « étudiants de retour ») fut nommé secrétaire du parti tandis que Mao reprenait les fonctions qu'il occupait avant sa destitution du Comité militaire. Ces nominations furent remises en cause peu après par une partie importante du parti, car la réunion de Zunyi n'avait pas valeur de Congrès ; elles seront une des causes de la scission du PCCh.
La seconde anecdote concerne les événements de la région du Sichuan, quelques mois plus tard. Plusieurs régiments de l'« Armée rouge » s'y étaient concentrés. C'est alors que Mao, soutenu par la bande des « étudiants de retour », tenta de prendre le commandement de l'ensemble de ces forces. Zhang Kuo-tao, vieux membre du PCCh – qui avait été au commandement d'une « base rouge » et qui dirigeait alors un régiment plus puissant que celui de Mao et Chang Wentian – s'opposa à cette nomination. Cela provoqua une querelle très violente qui s'acheva par une scission dans le parti et dans l'armée, qui se retrouvèrent dirigés par deux Comités centraux. Zhang garda sa position dans la région du Sichuan avec la majeure partie des forces qui y étaient concentrées. Et même des compagnons de Mao comme Liu Bocheng et le fidèle Zhu De (qui le suivait pourtant comme son ombre depuis la débandade du Xikang après 1927) passèrent du côté de Zhang Kouo-t'ao. Mao Zedong et Chang Wentian, à la tête de ce qui restait de leur propre régiment, quittèrent précipitamment la région et se réfugièrent dans la « base rouge » de Yan'an qui était le point de concentration définitif des régiments de l'« Armée rouge ».
Les forces demeurées au Sichuan restèrent isolées et furent peu à peu décimées, ce qui obligea les rescapés à rejoindre à leur tour Yan'an. Le destin de Zhang Kouo-t'ao était alors scellé : il fut immédiatement destitué de ses fonctions et il passa au Guomindang en 1938. C'est de ces événements qu'est née la légende maoïste du « combat contre le traître Zhang Kouo-t'ao ». A dire vrai, Zhang Kouo-t'ao n'avait pas le choix : s'il voulait sauver sa peau et échapper aux purges lancées par Mao à Shaanxi, il devait trouver l'appui de l'autre parti de la bourgeoisie. Mais il n'y avait pas la moindre différence de classe entre Mao et Zhang Kouo-t'ao, comme il n'y en avait aucune entre le PCCh et le Guomindang.
Il faut aussi signaler que c'est précisément au cours de cette période de concentration militaire à Sichuan que fut publié, faisant écho à la politique impérialiste de l'URSS proclamée par le 7e Congrès de l'internationale stalinienne en 1935, l'appel au front unique national contre le Japon, c'est-à-dire l'appel aux exploités pour qu'ils se mettent au service des intérêts de leurs exploiteurs. Le PCCh ne fait pas que réaffirmer sa nature bourgeoise par cet acte, il se signale particulièrement comme le principal fournisseur de chair à canon pour la guerre impérialiste.
Le contrôle de Yan'an et l'alliance avec le Guomindang
C'est à Yan'an, entre 1936 et 1945, pendant la guerre contre le Japon, que Mao Zedong s'attaqua au contrôle du PCCh et de l'« Armée rouge », en déployant toute une panoplie de ruses, de manoeuvres et en organisant des purges. On peut distinguer trois phases dans cette guerre clanique de Yan'an qui marque l'ascension de Mao : celle de l'élimination du groupe fondateur de la base de Yan'an, celle de la consolidation de la bande de Mao et celle des premiers affrontements ouverts contre la bande de Wang Ming qui se conclut par l'élimination de cette dernière.
Le maoïsme glorifie l'expansion de l'« Armée rouge » dans la région de Shaanxi en tant que produit de la lutte révolutionnaire des paysans. Nous avons déjà montré comment cette expansion se basait tant sur les méthodes d'embrigadement des paysans adoptées par le PCCh (alliance interclassiste, dans laquelle les paysans obtenaient une réduction d'impôt – assez modeste pour qu'elle soit acceptée par les grands propriétaires – en échange de leur mobilisation dans la boucherie impérialiste), que sur l'alliance avec les seigneurs de la guerre régionaux et le Guomindang lui-même. Les événements de 1936 sont assez révélateurs de cet aspect et ils montrent aussi comment fut liquidée l'ancienne direction de Yan'an.
Lorsque le régiment de Mao Zedong et de Chang Wentian parvint à Yan'an en octobre 1935, la région était déjà en proie aux luttes de factions : Liu Shidan, fondateur et dirigeant de la base depuis le début des années 1930, avait été victime des purges, torturé et emprisonné. Il reçut immédiatement l'appui et le soutien du régiment nouvellement arrivé et fut libéré, en échange bien sûr de sa subordination à Mao et à Chang Wentian.
Les troupes de Liu Shidan reçurent l'ordre au début de 1936 de lancer une expédition vers l'Est, vers Shansi, pour affronter un seigneur de la guerre (Yan Jishan) et les troupes du Guomindang qui lui prêtaient main-forte. L'expédition fut défaite et Liu Shidan y perdit la vie. Une autre expédition fut décidée vers l'Ouest qui connût le même sort. Ce sont ces événements, et en particulier la mort de Liu Shidan, qui permirent à Mao et à Chang Wentian de prendre le contrôle de la base de Shidan. Ce n'est pas sans rappeler la méthode qu'avait utilisé Mao pour prendre le contrôle des montagnes du Jinggang quelques années auparavant : il s'était tout d'abord allié avec les chefs de cette zone, mais leur prétendue « disparition malheureuse » permit à Mao de garder seul le commandement.
Tandis que les expéditions vers l'Est et vers l'Ouest étaient défaites, Mao établissait une alliance avec un autre seigneur de la guerre. La région de Sian, au Sud de Yan'an, était contrôlée par le soudard Yang Hucheng qui avait donné asile au gouverneur de Mandchourie Zhang Xueliang et à ses régiments après leur défaite contre le Japon. Mao entra en contact avec Yang Hucheng dès décembre 1935 et ils établirent quelques mois plus tard un pacte de non-agression. C'est sur la base de ce pacte qu'eut lieu « l'incident de Sian » que nous avons commenté dans la Revue internationale n° 84 : Tchang kaï-chek fut fait prisonnier par Yang Hucheng et Zhang Xueliang, qui voulaient le faire passer devant un tribunal pour sa collaboration avec les japonais. Mais sous la pression de Staline, sa capture ne servit qu'à négocier une nouvelle alliance entre le PCCh et le Guomindang.
Les maoïstes ont bien sûr tenté de faire passer les alliances du PCCh avec les « chefs de guerre » et avec le bourreau de Shangaï – alliances auxquelles participa directement Mao – pour une habile manoeuvre destinée à profiter des divisions existant dans les classes dominantes. Il est vrai que la bourgeoisie traditionnelle, les grands propriétaires et les militaires étaient divisés, mais non parce qu'ils auraient eu des intérêts de classe différents, ni même parce que certains auraient été progressistes et d'autres réactionnaires ou, comme le disait Mao, parce que certains étaient « sensés » et pas les autres. Leur division était basée sur la défense d'intérêts particuliers, les uns voyant d'un bon oeil l'unité de la Chine sous le contrôle du Japon parce que celui-ci leur permettait de garder ou d'obtenir un pouvoir régional, alors que les autres, qui avaient été déplacés, comme le seigneur de Mandchourie, cherchaient des appuis auprès des puissances ennemies du Japon.
Dans ce sens, l'alliance entre le PCCh et le Guomindang revêtait clairement un caractère bourgeois, impérialiste, allant jusqu'à se concrétiser par un pacte d'aide militaire de l'URSS à l'armée de Tchang kaï-chek – incluant la fourniture de centaines d'avions chasseurs et bombardiers et d'un convoi de deux cent camions – qui fut la principale source d'approvisionnement du Guomindang jusqu'en 1941. Parallèlement était établie une zone propre pour le PCCh, la mythique Shaanxi-Gansu-Ningxia, qui trouva son pendant dans l'intégration des principaux régiments de l'« Armée rouge » (le Huitième et le Quatrième régiments) dans la propre armée de Tchang kaï-chek et dans la participation d'une commission du PCCh dans le gouvernement du Guomindang.
Au niveau de la vie interne du PCCh, il faut signaler que les membres de la commission aux négociations et ensuite au gouvernement de Tchang représentaient tant les « étudiants de retour » (Po Ku et Wang Ming lui-même) que la bande à Mao (Zhou Enlai), ce qui confirme que Mao n'avait pas encore le contrôle du parti et de l'armée et qu'il se maintenait encore du côté des sbires déclarés de Staline, du moins en apparence.
La défaite de Wang Ming et le flirt avec les Etats-Unis
L'antagonisme entre Mao et les « étudiants de retour » se manifesta pour la première fois en octobre 1938, pendant le plénum du Comité central du PCCh. Mao profita du fiasco de la défense de Wuhan (siège du gouvernement du Guomindang attaqué par les japonais), dont Wang Ming avait la responsabilité, pour remettre en question l'autorité de celui-ci sur le Parti. Il dut cependant accepter la nomination de Chang Wentian comme Secrétaire général et attendre deux ans encore pour lancer son attaque définitive contre Wang Ming quand la guerre impérialiste permit de retourner la situation contre la bandes des « étudiants de retour ».
L'armée allemande envahit en effet l'URSS en 1941; et pour éviter d'ouvrir un nouveau front de guerre sur ses arrières, Staline opta pour la signature d'un pacte de non agression avec le Japon. La conséquence immédiate en fut la fin de l'aide militaire de l'URSS au Guomindang mais aussi, de ce fait, la paralysie de la fraction stalinienne de Wang Ming dans le PCCh et sa chute, celle-ci étant mise en demeure de « collaborer avec l'ennemi » japonais. Décembre fut marqué par l'attaque contre Pearl-Harbour et l'entrée en guerre des Etats-Unis contre le Japon pour le contrôle du Pacifique. Ces événements provoquèrent un grand mouvement du Guomindang et du PCCh vers les Etats-Unis, en particulier de la part de la bande de Mao.
Mao se jeta alors avec force contre la bande des « étudiants de retour » et leurs acolytes. Tel est le sens de la fameuse « campagne de rectification », campagne punitive qui dura de 1942 à 1945. Mao commença donc par s'en prendre aux dirigeants du parti, en particulier aux « étudiants de retour », en les traitant de « dogmatiques incapables d'appliquer le marxisme en Chine ». Profitant des rivalités existantes au sein de la bande de Wang, Mao parvint à retourner certains de ses membres, comme Liu Chaichi à qui il donna le poste de Secrétaire général du parti ou Kang Cheng qui devint l'inquisiteur chargé des « sales besognes », rôle qui avait auparavant été celui de Mao en 1930 à Fujian.
Toute la presse de la bande de Wang fut suspendue et seule la presse sous le contrôle de Mao fut dès lors autorisée. La bande de Mao prenait ainsi le contrôle des écoles du parti et des lectures des militants. La « purge » se renforça, donnant lieu à des arrestations et des persécutions qui s'étendirent à partir de Yan'an à tout le parti et à l'armée. Les « convaincus » (comme Chou Enlai) restèrent subordonnés à Mao. Les « récalcitrants » étaient, quant à eux, expédiés dans les zones de combat où ils tombaient inévitablement entre les mains des japonais quand ils n'étaient pas purement et simplement éliminés.
La « purge » atteint son apogée en 1943, coïncidant avec la dissolution officielle de la Troisième internationale et la médiation des Etats-Unis entre le Guomindang et le PCCh. Le nombre de personnes liquidées pendant la purge aurait atteint le nombre de cinquante à soixante mille. Les plus éminents membres des « étudiants de retour » étaient éliminés : Chang Wentian fut expulsé de Yan'an, Wang Ming survécut de justesse à un empoisonnement, Po Ku mourut mystérieusement en 1946 dans un « accident d'avion »...
La « campagne de rectification » correspond, dans le cadre de la guerre impérialiste, au virage qu'a fait le PCCh vers les Etats-Unis. Nous avons déjà abordé cet aspect dans la Revue internationale n° 84. Il faut juste préciser que c'est précisément Mao et sa bande qui impulsèrent ce virage, comme on peut le constater dans la correspondance de la mission officielle américaine à Yan'an à cette époque [6] [3407]. Et ce n'est pas un hasard si le combat contre la bande stalinienne correspond au rapprochement avec les Etats-Unis. Cela n'a évidemment pas fait de Mao un traître au « camp communiste » comme le prétendront plus tard Wang Ming et la clique gouvernant en Russie. Cela montre uniquement la nature bourgeoise de sa politique. Pour Tchang kaï-chek, comme pour toute la bourgeoisie chinoise Mao inclus, les chances de survie dépendaient de leur capacité à calculer froidement quelle puissance impérialiste il valait mieux servir, l'URSS ou les Etats-Unis.
Ce n'est pas non plus un hasard si le ton de la « rectification » est devenu plus modéré quand les probabilités de victoire de l'URSS en Allemagne se sont confirmées. La purge s'acheva « officiellement » en avril 1945, deux mois après la signature du Traité de Yalta dans lequel, entre autres, les puissances impérialistes « alliées » décidèrent que la Russie devait déclarer la guerre au Japon, précisément quand elle se disposait à envahir le Nord de la Chine. Voilà pourquoi le PCCh dut se tenir sous les ordres de l'URSS. Le retour temporaire de Mao dans le sérail de Staline ne se fit pas de son plein gré mais du fait de la nouvelle répartition impérialiste du monde entre les grandes puissances.
Le résultat final de la « rectification » n'en fut pas moins la prise de contrôle du PCCh et de l'armée par Mao et sa bande. Il créa pour lui-même le titre du Président du parti et proclama que le maoïsme, « la pensée de Mao Zedong », était « le marxisme appliqué en Chine ». Dès lors, les maoïstes recourront à la légende pour expliquer que Mao était parvenu au commandement suprême grâce à son génie théorique et stratégique, grâce à son combat contre les « lignes incorrectes ». C'est un pur mensonge ! A les en croire, Mao aurait été le fondateur de l'« Armée rouge », il aurait mis au point la réforme agraire, dirigé triomphalement la Longue Marche, mis en place les bases rouges etc. Voilà comment l'arriviste sournois et rusé Mao Zedong se fit passer pour un messie.
Le maoïsme : une arme idéologique du capital
Le maoïsme s'imposa donc comme « théorie », pendant la guerre impérialiste mondiale, dans un parti qui appartenait déjà à la bourgeoisie bien qu'il continuât à se dire communiste. Le maoïsme cherchait, à ses débuts, à justifier et à consolider la main mise de Mao Zedong et de sa bande sur tous les rouages du parti. Il devait aussi justifier la participation du parti à la guerre impérialiste, aux côtés du Guomindang, de la noblesse, des « chefs de guerre », de la grande bourgeoisie et enfin de l'ensemble des puissances impérialistes. Il fallait pour cela occulter les véritables origines du PCCh, de sorte que le maoïsme ne put se contenter de donner une « interprétation » particulière de la guerre clanique au sein du parti, il dut en outre déformer complètement l'histoire de celui-ci ainsi que celle de la lutte de classe. La défaite de la révolution prolétarienne et la dégénérescence du parti communiste de Chine furent soigneusement effacées; et la nouvelle identité du PCCh en tant qu'instrument du capital trouva sa justification « théorique » dans le maoïsme.
Sur cette base de falsification, le maoïsme montra ses capacités à être un instrument de plus de la propagande idéologique de la bourgeoisie utilisé pour mobiliser les travailleurs, et principalement les masses paysannes, sous les drapeaux patriotiques de la boucherie impérialiste. Enfin, quand le PCCh pris définitivement le pouvoir, le maoïsme devint la « théorie » officielle de « l'Etat populaire » chinois, c'est-à-dire de la forme de capitalisme d'Etat qui s'instaura en Chine.
Pour le reste, bien qu'elle fasse vaguement référence à un langage pseudo marxiste, la « pensée de Mao Zedong » ne peut cacher que ses sources se trouvent dans le camp de la bourgeoisie. Lorsqu'il participait à la coalition entre le Guomindang et le PCCh, Mao considérait déjà que la lutte de la paysannerie devait se plier aux intérêts de la bourgeoisie nationale, représentée par Sun Yat-sen : « Défaire les forces féodales est le véritable objectif de la révolution nationale (...) Les paysans ont compris ce que voulait mais ne put réaliser le Dr Sun Yat-sen durant les quarante années qu'il consacra à la révolution nationale » [7] [3408]. Les références aux principes de Sun Yat-sen resteront d'ailleurs au centre de la propagande maoïste pour embrigader les paysans dans la guerre impérialiste : « En ce qui concerne le Parti communiste, toute la politique qu'il a suivie ces dix dernières années correspondent fondamentalement à l'esprit révolutionnaire des Trois principes du peuple et des Trois grandes politiques du Dr Sun Yat-sen » [8] [3409]. « Notre propagande doit se faire en conformité avec ce programme : réaliser le Testament du Dr Sun Yat-sen en réveillant les masses à la résistance contre le Japon » [9] [3410].
Dans le premier article de cette série, nous avons déjà mis au clair qu'au cours des « quarante années qu'il consacra à la révolution nationale », Sun Yat-sen n'eut de cesse de trouver des alliances avec les grandes puissances impérialistes, y compris le Japon, que son « nationalisme révolutionnaire » n'était qu'une vaste mystification derrière laquelle se cachaient les intérêts impérialistes de la bourgeoisie chinoise, et ceci dès la « révolution » de 1911. Le maoïsme se borna à s'approprier cette mystification, c'est-à-dire à se mettre au diapason des vieilles campagnes idéologiques de la bourgeoisie chinoise.
Par ailleurs, la « pensée géniale de Mao Zedong » n'est, en grande partie, qu'un vulgaire plagiat des grossiers manuels staliniens officiels de cette époque. Mao adule Staline dont il fait un « grand continuateur du marxisme », ne serait-ce que pour reprendre à son compte la falsification éhontée du marxisme menée à terme par Staline et ses sbires. La soi-disant application du marxisme aux conditions de la Chine faite par le maoïsme n'est rien de plus que l'application des thèmes idéologiques de la contre-révolution stalinienne.
Une complète falsification du marxisme
Nous allons passer en revue quelques-uns des aspects essentiels de la prétendue application du marxisme revue et corrigée par « la pensée Mao Zedong ».
Sur la révolution prolétarienne
Etudier l'histoire de la Chine en se basant sur l'oeuvre de Mao Zedong ne permettra jamais à quiconque de savoir que la vague révolutionnaire prolétarienne mondiale déclenchée en 1917 eut des répercussions dans ce pays. Le maoïsme (et donc l'histoire officielle qu'elle soit ou non maoïste) a enterré corps et biens l'histoire de la révolution prolétarienne en Chine.
Quand Mao mentionne le mouvement ouvrier, ce n'est jamais que pour l'inclure dans la prétendue « révolution bourgeoise » : « La révolution de 1924-27 se fit grâce à la collaboration des deux partis – le PCCh et le Guomindang – se basant sur un programme défini. En deux ou trois ans à peine, la révolution nationale connût d'immenses succès (...) Ces succès se basèrent sur la création de la base de soutien révolutionnaire de Kouang-Tong et la victoire de l'Expédition du Nord » [10] [3411]. Tout ce qui est affirmé là est pur mensonge : la période allant de 1924 à 1927 ne se caractérise pas par la « révolution nationale » comme nous l'avons vu, mais par la montée de la vague révolutionnaire de la classe ouvrière dans toutes les grandes villes chinoises jusqu'à l'insurrection. La coopération entre le PCCh et le Guomindang, c'est-à-dire l'alignement opportuniste du parti prolétarien sur la bourgeoisie, ne fut pas à la base « d'énormes succès » mais bien de défaites tragiques pour le prolétariat. Et enfin, l'expédition du Nord, loin d'être une « victoire » de la révolution, ne fut qu'une manoeuvre d'encerclement de la bourgeoisie pour parvenir à contrôler les villes et massacrer la classe ouvrière. Et le point d'orgue de cette expédition fut précisément le massacre du prolétariat par le Guomindang.
Concernant 1926, c'est-à-dire en pleine effervescence du mouvement ouvrier, Mao ne put éviter de faire référence aux « grèves générales de Shangaï et de Hong-Kong, à l'origine des incidents du 30 mai » [11] [3412]. Mais dès 1939, il la réduisit à une simple manifestation de la petite bourgeoisie intellectuelle et il ne mentionna même pas l'insurrection historique de Shangaï en mars 1927, à laquelle participèrent près d'un million d'ouvriers [12] [3413].
L'enterrement méthodique de toute l'expérience et de l'importance historique et mondiale du mouvement révolutionnaire en Chine constitue un des aspects essentiels de la contribution « originale » du maoïsme à l'idéologie bourgeoise, dans le sens d'obscurcir la conscience de classe du prolétariat, même s'il n'est pas le seul à agir dans ce sens.
L'internationalisme
C'est là un des principes fondamentaux de la lutte historique du prolétariat, et donc un des principes de base du marxisme, qui contient en lui la question de la destruction des Etats capitalistes et le dépassement des barrières nationales imposées par la société bourgeoise. « L'internationalisme constitue, de façon indiscutable, une des pierres angulaires du communisme. Depuis 1848, il a été bien établi dans le mouvement ouvrier que "les prolétaires n'ont pas de patrie" (...) Si le capitalisme a trouvé dans la nation le cadre le plus approprié à son développement, le communisme ne peut s'instaurer qu'à l'échelle mondiale : la révolution prolétarienne détruira les nations. » (Introduction à notre brochure Nation ou classe ?).
Ce principe devient exactement son contraire entre les mains de Mao. Pour lui, patriotisme et internationalisme sont identiques : « Un communiste, internationaliste peut-il être en même temps patriote ? Non seulement il peut, mais il doit l'être (...) Dans les guerres de libération nationale, le patriotisme est l'application du principe internationaliste. (...) Nous sommes à la fois internationalistes et patriotes, et notre mot d'ordre est : "lutter contre l'agresseur pour défendre la patrie" » [13] [3414]. Rappelons simplement en passant que la « guerre nationale » en question n'est rien de moins que la seconde guerre mondiale ! Voilà comment l'embrigadement des travailleurs dans la guerre impérialiste devient une application de l'internationalisme prolétarien ! C'est en s'appuyant sur des mystifications aussi monstrueuses que la bourgeoisie parvint à pousser les ouvriers à s'entre-massacrer.
Et Mao Zedong n'a même pas la gloire d'être le premier à avoir formulé cette idée « ingénieuse » qui permet à « un internationaliste d'être en même temps patriote ». Il ne fait que reprendre le discours de Dimitrov, un des idéologues à la botte de Staline : « L'internationalisme prolétarien doit, pour ainsi dire, "s'acclimater" à chaque pays. (...) Les "formes" nationales de la lutte prolétarienne ne contredisent en rien l'internationalisme prolétarien. (...) La révolution socialiste signifiera le sauvetage de la nation » [14] [3415]. Et lui-même ne faisait d'ailleurs que reprendre les déclarations des social-patriotes, du style de Kautsky, qui envoyèrent le prolétariat se faire massacrer pendant la première boucherie mondiale, en 1914 : « Tous ont le droit et le devoir de défendre la patrie ; le véritable internationalisme consiste en reconnaître ce droit pour les socialistes de tous les pays » [15] [3416]. Sur cet aspect, c'est donc bien volontiers que nous reconnaissons l'évidente continuité non pas entre le maoïsme et le marxisme mais entre le maoïsme et les « théories » qui ont toujours tenté de déformer le marxisme au service du capital.
La lutte de classe
Nous avons déjà montré comment Mao Zedong a enterré toute l'expérience du prolétariat tout au long de son oeuvre. Et pourtant, il n'a jamais cessé de se référer à la « direction du prolétariat dans la révolution ».
Mais l'aspect le plus important de la « pensée de Mao Zedong » sur la lutte de classe est celui qui subordonne les intérêts des classes exploitées à ceux des classes exploiteuses : « C'est un principe établi maintenant que pendant la durée de la guerre de résistance contre le Japon, tout doit être abandonné dans l'intérêt de la victoire. Par conséquent, les intérêts de la lutte de classe doivent se subordonner aux intérêts de la guerre de résistance et ne pas entrer en conflit avec eux. (...) Il faut appliquer une politique appropriée de réajustement des rapports entre les classes, une politique qui ne laisse pas les masses travailleuses sans garanties politiques et matérielles, mais qui prenne en compte les intérêts des possédants » [16] [3417].
Voilà quel est le discours de Mao Zedong, celui d'un bourgeois nationaliste classique, qui exige des ouvriers le sacrifice suprême en échange de promesses sur les « garanties politiques et matérielles » mais dans le cadre de « l'intérêt national », c'est-à-dire dans le cadre des intérêts de la classe dominante. Il ne se distingue des autres que par le cynisme particulier qui lui permet de parler à ce propos « d'approfondissement du marxisme ».
L'Etat
Le fameux « développement du marxisme » que serait le maoïsme se retrouve dans la question de l'Etat à travers la théorie de la « nouvelle démocratie » présentée comme « la voie révolutionnaire » pour les pays sous-développés. A le lire, « la révolution de la nouvelle démocratie (...) ne mène pas à la dictature de la bourgeoisie, mais à la dictature du front uni des diverses classes révolutionnaires sous la direction du prolétariat. (...) Elle est différente aussi de la révolution socialiste dans le sens où elle ne peut que défaire la domination des impérialistes, des collaborationnistes et des réactionnaires en Chine, car elle n'élimine aucun des secteurs du capitalisme qui contribue à la lutte anti-impérialiste et antiféodale ».
Mao aurait donc découvert une nouvelle espèce d'Etat qui ne serait l'instrument d'aucune classe en particulier, qui serait un front ou une alliance interclassiste. C'est peut-être une nouvelle formulation de la vieille théorie de la collaboration de classes mais cela n'a rien à voir avec le marxisme. La théorie de la « nouvelle démocratie » n'est qu'une nouvelle édition de la démocratie bourgeoise qui prétend être le gouvernement du peuple, c'est-à-dire de toutes les classes, avec la particularité que Mao la nomme « front des diverses classes »; comme il le reconnaît lui-même : « La révolution de la nouvelle démocratie coïncide pour l'essentiel avec la révolution préconisée par Sun Yat-sen avec ses Trois principes du peuple. (...) Sun Yat-sen disait : "Dans les Etats modernes, le soi-disant système démocratique est en général monopolisé par la bourgeoisie et est devenu un simple instrument d'oppression contre le petit peuple. Par contre, le principe de démocratie défendu par le Guomindang défend un système démocratique aux mains de ce petit peuple et ne permet pas qu'il soit confisqué par quelques-uns" » [17] [3418].
Concrètement, la théorie de « la nouvelle démocratie » fut le moyen d'embrigader les populations en majorité paysannes dans les zones contrôlées par le PCCh. Elle devint par la suite le cache-sexe idéologique du nouveau capitalisme d'Etat qui s'instaura en Chine quand le PCCh prit le pouvoir.
Le matérialisme dialectique
Les « oeuvres philosophiques » de Mao Zedong ont été, pendant des années, caractérisées et enseignées dans les cercles universitaires comme de la « philosophie marxiste ». Non seulement la philosophie de Mao – malgré le langage pseudo marxiste qu'il prétend utiliser – n'a rien à voir avec la méthode marxiste, mais en outre elle lui est totalement antagonique. La philosophie de Mao, tout juste inspirée par les manuels de vulgarisation staliniens de l'époque, n'est rien d'autre qu'un moyen pour justifier les contorsions politiques de son créateur. Prenons par exemple la rhétorique embarrassée avec laquelle il aborde la question des contradictions : « Dans le processus de développement d'une chose complexe se trouvent beaucoup de contradictions, et l'une d'elles est nécessairement la principale, dont l'existence et le développement déterminent ou influent sur l'existence et le développement des autres. (...) Un pays semi-colonial comme la Chine donne un cadre complexe au rapport entre la contradiction principale et les contradictions secondaires. Quand l'impérialisme déchaîne une guerre contre un tel pays, les différentes classes qui composent ce dernier (à l'exception d'un petit nombre de traîtres) peuvent s'unir momentanément dans une guerre nationale contre l'impérialisme. La contradiction entre l'impérialisme et le pays en question devient alors la contradiction principale, reléguant temporairement les contradictions entre les différentes classes du pays à une niveau secondaire et subordonné. (...) Telle est la situation dans l'actuelle guerre sino-japonaise ».
En d'autres termes, la « théorie » maoïste des « contradictions qui se déplacent » revient simplement à dire que le prolétariat peut et doit abandonner son combat contre la bourgeoisie au nom de l'intérêt national, que les classes antagoniques peuvent et doivent s'unir dans le cadre de la boucherie impérialiste, que les classes exploitées peuvent et doivent se plier aux intérêts des classes exploiteuses. On comprend mieux pourquoi la bourgeoisie de tous les pays a répandu la philosophie maoïste dans les universités en la présentant comme du marxisme !
En résumé, nous dirons que le maoïsme n'a rien à voir ni avec la lutte, ni avec la conscience, ni avec les organisations révolutionnaires de la classe ouvrière. Il n'a rien à voir avec le marxisme, il n'est ni une partie ni une tendance de celui-ci, ni un développement de la théorie révolutionnaire du prolétariat. Tout au contraire, le maoïsme n'est qu'une grossière falsification du marxisme, sa seule fonction est d'enterrer tous les principes révolutionnaires, d'obscurcir la conscience de classe du prolétariat pour la remplacer par la plus stupide et bornée idéologie nationaliste. Comme « théorie », le maoïsme n'est qu'une des misérables formes qu'a été capable d'adopter la bourgeoisie dans sa période de décadence, pendant la contre-révolution et la guerre impérialiste.
Ldo.
Chen Duxiu et l'Opposition de gauche
Chen Duxiu (1879-1942) est d'abord le fondateur d'un courant novateur et occidentaliste La Nouvelle Jeunesse en 1915, qui se radicalise dans le « mouvement du 4 Mai » à Pékin. Il est ensuite à l'initiative de la Ligue de la jeunesse socialiste, précurseur du PCCh en 1920. Enfin il fonde le PCCh en juillet 1921 et il en devient le premier secrétaire. Il accepte sur les insistances du Komintern la politique de collaboration avec le Guomindang en misant sur la possibilité de le contrôler de l'intérieur. Mais à l'inverse de Mao Zedong il ne croit pas aux potentialités révolutionnaires des paysans. Il est exclu du PCCh lors du 6e congrès de l'Internationale communiste en 1929 (congrès auquel il n'assiste pas) en même temps que les militants qui ont signé avec lui une demande de discussion générale au sein du parti pour un réexamen de ses positions politiques. C'est à cette époque qu'il rencontre des trotskistes revenant de Moscou qui venaient de fonder le journal Wo-men Ti-hua (Notre parole). Fort de cet appui il dénonce l'aventurisme du PCCh inféodé au Komintern stalinisé. Il est arrêté par le Guomindang en 1932 et condamné à quinze ans d'emprisonnement. Lors de l'entrée en guerre de la Chine contre le Japon en 1937 il est libéré. Il annonce qu'il rejoint le front uni anti-japonais. Dès lors il passe dans le camp de la défense de la nation et de la bourgeoisie, comme le PCCh stalinien. Il est clair qu'en Extrême-Orient la 2e guerre mondiale a commencé dès 1937.
L'organisation de l'Opposition de gauche du PCCh se développe dès 1928 sur la base d'une discussion sur la défaite de 1927 et de la publication de textes de Trotsky sur la Chine. Il s'agit d'un groupe de militants prestigieux du PCCh qui publient La Force motrice. Chen Duxiu se dit d'accord avec les positions de Trotsky sans se déclarer comme trotskiste. L'Opposition de gauche est divisée en quatre : l'«Association prolétarienne » de Chen Duxiu et Peng Shu-tse qui diffuse Le Prolétaire ; Notre Parole (Wo-men Ti-hua), groupe de Shangaï ; Octobre (Chan-tou She), groupe de Liu Jen Ching ; et Militant. (Cf. Leon Trotsky on China, Pathfinder, New York 1976, Introduction de Peng Shu-tse)
L'unification intervient en 1931 avec la fondation de la Ligue communiste de Chine (LCC). Mais lors de l'agression de la Chine par le Japon, la majorité de la LCC est d'accord pour soutenir la Résistance et passe de ce fait dans le camp ennemi, celui de la bourgeoisie. Seuls Zheng Chaolin, Wang Fanxi et une poignée de militants restent fidèles aux principes révolutionnaires et internationalistes et se réclament du « défaitisme révolutionnaire ». Ils publient L'Internationaliste et soutiennent que le conflit fait partie d'une 2e guerre mondiale imminente.
Zheng Chaolin continue la publication de L'Internationaliste et boycotte le 2e congrès de la LCC en août 1941. Sa position politique est cohérente, alors que Wang Fanxi accepte de participer à ce congrès, en faisant une distinction : il est pour la guerre « de défense » d'un pays attaqué mais il refuse de participer à la guerre impérialiste au cas où les puissances anglo-saxonnes rentreraient en guerre contre le Japon. Finalement sa fraction minoritaire est exclue et battue au cours du congrès par le trotskiste Peng Shu-tse.
Nous saluons cette poignée d'internationalistes qui ont su maintenir haut le drapeau communiste et internationaliste comme la gauche communiste italienne l'a fait en Europe, alors que ces éléments révolutionnaires isolés traversaient la période la plus noire du mouvement ouvrier. Les trotskistes chinois, dans leur journal clandestin La Lutte qualifièrent leur ralliement à la Résistance anti-japonaise de « victorisme révolutionnaire ». Quel pathos pour ce ralliement honteux à la bourgeoisie nationale !
[2] [3420] Rapport sur une enquête du mouvement paysan du Hunan, Mao Zedong, mars 1927.
[13] [3431] Le rôle du PCCh dans la guerre nationale, Mao Zedong, octobre 1938.
[14] [3432] Fascisme, démocratie et Front populaire, rapport présenté par Georgi Dimitrov au 7e Congrès de l'Internationale communiste, août 1935.
[15] [3433] Cité par Lénine dans La faillite de la deuxième Internationale, septembre 1915.
[16] [3434] Le rôle du PCCh dans la guerre nationale, Op. cité.
[17] [3435] La révolution chinoise et le PCCh, Op. cité.
Géographique:
- Chine [1980]
Courants politiques:
- Maoïsme [1983]
Le communisme n'est pas un bel idéal, il est à l'ordre du jour de l'histoire [4° partie]
- 3168 reads
La Plate-forme de l'Internationale Communiste
Introduction du CCI
Parallèlement à la série d'articles « Le communisme n'est pas un bel idéal, il est à l'ordre du jour de l'histoire », nous publions certains documents du mouvement révolutionnaire au 20e siècle liés aux moyens et aux buts de la révolution prolétarienne. Nous commençons par la plate-forme de l'Internationale Communiste adoptée lors de son congrès de fondation, en mars 1919, comme base d'adhésion de tous les groupes et courants authentiquement révolutionnaires au nouveau parti mondial.
L'année 1919 a marqué le zénith de la grande vague révolutionnaire qui s'est développée dans le sillage de la guerre impérialiste de 1914-18. Sous la direction du parti bolchevik, l'insurrection d'Octobre en Russie et la prise du pouvoir par le prolétariat organisé en conseils ouvriers ont allumé une flamme qui a menacé d'embraser le monde capitaliste. Entre 1918 et 1920, au coeur du capitalisme mondial, l'Allemagne a vu se développer une série de surgissements révolutionnaires ; des grèves de masse ont éclaté dans les principales villes industrielles de l'Italie à l'Ecosse, des Etats-Unis à l'Argentine. Au moment où se tenait le premier congrès de l'Internationale, arrivait la nouvelle de la proclamation de la République hongroise des soviets.
Mais, dans le même temps, d'autres événements qui ont eu lieu juste avant ce congrès démontraient les graves conséquences qui pourraient en résulter si ce mouvement de masse croissant n'était pas guidé par un parti communiste clair programmatiquement et internationalement centralisé. La défaite du soulèvement de Berlin en janvier 1919, marqué notamment par l'assassinat de Luxemburg et Liebknecht, a été en grande partie le résultat de l'incapacité du KPD naissant à détourner les ouvriers des pièges tendus par la bourgeoisie et à les amener à préserver leurs forces pour un moment plus propice. La fondation de l'IC correspondait donc aux besoins les plus urgents de la lutte de classe. Elle a été le couronnement du travail inlassable mené par la gauche révolutionnaire depuis l'effondrement de la 2e Internationale en 1914.
Mais loin d'être une direction imposée de l'extérieur, l'IC constituait elle-même un produit organique du mouvement prolétarien. La clarté de ses positions programmatiques en 1919 reflétait son lien étroit avec les forces les plus profondes à l'oeuvre dans la vague révolutionnaire. De même, sa dégénérescence opportuniste ultérieure fut intimement liée au déclin de cette vague et à l'isolement du bastion russe.
Le projet de plate-forme a été rédigé par Boukharine et le délégué du KPD Eberlein qui, de plus, ont eu la responsabilité d'en présenter les principaux points au congrès. Les remarques introductives faites par Boukharine méritent d'être rappelées parce qu'elles montrent comment la plate-forme intégrait certaines des avancées théoriques les plus importantes accomplies par le mouvement communiste au sortir du naufrage de la social-démocratie :
« D'abord, l'introduction théorique. Celle-ci donne la caractéristique générale de l'époque tout entière, sous un angle très particulier, à savoir sous l'angle de l'effondrement du système capitaliste. Auparavant, lorsqu'on écrivait de telles introductions, on donnait simplement une description générale du système capitaliste. A mon avis, cela ne suffit plus aujourd'hui. Nous devons non seulement donner la caractéristique générale du système capitaliste et impérialiste, mais décrire également le processus de désagrégation et d'effondrement de ce système. C'est le premier point de vue. L'autre est que nous devons considérer le système capitaliste, non pas seulement dans sa forme abstraite, mais également pratique en tant que capitalisme mondial, et que nous devons considérer celui-ci comme une totalité économique. Si nous considérons à présent ce système capitaliste économique mondial du point de vue de son effondrement nous devons poser la question suivante : comme cet effondrement a-t-il été rendu possible ? Et il s'agit alors en premier lieu d'analyser les contradictions du système capitaliste » (Procès-verbal du premier congrès de l'IC; Rapport sur la plate-forme.)
Boukharine continue en soulignant également que, dans cette époque de désintégration, « la forme primitive du capital, du capital dispersé et inorganisé, a presque disparu. Ce processus avait déjà commencé avant la guerre et s'est renforcé au cours de la guerre. Cette guerre a joué un grand rôle d'organisation. Sous sa pression, la forme du capitalisme financier s'est transformée en une forme supérieure, la forme du capitalisme d'Etat. »
Ainsi, dès le début, l'IC s'est fondée sur la compréhension que, du fait même que le capitalisme développait son économie au niveau mondial, il atteignait ainsi ses limites géographiques et entrait dans sa période de déclin historique. Cela remet à leur place tous les actuels tenants de la « modernité » qui imaginent que la « globalisation » est une nouveauté et que celle-ci va donner un nouveau souffle au capitalisme ! Mais c'est aussi un rappel pénible pour ces organisations révolutionnaires (de tradition bordiguiste notamment) qui se revendiquent des positions programmatiques de l'IC et qui rejettent cependant la notion de décadence du capitalisme qui est la pierre de touche de la politique révolutionnaire aujourd'hui. Il en va de même pour la notion de capitalisme d'Etat que Boukharine a de façon centrale contribué à élaborer ; nous aurons l'occasion de revenir sur sa signification dans la suite de notre série sur le communisme. Il suffit de dire ici que l'Internationale considérait qu'elle était assez importante pour l'inclure comme caractéristique fondamentale de la nouvelle époque.
Après l'introduction générale, la plate-forme se tourne vers les questions centrales de la révolution prolétarienne : d'abord et avant tout, la conquête du pouvoir politique par la classe ouvrière ; ensuite, l'expropriation de la bourgeoisie et la transformation économique de la société. Sur le premier point, la plate-forme affirme les leçons essentielles de la révolution d'Octobre : la nécessité de détruire le vieil Etat bourgeois et de le remplacer par la dictature du prolétariat, organisé dans le système des conseils ou soviets. Ici, la plate-forme est complétée par les Thèses sur la démocratie bourgeoise et la dictature du prolétariat rédigées par Lénine et adoptées au même Congrès. La rupture avec la social-démocratie et son fétichisme de la démocratie en général et des parlements bourgeois en particulier a été axée autour de ce point ; et la revendication du transfert du pouvoir aux conseils ouvriers a constitué le cri de ralliement, simple mais irremplaçable, de l'ensemble du mouvement international.
La partie sur les mesures économiques est nécessairement générale ; à ce moment-là, en effet, ce n'était qu'en Russie que ces mesures pouvaient se poser comme une question concrète (mais non se résoudre en Russie seulement). Cette partie met en avant les traits essentiels de la transition vers une société communiste : l'expropriation des grandes entreprises privées et d'Etat ; les premiers pas vers la socialisation de la distribution en remplacement du marché ; l'intégration graduelle des petits producteurs à la production sociale. La série sur le communisme examinera ultérieurement certaines des difficultés et des erreurs qui ont entravé le mouvement révolutionnaire de cette époque. Cependant, les mesures mises en avant par l'IC constituaient néanmoins un point de départ adéquat et leurs faiblesses auraient pu être dépassées si la révolution mondiale s'était développée avec succès.
La partie sur « Le chemin de la victoire » est également assez générale. Là où elle est le plus explicite, c'est dans son insistance sur la nécessité de l'internationalisme et du regroupement international des forces révolutionnaires, en rupture complète avec les social-chauvins et les Kautskystes et en contradiction absolue avec la politique opportuniste du Front unique développée après 1921. Sur d'autres questions sur lesquelles l'IC devait exprimer des confusions dangereuses – le parlement, la question nationale, les syndicats – la plate-forme reste extrêmement ouverte. La possibilité d'utiliser le parlement comme tribune pour la propagande révolutionnaire est affirmée, c'est sûr, mais seulement comme une tactique subordonnée aux méthodes de la lutte de masse. La question nationale n'est pas du tout mentionnée, mais ce que le Manifeste adopté par le congrès fait ressortir c'est que la victoire de la révolution communiste dans les pays développés constitue la question clé pour l'émancipation des masses opprimées des colonies. Sur la question syndicale, l'ouverture de la plate-forme est encore plus évidente comme Boukharine l'explique dans sa présentation :
« Si nous avions écrit pour des russes, nous aurions traité du rôle des syndicats dans le processus de transformation révolutionnaire. Mais, d'après l'expérience des communistes allemands, cela est impossible car ces camarades nous disent que les syndicats allemands sont entièrement opposés aux nôtres. Chez nous, les syndicats jouent le rôle principal dans le processus du travail positif. Le pouvoir soviétique s'appuie précisément sur eux ; en Allemagne c'est le contraire. Cela semble être dû au fait qu'en Allemagne les syndicats étaient aux mains des jaunes, des Legien et Cie. Ils étaient dirigés contre l'intérêt du prolétariat allemand et ils le sont encore, mais le prolétariat liquide à présent ces vieux syndicats. A leur place sont apparues en Allemagne de nouvelles formes d'organisation, les conseils d'usine qui essaient de prendre en main les usines. Les syndicats ne jouent plus de rôle positif. Nous ne pouvons pas élaborer ici de lignes directrices concrètes ; c'est pourquoi nous avons dit de manière générale que pour la gestion des usines il fallait créer des organes sur lesquels le prolétariat s'appuie, organisations qui sont très étroitement liées et intriquées à la production. »
Nous pouvons discuter certaines formulations de Boukharine, en particulier sur le rôle des syndicats en Russie, mais le passage donne quand même une indication frappante sur l'attitude réceptive de l'Internationale à ce moment-là. Confrontée aux nouvelles conditions imposées par la décadence du capitalisme, l'IC manifestait une préoccupation, celle que les nouvelles méthodes de lutte prolétarienne adaptées à ces conditions s'expriment. Cela est une preuve éclatante que sa plate-forme était bien le produit du haut niveau atteint par le mouvement mondial du prolétariat et qu'elle reste une référence essentielle pour les révolutionnaires d'aujourd'hui.
CDW.
Plate-forme de l'Internationale Communiste
Les contradictions du système capitaliste mondial, auparavant dissimiluées dans son sein, se sont manifestées avec une force inouïe en une formidable explosion : la grande guerre impérialiste mondiale.
Le capitalisme a tenté de surmonter sa propre anarchie en organisant la production. A la place des nombreuses entreprises concurrentes se sont organisées de vastes associations capitalistes (syndicats, cartels, trusts) ; le capital bancaire s'est uni au capital industriel ; toute la vie économique est tombée sous la domination d'une oligarchie financière capitaliste qui, par son organisation sur la base de ce pouvoir, a acquis une maîtrise exclusive. Le monopole supplante la libre concurrence. Le capitaliste isolé se transforme en membre d'une association capitaliste. L'organisation remplace l'anarchie insensée.
Mais, dans la mesure où, dans les différents Etats, les procédés anarchiques de la production capitaliste ont été remplacés par l'organisation capitaliste, les contradictions, la concurrence, l'anarchie, n'ont cessé de s'aggraver dans l'économie mondiale. La lutte entre les plus grands Etats conquérants a conduit, par une nécessité de fer, à la monstrueuse guerre impérialiste. La soif de bénéfices a poussé le capitalisme mondial à la lutte pour la conquête de nouveaux marchés, de nouvelles sphères d'investissement, de nouvelles sources de matières premières et la main-d'oeuvre à bon marché des esclaves coloniaux. Les Etats impérialistes qui se sont partagés le monde entier, qui ont transformé des millions de prolétaires et de paysans d'Afrique, d'Asie, d'Amérique, d'Australie, en bêtes de somme, devaient tôt ou tard révéler dans un conflit gigantesque la nature anarchique du capital. Ainsi se produisit le plus grand des crimes – la guerre mondiale de brigandage.
Le capitalisme a tenté de surmonter les contradictions de sa structure sociale. La société bourgeoise est une société de classes. Mais le capital des grands Etats « civilisés », s'est efforcé d'étouffer les contradictions sociales. Aux dépens des peuples coloniaux qu'il exploitait, le capital a corrompu ses esclaves salariés, créant une communauté d'intérêts entre les exploiteurs et les exploités – communauté d'intérêts dirigée contre les colonies opprimées et les peuples coloniaux jaunes, noirs ou rouges ; il a enchaîné la classe ouvrière européenne ou américaine à la « patrie » impérialiste.
Mais, cette même méthode de corruption permanente, qui servait à alimenter le patriotisme de la classe ouvrière et sa sujétion morale, s'est transformée en son contraire grâce à la guerre. L'extermination, la sujétion totale du prolétariat, le joug monstrueux, l'appauvrissement, la dégénérescence, la faim dans le monde entier – telle fut la dernière rançon de la paix sociale. Et cette paix a fait faillite. La guerre impérialiste est transformée en guerre civile.
Une nouvelle époque est née : l'époque de désagrégation du capitalisme, de son effondrement intérieur. L'époque de la révolution communiste du prolétariat.
Le système impérialiste croule. Troubles aux colonies, fermentation parmi les petites nationalités jusqu'à présent privées de leur indépendance, insurrections du prolétariat, révolutions prolétariennes victorieuses dans plusieurs pays, décomposition des armées impérialistes, incapacité absolue des classes dirigeantes à diriger dorénavant les destinées des peuples – tel est le tableau de la situation actuelle dans le monde entier.
L'humanité, dont toute la culture a été dévastée, est menacée de destruction totale. Il n'est plus qu'une force capable de la sauver, et cette force, c'est le prolétariat. L'ancien « ordre » capitaliste n'existe plus. Il ne peut plus exister. Le résultat final du mode de production capitaliste est le chaos, – et ce chaos ne peut être vaincu que par la plus grande classe productrice : la classe ouvrière. C'est elle qui doit instituer l'ordre véritable, l'ordre communiste. Elle doit briser la domination du capital, rendre les guerres impossibles, effacer les frontières entre les Etats, transformer le monde en une vaste communauté travaillant pour elle-même, réaliser la solidarité fraternelle et la libération des peuples.
Entre temps, contre le prolétariat, le capital mondial s'est armé pour le dernier combat. Sous le couvert de la Société des Nations et des bavardages pacifiques, il tente un dernier effort pour recoller les parties désagrégées du système capitaliste et diriger ses forces contre la révolution prolétarienne montante.
A ce nouveau et immense complot des classes capitalistes, le prolétariat doit répondre par la conquête du pouvoir politique, tourner ce pouvoir contre ses ennemis de classe et s'en servir comme levier pour la transformation économique de la société. La victoire définitive du prolétariat mondial marquera le commencement de l'histoire véritable de l'humanité libérée.
LA CONQUETE DU POUVOIR POLITIQUE
La conquête du pouvoir politique par le prolétariat signifie la destruction du pouvoir politique de la bourgeoisie. L'appareil d'Etat bourgeois avec son armée capitaliste, placée sous le commandement d'un corps d'officiers bourgeois et de junkers, avec sa police et sa gendarmerie, ses geôliers et ses juges, ses prêtres, ses fonctionnaires, etc., constitue le plus puissant instrument de domination de la bourgeoisie. La conquête du pouvoir politique ne peut consister en un simple changement de personnes dans les ministères, mais signifie la destruction de l'appareil d'Etat ennemi, la prise en mains de la force réelle, le désarmement de la bourgeoisie, du corps d'officiers contre-révolutionnaires, des gardes blancs, l'armement du prolétariat, des soldats révolutionnaires et de la garde rouge ouvrière ; la destitution de tous les juges bourgeois et l'organisation des tribunaux prolétariens, la destruction du fonctionnarisme réactionnaire et la création de nouveaux organes d'administration prolétariens. La victoire prolétarienne est assurée par la désorganisation du pouvoir ennemi et l'organisation du pouvoir prolétarien ; elle signifie la destruction de l'appareil d'Etat bourgeois et la construction de l'appareil d'Etat prolétarien. Ce n'est qu'après sa victoire complète, quand le prolétariat aura définitivement brisé la résistance de la bourgeoisie, qu'il pourra obliger ses anciens adversaires à le servir utilement, les amenant progressivement, sous son contrôle, à l'oeuvre de construction communiste.
DEMOCRATIE ET DICTATURE
Comme tout Etat, l'Etat prolétarien est un appareil de contrainte et cet appareil est maintenant dirigé contre les ennemis de la classe ouvrière. Sa mission est de briser et de rendre impossible la résistance des exploiteurs qui emploient dans leur lutte désespérée tous les moyens pour étouffer la révolution dans le sang. D'autre part, la dictature du prolétariat qui donne officiellement à la classe ouvrière l'hégémonie dans la société est une institution provisoire.
Dans la mesure où sera brisée la résistance de la bourgeoisie, où celle-ci sera expropriée et se transformera en une masse laborieuse, la dictature du prolétariat disparaîtra, l'Etat dépérira et les classes sociales avec lui.
La prétendue démocratie, c'est-à-dire la démocratie bourgeoise, n'est rien d'autre que la dictature bourgeoise déguisée. La « volonté populaire » tant prônée est une fiction, comme l'unité du peuple. En fait, il n'existe que des classes dont les intérêts antagoniques sont irréductibles. Et comme la bourgeoisie n'est qu'une petite minorité, elle utilise cette fiction, cette prétendue « volonté populaire » nationale, afin d'affermir, sous le couvert de ces belles phrases, sa domination sur la classe ouvrière, et de lui imposer sa volonté de classe. Au contraire, le prolétariat constituant l'énorme majorité de la population, utilise ouvertement la violence de classe de ses organisations de masses, de ses conseils, pour supprimer les privilèges de la bourgeoisie et assurer la transition vers une société communiste sans classes.
L'essence de la démocratie bourgeoise réside dans la reconnaissance purement formelle des droits et des libertés, précisément inaccessibles au prolétariat et aux éléments semi-prolétariens, du fait de leur manque de ressources matérielles, tandis que la bourgeoisie a toutes les possibilités de tirer parti de ces ressources matérielles, de sa presse et de son organisation, pour mentir au peuple et le tromper. Au contraire, l'essence du système des conseils – ce nouveau type de pouvoir d'Etat – consiste en ce que le prolétariat a la possibilité d'assurer dans les faits ses droits et sa liberté. Le pouvoir du conseil remet au peuple les plus beaux palais, les maisons, les typographies, les réserves de papier, etc., pour sa presse, ses réunions, ses associations. Ce n'est qu'alors que devient possible la véritable démocratie prolétarienne.
Avec son système parlementaire, la démocratie bourgeoise ne donne qu'en paroles le pouvoir aux masses. Les masses et leurs organisations sont tenues complètement à l'écart et du pouvoir véritable et de la véritable administration de l'Etat. Dans le système des Conseils, les organisations de masse et par elles les masses elles-mêmes gouvernent l'Etat, appelant à administrer un nombre toujours plus grand d'ouvriers ; et ce n'est que de cette façon que tout le peuple travailleur est à peu près appelé à prendre part effectivement au gouvernement de l'Etat. Le système des Conseils s'appuie de la sorte sur les organisations des masses prolétariennes, représentées par les Conseils eux-mêmes, les syndicats révolutionnaires, les coopératives, etc.
La démocratie bourgeoise et le parlementarisme, renforcés par la séparation des pouvoirs législatif et exécutif et l'absence du droit de révoquer les députés, achèvent de séparer les masses de l'Etat. Au contraire, le système des Conseils, par le droit de révocation, par la fusion des pouvoirs législatif et exécutif et par la capacité des Conseils à constituer des collectivités de travail, lie les masses aux organes de l'administration. Ce lien est encore affermi par le fait que, dans le système des Conseils, les élections ne se font pas d'après des subdivisions territoriales artificielles, mais d'après les unités locales de la production.
Le système des Conseils rend ainsi possible la véritable démocratie prolétarienne, démocratie pour le prolétariat et à l'intérieur du prolétariat, dirigée contre la bourgeoisie. Dans ce système, la position dominante est assurée au prolétariat industriel, auquel appartient, du fait de sa meilleure organisation et de son plus grand développement politique, le rôle de classe dirigeante, et dont l'hégémonie permettra au semi-prolétariat et aux paysans pauvres de s'élever progressivement. Ces privilèges temporaires du prolétariat industriel doivent être utilisés pour arracher les masses non possédantes de la petite-bourgeoise paysanne à l'influence des gros propriétaires ruraux et de la bourgeoisie, pour les organiser et les appeler à collaborer à la construction communiste.
L'EXPROPRIATION DE LA BOURGEOISIE ET LA SOCIALISATION DES MOYENS DE PRODUCTION
La décomposition du système capitaliste et de la discipline capitaliste du travail rendent impossible, étant donné les relations entre les classes, la reconstitution de la production sur les anciennes bases. La lutte des ouvriers pour l'augmentation des salaires, même en cas de succès, n'amène pas l'amélioration espérée des conditions d'existence, l'augmentation des prix des produits de consommation rendant chaque succès illusoire. La lutte énergique des ouvriers pour l'augmentation des salaires dans tous les pays dont la situation est désespérée, par sa puissance élémentaire, par sa tendance à la généralisation, rend impossibles dorénavant les progrès de la production capitaliste. L'amélioration de la condition des ouvriers ne pourra être atteinte que lorsque le prolétariat lui-même s'emparera de la production. Pour élever les forces productives de l'économie, pour briser au plus vite la résistance de la bourgeoisie qui prolonge l'agonie de la vieille société, créant par là même le danger d'une ruine complète de la vie économique, la dictature prolétarienne doit réaliser l'expropriation de la grande bourgeoisie et des hobereaux et faire des moyens de production et de transport la propriété collective de l'Etat prolétarien.
Le communisme est en train maintenant de naître sur les décombres de la société capitaliste ; l'histoire ne laisse pas d'autre issue à l'humanité. Les opportunistes, en retardant la socialisation par leur utopique revendication du rétablissement de l'économie capitaliste, ne font qu'ajourner la solution de la crise et créent la menace d'une ruine totale. La révolution communiste apparaît dans une telle période comme le seul moyen qui permette de sauvegarder la force productive, la plus importante de la société, le prolétariat, et avec lui l'ensemble même de la société.
La dictature prolétarienne n'entraîne aucun partage des moyens de production et de transport. Au contraire, sa tâche est de réaliser une plus grande centralisation des forces productives et de subordonner l'ensemble de la production à un plan unique.
Le premier pas vers la socialisation de toute l'économie comporte nécessairement les mesures suivantes : socialisation des grandes banques qui dirigent maintenant la production ; prise en mains par le pouvoir d'Etat prolétarien de tous les organes de l'Etat capitaliste régissant la vie économique ; prise en mains de toutes les entreprises communales ; socialisation des branches d'industrie trustées ou cartellisées ; de même, socialisation des branches d'industrie dont le degré de concentration et de centralisation rend la réalisation techniquement possible ; socialisation des propriétés agricoles et leur transformation en entreprises agricoles dirigées par la société.
Quant aux entreprises de moindre importance, le prolétariat doit, en tenant compte de leur dimension, les socialiser petit à petit et les unifier.
Il importe de souligner ici que la petite propriété ne doit pas être expropriée et que les petits propriétaires qui n'exploitent pas le travail salarié ne doivent subir aucune mesure de violence. Cette classe sera peu à peu intégrée dans l'organisation socialiste. L'exemple et la pratique démontreront en effet la supériorité de la nouvelle structure sociale qui libère la classe des petits paysans et la petite-bourgeoisie urbaine du joug économique des grands capitalistes usuriers, des hobereaux, des impôts excessifs (principalement par suite de l'annulation des dettes d'Etat, etc.).
La tâche de la dictature prolétarienne dans le domaine économique ne peut être réalisée que dans la mesure où le prolétariat saura créer des organes centralisés de direction de la production et réaliser la gestion par les ouvriers eux-mêmes. A cette fin, il devra tirer parti de celles de ses organisations de masses qui sont le plus étroitement liées au processus de production.
Dans le domaine de la distribution, la dictature prolétarienne doit remplacer le commerce par une juste répartition des produits. Parmi les mesures indispensables, il faut indiquer : la socialisation des grandes entreprises commerciales, la prise en mains par le prolétariat de tous les organes de distribution bourgeois étatiques et municipaux ; le contrôle des grandes unions coopératives dont l'organisation aura encore, pendant la période de transition, une importance économique considérable ; la centralisation progressive de tous ces organes et leur transformation en un système unique de répartition rationnelle des produits.
De même que dans le domaine de la production, dans celui de la répartition il importe d'utiliser tous les techniciens et les spécialistes qualifiés – sitôt que leur résistance dans le domaine politique aura été brisée et qu'ils seront en état de servir, non plus le capital, mais le nouveau système de production.
Le prolétariat n'a pas l'intention de les opprimer : au contraire, lui seul leur donnera, le premier, la possibilité de développer l'activité créatrice la plus intense. La dictature prolétarienne remplacera la division du travail physique et intellectuel, propre au capitalisme, par leur union, fusionnant ainsi le travail et la science.
En même temps qu'il expropriera les fabriques, les mines, les propriétés, etc., le prolétariat devra mettre fin à l'exploitation de la population par les capitalistes propriétaires d'immeubles, remettre les grandes habitations aux Conseils ouvriers locaux, installer la population ouvrière dans les appartements bourgeois, etc.
Au cours de cette période d'immense transformation, le pouvoir des Conseils doit, d'une part, échafauder un énorme appareil de gouvernement toujours plus centralisé et, d'autre part, appeler à un travail d'administration directe des couches toujours plus nombreuses des masses laborieuses.
LE CHEMIN DE LA VICTOIRE
La période révolutionnaire exige que le prolétariat use d'une méthode de lutte qui concentre toute son énergie, à savoir l'action directe des masses jusque et y compris sa suite logique, le choc direct, la guerre déclarée avec la machine d'Etat bourgeoise. A ce but doivent être subordonnés tous les autres moyens tels que, par exemple, l'utilisation révolutionnaire du parlementarisme bourgeois.
Les conditions préliminaires indispensables à cette lutte victorieuse sont : la rupture, non seulement avec les laquais directs du capital et les bourreaux de la révolution communiste – dont les social-démocrates de droite assument aujourd'hui le rôle, – mais encore la rupture avec le « Centre » (groupe Kautsky), qui, au moment critique, abandonne le prolétariat et lie partie avec ses ennemis déclarés.
D'un autre côté, il est nécessaire de réaliser un bloc avec ces éléments du mouvement ouvrier révolutionnaire qui, bien que n'ayant pas appartenu auparavant au parti socialiste, se placent maintenant dans l'ensemble sur le terrain de la dictature prolétarienne sous la forme du pouvoir des Conseils, c'est-à-dire avec les éléments révlutionnaires du syndicalisme.
La montée du mouvement révolutionnaire dans tous les pays, le danger, pour cette révolution, d'être étouffée par la ligue des Etats bourgeois, les tentatives d'union des partis social-traîtres (formation de l'Internationale jaune, à Berne), dans le but de servir bassement la ligue de Wilson – et enfin la nécessité absolue pour le prolétariat de coordonner ses efforts – tout cela nous conduit inévitablement à la fondation de l'Internationale communiste, véritablement révolutionnaire et véritablement prolétarienne.
L'Internationale, qui subordonnera les intérêts dits nationaux aux intérêts de la révolution mondiale, réalisera ainsi l'entraide des prolétaires des différents pays – car sans cette solidarité économique et autre, le prolétariat ne sera pas capable d'édifier une société nouvelle. D'autre part, contrairement à l'Internationale socialiste jaune, l'Internationale prolétarienne et communiste soutiendra les peuples exploités des colonies dans leur lutte contre l'impérialisme, afin de hâter l'effondrement final du système impérialiste mondial.
Les brigands capitalistes affirmaient, au début de la guerre mondiale, qu'ils ne faisaient que défendre leur patrie. Mais l'impérialisme allemand devait révéler sa nature bestiale véritable par la série de ses sanglants forfaits commis en Russie, en Ukraine, en Finlande. Maintenant se démasquent à leur tour, même aux yeux des couches les plus arriérées de la population, les puissances de l'Entente qui pillent le monde entier et assassinent le prolétariat. D'accord avec la bourgeoisie allemande et les social-patriotes, des phrases hypocrites sur la paix aux lèvres, elles s'efforcent d'écraser, au moyen de leurs armes de guerre et de troupes coloniales abruties et barbares, la révolution du prolétariat européen. La terreur blanche des bourgeois-cannibales a été féroce au-delà de toute expression. Les victimes sont innombrables dans les rangs de la classe ouvrière qui a perdu ses meilleurs champions : Liebknecht, Rosa Luxemburg.
Le prolétariat doit se défendre à tout prix. L'Internationale communiste appelle le prolétariat mondial à cette lutte décisive. Arme contre arme ! Violence contre violence ! A bas la conspiration impérialiste du capital ! Vive la République internationale des Conseils prolétariens !
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Russe [2920]
Conscience et organisation:
- Troisième Internationale [1881]
Approfondir:
Questions théoriques:
- Communisme [492]
Heritage de la Gauche Communiste:
Débat entre groupes "bordiguistes" : Marxisme et mysticisme
- 3370 reads
Comme nous l'avons montré dans la Revue internationale n° 93, l'ouverture récente de débats entre groupes « bordiguistes » représente une évolution importante pour l'ensemble du milieu prolétarien. En particulier, nous avons mentionné le numéro de mai 1997 de Programme communiste (PC) ([1] [3436]) qui illustre clairement cette évolution et nous avons signalé qu'il est le groupe qui évolue actuellement le plus. L'intensification de l'attaque bourgeoise contre les traditions communistes de la classe ouvrière – contre la révolution russe, contre le parti bolchevik et contre leurs défenseurs les plus cohérents, les organisations de la Gauche communiste – contraint le PCI à reconnaître, même timidement, qu'il fait partie d'un camp politique prolétarien qui a des intérêts communs face à l'offensive de l'ennemi. Une autre expression évidente de cette existence du camp prolétarien a été constituée par le travail commun d'intervention très fructueux mené par le CCI et la CWO ([2] [3437]). Mais le fait que certains groupes bordiguistes aient commencé non seulement à reconnaître l'existence des autres, mais aussi à polémiquer entre eux et même à reconnaître le caractère prolétarien d'autres courants dans la tradition du Communisme de Gauche, est également extrêmement significatif, étant donné l'isolement sectaire extrême qui a constitué jusqu'à présent une des caractéristiques distinctives de cette branche de la Gauche italienne.
PC n° 95 contient une polémique sérieuse avec le groupe Programma comunista-Internationalist Papers sur la question kurde et critique ce dernier pour les graves concessions qu'il fait au nationalisme ; et ce qui est particulièrement notable, c'est que l'article montre que ce sont des erreurs exactement du même type qui ont conduit à l'explosion du PCI au début des années 1980. Cette volonté de discuter de la crise de la principale organisation bordiguiste à l'époque constitue une nouveauté potentiellement fertile. Le même numéro contient une réponse au compte-rendu du livre du CCI sur la Gauche italienne, publié par le journal trotskiste Revolutionary History. Ici PC montre qu'il est conscient que l'attaque contre le CCI contenue dans ce compte-rendu est aussi une attaque contre toute la tradition de la Gauche communiste italienne.
Nous renvoyons nos lecteurs à l'article de la Revue internationale n° 93 pour de plus amples commentaires sur ces articles. Dans celui-ci, nous voulons répondre à un autre texte de PC n° 95 – une polémique avec le groupe Il partito comunista, basé à Florence, critiquant ce dernier pour être tombé dans le mysticisme.
Le marxisme contre le mysticisme
A première vue, cela peut paraître un sujet de polémique bien étrange entre groupes révolutionnaires ; mais ce serait une erreur de penser que les fractions les plus avancées du mouvement prolétarien sont immunisées contre l'influence des idéologies religieuses et mystiques. Cela a été le cas dans la lutte pour la fondation de la Ligue des communistes où Marx et Engels ont dû combattre les visions sectaires, semi-religieuses du communisme que professaient Weitling et d'autres ; cela n'en a pas été moins vrai pendant la période de la première Internationale quand la fraction marxiste a dû affronter les idéologies maçonniques de sectes tels que les Philadelphiens et, avant tout, la « Fraternité internationale » de Bakounine.
Mais c'est surtout une fois que la bourgeoisie a cessé d'être une classe révolutionnaire et plus encore quand elle est entrée dans son époque de décadence que, de plus en plus, elle a abandonné la vision matérialiste de sa jeunesse et qu'elle est retombée dans des visions du monde irrationnelles et semi-mystiques : le cas du nazisme en est un exemple en concentré. Et la phase finale de la décadence capitaliste – l'actuelle phase de décomposition – a encore plus exacerbé ces tendances, comme en témoignent, par exemple, le surgissement du fondamentalisme islamique et la prolifération de cultes suicidaires. Ces idéologies sont de plus en plus envahissantes et les prolétaires ne peuvent en aucune façon y échapper.
Le fait que l'actuel milieu politique prolétarien lui-même doive être sur ses gardes contre de telles idéologies a été clairement démontré dans la dernière période. Nous pouvons citer le cas de la « London psychogeographical association » (LPA) et celui d'autres « groupes » similaires qui ont concocté une infâme mixture de communisme et d'occultisme et ont activement tenté de la vendre dans le milieu. Dans le CCI lui-même, nous avons connu les activités de l'aventurier JJ, exclu pour avoir cherché à créer un réseau clandestin d'« intérêt » pour les idées de la franc-maçonnerie.
De plus, le CCI a déjà brièvement critiqué les efforts d'Il partito pour créer un « mysticisme communiste » ([3] [3438]). Quant aux critiques plus détaillées portées par Programme communiste, elles sont parfaitement justifiées. Les citations de la presse d'Il partito contenues dans l'article de PC montrent que le glissement de ce groupe dans le mysticisme est devenu tout à fait ouvert. Pour Il partito, « la seule société capable de mysticisme est le communisme » dans le sens où « l'espèce est mystique parce qu'elle sait comment se voir elle-même sans contradiction entre le ici et maintenant... et son futur ». De plus, puisque le mysticisme, dans son sens grec originel, est défini ici comme « la capacité à voir sans yeux », le parti aussi « a sa mystique, dans le sens où il est capable de voir... les yeux fermés, puisqu'il est capable de voir plus que les yeux individuels de ses membres » ; « (...) la seule réalité qui puisse vivre le mode (mystique) de vie pendant la domination de la société de classe, est le parti ». Et finalement, « c'est seulement dans le communisme que la Grande philosophie coïncide avec l'être dans un circuit organique entre l'action de manger (considérée aujourd'hui comme triviale et indigne de l'esprit) et l'action de respirer dans l'Esprit, conçu sublimement comme véritablement digne de l'être complet, c'est-à-dire Dieu. »
PC est également conscient que la lutte du marxisme contre la pénétration des idéologies mystiques n'est pas nouvelle. Il cite Matérialisme et empiriocriticisme de Lénine, livre dans lequel ce dernier menait un combat contre le développement d'une philosophie idéaliste dans le parti bolchevik des années 1900, et en particulier contre les tentatives de transformer le socialisme en une nouvelle religion (la tendance des « constructeurs de Dieu » de Lounacharsky). Le livre de Lénine – tout en souffrant de faiblesses importantes ([4] [3439]) – traçait une claire démarcation, un rempart non seulement contre la rechute dans la religiosité qui a accompagné le recul de la lutte de classe après la révolution de 1905, mais aussi contre le danger concomitant de liquidation du parti, de son éclatement en clans.
Les critiques de PC aux erreurs d'Il partito sont donc en continuité avec les luttes passées du mouvement ouvrier et valables pour la lutte contre les réels dangers auxquels le camp politique prolétarien est confronté aujourd'hui. Le goût de Il partito pour le mysticisme n'est pas sa seule faiblesse : sa profonde confusion sur les syndicats, son interprétation désastreuse d'un prétendu « soulèvement prolétarien » en Albanie, son extrême sectarisme en font aujourd'hui le groupe bordiguiste le plus en danger de succomber à l'idéologie bourgeoise. La polémique de PC qui met explicitement en garde Il partito contre le danger de « passer de l'autre côté de la barricade » – doit donc être considérée comme faisant partie de la lutte pour défendre le milieu prolétarien, une lutte dans laquelle le CCI est pleinement engagé.
Les racines de la mystique bordiguiste
Cependant, pour qu'une critique soit radicale, elle doit aller à la racine. Et une faiblesse frappante de la polémique de PC est son incapacité à aller jusqu'aux racines des erreurs d'Il partito – une tâche qui, il faut l'admettre, est difficile puisque ces racines sont, dans une mesure plus ou moins grande, communes à toutes les branches de la famille bordiguiste.
Cela apparaît dès le départ quand PC reproche à Il partito de se proclamer « le seul véritable continuateur du parti ». Mais si Il partito est le plus sectaire des groupes bordiguistes, le retrait sectaire, la pratique d'ignorer ou de rejeter toute autre expression de la Gauche communiste ont toujours constitué un trait distinctif du courant bordiguiste et cela bien avant qu'Il partito n'apparaisse dans les années 1970. Et même si l'on peut comprendre les origines d'un tel sectarisme – comme une réaction de sauvegarde face à la profonde contre-révolution qui a prévalu à l'époque de la naissance du bordiguisme dans les années 1940 et 1950 –, il reste toujours un défaut fondamental de ce courant, défaut qui a causé des dommages permanents au milieu prolétarien. Le fait même que nous soyons aujourd'hui confrontés à l'existence de trois groupes, qui chacun se proclame le « Parti communiste international », en est une preuve suffisante puisque cela tend à jeter le discrédit sur la notion même d'organisation communiste.
Mais, même sur la question du mysticisme et de la religion, il faut admettre que les idées d'Il partito ne sont pas tombées du ciel. En réalité, on trouve certaines racines du « mysticisme florentin » chez Bordiga lui-même. Pour preuve le passage suivant des « Commentaires sur les Manuscrits de 1844 » par Bordiga, texte qui est paru d'abord dans Il programma comunista en 1959 et qui est republié dans Bordiga et la passion du communisme édité par Jacques Camatte en 1972 :
« Quand, à un certain point, notre banal contradicteur (...) nous dira que nous construisons ainsi notre mystique, se posant lui, le pauvre, comme l'esprit qui a dépassé tous les fidéismes et les mystiques, nous tournera en dérision en nous traitant de prosternés devant les tables mosaïques ou talmudiques, de la Bible ou du Coran, des évangiles ou des catéchismes, nous lui répondrons (...) que nous n'avons pas de motifs de considérer comme une offense l'affirmation qu'on peut encore attribuer à notre mouvement – tant qu'il n'a pas triomphé dans la réalité (qui précède dans notre méthode toute conquête ultérieure de la conscience humaine) – une mystique et, si l'on veut, un mythe.
Le mythe, dans ses formes innombrables, ne fut pas un délire des esprits qui avaient leurs yeux physiques fermés à la réalité – naturelle et humaine de façon inséparable comme chez Marx – mais c'est une étape irremplaçable dans l'unique voie de conquête réelle de la conscience... »
Avant d'aller plus loin, il est nécessaire de replacer ce passage dans le contexte approprié.
D'abord, nous ne mettons pas Bordiga au même niveau que ses épigones d'Il partito, encore moins à celui des occultistes « communistes » actuels tels que le LPA. En tant que marxiste, Bordiga situe avec soin ces prises de positions dans un contexte historique ; ainsi, dans le paragraphe suivant, il continue en expliquant pourquoi les marxistes peuvent avoir du respect et de l'admiration pour les mouvements d'exploités des sociétés de classe passées, mouvements qui ne pouvaient atteindre une compréhension scientifique de leurs buts et manifestaient donc leurs aspirations à l'abolition de l'exploitation en termes de mythes et de mysticisme. Nous avons nous-mêmes noté ([5] [3440]) que la description par Bordiga de la conscience humaine dans une société communiste – une conscience qui va au-delà du moi atomisé qui se considère lui-même en dehors de la nature – est proche de la description de l'expérience d'illumination dans certaines des traditions mystiques les plus développées. Nous pensons que Bordiga était suffisamment cultivé pour être conscient de ces liens et, encore une fois, il est valable que les marxistes les fassent, à condition qu'ils ne perdent pas de vue la méthode historique qui montre que n'importe laquelle de ces anticipations est inévitablement limitée par les conditions matérielles et sociales dans lesquelles elles émergent. En conséquence, la société communiste les transcendera. Il partito a certainement perdu de vue cette méthode et, comme les passages étranges et plein de circonvolutions cités plus haut le révèlent, il est donc tombé la tête la première dans le mysticisme – pas seulement à cause de l'obscurité de sa prose, mais surtout parce qu'au lieu de voir le communisme comme la réalisation matérielle et rationnelle des aspirations humaines passées, il tend à subordonner le futur communiste à un grandiose projet mystique.
Deuxièmement, nous devons également comprendre le moment historique pendant lequel Bordiga a rédigé de tels passages. En effet, il polémiquait avec la version de l'idéologie de la « fin du marxisme » qui prévalait pendant la période de reconstruction d'après-guerre, période où le capitalisme donnait l'apparence d'avoir surmonté ses crises et d'avoir donc réfuté le fondement de la théorie marxiste. Cette attaque contre le marxisme – qui aurait été « dépassé », qui serait devenu un genre de dogme mystique – était très similaire à la dérision dont font l'objet aujourd'hui les communistes taxés d'« antédiluviens » qui défendent encore la révolution d'Octobre et la tradition marxiste. Ce n'est pas seulement le sectarisme invétéré du bordiguisme mais aussi les conceptions de l'« invariance » et du parti monolithique qui lui sont étroitement liées qui étaient des réactions de défense contre les pressions qui s'exerçaient sur l'avant-garde du prolétariat à l'époque. Ces pressions étaient très réelles, comme on a pu le voir à travers le destin d'un groupe comme Socialisme ou barbarie qui a complètement succombé à l'idéologie « moderniste » du capitalisme. C'est dans ce contexte qu'il faut considérer la défense du marxisme par Bordiga comme celle d'une sorte de « mystique », la défense du programme communiste comme étant une sorte de Loi de Moïse.
Mais le comprendre n'est pas l'excuser. Et malgré le profond attachement de Bordiga au marxisme, il n'en reste pas moins qu'il a lui-même dépassé la ligne de démarcation qui distingue clairement le marxisme de tout genre d'idéologie mystique ou religieuse. Le concept de l'invariance – « La théorie marxiste est un bloc invariant, depuis l'origine jusqu'à la victoire finale. La seule chose qu'elle attende de l'histoire, c'est de se trouver elle-même appliquée de façon de plus en plus stricte et par conséquent de plus en plus profondément enracinée avec ses caractéristiques invariantes, dans le programme du parti de classe » (PC n° 2, mars 1978) – constitue une véritable concession à une conception a-historique, semi-religieuse du marxisme.
Bien que le coeur véritable du programme communiste reste inchangé (au niveau de ses principes généraux comme la lutte de classe, la nature transitoire de la société de classe, la nécessité de la dictature du prolétariat et du communisme etc.), celui-ci est loin d'être « un bloc invariant » depuis sa naissance. Il a été développé, concrétisé, élaboré par l'expérience réelle de la classe ouvrière et par les réflexions théoriques de l'avant-garde communiste ; et les changements de période dans le capitalisme, notamment son entrée en décadence (un concept qui a été largement ignoré et même rejeté dans la théorie bordiguiste), ont nécessité en particulier de profondes modifications aux positions programmatiques défendues par les communistes. Quand la bourgeoisie ou la petite bourgeoisie ricane sur le marxisme qui serait comparable à la Bible ou au Coran – qui sont considérés comme la parole de Dieu précisément parce que ni un point ni une virgule ne doivent y être changés –, il n'est pas très judicieux ni marxiste de répondre : « oui, et alors? ».
Le concept d'invariance est le produit d'une ligne de pensée qui a perdu de vue le lien dialectique entre la continuité et le changement et, ce faisant, tend à transformer le marxisme d'une méthode dynamique en une doctrine fixe et immuable. Dans une polémique publiée dans le Revue internationale n° 14 et intitulée « Une caricature de parti : le parti bordiguiste », le CCI a déjà souligné les similarités réelles entre la démarche bordiguiste et l'attitude des islamistes de soumission à une doctrine immuable. Et comme nous l'avons également montré dans une autre polémique, la distinction bordiguiste entre le « parti formel » et le « parti historique » – inventée pour expliquer que les partis communistes réels et fonctionnant (agissant) n'ont existé que durant des périodes limitées de l'histoire du mouvement ouvrier – n'est pas moins a-historique et non matérialiste. « Selon cette "théorie", le corps formel, extérieur, et donc matériel et visible du parti peut disparaître, mais le parti réel vit, personne ne sait où, un pur esprit invisible. » ([6] [3441])
Les courants de la Gauche communiste en dehors du bordiguisme ont aussi critiqué les notions liées de monolithisme interne et de « chef génial » développées dans le parti d'après-guerre ([7] [3442]) et l'utilisation de la théorie du « centralisme organique » pour justifier les pratiques élitistes au sein du parti (8[8] [3443]). Ces conceptions sont cohérentes avec la notion semi-religieuse du parti comme le gardien de la révélation définitive uniquement accessible à quelques élus ; à partir de ces conceptions, il n'est pas du tout surprenant qu'Il partito proclame que la seule véritable façon de vivre la vie mystique aujourd'hui soit de rejoindre le parti !
En fin de compte, nous devons aussi souligner que toutes ces conceptions du fonctionnement interne du parti sont profondément liées à l'article de foi bordiguiste selon lequel la tâche du parti est d'exercer la dictature du prolétariat au nom de la masse du prolétariat et même contre elle. Et la Gauche communiste – en particulier sa branche italienne à l'époque de Bilan, sans oublier le travail de la GCF et de la tendance Damen – ont abondamment critiqué cette notion également.
Nous pensons donc que les critiques de Programme communiste doivent aller plus au fond, jusqu'aux racines historiques véritables de ces erreurs et, ce faisant, se réapproprier le riche héritage de l'ensemble de la Gauche communiste. Nous sommes convaincus de ne pas prêcher dans le désert ; le nouvel esprit d'ouverture dans le milieu bordiguiste en témoigne. Et PC donne même des signes importants de mouvement sur la question du parti lui-même puisqu'à la fin de son article, tout en gardant l'idée du parti comme « Etat major » de la classe, il insiste sur le fait qu'« il n'y a pas la place dans le fonctionnement et la vie interne pour l'idéalisme, le mysticisme, le culte des chefs et des autorités supérieures, comme c'est le cas dans des partis qui sont sur le point de dégénérer et de passer à la contre-révolution. » Nous ne pouvons qu'être d'accord avec ces affirmations et espérer que les débats actuels dans le milieu bordiguiste permettront à ses composantes de mener ces développements à leur conclusion logique.
Amos
[6] [3449] « Le parti défiguré : la conception bordiguiste », Revue internationale n° 23.
[7] [3450] Voir la réedition de textes de la GCF (Internationalisme, août 1947) dans la Revue internationale n° 33 et 34, « Contre la conception du chef génial » et « Contre la conception de la discipline du PCI ».
[8] [3451] Voir « Un chiarimento, Fra le ombre del bordighismo e dei suoi epigoni », Supplément à Battaglia Comunista n° 11-1997.
Courants politiques:
- Bordiguisme [1287]
Heritage de la Gauche Communiste:
Construction de l'organisation des révolutionnaires : thèses sur le parasitisme
- 3858 reads
1) Tout au long de son histoire, le mouvement ouvrier a dû faire face à la pénétration dans ses rangs d'idéologies étrangères provenant soit de la classe dominante, soit de la petite bourgeoisie. Cette pénétration s'est manifestée sous de multiples formes au sein des organisations ouvrières. Parmi les plus répandues et connues on peut citer notamment :
- le sectarisme,
- l'individualisme,
- l'opportunisme,
- l'aventurisme-putschisme.
2) Le sectarisme est une manifestation typique d'une vision petite bourgeoise de l'organisation. Il s'apparente à l'état d'esprit du petit boutiquier, du « bougnat maître chez soi » et s'exprime dans la tendance à faire prédominer les intérêts et les conceptions propres de l'organisation au détriment des intérêts du mouvement dans son ensemble. Dans la vision sectaire, l'organisation est « seule au monde » et elle affiche un royal mépris pour toutes les autres organisations appartenant au camp du prolétariat qui sont vues comme des « concurrentes », voire des « ennemies ». Se sentant menacée par celles-ci, l'organisation sectaire se refuse en général à engager le débat et la polémique politiques avec elles. Elle préfère se réfugier dans un « splendide isolement », faisant comme si les autres n'existaient pas, ou bien elle met en avant obstinément ce qui la distingue de celles-ci sans tenir compte de ce qui la rapproche d'elles.
3) L'individualisme peut provenir aussi bien des influences petites bourgeoises que directement bourgeoises. De la classe dominante, il reprend l'idéologie officielle qui fait des individus les sujets de l'histoire, qui valorise le « self made man », qui justifie la « lutte de tous contre tous ». Cependant, c'est surtout par le véhicule direct de la petite bourgeoisie qu'il pénètre dans les organisations du prolétariat, notamment à travers les éléments récemment prolétarisés en provenance de couches comme la paysannerie et l'artisanat (c'était principalement le cas au siècle dernier) ou comme le milieu intellectuel et étudiant (c'est notamment le cas depuis la reprise historique de la classe ouvrière à la fin des années 1960). L'individualisme se manifeste principalement par la tendance à :
- concevoir l'organisation non comme un tout collectif mais comme une somme d'individus dans laquelle, notamment, les relations entre personnes priment sur les relations politiques et statutaires ;
- faire valoir, face aux nécessités de l'organisation, ses propres « envies » et « intérêts » ;
- résister, en ce sens, à la nécessaire discipline au sein de celle-ci ;
- rechercher, dans l'activité militante, une « réalisation personnelle » ;
- adopter une attitude contestataire vis-à-vis des organes centraux supposés « brimer les individualités » avec, comme complément, rechercher une « promotion » par sa propre accession à ces organes ;
- adhérer, plus généralement, à une vision élitiste de l'organisation dans laquelle on aspire à faire partie des « militants de première classe » en développant un mépris pour ceux qu'on considère comme des « militants de seconde classe ».
4) L'opportunisme, qui a constitué historiquement le plus grave danger pour les organisations du prolétariat, est une autre expression de la pénétration d'idéologies étrangères : bourgeoise et surtout petite-bourgeoise. En particulier, un de ses moteurs est l'impatience laquelle exprime la vision d'une couche de la société condamnée à l'impuissance au sein de celle-ci et qui n'a aucun avenir à l'échelle de l'histoire. Son autre moteur est la tendance à vouloir concilier les intérêts et les positions des deux principales classes de la société, le prolétariat et la bourgeoisie, entre lesquelles se trouve coincée la petite bourgeoisie. De ce fait, l'opportunisme se distingue par le fait qu'il tend à sacrifier les intérêts généraux et historiques du prolétariat au bénéfice d'illusoires « succès » immédiats et circonstanciels. Mais, comme il n'y a pas opposition pour la classe ouvrière entre sa lutte au sein du capitalisme et sa lutte historique pour l'abolition de ce dernier, la politique de l'opportunisme revient finalement à sacrifier également les intérêts immédiats du prolétariat en le poussant, notamment, à composer avec les intérêts et les positions de la bourgeoisie. En fin de compte, lors des moments historiques cruciaux, comme la guerre impérialiste et la révolution prolétarienne, les courants politiques opportunistes sont conduits à rejoindre le camp de la classe ennemie comme ce fut le cas avec la majorité des partis socialistes lors de la première guerre mondiale et des partis communistes à la veille de la seconde.
5) Le putschisme –également appelé aventurisme[1] – se présente comme l'opposé de l'opportunisme. Sous couvert de «°l'intransigeance°» et du «°radicalisme°», il se déclare toujours prêt à se lancer à l'assaut de la bourgeoisie pour des combats « décisifs » alors que les conditions d'un tel combat n'existent pas encore pour le prolétariat. A l'occasion, il ne néglige pas de qualifier d'opportuniste, de conciliateur, voire de « traître » le courant authentiquement prolétarien et marxiste qui se préoccupe d'éviter à la classe ouvrière de s'engager dans un combat perdu d'avance. En réalité, issu des mêmes sources que l'opportunisme, l'impatience petite-bourgeoise, il est fréquent qu'il converge avec celui-ci. L'histoire n'est pas avare en exemples où des courants opportunistes ont soutenu des courants putschistes ou se sont convertis au radicalisme putschiste. C'est ainsi qu'au début du siècle, la droite de la social-démocratie allemande apportait, contre l'opposition de sa gauche représentée notamment par Rosa Luxemburg, son soutien aux socialistes révolutionnaires russes adeptes du terrorisme. De même, en janvier 1919, alors que la même Rosa Luxemburg se prononce contre l'insurrection des ouvriers à Berlin, suite à la provocation du gouvernement social-démocrate, les indépendants qui viennent à peine de quitter ce gouvernement se précipitent dans l'insurrection qui aboutit au massacre de milliers d'ouvriers ainsi que des principaux dirigeants communistes.
6) Le combat contre la pénétration de l'idéologie bourgeoise et petite bourgeoise dans l'organisation de classe, de même que contre les différentes manifestations de cette pénétration, constitue une responsabilité permanente des révolutionnaires. En fait, c'est même le combat principal qu'ait eu à mener le courant authentiquement prolétarien et révolutionnaire au sein des organisations de la classe dans la mesure où il était bien plus difficile que le combat direct contre les forces officielles et avérées de la bourgeoisie. Le combat contre les sectes et le sectarisme est un des premiers qu'aient livré Marx et Engels, particulièrement au sein de l'AIT. De même, le combat contre l'individualisme, sous la forme de l'anarchisme notamment, a mobilisé aussi bien ces derniers que les marxistes de la seconde internationale (particulièrement Rosa Luxemburg et Lénine). Le combat contre l'opportunisme est certainement le plus constant et systématique conduit par le courant révolutionnaire depuis ses origines :
- contre le « socialisme d’État » des lassaliens dans les années 1860 et 1870 ;
- contre tous les révisionnistes et réformistes à la Bernstein ou à la Jaurès au tournant du siècle ;
- contre le menchevisme ;
- contre le centrisme à la Kautsky à la veille, au cours et à la suite de la première guerre mondiale ;
- contre la dégénérescence de l'IC et des partis communistes tout au long des années 1920 et au début des années 1930 ;
- contre celle du courant trotskiste au cours des années 1930.
Le combat contre l’aventurisme-putschisme, enfin, ne s’est pas imposé avec la même constance que le précédent. Cependant, il est mené dès les premiers pas du mouvement ouvrier (contre la tendance immédiatiste Willich-Schapper dans la Ligue des communistes, contre les aventures bakounistes lors de la « Commune » de Lyon en 1870 et la guerre civile en Espagne en 1873). De même, il est particulièrement important au cours de la vague révolutionnaire de 1917-23 ; c’est notamment grâce à la capacité des bolcheviks à mener ce combat en juillet 1917 que la révolution d’Octobre a pu avoir lieu.
7) Les exemples précédents mettent en évidence que l’impact de ces différentes manifestations de la pénétration d'idéologies étrangères dépend étroitement :
- des périodes historiques ;
- du moment du développement de la classe ouvrière ;
- des responsabilités qui sont les siennes dans telle ou telle circonstance.
Par exemple, une des manifestations les plus importantes et explicitement combattues de la pénétration d'idéologies étrangères au prolétariat, l'opportunisme, même si elle s’est manifestée tout au long de l’histoire du mouvement ouvrier, trouve son terrain par excellence dans les partis de la deuxième internationale au cours d’une période :
- propice aux illusions d'une possible conciliation avec la bourgeoisie du fait de la prospérité du capitalisme et des réelles avancées dans les conditions de vie de la classe ouvrière ;
- où l’existence de partis de masse favorise l’idée que la simple pression de ces partis pourrait progressivement transformer le capitalisme pour aboutir au socialisme.
De même, la pénétration de l’opportunisme au sein des partis de la troisième internationale est fortement déterminée par le reflux de la vague révolutionnaire. Ce reflux encourage l’idée qu’il est possible de gagner une audience dans les masses ouvrières en faisant des concessions aux illusions qui pèsent sur celles-ci concernant des questions comme le parlementarisme, le syndicalisme ou la nature des partis socialistes.
L’importance du moment historique sur les différents types de manifestations de la pénétration des idéologies étrangères à la classe se manifeste encore plus clairement pour ce qui concerne le sectarisme. En effet celui-ci est particulièrement présent aux tout débuts du mouvement ouvrier, lorsque les prolétaires sortent à peine de l’artisanat et des sociétés de compagnonnage (avec leurs rituels et leurs secrets de métier). De même, il connaît un regain important au plus profond de la contre-révolution avec le courant bordiguiste pour qui le repliement sur soi apparaît comme un moyen (évidemment erroné) de se protéger de la menace de l’opportunisme.
8) Le phénomène du parasitisme politique, qui lui aussi résulte essentiellement de la pénétration d’idéologies étrangères au sein de la classe ouvrière, n’a pas fait l’objet, tout au cours de l’histoire du mouvement ouvrier, de la même attention que d’autres phénomènes comme celui de l’opportunisme. Il en est ainsi parce le parasitisme n’affecte de façon significative les organisations prolétariennes que dans des moments très spécifiques de l’histoire. L’opportunisme, par exemple, constitue une menace constante pour les organisations prolétariennes et il s’exprime particulièrement dans les moments où celles-ci connaissent leur plus grand développement. En revanche, le parasitisme ne trouve pas fondamentalement sa place dans les moments les plus importants du mouvement de la classe. Au contraire, c’est dans une période d'immaturité relative du mouvement où les organisations du prolétariat ont encore un faible impact et peu de traditions que le parasitisme trouve son terrain le plus propice. Ce fait est lié à la nature même du parasitisme qui, pour être efficace, doit trouver en face de lui des éléments en recherche vers des positions de classe qui aient du mal à faire la différence entre les véritables organisations révolutionnaires et les courants dont la seule raison d’être est de vivre aux dépends de celles-ci, de saboter leur action, voire de les détruire. En même temps, le phénomène du parasitisme, également par nature, n’apparaît pas au tout début du développement des organisations de la classe mais lorsqu’elles sont déjà constituées et qu’elles ont fait la preuve qu’elles défendent véritablement les intérêts prolétariens.
Ce sont bien ces éléments qu’on trouve dans la première manifestation historique du parasitisme politique, l’Alliance de la Démocratie Socialiste qui a tenté de saboter le combat de l’AIT et de la détruire.
9) Il appartient à Marx et Engels d’avoir les premiers identifié la menace que constitue le parasitisme pour les organisations prolétariennes :
- « Il est grand temps, une fois pour toutes, de mettre fin aux luttes internes quotidiennement provoquées dans notre Association par la présence de ce corps parasite. Ces querelles ne servent qu'à gaspiller l'énergie qui devrait être utilisée à combattre le régime de la bourgeoisie. En paralysant l'activité de l'Internationale contre les ennemis de la classe ouvrière, l'Alliance sert admirablement la bourgeoisie et les gouvernements. » (Engels, « Le Conseil général à tous les membres de l'Internationale », avertissement contre l'Alliance de Bakounine).
Ainsi, la notion de parasitisme politique n’est nullement « une invention du CCI ». C’est l’AIT qui la première a été confrontée à cette menace contre le mouvement prolétarien, qui l’a identifiée et combattue. C’est elle, à commencer par Marx et Engels, qui caractérisait déjà de parasites ces éléments politisés qui, tout en prétendant adhérer au programme et aux organisations du prolétariat, concentrent leurs efforts sur le combat, non pas contre la classe dominante, mais contre les organisations de la classe révolutionnaire. L'essence de leur activité est de dénigrer et de manœuvrer contre le camp communiste, même s'ils prétendent lui appartenir et le servir[2].
- « Pour la première fois dans l'histoire de la lutte de classe, nous sommes confrontés à une conspiration secrète au cœur de la classe ouvrière, et destinée à saboter non le régime d'exploitation existant, mais l'Association elle-même qui représente l'ennemi le plus acharné de ce régime. » (Engels, «Rapport au Congrès de La Haye sur l'Alliance»).
10) Dans la mesure où le mouvement ouvrier dispose avec l’AIT d’une riche expérience de lutte contre le parasitisme, il est de la plus haute importance, pour faire face aux offensives parasitaires actuelles et s’armer contre elles, de rappeler les principaux enseignements de cette lutte passée. Ces enseignements concernent toute une série d’aspects :
- le moment de surgissement du parasitisme ;
- ses spécificités par rapport aux autres dangers auxquels se confrontent les organisations prolétariennes ;
- son terrain de recrutement ;
- ses méthodes ;
- les moyens d’une lutte efficace contre lui.
En fait, comme on le verra, il existe sur tous ces aspects, une similitude frappante entre la situation à laquelle est confronté aujourd’hui le milieu prolétarien et celle affrontée par l’AIT.
11) Même s’il affecte une classe ouvrière encore inexpérimentée, le parasitisme, comme on l'a vu, n'est apparu historiquement comme ennemi du mouvement ouvrier que lorsque celui-ci a atteint un certain degré de maturité, dépassant sa phase infantile du sectarisme.
- « La première phase dans la lutte du prolétariat contre la bourgeoisie est caractérisée par le mouvement des sectes. C'était justifié au temps où le prolétariat n'était pas suffisamment développé pour agir en tant que classe. » (Marx-Engels).
C'est l'apparition du marxisme, la maturation de la conscience de classe prolétarienne et la capacité de la classe et de son avant-garde d'organiser sa lutte qui asseyent le mouvement ouvrier sur des bases saines.
- « A partir de ce moment, où le mouvement de la classe ouvrière est devenu une réalité, les utopies fantastiques ont disparu (...) parce que la place de ces utopies avait été prise par une compréhension réelle des conditions historiques de ce mouvement, et parce que les forces d'une organisation de combat de la classe ouvrière commençaient de plus en plus à se rassembler. » (Marx, La guerre civile en France, premier projet).
En fait, le parasitisme est historiquement apparu en réponse à la fondation de la première Internationale, qu'Engels décrivait comme « le moyen de progressivement dissoudre et absorber toutes les différentes petites sectes ». (Engels, Lettre à Kelly/Vischnevetsky)
En d'autres termes, l'Internationale était un instrument obligeant les différentes composantes du mouvement ouvrier à s'engager dans un processus collectif et public de clarification, et à se soumettre à une discipline unifiée, impersonnelle, prolétarienne, organisationnelle. C'est d'abord en résistance à cette « dissolution et absorption » internationale de toutes les particularités et autonomies programmatiques et organisationnelles non prolétariennes que le parasitisme a déclaré sa guerre au mouvement révolutionnaire.
- « Les sectes, au début un levier du mouvement, deviennent une entrave, dès qu'elles ne sont plus à l'ordre du jour ; elles deviennent alors réactionnaires. La preuve de ceci, ce sont les sectes en France et en Grande-Bretagne, et récemment les lassalliens en Allemagne qui, après des années de soutien à l'organisation du prolétariat, sont simplement devenues des armes de la police. » (Marx-Engels, Les prétendues scissions dans l'Internationale).
12) C'est ce cadre d'analyse dynamique développé par la première Internationale qui explique pourquoi la période actuelle, celle des années 1980 et surtout des années 1990, a été le témoin d'un développement du parasitisme sans précédent depuis l'époque de l’Alliance et du courant lassalien. En effet, nous sommes actuellement confrontés à de multiples regroupements informels, agissant souvent dans l'ombre, prétendant appartenir au camp de la Gauche communiste, mais qui dédient leurs énergies à combattre les organisations marxistes existantes plutôt que le régime bourgeois. Comme à l'époque de Marx et Engels, cette vague parasitaire réactionnaire a pour fonction de saboter le développement du débat ouvert et de la clarification prolétarienne, et d'empêcher l'établissement de règles de conduite liant tous les membres du camp prolétarien. L'existence :
- d'un courant international marxiste comme le CCI, rejetant le sectarisme et le monolithisme ;
- de polémiques publiques entre organisations révolutionnaires ;
- du débat actuel à propos des principes organisationnels marxistes et de la défense du milieu révolutionnaire ;
- de nouveaux éléments révolutionnaires à la recherche des véritables traditions marxistes, organisationnelles et programmatiques ;
sont parmi les éléments les plus importants suscitant actuellement la haine et l’offensive du parasitisme politique.
Comme on l’a vu avec l’expérience de l’AIT, ce n'est que dans les périodes où le mouvement ouvrier passe d'un stade d'immaturité fondamentale vers un niveau qualitativement supérieur, spécifiquement communiste, que le parasitisme devient son principal opposant. Dans la période actuelle, cette immaturité n’est pas le produit de la jeunesse du mouvement ouvrier dans son ensemble, comme au temps de l’AIT, mais avant tout le résultat des 50 ans de contre-révolution qui ont suivi la défaite de la vague révolutionnaire de 1917-23. Aujourd'hui, c'est cette rupture de la continuité organique avec les traditions des générations passées de révolutionnaires qui explique avant tout le poids des réflexes et des comportements anti-organisationnels petits-bourgeois parmi beaucoup d’éléments qui se réclament du marxisme et de la Gauche communiste.
13) A côté de toute une série de similitudes existant entre les conditions et les caractéristiques du surgissement du parasitisme au moment de l'AIT et du parasitisme d'aujourd'hui, il convient de signaler une différence notable entre les deux époques : au siècle dernier, le parasitisme avait principalement pris la forme d'une organisation structurée et centralisée dans l'organisation de la classe alors qu'aujourd'hui il prend essentiellement la forme de petits groupes, ou même d'éléments « non organisés » (bien que travaillant souvent en lien les uns avec les autres). Une telle différence ne remet pas en cause la nature fondamentalement identique du phénomène du parasitisme lors des deux périodes. Elle s'explique essentiellement par les faits suivants :
- un des terrains sur lesquels s'est développée l'Alliance était celui des vestiges des sectes de la période précédente : elle-même a repris des sectes leur structure étroitement centralisée autour d'un « prophète » et leur goût de l'organisation clandestine ; en revanche, un des éléments sur lesquels s'appuie le parasitisme actuel est constitué par les vestiges de la contestation étudiante qui avait pesé sur la reprise historique du combat prolétarien à la fin des années 60, et particulièrement en 1968, avec tout son bagage d'individualisme et de remise en cause de l'organisation ou de la centralisation censées «°étouffer les individus°»[3];
- au moment de l'AIT, il existait une seule organisation regroupant l'ensemble du mouvement prolétarien et il appartenait aux courants qui avaient vocation de le détruire, tout en se revendiquant de son combat contre la bourgeoisie, d'agir au sein de cette organisation ; par contre, à un moment historique où les éléments représentant le combat révolutionnaire de la classe ouvrière sont dispersés entre les différentes organisations du milieu politique prolétarien, chaque groupe de la mouvance parasitaire peut se présenter comme appartenant à celui-ci dont il représenterait une «composante» à côté des autres groupes.
En ce sens, il importe d'affirmer clairement que la dispersion actuelle du milieu politique prolétarien, et toutes les démarches sectaires empêchant ou entravant un effort vers le regroupement ou le débat fraternel entre ses différentes composantes, fait le jeu du parasitisme.
14) Le marxisme, suite à l'expérience de l’AIT, a mis en évidence les différences entre le parasitisme et les autres manifestations de la pénétration des idéologies étrangères dans les organisations de la classe. Par exemple, l’opportunisme, même s’il peut dans un premier temps se manifester sous la forme organisationnelle (comme ce fut le cas des mencheviks en 1903), s’attaque fondamentalement au programme de l’organisation prolétarienne. Pour sa part, le parasitisme, afin de pouvoir tenir son rôle, ne s’attaque pas à priori à ce programme. C’est essentiellement sur le terrain organisationnel qu’il exerce son action, même si, afin de mieux pouvoir « recruter », il est souvent conduit à remettre en cause certains aspects du programme. On a pu voir ainsi Bakounine enfourcher le cheval de « l’abolition du droit d’héritage », lors du Congrès de Bâle de 1869, parce qu’il savait qu’il pourrait rassembler de nombreux délégués autour de cette revendication creuse et démagogique compte tenu des nombreuses illusions existant alors sur ce sujet dans l’Internationale. Mais en réalité, ce qu’il visait c’était de renverser le Conseil Général influencé par Marx, et qui combattait cette revendication, afin de pouvoir constituer un Conseil Général qui serait à sa dévotion[4]. Du fait que le parasitisme s'attaque directement à la structure organisationnelle des formations prolétariennes, il représente, quand les conditions historiques permettent son apparition, un danger beaucoup plus immédiat que l'opportunisme. Ces deux manifestations de la pénétration d'idéologies étrangères constituent un danger mortel pour les organisations prolétariennes. L'opportunisme conduit à leur mort comme instruments de la classe ouvrière par leur passage au service de la bourgeoisie mais dans la mesure où il s'attaque avant tout au programme, il ne peut parvenir à ce résultat qu'à travers tout un processus où le courant révolutionnaire, la Gauche, pourra de son côté développer au sein de l'organisation le combat pour la défense de ce programme[5]. En revanche, dans la mesure où c'est l'organisation elle-même, en tant que structure, qui est menacée par le parasitisme, cela laisse beaucoup moins de temps au courant prolétarien d'organiser la défense. L'exemple de l'AIT est significatif à cet égard : l'ensemble du combat en son sein contre l'Alliance ne dure pas plus de 4 ans, entre 1868 où Bakounine entre dans l'Internationale et 1872 où il en est exclu par le Congrès de la Haye. Cela ne fait que souligner une chose : la nécessité pour le courant prolétarien de riposter rapidement au parasitisme, de ne pas attendre qu'il ait fait des ravages pour engager le combat contre lui.
15) Comme on l'a vu, il importe de distinguer le parasitisme des autres manifestations de la pénétration au sein de la classe d'idéologies étrangères. Cependant, c'est une des caractéristiques du parasitisme que d'utiliser ces autres types de manifestations. Cela découle des origines du parasitisme qui lui aussi résulte d'une telle pénétration d'influences étrangères mais aussi du fait que sa démarche, qui vise en dernier ressort à détruire les organisations prolétariennes, ne s'embarrasse d'aucun principe ni d'aucun scrupule. Ainsi, au sein de l'AIT et du mouvement ouvrier de son époque, l'Alliance s'est distinguée, comme on l'a déjà vu, par sa capacité à mettre à profit les vestiges du sectarisme, à employer une démarche opportuniste (sur la question du droit d'héritage, par exemple) ou à se lancer dans des mouvements totalement aventuristes (« Commune » de Lyon et guerre civile en Espagne de 1873). De même, elle s'est fortement appuyée sur l'individualisme d'un prolétariat sortant à peine de l'artisanat ou de la paysannerie (particulièrement en Espagne et dans le Jura suisse). Les mêmes caractéristiques se retrouvent dans le parasitisme d'aujourd'hui. Le rôle de l'individualisme dans la constitution du parasitisme actuel a déjà été relevé mais il vaut la peine de signaler aussi que toutes les scissions du CCI qui ont par la suite constitué des groupes parasites (GCI, CBG, FECCI) se sont appuyées sur une démarche sectaire en rompant de façon prématurée et se refusant à mener jusqu'au bout le débat pour la clarification. De même, l'opportunisme a été une des marques du GCI qui, après avoir accusé le CCI, quand il n'était qu'une « tendance » en son sein, de ne pas imposer assez d'exigences aux nouveaux candidats, s'est converti au racolage sans principes, modifiant son programme dans le sens des mystifications gauchistes à la mode (comme le tiers-mondisme). Ce même opportunisme a été mis en pratique par le CBG et la FECCI qui, au début des années 1990, se sont livrés à un marchandage incroyable afin d'essayer d'engager une démarche vers leur regroupement. Enfin, pour ce qui concerne l'aventurisme-putschisme, il est remarquable que, même si on laisse de côté les complaisances du GCI à l'égard du terrorisme, tous ces groupes aient systématiquement plongé dans les pièges que la bourgeoisie tendait à la classe, appelant celle-ci à développer ses luttes alors que le terrain avait été préalablement miné par la classe dominante et ses syndicats, comme ce fut le cas, notamment, à l'automne 1995 en France.
16) L'expérience de l'AIT a mis en évidence la différence pouvant exister entre le parasitisme et le marais (même si à cette époque, ce dernier terme n'était pas encore utilisé). Le marxisme définit le marais comme une mouvance politique partagée entre les positions de la classe ouvrière et celles de la bourgeoisie ou de la petite bourgeoisie. De telles mouvances peuvent surgir comme une première étape dans un processus de prise de conscience de secteurs du prolétariat ou de rupture avec des positions bourgeoises. Elles peuvent également représenter des vestiges de courants qui, à un moment donné, ont exprimé un réel effort de prise de conscience de la classe mais qui se sont révélés incapables d'évoluer en fonction des nouvelles conditions de la lutte prolétarienne et de l'expérience de cette dernière. Les mouvances du marais ne peuvent pas, en général, se maintenir de façon stable. Le tiraillement qui les affecte entre les positions prolétariennes et celles d'autres classes les conduisent soit à rejoindre pleinement les positions révolutionnaires, soit à rejoindre les positions de la bourgeoisie, ou bien encore à se déchirer entre ces deux tendances. Un tel processus de décantation est en général impulsé et accéléré par les grands événements auxquels se confronte la classe ouvrière (au 20e siècle, il s'agit essentiellement de la guerre impérialiste et de la révolution prolétarienne) et le sens général de cette décantation dépend grandement de l'évolution du rapport de forces entre la bourgeoisie et le prolétariat. Face à ces courants, la Gauche dans le mouvement ouvrier a toujours eu comme attitude de ne pas les considérer comme perdus en bloc pour le combat prolétarien mais d'impulser en leur sein une clarification permettant à leurs éléments les plus sains de rejoindre pleinement ce combat tout en dénonçant avec la plus grande fermeté ceux qui prenaient le chemin de la classe ennemie.
17) Au sein de l'AIT il existait à côté du courant marxiste, qui constituait son avant-garde, des courants qu'on pourrait définir comme appartenant au marais. Tel était le cas, par exemple, de certains courants proudhoniens qui, dans la première partie du 19e siècle, avaient constitué une réelle avant-garde du prolétariat en France. Au moment du combat contre le corps parasitaire de l'Alliance, ces courants avaient cessé de constituer une telle avant-garde. Cependant, malgré toutes leurs confusions, ils avaient été capables de participer à ce combat pour la sauvegarde de l'Internationale, notamment au Congrès de La Haye. Envers eux, le courant marxiste avait eu une tout autre attitude qu'envers l'Alliance. A aucun moment il n'avait été question de les exclure. Au contraire, il importait de les associer au combat de l'AIT contre ses ennemis, non seulement du fait du poids qu'ils représentaient encore dans l'Internationale, mais aussi parce que ce combat constituait une expérience permettant à ces courants de se clarifier. Dans la pratique, ce combat a permis de vérifier qu'il existe une différence fondamentale entre le marais et le parasitisme : alors que le premier est traversé par une vie prolétarienne qui lui permet, ou à ses meilleurs éléments, de rejoindre le courant révolutionnaire, le second, dont la vocation profonde est de détruire l'organisation de classe ne peut, en aucune façon, évoluer en ce sens, même si certains des éléments qui ont pu être trompés par le parasitisme peuvent faire une telle démarche.
Aujourd'hui, il importe également de faire une telle différence entre les courants du marais[6] et les courants parasites. Autant les groupes du milieu prolétarien se doivent de tenter de faire évoluer les premiers vers des positions marxistes et de provoquer en leur sein une clarification politique, autant ils doivent faire montre de la plus grande sévérité envers le parasitisme, de dénoncer le rôle sordide qu'il joue au grand bénéfice de la bourgeoisie. Et cela est d'autant plus important que les courants du marais, du fait de leurs confusions (notamment de leurs réticences envers l'organisation, comme c'est le cas pour ceux qui se rattachent au conseillisme), sont particulièrement vulnérables aux attaques du parasitisme.
18) Toutes les manifestations de la pénétration d'idéologies étrangères au sein des organisations prolétariennes font le jeu de la classe ennemie. Cela est particulièrement évident en ce qui concerne le parasitisme dont le but est la destruction de ces organisations (que ce soit de façon avouée ou non). Là-dessus, l'AIT a été particulièrement claire en affirmant que, même s'il n'était pas un agent de l’État capitaliste, Bakounine servait ses intérêts bien mieux qu'un tel agent n'aurait pu le faire. Cela ne signifie pas pour autant que le parasitisme représente en soi un secteur de l'appareil politique de la classe dominante à l'image des courants bourgeois d'extrême gauche comme le trotskisme aujourd'hui. En fait, aux yeux de Marx et Engels, même les parasites les mieux connus de leur époque, Bakounine et Lassalle, n'étaient pas vus comme des représentants politiques de la classe bourgeoise. Cette analyse découle de la compréhension que le parasitisme ne constitue pas comme tel une fraction de la bourgeoisie, n'ayant ni programme ou orientation spécifique pour le capital national, ni une place particulière dans les organes étatiques pour contrôler la lutte de la classe ouvrière. Cela dit, compte tenu des services que le parasitisme rend à la classe capitaliste, il bénéficie d'une sollicitude toute particulière de la part de celle-ci. Cette sollicitude se manifeste principalement sous trois formes :
- un soutien politique aux agissements du parasitisme ; ainsi, la presse bourgeoise européenne a pris fait et cause pour l'Alliance et Bakounine dans son conflit avec le Conseil général ;
- l'infiltration et les manœuvres d'agents de l’État au sein des courants parasitaires ; c'est ainsi que la section de Lyon de l'Alliance est carrément dirigée par deux agents bonapartistes : Richard et Blanc.
- la création directe par des secteurs de la bourgeoisie de courants politiques ayant vocation de parasiter l'organisation prolétarienne ; c'est ainsi que se crée « La Ligue pour la Paix et la Liberté » (dirigée par Vogt, agent bonapartiste) qui, aux dires mêmes de Marx, «est fondée en opposition à l'Internationale» et qui tente, en 1868, de « s'allier » avec elle.
Il faut noter à ce propos que, bien que la plupart des courants parasitaires affichent un programme prolétarien, ce dernier n’est pas indispensable pour qu’une organisation puisse accomplir une fonction de parasitisme politique lequel ne se distingue pas par les positions qu’il défend mais par son attitude destructrice envers les véritables organisations de la classe ouvrière.
19) Dans la période actuelle, alors que les organisations prolétariennes n'ont pas la notoriété que pouvait avoir l'AIT en son temps, la propagande bourgeoise officielle ne se préoccupe pas dans l'ensemble d'apporter un soutien aux groupes et éléments parasitaires (ce qui aurait, en outre, le désavantage de les discréditer aux yeux des éléments qui s'approchent des positions communistes). Il faut cependant noter que dans les campagnes bourgeoises spécifiquement dirigées contre la Gauche communiste, celles touchant au « négationnisme », il est fait une place importante à des groupes comme l'ex Mouvement communiste, la Banquise, etc. présentés comme des représentants de la Gauche communiste, alors qu'ils avaient une forte coloration parasitaire.
En revanche, c'est bien un agent d'une officine de l’État, Chénier[7], qui a joué le rôle moteur dans la formation en 1981 au sein du CCI d'une « tendance secrète » qui, après avoir provoqué la perte de la moitié de la section en Grande-Bretagne, a donné le jour à un des groupuscules parasitaires les plus typiques, le CBG.
Enfin, les tentatives de courants bourgeois de s'infiltrer dans le milieu prolétarien pour y assumer une fonction parasitaire sont tout à fait présentes avec l'action du groupe gauchiste espagnol Hilo Rojo (qui a essayé pendant des années de s'attirer les bonnes grâces du milieu prolétarien avant que de lancer une attaque en règle contre lui) ou avec l'OCI (groupe gauchiste italien dont certains éléments sont passés par le bordiguisme et qui aujourd'hui se présente comme le « véritable héritier » de ce courant).
20) La pénétration d'agents de l’État dans la mouvance parasitaire est évidemment facilitée par la nature même de celle-ci dont la vocation fondamentale est de combattre les véritables organisations prolétariennes. En fait, c'est le recrutement même du parasitisme parmi les éléments qui rejettent la discipline d'une organisation de classe, qui n'ont que mépris pour son fonctionnement statutaire, qui se complaisent dans l'informalisme et les loyautés personnelles plutôt que s'attacher à la loyauté envers l'organisation, qui ouvre largement les portes du milieu parasitaire à cette infiltration. Ces portes sont également largement ouvertes aux auxiliaires involontaires de l’État capitaliste que sont les aventuriers, ces éléments déclassés qui essaient de mettre le mouvement ouvrier au service de leurs ambitions, d'une notoriété et d'un pouvoir que leur refuse la société bourgeoise. Dans l'AIT, l'exemple de Bakounine est évidemment le plus connu. Marx et ses camarades n'ont jamais prétendu que celui-ci fut un agent direct de l’État. En revanche, ils ont été parfaitement capables non seulement d'identifier et de dénoncer les services qu'il rendait involontairement à la classe dominante, mais aussi la démarche et les origines de classe des aventuriers au sein des organisations prolétariennes et le rôle qu'ils jouaient comme dirigeants du parasitisme. Ainsi, à propos des agissements de l'Alliance secrète de Bakounine dans l'AIT, ils écrivaient que les « éléments déclassés » avaient été capables de « s'y infiltrer et d'y établir, dans son centre lui-même, des organisations secrètes ». Cette même approche est reprise par Bebel à propos de Schweitzer, leader du courant lassalien (qui, en plus de son opportunisme, avait une composante parasitaire importante) : « Il a rejoint le mouvement dès qu'il a vu qu'il n'y avait pas d'avenir pour lui dans la bourgeoisie, que pour lui, que son mode de vie avait déclassé très tôt, le seul espoir était de jouer un rôle dans le mouvement ouvrier, auquel son ambition et ses capacités le prédestinaient. » (Bebel, Autobiographie).
21) Cela dit, même si les courants parasitaires sont souvent dirigés par des aventuriers déclassés (quand ce n'est pas par des agents directs de l’État), ils ne recrutent pas uniquement dans cette catégorie. On y trouve également des éléments qui peuvent au départ être animés par une volonté révolutionnaire et qui ne visent pas à détruire l’organisation mais qui :
- imprégnés de l’idéologie petite-bourgeoise, impatiente, individualiste, affinitaire, élitiste ;
- «°déçus°» par la classe ouvrière qui n’avance pas assez vite à leur gré ;
- supportant mal la discipline organisationnelle, frustrés de ne pas trouver dans l’activité militante les «°gratifications°» qu’ils attendaient ou de ne pas accéder à des « postes » auxquels ils aspiraient ;
en viennent à développer une hostilité fondamentale contre l’organisation prolétarienne, même si cette hostilité s’habille d’une prétention « militante ».
Dans l’AIT on a assisté à un tel phénomène de la part d’un certain nombre de membres du Conseil Général comme Eccarius, Jung et Hales.
Par ailleurs, le parasitisme est capable de recruter des éléments prolétariens sincères et militants mais qui, affectés de faiblesses petites-bourgeoises ou d’un manque d’expérience, se laissent entraîner, tromper, voire manipuler, par des éléments clairement anti-prolétariens. Dans l’AIT, c’est typiquement le cas de la plupart des ouvriers qui ont fait partie de l’Alliance en Espagne.
22) Pour ce qui concerne le CCI, la plupart des scissions ayant abouti à la formation de groupes parasitaires étaient très clairement constituées d’éléments animés par la démarche petite bourgeoise décrite ci-dessus. L’impulsion donnée par des intellectuels en mal de « reconnaissance » et qui ont été frustrés de ne pas l’obtenir de la part de l’organisation, l’impatience face au fait qu’ils ne parvenaient pas à convaincre les autres militants de la « justesse » de leurs positions ou face à la lenteur du processus de développement de la lutte de classe, les susceptibilités heurtées par la critique de leurs positions ou de leur comportement, le refus d’une centralisation qu’ils vivaient comme du « stalinisme », ont été le moteur de la constitution des « tendances » ayant abouti à la formation de groupes parasites plus ou moins éphémères et aux désertions venant alimenter le parasitisme informel. Successivement, la « tendance » de 1979 qui allait aboutir à la formation du « Groupe Communiste Internationaliste », la tendance Chénier dont un des avatars fut le défunt Communist Bulletin Group, la « tendance » McIntosh-ML-JA (constitué en grande partie de membres de l’organe central du CCI) ayant donné vie à la FECCI (« Fraction Externe du CCI », devenue depuis Perspective Internationaliste) ont constitué des illustrations typiques de ce phénomène. Dans ces épisodes on a pu voir également que des éléments ayant des préoccupations prolétariennes indiscutables ont pu se laisser entraîner par fidélité personnelle envers les chefs de file de ces « tendances » qui n’en étaient pas vraiment mais des clans au sens où le CCI les a déjà définis. Le fait que toutes les scissions parasitaires de notre organisation soient apparues d’abord sous forme de clans internes n’est évidemment pas le fait du hasard. En réalité, il existe une très grande similitude entre les comportements organisationnels qui sont à la base de la formation des clans et celles dont se nourrit le parasitisme : individualisme, cadre statutaire ressenti comme une contrainte, frustrations envers l’activité militante, loyauté à l’égard des personnes au détriment de la loyauté envers l’organisation, influence de « gourous » (personnages à la quête d’une emprise personnelle sur les autres militants).
En fait, ce que représente déjà la formation des clans, la destruction du tissu organisationnel, trouve dans le parasitisme son expression ultime : la volonté de détruire les organisations prolétariennes elles-mêmes[8].
23) L’hétérogénéité qui est une marque du parasitisme, puisqu’il compte dans ses rangs à la fois des éléments relativement sincères et des éléments animés par la haine de l’organisation prolétarienne, voire des aventuriers politiques ou des agents directs de l'État, en fait le terrain par excellence des politiques secrètes permettant aux éléments les plus hostiles aux préoccupations prolétariennes d’entraîner les premiers avec eux. La présence de ces éléments « sincères », notamment d’éléments ayant consacré de réels efforts à la construction de l’organisation, constitue pour le parasitisme une des conditions de son succès puisqu’il peut ainsi se dédouaner et accréditer son étiquette « prolétarienne » frauduleuse (tout comme le syndicalisme a besoin de militants « sincères et dévoués » pour tenir son rôle). En même temps, le parasitisme et ses éléments les plus en pointe ne peuvent établir leur contrôle sur une bonne partie de leurs troupes qu’en cachant, dissimulant leurs buts véritables. Ainsi, l’Alliance dans l’AIT comprenait plusieurs cercles autour du « citoyen B » de même que des statuts secrets réservés aux « initiés ». « L'Alliance divise ses membres en deux castes, initiés et non-initiés, aristocrates et plébéiens, les seconds étant condamnés à être dirigés par les premiers via une organisation dont ils ignorent l'existence. » (Engels, Rapport sur l'Alliance). Aujourd’hui, le parasitisme agit de la même façon et il est rare que des groupes parasites, et particulièrement les aventuriers ou les intellectuels frustrés qui les animent, affichent clairement leur programme. En ce sens, le Mouvement Communiste[9], qui dit clairement qu’il faut détruire le milieu de la Gauche communiste, est à la fois une caricature et le porte-parole le plus clair de la nature profonde du parasitisme.
24) Les méthodes employées par la 1re Internationale et les Eisenachiens contre le parasitisme ont servi de modèle à celles qu'utilise le CCI aujourd'hui. Dans les documents publics des congrès, dans la presse, dans les réunions ouvrières et même au parlement, les manœuvres du parasitisme ont été dénoncées. De façon répétée, il fut démontré que c'était les classes dominantes elles-mêmes qui se trouvaient derrière ces attaques et que leur but était la destruction du marxisme. Les travaux du congrès de La Haye ainsi que les célèbres discours de Bebel contre la politique secrète de Bismarck et Schweitzer révèlent la capacité du mouvement ouvrier à donner une explication globale tout en dénonçant ces manœuvres d'une manière extrêmement concrète. Parmi les raisons les plus importantes données par la 1re Internationale pour la publication des révélations sur les agissements de Bakounine, nous trouvons avant tout les suivantes :
- les démasquer ouvertement constituait le seul moyen pour débarrasser le mouvement ouvrier de telles méthodes ; seule une prise de conscience de tous ses membres de l'importance de ces questions pouvait empêcher leur répétition dans le futur ;
- il était nécessaire de dénoncer publiquement l'Alliance de Bakounine afin de dissuader ceux qui utilisaient les mêmes méthodes ; Marx et Engels savaient bien que d'autres parasites menant une politique secrète dans et en dehors de l'organisation, tels que les adeptes de Pyatt, existaient toujours ;
- seul un débat public pouvait briser le contrôle de Bakounine sur beaucoup de ses victimes et les encourager à témoigner ; à cette fin, les méthodes de manipulation de Bakounine furent révélées en particulier par la publication du Catéchisme révolutionnaire ;
- une dénonciation publique était indispensable pour empêcher l'Internationale d'être associée à de telles pratiques ; ainsi, la décision d'exclure Bakounine de l'Internationale fut prise après que soient arrivées des informations sur l'affaire Netchaïev et la prise de conscience du danger que celle-ci ne soit utilisée contre l'Association ;
- les leçons de cette lutte avaient une importance historique, pas seulement pour l'Internationale mais pour l'avenir du mouvement ouvrier ; c'est dans cet esprit que des années après, Bebel a dédié près de 80 pages de son autobiographie à la lutte contre Lassalle et Schweitzer.
Enfin, au centre de cette politique se trouvait la nécessité de démasquer les aventuriers politiques, tels que Bakounine et Schweitzer.
On ne peut assez souligner que cette attitude a caractérisé toute la vie politique de Marx, comme on peut le voir dans sa dénonciation des acolytes de Lord Palmerston ou de Herr Vogt. Il comprenait parfaitement que mettre de telles affaires sous le tapis ne pouvait bénéficier qu'à la classe dominante.
25) C'est cette tradition du mouvement ouvrier que poursuit le CCI avec ses articles sur sa propre lutte interne, ses polémiques contre le parasitisme, l'annonce publique de l'exclusion unanime d'un de ses membres par le 11e Congrès international, la publication d'articles sur la franc-maçonnerie, etc. En particulier, la démarche du CCI en défense des jurys d'honneur dans les cas d'éléments ayant perdu la confiance des organisations révolutionnaires, afin de défendre le milieu comme un tout, relève d'un esprit identique à celui du Congrès de La Haye, et des commissions d'enquête des partis ouvriers en Russie qui se sont tenues envers des gens soupçonnés d'être des agents provocateurs.
La tempête de protestations et d'accusations relayée par la presse bourgeoise à la publication des principaux résultats de l'enquête sur l'Alliance révèlent que c'est cette méthode rigoureuse de dénonciation publique qui indispose la bourgeoisie plus que toute autre chose. De même, la façon dont la direction opportuniste de la 2e Internationale a systématiquement ignoré, dans les années avant 1914, le fameux chapitre « Marx contre Bakounine » dans l'histoire du mouvement ouvrier montre la même peur de la part de tous les défenseurs des conceptions organisationnelles petites-bourgeoises.
26) Envers l'infanterie petite-bourgeoise du parasitisme, la politique du mouvement ouvrier a été de la faire disparaître de la scène politique. Ici, la dénonciation de l'absurdité des positions et des activités politiques des parasites joue un rôle important. Ainsi, Engels dans son célèbre article Les bakouninistes à l’œuvre (au cours de la guerre civile en Espagne) a soutenu et complété les révélations sur le comportement organisationnel de l'Alliance.
Aujourd'hui, le CCI adopte la même politique en combattant l'existence d'adeptes de différents centres organisés et « inorganisés » du réseau parasitaire.
En ce qui concerne les éléments plus ou moins prolétariens qui se laissent tromper par le parasitisme, la politique du marxisme a toujours été très différente. Sa politique a consisté à enfoncer un coin entre ces éléments et la direction parasitaire orientée ou encouragée par la bourgeoisie, en montrant que les premiers sont les victimes des derniers. Le but de cette politique est toujours d'isoler la direction parasitaire en éloignant ses victimes de sa zone d'influence. Envers ces « victimes », le marxisme a toujours dénoncé leur attitude et leurs activités tout en luttant en même temps pour raviver leur confiance dans l'organisation et le milieu prolétarien. Le travail de Lafargue et Engels envers la section espagnole de la Première Internationale en est une parfaite concrétisation.
Le CCI poursuit aussi cette tradition en organisant des confrontations avec le parasitisme afin de regagner des éléments trompés. La dénonciation par Bebel et Liebknecht de Schweitzer comme agent de Bismarck, face à un meeting de masse du parti lassallien à Wuppertal est un exemple bien connu de cette attitude.
27) Dans le mouvement ouvrier, la tradition de lutte contre le parasitisme s'est considérablement perdue depuis les grands combats au sein de l’AIT du fait :
- que celui-ci n’a pas représenté un danger majeur pour les organisations prolétariennes après l’AIT ;
- de la longueur et de la profondeur de la contre-révolution.
Cela constitue un élément de faiblesse très important du milieu politique prolétarien face à l’offensive du parasitisme. Ce danger est d’autant plus grave que la pression idéologique de la décomposition du capitalisme, pression qui, comme le CCI l’a mis en évidence, facilite la pénétration de l’idéologie petite-bourgeoise avec ses caractéristiques les plus extrêmes[10], crée en permanence un terrain propice au développement du parasitisme. C’est donc une responsabilité extrêmement importante qui incombe au milieu prolétarien que d’engager un combat déterminé contre ce fléau. D’une certaine façon, la capacité des courants révolutionnaires à identifier et à combattre le parasitisme sera un indice de leur capacité à combattre les autres menaces qui pèsent sur les organisations du prolétariat, et particulièrement la menace la plus permanente, celle de l’opportunisme.
En fait, dans la mesure où l’opportunisme et le parasitisme proviennent tous les deux de la même source (la pénétration de l’idéologie petite bourgeoise) et représentent une attaque contre les principes de l’organisation prolétarienne (les principes programmatiques pour le premier, les principes organisationnels pour le second), c’est tout naturellement qu’ils se tolèrent mutuellement et convergent. Ainsi, ce n’est nullement un paradoxe si dans l’AIT on a retrouvé côte à côte les bakouniniens « anti-étatistes » et les lassaliens « étatistes » (qui représentaient une variante de l’opportunisme). Une des conséquences de cela consiste dans le fait que c'est aux courants de Gauche des organisations prolétariennes qu'il revient de mener l'essentiel du combat contre le parasitisme. Dans l'AIT, c'est directement Marx et Engels et leur tendance qui assument le combat contre l'Alliance. Ce n'est nullement par hasard si les principaux documents rédigés au cours de ce combat portent leur signature (la circulaire du 5 mars 1872, Les prétendues scissions dans l'Internationale, est rédigée par Marx et Engels ; le rapport de 1873 sur « L'Alliance de la Démocratie socialiste et l'Association internationale des travailleurs » est le travail de Marx, Engels, Lafargue et Outine).
Ce qui était valable au moment de l’AIT le reste aujourd’hui. La lutte contre le parasitisme constitue une des responsabilités essentielles de la Gauche communiste. Elle se rattache étroitement à la tradition de ses combats acharnés contre l’opportunisme. Elle est, à l’heure actuelle, une des composantes fondamentales pour la préparation du parti de demain et conditionne en partie, de ce fait, tant le moment où celui-ci pourra surgir que sa capacité à jouer son rôle lors des luttes décisives du prolétariat.
[1] Il est évidemment nécessaire de distinguer les deux sens qu'on peut attribuer au terme «°aventurisme°». D'un part, il existe l'aventurisme de certains éléments déclassés, les aventuriers politiques, qui ne pouvant jouer un rôle au sein de la classe dominante et ayant compris que le prolétariat est appelé à occuper une place de premier plan dans la vie de la société et dans l'histoire, essayent de gagner auprès de ce dernier, ou de ses organisations, une reconnaissance qui leur permettra de jouer ce rôle personnel que leur refuse la bourgeoisie. En se tournant vers la lutte de la classe ouvrière, ces éléments n'ont pas comme objectif de se mettre à son service mais de la mettre au service de leurs ambitions. Ils cherchent la notoriété en « allant au prolétariat » comme d'autres la recherchent en parcourant le monde. D'autre part, l'aventurisme désigne également l'attitude politique consistant à se lancer dans des actions inconsidérées alors que les conditions minimales de leur succès, une maturité suffisante de la classe, n'existent pas. Une telle attitude, si elle peut être aussi le fait d'aventuriers politiques à la recherche d'émotions fortes, peut parfaitement être adoptée par des ouvriers et des militants totalement sincères, dévoués et désintéressés mais qui manquent de jugement politique ou sont tenaillés par l'impatience.
[2] Marx et Engels ne furent pas les seuls à identifier et à caractériser le parasitisme politique. Ainsi, à la fin du 19e siècle, un grand théoricien marxiste comme Antonio Labriola reprenait la même analyse du parasitisme : « Dans ce premier type de nos partis actuels [il s'agit de la Ligue des Communistes], dans cette cellule première, pour ainsi dire, de notre organisme complexe, élastique et très développé, il y avait non seulement la conscience de la mission à accomplir comme précurseur, mais il y avait aussi la forme et la méthode d'association qui conviennent seules aux premiers initiateurs de la révolution prolétarienne. Ce n'était plus une secte ; cette forme était déjà en fait dépassée. La domination immédiate et fantastique de l'individu était éliminée. Ce qui prédominait, c'était une discipline qui avait sa source dans l'expérience de la nécessité, et dans la doctrine qui doit être précisément la conscience réflexe de cette nécessité. Il en fut de même de l'Internationale, qui ne parut autoritaire qu'à ceux qui ne purent y faire valoir leur propre autorité. Il doit en être de même et il en sera ainsi dans tous les partis ouvriers : et là où ce caractère n'est pas ou ne peut pas être encore marqué, l'agitation prolétarienne, encore élémentaire et confuse, engendre seulement des illusions et n'est qu'un prétexte à intrigues. Et quand il n'en est pas ainsi, alors c'est un cénacle, où l'illuminé coudoie le fou et l'espion ; ce sera encore la Société des Frères Internationaux qui s'attacha comme un parasite à l'Internationale et la discrédita ; (...) ou enfin un groupement de mécontents pour la plupart déclassés et petits bourgeois qui se livrent à des spéculations sur le socialisme comme sur une quelconque des phrases de la mode politique. » (Essai sur la conception matérialiste de l'histoire)
[3] Ce phénomène est évidemment renforcé par le poids du conseillisme qui constitue, comme le CCI l'a mis en évidence, un des prix que paie et paiera le mouvement ouvrier renaissant à l'emprise du stalinisme durant toute la période de contre-révolution.
[4] C'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'à ce congrès les amis de Bakounine avaient appuyé la décision de renforcer très sensiblement les pouvoirs du Conseil Général alors que, par la suite, ils vont exiger que celui-ci ne dépasse pas le rôle d'une « boîte aux lettres ».
[5] L'histoire du mouvement ouvrier est riche de ces longs combats menés par la Gauche. Parmi les plus importants on peut citer :
- Rosa Luxemburg contre le révisionnisme de Berstein à la fin du 19e siècle ;
- Lénine contre les mencheviks à partir de 1903 ;
- Rosa Luxemburg et Pannekoek contre Kautsky sur la question de la grève de masse (1908-1911) ;
- Rosa et Lénine pour la défense de l'internationalisme (congrès de Stuttgart en 1907, Bâle en 1912) ;
- Pannekoek, Gorter, Bordiga et l'ensemble des militants de la Gauche de l'Internationale Communiste (sans oublier Trotsky dans une certaine mesure) lors de la dégénérescence de celle-ci.
[6] A notre époque, le marais peut être représenté notamment par des variantes du courant conseilliste (comme celles qu'avait fait surgir la reprise historique de la fin des années 1960 et qui réapparaîtront probablement lors des futurs combats de la classe), par des vestiges du passé comme les De Leonistes présents dans l'aire anglo-saxonne, ou par des éléments en rupture avec les organisations gauchistes.
[7] Il n'existe pas de preuve établissant que Chénier fut un agent des services de sécurité de l'État. En revanche, sa rapide carrière, tout de suite après son exclusion du CCI, au sein de l'administration d'Etat et surtout au sein de l'appareil du Parti socialiste (qui à cette époque dirigeait le gouvernement) démontre qu'il devait déjà travailler pour cet appareil de la bourgeoisie lorsqu'il se présentait encore comme un « révolutionnaire ».
[8] Aux analyses et préoccupations du CCI concernant le parasitisme, il est souvent opposé que ce phénomène ne concerne que notre organisation, soit en tant que cible soit comme « pourvoyeur » de la mouvance parasitaire à travers ses scissions. C'est vrai que le CCI est aujourd'hui la principale cible du parasitisme ce qui s'explique assez bien dans la mesure où il constitue l'organisation la plus importante et étendue du milieu prolétarien. De ce fait, c'est elle qui suscite le plus de haine de la part des ennemis de ce milieu lesquels ne perdent pas une occasion de tenter de susciter à son égard l'hostilité des autres organisations prolétariennes. Une autre cause de ce « privilège » dont bénéficie le CCI de la part du parasitisme réside dans le fait que notre organisation est justement celle d'où est sorti le plus grand nombre de scissions ayant abouti à des groupes parasites. A ce phénomène on peut apporter plusieurs explications.
En premier lieu, parmi les organisations du milieu politique prolétarien qui se sont maintenues durant les trente années qui nous séparent de 1968, le CCI est la seule qui soit nouvelle alors que toutes les autres existaient déjà à cette date. Partant, il y avait au départ dans notre organisation un poids plus fort de l'esprit de cercle qui est le terreau pour les clans et le parasitisme. Par ailleurs il y avait eu dans les autres organisations, avant même la reprise historique de la classe, une « sélection naturelle » éliminant les éléments aventuriers et semi-aventuriers ainsi que les intellectuels à la recherche d'un public lesquels n'avaient pas eu la patience de mener un travail obscur dans de petites organisations à un moment où elles avaient un impact négligeable dans la classe du fait de la contre-révolution. Au moment de la reprise prolétarienne, les éléments de ce type avaient jugé qu'ils pourraient plus facilement « prendre des places » dans une organisation nouvelle, en voie de constitution, que dans une organisation ancienne où « les places étaient prises ».
En second lieu, il existe généralement une différence fondamentale entre les scissions (également nombreuses) ayant affecté le courant bordiguiste (qui était le plus développé internationalement jusqu'à la fin des années 1970) et les scissions ayant affecté le CCI. Dans les organisations bordiguistes, qui se réclament officiellement du monolithisme, les scissions sont essentiellement la conséquence de l'impossibilité de développer en leur sein des désaccords politiques ce qui signifie que celles-ci n'ont pas nécessairement une dynamique parasitaire. En revanche, les scissions qui sont intervenues dans le CCI n'étaient pas le résultat du monolithisme ou du sectarisme puisque notre organisation a toujours permis, et encouragé, les débats et les confrontations en son sein : les désertions collectives faisaient suite forcément à une impatience, à des frustrations individualistes, à une démarche clanique et portaient donc avec elles un esprit et une dynamique parasitaires.
Cela-dit, il importe de souligner que le CCI est loin d'être la seule cible du parasitisme. Par exemple, les dénigrements de Hilo Rojo, ainsi que ceux de Mouvement Communiste, concernent l'ensemble de la Gauche communiste. De même, la cible privilégiée de l'OCI est le courant bordiguiste. Enfin, même lorsque des groupes parasites concentrent leurs attaques contre le CCI en épargnant, et même en flattant, les autres groupes du milieu politique prolétarien (comme c'était le cas du CBG ou comme le fait systématiquement Échanges et Mouvement), c'est en général avec l'objectif d'accroître les divisions et la dispersion entre ces groupes, faiblesses que le CCI a toujours été le premier à combattre.
[9] Groupe animé par d'ex-membres du CCI ayant appartenu au GCI et d'anciens transfuges du gauchisme, et qu'il ne faut pas confondre avec le Mouvement Communiste des années 1970 qui avait été un des apôtres du modernisme.
[10] « Au départ, la décomposition idéologique affecte évidemment en premier lieu la classe capitaliste elle-même et, par contrecoup, les couches petites-bourgeoises qui n'ont aucun autonomie propre. On peut même dire que celles-ci s'identifient particulièrement bien avec cette décomposition dans la mesure où leur situation spécifique, l'absence de tout avenir, se calque sur la cause majeure de la décomposition idéologique : l'absence de toute perspective immédiate pour l'ensemble de la société. Seul le prolétariat porte en lui une perspective pour l'humanité et, en ce sens, c'est dans ses rangs qu'il existe les plus grandes capacités de résistance à cette décomposition. Cependant, lui-même n'est pas épargné, notamment du fait que la petite-bourgeoisie qu'il côtoie en est justement le principal véhicule. Les différents éléments qui constituent la force du prolétariat se heurtent directement aux diverses facettes de cette décomposition idéologique :
- l'action collective, la solidarité, trouvent en face d'elles l'atomisation, le "chacun pour soi", la "débrouille individuelle" ;
- le besoin d'organisation se confronte à la décomposition sociale, à la destruction des rapports qui fondent toute vie en société ;
- la confiance dans l'avenir et en ses propres forces est en permanence sapée par le désespoir général qui envahit la société, par le nihilisme, par le "no future" ;
- la conscience, la lucidité, la cohérence et l'unité de la pensée, le goût pour la théorie, doivent se frayer un chemin difficile au milieu de la fuite dans les chimères, la drogue, les sectes, le mysticisme, le rejet de la réflexion, la destruction de la pensée qui caractérise notre époque. »
(Revue Internationale n° 62, « La décomposition, phase ultime de la décadence du capitalisme », point 13)
On voit que la mesquinerie, la fausse solidarité des clans, la haine de l'organisation, la méfiance, la calomnie qui sont des attitudes et des comportements dans lesquels se complaît le parasitisme trouvent dans la décomposition sociale d'aujourd'hui un aliment de choix. Le proverbe dit que les plus belles fleurs poussent sur le fumier. La science nous enseigne que beaucoup d'organismes parasites s'en repaissent également. Et le parasitisme politique, dans son domaine, respecte les lois de la biologie, lui qui fait son miel de la putréfaction de la société.
Courants politiques:
Heritage de la Gauche Communiste:
Revue Internationale no95 - 4e trimestre 1998
- 3110 reads
Après l'Asie, la Russie et l'Amérique latine - le catastrophe économique atteint le coeur du capitalisme
- 3633 reads
Après l'Asie, la Russie et l'Amérique Latine
LA CATASTROPHE ECONOMIQUE
ATTEINT LE COEUR DU CAPITALISME
La crise financière qui s'était déclarée il y a un peu plus d'un an en Asie du sud-est est aujourd'hui en train de prendre sa véritable ampleur. Elle a connu un nouveau rebond au cours de l'été avec l'effondrement de l'économie russe et des convulsions sans précédent dans les « pays émergents » d'Amérique latine. Mais ce sont maintenant les principales métropoles du capitalisme, les pays les plus développés d'Europe et d'Amérique du nord qui se retrouvent en première ligne avec une chute continue de leurs indices boursiers et des prévisions de croissance sans cesse revues à la baisse. Nous sommes loin de l'euphorie qui animait les bourgeoisies il y a quelques mois encore, une euphorie qui se reflétait par une montée vertigineuse des Bourses occidentales tout au long de la première partie de 1998. Aujourd'hui, les mêmes « spécialistes » qui se félicitaient de la « bonne santé » des pays anglo-saxons et qui prévoyaient une reprise dans tous les pays d'Europe ne sont pas les derniers à parler de récession, voire de « dépression ». Et ils ont raison d'être pessimistes. Les nuages qui maintenant s'amoncèlent sur les économies les plus puissantes ne présagent pas une petite bourrasque. Ce qu'ils annoncent, c'est une véritable tempête manifestant l'impasse dans laquelle se trouve plongée l'économie capitaliste.
Théâtre d'un nouveau et brutal coup d'accélérateur, l'été 1998 aura été meurtrier pour la crédibilité du système capitaliste : approfondissement de la crise en Asie où la récession s'installe durablement et atteint maintenant de plein fouet les deux « grands » que sont le Japon et la Chine, menaces autour de la situation en Amérique latine, effondrement spectaculaire de l'économie russe et baisses frisant les records historiques sur les principales places boursières. En trois semaines, le rouble a perdu 70 % de sa valeur (depuis juin 1991, le PIB russe a chuté de 50 % si ce n'est de 80 %). Le 31 août, le fameux « lundi bleu », selon l'expression d'un journaliste qui n'ose l'appeler « noir », a vu Wall Street chuter de 6,4 % et le Nasdaq, l'indice des valeurs technologiques, de 8,5 %. Le lendemain, 1er septembre, les Bourses européennes étaient également touchées. Francfort débutait la matinée avec une perte de 2 % et Paris de 3,5 %. Dans la journée, Madrid perdait 4,23 %, Amsterdam 3,56 % et Zürich 2,15 %. Pour l'Asie, le 31 août, la Bourse de Hong kong chutait de plus de 7 %, quant à celle de Tokyo, elle dégringolait, atteignant son niveau le plus bas depuis 12 ans. Depuis, le mouvement de baisse des marchés boursiers n'a fait que se poursuivre au point que le lundi 21 septembre (et il est probable que la situation se sera encore aggravée lorsque sortira ce numéro de notre Revue internationale) la plupart des indices étaient revenus à leur niveau du début de 1998 : + 0,32 % à New York, + 5,09 % à Francfort mais solde négatif à Londres, Zürich, Amsterdam, Stockholm...
L'accumulation de tous ces événements ne doit rien au hasard. Elle n'est pas non plus, comme on a voulu nous le faire croire, la manifestation d'une « crise de confiance passagère » envers les pays dits « émergents » ou une « correction mécanique salutaire d'un marché surévalué », il s'agit bel et bien d'un nouvel épisode de la descente aux enfers du capitalisme comme un tout, une descente aux enfers dont l'effondrement de l'économie russe nous offre une sorte de caricature.
La crise en Russie
Pendant des mois, la bourgeoisie mondiale et ses « experts », qui avaient connu de sérieuses frayeurs avec la crise financière des pays d'Asie du sud-est il y a un an, s'étaient consolés en constatant qu'elle n'avait pas entraîné dans sa foulée les autres pays « émergents ». Les médias en avaient alors rajouté sur le caractère « spécifique » des difficultés qui assaillaient la Thaïlande, la Corée, l'Indonésie, etc. Et puis la sonnette d'alarme s'est faite entendre à nouveau avec le véritable chaos qui s'est emparé de l'économie russe au début de l'été ([1] [3452]). Après s'être fait tirer l'oreille, la « communauté internationale », qui avait été déjà fortement mise à contribution avec l'Asie du Sud-Est, a fini par lâcher une aide de 22,6 milliards de dollars sur 18 mois, assortie, comme à l'accoutumée, de conditions draconiennes : réduction drastique des dépenses de l'Etat, augmentation des impôts (plus particulièrement ceux qui pèsent sur les salariés, histoire de compenser l'impuissance avérée de l'Etat russe à recouvrer ceux dus par les entreprises), hausses des prix, augmentation des cotisations de retraites. Tout cela alors que les conditions d'existence des prolétaires russes étaient déjà misérables et que la plupart des employés d'Etat et une bonne partie de ceux des entreprises privées n'avaient pas touché leurs salaires depuis plusieurs mois. Une misère qui se traduit de façon dramatique : depuis juin 1991, il est reconnu que l'espérance de vie masculine a été ramenée de 69 à 58 ans ; le taux de natalité de 14,7 °/°° à 9,5 °/°°.
Un mois plus tard, le constat était là : les fonds débloqués l'avaient été en pure perte. Après une semaine noire qui a vu la Bourse de Moscou chuter vertigineusement et mis des centaines de banques au bord de la faillite, Eltsine et son gouvernement ont été contraints, le 17 août, de lâcher sur ce qui restait le dernier rempart de leur crédibilité : le rouble et sa parité par rapport au dollar. Sur la première tranche de 4,8 milliards de dollars versée en juillet au titre de l'aide du FMI, 3,8 avaient été engloutis, en vain, dans la défense du rouble. Quant au milliard restant, il n'avait nullement servi à la mise en oeuvre des mesures d'assainissement des finances de l'Etat et encore moins à payer les arriérés de salaire des ouvriers, pour la bonne raison qu'il avait déjà fondu, lui aussi, dans le seul service de la dette (qui dévore plus de 35 % des revenus du pays), autrement dit dans le simple paiement des intérêts tombés à échéance dans la même période. Sans parler des fonds détournés qui vont directement dans la poche de telle ou telle faction d'une bourgeoisie gangstérisée. L'échec de cette politique signifie pour la Russie, qu'en plus des faillites de banques en chaîne (près de 1500 banques sont concernées), de la plongée dans la récession et de l'explosion de sa dette externe libellée en dollars, c'est le retour de l'inflation galopante qui l'attend. D'ores et déjà, on estime qu'elle pourrait atteindre 200 à 300 % dès cette année. Et ce n'est pas fini.
Ce marasme a immédiatement provoqué la débandade au sommet de l'Etat russe, provoquant une crise politique qui, à la fin septembre, n'est pas encore résolue. Cette déconfiture de la sphère dirigeante russe, qui la fait ressembler de plus en plus à celle d'une vulgaire république bananière, n'a pas manqué d'alarmer les bourgeoisies occidentales. Mais la bourgeoisie peut bien se préoccuper du sort d'Eltsine et consorts, c'est d'abord la population russe et la classe ouvrière qui payent et vont payer au prix fort les conséquences de cette situation. Ainsi, la chute du rouble a déjà renchéri de plus de 50 % les prix des denrées alimentaires importées qui représentent plus de la moitié de celles consommées en Russie. La production est d'à peine 40 % de ce qu'elle était avant la chute du mur de Berlin...
Aujourd'hui, la réalité vérifie pleinement ce que nous disions il y neuf ans dans les « Thèses sur la crise économique et politique en URSS et dans les pays de l'Est », rédigées en septembre 1989 : « Face à la faillite totale de l'économie de ces pays, la seule issue permettant à celle-ci non pas d'accéder à une réelle compétitivité, mais de garder au moins la tête hors de l'eau, consiste en l'introduction de mécanismes permettant une véritable responsabilisation de ses dirigeants. Ces mécanismes supposent une "libéralisation" de l'économie, la création d'un marché intérieur qui en soit un, une plus grande "autonomie" des entreprises et le développement d'un fort secteur "privé" (...) Cependant, bien qu'un tel programme devienne de plus en plus indispensable, sa mise en application comporte des obstacles pratiquement insurmontables. » (Revue Internationale n° 60)
Quelques mois après, nous ajoutions : « (...) certains secteurs de la bourgeoisie répondent qu'il faudrait un nouveau "Plan Marshall" qui permettrait de reconstituer le potentiel économique de ces pays (...) aujourd'hui, une injection massive de capitaux vers les pays de l'Est visant à développer leur potentiel économique, et particulièrement industriel, ne peut être à l'ordre du jour. Même en supposant qu'on remette sur pieds un tel potentiel productif, les marchandises produites ne feraient qu'encombrer encore plus un marché mondial déjà sursaturé. Il en est des pays qui aujourd'hui sortent du stalinisme comme des pays sous-développés : toute la politique de crédits massifs injectés dans ces derniers au cours des années 70 et 80 n'a pu aboutir qu'à la situation catastrophique que l'on connaît bien (une dette de 1 400 milliards de dollars et des économies encore plus ravagées qu'auparavant). Les pays de l'Est (dont l'économie s'apparente d'ailleurs à celle des pays sous-développés par bien des côtés) ne peuvent connaître de sort différent. (...) La seule chose à laquelle on puisse s'attendre, c'est l'envoi de crédits ou d'aides d'urgence permettant à ces pays de s'éviter une banqueroute financière ouverte et des famines qui ne feraient qu'aggraver les convulsions qui les secouent. » (« Après l'effondrement du bloc de l'Est, déstabilisation et chaos », Revue Internationale n° 61)
Deux ans après, nous écrivions : « C'est également pour relâcher un peu l'étranglement financier de l'ex-URSS que le G7 a accordé un délai d'un an pour le remboursement des intérêts de la dette soviétique, laquelle se monte aujourd'hui à 80 milliards de dollars. Mais ce ne sera qu'un emplâtre sur une jambe de bois tant les crédits alloués semblent disparaître dans un puits sans fond. Il y a deux ans avaient été colportées toutes sortes d'illusions sur le "marché nouveau" ouvert par l'effondrement des régimes staliniens. Aujourd'hui, alors même que la crise économique mondiale se traduit, entre autres, par une crise aiguë des liquidités, les banques sont de plus en plus réticentes à placer leurs capitaux dans cette partie du monde. » (Revue Internationale n° 68)
Ainsi, la réalité des faits est venue confirmer, contre toutes les illusions intéressées de la bourgeoisie et de ses thuriféraires, ce que la théorie marxiste permettait aux révolutionnaires de prévoir. Aujourd'hui, c'est une désagrégation totale, développant une misère effroyable, qui se développe aux portes même de ce qui apparaît encore comme la « forteresse Europe ».
La tentative des médias de faire passer le message que, tombé l'actuel vent de panique boursière, les conséquences pour l'économie réelle au niveau international seraient minimes, n'a pas eu beaucoup de succès. Et c'est normal car la volonté des capitalistes de se rassurer eux-mêmes et surtout de cacher à la classe ouvrière la gravité de la crise mondiale se heurte à la dure réalité des faits. D'abord, ce sont tous les créanciers de la Russie qui sont à nouveau sévèrement mis à mal. Près de 75 milliards de dollars ont été prêtés à ce pays par des banques occidentales, les bons du Trésor qu'elles détiennent ont déjà perdu 80 % de leur valeur et la Russie a interrompu tout remboursement pour ceux libellés en dollars. En outre, la bourgeoisie occidentale redoute qu'à leur tour les autres pays d'Europe de l'Est ne connaissent le même cauchemar. Il y a de quoi : la Pologne, la Hongrie et la République tchèque représentent ensemble 18 fois plus d'investissements occidentaux que la Russie. Or, dès la fin août, les premiers craquements se sont fait entendre dans les Bourses de Varsovie (‑9,5 %) et de Budapest (‑5,5 %) attestant que les capitaux commençaient à déserter ces nouvelles places financières. De plus, et de façon encore plus pressante, la Russie entraîne dans son effondrement les pays de la CEI dont les économies sont très liées à la sienne. Ainsi, même si la Russie n'est finalement qu'un « petit débiteur » du monde au regard d'autres régions, sa situation géopolitique, le fait qu'elle constitue, en pleine Europe, un champ miné d'armes nucléaires et la menace de plongée dans le chaos provoquée par la crise économique et politique, tout cela donne une gravité particulière à la situation dans ce pays.
Par ailleurs, le fait que la dette de la Russie soit relativement limitée à côté des crédits accordés en Asie ou dans d'autres régions du monde est une bien piètre consolation. En réalité, ce constat doit au contraire attirer l'attention sur d'autres menaces qui se précisent, comme celle de voir s'étendre la crise financière à l'Amérique Latine qui a constitué, ces dernières années, la principale destination des investissements directs étrangers dans les pays « en développement » (45 % du total en 1997, contre 20 % en 1980 et 38 % en 1990). Les risques de dévaluation au Venezuela, la violente baisse des prix des matières premières depuis la crise asiatique qui touche les pays sud-américains avec encore plus d'ampleur qu'en Russie, une dette extérieure phénoménale, un endettement public astronomique (le déficit public du Brésil, le 7e PIB mondial, est bien supérieur à celui de la Russie) font de l'Amérique latine une bombe à retardement qui menace d'ajouter ses effets destructeurs à ceux des marasmes asiatique et russe. Une bombe à retardement qui se trouve aux portes de la première puissance économique mondiale, les Etats-Unis.
Cependant, la menace principale ne provient pas de ces pays sous-développés ou faiblement développés. Elle se trouve dans un pays hyperdéveloppé, deuxième puissance économique de la planète, le Japon.
La crise au Japon
Avant même la cataclysme de l'économie russe qui est venu doucher l'optimisme de la bourgeoisie dans tous les pays, en juin 1998, un séisme qui avait Tokyo comme épicentre avait lancé ses menaces de déstabilisation du système économique mondial. Depuis 1992, malgré sept plans de « relance » qui ont injecté l'équivalent de 2 % à 3 % de PNB par an et une dévaluation du yen de moitié sur trois ans qui aurait dû soutenir la compétitivité des produits japonais sur le marché mondial, l'économie nippone continue de s'enfoncer dans le marasme. De peur d'être confronté aux conséquences économiques et sociales dans un contexte déjà très fragile, l'Etat japonais n'en finissait pas de reporter les mesures d' « assainissement » de son secteur bancaire. Le montant des créances non recouvrables représente une somme équivalant à 15 % du PIB... De quoi plonger l'économie japonaise, et internationale par contre-coup, dans une récession d'une ampleur sans précédent depuis la grande crise de 1929. Face à cet enlisement croissant du Japon dans la récession et aux atermoiements du pouvoir à prendre les mesures qui s'imposaient, le yen a fait l'objet d'une importante spéculation menaçant toutes les monnaies d'Extrême-Orient d'une dévaluation en chaîne qui aurait donné le signal au pire scénario déflationniste. Le 17 juin 1998 ce fut le branle bas de combat sur les marchés financiers : la Réserve fédérale américaine finit par se porter massivement au secours d'un yen qui commençait à dégringoler. Cependant, la partie n'était que remise ; aidé par la communauté internationale, le Japon a pu reporter l'échéance... mais au prix d'un endettement qui augmente à une allure vertigineuse. La seule dette publique s'élève déjà à l'équivalent d'une année de production (100 % du PNB).
Il est intéressant de noter, à ce propos, que ce sont les mêmes économistes « libéraux », ceux qui vouent aux gémonies l'intervention de l'Etat dans l'économie et qui aujourd'hui tiennent le haut du pavé dans les grandes institutions financières internationales comme auprès des gouvernements occidentaux, qui réclamaient à cors et à cris une nouvelle injection massive des fonds publics dans le secteur bancaire afin de le sauver de la faillite. C'est bien la preuve qu'au delà de tous les bavardages idéologiques sur le « moins d'Etat », les « experts » bourgeois savent pertinemment que l'Etat constitue le dernier rempart face à la débandade économique. Lorsqu'ils parlent de « moins d'Etat », c'est fondamentalement « l'Etat providence », c'est-à-dire les dispositifs de protection sociale des travailleurs (allocations chômage et maladie, minimums sociaux) qu'ils visent et leurs discours signifient qu'il faut attaquer les conditions de vie de la classe ouvrière encore et toujours plus.
Finalement, le 18 septembre, gouvernement et opposition signaient un compromis pour sauver le système financier nippon mais, au lieu de relancer les marchés boursiers, ces mesures étaient accueillies par une nouvelle chute de ces derniers, preuve de la défiance profonde que les financiers ont désormais pour l'économie de la deuxième puissance économique de la planète qui nous avait été présentée pendant des décennies comme un « modèle ». L'économiste en chef de la Deutsche Bank à Tokyo, Kenneth Courtis, personnage sérieux s'il en est, n'y va pas par quatre chemins :
« Il faut renverser la dynamique à la baisse, plus grave qu'après les crises pétrolières du début des années 70 (consommation et investissements en chute libre), car on est désormais entré dans une phase où l'on est en train de créer de nouvelles créances douteuses. On parle de celles des banques, mais guère de celles des ménages. Avec la perte de valeur des logements et le chômage qui s'accroît, on risque de voir des défaillances dans les remboursements des prêts garantis sur des bien immobiliers hypothéqués par des particuliers. Ces hypothèques se chiffrent au montant faramineux de 7 500 milliards de dollars, dont la valeur est tombée de 60 %. Le problème politique et social est latent. (...) On ne doit pas s'y tromper : une purge de grande ampleur de l'économie est en cours... et les entreprises qui y survivront seront d'une force incroyable. C'est au Japon que peut se concrétiser le plus grand risque pour l'économie mondiale depuis les années 30... » (Le Monde, 23 septembre)
Les choses sont claires, pour l'économie du Japon, et pour la classe ouvrière de ce pays, le plus dur est à venir, les travailleurs japonais déjà durement touchés par ces dix dernières années de stagnation, et maintenant de récession, vont encore devoir subir de multiples plans d'austérité, des licenciements massifs et une forte aggravation de leur exploitation dans un contexte où la crise financière s'accompagne dès à présent de la fermeture d'usines parmi les plus importantes. Mais, ce n'est pas cela qui, dans l'immédiat, alors que la classe ouvrière mondiale n'a pas encore fini de digérer la défaite idéologique qu'elle a subi lors de l'effondrement du bloc de l'Est, préoccupe le plus les capitalistes. Ce qui commence de plus en plus à les tarauder, c'est la destruction de leurs illusions et la découverte croissante des perspectives catastrophiques de leur économie.
Vers une nouvelle récession mondiale
Si à chaque alerte passée les « spécialistes » nous avaient habitués à des déclarations consolatrices : « les échanges commerciaux avec l'Asie du Sud-Est sont peu importants », « la Russie ne pèse pas lourd dans l'économie mondiale », « l'économie européenne est dopée par la perspective de l'Euro », « les fondamentaux US sont bons », etc., aujourd'hui le ton change ! Le mini krach de la fin août dans toutes les grandes places financières du globe est venu rappeler que si ce sont les branches les plus fragiles de l'arbre qui se brisent dans la tempête c'est d'abord et avant tout parce que le tronc ne trouve plus suffisamment d'énergie dans les racines pour alimenter ses parties les plus éloignées.
Le coeur du problème est bien dans les pays centraux, les professionnels de la Bourse ne s'y sont pas trompés. A l'allure où les propos rassurants sont à chaque fois infirmés par les faits, il n'est plus possible de cacher la réalité. Plus fondamentalement, il s'agit maintenant pour la bourgeoisie de préparer peu à peu les esprits aux conséquences sociales et économiques douloureuses d'une récession internationale de plus en plus certaine : « une récession à l'échelle mondiale n'est pas conjurée. Les autorités américaines ont jugé bon de faire savoir qu'elles suivaient les événements de près (...) la probabilité d'un ralentissement économique à l'échelle mondiale n'est pas négligeable. Une grande partie de l'Asie est en récession. Aux Etats-Unis, la baisse des cours pourrait inciter les ménages à augmenter l'épargne au détriment des dépenses de consommation, provoquant un ralentissement économique. » (Le Soir, 2 septembre)
La crise en Asie orientale a déjà engendré une dévalorisation massive de capital par la fermeture de centaines de sites de production, par la dévaluation des avoirs, les faillites de milliers d'entreprises et la plongée dans une profonde misère de dizaines de millions de personnes : « l'effondrement le plus dramatique d'un pays depuis les cinquante dernières années », c'est ainsi que la Banque mondiale qualifie la situation en Indonésie. D'ailleurs, le déclencheur du recul des Bourses asiatiques était l'annonce officielle de l'entrée en récession au second trimestre 1998 de la Corée du sud et de la Malaisie. Après le Japon, Hongkong, l'Indonésie et la Thaïlande, c'est quasi tout le sud-est asiatique tant vanté qui plonge car il est prévu que même Singapour rentrera en récession à la fin de l'année. Il ne reste plus que la Chine continentale et Taïwan qui font exception, mais pour combien de temps ? Ce n'est d'ailleurs plus de récession dont on parle à propos de l'Asie mais de dépression : « Il y a dépression lorsque la chute de la production et celle des échanges se cumulent à un point tel que les fondements sociaux de l'activité économique sont entamés. A ce stade, il devient impossible de prévoir un renversement de tendance et difficile, sinon inutile, d'engager des actions classiques de relance. Telle est la situation que connaissent actuellement beaucoup de pays d'Asie, de sorte que la région toute entière est menacée » (Le Monde Diplomatique, septembre 1998).
Si l'on conjugue les difficultés économiques dans les pays centraux avec la récession de la seconde économie du monde – le Japon – et celle de toute la région du Sud-est asiatique, que l'on additionne les effets récessifs induits par le krach de la Russie sur les autres pays de l'Est et l'Amérique latine (notamment avec la diminution du prix des matières premières, dont le pétrole), nous aboutissons à une contraction inévitable du marché mondial qui sera à la base de la nouvelle récession internationale. Le FMI ne s'y trompe d'ailleurs pas, il a déjà intégré l'effet récessif dans ses prévisions et la diminution s'avère de taille : la crise financière coûtera 2 % de croissance mondiale en moins en 1998 par rapport à 1997 (4,3 %), alors que 1999 devrait porter l'essentiel du choc, une paille pour ce qui ne devait qu'être un épiphénomène sans importance !
Le deuxième millénaire, censé être le témoin de la victoire définitive du capitalisme et du nouvel ordre mondial commencera vraisemblablement par une croissance zéro !
Continuité et limites des palliatifs
Depuis plus d'une trentaine d'année, la fuite en avant dans un endettement de plus en plus grand ainsi qu'un report des effets les plus dévastateurs de la crise sur la périphérie ont permis à la bourgeoisie internationale de reporter les échéances. Cette politique qui est encore largement de mise à l'heure actuelle marque des signes de plus en plus évidents d'essoufflement. Le nouvel ordre financier qui a progressivement remplacé les accords de Bretton Woods d'après-guerre « se révèle aujourd'hui fort coûteux. Les pays riches (Etats-Unis, Union européenne, Japon) en ont bénéficié, alors que les petits sont facilement submergés par une arrivée même modeste de capitaux » (John Llewellyn, Global chief economist chez Lehman Brothers London). Tel un retour de manivelle, les effets les plus dévastateurs de la crise ont de plus en plus de mal à être contenus à la marge du système économique international. La dégradation et les secousses économiques y sont d'une telle ampleur que les répercussions se font inévitablement et directement sentir au cœur même des plus puissantes métropoles.
Après la faillite du tiers-monde, du bloc de l'Est et de l'Asie du Sud-est, c'est maintenant la seconde puissance économique mondiale – le Japon – qui est en train de vaciller. Il n'est plus ici question de parler de périphérie du système, c'est l'un des trois pôles qui constituent le cœur même du système qui est atteint. Autre signe inéquivoque de cet épuisement des palliatifs, c'est l'incapacité de plus en plus grande des institutions internationales, tels le FMI ou la Banque mondiale – qui ont été mises en place pour éviter que ne se reproduisent des scénarios comme en 1929 – à éteindre les incendies qui se multiplient à intervalle de plus en plus rapprochés aux quatre coins du monde. Ceci se traduit concrètement dans les milieux financiers par « l'incertitude du FMI prêteur en dernier ressort ».
Les marchés murmurent que le FMI n'a plus de ressources suffisantes pour jouer au pompier : « En outre, les derniers rebondissements de la crise russe ont montré que le Fond Monétaire International (FMI) n'était plus disposé – capable disent certains – à jouer systématiquement le pompier. La décision du FMI et du groupe des sept pays les plus industrialisés de ne pas apporter à la Russie de soutien financier supplémentaire la semaine dernière peut-être considérée comme fondamentale pour l'avenir de la politique d'investissement dans les pays émergents (...) Traduction : rien ne dit que le FMI interviendrait financièrement pour éteindre une crise possible en Amérique latine ou ailleurs. Voilà qui n'est pas pour rassurer des investisseurs » (d'après AFP, Le Soir, 25 août). De plus en plus, à l'image du continent africain à la dérive, la bourgeoisie n'aura pas d'autre choix que d'abandonner des pans entiers de son économie mondiale pour s'isoler des foyers les plus gangrenés et préserver un minimum de stabilité sur une base plus restreinte.
Telle est l'une des raisons majeures de l'accélération dans la mise en place d'ensembles économiques régionaux (Union européenne, ALENA, etc.). Ainsi, de même que depuis 1995 la bourgeoisie des pays développés travaille à recrédibiliser ses syndicats dans le but de tenter d'encadrer les luttes ouvrières à venir, de même, avec l'Euro, elle se préparait et elle se prépare encore à tenter de résister aux ébranlements financiers et monétaires en travaillant à stabiliser ce qui, dans l'économie mondiale, fonctionne encore. C'est dans ce sens que la bourgeoisie européenne parle de l'Euro comme bouclier. Un calcul cynique commence à être élaboré : le bilan pour le capitalisme international est estimé entre le coût des moyens qui devraient être mis en oeuvre pour sauver un pays ou une région et les conséquences de sa banqueroute elle-même si rien n'était tenté. C'est dire que dans l'avenir, la certitude que le FMI sera toujours là comme « prêteur en dernier ressort » n'est plus de mise. Cette incertitude assèche les dits pays « émergents » des capitaux sur lesquels ils avaient bâti leur « prospérité », hypothéquant par-là une possible reprise économique.
La faillite du capitalisme
Il n'y a encore pas si longtemps, le terme de « pays émergents » faisait frémir d'excitation les capitalistes du monde entier qui, dans un marché mondial saturé, recherchaient désespérément de nouveaux terrains d'accumulation pour leurs capitaux. Il était la tarte à la crème de tous les idéologues aux ordres qui nous les présentaient comme la preuve même de l'éternelle jeunesse du capitalisme qui était en train de trouver dans ces territoires son « second souffle ». Aujourd'hui le terme évoque immédiatement la panique boursière, et la crainte qu'une nouvelle « crise » ne vienne s'abattre dans les pays centraux en provenance de quelque région « lointaine ».
Mais la crise ne provient pas de cette partie du monde en particulier. Elle n'est pas une crise des « pays jeunes », mais une crise de sénilité, celle d'un système entré en décadence il y a plus de 80 ans et qui se heurte depuis lors sans cesse aux mêmes insolubles contradictions : l'impossibilité de trouver toujours plus de débouchés solvables pour les marchandises produites, afin d'assurer la poursuite de l'accumulation du capital. Deux guerres mondiales, des phases de crise ouvertes destructrices, dont celle que nous vivons depuis trente ans, en ont été le prix. Pour « tenir », le système n'a cessé de tricher avec ses propres lois. Et la principale de ces tricheries, c'est la fuite en avant dans un endettement de plus en plus faramineux.
L'absurdité de la situation en Russie où les banques et l'Etat ne « tenaient bon » qu'au prix de plus en plus insupportable d'une dette exponentielle qui les contraignait à s'endetter toujours plus, rien que pour payer les intérêts de ces dettes accumulées, cette folie là n'est nullement « russe ». C'est l'ensemble de l'économie mondiale qui se maintient en vie depuis des décennies au prix de la même fuite en avant délirante, parce que c'est la seule réponse qu'elle ait à ses contradictions, parce que c'est le seul moyen de créer artificiellement de nouveaux marchés pour les capitaux et les marchandises. C'est le système tout entier qui est mondialement bâti sur un énorme château de cartes de plus en plus fragilisé. Les prêts et investissements massifs vers les pays « émergents », eux-mêmes financés par d'autres prêts, n'ont été qu'un moyen de reporter la crise du système et ses contradictions explosives du centre vers la périphérie. Les krachs boursiers successifs – 1987, 1989, 1997, 1998 – qui en sont un produit, expriment l'ampleur toujours plus grande de l'effondrement du capitalisme.
Face à cet enfoncement brutal que nous avons sous les yeux, la question n'est pas de savoir pourquoi il y a une telle récession maintenant, mais plutôt pourquoi elle n'est pas arrivée beaucoup plus tôt. La seule réponse est : parce que la bourgeoisie, au niveau mondial, a tout fait pour repousser de telles échéances dans le temps en utilisant des tricheries avec les lois de son système. La crise de surproduction, inscrite dans les prévisions du marxisme dès le siècle dernier, ne peut trouver de solution réelle dans les tricheries. Et aujourd'hui, c'est encore le marxisme qui renvoie dos à dos ces messieurs les experts tenants du « libéralisme » comme ceux partisans d'un « contrôle plus strict » des aspects financiers. Ni les uns ni les autres ne peuvent sauver un système économique dont les contradictions explosent malgré les tricheries. Cette faillite du capitalisme, seul le marxisme l'a vraiment analysée comme inévitable, faisant de cette compréhension une arme pour la lutte des exploités.
Et lorsqu'il faut payer la note, lorsque le fragile système financier craque, les contradictions de fond reprennent leurs droits : c'est la plongée dans la récession, l'explosion du chômage, les faillites en série d'entreprises et de secteurs industriels. En quelques mois, en Indonésie et en Thaïlande par exemple, la crise a plongé des dizaines de millions de personnes dans une profonde misère. La bourgeoisie elle-même le reconnaît et, lorsqu'elle est obligée de reconnaître de tels faits, c'est que la situation est vraiment grave. Et cela n'est nullement l'apanage des pays « émergents ».
L'heure de la récession a sonné dans les pays centraux du capitalisme. Les pays les plus endettés du monde ne sont d'ailleurs ni la Russie, ni le Brésil, mais appartiennent au cœur le plus développé du capitalisme, à commencer par le premier d'entre eux, les Etats-Unis. Le Japon est maintenant entré officiellement en récession après deux trimestres de croissance négative et il prévu que son PIB baisse de plus de 1,5 % pour 1998. La Grande-Bretagne, qui était présentée comme un modèle il n'y a pas si longtemps, aux côtés des Etats-Unis, de « dynamisme » économique, est contrainte devant la poussée des menaces inflationnistes, de prévoir un « refroidissement de l'économie » et une « hausse rapide du chômage » (Libération, 13 août). Les annonces de licenciements se multiplient déjà dans l'industrie (100 000 suppressions d'emplois sur 1,8 millions sont prévues dans les industries mécaniques dans les 18 prochains mois).
La perspective de l'économie capitaliste mondiale, c'est l'Asie qui nous la présente. Alors que les plans de sauvetage et d'assainissement étaient censés donner une nouvelle vigueur à ces pays, on voit au contraire s'y installer la récession, et s'y former d'énormes poches de misère et de famine.
Le capitalisme n'a pas de solution à sa crise et celle-ci n'a pas de limite au sein du système. C'est pourquoi la seule solution à la barbarie et à la misère qu'il impose à l'humanité, c'est son renversement par la classe ouvrière. Pour cette perspective, le prolétariat du cœur même du capitalisme, celui d'Europe notamment, à cause de sa concentration et de son expérience historique, porte une responsabilité décisive vis-à-vis de ses frères de classe du reste du monde.
MFP, 20 septembre 1998
[1] [3453] Il faut signaler que lors de son assemblée générale annuelle d'octobre 1997, le FMI avait considéré que le prochain « pays à risque » important pourrait bien être la Turquie. Et vive la lucidité des instances les plus "qualifiées" de la bourgeoisie !
Questions théoriques:
- L'économie [86]
Heritage de la Gauche Communiste:
Conflits impérialistes : un nouveau pas dans le chaos
- 2816 reads
CONFLITS IMPÉRIALISTES
UN NOUVEAU PAS DANS LE CHAOS
Durant le dernier été, il n'y a pas eu de pause dans les convulsions du monde capitaliste. Bien au contraire, comme cela est arrivé fréquemment au cours des dernières années, la période estivale a été marquée par une aggravation brutale des conflits impérialistes et de la barbarie guerrière. Attentats contre deux ambassades des États-Unis en Afrique, bombardements américains en Afghanistan et au Soudan faisant suite à ces attentats, rébellion au Congo, avec une forte participation des pays du voisinage, contre le tout nouveau régime de Kabila, etc. Tous ces nouveaux événements sont venus se surajouter à la multitude de conflits armés qui dévastent le monde mettant en relief une nouvelle fois le chaos sanglant dans lequel s'enfonce toujours plus la société humaine sous la domination du capitalisme.
A plusieurs reprises, nous avons mis en évidence dans notre presse le fait que l'effondrement du bloc de l'Est à la fin des années 1980 n'avait pas débouché sur un « nouvel ordre mondial », comme l'avait annoncé le président américain Bush à l'époque, mais bien sur le plus grand chaos de l'histoire humaine. Depuis la fin de la seconde boucherie impérialiste, le monde avait vécu sous la férule de deux blocs militaires qui n'avaient cessé de s'affronter dans des guerres provoquant en quatre décennies autant de morts que la guerre mondiale elle-même. Cependant, le partage du monde entre deux blocs impérialistes ennemis, s'il constituait un aliment de nombreux conflits locaux, contraignait les deux super-puissances à exercer une certaine « police » pour maintenir ces conflits dans un cadre « acceptable » et éviter qu'ils ne dégénèrent dans un chaos général.
L'effondrement du bloc de l'Est, et la disparition du bloc qui lui faisait face, n'ont pas fait disparaître les antagonismes impérialistes entre États capitalistes, bien au contraire. La menace d'une nouvelle guerre mondiale s'est momentanément éloignée puisque les blocs qui auraient pu s'y affronter n'existent plus mais, attisées par l'enfoncement de l'économie capitaliste dans une crise insurmontable, les rivalités entre États n'ont fait que s'aiguiser et se développer d'une façon de plus en plus incontrôlable. A partir de 1990, en provoquant délibérément la crise et la guerre du Golfe où ils ont fait l'étalage de leur énorme supériorité militaire, les États-Unis ont tenté d'affirmer leur autorité sur l'ensemble de la planète, et particulièrement sur leurs anciens alliés de la guerre froide. Cependant, le conflit dans l'ex-Yougoslavie a vu ces alliés s'affronter et remettre en cause la tutelle américaine, certains soutenant la Croatie (Allemagne), d'autres la Serbie (France et Grande-Bretagne, notamment) alors que les États-Unis, après un soutien à la Serbie, avaient fini par soutenir la Bosnie. C'était le début d'un « chacun pour soi » dans lequel les alliances perdaient de plus en plus de leur pérennité et où, notamment, la puissance américaine éprouvait des difficultés croissantes à exercer son leadership.
L'illustration la plus frappante de cette situation, nous l'avions eue au cours de l'hiver dernier, lorsque les États-Unis avaient dû renoncer à leurs menaces guerrières contre l'Irak en acceptant une solution négociée par le secrétaire général de l'ONU avec le plein soutien de pays comme la France qui n'ont pas cessé, depuis le début des années 1990 de contester ouvertement l'hégémonie américaine (voir Revue internationale n° 93, « Un revers des États-Unis qui relance les tensions guerrières »). Ce qui s'est passé au cours de l'été a constitué une nouvelle illustration de cette tendance au chacun pour soi et même une accentuation spectaculaire de cette tendance.
La guerre au Congo
Le chaos dans lequel s'enfoncent aujourd'hui les relations entre États saute aux yeux lorsqu'on essaie de démêler les tenants et les aboutissants des divers conflits qui ont secoué la planète récemment.
Par exemple, dans la guerre qui se développe aujourd'hui au Congo, nous voyons des pays qui avaient soutenu il y a moins de deux ans l'offensive de Laurent-Désiré Kabila contre le régime de Mobutu, le Rwanda et l'Ouganda, apporter leur plein appui à la rébellion contre ce même Kabila. Plus étrangement, ces pays qui, sur place, avaient trouvé dans les États-Unis un allié de premier ordre contre les intérêts de la bourgeoisie française, se retrouvent aujourd'hui du même côté que cette dernière, laquelle apporte un soutien discret à la rébellion contre celui qu'elle considère comme un ennemi depuis qu'il a renversé le régime « ami » de Mobutu. Plus surprenant encore est le soutien, et qui s'est révélé décisif, apporté par l'Angola au régime de Kabila alors que celui-ci était sur le point de succomber. Jusqu'à présent, Kabila, qui pourtant au début avait bénéficié du soutien angolais (notamment sous la forme de l'entraînement et de l'équipement des « ex-gendarmes katangais »), permettait aux troupes de l'UNITA en guerre contre le régime actuel de Luanda, de se replier et s'entraîner sur le territoire du Congo. Apparemment, l'Angola ne lui a pas tenu rigueur de cette infidélité. De plus, pour compliquer encore les choses, l'Angola qui avait permis, il y a juste un an, la victoire de la clique de Denis Sassou Ngesso, appuyée par la France contre celle de Pascal Lissouba pour le contrôle du Congo Brazzaville, se retrouve aujourd'hui dans le camp ennemi de la France. Enfin, concernant la tentative des États-Unis de déployer leur emprise en Afrique, notamment contre les intérêts français, on peut constater qu'après les succès représentés par l'installation au Rwanda d'un régime « ami » et surtout l'élimination de Mobutu soutenu jusqu'à la fin par la bourgeoisie française, elle marque le pas. Le régime que la première puissance mondiale avait installé à Kinshasa en mai 1997 a réussi à dresser contre lui, non seulement une proportion considérable de la population qui l'avait pourtant accueilli avec des fleurs après trente ans de « mobutisme », mais aussi un bon nombre de pays voisins, et particulièrement ses « parrains » ougandais et rwandais.
Dans la crise actuelle, la diplomatie américaine est particulièrement silencieuse (elle s'est contentée de « demander instamment » au Rwanda de ne pas s'en mêler et de suspendre l'aide militaire qu'elle apporte à ce pays) alors que son adversaire français, avec la discrétion qui s'impose, apporte un soutien clair à la rébellion.
En réalité, ce qui saute aux yeux, au milieu du chaos dans lequel s'enfonce l'Afrique centrale, c'est le fait que les divers États africains échappent de plus en plus au contrôle des grandes puissances. Durant la guerre froide, l'Afrique était un des enjeux de la rivalité des deux blocs impérialistes qui se partageaient la planète. Les anciennes puissances coloniales, et tout particulièrement la France, avaient reçu mandat du bloc occidental pour y faire la police pour le compte de ce dernier. Progressivement, les différents États qui, au lendemain de l'indépendance, avaient tenté de s'appuyer sur le bloc russe (par exemple, l'Egypte, l'Algérie, l'Angola, le Mozambique) avaient changé de camp et étaient devenus de fidèles alliés du bloc américain avant même l'effondrement de son rival soviétique. Cependant, tant que ce dernier, même affaibli, se maintenait, il existait une solidarité fondamentale entre les puissances occidentales pour empêcher l'URSS de reprendre pied en Afrique. C'est justement cette solidarité qui a volé en éclats dès que s'est effondré le bloc russe. Pour la puissance américaine, le maintien par la France d'une emprise sur une bonne partie du continent africain, emprise disproportionnée par rapport au poids économique et surtout militaire de ce pays dans l'arène mondiale, constituait une anomalie d'autant plus que ce dernier ne perdait aucune occasion de contester le leadership américain. En ce sens, l'élément fondamental qui sous-tendait les différents conflits qui ont ravagé l'Afrique au cours des dernières années était la rivalité croissante entre les deux anciens alliés, la France et les États-Unis, ces derniers tentant par tous les moyens de chasser la première de son pré-carré. La concrétisation la plus spectaculaire de cette offensive américaine a été, en mai 1997, le renversement du régime de Mobutu qui avait constitué pendant des décennies une des pièces maîtresse du dispositif impérialiste français (et aussi américain en moment de la guerre froide) en Afrique. Lors de son accession au pouvoir, Laurent-Désiré Kabila n'avait pas pris de gants pour déclarer son hostilité à la France et son « amitié » pour les États-Unis qui venaient de lui mettre le pied à l'étrier. A cette époque encore, au-delà des rivalités entre les différentes cliques, notamment ethniques, qui s'affrontaient sur le terrain, la marque du conflit entre les puissances américaine et française était clairement visible, comme elle l'avait été peu auparavant avec les changements de régime au Rwanda et au Burundi au bénéfice des Tutsis soutenus par les États-Unis.
Aujourd'hui, il serait difficile de distinguer les mêmes lignes d'affrontement dans la nouvelle tragédie qui vient ensanglanter le Congo. En fait, il apparaît que les différents États qui sont impliqués dans le conflit jouent essentiellement leur propre carte, indépendamment de l'affrontement fondamental entre France et États-Unis qui avait déterminé l'histoire africaine au cours de la dernière période. C'est ainsi que l'Ouganda, un des principaux artisans de la victoire de Kabila, rêve avec son entreprise actuelle contre le même Kabila, de prendre la tête d'un « Tutsiland » qui regrouperait autour de lui le Rwanda, le Kenya, la Tanzanie, le Burundi et les provinces orientales du Congo. Pour sa part, le Rwanda, en participant à l'offensive contre Kabila, vise à procéder à un « nettoyage ethnique » des sanctuaires congolais utilisés par les miliciens Hutu qui continuent leurs raids contre le régime de Kigali et, au-delà, se propose de mettre la main sur la province du Kivu (d'ailleurs, un des chefs de la rébellion, Pascal Tshipata, affirmait le 5 août que celle-ci a pour raison la trahison par Kabila de sa promesse de céder le Kivu aux Banyamulengues qui l'avaient soutenu contre Mobutu).
Pour sa part, le soutien angolais au régime de Kabila n'est pas non plus gratuit. En fait, ce soutien ressemble à celui de la corde qui soutient le pendu. En faisant dépendre la survie du régime de Kabila de son aide militaire, l'Angola est en position de force pour lui dicter ses conditions : interdiction du territoire congolais aux rebelles de l'UNITA et droit de passage à travers le Congo avec l'enclave du Cabinda coupée géographiquement de son propriétaire angolais.
La tendance générale au « chacun pour soi » que manifestaient de plus en plus les anciens alliés du bloc américain, et qui s'était exprimée de façon éclatante dans l'ex-Yougoslavie, a fait avec le conflit actuel au Congo un pas supplémentaire : désormais, ce sont des pays de troisième ou de quatrième zone, comme l'Angola ou l'Ouganda, qui affirment leurs visées impérialistes indépendamment des intérêts de leurs « protecteurs ». Et c'est bien cette même tendance qu'on voit en œuvre avec les attentats du 7 août contre les ambassades américaines en Afrique et la « riposte » des États-Unis deux semaines après.
Les attentats contre les ambassades américaines et la réponse des Etats-Unis
La préparation minutieuse, la coordination et la violence meurtrière des attentats du 7 août permettent de penser que ces derniers ne sont pas le fait d'un groupe terroriste isolé mais qu'ils ont été appuyés, voire organisés par un Etat. D'ailleurs, dès le lendemain de ces attentats, les autorités américaines affirmaient bien fort que la guerre contre le terrorisme constitue désormais un objectif prioritaire de leur politique (objectif que le Président Clinton a réaffirmé avec force à la tribune des Nations-Unies le 21 septembre).
En réalité, et le gouvernement américain est clair là-dessus, ce sont les Etats pratiquant ou soutenant le terrorisme qui sont visés. Cette politique n'est pas nouvelle : cela fait déjà de nombreuses années que les Etats-Unis stigmatisent les « Etats terroristes » (ont fait partie de cette catégorie notamment la Libye, la Syrie et l'Iran). Evidemment, il existe des « Etats terroristes » qui ne font pas l'objet du courroux américain : ce sont ceux qui soutiennent des mouvements qui servent les intérêts des Etats-Unis (comme c'est le cas de l'Arabie saoudite qui a financé les intégristes algériens en guerre contre un régime ami de la France). Cependant, que la première puissance mondiale, celle qui prétend au rôle de « Gendarme du monde », accorde une telle importance à cette question ne relève pas seulement de la propagande au service de ses intérêts circonstanciels. En réalité, le fait que le terrorisme soit devenu aujourd'hui un moyen de plus en plus utilisé dans les conflits impérialistes constitue une illustration du chaos qui se développe dans les relations entre Etats ([1] [3454]), un chaos qui permet à des pays de faible importance de contester la loi des grandes puissances, et particulièrement de la première d'entre elles, ce qui contribue, évidemment, à saper un peu plus le leadership de cette dernière.
Les deux ripostes des Etats-Unis aux attentats contre leurs ambassades, le bombardement par des missiles de croisière d'une usine de Karthoum et de la base de Oussama Ben Laden en Afghanistan, illustrent de façon probante la situation des relations internationales aujourd'hui. Dans les deux cas, le premier pays du monde, afin de réaffirmer son leadership, a fait une nouvelle fois étalage de ce qui constitue sa force essentielle : son énorme supériorité militaire sur tous les autres. L'armée américaine est la seule qui puisse ainsi porter la mort de façon massive et avec une précision diabolique à des dizaines de milliers de kilomètres de son territoire, et cela sans prendre le moindre risque. C'est un avertissement aux pays qui seraient tentés d'apporter leur soutien aux groupes terroristes mais aussi aux pays occidentaux qui entretiennent de bonnes relations avec eux. Ainsi, la destruction d'une usine au Soudan, même si le prétexte invoqué (la fabrication dans cette usine d'armes chimiques) a du mal à tenir la route, permet aux Etats-Unis de frapper un régime islamiste qui entretient de bonnes relations avec la France.
Cependant, comme en d'autres occasions, cet étalage de la puissance militaire s'est révélé fort peu efficace pour rassembler les autres pays autour des Etats-Unis. D'une part, la presque totalité des pays arabes ou musulmans ont condamné les bombardements. D'autre part, les grands pays occidentaux, même quand ils ont fait semblant d'approuver, ont fait part de leurs réserves vis-à-vis des moyens employés par les Etats-Unis. C'est là un nouveau témoignage des difficultés considérables que rencontre aujourd'hui la première puissance mondiale a affirmer son leadership : en l'absence de menace provenant d'une autre superpuissance (comme c'était le cas au temps de l'existence de l'URSS et de son bloc), l'étalage et l'utilisation de la force militaire ne réussit pas à resserrer les alliances autour d'elle ni à surmonter le chaos qu'elle se propose de combattre. Une telle politique ne fait bien souvent qu'attiser les antagonismes contre les Etats-Unis et qu'aggraver le chaos et le chacun pour soi.
La montée incessante du chacun pour soi et les difficultés du leadership américain apparaissent clairement avec les bombardements des bases de Oussama Ben Laden. La question de savoir si c'est bien lui qui a commandité les attentats de Dar es-Salaam et de Nairobi n'est pas vraiment élucidée. Cependant, le fait que les États-Unis aient décidé d'envoyer des missiles de croisière sur ses bases d'entraînement en Afghanistan fait bien la preuve que la première puissance mondiale le considère comme un ennemi. Et justement, ce même Ben Laden avait été au temps de l'occupation russe un des meilleurs alliés des États-Unis qui l'avaient financé et armé généreusement. Bien plus surprenant encore, il y a le fait que Ben Laden dispose de la protection des Talibans dont le soutien par les États-Unis (avec la complicité du Pakistan et de l'Arabie Saoudite) a été décisif dans leur conquête de l'essentiel du territoire afghan. Aujourd'hui, Talibans et américains se trouvent donc dans des camps opposés. En fait, il existe plusieurs raisons permettant de comprendre ce coup porté aux Talibans par les États-Unis.
D'une part, l'appui inconditionnel apporté jusqu'à maintenant par Washington aux Talibans constituait un obstacle au processus de « normalisation » des relations avec le régime iranien. Ce processus avait connu une avancée médiatique spectaculaire avec les amabilités échangées entre les équipes de football américaine et iranienne lors de la dernière coupe du Monde. Cependant, dans leur diplomatie en direction de l'Iran, les États-Unis ont une longueur de retard par rapport à d'autres pays comme la France, laquelle a justement envoyé au même moment son ministre des affaires étrangères à Téhéran. Pour la puissance américaine, il s'agit de ne pas passer à côté de la tendance actuelle d'ouverture qui se manifeste dans la diplomatie iranienne et de pas se laisser couper l'herbe sous le pied par d'autres puissances.
Cependant, le coup porté aux Talibans constitue également une mise en garde contre les velléités de ces derniers de prendre leurs distances avec Washington maintenant que leur victoire quasi complète sur leurs ennemis les rend moins dépendants de l'aide américaine. En d'autres termes, la première puissance mondiale veut éviter que ne se renouvelle en plus grand avec les Talibans ce qui s'est passé avec Ben Laden, que ses « amis » ne se transforment en ennemis. Mais dans ce cas comme dans beaucoup d'autres, il n'est pas assuré que le coup de force américain soit payant. Le chacun pour soi et le chaos qu'il entraîne ne pourra pas être contrecarré par l'étalage de la force du « gendarme du monde ». Ces phénomènes font partie intégrante de la période historique actuelle de décomposition du capitalisme et ils sont insurmontables.
D'ailleurs, l'incapacité fondamentale dans laquelle se trouve la première puissance mondiale à résoudre cette situation se répercute aujourd'hui dans la vie interne de sa bourgeoisie. Dans la crise que traverse aujourd'hui l'exécutif américain autour du « Monicagate », il existe probablement des causes de politique politicienne interne. De même, ce scandale, systématiquement couvert par les médias, est opportunément mis à profit pour détourner l'attention de la classe ouvrière d'une situation économique qui va en se dégradant, d'attaques patronales croissantes, comme en témoigne la montée de la combativité ouvrière (grèves de General Motors et de Northwest). Enfin, l'aspect surréaliste du procès qui est fait à Clinton constitue un autre témoignage du pourrissement sur pieds de la société bourgeoise propre à la période de décomposition. Cependant, une telle offensive contre le président américain, qui pourrait conduire à sa destitution, révèle le malaise de la bourgeoisie de la première puissance mondiale incapable d'affirmer son leadership sur la planète.
Cela dit, les déboires de Clinton, et même de l'ensemble de la bourgeoisie américaine, ne sont qu'un aspect mineur, insignifiant du drame qui se joue aujourd'hui à l'échelle mondiale. Pour un nombre toujours croissant d'êtres humains, et aujourd'hui c'est particulièrement le cas au Congo, le chaos qui n'en finit pas de se développer de par le monde est synonyme de massacres, de famines, d'épidémies, de barbarie. Une barbarie qui a connu au cours de l'été une nouvelle avancée et qui va encore s'aggraver tant que le capitalisme n'aura pas été renversé.
Fabienne
[1] [3455]. Dans l'article « Face à l'enfoncement dans la barbarie, la nécessité et la possibilité de la réovlution » (Revue Internationale n° 48, 1er trim. 1987), nous avions déjà mis en évidence que les attentats terroristes comme ceux qui s'étaient produits à Paris en 1986 constituaient une des manifestations de l'entrée du capitalisme dans une nouvelle phase de sa décadence, celle de la décomposition. Depuis, l'ensemble des convulsions qui ont secoué la planète, notamment l'effondrement du bloc impérialiste russe à la fin des années 1980, sont venues illustrer abondamment cet enfoncement de la société capitaliste dans la décomposition et le pourrissement sur pied.
Questions théoriques:
- Impérialisme [321]
Heritage de la Gauche Communiste:
Berlin 1948 : en 1948, le pont aérien de Berlin cache les crimes de l'impérialisme allié
- 8378 reads
BERLIN 1948
EN 1948, LE PONT AÉRIEN DE BERLIN CACHE LES CRIMES DE L'IMPÉRIALISME ALLIÉ
A de nombreuses reprises, dans notre presse, nous avons dénoncé les massacres et les crimes des « grandes démocraties » et mis en relief la co-responsabilité des « alliés » et des nazis dans l'holocauste (Revue internationale n° 66 et 89).
Contrairement à ce que la propagande mensongère de la bourgeoisie met en avant – répétant inlassablement que la Seconde Guerre mondiale a été un combat entre les « forces du bien », « démocratiques et humanistes », et le « mal absolu », nazi et totalitaire –, celle-ci fut l'affrontement sanglant entre intérêts impérialistes rivaux et antagoniques tout aussi barbares et meurtriers les uns que les autres.
Une fois la guerre terminée et l'Allemagne battue, ce furent encore les tendances naturelles du capitalisme décadent et les nouvelles rivalités impérialistes entre « alliés » de la veille qui imposèrent un régime de famine et de terreur aux populations européennes et, en premier lieu, à la population allemande. Là-aussi, contrairement à ce que développe la propagande des bourgeoisies occidentales, cette politique ne fut pas l'apanage du stalinisme.
L'épisode du pont aérien sur Berlin en 1948 marqua une accélération brutale des antagonismes impérialistes entre les blocs qui se sont constitués autour de la Russie stalinienne et des Etats-Unis. Il fut un tournant dans la politique de ces derniers à l'égard de l'Allemagne. Loin d'être l'expression de leur humanisme, le pont aérien des occidentaux sur Berlin fut une expression de leur contre-offensive face aux visées impérialistes russes. Par la même occasion, il leur permit aussi de masquer la politique de terreur, de famine organisée, de déportations massives et d'enfermement dans des camps de travail qu'ils imposèrent à la population allemande dans l'immédiat après-guerre.
Il n'est pas surprenant que les vainqueurs démocrates de la deuxième guerre mondiale – les bourgeoisies américaine, britannique et française – aient saisi l'opportunité de cette année pour célébrer le cinquantième anniversaire du pont aérien de Berlin qui a commencé le 26 juin 1948. Selon leur propagande actuelle, cet événement d'une part prouverait le soi-disant humanisme des grandes "démocraties" occidentales et leur compassion envers une nation défaite; d'autre part il aurait été le signal de la résistance contre les menaces du totalitarisme russe. Durant plus d'une année, plus de 2,3 millions de tonnes d'approvisionnement de secours ont été livrés par les 277 728 vols des avions américains et britanniques sur Berlin ouest isolé par le blocus imposé par l'impérialisme russe. La "passion" pour la paix, la liberté et la dignité humaine qui s'était manifestée à travers cet épisode historique, continuerait aujourd'hui d'animer les coeurs des impérialistes occidentaux, selon leurs propres médias et politiciens.
Rien n'est aussi éloigné de la vérité ! Que l'on se penche sur l'histoire des cinquante dernières années en général qui multiplie les preuves de leur barbarie sanguinaire ou même sur l'épisode du pont aérien sur Berlin et sa signification réelle ! En réalité, le pont aérien marque essentiellement un changement dans la politique impérialiste américaine. L'Allemagne ne devait plus être désindustrialisée et transformée en pays agricole, comme cela avait été décidé à la conférence de Postdam en 1945, mais elle devait désormais être reconstruite comme rempart du bloc impérialiste occidental nouvellement créé contre le bloc de l'Est. Ce changement de la part de l'impérialisme occidental n'était pas motivé par la compassion. Au contraire, la raison qui motivait cette réorientation était le poids grandissant de l'hégémonie russe qui menaçait de s'étendre à l'Europe de l'ouest du fait du marasme économique et politique que celle-ci connaissait après les massacres et les destructions en masse de la Seconde Guerre mondiale. Ainsi le pont aérien, bien que servant à nourrir une partie de la population affamée, a été un coup de propagande bien concocté pour faire oublier la misère noire des années précédentes et pour faire accepter la nouvelle orientation aux populations ouest-allemandes et ouest-européennes qui allaient alors être prises en otage dans la guerre froide qui commençait. Grâce à ces vols d'approvisionnement "humanitaires" sur Berlin, trois groupes de bombardiers américains B-29 furent envoyés en Europe, plaçant ainsi les objectifs russes à leur portée...
Cependant la célébration du pont aérien cette année a été relativement discrète malgré une visite spéciale à Berlin du président américain Clinton. Une explication possible de cette campagne en sourdine autour de cet anniversaire particulier est qu'une célébration plus bruyante pouvait soulever d'inconfortables questions sur la véritable politique des Alliés, notamment les occidentaux, vis à vis du prolétariat allemand durant et immédiatement après la seconde guerre mondiale. Elle aurait pu révéler l'énorme hypocrisie des « démocraties » et leurs propres « crimes contre l'humanité ». Elle aurait aussi aidé à faire valoir la Gauche communiste qui, la première et constamment, a dénoncé toutes les manifestations de la barbarie du capitalisme décadent, que ce soit sous sa forme démocratique, stalinienne ou fasciste.
Le CCI a souvent montré ([1] [3456]), aux côtés d'autres tendances politiques de la Gauche communiste, comment les crimes de l'impérialisme allié durant la seconde guerre mondiale n'étaient pas moins odieux que ceux des impérialismes fascistes. Ils étaient le produit du capitalisme à une certaine étape de son déclin historique. Les bombardements massifs des principales villes allemandes et japonaises à la fin de la guerre ont montré ce qu'était en réalité la philanthropie des Alliés : une énorme contrevérité. Les bombardements de tous les centres à haute densité de population en Allemagne n'avaient pas pour objet de détruire des cibles militaires, ni même économiques. La dislocation de l'économie allemande à la fin de la guerre n'a pas été achevée par ces bombardements massifs, mais par la destruction du système de transports ([2] [3457]). En fait, ces bombardements avaient pour objectif spécifique de décimer et de terroriser la classe ouvrière et d'empêcher qu'un mouvement révolutionnaire ne se développe à partir du chaos de la défaite comme ce fut le cas en 1918.
Mais 1945, « année zéro », n'a pas marqué la fin du cauchemar :
« La Conférence de Potsdam de 1945 et l'accord interalliés de mars 1946 ont formulé les décisions concrètes [...] de réduire la capacité industrielle allemande à un bas niveau et de donner à la place une plus grande priorité à l'agriculture. Afin d'éliminer toute capacité de l'économie allemande de mener une guerre, il fut décidé d'interdire totalement la production par l'Allemagne de produits stratégiques tels que l'aluminium, le caoutchouc et le benzène synthétiques. De plus, l'Allemagne était obligée de réduire sa capacité sidérurgique à 50 % de son niveau de 1929, et l'équipement superflu devait être démantelé et transporté dans les pays victorieux à la fois de l'Est et de l'Ouest. » ([3] [3458])
Il n'est pas difficile d'imaginer les « décisions concrètes » qui ont été prises par rapport au bien-être de la population :
« A la capitulation de mai 1945, les écoles et les universités étaient fermées, tout comme les stations de radio, les journaux, la Croix Rouge nationale et le courrier. L'Allemagne était aussi dépouillée de beaucoup de charbon, de ses territoires de l'Est [comptant pour 25 % de ses terres arables], de ses brevets industriels, de ses bois, de ses réserves d'or, et de la plupart de sa force de travail. Les Alliés pillèrent et détruisirent usines, bureaux, laboratoires et ateliers de l'Allemagne. [...] A partir du 8 mai, date de la capitulation à l'Ouest, les prisonniers allemands et italiens au Canada, aux USA et au Royaume-Uni, qui avaient été nourris conformément à la Convention de Genève, furent soudain soumis à des rations grandement réduites. [...] Les agences de secours étrangères furent empêchées d'envoyer de la nourriture de l'étranger ; les trains de nourriture de la Croix Rouge furent renvoyés en Suisse ; on refusa à tous les gouvernements la permission d'envoyer de la nourriture aux civils allemands ; la production d'engrais fut réduite brusquement ; et la nourriture était confisquée la première année, spécialement dans la zone française. La flotte de pêche était maintenue au port alors que les gens mourraient de faim. » ([4] [3459])
L'Allemagne était effectivement transformée en un vaste camp de la mort par les puissances occupantes russe, britannique, française et américaine. Les démocraties occidentales capturèrent 73 % de tous les prisonniers allemands dans leurs zones d'occupation. Beaucoup plus d'Allemands moururent après la guerre qu'au cours des batailles, sous les bombardements et dans les camps de concentration de la guerre. Entre 9 et 13 millions périrent comme résultat de la politique de l'impérialisme allié entre 1945 et 1950. Ce monstrueux génocide eut trois sources principales :
– d'abord parmi les 13,3 millions d'Allemands d'origine qui furent expulsés des régions orientales d'Allemagne, de Pologne, de Tchécoslovaquie, de Hongrie, etc., selon les accords de Potsdam ; cette épuration ethnique fut si inhumaine que seuls 7,3 millions arrivèrent à destination, derrière les nouvelles frontières allemandes de l'après-guerre ; le reste « disparut » dans les circonstances les plus horribles ;
– ensuite, parmi les prisonniers de guerre allemands qui moururent à cause des conditions de famine et de maladie dans les camps alliés – entre 1,5 et 2 millions ;
– enfin, parmi la population en général qui n'avait que des rations de 1000 calories par jour ne garantissant qu'une lente famine et la maladie – 5,7 millions en moururent.
La comptabilité exacte de cette barbarie inimaginable reste encore un secret des impérialismes « démocratiques ». Même la bourgeoisie allemande couvre, encore aujourd'hui, les faits qui ne peuvent être glanés que par des recherches indépendantes qui mettent en évidence les incohérences dans les chiffres officiels. Par exemple, l'estimation du nombre de civils qui périrent dans cette période est calculée, entre autres moyens, à partir de l'énorme manque de population enregistré par recensement de l'Allemagne en 1950. Mais le rôle des démocraties occidentales dans cette campagne d'extermination est devenu plus clair après la chute de l'empire « soviétique » et l'ouverture des archives russes. Nombre de pertes dont l'URSS était blâmée par la propagande des occidentaux jusque là se sont révélées être de la responsabilité de ces derniers. Il s'avère, par exemple, que la plus grande partie des prisonniers de guerre sont morts dans les camps tenus par les puissances occidentales. Les décès n'étaient simplement pas enregistrés ou étaient cachés sous d'autres rubriques. L'échelle du massacre n'est pas surprenante si on considère les conditions qui étaient faites aux prisonniers : ils étaient laissés sans nourriture ou restaient sans abri ; leur nombre se voyait régulièrement augmenté par les malades renvoyés des hôpitaux ; durant la nuit, ils pouvaient être mitraillés au hasard, pour le sport ; quant au fait de leur fournir de la nourriture, il fut décrété « délit capital » pour la population civile (4).
L'ampleur de la famine de la population civile, dont 7,5 millions étaient sans-abri après la guerre, peut être appréciée aussi aux rations qui étaient allouées par les occupants occidentaux. Dans la zone française, où les conditions étaient les pires, la ration officielle en 1947 était de 450 calories par jour, la moitié de la ration de l'infâme camp de concentration de Belsen.
La bourgeoisie occidentale présente encore cette période comme une période de « réajustement » pour la population allemande après les inévitables horreurs de la deuxième guerre mondiale. Les privations étaient une conséquence « naturelle » de la dislocation de l'après-guerre. Dans tous les cas, argumente la bourgeoisie, la population allemande méritait un tel traitement pour avoir commencé la guerre et pour paiement des crimes de guerre du régime nazi. Cet argument écœurant est particulièrement hypocrite pour nombre de raisons. Premièrement, parce que la destruction complète de l'impérialisme allemand était déjà un but de la guerre pour les Alliés avant même qu'ils aient décidé d'utiliser le « grand alibi » d'Auschwitz pour le justifier. Deuxièmement, parce que ceux qui ont été directement responsables de l'arrivée au pouvoir du national-socialisme et de ses ambitions impérialistes – les grands capitalistes allemands – sont sortis relativement indemnes de la guerre et de ses conséquences. Même si plusieurs grandes figures furent exécutées à l'issue des procès de Nuremberg, la majorité des fonctionnaires et des patrons de l'ère nazie fut « recyclée » et occupa les postes dans le nouvel Etat mis en place par les Alliés ([5] [3460]). Les prolétaires allemands, qui ont souffert le plus de la politique des Alliés après-guerre, n'avaient pas de responsabilité dans le régime nazi : ils en ont été ses premières victimes. Les bourgeoisies alliées, qui avaient appuyé la répression d'Hitler contre le prolétariat en 1933, châtièrent une génération entière de la classe ouvrière allemande durant et après la guerre, non pas pour prendre une revanche sur l'ère d'Hitler, mais pour exorciser le spectre de la révolution allemande qui les hantait depuis l'après-Première Guerre mondiale.
C'est seulement lorsque cet objectif meurtrier fut atteint et que l'impérialisme américain réalisa que l'épuisement de l'Europe après la guerre risquait de mener à la domination de l'impérialisme russe sur tout le continent que la politique de Potsdam fut changée. La reconstruction de l'Europe de l'ouest exigeait la résurrection de l'économie allemande. Alors la richesse des Etats-Unis, grossie en partie par le pillage de l'Allemagne, pouvait être canalisée vers le plan Marshall pour aider à reconstruire le bastion européen de ce qui allait devenir le bloc de l'Ouest. Le pont aérien de Berlin en 1948 était le symbole de ce changement de stratégie.
Les crimes de l'impérialisme sous ses formes fasciste et stalinienne sont bien connus. Quand ceux des impérialismes démocratiques seront plus clairs pour la classe ouvrière mondiale, alors la possibilité de la mission historique du prolétariat sera plus clairement révélée. Il n'est pas étonnant que la bourgeoisie veuille essayer d'assimiler de manière frauduleuse le travail de la Gauche communiste sur cette question aux mensonges de l'extrême-droite et du « négationnisme ». La bourgeoisie veut cacher le fait que le génocide, au lieu d'être une exception aberrante perpétuée par des fous sataniques, a été une règle générale de l'histoire du capitalisme décadent.
Como
[1] [3461]. Revue internationale n° 83, « Hiroshima, Nagazaki, ou les mensonges de la bourgeoisie » ; Revue internationale n° 88, « L'anti-fascisme justifie la barbarie » ; Revue internationale n° 89, « La coresponsabilité des alliés et des nazis dans l'holocauste ».
[2] [3462]. Selon « The strategic air war against Germany 1939-45, the official report of the Bristish bombing survey unit » qui vient seulement d'être publié.
[3] [3463]. Herman Van der Wee, « Prosperity and upheaval », Pelican 1987.
[4] [3464]. James Bacque, « Crimes and mercies, the fate of German civilians under allied occupation 1945-50 », Warner Books.
[5] [3465] Voir Tom Bower, « Blind eye to murder ».
Géographique:
- Allemagne [98]
Questions théoriques:
- Impérialisme [321]
Heritage de la Gauche Communiste:
Révolution allemande (X) : le reflux de la vague révolutionnaire et la dégénérescence de l'Internationale
- 6206 reads
REVOLUTION ALLEMANDE, X
Le reflux
de la vague
révolutionnaire
et la dégénérescence
de l'Internationale
La conquête victorieuse du pouvoir en Russie par la classe ouvrière en octobre 1917 allume une flamme qui va illuminer le monde entier. La classe ouvrière des pays voisins reprend immédiatement l'exemple donné par les ouvriers en Russie. Dès novembre 1917, la classe ouvrière en Finlande rejoint le combat. Dans les provinces tchèques, en Pologne, en Autriche, en Roumanie et en Bulgarie en 1918, des vagues de grèves font l'une après l'autre trembler les régimes en place. Et quant à leur tour, en novembre 1918, les ouvriers allemands entrent en scène, c'est un pays-clé que gagne la vague révolutionnaire, un pays qui va être décisif pour l'issue future de ces luttes, où va se jouer la victoire ou la défaite de la révolution.
En mettant rapidement fin à la guerre en novembre 1918, à travers le sabotage des luttes orchestré par la social-démocratie et les syndicats – travaillant main dans la main avec l'armée – afin de vider le mouvement de son contenu et finalement à travers la provocation d'un soulèvement prématuré, la bourgeoisie allemande réussit, avant tout grâce aux forces de la « démocratie », à empêcher la conquête victorieuse du pouvoir par la classe ouvrière et une généralisation de la révolution à sa suite.
La bourgeoisie internationale s'unit pour arrêter la vague révolutionnaire
La série de soulèvements qui ont lieu en 1919, en Europe comme sur d'autres continents, la fondation de la République des soviets en Hongrie en mars, celle des conseils ouvriers slovaques en juin, la vague de grèves en France au printemps ainsi que de puissantes luttes aux Etats-Unis et en Argentine, tous ces événements ont lieu alors que l'extension de la révolution en Allemagne vient de connaître un coup d'arrêt. Comme l'élément-clé de l'extension de la révolution, la classe ouvrière d'Allemagne, n'a pas réussi à renverser la classe capitaliste par un assaut soudain et rapide, la vague de luttes commence à perdre son élan en 1919. Bien que les ouvriers continuent à se battre héroïquement contre l'offensive de la bourgeoisie dans une série de confrontations comme en Allemagne même (le putsch de Kapp en mars 1920) et en Italie à l'automne 1920, ces luttes ne vont pas parvenir à pousser le mouvement en avant.
Enfin, ces luttes ne vont pas réussir à briser l'offensive que la classe capitaliste a lancée contre le bastion isolé des ouvriers en Russie. Au printemps 1918, la bourgeoisie russe qui a été renversée très rapidement et quasiment sans violence, commence à mener une guerre civile avec le soutien de 14 armées des Etats « démocratiques ». Dans cette guerre civile qui va durer presque trois ans et s'accompagner d'un blocus économique visant à affamer les ouvriers, les armées « blanches » des Etats capitalistes épuisent la classe ouvrière russe. A travers une offensive militaire dont l'Armée rouge sort victorieuse, la classe ouvrière est entraînée dans une guerre dans laquelle elle doit affronter, de façon isolée, la furie des armées impérialistes. Après des années de blocus et d'encerclement, la classe ouvrière en Russie sort de la guerre civile, à la fin de 1920, saignée à blanc, épuisée, avec plus d'un million de morts dans ses rangs et, par-dessus tout, politiquement affaiblie.
A la fin de 1920, quand la classe ouvrière connaît une première défaite en Allemagne, quand celle d'Italie est entraînée dans un piège à travers les occupations d'usine, quand l'Armée rouge échoue dans sa marche sur Varsovie, les communistes commencent à comprendre que l'espoir d'une extension rapide, continue de la révolution ne va pas se réaliser. Dans le même temps la classe capitaliste réalise que le danger principal, mortel, contenu dans le soulèvement des ouvriers en Allemagne, s'éloigne pour le moment.
La généralisation de la révolution est contrecarrée avant tout parce que la classe capitaliste a rapidement tiré les leçons de la conquête victorieuse du pouvoir par les ouvriers en Russie.
L'explication historique du développement explosif de la révolution et de sa défaite rapide réside dans le fait qu'elle a surgi contre la guerre impérialiste et non comme réponse à une crise économique généralisée comme Marx l'attendait. Contrairement à la situation qui prévaudra en 1939, le prolétariat n'a pas été battu de façon décisive avant la première guerre mondiale ; il est capable, malgré trois années de carnage, de développer une réponse révolutionnaire à la barbarie ouverte de l'impérialisme mondial. Mettre fin à la guerre et donc empêcher le massacre d'autres millions d'exploités ne peut se faire que de façon rapide et décisive, en s'attaquant directement au pouvoir. Voila pourquoi la révolution, une fois enclenchée, s'est développée et répandue avec une grande rapidité. Et dans le camp révolutionnaire, tous s'attendent à une victoire rapide de la révolution au moins en Europe.
Cependant, si la bourgeoisie est incapable de mettre un terme à la crise économique de son système, elle peut, en revanche, arrêter la guerre impérialiste quand il faut faire face à une menace révolutionnaire. C'est ce qu'elle fait une fois que la vague révolutionnaire, en novembre 1918, atteint le cœur du prolétariat mondial en Allemagne. Ainsi, les exploiteurs ont été capables de renverser la dynamique vers l'extension internationale de la révolution.
Le bilan de la vague révolutionnaire de 1917–23 révèle, de façon concluante, que la guerre mondiale, déjà avant l'ère des armes atomiques de destruction massive, fournit un terrain peu favorable à la victoire du prolétariat. Comme le soulignait Rosa Luxemburg dans la Brochure de Junius, la guerre moderne globale, en tuant des millions de prolétaires, incluant les bataillons les plus expérimentés et les plus conscients, menace le fondement même de la victoire du socialisme. De plus, elle crée des conditions de lutte différentes pour les ouvriers selon qu'ils se trouvent dans les pays vaincus, les pays neutres ou les pays vainqueurs. Ce n'est pas par hasard si la vague révolutionnaire est la plus forte dans le camp des vaincus, en Russie, en Allemagne, dans l'Empire austro-hongrois, mais aussi en Italie (qui n'appartenait au camp des vainqueurs que de façon formelle) et qu'elle l'est nettement moins dans des pays comme la France, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. Ces derniers sont non seulement capables de stabiliser temporairement leur économie à travers les spoliations de guerre mais aussi de contaminer de nombreux ouvriers avec l'euphorie de la « victoire ». La bourgeoisie réussit même, dans une certaine mesure, à aviver les flammes du chauvinisme. Ainsi, malgré la solidarité mondiale avec la révolution d'Octobre et l'influence grandissante des révolutionnaires internationalistes au cours de la guerre, le poison nationaliste sécrété par la classe dominante continue à faire des dégâts dans les rangs ouvriers une fois la révolution commencée. Le mouvement révolutionnaire en Allemagne en donne des exemples édifiants : l'influence du nationalisme extrémiste, soi-disant « communiste de gauche », des nationaux-bolcheviks qui, pendant la guerre à Hambourg, distribuent des tracts antisémites contre la direction de Spartakus à cause de sa position internationaliste ; les sentiments patriotiques attisés après la signature du Traité de Versailles; le chauvinisme anti-français suscité par l'occupation de la Ruhr en 1923, etc. Comme nous le verrons dans la suite de cette série d'articles, l'Internationale communiste, dans sa phase de dégénérescence opportuniste, va chercher de plus en plus à chevaucher cette vague de nationalisme au lieu de s'y opposer.
Mais l'intelligence et la perfidie de la bourgeoisie allemande ne se manifestent pas seulement lorsqu'elle met immédiatement fin à la guerre dès que les ouvriers ont commencé à lancer leur assaut contre l'Etat bourgeois. Contrairement à la classe ouvrière en Russie qui a fait face à une bourgeoisie faible et inexpérimentée, celle d'Allemagne affronte le bloc uni des forces du capital, avec à sa tête la social-démocratie et les syndicats.
En tirant le maximum de profit des illusions persistantes chez les ouvriers sur la démocratie, en attisant et en exploitant leurs divisions nées de la guerre notamment entre les « vainqueurs » et les « vaincus », à travers une série de manœuvres politiques et de provocations, la classe capitaliste est parvenue à prendre la classe ouvrière dans ses filets et la défaire.
L'extension de la révolution est stoppée. Après avoir survécu à la première vague de réactions ouvrières, la bourgeoisie peut dès lors passer à l'offensive. Elle va faire tout ce qui est en son pouvoir pour renverser le rapport de forces en sa faveur.
Nous allons maintenant examiner comment les organisations révolutionnaires ont réagi face à ce coup d'arrêt de la lutte de classe et quelles ont été les conséquences pour la classe ouvrière en Russie.
L'Internationale communiste du IIe au IIIe congrès
Quand la classe ouvrière commence à bouger en Allemagne en novembre 1918, les bolcheviks, dès décembre, appellent à une conférence internationale. A ce moment-là, la plupart des révolutionnaires pensent que la conquête du pouvoir par la classe ouvrière en Allemagne va réussir au moins aussi rapidement qu'en Russie. Dans la lettre d'invitation à cette conférence il est proposé qu'elle se tienne en Allemagne (en toute légalité) ou en Hollande (dans l'illégalité) le 1er février 1919. Personne ne prévoit, dans un premier temps, de la tenir en Russie. Mais l'écrasement des ouvriers en janvier à Berlin, l'assassinat des chefs révolutionnaires Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht et la répression organisée par les corps-francs, eux-mêmes dirigés par le SPD, rendent impossible la tenue de cette réunion dans la capitale allemande. C'est seulement à ce moment-là que Moscou est choisie. Quand l'Internationale communiste est fondée en mars 1919, Trotski écrit dans les Izvestia le 29 avril 1919 : « Si le centre de l'Internationale se trouve aujourd'hui à Moscou, demain il sera déplacé – nous en sommes profondément convaincus – à l'ouest, vers Paris, Berlin, Londres. »
Pour toutes les organisations révolutionnaires la politique de l'IC est déterminée par les intérêts de la révolution mondiale. Les premiers débats au congrès, sont marqués par la situation en Allemagne, sur le rôle de la social-démocratie dans l'écrasement de la classe ouvrière durant les luttes de janvier et sur la nécessité de combattre ce parti en tant que force capitaliste.
Trotski écrit dans l'article mentionné ci-dessus : « La question du "droit d'aînesse" révolutionnaire du prolétariat russe n'est qu'une question temporaire... La dictature du prolétariat russe ne sera abolie une fois pour toutes et transformée en une construction générale du socialisme que lorsque la classe ouvrière européenne nous aura libérés du joug économique et surtout militaire de la bourgeoisie européenne. » (Trotski, Izvestia, 29 avril et 1er mai 1919). Et encore : « Si le peuple européen ne se soulève pas et ne renverse pas l'impérialisme, c'est nous qui seront renversés – il n'y a aucun doute là-dessus. Soit la révolution russe ouvre les vannes de l'ouragan des luttes à l'ouest, soit les capitalistes de tous les pays annihileront et étrangleront notre lutte. » (Trotski au IIe congrès des soviets)
Après que plusieurs partis aient rejoint l'IC en un court espace de temps, à son IIe congrès en juillet 1920, il est noté : « Dans certaines circonstances, il peut y avoir pour l'IC le danger d'être diluée au milieu de groupes tanguant dans une politique à demi-convaincue et qui ne se sont pas encore libérés de l'idéologie de la 2e Internationale. Pour cette raison, le IIe congrès mondial de l'IC considère qu'il est nécessaire d'établir des conditions très précises à l'admission de nouveaux partis. »
Même si l'Internationale est fondée dans le feu de la situation, elle établit certaines délimitations claires sur des questions aussi centrales que l'extension de la révolution, la conquête du pouvoir politique, la délimitation la plus claire possible vis-à-vis de la social-démocratie, la dénonciation claire de la démocratie bourgeoise ; par contre, d'autres questions telles que les syndicats et la question parlementaire, l'IC les laisse ouvertes.
La majorité de l'IC adopte comme orientation la participation aux élections parlementaires mais sans que ce soit une obligation explicite du fait qu'une forte minorité (notamment le groupe autour de Bordiga connu, à ce moment-là, comme « la fraction abstentionniste ») y est totalement opposée. Par contre, l'IC décide qu'il est obligatoire que tous les révolutionnaires travaillent dans les syndicats. Les délégués du KAPD qui ont quitté le congrès avant qu'il ne commence, d'une façon totalement irresponsable, ne peuvent pas défendre leur point de vue sur ces questions, contrairement aux camarades italiens. Le débat qui s'est déjà engagé avant le congrès avec la publication du texte de Lénine La maladie infantile du communisme, va évoluer autour de la question des méthodes de lutte dans la nouvelle époque de décadence du capitalisme. C'est dans cette bataille politique qu'apparaît la Gauche communiste.
Par rapport au développement à venir de la lutte de classe, le IIe congrès manifeste encore de l'optimisme. Pendant l'été 1920, tout le monde s'attend à une intensification des luttes révolutionnaires. Mais après la défaite des luttes à l'automne 1920, la tendance va s'inverser.
Le reflux de la lutte de classe, un tremplin pour l'opportunisme
Dans les Thèses sur la situation internationale et les tâches de l'Internationale communiste, l'IC, à son IIIe congrès en juillet 1921, analyse la situation de la manière suivante :
« Pendant l'année écoulée entre le IIe et le IIIe congrès de l'Internationale communiste, une série de soulèvements et de batailles de la classe ouvrière ont abouti à des défaites partielles (l'offensive de l'Armée rouge sur Varsovie en août 1920, le mouvement du prolétariat italien en septembre 1920, le soulèvement des ouvriers allemands en mars 1921). La première période du mouvement révolutionnaire après la guerre doit être considérée comme globalement terminée, la confiance de la classe bourgeoise en elle-même et la stabilité de ses organes d'Etat se sont indubitablement renforcés. (...) Les dirigeants de la bourgeoisie (...) ont mené partout une offensive contre les masses ouvrières. (...) Face à cette situation, l'IC se pose et pose à l'ensemble de la classe ouvrière les questions suivantes : dans quelle mesure ces nouveaux rapports politiques entre le prolétariat et la bourgeoisie correspondent plus profondément au rapport de forces entre les deux camps opposés ? Est-il vrai que la bourgeoisie est sur le point de restaurer l'équilibre social qui a été bouleversé par la guerre ? Existe-t-il des bases pour supposer que l'époque des paroxysmes politiques et des batailles de classe est dépassée par une nouvelle époque prolongée de restauration et de croissance capitaliste ? Ceci ne nécessite-t-il pas de réviser le programme ou la tactique de l'Internationale communiste ? » (Thèses sur la situation internationale et les tâches de l'IC, IIIe Congrès mondial, 4 juillet 1921).
Et dans les Thèses sur la tactique, il est suggéré que « La révolution mondiale (...) nécessitera une plus longue période de luttes (...) La révolution mondiale n'est pas un processus linéaire. »
L'IC va s'adapter à la nouvelle situation de différentes façons.
Le slogan « Aux masses », un pas vers la confusion opportuniste
Dans un précédent article, nous avons déjà traité de la pseudo théorie de l'offensive. Une partie de l'IC et une partie du camp révolutionnaire en Allemagne poussent en effet à l'« offensive » et à « porter un coup » pour soutenir la Russie. Elles théorisent leur aventurisme en « théorie de l'offensive » selon laquelle le parti peut se lancer à l'assaut du capital sans prendre en compte le rapport de forces ni la combativité de la classe, du moment que le parti est assez déterminé et courageux.
Cependant, l'histoire montre que la révolution prolétarienne ne peut être provoquée de façon artificielle et que le parti ne peut compenser le manque d'initiative et de combativité des masses ouvrières. Même si l'IC rejette en fin de compte les activités aventureuses du KPD en juillet 1921, à son IIIe congrès, elle-même préconise des moyens opportunistes pour accroître son influence parmi les masses indécises : « Aux masses, c'est le premier slogan que le 3e congrès envoie aux communistes de tous les pays ». En d'autres termes, si les masses piétinent, alors les communistes doivent aller aux masses.
Afin d'augmenter son influence parmi les masses, l'IC, à l'automne 1920, pousse à l'établissement de partis de masse dans plusieurs pays. En Allemagne, l'aile gauche de l'USPD centriste se joint au KPD pour former le VKPD en décembre 1920 (ce qui fait monter son effectif à 400 000 membres). Dans cette même période, le parti communiste tchèque avec ses 350 000 membres et le parti communiste français avec environ 120 000 membres sont admis dans l'Internationale.
« Depuis le premier jour de sa formation, l'IC s'est donné clairement et sans équivoque le but de ne pas former des petites sectes communistes (...), mais bien la participation aux luttes de la classe ouvrière, l'orientation de ces luttes dans une direction communiste et la formation, dans la lutte, de grands partis communistes révolutionnaires. Dès le début de son existence, l'IC a rejeté les tendances sectaires en appelant ses partis associés – quelle que soit leur taille – à participer aux syndicats afin de renverser de l'intérieur leur bureaucratie réactionnaire et de faire des syndicats des organes révolutionnaires de masse, des organes de sa lutte. (...) A son IIe congrès, l'IC a ouvertement rejeté les tendances sectaires dans sa résolution sur la question syndicale et l'utilisation du parlementarisme. (...) Le communisme allemand, grâce à la tactique de l'IC (travail révolutionnaire dans les syndicats, lettres ouvertes, etc.) est devenu un grand parti révolutionnaire de masse. (...) En Tchécoslovaquie, les communistes sont parvenus à gagner à leurs côtés la majorité des ouvriers organisés politiquement. (...) D'un autre côté, les groupes communistes sectaires (tels que le KAPD, etc.) n'ont pas été capables d'obtenir le moindre succès. » (Thèses sur la tactique, IIIe congrès de l'IC)
En réalité, ce débat sur les moyens de la lutte et la possibilité d'un parti de masse dans la nouvelle époque du capitalisme décadent a déjà commencé au congrès de fondation du KPD en décembre 1918-janvier 1919. A cette époque, le débat tourne autour de la question syndicale et de savoir si l'on peut encore utiliser le parlement bourgeois.
Même si Rosa Luxemburg, à ce congrès, se prononce encore pour la participation aux élections parlementaires et pour le travail dans les syndicats, c'est avec la vision claire que de nouvelles conditions de lutte ont surgi, conditions dans lesquelles les révolutionnaires doivent lutter pour la révolution avec la plus grande persévérance et sans l'espoir naïf d'une « solution rapide ». Mettant en garde le congrès contre l'impatience et la précipitation, elle dit avec beaucoup d'insistance : « Si je décris le processus de cette façon, ce processus peut apparaître d'une certaine manière plus long que nous ne l'avons imaginé au début. » Même dans le dernier article qu'elle écrit avant son assassinat, elle affirme : « De tout cela, on peut conclure que nous ne pouvons pas attendre une victoire finale et durable en ce moment. » (L'ordre règne à Berlin)
L'analyse de la situation et l'évaluation du rapport de forces entre les classes a toujours été une des tâches primordiales des communistes. S'ils n'assument pas correctement ces responsabilités, s'ils continuent d'attendre un mouvement montant quand celui-ci est en train de reculer, il y a le danger de tomber dans des réactions d'impatience, aventuristes, et de chercher à substituer au mouvement de la classe des tentatives artificielles.
C'est la direction du parti communiste allemand qui, à sa conférence d'octobre 1919, après le premier reflux des luttes en Allemagne, propose d'orienter son travail en direction d'une participation aux syndicats et aux élections parlementaires afin d'accroître son influence dans les masses travailleuses, tournant ainsi le dos au vote majoritaire de son congrès de fondation. Deux ans plus tard, au IIIe congrès de l'IC, ce débat refait surface.
La gauche italienne autour Bordiga a déjà attaqué l'orientation du IIe congrès sur la participation aux élections parlementaires (voir les Thèses sur le parlementarisme), mettant en garde contre cette orientation qui serait un terrain fertile pour l'opportunisme; et si le KAPD n'a pas pu se faire entendre au IIe congrès, sa délégation intervient au IIIe congrès dans des circonstances plus difficiles et combat cette dynamique opportuniste.
Tandis que le KAPD souligne que « le prolétariat a besoin d'un parti-noyau ultra-formé », l'IC cherche une porte de sortie dans la création de partis de masse. La position du KAPD est rejetée.
Quant à l'orientation opportuniste « Aux masses », elle va faciliter l'adoption de la « tactique du front unique » qui sera adoptée quelques mois après le IIIe congrès.
Ce qui est notable ici, c'est que l'IC s'embarque dans cette voie alors que la révolution en Europe ne s'étend plus et que la vague de luttes connaît un reflux. De même que la révolution russe de 1917 n'a constitué que l'ouverture d'une vague internationale de luttes, le déclin de la révolution et le recul politique de l'Internationale ne sont que le résultat et une expression de l'évolution du rapport de forces international. Ce sont les circonstances historiquement peu favorables d'une révolution émergeant d'une guerre mondiale ainsi que l'intelligence de la bourgeoisie qui a mis fin à la guerre à temps et joué la carte de la démocratie qui ont créé, en empêchant l'extension de la révolution, les conditions de l'opportunisme croissant au sein de l'Internationale.
Le débat sur l'évolution en Russie
Afin de comprendre les réactions des révolutionnaires envers l'isolement de la classe ouvrière en Russie et le changement du rapport de forces entre la bourgeoisie et le prolétariat, nous devons examiner l'évolution de la situation en Russie même.
Quand en Octobre 1917, la classe ouvrière, sous la direction du parti bolchevik, prend le pouvoir, il n'existe en Russie aucune illusion sur la possibilité de construction du socialisme en un seul pays. L'ensemble de la classe a les yeux tournés vers l'étranger, attendant une aide de l'extérieur. Et quand les ouvriers prennent les premières mesures économiques comme la confiscation des usines et celles qui vont dans le sens de la prise en main de la production, ce sont précisément les bolcheviks qui les mettent en garde contre de fausses attentes par rapport à de telles mesures. Ces derniers sont particulièrement clairs sur le caractère prioritaire et vital des mesures politiques, c'est-à-dire l'orientation vers la généralisation de la révolution. Ils sont particulièrement clairs sur le fait que la conquête du pouvoir par le prolétariat dans un pays ne constitue pas évidemment l'abolition du capitalisme. Tant que la classe ouvrière n'a pas renversé la classe dominante à l'échelle mondiale ou dans des régions décisives, ce sont les mesures politiques qui restent primordiales, déterminantes. Dans les zones conquises, le prolétariat ne peut qu'administrer, au mieux de ses intérêts, la pénurie caractéristique de la société capitaliste.
Plus grave, au printemps 1918 quand les Etats capitalistes mettent en place le blocus économique et se jettent dans la guerre civile aux côtés de la bourgeoisie russe, la classe ouvrière et les paysans en Russie se trouvent confrontés à une situation économique désastreuse. Comment résoudre de graves problèmes de pénurie alimentaire tout en faisant face au travail de sabotage orchestré par la classe capitaliste ? Comment organiser et coordonner les efforts militaires pour riposter efficacement aux attaques des armées blanches ? Seul l'Etat est capable de remplir ce type de tâches. Et c'est bien un nouvel Etat qui surgit après l'insurrection et qui, à bien des niveaux, est composé par les anciennes catégories de fonctionnaires. Cependant, pour faire face à l'ampleur des tâches telles que la guerre civile et la lutte contre le sabotage de l'intérieur, les milices de la première période ne sont plus suffisantes ; il faut créer une armée rouge et des organes de répression spécialisés.
Ainsi, alors que la classe ouvrière détient les rênes du pouvoir depuis la révolution d'Octobre et pendant une courte période qui lui fait suite, alors que durant cette période les principales décisions sont prises par les soviets, un processus va se mettre en place rapidement dans lequel les soviets vont perdre de plus en plus leur pouvoir et leurs moyens de coercition au bénéfice de l'Etat post-insurrectionnel. Au lieu que ce soient les soviets qui contrôlent l'appareil d'Etat, qui exercent leur dictature sur l'Etat, qui utilisent l'Etat comme instrument dans le sens des intérêts de la classe ouvrière, c'est ce nouvel « organe » – que les bolcheviks appellent de façon erronée un « Etat ouvrier » – qui commence à saper le pouvoir des soviets et à leur imposer ses propres directives. Cette évolution a pour origine le fait que le mode de production capitaliste continue à prévaloir. De plus, non seulement l'Etat post-insurrectionnel n'a pas commencé à dépérir mais au contraire il tend à enfler de plus en plus. Cette tendance va s'accentuer au fur et à mesure que la vague révolutionnaire va cesser de s'étendre et même refluer, laissant de plus en plus la classe ouvrière isolée en Russie. Moins le prolétariat sera capable de mettre la pression sur la classe capitaliste à l'échelle internationale, moins il sera capable de contrecarrer ses plans et notamment d'empêcher les opérations militaires contre la Russie ; c'est ainsi que la bourgeoisie va disposer d'une plus grande marge de manœuvre pour étrangler la révolution en Russie. Et c'est dans cette dynamique de rapport de forces que l'Etat post-insurrectionnel en Russie va se développer. Ainsi, c'est la capacité de la bourgeoisie d'empêcher l'extension de la révolution qui est à la base du fait que l'Etat soit devenu de plus en plus hégémonique et « autonome ».
Pour faire face à la pénurie croissante des biens imposée par les capitalistes, aux mauvaises récoltes, au sabotage des paysans, aux destructions causées par la guerre civile, aux famines et aux épidémies qui découlent de tout cela, l'Etat dirigé par les bolcheviks est forcé de prendre de plus en plus de mesures de coercition de toutes sorte, telles que la confiscation des récoltes et le rationnement de presque tous les biens. Il est également contraint de chercher à nouer des liens commerciaux avec les pays capitalistes et cette question ne se pose pas comme question morale mais comme une question de survie. La pénurie et le commerce ne peuvent être directement administrés que par l'Etat. Mais qui contrôle l'Etat ?
Qui doit exercer le contrôle sur l'Etat ? Le parti ou les conseils ?
A l'époque, la conception selon laquelle le parti de la classe ouvrière doit prendre, en son nom, le pouvoir et donc les postes de commande du nouvel Etat post-insurrectionnel est largement partagé chez les révolutionnaires. C'est ainsi qu'à partir d'octobre 1917 les membres dirigeants du parti bolchevik occupent les plus hautes fonctions dans le nouvel Etat et commencent à s'identifier avec cet Etat lui-même.
Cette conception aurait pu être mise en question et rejetée si, à travers d'autres insurrections victorieuses et notamment en Allemagne, la classe ouvrière avait triomphé de la bourgeoisie au niveau internationale. Après une telle victoire, le prolétariat et ses révolutionnaires auraient eu les moyens de mieux mettre en évidence les différences, voire les conflits d'intérêts qui existent entre l'Etat et la révolution. Ils auraient donc pu mieux critiquer les erreurs des bolcheviks. Mais l'isolement de la révolution russe a fait que le parti, à son tour, a pris de plus en plus fait et cause pour l'Etat au lieu de défendre les intérêts du prolétariat international. Progressivement, toute initiative est ôtée des mains des ouvriers et l'Etat va dérouler ses tentacules, devenir autonome. Quant au parti bolchevik, il va être à la fois le premier otage et le principal promoteur de son développement.
A la fin de la guerre civile, la famine s'aggrave encore durant l'hiver 1920-21 au point que la population de Moscou, dont une partie tente de fuir la famine, chute de 50 %, et celle de Petrograd des 2/3. Les révoltes paysannes et les protestations ouvrières se multiplient. Une vague de grèves surgit surtout dans la région de Petrograd et les marins de Kronstadt sont le fer de lance de cette résistance contre la dégradation des conditions de vie et contre l'Etat. Ils établissent des revendications économiques et politiques : à côté du rejet de la dictature du parti, c'est surtout la revendication du renouveau des soviets qui est mise en avant.
L'Etat, avec à sa tête le parti bolchevik, décide d'affronter violemment les ouvriers, les considérant comme des forces contre-révolutionnaires manipulées par l'étranger. Pour la première fois, le parti bolchevik participe de manière homogène à l'écrasement violent d'une partie de la classe ouvrière. Et ceci a lieu au moment où il célèbre le 50e anniversaire de la Commune de Paris et trois ans après que Lénine, au congrès de fondation de l'IC, ait écrit le slogan « Tout le pouvoir aux soviets » sur les drapeaux de l'Internationale. Bien que ce soit le parti bolchevik qui assume concrètement l'écrasement du soulèvement de Kronstadt, c'est l'ensemble du mouvement révolutionnaire de l'époque qui est dans l'erreur sur la nature de ce soulèvement. L'Opposition ouvrière russe comme les partis membres de l'Internationale le condamnent clairement.
En réponse à cette situation de mécontentement général grandissant et afin d'inciter les paysans à produire et à livrer leurs récoltes sur les marchés, il est décidé en mars 1921 d'introduire la Nouvelle politique économique (NEP) qui, en réalité, ne représente pas une « retour » vers le capitalisme puisque celui-ci n'a jamais été aboli, mais une adaptation au phénomène de pénurie et aux lois du marché. En même temps, un accord commercial est signé entre la Grande Bretagne et la Russie.
Par rapport à cette question de l'Etat et à l'identification du parti avec cet Etat, des divergences existent au sein du parti bolchevik. Comme nous l'avons écrit dans la Revue internationale n° 8 et n° 9, des voix communistes de gauche en Russie ont déjà tiré la sonnette d'alarme et mis en garde contre le danger d'un régime capitaliste d'Etat. Ainsi en 1918, le journal Le communiste s'élève contre les tentatives de discipliner la classe ouvrière. Même si avec la guerre civile, la plupart des critiques sont mises à l'arrière plan et si, sous la pression de l'agression des capitalistes étrangers, le parti voit ses rangs se resserrer, une opposition continue à se développer contre le poids croissant des structures bureaucratiques au sein du parti. Le groupe du Centralisme démocratique autour d'Ossinski fondé en 1919 critique la perte d'initiative des ouvriers et appelle au rétablissement de la démocratie au sein du parti, notamment lors de la IXe Conférence à l'automne 1920 où il dénonce sa bureaucratisation croissante.
Lénine lui-même, qui pourtant assume les plus hautes responsabilités étatiques, est celui qui pressent le mieux le danger que peut représenter ce nouvel Etat pour la révolution. Il est souvent le plus déterminé dans ses arguments pour appeler et encourager les ouvriers à se défendre contre cet Etat.
Ainsi, dans le débat sur la question syndicale, alors que Lénine insiste sur le fait que les syndicats doivent servir à défendre les intérêts ouvriers, même contre l'« Etat ouvrier » qui souffre de déformations bureaucratiques – preuve claire que Lénine admet l'existence d'un conflit entre l'Etat et la classe ouvrière –, Trotski demande l'intégration totale des syndicats à l'« Etat ouvrier ». Il veut parachever la militarisation du processus de production, même après la fin de la guerre civile. Le groupe de L'opposition ouvrière qui apparaît pour la première fois en mars 1921, au Xe congrès du parti, veut que la production soit contrôlée par les syndicats industriels eux-mêmes étant sous le contrôle de l'Etat soviétique.
Au sein du parti, les décisions sont de plus en plus transférées des conférences du parti au réunions du comité central et du Bureau politique récemment constitué. La militarisation de la société que la guerre civile a provoquée, s'étend profondément de l'Etat jusqu'aux rangs du parti. Au lieu de pousser à l'initiative de ses membres dans les comités locaux, le parti soumet la totalité de l'activité politique en son sein au strict contrôle de la direction, à travers des « départements » politiques, menant ainsi à la décision du Xe congrès, en mars 1921, d'interdire les fractions dans le parti.
Dans la seconde partie de cet article, nous analyserons la résistance de la Gauche communiste contre cette tendance opportuniste et comment l'Internationale devint de plus en plus l'instrument de l'Etat russe.
DV
Géographique:
- Allemagne [98]
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Allemande [1955]
Conscience et organisation:
- Troisième Internationale [1881]
- La Gauche Germano-Hollandaise [1956]
Approfondir:
- Révolution Allemande [1957]
Heritage de la Gauche Communiste:
- La Révolution prolétarienne [1149]
Le communisme n'est pas un bel idéal, il est à l'ordre du jour de l'histoire [5° partie]
- 3377 reads
1919 : Le programme de la dictature du prolétariat
La période 1918-20, phase « héroïque » de la vague révolutionnaire inaugurée par l'insurrection d'Octobre en Russie, a aussi été la période durant laquelle les partis communistes de l'époque ont formulé leur programme de renversement du capitalisme et de transition vers le communisme.
Dans la Revue internationale n° 93, nous avons examiné le programme du KPD – le parti communiste d'Allemagne – qui venait de se former. Nous avons vu qu'il consistait essentiellement en une série de mesures pratiques destinées à guider la lutte du prolétariat en Allemagne du stade de la révolte spontanée à la conquête consciente du pouvoir politique. Dans la Revue internationale n° 94, nous avons publié la plate-forme de l'Internationale communiste – adoptée à son congrès de fondation comme base du regroupement international des forces communistes et comme ébauche des tâches révolutionnaires auxquelles étaient confrontés les ouvriers de tous les pays.
Quasiment au même moment, le Parti communiste de Russie (PCR) – le parti bolchevik – publiait son nouveau programme. Il était étroitement lié à celui de l'IC et avait en fait le même auteur, Nicolas Boukharine. Malgré cela, cette séparation entre la plate-forme de l'IC et les programmes des partis nationaux (de même que celle qui existait entre ces derniers) reflétait la persistance de conceptions fédéralistes héritées de l'époque de la social-démocratie; et comme Bordiga devait le souligner plus tard, l'incapacité du « parti mondial » à soumettre ses sections nationales aux priorités de la révolution internationale allait avoir de sérieuses implications face au recul de la vague révolutionnaire et à l'isolement et la dégénérescence de la révolution en Russie. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce problème particulier. Il est cependant instructif de faire une étude spécifique du programme du PCR et de le comparer à ceux qu'on a examinés auparavant. Le programme du KPD était le produit d'un parti confronté à la tâche de mener les masses à la prise du pouvoir; la plate-forme de l'IC, elle, était plus considérée comme un point de référence pour les partis voulant se regrouper dans l'Internationale que comme un programme d'action détaillé. C'est en fait une des petites ironies de l'histoire que l'IC n'ait adopté un programme formel et unifié qu'à son VIe Congrès, en 1928. Boukharine en était encore une fois l'auteur mais, cette fois, le programme était aussi la marque du suicide de l'Internationale puisque celle-ci adoptait l'infâme théorie du socialisme en un seul pays et cessait donc d'exister comme organe du prolétariat internationaliste.
Le programme du PCR, pour sa part, a été rédigé après le renversement du régime bourgeois en Russie et constituait d'abord et avant tout une présentation détaillée et précise des buts et des méthodes du nouveau pouvoir des soviets. C'était donc un programme pour la dictature du prolétariat et, en ce sens, il constitue une indication unique du niveau de clarté programmatique atteint par le mouvement communiste à ce moment-là. Plus encore, si nous n'hésiterons pas à indiquer les parties du programme que l'expérience pratique devait mettre en question ou réfuter de façon définitive, nous montrerons aussi que, dans la plupart de ses lignes essentielles, ce document reste un point de référence profondément valable pour la révolution prolétarienne du futur.
Le programme du PCR a été adopté au VIIIe congrès du parti en mars 1919. La nécessité d'une révision fondamentale du vieux programme de 1908 était apparue au moins depuis 1917, lorsque les bolcheviks avaient abandonné la perspective de la « dictature démocratique » pour adopter celle de la conquête prolétarienne du pouvoir et de la révolution socialiste mondiale. A l'époque du VIIIe congrès, il y avait de nombreux désaccords au sein du parti concernant le pouvoir des soviets et son développement (nous y reviendrons dans un article ultérieur). Aussi le programme exprime-t-il, en un certain sens, un compromis entre différents courants au sein du parti, incluant ceux qui estimaient que le processus révolutionnaire n'allait pas assez vite en Russie et ceux qui se rendaient compte que certains principes fondamentaux étaient remis en question.
Le programme allait rapidement être suivi d'un ouvrage d'explication et de popularisation considérable, L'ABC du communisme rédigé par Boukharine et Preobrajenski. Ce livre est bâti autour des points du programme mais il constitue plus qu'un simple commentaire de celui-ci. En fait, il est devenu lui-même un classique, une synthèse de la théorie marxiste et de son développement depuis Le manifeste communiste jusqu'à la révolution russe, rédigé dans un style accessible et vivant qui a fait de lui un manuel d'éducation politique à la fois pour les membres du parti et pour la large masse des ouvriers qui soutenaient et faisaient vivre la révolution. Si le présent article se concentre sur le programme du PCR plutôt que sur L'ABC du communisme, c'est parce qu'un examen détaillé de ce dernier ne peut être fait dans un seul article; ce n'est pas du tout pour minimiser l'importance du livre qui vaut toujours la peine d'être lu aujourd'hui.
C'est aussi valable et même encore plus, pour les nombreux décrets émis par le pouvoir des soviets pendant les premières phases de la révolution et jusqu'à la constitution de 1918 qui définit la structure et le fonctionnement du nouveau pouvoir. Ces documents méritent aussi d'être étudiés comme faisant partie du « programme de la dictature du prolétariat », d'autant plus que, comme Trotski l'écrit dans son autobiographie, « durant cette phase, les décrets étaient véritablement plus de la propagande que de vraies mesures administratives. Lénine était pressé de dire au peuple ce qu'était le nouveau pouvoir, ce qu'il serait après et comment il allait procéder pour atteindre ses buts » (Ma vie). Ces décrets ne traitaient pas seulement de questions économiques et politiques brûlantes – telles que la structure de l'Etat et de l'armée, la lutte contre la contre-révolution, l'expropriation de la bourgeoisie et le contrôle ouvrier sur l'industrie, la conclusion d'une paix séparée avec l'Allemagne, etc. –, mais aussi de nombreuses questions sociales telles que le mariage et le divorce, l'éducation, la religion, etc. Toujours selon les termes de Trotski, ces décrets « seront préservés pour toujours dans l'histoire en tant que proclamations d'un nouveau monde. Non seulement les sociologues et les historiens, mais les futurs législateurs s'inspireront de nombreuses fois de cette source. »
Mais précisément à cause de leur gigantesque objectif, nous ne pouvons les analyser dans cet article qui se concentrera sur le programme bolchevik de 1919 du fait même qu'il nous fournit la position la plus synthétique et la plus concise des buts généraux poursuivis par le nouveau pouvoir et par le parti qui les a adoptés.
L'époque de la révolution prolétarienne
Tout comme la plate-forme de l'IC, le programme commence en se situant dans la nouvelle « ère de la révolution communiste prolétarienne mondiale », caractérisée d'un côté par le développement de l'impérialisme, la lutte féroce entre grandes puissances capitalistes pour la domination mondiale et donc par l'éclatement de la guerre impérialiste mondiale (expression concrète de l'effondrement du capitalisme) et d'un autre côté par le soulèvement international de la classe ouvrière contre les horreurs du capitalisme en déclin, un soulèvement qui a pris une forme tangible dans la révolution d'Octobre en Russie et dans le développement de la révolution dans tous les pays capitalistes centraux, en particulier en Allemagne et en Autriche-Hongrie. Le programme lui-même ne fait pas d'élaboration sur les contradictions économiques du capitalisme qui avaient mené à son effondrement; elles sont examinées dans L'ABC du communisme, même si ce dernier ne formule pas non plus de théorie cohérente et définitive sur les origines de la décadence capitaliste. De même et en contraste surprenant avec la plate-forme de l'IC, le programme n'utilise pas le concept de capitalisme d'Etat pour décrire l'organisation interne du régime bourgeois dans la nouvelle période. Mais là aussi ce concept est élaboré dans L'ABC du communisme et dans d'autres contributions théoriques de Boukharine sur lesquelles nous reviendrons dans un autre article. Pour finir, tout comme la plate-forme de l'IC, le programme du PCR est totalement clair dans son insistance qu'il est impossible à la classe ouvrière de faire la révolution « sans faire de la rupture des relations et du développement d'une lutte sans pitié contre cette perversion bourgeoise du socialisme qui est dominante dans les partis social-démocrates et socialistes officiels, une question de principe. »
Ayant affirmé son appartenance à la nouvelle Internationale communiste, le programme traite ensuite des tâches pratiques de la dictature du prolétariat « telles qu'elles sont appliquées en Russie, pays dont la particularité la plus notable est la prédominance numérique des couches petites-bourgeoises de la population. »
Les sous-titres qui suivent dans cet article, correspondent à l'ordre et aux titres des parties du programme du PCR.
Politique générale
Le première tâche de toute révolution prolétarienne (révolution d'une classe qui n'a aucune assise économique dans l'ancienne société) est de consolider son pouvoir politique; dans ce cadre, la Plate-forme de l'Internationale communiste et les Thèses sur la démocratie bourgeoise et la dictature du prolétariat qui l'accompagnent, ainsi que les parties « pratiques » du programme du PCR commencent toutes par affirmer la supériorité du système des soviets sur la démocratie bourgeoise. Contrairement à la tromperie de cette dernière sur la soi-disant participation de tous à la démocratie, le système des soviets, dont la base se situe avant tout sur les lieux de travail plutôt que sur des unités territoriales, affirme ouvertement son caractère de classe. Contrairement aux parlements bourgeois, les soviets, avec leur principe de mobilisation permanente à travers des assemblées de masse et celui de la révocabilité immédiate de tous les délégués, fournissent aussi les moyens à l'immense majorité de la population exploitée et opprimée d'exercer un contrôle réel sur les organes de pouvoir de l'Etat, de participer directement à la transformation économique et sociale et ceci quels que soient la race, la religion ou le sexe. En même temps, comme l'immense majorité de la population russe était composée de paysans – et puisque le marxisme ne reconnaît qu'une seule classe révolutionnaire dans la société capitaliste – le programme affirme aussi le rôle dirigeant du « prolétariat industriel urbain » et souligne que « notre constitution en soviets reflète ceci, en assignant certains droits préférentiels au prolétariat industriel, contrairement aux masses petites-bourgeoises, désunies en comparaison, dans les villages. » En particulier comme l'explique Victor Serge dans son livre L'an I de la révolution russe : « Le congrès pan-russe des soviets consiste dans les représentants des soviets locaux, les villes étant représentées par un député pour 25 000 habitants et les campagnes par un député pour 125 000. Cet article formalise la domination du prolétariat sur la paysannerie. »
Il faut se rappeler que le programme est celui d'un parti et qu'un véritable parti communiste ne peut jamais se satisfaire d'un statu quo tant que le but ultime du communisme n'a pas été atteint, situation où il n'y aura plus besoin qu'existe un parti comme organe politique distinct. C'est pourquoi cette partie du programme insiste lourdement sur la nécessité pour le parti de lutter pour une participation croissante des masses à la vie des soviets, pour développer leur niveau culturel et politique, pour combattre le national-chauvinisme et les préjugés contre les femmes qui existent encore dans le prolétariat et les classes opprimées. Il vaut la peine de noter que, dans ce programme, il n'existe pas de théorisation de la dictature du parti (cela devait venir après), même si la question de savoir si c'est le parti qui doit ou non détenir le pouvoir est toujours restée ambiguë chez les bolcheviks de même que pour l'ensemble du mouvement révolutionnaire de l'époque. Au contraire même, ce programme exprime une réelle conscience des conditions difficiles dans lesquelles se trouvait le bastion russe à l'époque (l'arriération culturelle, la guerre civile) qui avaient déjà créé un danger véritable de bureaucratisation dans le pouvoir soviétique; et une série de mesures pour combattre ce danger sont donc mises en avant :
« 1. Tout membre d'un soviet doit prendre en charge un travail défini dans un service administratif.
2. Il doit y avoir une rotation permanente parmi ceux qui sont engagés dans de telles tâches, de sorte que chaque membre gagne à son tour de l'expérience dans chaque branche de l'administration.
Peu à peu, l'ensemble de la population travailleuse doit être poussé à prendre un tour dans les services administratifs. »
En fait, ces mesures étaient largement insuffisantes étant donné que le programme sous-estimait les véritables difficultés posées par l'encerclement impérialiste et la guerre civile : l'état de siège, la famine, la sombre réalité de la guerre civile menée avec la plus extrême férocité, la dispersion des couches les plus avancées du prolétariat sur le front, les complots de la contre-révolution et la terreur rouge correspondante; tout cela sapait la vie des soviets et des autres organes de la démocratie prolétarienne qui étaient de plus en plus étouffés sous le poids grandissant d'un appareil bureaucratique. A l'époque où le programme a été écrit, l'implication des ouvriers, même les plus avancés, dans les tâches d'administration de l'Etat avait pour effet de les retirer de la vie de la classe et de les transformer en bureaucrates. A la place de la tendance au dépérissement de l'Etat défendu par Lénine dans L'Etat et la révolution, ce sont les soviets qui commençaient à dépérir, ce qui isolait le parti à la tête d'un appareil d'Etat et le coupait de plus en plus de l'auto-activité des masses. Dans de telles circonstances, le parti, loin d'agir en rejetant radicalement les situations de statu quo, tendait à fusionner avec l'Etat et à devenir ainsi un organe de conservation sociale. (Pour plus de développement sur les conditions auxquelles se confrontait le bastion prolétarien, lire « L'isolement sonne la mort de la révolution » dans la Revue internationale n° 75)
Cette négation rapide et tragique de la vision radicale que Lénine avait défendue en 1917 – une situation qui avait déjà avancé à un degré considérable au moment où fut adopté le programme du PCR – est souvent utilisée par les ennemis de la révolution pour prouver qu'une telle vision était au mieux utopique, au pire une simple supercherie ayant pour but de gagner le soutien des masses et de propulser les bolcheviks au pouvoir. Pour les communistes cependant, c'est seulement une preuve que si le socialisme en un seul pays est impossible, c'est tout aussi vrai pour la démocratie prolétarienne qui constitue la précondition politique à la création du socialisme. Et s'il existe d'importantes faiblesses dans cette partie du programme et dans d'autres, elles se trouvent dans les passages qui sous-entendent qu'il suffisait d'appliquer les principes de la Commune, de la démocratie prolétarienne, au cas de la Russie pour arriver à la disparition de l'Etat, sans que soit établi clairement et sans ambiguïté que ce ne peut être le résultat que d'une révolution internationale victorieuse.
Le problème des nationalités
Alors que sur bien des questions, pas moins importante que la démocratie prolétarienne, le programme du PCR était avant tout confronté à des difficultés de mise en pratique dans des conditions de guerre civile, sur le problème de la nationalité il est faussé d'emblée. Correct dans son point de départ, « l'importance primordiale de (...) la politique d'unir les prolétaires et les semi-prolétaires des différentes nationalités dans une lutte révolutionnaire commune pour le renversement de la bourgeoisie » et dans sa reconnaissance de la nécessité de surmonter les sentiments de méfiance engendrés par de longues années d'oppression nationale, le programme adopte le slogan qu'avait défendu Lénine depuis l'époque de la 2e Internationale : le « droit des nations à disposer d'elles-mêmes » comme le meilleur moyen de dissiper cette méfiance et applicable même (et en particulier) par le pouvoir des soviets. Sur ce point, l'auteur du programme, Boukharine, a fait un pas en arrière significatif par rapport à la position que lui ainsi que Piatakov et d'autres avaient mis en avant pendant la guerre impérialiste : le slogan d'autodétermination nationale est « avant tout utopique (il ne peut être réalisé dans les limites du capitalisme) et nocif en tant que slogan qui répand des illusions. » (Lettre au comité central du parti bolchevik, novembre 1915). Et comme l'a montré Rosa Luxemburg dans sa brochure La révolution russe, la politique des bolcheviks de permettre aux « nations assujetties » de se séparer du pouvoir soviétique n'a fait qu'inféoder les prolétaires de ces nouvelles nations bourgeoisies « auto-déterminées » à leurs propres classes dominantes rapaces et par-dessus tout aux plans et aux manœuvres des grandes puissances impérialistes. Les mêmes résultats désastreux ont été obtenus dans les pays « coloniaux » tels que la Turquie, l'Iran ou la Chine où le pouvoir soviétique pensait qu'il pourrait s'allier avec la bourgeoisie « révolutionnaire ». Au XIXe siècle, Marx et Engels avaient effectivement soutenu certaines luttes pour l'indépendance nationale, mais seulement parce que, dans cette période, le capitalisme avait encore un rôle progressif à jouer vis-à-vis des vieux vestiges féodaux ou despotiques de la période précédente. A aucune étape de l'histoire, l' « autodétermination nationale » n'a signifié autre chose que l'autodétermination de la bourgeoisie. A l'époque de la révolution prolétarienne, quand l'ensemble de la bourgeoisie constitue un obstacle réactionnaire à la progression de l'humanité, l'adoption de cette politique devait s'avérer extrêmement nuisible envers les nécessités de la révolution prolétarienne (voir notre brochure Nation ou classe et l'article sur la question nationale dans la Revue internationale n° 67). Le seul et unique moyen de lutter contre les divisions nationales qui existaient au sein de la classe ouvrière, était de travailler au développement de la lutte de classe internationale.
Les affaires militaires
C'est sans conteste une partie importante du programme du fait que celui-ci a été écrit alors que la guerre civile faisait encore rage. Le programme affirme certains principes de base : la nécessité de la destruction de l'ancienne armée bourgeoise et que la nouvelle Armée rouge soit un instrument de défense de la dictature du prolétariat. Certaines mesures sont mises en avant pour s'assurer que la nouvelle armée serve vraiment les besoins du prolétariat: elle doit être « exclusivement composée de prolétaires et des couches semi-prolétariennes apparentées de la paysannerie » ; l'entraînement et l'instruction dans l'armée doivent être « effectués sur une base de solidarité de classe et d'une instruction socialiste » ; dans ce but « il doit y avoir des commissaires politiques appointés choisis parmi les communistes de confiance et totalement désintéressés pour coopérer avec l'état-major militaire » ; tandis qu'une nouvelle catégorie d'officiers, composée d'ouvriers et de paysans ayant une conscience de classe, doit être entraînée et préparée à jouer un rôle dirigeant dans l'armée; afin d'empêcher la séparation entre l'armée et le prolétariat, il doit y avoir « l'association la plus étroite possible entre les unités militaires et les usines, les ateliers, les syndicats et les organisations de paysans pauvres » tandis que la période de caserne doit être réduite au minimum. L'utilisation d'experts militaires provenant de l'ancien régime doit être acceptée à la condition que de tels éléments soient strictement supervisés par les organes de la classe ouvrière. Les prescriptions de ce type expriment une conscience plus ou moins intuitive du fait que l'Armée rouge était particulièrement vulnérable et pouvait échapper facilement au contrôle politique de la classe ouvrière; mais étant donné que c'était la première Armée rouge et le premier Etat soviétique dans l'histoire, cette conscience était inévitablement limitée tant au niveau théorique que pratique.
Le dernier paragraphe de cette partie pose certains problèmes, notamment quand il est dit que « la revendication de l'élection des officiers qui avait une grande importance comme question de principe par rapport à l'armée bourgeoise dont les cadres étaient spécialement formés en tant qu'appareil de l'assujettissement de classe du commun des soldats (et, au travers de l'instrument du commun des soldats, l'assujettissement des masses laborieuses), cesse d'avoir une signification comme question de principe par rapport à l'armée de classe des ouvriers et des paysans. Une combinaison possible d'élection et de nomination d'en haut peut constituer un expédient pour l'armée de classe révolutionnaire au niveau pratique. »
S'il est vrai que l'élection et la prise de décision collective peuvent rencontrer des limites dans un contexte militaire – en particulier dans le feu de la bataille – le paragraphe semble sous-estimer le degré auquel la nouvelle armée reflétait elle-même la bureaucratisation de l'Etat en revivifiant beaucoup des anciennes normes de subordination. En fait, une « Opposition militaire » liée au groupe Centralisme démocratique, avait déjà surgi dans le parti et avait été particulièrement virulente au 8e congrès dans sa critique de la tendance à dévier des « principes de la Commune » dans l'organisation de l'armée. Ces principes sont importants non seulement sur le terrain « pratique » mais surtout parce qu'ils créent les meilleures conditions pour que la vie politique du prolétariat soit insufflée dans l'armée. Mais durant la période de guerre civile, c'est l'opposé qui tendait à se créer: l'imposition de méthodes militaires « normales » aidait à créer un climat favorisant la militarisation de l'ensemble du pouvoir soviétique. Le chef de l'Armée rouge, Trotski, se trouva de plus en plus associé à une telle démarche dans la période 1920-21.
Le problème central dont il est question ici est celui de l'Etat de la période de transition. L'Armée rouge – de même que la force spéciale de sécurité, la Tcheka, qui n'est même pas mentionnée dans le programme – est un organe d'Etat par excellence ; aussi, bien que pouvant être utilisée pour sauvegarder les acquis de la révolution, elle ne peut être considérée comme un organisme prolétarien et communiste. Même si elle avait été exclusivement composée de prolétaires, elle n'aurait pu qu'être en retrait par rapport à la vie collective de la classe. Il était donc particulièrement préjudiciable que l'Armée rouge comme d'autres institutions étatiques échappent de plus en plus au contrôle politique global des conseils ouvriers; alors qu'en même temps, la dissolution des Gardes rouges basés dans les usines privait la classe des moyens d'une autodéfense directe contre le danger de la dégénérescence interne. Mais ce sont des leçons qui ne pouvaient être apprises qu'à l'école souvent impitoyable de l'expérience révolutionnaire.
La justice prolétarienne
Cette partie du programme complète celle sur la politique générale. La destruction de l'ancien Etat bourgeois implique aussi le remplacement des anciens tribunaux bourgeois par un nouvel appareil judiciaire dans lequel les juges sont élus parmi les ouvriers et les jurés pris dans la masse de la population travailleuse ; le nouveau système judiciaire devait être simplifié et rendu plus accessible à la population que le vieux labyrinthe des cours haute et basse. Les méthodes pénales devaient être libérées de toute attitude de revanche et devenir constructives et éducatives. Le but à long terme étant que « le système pénal devra en dernière instance être transformé en un système de mesures à caractère éducatif » dans une société sans classe et sans Etat. L'ABC du communisme souligne cependant que les besoins urgents de la guerre civile avaient nécessité que les nouveaux tribunaux populaires soient complétés par les tribunaux révolutionnaires pour traiter non seulement des crimes sociaux « ordinaires » mais des activités de la contre-révolution. La justice sommaire prononcée par ces derniers tribunaux était le produit d'une nécessité urgente, bien que des abus aient été commis et portait certainement le danger que l'introduction de méthodes plus humaines soit repoussée indéfiniment. Ainsi, la peine de mort, abolie par l'un des premiers décrets du pouvoir soviétique en 1917, a-t-elle été rapidement restaurée dans la bataille contre la Terreur blanche.
L'éducation
Tout comme les propositions de réforme pénale, les efforts du pouvoir des soviets pour réformer le système éducatif furent très assujettis aux besoins de la guerre civile. De plus, étant donné l'extrême arriération des conditions sociales en Russie où l'analphabétisme était largement répandu, beaucoup des changements proposés n'allaient pas plus loin que de permettre à la population russe d'atteindre un niveau d'éducation déjà atteint dans certaines des démocraties bourgeoises les plus avancées. Il en est ainsi de l'appel à la scolarisation obligatoire mixte et libre pour tous les enfants jusqu'à 17 ans ; de la création de crèches et de jardins d'enfants pour libérer les femmes de la corvée des tâches domestiques ; de la suppression de l'influence religieuse dans les écoles ; de la création de facilités extra-éducatives telles que l'éducation pour adultes, les bibliothèques, les cinémas, etc.
Néanmoins, le but à long terme était « la transformation de l'école de sorte que d'organe de maintien de la domination de classe de la bourgeoisie, elle devienne un organe de l'abolition complète de la division de la société en classes, un organe de régénération communiste de la société. »
Dans ce but « l'école du travail unifié » constituait un concept-clé qui est plus complètement élaboré dans L'ABC du communisme. Sa fonction était vue comme le début du dépassement de la division entre les écoles élémentaires, moyennes et supérieures, entre les sexes, entre les écoles publiques et les écoles d'élite. Là encore, il était reconnu que de telles écoles étaient un idéal pour tout éducateur avancé, mais comme école du travail unifié, elle était vue comme un facteur crucial de l'abolition communiste de l'ancienne division du travail. L'espoir était porté sur le fait que dès les premiers moments de la vie d'un enfant, il n'y aurait plus de séparation rigide entre l'éducation mentale et le travail productif, de sorte que « dans la société communiste, il n'y aurait pas de corporations fermées, de guildes stéréotypées, de groupes de spécialistes pétrifiés. Le plus brillant homme de science doit aussi être qualifié dans le travail manuel.(...) Les premières activités d'un enfant prennent la forme du jeu; le jeu doit se transformer graduellement en travail, par une transition imperceptible, de sorte que l'enfant apprend dès son plus jeune âge à regarder le travail non comme une nécessité désagréable ou une punition, mais comme une expression naturelle et spontanée de ses facultés. Le travail doit être un besoin, comme le besoin de manger ou de boire ; ceci doit être instillé et développé dans l'école communiste. »
Ces principes fondamentaux resteront certainement valables dans une révolution future. Contrairement à certaines tendances de la pensée anarchiste, l'école ne peut être abolie en une nuit, mais son aspect d'instrument d'imposition de la discipline et de l'idéologie bourgeoises devra certainement être directement attaqué, pas seulement dans le contenu de ce qui est enseigné (L'ABC insiste beaucoup sur la nécessité de distiller à l'école une vision prolétarienne dans tous les domaines de l'éducation), mais aussi dans la façon dont a lieu l'enseignement (le principe de la démocratie directe devra, autant que possible, remplacer les anciennes hiérarchies au sein de l'école). De même, le gouffre entre le travail manuel et intellectuel, le travail et le jeu devront aussi être traités au départ. Dans la révolution russe, de nombreuses expériences ont eu lieu dans ces directions ; bien que troublées par la guerre civile, certaines d'entre elles se sont poursuivies durant les années 1920. En fait, l'un des signes que la contre-révolution avait finalement triomphé, a été que les écoles sont de nouveau devenues des instruments d'imposition de l'idéologie et de la hiérarchie bourgeoisies, même si c'était dissimulé sous le costume du « marxisme » stalinien.
La religion
L'inclusion d'un point particulier sur la religion dans le programme du parti, était, à un certain niveau, l'expression de l'arriération des conditions matérielles et culturelles de la Russie, obligeant le nouveau pouvoir à « achever » certaines tâches non réalisées par l'ancien régime, en particulier la séparation de l'Eglise et de l'Etat et la fin des subventions d'Etat aux institutions religieuses. Cependant, cette partie explique également que le parti ne peut se satisfaire des mesures « que la démocratie bourgeoise inclut dans son programme, mais n'a réalisé nulle part, à cause des multiples associations qui en réalité existent entre capital et propagande religieuse. » Il y avait des buts à plus long terme guidés par la reconnaissance que « seules la réalisation des buts et la pleine conscience dans toutes les activités économiques et sociales des masses peuvent amener à la disparition complète des illusions religieuses. » En d'autres termes, l'aliénation religieuse ne peut être éliminée sans l'élimination de l'aliénation sociale et ce n'est possible que dans une société pleinement communiste. Cela ne voulait pas dire que les communistes devaient adopter une attitude passive envers les illusions religieuses existantes des masses ; ils devaient les combattre activement sur la base d'une conception scientifique du monde. Mais c'était avant tout un travail de propagande ; l'idée de chercher une suppression forcée de la religion était tout à fait étrangère aux bolcheviks – une autre caractéristique du régime stalinien qui a pu oser, dans son arrogance contre-révolutionnaire, prétendre avoir réalisé le socialisme et avoir donc extirpé les racines sociales de la religion. Au contraire, tout en menant une propagande militante athéiste, il était nécessaire que les communistes et le nouveau pouvoir révolutionnaire « évitent tout ce qui pouvait blesser les sentiments des croyants, car une telle méthode ne pouvait que mener au renforcement du fanatisme religieux. » C'est aussi une démarche bien éloignée de celle des anarchistes qui favorise la méthode de la provocation directe et des insultes.
Ces prescriptions fondamentales n'ont pas perdu de leur valeur aujourd'hui. L'espoir, parfois exprimé par Marx dans ses premiers écrits, que la religion soit déjà morte pour le prolétariat, n'a pas été accompli. Non seulement la persistance de l'arriération économique et sociale dans bien des parties du monde, mais aussi la décadence et la décomposition de la société bourgeoise, sa tendance à régresser vers des formes extrêmement réactionnaires de pensée et de croyance, ont permis que la religion et ses divers rejetons restent une force puissante de contrôle social. En conséquence, les communistes sont toujours confrontés à la nécessité de lutter contre les « préjugés religieux des masses ».
Les affaires économiques
La révolution prolétarienne commence nécessairement comme une révolution politique parce que, n'ayant pas de moyens de production ou de propriété sociale propre, la classe ouvrière a besoin du levier du pouvoir politique pour commencer la transformation économique et sociale qui mènera à une société communiste. Les bolcheviks étaient fondamentalement clairs sur le fait que cette transformation ne pouvait être menée à sa conclusion qu'à une échelle globale ; bien que, comme nous l'avons noté, le programme du PCR, y compris dans cette partie, contienne un certain nombre de formulations ambiguës qui parlent de l'établissement d'un communisme complet comme une sorte de développement progressif au sein du « pouvoir des soviets », sans dire clairement si cela se réfère au pouvoir soviétique existant en Russie ou à la république mondiale des conseils. Dans l'ensemble, cependant, les mesures économiques défendues dans le programme sont relativement modestes et réalistes. Un pouvoir révolutionnaire ne pouvait certainement pas éviter de poser la question « économique » dès le départ, puisque c'est précisément le chaos économique provoqué par la chute du capitalisme qui contraint le prolétariat à intervenir afin d'assurer une société avec un minimum pour survivre. C'était le cas en Russie où la revendication du « pain » a constitué l'un des principaux facteurs de mobilisation révolutionnaire. Cependant, toute idée selon laquelle la classe ouvrière, assumant le pouvoir, pourrait réorganiser calmement et pacifiquement la vie économique a été immédiatement battue en brèche par la vitesse et la brutalité de l'encerclement impérialiste et de la contre-révolution blanche qui, venant à la suite de la première guerre mondiale, ont « légué une situation complètement chaotique » au prolétariat victorieux. Dans ces conditions, les premiers buts du pouvoir soviétique dans la sphère économique étaient définis ainsi :
– la réalisation de l'expropriation de la classe dominante, la prise en main des principaux moyens de production par le pouvoir soviétique ;
– la centralisation de toutes les activités économiques dans toutes les régions sous la direction du soviet (y compris celles dans les « autres » pays) selon un plan commun ; le but d'un tel plan était d'assurer « l'accroissement universel des forces productives dans le pays » – non pour le bien du « pays » mais pour assurer « un accroissement rapide de la quantité de biens dont la population a un besoin urgent » ;
– l'intégration graduelle de la production urbaine de petite échelle (artisans, etc) dans le secteur socialisé à travers le développement de coopératives et d'autres formes plus collectives ;
– l'utilisation maximale de toute la force de travail disponible par « la mobilisation générale par le pouvoir des soviets de tous les membres de la population qui sont physiquement et mentalement aptes au travail » ;
– l'encouragement à une nouvelle discipline de travail basé sur un sens collectif des responsabilités et la solidarité ;
– la maximalisation des bénéfices de la recherche scientifique et de la technologie, y compris l'utilisation de spécialistes hérités de l'ancien régime.
Ces lignes générales restent fondamentalement valables à la fois comme premières étapes du pouvoir prolétarien cherchant à produire ce qui est nécessaire à la survie dans une région donnée et comme débuts réels d'une construction socialiste par la république mondiale des conseils. Le principal problème ici se situe une nouvelle fois dans le conflit aigu entre les buts généraux et les conditions immédiates. Le projet d'élever le pouvoir de consommation des masses fut immédiatement contrecarré par les besoins de la guerre civile qui a transformé la Russie en une véritable caricature d'économie de guerre. Le chaos apporté par la guerre civile était si grand que « le développement des forces productives dans le pays » n'a pas eu lieu. Au contraire, les forces productives de la Russie largement réduites par la guerre mondiale, ont encore diminué avec les ravages de la guerre civile et par la nécessité de nourrir et de vêtir l'Armée rouge dans son combat contre la contre-révolution. Le fait que cette économie de guerre était hautement centralisée et, dans des conditions de chaos financier, ait en fait perdu toute forme monétaire, a amené à ce qu'on la qualifie de « communisme de guerre », mais cela ne change rien au fait que les nécessités militaires prévalaient de plus en plus sur les buts et les méthodes réels de la révolution prolétarienne. Afin de maintenir sa domination politique collective, la classe ouvrière a besoin d'assurer au moins les besoins matériels fondamentaux de la vie et, en particulier, d'avoir le temps et l'énergie de s'engager dans la vie politique. Mais, nous l'avons déjà vu, à la place, pendant la guerre civile, la classe ouvrière a été réduite à la pénurie absolue, ses meilleurs éléments étant dispersés sur le front ou engloutis dans la bureaucratie croissante du « soviet », sujets à un véritable processus de « déclassement », pendant que d'autres fuyaient à la campagne ou s'essayant pour survivre à des petits trafics et à des vols ; ceux qui restaient dans les usines qui produisaient encore, étaient forcés de faire des journées de travail plus longues que jamais, parfois sous l'oeil vigilant des détachements de l'Armée rouge. C'est volontairement que le prolétariat russe a fait ces sacrifices, mais comme ils n'étaient pas compensés par l'extension de la révolution, ils devaient avoir des effets à long terme profondément dévastateurs, avant tout en sapant la capacité du prolétariat à défendre et maintenir sa dictature sur la société.
Le programme du PCR, comme nous l'avons vu également, reconnaissait le danger de la bureaucratisation croissante pendant cette période et défendait une série de mesures pour la combattre. Mais alors que la partie « politique » du programme est toujours liée à la défense des soviets comme meilleur moyen de maintenir la démocratie prolétarienne, la partie sur les affaires économiques insiste sur le rôle des syndicats, à la fois dans l'organisation de l'économie et dans la défense des travailleurs contre les excès de la bureaucratie : « La participation des syndicats dans la conduite de la vie économique et l'implication à travers eux des grandes masses du peuple dans ce travail apparaissent en même temps être notre principale aide dans la campagne contre la bureaucratisation du pouvoir soviétique. Cela facilitera aussi l'établissement d'un contrôle effectif sur les résultats de la production. »
Que le prolétariat, comme classe politiquement dominante, ait aussi besoin d'exercer un contrôle sur le processus de production, est un axiome et – sur la compréhension que les tâches politiques ne peuvent être subordonnées aux tâches économiques, par-dessus tout dans la période de guerre civile – cela reste vrai dans toutes les phases de la période de transition. Des ouvriers qui ne peuvent « diriger » les usines, seront probablement incapables de prendre le contrôle politique de la société toute entière. Mais ce qui est faux ici, c'est l'idée que les syndicats puissent être l'instrument de cette tâche. Au contraire, par leur nature même, les syndicats étaient bien plus susceptibles d'être atteints par le virus de la bureaucratisation; et ce n'est pas par hasard que l'appareil des syndicats est devenu l'organe d'un Etat de plus en plus bureaucratique au sein des usines, en abolissant ou absorbant les comités d'usine qui avaient été produits par le grand élan révolutionnaire de 1917 et qui étaient donc une expression bien plus directe de la vie de la classe et une bien meilleure base pour résister à la bureaucratie et régénérer le système soviétique dans son ensemble. Mais les comités d'usine ne sont même pas mentionnés dans le programme. Il est certainement vrai que ces comités ont souvent souffert de fausses conceptions localistes et syndicalistes, selon lesquelles chaque usine était vue comme la propriété privée des ouvriers qui y travaillaient : durant les jours désespérés de la guerre civile, de telles idées ont atteint leur sommet dans la pratique des travailleurs troquant leurs « propres » produits contre de la nourriture et du charbon. Mais la réponse à de telles erreurs n'était pas l'absorption de ces comités d'usine dans les syndicats et l'Etat ; c'était d'assurer qu'ils fonctionnent comme organes de la centralisation prolétarienne, en se liant bien plus étroitement aux soviets ouvriers – une possibilité évidente étant donné que la même assemblée d'usine qui élisait des délégués au soviet de la ville, élisait aussi son comité d'usine. A ces observations, il faut ajouter ceci : les difficultés qu'avaient les bolcheviks à comprendre que les syndicats étaient obsolètes comme organes de la classe (un fait confirmé par l'émergence même de la forme soviétique) devaient aussi avoir de graves conséquences dans l'Internationale, en particulier après 1920 où l'influence des communistes russes a été décisive en empêchant l'IC d'adopter une position claire et sans ambiguïté sur les syndicats.
L'agriculture
La démarche fondamentale sur la question paysanne dans le programme avait déjà été soulignée par Engels par rapport à l'Allemagne. Tandis que les fermes capitalistes de grande échelle pouvaient être normalement socialisées très rapidement par le pouvoir prolétarien, il ne serait pas possible de contraindre les petits agriculteurs de rejoindre ce secteur. Il allait falloir les gagner graduellement, avant tout grâce à la capacité du prolétariat à prouver, dans la pratique, la supériorité des méthodes socialistes.
Dans un pays comme la Russie où les rapports pré-capitalistes dominaient encore la majorité de la campagne et où l'expropriation des grands domaines pendant la révolution avait eu pour résultat la division de ceux-ci par les paysans en d'innombrables parcelles, c'était encore plus vrai. La politique du parti ne pouvait donc être que, d'un côté, encourager la lutte de classe entre les paysans pauvres semi-prolétaires et les paysans riches et les capitalistes ruraux, en aidant à la création d'organes spéciaux pour les paysans pauvres et les ouvriers agricoles qui constitueraient le principal support à l'extension et l'approfondissement de la révolution à la campagne ; et, d'un autre côté, établir un modus vivendi avec les paysans petits propriétaires, en les aidant matériellement avec des semailles, des engrais, de la technologie, etc., de sorte à accroître leur rendement et en même temps favoriser des coopératives et des communes comme étapes transitoires vers la collectivisation réelle. « Le parti a pour but de les détacher (les paysans moyens) des riches paysans, de les amener du côté de la classe ouvrière en portant une attention particulière à leurs besoins. Il cherche à surmonter leur arriération en matière culturelle par des mesures à caractère idéologique, évitant soigneusement toute attitude coercitive. Dans toutes les occasions où sont touchés leurs intérêts vitaux, il cherche à arriver à un accord pratique avec eux, en leur faisant des concessions telles qu'elles promeuvent la construction socialiste. » Etant donné la terrible pénurie en Russie immédiatement après l'insurrection, le prolétariat n'était pas en position d'offrir grand chose à ces couches au niveau de l'amélioration matérielle et en fait, sous le communisme de guerre, beaucoup d'abus contre les paysans furent commis pendant la réquisition du grain pour nourrir l'armée et les villes affamées. Mais c'était encore bien loin de la collectivisation stalinienne forcée des années 1930 qui était basée sur l'affirmation monstrueuse que l'expropriation violente de la petite-bourgeoisie (et ceci pour les besoins de l'économie de guerre capitaliste) signifiait la réalisation du socialisme.
La distribution
« Dans la sphère de la distribution, la tâche du pouvoir des soviets aujourd'hui est de continuer sans se tromper à remplacer le commerce par une distribution orientée de biens, par un système de distribution organisé par l'Etat à l'échelle nationale. Le but est de réaliser l'organisation de l'ensemble de la population dans un réseau intégral de communes de consommateurs qui seront capables, avec la plus grande rapidité, détermination, économie et un minimum de dépense de travail de distribuer tous les biens nécessaires, tout en centralisant strictement l'ensemble de l'appareil de distribution. » Les associations coopératives existantes, définies comme « petites bourgeoises », devaient être aussi loin que possible transformées en « communes de consommateurs dirigées par les prolétaires et les semi-prolétaires. » Ce passage traduit toute la grandeur mais aussi les limitations de la révolution russe. La mise en commun de la distribution est une partie intégrante du programme révolutionnaire et cette partie montre à quel point elle était prise au sérieux par les bolcheviks. Mais le véritable progrès qu'ils avaient fait dans ce sens a été grandement exagéré pendant – et en fait à cause de – la période de communisme de guerre. Le communisme de guerre n'était en réalité rien d'autre que la collectivisation de la misère et il a été largement imposé par l'appareil d'Etat qui glissait déjà hors des mains des ouvriers. La fragilité de son fondement devait être prouvée dès que la guerre civile interne fut terminée, quand il y eut un retour rapide et général à l'entreprise privée et au commerce (qui avaient de toutes façons fleuri sous forme de marché noir pendant le communisme de guerre). Il est certainement vrai que, tout comme le prolétariat aura à collectiviser de larges secteurs de l'appareil productif après l'insurrection dans une région du monde, il devra aussi faire de même pour bien des aspects de la distribution. Mais alors que ces mesures peuvent avoir une certaine continuité avec les politiques constructives d'une révolution mondiale victorieuse, elles ne doivent pas être identifiées avec ces dernières. La collectivisation réelle de la distribution dépend de la capacité du nouvel ordre social de « produire des biens » de façon plus efficace que le capitalisme (même si les biens eux-mêmes diffèrent substantiellement). La pénurie matérielle et la pauvreté font le lit de nouveaux rapports marchands ; l'abondance matérielle est la seule base solide pour le développement de la distribution collectivisée et pour une société qui « inscrive sur son drapeau : de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. » (Marx, Critique du Programme de Gotha, 1875)
La monnaie et les banques
Pour l'argent, il en est de même que pour la distribution dont il constitue le véhicule « normal » sous le capitalisme : étant donné l'impossibilité d'installer immédiatement le communisme intégral, encore moins dans les limites d'un seul pays, le prolétariat ne peut que prendre une série de mesures qui tendent vers une société sans argent. Cependant, les illusions du communisme de guerre – durant lequel l'effondrement de l'économie était confondu avec la reconstruction communiste – donnèrent un ton trop optimiste à cette partie et d'autres qui y sont liées. Egalement trop optimiste est la notion que la simple nationalisation des banques et leur fusion dans une banque d'Etat unique constitueraient les premières étapes vers « la disparition des banques et leur conversion en établissement central de comptabilité de la société communiste. » Il est douteux que des organes aussi centraux que ceux où opère le capital, puissent être pris de cette façon, même si la prise physique des banques sera certainement nécessaire comme l'un des premiers coups révolutionnaires pour paralyser le bras du capital.
Les finances
« Durant l'époque où la socialisation des moyens de production confisqués aux capitalistes a commencé, le pouvoir d'Etat cesse d'être un appareil parasitaire nourri sur le processus productif. Alors commence sa transformation en une organisation remplissant directement la fonction d'administrer la vie économique du pays. Dans cette mesure, le budget de l'Etat sera un budget de l'ensemble de l'économie nationale. » A nouveau, les intentions sont louables, mais l'amère expérience devait montrer que dans les conditions de la révolution isolée ou stagnante, même le nouvel Etat-commune devient de plus en plus parasitaire qui se nourrit sur la révolution et la classe ouvrière ; et même dans les meilleures conditions, on ne peut plus supposer que le simple fait de centraliser les finances entre les mains de l'Etat conduise « naturellement » une économie qui a, par le passé, fonctionné sur la base du profit, à en devenir une qui fonctionne sur la base des besoins.
La question du logement
Cette partie sur le programme est plus enracinée dans les nécessités et les possibilités immédiates. Un pouvoir prolétarien victorieux ne peut éviter de prendre des mesures rapides pour soulager les sans-logis et le surpeuplement, comme l'a fait le pouvoir des soviets en 1917 quand il a « complètement exproprié toutes les maisons appartenant aux propriétaires capitalistes et les a remises aux soviets urbains. Il a effectué des installations massives d'ouvriers des faubourgs dans les résidences bourgeoises. Il a remis les meilleurs de ces résidences aux organisations prolétariennes, arrangeant l'entretien de ces maisons, payé par l'Etat ; il a donné du mobilier à des familles prolétariennes, etc. » Mais ici encore, les buts les plus constructifs du programme – la suppression des taudis et la fourniture de logements décents pour tous – sont restés largement irréalisés dans un pays ravagé par la guerre. Et alors que le régime stalinien a plus tard lancé des plans massifs de logement, le résultat cauchemardesque de ces plans (les infâmes immeubles-casernes ouvriers de l'ex-bloc de l'Est) n'apportait certainement pas une solution au « problème du logement ».
Evidemment, la solution à long terme à la question du logement réside dans une transformation totale de l'environnement rural et urbain – dans l'abolition de l'opposition entre la ville et la campagne, la réduction du gigantisme urbain et la distribution rationnelle de la population mondiale sur la terre. Il est clair que de telles transformations grandioses ne peuvent être menées à bien avant la défaite définitive de la bourgeoisie.
La protection du travail et le travail d'assistance sociale
Les mesures immédiates mises en avant ici, étant donné les conditions extrêmes de l'exploitation qui prévalent en Russie, sont simplement l'application des revendications minimum pour lesquelles le mouvement ouvrier a lutté depuis longtemps: journée de 8 heures, allocations d'invalidité et de chômage, congés payés et congés maternité, etc. Et comme l'admet le programme lui-même, beaucoup de ces acquis durent être suspendus ou modifiés à cause des besoins de la guerre civile. Cependant, le document engage le parti à lutter non seulement pour ces « revendications immédiates » mais aussi pour de plus radicales – en particulier, la réduction de la journée de travail à 6 heures de sorte que plus de temps puisse être dédié à des stages de formation, non seulement dans les domaines liés au travail, mais aussi et surtout dans l'administration de l'Etat. C'était crucial puisque, comme nous l'avons noté auparavant, une classe ouvrière épuisée par le travail quotidien n'aura pas le temps ou l'énergie pour l'activité politique et le fonctionnement de l'Etat.
L'hygiène publique
Ici encore il s'agissait de lutter pour des « réformes » qui étaient réclamées depuis longtemps étant donné les terribles conditions d'existence que connaissait le prolétariat russe (maladies liées au logement dans des taudis, hygiène non supervisée et règles de sécurité au travail, etc). Aussi, « le Parti communiste de Russie considère les points suivants comme des tâches immédiates:
1. la poursuite vigoureuse de mesures sanitaires étendues dans l'intérêt des ouvriers, telles que :
a. l'amélioration des conditions sanitaires sur tous les lieux publics, la protection de la terre, de l'eau, de l'air ;
b. l'organisation de cantines communales et d'approvisionnement en nourriture de façon générale sur une base scientifique et hygiénique ;
c. des mesures pour empêcher l'extension des maladies à caractère contagieux ;
d. une législation sanitaire ;
2. une campagne contre les maladies sociales (tuberculose, maladies vénériennes, alcoolisme) ;
3. l'apport gratuit de conseils et de traitement médicaux pour l'ensemble de la population. »
Bien de ces points, apparemment élémentaires, doivent toujours être réalisés dans bien des régions du globe. Si on peut dire quelque chose, c'est que l'étendue du problème s'est considérablement développée. Pour commencer, la bourgeoisie, face au développement de la crise, supprime partout les prestations médicales qui avaient commencé à être considérées comme « normales » dans les pays capitalistes avancés. Deuxièmement, l'aggravation de la décadence du capitalisme a largement amplifié certains problèmes, par dessus tout à travers la destruction « progressive » de l'environnement. Alors que le programme du PCR ne fait que mentionner brièvement la nécessité de « protection de la terre, de l'eau et de l'air », tout programme du futur devra reconnaître quelle énorme tâche cela représente après des décennies d'empoisonnement systématique de « la terre, de l'eau et de l'air ».
CDW.
Nous avons noté que le radicalisme fondamental du programme du PCR était le produit de l'unité de but et de détermination dans le parti bolchevik en 1919 et un reflet des grands espoirs révolutionnaires de ce moment. Dans le prochain article de cette série, nous examinerons un autre effort du parti bolchevik pour comprendre la nature et les tâches de la période de transition, posées, cette fois-ci, d'une façon plus générale et plus théorique. Là encore, l'auteur du texte en question, L'économie de la période de transition, était Nicolas Boukharine.
Conscience et organisation:
- Troisième Internationale [1881]
Approfondir:
Questions théoriques:
- Communisme [492]
Heritage de la Gauche Communiste:
Gauche communiste d'Italie : "Parmi les ombres du bordiguisme et de ses épigones" (Battaglia Comunista)
- 3329 reads
Ceux qui aujourd'hui se posent des questions sur les perspectives révolutionnaires de la classe ouvrière se trouvent confrontés à une importante dispersion du milieu politique prolétarien ([1] [3466]). L'approche de ce milieu politique par les nouvelles forces militantes qui surgissent est entravée par plusieurs facteurs. Il y a d'abord la pression générale des campagnes médiatiques contre le communisme. Il y a ensuite toute la confusion que sèment les courants « gauchistes » de l'appareil politique de la bourgeoisie ainsi que la kyrielle de groupes et publications parasitaires qui ne se réclament du communisme que pour en ridiculiser le contenu et la forme organisationnelle ([2] [3467]). Il y a enfin le fait que les différentes composantes organisées de cette Gauche communiste s'ignorent mutuellement la plupart du temps et répugnent à la nécessaire confrontation publique de leurs positions politiques, que ce soit sur leurs principes programmatiques ou leurs origines organisationnelles. Cette attitude est une entrave à la clarification des positions politiques communistes, à la compréhension de ce que partagent en commun les différentes tendances de ce milieu politique et les divergences qui les opposent et expliquent leur existence organisationnelle séparée. C'est pourquoi nous pensons que tout ce qui va dans le sens de briser cette attitude doit être salué à partir du moment où il s'agit d'une préoccupation politique de clarifier publiquement et sérieusement les positions et analyses des autres organisations.
Cette clarification est d'autant plus importante pour ce qui concerne les groupes qui se présentent comme les héritiers directs de la « Gauche italienne ». Ce courant comporte en effet plusieurs organisations et publications qui se réclament toutes du même tronc commun – le Parti communiste d'Italie des années 1920 (l'opposition la plus conséquente à la dégénérescence stalinienne de l'Internationale communiste) –, et de la même filiation organisationnelle – la constitution du Partito Communista Internazionalista (PCI) en Italie en 1943. Ce PCI de 1943 devait donner naissance à deux tendances en 1952 : d'une part le Partito Communista Internazionalista (PCInt) ({C}[3]{C} [3468]), d'autre part le Partito Communista Internazionale (PCI) ([4] [3469]) animé par Bordiga. Ce dernier s'est disloqué au cours des années pour donner naissance à pas moins de trois principaux groupes qui se dénomment aujourd'hui tous PCI, ainsi qu'à une multitude de petits groupes plus ou moins confidentiels, sans parler des individus qui quasiment tous se présentent comme les « seuls » continuateurs de Bordiga. Et c'est la dénomination de « bordiguisme » qui, du fait de la personnalité et de la notoriété de Bordiga, est souvent utilisée pour qualifier, en fait abusivement, les continuateurs de la gauche italienne.
Le CCI pour sa part, s'il ne se revendique pas du PCI de 1943, se réfère aussi à la Gauche italienne des années 1920, à la Fraction de gauche du Parti communiste d'Italie transformée ensuite en Fraction italienne de la Gauche communiste internationale dans les années 1930, ainsi qu'à la Fraction française de la Gauche communiste qui s'opposa dans les années 1940 à la dissolution de la Fraction italienne dans la formation du dit PCI du fait qu'elle considérait la constitution du parti comme prématurée et confuse. ({C}[5]{C} [3470])
Quelles sont les positions communes et les divergences ? Pourquoi une telle dispersion organisationnelles ? Pourquoi l'existence de tant de « Partis » et groupes issus de la même filiation historique ? Telles sont les questions que tous les groupes sérieux devraient aborder, afin de répondre au besoin de clarté politique qui existe dans la classe ouvrière dans son ensemble et parmi les minorités en recherche qui apparaissent dans la classe.
C'est dans ce sens que nous avons salué les polémiques récentes internes au milieu bordiguiste, avec la tentative, timide mais sérieuse, d'affronter la question des racines politiques de la crise explosive du PCI-Programma Comunista en 1982 (voir Revue internationale n° 93). C'est dans le même sens que nous avons pris position brièvement dans l'article Marxisme et mysticisme de la Revue internationale n° 94 sur le débat entre les deux formations bordiguistes qui publient respectivement Le Prolétaire et Il Partito. Dans ce dernier article, nous montrions que si Le Prolétaire a raison de critiquer le glissement de Il Partito vers le mysticisme, ces idées ne tombent pas du ciel mais ont leur racines chez Bordiga lui même et nous concluions cet article en affirmant donc que « les critiques du Prolétaire doivent aller plus au fond, jusqu'aux racines historiques véritables de ces erreurs et, ce faisant, se réapproprier le riche héritage de l'ensemble de la Gauche Communiste. » Et c'est dans ce sens que nous tenons à saluer la parution il y a quelques mois d'une brochure publiée par Battaglia Communista (BC) sur le bordiguisme, « Parmi les ombres du bordiguisme et de ses épigones », un bilan critique sérieux du bordiguisme de l'après deuxième guerre mondiale et qui se présente d'ailleurs explicitement comme « Une clarification » comme l'indique le surtitre de la brochure.
D'un abord un peu difficile pour qui n'est pas rompu aux positions du bordiguisme et aux divergences qui opposent depuis plus de quarante ans BC à ce courant, cette brochure est néanmoins précieuse pour faire comprendre précisément ces divergences et pour resituer le bordiguisme et ses spécificités dans le cadre bien plus large de la Gauche italienne. ({C}[6]{C} [3471])
Une bonne critique des conceptions du bordiguisme
Nous partageons l'essentiel de l'analyse et de la critique que fait BC des conceptions du bordiguisme du développement historique du capitalisme : « (...) Le risque, en somme, c'est précisément celui de se placer abstraitement face au "développement historique des situations" dont – nous sommes ici d'accord avec Bordiga – "le Parti est en même temps un facteur et un produit", justement parce que les situations historiques ne sont jamais comme de simples photocopies l'une de l'autre, et leur différence doit toujours être estimée de façon matérialiste. »
De même nous souscrivons globalement à la critique de la vision du marxisme et du culte du « chef génial » des épigones de Bordiga ; à celle d'un marxisme « invariant » qui ne souffrirait aucun enrichissement de l'expérience et n'aurait qu'à être « restauré » à partir des seuls textes élaborés par Bordiga :
"La restauration du marxisme est contenue dans les textes élaborés par Bordiga, le seul en mesure – selon ses épigones – d'appliquer la méthode de la Gauche et de fournir le bagage théorique nécessaire. On doit absolument revenir et repartir de ces textes, soutiennent les bordiguistes les plus... intégristes. Non seulement, c'est la continuité de la Gauche qui serait en jeu, mais l'invariance même du marxisme. C'est pour cela que se pose la question de la nécessité suprême de répertorier les oeuvres du Maître pour pouvoir les donner matériellement aux nouveaux camarades, puisque les textes sont épuisés, non réimprimés, ou dispersés. La solution consiste à imprimer des livres qui contiennent toutes les thèses et les "semi-travaux" laissés par Bordiga et à les "éplucher". Pour résumer : la mythification de la pensée de Bordiga dans l'après deuxième guerre mondiale se fonde sur la conviction que ce n'est que dans son travail théorique qu'on a "la restauration" de la science marxiste et la "redécouverte" de la vraie pratique révolutionnaire."
On peut également souligner la validité de la critique que fait BC aux implications de ces conceptions sur l'incapacité de l'organisation à être à la hauteur de la situation : « C'est une vérité matérialiste que le parti aussi est un produit historique, mais il existe le risque de réduire ce principe à une affirmation complètement contemplative, passive, abstraite, de la réalité sociale. Il y a le risque, donc, de retomber encore une fois dans un matérialisme mécaniste, qui n'a en réalité rien de dialectique, qui néglige les liens, les passages des phases que le mouvement accomplit réellement dans son processus au cours de la succession des situations. Il y a le risque de ne pas comprendre les relations qui interfèrent réciproquement dans le développement historique, et donc de réduire la préparation et l'activité du parti à une présence "historique" idéaliste, ou à une apparence "formelle". »
Un point fort de la critique que fait BC au bordiguisme réside dans le fait que BC cherche à aller aux racines des divergences, en revenant sur les diverses positions qui s'étaient déjà faites jour à l'intérieur du vieux Parti Communiste Internationaliste après sa constitution en 1943 et jusqu'en 1952 quand s'est produite la scission entre les bordiguistes d'un côté et les battaglistes de l'autre. A ce propos, il faut noter que BC a fait un effort particulier de documentation et d'analyse de cette phase en publiant deux Quaderni di Battaglia Communista, le n° 6, « Le processus de formation et la Naissance du Parti communiste internationaliste », et le n° 3, « La scission internationaliste de 1952. Documents ».
La richesse de la critique de BC réside aussi dans le fait qu'elle concerne aussi bien les aspects relatifs au fonctionnement et à la structure de l'organisation révolutionnaire qu'aux positions politiques programmatiques que celle ci doit défendre.
Dans la suite de cet article, nous nous limiterons à certains aspects relatifs au premier point, à propos duquel BC développe une critique très forte et très efficace du centralisme organique et du mythe de l'unanimisme théorisés par Bordiga et défendus par ses héritiers politiques.
Centralisme organique et unanimisme dans les décisions
En substance, le centralisme organique, par opposition au centralisme démocratique, correspond à l'idée selon laquelle l'organisation révolutionnaire du prolétariat ne doit pas se soumettre à la logique de l'approbation formelle des décisions par la majorité du parti ; cette logique « démocratique » serait une logique empruntée à la bourgeoisie pour qui la position qui l'emporte est celle qui reçoit le plus de votes, indépendamment du fait de savoir si elle répond ou pas aux attentes et aux perspectives de la classe ouvrière :
« L'adoption et l'emploi général ou partiel du critère de consultation et de délibération sur base numérique et majoritaire, quand il est prévu dans les statuts ou dans la praxis technique, a un caractère de moyen technique ou d'expédient, mais pas un caractère de principe. Les bases de l'organisation du Parti ne peuvent donc recourir à des règles qui sont celles d'autres classes et d'autres dominations historiques, comme l'obéissance hiérarchique des simples soldats aux chefs de différents grades héritée des organismes militaires ou théocratiques prébourgeois, ou la souveraineté abstraite des électeurs de base déléguée à des assemblées représentatives ou à des comités exécutifs, propres à l'hypocrisie juridique, caractéristique du monde capitaliste, la critique et la destruction de telles organisations étant la tâche essentielle de la révolution prolétarienne et communiste » (texte bordiguiste publié par le PCInt en 1949 et reproduit dans la brochure de BC « La scission internationaliste »).
On peut comprendre le souci fondamental qui animait Bordiga quand, avec son retour à la politique active dans l'après-guerre, il cherchait à faire obstacle à l'idéologie envahissante de la bourgeoisie et de la petite bourgeoisie et à l'emprise que celles ci pouvaient facilement avoir sur une génération de militants nouvellement intégrés dans le PCI, inexpérimentés pour la plupart, théoriquement peu formés et même souvent influencés par les idéologies contre-révolutionnaires ({C}[7]{C} [3472]). Le souci peut se comprendre, mais on ne peut pas partager la solution que cherchait à donner Bordiga. BC répond justement :
"Condamner le centralisme démocratique en tant qu'application de la démocratie bourgeoise à l'organisation politique révolutionnaire de classe, c'est avant tout une méthode de discussion comparable à celle utilisée en de nombreuses occasions par le stalinisme », en rappelant comment « Bordiga, à partir de 45, a ridiculisé en plusieurs occasions les "solennelles résolutions des congrès souverains" (et la fondation de Programme Communiste en 1952 a justement son origine dans son mépris envers les deux premiers Congrès du Parti Communiste Internationaliste. »
Naturellement, pour pouvoir réaliser le centralisme organique, il fallait valoriser l'unanimisme, c'est-à-dire que les cadres du parti soient prêts à accepter passivement les directives (organiques !) du centre, en faisant abstraction de leurs divergences, en les cachant, ou tout au plus en les faisant circuler discrètement dans les couloirs des réunions officielles du parti. L'unanimisme est l'autre face de la médaille du centralisme organique. Tout cela s'explique par l'idée – qui a fait son chemin au sein d'une partie consistante du PCInt des années 1940 (celle qui formera la branche de Programme) – selon laquelle Bordiga était le seul capable intellectuellement de résoudre les problèmes qui se posaient au mouvement révolutionnaire d'après-guerre. Citons ce témoignage significatif d'Ottorino Perrone (Vercesi) :
« Le Parti italien est composé dans sa grande majorité, d'éléments nouveaux sans formation théorique et politiquement vierges. Les anciens militants eux-mêmes, sont restés pendant 20 ans isolés, coupés de tout mouvement de la pensée. Dans l'état présent, les militants sont incapables d'aborder les problèmes de la théorie et de l'idéologie. La discussion ne ferait que troubler leur vue et ferait plus de mal que de bien. Ils ont pour le moment besoin de marcher sur la terre ferme, serait-ce même les vieilles positions actuellement périmées, mais déjà formulées et compréhensibles pour eux. Pour le moment, il suffit de grouper les volontés pour l'action. La solution des grands problèmes soulevés par l'expérience d'entre les deux guerres exige le calme de la réflexion. Seul un "grand cerveau" peut les aborder avec profit et donner la réponse qu'ils nécessitent. La discussion générale ne ferait qu'apporter de la confusion. Le travail idéologique n'est pas le fait de la masse des militants mais des individualités. Tant que ces individualités géniales n'auront pas surgi, on ne peut espérer avancer en idéologie. Marx, Lénine étaient ces individualités, ces génialités, dans une période passée. Il faut attendre la venue d'un nouveau Marx. Nous, en Italie, sommes convaincus que Bordiga sera cette génialité. Ce dernier travaille actuellement sur une oeuvre d'ensemble qui contiendra la réponse aux problèmes qui tourmentent les militants de la classe ouvrière. Quand cette oeuvre paraîtra, les militants n'auront qu'à l'assimiler et le Parti à aligner sa politique et son action sur ces nouvelles données. » (tiré de l'article « La conception du chef génial », Internationalisme n° 25, août 47, et reproduit dans la Revue internationale n° 33, 2e trimestre 1983)
Ce témoignage est l'expression globale de toute une conception du parti qui est étrangère à l'héritage du marxisme révolutionnaire dans la mesure où, à la différence des stupidités contre le centralisme démocratique dont on a parlé avant, on introduit vraiment ici une conception bourgeoise de l'avant-garde révolutionnaire. La conscience, la théorie, l'analyse, seraient exclusivement l’œuvre d'une minorité – et même d'un cerveau, d'un seul intellectuel – tandis qu'il ne resterait au parti qu'à attendre les directives du chef (imaginons combien de temps devrait attendre la classe ouvrière qui aurait ce parti pour guide !). Voilà la véritable signification du centralisme organique et du besoin d'unanimisme ({C}[8]{C} [3473]). Mais comment faire cadrer cela avec le fait que Bordiga a été le camarade qui, pour défendre les positions de la minorité, a créé et animé la fraction abstentionniste du PSI, qui a fait la démonstration de son courage et de sa combativité en défendant face à l'Internationale Communiste, les points de vue de son parti et qui, à cause de tout cela, a été l'inspirateur des camarades en exil qui, pendant les années du fascisme en Italie, ont constitué la fraction du PCI, avec pour but, de faire le bilan de la défaite pour former les cadres du futur parti ? Sans problème, il suffit de tirer un trait sur tout cela en disant simplement que la fraction ne sert plus ; maintenant, c'est le chef génial qui résout tout :
« Le Parti considère la formation de fractions et la lutte entre celles-ci au sein d'une organisation politique comme un processus historique que les communistes ont trouvé utile et ont appliqué quand s'était vérifiée une dégénérescence irrémédiable des vieux partis et de leurs directions et que venait à manquer le parti ayant les caractères et fonctions révolutionnaires.
Quand un tel parti s'est formé et agit, il ne renferme pas en son sein de fractions divisées idéologiquement et encore moins organisées. (...) » (Extrait de Note sur les bases de l'organisation du parti de classe, texte bordiguiste publié par le PCInt en 1949 et reproduit dans la brochure de BC, « La scission internationaliste... »)
Rien d'étonnant à ce que, Bordiga disparu, ses héritiers aient fini par se quereller les uns avec les autres, chacun s'agrippant aux dépouilles politiques du grand chef dans la tentative aussi difficile qu'inutile de trouver les réponses aux problèmes qui se posent de façon toujours plus cruciale à l'avant-garde révolutionnaire. Et tout ceci n'a que peu à voir avec le parti compact et puissant vanté par les différentes formations bordiguistes. Nous croyons que les camarades bordiguistes, qui ont montré qu'ils savaient rectifier les erreurs du passé et qui ont une attitude de moins en moins sectaire, devraient se convaincre de revenir sur leur conception du parti, à laquelle ils payent encore aujourd'hui un tribut politique très important.
Les limites de la critique de Battaglia Communista
Comme nous l'avons dit avant, nous estimons comme très valable la prise de position critique formulée par BC et nous sommes d'accord avec une bonne partie des points traités. Il y a cependant un point faible dans la prise de position qui a déjà été souvent l'objet de polémiques entre nos deux organisations et sur lequel il est important que nous arrivions à une clarification. Ce point faible concerne l'analyse de la formation du PCI en 1943, une formation qui, pour nous, a obéi à une logique opportuniste, analyse qu'évidemment BC ne partage pas, ce qui du coup affaiblit grandement sa critique au bordiguisme. Nous ne pouvons pas revenir ici sur chaque aspect du problème, d'ailleurs exposés dans les deux articles récents déjà mentionnés « A l'origine du CCI et du BIPR » ([9] [3474]), mais il est important de rappeler les principaux points :
- Contrairement à ce qu'affirme Battaglia selon qui nous aurions toujours été, de toute façon, opposés à la formation du parti en 1943, rappelons que « lorsqu'en 1942-43, se développent dans le nord de l'Italie de grandes grèves ouvrières conduisant à la chute de Mussolini et à son remplacement par l'amiral pro-alliés, Badoglio, (...) la Fraction estime que, conformément à sa position de toujours, "le cours de la transformation de la Fraction en parti en Italie est ouvert". Sa Conférence d'Août 1943 décide de reprendre le contact avec l'Italie et demande aux militants de se préparer à y retourner dès que possible. » (Revue internationale, n° 90)
- Une fois connues les modalités de construction de ce parti en Italie, modalités qui consistaient à regrouper les camarades du vieux parti de Livourne de 1921, chacun avec son histoire et ses conséquences, sans même la moindre vérification d'une plate-forme commune, jetant à l'eau par là même tout le travail élaboré par la Fraction à l'étranger ({C}[10]{C} [3475]), la Gauche Communiste de France ({C}[11]{C} [3476]) a développé des critiques très fortes que nous partageons sur tous ses points essentiels.
- Cette critique concernait, entre autre, l'intégration dans le parti, de plus à un poste à haute responsabilité, d'un personnage comme Vercesi qui s'était fait exclure de la Fraction pour avoir participé, à la fin de la guerre, au Comité antifasciste de Bruxelles. Vercesi n'avait pas fait la moindre critique de son activité.
- La critique concernait aussi l'intégration, au sein du parti, des éléments de la minorité de la Fraction à l'étranger qui avaient scissionné pour aller faire un travail de propagande politique chez les partisans de la République pendant la guerre d'Espagne en 1936. Ici encore, la critique ne portait pas sur l'intégration de ces éléments dans le parti mais sur le fait qu'elle se réalisait sans qu'il y ait eu une discussion préalable sur leurs erreurs passées.
- Enfin, il y a une critique qui porte sur l'attitude ambiguë qu'a eu le PCI pendant les années de la résistance antifasciste à l'égard des formations partisanes.
Pas mal de critiques que BC porte à la composante bordiguiste du PCI des années 1943-52 sont en fait l'expression de cette union sans principe qui a été à la base de la formation du parti dont étaient pleinement conscients les camarades responsables des deux bords et que la GCF avait dénoncé sans concession ({C}[12]{C} [3477]). L'explosion ultérieure du parti en deux branches, dans une phase de très grande difficulté du fait du reflux des luttes qui avaient éclaté au milieu de la guerre, a été la conséquence logique de la façon opportuniste dont le parti s'était construit.
C'est justement parce que c'est le point faible de sa prise de position que BC fait d'étranges contorsions : parfois, elle minimise ces différences entre les deux tendances du PCI à l'époque ; d'autres fois, elle les fait apparaître au moment de la scission seulement et d'autres fois encore, elle les attribue à la Fraction à l'étranger elle même.
Quand BC minimise le problème, elle donne l'impression qu'avant le PCI il n'y avait rien, qu'il n'y avait pas eu toute l'activité de la Fraction auparavant et de la GCF après, qui ont fourni un travail énorme de réflexion et des premières conclusions importantes :
« Quand on reconsidère tous ces événements, il faut avoir présent à l'esprit la courte, mais intense, période historique dans laquelle s'est réalisée la constitution du PC Internationaliste: il était entre autre inévitable, après presque deux décennies de dispersion et d'isolement des cadres de la Gauche Italienne survivants, que se fassent jour quelques dissensions internes, fondées pour la plupart sur des malentendus et sur des bilans différents des expériences personnelles et locales. » (Quaderno di Battaglia Communista n° 3, La scissione internazionalista)
Quand BC fait apparaître les divergences au moment de la scission seulement, elle commet tout simplement un faux historique tendant à dissimuler la responsabilité qu'ont eue ses ancêtres politiques en visant de façon opportuniste à gonfler le plus possible le parti de militants :
« Ce qui est arrivé en 1951-52 a justement eu lieu dans la période dans laquelle certaines caractéristiques les plus négatives de cette tendance – qui aurait continué à causer d'autres dommages, notamment grâce aux soins des épigones – se manifestaient pour la première fois. » (Ibid., souligné par nous)
Quand enfin, BC attribue à la Fraction les divergences qui se seraient ensuite manifestées dans le Parti, elle démontre seulement qu'elle n'a pas compris la différence entre les tâches de la Fraction et celles du Parti. La tâche de la Fraction, c'est celle de faire un bilan à partir d'une défaite historique et de préparer de cette façon les cadres du futur parti. Il est normal que dans ce bilan s'expriment des points de vue différents et c'est justement pour cela que Bilan défendait l'idée que, dans le débat interne, la critique la plus large possible soit faite sans aucun ostracisme. La tâche du Parti c'est, au contraire, d'assumer, sur la base d'une plate-forme et d'un programme clairs et admis par tous, la direction politique des luttes ouvrières dans un moment décisif des affrontements de classe, de telle façon qu'il s'établisse une osmose entre le parti et la classe, un rapport dans lequel le parti est reconnu comme tel par sa classe : « Mais dans la Fraction avant et dans le Parti ensuite cohabitaient deux états d'esprit que la victoire définitive de la contre-révolution (...) devaient amener à se séparer. » (Ibid.)
C'est justement l'incompréhension de ce qu'est la fonction de la Fraction par rapport à celle du Parti qui a conduit BC (comme par ailleurs, Programma lui même avec ses différentes scissions successives) à garder les attributs de Parti à son organisation, alors même que la poussée ouvrière après 1945 s'était complètement epuisée et qu'il fallait alors reprendre le travail patient, mais non moins absorbant, d'achèvement du bilan des défaites et de formation des futurs cadres. A ce propos, malgré la fausseté de certains arguments donnés par Vercesi lui-même et par d'autres éléments de l'aile bordiguiste, BC ne peut pas interpréter comme étant liquidationniste l'idée selon laquelle, la situation historique ayant changé, on doive retourner à un travail de fraction :
« C'étaient les premiers pas qui auraient ensuite amené certains à envisager la démobilisation du parti, la suppression de l'organisation révolutionnaire et le renoncement à tout contact avec les masses, en remplaçant la fonction et la responsabilité militante du parti par la vie de fraction, de cercle qui fait l'école du marxisme. » (Ibid.)
Au contraire, c'est précisément la formation du parti et la prétention de pouvoir développer un travail de parti quand objectivement les conditions n'existent pas, qui a poussé et pousse Battaglia à faire quelques pas vers l'opportunisme, comme nous l'avons mis en évidence récemment dans un article paru dans notre presse territoriale à propos de l'intervention de ce groupe vis à vis des GLP, une formation politique qui est issue de l'aire de l'autonomie :
« Honnêtement, notre crainte c'est que BC, au lieu de jouer son rôle de direction politique vis-à-vis de ces groupes en les poussant à une clarification et à une cohérence politique, tende par opportunisme à s'adapter à leur activisme, en fermant les yeux sur leurs dérapages politiques, courant ainsi le risque sérieux d'être entraînée elle même dans la dynamique gauchiste dont les GLP sont porteurs. » ({C}[13]{C} [3478])
C'est une chose grave parce que, mis à part le danger de glissements vers le gauchisme, BC en arrive à limiter son intervention en réduisant son rôle à celui d'un groupe local avec une intervention parmi les étudiants et les autonomes. BC a au contraire un rôle d'importance primordiale à jouer autant dans la dynamique actuelle du camp prolétarien que pour son propre développement et celui du BIPR.
5 septembre 1998, Ezechiele
[1] [3479]. Comme nous l'avons déjà développé à plusieurs reprises dans notre presse, ce que nous entendons par milieu politique prolétarien est la mouvance qui comprend ceux qui se réclament ou se rapprochent des positions de la Gauche communiste. Parce qu'elle est constituée des groupes et organisations qui ont été capables de maintenir les principes de l'internationalisme prolétarien dans et depuis la seconde guerre mondiale, et qui ont toujours combattu le caractère contre-révolutionnaire du stalinisme et de la gauche du capital, la Gauche communiste, avec ceux qui en reprennent les principes et se rattachent à cette tradition, est le seul milieu politique authentiquement prolétarien.
{C}[2]{C} [3480]. Voir Revue internationale n° 95, « Thèses sur le parasitisme ».
{C}[3]{C} [3481]. C'est ce groupe qui publie Prometeo et Battaglia Comunista qui a formé dans les années 1980 le Bureau International pour le Parti Révolutionnaire (BIPR) avec la Communist Workers Organisation de Grande-Bretagne.
[4] [3482]. L'organe théorique du PCI était Programma comunista en Italie et Programme communiste en France, pour les pays où il était le plus fortement représenté.
{C}[5]{C} [3483]. Voir Polémique : à l'origine du CCI et du BIPR, « La Fraction italienne et la Gauche communiste de France », Revue internationale n° 90, 3e trim. 1997, « La formation du Partito Comunista Internazionalista », n° 91, 4e trim. 1997.
Les différents groupes bordiguistes présentent cette bizarrerie de tous s'appeler Partito Communista Internazionale. Pour les différencier nous les désignerons donc par le périodique le plus connu publié par chacun à l'échelle internationale, même quand ces groupes sont présents dans plusieurs pays. Nous parlerons donc de Le Prolétaire (qui publie aussi Il Comunista en Italie), de Il Partito (qui publie sous le même nom), de Programma Communista (italien, à ne pas confondre avec Programme Communiste en français).
[6] [3484]. La brochure existe actuellement en italien, elle sera disponible en français fin 1998, et l'an prochain en anglais.
{C}[7]{C} [3485]. Voir à ce propos le passage suivant tiré d'une lettre au Comité Exécutif de mars 1951 (nous sommes en pleine phase de scission) signée par Bottaïoli, Stefanini, Lecci et Damen : « dans la presse du parti reviennent souvent des formulations théoriques, des indications politiques et des justifications pratiques qui manifestent la détermination du CE de faire des cadres du parti, organisationnellement peu sûrs et politiquement non préparés, des espèces de cobayes pour des expériences de dilettantisme politique qui n'a rien à voir avec la politique d'une avant-garde révolutionnaire. » (souligné par nous)
[8] [3486]. La vision alternative au centralisme organique n'est naturellement pas l'anarchisme, la recherche obsessionnelle de la liberté individuelle, le manque de discipline, mais assumer sa responsabilité militante dans les débats de l'organisation révolutionnaire et de la classe, tout en appliquant les orientations et décisions de l'organisation une fois qu'elles ont été adoptées.
{C}[9]{C} [3487]. Voir également les polémiques plus anciennes sur ce thème : « Le parti défiguré: la conception bordiguiste », Revue internationale n° 23, « Contre la conception du chef génial », n° 33, « La discipline... force principale... », n° 34.
{C}[10]{C} [3488]. Sur le niveau extrêmement peu qualifié des cadres de ce parti, nous avons déjà cité au début de cet article les témoignages de la composante Battaglia comme de celle Programma.
{C}[11]{C} [3489]. La Gauche communiste de France se constitue selon les enseignements de la Fraction italienne en 1942, prenant initialement le nom de Noyau français de la Gauche communiste.
{C}[12]{C} [3490]. Voila comment s'exprime sur cette question le groupe bordiguiste Le Prolétaire dans un article dédié lui aussi à la scission de 1952 : « Un autre point de désaccord a été la façon de concevoir le processus de formation du Parti en tant que tel comme un processus d'"aggrégation" de noyaux d'origine disparate et dont les lacunes devaient se compenser mutuellement (c'était notamment la fameuse tentative de "regroupement à quatre" – quadrifolio – par la fusion de groupes différents, trotskistes y compris, qui connut par la suite de nombreuses rééditions, toujours infructueuses, avant de s'incarner dans la formule du "Buro", etc.). » Tiré de « La portée de la scission de 1952 dans le Partito Communista Internazionalista », in: Programme Communiste n° 93, mars 1993.
[13] [3491]. Voir l'article « Les "Groupes de Lutte prolétarienne" : une tentative inachevée pour atteindre une cohérence révolutionnaire », Rivoluzione Internazionale n° 106, à paraître dans un prochain n° de Révolution internationale.
Conscience et organisation:
- La Gauche Italienne [3492]
Courants politiques:
- Bordiguisme [1287]
Revue Int. 1999 - 96 à 99
- 4384 reads
Revue Internationale no 96 - 1e trimestre 1999
- 3409 reads
Crise économique : toujours plus profond dans l'abime
- 3311 reads
La plongée dans une récession ouverte qui sera encore plus profonde que les précédentes ‑ certains parlent même de «dépression» - est en train de faire taire les discours sur une croissance économique durable promise par les «experts». Selon ces derniers, l’effondrement en cascade des pays du sud-est asiatique à partir de l’été 1997 n’aurait dû être qu’un accroc sans grande conséquence pour l’économie des pays développés. Depuis, de la Russie au Brésil, du Venezuela au Japon, «l’heure est aux révisions déchirantes» et c’est bien une lame de fond qui vient frapper au coeur même des grandes puissances capitalistes.
Entre juillet et décembre 1998, 3500 millards de dollars au bas mot sont partis en fumée dans l’effondrement des Bourses, une perte sèche dont la moitié pour les Etats-Unis, le reste en Europe et en Asie, l’équivalent de 12 % de la production annuelle mondiale. Au Japon l’Etat décide d’injecter 520 milliards de dollars «dans ses banques pour les sauver du naufrage et ranimer la seconde économie du monde.» Partout «les analystes revoient brutalement à la baisse les prévisions de bénéfices des entreprises, tandis que sont annoncés les premiers plans de licenciements massifs.» Les auto-congratulations autour du lancement de l’Euro ont du mal à cacher la profonde inquiétude des bourgeoisies des pays d’Europe de l’ouest qui parlent de moins en moins d’une Europe «à l’abri» des turbulences de la crise mondiale. Partout «on peut se demander si la croissance de 2 % pour 1999, initialement jugée trop basse, ne s’avèrera pas au contraire difficile à réaliser.»
Tout cela serait risible si les premiers à faire les frais de cette nouvelle accélération dramatique de la crise économique n’étaient pas des centaines de millions de travailleurs, de chômeurs et de sans-travail qui vont être plongés dans une misère grandissante sans perspective de sortie. Après le continent africain quasiment laissé à l’abandon, en proie aux ravages des famines, des massacres et des guerres «locales» à répétition, c’est au tour des pays de l’Asie du sud-est d’être entraînés les uns après les autres dans la spirale d’une décomposition sociale qui emporte tout sur son passage. Aux Etats-Unis, les pertes boursières frappent directement des millions d’ouvriers dont l’épargne et les fonds de retraite sont placés en Bourse. Dans les pays développés, derrière les discours qui se veulent rassurants, la classe dominante déchaîne de nouvelles attaques contre les conditions d’existence de la classe ouvrière : baisses des salaires et de toutes les formes d’allocations de ressources, «flexibilité», licenciements et «réductions d’effectifs», coupes sombres dans les budgets de santé, de logement, d’éducation ; la liste est longue des mesures tous azimuts que la bourgeoisie concocte dans tous les pays «démocratiques» pour tenter de sauvegarder ses profits face à la tourmente financière mondiale.
Ce qui se passe n’est ni une «purge salutaire», ni un «réajustement» face aux excès de la spéculation qu’il suffirait de réguler pour éviter la catastrophe. La spéculation débridée n’est que la conséquence de l’impasse de l’économie mondiale. Elle résulte de l’impossibilité de contrecarrer le rétrécissement toujours plus important du marché mondial et la baisse des taux de profit. Dans une guerre commerciale sans merci entre capitalistes de tous bords et de tous horizons, les capitaux qu’il est impossible de placer dans des investissements productifs sans risquer des pertes certaines, du fait de l’insuffisance des marchés solvables, se réfugient dans des placements financiers d’autant plus hasardeux qu’ils ne correspondent à aucune production dans l’économie réelle et reposent simplement sur un endettement massif et généralisé. La retentissante faillite du fond de pension américain Long Term Capital Management en est une illustration éclatante : «Alors que ce fond spéculatif n’avait que 4,7 milliards de dollars de capital, il s’est endetté à hauteur de 100 milliards de dollars et, selon certaines estimations, ses engagements sur le marché représentent en tout plus de 1300 milliards de dollars, soit à peu près la valeur du PIB de la France ! Des engagements vertigineux dans lesquels sont impliqués tous les grands de la finance mondiale.» Il s’agit certes là d’une spéculation débridée, mais ce que ne disent pas ceux qui soudain s’insurgent contre de «telles pratiques», c’est surtout qu’il s’agit du fonctionnement «normal» du capitalisme aujourd’hui. «Tous les grands de la finance mondiale» - les banques, les entreprises, les institutions financières privées et étatiques - procèdent de la même manière, suivant des directives des Etats qui fixent les règles du jeu et des organismes internationaux tels que la Banque mondiale, le FMI, l’OCDE et autres, qui fournissent les «analyses» ainsi que les «conseils» en placements lucratifs, «conseils» qu’on peut surtout résumer en un leitmotiv lancinant : pressurer, comprimer, réduire le prix de la force de travail par tous les moyens !
Avec la catastrophe au coeur du monde industrialisé, les «experts» semblent soudain découvrir les méfaits du «moins d’Etat» et de la «mondialisation» qui ont été depuis près de vingt ans les thèmes de la propagande pour un capitalisme «libre, riche et prospère». La classe ouvrière a pendant ces mêmes vingt années appris à ses dépens ce qu’il en était de cette propagande : une mystification pour justifier les attaques contre les conditions d’existence des salariés en même temps qu’une multiplication de mesures destinées à maintenir la compétitivité de chaque capital national face à ses concurrents dans la guerre économique. Outre sa fonction anti-ouvrière, la défense du «moins d’Etat» et de la «mondialisation» a surtout été une arme des plus puissants contre les plus faibles. Le «moins d’Etat» et la dénonciation du protectionnisme prônés par la bourgeoisie nord-américaine n’a pas empêché cette dernière d’accroître de 20 à 35 % la part des importations que les Etats-Unis soumettent à un contrôle draconien, ceci au nom de la «sécurité», de la «pollution», ou de n’importe quel autre alibi destiné à masquer... son propre protectionnisme. Si l’Etat s’est débarrassé de toutes une série de responsabilités dans la gestion des entreprises, par le biais des privatisations, cela ne signifie pas pour autant qu’il ait abandonné ses prérogatives de contrôle politique du capital national ou que le cadre de la gestion économique capitaliste ait dépassé les frontières nationales. Bien au contraire, le «moins d’Etat» n’a été que la forme de la nécessaire adaptation pour chaque capital national à l’intensification de la guerre économique, guerre dans laquelle l’Etat garde toujours plus le rôle principal, main dans la main avec les grandes entreprises ; la «mondialisation» n’a été que l’imposition de règles du jeu de cette guerre économique par les plus grandes puissances capitalistes pour avoir au maximum les coudées franches pour piller leurs rivaux sur le champ de bataille du marché mondial. Aujourd’hui le «plus d’Etat» fait un retour en force dans la propagande de la bourgeoisie, en particulier de la part de tous les gouvernements social-démocrates installés en Europe de l’ouest, parce que la nouvelle accélération de l’inexorable faillite du capitalisme mondial remet au premier plan cruement les besoins élémentaires du capital : resserrer les rangs autour de chaque capital national pour faire face à la concurrence, attaquer les conditions d’existence de la classe ouvrière.
Après trente ans de descente dans l’abîme de la crise économique, dont nous rappelons les caractéristiques et les principaux moments d’accélération des années 1970 dans l’article qui suit, aujourd’hui l’«ordre économique» mondial vacille au centre du capitalisme. Derrière la solidarité internationale manifestée pour affronter la «crise asiatique», derrière la volonté commune affichée pour «repenser le système monétaire international» ou pour «réinventer un nouveau Bretton Woods», les bourgeoisies des principaux pays industrialisés sont en fait entraînées dans un «chacun pour soi» toujours plus aigu, un renforcement considérable du capitalisme d’Etat comme politique de défense déterminée de chaque capital national, et dont la classe ouvrière est la principale cible dans tous les pays, une fuite en avant dans la guerre de tous contre tous comme en témoigne l’intensification des tensions impérialistes, ce que nous abordons également dans ce numéro.
MG, 4 janvier 1999
Sources : Le Monde, Economie, «Comment réinventer Bretton-Woods ?», octobre 1998 ; L’Expansion (www.lexpansion.com [3493]) décembre 1998, Banque Mondiale (www.worldbank.org [3494]) décembre 1998, Le Monde Diplomatique, «Anatomie de la crise financière», novembre-décembre 1998.
Récent et en cours:
- Crise économique [28]
Heritage de la Gauche Communiste:
Crise économique : trente ans de crise ouverte du capitalisme (I. les années 1970)
- 5054 reads
Le capitalisme a subi depuis trente ans de nombreuses convulsions économiques qui ont systématiquement démenti les discours de la classe dominante vantant la «bonne santé» et la pérennité de son système d’exploitation. Nous nous bornerons à rappeler entre autres les récessions de 1974-75, de 1980-82, celle particulièrement sévère de 1991-93 ainsi que les cataclysmes boursiers en octobre 1987 et l’effet « Tequila » au Mexique en 1994. La série de catastrophes économiques qui s’accumulent depuis août 1997, avec l’effondrement de la monnaie thaïlandaise, la débâcle des « tigres » et des « dragons » asiatiques, la purge brutale des bourses mondiales, la banqueroute en Russie, la situation extrêmement délicate au Brésil et dans d’autres pays « émergents » d’Amérique Latine et surtout l’état gravissime dans lequel se trouve le Japon (2e puissance mondiale) sont à ce jour l’événement le plus grave de la crise historique du capitalisme et l’éclatante confirmation de l’analyse marxiste, mettant en évidence la nécessité objective de la destruction du capitalisme et de la révolution prolétarienne mondiale.
Ceci dit, il faut aussi remarquer que durant ces trente dernières années, la forme qu’a revêtu cette crise n’a pas été, en particulier dans les grands pays industrialisés, celle d’une dépression brutale comme ce fut le cas pendant les années 1930. Nous avons assisté dans ces pays à une chute lente et progressive, à une descente petit à petit aux enfers du chômage et de la misère, alors que les effets majeurs se concentraient dans la majorité des pays de la « périphérie » : l’Afrique, l’Amérique du Sud, l’Asie, qui se sont irrémédiablement enfoncés dans la barbarie et la décomposition, dans le marasme absolu.
Pour la bourgeoisie des grands pays industrialisés, cette forme inédite de la crise historique du capitalisme a présenté l’avantage de masquer l’agonie du capitalisme en créant l’illusion que les convulsions n’étaient que passagères et correspondaient à des crises cycliques, comme il y en avait au siècle dernier, suivies de période de développement général intensif.
Pour contribuer à la lutte contre ces mystifications, nous publions une analyse de l’évolution du capitalisme ces trente dernières années qui met en évidence d’une part que ce rythme lent et progressif de la crise est le fait d’une «gestion» des Etats basée sur des tricheries quant aux propres lois du système capitaliste (en particulier le recours à un endettement astronomique, à un niveau jamais vu dans l’histoire de l’humanité) et d’autre part que de telles politiques ne contiennent pas la moindre solution à la maladie mortelle du capitalisme. Elles ne peuvent tout au plus que retarder ses manifestations les plus catastrophiques dans les pays développés, au prix de rendre les contradictions encore plus explosives et d’aggraver davantage encore le cancer incurable dont est frappé le capitalisme mondial.
Effondrement ou écroulement progressif ?
Le marxisme a clairement démontré que le capitalisme n’a pas de solution à sa crise historique, laquelle est à l’ordre du jour depuis la première guerre mondiale. Cependant, la forme et les causes de cette crise ont toujours été l’objet de débats entre les révolutionnaires de la Gauche communiste [1] [3495]. La forme est-elle celle d’une dépression déflationniste comme l’était celle des crises cycliques de la période ascendante, entre 1820 et 1913, ou au contraire est-elle celle d’un processus progressif de dégénérescence au cours duquel s’écroule toute l’économie mondiale, dans un état toujours plus critique d’épuisement et de décomposition ?
Au cours des années 1920, quelques tendances du KAPD avaient soutenu la « théorie de l’effondrement » selon laquelle la crise historique du capitalisme devait prendre la forme d’un effondrement brutal et irréversible qui mettrait le prolétariat dans les conditions nécessaires pour faire la révolution. On retrouve d’ailleurs cette vision chez certains courants bordiguistes pour lesquels la forme subite de la crise mettrait le prolétariat au pied du mur de l’action révolutionnaire.
Nous ne ferons pas dans cet article l’analyse détaillée de cette théorie. Nous voulons cependant mettre en évidence que cette vision a été réfutée, tant économiquement que politiquement, par la réalité même de l’évolution du capitalisme depuis 1914. Cette expérience historique a confirmé que la bourgeoisie était capable de faire l’impossible pour éviter l’effondrement brutal de son système de production. La question du dénouement de la crise historique du capitalisme n’est pas strictement économique mais essentiellement politique, conditionnée par l’évolution de la lutte de classe :
– ou bien le prolétariat est capable de développer ses combats jusqu’à l’affirmation de sa dictature révolutionnaire qui libérera l’humanité du marasme actuel et la conduira au communisme, comme nouveau mode de production capable de résoudre et de dépasser les contradictions insolubles dans le capitalisme,
– ou alors la survie de ce système plonge l’humanité dans la barbarie et la destruction définitive que ce soit par la guerre mondiale généralisée ou par une agonie sans fin, celle d’une décomposition progressive et systématique [2] [3496].
La bourgeoisie répond à la crise permanente de son système par la tendance universelle au capitalisme d’Etat. Le capitalisme d’Etat n’est pas qu’une réponse économique. Elle est aussi et surtout une réponse politique tant en ce qui concerne la nécessité de mener à bien la guerre impérialiste qu’en ce qui concerne celle d’affronter le prolétariat. Mais du seul point de vue économique, le capitalisme d’Etat est moins une tentative de dépasser cette crise que de l’accompagner et de la ralentir [3] [3497].
La dépression violente de 1929 a montré à la bourgeoisie, sur le plan économique, les graves dangers contenus par sa crise historique, comme la vague révolutionnaire internationale du prolétariat en 1917-23 lui avait montré, sur le plan politique, la gigantesque menace constituée par la classe révolutionnaire, le prolétariat. La bourgeoisie a réagi sur les deux fronts, en développant l’Etat totalitaire comme rempart autant contre la menace prolétarienne que pour faire face aux contradictions de son système d’exploitation.
Au cours de ces trente dernières années marquées tant par la réapparition de la crise ouverte du capitalisme que par la reprise de la lutte du prolétariat, nous avons vu la bourgeoisie perfectionner et généraliser ses mécanismes étatiques de palliatifs à la crise économique afin d’éviter une explosion brutale et incontrôlable de celle-ci, au moins dans les grandes concentrations industrielles d’Europe, d’Amérique du Nord et du Japon, là où se situe le coeur du capitalisme, le centre des enjeux historiques. [4] [3498]
La bourgeoisie utilise les plus incroyables tricheries par rapport aux lois économiques de son système pour éviter que ne se répète l’expérience douloureuse de 1929, avec une chute catastrophique de 30 % en moins de trois ans de la production mondiale et une explosion du chômage de 4 % à 28 % dans le même laps de temps. Non seulement elle ressasse des campagnes idéologiques pour tenter de cacher la gravité de la crise et ses causes véritables, mais elle a en outre recours à tous les artifices de sa «politique économique» pour maintenir l’apparence d’un édifice économique qui fonctionne, progresse et serait même susceptible de porter quelques perspectives... radieuses.
Le CCI l’a affirmé clairement dès sa constitution : «A certains moments, la convergence de plusieurs de ces points peut provoquer une dépression importante dans certains pays, tels que l’Angleterre, l’Italie, le Portugal ou l’Espagne. C’est une éventualité que nous ne nions pas. Toutefois, bien qu’un tel désastre ébranle irréparablement l’économie mondiale (les investissements et actions britanniques à l’étranger comptent à eux seuls pour 20 milliards de dollars), le système capitaliste mondial pourra encore se maintenir, tant que sera assuré un minimum de production dans certains pays avancés tels que les USA, l’Allemagne, le Japon ou les pays de l’Est. De tels événements tendent évidemment à porter atteinte au système tout entier, et les crises sont inévitablement aujourd’hui des crises mondiales. Mais pour les raisons que nous avons exposées plus haut, nous avons lieu de croire que la crise sera étalée, avec des convulsions, en dents de scie, mais son mouvement ressemblera plus au mouvement rebondissant d’une balle qu’à une chute brutale et soudaine. Même l’effondrement d’une économie nationale ne signifierait pas nécessairement que tous les capitalistes en faillite vont aller se pendre, comme le disait Rosa Luxemburg dans un contexte légèrement différent. Pour qu’une telle chose arrive, il faut que la personnification du capital national, l’Etat, soit détruit : il ne le sera que par le prolétariat révolutionnaire.» [5] [3499]
Dans le même ordre d’idées, après les violentes secousses économiques des années 1980, nous affirmions : « ... la machine capitaliste ne s’est pas réellement effondrée. Malgré des records historiques de faillites, malgré des craquements de plus en plus puissants et fréquents, la machine à profits continue de tourner, concentrant de nouvelles fortunes gigantesques – produit du carnage auquel se livrent les capitaux entre eux – et affirmant une arrogance cynique sur les bienfaits des lois du "libéralisme mercantile". » [6] [3500]
En tout état de cause, la crise reste le meilleur allié du prolétariat pour l’accomplissement de sa mission révolutionnaire. Mais elle ne l’est pas de façon spontanée ou mécanique. Elle l’est à travers un processus de développement de ses luttes et de sa conscience. Elle reste cet allié à condition que le prolétariat développe une réflexion sur ses causes profondes et si les organisations révolutionnaires poursuivent leur combat tenace et obstiné pour montrer la réalité de l’agonie du capitalisme, dénonçant toutes les tentatives du capitalisme d’Etat pour retarder les effets de la crise, la ralentir, la masquer, la déplacer des centres névralgiques du capitalisme mondial vers des régions plus périphériques dans lesquelles le prolétariat est plus faible.
La «gestion de la crise»
L’accompagnement de la crise ou, pour employer les termes du rapport de notre dernier Congrès international [7] [3501], la «gestion de la crise» est la manière dont le capitalisme a répondu à la réapparition de la forme ouverte de sa crise historique depuis 1967. Cette «gestion de la crise» est la clé pour comprendre tant le cours de l’évolution économique de ces trois dernières décennies que les succès obtenus par la bourgeoisie dans son entreprise pour aveugler le prolétariat quant à l’ampleur et à la gravité de la crise.
Cette politique constitue l’expression la plus achevée de la tendance historique générale au capitalisme d’Etat. En réalité, les Etats occidentaux ont développé de façon progressive, durant cette période, toute une politique de manipulation de la loi de la valeur, d’endettement massif et généralisé, d’intervention autoritaire de leur part sur les agents économiques et les processus de production, de tricheries systématiques sur les monnaies, sur le commerce extérieur et la dette publique; politique à côté de laquelle les méthodes de planification étatique des bureaucrates staliniens n’étaient que des jeux d’enfant. Toutes les fanfaronnades des bourgeoisies occidentales sur «l’économie de marché», le «libre jeu des forces économiques», la «supériorité du libéralisme» etc., ne sont qu’une gigantesque mystification. Comme l’a affirmé la Gauche communiste, deux systèmes économiques ne coexistent pas côte à côte depuis 70 ans, celui de « l’économie planifiée » et celui de « l’économie libre »; il n’existe qu’un seul système, le capitalisme, qui dans sa lente agonie est soutenu par l’intervention toujours plus hégémonique et totalitaire de l’Etat.
Cette intervention de l’Etat pour accompagner la crise, s’adapter à elle pour la ralentir et si possible en retarder les effets a permis aux grandes puissances industrielles d’éviter un effondrement brutal, une débâcle générale de l’appareil économique. Elle n’est cependant parvenue ni à trouver une solution à la crise, ni à résoudre ne serait-ce que quelques-unes de ses expressions les plus aiguës comme le chômage et l’inflation. Trente années de ces politiques de palliatifs à la crise n’ont permis qu’une espèce de descente accompagnée au fond de l’abîme, comme une chute planifiée dont l’unique résultat réel est de prolonger la domination de son système avec son cortège de souffrances, d’incertitude et de désespoir pour la classe ouvrière et pour l’immense majorité de la population mondiale. Pour sa part, la classe ouvrière des grands centres industriels a été soumise à une politique systématique d’attaques graduelles et successives contre son pouvoir d’achat, ses conditions de vie, ses salaires, ses emplois, sa survie même. Quant à la grande majorité de la population mondiale, celle qui survit misérablement et agonise dans l’énorme périphérie qui entoure les centres vitaux du capitalisme, elle n’a connu, pour l’essentiel, que la barbarie croissante, la famine et la mort, à un niveau tel qu’on peut aujourd’hui parler du plus gigantesque génocide que l’humanité ait jamais connu.
Cette politique est cependant la seule possible pour l’ensemble du capitalisme mondial, la seule à pouvoir le maintenir en vie même s’il lui faut pour cela précipiter dans l’abîme des parties toujours plus importantes de sa propre structure économique. Les Etats les plus puissants du point de vue impérialiste, économique mais également décisifs en ce qui concerne la lutte de classe concentrent tous leurs efforts afin d’exporter la crise sur les pays plus faibles, qui ont moins de recours face à ses effets dévastateurs et dans lesquels s’exerce moins le poids direct du prolétariat et de ses combats de classe. C’est ainsi que dans les années 1970-80 se sont effondrés la plupart des pays d’Afrique, une bonne partie de l’Amérique du Sud et toute une série de pays asiatiques. Dans les années 1990, cela a été le tour des pays d’Europe de l’Est, de l’Asie centrale etc., qui étaient jusque là sous la férule de ce géant aux pieds d’argile nommé Russie. Aujourd’hui c’est celui des anciens « dragons » et autres « tigres » asiatiques qui connaissent la plus brutale chute de l’économie qu’on ait connue depuis 80 ans.
Nous avons entendu beaucoup de bavardages d’hommes politiques, de syndicalistes, de soi-disant experts en «modèles économiques», les «politiques économiques appropriées» et les «solutions à la crise». Tout au long de ces trente dernières années, la froide réalité de la crise a réduit les discours de ces «savants» à ce qu’ils sont : d’insondables stupidités ou de vulgaires embrouilles de prestidigitateur. Le fameux «modèle japonais» est aujourd’hui retiré des catalogues de propagande; le «modèle allemand» a discrètement été rangé dans l’armoire à souvenirs; quant au disque rayé des «succès» des «tigres» et des «dragons» asiatiques, il a disparu précipitamment du hit-parade idéologique. Pratiquement, la seule politique possible des gouvernements, qu’ils soient de gauche ou de droite, totalitaires ou démocratiques, libéraux ou interventionnistes, est celle qui consiste à gérer la crise et à l’accompagner dans une descente aux enfers graduelle et le plus possible planifiée.
Cependant cette politique ne peut avoir pour effet de figer le capitalisme mondial dans une espèce de point mort, de situation statique dans laquelle pourraient être contenues et limitées éternellement les contradictions brutales du système d’exploitation. C’est la nature même du capitalisme qui rend cette «stabilité» impossible ; c’est sa propre dynamique qui le pousse sans cesse à chercher à accumuler toujours plus de capital, à faire qu’au sein de la classe capitaliste la concurrence et la lutte pour le partage du marché mondial ne peuvent cesser d’exister. De ce fait, la politique de ralentissement et de palliatifs à la crise a comme effet pervers de rendre plus violentes encore les contradictions du capitalisme. Si les «succès» des politiques économiques de ces dernières trente années ont été de différer en partie les effets de la crise, la bombe est à retardement et devient de plus en plus explosive, plus dangereuse et plus destructrice :
– trente années d’endettement ont conduit à une fragilisation générale des mécanismes financiers qui rend bien plus difficile et risquée la poursuite de leur utilisation ;
– trente années de surproduction généralisée ont provoqué l’effondrement de pans entiers des appareils industriel et agricole au niveau mondial, ce qui réduit les marchés et aggrave d’autant cette surproduction ;
– trente années d’étalement et de dosage du chômage ont rendu aujourd’hui celui-ci beaucoup plus dramatique, imposant une politique sans fin de licenciements, de mesures de précarisation du travail, de sous-emploi etc.
Les tricheries du capitalisme avec ses propres lois économiques ont fait que la crise n’a pas pris la forme d’un effondrement soudain de la production comme ce fut le cas lors des crises cycliques du capitalisme ascendant au siècle dernier ou encore lors de la dépression de 1929. Mais elle a pris une forme plus étalée et destructrice pour les conditions de vie du prolétariat et de l’ensemble de l’humanité : celle d’une descente par paliers successifs toujours plus brutaux vers une situation de marasme et de décomposition de plus en plus généralisée.
Les convulsions que nous connaissons depuis août 1997 correspondent à un nouveau palier dans cette descente aux abîmes. Sans le moindre doute, il s’agit là de l’épisode le plus terrible de ces trente dernières années. Pour mieux cerner le niveau d’aggravation de la crise du capitalisme auquel cet épisode correspond et pour évaluer ses effets sur les conditions de vie du prolétariat, il nous parait nécessaire de faire un retour en arrière sur l’ensemble de cette période.
Dans l’article «La situation politique internationale» (Revue Internationale n° 8, octobre 1976), nous mettions en évidence que la politique capitaliste «d’accompagnement de la crise» se développait selon trois axes : « report de ses difficultés sur les autres pays, sur les couches intermédiaires et sur les travailleurs ». Ce sont ces trois axes qui ont défini les diverses étapes d’effondrement du système.
La politique des années 1970
Dès 1967 et avec la dévaluation de la livre sterling, nous assistions à l’une des premières manifestations d’une nouvelle crise ouverte du capitalisme. Celle-ci succédait aux années de relative prospérité dues à la reconstruction de l’économie mondiale après les destructions gigantesques de la seconde guerre mondiale. Le chômage connaissait sa première alerte, avec une hausse allant jusqu’à 2 % dans certains pays européens. Les gouvernements y ont répondu par des politiques de hausse des dépenses publiques qui rapidement vont masquer la situation réelle et permettre une reprise de la production jusqu’en 1971.
A cette date, la crise s’est à nouveau manifestée sous la forme de violentes tempêtes monétaires concentrées autour de la première monnaie mondiale, le dollar. Le gouvernement Nixon y a répondu par une mesure qui va momentanément faire reculer le problème mais qui aura de graves conséquences dans l’évolution future du capitalisme : il dénonça les accords de Bretton Woods, qui avaient été adoptés en 1944 et qui régissaient depuis lors l’économie mondiale.
Ces accords avaient abandonné définitivement l’étalon-or pour le remplacer par le dollar. Une telle mesure supposait, déjà en son temps, un pas vers la fragilisation du système monétaire mondial et une stimulation des politiques d’endettement. Pendant sa période ascendante, le capitalisme avait lié les monnaies aux réserves d’or ou d’argent, établissant ainsi une relation plus ou moins cohérente entre l’évolution de la production et la masse monétaire en circulation, afin d’éviter ou tout au moins pallier aux effets négatifs du recours incontrôlé au crédit. L’attachement des monnaies au dollar éliminait ces mécanismes de contrôle et supposait, outre l’avantage très important qu’en retirait le capitalisme américain sur ses concurrents, un risque considérable d’instabilité monétaire ainsi que sur le crédit.
Ce risque était resté latent durant la reconstruction, qui laissait une marge pour la réalisation d’une production en continuelle expansion. Mais il apparut au grand jour dès 1967 quand cette marge se réduisit dramatiquement. L’abandon de l’étalon dollar et son remplacement par des Droits de tirage spéciaux (DTS), qui permettaient à chaque Etat de battre monnaie sans plus de garantie que celle qu’il s’accordait lui-même, rendirent alors plus tangibles et dangereux les risques d’instabilité et d’endettement incontrôlé.
Le «boom» de 1972-73 occulta une fois de plus ces problèmes et créa un de ces mirages avec lesquels le capitalisme cherche à masquer sa crise mortelle. Les records historiques de production furent battus pendant ces deux années, phénomène essentiellement dû à une poussée effrénée de la consommation. Ivre de cet éphémère «succès», le capitalisme put alors se glorifier de sa capacité à dépasser définitivement la crise, fanfaronnant sur la défaite du marxisme et de ses prédictions quand à la faillite mortelle du système. Mais ces proclamations furent rapidement démenties par la prétendue «crise du pétrole» de 1974-75 : les indices de production chutèrent dans les pays industrialisés atteignant à peine 2 % à 4 %.
La réponse à cette nouvelle et violente convulsion se fit sur deux axes :
– par un accroissement impressionnant des déficits publics des pays industrialisés et en particulier ceux des Etats Unis ;
– mais surtout par un endettement gigantesque des pays du tiers-monde et des pays de l’Est. Entre 1974 et 1975 s’est développée la plus gigantesque vague de crédits de l’histoire jusqu’alors. 78 000 millions de dollars sont prêtés à des pays du tiers-monde, hors le bloc soviétique. Pour se faire une idée plus précise, rappelons que les crédits accordés par le plan Marshall aux pays européens – qui, en leur temps, battirent déjà spectaculairement un record – s’élevaient à peine à 15 000 millions de dollars entre 1948 et 1953 !
Ces mesures parvinrent à relancer la production même si cette dernière n’a jamais atteint les niveaux de 1972-73. Le prix à payer fut cependant une explosion de l’inflation qui, dans certains pays centraux du capitalisme, se situait autour de 20 % (30 % en Italie). L’inflation est un signe caractéristique du capitalisme décadent [8] [3502]; il est dû a l’immense masse de dépenses improductives que doit faire le système pour survivre : production de guerre, entretien de l’appareil étatique hypertrophié, dépenses de financement, de publicité etc. Ces dépenses ne sont en rien comparables avec celles des frais de circulation et de représentation connus durant la période ascendante. Cependant, cette inflation permanente et structurelle devint, au milieu des années 1970, une inflation galopante à cause de l’accumulation des déficits publics et de l’émission de monnaies sans contrepartie ni contrôle.
L’évolution de l’économie mondiale va alors osciller entre des moments de relance et des moments de ralentissement, de récession. En effet, chaque tentative de relancer l’économie provoquait une poussée inflationniste (c’est ce que les capitalistes appellent une «surchauffe») qui obligeait les Etats à procéder à un «refroidissement» : augmentation brusque des taux d’intérêt, coups de frein à la circulation des monnaies, etc.; mesures qui conduisaient inévitablement à une phase de récession. Tout cela mettait en évidence l’impasse générale dans laquelle se trouve l’économie capitaliste à cause de la surproduction.
Le bilan des années 1970
Après cette description de l’évolution de la crise ainsi que celle des politiques économiques durant les années 1970, nous allons donner des éléments permettant d’évaluer :
– la situation de l’économie ;
– la dégradation des conditions de vie de la classe ouvrière.
Situation générale de l’économie
1. Les taux de production étaient élevés; la croissance durant cette décennie, dans les vingt-quatre pays de l’OCDE, atteignait en moyenne 4,1 %. Pendant le boom des années 1972-73, cette moyenne s’est hissée à 8 % et même 10 % au Japon. On peut cependant constater une tendance claire à la baisse si on compare ces chiffres avec ceux de la décennie précédente.
2. Les crédits massifs accordés aux pays du tiers-monde permettaient l’exploitation et l’incorporation au marché mondial des derniers réduits précapitalistes. Même s’ils étaient très peu importants, on peut dire que le marché mondial a connu, de ce fait, une très légère expansion, un peu comme ce fut également le cas lors de la reconstruction d’après 1945.
3. L’ensemble des secteurs productifs, y compris les secteurs traditionnels comme la construction navale, les mines ou la sidérurgie, ont connu une grande expansion entre 1972 et 1978. Mais cette expansion fut aussi leur chant du cygne : les manifestations de saturation s’accumulaient et furent à l’origine des fameuses «reconversions» (doux euphémisme pour parler de licenciements massifs) qui commencèrent en 1979 et imposèrent leur marque sur la décennie suivante.
4. Les phases de relance concernaient toute l’économie mondial de façon assez homogène. A de rares exceptions (un exemple significatif nous fut donné par le recul de la production dans les pays d’Amérique du Sud), tous les pays bénéficiaient alors de l’accroissement de la production, sans qu’apparaisse le phénomène de pays « décrochés » significatif des années 1980.
5. Les prix des matières premières connaissaient une tendance constante à la hausse qui culmina lors du boom spéculatif sur le pétrole (1972-77). Après, La tendance commença à s’inverser.
6. La production d’armement avait augmenté par rapport à la décennie précédente et va croître spectaculairement à partir de 1976.
7. Le niveau d’endettement s’accélérait fortement à partir de 1975, même s’il restait très nettement inférieur à ceux que le capitalisme va connaître par la suite. Ses caractéristiques étaient alors les suivantes :
– il était relativement modéré dans les pays centraux (même s’il va connaître une augmentation spectaculaire, dès 1977, aux Etats Unis sous l’administration Carter) ;
– son escalade fut gigantesque dans les pays du tiers-monde.
8. Le système bancaire restait solide et la concession de prêts (pour la consommation comme pour les investissements, aux familles, aux entreprises et aux institutions) était soumise à une série de très rigoureux contrôles.
9. La spéculation restait un phénomène limité bien que la fièvre spéculative lors de la « crise du pétrole » (les fameux pétrodollars) annonçait une tendance qui ira en se généralisant dans la décennie suivante.
La situation de la classe ouvrière
1. Le chômage restait relativement limité, même si sa croissance fut constante à partir de 1975 :
2. Les salaires se sont accrus nominalement de façon significative (jusqu’à 20-25 %) et, dans des pays comme l’Italie, s’instaurait l’échelle mobile des salaires. Cette croissance était cependant trompeuse puisque globalement les salaires perdaient du terrain face à une inflation galopante.
3. Les postes fixes de travail prédominaient encore largement et les contrats publics s’accroissaient fortement dans les pays les plus importants.
4. Les prestations sociales, les subsides, les systèmes de sécurité sociale, les aides au logement, à la santé et à l’éducation s’accroissaient de façon significative.
5. Durant cette décennie, la dégradation des conditions de vie, bien que réelle, restait relativement douce. Alertée par la reprise historique de la lutte de classe et bénéficiant d’une certaine marge de manoeuvre sur le plan économique, la bourgeoisie choisit de s’attaquer plutôt aux secteurs faibles du capital national qu’à la classe ouvrière. La décennie des années 1970 fut celle des «années d’illusion», caractérisée par la dynamique politique de gauche au pouvoir.
Dans le prochain article, nous ferons un bilan des années 1980 et 1990, qui nous permettra d’une part d’évaluer la violente dégradation de l’économie et de la situation de la classe ouvrière et, d’autre part, de comprendre avec plus de profondeur les sombres perspectives de ce nouveau palier dans la descente vers l’enfer qu’a été l’épisode ouvert par août 1997.
Adalen
[1] [3503] Deux théories se sont opposées essentiellement, respectivement fondées sur la saturation du marché mondial pour l’une et sur la baisse tendancielle du taux de profit pour l’autre. Voir sur cette question les articles de la Revue internationale n° 13, 16, 23, 29, 30, 76 et 83.
[2] [3504] Voir l’article «La décomposition du capitalisme», Revue internationale n° 62.
[3] [3505] Voir les articles «Sur le capitalisme d’Etat», Revue internationale n° 21, et «Le prolétariat dans le capitalisme décadent», Revue internationale n° 23.
[4] [3506] Voir l’article «Le prolétariat d’Europe de l’Ouest au coeur de la lutte de classe», Revue internationale n° 31.
[5] [3507] Voir l’article «La situation internationale : la crise, la lutte de classe et les tâches de notre Courant international», Revue internationale no 1.
[6] [3508] Voir l’article «Où en est la crise économique ? Le crédit n’est pas une solution éternelle», Revue internationale no 56.
[7] [3509] Ce rapport est publié dans la Revue internationale no 92.
[8] [3510] Voir notre brochure la Décadence du capitalisme.
Récent et en cours:
- Crise économique [28]
Heritage de la Gauche Communiste:
Irak, Kosovo, accords de Wye Plantation : l'offensive américaine aggrave le chaos et la barbarie impérialiste
- 3832 reads
Durant quatre jours, du 16 au 19 décembre 1998, l’Irak a reçu plus de missiles de croisière que durant toute la guerre du Golfe en 1991. Après les menaces non suivies d’effet de février et novembre 1998, les Etats-Unis sont passés à l’acte en déchaînant un nouvel enfer sur une population irakienne déjà victime de la terrible guerre de 1991 et de «sanctions» qui sont synonymes de famines, de maladies et d’une misère quotidienne ayant dépassé les limites du supportable. Au moment de l’effondrement du bloc russe en 1989, le président Bush avait annoncé un «nouvel ordre mondial fait de paix et de prospérité». Depuis nous avons eu un chaos croissant, encore plus de guerres et une extension sans précédent de la misère de par le monde. Les récents bombardements sur l’Irak le confirment une nouvelle fois. Ils confirment également ce que nous avons écrit dans l’article qui suit et qui a été rédigé avant ces derniers bombardements : «Une spirale de destruction dans laquelle la force armée employée par les Etats-Unis dans la défense de leur autorité tend à devenir plus fréquente et massive, les résultats politiques de ces efforts plus discutables, la généralisation du chaos et du militarisme plus certaine, l’abandon des règles de jeu communes plus prononcé.»
Comme l’analyse cet article, les Etats-Unis sont de plus en plus conduits à agir pour leur propre compte, sans s’embarrasser de l’accord du prétendu gardien de la «légalité internationale», l’ONU. Cette fois-ci, les bombardements ont commencé en «prime time» de la télévision américaine alors que le Conseil de Sécurité de l’ONU était réuni pour examiner le fameux rapport rédigé par Richard Butler, chef de l’UNSCOM, qui a justement servi de prétexte à l’intervention américaine. Il est de notoriété publique que ce rapport est truffé de mensonges, en complète contradiction avec l’autre rapport examiné en même temps et émanant de l’Agence internationale de l’énergie atomique qui conclut à l’exécution par l’Irak des décisions de l’ONU [1] [3511]. La réaction plus que mitigées des «alliés» des Etats-Unis (à l’exception de la Grande-Bretagne) [2] [3512], et notamment de Kofi Annan à la suite de leur coup de force, illustrent bien que le gouvernement américain s’est rallié à la politique déjà défendue depuis longtemps par toute une partie de la bourgeoisie représentée notamment par le parti républicain : ne pas essayer de recueillir l’assentiment des autres puissances ou de l’ONU (afin de les prendre en otage) mais engager de façon unilatérale les interventions jugées utiles pour l’affirmation du leadership américain. C’est ce désaccord au sein de la bourgeoisie américaine quant aux moyens d’affirmer une hégémonie US sur le monde de plus en plus battue en brèche qui permet d’expliquer le «monicagate». En ce sens, les «analyses» abondamment produites dans la presse de nombreux pays expliquant les frappes américaines de décembre par la volonté de Clinton de repousser son procès par le Congrès n’ont d’autre objectif que de discréditer les Etats-Unis soupçonnés de semer la mort uniquement pour défendre les intérêts personnels et sordides de leur président. En réalité, Clinton n’a pas décidé de procéder à des frappes unilatérales contre l’Irak à cause du «monicagate» mais il y a eu un «monicagate» en grande partie parce que Clinton ne s’était pas résolu à adopter plus tôt cette attitude, notamment en février 1998. Cependant, comme le met en évidence l’article ci-dessous, l’affirmation de cette nouvelle orientation de la politique US ne sera pas, elle non plus, en mesure de remettre en cause la donnée essentielle des relations internationales : un chaos grandissant, une perte continue de l’autorité du gendarme américain et l’emploi répété par ce dernier de la force des armes. Dès à présent, on peut constater que le seul succès réel qu’ait remporté le gouvernement américain est d’avoir saboté le rapprochement qui se développait dans le domaine militaire entre la Grande-Bretagne et les autres pays d’Europe. Pour le reste, les frappes américaines n’ont fait que renforcer le régime de Saddam Hussein alors que l’échec diplomatique du voyage de Clinton en Israël et en Palestine venait de mettre en relief les limites du succès de Wye Plantation.
Selon les médias bourgeois, l’année 1998 s’est terminée sur une consolidation importante de la paix, de la collaboration internationale et de la défense des Droits de l’homme dans le monde. Dans le Golfe persique, la menace de sanctions par les forces américaines et britanniques - avec, semble-t-il, cette fois-ci le soutien de la «communauté internationale» - a imposé à l’Irak la poursuite des inspections d’armement dont le but serait de retirer les armes de destruction massive des «mains irresponsables» d’un dictateur sanguinaire comme Saddam Hussein. Au Moyen-Orient, le «processus de paix» patronné par les américains - qui est au bord de la faillite - aurait été sauvé par les accords de Wye Plantation. Ces accords auraient permis au président américain Bill Clinton, après de «longues heures de persuasion patiente», d’amener Arafat et Netanyahou à exécuter certaines parties des «accords d’Oslo» basées sur la célèbre formule «la terre contre la paix». Dans les Balkans, l’OTAN - de nouveau par la menace de sanctions militaires - a mis fin aux opérations guerrières qui se développaient entre les forces serbes et kosovar-albanaises et a imposé un fragile cessez-le-feu sous la surveillance d’«observateurs internationaux pour la paix». Et en cette fin d’année, les diplomaties américaine et sud-africaine ont lancé une nouvelle offensive présentée comme capable de mettre fin à la guerre au Congo alors que le président français Chirac était même prêt à serrer la main du «dictateur congolais» Kabila au sommet franco-africain de Paris dans le même but, paraît-il.
Est-ce que la bourgeoisie - à la fin d’un siècle durant lequel elle a transformé le monde en un gigantesque abattoir impérialiste - commencerait à diriger la société selon la charte du maintien de la paix des Nations Unies et selon les principes «humanitaires» d’Amnisty International ? La propagande de la classe dominante, qu’elle concerne la croisade démocratique contre Pinochet ou la prétendue paix établie au Moyen-Orient ou dans les Balkans, fait tout ce qu’elle peut pour présenter les conflits impérialistes d’aujourd’hui sous cette lumière trompeuse. Mais la réalité de ces conflits révèle exactement le contraire : l’aggravation de la barbarie militariste d’un système capitaliste à l’agonie et l’explosion continue de la lutte impérialiste caractérisée par le «chacun pour soi» et le «tous contre tous» ; cette réalité se manifeste aujourd’hui notamment par la nécessité croissante pour les Etats-Unis, première puissance impérialiste de la planète, d’employer la force militaire dans la défense de leur autorité mondiale.
Derrière l’«autorité des Nations Unies» sur l’Irak, les négociations «entre la Serbie et l’Armée de Libération du Kosovo» (ALK) imposées par la force ou celles de «la terre contre la paix» exigées auprès des bourgeoisies israélienne et palestinienne, il y a une offensive de l’impérialisme américain. Une nouvelle et importante réaction contre l’affaiblissement global de son autorité. En réalité, les Etats-Unis se sont imposés en Irak et au Kosovo justement au mépris ouvert des «lois» et de l’«autorité» des Nations Unies qui avaient été, ces derniers temps, de plus en plus utilisées contre les intérêts américains.
Irak : les Etats-Unis humilient la France et la Russie au Conseil de Sécurité
Cela marque un changement important dans la politique américaine envers le reste du monde et surtout envers ses principaux rivaux, une défense plus agressive et plus «unilatérale» de ses intérêts nationaux. Ce sont les Etats-Unis eux-mêmes qui, en préparant en novembre une nouvelle frappe militaire contre l’Irak, jettent aux poubelles de l’histoire les mythes de l’«unité» et de la «légalité internationale» des Nations Unies si chers à la propagande bourgeoise. Cela n’a pas toujours été la position de Washington. Après l’effondrement de l’ordre mondial de Yalta avec la désintégration du bloc impérialiste russe, ce sont les Etats-Unis eux-mêmes - au sommet de leur autorité puisque restant la seule super-puissance mondiale - qui ont utilisé les Nations Unies et leur Conseil de Sécurité pour imposer la guerre du Golfe au reste du monde. En amenant Saddam Hussein à envahir le Koweït, Washington a été capable de présenter cette guerre comme une défense nécessaire du «droit international» (ce qui, dans cette société de classe, a toujours été le droit du plus fort), et de la faire légitimer par la «communauté internationale». Saddam Hussein a été pris au piège : il ne pouvait se retirer du Koweït sans combat car cela pouvait amener à la chute de son régime. Mais avec Saddam Hussein, le reste du monde impérialiste, et surtout les autres principales puissances du défunt bloc occidental ont aussi été piégés : tous ont été obligés de participer ou de payer pour une guerre dont, en réalité, l’objectif essentiel était d’écraser leurs ambitions visant à une plus grande indépendance vis-à-vis des Etats-Unis.
Cependant, il y a un an, ayant tiré les leçons de la guerre du Golfe, l’Irak a inversé les rôles en utilisant à son tour les Nations Unies et son Conseil de Sécurité contre l’Amérique. Loin de chercher à rééditer une action comme l’occupation du Koweït, Saddam Hussein a alors placé au centre de la nouvelle crise du Golfe une simple obstruction aux inspections d’armement de l’ONU, une question secondaire. Il était ainsi plus difficile à Washington de justifier la nécessité d’une action militaire commune. De plus, pour Bagdad, il était plus facile de céder à n’importe quel moment et de couper l’herbe sous les pieds à la première puissance mondiale et à sa politique belliciste. Cette fois, c’était les Etats-Unis et non l’Irak qui étaient piégés ; et cela permettait aux «alliés», aux conseillers de Bagdad au sein du Conseil de Sécurité, la France et la Russie, ainsi qu’au Secrétaire Général de l’ONU, Kofi Annan, de mettre en place une «solution diplomatique» dont le principal résultat a été d’empêcher le déploiement de la force armée américaine et britannique, et ainsi d’humilier le leader mondial. Jusqu’à aujourd’hui, cet épisode a représenté le point le plus significatif de l’affaiblissement de l’autorité de la seule superpuissance restante. Cet affaiblissement était déjà devenu manifeste, juste après la guerre du Golfe, quand une Allemagne à peine réunifiée avait appuyé l’indépendance de la Croatie et de la Slovénie et ainsi provoqué l’explosion de la Yougoslavie contre la volonté de Washington.
C’est à cet affaiblissement de son leadership que la politique américaine répond maintenant en s’affranchissant de l’entrave que représente l’ONU dans ce processus. Dans une tentative de se débarrasser de l’embargo contre l’Irak et de profiter des conflits d’intérêts au sein du Conseil de Sécurité de l’ONU, Saddam Hussein a renouvelé son obstruction aux inspections d’armement pour provoquer une crise. Puis il a de nouveau cédé au dernier moment afin d’éviter une frappe militaire américaine. Mais cette fois, il a dû céder si rapidement et dans des circonstances si humiliantes que l’issue de cette crise représente, sans aucun doute, un renforcement de l’autorité mondiale des Etats-Unis. La différence, maintenant, est que les Etats-Unis, contrairement au passé, se fichent complètement d’obtenir de l’ONU la permission de frapper.
La «sympathie» et la «compréhension» que les autres grandes puissances ont montré devant l’«impatience américaine à l’égard de Saddam» - présentées par la propagande bourgeoise comme un renouveau de l’esprit d’unité des «grandes démocraties» - s’expliquent seulement par le fait que visiblement les Etats-Unis n’étaient plus disposés à se laisser arrêter par quiconque. Critiquer ouvertement la politique agressive de l’Amérique dans de telles circonstances, tout en manquant des moyens concrets de la bloquer, aurait abouti pour les autres puissances à partager publiquement l’humiliation imposée à Saddam.
Kosovo : les Etats-Unis font la loi via l’OTAN
Bien avant ces derniers épisodes de la crise irakienne, au sein de l’ONU, les tensions entre Washington et ses rivaux étaient apparues clairement notamment lors des différents conflits militaires dans l’ex-Yougoslavie. Les principales grandes puissances soutenant la Serbie - Grande-Bretagne, France et Russie - ont utilisé l’ONU afin d’empêcher, aussi longtemps que possible, les Etats-Unis de jouer un rôle majeur spécialement dans le conflit bosniaque. C’est pour cela que, lorsque ces derniers ont réussi (momentanément) à imposer leur autorité sur leurs rivaux européens en Bosnie notamment à travers les accords de Dayton, cela s’est fait sous l’égide, non pas de l’ONU, mais de l’OTAN qui fut l’organisation militaire spécifique du bloc impérialiste américain, qui continue à exister malgré la disparition de celui-ci et que Washington est encore capable de dominer. Ainsi, aujourd’hui, à côté de la démonstration de force dans le Golfe, la menace d’intervention militaire, via l’OTAN, au Kosovo et en Serbie constitue le second axe de l’offensive des Etats-Unis en défense de leur leadership. Le principal succès américain n’est pas d’avoir obligé Milosevic à retirer ses troupes du Kosovo : en réalité, Washington s’est arrangé pour que l’armée serbe reste assez longtemps sur place pour lui permettre de contrer et affaiblir sévèrement l’Armée de Libération du Kosovo qui est soutenue par l’impérialisme allemand. Le succès des Etats-Unis repose surtout dans le fait d’avoir obligé leurs ex-alliés de l’OTAN qui sont pro-serbes, la Grande-Bretagne et la France, à s’aligner et à appuyer sa menace d’intervention contre la Serbie. Tout comme Saddam Hussein, Milosevic a dû céder à temps pour éviter que les missiles américains ne s’abattent sur son pays. Et de nouveau, comme pour l’Irak, les tentatives anti-américaines visant à exiger un mandat du Conseil de Sécurité de l’ONU pour une intervention armée (une carte surtout jouée ouvertement par la Russie dans la crise du Kosovo) ont été enrayées par l’«unilatéralisme» tout récent de Washington. Selon le «vertueux» Clinton, avec le risque d’un afflux massif de réfugiés sans-logis de la guerre au Kosovo et cela à l’approche de l’hiver, il ne peut être question pour le leader du monde d’attendre une «permission» de l’ONU, de la Russie ou de quiconque pour réagir et frapper «celui qui est responsable de cette situation».
ONU et OTAN : les restes d’un ordre mondial révolu que les grandes puissances se disputent
L’ONU, comme son ancêtre la SDN (Société Des Nations), n’est pas, comme on veut nous le faire croire, une organisation de maintien de la paix, réunissant les puissances capitalistes sous une loi internationale commune. C’est un repaire de brigands impérialistes et sa politique est complètement déterminé par le rapport des forces entre les principaux rivaux capitalistes. En ce sens, l’évolution de la politique des Etats-Unis envers l’ONU, depuis sa création, est particulièrement significative.
Durant la guerre froide, l’ONU, divisée entre les deux blocs impérialistes, servait principalement à la propagande pacifiste bourgeoise. A certaines occasions, le bloc occidental, grâce à la majorité qu’il avait parmi les membres permanents du Conseil de Sécurité (composé des puissances victorieuses de la deuxième guerre mondiale), a pu en tirer profit. Après 1989, la capacité des Etats-Unis d’exploiter cet organisme pour leurs propres intérêts allait connaître un rapide déclin. La guerre du Golfe, cette sinistre démonstration de la supériorité des Etats-Unis sur le reste du monde impérialiste, loin d’aboutir à la soumission de tous à «l’ordre américain», a été très vite suivie par l’explosion du «chacun pour soi» dans les relations entre Etats capitalistes et ainsi par un affaiblissement du leadership américain. Depuis, dans un monde sans blocs impérialistes, le chaos et le «chacun pour soi» sont devenus inévitablement des tendances dominantes. L’ONU même est de plus en plus utilisée pour affaiblir l’autorité des Etats-Unis. C’est ce qui explique pourquoi la bourgeoisie américaine, tout au long des années 1990, a pris de plus en plus une position hostile envers cette organisation, refusant régulièrement de payer ses cotisations de membre. Cependant, jusqu’à l’offensive américaine actuelle, l’administration Clinton hésitait à passer outre aux recommandations de l’ONU ; elle considérait cet organisme comme instrument possible de mobilisation des autres puissances. En fait, le mécontentement d’importantes fractions de la bourgeoisie américaine face à ces hésitations explique en partie la pression récente faite sur Clinton avec l’affaire Lewinsky. La politique américaine actuelle envers l’Irak et la Serbie montre que les Etats-Unis sont aujourd’hui contraints d’adopter la stratégie «d’y aller tout seul» contrairement à celle qui prévalait à l’époque de la guerre du Golfe ou même de Dayton. C’est, de fait, la reconnaissance par la superpuissance mondiale elle-même que la tendance dominante est au «chacun pour soi», donc à l’affaiblissement du leadership américain. Bien sûr, quand les Etats-Unis mettent leurs forces armées en action, il n’y a pas de puissance dans le monde capable de s’y opposer. Mais en agissant ainsi, ils ne font qu’affaiblir leur propre leadership et aggraver le chaos international et le «chacun pour soi».
En rejetant les règles du jeu de l’ONU, Washington ôte, en grande partie, à ce dinosaure issu d’une ère révolue sa raison d’être. Mais si cette évolution lui profite, elle profite aussi à certains de ses rivaux et pas des moindres. Il s’agit des puissances vaincues de la 2e guerre mondiale, l’Allemagne et le Japon, les deux puissances écartées du Conseil de Sécurité mais en même temps les principaux rivaux des Etats-Unis. Plus important : dès à présent, l’OTAN devient le lieu privilégié dans lequel les rivalités entre les ex-alliés du bloc de l’Ouest s’expriment. C’est ainsi qu’en réponse à l’offensive américaine au Kosovo au moyen de l’OTAN, le nouveau ministre des Affaires étrangères de l’Allemagne, Fischer, a appelé l’alliance à renoncer à la stratégie de première frappe atomique [3] [3513]. De même, Tony Blair, lors de la réunion au sommet franco-britannique de Saint-Malo, a engagé officiellement la Grande-Bretagne dans le «renforcement du pilier européen de l’OTAN», aux dépens de l’Amérique bien sûr ! Cela représente un accroissement des enjeux dans la rivalité entre les grandes puissances. L’OTAN comme l’ONU est un vestige de l’ancien ordre mondial. Mais c’est un vestige beaucoup plus important car il représente encore l’instrument principal de la présence militaire américaine en Europe.
Accords de Wye Plantation : un avertissement des Etats-Unis à leurs rivaux européens
Mais si la menace de guerre contre Saddam Hussein et Milosevic est une expression non d’unité mais de rivalité entre les grandes puissances, l’accord de Wye Plantation entre Clinton, Netanyahou et Arafat ne serait-il pas le triomphe de la «persuasion pacifique» si chère à certains européens ? En réalité, aussi modeste et fragile que soit cet accord entre Israël et l’OLP, il est la manifestation d’une nouvelle victoire pour l’impérialisme américain, ne serait-ce que par le fait que la CIA est officiellement en charge de l’application de certaines de ses parties. La «persuasion» exercée par les Etats-Unis n’a pas été complètement «pacifique» : la mobilisation militaire américaine dans le Golfe au même moment était, indirectement, autant un avertissement à Netanyahou et Arafat qu’à Saddam Hussein. Mais surtout, il s’agissait d’un avertissement aux rivaux européens afin qu’ils ne cherchent pas à mettre leur nez dans une des zones stratégiques les plus importantes et explosives du monde et où l’Amérique a bien l’intention de maintenir sa domination à tout prix.
De tels avertissements s’avèrent toujours plus nécessaires car malgré l’offensive actuelle, l’effort des autres puissances pour se débarrasser de la domination américaine ne peut que s’accroître. C’est précisément parce que les Etats-Unis sont militairement capables d’imposer leurs intérêts aux dépens de n’importe quelle autre puissance existante qu’aucune de ces puissances n’a fondamentalement intérêt à participer au renforcement de la position américaine. Cela vaut aussi pour la Grande-Bretagne qui a des intérêts communs avec l’Amérique par rapport à l’Irak mais des intérêts opposés en Europe, en Afrique et surtout au Moyen-Orient. Toutes ces puissances sont condamnées à contester les Etats-Unis, qu’elles le veuillent ou non, et par conséquent à plonger encore plus le monde dans le chaos. Les Etats-Unis, les seuls à pouvoir prétendre être la superpuissance de l’ordre capitaliste mondial, sont condamnés à imposer leur ordre, et par conséquent à plonger eux aussi le monde dans la barbarie.
La base de cette contradiction est l’absence de blocs. Quand les blocs existent, le renforcement du leader renforce la position des autres membres du bloc contre le bloc rival. En l’absence d’un tel rival, et donc de blocs impérialistes, le renforcement du leader entre en contradiction avec les intérêts des autres. C’est pourquoi l’explosion du chacun pour soi, tout comme les contre-offensives des Etats-Unis, est une donnée fondamentale de la situation historique actuelle. Aujourd’hui, comme durant la guerre du Golfe, les Etats-Unis sont à l’offensive. Bien qu’aucun missile américain n’ait encore été tiré contre l’Irak ou la Serbie, la situation d’aujourd’hui ne représente pas une répétition du début des années 1990 mais une aggravation par rapport à celle-ci. Une spirale de destruction dans laquelle la force armée employée par les Etats-Unis dans la défense de leur autorité tend à devenir plus fréquente et massive, les résultats politiques de ces efforts plus discutables, la généralisation du chaos et du militarisme plus certaine, l’abandon des règles de jeu communes plus prononcé. La rivalité entre les «démocraties occidentales», entre les prétendus «vainqueurs du communisme» est au coeur même de cette barbarie qui menace sur le long terme la survie de l’humanité même s’il n’y a pas de troisième guerre mondiale. Le prolétariat doit comprendre l’essence de cette barbarie impérialiste et l’intégrer comme un aspect fondamental dans sa conscience de classe et dans sa détermination à détruire le système capitaliste.
KR, 6 décembre 1998
[1] [3514] En fait, on a appris par la suite qu’il avait été rédigé en étroite collaboration avec l’Administration américaine. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que celle-ci construit de toutes pièces des faux pour justifier ses actions de guerre. Par exemple, l’attaque du 5 août 1964 par la flotte nord-viêtnamienne de deux destroyers américains qui avait servi de prétexte au début des bombardements du Nord-Vietnam s’est révélé par la suite n’être qu’une pure invention. C’est une technique vieille comme la guerre et dont un des exemples les plus connus est la fameuse «dépêche d’Ems» du 13 juillet 1870 qui permit à Bismarck de pousser la France à déclarer contre la Prusse une guerre que cette dernière était sûre de gagner.
[2] [3515] Il faut noter que le soutien de Blair à l’action américaine n’a pas rencontré l’unanimité au sein de la bourgeoisie anglaise, de nombreux journaux l’ayant sévèrement critiqué.
[3] [3516] La stratégie de l’OTAN est d’utiliser la première les frappes atomiques.
Questions théoriques:
- Impérialisme [321]
Heritage de la Gauche Communiste:
1918 - 1919 : la révolution prolétarienne met fin à la guerre impérialiste
- 3911 reads
Il y a peu, la bourgeoisie a célébré la fin de la première guerre mondiale. Évidemment, il y a eu beaucoup de déclarations émues sur la terrible tragédie que cette guerre avait représenté. Mais dans l’ensemble de ces commémorations, dans les déclarations des hommes politiques de même que dans les articles de journaux et les émissions de télévision, il n’a jamais été évoqué les événements qui ont conduit les gouvernements à mettre un terme à la guerre. On a fait référence à la défaite militaire des empires centraux, l’Allemagne et son alliée autrichienne, mais on a soigneusement omis de signaler l’élément déterminant qui a provoqué la demande d’armistice par ces derniers : le mouvement révolutionnaire qui s’est développé en Allemagne à la fin de 1918. Il n’a pas été question non plus (et on peut comprendre la bourgeoisie) des véritables responsabilités de cette boucherie. Certes, des «spécialistes» se sont penchés sur les archives des différents gouvernements pour conclure que ce sont l’Allemagne et l’Autriche qui avaient poussé le plus à la guerre. De même, des historiens ont mis en évidence que du côté de l’Entente, il existait aussi des buts de guerre bien spécifiques. Cependant, dans aucune de leurs «analyses» on ne trouve mis en cause le véritable responsable : le système capitaliste lui-même. Et justement, seul le marxisme permet d’expliquer pourquoi ce n’est pas la «volonté», ou la «rapacité» en soi de tel ou tel gouvernement qui est à l’origine de la guerre, mais les lois même du capitalisme. Pour notre part, l’anniversaire de la fin de la première guerre mondiale est une occasion pour revenir sur l’analyse qu’en ont fait les révolutionnaires de l’époque et la lutte qu’ils ont menée contre elle. Nous nous appuierons en particulier sur les écrits, les positions et l’attitude de Rosa Luxemburg et de Karl Liebknecht qui ont été assassinés il y aura bientôt 80 ans par la bourgeoisie. C’est le meilleur hommage que nous puissions rendre à ces deux magnifiques combattants du prolétariat mondial [1] [3517] à l’heure où la bourgeoisie essaie par tous les moyens de tuer sa mémoire. La guerre qui éclate en Europe en août 1914 a été précédée sur ce continent par de nombreuses autres guerres. On peut rappeler, par exemple, (en se limitant au seul 19e siècle) les guerres napoléoniennes et la guerre entre la Prusse et la France de 1870. Cependant, il existe entre le conflit de 1914 et tous les précédents des différences fondamentales. La plus évidente, celle qui a frappé le plus les esprits, c’est évidemment le carnage et la barbarie qu’elle a fait déferler sur le continent dit de la «civilisation». Aujourd’hui, après la barbarie encore bien plus grande de la seconde guerre mondiale, celle de la première apparaît évidemment modeste. Mais dans l’Europe du début du siècle, alors que le dernier conflit militaire d’importance remontait à 1870, alors que brillaient les ultimes feux de la «belle époque», celle de l’apogée du mode de production capitaliste qui avait permis à la classe ouvrière d’améliorer de façon significative ses conditions d’existence, la brutale plongée dans les massacres de masse, dans l’horreur quotidienne des tranchées et dans une misère inconnue depuis plus d’un demi siècle furent vécus, particulièrement par les exploités, comme un sommet indépassable de la barbarie. Des deux côtés, chez les principaux belligérants, l’Allemagne et la France, les soldats et les populations avaient eu écho par leurs aînés de la guerre de 1870 et de sa cruauté. Mais ce qu’ils vivaient n’avait plus rien à voir avec cet épisode. Le conflit de 1870 n’avait duré que quelques mois, il avait provoqué un nombre incomparablement moindre de victimes (de l’ordre de la centaine de milliers) et il n’avait nullement ruiné ni le vainqueur ni le vaincu. Avec la première guerre mondiale, c’est par millions qu’il faut désormais dans chaque pays dénombrer les tués, les blessés, les mutilés, les invalides [2] [3518]. C’est en années (plus de quatre) qu’il faut mesurer la durée de l’enfer quotidien que vivent au front et à l’arrière les populations. Au front, cet enfer prend la forme d’une survie sous terre, dans la boue et la crasse, dans la puanteur des cadavres, dans la peur permanente des obus et de la mitraille, dans le spectacle de ce qui attend demain les survivants : les corps mutilés, déchiquetés, les blessés qui agonisent durant des heures ou des jours dans des trous d’obus. A l’arrière, c’est un travail accablant pour suppléer les mobilisés et produire toujours plus d’armes ; ce sont des hausses de prix qui divisent par deux ou par cinq les salaires, les queues interminables devant les boutiques vides, la faim ; c’est en permanence l’angoisse d’apprendre la mort d’un mari, d’un frère, d’un père ou d’un fils ; c’est la douleur et le désespoir, une vie brisée lorsque le drame arrive et il arrive des millions de fois.
L’autre caractéristique marquante et inédite de cette guerre, et qui explique cette barbarie massive, c’est qu’elle est totale. Toute la puissance de l’industrie, toute la main d’œuvre sont mises au service d’un but unique : la production d’armements. Tous les hommes, depuis la fin de l’adolescence jusqu’au début de la vieillesse sont mobilisés. Elle est totale aussi du point de vue des dégâts qu’elle provoque dans l’économie. Les pays du champ de bataille sont détruits ; l’économie des pays européens sort ruinée de la guerre : c’est la fin de leur puissance séculaire et le début de leur déclin au bénéfice des États-Unis. Elle est totale, enfin, du fait qu’elle n’a pas été circonscrite aux premiers belligérants : c’est pratiquement tous les pays d’Europe qui y ont été entraînés et elle a embrassé les autres continents avec les fronts de guerre au Proche-Orient, avec la mobilisation des troupes coloniales et avec l’entrée en guerre du Japon, des États-Unis et de plusieurs pays d’Amérique latine aux côtés des Alliés.
En fait, déjà sous l’aspect de l’ampleur de la barbarie et des destructions qu’elle engendre, la guerre de 1914-18 constitue l’illustration tragique de ce que les marxistes avaient prévu : l’entrée du mode de production capitaliste dans sa période de déclin, de décadence. Elle confirme avec éclat la prévision avancée par Marx et Engels au siècle précédent : «Ou le socialisme, ou la chute dans la barbarie».
Mais il appartient aussi au marxisme et aux marxistes de donner l’explication théorique de cette nouvelle phase dans la vie de la société capitaliste.
Les causes fondamentales de la guerre mondiale
C’est l’identification de ces causes fondamentales que se donne pour but Lénine en 1916 avec son livre L’impérialisme, stade suprême du capitalisme. Mais il est revenu à Rosa Luxemburg, dès 1912, deux ans avant l’éclatement du conflit mondial, de donner, avec «L’accumulation du capital», l’explication la plus profonde des contradictions qui allaient frapper le capitalisme dans cette nouvelle période de son existence.
«Le capitalisme a besoin pour son existence et son développement de formes de production non capitalistes autour de lui (...) Il lui faut des couches sociales non capitalistes comme débouchés pour sa plus-value, comme sources de moyens de production et comme réservoirs de main-d’œuvre pour son système de salariat... Le capital ne peut se passer des moyens de production ni des forces de travail de ces sociétés primitives, qui lui sont en outre indispensables comme débouchés pour son surproduit. Mais pour les dépouiller de leurs moyens de production, leur prendre les forces de travail et les transformer en clients de ses marchandises, il travaille avec acharnement à les détruire en tant que structures sociales autonomes. Cette méthode est du point de vue du capital la plus rationnelle parce qu’elle est à la fois la plus rapide et la plus profitable. Par ailleurs elle a pour conséquence le développement du militarisme.» (L’accumulation du Capital, La lutte contre l’économie naturelle, Éditions Maspero, 1967 pages 43 et 46 du Tome II))
«L’impérialisme est l’expression politique du processus de l’accumulation capitaliste se manifestant par la concurrence entre les capitalismes nationaux autour des derniers territoires non capitalistes encore libres du monde (...) Avec le degré d’évolution élevé atteint par les pays capitalistes et l’exaspération de la concurrence des pays capitalistes pour la conquête des territoires non capitalistes, la poussée impérialiste, aussi bien dans son agression contre le monde non capitaliste que dans les conflits plus aigus entre les pays capitalistes concurrents, augmente d’énergie et de violence. Mais plus s’accroissent la violence et l’énergie avec lesquelles le capital procède à la destruction des civilisations non capitalistes, plus il rétrécit sa base d’accumulation. L’impérialisme est à la fois une méthode historique pour prolonger les jours du capital et le moyen le plus sûr et le plus rapide d’y mettre objectivement un terme. Cela ne signifie pas que le point final ait besoin à la lettre d’être atteint. Le seule tendance vers ce but de l’évolution capitaliste se manifeste déjà par des phénomènes qui font de la phase finale du capitalisme une période de catastrophes.» (Ibid., Le protectionnisme et l’accumulation, pages 115-116)
«Plus s’accroît la violence avec laquelle à l’intérieur et à l’extérieur le capital anéantit les couches non capitalistes et avilit les conditions d’existence de toutes les couches laborieuses, plus l’histoire quotidienne de l’accumulation dans le monde se transforme en une série de catastrophes et de convulsions, qui, se joignant aux crises économiques périodiques, finiront par rendre impossible la continuation de l’accumulation et par dresser la classe ouvrière internationale contre la domination du capital avant même que celui-ci ait atteint économiquement les dernières limites objectives de son développement.
Le capitalisme est la première forme économique douée d’une force de propagande ; il tend à se répandre sur le globe et à détruire toutes les autres formes économiques, n’en supportant aucune autre à côté de lui. Et pourtant il est en même temps la première forme économique incapable de subsister seule, à l’aide de son seul milieu et de son sol nourricier. Ayant tendance à devenir une forme mondiale, il se brise à sa propre incapacité d’être cette forme mondiale de la production. Il offre l’exemple d’une contradiction historique vivante ; son mouvement d’accumulation est à la fois l’expression, la solution progressive et l’intensification de cette contradiction. A un certain degré de développement, cette contradiction ne peut être résolue que par l’application des principes du socialisme, c’est-à-dire par une forme économique qui est par définition une forme mondiale, un système harmonieux en lui-même, fondé non sur l’accumulation mais sur la satisfaction des besoins de l’humanité travailleuse et donc sur l’épanouissement de toutes les forces productives de la terre.» (Ibid., Le militarisme, champ d’action du capital, pages 134-135)
Après l’éclatement de la guerre, en 1915, dans une réponse aux critiques qu’avait rencontrées L’Accumulation du Capital, Rosa Luxemburg actualisait son analyse : «Le trait caractéristique de l’impérialisme en tant que lutte concurrentielle suprême pour l’hégémonie mondiale capitaliste n’est pas seulement l’énergie et l’universalité de l’expansion - signe spécifique que la boucle de l’évolution commence à se refermer - mais le fait que la lutte décisive pour l’expansion rebondit des régions qui étaient l’objet de sa convoitise vers les métropoles. Ainsi l’impérialisme ramène la catastrophe, comme mode d’existence, de la périphérie de son champ d’action à son point de départ. Après avoir livré pendant quatre siècles l’existence et la civilisation de tous les peuples non capitalistes d’Asie, d’Afrique, d’Amérique et d’Australie à des convulsions incessantes et au dépérissement en masse, l’expansion capitaliste précipite aujourd’hui les peuples civilisés de l’Europe elle-même dans une suite de catastrophes dont le résultat final ne peut être que la ruine de la civilisation ou l’avènement de la production socialiste.» (Critique des critiques, Ibid., page 229)
Pour sa part, le livre de Lénine insiste, pour qualifier l’impérialisme, sur un de ses aspects particulier, l’exportation des capitaux des pays développés vers les pays arriérés afin de contrecarrer la baisse tendancielle du taux de profit résultant de l’élévation de la proportion du capital constant (machines, matières premières) par rapport au capital variable (les salaires) seul créateur de profit. Pour Lénine, ce sont les rivalités entre pays industriels pour s’accaparer les zones moins développées et y exporter leurs capitaux qui conduisaient nécessairement à leur affrontement.
Cependant, même s’il existe des différences dans les analyses élaborées par Lénine et Rosa Luxemburg et d’autres révolutionnaires de cette époque, elles convergent toutes sur un point essentiel : cette guerre n’est pas le résultat des mauvaises politiques ou de la «méchanceté» particulière de telle ou telle clique gouvernante ; elle est la conséquence inéluctable du développement du mode de production capitaliste. En ce sens, ces deux révolutionnaires dénonçaient avec la même énergie toute «analyse» tendant à faire croire aux ouvriers qu’il y aurait au sein du capitalisme une «alternative» à l’impérialisme, au militarisme et à la guerre. C’est ainsi que Lénine démolit la thèse de Kautsky sur la possibilité d’un «super-impérialisme» capable d’établir un équilibre entre les grandes puissances et d’éliminer leurs affrontements guerriers. De même, il détruit toutes les illusions sur «l’arbitrage international» censé, sous l’égide des gens de bonne volonté et des secteurs «pacifistes» de la bourgeoisie, réconcilier les antagonistes et mettre fin à la guerre. Ce n’est pas autrement que s’exprime Rosa Luxemburg dans son livre :
«A la lumière de cette conception, l’attitude du prolétariat à l’égard de l’impérialisme est celle d’une lutte générale contre la domination du capital. La ligne tactique de sa conduite lui est dictée par cette alternative historique [la ruine de la civilisation ou l’avènement de la production socialiste].
La ligne tactique prônée par le marxisme officiel des «experts» est tout autre. La croyance à la possibilité de l’accumulation dans une «société capitaliste isolée», l’opinion selon laquelle «le capitalisme est concevable même sans expansion» sont les expressions théoriques d’une conception tactique bien définie. Cette position tend à considérer la phase de l’impérialisme non pas comme une nécessité historique, comme la phase de la lutte décisive pour le socialisme, mais comme l’invention malveillante d’une poignée d’intéressés. Cette position tend à persuader la bourgeoisie que l’impérialisme et le militarisme lui sont nuisibles même du point de vue de ses propres intérêts capitalistes ; elle prétend la convaincre d’isoler la clique des prétendus profiteurs de cet impérialisme pour constituer ainsi un bloc du prolétariat et de larges couches de la bourgeoisie en vue de «modérer» l’impérialisme, de la paralyser par un «désarmement partiel», de la «rendre inoffensif» !… La lutte mondiale entre le prolétariat et le capital fait place à l’utopie d’un compromis historique entre le prolétariat et la bourgeoisie qui «atténuerait» les antagonismes impérialistes entre les États capitalistes.» (Critique des critiques, Ibid., pages 229-230)
Enfin c’est dans les mêmes termes que Lénine et Rosa Luxemburg expliquent que l’Allemagne a joué le rôle de boutefeu dans le déclenchement de la guerre mondiale (la grande idée de ceux qui cherchent LE pays responsable de celle-ci) tout en renvoyant dos à dos les deux camps :
«Contre le groupe franco-anglais s’est dressé un autre groupe capitaliste, le groupe allemand, encore plus rapace, encore plus doué pour le brigandage, qui est venu s’asseoir au banquet du festin capitaliste alors que toutes les places étaient déjà prises, apportant avec lui de nouveaux procédés de développement de la production capitaliste, une meilleure technique et une organisation incomparable dans les affaires... La voilà, l’histoire économique ; la voilà l’histoire diplomatique de ces dernières dizaines d’années, que nul ne peut méconnaître. Elle seule vous indique la solution du problème de la guerre et vous amène à conclure que la présente guerre est, elle aussi, le produit... de la politique de deux colosses qui, bien avant les hostilités, avaient étendu sur le monde entier les tentacules de leur exploitation financière et s’étaient partagé économiquement le monde. Ils devaient se heurter, car du point de vue capitaliste, un nouveau partage de cette domination était devenu inévitable.» (Lénine, «La guerre et la Révolution», Oeuvres, T. 24, page 413)
«(…) quand on veut porter un jugement général sur la guerre mondiale et apprécier son importance pour la politique de classe du prolétariat, la question de savoir qui est l’agresseur et l’agressé, la question de la «culpabilité» est totalement sans objet. Si l’Allemagne mène moins que quiconque une guerre défensive, ce n’est pas non plus le cas de la France et de l’Angleterre ; car ce que ces nations «défendent», ce n’est pas leur position nationale, mais celle qu’elles occupent dans la politique mondiale, ce sont leurs vieilles possessions impérialistes menacées par les assauts du nouveau venu allemand. Si les incursions de l’impérialisme allemand et de l’impérialisme autrichien en Orient ont sans aucun doute apporté l’étincelle, de leur côté l’impérialisme français en exploitant le Maroc, l’impérialisme anglais par ses préparatifs en vue de piller la Mésopotamie et l’Arabie et par toutes les mesures prises pour assurer son despotisme en Inde, l’impérialisme russe par sa politique des Balkans dirigée vers Constantinople, ont petit à petit rempli la poudrière. Les préparatifs militaires ont bien joué un rôle essentiel : celui du détonateur qui a déclenché la catastrophe, mais il s’agissait d’une compétition à laquelle participaient tous les États.» (Rosa Luxemburg, La Crise de la Social-démocratie, avril 1915, chapitre VII, Éditions la Taupe, 1970, pages 175-176)
Cette unité sur l’analyse des causes de la guerre qu’on retrouve chez les révolutionnaires provenant de pays situés dans des camps opposés, on la constate aussi pour ce qui est de la politique qu’ils mettent en avant pour le prolétariat et la dénonciation des partis social-démocrates qui ont trahi ce dernier.
Le rôle des révolutionnaires durant la guerre
Lorsque la guerre éclate, le rôle des révolutionnaires, de ceux qui sont restés fidèles au camp prolétarien est évidemment de la dénoncer. Ils doivent en premier lieu démasquer tous les mensonges que la bourgeoisie et ceux qui sont devenus ses larbins, les partis social-démocrates, mettent en avant pour la justifier, pour embrigader les prolétaires et les envoyer à la boucherie. En Allemagne, c’est chez Rosa Luxemburg que se réunissent les quelques dirigeants, dont Karl Liebknecht, qui sont restés fidèles à l’internationalisme prolétarien et que la résistance s’organise contre la guerre. Alors que toute la presse social-démocrate est passée au service de la propagande gouvernementale, ce petit groupe va publier une revue, l’Internationale, ainsi qu’une série de tracts qu’il va signer «Spartacus». Au Parlement, dans la réunion de la fraction social-démocrate du 4 août, Liebknecht s’oppose fermement au vote des crédits de guerre mais il se soumet à la majorité par discipline de parti. C’est une erreur qu’il ne commettra plus par la suite lorsque le gouvernement demandera des crédits supplémentaires. Dans le vote du 2 décembre 1914 il sera seul à voter contre et ce n’est qu’en août et décembre 1915 qu’il sera rejoint dans cette attitude par d’autres députés social-démocrates (qui cependant, à cette dernière occasion, font une déclaration basée sur le fait que l’Allemagne ne fait pas une guerre défensive puisqu’elle occupe la Belgique et une partie de la France, explication que Liebknecht dénonce pour son centrisme et sa couardise).
Aussi difficile que soit la propagande des révolutionnaires à un moment où la bourgeoisie a instauré un véritable état de siège, empêchant toute expression d’une parole prolétarienne, cette action de Rosa et de ses camarades est essentielle pour préparer l’avenir. Alors qu’elle est emprisonnée, en avril 1915, elle écrit La crise de la social-démocratie qui «est de la dynamite de l’esprit qui fait sauter l’ordre bourgeois» comme l’écrira Clara Zetkin, camarade de combat de Rosa, dans sa préface de mai 1919.
Ce livre est un réquisitoire impitoyable contre la guerre elle-même et contre tous les aspects de la propagande bourgeoise et c’est le meilleur hommage qu’on puisse rendre à Rosa Luxemburg que d’en publier quelques (trop) courts extraits.
Alors que dans tous les pays belligérants, les porte parole de toutes nuances de la bourgeoisie font de la surenchère nationaliste, elle commence, dans ce document, par stigmatiser l’hystérie chauvine qui s’est emparée de la population :
«(…) la population de toute une ville changée en populace, prête à dénoncer n’importe qui, à molester les femmes, à crier : hourra ! et à atteindre au paroxysme du délire en lançant elle-même des rumeurs folles ; un climat de crime rituel, une atmosphère de pogrome, où le seul représentant de la dignité humaine était l’agent de police au coin de la rue». (p. 53-54).
Ensuite, elle dévoile la réalité de cette guerre :
«Souillée, déshonorée, pataugeant dans le sang, couverte de crasse ; voilà comment se présente la société bourgeoise, voilà ce qu’elle est. Ce n’est pas lorsque, bien léchée et bien honnête, elle se donne des dehors de la culture et de la philosophies, de la morale et de l’ordre, de la paix et du droit, c’est quand elle ressemble à une bête fauve, quand elle danse le sabbat de l’anarchie, quand elle souffle la peste sur la civilisation et l’humanité qu’elle se montre toute nue, telle qu’elle est vraiment.» (p. 55)
Ainsi, d’emblée, Rosa va au cœur de la question : contre les illusions du pacifisme qui voudraient un société bourgeoise «sans ses excès», elle désigne le coupable de la guerre : le capitalisme comme un tout. Et immédiatement, elle prend le soin de dénoncer le rôle et le contenu de la propagande capitaliste, qu’elle vienne des partis bourgeois traditionnels ou de la social-démocratie :
«La guerre est un meurtre méthodique, organisé, gigantesque. En vue d’un meurtre systématique, chez les hommes normalement constitués, il faut cependant d’abord produire une ivresse appropriée. C’est depuis toujours la méthode habituelle des belligérants. La bestialité des pensées et des sentiments doit correspondre à la bestialité de la pratique, elle doit la préparer et l’accompagner.» (p. 72)
Une bonne partie du livre est consacrée à démonter systématiquement tous ces mensonges, à démasquer la propagande gouvernementale destinée à enrôler les masses pour la tuerie. [3] [3519] C’est ainsi que Rosa analyse les buts de guerre de tous les pays belligérants, et au premier chef de l’Allemagne, pour mettre en évidence le caractère impérialiste de cette guerre. Elle analyse l’engrenage qui, depuis l’assassinat le 28 juin à Sarajevo de l’Archiduc d’Autriche François-Ferdinand a conduit à l’entrée en guerre des principaux pays d’Europe, l’Allemagne, la Russie, la France, l’Angleterre et l’Autriche-Hongrie. Elle met en évidence que cet engrenage n’était nullement dû à la fatalité ou aux responsabilités spécifiques d’un quelconque «méchant» comme le veut la propagande officielle et social-démocrate des pays en guerre, mais qu’elle couvait déjà depuis longtemps au sein du capitalisme :
«La guerre mondiale déclarée officiellement le 4 août était celle-là même pour laquelle la politique impérialiste allemande et internationale travaillait inlassablement depuis des dizaines d’années, celle-là même dont, depuis dix ans, la social-démocratie allemande, d’une manière tout aussi inlassable, prophétisait l’approche presque chaque année, celle-là même que les parlementaires, les journaux et les brochures social-démocrates stigmatisaient à de multiples reprises comme étant un crime frivole de l’impérialisme, qui n’avait rien à voir avec la civilisation ni avec les intérêts nationaux mais qui, bien au contraire, agissait contre ces deux principes.» (p.132)
Évidemment, elle fustige particulièrement la social-démocratie allemande, le parti phare de l’Internationale socialiste, dont la trahison a rendu infiniment plus facile la manœuvre du gouvernement en vue d’enrôler le prolétariat, en Allemagne mais aussi dans les autres pays. Elle réserve un sort particulier à l’argument social-démocrate suivant lequel la guerre du côté allemand a pour objectif de défendre la «civilisation» et la «liberté des peuples» contre la barbarie tsariste.
Elle dénonce particulièrement les justifications de la Neue Zeit, l’organe théorique du parti, qui en appelle à l’analyse de Marx de la Russie comme «prison des peuples» et principale force de la réaction en Europe :
«Le groupe [parlementaire] social-démocrate avait prêté à la guerre le caractère d’une défense de la nation et de la civilisation allemandes ; la presse social-démocrate, elle, la proclama libératrice des peuples étrangers. Hindenburg devenait l’exécuteur testamentaire de Marx et Engels.» (p. 139)
En dénonçant les mensonges de la social-démocratie, Rosa met en évidence le rôle véritable qu’elle joue :
«En acceptant le principe de l’Union Sacrée, la social-démocratie a renié la lutte de classe pour toute la durée de la guerre. Mais par là, elle reniait le fondement de sa propre existence, de sa propre politique (…) Elle a abandonné la «défense nationale» aux classes dominantes, se bornant à placer la classe ouvrière sous leur commandement et à assurer le calme pendant la durée de l’état de siège, c’est-à-dire qu’elle joue le rôle de gendarme de la classe ouvrière.» (p. 159)
Enfin, un des aspects importants du livre de Rosa est la mise en avant d’une perspective pour le prolétariat : celle de mettre fin à la guerre par son action révolutionnaire. De même qu’elle affirme (et elle cite des politiciens bourgeois qui étaient très clairs là-dessus) que la seule force qui aurait pu empêcher le déclenchement de la guerre était la lutte du prolétariat, elle revient sur la résolution du congrès de 1907 de l’Internationale confirmée par le congrès de 1912 (le congrès extraordinaire de Bâle) :
«Au cas où le guerre éclaterait néanmoins, c’est le devoir de la social-démocratie d’agir pour la faire cesser promptement et de s’employer, de toutes ses forces, à exploiter la crise économique et politique provoquée par la guerre pour mettre en mouvement le peuple et hâter de la sorte l’abolition de la domination capitaliste.» (p. 164)
Rosa s’appuie sur cette résolution pour dénoncer la trahison de la social-démocratie qui fait exactement le contraire de ce qu’elle s’était engagée à faire. Elle en appelle à l’action unie du prolétariat mondial pour mettre fin à la guerre tout en soulignant tout le danger que celle-ci représente pour l’avenir du socialisme :
«Ici encore la guerre actuelle s’avère, non seulement un gigantesque assassinat, mais aussi un suicide de la classe ouvrière européenne. Car ce sont les soldats du socialisme, les prolétaires d’Angleterre, de France, d’Allemagne, de Russie, de Belgique qui depuis des mois se massacrent les uns les autres sur l’ordre du capital, ce sont eux qui enfoncent dans leur cœur le fer meurtrier, s’enlaçant d’une étreinte mortelle, chancelant ensemble, chacun entraînant l’autre dans la tombe (…)
Cette folie cessera le jour où les ouvriers d’Allemagne et de France, d’Angleterre et de Russie se réveilleront enfin de leur ivresse et se tendront une main fraternelle, couvrant à la fois le chœur bestial des fauteurs de guerre impérialistes et le rauque hurlement des hyènes capitalistes, en poussant le vieux et puissant cri de guerre du Travail : prolétaires de tous les pays, unissez-vous !» (p. 215)
Il faut noter que dans son livre, Rosa Luxemburg, comme d’ailleurs l’ensemble de la gauche du parti qui s’oppose fermement à la guerre (contrairement au «centre marxiste» animé par Kautsky qui avec des contorsions justifie la politique de la direction) ne tire pas toutes les conséquences de la résolution de Bâle en mettant en avant le mot d’ordre que Lénine exprime très clairement : «Transformation de la guerre impérialiste en guerre civile». C’est d’ailleurs pour cela qu’à la conférence de Zimmerwald, en septembre 1915, les représentants du courant qui s’est regroupé autour de Rosa Luxembourg et de Karl Liebknecht se retrouvent sur la position «centriste» représentée par Trotsky et non sur celle de la gauche représentée par Lénine. Ce n’est qu’à la conférence de Kienthal, en avril 1916, que ce courant rejoindra la gauche de Zimmerwald.
Cependant, même avec leurs insuffisances, il faut souligner le travail considérable effectué par Rosa Luxemburg et ses camarades au cours de cette période, un travail qui allait donner ses fruits en 1918.
Mais avant que d’évoquer cette dernière période, il importe de signaler le rôle extrêmement important joué par le camarade de Rosa, qui a été assassiné le même jour par la bourgeoisie, Karl Liebknecht. Ce dernier, tout en partageant les mêmes positions politiques, n’avait pas la même profondeur théorique que Rosa ni le même talent dans les articles qu’il écrivait (c’est pour cela que, par faute de place, nous n’avons pas cité ici ses écrits). Mais son attitude faite de courage et de détermination, ses dénonciations extrêmement claires de la guerre impérialiste, de tous ceux qui, ouvertement ou avec des contorsions, la justifiaient de même que ses dénonciations des illusions pacifistes a fait de Liebknecht au cours de cette période le symbole de la lutte prolétarienne contre la guerre impérialiste. Sans entrer dans les détails de son action (voir à ce sujet notre article «Les révolutionnaires en Allemagne pendant la première guerre mondiale», Revue Internationale n° 81), il nous faut ici rappeler un épisode significatif de son action : sa participation, le 1er mai 1916, à Berlin, à une manifestation de 10 000 ouvriers contre la guerre au cours de laquelle il prend la parole et crie : «A bas la guerre ! A bas le gouvernement !» ce qui provoque immédiatement son arrestation. Celle-ci va être à l’origine de la première grève politique de masse en Allemagne qui est déclenchée fin mai. Il faut également noter que face au tribunal militaire qui le juge le 28 juin, il revendique pleinement son action, sachant que cette attitude ne pourra qu’aggraver sa condamnation ; et il en profite pour dénoncer une nouvelle fois la guerre impérialiste, le capitalisme qui en est responsable et pour appeler les ouvriers au combat. Désormais, dans l’ensemble des pays d’Europe, le nom et l’exemple de Liebknecht deviennent un des drapeaux de ralliement de ceux, en premier lieu Lénine, qui se battent contre la guerre impérialiste et pour la révolution prolétarienne.
La révolution prolétarienne et la fin de la guerre
La perspective inscrite dans la résolution du congrès de Bâle trouve sa première concrétisation en février 1917 en Russie avec la révolution qui renverse le régime tsariste. Après trois ans de tueries et de misère indicibles, le prolétariat commence à relever puissamment la tête au point de renverser le tsarisme et de s’engager vers la révolution socialiste. Nous ne reviendrons pas ici sur les événements de Russie que nous avons traités récemment dans notre revue [4] [3520]. En revanche, il importe de signaler que ce n’est pas seulement dans ce pays qu’en cette année 1917 les prolétaires en uniforme se révoltent contre la barbarie guerrière. C’est peu après la révolution de février que se développent dans plusieurs armées du front des mouvements massifs de mutineries. C’est ainsi que les trois autres principaux pays de l’Entente, la France, la Grande-Bretagne et l’Italie, connaissent d’importantes mutineries qui conduisent les gouvernements à exercer une répression sanglante. En France, environ 40 000 soldats désobéissent collectivement aux ordres, une partie d’entre eux tentant même de marcher sur Paris où se déroulent au même moment des grèves ouvrières dans les usines d’armements. Cette convergence entre les luttes de classe à l’arrière et la révolte des soldats est probablement une des raisons qui explique la modération avec laquelle la bourgeoisie française exerce sa répression : sur les 554 condamnés à mort par les cours martiales, il n’y aura qu’une cinquantaine de fusillés. Cette «modération» ne sera pas de mise du côté anglais et italien où il y aura respectivement 306 et 750 exécutions.
En novembre dernier, au moment des célébrations de la fin de la première guerre mondiale, la bourgeoisie, et particulièrement les partis social-démocrates qui aujourd’hui majoritairement gouvernent les pays européens, nous ont donné à propos des mutineries de 1917 un nouvel aperçu de leur hypocrisie et de leur volonté de détruire totalement la mémoire du prolétariat. En Italie, le ministre de la défense a fait savoir qu’il fallait «rendre leur honneur» aux mutins fusillés et en Grande-Bretagne on leur a rendu un «hommage public». Quant au chef du gouvernement «socialiste» français, il a décidé de «réintégrer pleinement dans la mémoire collective nationale» les «fusillés pour l’exemple». Dans l’hypocrisie, le «camarade» Jospin fait vraiment très fort car qui était ministre des armements et ministre de la guerre à la même époque ? Les «socialistes» Albert Thomas et Paul Painlevé.
En fait, ce qu’oublient de dire les «socialistes» qui aujourd’hui font tous ces discours pacifistes et «émus» sur les atrocités de la première guerre mondiale, c’est qu’en 1914, dans les principaux pays européens, ils furent en première ligne pour embrigader les prolétaires et les envoyer au carnage. En voulant «réintégrer dans la mémoire nationale» les mutins de la première guerre mondiale, la bourgeoisie de gauche essaie de faire oublier qu’ils appartiennent à la mémoire du prolétariat mondial [5] [3521].
Quant à la thèse officielle des hommes politiques, comme des historiens aux ordres, affirmant que les révoltes de 1917 étaient dirigées contre un commandement incompétent, elle a du mal à résister au fait que c’est dans les deux camps et sur la plupart des fronts qu’elles se sont produites : faut-il croire que la première guerre mondiale n’a été conduite que par des incapables ? Qui plus est, ces révoltes se sont produites alors que dans les autres pays on commençait à avoir des nouvelles de la révolution de février en Russie [6] [3522]. En fait, ce que la bourgeoisie essaie de masquer, c’est le contenu prolétarien indiscutable des mutineries et le fait que la seule véritable opposition à la guerre ne peut provenir que de la classe ouvrière.
Au cours de la même période, le mouvement de mutineries frappe le pays où se trouve le prolétariat le plus puissant et dont les soldats sont en contact direct avec les soldats russes sur le front de l’Est : l’Allemagne. Les événements de Russie soulèvent beaucoup d’enthousiasme parmi les troupes allemandes et sur le front les cas de fraternisation sont fréquents [7] [3523]. C’est dans la flotte que débutent les mutineries durant l’été 1917. Le fait que ce soient des marins qui mènent ces mouvements est significatif : la presque totalité d’entre eux sont des prolétaires en uniforme (alors que parmi les fantassins, la part des paysans est beaucoup plus élevée). Parmi les marins, l’influence des groupes révolutionnaires, et notamment des Spartakistes est significative et va en s’accroissant. De façon claire, ces derniers mettent en avant la perspective pour l’ensemble de la classe ouvrière :
«La révolution russe victorieuse unie à la révolution allemande victorieuse sont invincibles. A partir du jour où s’effondrera le gouvernement allemand - y compris le militarisme allemand - sous les coups révolutionnaires du prolétariat s’ouvrira une ère nouvelle : une ère dans laquelle les guerres, l’exploitation et l’oppression capitalistes devront disparaître à tout jamais.» (Tract spartakiste, avril 1917)
«(…) ce n’est que par la révolution et la conquête de la république populaire en Allemagne qu’il sera mis un terme au génocide et que la paix générale sera instaurée. Et ce n’est qu’ainsi que la révolution russe pourra être sauvée.
Seule la révolution prolétarienne mondiale peut liquider la guerre impérialiste mondiale» (Lettre de Spartacus n° 6, août 1917).
Et c’est ce programme qui va de plus en plus animer les combats croissants que mène la classe ouvrière en Allemagne. Dans le cadre de cet article nous ne pouvons détailler l’ensemble de ces combats (voir à ce sujet notre série d’articles de la Revue Internationale à partir du n° 81) mais il est nécessaire de rappeler qu’une des raisons qui a poussé Lénine et les bolcheviks en octobre 1917 à considérer que les conditions étaient mûres en Russie pour la prise du pouvoir par le prolétariat est justement le développement de la combativité des ouvriers et des soldats en Allemagne.
Ce qu’il faut surtout mettre en évidence c’est comment l’intensification des luttes ouvrières et le soulèvement des soldats sur un terrain prolétarien a constitué l’élément déterminant dans la demande d’armistice par l’Allemagne et donc dans la fin de la guerre mondiale.
«Aiguillonnée par le développement révolutionnaire en Russie et faisant suite à plusieurs mouvements avant-coureurs, une grève de masse éclate en avril 1917. En janvier 1918 environ un million d’ouvriers se jettent dans un nouveau mouvement de grève et fondent un conseil ouvrier à Berlin. Sous l’influence des événements en Russie la combativité sur les fronts militaires s’effrite de plus en plus au cours de l’été 1918. Les usines bouillonnent ; de plus en plus d’ouvriers s’assemblent dans les rues afin d’intensifier la riposte à la guerre. («La Révolution allemande» II, Revue Internationale n° 82, page 15)
Le 3 octobre 1918, la bourgeoisie change de chancelier. Le prince Max von Baden remplace le comte Georg Hertling et il fait entrer le Parti Social-Démocrate (SPD) au gouvernement. Les révolutionnaires comprennent immédiatement le rôle échu à la social-démocratie. Rosa Luxemburg écrit :
«Le socialisme de gouvernement, par son entrée au ministère, se pose en défenseur du capitalisme et barre le chemin à la révolution prolétarienne montante».
A cette même période, les spartakistes tiennent une conférence avec d’autres groupes révolutionnaires qui lance un appel aux ouvriers :
«Il s’agit pour nous de soutenir par tous les moyens les mutineries de soldats, de passer à l’insurrection armée, d’élargir l’insurrection armée à la lutte pour tout le pouvoir au profit et des soldats et d’assurer la victoire grâce aux grèves de masse des ouvriers. Voilà la tâche des tout prochains jours et semaines à venir.»
«Le 23 octobre Liebknecht est libéré de prison. Plus de 20 000 ouvriers viennent le saluer à son arrivée à Berlin. (…)
Le 28 octobre débute en Autriche, dans les provinces tchèques et slovaques comme à Budapest, une vague de grèves qui conduit au renversement de la monarchie. Partout apparaissent des conseils ouvriers et de soldats, à l’image des soviets russes. (…)
Alors que le 3 novembre la flotte de Kiel doit prendre la mer pour continuer la guerre, les marins se révoltent et se mutinent. Des conseils de soldats sont aussitôt créés, suivis dans le même élan par la formation de conseils ouvriers. (…) Les conseils forment des délégations massives d’ouvriers et de soldats qui se rendent dans d’autres villes. D’énormes délégations sont envoyées à Hambourg, Brême, Flensburg, dans la Ruhr et même jusqu’à Cologne. Celles-ci s’adressent aux ouvriers réunis en assemblées et appellent à la formation de conseils ouvriers et de soldats. Des milliers d’ouvriers se déplacent ainsi des villes du Nord de l’Allemagne jusqu’à Berlin et dans d’autres villes en province. (…) En une semaine, des conseils ouvriers et de soldats surgissent dans les principales villes d’Allemagne et les ouvriers prennent eux-mêmes l’extension de leur mouvement en main.» (Ibid. pages 15 et 16)
A l’adresse des ouvriers de Berlin, les spartakistes publient le 8 novembre un appel où l’on peut lire :
«Ouvriers et soldats ! Ce que vos camarades ont réussi à accomplir à Kiel, Hambourg, Brême, Lübeck, Rostock, Flensburg, Hanovre, Magdebourg, Brunswick, Munich et Stuttgart, vous devez aussi réussir à l’accomplir. Car de ce que vous remporterez de haute lutte, de la ténacité et du succès de votre lutte, dépend la victoire de vos frères là-bas et dépend la victoire du prolétariat du monde entier. (…) Les objectifs prochains de votre lutte doivent être : (…)
- L’élection de conseils ouvriers et de soldats, l’élection de délégués dans toutes les usines et les unités de la troupe.
- L’établissement immédiat de relations avec les autres conseils ouvriers et de soldats allemands.
- La prise en charge du gouvernement par les commissaires des conseils ouvriers et de soldats.
- La liaison immédiate avec le prolétariat international et tout spécialement avec la République Ouvrière russe.
Vive la République socialiste !
Vive l’Internationale !»
Le même jour, un tract spartakiste appelle les ouvriers à descendre dans la rue : «Sortez des usines ! Sortez des casernes ! Tendez vous les mains ! Vive la république socialiste.»
«Aux premières heures du matin du 9 novembre le soulèvement révolutionnaire commence à Berlin. (…) Des centaines de milliers d’ouvriers répondent à l’appel du groupe Spartacus et du Comité exécutif [des conseils ouvriers], cessent le travail et affluent en de gigantesques cortèges de manifestations vers le centre de la ville. A leur tête marchent des groupes d’ouvriers armés. La grande majorité des troupes s’unit aux ouvriers manifestants et fraternise avec eux. A midi Berlin se trouve aux mains des ouvriers et des soldats révolutionnaires.» (Ibid. page 16)
Devant le palais des Hohenzollern Liebknecht prend la parole :
«Il nous faut tendre toutes nos forces pour construire le gouvernement des ouvriers et des soldats (...) Nous tendons la main aux ouvriers du monde entier et les invitons à achever la révolution mondiale. (...) je proclame la libre république socialiste d’Allemagne.»
Le soir même, les ouvriers et soldats révolutionnaires occupent l’imprimerie d’un journal bourgeois et permettent la publication du premier numéro de «Die rote Fahne» (Le Drapeau rouge), quotidien des Spartakistes, qui immédiatement met en garde contre le SPD : «Il n’y a aucune communauté d’intérêts avec ceux qui vous ont trahi quatre années durant. A bas le capitalisme et ses agents ! Vive la révolution ! Vive l’Internationale !»
Le même jour, face à la révolution montante, la bourgeoisie prend ses dispositions. Elle obtient l’abdication du Kaiser Guillaume II, proclame la République et elle nomme chancelier un dirigeant du SPD, Ebert. Celui-ci reçoit également l’investiture du comité exécutif des conseils dans lequel se sont fait désigner de nombreux fonctionnaires social-démocrates. Un «Conseil des commissaires du Peuple» est nommé composé de membres du SPD et de l’USPD (c’est-à-dire les «centristes» exclus du SPD en février 1917 en même temps que les spartakistes). En fait, derrière ce titre «révolutionnaire» (le même que celui du gouvernement des soviets en Russie) se cache un gouvernement parfaitement bourgeois qui va tout mettre en œuvre pour empêcher la révolution prolétarienne et préparer le massacre des ouvriers.
La première mesure que prend ce gouvernement est de signer l’armistice le jour après sa nomination (et alors que les troupes allemandes occupent encore les pays ennemis). Après l’expérience de la révolution en Russie où la poursuite de la guerre avait constitué le facteur décisif de mobilisation et de prise de conscience du prolétariat jusqu’au renversement du pouvoir bourgeois en octobre 1917, la bourgeoisie allemande sait pertinemment qu’elle doit arrêter immédiatement la guerre si elle ne veut pas connaître le même sort que la bourgeoisie russe.
Même si aujourd’hui les porte parole de la bourgeoisie cachent soigneusement le rôle de la révolution prolétarienne dans la fin de la guerre, c’est une réalité qui n’échappe pas aux historiens sérieux et scrupuleux (dont les écrits sont réservés à une petite minorité de lecteurs) :
«Décidé à poursuivre la négociation malgré Ludendorff, le gouvernement allemand va bientôt y être forcé. D’abord la capitulation autrichienne crée une nouvelle et terrible menace sur le sud du pays. Ensuite, et surtout, la révolution éclate en Allemagne. (…) Elle [la délégation allemande] signe l’armistice le 11 novembre, à 5h20, dans le fameux wagon de Foch. Elle le signe au nom du nouveau gouvernement qui la presse de se hâter. (…) La délégation allemande a obtenu de minces avantages qui, dit Pierre Renouvin, «ont le même but : laisser au gouvernement allemand des moyens de lutter contre le bolchevisme». En particulier, l’armée ne livrera que vingt-cinq mille mitrailleuses au lieu de trente mille. Elle pourra continuer à occuper la Ruhr, foyer de la révolution, au lieu que celle-ci soit ‘neutralisée’.» (Jean-Baptiste Duroselle, in Le Monde du 12 novembre 1968) [8] [3524]
Effectivement, une fois l’armistice signé, le gouvernement social-démocrate va développer toute une stratégie pour enrayer le mouvement prolétarien et l’écraser. Il va en particulier cultiver la division entre les soldats et les ouvriers d’avant-garde, les premiers estimant dans leur grande majorité qu’il n’y a pas lieu de poursuivre le combat puisque la guerre est terminée. De même, la social-démocratie va s’appuyer sur les illusions qu’elle maintient sur une bonne partie de la classe ouvrière pour isoler les Spartakistes des grandes masses ouvrières.
Nous ne pouvons ici passer en revue les détails de la période qui va de l’armistice aux événements qui ont conduit à l’assassinat de Rosa Luxemburg et de Karl Liebknecht (cette période fait l’objet de deux articles dans la Revue Internationale n° 82 et 83 dans notre série sur la révolution allemande). Cependant les écrits publiés quelques années plus tard par le général Groener, commandant en chef de l’armée fin 1918-début 1919, sont édifiants sur la politique menée par Ebert qui était en liaison quotidienne avec lui :
«Nous nous sommes alliés pour combattre le bolchevisme. (...) J’avais conseillé au Feldmarschall de ne pas combattre la révolution par les armes, parce qu’il était à craindre que compte tenu de l’état des troupes un tel moyen irait à l’échec. Je lui ai proposé que le haut commandement militaire s’allie avec le SPD vu qu’il n’y avait aucun parti disposant de suffisamment d’influence dans le peuple, et parmi les masses pour reconstruire une force gouvernementale avec le commandement militaire. (…) Il s’agissait en premier lieu d’arracher le pouvoir des mains des conseils ouvriers et de soldats de Berlin. Dans ce but une entreprise fut prévue. Dix divisions devaient entrer dans Berlin. Ebert était d’accord. (...) Nous avons élaboré un programme qui prévoyait, après l’entrée des troupes, le nettoyage de Berlin et le désarmement des Spartakistes. Cela fut aussi convenu avec Ebert, auquel je suis reconnaissant pour son amour absolu de la patrie. (...) Cette alliance fut scellée contre le danger bolchevik et le système des conseils.» (octobre-novembre 1925, Zeugenaussage)
C’est en janvier 1919 que la bourgeoisie a porté le coup décisif contre la révolution. Après avoir massé plus de 80 000 soldats autour de Berlin elle lance le 4 janvier une provocation en démettant de ses fonctions le préfet de police de Berlin Eichhorn, membre de l’USPD. D’immenses manifestations répondent à cette provocation. Alors que le congrès constitutif du Parti communiste d’Allemagne, avec à sa tête Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht, avait estimé 4 jours auparavant que la situation n’était pas encore mûre pour l’insurrection, ce dernier se laisse piéger et participe à un Comité d’Action qui appelle justement à l’insurrection. C’est un véritable désastre pour la classe ouvrière. Des milliers d’ouvriers, et particulièrement les Spartakistes, sont massacrés. Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht qui n’avaient pas voulu quitter Berlin sont arrêtés le 15 janvier et exécutés froidement, sans procès, par la soldatesque, sous le faux prétexte de «tentative de fuite». Deux mois plus tard, Leo Jogisches, ancien compagnon de Rosa et également dirigeant du parti communiste est assassiné dans sa prison.
Aujourd’hui, on comprend pourquoi la bourgeoisie, et particulièrement ses partis «socialistes», essaient de jeter le voile sur les événements qui ont mis fin à la guerre mondiale.
En premier lieu, les partis «démocratiques», et particulièrement les partis «socialistes», n’ont aucune envie qu’on dévoile leur rôle de massacreurs de la classe ouvrière, rôle qui est réservé dans les fables actuelles aux «dictatures fascistes» ou «communistes».
En second lieu, il importe de cacher au prolétariat que sa lutte constitue le seul véritable obstacle à la guerre impérialiste. Alors que partout dans le monde se poursuivent et s’intensifient les massacres, il faut absolument maintenir un sentiment d’impuissance des ouvriers face à cette situation. Il faut à tout prix les empêcher de prendre conscience que leurs luttes contre les attaques croissantes provoquées par une crise sans issue constituent le seul moyen d’empêcher que ces conflits ne se généralisent et ne viennent à terme les soumettre à une nouvelle barbarie guerrière comme celles qu’ils ont subies déjà deux fois au cours de ce siècle. Il faut continuer à les détourner de l’idée de révolution qu’on présente comme la mère des maux de ce siècle, alors que c’est son écrasement qui a permis que celui-ci soit le plus sanglant et barbare de l’histoire, alors qu’elle représente le seul espoir pour l’humanité.
Fabienne
[1] [3525] Rappelons que quelques semaines après leur assassinat, la première séance du premier congrès de l’Internationale communiste débutait par un hommage à ces deux militants et que, depuis, les organisations du mouvement ouvrier ont régulièrement salué leur mémoire.
[2] [3526] Pour un pays comme la France, ce sont 16,8% de ses mobilisés qui sont tués. La proportion est à peine plus faible pour l’Allemagne, 15,4%, mais elle s’élève à 22% pour la Bulgarie, 25% pour la Roumanie, 27% pour la Turquie, 37% pour la Serbie. Certaines catégories de combattants connaissent des hécatombes encore plus terribles : ainsi pour la France, elles représentent 25% dans l’infanterie et un tiers des jeunes hommes qui avaient 20 ans en 1914 a disparu. Dans ce pays, il a fallu attendre 1950 pour que la population retrouve son niveau du 1er août 1914. Par ailleurs, il faut avoir en tête la tragédie humaine de tous les invalides et mutilés. Parmi les mutilations, certaines sont réellement atroces : ainsi, uniquement du côté français on compte une vingtaine de milliers de «gueules cassées», des soldats complètement défigurés et qui n’ont pu connaître de réinsertion sociale au point qu’on a créé pour eux des institutions spéciales où ils ont vécu dans un ghetto le restant de leurs jours. Faut-il parler également des centaines de milliers de jeunes hommes qui sont revenus fous de la guerre et que les autorités ont préféré en général considérer comme des «simulateurs».
[3] [3527] De tous les côtés, les mensonges bourgeois rivalisent en grossièreté et infamie. «Dès août 1914, les Alliés dénonçaient les «atrocités» commises par les envahisseurs contre les populations de la Belgique et de la France du Nord : les «mains coupées» des enfants, les viols, les otages fusillés et les villages brûlés «pour l’exemple»… De leur côté, les journaux allemands publièrent quotidiennement le récit d’»atrocités» que les civils belges auraient commises contre des soldats allemands : yeux crevés, doigts coupés, captifs brûlés vifs.» («Réalité et propagande : la barbarie allemande», in L’Histoire de novembre 1998
[4] [3528] Voir les n° 88 à 91 de la Revue Internationale.
[5] [3529] Le première ministre français a cité dans son discours un vers de la «Chanson de Craonne» composée à la suite des mutineries. Il s’est cependant bien gardé de citer le passage qui dit :
«Ceux qu’ont le pognon, ceux là reviendront,
Car c’est pour eux qu’on crève.
Mais c’est fini, car les trouffions
Vont tous se mettre en grève.»
[6] [3530] Suite aux mutineries de l’armée française, une dizaine de milliers de soldats russes qui combattaient sur le front occidental aux côtés des soldats français ont été retirés du front et isolés jusqu’à la fin de la guerre dans le camp de La Courtine. Il ne fallait pas que l’enthousiasme qu’ils manifestaient pour la révolution qui se développait dans leur pays vienne contaminer les soldats français.
[7] [3531] Il faut noter que les fraternisations avaient commencé sur le front occidental quelques mois à peine après le début de la guerre et des départs la fleur au fusil avec les slogans : «A Berlin !» ou «Nach Paris !». «25 décembre 1914 : aucune activité de la part de l’ennemi. Pendant la nuit et au cours de la journée du 25, des communications s’établissent entre Français et Bavarois, de tranchée à tranchée (conversations, envoi par l’ennemi de billets flatteurs, de cigarettes…, visites même de quelques soldats aux tranchées allemandes)» (Journal de marche et des opérations de la 139e brigade) Dans une lettre du 1er janvier 1915 d’un général à un autre général on peut lire : «Il est à remarquer que les hommes restant trop longtemps au même endroit, finissent par trop connaître leurs voisins d’en face, et qu’il en résulte des conversations et parfois des visites qui ont la plupart du temps des conséquences fâcheuses.» Ces faits se poursuivent au cours de la guerre, notamment en 1917. Dans une lettre de novembre 1917 interceptée par le contrôle postal, un soldat français écrit à son beau-frère : «Nous sommes à vingt mètres des Boches, mais ils sont assez gentils car ils nous passent des cigares et des cigarettes, et nous on leur fait passer du pain.» (citations tirées de L’Histoire de janvier 1988) .
[8] [3532] Jean-Baptiste Duroselle et Pierre Renouvin sont deux historiens très réputés, spécialistes de cette période.
Questions théoriques:
- Impérialisme [321]
Heritage de la Gauche Communiste:
- La Révolution prolétarienne [1149]
Le communisme n'est pas un bel idéal, il est à l'ordre du jour de l'histoire [6° partie]
- 3973 reads
1920 : BOUKHARINE ET LA PÉRIODE DE TRANSITION
Dans le dernier article de cette série (Revue internationale n°95), nous avons examiné de près le programme de 1919 du Parti communiste de Russie, estimant qu’il représente l’étalon du plus haut niveau de compréhension atteint par les révolutionnaires de cette époque quant aux formes, aux méthodes et aux buts de la transformation communiste de la société. Mais un tel examen serait incomplet si l’on ne prenait pas en compte, à côté des mesures pratiques mises en avant dans le programme du PCR, le plus sérieux effort d’élaboration d’un cadre théorique plus général pour analyser les problèmes de la période de transition. Ce dernier, comme le programme lui-même, a été rédigé par Nicolas Boukharine que Lénine considérait comme «le théoricien du parti le plus précieux et le plus important» ; et le texte en question est L’Économique de la période de transition, rédigé en 1920. Selon le responsable de l’édition en anglais de ce livre, en 1971, «Jusqu’à l’introduction du plan quinquennal en 1928 qui a coïncidé avec la chute de Boukharine comme leader du Combiner, l’Économique de la période de transition était considéré comme une oeuvre théorique du parti bolchevik d’une importance comparable à celle de L’État et la révolution de Lénine.» [1] [3533]
Comme nous le verrons, le livre de Boukharine contient certaines faiblesses fondamentales qui ne lui ont pas permis de passer l’épreuve du temps contrairement à L’État et la révolution. Il reste, cependant, une importante contribution à la théorie marxiste.
Une véritable contribution à la théorie marxiste
Boukharine s’était fait connaître pendant la grande guerre impérialiste lorsque, avec Piatakov et d’autres, il fut un membre actif du groupe d’exilés bolcheviks en Suisse (le groupe appelé «groupe Baugy») qui se situait à l’extrême gauche du parti. En 1915, il a publié L’impérialisme et l’économie mondiale dans lequel il montre que le capitalisme, précisément en devenant un système global avec une économie mondiale, avait créé les conditions de son propre dépassement; mais que, loin de le faire évoluer pacifiquement vers un ordre mondial harmonieux, cette «globalisation» avait plongé le système dans l’agonie de l’effondrement violent. Cette ligne de pensée était parallèle à celle de Rosa Luxemburg. Dans son livre L’accumulation du capital (1913), Luxemburg, avec des références plus approfondies aux contradictions fondamentales du capitalisme, avait démontré pourquoi la période d’expansion du capitalisme arrivait maintenant à son terme. Comme Luxemburg, Boukharine a montré que la forme concrète du déclin du capitalisme était l’exacerbation de la concurrence inter-impérialiste, culminant dans la guerre mondiale. L’impérialisme et l’économie mondiale a aussi fait date dans l’analyse marxiste du capitalisme d’État, le régime économique et politique totalitaire requis par l’exacerbation des antagonismes impérialistes «à l’extérieur» et des antagonismes sociaux «à l’intérieur». La subordination relative de la concurrence au sein de chaque pays capitaliste, insistait Boukharine, n’est que le corollaire de l’accentuation du conflit entre les «trusts capitalistes d’État» nationaux pour la domination du marché mondial.
Dans son article «Vers une théorie de l’État impérialiste» (1916), Boukharine allait plus loin dans les implications de ces développements. La montée de cette pieuvre capitaliste d’État national, qui étendait ses tentacules à tous les aspects de la vie sociale et économique, avait amené Boukharine (tout comme Pannekoek l’avait fait quelques années plus tôt) à revoir les classiques du marxisme et à revenir à la défense de la vision que le prolétariat n’aurait pas à conquérir un tel État mais devrait lutter pour sa «destruction révolutionnaire» et pour la création de nouveaux organes de pouvoir politique. Une autre conclusion tout aussi importante, tirée de cette analyse de la nouvelle phase du capitalisme, est résumée dans les «Thèses» que le groupe Baugy a présentées à la conférence de Berne du parti bolchevik en 1915. Ici, Boukharine et Piatakov, dans la même ligne que les arguments présentés par Luxemburg au même moment, appelaient le parti à rejeter le slogan de «l’autodétermination nationale» et de «la libération nationale» :
«L’époque impérialiste est une époque d’absorption des petits États par les grands États nationaux. (...) Il est donc impossible de lutter contre l’inféodation des nations autrement qu’en luttant contre l’impérialisme, donc (ergo) par des luttes contre le capital financier, donc (ergo) contre le capitalisme en général. Toute déviation de cette voie, toute mise en avant de tâches «partielles», de «libération des nations» dans le royaume de la civilisation capitaliste, signifie dévier les forces prolétariennes de la solution réelle du problème.» [2] [3534]
Dans un premier temps, Lénine fut furieux contre Boukharine sur les deux points. Mais s’il n’a jamais changé d’opinion sur la question nationale, il a été peu à peu convaincu par ce qu’il avait taxé, à l’origine, de position «semi-anarchiste» de Boukharine sur l’État lorsqu’il a exposé sa nouvelle vision dans L’État et la révolution en 1917.
Il est donc clair qu’à cette étape de germination et de floraison de la révolution prolétarienne provoquée par la guerre mondiale, Boukharine était à la pointe même de l’effort marxiste pour comprendre les nouvelles conditions apportées par la décadence du capitalisme et nombre de ses contributions théoriques les plus importantes apparaissent non seulement dans l’Économique de la période de transition mais y sont aussi plus élaborées.
En premier lieu, il faut considérer le livre de Boukharine de pair avec d’autres travaux féconds tels que La révolution prolétarienne et le renégat Kautsky de Lénine ainsi que Terrorisme et communisme de Trotsky qui constituaient la réponse des bolcheviks au marxisme abâtardi de Kautsky. Celui-ci était passé d’une position centriste et pacifiste à celle d’une défense totale de l’ordre bourgeois contre la menace de la révolution. Malgré cela, il se proclamait toujours le roi de l’orthodoxie marxiste. Lénine a essentiellement dénoncé la défense que faisait Kautsky de la démocratie bourgeoise contre la démocratie prolétarienne des soviets, alors que, dans son livre, Trotsky s’était centré sur le problème de la violence révolutionnaire. Pour sa part, Boukharine avait élaboré L’impérialisme et l’économie mondiale ainsi que d’autres travaux similaires comme une polémique contre la théorie de Kautsky du «super-impérialisme» qui prétendait que le capitalisme avançait vers un ordre mondial unifié dans lequel la guerre ne pourrait être qu’une aberration. Dans l’Économique de la période de transition, il se proposait de rétablir la conception marxiste de la transformation révolutionnaire de la société contre la vision idyllique de kautsky d’une transition pacifique et ordonnée au socialisme. Faisant écho à Marx, Boukharine insiste sur le fait que, pour qu’un nouvel ordre social puisse émerger, l’ancien ordre doit traverser une période de profonde crise et d’effondrement; et c’est encore plus vrai pour le passage du capitalisme au communisme : «...l’expérience de toutes les révolutions qui jouèrent un rôle positif important précisément du point de vue du développement des forces productives, prouve que ce développement fut réalisé au prix de leur gaspillage et de leur destruction... S’il en est ainsi... il est clair a priori que la révolution prolétarienne s’accompagne inévitablement d’un affaiblissement extrêmement profond des forces productives car aucune révolution n’entraîne une rupture aussi profonde des rapports anciens et la reconstruction de ceux-ci sur une nouvelle base.» [3] [3535]
L’Economique de la période de transition est dans une large mesure une défense de la révolution russe malgré les «coûts» considérables qu’elle a engendrés. Il dénonce aussi tous ceux qui se servaient de ces «coûts» pour pousser les ouvriers à être de bons citoyens, respectueux des lois bourgeoises et pour lesquels le seul espoir de changement social ne résidait que dans les urnes électorales.
Deuxièmement, l’Economique de la période de transition réitère l’argument selon lequel le capitalisme, bien qu’il soit effectivement devenu une économie mondiale, est incapable d’organiser les forces productives de l’humanité - en tant que sujet conscient et unifié - dans la mesure où c’est précisément quand la concurrence capitaliste atteint ce stade qu’elle est poussée à ses conséquences les plus extrêmes et les plus catastrophiques. Mais sur ce point, Boukharine va plus loin et en arrive à faire un certain nombre d’anticipations brillantes sur le mode de fonctionnement du capitalisme dans son époque de décadence, notamment à travers sa tendance naturelle à survivre au moyen de la stérilisation et de la destruction complète des forces productives avant tout à travers l’économie de guerre et la guerre elle-même. C’est là que Boukharine introduit le concept de «reproduction élargie négative» - formule qu’on peut éventuellement remettre en question mais il met le doigt sur une réalité fondamentale. Il en fait de même lorsqu’il montre que, malgré sa croissance apparente, la production de guerre, en réalité, ne signifie pas une extension mais une destruction de capital : «La production de guerre a une tout autre signification : un canon ne se transforme pas en élément d’un nouveau cycle productif; la poudre explose dans l’air et ne revient sous aucune forme nouvelle dans le cycle de production suivant. Tout au contraire. L’effet économique de ces éléments in actu est une grandeur purement négative (...). Examinons par exemple les moyens de consommation qui entretiennent l’armée. Dans ce cas également, on observe la même chose. Les moyens de consommation n’engendrent pas alors de forces de travail puisque les soldats ne figurent pas dans le processus de production ; ils en sont exclus, ils sont situés en dehors du processus de production (...) le processus de reproduction revêt avec la guerre un caractère "déformé", régressif, négatif : dans tous les cycles productifs ultérieurs, la base réelle de la production devient toujours plus étroite ; le "développement" s’accomplit selon une spirale qui ne s’élargit pas, mais qui rétrécit constamment.» [4] [3536] Dans le capitalisme décadent cette spirale toujours plus étroite constitue la réalité essentielle de l’activité économique, même en dehors des périodes de guerre ouverte totale, à la fois à cause de la tendance à l’économie de guerre permanente et parce que, de plus en plus, le capitalisme finance sa «croissance» à travers le stimulant totalement artificiel de l’endettement. La vision de Boukharine est une brillante réfutation de tous les adorateurs de la croissance économique qui se rient de la notion de décadence du capitalisme parce qu’ils sont incapables de voir l’essence décadente, fictive de cette croissance.
Également sur la question du capitalisme d’État, l’Économique de la période de transition reprend des formulations antérieures sur le capitalisme d’État, le présentant comme la forme caractéristique de l’organisation politique du capital dans son époque de déclin. Boukharine rappelle la double fonction du capitalisme d’Etat : d’une part limiter la concurrence économique au sein de chaque capital national, ce qui crée les meilleures conditions pour assumer la concurrence économique et surtout la concurrence militaire sur l’arène mondiale ; d’autre part il s’agit de préserver la paix sociale dans une situation où les souffrances engendrées par la crise économique et la guerre tendent à pousser le prolétariat vers une confrontation avec le régime bourgeois. Il faut particulièrement souligner comment Boukharine met en évidence l’arme la plus efficace dont le capitalisme d’Etat s’est doté pour maintenir l’ordre existant à travers l’annexion des anciennes organisations ouvrières, leur incorporation dans l’Etat Léviathan : «...la méthode de transformation était la même méthode de subordination à l’Etat bourgeois omniprésent. La trahison des partis socialistes et des syndicats s’exprima précisément en ceci qu’ils se mirent au service de l’Etat bourgeois, qu’ils furent à vrai dire étatisés par cet Etat impérialiste, qu’ils se transformèrent en «section ouvrière» de la machine militaire.» [5] [3537]
Cette lucidité sur les caractéristiques et les formes de capitalisme en déclin s’accompagnait d’une compréhension authentique des méthodes et des buts de la révolution prolétarienne. L’Economique de la période de transition montre qu’une révolution ayant pour but de remplacer les lois aveugles de la marchandise par la régulation consciente de la vie sociale assumée par une humanité libérée, ne peut être qu’une révolution consciente, fondée sur l’auto-activité et l’auto-organisation du prolétariat à travers ses nouveaux organes de pouvoir politique que sont les conseils et les comités d’usine. En même temps, la révolution engendrée par l’effondrement de l’économie capitaliste mondiale ne pouvait être qu’une révolution mondiale et ne pouvait parvenir à ses buts ultimes qu’à l’échelle de tout le globe. Les paragraphes de conclusion de Boukharine résument les espoirs internationalistes authentiques de l’époque, anticipant un futur dans lequel «pour la première fois depuis qu’existe l’humanité, un système construit harmonieusement dans toutes ses parties sera créé ; il ne connaît ni l’anarchie sociale, ni l’anarchie dans la production. Il élimine à jamais la lutte des hommes entre eux, et rassemble toute l’humanité en une seule collectivité qui embrasse rapidement les richesses incalculables de la nature.» [6] [3538]
Confondre l’embryon et l’être humain achevé
La reconnaissance des moyens et des buts authentiques de la révolution prolétarienne ne peut cependant rester au niveau des généralités ; elle doit se vérifier concrètement dans le processus révolutionnaire lui-même -ce qui fut extrêmement difficile dans le cas de la révolution russe qui a occasionné une expérience douloureuse et des années de réflexion. Globalement le travail de tirer et approfondir les leçons de la révolution russe a été mené par la Gauche communiste dans le sillage de la défaite de la révolution. Mais, même dans le feu de la révolution et au sein du parti bolchevik lui-même, se sont élevées des voix critiques qui jetaient déjà les bases de cette réflexion future. Cependant, bien que le nom de Boukharine fut généralement lié à l’opposition communiste de gauche dans le parti bolchevik en 1918, le Boukharine de l’Economique de la période de transition s’était, en 1920, déjà embarqué dans une trajectoire qui devait l’éloigner de la Gauche communiste dans son ensemble. Son ouvrage reflète cela en ce que, à côté de ses apports significatifs à la théorie marxiste, il a un côté profondément «conservateur» qui l’éloigne de la critique radicale du statu quo - y compris le statu-quo «révolutionnaire» - et le pousse à faire une apologie des choses telles qu’elles sont. Pour être plus précis, Boukharine tendait à confondre les méthodes et les exigences du «communisme de guerre» avec l’émergence réelle du communisme lui-même. En cela, il n’était pas du tout le seul mais ne faisait que fournir un soubassement théorique à une illusion largement répandue. Il considérait une situation contingente et extrêmement difficile pour la révolution et il en déduisait certaines «lois» ou normes qui seraient universellement applicables à la période de transition dans son ensemble. Avant de poursuivre sur ces arguments, il est nécessaire de souligner que Boukharine fut très prompt à se défendre lui-même contre cela. En décembre 1921, il écrivait une postface à l’édition allemande qui commence ainsi : «Il s’est écoulé beaucoup de temps depuis que ce livre a été écrit. Depuis ce moment, ce qu’on appelle la "nouvelle orientation de la politique économique" (NEP) a été introduite en Russie : pour la première fois, l’industrie socialisée, l’économie petite-bourgeoise, l’entreprise capitaliste privée et les entreprises "mixtes" ont été placées dans un rapport économique correct. Ce tournant russe spécifique, dont la condition préliminaire profonde est le caractère paysan-agraire du pays, a incité quelques-uns de mes ingénieux critiques à prétendre que je devrais refaire ce livre de bout en bout. Ce point de vue part de l’ignorance complète de ces subtils individus qui ne comprennent pas, dans leur sainte naïveté, la différence qu’il y a entre une analyse abstraite qui décrit les choses et les processus selon leur "coupe idéale", selon l’expression de Marx, et la réalité empirique qui se complique de plus en plus au milieu de toutes les circonstances, de toute autre façon que dans la représentation abstraite. Je n’ai pas écrit une histoire économique de la Russie soviétique, mais plutôt une théorie générale de la période de transition, qui n’a pas accru le patrimoine intellectuel des journalistes par excellence et des "praticiens" mesquins, incapables de concevoir les problèmes généraux.» [7] [3539]
Ce que reproche Boukharine à ses critiques bourgeois est sans aucun doute valable. Il n’en reste pas moins que lui non plus, tout au long de l’Economique de la période de transition, ne réussit pas à saisir la différence entre la théorie générale et la réalité empirique. On peut donner un certain nombre d’exemples qui illustrent cette affirmation ; nous nous limiterons aux plus significatifs.
L’une des grandes illusions concernant la période de «communisme de guerre» était précisément l’idée qu’il s’agissait vraiment de communisme. Et l’une des principales sources de cette illusion était la disparition apparente de certaines caractéristiques du capitalisme telles que la monnaie et les salaires. C’est la même illusion - allant de pair avec l’étatisation de vastes secteurs de l’économie - qui a fait naître plus tard l’idée que la NEP de 1921 représentait un pas en arrière vers le capitalisme dans la mesure où elle a restauré une quantité considérable de propriété privée formelle et a rétabli ouvertement l’économie marchande. En fait, la disparition de l’argent et des salaires dans la période de 1918-20 n’était en aucune façon le résultat d’une politique délibérée et planifiée à l’avance de la part du pouvoir des soviets. Elle a plutôt été l’expression directe de l’effondrement catastrophique de l’économie face au blocus économique, à l’invasion impérialiste et à la guerre civile interne. Elle allait de pair avec l’extension de la famine, de la maladie, la diminution de la population dans les villes et la décimation physique et sociale de la classe ouvrière. Evidemment, ce «coût» très élevé fut imposé à la révolution par la haine féroce de classe de la bourgeoisie mondiale. Le prolétariat l’a volontairement accepté en faisant les sacrifices les plus gigantesques et les plus héroïques pour assurer l’écrasement militaire des forces de la contre-révolution. Mais comme nous le verrons plus loin, le «coût» le plus important de cette lutte a été l’affaiblissement rapide de la classe ouvrière et de sa dictature sur la société. Confondre cette situation terrible avec la construction consciente de la société communiste est une erreur extrêmement grave ; et comme le montre le passage suivant, Boukharine a commis cette erreur :
«Ce phénomène, à son tour, est aussi lié à l’écroulement du système monétaire. L’argent représente ce lien social matériel, ce noeud auquel est lié tout le système marchand développé de la production. Il s’entend qu’au cours de la période de transition, dans le processus d’anéantissement du système marchand comme tel, un processus d’"auto-négation" de l’argent s’engage. Ce processus s’exprime en premier lieu dans ce qu’on appelle la "dépréciation monétaire", puis dans le fait que la distribution des signes monétaires devient indépendante de la répartition du produit, et inversement. La monnaie cesse d’être un équivalent universel et devient un signe conventionnel de la circulation des produits, excessivement imparfait.
Le salaire devient une grandeur formelle sans contenu. Dès que la classe ouvrière devient classe dominante, le travail salarié disparaît. La production socialisée ne comporte pas de travail salarié. Et pour autant qu’il n’existe pas de travail salarié, il n’existe aucun salaire comme prix de la force de travail vendue au capitaliste. Il ne subsiste que la forme extérieure du salaire - la forme monétaire qui s’achemine, ainsi que le système monétaire, vers son autodestruction. Dans le système de la dictature prolétarienne, "l’ouvrier" obtient une part du travail social (en russe "payok") et non plus un salaire.» [8] [3540]
Il est évident que Boukharine confond ici plusieurs choses. D’abord, il confond la période de guerre civile (la période de lutte à mort entre le prolétariat et la bourgeoisie) avec la véritable période de transition qui ne peut commencer son travail propre, constructif qu’après que la guerre civile a été gagnée à l’échelle mondiale. Deuxièmement, et en conséquence, il confond l’effondrement du système monétaire en tant que résultat de l’effondrement économique (la dévaluation, la pénurie) avec le véritable dépassement de l’économie marchande qui ne peut être véritablement réalisé qu’avec l’unification communiste de l’ensemble de la société et l’émergence d’une société d’abondance. Sinon, toute «abolition» de l’argent et des salaires dans une région donnée reste sous la domination globale de la loi de la valeur et ne garantit en aucune façon un mouvement automatique vers le communisme. Pourtant, Boukharine donne clairement l’impression qu’en Russie ce stade espéré a déjà été atteint (il utilise même un mot russe spécifique pour cela, «payok», et met des guillemets à «ouvrier», laissant entendre que ce dernier ne fait plus partie des exploités). Il s’agit, dans ce passage, de l’erreur politique la plus dangereuse : l’idée qu’après avoir conquis le pouvoir politique, établi sa dictature politique et s’être débarrassé de la propriété privée des moyens de production, le prolétariat n’est plus exploité et qu’il n’y a plus de travail salarié. Boukharine est encore plus explicite ailleurs lorsqu’il écrit : «Les rapports de production capitalistes sont totalement impensables sous une domination politique de la classe ouvrière.» [9] [3541] Très radicales en apparence, de telles formulations en viennent en fait à justifier l’exploitation accrue de la classe ouvrière.
Avant de poursuivre sur cet aspect, il est instructif de donner un autre exemple d’erreur méthodologique de la part de Boukharine. Le «communisme de guerre» était également caractérisé par l’application de solutions militaires à des aires de plus en plus vastes de la vie de la révolution - d’une manière plus insidieuse dans les aires où il était vital que les aspects politiques prennent le pas sur les aspects militaires. L’une des plus importantes d’entre elles concerne l’extension internationale de la révolution. Un bastion prolétarien qui s’est établi dans une région ne peut étendre la révolution en s’imposant militairement à d’autres secteurs de la classe ouvrière mondiale ; la révolution s’étend avant tout par des moyens politiques, par la propagande, par l’exemple, en appelant les ouvriers du monde à se dresser contre leur propre bourgeoisie. Et, concrètement, au plus haut de la vague révolutionnaire qui a débuté en 1917, c’est exactement ainsi que la révolution s’est étendue. Mais en 1920, la révolution russe faisait déjà l’expérience des conséquences mortelles de l’isolement, de la défaite des assauts révolutionnaires dans les autres pays. Face à cette situation dramatique, qui était couplée au succès militaire croissant de la guerre civile interne, nombreux furent les bolcheviks qui commencèrent à mettre leurs espoirs dans la possibilité d’étendre la révolution à d’autres pays par la force des armes. La marche de l’Armée rouge sur Varsovie s’est nourrie de ces espoirs. Et l’échec de cette «expérience», qui n’a abouti qu’à pousser les ouvriers polonais à faire un front commun avec leur bourgeoisie, devait montrer à quel point ces espoirs avaient été mal placés. D’un autre côté, Boukharine avait été un avocat fervent de la «guerre révolutionnaire» pendant les débats de 1918 sur le Traité de Brest-Litovsk; et son travail de 1920 faisait largement écho à sa position précédente. Une fois de plus, il prenait une réalité contingente de la situation en Russie, la nécessité d’une guerre de fronts à travers l’immense territoire de la Russie et la formation inévitable d’une armée permanente, et il en faisait une «norme» de toute la période de guerre civile : «Avec le développement du processus révolutionnaire en processus révolutionnaire mondial, la guerre civile se transforme en guerre de classes, du côté du prolétariat, par une "armée rouge" régulière.» [10] [3542] En fait c’est probablement l’inverse qui est vrai : plus la révolution s’étend mondialement, plus elle sera directement dirigée par les conseils ouvriers et leurs milices, plus les aspects politiques de la lutte prédomineront sur le militaire, moins il y aura besoin d’une «Armée rouge» pour mener la lutte. Une guerre de fronts n’est pas du tout un point fort du prolétariat. En termes purement militaires, la bourgeoisie aura toujours les meilleures armes. La force du prolétariat réside dans sa capacité à s’organiser, à étendre ses luttes, à gagner des secteurs toujours plus nombreux de la classe, à saper les forces armées de l’ennemi à travers la fraternisation et le développement de la conscience de classe. Dans un autre passage, Boukharine montre encore plus clairement qu’il a mis les choses à l’envers en faisant une identité entre la guerre de classe et les conflits militaires entre les Etats : «La guerre socialiste est une guerre de classe qu’il faut distinguer de la simple guerre civile. Celle-ci n’est pas une guerre entre deux organisations d’Etat. Dans la guerre de classe, en revanche, les deux parties sont organisées en pouvoir d’Etat : d’un côté, l’Etat du capital financier, de l’autre l’Etat du prolétariat.» [11] [3543] Cette idée est même encore plus dangereuse que la position qu’il avait mise en avant en 1919 quand il envisageait dans une large mesure une guerre défensive de résistance par des unités partisanes ; ici, la révolution mondiale elle-même devient une bataille apocalyptique entre deux types de pouvoir d’Etat. Il est significatif que Lénine qui s’était fermement opposé à Boukharine dans le débat sur Brest-Litovsk mais dont les notes marginales sur l’Economique de la période de transition soulèvent très peu de critiques de fond, n’ait eu aucune patience envers cet argument qu’il qualifia de «totale confusion».
L’aveuglement sur le danger de l’État
L’une des ironies de l’Economique de la période de transition, c’est que Boukharine qui avait exprimé un tel niveau de clarté dans la compréhension du capitalisme d’Etat, ne parvint absolument pas à reconnaître le danger du capitalisme d’Etat émergeant de la dégénérescence de la révolution. Nous avons déjà noté qu’il insistait particulièrement sur le fait que les rapports capitalistes ne pouvaient exister sous la dictature politique du prolétariat. Dans un autre passage, Boukharine dit explicitement que «puisque le capitalisme d’Etat est une fusion de l’Etat bourgeois et des trusts capitalistes, il est évident qu’on ne peut parler de "capitalisme d’Etat" sous la dictature du prolétariat, qui exclut en principe toute possibilité de ce genre.» [12] [3544] Et il développe cela avec l’argument suivant : «Dans le système de capitalisme d’Etat, le sujet administrant l’économie est l’Etat capitaliste, le capitalisme collectif. Sous la dictature du prolétariat, le sujet qui administre l’économie est l’Etat prolétarien, le collectif de la classe ouvrière organisée, "le prolétariat institué en pouvoir d’Etat". Dans le capitalisme d’Etat, le processus de production est une processus de production de plus-value, accaparée par la classe des capitalistes, qui a tendance à transformer cette valeur en surproduit. Avec la dictature prolétarienne, le processus de production sert de moyen pour la satisfaction planifiée des besoins sociaux. Le système du capitalisme d’Etat est la forme la plus accomplie de l’exploitation des masses par une poignée d’oligarques. Le système de la dictature du prolétariat rend inconcevable toute forme d’exploitation puisqu’elle transforme la propriété capitaliste collective et sa forme capitaliste-privée en "propriété" collective-prolétarienne. Par conséquent, en dépit d’une similitude formelle ces deux formes sont par essence diamétralement opposées.» [13] [3545] Et pour finir, «si l’on ne considère pas - contrairement aux représentants de la science bourgeoise - l’appareil d’Etat comme une organisation neutre et mystique, alors il faut aussi admettre que ce sont toutes les fonctions de l’Etat qui ont un caractère de classe. Il s’ensuit qu’il est nécessaire de distinguer rigoureusement la nationalisation bourgeoise de la nationalisation prolétarienne. La nationalisation bourgeoise conduit au système du capitalisme d’Etat. La nationalisation prolétarienne conduit à une structure étatique du socialisme. De même que la dictature prolétarienne est précisément la négation, l’opposé de la dictature bourgeoise, de même la nationalisation prolétarienne est la négation, la contradiction la plus radicale de la nationalisation bourgeoise.» ([14] [3546]
Parmi les nombreuses faiblesses de ces arguments, deux ressortent plus clairement. En premier, il y a, une fois de plus, la confusion, chez Boukharine, entre la période de la guerre civile où des bastions prolétariens peuvent exister temporairement dans des pays ou des régions et la période de transition à proprement parler qui commence une fois que le prolétariat a pris le pouvoir à l’échelle mondiale. Toute l’expérience de la révolution russe nous enseigne que l’appropriation par l’Etat des moyens de production, même par un Etat soviétique, ne supprime pas l’exploitation. Ce serait vrai dans une dictature prolétarienne opérant dans des conditions «optimales» (un processus révolutionnaire qui s’étend, un maximum de démocratie prolétarienne, etc.), sinon les exigences mondiales de la loi de la valeur exerceraient encore leur pression sans pitié sur les ouvriers. C’est encore plus vrai dans un bastion prolétarien souffrant de l’isolement et de privations matérielles extrêmes : dans de telles circonstances, une tendance à la dégénérescence apparaîtrait directement comme elle l’a fait en Russie. Les ouvriers seraient confrontés au danger imminent de perdre leur autorité et leur indépendance politiques tandis que, sur le terrain économique, ils seraient sujets à des exigences toujours plus draconiennes dans leurs conditions de vie et de travail. Parler en de telles circonstances de l’«impossibilité de l’exploitation» simplement parce que les capitalistes privés ont été expropriés, ne peut qu’affaiblir les efforts du prolétariat pour se défendre tant sur le plan économique que sur le plan politique.
Deuxièmement, l’histoire a vraiment confirmé que l’organe à travers lequel ce processus de dégénérescence s’exprime le plus facilement est précisément l’Etat «prolétarien». La définition simpliste, avancée par Boukharine, de l’Etat comme simple «instrument» de la classe dominante ignore la vision marxiste profonde selon laquelle l’origine historique de l’Etat ne réside pas dans sa création ex-nihilo par une classe dominante mais dans son «surgissement» à partir d’une situation d’antagonismes de classe croissants qui menacent de faire exploser la société. Ceci ne veut pas dire qu’il est d’une «neutralité mystique» : il surgit pour défendre un ordre divisé en classe et ne peut donc opérer qu’au nom de la classe économiquement dominante. Mais cela ne veut pas dire non plus que l’Etat n’est rien d’autre qu’un outil passif entre les mains d’une telle classe. En fait, le capitalisme d’Etat est précisément l’expression du fait que, dans son époque de déclin, le capital doit fonctionner de plus en plus «sans capitalistes». Même dans les prétendues économies mixtes, ce sont les capitalistes privés, les «capitalistes financiers» et les autres qui doivent subordonner leurs intérêts particuliers aux besoins impersonnels et généraux du capital national imposés avant tout par l’Etat.
Dans la période d’instabilité qui suit la destruction de l’ancien Etat bourgeois, un nouvel Etat surgit parce qu’existe encore la nécessité de maintenir la cohésion de la société, d’empêcher les antagonismes de classe de la faire éclater. Mais cette fois-ci, il n’y a pas de classe «économiquement dominante». La classe dominante est elle-même une classe exploitée, ne possédant pas de moyens de production. Par conséquent, il y a encore moins de raison de supposer que le nouvel Etat agisse automatiquement au nom du prolétariat. Il ne le fera que si la classe ouvrière est organisée, consciente et que si elle impose sa direction révolutionnaire au nouveau pouvoir étatique. Quand le moment de la révolution reflue, les forces de conservation sociale tendent à se réunir autour de l’Etat et à en faire leur instrument contre les intérêts du prolétariat. Et c’est pourquoi le capitalisme d’Etat reste un profond danger même sous la dictature du prolétariat.
Pour se garder de tels dangers, le prolétariat doit maintenir ses propres organes de classe aussi intacts et vivants que possible, autant ses organes unitaires (conseils, comités d’usine, etc.) que son avant-garde politique, le parti. Mais l’Economique de la période de transition, loin de comprendre qu’ils doivent éviter de se mêler à l’Etat, appelle ces organes de classe authentiques du prolétariat à fusionner avec lui, à se subordonner entièrement à l’Etat : «Il nous faut alors poser le problème du principe général qu’anime le système organisationnel de l’appareil prolétarien, c’est-à-dire des rapports réciproques entre les différentes formes d’organisation prolétariennes. Il est clair, d’un point de vue formel, que la méthode nécessaire à la classe ouvrière est la même que celle de la bourgeoisie à l’époque du capitalisme d’Etat. Cette méthode d’organisation consiste en la coordination la plus universelle, c’est-à-dire avec l’organisation étatique de la classe ouvrière, avec l’Etat soviétique du prolétariat. "L’étatisation" des syndicats et l’étatisation effective de toutes les organisations de masse du prolétariat découle de la logique interne du processus de transformation lui-même. Les plus petites cellules de l’appareil ouvrier doivent se transformer en structure porteuse du processus général d’organisation qui sera dirigé de façon planifiée, et conduite par la raison collective de la classe ouvrière qui trouve son incarnation matérielle dans l’organisation suprême et universelle, celle de l’appareil d’Etat. Le système du capitalisme d’Etat se transforme ainsi dialectiquement en son propre contraire, sous la forme étatique du socialisme ouvrier.» [15] [3547]
Par la même «dialectique», Boukharine explique ailleurs que le système de direction par un seul homme, de nomination par en haut pour la marche de l’industrie - une pratique qui se généralisa quasiment durant la période de communisme de guerre et qui était, en réalité, un recul résultant de l’effondrement du prolétariat industriel et de la perte de son auto-organisation - exprime en fait une phase supérieure de maturation révolutionnaire. C’est parce que «le centre de gravité ne réside pas dans la transformation de principe des rapports de production, mais dans la recherche d’une forme d’administration qui garantisse un maximum d’efficacité. Au principe de l’éligibilité étendu de la base au sommet (appliqué ordinairement même par les travailleurs dans les usines) se substitue le principe d’une sélection soigneuse qui dépend des capacités techniques et administratives, de la compétence et de la crédibilité des candidats.» [16] [3548] En d’autres termes, puisque les rapports capitalistes ont déjà été abolis par «l’Etat prolétarien», le principe militaire du «maximum d’efficacité» peut remplacer le principe politique de l’auto-éducation du prolétariat à travers sa participation directe et collective à la direction de l’économie et de l’Etat.
Et par la même dialectique, la fonction coercitive de l’Etat sur le prolétariat devient la forme supérieure de l’auto-activité de la classe. «Il va sans dire que cet élément de contrainte, qui correspond ici à une auto-contrainte de la classe ouvrière, se développe à partir du centre de cristallisation vers la périphérie de plus en plus amorphe et atomisée. C’est une force qui pousse à la cohésion des différentes particules de la classe ouvrière, qui apparaît subjectivement à certaines catégories comme une pression extérieure, mais qui pour l’ensemble de la classe ouvrière, est objectivement un élément d’auto-organisation accélérée.» [17] [3549] Par «la périphérie amorphe» Boukharine entend non seulement les autres couches non-exploiteuses de la société mais également les couches «moins révolutionnaires» de la classe ouvrière elle-même pour lesquelles «une discipline contraignante devient absolument indispensable et son caractère contraignant est d’autant plus fortement ressenti que la discipline interne est moins volontairement acceptée.» [18] [3550] Il est certainement vrai que la classe ouvrière, dans une révolution, doit mettre en oeuvre une autodiscipline prodigieuse, et assurer que les décisions majoritaires sont acceptées. Mais il ne peut être question d’utiliser la force pour contraindre les couches plus arriérées de la classe à adhérer au projet communiste ; et l’expérience de la tragédie de Cronstadt nous a enseigné que traiter les conflits, même les plus aigus, au sein de la classe ouvrière par la violence ne peut qu’affaiblir l’emprise du prolétariat sur la société. La dialectique de Boukharine, au contraire, apparaît déjà comme une apologie d’une militarisation de plus en plus intolérable du prolétariat. Poussée jusqu’à sa conclusion logique, elle mène tout droit à l’erreur terrible commise à Cronstadt où le «centre de cristallisation» - l’appareil du parti-Etat qui s’était de plus en plus éloigné des masses - avait imposé une «discipline contraignante» à ce qu’il jugeait être «la périphérie amorphe», les couches «moins révolutionnaires» du prolétariat, alors que ces dernières appelaient, en fait, à la régénérescence tout à fait nécessaire des soviets et à la fin des excès du communisme de guerre.
La trajectoire de Boukharine : reflet du cours de la révolution
Après avoir été très critique par rapport à la NEP au début, Boukharine devint rapidement son avocat le plus enthousiaste. Tout comme l’Economique de la période de transition tendait à considérer le communisme de guerre comme la voie «enfin trouvée» vers la nouvelle société, les écrits suivants de Boukharine présentent de plus en plus la NEP et sa démarche prudente, pragmatique comme le modèle exemplaire de la période de transition. Sa conversion soudaine à une sorte de «socialisme de marché» trouve chez certains économistes bourgeois actuels, staliniens repentis et autres, un regain d’intérêt pour Boukharine, mais naturellement pas pour ses écrits authentiquement révolutionnaires de la première période. En 1924, Boukharine était même allé plus loin. Pour lui, la NEP avait déjà réalisé le socialisme, le socialisme en un seul pays. A ce moment-là, il avait commencé à oeuvrer contre la gauche, en partenaire de Staline et comme son théoricien de service, même si, quelques années plus tard, lui-même devait être écrasé par les forces criminelles du stalinisme.
Cette volte-face n’est pas si surprenante qu’elle pourrait paraître. L’apologie du communisme de guerre et celle de la NEP s’appuyaient sur des concessions significatives à l’idée que quelque chose de socialiste avait été construit dans les frontières de la Russie ou, pour le moins, qu’une «accumulation socialiste primitive» (terme utilisé dans l’Economique de la période de transition) s’y était réalisée. Entre ce point de vue et la conclusion que le socialisme était réalisé, le saut n’était pas si vertigineux, même s’il a eu besoin du tremplin de la contre-révolution.
Néanmoins, la trajectoire de Boukharine, de l’extrême-gauche du parti entre 1915 et 1919 à l’extrême-droite après 1921, nécessite une explication. Dans La tragédie de Boukharine (1994), Donny Gluckstein traite la question du point de vue du SWP trotskiste. C’est un travail extrêmement sophistiqué qui contient beaucoup de critiques de la pensée de Boukharine, y compris de l’Economique de la période de transition, critiques qui, d’un point de vue formel, sont identiques à celles portées par la Gauche communiste. Mais la démarche fondamentalement gauchiste du livre de Gluckstein se révèle lorsque, pour répondre à la question de la trajectoire de Boukharine, elle se centre sur la méthode «philosophique» de ce dernier, sur sa tendance à la scholastique, à la logique formelle, à poser des alternatives rigides «ou bien/ou bien», ainsi que sur son penchant pour la philosophie «moniste» de Bogdanov et à amalgamer le marxisme et la sociologie. Ainsi le saut entre la défense acritique du communisme de guerre à l’adhésion tout aussi acritique à la NEP trahit un manque de pensée dialectique, une incapacité à saisir la nature toujours changeante de la réalité. De même, l’appel de Boukharine à la guerre révolutionnaire dans le débat sur Brest-Litovsk est également fondé sur une série d’erreurs méthodologiques, puisqu’il prend pour point de départ un choix absolu et immédiat que devait faire la Russie, entre «se vendre» à l’impérialisme allemand ou accomplir un acte héroïque quoique condamné face au prolétariat mondial. Et, si dans l’Economique de la période de transition, Boukharine réduisit l’extension de la révolution mondiale à une sorte de dernier ornement, un après-coup faisant suite à la création de rapports communistes en Russie, en 1918 il était prêt à sacrifier tout le bastion prolétarien russe à une révolution mondiale qui n’était pas encore une réalité immédiate et était donc traitée comme une sorte d’idéal abstrait. Il est certain que Lénine et Trotsky firent un certain nombre de critiques incisives à la méthode de Boukharine. Certaines qu’a faites Lénine apparaissent dans ses notes marginales à l’Economique de la période de transition. Mais derrière son insistance sur ce point, Gluckstein, lui, a un autre programme : montrer que la méthode rigide de Boukharine du «ou/ou» serait fondamentalement celle du communisme de gauche. La critique de Boukharine, dans le livre de Gluckstein, est donc une sorte d’«avertissement» contre ce qui arrive à ceux qui se frottent aux positions et à la politique des communistes de gauche.
Nous n’avons pas l’intention de réfuter ici les attaques de Gluckstein contre «les racines théoriques du communisme de gauche». Bien qu’il y ait sans aucun doute un lien entre les erreurs politiques de Boukharine et certaines de ses conceptions «philosophiques» sous-jacentes, ces dernières ne sont en aucune façon identiques à celles du communisme de gauche et en sont le plus souvent l’antithèse. De toutes façons, il est bien plus instructif de considérer la trajectoire d’ensemble de Boukharine comme reflet du cours global de la révolution. Il arrive souvent que la trajectoire «personnelle» d’un révolutionnaire ait un rapport quasi symbolique avec la trajectoire plus générale des événements. Trotsky, par exemple, a été expulsé de Russie à la suite de la défaite de la révolution de 1905 ; il y est revenu pour diriger la victoire d’Octobre et fut à nouveau expulsé en 1929, une fois que la contre-révolution eût tout balayé devant elle. La trajectoire de Boukharine est différente, mais également significative : sa meilleure contribution au marxisme a eu lieu dans les années 1915-19, lorsque la vague révolutionnaire se développait, atteignait son point culminant et que le parti bolchevik agissait comme un véritable laboratoire de la pensée révolutionnaire. Mais bien que, comme nous l’avons mentionné, le nom de Boukharine ait été étroitement associé au groupe communiste de gauche en 1918, après 1919, il a pris une voie différente des autres dirigeants communistes de gauche. En 1918, le traité de Brest-Litovsk constituait la principale pomme de discorde pour lui. Une fois ce débat clos, d’autres «gauches» engagées ont étudié avec attention les problèmes internes du régime, en particulier le danger d’opportunisme et de bureaucratie dans le parti et dans l’Etat. Certains de ces éléments comme Sapranov et V.Smirnov ont maintenu et développé leurs critiques pendant la période de dégénérescence jusque pendant la période de contre-révolution la plus profonde. Boukharine, lui, devait de plus en plus devenir un «homme d’Etat», on pourrait dire «le théoricien de l’Etat». Il est certain que cette trajectoire explique les ambiguïtés et les incohérences de l’Economique de la période de transition, avec son mélange de théorie radicale et d’apologie conservatrice du statu quo. De plus, la révolution russe elle-même avait atteint un moment critique où le mouvement montant et le mouvement descendant étaient en contradiction. Après 1921, le mouvement descendant a clairement prédominé, et Boukharine devint alors de plus en plus le porte-parole et le justificateur du processus de dégénérescence même si, à la fin, il en a lui-même été l’une des innombrables victimes. Derrière sa trajectoire personnelle de déclin intellectuel réside l’histoire du parti bolchevik qui, plus il fusionnait avec l’Etat, plus il devenait incapable de jouer son rôle d’avant-garde politique et théorique. Les prochains articles de cette série traiteront de l’histoire de la résistance à ce cours des éléments les plus clairvoyants du parti bolchevik et du mouvement communiste international.
CDW.
[1] [3551] Bergman Publishers, New York, et Pluto Press.
[2] [3552] Cité dans The tragedy of Bukharin, D.Gluckstein, Pluto press, 1994.
[3] [3553] E.D.I., Paris 1976, pages 182, 183.
[4] [3554] Idem, pages 77-78.
[5] [3555] Idem, page 74.
[6] [3556] Idem, page 196.
[7] [3557] E.D.I., Paris 1976, page 205, (Postface à l’édition allemande, Moscou, décembre 1921).
Dans la même postface, Boukharine dit aussi que son travail a été utilisé de façon fausse comme une justification de la théorie de «l’offensive en toutes circonstances», qui avait eu une suite considérable dans le parti allemand et qui avait contribué au désastre de l’Action de mars en 1921. Néanmoins, il y a certaines connexions, notamment dans la façon dont l’Economique de la période de transition tend à présenter le déclin du capitalisme non comme l’ensemble d’une époque mais comme une crise finale, mortelle une fois pour toute, d’où l’idée qu’une « restauration de l’industrie à laquelle rêvent les utopistes du capitalisme, est impossible. » La théorie de l’offensive était basée précisément sur l’idée qu’il n’y avait pas de perspective de reconstruction capitaliste et que la crise ouverte ne pourrait qu’empirer.
Peut-être plus en rapport avec le sujet, la vision apocalyptique de Boukharine amène aussi à soutenir sa tendance à faire une équation entre effondrement du capitalisme et émergence du communisme. Face à la bourgeoisie, Boukharine avait raison d’insister que la révolution prolétarienne impliquait immédiatement un certain niveau d’anarchie sociale, d’effondrement des activités productives de la société. Mais il y a dans l’Economique de la période de transition une sous-estimation nette des dangers posés au prolétariat si ce processus d’effondrement allait trop loin -dangers qui étaient très réels dans la Russie de 1920 où la classe ouvrière avait été décimée et, dans une certaine mesure, avait subi un certain niveau de décomposition par les ravages de la guerre civile. Certains passages du livre donnent l’impression que plus l’économie se désintègre, plus c’est salutaire, plus cela active le développement de rapports sociaux communistes.
[8] [3558] E.D.I., page 173.
[9] [3559] Idem, pp. 81, 135, 65, 143, 144, 148, 109- 110, 157, 182.
[10] [3560] Idem, pp. 81, 135, 65, 143, 144, 148, 109- 110, 157, 182.
[11] [3561] Idem, pp. 81, 135, 65, 143, 144, 148, 109- 110, 157, 182.
[12] [3562] Idem, pp. 81, 135, 65, 143, 144, 148, 109- 110, 157, 182.
[13] [3563] Idem, pp. 81, 135, 65, 143, 144, 148, 109- 110, 157, 182.
[14] [3564] Idem, pp. 81, 135, 65, 143, 144, 148, 109- 110, 157, 182.
[15] [3565] Idem, pp. 81, 135, 65, 143, 144, 148, 109- 110, 157, 182.
[16] [3566] Idem, pp. 81, 135, 65, 143, 144, 148, 109- 110, 157, 182.
[17] [3567] Idem, pp. 81, 135, 65, 143, 144, 148, 109- 110, 157, 182.
[18] [3568] Idem, pp. 81, 135, 65, 143, 144, 148, 109- 110, 157, 182.
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Russe [2920]
Approfondir:
Questions théoriques:
- Communisme [492]
Heritage de la Gauche Communiste:
La question chinoise (1920 - 1940) : la Gauche Communiste contre la trahison de l'Internationale Communiste dégénérée
- 7346 reads
Du combat de l’Opposition de gauche au rejet des luttes de libération nationales par la Fraction italienne
Nous avons déjà publié une série d’articles sur la Chine dite communiste où nous avons montré la nature contre révolutionnaire du maoïsme ([1] [3569]). Si nous revenons ici sur le combat qu’a mené le prolétariat chinois, durant les années 1920, jusqu’à la terrible défaite qu’il a subie notamment à Shanghaï et à Canton, c’est non seulement parce qu’il a été significatif de l’évolution du rapport de forces entre bourgeoisie et prolétariat au niveau international mais aussi parce qu’il a joué un rôle important dans le mouvement révolutionnaire même par les combats politiques déterminants qu’il a occasionnés en son sein.tous les révolutionnaires dans le monde. En effet, à cette date, les événements en Chine sont en train de marquer la fin de la vague révolutionnaire mondiale pendant que le stalinisme s’impose de plus en plus au sein de l’Internationale communiste (IC).
Comme l’écrit Zinoviev en 1927 : «Les événements en Chine ont une aussi grosse importance que les événements d’Allemagne en octobre 1923. Et si toute l’attention de notre parti se porta alors sur l’Allemagne, il faut qu’il en soit de même maintenant en ce qui concerne la Chine, d’autant plus que la situation internationale est devenue pour nous plus compliquée et plus inquiétante.» ([2] [3570]) Et Zinoviev a raison de souligner la gravité de la situation, comme avec lui la perçoivent LA QUESTION CHINOISE (1920-1940)
Cependant, la situation en Chine est aussi une des questions qui va permettre, d’une part, à «l’Opposition de gauche» de se structurer et, d’autre part, à la «gauche italienne» (Bilan) de s’affirmer politiquement comme un des plus importants courants au sein de l’opposition internationale avant de développer, les années suivantes, une activité et un travail de réflexion politiques inestimables.
L’écrasement de la révolution en Chine
Le milieu des années 1920 est une période cruciale pour la classe ouvrière et ses organisations révolutionnaires. La révolution peut-elle encore se développer et l’emporter au niveau mondial ? Sinon, la révolution russe pourra-t-elle survivre longtemps à son isolement ? Telles sont les questions qui traversent le mouvement communiste; et toute l’IC est suspendue aux possibilités de la révolution en Allemagne. Depuis 1923, la politique de l’IC est de pousser à l’insurrection. Zinoviev, qui est encore son président, sous-estime totalement l’ampleur de la défaite en Allemagne ([3] [3571]). Il déclare qu’il ne s’agit que d’un épisode et que de nouveaux assauts révolutionnaires sont à l’ordre du jour dans plusieurs pays. L’IC ne dispose plus manifestement d’une boussole politique fiable ; aussi, en cherchant à pallier le reflux de la vague révolutionnaire, elle ne fait que développer une stratégie de plus en plus opportuniste. A partir de 1923, Trotsky et la première Opposition dénoncent ses graves erreurs, aux conséquences tragiques mais sans aller jusqu’à parler de trahison. La dégénérescence de l’IC se développe et, à la fin de l’année 1925, la troïka Zinoviev-Kamenev-Staline se défait ; l’IC est alors dirigée par le duo Boukharine-Staline. La stratégie «putschiste» qui prévalait sous Zinoviev fait place, après 1925, à une politique basée sur la «stabilisation» prolongée du capitalisme. C’est le «cours de droite» avec la mise en avant, en Europe, de politiques de front unique avec les partis «réformistes» ([4] [3572]). En Chine, l’IC met en oeuvre une politique qui se situe en deçà même de celle préconisée par les mencheviks pour les pays économiquement peu développés comme en Russie. En effet, dès 1925, elle défend que c’est la politique du Guomindang pour la révolution bourgeoise qui est encore à l’ordre du jour, la révolution communiste devant intervenir ensuite. Cette position mènera à livrer les ouvriers chinois au massacre.
C’est durant sa période putschiste d’ultra-gauchisme que l’IC harcèle le Parti Communiste Chinois (PCC) jusqu’à ce qu’il se décide à entrer dans le Guomindang déclaré «parti sympathisant» lors de son 5e congrès (Pravda, 25 juin 1924). C’est ce parti «sympathisant» qui sera le fossoyeur du prolétariat !
L’IC stalinisée «considérait le Guomindang comme l’organe de la révolution nationale chinoise. Les communistes allaient aux masses sous le nom et la bannière du Guomindang. Cette politique aboutit, en mars 1927 à l’entrée des communistes dans le gouvernement national. Ils reçurent le portefeuille de l’Agriculture (après que le parti se soit prononcé contre toute révolution agraire et pour ‘arrêter l’action trop vigoureuse des paysans’) et celui du Travail, afin de mieux canaliser les masses ouvrières vers une politique de compromis et de trahison. Le Plénum de juillet du PCC se prononça d’ailleurs également contre la confiscation de la terre, contre l’armement des ouvriers et des paysans, c’est-à-dire pour la liquidation du parti et des mouvements de classe des ouvriers, pour la sujétion absolue au Guomindang, afin d’éviter à tout prix la rupture avec ce dernier. Pour cette politique criminelle, tous étaient d’accord : de la droite avec Peng Chou Chek, du centre avec Chen Duxiu et de la soi-disant gauche avec Tsiou Tsiou-Bo.» (Bilan n°9, juillet 34)
Cette politique opportuniste parfaitement analysée par Bilan quelques années plus tard, qui pousse le PCC à quasiment se fondre dans le Guomindang, aboutit au bout du compte à une terrible défaite et à l’écrasement des ouvriers chinois. «Le 26 mars, Tchang Kaï-Chek se livra à un premier coup de force, en arrêtant de nombreux communistes et sympathisants. (...) Ces faits furent cachés au Comité exécutif de l’IC ; en revanche une grande place fut accordée aux propos anti-impérialistes de Tchang Kaï-Chek lors du Congrès du travail en 1926. En juillet 1926, les troupes du Guomindang commencèrent leur marche vers le nord. Elle servit de prétexte à l’arrêt des grèves à Canton, Hongkong, etc. (...) A l’approche des troupes il y eut un soulèvement à Shanghaï : le premier du 19 au 24 février, le second fut victorieux, le 21 mars. Les troupes de Tchang Kaï-Chek n’entrèrent dans la ville que le 26 mars. Le 3 avril, Trotsky écrit une mise en garde contre le ‘Pilsudsky chinois’ ([5] [3573]). Le 5 avril, Staline déclare que Tchang Kaï-Chek s’est soumis à la discipline, que le Guomindang est un bloc, une sorte de parlement révolutionnaire.» ([6] [3574])
Le 12 avril Tchang Kaï-Chek procède à un coup de force, une manifestation est attaquée à la mitrailleuse, il y a des milliers de victimes.
«A la suite de ses événements, la délégation de l’Internationale communiste, le 17 avril, soutient à Hunan le centre du ‘Guomindang de gauche’ ([7] [3575]) auquel participent les ministres communistes. Là, le 15 juillet, se produit une réédition du coup de Shanghaï. La victoire de la contre-révolution est assurée. Une période de massacre systématique la suit, on évalue au bas mot à 25 000 le nombre de communistes tués.» Et, en septembre 1927, «la nouvelle direction du PC (...) fixe l’insurrection au 13 décembre. (...) Un soviet est désigné d’en haut. Le soulèvement est avancé au 10 décembre. Le 13, il est totalement réprimé. La deuxième révolution chinoise est définitivement écrasée.» ([8] [3576])
Les ouvriers et les révolutionnaires chinois accomplissent une terrible descente aux enfers. C’est le prix que leur coûte la politique opportuniste de l’IC.
«Malgré toutes ces concessions, la rupture avec le Guomindang survint à la fin de juillet 1927, quand le gouvernement de Hunan exclut les communistes du Guomindang en ordonnant leur arrestation.» Puis «... la Conférence du parti d’août 1927 condamna définitivement ce que l’on appela la ligne opportuniste de la vieille direction de Chen-Duxiu et fit table rase des anciens dirigeants (...). S’ouvre ainsi l’époque ‘putschiste’, qui trouve son expression dans la Commune de Canton de décembre 1927. Toutes les conditions étaient défavorables pour une insurrection à Canton.(...) Il est bien entendu que nous ne voulons en rien diminuer l’héroïsme des communards de Canton, qui luttèrent jusqu’à la mort. Mais l’exemple de Canton n’est pas isolé. A la même époque 5 autres comités régionaux (...) se prononcèrent pour le soulèvement immédiat.» Et malgré l’offensive victorieuse de la contre-révolution, «... Le 6e congrès du PCC de juillet 1928 continua à maintenir la perspective de ‘lutter pour la victoire dans une ou plusieurs provinces’.» ([9] [3577])
La question chinoise et l’Opposition russe
La défaite de la révolution chinoise constitue la condamnation la plus sévère de la stratégie de l’IC après la mort de Lénine et plus encore de celle de l’IC stalinisée.
Trotsky souligne dans sa Lettre au 6e congrès de l’IC du 12 juillet 1928 ([10] [3578]) que la politique opportuniste de l’IC a affaibli le prolétariat d’abord en Allemagne en 1923, puis l’a trompé et trahi en Angleterre et enfin en Chine. «Voilà les causes immédiates et indiscutables des défaites.» Il poursuit : «Pour saisir la signification du revirement actuel vers la gauche ([11] [3579]), on doit avoir une vue complète non seulement ce que fut le glissement vers la ligne générale de centre-droit qui se démasqua totalement en 1926-1927, mais aussi de ce que fut la période précédante d’ultra-gauchisme en 1923-1925, dans la préparation de ce glissement.»
En effet, la direction de l’IC ne cesse de répéter, en 1924, que la situation révolutionnaire continue à se développer et que «des batailles décisives se livreraient dans un avenir proche.» «C’est sur la base de ce jugement fondamentalement faux que le 6e congrès établit toute son orientation, vers le milieu de 1924.» ([12] [3580]) L’Opposition exprime son desaccord avec cette vision et «sonne l’alarme» ([13] [3581]). «En dépit du reflux politique, le 6e congrès s’oriente démonstrativement vers l’insurrection. (...) 1924 (...) devient l’année des aventures en Bulgarie ([14] [3582]), en Estonie.» ([15] [3583]) Cet ultra gauchisme de 1924-25 «désorienté devant la situation fut brutalement remplacé par une déviation de droite.» ([16] [3584])
La nouvelle Opposition Unifié ([17] [3585]) se crée alors par le regroupement de l’ancienne Opposition de Trotsky avec le groupe Zinoviev-Kamenev et d’autres. Plusieurs sujets animent les discussions dans le parti bolchevik en 1926, notamment la politique économique de l’URSS et la démocratie au sein du parti. Mais le principal débat, celui qui divise le plus profondément le parti se développe sur la question chinoise.
A la ligne du «bloc avec le Guomindang», que Staline maintient et qu’exposent Boukharine et l’ex-menchevik Martynov, s’oppose celle de l’Opposition de gauche. Les problèmes débattus sont ceux du rôle de la bourgeoisie nationale, du nationalisme et de l’indépendance de classe du prolétariat.
Trotsky défend sa position dans son texte «les rapports de classe dans la révolution chinoise» (3 avril 1927). Il y développe que :
– La révolution chinoise dépend du cours général de la révolution prolétarienne mondiale. Et contre la vision de l’IC qui prône le soutien au Guomindang pour accomplir da révolution bourgeoise, il appelle les communistes chinois à en sortir du Guomindang.
– Pour aller à la révolution, il faut que les ouvriers chinois forment des soviets et s’arment. ([18] [3586])
A ce texte font suite, le 14 avril, les Thèses adressées par Zinoviev au bureau politique du PCUS ([19] [3587]) dans lesquelles celui-ci réaffirme la position de Lénine sur les luttes de libération nationales, en particulier qu’un PC ne doit se subordonner à aucun autre parti et que le prolétariat ne doit pas se perdre sur le terrain de l’interclassisme. Il réaffirme également l’idée que «l’histoire de la révolution a démontré que toute révolution démocratique bourgeoise, si elle ne se transforme pas en révolution socialiste, s’engage inévitablement dans la voie de la réaction.»
Mais l’Opposition russe n’a plus, à ce moment-là, les moyens de renverser le cours de la dégénérescence de l’IC parce que le prolétariat est en train de connaître la défaite non seulement en Chine mais aussi internationalement. On peut même dire que, dans le parti bolchevik, elle est battue. «Le prolétariat essuie sa plus terrible défaite» ([20] [3588]) dans la mesure où les révolutionnaires, ceux qui ont fait la révolution d’Octobre, vont, les uns après les autres, être emprisonnés, déportés dans des camps ou même assassinés. Il y a plus grave : «Le programme international est banni, les courants de la gauche internationaliste sont exclus (...), une nouvelle théorie fait son entrée triomphale au sein de l’IC.» ([21] [3589]) C’est la théorie du «socialisme en un seul pays». Le but de Staline et de l’IC est, dès lors, de défendre l’Etat russe. Mais l’Internationale, en rompant avec l’internationalisme, meurt en tant qu’organe du prolétariat.
La Chine et l’Opposition de Gauche internationale
Toutefois, même battue, le combat de l’Opposition au sein de l’IC a été fondamental. Il a un retentissement énorme, au niveau international, dans tous les PC. Mais surtout, il est probable que sans lui les courants de la Gauche communiste n’existeraient certainement pas aujourd’hui. En Chine même où les staliniens ont pourtant réussi à faire le black-out sur les textes de l’Opposition, Chen Duxiu réussit à envoyer sa Lettre à tous les membres du PCC (il est exclu du parti en août 1929; sa lettre est du 10 décembre de la même année) dans laquelle il prend position contre l’opportunisme de Staline sur la question chinoise.
En Europe et dans le monde ce combat politique permet aux groupes oppositionnels exclus des PC de se structurer et de s’organiser. Très vite ils se retrouvent divisés et n’arrivent pas à passer du stade d’opposition à celui de véritable courant politique.
En France, par exemple, le groupe de Souvarine «Le cercle Marx et Lénine», le groupe de Maurice Paz «Contre le courant» et celui de Treint «Le redressement communiste» publient les documents de l’Opposition de gauche russe et regroupent des énergies révolutionnaires. Les groupes de ce type vont même jusqu’à se multiplier dans un premier temps; mais malheureusement ils n’arrivent pas à collaborer.
Il y a enfin un regroupement après l’expulsion de Trotsky de l’URSS, regroupement qui prend le nom d’Opposition de Gauche Internationale (OGI) mais qui va laisser beaucoup d’énergies sur la touche.
En 1930 de nombreux groupes (*) se prononcent sur les positions défendues par Trotsky en 1927 puis sur celles développées dans sa Lettre au 6e congrès de l’IC de 1928. Ils signent même une déclaration commune «Aux communistes chinois et du monde entier» (12 décembre 1930). Candiani. ([22] [3590]) la signe au nom de la Fraction italienne (FI).
La déclaration est claire et sans la moindre concession à une politique opportuniste de collaboration de classe.
«Nous, représentants de l’opposition de gauche internationale, bolcheviks-léninistes, fûmes depuis le début adversaires de l’entrée du parti communiste dans le Guomindang, au nom d’une politique prolétarienne indépendante. Depuis le début de la montée révolutionnaire, nous avons exigé que les ouvriers prennent sur eux la direction du soulèvement paysan pour mener à son achèvement la révolution agraire. Tout cela fut repoussé. Nos partisans ont été traqués, exclus de l’IC et, en URSS, ils ont été emprisonnés et exilés. Au nom de quoi ? Au nom de l’alliance avec Tchang Kaï-Chek.»
Les leçons tirées par la Gauche italienne
Alors que l’OGI arrive à une bonne clarté sur les tâches de l’heure, très vite son rattachement politique, sans la moindre critique, aux 4 premiers congrès de l’IC, la fait basculer vers des positions opportunistes dès que le cours révolutionnaire s’inverse nettement dans les années 1930. Il n’en est pas de même pour la FI qui, sur les trois plans en discussion par rapport aux pays coloniaux (les luttes de libération nationales, les mots d’ordre démocratiques et la guerre entre impérialistes dans ces pays) se démarque nettement.
La question nationale et la révolution dans les pays de la périphérie du capitalisme.
Contrairement à la résolution du 2e Congrès de l’IC, dans la Résolution sur le conflit sino-japonais (février 1932), la FI pose cette question de façon radicalement nouvelle dans le mouvement communiste. A travers cette résolution elle accomplit une rupture avec la position classique sur les luttes de libération nationale. ([23] [3591])
«Point 1. Dans l’époque de l’impérialisme capitaliste, les conditions n’existent plus pour que, dans les colonies et dans les pays semi-coloniaux, se produise une révolution bourgeoisie donnant le pouvoir à une classe capitaliste capable de vaincre les impérialistes étrangers. (...)
La guerre étant le seul moyen de la libération des pays coloniaux, (...) il s’agit d’établir quelle classe est appelée à diriger dans l’époque actuelle de l’impérialisme capitaliste. Dans le cadre compliqué des formations économiques de la Chine, le rôle de la bourgeoisie indigène est celui d’empêcher le développement du mouvement révolutionnaire des ouvriers et des paysans et d’écraser les ouvriers communistes justement alors que le prolétariat se révèle comme la seule force capable de conduire la guerre révolutionnaire contre l’impérialisme étranger.»
Elle poursuit: «Le rôle du prolétariat consiste dans la lutte pour l’instauration de la dictature du prolétariat. (...)
Point 4. La fraction de gauche a toujours affirmé que l’axe central des situations est celui qui s’exprime dans le dilemme ‘guerre ou révolution’. Les événements actuels en Orient confirment cette position fondamentale. (...)
Point 7. Le devoir du Parti communiste chinois est celui de mettre en première ligne la lutte contre la bourgeoisie indigène y compris ses représentants de gauche du Guomindang, les émérites bourreaux de 1927. (...) Le Parti communiste chinois doit se réorganiser sur la base du prolétariat industriel, reconquérir l’influence sur les prolétaires de la ville, la seule classe qui pourra entraîner les paysans dans la lutte conséquente et décisive qui aboutira à l’instauration des véritables soviets en Chine.»
Il va sans dire qu’il s’agit là d’abord d’un rejet de la politique du Parti communiste chinois stalinisé (et bientôt «maoïsé») mais aussi d’une critique ouverte des positions politiques de Trotsky lui-même. Ce sont d’ailleurs ces positions politiques qui l’amèneront, un peu plus tard, à défendre la Chine contre le Japon dans le conflit guerrier qui va opposer ces deux pays.
Au cours des années 1930, la position de la FI se précise encore, comme le montre la «Résolution sur le conflit sino-japonais» de décembre 1937 (Bilan n° 45) : «Les mouvements nationaux, d’indépendance nationale, qui eurent en Europe une fonction progressive parce qu’ils exprimaient la fonction progressive qu’avait alors le mode bourgeois de production, ne peuvent avoir en Asie que la fonction réactionnaire d’opposer, au cours de la révolution prolétarienne, les conflagrations dont sont seules victimes les exploités des pays en guerre (et) le prolétariat de tous les pays.»
Les mots d’ordre démocratiques
Avec les mots d’ordre démocratiques on touche encore à la même question (la libération nationale). Existe-t-il encore des programmes différents pour les prolétaires des pays développés et pour ceux des pays où la bourgeoisie n’a pas encore accompli sa révolution ?
Les mots d’ordre démocratiques peuvent-ils être encore «progressistes» comme le défend l’OGI ? «En réalité, la conquête du pouvoir de la part de la bourgeoisie ne coïncide nulle part avec la réalisation de ses mots d’ordre démocratiques. Au contraire, nous assistons dans l’époque actuelle au fait que dans toute une série de pays, le pouvoir de la bourgeoisie n’est possible que sur la base de rapports sociaux et d’institutions semi-féodales. C’est seulement au prolétariat qu’il appartient de détruire ces rapports et ces institutions, c’est-à-dire de réaliser les objectifs historiques de la révolution bourgeoise.» ([24] [3592]) Il s’agit là d’une position menchevik, en opposition complète avec ce que Trotsky a été capable de défendre sur la tâche des communistes en Chine dans les années 1920 («toute révolution démocratique bourgeoise, si elle ne se transforme pas en révolution socialiste, s’engage inévitablement dans la voie de la réaction.»).
La position de la gauche italienne est radicalement différente, elle est présentée par sa délégation à la Conférence nationale de la Ligue Communiste en 1930 (Bulletin d’information de la Fraction italienne n° 3 et n° 4). Elle défend l’idée que les «mots d’ordre démocratiques» ne sont plus à l’ordre du jour dans les pays semi-coloniaux. Le prolétariat doit défendre l’intégralité du programme communiste puisque la révolution communiste est à l’ordre du jour internationalement.
«Nous disons que là où le capitalisme n’est pas à la direction économique et politique de la société (exemple des colonies), là les conditions existent – et pour une période déterminée – pour une lutte du prolétariat pour la démocratie. Mais (...) nous avons demandé que l’on sorte du vague, et que l’on précise sur quelle base de classe doit se dérouler cette lutte. (...) Cela, dans la situation actuelle de crise mortelle du capitalisme, serait destinée à précipiter la dictature du parti du prolétariat. (...)
Mais pour les pays où la révolution bourgeoise a été faite, (...) cela porte au désarmement du prolétariat devant les nouvelles tâches qui lui [au prolétariat] ont été ouvertes par les événements. (...)
Il faut commencer par donner une signification politique à la formule «mots d’ordre démocratiques». Nous croyons qu’on peut en donner les suivantes :
1/ mots d’ordre qui se rattachent directement à l’exercice du pouvoir politique par une classe donnée ;
2/ mots d’ordre qui expriment le contenu des révolutions bourgeoisies et que le capitalisme n’a pas – dans la situation actuelle – la possibilité et la fonction de réaliser ;
3/ mots d’ordre qui se rapportent aux pays coloniaux où s’entrecroisent les problèmes de la lutte contre l’impérialisme, de la révolution bourgeoise et de la révolution prolétarienne ;
4/ les «faux» mots d’ordre démocratiques, à savoir les mots d’ordre qui correspondent aux besoins vitaux des masses travailleuses.
Appartiennent au premier point toutes les formulations propres de la vie du gouvernement bourgeois, telles que ‘revendication du parlement et de son fonctionnement libre’, ‘élections d’administrations communales et leur libre fonctionnement, assemblée constituante, etc...’
Appartiennent au 2e point surtout les tâches de la transformation sociale dans les campagnes.
Au 3e points les problèmes de tactique dans les pays coloniaux.
Au 4e point les luttes partielles des ouvriers dans les pays capitalistes.»
La Fraction revient sur chacun de ces quatre domaines tout en disant qu’il faut adapter la tactique en fonction des situations mais reste ferme sur les principes.
«Les mots d’ordre démocratiques institutionnels.
(...) La divergence politique s’est manifestée plus clairement entre notre fraction et la gauche russe. Mais il faut préciser que cette divergence devrait rester dans le domaine de la tactique comme il est prouvé par le fait d’une rencontre entre Bordiga et Lénine. (...).»
En Espagne, en Italie, comme en Chine, la FI se démarque clairement de la tactique employée par l’Opposition de gauche.
«En Espagne, la transformation de l’Etat de monarchie en République qui, autrefois, était le résultat d’une bataille armée, se vérifiait dans la comédie du départ du roi à la suite de l’accord entre Zamora et Romanonés. (...)
En Espagne le fait que l’Opposition a adopté les positions politiques de l’appui à la transformation soi-disant démocratique de l’Etat, a enlevé toute possibilité de sérieux développement de notre section pour les questions mêmes qui se rapportent à la solution de la crise communiste.
Le fait qu’en Italie, le parti ait altéré le programme de la dictature du prolétariat et ait brandi le programme démocratique de la révolution populaire (24), a pour beaucoup contribué au raffermissement du fascisme.»
«Les mots d’ordre démocratiques et la question agraire.
(...) une transformation (la libération de l’économie agraire des rapports sociaux propres au féodalisme) d’une économie d’un pays comme l’Espagne en une économie de type de celles qui existent dans d’autres pays plus avancés, coïncidera avec la victoire de la révolution prolétarienne. Mais cela ne signifie pas du tout que le capitalisme n’ait pas la possibilité de se mettre sur le chemin de cette transformation... La position programmatique communiste doit rester celle de l’affirmation intégrale de la ‘socialisation des terres’.»
La Fraction fait une très petite place aux mots d’ordre intermédiaires concernant les campagnes.
«Les mots d’ordre institutionnels et la question coloniale.
Nous voulons ici nous en rapporter à ces pays coloniaux, où malgré l’industrialisation d’une partie importante de l’économie, le capitalisme n’existe pas encore en tant que classe de gouvernement au pouvoir.»
Même s’il faut adapter la tactique dans certains pays il n’existe pas, pour la FI, de mots d’ordre différents pour le prolétariat de Chine ou d’Espagne et celui des pays du coeur du capitalisme.
«En Chine, lors du manifeste de 1930 et dans la situation actuelle encore, il ne s’agit point d’établir un programme pour la conquête du pouvoir politique (..) alors que le ‘centrisme’ ([25] [3593]) s’évertue dans les acrobaties politiques qui voudraient faire passer pour les soviets, la falsification des buts et les mouvements de paysans.
Il n’existe encore une fois qu’une seule classe capable de mener la lutte victorieuse et c’est le prolétariat.»
«Les revendications partielles de la classe ouvrière.
Les partis bourgeois et surtout la social démocratie insistent particulièrement pour orienter les masses vers la nécessité de la défense de la démocratie et demandent et obtiennent aussi – par la faute du parti communiste – l’abandon de la lutte pour la défense des salaires et en général du niveau de vie des masses, comme il arrive par exemple en Allemagne actuellement.»
La Fraction défend ici l’idée que la classe ouvrière ne doit développer son combat que pour défendre ses propres intérêts et rester sur son propre terrain qui est le seul terrain permettant de faire avancer les masses vers la lutte révolutionnaire.
La guerre impérialiste et les trotskistes chinois
Dans ce domaine, Trotsky va renier ses positions de 1925-27, celles qu’il avait défendues dans L’Internationale après Lénine (ainsi que dans sa déclaration «Aux communistes chinois et du monde entier» de 1930). Il y défendait alors l’idée qu’il faut, à la solution de la guerre impérialiste, opposer la lutte du prolétariat pour ses propres intérêts révolutionnaires parce que «la bourgeoisie est définitivement passée dans le camp de la contre-révolution». Et il ajoutait en s’adressant aux membres du parti communiste chinois : «Votre coalition avec la bourgeoisie fut juste depuis 1924, jusqu’à la fin de 1927, mais maintenant elle ne vaut plus rien.»
Durant les années 1930, il appelle les ouvriers chinois «à faire tout leur devoir dans la guerre contre le Japon.» (La lutte ouvrière n° 43, 23 octobre 1937). Déjà, dans La lutte ouvrière n° 37, il affirme que «s’il y a une guerre juste, c’est la guerre du peuple chinois contre ses conquérants.» C’est la position même des sociaux-traîtres durant la première guerre mondiale ! Et il ajoute : «Toutes les organisations ouvrières, toutes les forces progressistes de la Chine, sans rien céder de leur programme et de leur indépendance politique, feront jusqu’au bout leur devoir dans cette guerre de libération indépendamment de leur attitude vis à vis du gouvernement de Tchang Kaï-Chek.»
Bilan attaque violemment la position de Trotsky dans sa Résolution sur le conflit sino-japonais de février 1932 :
«Trotsky, qui a une position d’Union Sacrée en Espagne et en Chine, alors qu’en France ou en Belgique il soulève un programme d’opposition au Front populaire, est une maille de la domination capitaliste et aucune action commune ne peut être faite avec lui. De même pour ce qui concerne la Ligue Communiste Internationaliste de Belgique qui prend position d’Union Sacrée en Espagne et internationaliste en Chine.» ([26] [3594])
La Fraction ira jusqu’à titrer un article paru dans Bilan n° 46 de janvier 1938 : «Un grand renégat à la queue de paon : Léon Trotsky» ([27] [3595]).
Mais cette involution de Trotsky qui aurait dû l’amener [s’il avait vécu plus longtemps et s’il avait pris position sur les conflits guerriers en conservant cette position politique] dans le camp de la contre-révolution, va amener les trotskistes chinois d’abord, et la 4e Internationale ensuite, à se vautrer, au cours de la deuxième guerre mondiale dans les bras du patriotisme et du social impérialisme.
Seul le groupe qui publie L’Internationale, autour de Zheng Chaolin et Weng Fanxi, se maintient sur la position de «défaitisme révolutionnaire» et c’est pour cette raison que certains de ses membres sont exclus et que d’autres rompent avec la Ligue communiste de Chine (trotskiste). ([28] [3596])
Au terme de cet article, il est important de noter que seule la Fraction Italienne a su développer les arguments qui montrent pourquoi les luttes de libération nationales ne sont plus «progressistes» mais sont devenues contre-révolutionnaires dans la phase actuelle du développement du capitalisme. C’est la Gauche communiste de France et, à sa suite, le CCI qui renforceront cette position en lui donnant une assise théorique solide.
MR
[1] [3597] Revue internationale n° 81, 84, 94.
[2] [3598] Thèses de Zinoviev pour le Bureau Politique du PC de l’URSS le 14 avril 1927.
[3] [3599] Voir les articles dans les derniers numéros de la Revue Internationale sur la révolution allemande. Trotsky écrit que l’échec de 1923 en Allemagne est «une gigantesque défaire» dans L’Internationale après Lénine, PUF p. 14.
[4] [3600] Nom donné aux partis socialistes ou sociaux-démocrates qui ont trahi pendant la 1re guerre mondiale.
[5] [3601] Dictateur polonais qui vient de réprimer la classe ouvrière, fondateur du parti socialiste polonais (PSP) de tendance réformiste et nationaliste.
[6] [3602] Trotsky dans L’Internationale après Lénine.
[7] [3603] L’existence d’un «Guomindang de gauche» est une affabulation de l’IC stalinisée.
[8] [3604] Harold Isaacs, La tragédie de la révolution chinoise, 1925-1927, cité par Trotsky dans L’Internationale après Lénine.
[9] [3605] Bilan n°9, juillet 34.
[10] [3606] Voir L’Internationale communiste après Lénine, PUF 1979.
[11] [3607] C’est ainsi qu’est appelé le cours de l’IC après 1927.
[12] [3608] Souligné par Trotsky lui même.
[13] [3609] Idem, Trotsky.
[14] [3610] Soulèvement qui a tenu du 19 au 28 septembre avant d’être écrasé.
[15] [3611] En décembre 1924, est organisé un soulèvement. Y participent 200 membres du PCE qui sont écrasés en quelques heures.
[16] [3612] Idem, Trotsky
[17] [3613] Fin 1925, la Troïka Staline-Zinoviev-Kamenev éclate. Un «bloc» des oppositions se forme et s’appellera l’Opposition Unifiée.
[18] [3614] On sait aujourd’hui que ce mot d’ordre n’était pas adéquat - Trotsky lui-même s’interroge sur sa validité (voir p. 211) - puisque le cours n’était plus favorable à la révolution.
[19] [3615] Thèses qui auraient du être discutées aux futurs 7e Plénum de l’IC et au 15e Congrès du parti russe (PCUS).
[20] [3616] Bilan n° 1, novembre 1933. C’est ce qui a été appelé par l’Opposition russe le «Thermidor de la révolution russe».
[21] [3617] Ibid.
[22] [3618] Enrico Russo (Candiani) membre du Comité central de la Fraction italienne.
[23] [3619] Aujourd’hui encore la composante bordiguiste a du mal à reprendre la position de la Fraction (FI) et traite, par exemple, la position du CCI d’»indifférentiste».
[24] [3620] Il s’agit de la tactique de «l’Aventin» qui consistait pour le PC à se retirer du parlement dominé par les fascistes pour se réunir sur l’Aventin avec les centristes et les sociaux démocrates. Cette politique a été dénoncée comme opportuniste par Bordiga.
[25] [3621] Il s’agit de l’IC et des PC stalinisés.
[26] [3622] La seule tendance qui prend la même position que la FI et la Fraction belge de la gauche communiste est constituée par la Revolutionary Workers League (RWL) (plus connue par le nom de son représentant Oelher) et le Grupo de Trabajadores Marxistas (lui aussi plus connu sous le nom de son représentant Eiffel).
[27] [3623] Pour notre part, nous considérons que Trotsky n’a pas trahi la classe ouvrière puisqu’il est mort avant le déclenchement de la guerre impérialiste mondiale. Il n’en est pas de même des trotskistes. Voir notre brochure «Le trotskisme contre la classe ouvrière».
[28] [3624] Voir Revue Internationale n° 94.
Conscience et organisation:
- Troisième Internationale [1881]
Courants politiques:
- Gauche Communiste [49]
Heritage de la Gauche Communiste:
Question d'organisation : sommes-nous devenus "léninistes"? (I)
- 5032 reads
Depuis la fin des années 1960 et la constitution des groupes politiques qui allaient former le CCI en 1975, nous avons toujours été confrontés à une double critique.
Pour les uns, en général les différentes organisations dénommées Parti communiste international, issues de la Gauche italienne, nous serions des idéalistes sur la question de la conscience de classe et des anarchistes en matière d’organisation politique.
Pour les autres, en général issus de l’anarchisme ou du courant conseilliste qui rejette ou sous-estime la nécessité de l’organisation politique et du parti communiste, nous serions des «partidistes» et des «léninistes». Les premiers appuient leur affirmation sur notre rejet de la position «classique» du mouvement ouvrier sur la prise du pouvoir par le parti communiste lors de la dictature du prolétariat et sur notre vision non-monolithique du fonctionnement de l’organisation politique. Les seconds rejettent notre conception rigoureuse du militantisme révolutionnaire et nos efforts incessants pour la construction d’une organisation internationale, unie et centralisée.
Aujourd’hui, une autre critique du même type que celle des conseillistes, mais plus virulente, se développe : le CCI qui serait en pleine dégénérescence, serait devenu une secte «léniniste» ([1] [3625]) et serait sur le point de rompre avec sa plate-forme politique et ses positions principielles. Nous mettons au défi quiconque de prouver ce mensonge que rien, ni dans nos publications, ni dans nos textes programmatiques, ne justifie. Cette dénonciation – car nous ne sommes plus dans le cadre d’une critique – son outrance ne font aucun doute pour quiconque suit sérieusement et sans a-priori la presse du CCI. Mais le fait qu’elle soit souvent portée par d’anciens militants de notre organisation, peut faire douter le lecteur peu attentif ou peu expérimenté et le faire succomber au «il n’y a jamais de fumée sans feu». En fait, ces anciens militants rejoignent ce que nous avons défini comme le milieu du «parasitisme politique» ([2] [3626]). Ce milieu s’oppose à notre lutte de toujours pour le regroupement international des forces militantes et l’unité du milieu politique prolétarien dans la lutte historique contre le capitalisme. Dans ce but, il essaie de saper et d’affaiblir notre combat contre tout dilettantisme et informalisme dans l’activité militante, tout comme notre défense acharnée d’une organisation internationale unie et centralisée.
Serions-nous devenus des léninistes comme l’affirment nos critiques ou nos dénonciateurs ? Voilà une accusation grave à laquelle nous ne pouvons nous dérober. Pour pouvoir y répondre sérieusement, il faut déjà savoir de quoi nous parlons. Qu’est-ce que le «léninisme» ? Qu’a-t-il représenté dans l’histoire du mouvement ouvrier ?
Le « léninisme » et Lénine
Le «léninisme» apparaît en même temps que le culte de Lénine dès la mort de ce dernier. Malade à partir de 1922, sa participation à la vie politique va en diminuant jusqu’à sa disparition en janvier 1924. Le reflux de la vague révolutionnaire internationale qui avait arrêté la 1re guerre mondiale et l’isolement du prolétariat en Russie sont les causes fondamentales de la montée en puissance de la contre-révolution dans le pays. Les principales manifestations de ce processus sont l’anéantissement du pouvoir des conseils ouvriers et de toute vie prolétarienne en leur sein, la bureaucratisation et la montée du stalinisme en Russie même, et tout spécialement au sein du Parti bolchevique au pouvoir. Les erreurs politiques souvent dramatiques – en particulier l’identification du parti et du prolétariat à l’Etat russe qui justifia la répression de Kronstadt par exemple – jouent un rôle important dans le développement de la bureaucratie et du stalinisme. Lénine n’est pas exempt de reproches même s’il reste bien souvent celui qui est le plus capable de s’opposer à la bureaucratisation comme en 1920 – contre Trotsky et une grande partie des dirigeants bolcheviks qui prônent la militarisation des syndicats – et comme dans la dernière année de sa vie où il dénonce le pouvoir de Staline et propose à Trotsky, fin 1922, de constituer une alliance, un bloc dit-il, «contre le bureaucratisme en général, contre le bureau d’organisation en particulier» [à la dévotion de Staline] ([3] [3627]). Ce n’est qu’une fois son autorité politique anéantie avec sa disparition, que la tendance bureaucratique contre-révolutionnaire développe le culte de la personnalité ([4] [3628]) autour de sa personne : on débaptise Petrograd en Leningrad, on momifie son corps, et surtout on crée l’idéologie du «léninisme» et du «marxisme-léninisme». Il s’agit pour la troïka formée de Staline, Zinoviev et Kamenev de s’approprier l’«héritage» de Lénine comme moyen de lutte contre Trotsky au sein du parti russe et pour s’emparer du pouvoir dans l’Internationale communiste (IC). L’offensive stalinienne pour prendre le contrôle des différents partis communistes, va se concentrer autour de la «bolchevisation» de ces partis et l’exclusion des militants qui ne se plient pas à la nouvelle politique.
Le «léninisme», c’est la trahison de l’oeuvre de Lénine, c’est la contre-révolution en marche
En 1939 dans sa biographie de Staline, Boris Souvarine ([5] [3629]) souligne la rupture entre Lénine et le «léninisme» : «Entre l’ancien bolchevisme et le nouveau "léninisme", il n’y eut pas solution de continuité, à proprement parler.» ([6] [3630]) Voilà comment il définit le «léninisme» : «Staline s’en institua le premier auteur classique, avec sa brochure : Fondements du léninisme, recueil de conférences lues aux "étudiants rouges" de l’université communiste de Sverdlov, au début d’avril 1924. Dans cette laborieuse compilation où des phrases démarquées alternent avec les citations, on cherche en vain la pensée critique de Lénine. Tout ce qui est vivant, relatif, conditionnel et dialectique dans l’oeuvre mise à contribution devient passif, absolu, catéchisme, d’ailleurs parsemé de contresens.» ([7] [3631])
Le «léninisme», c’est la «théorie» du socialisme en un seul pays totalement opposée à l’internationalisme de Lénine
L’avènement du «léninisme» marque la victoire du cours opportuniste qu’a pris l’IC à partir de son 3e congrès, en particulier avec l’adoption de la tactique de Front unique et le mot d’ordre «aller aux masses» alors que l’isolement de la Russie révolutionnaire se fait cruellement sentir. Les erreurs des bolcheviks sont un facteur négatif favorisant ce cours opportuniste. Il convient de rappeler ici que la position fausse sur «le parti exerçant le pouvoir» est alors partagée par tout le mouvement révolutionnaire, y inclus Rosa Luxemburg et la Gauche allemande. Ce n’est qu’au début des années 1920 que le KAPD commence à souligner la contradiction qu’il y a pour le parti révolutionnaire à être au pouvoir et à s’identifier au nouvel Etat surgi de l’insurrection victorieuse.
C’est contre cette gangrène, opportuniste d’abord puis ouvertement contre-révolutionnaire, qu’apparaissent et se développent différentes oppositions. Parmi celles-ci, les plus conséquentes sont les diverses oppositions de gauche, russe, italienne, allemande et hollandaise qui sont restées fidèles à l’internationalisme et à octobre 1917. Combattant le cours opportuniste croissant de l’IC, elles en sont les unes après les autres exclues tout au long des années 1920. Celles qui arrivent à s’y maintenir, s’opposent aux implications pratiques du «léninisme», c’est-à-dire à la politique de «bolchevisation» des partis communistes. En particulier, elles combattent la substitution de l’organisation en sections locales, c’est-à-dire sur une base territoriale, géographique, par l’organisation en cellules d’usines et d’entreprises qui aboutit à regrouper et organiser les militants sur des bases corporatistes et qui participe de vider les partis de toute vie réellement communiste faite de débats et de discussions politique d’ordre général.
La mise en avant du «léninisme» exacerbe le combat entre le stalinisme et les oppositionnels de gauche. Elle s’accompagne du développement de la théorie du «socialisme en un seul pays» qui est en rupture complète avec l’internationalisme intransigeant de Lénine et l’expérience d’Octobre. Elle marque l’accélération du cours opportuniste jusqu’à la victoire définitive de la contre-révolution. Avec l’adoption dans son programme du «socialisme en un seul pays» et l’abandon de l’internationalisme, l’IC – comme Internationale – meurt définitivement lors de son 6e congrès en 1928.
Le «léninisme», c’est la division entre Lénine et Rosa Luxemburg ;c’est la division entre la fraction bolchevique et les autres gauches internationalistes
En 1925, le 5e congrès de l’IC adopte les «Thèses sur la bolchevisation» qui manifestent l’emprise croissante de la bureaucratie stalinienne sur les PC et l’IC. Produite par la contre-révolution stalinienne, la bolchevisation devient au plan organisationnel le principal vecteur de la dégénérescence accélérée des partis de l’IC. L’utilisation croissante de la répression et de la terreur d’Etat en Russie et des exclusions dans les autres partis manifestent l’âpreté et la férocité de la lutte. Pour le stalinisme, existe encore à ce moment-là le danger de la constitution d’une forte opposition internationale autour de la figure de Trotsky, seul capable de regrouper autour de lui la plus grande partie des énergies révolutionnaires. Cette opposition contrecarre largement la politique de l’opportunisme et peut disputer au stalinisme, avec des chances de succès, la direction des partis comme le montrent les exemples de l’Italie et de l’Allemagne.
Un des objets de la «bolchevisation» est donc de dresser une opposition entre Lénine et les autres grandes figures du communisme appartenant aux autres courants de la gauche, en particulier entre Lénine et Trotsky bien sûr, mais aussi entre Lénine et Rosa Luxemburg : «Une véritable bolchevisation est impossible sans vaincre les erreurs du Luxemburgisme. Le "léninisme" doit être la seule boussole des partis communistes du monde entier. Tout ce qui s’éloigne du "léninisme", s’éloigne du marxisme.» ([8] [3632])
Reconnaissons au stalinisme la primeur d’avoir rompu, déchiré, le lien et l’unité entre Lénine et Rosa Luxemburg, entre la tradition bolchevique et le reste des gauches issues de la 2e Internationale. Dans sa foulée, les partis de la social-démocratie ont participé à dresser une barrière infranchissable entre la «bonne et démocratique» Rosa Luxemburg et le «mauvais et dictatorial» Lénine. Cette politique n’appartient pas qu’au passé. Ce qui a toujours fait l’unité entre ces deux grands révolutionnaires est encore aujourd’hui l’objet d’attaques. Les saluts hypocrites à la clairvoyance de Rosa Luxemburg pour... ses critiques de la révolution russe et du parti bolchevique sont lancés très souvent par les descendants politiques directs de ses assassins social-démocrates, c’est-à-dire les partis socialistes actuels. Et tout particulièrement par le parti socialiste allemand, sans doute parce que Rosa Luxemburg était... allemande !
Une fois de plus se vérifie l’alliance et la communauté d’intérêts entre la contre-révolution stalinienne et les forces «classiques» du capital. En particulier, se vérifie l’alliance entre la social-démocratie et le stalinisme pour falsifier l’histoire du mouvement ouvrier et détruire le marxisme. Gageons que la bourgeoisie ne manquera de célébrer à sa manière les 80 ans de l’assassinat de Rosa Luxemburg et des spartakistes à Berlin en 1919.
«Quel douloureux spectacle pour les militants révolutionnaires que de voir les assassins des artisans de la Révolution d’Octobre, devenus alliés des assassins des Spartakistes, oser commémorer la mort des chefs prolétariens. Non, ils n’ont pas le droit de parler de Rosa Luxemburg dont la vie fut toute d’intransigeance, de lutte contre l’opportunisme, de fermeté révolutionnaire, ceux qui, de trahison en trahison, sont aujourd’hui à l’avant-garde de la contre-révolution internationale.» ([9] [3633])
Bas les pattes sur Rosa Luxemburg et Lénine, ils appartiennent au prolétariat révolutionnaire !
Aujourd’hui, la plus grande partie des éléments du milieu parasite ([10] [3634]), viennent contribuer à ces falsifications historiques d’autant plus facilement qu’ils traînent pour la plupart leurs guêtres dans le marécage anarchisant, autre milieu grand spécialiste des attaques contre ce que représente Lénine.
Et malheureusement, la plupart des courants et groupes authentiquement prolétariens pêchent par leur manque de clarté politique. De par ses faiblesses théoriques et ses erreurs politiques, le conseillisme apporte sa petite pierre au mur qu’on tente d’élever entre le parti bolchevique et les gauches allemande et hollandaise, entre Lénine d’un côté et Rosa Luxemburg de l’autre. Tout comme les groupes bordiguistes, et même le PCInt Battaglia Comunista, qui, là-aussi de par leur faiblesses théoriques (on peut même parler d’aberrations pour ce qui touche à la théorie de l’«invariance» chère aux bordiguistes), ne voient pas les enjeux politiques derrière la défense aussi bien de Lénine et de Luxemburg, que de l’ensemble des fractions de gauche issues de l’IC.
Ce qu’il importe de retenir de Lénine et de Rosa Luxemburg et, au-delà de leurs figures, du parti bolchevique et des autres gauches au sein de la 2e Internationale, c’est l’unité et la continuité de leur combat. Malgré les débats et les divergences, ils se sont toujours retrouvés du même côté de la barricade face aux questions essentielles quand le prolétariat se trouvait confronté à des événements décisifs. Ils sont les leaders de la gauche révolutionnaire au congrès de Stuttgart de l’Internationale socialiste (1907), au cours duquel ils présentent ensemble avec succès un amendement à la résolution sur l’attitude des socialistes face à la guerre. Cet amendement appelle ceux-ci à «utiliser par tous les moyens la crise économique et politique provoquée par la guerre pour réveiller le peuple et de hâter par là la chute de la domination capitaliste» ; et Lénine va même jusqu’à confier le mandat du parti russe à Rosa Luxemburg dans la discussion sur cette question. Fidèles à leur combat internationaliste au sein de leur parti respectif, ils sont contre la première guerre impérialiste quand elle éclate. Le courant de Rosa Luxemburg, les spartakistes, participe avec les bolcheviks et Lénine aux conférences internationalistes de Zimmerwald et Kienthal (1915 et 1916). Ils sont encore ensemble, avec toutes les gauches, enthousiastes et unanimes dans le soutien à la révolution russe :
«La révolution russe est le fait le plus prodigieux de la guerre mondiale. (...) En misant à fond sur la révolution mondiale du prolétariat, les bolcheviks ont précisément donné la preuve éclatante de leur intelligence politique, de la fermeté de leurs principes, de l’audace de leur politique. (...) Le parti de Lénine a été le seul à comprendre les exigences et les devoirs qui incombent à un parti vraiment révolutionnaire et à assurer la poursuite de la révolution en lançant le mot d’ordre : tout le pouvoir aux mains du prolétariat et de la paysannerie. [Les bolcheviks] ont aussitôt défini comme objectif à cette prise du pouvoir le programme révolutionnaire le plus avancé dans son intégralité ; il ne s’agissait pas d’assurer la démocratie bourgeoise mais d’instaurer la dictature du prolétariat pour réaliser le socialisme. Ils ont ainsi acquis devant l’histoire le mérite impérissable d’avoir proclamé pour la première fois les objectifs ultimes du socialisme comme programme immédiat de politique pratique.» ([11] [3635])
Est-ce à dire qu’il n’y avait pas de divergences entre ces grandes figures et ces organisations du mouvement révolutionnaire ? Bien sûr que non. Est-ce à dire qu’il faudrait les ignorer ? Non plus. Mais pour les aborder et pour pouvoir en tirer le maximum de leçons, il faut pouvoir reconnaître et défendre ce qui les unit. Et ce qui les unit, c’est le combat de classe, le combat révolutionnaire conséquent contre le capital, contre la bourgeoisie et toutes ses forces politiques. Le texte de Rosa Luxemburg dont nous venons de citer un extrait est une critique sans concession de la politique du parti bolchevique en Russie. Mais elle prend bien soin de situer le cadre dans lequel ses critiques doivent être entendues : dans le cadre d’une solidarité et d’une lutte commune avec les bolcheviks. Elle dénonce de manière virulente l’opposition des mencheviks et de Kautsky à l’insurrection prolétarienne. Et afin d’éviter toute équivoque sur son positionnement de classe, toute dénaturation de son propos, elle termine ainsi : «En Russie, le problème ne pouvait qu’être posé. Il ne pouvait être résolu en Russie. En ce sens, l’avenir appartient partout au "Bolchevisme".»
La défense de ces figures et de leur unité de classe est une tâche que la tradition de la gauche italienne nous a léguée et que nous entendons poursuivre. Lénine et Rosa Luxemburg appartiennent au prolétariat révolutionnaire. Voilà comment la fraction italienne de la gauche communiste entendait défendre ce patrimoine contre le «léninisme» stalinien et la social-démocratie :
«Mais au côté de cette figure géniale de chef prolétarien (Lénine) se dressent tout aussi imposantes les figures de Rosa Luxemburg et de Karl Liebknecht. Produits d’une lutte internationale contre le révisionnisme et l’opportunisme, expression d’une volonté révolutionnaire du prolétariat allemand, ils appartiennent à nous et non à ceux qui veulent faire de Rosa le drapeau de l’anti-Lénine et de l’antiparti ; de Liebknecht le drapeau d’un antimilitarisme qui s’exprime en fait par le vote des crédits militaires dans les différents pays "démocratiques".» ([12] [3636])
Nous n’avons pas encore répondu à l’accusation d’avoir changé de position sur Lénine. Mais le lecteur peut déjà s’apercevoir clairement et concrètement que nous sommes résolument opposés au «léninisme». Et que nous restons fidèles à la tradition des fractions de gauche dont nous nous revendiquons, et tout particulièrement de la fraction italienne des années 1930. Nous essayons d’appliquer à chaque fois que cela se présente cette méthode qui vise à lutter pour la défense de l’unité et la continuité historiques du mouvement ouvrier. Contre le «léninisme» et toutes les tentatives de diviser et d’opposer les différentes fractions marxistes du mouvement ouvrier, nous luttons pour la défense de leur unité. Contre l’opposition abstraite et mécanique faite à partir de citations extraites de leur contexte, nous re-situons les conditions réelles dans lesquelles les prises de position ont été faites, toujours à partir de débats et de polémiques au sein du mouvement ouvrier. C’est-à-dire dans le même camp. C’est la méthode que le marxisme a toujours essayé d’appliquer, qui est tout le contraire du «léninisme» et qui est rejetée par les véritables disciples contemporains de ce dernier. Car il est tout de même amusant de voir que, pour le moins sur ce plan de la «méthode», ceux qui accusent le CCI d’être devenu «léniniste» se retrouvent parmi les continuateurs du stalinisme !
Bas les pattes devant la gauche hollandaise et les figures de Pannekoek et de Gorter !
Les adeptes contemporains de la «méthode» du «léninisme» sont facilement identifiables dans différents milieux. Il est en vogue, dans les milieux anarcho-conseillistes et parmi les éléments parasites, d’essayer de s’approprier frauduleusement la gauche hollandaise et de l’opposer aux autres fractions de gauche et à Lénine bien évidemment. A leur tour, tout comme Staline et son «léninisme» ont trahi Lénine, ces éléments trahissent la tradition de la Gauche hollandaise et ses grandes figures comme celle d’Anton Pannekoek – que Lénine salue avec respect et admiration dans L’Etat et la révolution – ou celle d’Herman Gorter qui s’empressera de traduire ce classique du marxisme dès 1918. Avant de développer la théorie du communisme de conseils dans les années 1930, Anton Pannekoek a été un des plus éminents militants de l’aile marxiste au sein de la 2e Internationale aux côtés de Rosa Luxemburg et Lénine, tout comme durant la guerre. Plus facile à arracher au camp prolétarien de par ses critiques conseillistes contre les bolcheviks à partir des années 1930 qu’un Bordiga, il est encore aujourd’hui l’objet d’attentions particulières visant à gommer tout souvenir de son adhésion à l’IC, de sa participation de premier plan à la constitution du Bureau d’Amsterdam pour l’Occident, et de son enthousiasme et son soutien résolu à Octobre 1917. Tout autant que les fractions de gauche italienne et russe au sein de l’IC, les gauches hollandaise et allemande appartiennent au prolétariat et au communisme. Et en nous revendiquant de toutes les fractions de gauche issues de l’IC, nous reprenons aussi la méthode utilisée par la gauche hollandaise à l’instar de toutes les gauches :
«La guerre mondiale et la révolution qu’elle a engendrée ont montré d’une manière évidente qu’il n’y a qu’une tendance dans le mouvement ouvrier qui conduise réellement les travailleurs au communisme. Seule l’extrême gauche des partis sociaux-démocrates, les fractions marxistes, le parti de Lénine en Russie, de Bela Kun en Hongrie, de Rosa Luxemburg et de Karl Liebknecht en Allemagne ont trouvé le bon et unique chemin.
La tendance qui a toujours eu pour but la destruction du capitalisme par la violence, qui, à l’époque de l’évolution, du développement pacifiques, faisait usage de la lutte politique et de l’action parlementaire pour la propagande révolutionnaire et pour l’organisation du prolétariat ; celle qui maintenant fait usage de la force de l’Etat pour la révolution. La même tendance qui a trouvé aussi le moyen de briser l’Etat capitaliste et de le transformer en Etat socialiste, ainsi que le moyen par lequel on construit le communisme : les conseils ouvriers, qui renferment eux-mêmes toutes les forces politiques et économiques ; la tendance qui a enfin découvert ce que la classe ignorait jusqu’à maintenant et l’a établi pour toujours : l’organisation par laquelle le prolétariat peut vaincre et remplacer le capitalisme.» ([13] [3637])
Même après l’exclusion du KAPD des rangs de l’IC en 1921, ils essaient de rester fidèles à leurs principes et solidaires des bolcheviks.
«Nous nous sentons, en dépit de l’exclusion de notre tendance par le congrès de Moscou, pleinement solidaires des bolcheviks russes (...). Nous restons solidaires non seulement du prolétariat russe mais aussi de ses chefs bolcheviks, bien que nous devions critiquer de la façon la plus vive leur conduite au sein du communisme international.» ([14] [3638])
En se revendiquant et en défendant l’unité et la continuité «des apports successifs de la Ligue des Communistes de Marx et Engels (1847-1852), des trois Internationales (l’Association Internationale des travailleurs, 1864-1872, l’Internationale Socialiste, 1889-1914, l’Internationale Communiste, 1919-1928), des fractions de gauche qui se sont dégagées dans les années 1920-1930 de la 3e Internationale lors de sa dégénérescence, en particulier les gauches allemande, hollandaise et italienne» ([15] [3639]), le CCI est fidèle à la tradition marxiste au sein du mouvement ouvrier. En particulier, il s’inscrit dans la lutte unie et constante de la «Tendance» définie par Gorter, des fractions de gauche au sein de la 2e Internationale et au sein de la 3e. En ce sens, nous sommes fidèles à Lénine, à Rosa Luxemburg, à Pannekoek et à Gorter, et à la tradition des fractions de gauche des années 1930, au premier chef à la revue Bilan.
Les «léninistes» d’aujourd’hui ne sont pas dans le CCI
Fidèles aussi aux fractions de gauche qui ont combattu le stalinisme dans des conditions dramatiques, nous rejetons toute accusation de «léninisme» à notre encontre. Et nous dénonçons ceux-la même qui les profèrent : ce sont eux qui reprennent la méthode utilisée par Staline et sa théorie du «léninisme» en l’attribuant à Lénine. Et toujours armés de la «méthode» de Staline, ils n’essaient même pas de fonder leurs accusations sur des éléments réels, concrets – tels nos prises de position écrites ou orales – mais plutôt sur des «on-dit» et des mensonges. Ils affirment que notre organisation est devenue une secte et qu’elle est en pleine dégénérescence afin d’en éloigner tous les éléments qui essaient de trouver une perspective politique et révolutionnaire conséquente. L’accusation est d’autant plus calomnieuse que derrière le mot «léninisme» se cache, quand elle n’est pas ouvertement affirmée, l’accusation de stalinisme à notre endroit.
La dénonciation de notre «léninisme» supposé s’appuie essentiellement sur des ragots concernant notre fonctionnement interne, en particulier sur la prétendue impossibilité de débattre au sein de notre organisation. Nous avons déjà répondu à ces accusations ([16] [3640]) et nous n’y reviendrons pas ici. Nous nous contenterons de retourner le compliment après avoir démontré quels étaient les véritables continuateurs de la méthode «léniniste», non marxiste, faussement révolutionnaire.
Le CCI s’est toujours revendiqué du combat de Lénine pour la construction du parti
Une fois rejetée l’accusation de «léninisme», reste une question beaucoup plus sérieuse : aurions-nous abandonné notre esprit critique vis-à-vis de Lénine sur la question de l’organisation politique ? Y a-t-il un changement de position du CCI sur Lénine tout particulièrement en matière d’organisation, sur la question du parti, de son rôle et de son fonctionnement ? Nous ne voyons pas ce qui pourrait constituer une rupture dans la position du CCI sur la question organisationnelle et vis-à-vis de Lénine, entre le CCI de ses débuts dans les années 1970 et celui de 1998.
Nous maintenons que nous sommes aux côtés de Lénine dans le combat contre l’économisme et le menchévisme. Il n’y a là rien de nouveau. Nous maintenons que nous sommes d’accord avec la méthode utilisée et avec la critique argumentée et développée contre l’économisme et les menchéviks. Et nous maintenons que nous sommes aussi en accord avec une grande partie des différents points qui sont développés par Lénine. Il n’y a là rien de changé.
Nous maintenons nos critiques sur certains aspects qu’il a pu développer en matière d’organisation. «Certaines conceptions défendues par Lénine (notamment dans Un pas en avant, deux pas en arrière) sur le caractère hiérarchisé et "militaire" de l’organisation, et qui ont été exploitées par le stalinisme pour justifier ses méthodes, sont à rejeter.» ([17] [3641]) Nous n’avons pas changé d’avis non plus sur ces critiques. Mais la question mérite une réponse plus approfondie à la fois pour appréhender l’ampleur réelle des erreurs de Lénine et pour comprendre le sens historique des débats qui ont eu lieu dans le Parti ouvrier social-démocrate russe (POSDR).
Pour pouvoir traiter sérieusement cette question centrale pour les révolutionnaires, y compris les erreurs de Lénine, il convient de rester fidèle à la méthode et à l’enseignement des différentes gauches communistes tels que nous les avons soulignés dans la première partie de cet article. Nous refusons de choisir entre ce qui nous plairait dans l’histoire du mouvement ouvrier et ce qui nous déplairait. Une telle attitude est a-historique et le propre de ceux qui s’autorisent de juger, 100 ou 80 ans plus tard, un processus historique fait de tâtonnements, de succès et d’échecs, de multiples débats et contributions, au prix d’énormes sacrifices et de dures luttes politiques. C’est vrai pour les questions théoriques et politiques. C’est vrai pour les questions d’organisation. Ni la fin menchevique de Plékhanov et son attitude chauvine durant la première guerre mondiale, ni l’utilisation de Trotsky par le... trotskisme et de Pannekoek par l’anarcho-conseillisme, ne retirent quoi que ce soit à la richesse de leurs contributions politiques et théoriques qui restent toujours d’actualité et d’un grand intérêt militant. Ni les morts honteuses de la 2e et 3e Internationales, ni la fin du parti bolchevique dans le stalinisme, ne retirent quoi que ce soit à leur rôle dans l’histoire du mouvement ouvrier et à la validité de leurs acquis organisationnels.
Avons-nous changé d’avis là-dessus ? Pas du tout : «Il existe un acquis organisationnel tout comme il y a un acquis théorique, et l’un conditionne l’autre de façon permanente.» ([18] [3642])
Tout comme les critiques de Rosa Luxemburg aux bolcheviks dans La révolution russe doivent être resituées dans le cadre de l’unité de classe qui l’associe aux bolcheviks, de même les critiques que nous pouvons porter sur la question organisationnelle doivent être situées dans le cadre de l’unité qui nous associe à Lénine dans son combat – avant et après la constitution de la fraction bolchevique – pour la construction du parti. Cette position n’est pas nouvelle et ne doit pas surprendre. Aujourd’hui encore, comme nous le «répétions» déjà en 1991, «nous répétons ([19] [3643]) que "l’histoire des fractions est l’histoire de Lénine" ([20] [3644]) et que c’est seulement sur la base du travail qu’elles ont accompli qu’il sera possible de reconstruire le parti communiste mondial de demain.» ([21] [3645])
Est-ce à dire que la compréhension sur l’organisation révolutionnaire qu’avait le CCI depuis sa constitution est restée exactement la même ? Est-ce à dire que cette compréhension ne s’est pas enrichie, approfondie, tout au long des débats et des combats organisationnels que notre organisation a dû mener ? Si c’était le cas, on pourrait nous accuser d’être une organisation sans vie, ni débat, d’être une secte se contentant de réciter les Saintes Ecritures du mouvement ouvrier. Nous n’allons pas refaire ici toute l’histoire des débats et combats organisationnels qui ont traversé notre organisation depuis sa constitution. A chaque fois, et il fallait qu’il en soit ainsi sinon à risquer l’affaiblissement, parfois même la liquidation du CCI, nous avons dû nous pencher sur «les acquis organisationnels» de l’histoire du mouvement ouvrier, nous les réapproprier, les préciser et les enrichir.
Mais les réappropriations et les enrichissements que nous avons accomplis en matière d’organisation, ne signifient pas que nous ayons changé de position sur cette question en général, ni même par rapport à Lénine. Elles s’inscrivent en continuité avec l’histoire et les acquis organisationnels que nous a légués l’expérience du mouvement ouvrier. Nous défions quiconque de prouver qu’il y ait eu rupture dans notre position. La question organisationnelle est une question politique à part entière au même titre que les autres. Nous affirmons même que c’est la question centrale qui, in fine, détermine la capacité d’aborder toutes les autres questions théoriques et politiques. En disant cela, nous sommes en accord avec Lénine. En disant cela, nous ne changeons pas de position avec ce que nous avons toujours affirmé. Nous avons toujours défendu que c’était la plus grande clarté sur cette question, en particulier sur le rôle de la fraction, qui avait permis à la gauche italienne non seulement de se maintenir comme organisation, mais même d’être capable de tirer les leçons théoriques et politiques les plus claires et les plus cohérentes, y compris en reprenant et en développant les apports théoriques et politiques initiaux de la gauche germano-hollandaise – sur les syndicats, sur le capitalisme d’Etat, sur l’Etat dans la période de transition.
Le CCI aux côtés de Lénine dans le combat contre l’économisme et les menchéviks
Le CCI s’est toujours revendiqué du combat des bolcheviks en matière d’organisation. C’est de leur exemple que nous nous inspirions quand nous écrivions : «l’idée qu’une organisation révolutionnaire se construit volontairement, consciemment, avec préméditation, loin d’être une idée volontariste est au contraire un des aboutissements concrets de toute praxis marxiste.» ([22] [3646])
En particulier, nous avons toujours affirmé notre appui au combat de Lénine contre l’économisme. De même, nous avons toujours soutenu son combat contre ceux qui allaient devenir mencheviks, au 2e congrès du POSDR. Ceci n’est pas nouveau. Comme n’est pas nouveau non plus que nous considérions Que Faire ? (1902) comme l’ouvrage essentiel pour le combat contre l’économisme et Un pas en avant, deux pas en arrière (1904) comme l’outil indispensable pour comprendre les enjeux et les lignes de fracture au sein du parti. Prendre ces deux livres pour des classiques du marxisme en matière d’organisation, affirmer que les principales leçons que tire Lénine dans ces ouvrages sont toujours d’actualité, n’est pas nouveau pour nous. Dire que nous sommes d’accord avec le combat, la méthode utilisée, ainsi qu’avecun grand nombre d’arguments qui sont donnés dans les deux textes, n’enlève rien à notre critique des erreurs de Lénine.
Qu’est-ce qui était essentiel dans Que faire ? dans la réalité du moment, c’est-à-dire en 1902 en Russie ? Qu’est-ce qui permettait d’accomplir un pas en avant pour le mouvement ouvrier ? De quel côté fallait-il se situer ? Du côté des économistes parce que Lénine reprend la conception fausse de Kautsky sur la conscience de classe ? Ou bien du côté de Lénine contre l’obstacle que représentaient les économistes dans la constitution d’une organisation conséquente de révolutionnaires ?
Qu’est-ce qui était essentiel dans Un pas en avant, deux pas en arrière ? Etre du côté des mencheviks parce que Lénine, entraîné par la polémique, défend sur certains points des conceptions fausses ? Ou être du côté de Lénine pour l’adoption de critères rigoureux d’adhésion des militants, pour un parti uni et centralisé et contre le maintien de l’existence de cercles autonomes ?
Dans ce cas, «poser les questions, c’est y répondre». Les erreurs sur la conscience et sur la vision d’un parti «militarisé» ont été corrigées par Lénine lui-même, en particulier avec l’expérience de la grève de masse et de la révolution de 1905 en Russie. L’existence d’une fraction bolchevique et d’une organisation rigoureuse a fourni les moyens aux bolcheviks d’être parmi ceux qui ont réussi le mieux à tirer les leçons politiques de 1905 alors qu’ils n’étaient pas les plus clairs au départ, surtout comparés à Trotsky et Rosa Luxemburg, à Plékhanov même, sur la dynamique de la grève de masse. Elle leur a permis de surmonter les erreurs précédentes.
Quelles étaient les erreurs de Lénine ? Elles sont de deux types. Les unes sont dues à la polémique, les autres à des questions théoriques, en particulier sur la question de la conscience de classe.
Les «tordages de barre» de Lénine dans les polémiques
Lénine a les défauts de ses qualités ; ainsi grand polémiste, il tend à «tordre la barre» en reprenant à son compte les arguments de ses opposants pour les retourner contre eux. «Nous tous, nous savons maintenant que les économistes ont tordu la barre dans un sens. Pour la redresser, il fallait la tordre dans le sens opposé, et je l’ai fait.» ([23] [3647]) Mais cette méthode, très efficace dans la polémique et dans la polarisation claire – indispensable à tout débat – a ses limites et peut représenter une faiblesse par ailleurs. En tordant la barre, il tombe dans les exagérations et déforme ses positions réelles. Que faire ? en est une des illustrations comme il l’a lui-même reconnu en plusieurs occasions :
«Au 2e congrès, je n’ai pas pensé ériger en "points programmatiques", en principes spéciaux, mes formulations faites dans Que faire ? Au contraire, j’ai employé l’expression redresser tout ce qui a été tordu, qui sera tant cité par la suite. Dans Que faire ?, j’ai dit qu’il fallait corriger tout ce qui avait été dénaturé par les "économistes" (...). La signification de ces paroles est claire : Que Faire ? rectifie de manière polémique l’économisme et il serait erroné de juger la brochure d’un autre point de vue.» ([24] [3648])
Malheureusement, nombreux sont ceux qui jugent Que faire ? et Un pas en avant, deux pas en arrière d’un «autre point de vue», s’attachant plus à la lettre qu’à l’esprit du texte. Nombreux sont ceux qui prennent ses exagérations pour argent comptant : d’abord ses critiques et ses opposants d’alors, au nombre desquels on retrouve Trotsky et Rosa Luxemburg qui répond dans Question d’organisation dans la social-démocratie russe (1904) au deuxième ouvrage. Puis, 20 ans plus tard et plus lourd de conséquences, ses laudateurs staliniens qui pour justifier le «léninisme» et la dictature stalinienne, s’appuient sur des formules malheureuses employées dans le feu de la polémique. Quand il est accusé d’être dictateur, jacobin, bureaucrate, de prôner la discipline militaire et une vision conspirative, il reprend et développe les termes de ses opposants, «tordant la barre» à son tour. On l’accuse d’avoir une vision conspirative de l’organisation quand il défend des critères stricts d’adhésion des militants et la discipline dans les conditions d’illégalité et de répression ? Voilà sa réponse de polémiste :
«A ne considérer que sa forme, cette forte organisation révolutionnaire dans un pays autocratique peut être qualifiée de "conspirative", car le secret lui est absolument nécessaire. Il lui est indispensable à un tel point que toutes les autres conditions (effectifs, choix des membres, leurs fonctions, etc.) doivent s’y accorder. C’est pourquoi nous serions bien naïfs de craindre qu’on ne nous accuse, nous social-démocrates, de vouloir créer une organisation conspirative. Pareille accusation est aussi flatteuse pour tout ennemi de l’"économisme", que l’accusation de "narodovolisme" ([25] [3649]).» ([26] [3650])
Dans sa réponse à Rosa Luxemburg (septembre 1904) que Kautsky et la direction du parti SD allemand refusent de publier, il nie être à l’origine des formules qu’il reprend :
«La camarade Luxemburg déclare que, selon moi "le Comité central est le seul noyau actif du parti". En réalité, cela n’est pas exact. Je n’ai jamais défendu cette opinion (...). La camarade Luxemburg écrit que je prône la valeur éducative de la fabrique. C’est inexact ; ce n’est pas moi, mais mon adversaire qui a prétendu que j’assimile le parti à une fabrique. J’ai ridiculisé ce contradicteur comme il convient en me servant de ses propres termes pour démontrer qu’il confond deux aspects de la discipline de fabrique, ce qui malheureusement est aussi le cas de la camarade Luxemburg.» ([27] [3651])
L’erreur de Que faire ? sur la conscience de classe
Par contre, il est beaucoup plus important et sérieux de relever et de critiquer une erreur théorique de Lénine dans Que faire ?. Selon lui, «les ouvriers ne pouvaient pas avoir encore la conscience social-démocrate. Celle-ci ne pouvait leur venir que du dehors.» ([28] [3652]) Nous n’allons pas revenir sur notre critique et notre position sur la question de la conscience ([29] [3653]). Evidemment cette position que Lénine reprend de Kautsky est non seulement fausse mais extrêmement dangereuse. Elle justifiera l’exercice du pouvoir par le parti après octobre 1917 en lieu et place de la classe ouvrière dans son ensemble. Elle servira d’arme redoutable au stalinisme par la suite, en particulier pour justifier les tentatives putschistes en Allemagne dans les années 1920 et surtout pour justifier la répression sanglante de la classe ouvrière en Russie.
Est-il besoin de préciser que nous n’avons pas changé de position sur cette question ?
Les faiblesses de la critique de Rosa Luxemburg
Après le 2e congrès du POSDR et la scission entre bolcheviks et mencheviks, Lénine doit affronter un grand nombre de critiques. Parmi celles-ci, seuls Plékhanov et Trotsky rejettent explicitement la position sur la conscience de classe «qui doit être introduite de l’extérieur de la classe ouvrière». Est surtout connue la critique de Rosa Luxemburg, Question d’organisation dans la social-démocratie russe, sur laquelle s’appuient les anti-lénine d’aujourd’hui pour... opposer les deux éminents militants et pour prouver que le vers stalinien était déjà dans le fruit «léninien». C’est-à-dire le mensonge de Staline repris à l’envers. En fait, Rosa s’attache surtout à revenir sur les «tordages de barre» et développe des conceptions justes en soi, mais qui restent abstraites, détachées du combat réel, pratique, qui s’est déroulé au congrès.
«La camarade Luxemburg ignore souverainement nos luttes de Parti et se répand généreusement sur des questions qu’il n’est pas possible de traiter avec sérieux (...). Cette camarade ne veut pas savoir quelles controverses j’ai soutenues au Congrès et contre qui étaient dirigées mes thèses. Elle préfère me gratifier d’un cours sur l’opportunisme... dans les pays parlementaires !» ([30] [3654])
Un pas en avant, deux pas en arrière met bien en évidence les enjeux du congrès et de la lutte qui s’y est menée – à savoir la lutte contre le maintien des cercles dans le parti, et une délimitation claire et rigoureuse entre l’organisation politique et la classe ouvrière. A défaut de les avoir bien compris, tels qu’ils se sont posés dans la lutte concrète, Rosa Luxemburg reste claire sur les objectifs généraux :
«Le problème, auquel la social-démocratie russe travaille depuis plusieurs années, consiste justement à passer d’un premier type d’organisation (organisation éparpillée, de caractère local, composée de cercles tout à fait indépendants les uns des autres, et adaptés à la phase préparatoire, essentiellement propagandiste, du mouvement) à un nouveau type d’organisation, tel que l’exige une action politique de masse, homogène, sur le territoire entier.» (31[31] [3655])
A la lecture de ce passage, on voit qu’elle se retrouve sur le même terrain que Lénine et avec le même but. Lorsqu’on connaît la conception «centraliste», voire «autoritaire» de Rosa Luxemburg et de Leo Jogisches au sein du parti social-démocrate polonais – la SDKPiL –, son positionnement, si elle avait été présente dans le POSDR, dans la lutte concrète contre les cercles et les mencheviks, ne fait pas de doute. Lénine aurait sûrement été contraint de freiner son énergie, et peut-être même ses excès.
Quant à nous aujourd’hui, presque un siècle plus tard, notre position sur la distinction précise entre organisation politique et organisation unitaire de la classe ouvrière nous vient des apports de l’Internationale socialiste, et particulièrement des avancées réalisées par Lénine. En effet, il a été le premier à poser – dans la situation particulière de la Russie tsariste – les conditions de développement d’une organisation minoritaire et réduite, contrairement aux réponses de Trotsky et Rosa Luxemburg qui ont encore à ce moment-là la vision de partis de masse. De même, c’est du combat de Lénine contre les mencheviks sur le point 1 des statuts lors du 2e congrès du POSDR, que nous tirons notre conception rigoureuse, précise et clairement définie de l’adhésion et de l’appartenance militante à l’organisation communiste. Enfin, nous estimons que ce congrès et la lutte de Lénine représentent un très haut moment d’approfondissement théorique et politique sur la question de l’organisation, en particulier sur sa centralisation, contre les visions fédéralistes, individualistes et petite-bourgeoises. C’est un moment qui, tout en reconnaissant le rôle historique positif des cercles dans le regroupement des forces révolutionnaires dans un premier temps, souligne la nécessité de dépasser ce stade pour constituer de réelles organisations unies et développer des rapports politiques fraternels et de confiance entre tous les militants.
Nous n’avons pas changé de position sur Lénine. Et nos principes organisationnels de base, en particulier nos statuts, qui s’appuient et synthétisent l’ensemble de l’expérience du mouvement ouvrier sur la question, s’inspirent grandement des apports de Lénine dans ses combats pour l’organisation. Sans l’expérience des bolcheviks en matière d’organisation, il manquerait une part importante et fondamentale des acquis organisationnels sur lesquels le CCI s’est fondé, et sur lesquels le parti communiste de demain devra s’ériger.
Dans la deuxième partie de cette article, nous allons revenir sur ce que dit, et ne dit pas Que faire ?, dont l’objet et le contenu ont été et sont toujours largement ignorés, ou dénaturés à dessein. Nous préciserons dans quelle mesure l’ouvrage de Lénine représente un réel classique du marxisme et un apport historique au mouvement ouvrier, tant sur le plan de la conscience que sur le plan organisationnel. Bref, dans quelle mesure, le CCI se revendique aussi de Que faire ?
RL
[1] [3656] Voir par exemple le texte d’un de nos anciens militants, RV, «Prise de position sur l’évolution récente du CCI», publié par nos soins dans notre brochure La prétendue paranoïa du CCI, tome I ; et ces «critiques» en général.
[2] [3657] Voir «Thèses sur le parasitisme politique», Revue internationale n° 94.
[3] [3658] Cité par Pierre Broué, Trotsky, Ma vie, III p. 200-201.
[4] [3659] . Rappelons une fois encore ce que disait Lénine lui-même sur les tentatives de récupération des grandes figures révolutionnaires : «Après leur mort, on cherche à en faire d’inoffensives icones, à les canoniser pour ainsi dire, à entourer leur "nom" d’une certaine gloire, pour "consoler" et mystifier les classes opprimées ; ce faisant, on vide leur doctrine révolutionnaire de son "contenu", on émousse son tranchant révolutionnaire, on l’avilit. (...) Et les savants bourgeois d’Allemagne, hier encore spécialisés dans la destruction du marxisme, parlent de plus en plus souvent d’un Marx "national-allemand". » Et les staliniens parlent d’un Lénine « national-Grand-russe »... pourrions-nous ajouter.
[5] [3660] Boris Souvarine,Staline, Editions Gérard Lebovici 1985.
[6] [3661] Boris Souvarine, Idem, p. 311.
[7] [3662] Idem, p. 312.
[8] [3663] Thèse 8 sur la bolchevisation, 5e congrès de l’IC, traduite par nous d’une version espagnole.
[9] [3664] Bilan n° 39, Bulletin théorique de la fraction italienne de la Gauche Communiste, janvier 1937.
[10] [3665] Voir «Thèses sur le parasitisme politique», Revue internationale n° 94.
[11] [3666] Rosa Luxemburg, La révolution russe, Petite collection Maspéro, chap.1 et 2, p.57, 64 et 65.
[12] [3667] Bilan n° 39, 1937.
[13] [3668] Herman Gorter, «La victoire du marxisme», publié en 1920 dans Il Soviet, repris dans Invariance n° 7, 1969.
[14] [3669] Article de Pannekoek dans Die Aktion n° 11-12, 19 mars 1921, cité par notre brochure sur La Gauche Hollandaise, p. 137.
[15] [3670] Dans le résumé des positions du CCI au dos de chacune de nos publications.
[16] [3671] Voir le 12e congrès du CCI, «Le renforcement politique du CCI», Revue internationale n°°90.
[17] [3672] «Rapport sur la structure et le fonctionnement de l’organisation des révolutionnaires», Conférence Internationale du CCI, janvier 1982, Revue internationale n° 33.
[18] [3673] «Rapport sur la question de l’organisation de notre courant international», Revue internationale n° 1, avril 1975.
[19] [3674] Nous ne pouvons résister à la tentation de citer un de nos anciens militants qui nous accuse aujourd’hui d’être devenus léninistes : «On doit par contre saluer la lucidité de Rosa Luxemburg (...) tout comme la capacité des bolcheviks à s’organiser en fraction indépendante avec ses propres moyens d’intervention au sein du Parti ouvrier social-démocrate de Russie. C’est pour cela qu’ils purent être l’avant-garde du prolétariat dans la vague révolutionnaire de la fin de la première guerre mondiale.» (RV, «La continuité des organisations politiques du prolétariat», Revue internationale n° 50, 1987.)
[20] [3675] Intervention de Bordiga au 6e comité exécutif élargi de l’Internationale communiste en 1926.
[21] [3676] Introduction à notre article sur «Le rapport Fraction parti dans la tradition marxiste», 3e partie, Revue Internationale n° 65.
[22] [3677] «Rapport sur la question de l’organisation de notre courant», Revue Internationale n° 1, avril 1975.
[23] [3678] PV du 2e congrès du POSDR, traduit de l’espagnol par nous, edition Era, 1977.
[24] [3679] Lénine, «Prologue à la recompilation Sur douze ans», septembre 1907, traduit de l’espagnol par nous, édition Era, 1977.
[25] [3680] Mouvement terroriste russe des années 1870 à l’organisation secrète.
[26] [3681] Que faire ?, c’est Lénine qui souligne, Chap. «L’organisation conspirative et le démocratisme».
[27] [3682] Un pas en avant, deux pas en arrière, réponse à Rosa Luxemburg, publié dans Nos tâches politiques de Trotsky, Pierre Belfond, 1970.
[28] [3683] Que faire ?, Chap. «La spontanéité des masses et l’esprit..., a)début de l’essor spontané».
[29] [3684] Voir notre brochure Organisations communistes et conscience de classe.
[30] [3685] Lénine, Réponse à Rosa Luxemburg, déjà citée.
[31] [3686] Rosa Luxemburg, Question d’organisation..., chap.1.
Conscience et organisation:
Courants politiques:
- Gauche Communiste [49]
Heritage de la Gauche Communiste:
Revue Internationale no 97 - 2e trimestre 1999
- 3295 reads
Editorial : La guerre en Europe : le capitalisme montre son vrai visage
- 2823 reads
La guerre qui vient d'éclater dans l'ex-Yougoslavie ? avec les bombardements de la Serbie par les armées de l'OTAN, constitue l'événement le plus grave sur la scène impérialiste mondiale depuis l'effondrement du bloc de l'Est en 1989. Même si, pour le moment, l'ampleur des moyens employés reste bien moindre que lors de la Guerre du Golfe en 1991, la signification du conflit actuel est d'une tout autre dimension. Aujourd'hui, c'est au coeur de l'Europe, à une heure ou deux des principales capitales de ce continent que se déchaîne la barbarie guerrière. C'était déjà le cas tout au long des multiples affrontements qui, depuis 1991, ont ravagé l'ex-Yougoslavie et qui avaient fait déjà des centaines de milliers de victimes. Mais cette fois-ci, ce sont les principales puissances du capitalisme, à commencer par la première puissance mondiale, qui sont les protagonistes de cette guerre.
Si le fait que cette guerre se déroule en Europe a une telle importance, c'est parce ce continent, en tant que berceau du capitalisme et première région industrielle du monde, a été le principal enjeu ainsi que l'épicentre de tous les conflits impérialistes majeurs du 20e siècle, à commencer par les deux guerres mondiales. La guerre froide elle-même qui, pendant 40 ans, a opposé le bloc russe et le bloc américain, avait comme principal enjeu l'Europe, même si les épisodes de guerre ouverte ont eu pour théâtre des pays de la périphérie ou d'anciennes colonies (guerres de Corée, du Vietnam, du Moyen-Orient, etc.). En outre, le conflit actuel se déroule dans une zone particulièrement sensible du continent, les Balkans, dont la position géographique (bien plus que l'économie), en a fait, dès avant la première guerre mondiale, un des lieux les plus disputés de la planète. N'oublions pas que la première boucherie impérialiste a commencé à Sarajevo.
Enfin, il est un autre élément qui contribue à donner au conflit actuel toute sa dimension : c'est la participation directe, active, de l'Allemagne dans les affrontements, et pas en tant que comparse mais dans une position importante. C'est une première historique depuis plus d'un demi-siècle puisque ce pays, du fait de son statut de vaincu de la seconde guerre mondiale, avait été contraint depuis lors de se dispenser de toute intervention militaire. Le fait que la bourgeoisie allemande reprenne aujourd'hui sa place sur les champs de bataille est significatif de l'aggravation générale des tensions guerrières que le capitalisme décadent, et confronté à une crise économique insoluble, ne peut qu'engendrer toujours plus.
Les politiciens et les médias des pays de l'OTAN nous présentent la guerre actuelle comme une action de “défense des droits de l'homme” contre un régime particulièrement odieux, responsable, entre autres méfaits, de la “purification ethnique” qui a ensanglanté l'ex-Yougoslavie depuis 1991. En réalité, les puissances “démocratiques” n'ont rien à faire du sort de la population du Kosovo, tout comme elles se moquaient royalement du sort des populations kurdes et shiites en Irak qu'elles ont laissé massacrer par les troupes de Saddam Hussein après la guerre du Golfe. Les souffrances des populations civiles persécutées par tel ou tel dictateur ont toujours été le prétexte permettant aux grandes “démocraties” de déchaîner la guerre au nom d'une “juste cause”. Ce fut le cas, notamment, lors de la seconde guerre mondiale où l'extermination des juifs par le régime hitlérien (extermination contre laquelle les Alliés ne firent rien, même quand ils en avaient la possibilité) servit après coup à justifier tous les crimes commis par les “démocraties” ; entre autres, les 250 000 morts de Dresde sous les bombes alliées dans la seule nuit du 13-14 février 1945 ou les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, les 6 et 9 août 1945.
Si les médias nous inondent, depuis plusieurs semaines, d'images montrant la tragédie des centaines de milliers de réfugiés albanais du Kosovo victimes de la barbarie de Milosevic, c'est pour justifier la campagne guerrière des pays de l'OTAN qui, lorsqu'elle a débuté, rencontrait un fort scepticisme sinon une hostilité dans les populations de ces pays. C'est aussi dans le but de faire adhérer celles-ci à la dernière phase de l'opération “Force déterminée”, si les bombardements ne font pas plier Milosevic : celle de l'offensive terrestre qui risque de provoquer de nombreux morts non seulement du côté serbe, mais aussi du côté des alliés.
En réalité, la “catastrophe humanitaire” des réfugiés du Kosovo était prévue et voulue par les “démocraties” afin de justifier leurs plans de guerre ; tout comme le massacre des Kurdes et des Shiites d'Irak était voulu puisque les alliés avaient appelé ces populations à se soulever contre Saddam Hussein au cours de la guerre.
Le véritable responsable de la guerre actuelle n'est pas à chercher à Belgrade, ou même à Washington. C'est le capitalisme comme un tout qui est responsable de la guerre ; et la barbarie guerrière, avec son cortège de massacres, de génocides, d'atrocités, ne connaîtra de terme qu'avec le renversement de ce système par la classe ouvrière mondiale. Sinon, le capitalisme agonisant risque d'entraîner dans sa mort l'ensemble de la société.
Face à la guerre impérialiste et à toutes ses atrocités, les communistes ont un devoir de solidarité. Mais cette solidarité ne va pas à telle ou telle nation ou ethnie, dans lesquelles on retrouve pêle-mêle, exploités et exploiteurs, victimes et bourreaux, que ces derniers aient le visage de Milosevic ou de la clique nationaliste de l'UCK qui déjà enrôle de force les hommes valides dans les colonnes de réfugiés. La solidarité des communistes est une solidarité de classe qui va aux ouvriers et aux exploités serbes et albanais, aux ouvriers en uniforme de tous les pays qui se font tuer ou qu'on transforme en assassins au nom de la “Patrie” ou de la “Démocratie”. Cette solidarité de classe, c'est en premier lieu aux bataillons les plus importants du prolétariat mondial de la manifester, les ouvriers d'Europe et d'Amérique du Nord, non pas en marchant derrière les banderoles du pacifisme mais en développant leurs luttes contre le capitalisme, contre ceux qui les exploitent dans leur pays.
Les communistes ont le devoir de dénoncer avec autant d'énergie les pacifistes que ceux qui prêchent la guerre. Le pacifisme est un des pires ennemis du prolétariat. Il cultive l'illusion que la “bonne volonté” ou les “négociations internationales” peuvent venir à bout des guerres. Ce faisant, ils entretiennent le mensonge qu'il pourrait exister un “bon capitalisme” respectueux de la paix et des “droits de l'homme” détournant ainsi les prolétaires de la lutte de classe contre le capitalisme comme un tout. Pire encore, ils sont les rabatteurs des “jusqu'au-boutistes”, des chantres des croisades guerrières : “Puisque les guerres sont provoquées par de "mauvais capitalistes", "nationalistes" et "sanguinaires", nous n'aurons la paix qu'en liquidant ces "mauvais capitalistes", au besoin… en leur faisant la guerre”. C'est exactement ce qu'on a vu en Allemagne où le principal leader des mouvements pacifistes des années 1980, Joschka Fischer, est aujourd'hui celui qui assume la principale responsabilité dans la politique impérialiste de son pays. Et il s'en félicite en déclarant que “pour la première fois depuis longtemps, l'Allemagne fait la guerre pour une bonne cause.”.
Dès les premiers jours de la guerre, les internationalistes ont fait entendre, avec leurs moyens encore modestes, leur voix contre la barbarie impérialiste. Le 25 mars, le CCI a publié un tract qu'il distribue à l'heure actuelle aux ouvriers dans 13 pays et dont nos lecteurs pourront prendre connaissance dans nos publications territoriales. Mais notre organisation n'a pas été la seule à réagir pour défendre la position internationaliste. C'est l'ensemble des groupes se réclamant de la Gauche communiste qui a réagi au même moment et en mettant en avant les mêmes principes fondamentaux ([1] [3687]). Dans le prochain numéro de notre Revue internationale nous reviendrons plus en détail sur les positions et analyses développées par ces différents groupes. Mais, dès à présent, il nous faut souligner tout ce qui nous rapproche (la défense des positions internationalistes, telles qu'elles s'étaient exprimées aux conférences de Zimmerwald et Kienthal au cours de la première guerre mondiale ainsi que dans les premiers congrès de l'Internationale communiste) et tout ce qui nous oppose à l'ensemble des organisations (staliniennes, trotskistes, etc.) qui, tout en se réclamant de la classe ouvrière, distillent en son sein le poison du nationalisme ou du pacifisme.
Evidemment, le rôle des communistes ne se limite pas à défendre les principes, aussi importante et fondamentale que soit cette tâche. Il consiste également à fournir une analyse permettant à la classe ouvrière de comprendre les enjeux, les tenants et aboutissants, des principaux aspects de la situation internationale. L'analyse de la guerre en Yougoslavie, qui venait juste de débuter, a constitué un des axes des travaux du 13e congrès du CCI qui s'est tenu début avril. Dans le prochain numéro de la Revue internationale nous reviendrons sur ce congrès, mais nous publions ici, dès à présent, la résolution sur la situation internationale qu'il a adoptée et dont une partie importante est consacrée à la guerre actuelle.
10 avril 1999
[1] [3688] Il s'agit des organisations suivantes : Bureau International pour le Parti Révolutionnaire, Partito Comunista Internazionale - Il Programma Comunista, Partito Comunista Internazionale - Il Comunista, Partito Comunista Internazionale - Il Partito Comunista
Géographique:
- Europe [95]
Questions théoriques:
- Impérialisme [321]
13° congrès du C.C.I. : résolution sur la situation internationale
- 2818 reads
Le 20e siècle a vu l’entrée du système capitaliste dans sa phase de décadence marquée par la Première Guerre mondiale et par la première tourmente révolutionnaire internationale du prolétariat qui a mis fin à cette guerre et qui a engagé le combat pour une société communiste. A cette époque déjà, le marxisme révolutionnaire avait annoncé l’alternative pour l’humanité - socialisme ou barbarie - et avait prédit qu’en cas d’échec de la révolution, la Première Guerre mondiale serait suivie par une seconde et par la plus importante et dangereuse régression de la culture humaine dans l’histoire de l’humanité. Avec l’isolement et l’étranglement de la révolution d’Octobre en Russie - conséquence de la défaite de la révolution mondiale - la plus profonde contre-révolution de l’histoire, avec à sa tête le stalinisme, a triomphé pour un demi-siècle. En 1968, une nouvelle génération invaincue de prolétaires a mis fin à cette contre-révolution et a barré la route du processus inhérent de la descente du capitalisme vers une troisième guerre mondiale avec la probable destruction de l’humanité. Vingt ans plus tard, le stalinisme s’effondrait - non cependant sous les coups du prolétariat mais de par l’entrée du capitalisme décadent dans sa phase finale de décomposition.
Dix ans après, le siècle se termine comme il a commencé, c’est-à-dire dans les convulsions économiques, les conflits impérialistes et le développement des luttes de classe. En particulier l’année 1999 est, dès à présent, marquée par l’aggavation considérable des conflits impérialistes que représente l'offensive militaire de l’Otan déclenchée à la fin mars contre la Serbie.
Aujourd’hui, le capitalisme agonisant fait face à une des périodes les plus difficiles et dangereuses de l’histoire moderne, comparable dans sa gravité à celle des deux guerres mondiales, au surgissement de la révolution prolétarienne en 1917-1919 ou encore à la grande dépression qui débuta en 1929. Cependant, à l’heure actuelle, ni la guerre mondiale, ni la révolution mondiale ne sont en gestation dans un avenir prévisible. Plus exactement, la gravité de la situation est conditionnée par l’aiguisement des contradiction à tous les niveaux :
- celui des tensions impérialistes et du développement du désordre mondial ;
- une période très avancée et dangereuse de la crise du capitalisme ;
- des attaques sans précédent depuis la dernière guerre mondiale contre le prolétariat international ;
- une décomposition accélérée de la société bourgeoise.
Dans cette situation pleine de périls, la bourgeoisie a confié les rênes du gouvernement aux mains du courant politique le plus capable de prendre soin de ses intérêts : la Social-Démocratie, le principal courant responsable de l’écrasement de la révolution mondiale après 1917-1918. Le courant qui a sauvé le capitalisme à cette époque et qui revient aux postes de commande pour assurer la défense des intérêts menacés de la classe capitaliste.
La responsabilité qui pèse sur le prolétariat aujourd’hui est énorme. C’est uniquement en développant sa combativité et sa conscience qu’il pourra mettre en avant l’alternative révolutionnaire qui seule peut assurer la survie et l’ascension continue de la société humaine. Mais la responsabilité la plus importante repose sur les épaules de la Gauche communiste, sur les organisations présentes du camp prolétarien. Elles seules peuvent fournir les leçons théoriques et historiques ainsi que la méthode politique sans lesquelles les minorités révolutionnaires qui émergent aujourd’hui ne peuvent se rattacher à la construction du parti de classe du futur. En quelque sorte, la Gauche communiste se trouve aujourd’hui dans une situation similaire à celle de Bilan des années 1930, au sens où elle est contrainte de comprendre une situation historique nouvelle sans précédent. Une telle situation requiert à la fois un profond attachement à l’approche théorique et historique du Marxisme et de l’audace révolutionnaire pour comprendre les situations qui ne sont pas totalement intégrées dans les schémas du passé. Afin d’accomplir cette tâche, les débats ouverts entre les organisations actuelles du milieu prolétarien sont indispensables. En ce sens, la discussion, la clarification et le regroupement, la propagande et l’intervention des petites minorités révolutionnaires sont une partie essentielle de la réponse prolétarienne à la gravité de la situation mondiale au seuil du prochain millénaire.
Plus encore, face à l’intensification sans précédent de la barbarie guerrière du capitalisme, la classe ouvrière attend de son avant-garde communiste d’assumer pleinement ses responsabilités en défense de l’internationalisme prolétarien. Aujourd’hui les groupes de la Gauche communiste sont les seuls à défendre les positions classiques du mouvement ouvrier face à la guerre impérialiste. Seuls les groupes qui se rattachent à ce courant, le seul qui n’ait pas trahi au cours de la seconde guerre mondiale, peuvent apporter une réponse de classe aux interrogations qui ne manqueront pas de se faire jour au sein de la classe ouvrière.
C’est de façon la plus unie possible que les groupes révolutionnaires doivent apporter cette réponse exprimant en cela l’unité indispensable du prolétariat face au déchaînement du chauvinisme et des conflits entre nations. Ce faisant les révolutionnaires reprendront à leur compte la tradition du mouvement ouvrier représentée particulièrement par les conférences de Zimmerwald et de Kienthal et par la politique de la Gauche au sein de ces conférences.
Les conflits impérialistes
1) La nouvelle guerre qui vient d'éclater dans l'ex- Yougoslavie avec les bombardements de l'OTAN sur la Serbie, le Kosovo et le Monténégro, constitue l'événement le plus important sur la scène impérialiste depuis l'effondrement du bloc de l'Est à la fin des années 1980. Il en est ainsi parce que :
- cette guerre concerne non plus un pays de la périphérie, comme ce fut le cas de la guerre du Golfe en 1991, mais un pays européen ;
- c'est la première fois depuis la seconde guerre mondiale qu'un pays d'Europe - et notamment sa capitale - est bombardé massivement ;
- c'est aussi la première fois depuis cette date que le principal pays vaincu de cette guerre, l'Allemagne, intervient directement avec les armes dans un conflit militaire ;
- cette guerre constitue un pas de plus, et de grande amplitude, dans le processus de déstabilisation de l'Europe, avec un impact de premier ordre sur l’aggravation du chaos mondial.
Ainsi, après la dislocation de la Yougoslavie, à partir de 1991, c'est la principale composante de celle-ci, la Serbie qui est menacée de dislocation en même temps que se profile l'éventualité de la disparition de ce qui restait de l'ancienne fédération Yougoslave (Serbie et Monténégro). Plus largement, la guerre actuelle, notamment à travers la question de l'arrivée massive de réfugiés en Macédoine, est porteuse d'une déstabilisation de ce pays avec la menace d'une implication de la Bulgarie et de la Grèce, qui, avec leurs propres prétentions, se considèrent comme ses “ parrains ”. Avec l'implication possible de la Turquie, à partir du moment où la Grèce est concernée, la crise actuelle risque de provoquer un véritable embrasement de toute la région des Balkans et d’une bonne partie de la Méditerranée.
Par ailleurs, la guerre qui vient d'éclater risque de provoquer de très sérieuses difficultés au sein de toute une série de bourgeoisies européennes.
En premier lieu, l'intervention de l'OTAN contre un allié traditionnel de la Russie, constitue pour la bourgeoisie de ce pays une véritable provocation qui ne peut que la déstabiliser encore plus. D'une part, il est clair que la Russie ne dispose plus des moyens de peser sur la situation impérialiste mondiale dès lors que les grandes puissances, et particulièrement les Etats-Unis, y sont impliquées. En même temps, toute une série de secteurs au sein de la bourgeoisie russe se manifestent contre l'impuissance actuelle de la Russie, particulièrement les secteurs ex-staliniens et les ultra-nationalistes, ce qui va encore déstabiliser davantage le gouvernement de ce pays. Par ailleurs la paralysie de l'autorité de Moscou ne peut être qu'une incitation pour différentes républiques de la fédération de Russie à contester le gouvernement central.
En second lieu, si au sein de la bourgeoisie allemande il existe une réelle homogénéité en faveur de l'intervention, d'autres bourgeoisies comme la bourgeoisie française, peuvent être affectées par la contradiction entre leur alliance traditionnelle envers la Serbie et la participation à l'action de l'OTAN.
De même, certaines bourgeoisies comme la bourgeoisie italienne peuvent craindre les répercussions de la situation actuelle du point de vue de la menace d'un nouvel afflux de réfugiés de cette partie du monde.
2) Un des aspects qui souligne le plus l'extrême gravité de la guerre qui se développe aujourd'hui est justement le fait qu'elle se déroule au cœur même des Balkans qui, depuis le début du siècle, ont été considérés comme la poudrière de l'Europe.
Dès avant la première guerre mondiale, il y avait déjà eu deux “ guerres balkaniques ” qui constituaient certaines des prémisses de la boucherie impérialiste, et surtout celle-ci avait comme point de départ la question des Balkans avec la volonté de l'Autriche de mette au pas la Serbie et la réaction de la Russie en faveur de son allié serbe. La formation du premier Etat yougoslave après la première guerre mondiale constituait une des expressions de la défaite de l'Allemagne et de l'Autriche. En ce sens, elle constituait déjà, au même titre que l'ensemble de la paix de Versailles, un des points de friction majeurs ouvrant la porte à la seconde guerre mondiale. Alors que, au cours de la seconde guerre mondiale, les différentes composantes de la Yougoslavie s'étaient rangées derrière leurs alliés traditionnels (Croatie du côté de l'Allemagne, Serbie du côté des alliés), la reconstitution de la Yougoslavie au lendemain du deuxième conflit mondial sur des frontières très proches du premier Etat yougoslave, constituait à nouveau la concrétisation de la défaite du bloc allemand et du barrage que les alliés entendaient maintenir face aux visées impérialistes allemandes en direction du Moyen-Orient.
En ce sens, l'attitude très offensive de l'Allemagne en direction des Balkans immédiatement après l'effondrement du bloc de l'Est, lorsque la solidarité face à la Russie n'avait plus de raison d'être (attitude qui a stimulé l'éclatement de l'ex- Yougoslavie avec la constitution des deux Etats indépendants de Slovénie et de Croatie), mettait en évidence que cette région redevenait un des foyers des affrontements entre les puissances impérialistes en Europe.
Aujourd'hui, un facteur supplémentaire de la gravité de la situation est constitué par le fait que, contrairement à la première guerre mondiale ou même la seconde, les Etats-Unis affirment une présence militaire dans cette région du monde. La première puissance mondiale ne pouvait pas rester absente d'un des théâtres principaux des affrontements impérialistes en Europe et en Méditerranée signifiant ainsi sa détermination à être présente dans toutes les zones cruciales où s'affrontent les différents intérêts impérialistes.
3) Même si les Balkans constituent un des épicentres des tensions impérialistes, la forme actuelle de la guerre (l'ensemble des pays de l'OTAN contre la Serbie) ne recouvre pas les véritables antagonismes d'intérêts qui existent entre les différents belligérants. Avant que de mettre en avant les véritables buts des participants à la guerre, il importe de rejeter tant les justifications que les fausses explications qui sont données du conflit :
La justification officielle des pays de l'OTAN, c'est-à-dire une opération humanitaire en faveur des populations albanaises du Kosovo, est radicalement démentie par le simple fait que jamais cette population n'avait subi une répression aussi brutale de la part des forces armées serbes que depuis le début des bombardements de l’OTAN; et cela était déjà prévu par la bourgeoisie américaine et l'ensemble de celles de l'OTAN bien avant l'opération (comme d'ailleurs certains secteurs de la bourgeoisie américaine le rappellent aujourd'hui). L'opération de l'OTAN n'est pas la première intervention militaire qui se pare des habits de “ l'action humanitaire ”, mais c'est une de celles où le mensonge éclate de la façon la plus évidente.
Par ailleurs, il faut également écarter toute idée que l'action actuelle de l'OTAN représenterait une reconstitution du camp occidental contre la puissance de la Russie. Ce n'est pas parce que la bourgeoisie russe est gravement affectée par la guerre actuelle que les pays de l'OTAN visaient ce but en y participant. Ces pays, et notamment les Etats-Unis, n'ont aucun intérêt à aggraver le chaos qui existe déjà en Russie.
Enfin, les explications (qu'on retrouve même parmi des groupes révolutionnaires) qui essaient d'interpréter l'offensive actuelle de l'OTAN comme une tentative de contrôler les matières premières dans la région constituent une sous-estimation, voire un aveuglement, face à la véritable ampleur des enjeux. En se voulant “ matérialiste ”, en donnant une explication de la guerre basée uniquement sur la recherche d'intérêts économiques immédiats, elles s’écartent d’une véritable compréhension marxiste de la situation présente.
Cette situation est en premier lieu déterminée par la nécessité pour la première puissance mondiale d'affirmer et de réaffirmer en permanence sa suprématie militaire alors que depuis l'effondrement du bloc de l'Est son autorité sur ses anciens alliés s'est évanouie.
En deuxième lieu, la présence active de l'Allemagne pour la première fois depuis un demi siècle dans ce conflit exprime un nouveau pas accompli par cette puissance en vue d'affirmer son statut de candidat à la direction d'un futur bloc impérialiste. Ce statut suppose d'être reconnu comme une puissance militaire de premier plan capable de jouer un rôle direct sur le terrain militaire, et la couverture que lui offre aujourd'hui l'OTAN lui permet de contourner l'interdiction implicite, qui lui avait été faite depuis sa défaite dans la seconde guerre mondiale, d'intervenir militairement dans les conflits impérialistes.
En outre, dans la mesure où l'opération actuelle s'attaque à la Serbie, “ ennemi traditionnel ” de l'Allemagne dans ses visées en direction du Moyen-Orient, cette opération va dans le sens des intérêts de l'impérialisme allemand, surtout si elle aboutit au démembrement de la fédération yougoslave et de la Serbie elle-même avec la perte du Kosovo.
Pour les autres puissances qui sont impliquées dans la guerre, notamment pour la Grande-Bretagne et la France, il existe une contradiction entre leur alliance traditionnelle avec la Serbie, qui s'était manifestée de façon très claire pendant la période où l'ex-Forpronu était dirigée par ces puissances, et l'opération actuelle. Pour ces deux pays, ne pas participer à l'opération “ Force déterminée ” signifiait être exclus du jeu dans une région aussi importante que celle des Balkans ; le rôle qu'ils pouvaient jouer dans une résolution diplomatique de la crise yougoslave était conditionné par l'importance de leur participation aux opérations militaires.
4) En ce sens, la participation de pays comme la France ou la Grande-Bretagne à l'opération actuelle de “ Force déterminée ” contient des similitudes très importantes avec la participation militaire directe (cas de la France) ou financière (Allemagne, Japon) à l'opération “ Tempête du désert ” en 1991. Cependant, il existe, au delà de ces similitudes, des différences très importantes entre la guerre actuelle et celle de 1991.
Une des caractéristiques majeures de la guerre du Golfe de 1991 était la planification par la bourgeoisie américaine de l'ensemble du déroulement de l'opération depuis le piège tendu à Saddam Hussein durant l'été 1990 jusqu'à la fin des hostilités concrétisée par le retrait des troupes irakiennes du Koweït. Cela exprimait le fait que, tout de suite après l'effondrement du bloc de l'Est conduisant à la disparition du bloc occidental, les Etats-Unis conservaient encore un leadership très fort sur la situation mondiale, ce qui leur avait permis de réaliser un sans-faute dans la conduite des opérations aussi bien militaires que diplomatiques et ce, même si la guerre du Golfe avait pour vocation de faire taire les velléités de contestation de l'hégémonie américaine qui s'étaient déjà manifestées, particulièrement de la part de la France et de l'Allemagne. A cette époque, les anciens alliés des Etats-Unis n'avaient pu encore avoir l'occasion de développer leurs propres visées impérialistes en contradiction avec celles des Etats-Unis.
La guerre qui se déroule aujourd'hui ne correspond pas à un tel scénario écrit de la première à la dernière ligne par la puissance américaine. Entre 1991 et aujourd'hui, la contestation de l'autorité des Etats-Unis s'est manifestée à de nombreuses reprises; y compris de la part de pays de second plan tel qu'Israël, mais aussi de la part des alliés les plus fidèles de la guerre froide comme la Grande-Bretagne. Justement, c'est en Yougoslavie que s'était manifesté cet événement historique inédit qui était le divorce entre les deux meilleurs alliés du 20ème siècle, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis; lorsque la Grande-Bretagne, à côté de la France, avait joué son propre jeu. Les difficultés des Etats-Unis à affirmer leurs propres intérêts impérialistes en Yougoslavie avaient d’ailleurs constitué une des causes du remplacement de Bush par Clinton.
En outre, la victoire finalement obtenue par les Etats-Unis, à travers les accords de Dayton de 1996, ne constituait pas une victoire définitive dans cette partie du monde ni un arrêt de la tendance générale de la perte de son leadership comme première puissance mondiale.
Aujourd'hui, même si les Etats-Unis sont à la tête de la croisade anti-Milosevic, ils doivent compter beaucoup plus qu'auparavant avec les jeux spécifiques des autres puissances – notamment l'Allemagne - ce qui introduit un facteur considérable d'incertitude sur l'issue de l'ensemble de l'opération.
En particulier, il n'existait pas, sur cette question, un seul scénario écrit d'avance de la part de la bourgeoisie américaine mais plusieurs. Le premier scénario qui avait les faveurs de la bourgeoisie américaine, c'était une reculade de Milosevic face au chantage de frappes militaires comme cela avait été le cas avant les accords de Dayton.
C'est ce scénario que les Etats-Unis avec l'envoi de Holbrooke ont essayé de dérouler jusqu'au bout à la suite même de l'échec de la conférence de Paris.
En ce sens, si l'intervention militaire massive des Etats-Unis en 1991 était la seule option envisagée par ce pays dans la crise du Golfe (et il a fait en sorte qu'il en n'y en ait pas d'autre, en empêchant toute solution diplomatique) l'option militaire, tel qu'elle se déroule aujourd'hui, résulte de l'échec de l'option diplomatique (avec le chantage militaire) représenté par les conférences de Rambouillet et de Paris.
La guerre actuelle avec la nouvelle déstabilisation qu'elle représente dans la situation européenne et mondiale, constitue une nouvelle illustration du dilemme dans lequel se trouvent aujourd'hui enfermés les Etats-Unis. La tendance au “ chacun pour soi ” et l'affirmation de plus en plus explicite des prétentions impérialistes de leurs anciens alliés les obligent de façon croissante à faire étalage et usage de leur énorme supériorité militaire. En même temps, cette politique ne peut aboutir qu'à une aggravation encore plus grande du chaos qui règne déjà dans la situation mondiale.
Un des aspects de ce dilemme se manifeste dans le cas présent, comme cela avait d'ailleurs été le cas avant Dayton lorsque les Etats-Unis avaient favorisé les ambitions croates dans la Krajina, par le fait que leur intervention militaire fait, d'une certaine façon, le jeu de leur principal rival potentiel, l'Allemagne. Cependant, l'échelle de temps dans lequel s'expriment les intérêts impérialistes respectifs de l'Allemagne et les Etats-Unis est très différente. C'est à long terme que l'Allemagne est obligée d'envisager son accession au rang de superpuissance alors que c'est dès maintenant, et déjà depuis plusieurs années, que les Etats-Unis sont confrontés à la perte de leur leadership et à la montée du chaos mondial.
5) Un trait essentiel du désordre mondial actuel est donc l’absence de blocs impérialistes. En effet, dans la lutte pour la survie de tous contre tous dans le capitalisme décadent, la seule forme qu’un ordre mondial plus ou moins stable peut assumer est une organisation bipolaire en deux camps guerriers rivaux. Cela ne signifie cependant pas que l’absence actuelle de blocs impérialistes est la cause du chaos contemporain puisque le capitalisme décadent a déjà connu une période où il n’y avait pas de bloc impérialiste - celle des années 20 - sans que cela implique un chaos particulier de la situation mondiale.
En ce sens, la disparition des blocs en 1989, et la dislocation de l’ordre mondial qui s’en est suivie, sont des signes que nous avons désormais atteint une étape beaucoup plus avancée dans la décadence du capitalisme qu’en 1914 ou 1939. C’est l’étape de décomposition, la phase finale de la décadence du capitalisme.
En dernière analyse, cette phase est le produit du poids permanent de la crise historique, l’accumulation de toutes les contradictions d’un mode de production en déclin s’étalant sur un siècle entier. Mais la période de décomposition a été inaugurée par un facteur spécifique : le blocage du chemin vers une guerre mondiale sur deux décennies grâce à une génération invaincue du prolétariat. En particulier, le Bloc de l’Est, plus faible, s’est finalement effondré sous le poids de la crise économique parce qu’en dernière analyse il a été incapable de s’acquitter de sa raison d’être : la marche vers la guerre généralisée.
Ceci confirme une thèse fondamentale du Marxisme à propos du capitalisme du 20e siècle selon laquelle la guerre est devenue son mode d’existence dans sa période de déclin. Cela ne veut pas dire que la guerre est une solution à la crise du capitalisme - tout au contraire. Ce que cela veut dire c’est que la marche vers la guerre mondiale - et donc en fin de compte la destruction de l’humanité - est devenu le moyen à travers lequel l’ordre impérialiste est maintenu. C’est le mouvement vers la guerre globale qui oblige les Etats impérialistes à se regrouper et à accepter la discipline des leaders de blocs. C’est le même facteur qui permet à l’Etat-nation de maintenir un minimum d’unité au sein de la bourgeoisie elle-même ; ce qui a permis jusqu'à présent au système de limiter l’atomisation totale de la société bourgeoise agonisante en lui imposant la discipline de caserne ; ce même facteur a contrecarré le vide idéologique d’une société sans avenir en créant une communauté du champ de bataille.
Sans la perspective d’une guerre mondiale, la voie est libre pour le plus complet développement de la décomposition capitaliste : un développement, qui même sans guerre mondiale, a le potentiel de détruire l’humanité.
La perspective aujourd’hui est à une multiplication et à une omniprésence de guerres locales et d’interventions des grandes puissances, que les Etats bourgeois sont en mesure de développer jusqu'à un certain point sans l’adhésion du prolétariat.
6) Rien ne nous permet d’exclure la possibilité de formation de nouveaux blocs dans l’avenir. L’organisation bi-polaire de la compétition impérialiste qui est une tendance “ naturelle ” du capitalisme en déclin, est déjà apparue en germe, au tout début de la nouvelle phase de la décadence capitaliste, en 1989-90, avec l’unification de l’Allemagne et continue à s’affirmer via la montée en puissance de ce pays.
Bien que restant un facteur important de la situation internationale, la tendance à la formation de blocs ne peut cependant être réalisée dans un futur prévisible : les contre-tendances travaillant contre elle sont plus fortes que jamais auparavant de par l’instabilité croissante à la fois des alliances et de la situation interne de la plupart des puissances capitalistes. Pour le moment, la tendance aux blocs a principalement pour effet de renforcer elle-même le “ chacun-pour-soi ” dominant.
En fait, le processus de formation de nouveaux blocs n’est pas fortuit mais suit un certain scénario et requiert certaines conditions de développement, comme les blocs des deux guerres mondiales et de la guerre froide l’ont clairement montré. Dans chacun de ces cas, les blocs impérialistes ont regroupé d’une part un nombre de pays “ démunis ” contestant la division existante du monde et ainsi assumant le rôle “ offensif ” de “ fauteurs de troubles ” et, d’autre part, un bloc de puissances “ nanties ” en tant que bénéficiaires principaux du statu-quo, et partant, principaux défenseurs de celui-ci. Pour parvenir à se constituer, le bloc challenger des insatisfaits a besoin d'un leader qui soit assez fort militairement pour défier les principales puissances du statu-quo, un leader derrière lequel les autres nations “ démunies ” peuvent se rallier.
Actuellement, il n’existe aucune puissance capable, même un tant soit peu, de défier militairement les Etats-Unis. L’Allemagne et le Japon, les rivaux les plus solides de Washington, ne disposent toujours pas de l'arme atomique, un attribut essentiel d’une grande puissance moderne. Quant à l’Allemagne, le leader “ désigné ” d’un éventuel futur bloc contre les Etats-Unis à cause de sa position centrale en Europe, elle ne fait pas partie à l'heure actuelle des Etats “ démunis ”. En 1933, l’Allemagne était quasiment une caricature d’un tel Etat : elle était coupée de ses zones d’influence stratégiques proches en Europe centrale et du sud-est suite au Traité de Versailles, financièrement en banqueroute et déconnectée du marché mondial par la grande dépression et l’autarcie économique des empires coloniaux de ses rivaux. Aujourd’hui, au contraire, la montée en puissance de l’influence allemande dans ses zones d’influence d’antan se révèle irrésistible ; c’est le cœur économique et financier de l’économie européenne. C’est pourquoi l’Allemagne, à l’opposé de son attitude avant les deux guerres, appartient aujourd’hui aux puissances les plus “ patientes ”, capable de développer sa puissance d’une manière déterminée et agressive, mais aussi méthodiquement et, jusqu’ici, souvent discrètement.
En réalité, la façon dont l’ordre mondial de Yalta a disparu - une implosion sous la pression de la crise économique et de la décomposition, et non à travers une redivision du monde via la guerre - a donné naissance à une situation dans laquelle il n’y a plus de zones d’influence des différentes puissances clairement définies et reconnues. Même les zones qui, il y a dix ans, apparaissaient comme l’arrière-cour de certaines puissances (l'Amérique Latine ou le Moyen-Orient pour les Etats-Unis, la zone francophone d’Afrique pour la France) sont englouties dans le “ chacun-pour-soi ” ambiant. Dans une telle situation, il est encore très difficile de voir quelles puissances appartiendront finalement au groupe des pays “ nantis ” et lesquelles finiront les mains vides.
7) En réalité, ce n’est pas tant l’Allemagne ou n’importe quel autre challenger de la seule superpuissance mondiale restante mais les Etats-Unis eux-mêmes qui, dans les années 1990, ont assumé le rôle de la puissance “ agressive ” militairement à l’offensive. En retour, cela est la plus claire expression d’une nouvelle étape dans le développement de l’irrationalité de la guerre dans le capitalisme décadent, directement liée à la phase de décomposition
L’irrationalité de la guerre est le résultat du fait que les conflits militaires modernes - contrairement à ceux de l’ascendance capitaliste (guerres de libération nationale ou de conquête coloniale qui aidaient à l’expansion géographique et économique du capitalisme) - visent uniquement au repartage des positions économiques et stratégiques déjà existantes. Dans ces circonstances, les guerres de la décadence, via les dévastations qu’elles causent et leur coût gigantesque, ne représentent pas un stimulant mais un poids mort pour le mode de production capitaliste. A travers leur caractère permanent, totalitaire et destructif, elles menacent l’existence même des Etats modernes. En conséquence, bien que la cause des guerres capitalistes reste la même - la rivalité entre les Etats-nations - leur but change. Plutôt que des guerres à la poursuite de profits économiques certains, elles deviennent de façon croissante des guerres à la poursuite d’avantage stratégiques destinés à assurer la survie de la nation en cas de conflagration globale. Tandis que dans l’ascendance capitaliste le militaire était au service des intérêts de l’économie, dans la décadence, c’est de plus en plus l’économie qui est au service des besoins du militaire. L’économie capitaliste devient l’économie de guerre. Comme les autres expressions majeures de la décomposition, l’irrationalité de la guerre est de ce fait une tendance générale qui se déploie tout au long du capitalisme décadent. Déjà en 1915, la brochure de Junius de Rosa Luxembourg reconnaissait la primauté des considérations stratégiques globales sur les intérêts économiques immédiats pour les principaux protagonistes de la Première Guerre mondiale. A la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Gauche Communiste de France pouvait déjà formuler la thèse de l’irrationalité de la guerre.
Mais durant ces guerres et la Guerre froide qui a suivi, un reste de rationalité économique s’exprimait dans le fait que le rôle offensif était principalement assumé, non par les puissances du statu-quo tirant des avantages économiques de la division existante du monde, mais par celles largement exclues de ces avantages.
Aujourd’hui, même la guerre dans l’ex Yougoslavie, dont aucun des pays belligérants ne peut attendre le moindre avantage économique, confirme ce qui s’était déjà manifesté avec éclat lors de la guerre du Golfe en 1991 : l’absolue irrationalité de la guerre d’un point de vue économique.
8) Le fait que, aujourd’hui, la guerre ait perdu toute rationlité économique, qu’elle soit uniquement synonyme de chaos, ne signifie en aucune façon que la bourgeoisie affronte cette situation de façon désordonnée ou empirique. Au contraire : cette situation contraint la classe dominante à une prise en charge particulièrement systématique et à long terme des préparatifs guerriers. Cela s’est exprimé au cours de la dernière période notamment par :
- le développement de systèmes d’armements toujours plus sophistiqués et coûteux en Amérique, en Europe et au Japon en particulier - armements qui sont avant tout requis par les grandes puissances pour des conflits futurs éventuels les unes contre les autres ;
- l’augmentation des budgets de “ défense ”, Etats-Unis en tête (100 milliards de dollars supplémentaires alloués pour la modernisation des forces armées dans les 6 années à venir) - inversant une certaine tendance vers la baisse des budgets militaires à la fin de la Guerre Froide (les prétendus “ dividendes de la paix ”) .
Au niveau politique et idéologique, des signes de préparation sérieuse à la guerre sont perceptibles par :
- le développement de toute une idéologie pour justifier les interventions militaires : celle de “ l’humanitaire ” et de la défense des “ droits de l’homme ” ;
- la venue au gouvernement dans la plupart des grands pays industrialisés des partis de gauche, les plus à même de représenter cette propagande belliciste humanitaire (d’une importance particulière en Allemagne, où la coalition SPD-Verts a le mandat de surmonter les obstacles politiques à l'intervention militaire de ce pays à l’extérieur de ses frontières) ;
- l’orchestration d’attaques politiques systématiques contre les traditions internationalistes du prolétariat contre la guerre impérialiste (dénigrement de Lénine comme agent de l’impérialisme allemand durant la Première Guerre mondiale, de Bordiga comme collabo du bloc fasciste durant la Seconde Guerre mondiale, de Rosa Luxembourg - comme récemment en Allemagne - en tant que précurseur du Stalinisme etc.). Plus le capitalisme se dirige vers la guerre, plus l’héritage et les organisations actuelles de la Gauche Communiste vont être la cible privilégiée de la bourgeoisie.
En fait, ces campagnes idéologiques de la bourgeoisie ne visent pas seulement à préparer le terrain politique pour la guerre. L'objectif fondamental qui est visé par la classe dominante est de détourner le prolétariat de sa propre perspective révolutionnaire, une perspective que l'aggravation incessante de la crise capitaliste mettra nécessairement de plus en plus à l'ordre du jour.
La crise économique
8) Si, à l’époque du déclin capitaliste, la crise économique prend un caractère permanent et chronique, c’est principalement à la fin des périodes de reconstruction après les guerres mondiales que cette crise a revêtu un caractère ouvertement catastrophique avec des chutes brutales de la production, des profits et des conditions de vie des ouvriers, une augmentation dramatique du chômage de masse. Cela a été le cas de 1929 à la Seconde Guerre mondiale. C’est le cas aujourd’hui.
Bien que depuis la fin des années 1960, la crise se soit déployée d’une façon plus lente et moins spectaculaire qu’après 1929, la manière avec laquelle les contradictions économiques d’un mode de production en déclin se sont accumulées sur trois décennies, devient aujourd’hui de plus en plus difficile à cacher. Les années 1990 en particulier - malgré toute la propagande sur la “ bonne santé économique ” et les “ profits fantastiques ” du capitalisme - ont été des années d’une accélération énorme de la crise économique, dominées par des marchés chancelants, des entreprises en banqueroute et un développement sans précédent du chômage et de la paupérisation.
Au début de la décennie, la bourgeoisie a caché ce fait en présentant l’effondrement du bloc de l’Est comme la victoire finale du capitalisme sur le communisme. En réalité la faillite de l’Est a été un moment-clé dans l’approfondissement de la crise capitaliste mondiale. Elle a révélé la banqueroute d’un modèle bourgeois de gestion de la crise : le Stalinisme. Depuis lors, l'un après l’autre, les “ modèles économiques ” ont mordu la poussière, en commençant par la deuxième et la troisième puissances industrielles du monde, le Japon et l’Allemagne. Elles devaient être suivies par l’échec des Tigres et des Dragons d’Asie et des économies “ émergentes ” d’Amérique Latine. La banqueroute ouverte de la Russie a confirmé l’incapacité du “ libéralisme occidental ” à régénérer les pays d’Europe de l’Est.
Jusqu'à présent, la bourgeoisie, en dépit de décennies de crise chronique, a toujours été convaincue qu’il ne peut plus y avoir de convulsions économiques aussi profondes que celles de la “ Grande Dépression ” qui, après 1929, ont ébranlé les fondations mêmes du capitalisme. Bien que la propagande bourgeoise essaie encore de présenter la catastrophe économique qui a englouti l’Asie de l’Est et du Sud-Est en 1997, la Russie en 1998 et le Brésil au début de 1999, comme particulièrement sévère mais comme une récession conjoncturelle et temporaire, ce que ces pays ont subi en vérité est une dépression en tous points aussi brutale et dévastatrice que celle des années 1930. Le chômage qui a triplé, les chutes de 10% ou plus de la production en une année parlent d’eux-mêmes. De plus, des régions comme l’ancienne URSS ou l’Amérique Latine sont toutes deux incomparablement plus touchées par la crise que pendant les années 1930.
Il est vrai que les ravages à cette échelle sont encore principalement restreints à la périphérie du capitalisme. Mais cette “ périphérie ” inclut non seulement des producteurs agricoles et de matières premières mais aussi des pays industriels comprenant des dizaines de millions de prolétaires. Elle inclut la huitième et la dixième économie du monde : le Brésil et la Corée du Sud. Elle inclut le plus grand pays sur terre, la Russie. Elle va bientôt inclure le pays le plus peuplé, la Chine, où, après l’insolvabilité de la plus grande compagnie d’investissement, la Gitic, la confiance des investisseurs internationaux a commencé à s’effriter.
Ce que toutes ces banqueroutes démontrent c’est que l’état de santé de l’économie mondiale est bien pire que dans les années 1930. Contrairement à 1929, la bourgeoisie dans les trente dernières années n’a pas été surprise ou inactive face à la crise mais a réagi en permanence afin de contrôler son cours. C’est ce qui donne au déploiement de la crise sa nature très prolongée et impitoyablement profonde. La crise s’approfondit malgré tous les efforts de la classe dominante. La caractère soudain, brutal et incontrôlé de la crise de 1929, d’autre part, s’explique par le fait que la bourgeoisie avait démantelé le contrôle capitaliste d’Etat de l’économie (qu’elle avait été contrainte d’introduire pendant la Première Guerre mondiale), et elle n'a réintroduit et imposé ce régime qu’à partir du début des années 1930. En d’autres termes : la crise a frappé aussi brutalement parce que les instruments de l’économie de guerre des années 1930 et la coordination internationale des économies occidentales après 1945 n’avaient pas encore été développés. En 1929, il n’existait pas encore un état permanent de surveillance de l’économie, des marchés financiers et des accords commerciaux internationaux, pas de prêteur de dernier recours, pas de brigade internationale de pompiers pour renflouer les pays en difficulté. Entre 1997-99 au contraire, toutes ces économies d’une importance économique et politique considérable pour le monde capitaliste ont été anéanties malgré l’existence de tous ces instruments capitalistes d’Etat. Le Fonds Monétaire International, par exemple, avait soutenu le Brésil en injectant des fonds considérables déjà avant la crise récente, dans la continuité de sa nouvelle stratégie de prévention des crises. Il avait promis de défendre la monnaie brésilienne “ à tous prix ” - et il a échoué.
9) Bien que les pays centraux du capitalisme aient échappé à ce sort jusqu'à présent, ils sont en train de faire face à leur pire récession depuis la guerre - au Japon c’est déjà commencé.
Aujourd`hui la bourgeoisie veut rejeter la résponsabilité des difficultés accrues des économies des pays centraux sur les crises “ asiatiatique ”, “ russe ”, “ brésilienne ”, etc. mais c’est le contraire qui constitue la réalité : c'est l'impasse croissante des économies centrales, due à l'épuissement des marchés solvables, qui a provoqué l'effondrement successif des “ tigres ” et des “ dragons ”, de la Russie, du Brésil, etc. La récession au Japon révèle la réduction considérable de la marge de manoeuvre des pays centraux - une série de programmes conjoncturels “ Keynésiens ” massifs du gouvernement (la recette “ découverte ” par la bourgeoisie dans les années 1930) a échoué à remettre à flot l’économie et empêcher la récession :
- la dernière opération de sauvetage - 520 milliards de dollars pour renflouer des banques insolvables - n’a pas réussi à restaurer la confiance dans le système financier ;
- la politique traditionnelle agressive de maintien de l’emploi dans le pays, via des offensives d’exportation sur le marché mondial, a atteint ses limites : le chômage augmente rapidement, la politique des taux d’intérêts négatifs pour fournir des liquidités suffisantes et maintenir un Yen faible favorable aux exportations est à bout de souffle. Il est dorénavant clair que ces buts, de même qu’une réduction de la dette publique, ne peuvent être atteints que par un retour à une politique inflationniste à la manière des années 1970. Cette tendance, que d’autres pays industrialisés vont suivre, signifie le début de la fin de la fameuse “ victoire sur l’inflation ” et de nouveaux dangers pour le commerce mondial.
En Amérique, le prétendu “ boom ” de ces dernières années a été accompli aux dépens du reste du monde à travers une véritable explosion de sa balance commerciale, de ses déficits des paiements, et à travers un endettement faramineux des ménages (l’épargne aux Etats-Unis est maintenant virtuellement inexistante). Les limites d’une telle politique sont dorénavant en voie d’être atteintes, avec ou sans la “ grippe asiatique ”.
Quant à “ l’Euroland ”, le seul “ modèle ” capitaliste restant aux côtés de l’Amérique, la situation n'y est pas plus brillante : dans les principaux pays d'Europe occidentale la plus courte et faible reprise d’après guerre arrive à sa fin avec la chute des taux de croissance et l’augmentation du chômage, en particulier en Allemagne.
C’est la récession dans les pays centraux qui, au début du nouveau siècle, va révéler l’étendue complète de l’agonie du mode de production capitaliste.
10) Mais si historiquement l’impasse du capitalisme est beaucoup plus flagrante que dans les années 1930 et si la phase actuelle représente l'accélération la plus importante de la crise des trois décennies écoulées, cela ne signifie pas que l’on doit s’attendre à un effondrement abrupt et catastrophique dans les pays du cœur du capitalisme comme dans les années 1930. C’est ce qui s’est passé en Allemagne entre 1929-1932 quand (selon les statistiques de l’époque) la production industrielle avait chuté de 50%, les prix de 30%, les salaires de 60% et le chômage avait augmenté de 2 à 8 millions en l’espace de 3 ans.
Aujourd’hui, au contraire, bien que considérablement profonde et s’accélérant, la crise garde son caractère plus ou moins contrôlé et étalé dans le temps. La bourgeoisie démontre sa capacité à éviter une répétition du krach de 1929. Elle a réussit cela non seulement au moyen de la mise en place d’un régime capitaliste d’Etat permanent depuis les années 1930, mais surtout à travers une gestion de la crise coordonnée internationalement en faveur des puissances les plus fortes. Elle a appris à faire cela après 1945 dans le cadre du bloc de l’Ouest qui rassemblait l’Amérique du Nord, l’Europe de l’Ouest et l’Asie orientale sous le leadership américain. Après 1989, elle a montré sa capacité à maintenir cette gestion de la crise, même en l’absence de blocs impérialistes. Ainsi, tandis qu’au niveau impérialiste, 1989 a marqué le début de la loi du chaos et du “ chacun-pour-soi ”, au niveau économique cela n’est pas encore le cas.
Les deux conséquences les plus dramatiques de la crise de 1929 furent :
- l’effondrement du commerce mondial sous une avalanche de dévaluations compétitives et de mesures protectionnistes menant à l’autarcie des années d’avant-guerre ;
- le fait que les deux nations capitalistes les plus solides, les Etats-Unis et l’Allemagne, furent les premières et les plus touchées par la dépression industrielle et le chômage de masse.
Les programmes nationaux capitalistes d’Etat qui furent alors adoptés par les différents pays - les Plans quinquennaux en URSS, les Plans de quatre ans en Allemagne, le New Deal aux Etats-Unis etc. - ne changèrent en aucune façon la fragmentation du marché mondial : ils se conformèrent à ce cadre comme leur point de départ. A l’opposé de cela, face à la crise des années 1970 et 80, la bourgeoisie occidentale a agi rigoureusement pour empêcher un retour de ce protectionnisme extrême des années 1930, puisque cela était la précondition pour s’assurer que les pays centraux ne seraient pas les premières victimes comme en 1929, mais les derniers à souffrir des conséquences les plus brutales de la crise. Le résultat de ce système a été que toute une série de secteurs de l’économie mondiale tels que l’Afrique, la plus grande partie de l’Europe de l’Est, la plus grande partie de l’Asie et de l’Amérique Latine ont été, ou vont être, pratiquement éliminés en tant qu’acteurs sur la scène mondiale et plongés dans la barbarie la plus innommable.
Dans son combat contre Staline au milieu des années 1920, Trotsky a démontré que non seulement le socialisme mais même un capitalisme hautement développé est “ impossible ” dans “ un seul pays ”. En ce sens, l’autarcie des années 1930 fut un immense retour en arrière pour le système capitaliste. En fait, cela était possible uniquement parce que la voie vers la guerre mondiale était ouverte - ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
11) La gestion capitaliste d’Etat de la crise internationale actuelle impose certaines règles pour la guerre commerciale entre les capitaux nationaux - aux plans commercial, financir, monétaire ou des accords d’investissement et des traités - règles sans lesquelles le commerce mondial dans les conditions présentes serait impossible.
Que cette capacité des principales puissances (sous-estimée par le CCI au début des années 1990) n’ait pas encore atteint sa limite est attestée par le projet d’une monnaie européenne unique, montrant comment la bourgeoisie est contrainte, à cause de l’avancée de la crise, à prendre des mesures de plus en plus compliquée et audacieuses pour se protéger. L’Euro est d’abord et avant tout une gigantesque mesure capitaliste d’Etat pour contrecarrer un des points faibles du système les plus dangereux dans ses lignes de défense : le fait que parmi les deux centres du capitalisme mondial, l’Amérique du Nord et l’Europe occidentale, cette dernière est divisée en une série de capitaux nationaux, chacun avec leur propre monnaie. Des fluctuations monétaires dramatiques entre ces monnaies, telles que celles qui ont frappé le Système Monétaire Européen au début des années 1990, ou les dévaluations compétitives comme dans les années 1930, menacent de paralyser le commerce au sein de l’Europe. Ainsi, loin de représenter un pas vers un bloc impérialiste européen, le projet de l’Euro est soutenu par les Etats-Unis qui seraient une des principales victimes d’un effondrement du marché européen.
L’Euro, comme l’Union Européenne elle-même, illustre aussi comment cette coordination entre Etats, loin d’abolir la guerre commerciale entre eux, est une méthode en vue de l’organiser en faveur du plus fort. Si la monnaie unique est un point d’ancrage de stabilité pour l’économie européenne, elle est en même temps un système destiné à assurer la survie des puissances les plus fortes (surtout le pays qui dicte les conditions de sa mise en place, l’Allemagne) aux dépens des participants les plus faibles (qui est la raison pour laquelle la Grande-Bretagne, à cause de sa force traditionnelle comme puissance financière mondiale, peut encore se permettre le luxe de rester en dehors de la zone Euro).
Nous sommes face à un système capitaliste d’Etat infiniment plus développé que celui de Staline, Hitler ou Roosevelt dans les années 1930, au sein duquel non seulement la concurrence au sein de chaque Etat-nation mais jusqu'à un certain point celle des capitaux nationaux sur le marché mondial prend un caractère moins spontané, plus régulé - en fait plus politique. Ainsi, après la débâcle de la “ crise asiatique ”, les leaders des principaux pays industriels ont insisté pour qu’à l’avenir le FMI adopte des critères plus politiques en décidant quels pays devront être maintenus “ la tête hors de l’eau ” et à quel prix (et à l’inverse, ceux qui pourront être éliminés du marché mondial).
12) Avec l’accélération de la crise, la bourgeoisie se trouve contrainte aujourd’hui de revoir sa politique économique : c’est l’une des raisons de la mise en place de gouvernements de gauche en Europe et au Etats-Unis. En Grande-Bretagne, en France ou en Allemagne, les nouveaux gouvernements de gauche ont développé une critique de la politique antérieure de la “ globalisation ” et de la “ libéralisation ” lancée dans les années1980 sous Reagan et Thatcher, appelant à plus d’intervention étatique dans l’économie et pour une régulation des flux internationaux des capitaux. La bourgeoisie se rend compte aujourd’hui que cette politique a atteint ses limites.
La “ mondialisation ”, en baissant les barrières commerciales et pour les investissements en faveur de la circulation du capital, a été la réponse des puissances dominantes au danger du retour du protectionnisme et de l’autarcie des années 1930 : une mesure capitaliste d’Etat protégeant les concurrents les plus forts au dépens des plus faibles. Mais aujourd’hui, cette mesure a besoin à son tour d’une régulation d’Etat plus forte, visant non pas à congédier mais à contrôler le mouvement “ global ” du capital.
La “ mondialisation ” n’est pas la cause de la folle spéculation internationale de ces dernières années, mais elle a ouvert tout grand les portes à son développement. En conséquence, en étant un refuge du capital menacé par l’absence d’investissements profitables réels, la spéculation est devenue un énorme danger pour le capital. Si la bourgeoisie réagit à ce danger aujourd’hui, c'est non seulement parce que ce développement est en mesure de mettre sur les genoux des économies nationales entières plus périphériques du jour au lendemain (Thaïlande, Indonésie, Brésil etc.) mais surtout parce que les principaux groupes capitalistes leaders dans les grands pays risqueraient la banqueroute dans l’affaire. En fait, le but principal des programmes du FMI pour ces différents pays, ces deux dernières années, fut de sauver non pas les pays directement touchés, mais les investissements spéculatifs des capitalistes occidentaux dont la banqueroute auraient déstabilisé les structures financières internationales elles-mêmes.
De la même façon que la “ mondialisation ” n’a jamais remplacé la concurrence de l’Etat-nation par celle des multinationales, comme l’idéologie bourgeoise le prétendait, mais était une politique de certains capitaux nationaux, de même la politique de “ libéralisation ” n’a jamais constituée un affaiblissement du capitalisme d’Etat mais un moyen de le rendre plus efficace et, en particulier, de justifier les énormes coupes sombres dans les budgets sociaux. Cependant, la situation présente de crise aigüe demande une intervention étatique beaucoup plus directe et manifeste (comme la récente nationalisation des banques japonaises en faillite, une mesure qui a été demandée publiquement par les Etats du G7). De telles circonstances ne sont plus désormais compatibles avec une idéologie “ libérale ”.
A ce niveau également, la gauche du capital est mieux à même de mettre en œuvre les nouvelles “ mesures correctives ” (quelque chose que la résolution du 10e Congrès du CCI en 1993 avait déjà pointé avec le remplacement de Bush par Clinton aux Etats-Unis) :
- politiquement, parce que la gauche est historiquement moins liée à la clientèle des intérêts capitalistes privés que la droite et ainsi mieux à même d’adopter des mesures contre la volonté de groupes particuliers mais tout en défendant le capital national comme un tout ;
- idéologiquement, parce que la droite avait inventé et principalement mis en œuvre la politique précédente qui est dorénavant modifiée.
Cette modification ne signifie pas que la politique économique dite “ néo-libérale ” va être abandonnée. En fait, et comme expression de la gravité de la situation, la bourgeoisie est obligée de combiner les deux politiques, lesquelles ont des effets de plus en plus graves sur l'évolution de l'économie mondiale. Une telle combinaison, en fait un équilibre sur la corde raide entre les deux, malgré ses effets positifs dans l'immédiat mais de plus en plus faibles, ne peut qu'aggraver à terme la situation.
Ceci ne signifie cependant pas qu’il y a “ un point de non retour ” économique au-delà duquel le système serait voué à disparaître irrévocablement, ni qu’il y aurait une limite théorique définie au montant des dettes (la principale drogue du capitalisme à l’agonie) que le système peut s’administrer sans rendre sa propre existence impossible. En fait, le capitalisme a déjà dépassé ses limites économiques avec l’entrée dans sa phase de décadence. Depuis lors, le capitalisme a seulement réussi à survivre par une manipulation croissante des lois du capitalisme : une tâche que seul l’Etat peut effectuer.
En réalité, les limites de l'existence du capitalisme ne sont pas économiques mais fondamentalement politiques. Le dénouement de la crise historique du capitalisme dépend de l'évolution du rapport de forces entre les classes :
- soit le prolétariat dévéloppe sa lutte jusqu'à la mise en place de sa dictature révolutionnaire mondiale ;
- soit le capitalisme, à travers sa tendance organique vers la guerre, plonge l'humanité dans la barbarie et la destruction définitive.
La lutte de classe
13) En réponse aux premières manifestations de la nouvelle crise ouverte à la fin des années 1960, le retour de la lutte de classe en 1968, mettant un terme à quatre décennies de contre-révolution, a barré la route à la guerre mondiale et a ouvert à nouveau une perspective à l’humanité. Pendant les premières grandes luttes de la fin des années 1960 et du début des années 1970, une nouvelle génération de révolutionnaires commença à être sécrétée par la classe et la nécessité de la révolution prolétarienne fut débattue dans les assemblées générales de la classe. Pendant les différentes vagues de luttes ouvrières entre 1968 et 1989, une expérience de lutte difficile mais importante fut acquise et la conscience dans la classe se développa en confrontation avec la gauche du capital, particulièrement les syndicats, en dépit d’une série d’obstacles placés sur le chemin du prolétariat. Le plus haut point de toute cette période fut la grève de masse de 1980 en Pologne, démontrant que dans le bloc russe aussi - historiquement condamné par sa position de faiblesse à être “ l’agresseur ” dans toute guerre - le prolétariat n’était pas prêt à mourir pour l’Etat bourgeois.
Cependant, si le prolétariat a barré la route vers la guerre, il n’a pas été capable d’effectuer des pas significatifs vers une réponse à la crise du capitalisme : la révolution prolétarienne. C’est ce blocage dans le rapport de force entre les classes, où aucune des deux principales classes de la société moderne n'est en mesure d’imposer sa propre solution, qui a ouvert la période de décomposition du capitalisme.
En revanche, ce fut le premier véritable événement historique mondial de cette période de décomposition - l’effondrement des régimes staliniens (soi-disant communistes) en 1989 - qui mit un terme à toute une période de développement des luttes et de la conscience depuis 1968. Le résultat de ce tremblement de terre historique a été le plus profond recul dans la combativité et surtout dans la conscience du prolétariat depuis la fin de la contre-révolution.
Ce revers n’a pas représenté une défaite historique de la classe, comme le CCI l’a pointé à l’époque. Dès 1992, avec les importantes luttes en Italie, la classe ouvrière avait déjà repris le chemin de la lutte. Mais au cours des années 1990, ce chemin s’est révélé plus ardu à parcourir que dans les deux décennies précédentes. Malgré ces luttes, la bourgeoisie en France en 1995, et peu après en Belgique, en Allemagne et aux Etats-Unis, fut en mesure de tirer profit de la combativité hésitante et de la désorientation politique de la classe et organisa des mouvements spectaculaires visant spécifiquement à restaurer la crédibilité des syndicats, ce qui affaiblit encore plus la conscience de classe des ouvriers. A travers de telles actions, les syndicats atteignirent leur plus haut niveau de popularité depuis plus d’une décennie. Après les manoeuvres syndicales massives en novembre et décembre 1995 en France, la résolution sur la situation internationale du 12e congrès de la section du CCI en France de 1996 notait : “ ... dans les principaux pays du capitalisme, la classe ouvrière se retrouve ramenée à une situation comparable à celle des années 1970 en ce qui concerne ses rapports aux syndicats et au syndicalisme ” (...) “ ... la bourgeoisie a momentanément réussi à effacer des consciences ouvrières les leçons acquises au cours des années 1980, suite aux expériences répétées de confrontation aux syndicats. ”
Tout ce développement confirme qu’après 1989, le chemin vers des affrontements de classe décisifs est devenu plus long et plus difficile.
14) Malgré ces énormes difficultés, les années 1990 ont été une décennie de redéveloppement des luttes de classe. Cela était déjà visible au milieu des années 1990 à travers la stratégie de la bourgeoisie elle-même :
- les manoeuvres syndicales annoncées à grand renfort de publicité visaient à renforcer les syndicats avant qu’une accumulation importante de la combativité ouvrière ne rende ces mobilisations à grande échelle trop dangereuses ;
- les “ mouvements de chômeurs ” qui ont suivi, tout aussi artificiellement orchestrés en France, Allemagne et dans d’autres pays en 1997-98, destinés à créer une division entre actifs et chômeurs – cherchant à culpabiliser les premiers, créant des structures syndicales en vue de l’encadrement futur des derniers – a révélé l’inquiétude de la classe dominante face au potentiel radical du chômage et des chômeurs ;
- les campagnes idéologiques énormes et incessantes (partant souvent de thèmes liés à la décomposition comme celle à propos de l’affaire Dutroux en Belgique, du terrorisme de l’ETA en Espagne, de l’extrème droite en France, en Autriche ou en Allemagne) appelant à la défense de la démocratie, se sont multipliées pour saboter la réflexion des ouvriers, prouvant que la classe dominante elle-même était convaincue de l’inévitabilité de l'accroissement de la combativité ouvrière avec l’aggravation de la crise et des attaques. Et il faut noter que toutes les actions préventives furent coordonnées et montées en épingle à un niveau international.
La justesse de l’instinct de classe de la bourgeoisie a été rendue évidente par une augmentation des luttes ouvrières vers la fin de la décennie.
A nouveau, la manifestation la plus importante d’un sérieux développement de la combativité est venu des pays du “ Bénélux ”, avec des grèves dans différents secteurs en 1997 aux Pays Bas, notamment dans le plus grand port du monde, Rotterdam. Ce signal important allait bientôt être confirmé dans un autre petit pays d’Europe occidentale mais hautement développé, le Dannemark, quand presqu’un million de travailleurs du secteur privé (un quart des salariés de ce pays) partirent en grève pendant presque deux semaines en mai 1998. Ce mouvement révéla :
- une tendance à la massivité des luttes ;
- l’obligation pour les syndicats de reprendre leurs habitudes de contrôler, isoler et saboter les mouvements de luttes de sorte que les ouvriers à la fin de ces mouvements n’apparurent pas euphoriques (comme en France en 1995) mais avaient perdus leurs illusions ;
- la nécessité pour la bourgeoisie de reprendre internationalement sa politique de minimisation de luttes ou, chaque fois que possible, de faire le black out sur elles afin de ne pas étaler le “ mauvais exemple ” de la résistance ouvrière.
Depuis lors, cette vague de luttes s’est poursuivie dans deux directions :
- des actions à grande échelle organisées par les syndicats (Norvège, Grèce, Etats-Unis, Corée du Sud) sous la pression d’un mécontentement ouvrier grandissant ;
- une multiplication de petites luttes non-officielles, quelques fois même spontanées, dans les nations capitalistes centrales d’Europe (France, Grande-Bretagne, Belgique, Allemagne) que les syndicats prennent en charge pour les encadrer et les isoler.
Significatifs sont les faits suivants :
- la simultanéité grandissantedes luttes à l'échelle nationale et internationale, notamment en Europe occidentale ;
- l’irruption du combat en réponse aux différents aspects des attaques capitalistes : licenciements et chômage, baisse des salaires réels, coupes sombres dans le “ salaire social ”, conditions insupportables d’exploitation, réduction de congés etc. ;
- l’embryon d’une réflexion au sein de la classe sur les revendications et comment lutter et même sur l’état actuel de la société ;
- l’obligation pour la bourgeoisie – bien que les syndicats officiels ne soient pas encore sérieusement discrédités dans les récents mouvements – de développer à temps la carte du “ syndicalisme de combat ” ou “ de base ” avec l’implication forte du gauchisme.
15) Malgré ces pas en avant, l’évolution de la lutte de classe depuis 1989 est restée difficile non sans reculs, surtout à cause :
- du poids de la décomposition, un facteur de plus en plus prégnant contre le développement d’une solidarité collective et d’une réflexion théorique, historique et cohérente de la classe ;
- de la véritable dimension du recul qui a débuté en 1989, qui, au niveau de la conscience, va peser négativement et à long terme puisque c’est la perspective du communisme elle-même qui a été attaquée.
Soulignant ce recul - qui a fait revenir la lutte prolétarienne à plus de dix ans en arrière –est le fait qu’à l’époque de la décomposition, le temps ne joue plus en faveur du prolétariat. Bien qu’une classe non-vaincue puisse empêcher la dérive vers la guerre mondiale, elle ne peut empêcher la prolifération de toutes les manifestations de pourrissement d’un ordre social en décomposition.
En fait, ce recul est lui-même l’expression d’un retard de la lutte prolétarienne, face à une accélération générale du déclin du capitalisme. En particulier, malgré toute la signification de la Pologne en 1980 pour la situation mondiale, neuf ans plus tard, ce n’est pas la lutte de classe internationale qui a fait tomber le Stalinisme en Europe de l’Est – la classe ouvrière étant complètement absente au moment de son effondrement.
Néanmoins, la faiblesse centrale du prolétariat entre 1968 et 1989 ne consistait pas en un retard général (à l’opposé du rapide développement de la situation révolutionnaire qui a surgi de la Première Guerre mondiale, la lente évolution depuis 1968 en réponse à la crise économiques a de nombreux avantages) mais avant tout d’une difficulté dans la politisation de son combat.
Cette difficulté est le résultat du fait que la génération qui, en 1968, a mis un terme à la plus longue contre-révolution de l’histoire a été coupée de l’expérience des générations passées de sa classe et a réagi aux traumatismes infligés par la Social-Démocratie et le Stalinisme avec une tendance à rejeter la “ politique ”.
Ainsi le développement d'une telle “ culture politique ” devient la question centrale des luttes à venir. Cette question, en fait, contient la réponse à une seconde question : comment compenser le terrain perdu au cours des années passées pour surmonter l’amnésie présente de la classe concernant les leçons de ses luttes avant 1989 ?
Il est clair que cela ne peut être fait en répétant les combats des deux décennies précédentes : l’histoire ne permet pas de telles répétitions, encore moins aujourd’hui quand le temps manque à l’humanité. Mais surtout, le prolétariat est une classe historique. Même si les leçons de 20 années sont absentes actuellement de sa conscience, en réalité le processus de “ politisation ” n’est rien d’autre que la redécouverte des leçons du passé dans la trajectoire de redéveloppement de la perspective de lutte.
16) Nous avons de bonnes raisons de penser que la période qui vient, sur le long terme, sera par beaucoup de côtés particulièrement favorable pour une telle politisation. Ces facteurs favorables incluent :
- l’état avancée de la crise elle-même, impulsant la réflexion prolétarienne sur le besoin de confronter et dépasser le système ;
- le caractère de plus en plus massif, simultané et généralisé des attaques, posant le besoin d’une réponse de classe généralisée. Cela comprend la question de plus en plus grave du chômage, la réflexion sur la faillite du capitalisme et aussi le problème de l'inflation, qui est moyen employé par le capitalisme pour piller la classe ouvrière et d’autres couches de la société.
Cela comprend aussi le problème de la répression de l'Etat, poussé de plus en plus à mettre hors la loi toute véritable expression de la lutte prolétarienne.
Cela comprend enfin l’omniprésence de la guerre, détruisant les illusions sur un possible capitalisme “ pacifique ”. La guerre actuelle dans les Balkans, une guerre au cœur du centre du capitalisme, va avoir un impact significatif sur la conscience des ouvriers, malgré les alibis humanitaires. Quelque soit l'impact qu'elle puisse avoir dans l'évolution des lutte immédiates, elle va exprimer de façon accrue la perspective catastrophique que le capitalisme offre à l'humanité. En plus, le glissement accéléré vers la guerre va démander l'augmentation des budgets de guerre et, par voie de conséquence, des sacrifices de plus en plus extrêmes pour le prolétariat ogligeant ce dernier à défendre ses intérêts contre ceux du capital national.
Parmi les autres facteurs favorables, il faut relever :
- le renforcement de la combativité d’une classe non-défaite. C’est seulement en engageant le combat que les ouvriers peuvent rentrer en possession de l’expérience d’être une partie d’une classe collective, retrouver leur confiance en eux qu'ils avaient perdue, commencer à poser les questions de classe sur un terrain de classe et une fois de plus croiser le fer avec le syndicalisme et le gauchisme ;
- l’entrée en lutte d’une seconde et nouvelle génération d’ouvriers. La combativité de cette génération est toujours pleinement intacte. Née dans un capitalisme en crise, elle est débarrassée de certaines des illusions de la génération d'après 1968. Surtout, contrairement aux ouvriers d’après 1968, les jeunes prolétaires d’aujourd’hui peuvent apprendre d’une génération avant eux qui a déjà une expérience considérable de lutte à transmettre. Ainsi, les leçons “ perdues ” du passé peuvent être retrouvées dans la lutte par la combinaison de deux générations de prolétaires : c'est le processus normal d’accumulation de l’expérience historique que la contre-révolution avait brutalement interrompue.
- cette expérience de réflexion commune sur le passé, face au besoin d’un combat généralisé contre un système agonisant va donner naissance à des cercles de discussion ou des noyaux d'ouvriers avancés qui vont essayer de se réappropier les leçons de l'histoire du mouvement ouvrier. Dans une telle perspective, la responsabilité de la Gauche Communiste sera beaucoup plus grande que dans les années 1930.
Ce potentiel n’est pas un vœu pieux. Il est déjà confirmé par la bourgeoisie qui est pleinement consciente de ce danger potentiel et qui réagit déjà de façon préventive par des dénigrements incessants contre le passé et le présent révolutionnaire de son ennemi de classe.
Surtout, au vu de la dégradation de la situation mondiale, la bourgeoisie craint que la classe ne découvre ces épisodes qui démontrent la puissance du prolétariat, qu’elle est la classe qui détient les clés du futur de l’humanité entre ses mains : la vague révolutionnaire de 1917-1923, le renversement de la bourgeoisie en Russie, la fin de la Première Guerre mondiale via le mouvement révolutionnaire en Allemagne.
17) Cette inquiétude de la classe dominante face au danger prolétarien n’est pas moins reflétée dans la venue au pouvoir de la gauche dans 13 des 15 pays de l’Union Européenne.
Le retour de la gauche au gouvernement dans tant de pays importants, en commençant par les Etats-Unis après la Guerre du Golfe, est rendu possible par le choc sur la conscience prolétarienne subi avec les événements de 1989, comme le CCI l’avait pointé en 1990 :
“ C’est pour cette raison, en particulier, qu'il convient aujourd'hui de mettre à jour l’analyse développée par le CCI sur la "gauche dans l’opposition". Cette carte était nécessaire à la bourgeoisie depuis la fin des années 1970 et tout au long des années 1980 du fait de la dynamique générale de la classe vers des combats de plus en plus déterminés et conscients, de son rejet croissant des mystifications démocratiques, électorales et syndicales. (…) En revanche, le recul actuel de la classe n'impose plus à la bourgeoisie, pour un certain temps, l'utilisation prioritaire de cette stratégie. Cela ne veut pas dire que dans ces derniers pays on verra nécessairement la gauche retourner au gouvernement : nous avons, à plusieurs reprises, mis en évidence qu'une telle formule n'est indispensable que dans les périodes révolutionnaires ou de guerre impérialiste. Par contre, il ne faudra pas être surpris s'il advient un tel évènement, ou bien considérer qu'il s'agit d'un ”accident” ou l'expression d'une “faiblesse particulière” de la bourgeoisie de ces pays. ” (Revue Internationale n°61)
La résolution du 12e Congrès du CCI au printemps 1997, après avoir correctement prédit la victoire des Travaillistes aux élections générales de mai 1997 en Grande-Bretagne, ajoutait :
“ …il est important de souligner le fait que la classe dominante ne va pas revenir aux thèmes des années 1970 quand l’"alternative de gauche" avec son programme de mesures "sociales", et même de nationalisations, était mis en avant afin de briser l’élan de la vague de luttes qui avait débutée en 1968, en dévoyant le mécontentement et la militance vers l’impasse des élections. ”
La victoire électorale de Schröder-Fischer sur Khol en Allemagne à l’automne 1998 a confirmé :
- que le retour de gouvernements de gauche n’est en aucune façon un retour aux années 1970 : le SPD n’est pas revenu au pouvoir à l’occasion de grandes luttes, comme cela avait été le cas sous Brandt. Il n’a fait aucune promesse électorale irréaliste avant et poursuit une politique très “ modérée ” et “ responsable ” au gouvernement ;
- que dans la présente phase de lutte de classe, ce n’est pas un problème pour la bourgeoisie de mettre la gauche, en particulier les Sociaux-démocrates, au gouvernement. En Allemagne, il aurait été plus facile que dans d’autres pays de laisser la droite au gouvernement. Contrairement à la plupart des autres puissances occidentales, où les partis de droite sont soit dans un état de confusion (France, Suède), soit divisés sur la politique étrangère (Italie, Grande-Bretagne) ou accablés par des tendances irresponsables arriérées (Etats-Unis), en Allemagne, la droite, bien que quelque peu usée par 16 années de gouvernement, est en ordre de marche et est tout à fait capable de s’occuper des affaires de l'état allemand.
Cependant, le fait que l’Allemagne, le pays ayant aujourd’hui l’appareil politique le plus réglé et cohérent (reflétant son statut de leader de bloc impérialiste potentiel) ait porté au pouvoir le SPD, révèle que la carte de la gauche au gouvernement n’est pas seulement possible aujourd’hui mais est devenue une relative nécessité (tout comme la gauche dans l'opposition dans les années 1980 en était relativement une) dans le sens que ce serait une erreur pour la bourgeoisie de ne pas jouer cette carte maintenant.
Nous avons déjà montré quelles nécessités au niveau de la politique impérialiste et de la gestion de la crise avaient ouvert la voie pour la gauche au gouvernement. Mais sur le front social également, il y a surtout deux raisons importantes pour de tels gouvernements aujourd’hui :
- après de longues années de gouvernement de droite dans des pays-clé comme la Grande-Bretagne et l’Allemagne, la mise en place de la mystification électorale demande l’alternative démocratique maintenant – d’autant plus que dans l’avenir il deviendra beaucoup plus difficile d’avoir la gauche au gouvernement. Déjà, contre la vague révolutionnaire de 1917-1923 et plus encore depuis la chute du Stalinisme, la démocratie bourgeoise s'est confirmée comme la plus importante mystification anti-prolétarienne de la classe dominante, une mystification qui doit être de façon permanente alimentée.
- bien que la gauche ne soit pas nécessairement la plus adaptée pour porter des attaques à la classe ouvrière aujourd’hui, elle a l’avantage sur la droite d’attaquer d’une manière plus prudente et surtout moins provocante que la droite. C’est une qualité très importante à l’heure actuelle où il est vital pour la bourgeoisie d’éviter autant que possible des luttes importantes et massives de son ennemi mortel, puisque de telles luttes sont la première condition - et possèdent aujourd’hui un important potentiel - pour le développement de la confiance en soi et de la conscience politique du prolétariat comme un tout.
Vie du CCI:
- Résolutions de Congrès [131]
Heritage de la Gauche Communiste:
Crise économique : trente ans de crise ouverte du capitalisme (II. les années 1980)
- 5026 reads
II. LES ANNEES 1980
Dans le numéro précédent de la Revue internationale, nous avons vu que le capitalisme, confronté depuis 1967 à la réapparition de la forme ouverte de sa crise historique, a déployé les moyens d'intervention de l'Etat dans l'économie pour tenter de ralentir et de reporter ses effets les plus nocifs vers les pays plus périphériques, vers les secteurs les plus faibles du capital et, évidemment, sur l'ensemble de la classe ouvrière. Nous avons analysé l'évolution de la crise et la réponse du capitalisme pendant les années 1970. Nous allons voir maintenant cette évolution tout au long des années 1980. Cette analyse nous permet de comprendre pourquoi la politique menée par les Etats, c'est-à-dire « la politique d'accompagnement de la crise pour provoquer une chute lente et échelonnée », n'a apporté aucune solution sinon celle d'aggraver de plus en plus les contradictions de fond du capitalisme.
La crise de 1980-82
Au 2e congrès international du CCI en 1977 ([1] [3689]), nous avons mis en relief que les politiques d'expansion que venait d'employer le capitalisme étaient chaque fois moins efficaces et menaient à une impasse. L'oscillation entre les « relances » qui provoquaient l'inflation et les politiques de freinage qui aboutissaient à des récessions conduisait à ce que les économistes bourgeois appelaient la « réflation » (à la fois récession et inflation), démontrant ainsi la gravité de la situation du capitalisme et le caractère insoluble de ses contradictions. Le mal incurable de la surproduction, à son tour, aggravait globalement les tensions impérialistes de telle manière que les dernières années de la décennie ont connu un aiguisement considérable des confrontations militaires et un accroissement de l'effort d'armement tant au niveau nucléaire qu'au niveau « conventionnel » ([2] [3690]).
Les années 1980 commencent par une récession ouverte qui se prolonge jusqu'en 1982 et qui, sur toute une série d'aspects importants, est bien plus grave que la précédente, celle de 1974-75. Il y a un ralentissement de la production (la production industrielle de Grande-Bretagne tombe en 1982 au niveau de celle de 1967), une augmentation spectaculaire du chômage (en 1982, les Etats-Unis enregistrent en un mois un demi-million de chômeurs en plus) et, pour la première fois depuis 1945, le commerce mondial chute pendant deux années consécutives (3[3] [3691]). Les fermetures d'entreprises et les licenciements massifs se produisent à un niveau jamais vu depuis la crise de 1929. Ce que l'on appelle la désertification industrielle et agricole commence à se développer et ne va pas cesser de s'accroître depuis. D'une part, des régions entières de vieille tradition industrielle voient la fermeture systématique des usines et des mines et le chômage monter en flèche jusqu'à des taux de 30 %. C'est ce qui se produit dans des régions comme celles de Manchester, Liverpool ou Newcastle en Grande-Bretagne, celle de Charleroi en Belgique, celle de Détroit aux Etats-Unis ou la Lorraine en France. D'autre part, la surproduction agricole est telle que, dans de nombreux pays, les gouvernements subventionnent l'abandon de vastes zones, suppriment brutalement les aides aux exploitations agricoles et de pèche, ce qui provoque des faillites en cascade chez les paysans petits et moyens et le chômage des travailleurs agricoles.
Cependant, à partir de 1983, se produit une reprise de l'économie qui, dans un premier temps, va rester limitée aux Etats-Unis et, à partir de 1984-85, va atteindre l'Europe et le Japon. Cette reprise est fondamentalement permise grâce à l'endettement colossal des Etats-Unis qui ont soutenu la production et servi de locomotive aux économies du Japon et de l'Europe occidentale.
Ce sont les fameuses « Reaganomics » qui, à l'époque, sont présentées comme la solution enfin trouvée à la crise du capitalisme. De surcroît, cette « solution » est présentée comme un retour à « l'essence du capitalisme ». Face aux « excès » de l'intervention de l'Etat qui avait caractérisé les politiques économiques des Etats pendant les années 1970 (c'est-à-dire le keynésianisme) et qui était qualifiée de « socialiste » ou de « tendance au socialisme », les nouveaux théoriciens de l'économie se présentent comme « néo-libéraux » et répandent aux quatre vents leurs recettes du « moins d'Etat » , du « marché libre », etc.
En réalité, les Reaganomics ne résolvent pas grand chose (à partir de 1985, comme nous le verrons plus loin, il faudra payer la facture de l'endettement des Etats-Unis), et ne sont pas l'occasion d'un véritable « retrait de l'Etat ». Ce que fait l'administration Reagan c'est de lancer un programme massif de réarmement (la dite « guerre des étoiles » qui va puissamment contribuer à mettre à genoux le bloc rival) au moyen du recours classique à l'endettement étatique. La fameuse locomotive ne s'alimente pas avec un bon combustible constitué par une expansion véritable du marché, mais avec celui frelaté de l'endettement généralisé.
La « nouvelle » politique d'endettement
La seule nouveauté de la politique de Reagan est la forme de réalisation de l'endettement. Pendant les années 1970, les Etats étaient les responsables directs de celui-ci par des déficits croissants de la dépense publique financés par l'augmentation de la masse monétaire. Ceci supposait que c'était l'Etat qui procurait l'argent aux banques pour que celles-ci prêtent aux entreprises, aux particuliers ou aux autres Etats. C'est ce qui provoquait la dépréciation continuelle de l'argent et l'explosion de l'inflation qui en résultait.
Nous avons déjà vu l'impasse croissante dans laquelle se trouvait l'économie mondiale et particulièrement l'économie des Etats-Unis à la fin des années 1970. Pour sortir de celle-ci, durant les deux dernières années de l'administration Carter, le responsable de la Réserve fédérale, Volker, changea radicalement la politique du crédit. Il ferma le robinet de l'émission monétaire, ce qui provoqua la récession de 1980-82, mais simultanément il ouvrit la voie au financement massif par l'émission de bons et obligations qui se renouvelaient constamment sur le marché des capitaux. Cette orientation sera reprise et généralisée par l'administration Reagan et, plus tard, s'étendra à tous les pays.
Le mécanisme d'« ingénierie financière » est le suivant. D'un côté, l'Etat émet des bons et des obligations pour financer ses déficits énormes et toujours croissants qui sont souscrits par les marchés financiers (banques, entreprises et particuliers). D'un autre côté, il pousse les banques à chercher sur le marché le financement de leurs prêts, recourant, à leur tour, à l'émission de bons et obligations et à des augmentations de capital (émission d'actions). Il s'agit d'un mécanisme hautement spéculatif qui consiste à essayer de tirer profit du développement d'une masse croissante de capital fictif (plus-value immobilisée incapable d'être investie dans un nouveau capital).
De cette manière, les fonds privés tendent à peser beaucoup plus que les fonds publics dans le financement de la dette (publique et privée).
Financement de la dette publique aux Etats-Unis (milliards de dollars)
Fonds 1980 1985 1990 1995 1997
Publics 24 45 70 47 40
Privés 46 38 49 175 260
Source : Global Developmement Finance
Ceci signifie moins une diminution du poids de l'Etat (comme le proclament les « libéraux ») qu'une réponse aux nécessités chaque fois plus écrasantes de financement (et particulièrement de liquidités immédiates) qui obligent à une mobilisation massive de tous les capitaux disponibles.
La mise en marche de cette politique prétendument « libérale » et « monétariste » signifie que la fameuse locomotive Etats-Unis est financée par le reste de l'économie mondiale. En particulier, par le capital japonais qui, du fait de son énorme excédent commercial, souscrit massivement aux bons et obligations du Trésor américain ainsi qu'aux différentes émissions des entreprises de ce pays. Le résultat est que les Etats-Unis qui, depuis 1914, étaient le premier créditeur mondial se transforment en premier débiteur mondial. Un autre conséquence est qu'à la fin des années 1980, les banques japonaises possèdent pratiquement 50 % des actifs immobiliers américains. Enfin, cette forme d'endettement fait que, « alors que dans la période 1980-82 les pays industrialisés ont versé aux dits pays en développement 49 000 millions de dollars plus que ce qu'ils ont reçu, dans la période 1983-89 ce sont ces derniers qui ont fourni aux premiers plus de 242 000 millions de dollars. » (Prometeo n° 16, organe de Battaglia Comunista, « Une nouvelle phase dans la crise capitaliste », décembre 1998)
Pour rembourser les intérêts et l'essentiel des bons émis l'usage consiste à recourir à de nouvelles émissions de bons et obligations. Cependant ceci signifie de plus en plus de dettes et par voie de conséquence le risque que les prêteurs ne veuillent plus souscrire à de nouvelles émissions. Pour continuer à les appâter, on recoure à des réappropriations régulières du dollar en utilisant différents artifices de réévaluation de la devise. Le résultat est, d'une part, un énorme afflux de dollars sur l'ensemble de l'économie mondiale et, d'autre part, la plongée des Etats-Unis dans un énorme déficit commercial qui, année après année, va battre de nouveaux records. La majorité des Etats industrialisés suivent plus ou moins la même politique : ils jouent avec la monnaie comme instrument d'attraction des capitaux.
La manipulation des monnaies est une tendance qui va s'approfondir pendant les années 1990. La fonction classique de la monnaie sous le capitalisme était celle d'être la mesure de la valeur et l'étalon des prix, pour laquelle la monnaie de chaque Etat devait être soutenue par une proportion minimum de métaux précieux ([4] [3692]). Cette réserve de métaux précieux reflétait de manière tendancielle l'accroissement et le développement de la richesse du pays, laquelle se traduisait, également tendanciellement, dans le cours de sa monnaie.
Nous avons vu dans l'article précédent comment le capitalisme a abandonné, tout au long du 20e siècle, ses réserves et a laissé circuler les monnaies sans contreparties avec les risques graves que cela comporte. Cependant, les années 1980 constituent un véritable saut qualitatif vers l'abîme : au phénomène déjà grave des monnaies complètement dissociées de toute contrepartie en or et argent, phénomène qui continue à s'accélérer tout au long de la décennie, s'est d'abord ajouté le jeu des réévaluations/dévaluations afin d'attirer les capitaux, ce qui a provoqué une spéculation effrénée sur les monnaies. Dans un second temps, il y a le recours, de manière plus systématique aux « dévaluations compétitives », c'est-à-dire des baisses du cours de la monnaie, par décret, avec l'objectif de favoriser les exportations.
Cette « nouvelle » politique économique dont les piliers sont d'une part l'émission massive de bons et obligations qui enfle constamment comme une boule de neige et d'autre part la manipulation, sans cohérence, des monnaies, suppose un « système financier » sophistiqué et complexe qui ne peut être, en réalité, que l'oeuvre des Etats et des grandes institutions financières (banques, caisses d'épargne et sociétés d'investissement, lesquelles ont des liens très étroits avec l'Etat). En apparence c'est un mécanisme « libéral » et « non interventionniste ». Dans la pratique, c'est une construction typique du capitalisme d'Etat à l'occidentale, c'est-à-dire une gestion fondée sur la combinaison entre les secteurs dominants du capital privé et l'Etat.
Cette politique nous a été présentée comme la potion magique capable de permettre une croissance économique sans inflation. Le capitalisme pendant les années 1970 s'était trouvé confronté au dilemme insoluble inflation ou récession. Maintenant, quelle que soit leur coloration politique (« socialistes », de « gauche » ou du « centre »), les gouvernants se sont convertis au nouveau credo « néo-libéral » et « monétariste » et proclament que le capitalisme a surmonté ce dilemme, l'inflation ayant été réduite à des niveaux de 2 % à 5 % sans que cela nuise à la croissance économique.
Cette politique de « lutte contre l'inflation » ou d'une prétendue « croissance sans inflation » est basée sur les mesures suivantes :
1. L'élimination des capacités productives « excédentaires » dans l'industrie et l'agriculture. Le résultat est la fermeture de nombreuses installations industrielles et des licenciements massifs.
2. La suppression drastique des subventions à l'industrie et à l'agriculture qui entraîne aussi licenciements et fermetures d'usines.
3. La pression pour réduire les coûts et augmenter la productivité, ce qui signifie, en réalité, une déflation masquée et graduelle basée sur des attaques violentes contre la classe ouvrière des pays centraux et une baisse constante des prix des matières premières.
4. Le transfert, au moyen de mécanismes de pression monétaire et, plus particulièrement, par l'afflux massif de dollars, des effets inflationnistes vers les pays plus périphériques. Ainsi au Brésil, en Argentine et en Bolivie par exemple, se produisent des explosions d'hyperinflation amenant les prix à croître jusqu'à 30% par jour !
5. Et surtout, un remboursement des dettes avec de nouvelles dettes. En passant d'un financement de la dette par l'émission de papier-monnaie à celui effectué par l'émission de titres (bons et obligations d'Etat, actions d'entreprises, etc.), on arrive à retarder plus longtemps les effets de l'inflation. Les dettes contractées par une émission de titres se remboursent avec de nouvelles émissions. Ces titres sont l'objet d'une spéculation effrénée. On surévalue ainsi leur prix (cette surévaluation vient en complément de la manipulation du cours des monnaies) et de cette manière l'énorme inflation sous-jacente se trouve toujours remise à plus tard.
La mesure n° 4 ne résout pas l'inflation mais la change simplement de lieu (le transfert se fait vers les pays plus faibles). Ce à quoi la mesure n° 5 aboutit c'est à reporter l'inflation à plus tard, gonflant en contrepartie la bombe de l'instabilité et du désordre au niveau financier et monétaire.
Quand aux mesures n° 1 à 3, si elles réduisent réellement l'inflation à court terme, leurs conséquences sont beaucoup plus graves à moyen et long terme. En effet, elles impliquent une déflation cachée, c'est-à-dire une réduction méthodique et organisée par les Etats des capacités réelles de production. Comme nous le disions dans la Revue internationale n° 59 : « La production, qui peut correspondre à des biens réellement fabriqués, n'est pas une production de valeur, (...) le capitalisme ne s'est pas enrichi, au contraire il s'est appauvri. » ([5] [3693])
Le processus de désertification industrielle et agricole, la réduction énorme des coûts, les licenciements et l'appauvrissement général de la classe ouvrière qui s'opèrent, de manière systématique et méthodique par tous les gouvernements, tout au long des années 1980, et qui se poursuivent à une échelle supérieure pendant les années 1990, supposent un phénomène de déflation cachée et permanente. Alors qu'en 1929 s'était produite une déflation brutale et ouverte, le capitalisme est lancé, depuis les années 1980, dans une tendance inédite : la déflation planifiée et contrôlée, une espèce de démolition graduelle et méthodique des bases mêmes de l'accumulation capitaliste, une sorte de désaccumulation lente mais irréversible.
La réduction des coûts, l'élimination de secteurs obsolètes et non compétitifs et l'accroissement gigantesque de la productivité ne sont pas synonymes, en eux-mêmes, de croissance et développement du capitalisme. Il est certain que ces phénomènes ont accompagné les phases de développement du capitalisme au 19e siècle mais ils avaient un sens dans la mesure où ils étaient au service de l'extension et de l'élargissement des rapports de production capitalistes, de la croissance et de la formation du marché mondial. Leur fonction, à partir des années 1980, correspond à un objectif diamétralement opposé : se protéger de la surproduction. Et, de plus, ils n'aboutissent, en fait, qu'à une aggravation de la surproduction.
Pour cette raison, si ces politiques de « déflation compétitive », comme les appellent pudiquement les économistes, réduisent bien à court terme les bases de l'inflation, elles les stimulent en réalité et les renforcent à moyen et long terme, car la réduction de la base de la reproduction globale du capital ne peut être compensée que par des nouvelles masses toujours croissantes de dettes d'un côté, et de dépenses improductives (armement, bureaucratie étatique, financière et commerciale) de l'autre. Comme nous le disions dans le rapport sur la crise économique au 12e congrès du CCI : « ... le vrai danger de la "croissance" qui conduirait à l'inflation se situe ailleurs : dans le fait que toute croissance, toute prétendue reprise est basée sur une augmentation considérable de l'endettement, sur la stimulation artificielle de la demande, c'est-à-dire sur du capital fictif. C'est cela la matrice qui donne naissance à l'inflation parce qu'elle exprime une tendance profonde dans le capitalisme décadent : le divorce grandissant entre l'argent et la valeur, entre ce qui se passe dans le monde "réel" de la production des biens et un processus d'échanges qui est devenu "un mécanisme tellement complexe et artificiel" que même Rosa Luxemburg serait sidérée si elle pouvait voir cela aujourd'hui. » (Revue internationale n° 92)
Ainsi, en réalité, la seule politique qui est arrivée à maintenir un bas niveau d'inflation pendant les années 1980 et 1990 est le report permanent de la dette au moyen d'un carrousel de nouveaux titres qui se substituent aux précédents et le rejet de l'inflation globale vers les pays plus faibles (qui sont chaque fois plus nombreux).
Tout cela est clairement illustré avec la crise de la dette qui, depuis 1982, atteint les pays du tiers-monde (Brésil, Argentine, Mexique, Nigeria, etc.). Ces Etats, qui avec leurs énormes dettes avaient alimenté l'expansion des années 1970 (voir la première partie de cet article), menacent de se déclarer insolvables. Les pays plus riches réagissent immédiatement et leur viennent soi-disant en aide au moyen de plans de « restructuration » de la dette (Plan Brady) ou par l'intervention directe du Fond Monétaire International (FMI). En réalité, ce qu'ils cherchent c'est à éviter un effondrement brutal de ces Etats qui déstabiliserait tout le système économique mondial.
Les remèdes employés sont une reproduction de la « nouvelle politique d'endettement » :
- application de plans brutaux de déflation, sous l'égide du FMI et de la Banque Mondiale, ce qui suppose des attaques terribles contre la classe ouvrière et toute la population ; ces pays, qui pendant les années 1970 ont vécu le mirage du « développement », se réveillent brutalement avec le cauchemar de la misère généralisée de laquelle ils ne sortiront plus ;
- conversion des prêts en dette publique matérialisée en titres à intérêts très élevés (10 ou 20 % de plus que la moyenne mondiale) et soumis à une spéculation formidable ; l'endettement ne disparaît pas mais il se transforme en dette reportée ; avec cela le niveau de la dette des pays du tiers-monde loin de baisser croît de façon vertigineuse tout au long des années 1980 et 1990.
Le krach de 1987
A partir de 1985 la locomotive américaine commence à s'essouffler. Les taux de croissance baissent lentement mais inexorablement et touchent petit à petit les pays européens. Les politiciens et les économistes parlent d'un « atterrissage en douceur », c'est-à-dire qu'ils essaient de freiner le mécanisme d'endettement qui fait boule de neige et provoque une spéculation chaque fois plus incontrôlable. Le dollar, après des années de surévaluation, se dévalue brusquement, chutant entre 1985 et 1987 de plus de 50 %. Ceci soulage momentanément le déficit américain et parvient à réduire le paiement des intérêts de la dette. Mais la contrepartie est l'effondrement brutal de la Bourse de New York qui, en octobre 1987, chute de 27 %.
Ce chiffre est quantitativement inférieur à celui enregistré en 1929 (plus de 30 %), cependant un tableau comparatif de la situation de 1987 et 1929 permet de comprendre que les problèmes sont beaucoup plus graves en 1987.
La crise boursière de 1987 est une purge brutale de la bulle spéculative qui avait alimenté la réactivation économique des Reaganomics. Depuis lors, cette réactivation fait eau de toutes parts. La deuxième moitié des années 1980 connaît des indices de croissance de 1 % et 3 %, ce qui est, en réalité, un ralentissement. Mais en même temps, la décennie s'achève avec l'effondrement de la Russie et de ses satellites du bloc de l'Est, un phénomène qui, s'il a ses racines dans les particularités de ces régimes, est fondamentalement une conséquence de l'aggravation brutale de la crise économique mondiale.
En même temps que le phénomène de l'effondrement du bloc impérialiste russe, une tendance très dangereuse apparaît depuis 1987 : l'instabilité de tout l'appareil financier mondial, qui va être soumis à des cataclysmes chaque fois plus fréquents, à d'authentiques séismes qui montrent une fragilité et une vulnérabilité chaque fois plus grandes.
|
1929 : |
1987 : |
|
Au niveau de l’appareil productif
Crise dans les industries traditionnelles comme les mines, le textile, les chemins de fer, même si ultérieurement il y a une forte expansion. |
Au niveau de l’appareil productif
Crise chronique dans ces secteurs qui continueront à sombrer tout au long des années 1990 et de plus crise dans les secteurs « modernes » comme l’électronique, l’automobile, l’électro-ménager. |
|
Au niveau financier
La spéculation qui provoque le Krach était très récente (elle avait commencée en 1928) et était relativement nouvelle . |
Au niveau financier
La spéculation s’est développée depuis 1980 et avait de sérieux précédents dans la décennie antérieure (pétrodollars). |
|
Au niveau de la crise de surproduction
Elle se manifeste depuis 1929 après plusieurs années de croissance. |
Au niveau de la crise de surproduction
La crise précéde le Krach et dure de façon variable depuis 20 ans. |
|
Au niveau des politiques de capitalisme d’Etat
L’intervention de l’Etat est très limitée avant le Krach et se généralise à partir de 1933 pour juguler la crise et relancer la production. |
Au niveau des politiques de capitalisme d’Etat
L’intervention de l’Etat est massive et systèmatique depuis les années 1930 et a eu recours à de nombreuses mesures depuis 1970 pour, seulement épisodiquement, relancer la production. |
|
Au niveau de l’armement
La production massive de guerre retarde la crise à partir de 1934. |
Au niveau de l’armement
Le surarmement se développe depuis 1945 et dans les années 1980 connaît une accélération gigantesque qui fait que, comme carte pour pallier ou retarder la crise, c’est un moyen très usé. |
Bilan général des années 1980
Nous allons tirer quelques conclusions de l'ensemble de la décennie. Nous le ferons, comme dans l'article précédent, aussi bien sur l'évolution de l'économie que sur la situation de la classe ouvrière. La comparaison avec les années 1970 permet de constater une forte dégradation.
Evolution de la situation économique :
1) Les taux de croissance de la production atteignent un maximum en 1984 : 4,9 %. La moyenne de la période est de 3,4 % alors que la moyenne de la décennie antérieure était de 4,1 %.
2) Il y a une amputation importante dans l'appareil industriel et agricole. C'est un phénomène nouveau depuis 1945 qui affecte clairement les grands pays industrialisés. Le tableau suivant qui fait référence à trois pays centraux (Allemagne, Grande-Bretagne et Etats-Unis) met en évidence une chute très forte dans l'industrie et les mines et un déplacement de la croissance vers des secteurs non productifs et de caractère spéculatif.
Evolution de la production par secteurs entre 1974 et 1987
Allemagne Grande-Bretagne Etats-Unis
Mines - 8.1 - 42.1 - 24.9
Industries - 8.2 - 23.8 - 6.5
Construction - 17.2 - 5.5 12.4
Commerce et Hôtellerie - 3.1 5 15.2
Finances et Assurances 11.5 41.9 34.4
Source : OCDE.
3) La majorité des secteurs productifs subissent une baisse dans leurs chiffres de production, baisse qu'on observe aussi bien dans les secteurs dits « traditionnels » (chantiers navals, acier, textile, mines) que dans les secteurs de pointe (automobile, électronique, électro-ménager). Ainsi, par exemple, dans l'automobile, l'indice de production de 1987 est le même qu'en 1978.
4) Dans l'agriculture la situation est désastreuse :
- Les pays de l'Est et du tiers-monde se voient obligés pour la première fois depuis 1945 d'importer des aliments de première nécessité.
- Dans l'Union européenne, on décide de mettre en jachère 20 millions d'hectares.
5) Il est certain qu'il se produit un accroissement de l'industrie informatique, des télécommunications et des secteurs de l'électronique. Cependant, cette croissance ne compense pas la chute de l'industrie lourde et de l'agriculture.
6) Les phases de relance n'affectent désormais plus l'ensemble de l'économie mondiale. Elles sont plus courtes et s'accompagnent de phases de ralentissement (par exemple, entre 1987 et 1989) :
- les relances sont élevées aux Etats-Unis pendant la période 1983-85 mais, entre 1986-89, elles sont plus basses que la moyenne des années 1970 ;
- elles sont faibles (situation globale de demi ralentissement) dans tous les pays d'Europe occidentale, excepté l'Allemagne ;
- un grand nombre de pays du tiers-monde décrochent du train de la croissance et sombrent dans le marasme ;
- les pays de l'Est subissent un ralentissement quasi général pendant toute la décennie (à l'exception de la Hongrie et de la Tchécoslovaquie).
7) Le Japon et l'Allemagne parviennent à maintenir un niveau de croissance acceptable à partir de 1983. Cette croissance est supérieure à la moyenne et permet de substantiels excédents commerciaux qui en font de gros créditeurs financiers. Cependant, les indices de croissance ne sont pas aussi hauts que dans les décennies précédentes.
Moyenne de croissance annuelle du PIB du Japon
1960-70 8,7%
1970-80 5,9%
1980-90 3,7%
Source : OCDE
8) Les prix des matières premières connaissent une chute tout au long de la décennie (sauf dans la période 1987-88). Cela permet aux pays industrialisés d'alléger les tensions inflationniste sous-jacentes au prix de la plongée progressive des pays du « tiers-monde » (producteurs de matières premières) dans un marasme total.
9) La production d'armements connaît l'accroissement le plus important de l'histoire : entre 1980 et 1988 elle augmente de 41 % aux Etats-Unis selon les chiffres officiels. Cette augmentation suppose, comme cela a déjà été mis en évidence par la Gauche communiste, un affaiblissement à terme de l'économie. Cela se vérifie pour le capital américain : en même temps que croît sa part dans la production mondiale d'armements, la part de ses exportations dans le commerce mondial de secteurs clé décroît. C'est ce que montre le tableau ci-dessous.
Pourcentage des exportations des Etats-Unis dans le commerce mondial
1980 1987
Machines-outils 12,7% 9%
Automobiles 11,5% 9,4%
Informatique 31% 22%
10) L'endettement connaît une explosion brutale aussi bien quantitative que qualitative.
Au niveau quantitatif,
- il augmente de façon incontrôlé dans les pays du « tiers-monde ».
Dette en millions de dollars des pays sous-développés
1980 580.000
1985 950.000
1988 1.320.000
Source : Banque Mondiale
- il monte en flèche de façon spectaculaire aux Etats-Unis.
Dette totale en millions de dollars des Etats-Unis
1970 450.000
1980 1.069.000
1988 5.000.000
Source : OCDE
- il cependant modéré au Japon et en Allemagne.
Au niveau qualitatif :
- les Etats-Unis deviennent un pays débiteur en 1985 après avoir été, dans les années 1970, un pays créditeur ;
- en 1988, les Etats-Unis deviennent le pays le plus endetté de la planète non seulement de manière quantitative mais aussi qualitative ; ainsi, à cette date, alors que la dette extérieure du Mexique représente 9 mois de son PNB et celle du Brésil 6 mois, celle des Etats-Unis en représente 2 ans !
- le poids du remboursement des intérêts de prêts atteint dans les pays industrialisés une moyenne de 19 % du budget de l'Etat.
11) L'appareil financier, jusqu'alors relativement stable et sain, commence à subir, à partir de 1987, des turbulences chaque fois plus sérieuses :
- Faillites bancaires significatives : la plus importante est celle des caisses d'épargne américaines en 1988 avec un trou de 500 000 millions de dollars.
- Commence une succession de krachs boursiers périodiques à partir de 1987 : en 1989 il y aura un autre krach même si ses effets seront affaiblis du fait des mesures étatiques de suspension immédiate des cotations lorsqu'elles passent au dessus de 10 %.
- La spéculation monte en flèche de manière spectaculaire. Au Japon, par exemple, la spéculation immobilière démesurée provoque un krach en 1989 dont les conséquences continuent à se faire sentir depuis.
Situation de la classe ouvrière :
1) Nous assistons à la plus importante vague de licenciements depuis 1945. Le chômage monte en flèche dans les pays industrialisés.
Nombre de chômeurs dans les 24 pays de l'OCDE
1979 18.000.000
1989 30.000.000
Source : OCDE
2) Dans les pays industrialisés, à partir de 1984, la tendance au sous-emploi apparaît (travail à temps partiel, intermittent, précaire) alors que le sous-emploi se généralise dans les pays du « tiers-monde ».
3) A partir de 1985, les gouvernements des pays industrialisés adoptent des mesures qui favorisent les contrats à durée déterminée sous prétexte de « lutte contre le chômage », de telle manière qu'en 1990 ceux-ci représentent 8 % du personnel dans les pays de l'OCDE. Le travail fixe commence à diminuer.
4) Les salaires augmentent nominalement de façon très faible (moyenne de 3 % dans les pays de l'OCDE entre 1980-88) ce qui ne parvient pas à compenser l'inflation malgré le niveau très bas de celle-ci.
5) Les prestations sociales (aides, système de Sécurité sociale, subventions au logement, à la santé et à l'enseignement) connaissent les premières coupes importantes.
La dégradation des conditions de vie de la classe ouvrière est dramatique dans les pays « sous-développés » et forte dans les pays industrialisés. Dans ces derniers, elle n'est pas douce et lente comme dans la décennie précédente bien que les gouvernements, afin d'éviter une riposte unifiée de la part de la classe ouvrière, font tout pour étaler les attaques, évitant autant que possible qu'elles soient trop brusques et généralisées.
Cependant, pour la première fois depuis 1945, le capitalisme est incapable d'augmenter la force de travail totale : le nombre de salariés augmente à un rythme inférieur à celui de la population mondiale. En 1990, l'Organisation internationale du travail avance un chiffre de 800 millions de chômeurs. C'est un indicateur très clair de l'aggravation provoquée par la crise du capitalisme et le démenti le plus catégorique aux discours mensonger de la bourgeoisie sur la reprise de l'économie.
Adalen.
[1] [3694] Voir revue Internationale n°11, « De la crise à l’économie de guerre », rapport sur la situation économique mondiale du 2° congrès.
[2] [3695] La décénnie s’est terminée avec l’invasion russe de l’Afghanistan qui provoqua une guerre importante et devastratrice.
[3] [3696] Revue Internationale n°26, « Résolution sur la crise ».
[4] [3697] « Tout pays doit avoir un fond de réserve, aussi bien pour son commerce extérieur que pour sa circulation intérieure. Les fonctions
de ces réserves obeissent en partie à la fonction de l’argent comme moyen intérieur de circulation et de paiement, et en partie à sa fonction comme monnaie universelle. » (Marx, Le Capital, Livre I, Section 1, chapitre 3). Marxspécifie plus loin que : « les pays dans lesquels la production a atteint un haut degrès de développement limitent les trésors accumulés dans les banques au minimum que ses fonctions spécifique réclament. »
[5] [3698] Rapport sur la crise au 8° congrès du CCI.
Questions théoriques:
- L'économie [86]
Heritage de la Gauche Communiste:
Le communisme n'est pas un bel idéal, il est à l'ordre du jour de l'histoire [7° partie]
- 3256 reads
1920 : LE PROGRAMME DU K.A.P.D
Introduction
Avec la publication du programme du Parti communiste ouvrier d'Allemagne de 1920 (KAPD), nous terminons la partie de cette série consacrée aux programmes des partis communistes qui sont nés à l'apogée de la vague révolutionnaire (voir Revue internationale n° 93, "Le programme du KPD" ; n° 94, "La plate-forme de l'Internationale communiste" ; n° 95, "Le programme du parti communiste russe").
Nous avons traité par ailleurs l'arrière-plan historique de la formation du KAPD (voir la série d'articles sur la révolution allemande, en particulier dans la Revue internationale n° 89). La scission dans le jeune KPD a été sur beaucoup d'aspects une tragédie pour le développement de la révolution prolétarienne, mais ce n'est pas le lieu ici d'en analyser les causes et les conséquences. Notre but, en publiant le programme du KAPD, est de montrer le degré de clarté révolutionnaire que ce document représente, puisqu'il n'y a pas de doute que pratiquement toutes les meilleures forces du communisme en Allemagne rejoignirent le KAPD.
Selon la fable gauchiste (basée sur les conceptions, malheureusement fausses, adoptées par l'Internationale communiste après 1920), le KAPD a été la manifestation d'un courant insignifiant, sectaire, semi-anarchiste, qui a été liquidé une fois pour toutes par la publication du livre de Lénine Le gauchisme, maladie infantile du communisme. En fait, comme nous l'avons aussi montré par ailleurs (en particulier dans notre introduction à la plate-forme de l'IC), au plus haut de la vague révolutionnaire les positions de la gauche ont été dans une grande mesure dominantes à la fois dans le KPD et dans l'IC elle-même. Il est vrai que, à partir de 1920, au sein de l'IC et des partis qui la composaient, les premiers effets de la stagnation de la révolution mondiale et de l'isolement de la Russie soviétique ont commencé à se faire sentir, donnant naissance à une réaction conservatrice qui allait de plus en plus placer la gauche en situation d'opposition. Mais même comme opposition, les communistes de gauche étaient loin d'être une secte infantile ou anarchiste. En effet, ce qui ressort plus que tout autre chose de ce programme est combien les positions caractéristiques du KAPD (le rejet des tactiques parlementaire et syndicale qui seront bientôt adoptées par l'IC) se sont fondées sur une véritable assimilation de la conception marxiste de la décadence du capitalisme qui est affirmée dans le paragraphe introductif du même programme. Cette conception avait été affirmée avec une égale insistance au congrès de fondation de l'IC, mais l'Internationale comme un tout allait ensuite se montrer incapable d'en tirer toutes les implications au niveau programmatique.
La position du KAPD sur le parlement et les syndicats n'avait rien de commun avec le moralisme et le rejet de la politique préconisés par les anarchistes puisque, comme le porte-parole du KAPD Appel (Hempel) l'argumenta au 3e congrès de l'IC en 1921, elle était basée sur la reconnaissance que la participation au parlement et aux syndicats avait bien sûr été une tactique valable dans la période ascendante du capitalisme mais qu'elle était devenue obsolète dans la nouvelle période de déclin du capitalisme. En particulier, le programme montre que la gauche allemande avait déjà établi les bases théoriques pour expliquer comment les syndicats sont devenus "un des principaux piliers de l'Etat capitaliste."
L'accusation de sectarisme a aussi été portée à propos de ce que le KAPD mettait en avant comme alternative aux syndicats. Dans sa Maladie infantile, par exemple, Lénine accuse le KAPD de tenter de remplacer les organisations syndicales de masse existantes par des "syndicats révolutionnaires purs" [vérifier la citation]. En fait la méthode du KAPD était dans sa quintessence la méthode marxiste, consistant notamment à faire le lien avec le mouvement réel de la classe. Comme Hempel le pose au 3e congrès :"... comme communistes, comme gens qui veulent et doivent prendre la direction de la révolution, nous sommes obligés d'examiner l'organisation du prolétariat sous cet angle. Ce que nous, le KAPD, disons n'est pas né, comme le croit le camarade Radek, dans la tête et dans le [crucible] du camarade Gorter en Hollande, mais à travers l'expérience des luttes que nous avons menées depuis 1919." (La gauche allemande, Invariance, 1973, p.32) C'est, en effet, le mouvement réel de la classe qui a donné naissance aux conseils ouvriers ou soviets dans la première explosion de la révolution, et cela en s'opposant directement à la fois au parlementarisme et au syndicalisme. Après la dissolution ou la récupération par la bourgeoisie des conseils ouvriers qui avaient surgi en Allemagne, les luttes les plus combatives ont donné naissance aux "organisations d'usine" auxquelles il est fait référence en partie dans le programme. Il est vrai que l'insistance sur ces organisations sur les lieux de travail, plus locales, plutôt que sur les soviets centralisés était le résultat du caractère défensif de la dynamique dans laquelle la classe était entraînée. Ne comprenant pas vraiment ce qui se passait, le KAPD tendait à développer une vision fausse selon laquelle les organisations d'usine, regroupées en "Unionen", pourraient exister un peu comme des noyaux permanents des conseils du futur. Mais, parce qu'à l'époque du programme, les "Unionen" regroupaient plus de 100 000 militants ouvriers, elles n'étaient en rien une construction artificielle du KAPD.
Une autre accusation fréquemment portée au KAPD était qu'il était "antiparti". Cette formulation déforme complètement la réalité complexe du mouvement révolutionnaire allemand de l'époque. Dans une certaine mesure, le KAPD exprimait réellement un haut degré dans la clarification du rôle du parti communiste. Nous avons déjà publié les "Thèses sur le rôle du parti" du KAPD (Revue internationale n° 41, 2e trimestre 1985), qui avait été fondé sur la reconnaissance (héritée en grande partie de l'expérience bolchevik) qu'à l'époque de la révolution le parti ne pouvait pas être une organisation de "masse" mais était une minorité avancée programmatiquement dont la tâche essentielle était, par sa participation déterminée dans la lutte de classe, d'élever la "conscience de soi du prolétariat" ainsi que le programme l'affirme. Celui-ci contient aussi les premièrs éléments critiques de l'idée que la dictature du prolétariat est exercée par le parti. C'est une conception (ou plutôt une pratique, puisqu'elle n'a été théorisée que plus tard) qui devait avoir des conséquences désastreuses pour les bolcheviks en Russie.
Il n'y a pas de doute cependant qu'il y avait d'autres tendances dans le KAPD à l'époque et que certaines d'entre elles, en particulier le courant "conseilliste" autour de Otto Ruhle, étaient à l'évidence influencées par l'anarchisme. La rançon payée à ce courant est reflétée dans la préface du programme qui contient la notion fédéraliste et même individualiste selon laquelle "l'autonomie des membres dans toutes les circonstances est le principe de base du parti prolétarien, qui n'est pas un parti dans le sens traditionnel." Parce que le KAPD avait été dans une large mesure contraint de sortir du KPD à cause des manoeuvres de la clique irresponsable autour de Paul Levi, cette réaction contre les "chefs" incontrôlés et la politicaillerie bourgeoise était compréhensible. Mais elle exprimait aussi une faiblesse sur la question d'organisation qui, avec le reflux ultérieur de la révolution, allait avoir des conséquences désastreuses pour la survie de la gauche allemande.
La tendance "conseilliste" exprimait aussi une tendance à rompre la solidarité avec la révolution russe alors que celle-ci connaissait des conditions difficiles imposées par l'isolement et la guerre civile. Cette tendance se manifestera plus tard par un rejet ouvert de toute l'expérience russe comme n'étant rien de plus qu'une révolution bourgeoise tardive. Mais sur ce point il n'y avait pas du tout d'ambiguïté dans le programme : la solidarité avec le pouvoir soviétique assiégé est explicite dès le début; et la victoire de la révolution en Allemagne est également très clairement perçue comme la clé de la victoire de la révolution mondiale, donc du salut du bastion révolutionnaire en Russie.
Une comparaison avec les "mesures pratiques" contenues dans le programme du KPD de 1918 montre une grande similarité avec celles du programme du KAPD, ce qui ne devrait pas être une surprise. Ce dernier est cependant plus clair sur les tâches internationales de la révolution allemande. Il va également plus loin sur la question du contenu économique de la révolution, insistant sur la nécessité de prendre des mesures immédiates d'orientation de la production vers les besoins plutôt que vers l'accumulation (même si la possibilité d'une telle transformation rapide est discutable, tout comme la conception du programme selon laquelle un "bloc économique socialiste" formé avec la seule Russie pourrait faire des pas significatifs vers le communisme). Finalement, le programme soulève quelques "nouvelles" questions qui n'étaient pas traitées dans le programme de 1918, telles que l'approche de la révolution prolétarienne de l'art, de la science, de l'éducation et de la jeunesse. La préoccupation du KAPD pour ces questions est aussi intéressante parce qu'elle montre que ce dernier n'était pas (comme il a été souvent argumenté) un courant purement "ouvriériste", aveugle aux problèmes plus généraux posés par la transformation communiste de la vie sociale.
CDW
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Allemande [1955]
Conscience et organisation:
Approfondir:
Questions théoriques:
- Communisme [492]
Heritage de la Gauche Communiste:
Programme du "Parti Communiste Ouvrier d'Allemagne" (KAPD) Mai 1920
- 3550 reads
C'est dans le tourbillon de la révolution et de la contre‑révolution que s'est accomplie la fondation du Parti Communiste Ouvrier d'Allemagne. Mais la naissance du nouveau parti ne date pas de Pâques 1920, moment où le rassemblement de l'“opposition”, qui n'était unie jusqu'ici que par des contacts vagues, trouva sa conclusion organisationnelle. L'heure de la naissance du KAPD coïncide avec la phase de développement du KPD (Ligue Spartacus), au cours de laquelle une clique de chefs irresponsables, plaçant ses intérêts personnels au‑dessus des intérêts de la révolution prolétarienne, a entrepris d'imposer sa conception personnelle de la “mort” de la révolution allemande à la majorité du parti. Celui‑ci se dressa alors énergiquement contre cette conception personnellement intéressée. Le KAPD est né lorsque cette clique, se fondant sur cette conception personnelle qu'elle avait élaborée, voulut transformer la tactique du parti, jusqu'ici révolutionnaire, en une tactique réformiste. Cette attitude traîtresse des Lévi, Posner et Compagnie justifie une nouvelle fois la reconnaissance du fait que l'élimination radicale de toute politique de chefs doit constituer la première condition du progrès impétueux de la révolution prolétarienne en Allemagne. C'est en réalité la racine des oppositions qui sont apparues entre nous et la Ligue Spartacus, oppositions d'une telle profondeur que la faille qui nous sépare de la Ligue [= du KPD], est plus grande que l'opposition qui existe entre les Lévi, les Pieck, les Thalheimer etc. d'un côté et les Hilferding, les Crispien, les Stampfer, les Legien de l'autre ([1] [3699]). L'idée qu'il faut faire de la volonté révolutionnaire des masses le facteur prépondérant dans les prises de position tactiques d'une organisation réellement prolétarienne, est le leitmotiv de la construction organisationnelle de notre parti. Exprimer l’autonomie des membres dans toutes les circonstances, c'est le principe de base d'un parti prolétarien, qui n'est pas un parti dans le sens traditionnel.
Il est donc pour nous évident que le programme du parti, que nous transmettons ici à nos organisations et qui a été rédigé par la commission du programme mandatée par le congrès, doit rester projet de programme jusqu'à ce que le prochain congrès ordinaire se déclare d'accord avec la présente version ([2] [3700]). Du reste des propositions d'amendements, qui concerneraient les prises de position fondamentales et tactiques du parti, sont à peine probables, dans la mesure où le programme ne fait que formuler fidèlement, dans un cadre plus large, le contenu de la déclaration programmatique adoptée à l'unanimité par le congrès du parti. Mais d'éventuels amendements formels ne changeront rien à l'esprit révolutionnaire qui anime chaque ligne du programme. La reconnaissance marxiste de la nécessité historique de la dictature du prolétariat reste pour nous un guide immuable; inébranlable reste notre volonté de mener le combat pour le socialisme dans l'esprit de la lutte de classe internationale. Sous ce drapeau, la victoire de la révolution prolétarienne est assurée.
Berlin. Mi‑mai 1920.
La crise économique mondiale, née de la guerre mondiale, avec ses effets économiques et sociaux monstrueux, et dont l'image d'ensemble produit l'impression foudroyante d'un unique champ de ruines aux dimensions colossales, ne signifie qu'une seule chose : le crépuscule des dieux de l'ordre mondial bourgeois capitaliste est entamé. Aujourd'hui il ne s'agit pas d'une des crises économiques périodiques, propres au mode de production capitaliste ; c'est la crise du capitalisme lui‑même; secousses convulsives de l'ensemble de l'organisme social, éclatement formidable d'antagonismes de classes d'une acuité jamais vue, misère générale pour de larges couches populaires, tout cela est un avertissement fatidique à la société bourgeoise. Il apparaît de plus en plus clairement que l'opposition entre exploiteurs et exploités qui s’accroît encore de jour en jour, que la contradiction entre capital et travail, dont prennent de plus en plus conscience même les couches jusque là indifférentes du prolétariat, ne peut être résolue. Le capitalisme a fait l'expérience de son fiasco définitif, il s'est lui‑même historiquement réduit à néant dans la guerre de brigandage impérialiste, il a créé un chaos, dont la prolongation insupportable place le prolétariat devant l'alternative historique: rechute dans la barbarie ou construction d'un monde socialiste.
De tous les peuples de la terre seul le prolétariat russe jusqu'ici réussi dans des combats titanesques à renverser la domination de sa classe capitaliste et à s'emparer du pouvoir politique. Dans une résistance héroïque il a repoussé l'attaque concentrée de l'armée de mercenaires organisée par le capital international et il se voit maintenant confronté à une tâche qui dépasse l’entendement par sa difficulté: reconstruire, sur une base socialiste, l'économie totalement détruite par la guerre mondiale et la guerre civile qui lui a succédé pendant plus de deux ans. Le destin de la république des conseils russes dépend du développement de la révolution prolétarienne en Allemagne. Après la victoire de la révolution allemande on se trouvera en présence d'un bloc économique socialiste qui, au moyen de l'échange réciproque des produits de l'industrie et de l'agriculture, sera en mesure d'établir un mode de production véritablement socialiste, en n'étant plus obligé de faire des concessions économiques, et par la aussi politiques, au capital mondial. Si le prolétariat allemand ne remplit pas à très court terme sa tâche historique, le développement de la révolution mondiale sera remis en question pour des années, si ce n'est des dizaines d'années. En fait c'est l'Allemagne qui est aujourd'hui la clef de la révolution mondiale. La révolution dans les pays “vainqueurs” de l'Entente ne peut se mettre en branle, que lorsqu'aura été levée la grande barrière en Europe Centrale. Les conditions économiques de la révolution prolétarienne sont logiquement incomparablement plus favorables en Allemagne que dans les pays “vainqueurs” de l'Europe Occidentale. L'économie allemande pillée impitoyablement après la signature de la paix de Versailles a fait mûrir une paupérisation qui pousse à bref délai à la solution violente d'une situation catastrophique. En outre la paix de brigands versaillaise n'aboutit pas seulement à peser au‑delà de toute mesure sur un mode de production capitaliste en Allemagne, mais elle pose au prolétariat des fers qu'il ne peut supporter: son aspect le plus dangereux, c'est qu'elle sape les fondements économiques de la future économie socialiste en Allemagne, et donc, dans ce sens, également, remet en question le développement de la révolution mondiale. Seule une poussée en avant impétueuse de la révolution prolétarienne allemande peut nous sortir de ce dilemme. La situation économique et politique en Allemagne est plus que mûre pour l'éclatement de la révolution prolétarienne. A ce stade de l'évolution historique, où le processus de décomposition du capitalisme ne peut être voilé artificiellement que par un spectacle de positions de forces apparentes, tout doit tendre à aider le prolétariat a acquérir la conscience qu'il n'a besoin que d'une intervention énergique pour user efficacement du pouvoir qu'il possède déjà effectivement. A une époque de la lutte de classe révolutionnaire comme celle‑ci, où la dernière phase de la lutte entre le capital et le travail est entamée et où le combat décisif lui‑même est déjà en train, il ne peut être question de compromis avec l'ennemi mortel, mais d'un combat jusqu'à l’anéantissement. En particulier il faut attaquer les institutions qui tendent à jeter un pont au‑dessus des antagonismes de classes et qui s'orientent ainsi vers une sorte de “communauté de travail” ([3] [3701]) politique ou économique entre exploiteurs et exploités. Au moment où les conditions objectives de l'éclatement de la révolution prolétarienne sont données, sans que la crise permanente ne connaisse une aggravation définitive, ou bien au moment où une aggravation catastrophique se produit, sans qu'elle soit conçue et exploitée jusque dans ses dernières conséquences par le prolétariat, il doit y avoir des raisons de nature subjective pour freiner le progrès accéléré de la révolution. Autrement dit : l'idéologie du prolétariat se trouve encore en partie prisonnière de représentations bourgeoises ou petites‑bourgeoises. La psychologie du prolétariat allemand, dans son aspect présent, ne montre que trop distinctement les traces de l'esclavage militariste séculaire, avec en plus les signes caractéristiques d'un manque de conscience de soi; c'est le produit naturel du crétinisme parlementaire de la vieille social‑démocratie et de I'USPD d'un côté, de l'absolutisme de la bureaucratie syndicale de l'autre. Les éléments subjectifs jouent un rôle décisif dans la révolution allemande. Le problème de la révolution allemande est le problème du développement de la conscience de soi du prolétariat allemand.
Reconnaissant cette situation ainsi que la nécessité d'accélérer le rythme du développement de la révolution dans le monde, fidèle également à l'esprit de la 3ème Internationale, le KAPD combat pour la revendication maximale de l’abolition immédiate de la démocratie bourgeoise et pour la dictature de la classe ouvrière. Il rejette dans la constitution démocratique le principe, doublement absurde et intenable dans la période actuelle, qui veut concéder à la classe capitaliste exploiteuse elle - aussi des droits politiques et le pouvoir de disposer exclusivement des moyens de production.
Conformément à ses vues maximalistes le KAPD se déclare également pour le rejet de toutes les méthodes de lutte réformistes et opportunistes, dans lesquelles il ne voit qu'une manière d'esquiver les luttes sérieuses et décisives avec la classe bourgeoise. Il ne veut pas esquiver ces luttes, au contraire, il les provoque. Dans un Etat qui porte tous les symptômes de la période de décadence du capitalisme, la participation au parlementarisme appartient aussi aux méthodes réformistes et opportunistes. Exhorter, dans une telle période, le prolétariat à participer aux élections au parlement, cela signifie réveiller et nourrir chez lui l'illusion dangereuse que la crise pourrait être dépassée par des moyens parlementaires; c'est appliquer un moyen utilisé autrefois par la bourgeoisie dans sa lutte de classe, alors que l'on est dans une situation où seuls des moyens de lutte de classe prolétariens, appliqués de manière résolue et sans ménagements, peuvent avoir une efficacité décisive. La participation au parlementarisme bourgeois, en pleine progression de la révolution prolétarienne, ne signifie également en fin de compte rien d'autre que le sabotage de l'idée des conseils.
L'idée des conseils dans la période de la lutte prolétarienne pour le pouvoir politique est au centre du processus révolutionnaire. L'écho plus ou moins fort que l'idée des conseils suscite dans la conscience des masses est le thermomètre qui permet de mesurer le développement de la révolution sociale. La lutte pour la reconnaissance de conseils d'entreprise révolutionnaires et de conseils ouvriers politiques dans le cadre d'une situation révolutionnaire déterminée naît logiquement de la lutte pour la dictature du prolétariat contre la dictature du capitalisme. Cette lutte révolutionnaire, dont l'axe politique spécifique est constitué par l'idée des conseils, s'oriente, sous la pression de la nécessité historique, contre la totalité de l'ordre social bourgeois et donc aussi contre sa forme politique, le parlementarisme bourgeois. Système des conseils ou parlementarisme ? C'est une question d'importance historique. Edification d'un monde communiste prolétarien ou naufrage dans le marais de l'anarchie capitaliste bourgeoise ? Dans une situation aussi totalement révolutionnaire que la situation actuelle en Allemagne, la participation an parlementarisme signifie donc non seulement saboter l'idée des conseils, mais aussi par surcroît galvaniser le monde capitaliste bourgeois en putréfaction et par là, de manière plus ou moins voulue, ralentir le cours de la révolution prolétarienne.
A côté du parlementarisme bourgeois les syndicats forment le principal rempart contre le développement ultérieur de la révolution prolétarienne en Allemagne. Leur attitude pendant la guerre mondiale est connue. Leur influence décisive sur l'orientation principielle et tactique du vieux parti social‑démocrate conduisit à la proclamation de l'“union sacrée” avec la bourgeoisie allemande, ce qui équivalait à une déclaration de guerre au prolétariat international. Leur efficacité social-traître trouva sa continuation logique lors de l'éclatement de la révolution de novembre 1918 en Allemagne: ils attestèrent leurs intentions contre‑révolutionnaires en constituant avec les industriels allemands en pleine crise une “communauté de travail” (Arbeitsgemeinschaff) pour la paix sociale. Ils ont conservé leur tendance contre‑révolutionnaire jusqu'à aujourd'hui, pendant toute la période de la révolution allemande. C'est la bureaucratie des syndicats qui s'est opposée avec le plus de violence à l'idée des conseils qui s'enracinait de plus en plus profondément dans la classe ouvrière allemande, c'est elle qui a trouvé les moyens de paralyser avec succès des tendances politiques visant à la prise du pouvoir par le prolétariat, tendances qui résultaient logiquement des actions de masses économiques. Le caractère contre‑révolutionnaires des organisations syndicales est si notoire que de nombreux patrons en Allemagne n'embauchent que les ouvriers appartenant à un groupement syndical. Cela dévoile au monde entier que la bureaucratie syndicale prendra une part active au maintien futur du système capitaliste qui craque par toutes ses jointures. Les syndicats sont ainsi, à côté des fondements bourgeois, l'un des principaux piliers de l'Etat capitaliste. L'histoire syndicale de ces derniers 18 mois a amplement démontré que cette formation contre-révolutionnaire ne peut être transformée de l'intérieur. La révolutionnarisation des syndicats n'est pas une question de personnes : le caractère contre-révolutionnaire de ces organisations se trouve dans leur structure et dans leur système spécifique eux-mêmes. De ce fait découle la conclusion logique que seule la destruction même des syndicats peut libérer le chemin de la révolution sociale en Allemagne. L'édification socialiste a besoin d'autre chose que de ces organisations fossiles.
C'est dans les luttes de masses qu'est apparue l'organisation d'entreprise. Elle fait surface comme quelque chose qui n'a jamais eu ne serait-ce qu'un équivalent, mais là n'est pas la nouveauté. Ce qui est nouveau, c'est qu'elle perce partout pendant la révolution, comme une arme nécessaire de la lutte de classe contre le vieil esprit et le vieux fondement qui lui est à la base. Elle correspond à l'idée des conseils ; c'est pourquoi elle n'est absolument pas une pure forme oui un nouveau jeu organisationnel, ou même une “belle nuit mystique”; naissant organiquement dans le futur, constituant le futur elle est la forme d'expression d'une révolution sociale qui tend à la société sans classes. C'est une organisation de lutte prolétarienne pure. Le prolétariat ne peut pas être organisé pour le renversement sans merci de la vieille société s'il est déchiré en métiers, à l'écart de son terrain de lutte; pour cela il faut que la lutte soit menée dans l'entreprise. C'est là que l'on est l'un à côté de l'autre comme camarades de classe, c'est là que tous sont forcés d'être égaux en droit. C'est là que la masse est le moteur de la production et qu'elle est poussée sans arrêt à pénétrer son secret et à le diriger elle-même.
C'est là que la lutte idéologique, la révolutionnarisation de la conscience se fait dans un tumulte permanent, d'homme à homme, de masse à masse. Tout est orienté vers l'intérêt de classe suprême, non vers la manie de fonder des organisations, et l'intérêt de métier est réduit à la mesure qui lui revient. Une telle organisation, l'épine dorsale des conseils d'entreprise, devient un instrument infiniment plus souple de la lutte de classe, un organisme au sang toujours frais, vue la possibilité permanente de réélections, de révocations etc. Poussant dans les actions de masse et avec elles, l'organisation d'entreprise devra naturellement se créer l'organisme central qui correspond à son développement révolutionnaire. Son affaire principale sera le développement de la révolution et non pas les programmes, les statuts et les plans dans les détails. Elle n'est pas une caisse de soutien ou une assurance sur la vie, même si ‑ cela va de soi ‑ elle ne craint pas de faire des collectes pour le cas où il serait nécessaire de soutenir des grèves. Propagande ininterrompue pour le socialisme, assemblées d'entreprise, discussions politiques etc. tout cela fait partie de ses tâches; bref, c'est la révolution dans l'entreprise.
En gros, le but de l'organisation d'entreprise est double. Le premier but, c'est de détruire les syndicats, la totalité de leurs bases et l'ensemble des idées non prolétariennes qui sont concentrées en eux. Aucun doute bien sûr que dans cette lutte l'organisation d'entreprise affrontera, comme ses ennemis acharnés, toutes les formations bourgeoises ; mais elle fera de même aussi avec les partisans de l’USPD et du KPD, soit que ceux-ci se meuvent encore inconsciemment dans les vieux schémas de la social-démocratie (même s'ils adoptent un programme politique différent, ils s'en tiennent au fond a une critique politico-morale des “erreurs” de la social-démocratie), soit qu'ils soient ouvertement des ennemis, dans la mesure où le trafic politique, l'art diplomatique de se tenir toujours “en haut” leur importe plus que la lutte gigantesque pour le “social” en général. Devant ces petites misères il n'y a aucun scrupule à avoir. Il ne peut y avoir aucun accord avec l’USPD ([4] [3702]) tant qu'elle ne reconnaît pas, sur la base de l'idée des conseils, la justification des organisations d'entreprises, lesquelles ont sûrement encore besoin de transformation et sont aussi encore capables d'être transformées. Une grande partie des masses les reconnaîtra avant l’USPD comme direction politique. C'est un bon signe. L'organisation d'entreprise, en déclenchant des grèves de masses et en transformant leur orientation politique, se basant chaque fois sur la situation politique de moment, contribuera d'autant plus rapidement et d'autant plus sûrement à démasquer et à anéantir le syndicat contre-révolutionnaire.
Le deuxième grand but de l’organisation d'entreprise est de préparer l'édification de la société communiste. Peut devenir membre de l'organisation d'entreprise tout ouvrier qui se déclare pour la dictature du prolétariat ([5] [3703]). En plus il faut rejeter résolument les syndicats, et être résolument libéré de leur orientation idéologique. Cette dernière condition devra être la pierre de touche pour être admis dans l'organisation d'entreprise. C'est par là que l'on manifeste son adhésion à la lutte de classe prolétarienne et à ses méthodes propres; on n'a pas à exiger l'adhésion à un programme de parti plus précis. De par sa nature et sa tendance l'organisation d'entreprise sert le communisme et conduit à la société communiste. Son noyau sera toujours expressément communiste, sa lutte pousse tout le monde dans la même direction. Mais alors qu'un programme de parti sert et doit servir en majeure partie à l'actualité (au sens large, naturellement), alors que des qualités intellectuelles sérieuses sont exigées chez les membres du parti et qu'un parti politique comme le Parti Communiste Ouvrier (KAPD), progressant en avant et se modifiant rapidement en liaison avec le processus révolutionnaire mondial, ne peut jamais avoir une grande importance quantitative (à moins qu'il ne régresse et se corrompe), les masses révolutionnaires, au contraire, sont unies dans les organisations d'entreprises par la conscience de leur solidarité de classe, la conscience d'appartenir au prolétariat. C'est là que se prépare organiquement l'union du prolétariat; alors que sur la base d'un programme de parti cette union n'est jamais possible. L'organisation d'entreprise est le début de la forme communiste et devient le fondement de la société communiste à venir.
L'organisation d'entreprise résout ses tâches en union étroite avec le KAPD (Parti Communiste Ouvrier).
L'organisation politique a comme tâche de rassembler les éléments avancés de la classe ouvrière sur la base du programme du parti.
Le rapport du parti à l'organisation d'entreprise résulte de la nature de l'organisation d'entreprise. Le travail du KAPD à l'intérieur de ces organisations sera celui d'une propagande inlassable. Il faudra décider des mots d'ordre de la lutte. Les cadres révolutionnaires dans l'entreprise deviennent l'arme mobile du parti. De plus il est naturellement nécessaire que le parti lui aussi prenne un caractère toujours plus prolétarien, une expression de classe prolétarienne, qu'il satisfasse à la dictature par en bas. Par la le cercle de ses tâches s'élargit, mais en même temps il acquiert le plus puissant des soutiens. Ce qui doit être obtenu, c'est que la victoire (la prise du pouvoir par le prolétariat) aboutisse à la dictature de la classe et non pas à la dictature de quelques chefs de parti et de leur clique. L'organisation d'entreprise en est la garantie.
La phase de la prise du pouvoir politique par le prolétariat exige la répression la plus acharnée des mouvements capitalistes bourgeois. Cela sera atteint par la mise en place d'une organisation de conseils exerçant la totalité du pouvoir politique et économique. L'organisation d'entreprise elle-même devient dans cette phase un élément de la dictature prolétarienne, exercée dans l'entreprise par le conseil d'entreprise ayant pour base l'organisation d'entreprise. Celle-ci a en outre pour tâche dans cette phase de tendre à se transformer en fondement du système économique des conseils.
L'organisation d'entreprise est une condition économique de la construction de la communauté (Gemeinwesen) communiste. La forme politique de l'organisation de la communauté communiste est le système des conseils. L'organisation d'entreprise intervient pour que le pouvoir politique ne soit exercé que par l'exécutif des conseils.
Le KAPD lutte donc pour la réalisation du programme révolutionnaire maximum, dont les revendications concrètes sont contenues dans les points suivants :
1. Domaine politique :
1. Fusion politique et économique immédiate avec tous les pays prolétariens victorieux (Russie des Soviets, etc.), dans l'esprit de la lutte de classe internationale, dans le but de se défendre en commun contre les tendances agressives du capital mondial.
2 Armement de la classe ouvrière révolutionnaire politiquement organisée, mise en place de groupes de défense militaire locaux (Ortswehren), formation d'une armée rouge; désarmement de la bourgeoisie, de toute la police, de tous les officiers, des “groupes de défense des habitants” (einwohnerwehren) ([6] [3704]), etc.
3. Dissolution de tous les parlements ([7] [3705]) et de tous les conseils municipaux.
4. Formation de conseils ouvriers comme organes du pouvoir législatif et exécutif. Election d'un conseil central des délégués des conseils ouvriers d'Allemagne.
5. Réunion d'un congrès des conseils allemands comme instance politique constituante suprême de l'Allemagne des Conseils.
6. Remise de la presse à la classe ouvrière sous la direction des conseils politiques locaux.
7. Destruction de l'appareil judiciaire bourgeois et installation immédiate de tribunaux révolutionnaires. Prise en charge de la puissance pénitentiaire bourgeoise et des services de sécurité par des organes prolétariens adéquats.
2. Domaine économique, social et culturel.
1. Annulation des dettes d'Etat et des autres dettes publiques, annulation des emprunts de guerre ([8] [3706]).
2. Expropriation par la république des conseils de toutes les banques, mines, fonderies, de même que des grandes entreprises dans l'industrie et le commerce.
3. Confiscation de toutes les richesses à partir d'un certain seuil qui doit être fixé par le conseil central des conseils ouvriers d'Allemagne.
4. Transformation de la propriété foncière privée en propriété collective sous la direction des conseils locaux et des conseils agraires (Gutsrüte) compétents.
5. Prise en charge de tous les transports publics par la république des conseils.
6. Régulation et direction centrale de la totalité de la production par les conseils économiques supérieurs qui doivent être investis par le congrès des conseils économiques.
7. Adaptation de l'ensemble de la production aux besoins, sur la base des calculs économiques statistiques les plus minutieux.
8. Mise en vigueur impitoyable de l'obligation au travail.
9. Garantie de l'existence individuelle relativement à la nourriture, l'habillement, le logement, la vieillesse, la maladie, l'invalidité, etc.
10. Abolition de toutes les différences de castes, des décorations et des titres. Egalité juridique et sociale complète des sexes.
11. Transformation radicale immédiate du ravitaillement, du logement et de la santé dans l'intérêt de la population prolétarienne.
12. En même temps que le KAPD déclare la guerre la plus résolue au mode de production capitaliste et à l'Etat bourgeois, il dirige son attaque contre la totalité de l'idéologie bourgeoise et se fait le pionnier d'une conception du monde prolétarienne révolutionnaire. Un facteur essentiel de l'accélération de la révolution sociale réside dans la révolutionnarisation de tout l'univers intellectuel du prolétariat. Conscient de ce fait. le KAPD soutient toutes les tendances révolutionnaires dans les sciences et les arts, dont le caractère correspond à l’esprit de la révolution prolétarienne.
En particulier le KAPD encourage toutes les entreprises sérieusement révolutionnaires qui permettent à la jeunesse des deux sexes de s'exprimer elle‑même. Le KAPD rejette toute domination de la jeunesse.
La lutte politique contraindra la jeunesse elle-même à un développement supérieur de ses forces, ce qui nous donne la certitude qu'elle accomplira ses grandes tâches avec une clarté et une résolution totales.
Dans l'intérêt de la révolution, c'est un devoir du KAPD que la jeunesse obtienne dans sa lutte tout le soutien possible.
Le KAPD est conscient qu'également après la conquête du pouvoir politique par le prolétariat, un grand domaine d'activité revient à la jeunesse dans la construction de la société communiste : la défense de la république des conseils par l'armée rouge, la transformation du processus de production, la création de l'école du travail communiste qui résout ses taches créatrices en union étroite avec l'entreprise.
Voilà le programme du Parti Communiste Ouvrier D'Allemagne. Fidèle à l'esprit de la Troisième Internationale, le KAPD reste attaché à l'idée des fondateurs du socialisme scientifique, selon laquelle la conquête du pouvoir politique par le prolétariat signifie l'anéantissement du pouvoir politique de la bourgeoisie. Anéantir la totalité de l'appareil d'Etat bourgeois avec son armée capitaliste sous la direction d'officiers bourgeois et agraires, avec sa police, ses geôliers et ses juges, avec ses curés et ses bureaucrates ‑ voilà la première tâche de la révolution prolétarienne. Le prolétariat victorieux doit donc être cuirassé contre les coups de la contre‑révolution bourgeoise. Lorsqu'elle lui est imposée par la bourgeoisie, le prolétariat doit s'efforcer d'écraser la guerre civile avec une violence impitoyable. Le KAPD a conscience que la lutte finale entre le capital et le travail ne peut être trouver de solution à l'intérieur des frontières nationales. Aussi peu que le capitalisme s'arrête devant les frontières nationales et se laisse retenir par quelque scrupule national que ce soit dans sa razzia à travers le monde, aussi peu le prolétariat doit-il perdre des yeux, sous l'hypnose d'idéologies nationales, l'idée fondamentale de la solidarité internationale de classe. Plus l'idée de la lutte de classe internationale sera clairement conçue par le prolétariat, plus on mettra de conséquence à en faire le leitmotiv de la politique prolétarienne mondiale, et plus impétueux et massifs seront les coups de la révolution mondiale qui briseront en morceaux le capital mondial en décomposition. Bien au-dessus de toutes les particularités nationales, bien au-dessus de toutes les frontières, de toutes les patries brille pour le prolétariat, d'un rayonnement éternel, le fanal : PROLETAIRES DE TOUS LES PAYS, UNISSEZ‑VOUS.
Berlin. 1920.
[1] [3707]Dirigeants politiques et syndicalistes social‑démocrates.
[2] [3708] Ce qui fut fait effectivement au 2e Congrès du KAPD (dit “premier congrès ordinaire”) en août 1920.
[3] [3709] En allemand “Arbeitsgemeinschaft” (“communauté de travail”), du nom de l'accord signé en novembre 1918 entre syndicats et patronat allemands.
[4] [3710] Le KPD, dont venait de scissionner le KAPD, se ralliait en permanence aux mots d'ordre de l'USPD depuis la fin de 1919 et jusqu'à décembre 1920 (moment où le reste du KPD et la majorité de l'USPD fusionnent pour former la section allemande de la 3e Internationale ou VKPD).
Il est nécessaire de rappeler que pendant toute cette période les rapports entre les sigles organisationnels (KAPD - KPD - USPD - VKPD) cachent complètement les rapports politiques réels : le KAPD est la continuation directe du KPD révolutionnaire de l'année 1919 (la quasi totalité du KPD se constitue en KAPD). Ce que l'on appelle en 1920 le KPD, c'est juste la direction droitière du KPD, sans aucune base. Cette direction (Lévi) sans armée se fond fin 1920 dans la masse de l'aile gauche (c'est-à-dire la majorité) de l'USPD, laquelle forme l'essentiel, la majorité à 90 % du VKPD ou section allemande de l’IC. En termes de majorités on a: KPD ‑> KAPD, USPD ‑> VKPD. (cf. la présentation).
[5] [3711] Cf. programme de l’AAUD (l’ensemble des “organisations d'entreprises” constituant l’AAUD).
[6] [3712] . Organisations “fascistes” avant la lettre, analogues à des “Comités d'Action Civique”.
[7] [3713] Il y avait de nombreux parlements régionaux en Allemagne.
[8] [3714] Donc essentiellement à l'époque : refus d'appliquer le traité de Versailles, ce qui aurait été le prétexte à la reprise de la guerre entre les puissances réactionnaires de l'Entente et une Allemagne devenue révolutionnaire (cf. dans la présentation le passage sur la théorie du “National‑bolchévisme”).
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Allemande [1955]
Conscience et organisation:
Heritage de la Gauche Communiste:
- La Révolution prolétarienne [1149]
Révolution allemande (XI)
- 3469 reads
LA GAUCHE COMMUNISTE ET LE CONFLIT CROISSANT ENTRE L'ETAT RUSSE ET LES INTERETS DE LA REVOLUTION MONDIALE
Dans l'article précédent dans la Revue Internationale n°95, nous avons montré comment la capacité de la bourgeoisie à prévenir l'extension internationale de la révolution et le reflux de la vague de luttes ont provoqué une réaction opportuniste de l'Internationale Communiste (IC). Cette tendance opportuniste de l'IC rencontra la résistance des forces qui devaient s'appeler par la suite la Gauche communiste. Alors que le 2e Congrès, en 1920, a eu au centre de ses débats le mot d'ordre “aller aux masses”, orientation rejetée par les groupes de la Gauche communiste, le 3e Congrès de l'IC, tenu en 1921, est un moment vital dans la bataille de cette même Gauche communiste contre le début de soumission des intérêts de la révolution mondiale aux intérêts de l'Etat russe.
La contribution du KAPD
Au 3e Congrès mondial de l'IC, le KAPD intervient directement dans les débats en développant, pour la première fois, toute une série de points critiques visant l'approche globale de l'IC. Dans ses interventions sur “La crise économique et les nouvelles tâches de l'IC”, sur “Le rapport d'activités du Comité Exécutif de l'Internationale Communiste”, sur “la question de la tactique et sur la question syndicale”, et surtout par rapport au développement de la situation en Russie, le KAPD ne cesse de défendre le rôle dirigeant des organisations révolutionnaires qui, contrairement aux conceptions encore défendues par la majorité de l'IC, ne peuvent plus être des partis de masse.
Tandis que les délégués d'Italie, qui ont défendu avec courage, en 1920, leur position minoritaire sur le parlementarisme contre l'IC, ne disent quasiment rien sur le développement de la situation en Russie et sur le rapport entre le gouvernement soviétique et l'IC, tout le mérite revient au KAPD d'avoir posé cette question au 3e Congrès.
Avant d'aborder plus en profondeur les positions et l'attitude du KAPD, il faut souligner qu'il est loin d'être un parti homogène et uni face à la nouvelle période et au déroulement rapide des événements. Bien qu'il ait la hardiesse de commencer à tirer les implications concrètes de la nouvelle période sur les questions parlementaire et syndicale, bien qu'il comprenne qu'il n'est plus possible de maintenir un parti de masse, malgré donc toute cette audace programmatique, le KAPD fait preuve d'un certain manque de prudence, de circonspection, d'attention et de rigueur politique dans l'évaluation du rapport de forces entre les classes et sur la question de l'organisation politique. Sans avoir utilisé tous les moyens de lutte pour la défense de l'organisation, il tend à prendre des décisions précipitées à ce niveau.
Il n'est pas étonnant que le KAPD ait partagé beaucoup de confusions du mouvement révolutionnaire de l'époque. Comme les bolcheviks, les militants du KAPD pensaient aussi que le parti devait s'emparer du pouvoir. Selon le KAPD, l'Etat post-insurrectionnel devrait être un Etat-Conseil.
Au 3e Congrès, sa délégation intervint sur la question du rapport entre l'Etat et le parti dans les termes suivant :
“Nous n'oublions pas un seul instant les difficultés auxquelles le pouvoir soviétique russe s'est heurté en raison du retard de la révolution mondiale. Mais nous sentons aussi le danger que, de ces difficultés, on puisse voir surgir une contradiction apparente ou réelle entre les intérêts du prolétariat révolutionnaire international et les intérêts actuels de la Russie soviétique.” (La révolution bolchevique, E.H. Carr, Editions de minuit). “Mais la séparation politique et organisationnelle entre la 3e Internationale et le système politique de l'Etat russe est un objectif pour lequel il faut travailler si nous voulons qu'apparaissent les conditions de la révolution en Europe Occidentale.” (PV du congrès, traduit de l'anglais par nous)
Au 3e Congrès, le KAPD tend à sous-estimer les conséquences du fait que la bourgeoisie a réussi à empêcher l'extension de la vague révolutionnaire. Au lieu de tirer toutes les implications de cette extension contrecarrée, au lieu de reprendre l'argumentation de Rosa Luxemburg qui avait déjà compris en 1917 que “en Russie, le problème ne pouvait qu'être posé. Il ne pouvait pas être résolu en Russie”, et au lieu de se baser sur l'appel du Spartakusbund de novembre 1918 - celui-ci avertissait : “Si les classes dominantes dans nos pays s'arrangent pour étrangler la révolution prolétarienne en Allemagne et en Russie, alors elles se retourneront contre vous avec encore plus de force (...). L'Allemagne est grosse de la révolution sociale, mais le socialisme ne peut être accompli que par le prolétariat mondial” (traduit par nous) -, le KAPD tend à voir les racines des difficultés générales en Russie même.
”La magnifique idée d'une Internationale Communiste est et demeure vivante mais elle n'est plus liée à l'existence de la Russie soviétique. L'étoile de la Russie soviétique a énormément perdu de son pouvoir d'attraction aux yeux des ouvriers révolutionnaires dans la mesure où la Russie soviétique, avec la petite paysannerie, devient de plus en plus un Etat anti-prolétarien. C'est sans plaisir que nous disons cela; mais nous devons savoir qu'une compréhension claire, même des faits les plus difficiles, une dénonciation impitoyable sont les seuls moyens qui permettent à la Révolution de garder son caractère vivant. (...) A cause des conditions dans lesquelles se trouvait le pays, à cause du contexte dans lequel se trouvait la situation internationale, nous devons comprendre que les Communistes russes n'avaient pas d'autre choix que celui d'instaurer la dictature du Parti qui était alors le seul organisme apte à fonctionner de façon ferme et disciplinée; nous devons comprendre que les Bolchéviks devaient s'emparer du pouvoir comme ils l'ont fait malgrè les difficultés et que les ouvriers d'Europe de l'ouest, autant que ceux d'Europe centrale, sont principalement responsables du fait que la Russie soviétique d'aujourd'hui soit obligée de s'appuyer sur les forces capitalistes plutôt que sur les forces révolutionnaires. C'est un fait établi, la Russie soviétique doit s'appuyer sur les forces capitalistes d'Europe et d'Amérique (...)
Puisque la Russie soviétique n'a pas d'autres choix que celui de compter sur les forces capitalistes dans le domaine de sa politique extérieure et intérieure, combien de temps encore va-t'elle pouvoir rester ce qu'elle est ? Combien de temps et de quelle manière le PCR pourra-t'il rester celui qu'il était à l'origine ? Peut-il accomplir sa tâche tout en étant un Parti gouvernant ? Et si - afin de rester un Parti communiste - il quittait le pouvoir, quel serait, selon nous, le développement ultérieur de la Russie ?” (Gouvernement et 3e Internationale, Kommunistische Arbeiterzeitung, automne 1921, traduit par nous). Bien que le KAPD soit conscient des dangers qui pèsent sur la classe ouvrière, il fournit une mauvaise explication. Au lieu de souligner que l'énergie vitale de la révolution (le pouvoir et l'activité des soviets) s'épuise en Russie parce que la révolution elle-même est de plus en plus isolée au niveau mondial, au lieu de montrer que c'est cela qui permet à l'Etat de se renforcer aux dépens de la classe ouvrière (amenant au désarmement des soviets, à l'étouffement des initiatives ouvrières et, de plus, avec un parti bolchevique de plus en plus absorbé par l'Etat), le KAPD opte pour une explication déterministe, en réalité fataliste. Affirmer, comme il le fait, que “à cause des conditions dans lesquelles se trouvait le pays, à cause du contexte dans lequel se trouvait la situation internationale, nous devons comprendre que les Communistes russes n'avaient pas d'autre choix que celui d'instaurer la dictature du Parti”, ne peut pas permettre de comprendre comment la classe ouvrière en Russie, organisée en soviets, a été capable de s'emparer du pouvoir en octobre 1917. L'idée d'“Etat paysan petit-bourgeois” est aussi une distorsion de la réalité. Ces idées, rapidement formulées dans ce texte, seront développées par la suite dans une vision théorique globale par les communistes de conseil.
Le CCI a rejeté ces idées fausses et non-marxistes des conseillistes concernant la révolution en Russie (voir nos articles dans la Revue Internationale n° 12 et 13, notre brochure Russie 1917, début de la révolution mondiale, notre livre sur La Gauche hollandaise).
En particulier, nous rejetons :
- la théorie de la révolution double qui apparaît dans certaines fractions du KAPD en 1921, après le début du reflux de la vague révolutionnaire et le capitalisme d'Etat naissant, selon laquelle une révolution prolétarienne a eu lieu en Russie dans les centres industriels en même temps qu'une révolution paysanne démocratique dans les campagnes ;
- la conception fataliste selon laquelle la révolution en Russie devait nécessairement céder à la pression de la paysannerie et que le parti bolchevique était destiné, dès le début, à dégénérer ;
- la division en différentes aires géographiques, avec la “théorie du méridien” selon laquelle en Russie les conditions et les possibilités pour le surgissement de la révolution seraient différentes de ceux de l'Europe occidentale ;
- l'approche erronée vis-à-vis de la question des relations commerciales avec l'Ouest car elle ouvre la porte à l'illusion que l'argent pouvait être aboli immédiatement dans un seul pays et qu'“il était possible de maintenir” ou de “construire” le socialisme dans un seul pays sur le long terme.
Cependant, en nous penchant de façon plus détaillée sur les positions du KAPD, on peut constater à quel point cette organisation, à l'instar des autres groupes de la Gauche communiste, a comme objectif premier de pousser au maximum de clarification des questions politiques.
Le conflit croissant entre l'Etat russe et les intérêts de la révolution mondiale
A un moment où l'IC soutient inconditionnellement la politique étrangère de l'Etat russe, la délégation du KAPD joue au trouble-fête et remue le couteau dans la plaie :
“Nous nous souvenons tous du très puissant effet propagandiste des notes diplomatiques de la Russie soviétique au temps où le Gouvernement Ouvrier et Paysan ne portait pas la responsabilité de signer les traités commerciaux et les clauses de ces traités déjà signés. Le mouvement révolutionnaire d'Asie, qui représente un grand espoir pour chacun d'entre nous et une nécessité pour la révolution mondiale, ne peut être soutenu, ni officiellement ni officieusement, par la Russie soviétique. Les agents anglais en Afghanistan, en Perse et en Turquie agissent de façon très habile; chaque avancée révolutionnaire de la Russie mine la mise en oeuvre des traités commerciaux. Au vu de cette situation, qui doit diriger la politique étrangère de la Russie soviétique ? Qui doit prendre les décisions ? Les représentants russes en Angleterre, en Allemagne, en Amérique, en Suède etc...? Communistes ou non communistes, ils doivent de toute façon mener une politique d'accord.
En ce qui concerne la situation intérieure de la Russie, elle comporte des effets similaires, même plus dangereux. En réalité le pouvoir politique est aujourd'hui entre les mains du Parti Communiste (et pas des Soviets) (...) alors que les rares forces révolutionnaires dans le Parti sentent que leurs initiatives sont interdites et qu'ils développent une plus grande méfiance, en particulier face aux manoeuvres du gros appareil constitué par les fonctionnaires (dont l'influence s'accroît) qui ont adhéré au PC, non parce qu'il était un Parti Communiste mais parce qu'il était un Parti gouvernant.”
Tandis que la plupart des délégués soutient de plus en plus inconditionnellement le parti bolchevik qui est dans un processus d'intégration dans l'appareil d'Etat, la délégation du KAPD a le courage de pointer la contradiction ente les intérêts la classe ouvrière d'un côté, ceux du Parti et de l'Etat de l'autre.
“Le Parti Communiste Russe (PCR) a éliminé l'initiative des ouvriers révolutionnaires et s'y oppose encore plus puisqu'il doit offrir plus d'espace au capital qu'auparavant. Il a commencé à changer de caractère malgré toutes les mesures de précaution tant qu'il reste un parti de gouvernement. Déjà, il ne peut prévenir que la base économique sur laquelle il repose comme parti de gouvernement, est de plus en plus détruite et donc les fondations de son pouvoir politique deviennent de plus en plus limitées.
Ce qui va arriver à la Russie et ce qui va arriver au développement révolutionnaire dans le monde entier, une fois que le parti russe ne sera plus un parti de gouvernement, peut difficilement être envisagé. Et déjà les choses vont dans une direction où, s'il n'y a pas de soulèvements révolutionnaires en Europe agissant comme contrepoids, il deviendra nécessaire que la question soit posée avec tout le sérieux nécessaire, nous devons poser la question très sérieusement : ne serait-il pas mieux d'abandonner le pouvoir d'Etat en Russie dans l'intérêt de la révolution prolétarienne au lieu de s'y cramponner ? (...)
Le même Parti Communiste Russe qui est maintenant dans une telle situation critique par rapport à son rôle comme communiste et comme parti de gouvernement, est aussi le parti dirigeant de la 3e Internationale (...). C'est là que le noeud tragique peut être vu. La 3e Internationale a été prise d'une telle manière que son souffle révolutionnaire est étouffé. Sous l'influence décisive de Lénine, les camarades russes ne créent pas de contrepoids dans la 3e Internationale contre la politique de recul de l'Etat russe. Mais ils font tout pour synchroniser les politiques de l'Internationale avec ce cours de recul (...). Aujourd'hui, la 3e Internationale est un outil de la politique des réformistes d'entente avec le gouvernement soviétique.
Sans doute, Lénine, Boukharine, etc. sont-ils de vrais révolutionnaires dans leur coeur, mais ils sont devenus comme tout le Comité Central du parti, des porteurs de l'autorité de l'Etat, et ils sont donc inévitablement soumis à la loi du développement d'une politique nécessairement conservatrice.” (Kommunistische Arbeiterzeitung, Moscow Politics, autumn 1921)
Au congrès extraordinaire du KAPD de septembre 1921, Goldstein dit ceci : “Sera-t-il possible pour le PC de Russie de concilier ces deux contradictions d'une manière ou d'une autre sur le long terme ? Aujourd'hui le PCR montre déjà un caractère double. D'un côté, il doit représenter les intérêts de la Russie comme Etat puisqu'il est encore un parti de gouvernement en Russie. Et de l'autre, il doit et il veut représenter les intérêts de la lutte de classe internationale.”
Les communistes de gauche allemands ont tout à fait raison de souligner le rôle de l'Etat russe dans la dégénérescence opportuniste de l'Internationale Communiste et d'expliquer qu'il est nécessaire de défendre les intérêts de la révolution mondiale contre les intérêts de l'Etat russe.
Cependant, en réalité, comme nous l'avons dit précédemment, la première et principale raison du tournant opportuniste de l'IC n'est pas le rôle de l'Etat russe mais l'échec de l'extension de la révolution aux pays occidentaux et le recul de la lutte de classe internationale qui s'en suit. Ainsi, pendant que le KAPD tend à blâmer principalement le PC russe pour cet opportunisme, la politique “d'alignement” sans principe sur les illusions social-démocrates des masses affecte tous les partis ouvriers à ce moment. En fait, bien avant les communistes russes, c'est la direction-même du KPD en Allemagne qui est la première à prendre ce tournant opportuniste, après la défaite de janvier 1919 à Berlin, excluant la gauche, le futur KAPD, du parti.
En réalité, les propres faiblesses du KAPD sont d'abord et avant tout le produit de la désorientation résultant de la défaite et du reflux du mouvement révolutionnaire qui s'en suit particulièrement en Allemagne. Privée de l'autorité de sa direction révolutionnaire qui a été assassinée par la social-démocratie en 1919, la Gauche Communiste allemande, une des expressions politiques les plus claires et déterminées de la vague révolutionnaire montante, est incapable (contrairement à la Gauche italienne) de faire face à la défaite de la révolution. Quels facteurs aggravèrent ces faiblesses du KAPD ?
Les faiblesses du KAPD sur la question organisationnelle
Afin de comprendre les faiblesses dans le KAPD sur la question d'organisation, il faut faire un bref retour en arrière. Il faut se souvenir notamment qu'au sein du KPD, à cause d'une fausse conception de l'organisation, la Centrale dirigée par P. Levi a expulsé la majorité des militants ; durant le congrès d'octobre 1919, pour ses positions sur les questions syndicale et parlementaire. C'est après cela que s'est fondé le KAPD, en avril 1920 après les luttes gigantesques de la classe ouvrière lors du coup d'Etat de Kapp. Cette soudaine division des communistes a provoqué un affaiblissement fatal pour la classe ouvrière en Allemagne. Et le drame c'est que le courant de gauche - après avoir été exclu du KPD - est devenu un grand défenseur de cette conception erronée.
On peut voir une illustration de cette faiblesse, quelques mois plus tard, quand les délégués au 2e Congrès de l'IC, O. Rühle et P. Merges, se retirent des travaux du congrès et “désertent”. Un an plus tard quand il est face à l'ultimatum, adressé par le 3e Congrès de l'IC, ou de se joindre au VKPD ou bien d'être expulsé de l'IC, le KAPD fait à nouveau la preuve de sa grande faiblesse en matière de défense de l'organisation. Cette expulsion va provoquer beaucoup d'hostilité et de rancoeur dans ses rangs envers l'IC.
Cela va empêcher les forces d'opposition de gauche, qui commencent à se dégager dans l'IC, de travailler ensemble. Le courant allemand et hollandais de la Gauche communiste ne fait rien pour s'opposer, au sein de l'IC, à la pression énorme du Parti bolchevik et pour construire avec la Gauche italienne réunie autour de Bordiga une résistance commune contre l'opportunisme croissant. De plus, au même moment, le KAPD est très enclin à se précipiter et à prendre des décisions imprudentes comme on va le voir.
Comment réagir vis-à-vis du danger de dégénérescence de l'IC ? S'enfuir ou combattre ?
“Dans le futur, la Russie soviétique ne sera plus un facteur de révolution mondiale ; elle deviendra un bastion de la contre-révolution internationale.
Ainsi le prolétariat russe a déjà perdu le contrôle sur l'Etat.
Ceci signifie que le gouvernement soviétique n'a d'autre choix que de devenir le défenseur des intérêts de la bourgeoisie internationale (...) Le gouvernement soviétique ne peut que devenir un gouvernement contre la classe ouvrière après avoir rejoint ouvertement le camp de la bourgeoisie. Le gouvernement soviétique est le Parti Communiste de Russie. Par conséquent, le PCR est devenu un opposant à la classe ouvrière car, étant le gouvernement soviétique, il doit défendre les intérêts de la bourgeoisie aux dépens du prolétariat. Cela ne durera pas longtemps, le PCR devra subir une scission.
Il ne faudra pas longtemps pour que le gouvernement soviétique soit forcé de montrer son vrai visage comme Etat bourgeois national. La Russie soviétique n'est plus un Etat prolétarien révolutionnaire ou, pour être plus précis, la Russie soviétique ne peut déjà plus devenir un Etat prolétarien révolutionnaire.
Car, seule la victoire du prolétariat allemand au moyen de la conquête du pouvoir politique aurait pu éviter au prolétariat russe son destin actuel, aurait pu le sauver de la misère et de la répression de son propre gouvernement soviétique. Seules une révolution en Allemagne et une révolution en Europe occidentale aurait pu aider à une issue favorable aux ouvriers russes dans la lutte de classe entre les ouvriers et les paysans russes.
Le 3e Congrès a soumis la révolution prolétarienne mondiale aux intérêts de la révolution bourgeoise d'un simple pays. L'organe suprême de l'Internationale prolétarienne a placé celle-ci au service d'un Etat bourgeois. L'autonomie de la 3e Internationale a donc été supprimée et soumise à la dépendance directe de la bourgeoisie.
La 3e Internationale est perdue maintenant pour la révolution prolétarienne mondiale. De la même manière que la 2e Internationale, la 3e Internationale est maintenant dans les mains de la bourgeoisie.
Par conséquent, la 3e Internationale fera toujours preuve de son utilité à chaque fois que ce sera nécessaire pour défendre l'Etat bourgeois de Russie. Mais elle échouera toujours à chaque fois qu'il sera nécessaire d'appuyer la révolution prolétarienne mondiale. Ses activités seront une chaîne de trahison continue de la révolution prolétarienne mondiale.
La 3e Internationale est perdue pour la révolution prolétarienne mondiale.
Après avoir été l'avant-garde de la révolution prolétarienne mondiale, la 3e Internationale est devenue son ennemi le plus violent (...). C'est à cause de la confusion désastreuse entre la direction de l'Etat - dont le caractère à l'origine prolétarien a été transformé dans les dernières années en caractère réellement bourgeois - avec la direction de l'internationale prolétarienne dans les mains d'un seul et même organe, que la 3e Internationale a échoué dans sa tâche originelle. Confrontée à l'alternative entre une politique d'Etat bourgeois et la révolution prolétarienne mondiale, les communistes russes ont choisi la première et ont placé la 3e Internationale à son service” (“Le gouvernement soviétique et la 3e Internationale à la remorque de la bourgeoisie internationale”, août 1921).
Bien qu'il ait raison de dénoncer l'opportunisme croissant de l'IC, bien qu'il ait détecté le danger d'étranglement de celui-ci par les tentacules de l'Etat russe qui en fait son instrument, le KAPD cependant fait une erreur grave en considérant ces dangers comme déjà accomplis, comme des processus déjà achevés.
Même si le rapport de forces général s'est inversé en 1921 et que la vague internationale de luttes est en recul, le KAPD fait preuve, là, d'une impatience dangereuse et ne voit pas la nécessité vitale d'une lutte persévérante et tenace pour la défense de l'Internationale. Pour le KAPD, l'IC est “un instrument de la politique des réformistes d'entente du gouvernement soviétique (...) se situant au côté et maintenant dans les mains de la bourgeoisie. La 3e Internationale est maintenant perdue pour la révolution prolétarienne mondiale. Après avoir été l'avant-garde de la révolution prolétarienne mondiale, la 3e Internationale est devenue son ennemi le plus violent.” Cette vision, à ce moment-là, est fausse. Au sein du KAPD lui-même, elle pousse au sentiment que la bataille pour l'IC est déjà perdue. Bien que cette organisation pressente une situation qui allait s'avérer par la suite, sa mauvaise estimation de la situation générale, l'amène à refuser de se battre au sein de l'IC contre l'opportunisme.
Bien que l'ultimatum du 3e Congrès mondial soit à prendre en considération pour comprendre la colère et la rancoeur du KAPD, cela ne change rien au fait essentiel qu'il se retire de manière précipitée de la bataille et qu'il ne remplit pas son devoir de défense de l'Internationale.
On voit là, une fois de plus, comment des conceptions organisationnelles insuffisantes ou erronées peuvent avoir des conséquences désastreuses et comment elles se retournent contre des positions politiques correctes.
Un autre exemple de cette importante faiblesse se révèle dans l'attitude de la délégation du KAPD au 3e Congrès de l'IC. Alors que la délégation du KAPD au 2e Congrès s'est retiré sans combattre, celle qui est au 3e Congrès fait entendre sa voix en tant que minorité et appelle, juste après, à un congrès extraordinaire du parti.
Cette délégation accuse le 3e Congrès de chercher à tuer le débat en dénaturant les positions du KAPD, en limitant le temps de parole, en changeant l'ordre du jour et en sélectionnant la participation aux discussions. Elle affirme qu'elle est exclue de la participation au débat du Comité exécutif de l'IC qui se réunit durant le congrès pour discuter les statuts du KAPD, mais elle-même renonce à prendre la parole durant le débat sur les statuts car elle veut “éviter de participer contre son gré à une comédie”. Elle se retire du débat sous les protestations.
Au lieu de comprendre qu'il a la responsabilité de mener une lutte longue et persévérante contre la dégénérescence de l'organisation, le KAPD conclut hâtivement et condamne l'IC.
Il le déclare, ainsi que le PCR, “perdue pour le prolétariat”. De plus, bien que des contacts épisodiques existent, aucune politique commune n'est trouvée entre les délégués de la Gauche italienne et ceux du KAPD et cela alors que les premiers ont également engagé la lutte contre l'opportunisme montant dans l'IC sur la question parlementaire.
L'absence du KAPD dans l'IC du fait de son expulsion va affaiblir la position de la Gauche italienne au 4e Congrès, quand le Parti Communiste d'Italie sous la direction de Bordiga sera forcé de fusionner avec le Parti Socialiste italien. Ainsi les Gauches allemande et italienne se retrouvent toujours à lutter seules contre l'opportunisme ambiant, incapables de mener une lutte commune. Cependant, le courant réuni autour de Bordiga comprend parfaitement le besoin de mener un combat tenace pour la défense et le redressement de l'organisation politique. Ainsi, en 1923, quand Bordiga pense écrire un manifeste de rupture avec l'IC, il abandonne finalement son projet, convaincu du besoin de poursuivre son combat au sein de l'IC et au sein du Parti italien.
A sa conférence extraordinaire de septembre 1921, le KAPD se préoccupe à peine de l'estimation du rapport de forces à l'échelle mondiale et n'en tire pas les implications sur les tâches immédiates de l'organisation. La majorité du parti considère encore la révolution comme immédiatement à l'ordre du jour. La volonté pure semble plus importante que l'évaluation du rapport des forces. En outre une partie de l'organisation va se lancer dans l'aventure de la fondation de l'Internationale Communiste Ouvrière (KAI) au printemps 1922.
Cette incapacité à évaluer l'évolution du rapport de force entre les classes jouera, en fin de compte, un rôle décisif dans l'incapacité du KAPD à survivre au reflux général et aux nouvelles conditions imposées par la contre-révolution triomphante.
Les réponses erronées des communistes russes
Malgré toutes ses erreurs et ses confusions, le KAPD a le mérite de poser le problème du conflit croissant entre l'Etat russe et la classe ouvrière, entre l'Etat russe et l'Internationale, sans être capable d'y apporter les bonnes réponses. Quant aux communistes russes, ils ont les plus grandes difficultés à comprendre la nature de ce conflit.
A cause de l'intégration croissante du parti dans l'appareil d'Etat, ils ne peuvent développer qu'une vision très limitée du problème. L'attitude de Lénine - qui développa de la manière la plus claire la vision marxiste sur la question dans l'Etat et la Révolution en 1917 mais qui, depuis cette date, fait partie de la direction étatique - met en évidence ces contradictions et difficultés croissantes.
Aujourd'hui, la propagande bourgeoise se donne le plus grand mal pour présenter Lénine comme le père du capitalisme d'Etat totalitaire russe. En réalité, de tous les communistes russes d'alors, Lénine, avec sa brillante intuition révolutionnaire, est celui qui sera le plus près de la compréhension que l'Etat transitoire qui est apparu après la révolution d'octobre, ne représente pas vraiment les intérêts et la politique du prolétariat. Lénine en conclut d'ailleurs que la classe ouvrière doit lutter pour imposer sa politique à l'Etat et doit avoir le droit de se défendre contre lui.
A la 11e conférence du parti en mars 1922, Lénine remarque avec inquiétude :
“Une année s'est écoulée, l'Etat est entre nos mains, mais l'Etat fonctionne-t'il comme nous le voulons ? Non, la machine échappe au contrôle de ceux qui la conduisent : comme si quelqu'un était aux manoeuvres de la machine, mais que cette dernière emprunte une voie différente, comme mue par une main invisible...”
Il défend cette idée en particulier contre
Trotsky dans le débat sur les syndicats en 1921. Alors qu'apparemment la
question du rôle des syndicats au sein de la dictature prolétarienne semble
être la question en jeu, en réalité celle qui est au centre est : est-ce
que la classe ouvrière doit avoir le droit, ou non, de mener son propre combat
de classe pour se défendre contre l'Etat traditionnel ? Selon Trotsky,
puisque l'Etat de transition est par définition un Etat ouvrier, l'idée que le
prolétariat puisse se défendre contre lui est une absurdité. Trotsky, qui a au
moins le mérite de suivre la logique de sa position jusqu'au bout, défend
ouvertement la militarisation du travail. Même si Lénine n'est pas encore
capable de reconnaître clairement que cet Etat n'est pas un Etat ouvrier
(position qui sera développée et défendue plus tard par la revue Bilan dans les années 1930), il insiste
sur la nécessité pour les ouvriers de se défendre eux-mêmes contre l'Etat.
Ce souci parfaitement correct de Lénine ne
permet pas aux communistes russes d'arriver à une vraie clarification sur cette
question. Lénine lui-même, comme d'autres communistes d'alors, continue à
considérer qu'en Russie c'est le poids énorme de la petite-bourgeoisie qui est
la principale source de contre-révolution et non l'Etat bureaucratisé.
“Aujourd'hui, l'ennemi n'est plus le même qu'hier. L'ennemi, ce ne sont pas les masses des blancs... L'ennnemi c'est le gris de la gestion économique quotidienne dans un pays dominé par des petits paysans et dont la grosse industrie est détruite. L'ennemi, c'est l'élément petit-bourgeois. Le prolétariat est fragmenté, divisé, épuisé. Les "forces" de la classe ouvrière ne sont pas illimitées... L'affluence de nouvelles forces du prolétariat est faible, parfois très faible (...) il faudra encore s'accomoder d'une croissance ralentie des nouvelles forces de la classe ouvrière ?” (Lénine, Oeuvres complètes, vol. 33)
Le reflux de la lutte de classe permet le développement du capitalisme d'Etat
Après les défaites de la classe ouvrière au niveau international en 1920, les conditions pour la classe ouvrière en Russie s'aggravent considérablement. De plus en plus isolés, les ouvriers russes se confrontent à l'Etat - à la tête duquel se trouve le Parti bolchevik - qui leur impose de plus en plus systématiquement sa violence, comme à Kronstadt,. L'écrasement de cette révolte a mené au développement des tendances qui, dans le parti, sont pour le renforcement de l'Etat, si nécessaire aux dépens de la classe ouvrière, et pour assujettir l'IC à l'Etat russe.
L'Etat russe est de plus en plus un Etat “normal” parmi les autres Etats.
Déjà au printemps 1921, à travers des négociations secrètes, la bourgeoisie allemande prend contact avec Moscou afin d'explorer les possibilités de coopération entre les deux pays au niveau armement. Il est envisagé, par exemple, de faire fabriquer des avions par Albatrosswerke, des sous-marins par Blöhm et Voss, des fusils et des munitions par Krupp.
A la fin de l'année 1921, quand la Russie propose une conférence générale pour l'établissement de relations entre elle et le monde capitaliste, les négociations secrètes entre l'Allemagne et la Russie ont lieu depuis longtemps. A la conférence de Gênes, Tchitchérine, le dirigeant de la délégation russe exalte les immenses possibilités d'exploitation des ressources potentielles de la Russie grâce à la coopération avec les capitalistes occidentaux. Quand cette conférence prend fin, l'Allemagne et la Russie ont déjà conclu non loin de là, à Rappallo, un accord secret. Comme l'écrit E.H. Carr :“C'était la première fois que, dans une affaire diplomatique importante, la Russie soviétique aussi bien que la République de Weimar rencontraient un partenaire sur un pied d'égalité.” (La révolution bolchevique, tome 3, Editions de minuit) Mais Rappallo est plus que cela.
Durant l'hiver 1917-18 le traité de Brest-Litovsk n'est signé qu'après l'offensive allemande contre la Russie parce que les bolcheviks veulent ainsi protéger le bastion isolé de la révolution prolétarienne mondiale contre l'attaque capitaliste de l'impérialisme allemand. Ce traité est non seulement imposé à la classe ouvrière russe mais aussi il n'est signé qu'après un grand débat ouvert au sein du parti bolchevik. Par contre, il n'en est pas de même avec la signature du traité de Rappallo. Ce dernier traité, signé par les représentants de l'Etat russe, contient des accords secrets sur les armes; mais, de plus, au 4e Congrès mondial de novembre 1922, il n'est même pas mentionné.
Les instructions données par l'IC aux PC en Turquie et en Perse “pour appuyer le mouvement en faveur de la libération nationale en Turquie (et en Perse)” aboutissent en fait à une situation où les bourgeoisies nationales respectives peuvent massacrer la classe ouvrière beaucoup plus facilement. La volonté de maintenir des liens solides avec ces différents Etats montre que l'Etat russe fait prévaloir ses propres intérêts.
Etape par étape, l'IC se soumet aux besoins de la politique étrangère de l'Etat russe. Tandis qu'en 1919, à l'époque de sa fondation, l'IC a pour orientation principale la destruction des Etats capitalistes, à partir de 1921, celle de l'Etat russe est vers sa stabilisation. La révolution mondiale qui ne réussit pas à s'étendre donne suffisamment de latitude à l'Etat russe pour faire valoir sa place.
A la conférence commune des “partis ouvriers” qui se tient au début avril 1922 à Berlin, et à laquelle l'IC invite les partis de la 2e et 2e 1/2 Internationales ([1] [3715]), la délégation de l'IC essaya surtout d'obtenir des appuis pour la reconnaissance de la Russie soviétique, pour l'établissement de relations commerciales entre la Russie et l'Ouest et pour l'aide à la reconstruction de la Russie. Tandis qu'en 1919, le rôle de la 2e Internationale comme boucher de la classe ouvrière était dénoncé, et tandis qu'en 1920 au 2e Congrès avaient été adoptées les 21 conditions d'admission afin de se délimiter de la 2e Internationale et la combattre, ce fut au nom de l'Etat russe que la délégation de l'IC s'assit à la même table que les partis de la 2e Internationale. Il était devenu évident que l'Etat russe n'était plus intéressé dans l'extension de la révolution mondiale mais au renforcement de l'Etat. Plus l'IC était à la remorque de l'Etat, plus clairement elle tournait le dos à l'internationalisme.
La croissance hypertrophique de l'appareil d'Etat en Russie
L'orientation politique prise par l'Etat russe en vue d'être reconnu par les autres Etats va de pair avec son propre renforcement en Russie même. L'intégration toujours croissante du parti dans l'Etat, l'augmentation de la concentration du pouvoir dans les mains d'un cercle toujours plus concentré et limité de “forces dirigeantes”, la dictature croissante de l'Etat sur la classe ouvrière sont le résultat des efforts tenaces de ces forces favorables au renforcement de l'appareil d'Etat aux dépens de la vie même de la classe ouvrière.
En avril 1922, Staline est nommé secrétaire général du parti à son 11e congrès. A partir de là, il occupe trois postes importants en même temps : il est commissaire du peuple aux questions nationales, commissaire du peuple pour l'inspection ouvrière et paysanne et il est membre du Bureau Politique. En tant que secrétaire général, il prend rapidement en main la vie quotidienne du parti et s'arrange pour rendre le Bureau Politique dépendant du secrétaire général. Auparavant, il avait déjà été nommé à la tête des “activités d'épuration” en mars 1921 au 10e Congrès du parti (2[2] [3716]). Quelques membres du “Groupe de l'Opposition Ouvrière” demandent au Comité Exécutif de l'IC de “dénoncer le manque d'autonomie, la suppression de toute initiative ouvrière et le combat contre les membres qui ont des opinions divergentes. (...) Les forces unies du parti et de la bureaucratie syndicale profitant de leur pouvoir et de leur position battent en brèche le principe de la démocratie ouvrière.” (Rosmer) Mais après que le PCR ait exercé une pression sur le Comité Exécutif, celui-ci finit par rejeter la plainte du groupe de “l'Opposition Ouvrière”.
Au lieu de laisser la responsabilité de nommer les délégués aux sections locales du parti, au fur et à mesure que le parti s'intègre à l'Etat, ces nominations sont faites par la direction du parti et donc par l'Etat. Les élections et les votes dans le parti sur une base locale ne sont plus désirés dans la mesure où le pouvoir de décision est de plus en plus entre les mains du secrétaire général et du bureau d'organisation qui est tenu par Staline. Tous les délégués pour le 12e Congrès du parti en avril 1923 sont d'ailleurs nommés par la direction du parti.
Si nous soulignons le rôle du parti ici, ce n'est pas parce que nous voulons réduire le problème de l'Etat à une seule personne - Staline - et donc limiter et sous-estimer le danger venant de l'Etat. La raison en est que l'Etat qui a surgi après l'insurrection d'octobre 1917, qui absorbe le Parti bolchevik dans ses structures et qui étend ses tentacules sur l'IC, est devenu le centre de la contre-révolution. Mais la contre-révolution n'est pas processus anonyme animé par des forces inconnues, sans visage ou invisibles. Elle prend forme concrètement dans le parti et dans l'appareil d'Etat. Staline, le Secrétaire général, est un des représentants importants de ces forces qui tirent les fils du parti à différents niveaux et qui luttent contre tout ce qui reste de révolutionnaire dans le parti.
Au sein du Parti bolchevik, en effet, ce processus de dégénérescence provoque des résistances et des convulsions que nous avons déjà traitées plus spécifiquement dans nos articles dans la Revue Internationale n° 8 et 9.
Malgré les confusions que nous avons mentionnées, Lénine va devenir l'un des opposants les plus déterminés de l'appareil d'Etat. Après avoir été frappé une première fois par une attaque cérébrale en mai 1922 et une seconde le 9 mars 1923, il rédige un document - connu plus tard comme son testament - dans lequel il demande le remplacement de Staline en tant que Secrétaire général. Ce document montre que Lénine, qui a longtemps travaillé avec Staline, veut rompre avec lui et même veut engager le combat contre lui. Cependant, parce qu'il est cloué au lit, luttant contre sa propre agonie, sa rupture et sa déclaration de guerre ne sont pas publiées dans la presse du parti qui est, à ce moment-là, tenu fermement par le Secrétaire général, Staline lui-même !
Au même moment, ce n'est pas un hasard si Kamenev, Zinoviev et Staline, qui vont constituer la nouvelle direction en composant une “troïka”, défendent la conception typiquement bourgeoise de la nécessité d'un “successeur” à Lénine. C'est dans le contexte d'une lutte pour le pouvoir au sein du parti qu'un groupe d'opposants à la “troïka” fait paraître, durant l'été 1923, la “Plate-forme des 46” qui critique l'étouffement de la vie prolétarienne dans le parti, lequel, pour la première fois depuis octobre 1917, a refusé d'appeler à la révolution mondiale à l'occasion du 1ermai 1922.
A l'été 1923, un certain nombre de grèves éclatent en Russie, particulièrement à Moscou.
Au moment où l'Etat russe renforce sa position en Russie et fait tout pour être reconnu par les grands Etats capitalistes, le processus de dégénérescence de l'IC, après le tournant opportuniste du 3e Congrès, s'accélère sous la pression de l'Etat russe.
Le 4e Congrès mondial : la soumission à l'Etat russe
En adoptant la politique de Front Unique à son 4e Congrès en novembre 1922, l'IC jette par-dessus bord les positions de principes des 1er et 2e congrès au cours desquels il avait insisté sur la démarcation la plus claire avec la social-démocratie ainsi que sur le combat à mener contre elle.
Pour justifier sa politique, l'IC met en avant que le rapport de forces entre la bourgeoisie et le prolétariat montre que “les grandes masses prolétariennes ont perdu leur foi dans leur capacité de s'emparer du pouvoir dans un avenir prévisible. Elles sont repoussées vers une position défensive (...) alors la conquête du pouvoir comme tâche immédiate n'est pas à l'ordre du jour.” (intervention de Radek citée par E.H. Carr, La révolution bolchevique, Editions de Minuit). Par conséquent, il est nécessaire de s'unir avec les ouvriers qui sont encore sous l'influence de la social-démocratie :
“Le slogan du 3e congrès adressé "aux masses" est plus valide que jamais (...) Les tactiques du front uni est une proposition de lutte unitaire des communistes avec tous les ouvriers issus d'autres Partis ou d'autres groupes (...) Dans certaines circonstances, les communistes doivent se préparer à s'allier des ouvriers non communistes et avec des organisations ouvrières, afin de constituer un gouvernement.” (“Thèses sur la tactique du Comintern”, 4e congrès)
C'est le Parti Communiste allemand (le KPD) qui est le premier parti à encourager cette tactique comme nous le verrons dans le prochain article de cette série.
Au sein de l'IC, ce nouveau pas opportuniste qui pousse les ouvriers dans les bras de la social-démocratie, rencontre la résistance acharnée de la Gauche italienne.
Déjà en mars 1922, une fois les thèses sur le front unique adoptées, Bordiga écrit :
“Pour ce qui est du "gouvernement ouvrier", nous demandons : pourquoi veut-on s'allier avec les social-démocrates ? Pour faire les seules choses qu'ils savent, peuvent et veulent faire, ou bien pour leur demander de faire ce qu'ils ne savent, ne peuvent, ni ne veulent faire ? Veut-on que nous disions aux social-démocrates que nous sommes prêts à collaborer avec eux, même au parlement et même dans ce gouvernement qu'on a baptisé "ouvrier" ? Dans ce cas, c'est-à-dire si l'on nous demande d'élaborer au nom du parti communiste un projet de gouvernement ouvrier auquel devraient participer des communistes et des socialistes, et de présenter ce gouvernement aux masses comme un "gouvernement anti-bourgeois", nous répondrons, en prenant l'entière responsabilité de notre réponse, qu'une telle attitude s'oppose à tous les principes fondamentaux du communisme. Accepter cette formule politique signifierait, en effet, tout simplement déchirer notre drapeau, sur lequel il est écrit : il n'existe pas de gouvernement prolétarien qui ne soit constitué sur la base de la victoire révolutionnaire du prolétariat.” (26 mars 1922, dans La défense de la continuité du programme communiste, Editions programme communiste)
Au 4e Congrès, le PC d'Italie déclare que “le parti communiste n'acceptera donc pas de faire partie d'organismes communs à différentes organisations politiques... (il) évitera également d'apparaître comme co-participant à des déclarations communes avec d'autres partis politiques, lorsque ces déclarations contrediront en partie son programme et seront présentées au prolétariat comme le résultat de négociations pour trouver une ligne d'action commune. (...) Parler de gouvernement ouvrier (...) c'est nier en pratique le programme politique communiste, c'est-à-dire la nécessité de préparer les masses à la lutte pour la dictature.” (Thèses sur la tactique de l'Internationale Communiste présentées par le PC d'Italie au 4e Congrès mondial, 22 novembre 1922)
Mais après l'exclusion du KAPD de l'IC à l'automne 1921, qui fait taire la voix la plus critique contre la dégénérescence de l'IC, la Gauche italienne se retrouve, une fois encore, seule à défendre la position de la Gauche Communiste.
A la même époque, un événement est à prendre en considération : en octobre 1922, Mussolini prend le pouvoir en Italie, ce qui conduit à une aggravation des conditions de vie pour les révolutionnaires. “Absorbée” par cette question, la Gauche italienne a du mal à se mobiliser contre la dégénérescence en cours de l'IC et du parti bolchevik.
En même temps, le 4e Congrès met en place les conditions de la soumission future de l'IC aux intérêts de l'Etat russe. Confondant les intérêts de l'Etat russe et ceux de l'IC, le président de cette dernière, Zinoviev, affirme sur la question de la stabilisation du capitalisme et des attaques contre la Russie qui s'achèvent : “Nous pouvons dès à présent dire sans exagération que l'Internationale Communiste a survécu à ses moments les plus difficiles, et qu'elle s'est consolidée à tel point qu'elle n'a plus à craindre les attaques de la réaction mondiale.” (La révolution bolchevique, E.H. Carr, Editions de minuit)
Puisque la perspective de conquête du pouvoir ne se pose plus immédiatement, le 4e Congrès donne l'orientation, outre la tactique de front unique, que la classe ouvrière doit concentrer ses efforts sur le soutien et la défense de la Russie. La résolution sur la Révolution russe montre bien jusqu'à quel point l'analyse que fait l'IC part du point de vue des intérêts de l'Etat russe et non plus de ceux de la classe ouvrière internationale, mettant ainsi la construction de la Russie au premier plan :
“Le 4e Congrès mondial de l'Internationale Communiste exprime au peuple travailleur de la Russie des Soviets ses remerciements les plus profonds et son admiration sans bornes pour avoir (...) su défendre victorieusement jusqu'à aujourd'hui contre tous les ennemis de l'intérieur et de l'extérieur les conquêtes de la révolution (...). Le 4e Congrès mondial constate avec la plus grande satisfaction que le premier Etat ouvrier du monde, issu de la révolution prolétarienne, a complètement prouvé sa force de vie et de développement au cours des cinq années de son existence, malgré les difficultés et des dangers inouïs. L'Etat soviétiste est sorti renforcé des horreurs de la guerre civile. (...) Le 4e Congrès mondial constate avec satisfaction que la politique de la Russie des Soviets a assuré et renforcé la condition la plus importante pour l'instauration et le développement de la société communiste, le régime des Soviets, c'est-à-dire la dictature du prolétariat. Car, seule, cette dictature est capable de surmonter toutes les résistances bourgeoises à l'émancipation totale des travailleurs et d'assurer ainsi la défaite complète du capitalisme et la voie libre vers la réalisation du communisme.”
“Ne touchez pas à la Russie des Soviets ! Reconnaissance de la République des Soviets !”
“Tout renforcement de la Russie des Soviets équivaut à un affaiblissement de la bourgeoisie mondiale.” (Résolution sur la Révolution Russe, 4e Congrès de l'IC)
Le degré de contrôle de l'IC par l'Etat russe, six mois après Rappallo, devient palpable lorsque, dans le contexte de montée des tensions impérialistes, la Russie envisage la possibilité d'établir un bloc militaire avec un autre Etat capitaliste. L'IC affirme qu'une telle alliance peut être utilisée pour le renversement d'un autre régime bourgeois et montre, dans la réalité, qu'il est de plus en plus un instrument de l'Etat russe : “J'affirme que nous sommes dès maintenant assez forts pour conclure une alliance avec une bourgeoisie afin de pouvoir, au moyen de cet Etat bourgeois, renverser une autre bourgeoisie... En supposant qu'une alliance militaire ait été conclue avec un Etat bourgeois, le devoir des camarades de chaque pays est de contribuer à la victoire des deux alliés.” (Boukharine au congrès, cité par E.H. Carr, idem) Quelques mois plus tard, l'IC et le PC allemand mettent en avant la perspective d'une alliance entre la “nation allemande opprimée” et la Russie. Dans l'antagonisme entre l'Allemagne et les pays vainqueurs de la 1re Guerre mondiale, l'IC et l'Etat russe prennent position en faveur de l'Allemagne qui est présentée comme victime des intérêts impérialistes français.
Déjà en janvier 1922, au “1er congrès des travailleurs de l'Extrême-Orient”, l'IC donne, comme une orientation centrale, le besoin d'une coopération entre les communistes et les “révolutionnaires non-communistes”. Dans ses thèses sur la tactique, le 4e Congrès mondial décide le soutien à “tout mouvement national-révolutionnaire dirigé contre l'impérialisme” et rejeta fermement en même temps “le refus des communistes des colonies de prendre part à la lutte contre l'oppression impérialiste sous le prétexte de "défense" exclusive des intérêts de classe, est le fait d'un opportunisme du plus mauvais aloi qui ne peut que discréditer la révolution prolétarienne en Orient.” (“Thèses générales sur la question d'Orient”)
Ainsi l'IC contribue à désorienter et à affaiblir grandement la classe ouvrière.
Après que la vague révolutionnaire a atteint son point culminant en 1919, qu'elle connaît une phase de reflux suite à l'échec de l'extension internationale de la révolution, une fois que l'Etat russe a renforcé sa position et soumis l'IC à ses intérêts, la bourgeoisie peut se sentir suffisamment forte au niveau international et établir des plans pour donner le coup fatal à la partie de la classe ouvrière qui reste la plus combative : le prolétariat d'Allemagne. Nous examinerons donc les événements de 1923 en Allemagne dans le prochain article.
DV.
[1] [3717] . L'“Internationale 2 1/2” est le nom donné par les communistes à la tentative avortée de regroupement des éléments “centristes” qui se sont séparés de la Social-démocratie du fait de la guerre tout en refusant d'adhérer à l'IC.
[2] [3718] Alors que le nombre de membres a augmenté en 1920 jusqu'à 600 000, entre 1920-21 quelques 150 000 membres sont expulsés du parti. Il est clair que ne sont pas expulsés que des carriéristes, mais aussi beaucoup d'éléments ouvriers. La “commission d'épuration” dirigée par Staline est un des organes les plus puissants en Russie.
Géographique:
- Allemagne [98]
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Allemande [1955]
Conscience et organisation:
Approfondir:
- Révolution Allemande [1957]
Heritage de la Gauche Communiste:
- La Révolution prolétarienne [1149]
Question d'organisation : sommes-nous devenus "léninistes"? (II)
- 4998 reads
Dans la première partie de cet article, nous avons répondu à l'accusation qui nous est faite d'être devenus “léninistes” et d'avoir changé de position sur la question organisationnelle. Nous avons montré que le “léninisme” s'oppose non seulement à nos principes et positions politiques, mais aussi qu'il vise à la destruction de l'unité historique du mouvement ouvrier. En particulier, il rejette la lutte des gauches marxistes au sein, puis en dehors, des 2c et 3e Internationales en dressant Lénine contre Rosa Luxemburg, Pannekoek, etc. Le “léninisme” est la négation du militant communiste Lénine. Il est l'expression de la contre-révolution stalinienne au début des années 1920.
Nous avons aussi affirmé que nous nous étions toujours revendiqué du combat de Lénine pour la construction du parti contre l'opposition de l'économisme et des mencheviks. Nous avons aussi rappelé que nous maintenions notre rejet de ses erreurs en matière d'organisation, particulièrement sur le caractère hiérarchique et “militaire” de l'organisation, de même qu'au niveau théorique sur la question de la conscience de classe qui devrait être apportée au prolétariat de l'extérieur, tout en resituant ces erreurs dans leur cadre historique afin d'en comprendre leur dimension et leur signification réelles.
Quelle est la position du CCI sur Que faire? et sur Un pas en avant, deux pas en arrière ? Pourquoi affirmons-nous que ces deux ouvrages de Lénine représentent des acquis théoriques, politiques et organisationnels irremplaçables ? Est-ce que nos critiques qui portent sur des points qui ne sont pas du tout secondaires - en particulier sur la question de la conscience telle qu'elle est développée dans Que faire? - ne remettent pas en cause notre accord fondamental avec Lénine ?
LA POSITION DU CCI SUR QUE FAIRE?
“Il serait faux et caricatural d'opposer ainsi un Que faire? substitutionniste de Lénine à une vision saine et claire de Rosa Luxemburg et de Trotsky (celui-ci d'ailleurs se fera, dans les années 1920, l'âpre défenseur de la militarisation du travail et de la dictature toute puissante du parti !).” ([1] [3719]) Comme on le voit, notre position sur Que faire ? commence par reprendre notre méthode d'appréhension de l'histoire du mouvement ouvrier, méthode qui s'appuie sur l'unité et la continuité de ce dernier comme nous l'avons présenté dans la première partie de cet article. Elle n'est pas nouvelle et remonte à la fondation même du CCI.
Que faire ? (1902) comporte deux grandes parties. La première est dédiée à la question de la conscience de classe et du rôle des révolutionnaires. La deuxième porte directement sur les questions d'organisation. L'ensemble est une critique implacable des “économistes” qui ne considèrent possible un développement de la conscience dans la classe ouvrière qu'à partir de ses luttes immédiates. Ils tendent ainsi à sous-estimer et à nier tout rôle politique actif aux organisations révolutionnaires dont la tâche se limiterait à “aider” les luttes économiques. Conséquence naturelle de cette sous-estimation du rôle des révolutionnaires, l'économisme s'oppose à la constitution d'une organisation centralisée et unie capable d'intervenir largement et d'une seule voix sur toutes les questions, économiques comme politiques.
Le texte de Lénine, Un pas en avant, deux pas en arrière (1903), qui est un complément à Que faire ? sur le plan historique, rend compte de la rupture entre bolchéviks et mencheviks au 2e congrès du POSDR qui vient d'avoir lieu.
La faiblesse principale - nous l'avons dit - de Que faire ? est sur la conscience de classe. Quelle est l'attitude des autres révolutionnaires sur cette question ? Jusqu'au 2e congrès, seul l'“économiste” Martinov s'y oppose. Ce n'est qu'après le congrès que Plékhanov et Trotsky critiquent la conception erronée de Lénine sur la conscience apportée de l'extérieur à la classe ouvrière. Ils sont les seuls à rejeter explicitement la position de Kautsky reprise par Lénine selon laquelle “le socialisme et la lutte de classe surgissent parallèlement et ne s'engendrent pas l'un l'autre (et que) le porteur de la science n'est pas le prolétariat, mais les intellectuels bourgeois.” ([2] [3720])
La réponse de Trotsky sur ce point de la conscience est assez juste, bien qu'elle reste aussi très limitée. N'oublions pas que nous nous trouvons en 1903 et la réponse de Trotsky, Nos tâches politiques, date de 1904. Le débat sur la grève de masse a à peine débuté en Allemagne, et ce n'est qu'avec l'expérience de 1905 en Russie qu'il va réellement se développer. Trotsky repousse clairement la position de Kautsky et souligne le danger de substitutionnisme qu'elle comporte. Mais pour autant, et alors qu'il est très virulent contre Lénine sur les questions d'organisation, il ne se démarque pas complètement sur cet aspect particulier. Il comprend et explique les raisons d'une telle prise de position :
“Lorsque Lénine reprit à Kautsky l'idée absurde du rapport entre l'élément "spontané" et l'élément "conscient" dans le mouvement révolutionnaire du prolétariat, il ne faisait que définir grossièrement les tâches de son époque.” ([3] [3721])
Outre la clémence de Trotsky sur ce plan, il convient de relever que personne parmi les nouveaux opposants à Lénine ne s'était élevé contre la position de Kautsky sur la conscience avant le 2e congrès du POSDR quand ils étaient unis dans la lutte contre l'économisme. Au congrès, Martov, leader des mencheviks, reprend exactement la même position que Kautsky et Lénine : “Nous sommes l'expression consciente d'un processus inconscient.” ([4] [3722]) A la suite du congrès, cette question est jugée si peu importante que les mencheviks nient encore toute divergence programmatique et attribuent la division aux “élucubrations” de Lénine sur l'organisation :
“Avec ma faible intelligence, je ne suis pas capable de comprendre ce que peut être "l'opportunisme sur les problèmes organisationnels", posé sur le terrain comme quelque chose d'autonome, en dehors d'un lien organique avec les idées programmatiques et tactiques.” ([5] [3723])
La critique de Plékhanov, si elle est juste, reste assez générale et se contente de rétablir la position marxiste sur la question. L'argumentation principale est qu'il n'est pas vrai que “les intellectuels [ont] "élaboré" leurs propres théories socialistes "de manière totalement indépendante de la croissance spontanée du mouvement ouvrier" - cela n'est jamais arrivé et ne pouvait pas arriver.” ([6] [3724])
Plékhanov se limite au niveau théorique à la question de la conscience. Il n'aborde pas les débats du 2e Congrès. Il ne répond pas à la question centrale : quel Parti et quel rôle pour ce Parti ? Seul Lénine y répond.
La question centrale de Que faire? : élever la conscience
Lénine a un souci central dans sa polémique contre l'économisme sur le plan théorique : la question de la conscience de classe et son développement dans la classe ouvrière. On sait que Lénine est revenu rapidement sur la position de Kautsky. En particulier avec l'expérience de grève de masse russe de 1905 et l'apparition des premiers soviets. En janvier 1917, c'est-à-dire avant le début de la révolution en Russie, alors que la guerre impérialiste fait rage, Lénine revient sur la grève de masse en 1905. Des passages entiers sur “l'enchevêtrement des grèves économiques et grèves politiques” pourraient apparaître comme rédigés par Rosa Luxemburg ou Trotsky ([7] [3725]). Et ils donnent un aperçu du rejet par Lénine de son erreur initiale en grande partie provoquée par ses “tordages de barre” ([8] [3726]).
“La véritable éducation des masses ne peut jamais être séparée d'une lutte politique indépendante, et surtout de la lutte révolutionnaire des masses elles-mêmes. Seule l'action éduque la classe exploitée, seule elle lui donne la mesure de ses forces, élargit son horizon, accroît ses capacités, éclaire son intelligence et trempe sa volonté.” ([9] [3727]) On est loin de ce que dit Kautsky.
Mais déjà dans Que faire?, ce qui est dit sur la conscience est contradictoire. A côté de la position fausse, Lénine affirme par exemple : “Ceci nous montre que l'"élément spontané" n'est au fond que la forme embryonnaire du conscient.” ([10] [3728])
Ces contradictions sont la manifestation du fait que Lénine, comme le reste du mouvement ouvrier en 1902, n'a pas une position très précise et très claire sur la question de la conscience de classe ([11] [3729]). Les contradictions de Que faire ? et les prises de position ultérieures montrent qu'il n'est pas particulièrement attaché à la position de Kautsky. D'ailleurs il n'y a que trois passages bien délimités de Que faire ? dans lesquels il écrit que “la conscience doit être apportée de l'extérieur”. Et sur les trois, il en est un qui n'a rien à voir avec ce que dit Kautsky.
Rejetant que l'on puisse “développer la conscience politique de classe des ouvriers, pour ainsi dire de l'intérieur de leur lutte économique, c'est-à-dire en partant uniquement (ou du moins principalement) de cette lutte, en se basant uniquement (ou du moins principalement) sur cette lutte)... [Lénine répond que] ...la conscience politique de classe ne peut être apportée à l'ouvrier que de l'extérieur, c'est-à-dire de l'extérieur de la lutte économique, de l'extérieur de la sphère des rapports entre ouvriers et patrons.” ([12] [3730]) La formule est confuse, mais l'idée est juste. Et ne correspond pas à ce qu'il défend dans les deux autres utilisations du terme “extérieur” quand il parle de la conscience. Sa pensée est encore plus précise dans un autre passage : “La lutte politique de la social-démocratie est beaucoup plus large et plus complexe que la lutte économique des ouvriers contre le patronat et le gouvernement.” ([13] [3731])
Lénine rejette très clairement la position développée par les économistes sur la conscience de classe comprise comme produit immédiat, direct, mécanique et exclusif des luttes économiques.
Nous sommes du côté de Que faire ? dans le combat contre l'économisme. Nous sommes aussi d'accord avec les arguments critiques utilisés contre l'économisme et nous disons qu'ils sont encore aujourd'hui d'actualité quant à leur contenu théorique et politique.
“L'idée selon laquelle la conscience de classe ne surgit pas de manière mécanique des luttes économiques est entièrement correcte. Mais l'erreur de Lénine consiste à croire qu'on ne peut pas développer la conscience de classe à partir des luttes économiques et que celle-ci doit être introduite de l'extérieur par un parti.” ([14] [3732])
Est-ce là une nouvelle appréciation du CCI ? Voilà des citations de Que faire ? que nous reprenions à notre compte, en 1989, dans un article de polémique ([15] [3733]) avec le BIPR pour appuyer, déjà, ce que nous disons aujourd'hui :
“La conscience socialiste des masses ouvrières est la seule base qui peut nous garantir le triomphe (...). Le parti doit avoir toujours la possibilité de révéler à la classe ouvrière l'antagonisme hostile entre ses intérêts et ceux de la bourgeoisie. [La conscience de classe atteinte par le parti] doit être diffusée parmi les masses ouvrières avec un zèle croissant. (...) il faut s'efforcer le plus possible d'élever le niveau de conscience des ouvriers en général. [La tâche du parti est de] tirer profit des étincelles de conscience politique que la lutte économique a fait pénétrer dans l'esprit des ouvriers pour élever ceux-ci au niveau de la conscience social-démocrate.” ([16] [3734])
Pour les détracteurs de Lénine, les conceptions présentées dans Que Faire ? annoncent le stalinisme. Un lien unirait donc Lénine et Staline y compris en matière d'organisation ([17] [3735]). Nous avons repoussé ce mensonge dans la première partie de cet article sur le plan historique. Et nous le repoussons aussi sur le plan politique, y compris sur les questions de la conscience de classe et de l'organisation politique.
Il y a une unité et une continuité de Que faire ? avec la révolution russe, mais surement pas avec la contre-révolution stalinienne. Cette unité et cette continuité existent avec tout le processus révolutionnaire qui relie les grèves de masse de 1905 et celles de 1917, qui va de février 1917 à l'insurrection d'octobre 1917. Pour nous, Que faire ? annonce les Thèses d'avril en 1917 : “Les masses trompées par la bourgeoisie sont de bonne foi. Il importe de les éclairer avec soin, persévérance, avec patience sur leur erreur, de leur montrer le lien indissoluble du capital et de la guerre impérialiste (...). Explication aux masses que les soviets représentent la seule forme possible de gouvernement ouvrier.” ([18] [3736]) Pour nous, Que faire ? annonce l'insurrection d'octobre et le pouvoir des soviets.
Nos détracteurs actuels “anti-léninistes” passent complètement sous silence cette préoccupation centrale de Que Faire ? sur la conscience, reprenant ainsi un des éléments de la méthode stalinienne que nous avons dénoncée dans la première partie de cet article. Tel Staline qui faisait gommer les vieux militants bolcheviks sur les photos, ils gomment l'essentiel de ce que dit Lénine et nous accusent d'être devenus “léninistes”, c'est-à-dire staliniens.
Pour les laudateurs sans critique de Lénine tel le courant bordiguiste, nous serions d'indécrottables idéalistes par notre insistance sur le rôle et l'importance de “la conscience de classe dans la classe ouvrière” dans la lutte historique et révolutionnaire du prolétariat. Pour qui veut bien lire ce qu'a écrit Lénine et pour qui veut bien se plonger dans le processus réel de discussions et de confrontations politiques de l'époque, les deux accusations sont fausses.
La distinction de Que faire? entre organisation politique et organisation unitaire
Au niveau politique et organisationnel il y a d'autres apports fondamentaux dans Que faire ?. Il s'agit notamment de la distinction claire et précise que Lénine fait entre les organisations dont se dote la classe ouvrière dans ses luttes quotidiennes, les organisations unitaires, et les organisations politiques. Voyons d'abord l'acquis au plan politique.
“Ces cercles, associations professionnelles des ouvriers et organisations sont nécessaires partout ; il faut qu'ils soient le plus nombreux et que leurs fonctions soient le plus variées possible ; mais il est absurde et nuisible de les confondre avec l'organisation des révolutionnaires, d'effacer la ligne de démarcation qui existe entre eux (...) L'organisation d'un parti social-démocrate révolutionnaire doit nécessairement être d'un autre genre que l'organisation des ouvriers pour la lutte économique.” ([19] [3737])
A ce niveau, cette distinction n'est pas une découverte pour le mouvement ouvrier. La social-démocratie internationale, particulièrement allemande, est claire sur la question. Mais Que faire ?, dans sa lutte contre la variante russe de l'opportunisme à cette époque, l'économisme, et tenant en compte les conditions particulières, concrètes, de la lutte de classe dans la Russie tsariste, est amené à aller plus loin et à avancer une idée nouvelle.
“L'organisation des révolutionnaires doit englober avant tout et principalement des hommes dont la profession est l'action révolutionnaire. Devant cette caractéristique commune aux membres d'une telle organisation doit s'effacer toute distinction entre ouvriers et intellectuels et, à plus forte raison, entre les diverses professions des uns et des autres. Nécessairement cette organisation ne doit pas être très étendue, et il faut qu'elle soit la plus clandestine possible.” ([20] [3738])
Arrêtons-nous un instant là-dessus. Il serait erroné de voir dans ce passage des considérations liées uniquement aux conditions historiques dans lesquelles les révolutionnaires russes devaient agir, en particulier des conditions d'illégalité, de clandestinité et de répression. Lénine avance trois points qui ont une valeur universelle et historique. Et dont la validité n'a fait que se confirmer jusqu'à nos jours. La première est que le militantisme communiste est un acte volontaire et sérieux (il utilise le mot “professionnel” qui est aussi repris par les mencheviks dans les débats au congrès) qui engage le militant et détermine sa vie. Nous avons toujours été d'accord avec cette conception de l'engagement militant qui combat et rejette toute vision ou attitude dilettante.
Deuxièmement, Lénine défend une vision des rapports entre militants communistes qui dépasse la division ouvrier-intellectuel ([21] [3739]), dirigeant-dirigé dirions-nous aujourd'hui, qui dépasse toute vision hiérarchique ou de supériorité individuelle, dans une communauté de lutte au sein du parti, au sein de l'organisation révolutionnaire. Et il s'oppose à toute division par métier ou par corporation entre les militants. Il rejette, par avance, les cellules d'entreprises qui seront mises en place lors de la bolchévisation au nom du léninisme ([22] [3740]).
Enfin, il définit une organisation qui “ne doit pas être étendue”. Il est le premier à percevoir que la période des partis ouvriers de masse s'achève ([23] [3741]). Certes, les conditions de la Russie favorisent surement cette clarté. Mais ce sont les nouvelles conditions de vie et de lutte du prolétariat, qui se manifestent en particulier par “la grève de masse”, qui déterminent aussi les nouvelles conditions d'activité des révolutionnaires, tout spécialement le caractère “moins étendu”, minoritaire, des organisations révolutionnaires dans la période de décadence du capitalisme qui s'ouvre au début du siècle.
“Mais ce serait (...) du "suivisme" que de penser que sous le capitalisme presque toute la classe ou la classe toute entière sera un jour en état de s'élever au point d'acquérir le degré de conscience et d'activité de son détachement d'avant-garde, de son Parti social-démocrate.” ([24] [3742])
Si Rosa Luxemburg, Pannekoek ou Trotsky sont parmi les premiers à tirer les leçons de l'apparition des grèves de masse et des conseils ouvriers à la même époque, ils restent encore prisonniers d'une vision des partis comme organisations politiques de masse. Rosa Luxemburg critique Lénine du point de vue d'un parti de masse ([25] [3743]). Au point d'arriver elle-aussi à déraper comme lorsqu'elle écrit que “en vérité la social-démocratie n'est pas liée à l'organisation de la classe ouvrière, elle est le mouvement propre de la classe ouvrière.” ([26] [3744]) Victime, elle-aussi, du “tordage de barre” dans la polémique, victime de son positionnement aux côtés des mencheviks sur la question en jeu lors du 2e congrès du POSDR, elle glisse malencontreusement à son tour sur le terrain des mencheviks et des économistes en noyant l'organisation des révolutionnaires dans la classe ([27] [3745]). Elle saura se ressaisir - et avec quel brio ! - par la suite. Mais sur la distinction entre organisation de l'ensemble de la classe ouvrière et organisation des révolutionnaires, les formules de Lénine restent les plus claires. Ce sont celles qui vont le plus loin.
Qui est membre du parti ?
Que faire? et Un pas en avant, deux pas en arrière représentent donc des avancées politiques essentiels dans l'histoire du mouvement ouvrier. Les deux ouvrages représentent plus exactement des acquis politiques “pratiques” sur le plan organisationnel. Comme Lénine, le CCI a toujours considéré la question organisationnelle comme une question politique à part entière. L'organisation politique de la classe se distingue de son organisation unitaire et cela a, à son niveau, des implications pratiques. Parmi celles-ci, la stricte définition de l'adhésion et de l'appartenance au parti, c'est à dire la définition du militant, de ses tâches, de ses devoirs, de ses droits, bref de ses rapports à l'organisation, est essentielle. La bataille du 2e congrès du POSDR autour de l'article 1 des statuts est connue : c'est le premier affrontement, au sein du congrès même, entre bolcheviks et mencheviks. La différence entre les formulations proposées par Lénine et Martov peut paraître tout à fait insignifiante :
Pour Lénine, “est membre du Parti celui qui en reconnaît le programme et soutient le Parti tant par des moyens matériels que par sa participation personnelle dans une des organisations du Parti.” Pour Martov, “est considéré comme appartenant au Parti ouvrier social-démocrate de Russie celui qui, tout en reconnaissant son programme, travaille activement à mettre en oeuvre ses tâches sous le contrôle et la direction des organismes du Parti.”
La divergence porte sur la reconnaissance de la qualité de membre soit aux seuls militants qui appartiennent au Parti et qui sont reconnus comme tel par ce dernier - c'est la position de Lénine -, soit aux militants qui n'appartiennent pas formellement au Parti, qui à tel ou tel moment, et sur telle ou telle activité apportent un soutien au Parti, ou bien se déclarent eux-mêmes social-démocrates. La position de Martov et des mencheviks est donc beaucoup plus large, plus “souple”, moins restrictive et moins précise que celle de Lénine.
Derrière cette différence se cache une question de fond qui est vite apparue durant le congrès et à laquelle les organisations révolutionnaires sont encore confrontées de nos jours : qui est membre du parti et, plus difficile encore parfois à définir, qui ne l'est pas ?
Pour Martov, c'est clair : “Plus sera généralisée l'appellation de membre du parti, mieux cela vaudra. Nous ne pouvons que nous réjouir si chaque gréviste, chaque manifestant, en prenant la responsabilité de ses actes, peut se déclarer membre du Parti.” ([28] [3746])
La position de Martov tend à diluer, à dissoudre l'organisation des révolutionnaires, le parti dans la classe. Il rejoint l'économisme qu'il combattait auparavant aux côtés de Lénine. L'argumentation qu'il donne à sa proposition de Statut revient à liquider l'idée même de parti d'avant-garde, uni, centralisé et discipliné autour d'un Programme politique bien défini, bien précis et d'une volonté d'action militante et collective encore plus définie, précise et rigoureuse. Elle ouvre aussi la porte à des politiques opportunistes de “recrutement” sans principe de militants qui hypothèquent le développement du parti sur le long terme au profit de résultats immédiats. C'est Lénine qui a raison :
“Au contraire, plus fortes seront nos organisations du Parti englobant de véritables social-démocrates, moins il y aura d'hésitation et d'instabilité à l'intérieur du Parti, et plus large, plus variée, plus riche et plus féconde sera l'influence du Parti sur les éléments de la masse ouvrière qui l'environnent et sont dirigés par lui. Il n'est pas permis en effet de confondre le Parti, avant-garde de la classe ouvrière, avec toute la classe.” ([29] [3747])
L'extrême danger de la position opportuniste de Martov en matière d'organisation, de recrutement, d'adhésion et d'appartenance au parti apparaît très rapidement dans le congrès même avec l'intervention d'Axelrod : “On peut être un membre sincère et dévoué du parti social-démocrate, mais être complètement inadapté à l'organisation de combat rigoureusement centralisée.” ([30] [3748])
Comment peut-on être membre du parti, militant communiste, et “être inadapté à l'organisation de combat centralisée” ? Accepter une telle idée est tout aussi absurde qu'accepter l'idée d'un ouvrier combatif et révolutionnaire qui serait “inapte” à toute action collective de classe. Toute organisation communiste se doit de n'accepter en son sein que des militants aptes à sa discipline et à la centralisation de son combat. Comment peut-il en être autrement ? Sinon à accepter que les militants ne soient pas impérativement respectueux des rapports d'organisation et des décisions adoptées par celle-ci et de la nécessité du combat. Sinon à ridiculiser la notion même d'organisation communiste qui doit être “la fraction la plus résolue de tous les partis ouvriers de tous les pays, la fraction qui entraîne toutes les autres.” ([31] [3749]) La lutte historique du prolétariat est un combat de classe uni sur le plan historique et sur le plan international, collectif et centralisé. Et, à l'image de leur classe, les communistes mènent un combat historique, international, permanent, uni, collectif et centralisé qui s'oppose à toute vision individualiste. “Si la conscience critique et l'initiative volontaire n'ont qu'une valeur très limitée pour les individus, elles se trouvent pleinement réalisées dans la collectivité du Parti.” ([32] [3750]) Quiconque est incapable de s'inscrire dans ce combat centralisé est inapte à l'activité militante et ne peut être reconnu comme membre du parti. “Que le Parti n'admette que des éléments susceptibles d'au moins un minimum d'organisation.” ([33] [3751])
Cette “aptitude” est le fruit de la conviction politique et militante des communistes. Elle s'acquiert et se développe dans la participation à la lutte historique du prolétariat, tout particulièrement au sein de ses minorités politiques organisées. Pour toute organisation communiste conséquente, la conviction et l'aptitude “pratique” - non platonique - pour “l'organisation de combat rigoureusement centralisée” de tout nouveau militant sont à la fois des conditions indispensables pour son adhésion ainsi que des manifestations concrètes de son accord politique avec le Programme communiste.
La définition du militant, de la qualité de membre d'une organisation communiste est encore aujourd'hui une question essentielle. Que faire ? et Un pas en avant, deux pas en arrière fournissent les fondements et les réponses à de multiples questions en matière d'organisation. C'est pour cela que le CCI s'est toujours appuyé sur le combat des bolcheviks au 2e congrès pour distinguer, avec clarté, rigueur et fermeté un militant, c'est à dire celui “qui participe personnellement dans une des organisations du Parti”, comme le défend Lénine, et un sympathisant, un compagnon de route celui qui “adopte le programme, soutient le Parti par des moyens matériels et lui prête un concours personnel régulier [ou irrégulier, ajouterons-nous] sous la direction d'une de ses organisations”, tel que l'exprime la définition du militant selon Martov et qui est finalement adoptée par le 2e congrès. De même, nous avons toujours défendu que “dès l'instant où tu veux être membre du Parti, tu dois reconnaître aussi les rapports d'organisation, et pas seulement platoniquement.” ([34] [3752])
Tout cela n'est pas nouveau pour le CCI. C'est à la base même de sa constitution comme le prouve l'adoption de ses Statuts dès son premier congrès international en janvier 1976.
Il serait erroné de croire que cette question ne pose plus problème aujourd'hui. D'abord, le courant conseilliste, même si ces dernières expressions politiques sont silencieuses, sinon sur le point de disparaître ([35] [3753]), reste aujourd'hui une sorte d'héritier de l'économisme et du menchevisme en matière d'organisation. Dans une période de plus grande activité de la classe ouvrière, il ne fait pas de doute que les pressions d'ordre conseilliste pour “se leurrer soi-même, fermer les yeux sur l'immensité de nos tâches, restreindre ces tâches [en oubliant] la différence entre le détachement d'avant-garde et les masses qui gravitent autour de lui” ([36] [3754]) prendront une nouvelle vigueur. Ensuite, même dans le milieu qui se revendique exclusivement de la Gauche Italienne et de Lénine, c'est-à-dire le courant bordiguiste et le BIPR, la mise en pratique de la méthode de Lénine et de sa pensée politique en matière d'organisation est loin d'être un acquis. Il n'est que de voir la politique de recrutement sans principe du PCI bordiguiste dans les années 1970. Cette politique de type activiste et immédiatiste a d'ailleurs fini par précipiter son explosion de 1982. Il n'est que de voir le manque de rigueur du BIPR (qui regroupe Battaglia Comunista en Italie, et la CWO en Grande-Bretagne) qui a du mal parfois à décider qui est militant de l'organisation ([37] [3755]) et qui n'en est qu'un sympathisant, un contact proche; et cela malgré tous les risques qu'un tel flou organisationel comporte. L'opportunisme en matière d'organisation est aujourd'hui un des plus dangereux poisons pour le milieu politique prolétarien. Et malheureusement, les incantations à propos de Lénine et la nécessité du “Parti compact et puissant” ne peuvent servir d'antidote.
Lénine et le CCI : une même conception du militantisme
Que dit Rosa Luxemburg, dans sa polémique avec Lénine, sur la question du militant et de son appartenance au parti ?
“La conception qui est exprimée dans ce livre [Un pas en avant, deux pas en arrière] d'une manière pénétrante et exhaustive, est celle d'un centralisme impitoyable; son principe vital exige, d'un côté, que les phalanges organisées de révolutionnaires avoués et actifs sortent et se séparent résolument du milieu qui les entoure et qui, quoique non organisé, n'en est pas moins révolutionnaire; on y défend, d'autre part, une discipline rigide.” ([38] [3756])
Sans se prononcer explicitement contre la définition précise du militant donné par Lénine, le ton ironique qu'elle a quand elle évoque “les phalanges organisées qui sortent et se séparent du milieu qui les entoure” et... son silence complet sur la bataille politique au congrès autour de l'article 1 des statuts, indiquent la vision erronée de Rosa Luxemburg, à ce moment-là, et son positionnement aux côtés des mencheviks. Elle reste prisonnière de la vision du parti de masse donnée en exemple par la social-démocratie allemande d'alors. Elle ne voit pas le problème ou l'esquive, se trompant de combat. Le fait qu'elle ne dise rien sur le débat autour de l'article 1 des statuts lors du congrès, vient donner raison à Lénine quand il affirme qu'elle “se borne à ressasser des phrases creuses sans chercher à leur donner un sens. Elle brandit des épouvantails sans aller au fond du débat. Elle me fait dire des lieux communs, des idées générales, des vérités absolues et s'efforce de rester muette sur des vérités relatives qui s'appuient sur des faits précis.” ([39] [3757])
Comme dans le cas de Plékhanov et de beaucoup d'autres, les considérations générales avancées par Rosa Luxemburg - même quand elles sont justes en soi - ne répondent pas aux vraies questions politiques posées par Lénine. “C'est ainsi qu'un souci correct : insister sur le caractère collectif du mouvement ouvrier, sur le fait que «l'émancipation des travailleurs sera l'oeuvre des travailleurs eux-même”, entraîne de fausses conclusions pratiques » disions-nous déjà à son sujet en 1979 ([40] [3758]). Elle passe à côté des acquis politiques du combat des bolcheviks.
Or, sans le débat sur l'article 1, la question du parti clairement défini et clairement distinct, organisationnellement et politiquement, de l'ensemble de la classe ouvrière n'aurait pas été définitivement tranchée. Sans le combat mené par Lénine sur l'article 1, la question ne serait pas un acquis politique de première importance en matière d'organisation sur lequel les communistes d'aujourd'hui doivent impérativement s'appuyer pour constituer leur organisation, non seulement pour l'adhésion de nouveaux militants, mais aussi et surtout pour l'établissement clair, précis et rigoureux des rapports des militants à l'organisation révolutionnaire.
Est-ce que cette défense de la position de Lénine sur l'article 1 des statuts est nouvelle pour le CCI ? Avons-nous changé de position ?
“Pour être membre du CCI, il faut [...] s'intégrer dans l'organisation, participer activement à son travail et s'acquitter des tâches qui lui sont confiées” affirme l'article de nos statuts qui traite de la question de l'appartenance militante au CCI. Il est très clair que nous reprenons, sans aucune ambiguïté, la conception de Lénine, l'esprit et même la lettre du statut qu'il a proposé au 2e congrès du POSDR et surement pas celle de Martov et Trotsky. Il est dommage que les ex-membres du CCI qui nous accusent aujourd'hui d'être devenus “léninistes” aient oublié ce qu'ils avaient eux-mêmes adopté à l'époque. Sans doute l'avaient-ils fait avec une coupable légèreté et une grande insouciance dans l'enthousiasme estudiantin post-soixante-huitard. En tout cas, ils sont aujourd'hui particulièrement malhonnêtes quand ils accusent le CCI d'avoir changé de position afin de laisser entendre qu'ils seraient, eux, fidèles au vrai CCI, celui des origines.
LE CCI AUX COTES DE LENINE SUR LES STATUTS
Nous avons rapidement présenté notre conception du militant révolutionnaire et montré en quoi elle est l'héritière, pour une grande part du combat et des apports de Lénine dans Que faire ? et Un pas en avant, deux pas en arrière. Nous avons souligné l'importance de traduire le plus fidèlement et le plus rigoureusement possible dans la pratique militante quotidienne, au moyen des statuts de l'organisation, cette définition du militant. Et là encore, nous sommes fidèles depuis toujours à la méthode et aux enseignements de Lénine en matière d'organisation. Le combat politique pour l'établissement de règles précises régissant les rapports organisationnels, c'est-à-dire des statuts, est fondamental. Tout comme le combat pour leur respect bien sûr. Sans celui-ci, les grandes déclarations tonitruantes sur le Parti ne restent que des rodomontades.
Dans le cadre de cet article nous ne pouvons, faute de place, présenter notre conception de l'unité de l'organisation politique et montrer en quoi la lutte de Lénine contre le maintien des cercles, au 2e congrès du POSDR, est un apport théorique et politique considérable. Mais nous voulons insister sur l'importance pratique qu'il y a à traduire la nécessité de cette unité dans les statuts de l'organisation : “Le caractère unitaire du CCI s'exprime également dans les présents statuts” (statuts du CCI). Lénine en exprime très bien la raison et la nécessité.
“L'anarchisme de grand seigneur ne comprend pas que des statuts formels sont nécessaires précisément pour remplacer les liens limités des cercles par la large liaison du Parti. Le lien, à l'intérieur des cercles ou entre eux, ne devait ni ne pouvait revêtir une forme précise, car il était fondé sur la camaraderie ou sur une "confiance" incontrôlée et non motivée. La liaison du Parti ne peut et ne doit reposer ni sur l'une ni sur l'autre, mais sur des statuts formels, rédigés "bureaucratiquement" ([41] [3759]) (du point de vue de l'intellectuel indiscipliné), dont seule la stricte observation nous prémunit contre le bon plaisir et les caprices des cercles, contre leurs disputailleries appelées libre "processus" de la lutte idéologique.” ([42] [3760])
Il en est de même de la centralisation de l'organisation contre toute vision fédéraliste, localiste, ou vision de l'organisation comme une somme de parties, voire d'individus révolutionnaires, autonomes. “Le congrès international est l'organe souverain du CCI” (statuts du CCI). Sur ce plan aussi, nous nous revendiquons du combat de Lénine et de sa nécessaire traduction pratique dans les statuts de l'organisation, tant pour le POSDR à l'époque, que pour les organisations d'aujourd'hui.
“A l'époque du rétablissement de l'unité véritable du Parti et de la dissolution, dans cette unité, des cercles qui ont fait leur temps, ce sommet est nécessairement le congrès du Parti, organisme suprême de ce dernier.” ([43] [3761])
C’est la même chose pour ce qui est de la vie politique interne : l'apport de Lénine concerne aussi et particulièrement les débats internes, le devoir - et non pas le simple droit - d'expression de toute divergence dans le cadre organisationnel face à l'ensemble de l'organisation; et une fois les débats tranchés et les décisions prises par le congrès (qui est l'organe souverain, la véritable assemblée générale de l'organisation), la subordination des parties et des militants au tout. Contrairement à l'idée, copieusement repandue, d'un Lénine dictatorial, cherchant à étouffer les débats et la vie politique dans l'organisation, celui-ci, en réalité, ne cesse de s'opposer à la vision menchevik qui voit le congrès comme “un enregistreur, un contrôleur, mais pas un créateur.” ([44] [3762])
Pour Lénine et pour le CCI, le congrès est “créateur”. En particulier, nous rejetons radicalement toute idée de mandats impératifs des délégués par leurs mandants au congrès, ce qui est contraire aux débats les plus larges, les plus dynamiques et les plus fructueux. Et ce qui réduirait les congrès à n'être que des “enregistreurs” comme le voulait Trotsky en 1903. Un congrès “enregistreur” consacrerait la suprématie des parties sur le tout, le règne du “bougnat maître chez soi”, du localisme et du fédéralisme. Un congrès “enregistreur et contrôleur” est la négation du caractère souverain du congrès. Comme Lénine, nous sommes pour des congrès “organisme suprême” du parti qui ont pouvoir de décision et de “création”. Le congrès “créateur” implique des délégués qui ne sont pas “impérativement” limités, les mains liées, prisonniers du mandat qui leur est donné par leur mandants ([45] [3763]).
Le congrès “organe suprême” implique aussi sa suprématie, en terme programmatique, politique et d'organisation, sur toutes les différentes parties de l'organisation communiste.
"Le congrès est l'instance suprême du Parti". Donc celui-là transgresse la discipline du Parti et le règlement du congrès qui, d'une façon ou d'une autre, empêche un délégué de s'adresser directement au congrès sur toutes les questions de la vie du Parti, sans réserve ni exception. La controverse se ramène par conséquent au dilemme : l'esprit de cercle ou l'esprit de Parti ? Limitation des droits des délégués au congrès, au nom de droits ou règlements imaginaires de toutes sortes de collèges ou cercles, ou dissolution complète, non seulement verbale, mais effective, devant le congrès, de toutes les instances inférieures, des anciens petits groupes.” ([46] [3764])
Et sur ces points aussi, non seulement nous nous revendiquons du combat de Lénine, mais nous traduisons dans les règles organisationnelles, c'est à dire dans les statuts de notre organisation, ces conceptions dont nous sommes les héritiers et dont nous nous considérons comme les véritables continuateurs.
Les statuts ne sont pas des mesures exceptionnelles
Nous avons vu que Rosa Luxemburg et Trotsky, pour ne citer qu'eux, ne répondent pas à Lénine sur l'article 1 des statuts. Ils négligent complètement cette question tout comme celle des statuts en général. Ils préfèrent en rester, là-aussi, à des généralités abstraites. Et quand ils daignent évoquer la question des statuts, c'est pour la sous-estimer complètement. Au mieux, ils considèrent les statuts de l'organisation politique simplement comme des garde-fous, des bornes qui délimitent les côtés de la route et qu'il ne faut pas franchir. Au pire, ce ne sont que des outils de répression, des mesures exceptionnelles à n'utiliser qu'avec une extrême précaution. Relevons au passage que cette vision des statuts est la même que celle du stalinisme : lui aussi ne voit dans les statuts que des mesures de répression, la différence ne se situant que dans l'absence de “précaution”.
Pour Trotsky, la formule de Lénine dans l'article 1 aurait laissé “la satisfaction platonique [d'avoir] découvert le plus sûr remède statutaire contre l'opportunisme [...]. Aucun doute : il s'agit d'une manière simpliste, typiquement administrative de résoudre une question pratique sérieuse.” ([47] [3765])
Rosa Luxemburg elle-même répond à Trotsky, sans le savoir bien sûr, quand elle affirme que, dans le cas d'un parti déjà constitué (dans le cas d'un parti social-démocrate de masse comme en Allemagne), “une application plus sévère de l'idée centraliste dans le statut d'organisation et une formulation plus stricte des paragraphes de la discipline de parti sont très appropriées en tant que digue contre le courant opportuniste.” (48[48] [3766]) Elle est donc d'accord avec Lénine pour le cas allemand, c'est-à-dire en général. Pour le cas russe par contre, elle commence par dire des “vérités abstraites” (“Les égarements opportunistes ne peuvent être prévenus a priori, ils doivent être dépassé par le mouvement lui-même”) qui ne veulent rien dire et qui, dans la réalité, justifient “a priori” tout renoncement à la lutte contre l'opportunisme en matière d'organisation. Ce qu'elle ne manque pas de faire par la suite, toujours pour le cas du parti russe, c'est-à-dire dans le concret, en se moquant des statuts comme “des paragraphes de papier”, des “moyens paperassiers” et en les considérant comme des mesures exceptionnelles :
“Le statut du Parti ne devrait pas être une arme contre l'opportunisme, mais seulement un moyen d'autorité externe pour exercer l'influence prépondérante de la majorité révolutionnaire prolétarienne réellement existante dans le Parti.” ([49] [3767])
Nous n'avons jamais été d'accord avec Rosa Luxemburg sur ce point : “Rosa continue à répéter que c'est au mouvement de masse lui-même à surmonter l'opportunisme ; les révolutionnaires n'ont pas à accélérer artificiellement ce mouvement. [...] Ce que Rosa Luxemburg ne parvient pas à comprendre, c'est le fait que le caractère collectif de l'action révolutionnaire est quelque chose qui se forge.” ([50] [3768]) Sur la question des statuts, c'est avec Lénine que nous sommes et avons toujours été d'accord.
Les statuts comme règle de vie et comme arme de combat
Pour Lénine, les statuts sont beaucoup plus que de simples règles formelles de fonctionnement, règles auxquelles on ferait appel qu'en cas de situation exceptionnelle. A l'opposé de Rosa Luxemburg, ou des mencheviks, Lénine définit les statuts comme des lignes de conduite, comme l'esprit qui doit animer l'organisation et ses militants au quotidien. A l'opposé de la compréhension des statuts comme des moyens de répression ou de coercition, Lénine comprend les statuts comme des armes imposant la responsabilité des différentes parties de l'organisation et des militants, vis-à-vis de l'ensemble de l'organisation politique ; des armes contraignant au devoir d'expression ouverte, publique, devant toute l'organisation, des divergences et des difficultés politiques.
Lénine ne considère pas l'expression des points de vue, des nuances, des discussions, des divergences comme un droit des militants, un droit de l'individu face à l'organisation mais comme un devoir et une responsabilité vis-à-vis de l'ensemble du parti et de ses membres. Le militant communiste est responsable, devant ses camarades de lutte, de l'unité politique et organisationnelle du parti. Les statuts sont des outils au service de l'unité et de la centralisation de l'organisation, donc des armes contre le fédéralisme, contre l'esprit de cercle, contre le copinage, contre toute vie et discussions parallèles. Plus que des limites extérieures, plus même que des règles, les statuts, pour Lénine, sont comme un mode de vie politique, organisationnelle et militante.
“Les questions controversées, à l'intérieur des cercles, n'étaient pas tranchées d'après des statuts, «mais par la lutte et la menace de s'en alle” [...]. Quand j'étais uniquement membre d'un cercle [...], j'avais le droit, afin de justifier, par exemple, mon refus de travailler avec X, d'invoquer seulement ma défiance, incontrôlée, non motivée. Devenu membre du Parti, je n'ai pas le droit d'invoquer uniquement une vague défiance, car ce serait ouvrir toute grande la porte à toutes les lubies et à toutes les extravagances des anciens cercles ; je suis obligé de motiver ma confiance ou ma "défiance" par un argument formel, c'est-à-dire de me référer à telle à telle disposition formellement établie de notre programme, de notre tactique, de nos statuts. Mon devoir est de ne plus me borner à un «je fais confiance» ou «je ne fais pas confiance» incontrôlé, mais de reconnaître que je suis comptable de mes décisions, et qu'une fraction quelconque du Parti l'est des siennes, devant l'ensemble du Parti ; je dois suivre une voie formellement prescrite pour exprimer ma «défiance», pour faire triompher les idées et les désirs qui découlent de cette défiance. De la «confiance» incontrôlée, propre aux cercles, nous nous sommes élevés à une conception de parti qui réclame l'observation de formes strictes et de motifs déterminés pour exprimer et vérifier la confiance.” ([51] [3769])
Les statuts de l'organisation révolutionnaire ne sont pas de simples mesures exceptionnelles, des garde-fous. Ils sont la concrétisation des principes organisationnels propres aux avant-gardes politiques du prolétariat. Produits de ces principes, ils sont à la fois une arme du combat contre l'opportunisme en matière d'organisation et les fondements sur lesquels l'organisation révolutionnaire doit s'élever et se construire. Ils sont l'expression de son unité, de sa centralisation, de sa vie politique et organisationnelle et de son caractère de classe. Ils sont la règle et l'esprit qui doivent guider quotidiennement les militants dans leur rapport à l'organisation, dans leurs relations avec les autres militants, dans les tâches qui leur sont confiées, dans leurs droits et leurs devoirs, dans leur vie quotidienne personnelle qui ne peut être en contradiction ni avec l'activité militante ni avec les principes communistes.
Pour nous, comme pour Lénine, la question organisationnelle est une question politique à part entière. Plus même, c'est une question politique fondamentale. L'adoption des statuts et le combat permanent pour leur respect et leur mise en application est au coeur de la compréhension et de la bataille pour la construction de l'organisation politique. Les statuts, eux-aussi, sont une question théorique et politique à part entière. Est-ce une découverte pour notre organisation ? Un changement de position ?
“Le caractère unitaire du CCI s'exprime également dans les présents statuts qui sont valables pour toute l'organisation [...]. Ces statuts constituent une application concrète de la conception du CCI en matière d'organisation. Comme tels, ils font partie intégrante de la plate-forme du CCI.” (Statuts du CCI)
LE PARTI COMMUNISTE SE CONSTRUIRA SUR LES ACQUIS POLITIQUES ORGANISATIONNELS APPORTES PAR LENINE
Dans la lutte du prolétariat, ce combat de Lénine représente un des moments essentiels pour la constitution de son organe politique qui s'est finalement concrétisé avec la fondation de l'International Communiste (IC) en mars 1919. Avant Lénine, la première internationale (AIT) avait représenté un moment tout aussi important. Après Lénine, le combat de la fraction italienne de la Gauche communiste pour sa propre survie organisationnelle, a représenté un autre moment important.
Entre ces différentes expériences, il y a un fil rouge, une continuité principielle, théorique, politique en matière d'organisation. Les révolutionnaires d'aujourd'hui ne peuvent ancrer leur action que dans cette continuité et dans cette unité historique.
Nous avons déjà amplement cité nos propres textes qui rappellent clairement et sans ambiguïté notre filiation et notre héritage en matière d'organisation. Notre “méthode” de réappropriation des acquis politiques et théoriques du mouvement ouvrier n'est pas une invention du CCI.
Nous en avons hérité de la fraction italienne de la Gauche communiste et de sa publication Bilan dans les années 1930, ainsi que de la Gauche communiste de France et sa revue Internationalisme dans les années 1940. C'est la méthode dont nous nous sommes toujours revendiqué et sans laquelle le CCI n'existerait pas, en tout cas pas dans sa forme actuelle.
“L'expression la plus achevée de la solution au problème du rôle que l'élément conscient, le parti, est appelé à jouer pour la victoire du socialisme, a été donnée par le groupe de marxistes russes de l'ancienne Iskra, et tout particulièrement par Lénine qui, dès 1902, a donné une définition principielle du problème du parti dans son remarquable ouvrage Que faire ?. La notion de Parti de Lénine servira de colonne vertébrale au parti bolchevik et sera un des plus grands apports de ce parti dans la lutte internationale du prolétariat.” ([52] [3770])
Effectivement, et sans aucun doute, le Parti communiste mondial de demain ne pourra se constituer en dehors des acquis principiels, théoriques, politiques, et organisationnels que nous a fournis Lénine. La réappropriation réelle et non pas déclamatoire de ces acquis, tout comme leur mise en application rigoureuse et systématique aux conditions d'aujourd'hui, sont une des plus importantes tâches que les petits groupes communistes d'aujourd'hui doivent assumer s'ils veulent contribuer au processus de constitution de ce Parti.
RL
[1] [3771] Brochure du CCI sur Organisations communistes et conscience de classe, 1979.
[2] [3772] Kautsky, cité par Lénine dans Que faire ?
[3] [3773] Trotsky, Nos tâches politiques, chap. Au nom du marxisme !, Editions P. Belfond, 1970.
[4] [3774] PV du 2°congrès du POSDR, édition Era, 1977, traduit de l'espagnol par nous.
[5] [3775] P. Axelrod, Sur l'origine et la signification de nos divergences organisationnelles, lettre à Kautsky, 1904, idem.
[6] [3776] G. Plékhanov, La classe ouvrière et les intellectuels social-démocrates, 1904, idem.
[7] [3777] Voir Grève de masse, parti et syndicats (R. Luxemburg, 1906) et 1905 (Trotsky, 1908-1909).
[8] [3778] Voir la première partie de cet article dans le n°96 de cette revue.
[9] [3779] Lénine, Rapport sur 1905, janvier 1917.
[10] [3780] Lénine, Que faire ?.
[11] [3781] K. Marx est beaucoup plus clair sur la question dans ses travaux. Mais ces derniers sont, pour une bonne partie d'entre eux, inconnus parmi les révolutionnaires à l'époque, car pas disponibles ou pas publiés. Ouvrage fondamental sur la question de la conscience, L'idéologie allemande, par exemple, ne sera publié pour la première fois qu'en... 1932 !
[12] [3782] Lénine, Que faire ?.
[13] [3783] Idem.
[14] [3784] Organisations communistes et conscience de classe, brochure du CCI, 1979.
[15] [3785] Cet article n'est pas du CCI, mais des camarades du Grupo Proletario Internacionalista qui ont par la suite constitué la section du CCI au Mexique. L'objet de l'article "avant de critiquer Lénine [est de] le défendre, essayer de restituer sa pensée, exprimer clairement quelles étaient sa préoccupation et ses intentions dans le combat contre le courant “économiste” contre la compréhension partielle et partiale de Que faire ? par le BIPR. Il oppose les passages cités, "la préoccupation, les intentions" de Lénine à la position du BIPR qui considère qu'"admettre que l'ensemble ou même la majorité de la classe ouvrière, compte tenu de la domination du capital, peut acquérir une conscience communiste avant la prise du pouvoir et l'instauration de la dictature du prolétariat, c'est purement et simplement de l'idéalisme" (La conscience de classe dans la perspective communiste, Revue Communiste n°2, publié par le BIPR).
[16] [3786] "Conscience de classe et Parti", Revue Internationale n° 57, 1989.
[17] [3787] Au milieu des mensonges de la bourgeoisie, il convient de relever la petite contribution de RV, ex-militant du CCI, qui déclare qu'"il y a une véritable continuité et cohérence entre les conceptions de 1903 et des actions comme l'interdiction des fractions au sein du parti bolchévik ou l'écrasement des ouvriers insurgés à Kronstadt" (RV, "Prise de position sur l'évolution récente du CCI", publié par nos soins dans notre brochure sur La prétendue paranoïa du CCI).
[18] [3788] Lénine, "Thèses d'Avril", 1917.
[19] [3789] Lénine, Que faire ?
[20] [3790] Idem, c'est Lénine qui souligne.
[21] [3791] Il n'est pas besoin de rappeler ici la faiblesse du niveau "scolaire" et l'analphabétisme qui régnaient parmi les ouvriers russes. Ca n'empêche pas Lénine de considérer qu'ils peuvent et doivent s'intégrer à l'activité du parti au même titre que les "intellectuels".
[22] [3792] Voir la première partie de cet article dans la revue précédente.
[23] [3793] "Rupture sera faite également, par lui, avec la vision social-démocrate du parti de masse. Pour Lénine, les conditions nouvelles de la lutte imposent la nécessité d'un parti minoritaire d'avant-garde qui doit oeuvrer pour la transformation des luttes économiques en luttes politiques" (Organisations communistes et conscience de classe, CCI. 1979).
[24] [3794] Lénine, Un pas en avant, deux pas en arrière, sur le paragraphe 1 des statuts.
[25] [3795] "Cette militante qui est passée par les écoles du parti social-démocrate, développe un attachement inconditionnel au caractère de masse du mouvement révolutionnaire" (Organisations communistes et conscience de classe, CCI. 1979).
[26] [3796] Rosa Luxemburg, Questions d'organisation dans la social-démocratie russe, chap1, Belfond.
[27] [3797] Le lecteur aura remarqué aussi que cette vision laisse grande ouverte la porte à la position substitutionniste du parti - le parti se substituant à l'action de la classe ouvrière... jusqu'à exercer le pouvoir d'Etat en son nom ou bien à réaliser des actions "putchistes" comme le feront les staliniens dans les années 1920.
[28] [3798] Martov, cité par Lénine dans Un pas en avant, deux pas en arrière, i) le paragraphe 1 des statuts.
[29] [3799] Lénine, Un pas en avant, deux pas en arrière, i) le paragraphe premier des statuts
[30] [3800] Procès-verbal du 2e congrès du POSDR, édition Era, 1977, traduit de l'espagnol par nous.
[31] [3801] K. Marx, Le Manifeste du Parti Communiste.
[32] [3802] Thèses sur la tactique du Parti Communiste d'Italie, Thèses de Rome, 1922.
[33] [3803] Lénine, Un pas en avant, deux pas en arrière, souligné par Lénine, i) paragraphe premier.
[34] [3804] Le bolchevik Pavlovitch cité par Lénine dans Un pas en avant, deux pas en arrière.
[35] [3805] Voir notre presse territoriale sur l'arrêt de la publication de Daad en Gedachte, la revue du groupe conseilliste hollandais du même nom.
[36] [3806] Lénine, Un pas en avant, deux pas en arrière.
[37] [3807] Nous avons déjà critiqué le flou et l'opportunisme de BC en Italie sur cette question à propos des militants des GPL (cf. notre presse territoriale, en français Révolution Internationale n° 285, décembre 1998). Ce cas n'est pas isolé : est apparu sur le site Internet du BIPR un article "Est-ce les révolutionnaires doivent travailler dans les syndicats réactionnaires ?" Dans cet article, non signé, et où l'auteur peut apparaître comme membre de la CWO, il est répondu à la question du titre : "les matérialistes, pas les idéalistes, doivent répondre par l'affirmative" avec deux arguments principaux. "Beaucoup de travailleurs combatifs se trouvent dans les syndicats" et "les communistes ne doivent pas mépriser ces organisations qui regroupent les travailleurs en masse" (sic). Cette position est en contradiction complète avec la position de BC - et donc du BIPR nous supposons - réaffirmée lors de son dernier congrès qui défend qu'"il ne peut y avoir de réelle défense des intérêts ouvriers, même les plus immédiats, qu'en dehors et contre la ligne syndicale". Et surtout, le problème est qu'on ne saît pas qui a écrit l'article : un militant ou un sympathisant du BIPR ? Et dans les deux cas, pourquoi aucune prise de position, aucune critique ? Est-ce par oubli ? Par opportunisme afin de recruter un nouveau militant apparemment mal dégagé du gauchisme ? Ou bien par simple sous-estimation de la question organisationnelle ? Une fois de plus pour les groupes du BIPR, cela sent son Martov... Depuis, à notre connaissance, le texte a été retiré sans autre mention du site internet.
[38] [3808] Rosa Luxemburg, Questions d'organisation de la social-démocratie russe.
[39] [3809] Lénine, Réponse à Rosa Luxemburg, publié dans Nos tâches politiques, Trotsky, Edition Belfond.
[40] [3810] Organisations communistes et conscience de classe, CCI.
[41] [3811] Encore un exemple de la méthode polémique de Lénine qui reprend les accusations de ses adversaires pour les retourner contre eux (cf. la première partie de cet article).
[42] [3812] Lénine, Un pas en avant, deux pas en arrière. q) la nouvelle Iskra.
[43] [3813] Idem.
[44] [3814] Trotsky, Rapport de la délégation sibérienne.
[45] [3815] Le délégué du Parti Communiste Allemand, Eberlein à ce qui n'était au départ qu'une conférence internationale en mars 1919, avait le mandat de s'opposer à la constitution de la 3e Internationale, de l'Internationale Communiste (IC). Il était clair pour tous les participants, en particulier, Lénine, Trotsky, Zinoviev, les dirigeants bolcheviks, que la fondation de l'IC ne pouvait se faire sans l'adhésion du PC allemand. Si Eberlein était resté "prisonnier" d'un mandat impératif, sourd aux débats et à la dynamique même de la conférence, l'Internationale comme Parti mondial du prolétariat, n'aurait pas été fondée.
[46] [3816] Lénine, Un pas en avant, deux pas arrière, chap c) début du congrès.
[47] [3817] Trotsky, Rapport de la délégation sibérienne.
[48] [3818] Rosa Luxemburg, Question d'organisation d'organisation de la social-démocratie russe.
[49] [3819] Idem, souligné par nous.
[50] [3820] Organisations communistes et conscience de classe, CCI, 1979.
[51] [3821] Lénine, Un pas en avant, deux pas en arrière. q) l'opportunisme en matière d'organisation.
[52] [3822] Internationalisme n° 4, 1945.
Conscience et organisation:
Courants politiques:
- Gauche Communiste [49]
Heritage de la Gauche Communiste:
Revue Internationale no 98 - 3e trimestre 1999
- 3260 reads
EDITORIAL : La “paix” au Kosovo, un moment de la guerre impérialiste
- 2771 reads
“Nous sommes dans un monde un peu fou. Le Kosovo où l'on découvre chaque jour des crimes contre l'humanité ; les autres conflits moins spectaculaires mais aussi porteurs d'horreurs en Afrique et en Asie ; les crises économiques et financières qui éclatent soudain, imprévues, destructrices, la misère qui s'accroît dans bien des parties du monde...” (Le Monde, 22/6). Dix ans après la fin de la “guerre froide”, l'éclatement du bloc de l'Est et la disparition de l'URSS, dix ans après les proclamations dithyrambiques sur la “victoire du capitalisme” et les déclarations enthousiastes sur l'ouverture d'une “ère de paix et de prospérité”, voilà le constat désabusé, ou plutôt cynique, –mais discret– d'un des principaux dirigeants de la bourgeoisie, le président français, Jacques Chirac. Autre homme politique éminent de la bourgeoisie, l'ex-président américain Jimmy Carter trace exactement le même bilan sur la réalité du capitalisme depuis 1989. “Quand la guerre froide a pris fin il y a dix ans, nous nous attendions à une ère de paix. Ce que nous avons eu à la place c'est une décennie de guerre” (International Herald Tribune, 17/6). La situation du monde capitaliste est catastrophique. La crise économique jette des milliards d'êtres humains dans le dénuement et la misère la plus complète. La moitié de la population mondiale vit avec moins de 1,50 $ (1,53 €) par jour et un milliard d'hommes et de femmes avec moins de 1 $ (0,76 €) (Le Monde Diplomatique, juin 99). La guerre et son cortège d'atrocités font rage sur tous les continents. Cette folie –pour reprendre l'expression de J. Chirac– implacable, dévastatrice, sanglante et meurtrière est la conséquence de l'impasse historique du monde capitaliste dont les guerres au Kosovo et en Serbie, entre l'Inde et le Pakistan –deux pays dotés de l'arme nucléaire–, sont les dernières illustrations dramatiques.
Au moment où la guerre aérienne s'est achevée sur la Yougoslavie, où les grandes puissances impérialistes crient une nouvelle fois victoire, où les médias développent d'énormes campagnes sur les bienfaits humanitaires de la guerre menée par l'OTAN et sur la noble cause qu'elle défendait, au moment où l'on parle de reconstruction, de paix et de prospérité pour les Balkans, il est bon de retenir les confidences discrètes –dans un moment de lassitude?– de J. Carter et J. Chirac. Elles dévoilent la réalité des campagnes idéologiques que nous subissons chaque jour : elles ne sont que des mensonges.
A nous, communistes, elles ne nous apprennent rien. Depuis toujours, le marxisme[1] [3823] a défendu au sein du mouvement ouvrier que le capitalisme ne pouvait mener qu'à l'impasse économique, à la crise, à la misère et aux conflits sanglants entre Etats bourgeois. Depuis toujours, et plus particulièrement depuis la 1re guerre mondiale, le marxisme a affirmé que “le capitalisme, c'est la guerre”. Un temps de paix n'est qu'un moment de préparation à la guerre impérialiste ; plus les capitalistes parlent de paix, plus ils préparent la guerre.
Dans les colonnes de notre Revue internationale, durant ces dix dernières années, nous avons maintes fois dénoncé les discours sur la “victoire du capitalisme” et la “fin du communisme”, sur la “prospérité à venir” et la “disparition des guerres”. Nous n'avons eu de cesse de dénoncer les “paix qui préparent les guerres”. Ici même, nous avons dénoncé la responsabilité des grandes puissances impérialistes dans la multiplication des conflits locaux tout autour du globe. Ce sont les antagonismes impérialistes entre les principaux pays capitalistes qui sont à l'origine du dépeçage de la Yougoslavie, de l'explosion des exactions et tueries en tout genre par les petits gangsters nationalistes, et du déchaînement de la guerre. Dans la Revue internationale, nous avons dénoncé l'inéluctabilité du développement du chaos guerrier dans les Balkans. “La boucherie qui ensanglante l’ex-Yougoslavie, depuis maintenant trois ans, n’est pas près de se terminer. Elle n’a fait que démontrer à quel point les conflits guerriers et le chaos nés de la décomposition du capitalisme se trouvent attisés par les menées des grands impérialismes. Et aussi, qu’au bout du compte, au nom du ‘devoir d’ingérence humanitaire’, la seule alternative qu’ils aient, les uns et les autres, à proposer, c’est la suivante : soit bombarder les forces serbes, soit envoyer plus d’armes aux bosniaques. En d’autres termes, face au chaos guerrier que provoque la décomposition du système capitaliste, la seule réponse que celui-ci ait à donner, de la part des pays les plus puissants et les plus industrialisés, c’est d’y ajouter encore plus de guerre.” (Revue internationale n°78, juin 1994)
A l'époque, l'alternative était soit bombarder les serbes, soit armer les bosniaques. Et ils ont fini par bombarder les serbes et par armer les bosniaques. Résultat : cette guerre a fait encore plus de victimes ; la Bosnie est partagée en trois zones “ethniquement pures” et occupée par les armées des grandes puissances, la population vit dans la misère, une grande partie étant constituée de réfugiés qui ne rentreront jamais chez eux. Résultat : des populations qui pouvaient cohabiter depuis des siècles, sont maintenant déchirées, divisées, par le sang et les massacres.
LES GRANDS ET PETITS IMPERIALISMES SEMENT LA TERREUR ET LA MORT
Au Kosovo, “tirant les leçons de la Bosnie”, les grands impérialismes ont tout de suite bombardé les forces serbes et envoyé des armes aux kosovars de l'UCK ajoutant encore plus de guerre. L'admiration et l'enthousiasme des experts militaires et des journalistes devant les 1100 avions militaires utilisés par l'OTAN, les 35 000 missions accomplies, pour les 18 000 bombes dont plus de 10 000 missiles qui ont “traités” –c'est le mot utilisé– 2000 objectifs, est à vomir. Résultat de cette terreur exercée par les grands et les petits impérialismes, par l'OTAN, les forces serbes, et l'UCK : des dizaines de milliers de morts, des exactions innombrables exercées par la soldatesque des petits gangsters impérialistes, les paramilitaires serbes et l'UCK, 1 million de kosovars et une centaine de milliers de serbes obligés de fuir dans des conditions dramatiques, leur maison en flamme et leurs affaires pillées, rançonnés par les uns et les autres. Les grandes puissances impérialistes sont les premières responsables de la terreur et des massacres perpétués par les milices serbes et l'UCK. Les populations kosovars et serbes sont les victimes de l'impérialisme tout comme les bosniaques, croates et serbes l'étaient lors de la guerre en Bosnie et le sont encore. Depuis 1991, ce sont plus de 250 000 morts et 3 millions de “personnes déplacées” qu'a provoqué le partage nationaliste et impérialiste de la Yougoslavie.
Que disent les Etats démocratiques face à un bilan aussi effroyable ? “Il nous faut accepter la mort de quelques uns pour sauver le plus grand nombre” (Jamie Shea le 15 avril, Supplément Le Monde du 19/6). Cette déclaration du porte-parole de l'OTAN, qui justifie les meurtres de civils innocents serbes et kosovars à l'occasion des “dommages collatéraux”, faite au nom des “grandes démocraties”, n'a rien à envier au fanatisme des dictateurs diabolisés pour les besoins de la cause, d'un Milosevic d'aujourd'hui, d'un Saddam Hussein d'hier, d'un Hitler d'avant-hier. Voilà la réalité des beaux discours sur “l'ingérence humanitaire” des grandes puissances. Démocratie et dictature sont bien du même monde capitaliste.
Les impérialismes provoquent la ruine des Balkans et la catastrophe écologique
Nous l'avons vu avec Chirac et Carter, il arrive à la bourgeoisie de ne pas mentir. Il lui arrive même de tenir ses promesses. Les généraux de l'OTAN avait promis de détruire la Serbie et de la faire revenir 50 ans en arrière. Ils ont tenu parole. “Après 79 jours de bombardements, la fédération (de Yougoslavie) est économiquement retournée cinquante ans en arrière. Les centrales électriques et les raffineries de pétrole ont été sinon entièrement détruites, du moins au point de ne plus pouvoir fournir une production d'énergie suffisante –en tout cas pour cette hiver–, les infrastructures routières et les télécommunications sont hors d'usage, les voies navigables quasiment impraticables. Le chômage, qui atteignait presque 35 % avant les frappes, devrait presque doubler. Selon l'expert Pavle Petrovic, l'activité économique s'est rétractée de 60 % par rapport à ce qu'elle était en 1998.” (Supplément Le Monde, 19/6). La ruine de la Yougoslavie s'accompagne d'une véritable catastrophe économique aussi pour les pays voisins –déjà parmi les plus pauvres d'Europe, Macédoine, Albanie, Bulgarie, Roumanie– par l'afflux des réfugiés et la paralysie des économies, par l'arrêt des échanges avec la Serbie et par le blocage du commerce sur le Danube et par voie routière.
Les bombardements ont provoqué une catastrophe écologique en Serbie tout comme dans les pays alentour : largage des bombes non utilisées dans la mer Adriatique au grand dam des pêcheurs italiens, pluies acides en Roumanie, “taux anormaux de dioxine” en Grèce, “concentrations atmosphériques en dioxyde de soufre et en métaux lourds” en Bulgarie, de nombreuses nappes de pétrole sur le Danube. “En Serbie, les dégâts écologiques semblent nettement plus inquiétant (...). Mais comme le dit un fonctionnaire des Nations unies sous le couvert de l'anonymat, ‘en d'autres circonstances, personne n'hésiterait : on parlerait de désastre environnemental’.” (Le Monde, 26/5) Comme le dit notre courageux anonyme, “en d'autres circonstances” nombreux seraient ceux qui s'indigneraient, et au premier chef, les écologistes. Mais dans cette circonstance-là, les Verts, au gouvernement en Allemagne et en France en particulier, ont été parmi les plus va-t-en-guerre, les plus bellicistes, et ils partagent la responsabilité d'une des plus grosses catastrophes écologiques de notre temps. Ils ont participé à la décision de lancer des bombes au graphite qui provoquent des poussières cancérigènes aux conséquences incalculables pour les années à venir. Ils ont fait de même pour les bombes à fragmentation –aux mêmes effets dévastateurs que les mines anti-personel– qui sont maintenant disséminées en Serbie, et surtout au... Kosovo où elles ont déjà commencé à faire des ravages parmi les enfants (et les... soldats anglais) ! Leur “pacifisme” et leur “défense de l'écologie” sont au service du capital et, de toute façon, subordonnés aux intérêts fondamentaux de leur capital national, surtout lorsque ceux-ci sont en jeu. C'est-à-dire qu'ils sont pacifistes et écologistes quand il n'y a pas de guerre. Dans les faits, dans la guerre impérialiste et pour les besoins du capital national, ils sont bellicistes et pollueurs à grande échelle comme tous les autres partis de la bourgeoisie.
Le mensonge de la guerre juste et humanitaire de l'OTAN
Face à la terreur de l'Etat serbe sur les populations kosovars, ne fallait-il pas intervenir ? Ne fallait-il pas arrêter Milosevic ? C'est le coup du pompier pyromane. Les incendiaires, ceux qui ont mis le feu aux poudres à partir de 1991, viennent justifier leur intervention par leurs propres méfaits. Qui, sinon les grandes puissances impérialistes durant ces dix ans, ont permis aux pires cliques et mafias nationalistes croates, serbes, bosniaques, et maintenant kosovars, de déchaîner leur hystérie nationaliste sanglante et l'épuration ethnique généralisée dans un processus infernal ? Qui, sinon l'Allemagne, a poussé à l'indépendance unilatérale de la Slovénie et de la Croatie autorisant et précipitant les déferlements nationalistes dans les Balkans, aux massacres et à l'exil de populations serbes, puis bosniaques ? Qui, sinon la Grande-Bretagne et la France, ont cautionné la répression, les massacres des populations croate et bosniaque et l'épuration ethnique de Milosevic et des nationalistes grand-serbes ? Qui, sinon les Etats-Unis, ont soutenu puis équipé les différentes bandes armées en fonction du positionnement de leur rivaux à tel ou tel moment ? L'hypocrisie et la duplicité des démocraties occidentales “alliées” est sans borne quand elles justifient les bombardements par “l'ingérence humanitaire”. Tout comme les rivalités entre les grandes puissances en provoquant l'éclatement de la Yougoslavie ont libéré, précipité, l’hystérie et la terreur nationaliste, l'intervention aérienne massive de l'OTAN a autorisé Milosevic à aggraver sa répression anti-kosovar et à déchaîner sa soldatesque. Même les experts bourgeois le reconnaissent, discrètement certes, faisant mine de s'interroger : “L'intensification du nettoyage ethnique était prévisible (...). Le nettoyage ethnique massif au début des bombardements avait-il été prévu ? Si la réponse est positive, comment justifier alors la faible cadence des opérations de l'OTAN en comparaison du rythme qui leur a été imprimé au bout d'un mois, après le sommet de Washington ?” (François Heisbourg, président du Centre de politique de sécurité de Genève, 3/5, Supplément Le Monde 19/6). La réponse à la question est pourtant claire : l'utilisation ignoble du million de réfugiés, de leurs drames, des conditions de leur expulsion, des menaces, des sévices de tout ordre qu'ils subissaient de la part des milices serbes, à des fins impérialistes, ceci afin d'émouvoir les populations des grandes puissances et pouvoir ainsi justifier l'occupation militaire du Kosovo (et une éventuelle guerre terrestre si elle avait été “nécessaire”). Aujourd'hui, la découverte des charniers et son utilisation médiatique visent encore à justifier le maintien d’une situation de guerre et à masquer les vraies responsabilités.
Mais en fin de compte le succès militaire de l'OTAN n'a-t-il pas permis de faire rentrer les réfugiés chez eux et de ramener la paix ? Une partie des réfugiés kosovars (“Il est déjà clair que beaucoup d'Albanais kosovars ne retourneront jamais dans leur maison dévastée”, Flora Lewis, International Herald Tribune, 4/6) vont rentrer chez eux pour trouver une région dévastée et, bien souvent, les décombres fumantes de leur maison. Quant aux serbes vivant au Kosovo, ils deviennent à leur tour des réfugiés expulsés –dont la bourgeoisie serbe ne veut pas et qu'elle essaie de refouler au Kosovo, là où ils sont l'objet de toutes les haines– quand ils ne sont pas tout simplement assassinés par l'UCK. Tout comme en Bosnie, un fossé de sang et de haine sépare maintenant les différentes populations. Tout comme en Bosnie, tout est à reconstruire. Mais tout comme en Bosnie, la reconstruction et le développement économiques ne resteront que des promesses médiatiques des grandes puissances impérialistes. Les quelques réparations concerneront les routes et les ponts afin de rétablir au plus vite la meilleure circulation possible pour la force d'occupation de la KFOR. Les médias s'en serviront pour en remettre une couche de propagande sur les “bienfaits humanitaires” de l'intervention militaire. N'en doutons pas, le Kosovo déjà misérable avant la guerre, ne se relèvera pas. Par contre, la situation de guerre ne va pas disparaître. Les pompiers incendiaires de l'OTAN sont intervenus avec de l'essence et ont porté le feu à une dimension supérieure, déstabilisant encore plus la région : avec l'occupation, et le partage du Kosovo par les différents impérialismes sous la casquette KFOR, se reproduit la situation de la Bosnie -où IFOR et SFOR occupent toujours le pays depuis 1995- et les accords de “paix” de Dayton. “Avec la Bosnie, l'ensemble de cette région va être militarisée par l'OTAN pour vingt ou trente ans” (William Zimmermann, dernier ambassadeur des Etats-Unis à Belgrade, Le Monde 6-7/6). Qu’en est-il pour les populations ? Au mieux et dans un premier temps, une paix armée au milieu d'un pays en ruines, la division ethnique, la misère, les exactions des milices, le règne des bandes armées et de la mafia. Et dans un second temps, à nouveau des affrontements militaires sur place et aux alentours (au Monténégro, en Macédoine... ?) dans lesquels s'exprimeront encore et toujours les rivalités impérialistes des grandes puissances. S'ouvre donc au Kosovo le règne des petits seigneurs de la guerre, des différents clans mafieux, sous l'uniforme de l'UCK bien souvent, derrière lesquels chaque grand impérialisme –en particulier dans sa zone d'occupation– va essayer de damer le pion à ses rivaux.
En douterions-nous que la cavalcade précipitée des parachutistes russes pour arriver les premiers à Pristina et occuper l'aéroport, révèle ouvertement, et de manière caricaturale, la logique implacable des grands gangsters impérialistes. Non pas qu'ils espèrent en retirer des profits économiques, se gagner le “marché de la reconstruction”, voire s'assurer le contrôle des quelques pauvres ressources minières ou autres. Il n'y a point d'intérêt économique direct dans la guerre du Kosovo, ou d’une importance si minime qu’il n’est en rien la raison, ni même une des raisons de la guerre. Il serait ridicule de croire que la guerre contre la Serbie visait à s'assurer le contrôle des ressources économiques serbes, voire du contrôle du Danube, même si celui-ci est une voie d'eau commerciale importante. Dans cette guerre, il s'agit pour chaque impérialisme de s'assurer une place, la meilleure possible, dans le développement irréversible des rivalités entre grandes puissances afin de défendre ses intérêts impérialistes, c'est-à-dire stratégiques, diplomatiques et militaires.
Une des conséquences majeures de l'impasse économique du capitalisme et de la concurrence effrénée qui en résulte, est de porter cette concurrence du plan économique au plan impérialiste pour finir dans la guerre généralisée, comme le montrent les deux guerres impérialistes mondiales de ce siècle. Conséquence historique de l'impasse économique, les antagonismes impérialistes ont leur propre dynamique : ils ne sont pas l'expression directe des rivalités économiques et commerciales comme l'ont démontré les différents alignements impérialistes tout au long de ce siècle, particulièrement dans et à l'issue des deux guerres mondiales. La recherche d'avantages économiques directs joue un rôle de plus en plus secondaire dans les motivations impérialistes.
Une telle compréhension des enjeux stratégiques de la guerre actuelle, on la trouve chez un certain nombre de “penseurs” de la classe bourgeoise (dans des publications qui, évidemment, ne sont pas destinées aux masses ouvrières mais à une minorité “éclairée”) : “Concernant les finalités, les buts, les objectifs réels de cette guerre, l'Union européenne et les Etats-Unis poursuivent, chacun de leur côté et pour des motifs différents, des desseins fort précis mais non rendus publics. L'union européenne le fait pour des considérations stratégiques” et pour les Etats-Unis “ l'affaire du Kosovo procure un prétexte idéal pour boucler un dossier auquel ils tiennent fortement : la nouvelle légitimation de l'OTAN (...) ‘en raison de l'influence politique qu'elle procure aux Etats-Unis en Europe et parce qu'elle bloque le développement d'un système stratégique européen rival de celui des Etats-Unis’.” (Ignacio Ramonet, Le Monde Diplomatique, juin 99, citant William Pfaf, “What Good Is NATO if America Intends to Go It Alone” International Herald Tribune, 20/5)
LES RIVALITES IMPERIALISTES SONT LES VERITABLES CAUSES DE LA GUERRE AU KOSOVO
Cette logique implacable de l'impérialisme, faite de rivalités, d'antagonismes et de conflits chaque fois plus aigus, s'est exprimée dans l'éclatement et le cours même de la guerre. L'unité des alliés occidentaux dans l'OTAN n'était elle-même que le résultat d'un rapport de forces momentané et instable entre rivaux. Aux négociations de Rambouillet sous l'égide de la Grande-Bretagne et de la France –et desquelles était absente l'Allemagne– ce furent les représentants kosovars qui commencèrent par refuser les conditions d'un accord sous la pression... des Etats-Unis. Puis, avec l'arrivée impromptue de l'américaine Madeleine Albright face à l'impuissance des Européens, ce furent les Serbes qui refusèrent les conditions que les Etats-Unis voulaient leur imposer et qui exigeaient en fait la capitulation complète et sans combat de Milosevic : le droit pour les forces de l'OTAN de circuler librement, sans autorisation, ni avis sur tout le territoire de la Yougoslavie[2] [3824]. Pourquoi un tel ultimatum inacceptable ? “L'épreuve de force à Rambouillet, a dit récemment un de ses aides (de Mme Albright), avait ‘un seul but’ : que la guerre débute avec les Européens obligés d'y participer[3] [3825].” Encore un démenti aux mensonges humanitaires de la bourgeoisie sur les raisons de faire la guerre. Et effectivement, les bourgeoisies anglaise et française, alliées traditionnelles de la Serbie, ne purent se soustraire à l'engagement militaire contre la Serbie. Refuser de s'engager aurait signifié pour elles être hors jeu à la fin du conflit. A partir de là, toutes les forces impérialistes appartenant à l'OTAN, des plus grandes aux plus petites, se devaient de participer aux bombardements. Absente de Rambouillet, l'Allemagne eut là l'occasion “humanitaire” de revenir dans le jeu et de participer pour la première fois depuis 1945 à une intervention militaire. Le résultat direct de ces antagonismes fut d'octroyer carte blanche à Milosevic et aux siens pour l'épuration ethnique “sans entrave” et l'enfer pour plusieurs millions de personnes au Kosovo et en Serbie.
L'occupation et le partage impérialiste du Kosovo : un succès britannique
Et aujourd'hui, de ces divisions impérialistes a résulté le partage du Kosovo en cinq zones d'occupation –avec un contingent russe au milieu– dans lesquelles chaque impérialisme va jouer une nouvelle partie contre les autres. Chacun est en place pour protéger et mettre en avant ses alliés traditionnels contre les autres. Le jeu impérialiste meurtrier va pouvoir reprendre une nouvelle partie avec la nouvelle donne. La non-participation de la Grande-Bretagne et de la France aux bombardements contre la Yougoslavie, les aurait ravalé au niveau de la Russie. Leur participation aux frappes de l'OTAN leur a donné des cartes nettement meilleures, surtout aux britanniques qui sont à la tête de l'occupation terrestre. Dirigeant la KFOR, occupant le centre du pays et sa capitale, l’impérialisme anglais sort considérablement renforcé tant sur le plan militaire que diplomatique. Aujourd'hui au Kosovo, c'est lui qui a les meilleures cartes depuis la fin des bombardements et le début de l'intervention terrestre à la fois comme alliée historique de la Serbie, malgré les bombardements, grâce à sa plus grande capacité à envoyer le plus grand nombre de soldats le plus rapidement possible et l'extrême professionnalisation de ses troupes au sol. Là réside l'explication des appels incessants de Tony Blair à l'intervention terrestre tout au long de la guerre. La bourgeoisie américaine, maître absolu de la guerre aérienne, en essayant de saboter chaque avancée diplomatique, a essayé de retarder le moment d’un cessez-le-feu où elle perdrait son contrôle total sur les événements[4] [3826]. La France, à un degré nettement moindre que la Grande-Bretagne reste dans la partie, tout comme l'Italie plus au titre de voisin que de grande puissance déterminante. Enfin, la Russie a réussi à arracher un strapontin duquel elle ne pourra jouer aucun rôle déterminant, sinon celui de fauteur de trouble.
Un nouveau pas dans les prétentions impérialistes de l'Allemagne
Mais tout au long de cette dernière décennie sanglante dans les Balkans, il n'est qu'une seule puissance impérialiste qui ait réellement avancé vers ses objectifs : l'Allemagne. Alors que les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France –pour ne citer que les puissances les plus déterminantes– étaient opposées à l'éclatement de la Yougoslavie, dès le début de 1991, faisant “de l'affaire yougoslave son cheval de bataille”[5] [3827], l'Allemagne poursuivait un objectif opposé, contre le “verrou” serbe. C’est ce qu’elle poursuit aujourd’hui avec le financement et l’armement en sous-main de l'UCK au Kosovo, tout en s'assurant une position forte en Albanie. Tout au long de cette décennie, l'Allemagne a avancé ses pions impérialistes. La dislocation de la Yougoslavie lui a permis d'élargir son influence impérialiste de la Slovénie et de la Croatie jusqu'à l'Albanie. La guerre contre la Serbie, son isolement et sa ruine, lui ont permis de participer pour la première fois depuis 1945 à des opérations militaires aériennes et terrestres. Exclue de Rambouillet, c'est à Bonn et à Cologne, sous sa présidence, que le G8 –le groupe des sept pays les plus riches plus la Russie– a discuté et adopté les accords de paix et la résolution de l'ONU. Avec 8500 soldats, elle est la deuxième armée de la KFOR, adossée à l'Albanie. Qualifiée de géant économique et de nain politique encore au début des années 1990, l'Allemagne est la puissance impérialiste qui s'est affirmée chaque fois plus et a marqué le plus de points contre ses rivaux depuis lors.
Helmut Kohl, l'ex-chancelier allemand, exprime très bien les espérances et l'objectif de la bourgeoisie allemande : “le 20e siècle a été longtemps bipolaire. Aujourd'hui, nombreux sont ceux, y compris aux Etats-Unis, qui s'accrochent à l'idée que le 21e siècle sera unipolaire et américain. C'est une erreur.” (Courrier International, 12/5) Il ne le dit pas, mais il espère bien que le 21e siècle deviendra bipolaire avec l'Allemagne comme rivale de l'Amérique.
Le partage du Kosovo aggrave les rivalités entre les grandes puissances
Toutes les puissances impérialistes sont donc maintenant face à face au Kosovo, directement et militairement sur le terrain. Même si des affrontements armés directs entre les grandes puissances sont à écarter dans la période présente, ce face à face représente une nouvelle aggravation, un nouveau pas, dans le développement et l'aiguisement des antagonismes impérialistes. Directement sur place pour “vingt ans” comme le dit l'ex-ambassadeur américain en Yougoslavie, les uns et les autres vont armer et exciter les bandes armés de leurs protégés locaux, milices serbes et bandes mafieuses albanaises, afin de piéger et de gêner les rivaux. Les coups tordus en tout genre et les provocations vont se multiplier. En clair, pour des intérêts géostratégiques antagonistes, c'est-à-dire pour des intérêts impérialistes antagoniques, des millions d'ex-yougoslaves ont vécu l'enfer et vont maintenant payer de leur misère, de leurs drames et de leur désespoir la “folie” impérialiste du monde capitaliste.
La guerre du Kosovo va relancer encore plus la multiplication des conflits locaux
Car, il ne faut pas en douter, la mécanique infernale des conflits impérialistes va encore s'accentuer et s'accélérer, allant d'un point à l'autre du globe. Dans cette spirale dévastatrice, c'est tous les continents et tous les Etats capitalistes, petits et grands qui sont touchés. L'éclatement du conflit armé entre l'Inde et le Pakistan alors que ces deux pays se livrent déjà à une course effrénée aux armements nucléaires, en est une expression tout comme les derniers affrontements entre les deux Corée. D'ores et déjà, l'intervention armée de l'OTAN relance l'incendie de par le globe et annonce les conflagrations à venir. “Le succès de la coalition multinationale menée par les Etats-Unis au Kosovo renforcera la diffusion des missiles et des armes de destruction massives en Asie (...). Il est impératif maintenant que les nations aient la meilleure technologie militaire” (International Herald Tribune, 19/6)
Pourquoi est-ce impératif ? Parce que “dans la période de décadence du capitalisme, tous les Etats sont impérialistes et prennent les dispositions pour assumer cette réalité : économie de guerre, armements, etc. C’est pour cela que l’aggravation des convulsions de l’économie mondiale ne pourra qu’attiser les déchirements entre ces différents Etats, y compris, et de plus en plus, sur le plan militaire. La différence avec la période qui vient de s’achever [la disparition de l'URSS et du bloc de l'Est], c’est que ces déchirements et antagonismes, qui auparavant étaient contenus et utilisés par les deux grands blocs impérialistes, vont maintenant passer au premier plan. La disparition du gendarme impérialiste russe, et celle qui va en découler pour le gendarme américain vis-à-vis de ses principaux “partenaire” d’hier, ouvrent la porte à toute une série de rivalités plus locales. Ces rivalités et affrontements ne peuvent pas, à l’heure actuelle, dégénérer en un conflit mondial (même en supposant que le prolétariat ne soit plus en mesure de s’y opposer). En revanche, du fait de la disparition de la discipline imposée par la présence des blocs, ces conflits risquent d’être plus violents et plus nombreux, en particulier, évidemment, dans les zones où le prolétariat est le plus faible.” (Revue Internationale n° 61, février 1990)
Notre prise de position s'est vue confirmée depuis tout au long de cette décennie et jusqu'à aujourd'hui. Au moins sur le plan des conflits impérialistes locaux. Mais qu'en est-il de notre position sur le rôle et la place que nous donnions au prolétariat international dans l'évolution de la situation ?
LE PROLETARIAT FACE A LA GUERRE
Le prolétariat international n'a pu s'opposer à l'éclatement des conflits impérialistes locaux tout au long de la décennie. Même en Europe, en Yougoslavie, à deux pas des principales concentrations ouvrières du monde. L'impuissance du prolétariat à ce niveau s'est encore révélée lors de la guerre du Kosovo. Ni le prolétariat international, à plus forte raison ni le prolétariat en Serbie n'ont exprimé d'opposition directe à la guerre.
Nous sommes bien sûr solidaires de la population serbe qui a manifesté au retour des cercueils de ses soldats. Tout comme nous sommes solidaires des quelques désertions collectives qui se sont produites à cette occasion. Elles ont opposé un démenti clair aux ignobles mensonges de la propagande des grandes puissances de l'OTAN qui présentaient tous les serbes comme des assassins et des tortionnaires unis derrière Milosevic. Malheureusement, ces réactions à la guerre n'ont pu déboucher sur une réelle expression de la classe ouvrière, seule capable d'offrir ne serait-ce qu'un début de réponse prolétarienne à la guerre impérialiste. C'est essentiellement l'isolement international de la Serbie, le désespoir de fractions significatives de la bourgeoisie serbe devant les destructions de l'appareil économique, la perspective de l'intervention terrestre de l'OTAN qui se rapprochait, et la lassitude qui s'emparait de la population soumise quotidiennement aux bombardements, qui ont poussé Milosevic à signer les accords de paix. “Nous sommes seuls. L'OTAN n'est pas près de s'effondrer. La Russie n'aidera pas militairement la Yougoslavie et l'opinion internationale est contre nous.” (Vuk Draskovic, Vice premier ministre de Milosevic, tournant casaque le 26/4, Supplément Le Monde, 19/6)
Est-ce à dire que le prolétariat a été complètement absent face à la guerre au Kosovo ? Est-ce à dire que le rapport de forces existant entre le prolétariat et la bourgeoisie, au niveau historique et international, ne joue pas dans la multiplication des conflits locaux ? Non. En premier lieu, la situation historique actuelle issue de la fin des blocs impérialistes, est le résultat du rapport de forces entre les deux classes. L'opposition du prolétariat international tout au long des années 1970 et 1980 aux attaques économiques et politiques s'est aussi exprimée dans sa résistance, particulièrement dans les pays centraux du capitalisme, et son “insoumission” à la défense des intérêts nationaux au plan économique, et a fortiori au plan impérialiste (Voir Revue Internationale n°18, sur Le cours historique). Et ce cours historique, cette résistance prolétarienne, viennent d'être confirmés encore par le déroulement de la guerre au Kosovo même si le prolétariat n'a pu l'empêcher.
Durant cette guerre, la classe ouvrière est restée une préoccupation constante de la bourgeoisie. Les thèmes de campagne de propagande, l'intensité du matraquage médiatique, ont nécessité du temps et des efforts pour arriver péniblement à faire “accepter” –par défaut pourrions-nous dire– une faible majorité dans les... sondages dans les pays de l'OTAN en faveur de la guerre. Et pas dans tous les pays. Et certainement pas au début. Il a fallu les images dramatiques et insoutenables des familles albanaises affamées et exténuées pour que la bourgeoisie réussisse à obtenir un minimum d'acceptation (on ne peut pas parler d'“adhésion”). Et malgré cela, le “syndrome du Vietnam”, c'est-à-dire les inquiétudes devant l'intervention terrestre et les risques de réactions populaires face au retour de soldats morts, a continué à freiner la bourgeoisie dans l'engagement de ses forces armées. “L'option aérienne retenue vise à préserver autant que possible la vie des pilotes, car la perte ou la capture de quelques-uns d'entre eux pourrait avoir des effets néfastes sur le soutien de l'opinion publique à l'opération.” (Jamie Shea, 15/4, Supplément au Monde, 19/6) Et pourtant, il s'agit dans la plupart des armées occidentales de soldats de métier et non de contingents d'appelés. Ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les politiciens bourgeois eux-mêmes qui sont obligés de reconnaître que le prolétariat des grandes puissances impérialistes est un frein à la guerre. Même si “l’opinion publique” n’est pas identique au prolétariat, ce dernier est au sein de la population la seule classe capable d’avoir un poids sur la bourgeoisie.
Cette “insoumission” –latente et instinctive– du prolétariat international s'est exprimée aussi directement dans des différentes mobilisations ouvrières. Malgré la guerre, malgré les campagnes sur le nationalisme et la démocratie, des grèves significatives ont eu lieu dans certains pays. La grève des cheminots en France contre l'avis des grandes centrales syndicales, CGT et CFDT, et contre l'introduction d'une flexibilité accrue lors du passage aux 35 heures hebdomadaires ; une manifestation organisée par les syndicats qui a rassemblé plus de 25 000 ouvriers municipaux à New-York ; ce sont les deux expressions les plus significatives d'une montée lente mais réelle de la combativité ouvrière et de sa “résistance”, au moment même où se déchaînait la guerre. Contrairement à la guerre du Golfe qui avait provoqué un sentiment d'impuissance et d'apathie dans la classe ouvrière, le déferlement de la guerre dans les Balkans n'a pas suscité le même désarroi.
Certes, cette résistance ouvrière se limite encore au terrain économique, et le lien entre l'impasse économique du capitalisme, ses attaques, et la multiplication des conflits impérialistes n'est pas fait. Ce lien devra pourtant se réaliser car il sera un élément important, essentiel, pour le développement de la conscience révolutionnaire parmi les ouvriers. De ce point de vue, l'intérêt et l'accueil que nous avons reçus lors de la diffusion de notre tract international dénonçant la guerre impérialiste au Kosovo, par exemple l'accueil et les discussions qu'a suscité sa diffusion dans la manifestation ouvrière de New-York, alors que son objet était tout autre, est encourageant. Il appartient aux groupes communistes non seulement de dénoncer la guerre, et de défendre les positions internationalistes, mais aussi de favoriser la prise de conscience de l'impasse historique dans laquelle le capitalisme se trouve[6] [3828]. Sa crise économique porte les rivalités et la compétition économiques à un niveau exacerbé et pousse inéluctablement à l'aiguisement des antagonismes impérialistes et à la multiplication des guerres. Même si les rivalités économiques ne recoupent pas forcement et toujours les rivalités impérialistes, celles-ci ayant leur propre dynamique, les contradictions économiques qui s'expriment dans la crise du capitalisme, sont à la source de la guerre impérialiste. Le capitalisme, c'est la crise économique et la guerre. C'est la misère et la mort.
Face à la guerre, et dans des moments de “bombardement” médiatique massif, au milieu de campagnes idéologiques intenses, les révolutionnaires ne peuvent se contenter d'attendre que ça passe, d'attendre des jours meilleurs en gardant leur position internationaliste bien à l'abri de leur certitude (Voir dans ce numéro “A propos de l’appel lancé par le CCI sur la guerre en Serbie”). Ils doivent faire tout ce qu'ils peuvent pour intervenir et défendre les positions internationalistes face à la classe ouvrière, le plus largement possible, le plus efficacement possible, tout en inscrivant leur action sur le long terme. Ils doivent lui montrer qu'il y a une alternative à cette barbarie, et que cette alternative passe par l'affirmation et le développement de “l'insoumission” tant au plan économique qu'au plan politique. Qu'elle passe par le refus des sacrifices dans les conditions de travail et d'existence et par le rejet des sacrifices pour la guerre impérialiste. Si la guerre impérialiste est le produit, en dernière instance, de la faillite économique du capitalisme, elle est à son tour facteur d'aggravation de la crise économique, et donc de l'accentuation terrible des attaques économiques contre les ouvriers.
L'intensité de la guerre au Kosovo, son éclatement en Europe, la participation militaire sanglante de toutes les puissances impérialistes, les répercussions de cette guerre sur tous les continents, la dramatique aggravation et accélération des conflits impérialistes à l'échelle planétaire, l'étendue, la profondeur et l'actualité des enjeux historiques, mettent le prolétariat international et les groupes communistes devant leur responsabilité historique. Le prolétariat n'est pas battu. Il reste porteur du renversement du capitalisme et de la fin de ses horreurs. Socialisme ou aggravation de la barbarie capitaliste reste l'alternative historique.
RL, 25/6/99
[1] [3829] Rappelons encore une fois que le marxisme et le communisme n'ont rien à voir avec le stalinisme, les staliniens au pouvoir à l'époque dans les pays de l'ex-bloc de l'Est –tel un Milosevic– avec les staliniens des PC occidentaux, ni avec les maoïstes et ex-maoïstes qui pullulent aujourd'hui dans les milieux intellectuels occidentaux va-t-en-guerre. Historiquement et politiquement, le stalinisme, au service du capitalisme d'État russe, a été et est toujours la négation du marxisme et un des massacreurs de générations de militants communistes.
[2] [3830] Cette condition n'a été connue qu'à la suite du déclenchement de la guerre et a été confirmée lors des accords de cessez-le-feu : “Les Russes ont obtenu pour Mr Milosevic d'importantes concessions, disent les officiels, qui rendent meilleure l'offre finale pour Belgrade que le plan occidental précédent imposé aux Serbes et aux Albanais à Rambouillet.” (International Herald Tribune, 5/6). En particulier, “il n'est plus question d'autoriser les forces de l'OTAN à circuler librement dans l'ensemble du territoire yougoslave” J. Eyal, Le Monde, 8/6.
[3] [3831] International Herald Tribune, 11/6 : “The showdown at Rambouillet, one of her (Mrs Albright) aides said recently, has ‘only one purpose’: to get the war started with the Europeans locked in.”
[4] [3832] Les puissances européennes ont plus de moyens politiques, diplomatiques et militaires, et plus de détermination aussi, du fait de l'histoire et de la proximité géographique, pour contrecarrer et refuser de se laisser imposer le leadership américain comme, par exemple, dans la guerre du Golfe. La capacité militaire de “projection” des forces militaires - en particulier de la Grande-Bretagne - en Europe affaiblit d'autant le leadership américain une fois la guerre aérienne terminée, une fois les opérations militaires de “paix” entamées. La concrétisation de cette réalité s'est traduite par la direction de la KFOR par un général britannique à la place du général américain qui commandait les bombardements aériens.
[5] [3833] Nous avons analysé le rôle de l’Allemagne dans la dislocation de la Yougoslavie dès 1991 : voir, entre autres les Revue internationale n° 67 et 68. La bourgeoisie a elle aussi rapidement compris cette politique : “l'Allemagne eut une tout autre attitude. Bien avant que le gouvernement lui-même ne prenne position, la presse et les milieux politiques ont réagi de manière unanime, immédiate et comme instinctive : ils furent aussitôt, sans nuances, favorables à la sécession de la Slovénie et de la Croatie (...). Il est difficile, pourtant, de ne pas y voir une résurgence de l'hostilité de la politique allemande envers l'existence même de la Yougoslavie depuis les traités de 1919 et tout au long de l'entre-deux-guerre. Les observateurs allemands (...) ne pouvaient ignorer (...) que la dislocation de la Yougoslavie ne se ferait pas paisiblement, qu'elle susciterait de fortes résistances. Néanmoins, la politique allemande allait s'engager à fond en faveur du démembrement du pays.” (Paul-Marie de la Gorce, Le Monde Diplomatique, juillet 92)
[6] [3834] Pour rejeter nos propositions de faire quelque chose en commun contre la guerre, les groupes du BIPR essaient de ridiculiser notre analyse de l’influence du prolétariat dans la situation historique actuelle. La CWO déclare ainsi dans son courrier de refus de tenir une réunion publique commune : “Nous ne pouvons pas marcher ensemble pour combattre pour une alternative communiste si vous pensez que la classe ouvrière est encore une force avec qui il faut compter dans la situation actuelle. (...) nous ne voulons pas être identifiés même de façon minimale avec une vision qui considère que tout va bien pour la classe ouvrière.” Nous engageons la CWO à considérer avec plus d’attention et de sérieux nos analyses.
Géographique:
- Europe [95]
13e CONGRES du CCI : Présentation
- 2711 reads
Le CCI a tenu son 13e congrès fin mars et début avril 1999. Le Congrès de notre organisation, comme de toutes les organisations du mouvement ouvrier, constitue un moment extrêmement important de sa vie et de son activité. Cependant, ce congrès a revêtu une importance toute particulière. D'une part, c'était le dernier congrès du 20e siècle et il avait été prévu que les rapports préparatoires devaient, plus encore que d'habitude, donner une dimension historique aux questions abordées. Mais d'autre part, au delà des coïncidences du calendrier, le Congrès s'est tenu en un moment marqué par l'accélération considérable de l'histoire que constitue la guerre en Yougoslavie. Il s'agit là d'un événement historique de première grandeur puisque :
- cette guerre concerne non plus un pays de la périphérie, comme ce fut le cas de la guerre du Golfe en 1991, mais un pays européen ;
- c'est la première fois depuis la seconde guerre mondiale qu'un pays d'Europe –et notamment sa capitale– est bombardé massivement ;
- c'est aussi la première fois depuis cette date que le principal pays vaincu de cette guerre, l'Allemagne, intervient directement avec les armes dans un conflit militaire...” (Résolution sur la situation internationale)
En ce sens, la guerre en Yougoslavie, son analyse, ses implications pour la classe ouvrière et pour les organisations communistes, ont été au centre des préoccupations du congrès ce qu'il a traduit notamment dans sa décision de publier immédiatement dans la Revue internationale (n°97) la Résolution sur la situation internationale qu'il venait d'adopter.
Cette résolution, synthèse des rapports présentés au congrès et de ses discussions souligne le fait que :
“Aujourd'hui le capitalisme agonisant fait face à une des périodes les plus difficiles et dangereuses de l'histoire moderne, comparable dans sa gravité à celle des deux guerres mondiales, au surgissement de la révolution prolétarienne en 1917-19 ou encore à la grande dépression qui débuta en 1929. (...) Plus exactement, la gravité de la situation est conditionnée par l'aiguisement des contradictions à tous les niveaux :
- celui des tensions impérialistes et du développement du désordre mondial ;
- une période très avancée et dangereuse de la crise du capitalisme ;
- des attaques sans précédent depuis la dernière guerre mondiale contre le prolétariat international ;
- une décomposition accélérée de la société bourgeoise.” (Ibid.)
Tous ces éléments sont amplement traités dans la résolution. Ils sont encore plus développés dans le présent numéro sur la question la plus brûlante à l'heure actuelle, celle des conflits impérialistes, sous forme d'importants extraits du rapport présenté au congrès.
Par ailleurs, la résolution constate que : “Dans cette situation pleine de périls, la bourgeoisie a confié les rênes du gouvernement aux mains du courant politique le plus capable de prendre soin de ses intérêts : la Social-démocratie, le principal courant responsable de l'écrasement de la révolution mondiale après 1917-1918 ; courant qui a sauvé à cette époque le capitalisme et qui revient aux postes de commande pour assurer la défense des intérêts menacés de la classe capitaliste.” (Ibid.)
En ce sens, le congrès a adopté un texte d'orientation intitulé “Pourquoi la présence actuelle des partis de gauche dans la majorité des gouvernements européens ?” que nous publions également ci-dessous accompagné d'un certain nombre d'ajouts synthétisant des éléments apparus dans la discussion.
L'évolution de la crise capitaliste et de la lutte de classe ont aussi, évidemment, fait l'objet de discussions importantes lors du congrès. Dans le présent numéro de la Revue Internationale nous publions la troisième partie de l'article sur “Trente ans de crise ouverte du capitalisme” qui recoupe grandement le rapport présenté au congrès. Dans le prochain numéro nous publierons le rapport qu'il a adopté sur l'évolution de la lutte de classe qui illustre notamment ce passage de la résolution :
“La responsabilité qui pèse sur le prolétariat aujourd’hui est énorme. C’est uniquement en développant sa combativité et sa conscience qu’il pourra mettre en avant l’alternative révolutionnaire qui seule peut assurer la survie et l’ascension continue de la société humaine.” (Ibid.)
Outre l'analyse des différents aspects de la situation internationale, de l'extrême gravité de celle-ci, la préoccupation majeure du congrès a consisté à examiner les responsabilités des révolutionnaires face à cette situation comme le met en évidence la résolution :
“Mais la responsabilité la plus importante repose sur les épaules de la Gauche communiste, sur les organisations présentes du camp prolétarien. Elles seules peuvent fournir les leçons théoriques et historiques ainsi que la méthode politique sans lesquelles les minorités révolutionnaires qui émergent aujourd’hui ne peuvent se rattacher à la construction du parti de classe du futur. En quelque sorte, la Gauche communiste se trouve aujourd’hui dans une situation similaire à celle de Bilan[1] [3835] des années 1930, au sens où elle est contrainte de comprendre une situation historique nouvelle sans précédent. Une telle situation requiert à la fois un profond attachement à l’approche théorique et historique du Marxisme et de l’audace révolutionnaire pour comprendre les situations qui ne sont pas totalement intégrées dans les schémas du passé. Afin d’accomplir cette tâche, les débats ouverts entre les organisations actuelles du milieu prolétarien sont indispensables. En ce sens, la discussion, la clarification et le regroupement, la propagande et l’intervention des petites minorités révolutionnaires sont une partie essentielle de la réponse prolétarienne à la gravité de la situation mondiale au seuil du prochain millénaire.
Plus encore, face à l’intensification sans précédent de la barbarie guerrière du capitalisme, la classe ouvrière attend de son avant-garde communiste d’assumer pleinement ses responsabilités en défense de l’internationalisme prolétarien. Aujourd’hui les groupes de la Gauche communiste sont les seuls à défendre les positions classiques du mouvement ouvrier face à la guerre impérialiste. Seuls les groupes qui se rattachent à ce courant, le seul qui n’ait pas trahi au cours de la seconde guerre mondiale, peuvent apporter une réponse de classe aux interrogations qui ne manqueront pas de se faire jour au sein de la classe ouvrière.
C’est de façon la plus unie possible que les groupes révolutionnaires doivent apporter cette réponse exprimant en cela l’unité indispensable du prolétariat face au déchaînement du chauvinisme et des conflits entre nations. Ce faisant les révolutionnaires reprendront à leur compte la tradition du mouvement ouvrier représentée particulièrement par les conférences de Zimmerwald et de Kienthal et par la politique de la Gauche au sein de ces conférences.” (Ibid.)
C'est dans ce cadre que le 13e congrès du CCI a mené ses discussions concernant ses activités.
Les activités du CCI déterminées par la nouvelle période
Le bilan des activités établi par le 13e congrès est très positif. Il ne s'agit pas là d'une manifestation d'autosatisfaction mais d'une évaluation objective et critique de notre activité. Le 12e congrès avait diagnostiqué que le CCI devait revenir à un équilibre de l'ensemble de ses activités, après avoir mené pendant plus de trois ans un combat pour l'assainissement du tissu organisationnel. En accord avec le mandat du 12e congrès, ce “retour à la normale” a été concrétisé par :
- une ouverture envers le milieu politique prolétarien et envers les contacts, tout en poursuivant le combat contre les groupes et les éléments parasites ;
- un renforcement théorique-politique, avec la capacité de donner une dimension historique à notre propagande, en la basant sur le marxisme et la propre expérience de la classe ;
- un renforcement de “l'esprit de parti”, seule façon de renforcer l'organisation révolutionnaire.
Le renforcement de l'organisation s'est également concrétisé par la capacité du CCI à intégrer de nouveaux militants dans sept sections territoriales (et notamment dans la section en France). Ainsi, le renforcement numérique du CCI (qui est appelé à se poursuivre, comme en témoigne le fait que d'autres sympathisants ont posé récemment leur candidature à l'organisation) vient démentir toutes les calomnies du milieu parasitaire accusant notre organisation d'être devenue une “secte repliée sur elle-même”. Contrairement aux dénigrements de nos détracteurs, le combat mené par le CCI pour la défense de l’organisation, n'a pas fait fuir les éléments en recherche des positions de classe, mais a au contraire permis leur rapprochement et leur clarification politique.
Le CCI a développé une intervention sérieuse et sereine, dans une vision à long terme, en vue d'un rapprochement avec les groupes du milieu politique prolétarien. Cette activité s'est étendue aux contacts et sympathisants aux préoccupations desquels il faut répondre avec sérieux et profondeur et à qui il faut permettre de dépasser les incompréhensions et la méfiance envers l'organisation. Cette orientation du CCI ne résulte pas d'une vision mégalomane mais des exigences de la situation historique qui requiert que le prolétariat, et les minorités révolutionnaires à ses côtés, assume ses responsabilités.
La défense du milieu prolétarien a conduit le CCI à combattre la contre-offensive des éléments parasitaires, notamment en adoptant et en publiant les “Thèses sur le parasitisme” (Revue internationale n°94), lesquelles constituent une arme de compréhension historique et théorique sur cette question pour l'ensemble des groupes du milieu. La défense du milieu prolétarien a consisté aussi pour le CCI à développer une politique de discussions et de rapprochement, mettant en place avec d'autres groupes de ce milieu des interventions communes face aux campagnes anticommunistes qu'a déchaînées la bourgeoisie lors de l'anniversaire de la révolution d'Octobre. De même, cette démarche a connu un prolongement dans le travail d'intervention en direction du milieu politique qui surgit en Russie.
Enfin, dès les premiers jours de la guerre en Yougoslavie, tout de suite après avoir publié un tract international[2] [3836], le CCI a envoyé aux différents groupes de la Gauche communiste une proposition d'appel commun dénonçant la guerre impérialiste. Le congrès a soutenu unanimement cette initiative même s'il faut déplorer que les groupes concernés ne lui aient pas donné une réponse positive (voir dans ce numéro notre réponse face au refus des groupes de la Gauche communiste).
Le 13e congrès a établi que l'intervention en direction du “marais politique” doit être assumée de façon plus décidée par l'organisation. Ce “no man's land” indéterminé entre la bourgeoisie et le prolétariat est le lieu de passage obligé de tous les éléments de la classe qui s'acheminent vers une prise de conscience. Il constitue aussi un terrain privilégié de l'action du parasitisme avec lequel se joue une course de vitesse. Aussi l'organisation ne doit pas attendre que les éléments en recherche la “découvrent” pour s'intéresser à eux. Bien au contraire, elle doit s'adresser à ces éléments et mener le combat contre la bourgeoisie dans le marais lui-même.
Ce renforcement de notre vision du milieu politique prolétarien est un résultat du renforcement politique et théorique. Le congrès a souligné que ce dernier ne doit pas être considéré comme une “activité à part”, “à côté” ou “en plus” des autres tâches. Dans la situation historique actuelle et dans la perspective à long terme où s'inscrit la vie des organisations révolutionnaires, le renforcement politique et théorique doit inspirer et constituer le socle de nos activités, de nos réflexions et de nos décisions.
Ainsi, le bilan positif de nos activités se base sur une vision plus claire du fait que les questions d'organisation sont déterminantes face aux autres aspects des activités. En ce sens, le CCI est conscient qu'il doit poursuivre ses efforts et son combat sur ces questions, notamment en luttant contre les effets de l'idéologie dominante sur l'engagement militant. Au cours de ses 25 années d'existence, le CCI a payé les conséquences de la rupture de la continuité organique avec les organisations révolutionnaires du passé. Bien que nous tirions un bilan positif de cette expérience, nous savons que les acquis dans ce domaine ne sont pas définitifs ; surtout dans la période actuelle de décomposition, quand les efforts de l'organisation pour assurer un fonctionnement en cohérence avec les principes révolutionnaires sont sapés en permanence par les tendances de la société au “chacun pour soi”, au nihilisme, à l'irrationalité, qui se manifestent dans la vie organisationnelle par l'individualisme, la méfiance, la démoralisation, l'immédiatisme, la superficialité.
Le 13e congrès a inscrit l'orientation des activités du CCI (presse, diffusion, réunions publiques et permanences) dans la perspective, pour une part, d'une accentuation des effets de la décomposition mais aussi d'une accélération de l'histoire, exprimée par une aggravation de la crise du capitalisme et une tendance au resurgissent de la combativité du prolétariat. Le CCI, et avec lui l'ensemble du milieu prolétarien, sort de ce congrès mieux armé pour affronter cet enjeu historique.
Courant Communiste International
[1] [3837] Revue de la Gauche communiste d'Italie dans les années 1930. Cf. notre livre La Gauche communiste d'Italie.
[2] [3838] “Le capitalisme c'est la guerre, guerre au capitalisme”, tract international publié en première page de notre presse territoriale et diffusé dans tous les pays où existent des sections du CCI, ainsi qu'au Canada, en Australie et en Russie.
Vie du CCI:
- Résolutions de Congrès [131]
Rapport sur les conflits impérialistes (1999 - extraits)
- 3022 reads
avoir transformé la planète en un gigantesque abattoir, infligé deux guerres mondiales, la terreur nucléaire et d'innombrables conflits sur une humanité agonisante, le capitalisme décadent est entré dans sa phase de décomposition, une nouvelle phase historique marquée au premier plan par l'effondrement du bloc de l'Est en 1989. Durant cette phase historique, l'emploi direct de la violence militaire par les grandes puissances, surtout par les Etats-Unis, devient une donnée permanente. Durant cette phase, la discipline rigide des blocs impérialistes a cédé le pas à une indiscipline et un chaos rampants, à un chacun pour soi généralisé, à une multiplication incontrôlable des conflits militaires.
Au terme de ce siècle, l'alternative historique définie par le marxisme dès avant la 1re guerre mondiale –socialisme ou barbarie– est non seulement confirmée, mais elle doit être précisée et transformée en : socialisme ou destruction de l'humanité.
(...) Bien que pour l'instant une 3e guerre mondiale ne soit pas à l'ordre du jour, la crise historique du système l'a conduit dans une impasse telle que celui-ci n'a pas d'autre choix que d'aller vers la guerre. Pas seulement parce que la crise en s'accélérant a commencé à plonger des régions entières dans la misère et l'instabilité (comme l'Asie du sud-est qui jusqu'à un passé récent avait préservé un semblant de prospérité), mais surtout parce que les grandes puissances elles-mêmes sont de plus en plus obligées d'employer la violence pour défendre leurs intérêts.
-
La nature des conflits : une question clé aujourd'hui
(...) Les révolutionnaires ne parviendront à convaincre le prolétariat de la totale validité des positions marxistes que s'ils sont capables de défendre une vision théorique et historique cohérente de l'évolution de l'impérialisme actuel. En particulier, une de nos armes les plus puissantes contre l'idéologie bourgeoise est la capacité du marxisme à expliquer les causes et les enjeux réels des guerres modernes.
En ce sens, une claire compréhension du phénomène de la décomposition du capitalisme et de toute la phase historique qui en porte la marque constitue un instrument de première importance dans la défense des positions et des analyses des révolutionnaires concernant l'impérialisme et la nature des guerres aujourd'hui.
-
Décomposition et effondrement du bloc de l'Est
(...) L'événement clé qui détermine tout le caractère des conflits impérialistes au tournant du siècle est l'effondrement du bloc de l'Est.
(...) Le monde entier fut surpris par les événements de 1989. Le CCI n'a pas échappé à la règle mais on doit à la vérité de préciser qu'il a réussi très rapidement à comprendre toute la portée de ces événements (les thèses sur la crise dans les pays de l'Est, qui prévoyaient l'effondrement du bloc russe, ont été écrites en septembre 1989, c'est-à-dire deux mois avant la chute du mur de Berlin). La capacité de notre organisation à réagir de cette façon n'était pas le fruit du hasard. Elle résultait :
- du cadre d'analyse sur les caractéristiques des régimes staliniens, que le CCI s'était donné au début des années 1980, à la suite des événements de Pologne[1] [3839];
- de la compréhension du phénomène historique de la décomposition du capitalisme qu'il avait commencé à élaborer à partir de 1988[2] [3840].
C'était la première fois dans l'histoire qu'un bloc impérialiste disparaissait en dehors d'une guerre mondiale. Un tel phénomène a créé un désarroi profond, y compris dans les rangs des organisations communistes où l'on a cherché, par exemple, à en déterminer la rationalité économique. Pour le CCI, le caractère inédit d'un tel événement, qui n'avait aucune rationalité mais représentait une catastrophe pour l'ancien empire soviétique (et pour l'URSS elle-même qui n'allait pas tarder à exploser), constituait une éclatante confirmation de l'analyse sur la décomposition du capitalisme[3] [3841].
(...) Jusqu'en 1989, cette décomposition qui a mis à genoux la 2e super puissance mondiale, n'avait que très peu affecté les pays centraux du bloc de l'ouest. Même maintenant, dix ans plus tard, les manifestations de décomposition localisées dans ces pays sont presque dérisoires comparées à celles des pays périphériques. Cependant, en faisant exploser l'ordre impérialiste mondial existant, le phénomène de décomposition est devenu la période de décomposition, en plaçant les pays dominants au coeur même des contradictions du système, et tout particulièrement le premier d'entre eux, les Etats-Unis.
-
L'impérialisme américain au coeur des contradictions de la décomposition
L'évolution de la politique impérialiste américaine depuis 1989 est devenue l'expression la plus dramatique du dilemme actuel de la bourgeoisie.
Durant la guerre du Golfe de 1991, les Etats-Unis pouvaient apparaître, face au développement rapide du chacun pour soi, comme le seul contrepoids en étant encore capables, fouet à la main, de contraindre les autres pays à les suivre. En fait, à l'occasion de cette démonstration écrasante de supériorité militaire en Irak, l'unique super puissance fut capable de porter un coup décisif à la tendance à la formation d'un bloc autour de l'Allemagne, qui avait été ouverte avec l'unification de ce pays. Cependant, six mois seulement après la guerre du Golfe, l'explosion de la guerre en Yougoslavie, venait déjà confirmer que le “nouvel ordre mondial” annoncé par Bush, ne serait pas dominé par les Américains, mais par le “chacun pour soi” rampant. (...)
En février 1998, la puissance américaine, qui, durant la guerre du Golfe avait utilisé les Nations Unies et le Conseil de Sécurité afin que son leadership soit sanctionné par la “communauté internationale”, avait perdu le contrôle de cet instrument à un point tel, qu'elle pouvait être humiliée par l'Irak et ses alliés français et russe[4] [3842].
Bien sûr, les Etats-Unis furent capables de surmonter cet obstacle en jetant l'ONU dans les poubelles de l'histoire et en menant, fin 1998, en compagnie de la Grande-Bretagne, l'opération “Lone Ranger” (“Renard du Désert”), dans laquelle ils se sont passés ouvertement de l'avis de toutes les autres puissances concernées, petites ou grandes.
Washington n'a nul besoin de la permission de quiconque pour frapper quand et où il le veut. Mais en menant une telle politique, les états-Unis se placent simplement à la tête d'une tendance qu'ils veulent limiter, celle du chacun pour soi, comme ils avaient momentanément réussi à le faire durant la guerre du Golfe. Pire encore : le signal politique donné par Washington au cours de l'opération “Renard du Désert” s'est retourné contre la cause américaine. Pour la première fois depuis la fin de la guerre du Viêt-nam, la bourgeoisie américaine, dans un contraste marqué avec son partenaire britannique d'aujourd'hui, s'est montrée incapable de présenter un front uni vers l'extérieur alors qu'elle était en situation de guerre. Au contraire, le processus d'“empeachment” contre Clinton s'est intensifié durant les événements : les politiciens américains, plongés dans un véritable conflit interne de politique étrangère, au lieu de désavouer la propagande des ennemis de l'Amérique selon laquelle Clinton avait pris la décision d'intervenir militairement en Irak à cause de motivations personnelles (“Monicagate”), y ont apporté leur crédit. (…)
Le conflit de politique étrangère sous-jacent entre certaines fractions des partis Républicain et Démocrate s'est avéré très destructif, précisément parce que ce “débat” révèle une contradiction insoluble, que la résolution du 12e congrès du CCI formulait ainsi :
- d'une part, s'ils [les Etats-Unis] renoncent à la mise en oeuvre ou à l'étalage de leur supériorité militaire, cela ne peut qu'encourager les pays qui contestent leur autorité à aller encore plus loin dans cette contestation ;
- d'autre part, lorsqu'ils font usage de la force brute, même, et surtout, quand ce moyen aboutit momentanément à faire ravaler les velléités de leurs opposants, cela ne peut que pousser ces derniers à saisir la moindre occasion pour prendre leur revanche et tenter de se dégager de l'emprise américaine.”[5] [3843]
Paradoxalement, au temps où l'URSS tête de bloc impérialiste existait encore, les Etats-Unis étaient protégés des pires effets de la décomposition sur leur politique étrangère. (...) Aujourd'hui ils n'ont aucun adversaire assez puissant pour prétendre former son propre bloc impérialiste contre eux. De ce fait il n'y a pas d'ennemi commun, et donc pas de raison pour les autres puissances d'accepter la “protection” et la discipline de l'Amérique. (...)
-
Le caractère offensif de la stratégie militaire illustre l'irrationalité de plus en plus grande des relations impérialistes
Face à la montée irrésistible du chacun pour soi, les Etats-Unis n'ont d'autre choix que de mener en permanence une politique militaire offensive. Ce n'est pas un ennemi plus faible que Washington [???], mais la puissance américaine elle-même, qui est de plus en plus obligée d'intervenir militairement de façon régulière pour défendre ses positions (ce qui, normalement, caractérise une puissance plus faible et dans une situation plus désespérée).
Le CCI avait déjà souligné cet aspect lors de son 9e congrès :
“... Par certains côtés, la situation présente des Etats-Unis s'apparente à celle de l'Allemagne avant les deux guerres mondiales. Ce dernier pays, en effet, a essayé de compenser ses désavantages économiques (...) en bouleversant le partage impérialiste par la force des armes. C'est pour cela que, lors des deux guerres, il a fait figure ‘d'agresseur’ puisque les puissances mieux loties n'étaient pas intéressées à une remise en cause des équilibres. (...) Tant qu'existait le bloc de l'Est (...) les Etats-Unis n'avaient pas besoin, à priori, de faire un usage important de leurs armes puisque l'essentiel de la protection accordée à leurs alliés était de nature défensive (bien qu'au début des années 1980, les Etats-Unis aient engagé une offensive générale contre le bloc russe). Avec la disparition de la menace russe, ‘l'obéissance’ des autres grands pays avancés n'est plus du tout garantie (c'est bien pour cela que le bloc occidental s'est désagrégé). Pour obtenir une telle obéissance, les Etats-Unis ont désormais besoin d'adopter une démarche systématiquement offensive sur le plan militaire (...) qui s'apparente donc à celle de l'Allemagne par le passé. La différence avec la situation du passé, et elle est de taille, c'est qu'aujourd'hui ce n'est pas une puissance visant à modifier le partage impérialiste qui prend les devants de l'offensive militaire, mais au contraire la première puissance mondiale, celle qui pour le moment dispose de la meilleure part du gâteau.”[6] [3844]
-
Le chacun pour soi : une tendance dominante aujourd'hui
(...) En tirant un bilan des deux dernières années, l'analyse détaillée des événements concrets confirme le cadre posé par le rapport et la résolution du 12e congrès du CCI :
1) Le défi ouvert que représente l'arme nucléaire possédée par l'Inde et le Pakistan, est un exemple qui, de façon presque certaine, sera suivi par d'autres puissances, et qui accroît considérablement le risque de l'emploi de bombes atomiques.
2) L'agressivité militaire croissante de l'Allemagne, libérée de la discipline de fer des blocs impérialistes, est un exemple qui sera suivi par le Japon, autre grande puissance, elle aussi sous la coupe du bloc US après 1945.
3) L'accélération terrifiante du chaos et de l'instabilité en Russie, sont aujourd'hui l'expression la plus caricaturale de la décomposition et le centre le plus dangereux de toutes les tendances vers la dissolution de l'ordre bourgeois mondial.
4) La résistance persistante de Netanyahou à la Pax Americana au Moyen-Orient et le fait que l'Afrique devienne une terre de massacres, sont d'autres exemples confirmant que :
- les tendances dominantes dans les tensions impérialistes après 1989 sont le chaos et le chacun pour soi ;
- au centre de cette tendance dominante, il y a la contestation de l'hégémonie de la seule superpuissance, les Etats-Unis, et de ses actions militaires violentes de plus en plus nombreuses ;
- cette dynamique ne peut être comprise qu'en la replaçant dans le contexte de la décomposition ;
- cette tendance, ne gomme en aucune façon, la tendance vers la formation de nouveaux blocs qui aujourd'hui, en tant que tendance secondaire mais bien réelle, est un des principaux facteurs qui attisent les flammes de la guerre et du chaos.
- l'aggravation de la crise économique du capitalisme décadent est elle-même un facteur puissant d'exacerbation des tensions, sans qu'il faille cependant établir un lien mécanique entre les deux, ou prêter à ces conflits un caractère de rationalité économique ou historique. (...)
-
La décomposition de la bourgeoisie aggrave les tensions et le chacun pour soi
Avec la perte de vue de tout projet concrètement réalisable, mis à part celui de “sauver les meubles” face à la crise économique, l'absence de perspective de la bourgeoise tend à mener à une perte de vue des intérêts de l'Etat ou du capital national dans son ensemble.
La vie politique de la bourgeoisie (des différentes fractions ou cliques) dans les pays les plus faibles, tend à se réduire à la lutte pour le pouvoir ou simplement pour pouvoir survivre. Cela devient un obstacle énorme à l'établissement d'alliances stables ou à une politique étrangère cohérente, laissant la place au chaos, à l'imprévisible et même à la folie dans les relations entre Etats.
L'impasse du système capitaliste mène à l'éclatement de certains Etats qui furent créés tardivement dans la décadence du capitalisme, sur des bases malsaines (comme l'URSS ou la Yougoslavie) ou avec des frontières artificielles comme en Afrique, menant à l'apparition de guerres visant à redessiner les frontières.
A cela, vient s'ajouter l'aggravation de tensions d'ordre racial, ethnique, religieux, tribal ou autre, un aspect très important de la situation mondiale actuelle.
Une des tâches les plus progressistes du capitalisme ascendant fut de remplacer les fragmentations religieuses ou ethniques de l'humanité par de grandes unités centralisées au niveau national (le melting pot américain, l'unité nationale des catholiques et protestants en Allemagne ou des populations de langue française et italienne en Suisse). Mais même en ascendance, la bourgeoisie fut incapable de surmonter ses divisions qui remontaient à la période d'avant le capitalisme. Alors que les génocides, les divisions et les lois ethniques étaient à l'ordre du jour dans les régions non capitalistes où le système se développait, de tels conflits ont survécu au coeur même du capitalisme (Cf. l'Ulster). Bien que la bourgeoisie prétende que l'holocauste contre les Juifs fut unique dans l'histoire moderne et qu'elle accuse de façon mensongère la Gauche communiste parce qu'elle “excuserait” ce crime, le capitalisme décadent en général, la décomposition en particulier, constituent la période des génocides et des “nettoyages ethniques”. Ce n'est qu'avec la décomposition que tous ces conflits récents ou anciens, qui apparemment n'ont rien à voir avec la “rationalité” de l'économie capitaliste, atteignent une explosion généralisée – ils sont le résultat de l'absence totale d'une perspective bourgeoise. L'irrationalité est une des caractéristiques marquantes de la décomposition. Aujourd'hui, nous n'avons pas seulement des intérêts stratégiques concrètement divergents, mais également le caractère absolument insoluble de ces conflits innombrables. (...) La fin du 20e siècle justifie le mouvement marxiste qui au début du siècle, contre le Bund en Russie, montra que la seule solution progressiste à la question juive en Europe était le révolution mondiale ou ceux qui plus tard montrèrent qu'il ne pouvait pas y avoir de formation progressiste d'Etats-nations dans les Balkans. (...)
-
L’absence d’une division stable et réaliste du monde après 1989 attise le chacun pour soi
En plus de la supériorité américaine sur ses rivaux, il existe un autre facteur stratégique, en lien direct avec la décomposition, expliquant la prédominance actuelle du chacun pour soi : l’effondrement du Bloc russe sans défaite militaire. Jusqu'à présent, historiquement, la redivision du monde à travers la guerre impérialiste avait été la précondition à la formation de nouveaux blocs, comme on l’a vu après 1945. (...) De cet effondrement sans guerre il résulte que :
- un tiers de la planète, celui de l'ex-bloc de l’Est, est devenu une zone sans maître, une pomme de discorde entre les puissantes restantes ;
- les principales positions stratégiques des puissances de l'ex-bloc de l’Ouest dans le reste du monde après 1989 ne représentaient en aucune façon le véritable rapport de forces impérialiste entre elles, mais plutôt l’ancienne division du travail contre le Bloc russe.
Cette situation, en laissant complètement ouvertes les zones d’influence des plus et moins grandes puissances, et généralement de façon non satisfaisante, est un énorme encouragement au chacun pour soi, à une ruée non organisée en vue de positions et de zones d’influence.
Le principal alignement impérialiste entre les puissances européennes “nanties” et les plus dépourvues, qui a dominé la politique mondiale entre 1900 et 1939, était le produit de décennies voire même de siècles de développement capitaliste. L’alignement de la guerre froide a été pour sa part le résultat de plus d’une décennie de confrontations guerrières les plus aiguës et profondes entre les grandes puissances, du tout début des années 1930 jusqu'à 1945.
À l’opposé, l’effondrement de l’ordre mondial de Yalta est intervenu du jour au lendemain sans résoudre aucune des grandes questions des rivalités impérialistes posées par le capitalisme -excepté celle du déclin irréversible de la Russie.
-
La confrontation impérialiste en dehors du corset des blocs : une exception mais pas une complète nouveauté
Le seul “ordre mondial” impérialiste possible dans la décadence est celui des blocs impérialistes en vue de la guerre mondiale.
Dans le capitalisme décadent, il existe une tendance naturelle vers une bipolarisation impérialiste du monde, tendance qui ne peut être reléguée au second plan que lors de circonstances exceptionnelles, habituellement liées aux rapports de forces de classe entre la bourgeoisie et le prolétariat. Ce fut le cas après le 1re guerre mondiale jusqu'à la venue au pouvoir d'Hitler en Allemagne. Cette situation était le produit de la vague révolutionnaire mondiale qui a contraint la bourgeoisie d’abord à arrêter la guerre avant qu’elle n'aille jusqu'au bout de sa logique (c'est-à-dire la défaite totale de l’Allemagne qui aurait ouvert la voie à la formation de nouveaux blocs à l’intérieur du camp victorieux –probablement dirigés par la Grande-Bretagne et par les Etats-Unis), et qui l’a obligée ensuite, après la guerre, à collaborer pour sauver son système face à la menace prolétarienne. Ainsi, une fois le prolétariat battu et l’Allemagne remise de son épuisement, la 2e guerre mondiale a mis aux prises les mêmes principaux protagonistes que la première.
De façon évidente, aujourd’hui, les facteurs qui agissent contre la tendance à la bipolarité sont plus forts que dans les années 1920, où ils furent submergés par la formation de blocs en moins d’une décennie. Aujourd’hui, non seulement la suprématie évidente des États-unis, mais aussi la décomposition peuvent bien empêcher à jamais la formation de nouveaux blocs.
-
La tendance vers les blocs et la montée en puissance de l’Allemagne.
La décomposition est un énorme facteur favorisant le chacun pour soi. Mais elle n’élimine pas la tendance à la formation des blocs. Nous ne pouvons pas non plus prétendre théoriquement que la décomposition en tant que telle rend la formation de blocs impossible par principe. (...)
Ces deux considérations bourgeoises, la poursuite des ambitions impérialistes et la limitation de la décomposition, ne sont pas toujours et nécessairement opposées. En particulier, les efforts de la bourgeoisie allemande pour établir les premières fondations d’un éventuel bloc impérialiste en Europe de l’Est et pour stabiliser plusieurs des pays de cette zone contre le chaos, sont plus souvent complémentaires que contradictoires.
Nous savons aussi que le chacun pour soi et la formation de blocs ne sont pas dans l’absolu contradictoires, que les blocs ne sont que la forme organisée du chacun pour soi dans le but de canaliser une explosion unique de toutes les rivalités impérialistes refoulées.
Nous savons que le but à long terme des Etats-Unis, rester la puissance mondiale la plus forte, est un projet éminemment réaliste. Pourtant, dans la poursuite de ce but, ils sont empêtrés dans des contradictions insolubles. Pour l’Allemagne, c’est exactement le contraire : tandis que son projet à long terme d’un bloc mené par elle pourrait peut-être ne jamais se réaliser, sa politique concrète dans cette direction se révèle extrêmement réaliste. Nous avons souvent remarqué que les Etats-Unis et l’Allemagne sont les seules puissances qui aujourd’hui peuvent avoir une politique étrangère cohérente. A la lumière des récents événements, cela semble être plus le cas pour l’Allemagne que pour les Etats-Unis. (...)
L’alliance avec la Pologne, les avancées dans la péninsule balkanique, la réorientation de ses forces armées vers des interventions militaires sur des théâtres extérieurs, sont des pas dans la direction d’un futur bloc allemand. De petits pas, il est vrai, mais suffisants pour inquiéter considérablement la superpuissance mondiale. (...)
-
La crédibilité du marxisme
Toutes les organisations communistes ont expérimenté l’extrême difficulté depuis 1989 de convaincre la plupart des ouvriers de la validité de l’analyse marxiste des conflits impérialistes. Il y a deux raisons principales à cette difficulté. La première est la situation objective du chacun pour soi et le fait que les conflits d’intérêts des grandes puissances sont aujourd’hui, contrairement à la période de la Guerre Froide, encore largement cachés. L’autre raison cependant est que la bourgeoisie, avec son équation systématique identifiant le stalinisme avec le communisme, a été capable de présenter comme “marxiste” une vision complètement caricaturale de la guerre qui serait menée uniquement pour remplir les poches de quelques capitalistes cupides. Depuis 1989, la bourgeoisie a bénéficié énormément de cette falsification afin de semer la confusion la plus incroyable. Pendant la guerre du Golfe, la bourgeoisie elle-même a propagé la mystification pseudo-matérialiste d’une guerre “pour le prix du pétrole” afin de cacher le conflit sous-jacent entre les grandes puissances.
A l’opposé de cela, les organisations de la Gauche communiste (le BIPR et les groupes “bordiguistes”) ont exposé résolument les intérêts impérialistes des puissances impérialistes dans la tradition de Lénine et Rosa Luxemburg. Mais ils ont parfois mené ce combat avec des armes insuffisantes, en particulier avec une vision réductionniste, exagérant les motifs immédiats économiques de la guerre impérialiste moderne. Cela affaiblit l’autorité de l’argumentation marxiste. (...) Mais, en outre, cette approche “économiste” tombe dans la propagande de la bourgeoisie, comme le montre le cas de la CWO qui, sur base d'une telle approche, croit à une certaine réalité du “processus de paix” en Irlande.
-
Le caractère global de la guerre impérialiste
Tout le milieu prolétarien partage la compréhension que la guerre impérialiste est le produit des contradictions du capitalisme, ayant en dernière analyse une cause économique. Mais chaque guerre qui a lieu dans une société de classe a aussi, et c'est un aspect important, une dimension stratégique, avec une dynamique interne propre. Hannibal marcha dans le nord de l’Italie avec ses éléphants, non pas pour ouvrir une route commerciale à travers les Alpes, mais comme moyen d'une stratégie militaire dans les guerres puniques “mondiales” entre Carthage et Rome pour la domination de la Méditerranée.
Avec l’avènement de la concurrence capitaliste, il est vrai que la cause économique de la guerre devient plus prononcée : c'est clair pour les guerres coloniales de conquête et les guerres nationales d’unification du siècle dernier. Mais la création du marché mondial et la division de la planète entre les nations capitalistes donnent aussi à la guerre, à l’époque de l’impérialisme, un caractère global et donc ainsi plus politique et stratégique, et cela à une échelle encore inconnue dans l’histoire. C’est déjà clairement le cas pour la 1re guerre mondiale. La cause fondamentale de cette guerre est strictement économique : les limites de l’expansion du marché mondial étaient atteintes relativement aux besoins du capital existant accumulé, signant l’entrée du système dans sa phase de décadence. Cependant, ce n’est pas “la crise cyclique de l’accumulation” économique en tant que telle (suivant l'idée du BIPR) qui a conduit à la guerre impérialiste en 1914, mais le fait que toutes les zones d’influence étaient déjà partagées, de sorte que les “derniers arrivés” ne pouvaient s’étendre qu’au détriment des puissances déjà établies. La crise économique en tant que telle était beaucoup moins brutale que celle par exemple des années 1870. En réalité, ce fut plus la guerre impérialiste qui annonça la future crise économique mondiale du capitalisme décadent en 1929, que le contraire.
De la même façon, la situation économique immédiate de l’Allemagne, la principale puissance poussant à un repartage du monde, était loin d’être critique en 1914 –entre autres parce qu’elle avait encore accès aux marchés de l’Empire britannique et d’autres puissances coloniales. Mais cette situation plaçait l’Allemagne, politiquement, à la merci de ses principaux rivaux. Le but principal de la guerre pour l’Allemagne était donc, non pas la conquête de tel ou tel marché, mais de briser la domination britannique des océans : d’une part au moyen d'une flotte de guerre allemande et d'un chapelet de colonies et de bases navales à travers le monde, et d’autre part, à travers une route terrestre vers le Moyen-Orient et l’Asie via notamment les Balkans. Déjà à cette époque, les troupes allemandes furent envoyées dans les Balkans à la poursuite de ces buts globaux stratégiques beaucoup plus qu’à cause du simple marché yougoslave. Déjà à cette époque, la lutte pour contrôler certaines matières premières clés ne furent qu’un moment dans la lutte généralisée pour la domination du monde.
Nombre d'opportunistes dans la 2e et 3e Internationale –et les partisans du “socialisme dans un seul pays”– utilisèrent un tel point de vue partiel, et en dernière analyse national, afin de nier “les ambitions économiques et donc impérialistes” de... leur propre pays. La Gauche marxiste, au contraire fut capable de défendre cette vision globale parce qu’elle comprit que l’industrie capitaliste moderne ne peut survivre sans marchés, matières premières, produits agricoles, moyens de transports et force de travail à sa disposition. (...) A l’époque impérialiste, où l’économie mondiale dans son ensemble forme un tout compliqué, les guerres locales ont non seulement des causes globales mais font toujours partie d’un système international de lutte pour la domination du monde. C’est pourquoi Rosa Luxemburg avait raison quand elle écrivait dans la Brochure de Junius que tous les Etats, grands ou petits, étaient devenus impérialistes. (...)
-
Le caractère irrationnel de la guerre impérialiste
“La décadence de la société capitaliste trouve son expression éclatante dans le fait que, alors que les guerres avaient auparavant en vue le développement économique (période ascendante), aujourd’hui, l’activité économique se restreint essentiellement en vue de la guerre (période décadente). Cela ne signifie pas que la guerre soit devenue le but de la production capitaliste, le but restant toujours pour le capitalisme la production de la plus-value mais cela signifie que la guerre, prenant un caractère de permanence, est devenue le mode de vie du capitalisme décadent”. (“Rapport sur la Situation Internationale de la Gauche Communiste de France”, juillet 1945).
Cette analyse développée au sein de la Gauche communiste, représente un approfondissement supplémentaire de notre compréhension des conflits impérialistes : non seulement les buts économiques de la guerre impérialiste sont globaux et politiques, mais ils deviennent eux-mêmes dominés par des questions de stratégie et de “sécurité” militaires. Alors qu’au début de la décadence, la guerre était encore plus ou moins au service de l’économie, avec le passage du temps, la situation s’est renversée, l’économie est de façon croissante au service de la guerre. Un courant comme le BIPR, enraciné dans la tradition marxiste, est tout à fait conscient de cela : “... Nous devons clairement réitérer un élément de base de la pensée dialectique marxiste : quand les forces matérielles créent une dynamique vers la guerre, c’est cela qui devient la référence centrale pour les politiciens et les gouvernements. La guerre est menée pour vaincre : les amis et les ennemis sont choisis sur cette base.”
Et ailleurs dans le même article : “... il reste alors pour le leadership politique et l’armée d’établir la direction politique de chaque Etat selon un impératif unique : une estimation de comment accomplir une victoire militaire parce que cela dorénavant l’emporte sur la victoire économique.” (“Fin de la Guerre froide : nouvelle étape vers un nouvel alignement impérialiste”, Communist Review n° 10)
Ici nous sommes loin du pétrole du Golfe et des marchés yougoslaves. Mais malheureusement, cette compréhension n’est pas ancrée dans une théorie cohérente de l’irrationalité économique du militarisme aujourd’hui.
Par ailleurs, l'identification entre les tensions économiques et les antagonismes militaires conduit à une myopie en ce qui concerne la signification de l'Union européenne et de la monnaie unique, considérées par le BIPR comme le noyau d'un futur bloc continental. (...)
-
“L'Euroland” n’est pas un bloc impérialiste
Jusqu’aux années 1990, la bourgeoisie n’a pas trouvé d’autre moyen de coordonner ses politiques économiques entre les Etats-nations – dans une tentative de maintenir la cohésion du marché mondial face à la crise économique permanente – que le cadre des blocs impérialistes. Dans ce contexte, la nature du bloc de l’Ouest pendant la Guerre froide, composé de toutes les puissances économiques leaders, était particulièrement favorable à la gestion internationale de la crise ouverte du capitalisme, permettant pendant longtemps d’empêcher la dislocation du commerce mondial qui eut lieu pendant les années 1930. Les circonstances de l’ordre impérialiste mondial après 1945, qui ont duré près d’un demi siècle, pouvaient ainsi donner l’impression que la coordination de la politique économique et l’endiguement des rivalités commerciales entre Etats grâce à l'existence de certaines règles et limites, constitue la fonction spécifique des blocs impérialistes.
Après 1989, cependant, quand les blocs impérialistes disparurent, la bourgeoisie des grands pays fut capable de trouver de nouveaux moyens de coopération économique internationale pour gérer la crise tandis qu’au niveau impérialiste la lutte de tous contre tous est rapidement passée au premier plan.
La situation a été parfaitement illustrée par l’attitude des Etats-Unis qui, au niveau impérialiste résistent massivement à tout mouvement vers une alliance militaire des Etats européens, mais qui, au niveau économique (après quelques hésitations initiales) soutiennent et même tirent avantage de l’Union européenne et du projet de l'Euro.
Pendant la Guerre froide, “le processus d’intégration européenne” était d’abord et avant tout un moyen de renforcer la cohésion du bloc US en Europe occidentale contre le Pacte de Varsovie. Si l’Union européenne a survécu au démantèlement du bloc occidental, c’est surtout parce qu'elle a assumé un nouveau rôle en tant que pôle de stabilité économique ancré au coeur de l’économie mondiale.
En ce sens, la bourgeoisie a appris des années passées à opérer une certaine séparation entre les questions de coopération économique (la gestion de la crise) et celles des alliances impérialistes. Et la réalité aujourd’hui montre que si la lutte chacun pour soi domine au niveau impérialiste ce n'est pas le cas au niveau économique. Mais si la bourgeoisie est capable de faire une telle distinction, c'est uniquement parce les deux phénomènes sont distincts, même si pas complètement séparés : en réalité “l'Euroland” illustre parfaitement que les intérêts stratégiques impérialistes et le commerce mondial des Etats-nations ne sont pas identiques. L’économie des Pays-Bas par exemple, est fortement dépendante du marché mondial en général et de l’économie allemande en particulier. C’est la raison pour laquelle ce pays a été l’un des plus chauds partisans au sein de l’Europe de la politique allemande envers une monnaie commune. Au niveau impérialiste au contraire, la bourgeoisie néerlandaise, précisément à cause de sa proximité géographique de l’Allemagne, s’oppose aux intérêts de son puissant voisin chaque fois qu’elle le peut, et elle constitue un des alliés les plus loyaux des Etats-Unis sur le continent. Si “l’Euro” était d’abord et avant tout une pierre angulaire d’un futur bloc allemand, La Haye serait la première à s’y opposer. Mais en réalité, la Hollande, la France et d’autres pays qui craignent la résurgence impérialiste de l’Allemagne, soutiennent la monnaie unique précisément parce qu’elle ne menace pas leur sécurité nationale, c'est-à-dire leur souveraineté militaire.
A l’opposé d’une coordination économique, basée sur un contrat entre Etats bourgeois souverains (sous la pression de contraintes économiques données et des rapports de forces, évidemment) un bloc impérialiste est un corset de fer imposé sur un groupe d’Etats par la suprématie militaire d’un pays leader et tenus ensemble par une volonté commune de détruire l’alliance militaire opposée. Les blocs de la Guerre froide n’ont pas surgi à travers des accords négociés : ils ont été le résultat de la 2e guerre mondiale. Le bloc de l’Ouest est né parce que l’Europe occidentale et le Japon étaient occupés par les Etats-Unis alors que l’Europe de l’Est avait été envahie par l’URSS.
Le bloc de l’Est ne s’est pas effondré à cause d’une modification de ses intérêts économiques et de ses alliances commerciales, mais parce que le leader, qui tenait le bloc ensemble par la force et le sang, n’a plus été en mesure d’assumer cette tâche. Et le bloc de l’Ouest – qui était plus fort et qui ne s’est pas effondré – est mort simplement parce que l’ennemi commun avait disparu. Comme l’a écrit un jour Winston Churchill, les alliances militaires ne sont pas le produit de l’amour mais de la peur : la peur de l’ennemi commun.
-
L’Europe au coeur non d’un nouveau bloc mais du chacun pour soi
L’Europe et l’Amérique du Nord sont les deux centres principaux du capitalisme mondial. Les Etats-Unis, en tant que puissance dominante de l’Amérique du Nord, étaient destinés par leur dimension continentale, par leur situation à une distance de sécurité des ennemis potentiels en Europe et en Asie et par leur force économique, à devenir la puissance leader dans le monde.
Au contraire, la position économique et stratégique de l’Europe l’a condamnée à devenir et à rester le principal foyer de tensions impérialistes dans le capitalisme décadent. Champ de bataille principal dans les deux guerres mondiales et continent divisé par le “rideau de fer” pendant la Guerre froide, l’Europe n’a jamais constitué une unité et sous le capitalisme elle ne la constituera pas.
A cause de son rôle historique comme berceau du capitalisme et de sa situation géographique comme demi-péninsule de l’Asie s’étendant jusqu’au nord de l’Afrique, l’Europe au 20e siècle est devenue la clé de la lutte impérialiste pour la domination mondiale. En même temps, entre autres à cause de sa situation géographique, l’Europe est particulièrement difficile à dominer sur le plan militaire. La Grande-Bretagne, même au temps où elle “régnait sur les mers”, a dû se débrouiller pour surveiller l’Europe à travers un système compliqué de “rapports de forces”. Quant à l’Allemagne sous Hitler, même en 1941, sa domination du continent était plus apparente que réelle, dans la mesure où la Grande-Bretagne, la Russie et l’Afrique du Nord étaient entre des mains ennemies. Même les Etats-Unis, au plus fort de la Guerre froide, n’ont jamais réussi à dominer plus de la moitié du continent. Ironiquement, depuis leur “victoire” sur l’URSS, la position des Etats-Unis en Europe s’est considérablement affaiblie, avec la disparition de “l’Empire du Mal”. Bien que la superpuissance mondiale maintienne une présence militaire considérable sur le vieux continent, l’Europe n’est pas une zone sous-développée qui peut être contrôlée par une poignée de baraquements de GIs : des pays industriels du G7 sont européens.
En fait, tandis que les Etats-Unis peuvent, pratiquement à leur gré, manoeuvrer militairement dans le Golfe persique, le temps et l’effort imposés à Washington pour imposer sa politique dans l'ex-Yougoslavie, révèlent la difficulté actuelle pour la seule superpuissance restante de maintenir une présence décisive à 5000 kilomètres de son territoire.
Non seulement les conflits dans les Balkans ou le Caucase sont directement reliés à la lutte pour le contrôle de l’Europe, mais également ceux en Afrique et au Moyen-Orient. Le nord de l’Afrique constitue le rivage sud du bassin méditerranéen, sa côte nord-est (particulièrement “la Corne”) domine l’approche au canal de Suez, le sud de l’Afrique, les routes maritimes du sud entre l’Europe et l’Asie. Si Hitler, malgré l’étirement de ses ressources militaires en Europe, envoya Rommel en Afrique, c’est surtout parce qu’il savait qu’autrement l’Europe ne pouvait être contrôlée.
Ce qui est vrai pour l’Afrique l’est d’autant plus pour le Moyen-Orient, le point névralgique où l’Europe, l’Asie et l’Afrique se rencontrent. La domination du Moyen-Orient est l’un des principaux moyens par lequel les Etats-Unis peuvent rester une puissance décisive “européenne” et globale (d’où l’importance vitale de la “Pax Americana” entre Israël et les Palestiniens pour Washington).
L’Europe est aussi la raison principale pour laquelle Washington, depuis plus de 8 ans, a fait de l’Irak son point d’achoppement des crises internationales : en tant que moyen de diviser les puissances européennes. Tandis que la France et la Russie sont les alliés de l’Irak, la Grande-Bretagne est l’ennemi “naturel” du régime actuel à Bagdad, alors que l’Allemagne est plus proche des rivaux régionaux de l’Irak comme la Turquie et l’Iran.
Mais si l’Europe est le centre des tensions impérialistes aujourd’hui, c’est surtout parce que les principales puissances européennes ont des intérêts militaires divergents. On ne doit pas oublier que les deux guerres mondiales ont commencé d’abord comme des guerres entre les puissances européennes –tout comme les guerres des Balkans dans les années 1990. (...)
[1] [3845] Voir “Europe de l'Est, les armes de la bourgeoisie contre le prolétariat”, Revue Internationale n°34, 3e trimestre 1983.
[2] [3846] Voir “La décomposition du capitalisme”, Revue Internationale n°57, 2e trimestre 1989.
[3] [3847] Voir “La décomposition, phase ultime de la décadence du capitalisme”, Revue Internationale n° 62, 3e trimestre 1990.
[4] [3848] Voir “Irak, un revers des Etats-Unis qui renforce les tensions guerrières”, Revue Internationale n° 93, 2e trimestre 1998.
[5] [3849] Revue Internationale n°90, page 7.
[6] [3850] “Rapport sur la situation internationale”, Revue Internationale n°67, 4e trimestre 1991.
Vie du CCI:
- Résolutions de Congrès [131]
Questions théoriques:
- Guerre [129]
- Impérialisme [321]
- La "Gauche" au gouvernement (T.O.)
- 3023 reads
Pourquoi la présence actuelle des partis de gauche dans la majorité des gouvernements européens ?
(texte d'orientation)
1) Sur les 15 pays que compte l'Union européenne, 13 ont aujourd'hui des gouvernements dirigés par des partis social-démocrates où à participation sociale-démocrate (seules l'Espagne et l'Irlande font exception). Cette réalité a évidemment fait l'objet d'analyses et de commentaires de la part des journalistes bourgeois ainsi que de la part des groupes révolutionnaires. C'est ainsi que pour un “spécialiste” de politique internationale comme Alexandre Adler : “les gauches européennes ont au moins un objectif unique : la préservation de l'Etat providence, la défense d'une sécurité commune des Européens” (Courrier International, n°417) De même, Le Prolétaire de l'automne 1998 consacre un article à cette question qui affirme avec raison que la prédominance actuelle de la social-démocratie à la tête de la plupart des pays d'Europe correspond bien à une politique délibérée et coordonnée à l'échelle internationale de la bourgeoisie contre la classe ouvrière. Cependant, tant dans les commentaires bourgeois que dans l'article du Prolétaire on ne comprend pas la spécificité de cette politique par rapport à celles qu'a menées la classe dominante dans les périodes passées depuis la fin des années 1960. Il nous appartient donc de comprendre les causes du phénomène politique auquel nous assistons à l'heure actuelle à l'échelle européenne et même à l'échelle mondiale (avec la présence des démocrates à la tête de l'exécutif des Etats-Unis). Cela dit, avant même que de rechercher ces causes, il importe de répondre à une question : Peut-on considérer que le fait, indiscutable, de la présence presque hégémonique des partis social-démocrates à la tête des pays d'Europe occidentale résulte d'un phénomène d'ensemble avec des causes communes pour tous les pays ou bien peut on estimer qu'il s'agit d'une convergence circonstancielle d'une série de situations particulières et spécifiques à chaque pays ?
2) Le marxisme se distingue de la démarche empirique en ce sens qu'il ne tire pas ses conclusions à partir seulement des faits observés à un moment donné mais qu'il interprète et intègre ces faits dans une vision historique et globale de la réalité sociale. Cela dit, en tant que méthode vivante, le marxisme se préoccupe d'examiner en permanence cette réalité n'hésitant jamais à remettre en cause les analyses qu'il avait élaborées auparavant :
- soit parce qu'elles se sont révélées erronées (la méthode marxiste n'a jamais prétendu prévenir contre toute erreur) ;
- soit parce qu'ont surgi de nouvelles conditions historiques qui rendent caduques les analyses antérieures.
En aucune façon, la méthode marxiste ne doit être considérée comme un dogme intangible face auquel la réalité n'aurait d'autre alternative que de se plier. Un telle conception du marxisme est celle des bordiguistes (ou de feu le FOR qui niait la réalité de la crise parce qu'elle ne correspondait pas à ses schémas). Elle n'est pas celle que le CCI a héritée de Bilan et de l'ensemble de la Gauche communiste. Si la méthode marxiste se garde bien de s'en tenir aux faits immédiats et refuse de se soumettre aux “évidences” célébrées par les idéologues de la bourgeoisie, elle a cependant pour obligation de tenir compte en permanence de ces faits. Face au phénomène de la présence massive de la gauche à la tête des pays européens, on peut évidemment s'employer à trouver pour chaque pays des raisons spécifiques qui militent en faveur d'une telle disposition des forces politiques. Par exemple, nous avons attribué à l'extrême faiblesse politique et aux divisions de la droite en France le retour de la gauche au gouvernement en 1997. De même nous avons vu que des considérations de politique étrangère avaient joué un rôle important dans la constitution du gouvernement de gauche en Italie (contre le “pôle” de Berlusconi favorable à l'alliance avec les Etats-Unis) ou en Grande-Bretagne (où les conservateurs étaient profondément divisés par rapport à l'Union européenne et aux Etats-Unis). Cependant, vouloir faire découler la situation politique actuelle en Europe de la simple somme des situations particulières des pays qui la composent serait un exercice tout à fait vain et contraire à l'esprit du marxisme. En fait, dans la méthode marxiste, la quantité devient, dans certaines circonstances, une qualité nouvelle. Lorsque l'on constate que jamais depuis qu'ils ont rejoint le camp bourgeois autant de partis socialistes n'ont été simultanément au gouvernement (même si tous l'avaient été à un moment ou à un autre), lorsqu'on voit aussi que dans des pays aussi importants que la Grande-Bretagne et l'Allemagne (où la bourgeoisie habituellement maîtrise remarquablement son jeu politique) la gauche a été installée au gouvernement de façon délibérée par la bourgeoisie, il est nécessaire de considérer qu'il s'agit là d'une “qualité” nouvelle qui ne peut se résumer dans la simple superposition de “cas particuliers[1] [3851]”.
D'ailleurs, ce n'est pas autrement que nous avions raisonné lorsque nous avons mis en évidence le phénomène de “gauche dans l'opposition”, à la fin des années 1970. C'est ainsi que le texte adopté par le 3e congrès du CCI, et qui donnait le cadre de notre analyse sur la gauche dans l'opposition, commençait par prendre en compte le fait que dans la plus grande partie des pays d'Europe, la gauche avait été écartée du pouvoir :
“Il suffit de jeter un bref coup d'œil pour constater que… l'arrivée de la gauche au pouvoir ne s'est pas vérifiée ; mieux encore, la gauche a été cette dernière année systématiquement écartée du pouvoir dans la majeure partie des pays de l'Europe. Il suffit de citer le Portugal, l'Italie, l'Espagne, les pays scandinaves, la France, la Belgique, l'Angleterre ainsi qu'Israël pour le constater. Il ne reste pratiquement que deux pays en Europe où la gauche reste au pouvoir : l'Allemagne et l'Autriche.” (“Dans l'opposition comme au gouvernement, la ‘gauche’ contre la classe ouvrière”, Revue internationale n°18)
3) Dans l'analyse des causes qui motivent la venue de la gauche au gouvernement dans tel ou tel pays européen, il faudra continuer à prendre en compte des facteurs spécifiques (par exemple, dans le cas de la France, l'extrême faiblesse de “la droite la plus bête du monde”). Cependant, il est fondamental que les révolutionnaires soient en mesure de donner au phénomène d'ensemble une réponse d'ensemble et la plus complète possible. C'est ce que le CCI avait fait en 1979, lors de son 3e congrès, à propos de la gauche dans l'opposition et la meilleure façon de reprendre ce travail est de rappeler avec quelle méthode nous avions analysé ce phénomène à l'époque :
“Suite à l'apparition de la crise et aux premières manifestations de la lutte ouvrière, la gauche au gouvernement était la réponse la plus adéquate du capitalisme durant les premières années (...), tout comme la gauche posant sa candidature au gouvernement remplissait efficacement sa fonction d'encadrement du prolétariat, le démobilisant et le paralysant par ses mystifications du ‘changement’ et de l'électoralisme.
La gauche devait rester et est restée dans cette position tant que cette position lui permettait de remplir sa fonction. Il ne s'agit donc pas d'une erreur que nous aurions commise dans le passé mais de quelque chose de différent et de plus substantiel, d'un changement qui est intervenu dans l'alignement des forces de la bourgeoisie. Ce serait une grave erreur de ne pas reconnaître à temps ce changement et de continuer à répéter dans le vide sur ‘le danger de la gauche au pouvoir’. Avant de poursuivre l'examen du pourquoi de ce changement et de sa signification, il faut insister tout particulièrement sur le fait qu'il ne s'agit pas là d'un phénomène circonstanciel et limité à tel ou tel pays, mais d'un phénomène général, valable à court terme et peut être à moyen terme pour l'ensemble des pays du monde occidental. (...)
Après avoir efficacement réalisé sa tâche d'immobilisation de la classe ouvrière durant ces dernières années, la gauche au pouvoir ou en marche vers le pouvoir ne peut plus assumer cette fonction qu'en se plaçant aujourd'hui dans l'opposition. Les raisons de ce changement sont multiples ; elles relèvent notamment de conditions particulières spécifiques aux divers pays, mais ce sont là des raisons secondaires ; les principales raisons résident dans l'usure subie par la gauche et le lent dégagement des mystifications de la gauche de la part des masses ouvrières. La récente reprise des luttes ouvrières et leur radicalisation en sont le témoignage évident.
Rappelons les trois critères dégagés lors des analyses et discussions antérieures pour la gauche au pouvoir :
- 1) nécessité de renforcement des mesures capitalistes d'Etat ;
- 2) meilleure intégration dans le bloc impérialiste occidental sous la domination du capital des Etats-Unis ;
- 3) encadrement efficace de la classe ouvrière et immobilisation de ses luttes.
La gauche réunissait le mieux et le plus efficacement ces trois conditions, et les Etats-Unis, leader du bloc, appuyaient plus volontiers son arrivée au pouvoir, avec des réserves toutefois pour ce qui concerne les PC. (...) Mais si les Etats-Unis restaient quand même méfiants pour ce qui concerne les PC, leur soutien au maintien ou à l'arrivée des socialistes au pouvoir, partout où cela était possible, était total. (...)
Revenons aux critères pour la gauche au pouvoir. En les examinant de plus près, nous voyons que même si la gauche les représente le mieux, ils ne sont pas tous le patrimoine exclusif de la gauche. Les deux premiers, les mesures de capitalisme d'Etat et l'intégration dans le bloc peuvent parfaitement être accomplis, si la situation l'exige, par d'autres forces politiques de la bourgeoisie, comme les partis du centre ou même carrément de la droite[2] [3852] (...) Par contre, le troisième critère, l'encadrement de la classe ouvrière, est l'apanage propre et exclusif de la gauche. C'est sa fonction spécifique, sa raison d'être.
Cette fonction, la gauche ne l'accomplit pas uniquement, et même pas généralement au pouvoir. (...) En règle générale, la participation de la gauche au pouvoir n'est absolument nécessaire que dans deux situations précises :
- 1) dans l'Union Sacrée en vue de la guerre pour entraîner les ouvriers à la défense nationale ;
- 2) dans une situation révolutionnaire pour contrecarrer la marche de la révolution.
En dehors de ces deux situations extrêmes, dans lesquelles la gauche ne peut pas ne pas s'exposer ouvertement comme défenseur inconditionnel du régime bourgeois en affrontant ouvertement et violemment la classe ouvrière, la gauche doit toujours veiller à ne pas trop dévoiler sa véritable identité et sa fonction capitaliste et à maintenir la mystification que sa politique vise la défense des intérêts de la classe ouvrière. (…) Ainsi, même si la gauche comme tout autre parti bourgeois aspire ‘légitimement’ à accéder au pouvoir étatique, on doit cependant noter une différence qui distingue ces partis des autres partis de la bourgeoisie pour ce qui concerne leur présence au pouvoir. C'est que ces partis de la gauche prétendent être des partis ‘ouvriers’ et comme tels ils sont obligés de se présenter devant les ouvriers avec un masque, une phraséologie ‘anticapitaliste’ de loups vêtus de peau de mouton. Leur séjour au pouvoir les met dans une situation ambivalente plus difficile que pour tout autre parti franchement bourgeois. Un parti ouvertement bourgeois exécute au pouvoir ce qu'il disait être, la défense du capital, et ne se trouve nullement discrédité en faisant une politique anti-ouvrière. Il est exactement le même dans l'opposition que dans le gouvernement. C'est tout le contraire en ce qui concerne les partis dits ‘ouvriers’. Ils doivent avoir une phraséologie ouvrière et une pratique capitaliste, un langage dans l'opposition et une pratique absolument opposée dans le gouvernement. (…) Après une première explosion de mécontentement et de convulsions sociales qui avait surpris la bourgeoisie, et n'a été neutralisée que par la ‘gauche au pouvoir’, la continuation de la crise qui s'aggrave, les illusions de la gauche au pouvoir qui se dissipent, la reprise de la lutte qui s'annonce, il devenait urgent que la gauche retrouve sa place dans l'opposition et radicalise sa phraséologie pour pouvoir contrôler cette reprise des luttes qui se fait jour. Evidemment, cela ne peut être un absolu définitif, mais c'est actuellement et pour le proche avenir un fait général[3] [3853].” (Ibid.)
4) Le texte de 1979, comme on le voit, rappelait la nécessité d'examiner le phénomène du déploiement des forces politiques à la tête des Etats bourgeois sous trois angles différents :
- les nécessités de la bourgeoisie face à la crise économique ;
- les impératifs impérialistes de chaque bourgeoisie nationale ;
- la politique à mener face au prolétariat.
Il affirmait également que ce dernier aspect est, en dernière instance, le plus important dans la période historique ouverte avec la reprise prolétarienne à la fin des années 1960.
Dans la compréhension de la situation présente c'est un facteur que le CCI a déjà pris en compte dès janvier 1990 lors de l'effondrement du bloc de l'Est et le recul de la conscience qu'il avait provoqué dans la classe ouvrière : “C'est pour cette raison, en particulier, qu'il convient de mettre à jour l'analyse développée par le CCI sur la ‘gauche dans l'opposition’. Cette carte était nécessaire à la bourgeoisie depuis la fin des années 1970 et tout au long des années 1980 du fait de la dynamique générale de la classe vers des combats de plus en plus déterminés et conscients, de son rejet croissant des mystifications démocratiques, électorales et syndicales. (…) En revanche, le recul actuel de la classe n'impose plus à la bourgeoisie, pour un certain temps, l'utilisation prioritaire de cette stratégie.” (Revue internationale n°61)
Cependant, ce qui a l'époque était appréhendé comme une possibilité s'impose aujourd'hui comme règle quasi générale (plus générale encore que celle de la gauche dans l'opposition au cours des années 1980). Après avoir vu la possibilité du phénomène il importe donc de comprendre les causes de son apparition en prenant en compte les trois facteurs énoncés plus haut.
5) La recherche des causes du phénomène d'hégémonie de la gauche à la tête des pays européens doit se baser sur la prise en compte des caractéristiques spécifiques de la période actuelle. Ce travail appartient aux trois rapports sur la situation internationale présentés au congrès et il n'y a pas lieu d'y revenir ici de façon détaillée. Il est toutefois important de comparer la situation actuelle avec celle des années 1970 lorsque la bourgeoisie avait joué la carte de la gauche au gouvernement ou en marche vers le gouvernement.
Sur le plan économique, les années 1970 sont les premières années de la crise ouverte du capitalisme. En fait, c'est surtout à partir de la récession de 1974 que la bourgeoisie prend conscience de la gravité de la situation. Cependant, malgré la violence des convulsions de cette période, la classe dominante s'accroche à l'illusion qu'elles pourront être surmontées. Attribuant ses difficultés à la hausse des prix du pétrole faisant suite à la guerre du Kippour de 1973, elle espère surmonter celles-ci avec une stabilisation des prix pétroliers et la mise en place d'autres sources d'énergie. De même elle mise sur une relance basée sur les crédits très importants (puisés sur les “pétrodollars”) qui sont octroyés aux pays du tiers-monde. Enfin, elle s'imagine que de nouvelles mesures de capitalisme d'Etat de type néo-keynésien permettront de stabiliser les mécanismes de l'économie dans chaque pays.
Sur le plan des conflits impérialistes, on assiste à leur aggravation du fait principalement du développement de la crise économique même si cette aggravation est encore bien en deçà de celle du début des années 1980. La nécessité d'une plus grande discipline au sein de chacun des deux blocs constitue une donnée importante des politiques bourgeoises (c'est ainsi que dans un pays comme la France, la venue de Giscard d'Estaing en 1974 met fin aux velléités “d'indépendance” qui caractérisaient la période gaulliste).
Sur le plan de la lutte de classe, cette période est caractérisée par la très forte combativité qui s'est développée dans tous les pays du monde dans le sillage de mai 1968 en France et du “mai rampant” italien de 1969 ; une combativité qui avait surpris la bourgeoisie dans un premier temps.
Sur ces trois aspects, la situation actuelle se distingue très notablement de celle des années 1970.
Sur le plan économique, il y a belle lurette que la bourgeoisie a perdu ses illusions d'alors sur une “sortie” de la crise. Malgré les campagnes de la période passée sur les bienfaits de la “mondialisation”, elle n'escompte plus revenir au temps béni des “trente glorieuses” même si elle espère encore limiter les dégâts. Mais même cette dernière espérance est sévèrement battue en brèche depuis l'été 1997 avec l'effondrement des “dragons” et des “tigres”, suivi par celui de la Russie et du Brésil en 1998.
Sur le plan des conflits impérialistes, la situation s'est modifiée radicalement : il n'existe plus aujourd'hui de blocs impérialistes. Cependant, les affrontements guerriers n'ont pas cessé pour autant. Ils se sont même aggravés, multipliés et rapprochés des pays centraux, notamment des métropoles d'Europe occidentale. Ils sont également marqués par une tendance à une participation de plus en plus directe des grandes puissances, particulièrement de la première d'entre elles, alors que les années 1970 connaissaient un certain désengagement de celles-ci, particulièrement des Etats-Unis qui quittaient le Vietnam.
Sur le plan des luttes ouvrières, la période actuelle est encore marquée par le recul de la combativité et de la conscience provoqué par les événements de la fin des années 1980 (effondrement du bloc de l'Est et des régimes “socialistes”), début des années 1990 (guerre du Golfe, guerre en Yougoslavie, etc.) même si des tendances à une reprise de la combativité se font sentir et si on constate une fermentation politique en profondeur qui reste encore très minoritaire.
Enfin, il est important de souligner le facteur nouveau affectant la vie de la société aujourd'hui et qui n'existait pas au cours des années 1970 : l'entrée dans la phase de décomposition de la période de décadence du capitalisme.
6) Ce dernier facteur est à prendre en compte pour comprendre le phénomène présent de venue de la gauche au gouvernement. La décomposition affecte toute la société et au premier chef la classe dominante de celle-ci : la bourgeoisie. Ce phénomène est particulièrement spectaculaire dans les pays de la périphérie et constitue un facteur d'instabilité croissante venant souvent alimenter les affrontements impérialistes. Nous avons mis en évidence que dans les pays les plus développés, la classe dominante était beaucoup plus en mesure de contrôler les effets de la décomposition mais en même temps on peut constater qu'elle ne peut pas s'en prévenir totalement. Un des exemples les plus spectaculaires est certainement la pantalonnade du “Monicagate” au sein de la première bourgeoisie mondiale qui, si elle peut viser à une réorientation de la politique impérialiste de celle-ci, provoque en même temps une atteinte sensible de son autorité.
Au sein de l'éventail des partis bourgeois, tous les secteurs ne sont pas affectés de la même façon par le phénomène de la décomposition. Tous les partis bourgeois ont évidemment pour vocation la préservation des intérêts globaux à court terme et à long terme du capital national. Cependant, dans cet éventail, les partis qui ont la plus claire conscience de leurs responsabilités sont en général les partis de gauche par le fait qu'ils sont moins liés aux intérêts à court terme de tel ou tel secteur capitaliste et aussi par le fait que la bourgeoisie leur a déjà attribué un rôle de tout premier plan dans les moments décisifs de la vie de la société (guerres mondiales et surtout périodes révolutionnaires). Evidemment, les partis de gauche sont également affectés par les effets de la décomposition, la corruption, les scandales, les tendances à l'éclatement, etc. Cependant, l'exemple de pays comme l'Italie ou la France mettent en évidence qu'ils sont, de par leurs caractéristiques, plus épargnés que la droite par ces effets. En ce sens, un des éléments permettant d'expliquer la venue de partis de gauche au gouvernement dans beaucoup de pays consiste dans la plus grande résistance de ces partis à la décomposition, et notamment leur plus grande cohésion (ce qui est valable également pour un pays comme la Grande-Bretagne où les tories étaient beaucoup plus divisés que les travaillistes)[4] [3854].
Un autre facteur permettant d'expliquer le “succès” actuel de la gauche en lien avec la décomposition est la nécessité de redonner du tonus à la mystification démocratique et électorale. L'effondrement des régimes staliniens a constitué un facteur très important de relance de ces mystifications, et particulièrement auprès des ouvriers qui, tant qu'existait un système présenté comme différent du capitalisme, pouvaient nourrir un espoir dans une alternative au capitalisme (même s'ils se faisaient déjà peu d'illusions sur la réalité des pays “socialistes”). Cependant, la guerre du Golfe en 1991 a porté un coup aux illusions démocratiques. Plus encore, le désenchantement général envers les valeurs traditionnelles de la société qui caractérise la décomposition, et qui s'exprime principalement par l'atomisation et le “chacun pour soi”, ne pouvait pas ne pas avoir d'effet sur l'impact idéologique des institutions classiques des Etats capitalistes, et particulièrement sur la base de celles-ci, les mécanismes démocratiques et électoraux. Et justement, la victoire électorale de la gauche dans des pays où, conformément aux nécessités de la bourgeoisie, la droite avait gouverné pendant une très longue période (notamment dans deux pays aussi importants que l'Allemagne et la Grande-Bretagne) a pu constituer un facteur important de réanimation des mystifications électoralistes.
7) L'aspect conflits impérialistes (qu'il faut d'ailleurs mettre en lien avec la question de la décomposition : effondrement du bloc de l'Est, “chacun pour soi” dans l'arène internationale) constitue un facteur important de la venue de la gauche au gouvernement dans beaucoup de pays. Nous avons déjà vu que la nécessaire réorientation de la diplomatie de l'Italie au détriment de l'alliance américaine avait constitué un facteur de premier plan de la désagrégation et de la disparition de la Démocratie chrétienne dans ce pays de même que de l'écartement du “pôle” de Berlusconi (plus favorable aux Etats-Unis). Nous avons vu également que la plus grande homogénéité du Labour en Grande-Bretagne en faveur d'une politique plus ouverte envers l'Union européenne était une des clés du choix de Blair par la bourgeoisie britannique. Enfin, la venue au gouvernement en Allemagne des secteurs politiques les plus éloignés de l'hitlérisme et qui s'étaient même confectionné un costume de “pacifisme” (social-démocratie et surtout “verts”) constitue un meilleur paravent à l'affirmation des visées impérialistes de ce pays, principal rival des Etats-Unis à long terme. Cependant, il existe un autre élément à prendre en considération et qui s'applique aussi aux pays (comme la France) où il n'y a pas de différence entre la droite et le gauche en politique internationale. Il s'agit de la nécessité pour chaque bourgeoisie des pays centraux d'une participation croissante aux conflits militaires qui ravagent le monde et de la nature même de ces conflits. En effet, ces derniers se présentent souvent comme d'horribles massacres de populations civiles face auxquels la “communauté internationale” se doit de faire valoir “le droit” et mettre en place des missions “humanitaires”. Depuis 1990, la presque totalité des interventions militaires des grandes puissances (et particulièrement celle en Yougoslavie) s'est habillée de ce costume et non de celui de la défense des “intérêts nationaux”. Et pour conduire les guerres “humanitaires” il est clair que la gauche et mieux placée que la droite (même si cette dernière peut aussi faire l'affaire), elle dont un des fonds de commerce est justement la “défense des droits de l'homme[5] [3855]”.
8) Sur le plan de la gestion de la crise économique il existe également des éléments qui vont en faveur d'une venue de la gauche au gouvernement dans la plupart des pays. C'est notamment l'échec aujourd'hui patent des politiques ultra libérales dont Reagan et Thatcher étaient les représentants les plus notables. Evidemment, la bourgeoisie ne peut faire autre chose que de poursuivre ses attaques économiques contre la classe ouvrière. De même, elle ne reviendra pas sur les privatisations qui lui ont permis :
- de soulager les déficits du budget de l'Etat ;
- de mieux rentabiliser un certain nombre d'activités économiques ;
- d'éviter la politisation immédiate des conflits sociaux dès lors que le patron est l'Etat lui-même.
Cela dit, la faillite des politiques ultra-libérales (qui s'est exprimée notamment avec la crise asiatique) apporte de l'eau aux tenants d'une politique de plus grande intervention de l’Etat. Cela est valable au niveau des discours idéologiques : il faut que la bourgeoisie fasse semblant de corriger ce qu'elle peut présenter comme ses erreurs, l'aggravation de la crise, afin d'éviter que celle-ci ne favorise la prise de conscience du prolétariat. Mais c'est également valable au niveau des politiques réelles : la bourgeoisie prend conscience des “excès” de la politique “ultra-libérale”. Dans la mesure où la droite était fortement marquée par cette politique de “moins d'Etat”, la gauche est pour le moment la plus indiquée pour mettre en œuvre un tel changement (même si l'on sait que la droite peut également prendre ce type de mesures comme elle l'avait fait dans les années 1970 avec Giscard d'Estaing en France et même si aujourd'hui c'est une homme de droite, Aznar, qui en Espagne se réclame de la politique menée par le travailliste Blair). La gauche ne peut pas rétablir le “welfare state” mais elle fait semblant de ne pas trahir complètement son programme en rétablissant une plus grande intervention de l’Etat dans l'économie.
En outre, l'échec de la “mondialisation débridée” qui s'est notamment concrétisé par la crise asiatique constitue un facteur supplémentaire venant apporter de l'eau au moulin de la gauche. Lorsque la crise ouverte s'est développée, à partir des années 1970, la bourgeoisie a compris qu'il ne fallait pas qu'elle recommence les erreurs qui avaient contribué à aggraver celle des années 1930. En particulier, malgré toutes les tendances qui se faisaient jour en ce sens, il fallait combattre la tentation d'un repliement sur soi, du protectionnisme et de l'autarcie qui risquaient de porter un coup fatal au commerce international. C'est pour cela que la Communauté économique européenne à pu poursuivre son chemin jusqu'à aboutir à l'Union européenne et à la mise en place de l'Euro. C'est pour cela également que s'est mise en place l'Organisation mondiale du commerce visant à limiter les droits de douane et à favoriser les échanges internationaux. Cependant, cette politique d'ouverture des marchés a constitué un facteur important d'explosion de la spéculation financière (qui constitue le “sport” favori des capitalistes en période de crise quand ils se détournent de l'investissement productif aux faibles perspectives de rentabilisation) dont l'effondrement des pays asiatiques a mis en évidence les dangers. Même si la gauche ne remettra pas en cause fondamentalement la politique de la droite dans ce domaine, elle est plus favorable à une plus grande régulation des flux financiers internationaux (régulation dont une des formules est la “taxe Tobin”) permettant de limiter les excès de la “mondialisation”. Ce faisant, sa politique vise à créer une sorte de “cordon sanitaire” autour des pays les plus développés permettant de limiter l'impact des convulsions qui affectent les pays de la périphérie.
9) La nécessité de faire face au développement de la lutte de classe constitue un facteur essentiel de la venue de la gauche au gouvernement dans la période actuelle. Mais avant que d'en déterminer les raisons il faut relever les différences entre la situation actuelle et celle des années dans ce domaine. Dans les années 1970, la venue de la gauche au gouvernement avait comme argument auprès des masses ouvrières :
- il faut mettre en place une politique économique radicalement différente de celle de la droite, une politique “socialiste”, afin de relancer l'économie et de “faire payer les riches[6] [3856]”;
- pour ne pas compromettre cette politique ou permettre à la gauche de gagner les élections il faut limiter les luttes sociales.
De façon crue, on peut dire que “l'alternative de gauche” avait pour fonction de canaliser le mécontentement et la combativité des ouvriers dans les urnes électorales.
Aujourd'hui, les différents partis de gauche qui ont accédé au gouvernement en gagnant les élections étaient bien loin de tenir le langage “ouvrier” qu'ils tenaient au début des années 1970. Les exemples les plus frappants sont bien ceux de Blair qui se fait l'apôtre d'une troisième voie et de Schröder tenant d'un “nouveau centre”. En fait, il ne s'agissait pas de canaliser un combativité qui est encore très faible vers les urnes mais de se donner les moyens qu'une fois au gouvernement la gauche n'ait pas un langage trop différent de celui qu'elle avait durant la campagne électorale, et ceci afin d'éviter un discrédit rapide comme cela avait été le cas dans les années 1970 (par exemple, les travaillistes anglais venus au gouvernement début 1974 dans la foulée de la grève des mineurs avaient dû en sortir dès 1979 face à une combativité qui allait atteindre des niveaux exceptionnels au cours de cette même année). Le fait que la gauche d'aujourd'hui ait un visage beaucoup plus “bourgeois” que dans les années 1970 découle bien de la faiblesse actuelle de la combativité ouvrière. Cela permet à la gauche de venir remplacer la droite au gouvernement sans trop d'à coups. Cependant, la généralisation des gouvernements de gauche dans les pays les plus avancés n'est pas seulement un phénomène “par défaut” lié à la faiblesse de la classe ouvrière. Elle joue également un rôle “positif” pour la bourgeoisie face à son ennemi mortel. Et cela, aussi bien à moyen terme qu'à court terme.
A moyen terme l'alternance n'a pas seulement permis de recrédibiliser le processus électoral, elle permet aux partis de droite de se refaire des forces dans l'opposition[7] [3857] afin de pouvoir mieux jouer leur rôle lorsque réapparaîtra une situation rendant nécessaire la gauche dans l'opposition avec une droite “dure” au pouvoir[8] [3858].
Dans l'immédiat, le langage “modéré” de la gauche pour faire passer ses attaques permet de s'éviter les explosions de combativité favorisées par les provocations du langage dur de la droite modèle Thatcher. Et c'est bien là un des objectifs importants de la bourgeoisie. Dans la mesure où, comme nous l'avons mis en évidence, une des conditions essentielles permettant à la classe ouvrière de regagner le terrain qu'elle a perdu avec l'effondrement du bloc de l'Est et de reprendre son processus de prise de conscience est constitué par le développement de ses luttes, la bourgeoisie essaie aujourd'hui de gagner le plus de temps possible, même si elle sait qu'elle ne pourra pas toujours jouer cette carte.
10) Ainsi il apparaît que parmi les différents facteurs motivant à l'heure actuelle l'utilisation par la bourgeoisie de la carte de la gauche au gouvernement, la gestion de la crise, les conflits impérialistes et la politique face à la menace prolétarienne, c'est ce dernier facteur qui revêt la plus grande importance. Cette importance est d'autant plus grande que dans le facteur gestion de la crise, un des aspects essentiels de la politique de la gauche n'est pas tant dans les mesures concrètes qu'elle est amenée à prendre (et que la droite peut tout aussi bien adopter) que dans sa capacité à tenir un discours différent de celui de la droite qui se trouvait au gouvernement jusqu'à dernièrement. En ce sens, c'est par sa fonction idéologique que la gauche est particulièrement précieuse par rapport à la gestion de la crise, une fonction idéologique qui s'adresse à l'ensemble de la société mais tout particulièrement à la principale classe faisant face à la bourgeoisie, le prolétariat. De même, concernant la question des conflits impérialistes, la contribution essentielle que la gauche peut apporter aux politiques de guerre de la bourgeoisie, leur donner un habillage “humanitaire” le plus seyant possible, relève aussi du domaine du discours idéologique et de la mystification qui, là aussi, s'adresse à l'ensemble de la population mais principalement à la classe ouvrière qui est la seule force qui puisse faire obstacle à la guerre impérialiste.
Le rôle essentiel que joue, en fin de compte, le facteur défense contre la classe ouvrière dans la politique actuelle de gauche au gouvernement menée par la classe bourgeoise constitue une autre illustration de l'analyse développée par le CCI depuis plus de 30 ans : le rapport de forces général entre les classes, le cours historique, n'est pas en faveur de la bourgeoisie (contre-révolution, cours vers la guerre mondiale) mais en faveur du prolétariat (sortie de la contre-révolution, cours vers les affrontements de classe). Le recul subi par ce dernier avec l'effondrement des régimes staliniens et les campagnes sur la “mort du communisme” n'a pas remis en cause fondamentalement ce cours historique.
11) La présence massive des partis de gauche dans les gouvernements européens constitue un élément significatif et très important de la situation actuelle. Cette carte, les différentes bourgeoisies nationales ne la jouent pas chacune dans son coin. Déjà, au cours des années 1970, lorsque la carte de la gauche au gouvernement, ou en marche vers le gouvernement, avait été jouée par la bourgeoisie européenne, elle avait reçu le soutien du président démocrate des Etats-Unis, James Carter. Dans les années 1980, la carte de la gauche dans l'opposition et d'une droite “dure” au pouvoir avait trouvé dans Ronald Reagan (en même temps que Margaret Thatcher) son représentant le plus éminent. A cette époque, c'est au niveau de l'ensemble du bloc occidental que la bourgeoisie élaborait ses politiques. Aujourd'hui les blocs ont disparu et les tensions impérialistes n'ont cessé de s'aggraver entre les Etats-Unis et de nombreux pays européens. Cependant, face à la crise et à la lutte de classe, les principales bourgeoisies du monde ont à cœur de continuer à coordonner leurs politiques. C'est ainsi que le 21 septembre 1998 s'est tenue à New York une rencontre au sommet pour une “internationale de centre-gauche” où Tony Blair a célébré le “centre radical” et Romano Prodi “L'Olivier mondial”. Quant à Bill Clinton il s'est félicité de voir “la troisième voie s'étendre dans le monde[9] [3859]”. Cependant, ces manifestations enthousiastes des principaux dirigeants de la bourgeoisie ne doivent pas cacher la gravité de la situation mondiale qui constitue la toile de fond et la raison majeure de la stratégie actuelle de la bourgeoisie.
Cette stratégie, il est probable que la bourgeoisie la maintiendra pour un moment encore. En particulier, il est indispensable que les partis de droite récupèrent les forces et la cohésion qui leur permettront de reprendre leur place au sommet de l’Etat. D'ailleurs, le fait que la venue de la gauche dans un grand nombre de pays (et particulièrement en Grande-Bretagne et en Allemagne) se soit faite “à froid”, dans un climat de faible combativité ouvrière (contrairement à ce qui s'était passé en Grande-Bretagne en 1974 par exemple), avec un programme électoral très proche de celui qui est effectivement appliqué, signifie que la bourgeoisie a l'intention de jouer cette carte pour un bon moment encore. En fait, un des éléments décisifs qui déterminera le moment du retour de la droite sera le retour sur le devant de la scène des luttes massives du prolétariat. Dans l'attente de ce moment, alors que le mécontentement ouvrier ne parvient encore à s'exprimer que de façon limitée et souvent isolée, il appartient à la “gauche de la gauche” de canaliser ce mécontentement. Comme nous l'avons déjà vu, la bourgeoisie ne peut laisser totalement dégarni le terrain social. C'est pour cela qu'on assiste à une certaine montée en force des gauchistes (notamment en France) et que, dans certains pays, les partis socialistes au gouvernement ont essayé de prendre leurs distances avec les organisations syndicales qui peuvent se permettre ainsi d'avoir un langage “un peu contestataire”. Cependant, le fait qu'en Italie tout un secteur de Rifondazione comunista ait décidé de continuer à soutenir le gouvernement et qu'en France la CGT ait décidé lors de son dernier congrès de mener une politique plus “modérée” met en évidence qu'il n'y a pas encore urgence pour la classe dominante.
[1] [3860] Il faut noter qu'en Suède où, lors des dernières élections la Social-démocratie a obtenu son plus mauvais score depuis 1928, la bourgeoisie a quand même fait appel à ce parti (avec le soutien du parti stalinien) pour diriger les affaires de l’Etat.
[2] [3861] C'est une idée que le CCI avait déjà développée antérieurement à plusieurs reprises : “Ainsi il apparaît que les partis de gauche ne sont pas les représentants exclusifs de la tendance générale vers le capitalisme d'Etat, qu'en période de crise, celle-ci se manifeste avec une telle force, que, quelle que soit la tendance politique au pouvoir, celle-ci ne peut faire autre chose que de prendre des mesures d'étatisation, la seule différence pouvant subsister entre droite et gauche étant celle de la méthode pour faire taire le prolétariat : carotte ou bâton.” (Révolution Internationale n° 9, mai-juin 1974) Comme on peut le voir, l'analyse que nous avons développée au 3e congrès ne tombait pas du ciel mais découlait d'un cadre que nous avions déjà élaboré cinq ans auparavant.
[3] [3862] La possibilité pour un parti de gauche de mieux jouer son rôle en restant dans l'opposition plutôt qu'en allant au gouvernement n'était pas non plus une idée nouvelle dans le CCI. C'est ainsi que cinq ans auparavant nous écrivions à propos de l'Espagne : “[le PCE] est de plus en plus débordé dans les luttes actuelles et... il risque, depuis d'éventuels postes gouvernementaux, de ne pas pouvoir contrôler la classe comme c'est sa fonction ; dans ce cas, son efficacité anti-ouvrière serait bien plus grande en restant parti d'opposition.” (Révolution Internationale n°11, sept. 1974)
[4] [3863] Il est important de souligner toutefois ce qui est relevé plus haut : la décomposition affecte de façon très différente la bourgeoisie suivant qu'il s'agit d'un pays avancé ou d'un pays arriéré. Dans les pays de vieille bourgeoisie, l'appareil politique de celle-ci, y compris ses secteurs de droite pourtant les plus vulnérables, est capable en règle générale de rester maître de la situation et de s'éviter les convulsions qui affectent les pays du tiers-monde ou certains pays de l'ancien empire soviétique.
[5] [3864] Après que ce texte ait été rédigé, la guerre en Yougoslavie est venue apporter une illustration frappante de cette idée. Les frappes de l'OTAN se sont présentées uniquement comme “humanitaires”, avec pour objectif de protéger les populations albanaises du Kosovo contre les exactions de Milosevic. Tous les jours, le spectacle télévisé de la tragédie des réfugiés albanais est venu renforcer la thèse écoeurante de la “guerre humanitaire”. Dans cette campagne idéologique belliciste, la gauche de la gauche que représentent les “verts” s'est particulièrement illustrée puisque c'est le leader des verts allemands, Joshka Fischer qui conduisait la diplomatie de guerre allemande au nom des idéaux “pacifistes” et “humanitaires” dans lesquels il s'était illustré par le passé. De même, en France, alors que le Parti socialiste était hésitant sur la question d'une intervention terrestre, ce sont les verts qui, au nom de “l'urgence humanitaire”, appelaient à une telle intervention. La gauche d'aujourd'hui retrouvait ainsi les accents de son ancêtre des années 1930 qui réclamait “des armes pour l'Espagne” et ne voulait laisser à personne la première place dans la propagande belliciste au nom de l'anti-fascisme.
[6] [3865] C'était l'époque où Mitterrand (oui Mitterrand et non pas un quelconque gauchiste !) parlait avec ferveur dans ses discours électoraux de “rupture avec le capitalisme”.
[7] [3866] En règle générale, les “cures d'opposition” constituent une bonne thérapie pour les forces bourgeoises qu'une longue présence au pouvoir a usées. Cependant, ce n'est pas valable dans tous les pays. Ainsi, le retour dans l'opposition de la droite française, suite à l'échec électoral du printemps 1997, a constitué pour elle une nouvelle catastrophe. Ce secteur de l'appareil politique bourgeois n'en finit pas d'étaler ses incohérences et ses divisions, chose qu'elle n'aurait pu faire si elle avait gardé le pouvoir. Mais c'est vrai que nous avons à faire à “la droite la plus bête du monde”. A ce propos, il est difficile de considérer comme le laisse entendre Le Prolétaire dans son article que c'est délibérément pour permettre au parti socialiste de prendre la direction du gouvernement que le président Chirac a provoqué des élections anticipées en 1997. On sait que la bourgeoisie est machiavélique mais il y a des limites. Et Chirac, qui est lui-même “limité”, n'a certainement pas désiré la défaite de son parti qui lui donne actuellement un rôle de second plan.
[8] [3867] Note postérieure au Congrès du CCI : Les élections européennes de juin 1999, qui ont vu dans la plupart des pays (et particulièrement en Allemagne et en Grande-Bretagne) une remontée très sensible de la droite, ont fait la preuve que la cure d'opposition commence à faire le plus grand bien à ce secteur de l'appareil politique de la bourgeoisie. Le contre-exemple remarquable est évidemment celui de la France où ces élections ont représenté pour la droite une nouvelle catastrophe, non pas tant sur le plan du nombre de ses électeurs mais sur celui de ses divisions qui atteignent des proportions grotesques.
[9] [3868] Il faut noter que la carte de gauche au gouvernement jouée aujourd'hui par la bourgeoisie dans les pays les plus avancés trouve (au delà des particularités locales) un certain écho dans certains pays de la périphérie. Ainsi, la récente élection au Venezuela -avec le soutien de la “Gauche révolutionnaire” (MIR) et des staliniens- de l'ex-colonel putschiste Chavez au détriment de la droite (Copei) et d'un parti social-démocrate (Accion Democratica) particulièrement discrédité s'apparente à la formule de gauche au gouvernement. De même, on assiste actuellement au Mexique à la montée en force du parti de gauche PRD de Cardenas (fils d'un ancien président), qui a d'ores et déjà ravi la direction de la capitale au PRI (au pouvoir depuis huit décennies) et qui a bénéficié récemment du soutien discret de Bill Clinton lui-même.
Conscience et organisation:
Questions théoriques:
- Décadence [32]
Crise économique : trente ans de crise ouverte du capitalisme (III. les années 1990)
- 11704 reads
Nous consacrons la troisième partie de cette histoire de la crise capitaliste à la décennie des années 1990. Cette décennie n’est pas encore terminée mais les derniers trente mois ont connu une aggravation toute particulière de la situation économique[1] [3869].
Nous avons assisté tout au long de la décennie à l’effondrement de tous les modèles que le capitalisme présentait comme panacée et solution : en 1989 c’est le modèle stalinien que la bourgeoisie a vendu comme du “communisme” pour mieux faire avaler le mensonge du triomphe du “capitalisme”. Après lui se sont effondrés, l’un après l’autre, même si c’est de manière plus discrète, les “modèles” allemand, japonais, suédois, suisse et, finalement, celui des “tigres” et des “dragons” asiatiques. Cette succession d’échecs montre que le capitalisme n’a pas de solution à sa crise historique et que tant d’années de tricheries et de manipulations des lois économiques n’ont fait qu’empirer de façon considérable sa situation.
-
L’effondrement des pays de l’Est et la récession mondiale de 1991-93
L’effondrement des pays de l’ancien bloc russe[2] [3870] est un authentique cataclysme : de 1989 à 1993 les indices de production connaissent une chute régulière de 10% jusqu’à 30%. La Russie a perdu, entre 1989 et 1997, 70% de sa production industrielle ! Si à partir de 1994 les rythmes de la chute se ralentissent, le bilan continue à être lamentable : des pays comme la Bulgarie, la Roumanie ou la Russie continuent à présenter des indices négatifs tandis que seules la Pologne, la Hongrie et la République tchèque connaissent des taux de croissance positifs.
L’écroulement de ces économies qui représentent plus de 1/6e du territoire mondial est le plus grave de tout le 20e siècle en temps de “paix”. Il s’ajoute à la liste des victimes des années 1980 : la majorité des pays africains et un bon nombre de pays asiatiques, des Caraïbes, d’Amérique centrale et du sud. Les bases de la reproduction capitaliste à l’échelle mondiale souffrent d’une nouvelle amputation importante. Mais l’effondrement des pays de l’ancien bloc de l’Est n’est pas un fait isolé, c’est l’annonce d’une nouvelle convulsion de l’économie mondiale : après cinq ans de ralentissement et de tensions financières (voir l’article précédent), depuis la fin 1990 la récession s’est rapprochée des grandes métropoles industrielles :
- Les Etats-Unis connaissent un ralentissement de la croissance entre 1989 et 1990 (2% et 0,5%) qui se change en un taux négatif en 1991 : -0,8%.
- La Grande-Bretagne souffre d’une récession, la plus forte depuis 1945, qui se prolonge jusqu’en 1993.
- La Suède, dont la récession est la plus violente depuis l’après-guerre, entre à partir de cette période dans une situation de semi ralentissement (le fameux “modèle suédois” disparaît des tablettes).
- Même si la récession est plus tardive en Allemagne et dans les autres pays d’Europe occidentale, elle est effective à la mi-1992 et se prolonge en 1993-94. En 1993 la production industrielle de l’Allemagne chute de 8,3% et pour l’ensemble des pays de l’Union Européenne la production totale chute de 1%.
- Le Japon se trouve à partir de 1990 dans un état de récession larvée : la moyenne du taux de croissance pendant la période 1990-97 a été un rachitique 1,2% et ceci bien que le gouvernement ait réalisé rien moins que 11 plans de relance !
- Le chômage bat de nouveaux records historiques. Il suffit de signaler quelques données :
- pour la seule année 1991, les vingt-quatre pays de l’OCDE éliminent 6 millions de postes de travail ;
- entre 1991 et 1993, 8 millions d’emplois sont détruits dans les 12 pays de l’Union européenne ;
- en 1992, l’Allemagne retrouve son niveau de chômage des années 1930 et depuis lors, loin de baisser, celui-ci continue à augmenter, atteignant 4 millions en 1994 et jusqu’à 5 millions en 1997.
Même si en terme de chute des indices de la production, la récession de 1991-93 paraît moins brutale que les récessions pécédentes de 1974-75 et 1980-82, toute une série d’éléments qualitatifs montrent le contraire :
- A la différence des récessions antérieures aucun secteur n’est épargné par la crise.
- La récession touche particulièrement les secteurs de l’informatique et de l’armement qui n’avaient jamais été affectés. Ainsi en 1991 IBM procède à 20.000 licenciements (80.000 en 1993) ; NCR à 18.000 ; Digital Equipment à 10.000 ; Wang à 8.000 ; etc. En 1993 la puissante et très moderne industrie allemande de l’automobile planifie 100.000 licenciements.
- Il se produit également un phénomène inconnu dans les récessions précédentes. Ces dernières s’étaient produites parce que les gouvernements, face à la menace de l’inflation, avaient fermé brutalement le robinet du crédit. Au contraire, celle de 1991-93 se produit en même temps que sont réalisées d’énormes injections de crédit qui ne parviennent pas à stimuler la machine économique : “contrairement à ce qui se produit lors des récessions de 1967, 1970, 1974-75 et 1980-82, l’augmentation de la masse monétaire créée directement par l’Etat (billets de la banque centrale et pièces de monnaie) ne provoque plus une augmentation de la masse des crédits bancaires. Le gouvernement américain a beau appuyer sur l’accélérateur, la machine bancaire ne répond plus.” (Revue internationale n°70, “Une récession pire que les précédentes”). Ainsi, entre 1989 et 1992 la Réserve fédérale des Etats-Unis abaisse vingt-deux fois le taux d’intérêt qui passe de 10% à 3% (un chiffre inférieur au taux d’inflation, ce qui signifie qu’on emprunte de l’argent à la banque de manière pratiquement gratuite) sans pour autant parvenir à ranimer l’économie. C’est ce que les experts appellent le “credit crunch”, la “contraction du crédit”.
- Il se produit un important retour de l’inflation.
-
Les donnés pour 1989-90 sont
| Etat-unis | 6 % |
| Grande-Bretagne | 10,4 % |
| CEE | 10,4 % |
| Brésil | 1800 % |
| Bulgarie | 70 % |
| Pologne | 50 % |
| Hongrie | 40 % |
| URSS | 34 % |
La récession de 1991-93 montre la réapparition tendancielle de la combinaison tant redoutée et qui avait fait si peur aux gouvernements bourgeois dans les années 1970 : la récession plus l’inflation, la “stagflation”. De façon générale, cela met en évidence que la “gestion de la crise”, que nous avons analysée dans le premier article de cette série, ne peut ni surmonter ni même atténuer les maux du capitalisme et ne fait pas autre chose que de les repousser, de telle façon que chaque récession est pire que la précédente et moins grave que la suivante. Dans ce sens celle de 1991-93 manifeste 3 traits qualitatifs très importants :
- le crédit est chaque fois plus incapable de relancer la production ;
- le risque est aggravé d’une combinaison entre le ralentissement de la production d’un côté, et les explosions inflationnistes de l’autre ;
- les secteurs qui, jusqu’à présent, avaient échappé à la crise sont touchés à leur tour : l’informatique, les télécommunications, l’armement.
Une reprise sans emploi
Depuis 1994 et avec quelques timides tentatives en 1993, l’économie des Etats-Unis, accompagnée par celle du Canada et de la Grande-Bretagne, a commencé à présenter des chiffres de croissance qui n’ont jamais dépassé 5%. Ceci a pourtant permis à la bourgeoisie de crier victoire et de proclamer aux quatre vents la “relance” économique et y compris de parler des “années de croissance ininterrompue”, etc.
Cette “relance” s’appuie sur :
- L’endettement massif des Etats-Unis et de toute l’économie mondiale :
- Entre 1987 et 1997 l’endettement total des Etats-Unis a crû à un rythme quotidien de 628 millions de dollars. Les bases de cet endettement sont d’une part un drainage de l’énorme masse de dollars qui circulent dans le monde entier[3] [3871] et, d’autre part, le stimulant démesuré de la consommation domestique que provoque l’effondrement de l’épargne, un effondrement tel qu’en 1996, pour la première fois depuis cinquante-trois ans, le taux d’épargne devient négatif.
- La Chine et les prétendus “tigres” et “dragons” asiatiques reçoivent des fonds considérables sur la base de la parité entre leur monnaie locale et le dollar (un commerce fabuleux pour les investisseurs étrangers), ce qui sert d’aliment à leur croissance rapide bien qu’illusoire.
- Une série de pays clés d’Amérique latine (Brésil, Chili, Argentine, Venezuela, Mexique) sont le centre d’énormes prêts spéculatifs payés avec des intérêts élevés à court terme.
- Une augmentation spectaculaire de la productivité du travail qui permet d’abaisser les coûts et de rendre les marchandises américaines plus compétitives.
- Une politique commerciale agressive de la part du capital américain dont les piliers sont :
- l’obligation faite à ses rivaux de démanteler les barrières douanières et autres mécanismes protectionnistes ;
- les manipulations du dollar ; on laisse baisser son cours lorsque la priorité est de stimuler les exportations et on le fait remonter quand l’essentiel est d’attirer des fonds ;
- la mise à profit maximale de tous les instruments que les Etats-Unis détiennent par leur position de première puissance impérialiste (militaires, diplomatiques, économiques) pour favoriser leur position sur le marché mondial.
Les pays européens suivent le même chemin que les Etats-Unis et à partir de 1995 participent aussi à la “croissance” même si c’est dans une mesure bien moindre (leur indice de croissance oscille entre 1% et 3%).
La caractéristique la plus marquante de cette nouvelle “reprise” est qu’il s’agit d’une reprise sans emplois, ce qui constitue une nouveauté par rapport aux reprises antérieures. Nous voyons ainsi que :
- Malgré les opérations continuelles de maquillage des statistiques, le chômage ne cesse d’augmenter entre 1993 et 1996 dans les pays de l’OCDE.
- Les grandes entreprises loin d’augmenter l’emploi continuent à le détruire : on calcule que, aux Etats-Unis, les 500 premières entreprises ont éliminé 500.000 postes entre 1993 et 1996.
- Pour la première fois depuis 1945 le nombre de fonctionnaires est réduit. Ainsi l’administration fédérale américaine a éliminé 118.000 postes entre 1994 et 1996.
- A la différence des phases de reprise antérieures, l’augmentation des bénéfices des entreprises ne s’accompagne pas d’une croissance de l’emploi mais tout le contraire.
Les nouveaux emplois qui sont créés sont bien plus des sous-emplois, très mal payés et à temps partiel.
Cette reprise qui augmente le chômage est un témoignage éloquent de la gravité à laquelle est arrivée la crise historique du capitalisme comme nous l’avons signalé dans la Revue internationale n°80 : “quand l’économie capitaliste fonctionne de façon saine, l’augmentation ou le maintien des profits est le résultat de l’augmentation du nombre de travailleurs exploités, ainsi que de la capacité à en extraire une plus grande masse de plus-value. Lorsqu’elle vit dans une phase de maladie chronique, malgré le renforcement de l’exploitation et de la productivité, l’insuffisance des marchés l’empêche de maintenir ses profits, sa rentabilité sans réduire le nombre d’exploités, sans détruire du capital.”
Tout comme la récession ouverte de 1991-93, la reprise de 1994-97, de par sa fragilité et ses violentes contradictions, est une nouvelle manifestation de l’aggravation de la crise capitaliste mais à la différence des précédentes :
- elle touche un nombre beaucoup plus petit de pays ;
- les Etats-Unis ne sont déjà plus la locomotive mondiale qui impulse leurs “associés” mais ils se rattrapent à leurs dépens, principalement au détriment de l’Allemagne et du Japon ;
- le chômage continue de croître et le mieux qu’on puisse faire est d’atténuer son rythme d’augmentation ;
- elle s’accompagne de convulsions financières et boursières continuelles, entre autres :
- faillite de l’économie mexicaine (1994) ;
- cataclysme du système monétaire européen (1995) ;
- faillite de la banque Barings (1996).
Nous pouvons conclure que dans l’évolution de la crise capitaliste pendant les trente dernières années chaque moment de reprise est plus faible que le précédent même s’il est plus fort que le suivant, en même temps que chaque phase de récession est pire que la précédente même si elle est moins dure que la suivante.
La prétendue “mondialisation”
Pendant les années 1990, nous avons vu fleurir l’idéologie de la “mondialisation” selon laquelle la mise en oeuvre dans le monde entier des lois du marché, de la rigueur budgétaire, de la flexibilité du travail et de la circulation sans entrave des capitaux, permettrait la sortie “définitive” de la crise (ceci grâce à une nouvelle charge de sacrifices accablants sur les épaules du prolétariat). Comme tous les “modèles” qui l’ont précédée, cette nouvelle alchimie est une autre tentative des grands Etats capitalistes pour “accompagner” la crise et essayer de la ralentir. A cet égard cette politique contient trois axes essentiels :
- un accroissement considérable de la productivité ;
- une réduction des barrières douanières et des entraves au commerce mondial ;
- un développement spectaculaire des transactions financières
L’accroissement de la productivité
Pendant les années 1990 les pays les plus industrialisés ont connu un accroissement important de la productivité. Dans cette augmentation nous pouvons distinguer d’un côté la réduction des coûts, de l’autre, l’augmentation de la composition organique du capital (la proportion entre le capital constant et le capital variable).
Dans la réduction des coûts sont intervenus plusieurs facteurs :
- Une pression très forte sur les coûts salariaux : la réduction du salaire nominal et des coupes chaque fois plus fortes de la partie du salaire matérialisée dans les prestations sociales.
- Une chute vertigineuse des prix des matières premières.
- L’élimination systématique et organisée des secteurs non rentables de l’appareil productif, aussi bien privé que public, au moyen de différents mécanismes : fermeture pure et simple, privatisation de propriétés étatiques, fusion, cession et externalisation d’actifs.
- La prétendue “délocalisation”, c’est-à-dire le transfert de la production à faible valeur ajoutée dans les pays du tiers-monde, ce qui permet, avec des coûts du travail très bas et des prix de vente dérisoires (par des recours fréquents au dumping), aux pays centraux de baisser leurs coûts.
Le résultat général a été la réduction universelle des coûts du travail (une augmentationbrutale aussi bien de la plus-value absolue que de la plus-value relative).
-
Taux de variation annuelle des coûts unitaires du travail (Source : OCDE)
| Pays | 1985-95 | 1996 | 1997 | 1998 |
| Australie | 3,8 | 2,8 | 1,7 | 2,8 |
| Autriche | 2,4 | -0,6 | 0,0 | -0,2 |
| Canada | 3,1 | 3,8 | 2,5 | 0,8 |
| France | 1,5 | 0,9 | 0,8 | 0,4 |
| Allemagne | 0,0 | -0,4 | -1,5 | -1,0 |
| Italie | 4,1 | 3,8 | 2,5 | 0,8 |
| Japon | 0,5 | -2,9 | 1,9 | 0,5 |
| Corée | 7,0 | 4,3 | 3,8 | -4,3 |
| Espagne | 4,2 | 2,6 | 2,7 | 2,0 |
| Suède | 4,4 | 4,0 | 0,5 | 1,7 |
| Suisse | 3,5 | 1,3 | -0,4 | -0,7 |
| Grande-Bretagne | 4,6 | 2,5 | 3,4 | 2,8 |
| Etats-unis | 3,1 | 2,0 | 2,3 | 2,7 |
En ce qui concerne l’augmentation de la composition organique du capital, elle a continué à croître tout au long de la période de décadence car elle est indispensable pour compenser la chute du taux de profit. Dans les années 1990, l’introduction systématique de la robotique, de l’informatique et des télécommunications a provoqué une nouvelle accélération de ce phénomène.
Cet accroissement de la composition organique apporte pour tel ou tel capital individuel, ou pour une nation entière, un avantage certain sur ses compétiteurs, mais que signifie-t-il du point de vue de l’ensemble du capital mondial ? Dans la période ascendante du mode de production capitaliste, quand le système pouvait incorporer de nouvelles masses de travailleurs dans ses rapports d’exploitation, l’augmentation de la composition organique constituait un facteur accélérateur de l’expansion capitaliste. Dans le contexte actuel de la décadence et des trente années de crise chronique, l’effet de ces augmentations de la composition organique est complètement différent. Si elles sont bien indispensables pour chaque capital individuel pour lui permettre de compenser la tendance à la baisse de son taux de profit, elles ont un effet différent pour le capitalisme dans son ensemble car elles aggravent la surproduction et réduisent la base même de l’exploitation en poussant à la baisse du capital variable, en mettant à la rue des masses toujours plus grandes de prolétaires.
La réduction des barrières douanières
La propagande bourgeoise a présenté comme “le triomphe du marché” l’élimination des barrières douanières qui s’est opérée tout au long de la décennie. Nous ne pouvons pas en faire ici une analyse détaillée[4] [3872] mais, une fois de plus, il est nécessaire de montrer la réalité qui se cache derrière les rideaux de fumée idéologiques :
- Cette élimination des barrières douanières et des mesures protectionnistes s’est faite pour l’essentiel dans un seul sens : ce sont les pays les plus faibles qui l’ont réalisée au bénéfice des pays les plus forts et cela a particulièrement affecté le Brésil, la Russie, l’Inde, etc. Les pays plus industrialisés loin de réduire leurs barrières douanières en ont créé de nouvelles en employant les alibis de l’environnement, de la santé, des “droits de l’homme”, etc. Cette politique, contrairement à la présentation idéologique qu’en fait la bourgeoisie, a aggravé les tensions impérialistes.
- Face à l’aggravation de la crise, les pays plus industrialisés ont impulsé une politique de “coopération” dont le contenu s’est centré sur :
- détourner les effets de la crise et de l’aggravation de la concurrence sur les pays les plus faibles ;
- empêcher par tous les moyens un effondrement du commerce mondial qui ne ferait qu’aiguiser beaucoup plus la crise avec des conséquences particulièrement graves pour les pays centraux.
La globalisation des transactions financières
La décennie des années 1990 a connu une nouvelle escalade dans l’endettement. La quantité se transforme en qualité, et nous pouvons dire que l’endettement s’est converti en surendettement :
- Alors que dans les années 1970 l’endettement pouvait être réduit en prenant le risque de provoquer la récession, depuis le milieu des années 1980 l’endettement est une nécessité permanente et toujours croissante de tous les Etats aussi bien dans les moments de récession que dans les moments de reprise : “l’endettement n’est […] pas un choix, une politique économique que les dirigeants de ce monde pourraient suivre ou non. C’est une contrainte, une nécessité inscrite dans le fonctionnement et les contradictions même du système capitaliste.” (Revue internationale n°87, “Une économie de casino”)
- D’une part les Etats, les banques et les entreprises ont besoin d’un flux de crédits frais qui ne peut être obtenu que sur le marché des valeurs. Comme conséquence, il se produit une concurrence effrénée pour attirer les prêteurs. Pour cela on a recours aux tricheries les plus sophistiquées : on établit une parité forcée entre la monnaie locale et le dollar (c’est le truc employé par la Chine ou par les fameux “tigres” et “dragons”), on réévalue la monnaie pour attirer des fonds, on relève les taux d’intérêt, etc.
- D’autre part, “les profits tirés de la production ne trouvent plus de débouchés suffisants dans des investissements rentables susceptibles de développer les capacités de production. La “gestion de la crise” consiste alors à trouver d’autres débouchés à cet excédent de capitaux flottants de manière à éviter leur dévalorisation brutale.” (idem) Ce sont les Etats eux-mêmes et les institutions financières les plus respectables qui impulsent une spéculation effrénée non seulement pour éviter l’explosion de cette gigantesque bulle de capital fictif mais aussi pour alléger la charge des dettes toujours croissantes.
C’est par conséquent ce surendettement et la spéculation exacerbée et irrationnelle qu’il provoque qui mène à cette fameuse “liberté de mouvement” des capitaux, l’utilisation de l’électronique et d’Internet dans les transactions financières, l’indexation des monnaies par rapport au dollar, le libre rapatriement des profits... L’ingénierie financière compliquée des années 1980 (voir les articles précédents) semble être un jouet comparé aux engins sophistiqués et au labyrinthe de la “mondialisation” financière des années 1990. Jusqu’au milieu des années 1980, la spéculation, qui a toujours existé sous le capitalisme, n’était qu’un phénomène temporaire, plus ou moins perturbateur. Mais depuis lors elle s’est convertie en un poison mortel mais indispensable qui accompagne de manière inséparable le processus de surendettement et qui doit être intégré au fonctionnement même du système. Le poids de la spéculation est énorme ; selon les données de la banque mondiale le prétendu “argent chaud” a atteint les 30 milliards de dollars dont 24 milliards pour les pays industrialisés.
-
Bilan provisoire des années 1990
Nous soulignons ici quelques conclusions provisoires (pour la période 1990-96, avant l’explosion de ce qu’il est convenu d’appeler “la crise asiatique”) qui, cependant, nous paraissent assez significatives.
I. Evolution de la situation économique
1. Le taux moyen de croissance de la production continue de baisser.
-
Taux de croissance du PIB (moyenne pour les 24 pays de l’OCDE)
| 1960-70 | 5,6 |
| 1977-80 | 4,1 |
| 1980-90 | 3,4 |
| 1990-95 | 2,4 |
2. L’amputation des secteurs industriels et agricoles directement productifs devient permanente et affecte tous les secteurs, aussi bien les secteurs “traditionnels” que ceux des “technologies de pointe”.
-
Évolution du pourcentage du PIB des secteurs directement productifs (industrie et agriculture)
| Pays | 1975 | 1985 | 1996 |
| Etats-unis | 36,2 | 32,7 | 27,8 |
| Chine | 74,8 | 73,5 | 68,5 |
| Inde | 64,2 | 61,1 | 59,2 |
| Japon | 47,9 | 44,2 | 40,3 |
| Allemagne | 52,2 | 47,6 | 40,8 |
| Brésil | 52,3 | 56,8 | 51,2 |
| Canada | 40,7 | 38,1 | 34,3 |
| France | 40,2 | 34,4 | 28,1 |
| Grande-Bretagne | 43,7 | 43,2 | 33,6 |
| Italie | 48,6 | 40,7 | 33,9 |
| Belgique | 39,9 | 33,6 | 32 |
| Israël | 40,1 | 33,1 | 31,2 |
| Corée du sud | 57,5 | 53,5 | 49,8 |
3. Pour lutter contre la chute inévitable du taux de profit, les entreprises ont recours à toute une série de mesures qui, même si elles ralentissent la chute à court terme, à moyen terme aggravent les problèmes :
- diminution des coûts du travail et augmentation de la composition organique du capital ;
- décapitalisation : externalisation massive d’actifs (installations, propriétés immobilières, investissements financiers, etc.) pour cacher les bénéfices et réduire notablement les impôts à payer à l’Etat ;
- concentration : les fusions d’entreprises ont connu un accroissement spectaculaire.
-
Valeur des fusions en milliards de dollars (source : JP.Morgan)
| Année | Union européenne | Etats-unis |
| 1990 | 260 | 240 |
| 1992 | 214 | 220 |
| 1994 | 234 | 325 |
| 1996 | 330 | 628 |
| 1997 | 558 | 910 |
| 1998 | 670 | 1500 |
Alors que le gigantesque processus de concentration du capital entre 1850 et 1910 reflétait un développement de la production qui fut positif pour l’évolution de l’économie, le processus actuel exprime le contraire. Il s’agit d’une réponse sur la défensive, destinée à compenser la forte contraction de la demande, en organisant la réduction de la capacité de production (en 1998 les pays industrialisés ont réduit de 10% leurs capacités productives) et la diminution des effectifs employés : des estimations prudentes chiffrent à 11% du total les postes de travail ce qui a été éliminé par les fusions réalisées en 1998.
4. Il y a une nouvelle réduction des bases du marché mondial : une grande partie de l’Afrique, un certain nombre de pays d’Asie et d’Amérique, participent de ce même effondrement dans une situation de décomposition du système, de ce qu’il est convenu d’appeler les “trous noirs” : un état de chaos, la réapparition de formes d’esclavage, de l’économie de troc et de pillage, etc.
5. Les pays considérés comme “modèles” plongent dans un ralentissement prolongé. C’est le cas de l’Allemagne, de la Suisse, du Japon et de la Suède où :
- la moyenne de croissance de la production pour la période 1990-97 ne dépasse pas 2% ;
- le chômage croît de manière très significative : dans la période 1990-97 il a pratiquement doublé dans ces quatre pays (par exemple, en Suisse, la moyenne entre 1970 et 1990 était de 1%, en 1997 elle atteint le chiffre de 5,2%) ;
- de pays créditeurs ils deviennent pays débiteurs (les foyers suisses sont les plus endettés du monde après ceux des Etats-Unis et du Japon) ;
- le plus significatif est la situation de l’économie suisse considérée jusqu’à récemment comme le plus saine du monde.
-
Croissance du PIB en Suisse
1992 -0,3 1993 -0,8 1994 +0,5 1995 +0,8 1996 +0,2 1997 +0,7
6. Le niveau d’endettement continue son escalade inéluctable et se transforme en surendettement.
- L’endettement mondial atteint en 1995 le chiffre de 30 mille milliards de dollars (un an et demi de production mondiale).
- L’Allemagne, le Japon et l’ensemble des pays d’Europe occidentale s’intègrent dans le peloton des pays à endettement élevé (dans la décennie antérieure celui-ci avait été beaucoup plus modéré).
-
Les dettes publiques en pourcentage du PIB (Source : Banque Mondiale)
| Pays | 1975 | 1985 | 1996 |
| Etats-unis | 48,9 | 64,2 | |
| japon | 45,6 | 67 | 87,4 |
| Allemagne | 24,8 | 42,5 | 60,7 |
| Canada | 43,7 | 64,1 | 100,5 |
| France | 20,5 | 31 | 56,2 |
| Grande-Bretagne | 62,7 | 53,8 | 54,5 |
| Italie | 57,6 | 82,3 | 123,7 |
| Espagne | 12,7 | 43,7 | 69,6 |
| Belgique | 58,6 | 122,1 | 130 |
- Les pays du tiers-monde souffrent d’une nouvelle overdose de dettes :
-
Dette totale des pays “sous-développés” (Source : Banque Mondiale)
milliards de dollars
| 1990 | 1480 |
| 1994 | 1927 |
| 1996 | 2177 |
7. L’appareil financier souffre des pires convulsions depuis 1929 cessant d’être le lieu sûr qu’il avait été au milieu des années 1980. Sa détérioration va de pair avec un développement gigantesque de la spéculation qui affecte toutes les activités : actions boursières, immobilier, art, agriculture, etc.
8. Des phénomènes qui ont toujours existé dans le capitalisme prennent des proportions alarmantes au cours de cette décennie :
- La corruption des hommes politiques et des responsables de l’économie, qui est le produit de la combinaison de deux facteurs :
- le poids chaque fois plus écrasant de l’Etat sur l’économie (de ses plans d’investissement, ses subventions, ses achats, dont dépendent chaque fois plus les entreprises) ;
- la difficulté croissante à obtenir un profit raisonnable par les voies “légales”.
- La gangstérisation de l’économie, l’interpénétration chaque fois plus forte entre les Etats, les banques, les entreprises, les mafias et les trafiquants (de drogue, d’armes, d’enfants, d’émigrants, etc.). Les commerces les plus troubles sont les plus rentables et les institutions les plus “respectables”, aussi bien gouvernementales que privées, ne peuvent pas laisser passer des affaires aussi juteuses. C’est à la fois le produit en même temps qu’un facteur accélérateur de la décomposition.
9. En lien avec ce qui précède apparaît un phénomène dans les Etats industrialisés, jusque là réservé aux républiques bananières ou aux régimes staliniens : la falsification chaque fois plus débridée des indicateurs statistiques et les trucages comptables de tout type (la fameuse “comptabilité créative”). Ceci constitue une autre démonstration de l’aggravation de la crise car, pour la bourgeoisie, il a toujours été nécessaire de disposer de statistiques fiables (en particulier, dans les pays du capitalisme d’Etat “à l’occidentale” qui ont besoin de la sanction du marché comme verdict final du fonctionnement économique).
Dans le calcul du PIB, la Banque Mondiale, source de beaucoup de statistiques, inclut comme partie de celui-ci le concept de “services non commercialisables” où est rangée la rémunération des militaires, des fonctionnaires ou des enseignants. Un autre moyen de tricher avec les chiffres est de considérer comme “autoconsommation” non seulement les activités agricoles mais toute une série de services. L’“excédent fiscal” tant encensé de l’Etat américain est une fiction qui a été élaborée à partir du jeu pratiqué avec les excédents des fonds de la Sécurité sociale[5] [3873]. Mais c’est dans les statistiques du chômage, du fait de la grande importance politique et sociale de celui-ci, que les tricheries sont les plus scandaleuses aboutissant à une sous-évaluation substantielle des chiffres réels :
- Aux Etats-Unis notre publication Internationalism n°105 met en évidence les tricheries de l’administration Clinton pour aboutir à ses “magnifiques” chiffres du chômage : compter comme actifs les travailleurs à temps partiel, éliminer des statistiques les chômeurs qui rejettent les offres d’emploi bidon, compter divers emplois partiels d’un même travail comme différents postes de travail, etc.
- En Allemagne on ne considère comme chômeurs que ceux qui cherchent un emploi d’au moins 18 heures par semaine, alors qu’en Hollande c’est 12 heures par semaine et au Luxembourg 20 heures[6] [3874].
- L’Autriche et la Grèce ont éliminé les statistiques mensuelles au profit de statistiques trimestrielles qui permettent de masquer les chiffres réels.
- En Italie on ne considère pas comme chômeur ceux qui travaillent entre 20 et 40 heures par semaine ni non plus ceux qui travaillent entre 4 et 6 mois par an. En Grande-Bretagne certains chômeurs que les officines d’Etat considèrent ne pas mériter de toucher les allocations de chômage, sont éliminés des statistiques.
II. Situation de la classe ouvrière
1. Le chômage connaît une accélération très brutale tout au long de la décennie :
-
Millions de chômeurs dans les 24 pays de l’OCDE
| 1989 | 30 |
| 1993 | 35 |
| 1996 | 38 |
% de chômage des pays industrialisés (Source : OIT)
| Pays | 1976 | 1980 | 1985 | 1990 | 1996 |
| USA | 7,4 | 7,1 | 7,1 | 6,4 | 5,4 |
| Japon | 1,8 | 2 | 2,7 | 2,1 | 3,4 |
| Allemagne | 3,8 | 2,9 | 6,9 | 5 | 12,4 |
| France | 4,4 | 6,3 | 10,2 | 9,1 | 12,4 |
| Italie | 6,6 | 7,5 | 9,7 | 10,6 | 12,1 |
| G-B | 5,6 | 6,4 | 11,2 | 7,9 | 8,2 |
L’OIT reconnaît en 1996 que la population mondiale au chômage complet ou sous employée atteint le seuil du milliard de personnes.
2. Le sous-emploi qui est chronique dans les pays du tiers-monde se généralise dans les pays industrialisés :
- les multiples contrats à temps partiel (aussi appelés “contrats poubelles”) atteignent en 1995 20% de la population au travail des 24 pays de l’OCDE ;
- le rapport de l’OIT pour 1996 remarque que “au moins entre 25 et 30% des travailleurs dans le monde comptent sur une journée de travail moindre de ce qu’ils voudraient réaliser ou sur un salaire inférieur à celui dont ils ont besoin pour vivre dignement.”
3. Dans le tiers-monde commencent à se développer massivement des formes d’exploitation telles que le travail des enfants (environ 200 millions selon les statistiques de la Banque mondiale pour 1996) ; le travail sous un régime d’esclavage ou travail forcé ; même dans un pays développé comme la France, des diplomates ont été condamnés pour avoir traité comme esclaves du personnel de maison en provenance de Madagascar ou d’Indonésie !
4. En même temps que la généralisation des licenciements massifs (particulièrement dans les grandes entreprises) les gouvernements adoptent des politiques de “ réduction du coût des licenciements ” :
- réduction des indemnisations au moment du licenciement ;
- baisse des prestations de chômage, comme du nombre de “bénéficiaires” de celles-ci.
5. Les salaires connaissent pour la première fois depuis les années 1930 des baisses nominales :
- l’indice des salaires en Espagne en 1997 est tombé au niveau de 1980 ;
- aux Etats-Unis le salaire moyen nominal a perdu 20% entre 1974 et 1997 ;
- au Japon les salaires ont baissé pour la première fois depuis 1955 (0,9% en 1998).
6. Les prestations sociales connaissent une baisse substantielle qui devient permanente. En contrepartie les impôts, taxes et retenues pour la Sécurité sociale augmentent constamment.
7. Depuis le milieu de la décennie, le capital ouvre d’autres fronts d’attaques : l’élimination des minimum légaux dans les conditions de travail, ce qui aboutit à une série de conséquences :
- accroissement de la journée de travail (à travers en particulier la démagogie des 35 heures qui suppose l’“annualisation des heures travaillées”) ;
- l’élimination de la limite de l’âge de la retraite ;
- l’élimination des limites d’âge pour commencer à travailler (dans l’Union européenne travaillent déjà 2 millions d’enfants) ;
- réduction de la protection contre les accidents du travail, les maladies professionnelles, etc.
8. Un autre aspect, et qui n’est pas négligeable, c’est que les travailleurs se voient poussés par les banques, les compagnies d’assurance, etc., à placer leurs petites économies (ou les aides de la famille ou des parents) dans la roulette russe de la Bourse, devenant les premières victimes de ses convulsions. Mais le pire du problème est que, avec l’élimination ou la réduction des prestations dérisoires de retraite de la sécurité sociale, les travailleurs se trouvent forcés de faire dépendre leur retraite des Fonds de pension qui investissent le gros de leurs capitaux dans la Bourse, ce qui provoque de graves incertitudes : ainsi, le principal Fond des travailleurs de l’enseignement aux Etats-Unis a perdu 11% en 1997 (Internationalism n°105).
La propagande bourgeoise a insisté jusqu’à la nausée sur la diminution des inégalités, sur un processus de “démocratisation” de la richesse et de la consommation. L’aggravation, tout au
long des 30 dernières années, de la crise historique du capitalisme a démenti systématiquement ces proclamations et confirmé l’analyse marxiste de la tendance aggravée avec l’évolution de la crise à la paupérisation toujours plus grande de la classe ouvrière et de toute la population exploitée. Le capitalisme concentre à un pôle toujours plus petit des richesses énormes et provocantes, tandis qu’à l’autre pôle se développe une misère terrible et meurtrière. Ainsi en 1998, le rapport
annuel de l’ONU a récolté des données significatives : alors qu’en 1996 les 358 individus les plus riches du monde concentraient entre leurs mains autant d’argent que 2,5 milliards de personnes les plus pauvres, en 1997, pour parvenir à la même équivalence, il suffisait de prendre les 225 plus riches.
Adalen.
[1] [3875] Pour une analyser en détail de la nouvelle étape d e la crise ouverte en août 1997 avec la dite “crise asiatique”, voir la Revue internationale n°92 et les suivantes.
[2] [3876] Ce n’est pas l’objet de cet article d’analyser les conséquences de la crise sur la lutte de classe, sur les tensions impérialistes et sur la vie même des pays soumis au régime stalinien. Pour cela nous renvoyons à tout ce que nous avons publié dans la Revue internationale n°60, 61, 62, 63 et 64.
[3] [3877] Alors que la production des Etats-Unis représente 26,7% de la production mondiale, le dollar totalise 47,5% des dépôts bancaires, 64,1% des réserves mondiales et 47,6% des transactions (Données de la Banque Mondiale).
[4] [3878] Voir dans la Revue internationale n°86 “Derrière la ‘mondialisation’ de l’économie, l’aggravation de la crise du capitalisme”.
[5] [3879] Selon l’analyse réalisée par le New York Times du 9 novembre 1998.
[6] [3880] Ces données et les suivantes ont été tirées du Journal Officiel des Communautés Européennes (1997).
Récent et en cours:
- Crise économique [28]
Questions théoriques:
- L'économie [86]
Révolution allemande (XII) : 1923 - 1 -.
- 4179 reads
La bourgeoisie veut infliger une défaite décisive à la classe ouvrière
Dans les précédents articles de la Revue internationale nous avons vu comment le prolétariat en Russie reste isolé après que le plus haut point de la vague révolutionnaire soit atteint en 1919. Alors que l'Internationale communiste (IC) essaye de réagir contre le reflux de la vague de luttes par un tournant opportuniste, s'engageant ainsi dans un processus de dégénérescence, l'Etat russe devient de plus en plus autonome par rapport au mouvement de la classe et essaye de prendre l'IC sous sa coupe.
A la même époque la bourgeoisie réalise que, après avoir terminé la guerre civile en Russie, les ouvriers en Russie ne représentent plus le même danger et que la vague révolutionnaire a commencé à refluer. Elle prend consciense que l’IC ne combat plus avec la même énergie la social-démocratie et même qu'au lieu de cela elle essaye de s'allier avec cette dernière en développant la politique de front unique. L'instinct de classe de la bourgeoisie lui fait sentir que l’Etat russe n'est plus une force au service de la révolution essayant de s’étendre mais qu'il est devenu une force qui cherche à asseoir sa propre position en tant qu'Etat, comme la conférence de Rapallo le montre clairement. La bourgeoisie sent qu'elle peut exploiter à son profit le tournant opportuniste et la dégénérescence de l’IC ainsi que le rapport des forces au sein de l’Etat russe. La bourgeoisie internationale sent qu'elle peut se lancer dans une offensive internationale contre la classe ouvrière, offensive dont le centre se situe en Allemagne.
Mise à part la Russie en 1917, c'est en Allemagne et en Italie que le prolétariat a développé les luttes les plus radicales. Même après la défaite des ouvriers dans leur combat contre le putsch de Kapp au printemps 1920 et après la défaite de mars 1921, la classe ouvrière en Allemagne est encore très combative, mais internationalement elle est aussi relativement isolée. Alors que les ouvriers en Autriche, Hongrie et Italie, sont déjà défaits et continuent de subir de violentes attaques, et que le prolétariat d'Allemagne, de Pologne et de Bulgarie est poussé dans des réactions désespérées, la situation en France et en Grande-Bretagne, en comparaison, reste stable. Pour infliger une défaite décisive à la classe ouvrière en Allemagne, et affaiblir ainsi la classe ouvrière internationale, la bourgeoisie peut compter sur le soutien international de l'ensemble de la classe capitaliste qui, dans le même temps, a été capable de renforcer considérablement ses rangs avec l'intégration de la social-démocratie et des syndicats dans l'appareil d'Etat.
En 1923, la bourgeoisie essaye d'attirer la classe ouvrière en Allemagne dans un piège nationaliste, dans l'espoir de la détourner de ses luttes contre le capitalisme.
La politique désastreuse du KPD : la défense de la démocratie et du front unique
Nous avons vu précédemment comment l'expulsion des “radicaux de gauche” (Linksradikalen), qui devaient plus tard fonder le KAPD, a affaibli le KPD et facilité le développement de l'opportunisme dans ses rangs.
Alors que le KAPD fait des mises en garde contre les dangers de l'opportunisme, contre la dégénérescence de l’IC et le développement du capitalisme d’Etat, le KPD, lui, réagit de façon opportuniste. Dans une “lettre ouverte aux partis ouvriers”, en 1921, il est le premier parti à appeler pour un front unique.
“La lutte pour un front unique mène à la conquête des vieilles organisations de classe prolétarienne (syndicats, coopératives, etc.). Elle transforme ces organes de la classe ouvrière qui, à cause des tactiques des réformistes, sont devenus des instruments de la bourgeoisie, à nouveau en organes de la lutte de classe du prolétariat.” En même temps, les syndicats confessent fièrement: “Mais il reste un fait, que les syndicats sont la seule digue solide qui a protégé l'Allemagne de l'inondation bolchevik jusqu’à maintenant.” (Feuille de correspondance des syndicats, juin 1921)
Le congrès de fondation du KPD n'était pas dans l’erreur quand, par la voix de Rosa Luxemburg, il déclarait : “Les syndicats officiels ont prouvé pendant la guerre et dans la guerre jusqu'à aujourd'hui qu'ils sont une organisation de l'Etat bourgeois et de la domination de la classe capitaliste.” Et maintenant ce parti est pour la retransformation de ces organes passés à la classe ennemie!
En même temps, sa direction, sous l'autorité de Brandler, est pour un front unique au sommet avec la direction du SPD. Au sein du KPD, cette orientation est combattue par une aile autour de Fischer et Maslow qui met en avant le mot d'ordre de “gouvernement ouvrier”. Elle déclare que “le soutien de la minorité sociale-démocrate au gouvernement (ne signifie pas) une décomposition accrue du SPD”; non seulement une telle position entretient des “illusions dans les masses, comme si un cabinet social-démocrate pouvait être une arme de la classe ouvrière”, mais elle va dans le sens “d'éliminer le KPD, puisque le SPD peut mener une lutte révolutionnaire.”
Mais ce sont surtout les courants de la gauche communiste, qui viennent juste de surgir en Italie et en Allemagne, qui prennent position contre cela.
“ Pour ce qui est du gouvernement ouvrier, nous demandons : pourquoi veut-on s'allier avec les social-démocrates ? Pour faire les seules choses qu'ils savent, peuvent et veulent faire ou bien pour leur demander de faire ce qu'ils ne savent, ne peuvent, ni ne veulent faire ? Veut-on que nous disions aux sociaux-démocrates que nous sommes prêts à collaborer avec eux, même au Parlement et même dans ce gouvernement qu'on a baptisé 'ouvrier' ? Dans ce cas, c'est-à-dire si l'on nous demande d'élaborer au nom du parti communiste un projet de gouvernement ouvrier auquel devraient participer des communistes et des socialistes, et de présenter ce gouvernement aux masses comme “le gouvernement anti-bourgeois”, nous répondrons, en prenant l'entière responsabilité de notre réponse, qu'une telle attitude s'oppose à tous les principes fondamentaux du communisme.” (Il Comunista, n°26, mars 1922)
Au 4e congrès, “le PCI n'acceptera donc pas de faire partie d'organismes communs à différentes organisations politiques... (il) évitera aussi de participer à des déclarations communes avec des partis politiques, lorsque ces déclarations contredisent son programme et sont présentées au prolétariat comme le résultat de négociations visant à trouver une ligne d'action commune.
Parler de gouvernement ouvrier... revient à nier en pratique le programme politique du communisme, c'est-à-dire la nécessité de préparer les masses par la lutte pour la dictature du prolétariat.” (Rapport du PCI au 4e congrès de l’IC, novembre 1922)
Sans tenir compte de ces critiques des communistes de gauche, le KPD a déjà proposé de former une coalition gouvernementale avec le SPD en Saxe en novembre 1922, proposition rejetée par l’IC.
Le même KPD qui, à son congrès de fondation au début de 1919, disait encore “Spartakusbund refuse de travailler ensemble avec les laquais de la bourgeoisie, de partager le pouvoir gouvernemental avec Ebert-Scheidemann, parce qu'une telle coopération serait une trahison des principes du socialisme, un renforcement de la contre-révolution et une paralysie de la révolution”, défend maintenant le contraire.
A la même époque le KPD est leurré par le nombre de voix qu'il obtient, croyant que ces votes expriment un réel rapport de forces favorable ou même qu'ils reflètent l'influence du parti.
Alors que les premieres organisations fascistes sont mises en place par des membres de la classe moyenne et de la petite bourgeoisie, beaucoup de groupes armés de droite commencent à organiser des entraînements militaires. L’Etat est parfaitement informé sur ces groupes. La majorité d'entre eux est directement issu des corps francs que le gouvernement dirigé par le SPD avait mis en place, contre les ouvriers, pendant les luttes révolutionnaires de 1918-1919. Déjà, le 31 août 1921, Die Rote Fahne déclare: “La classe ouvrière a le droit et le devoir de protéger la république contre la réaction.” Un an plus tard, en novembre 1921, le KPD signe un accord avec les syndicats et le SPD (accord de Berlin), avec pour objectif la “démocratisation de la république” (protection de la république, élimination des réactionnaires de l'administration, de la justice et de l'armée). De cette façon le KPD accroît les illusions parmi les ouvriers sur la démocratie bourgeoise et se positionne en complet desaccord avec la gauche italienne réunie autour de Bordiga qui, au 4e congrès mondial de l’IC, insiste dans son analyse du fascisme sur le fait que la démocratie bourgeoise n'est qu'une facette de la dictature de la bourgeoisie.
Dans un article précédent nous avons déjà montré que l’IC, par son représentant Radek, critique la politique du KPD en utilisant des méthodes peu organisationnelles et qu'elle commence à affaiblir la direction en mettant en place un fonctionnement parallèle. En même temps des influences petites bourgeoises commencent à pénétrer le parti. Au lieu que la critique, lorsqu'elle est nécessaire, s'exprime de manière fraternelle, il se développe une atmosphère de suspicion et de récriminations, ce qui va amener à un affaiblissement de l'organisation[1] [3881]
La classe dominante se rend compte que le KPD commence à répandre la confusion dans la classe au lieu de remplir le rôle d'une véritable avant-garde basé sur la clarté et la détermination. Elle sent qu'elle peut exploiter cette attitude opportuniste du KPD contre la classe ouvrière.
Avec le reflux de la vague révolutionnaire, l’intensification des conflits impérialistes
Le changement du rapport de force entre la bourgeoisie et le prolétariat, suite au reflux de la vague révolutionnaire après 1920, devient aussi perceptible dans les relations impérialistes entre les Etats. Dès que la menace immédiate provenant de la classe ouvrière s'éloigne et que s’éteint la flamme révolutionnaire de la classe ouvrière en Russie, les tensions impérialistes reprennent le dessus.
L’Allemagne essaye par tous les moyens de renverser l'affaiblissement de sa position résultant de la fin de la première guerre mondiale et de la signature du traité de Versailles. Vis-à-vis des “pays victorieux” à l'ouest, sa tactique consiste à essayer de monter la France et la Grande-Bretagne l’un contre l’autre, puisqu'aucune confrontation militaire ouverte n'est plus possible avec l’un et l'autre. En même temps l'Allemagne essaye de reprendre ses relations traditionnellement étroites avec son voisin de l’est. Dans nos précédents articles nous avons déjà décrit comment, de façon déterminée, dans le contexte des tensions impérialistes à l'ouest, la bourgeoisie allemande a procédé pour fournir des armes au nouvel Etat russe et a signé des accords secrets de livraison d’armes et de coopération militaire. Ainsi un des grands dirigeants militaires allemands, Seeckt, reconnait : “La relation entre l'Allemagne et la Russie est le premier et jusqu'à présent presque le seul renforcement que nous ayons réalisé depuis la conclusion de la paix. Que la base de cette relation soit dans le domaine économique est dans la nature de l'ensemble de la situation ; mais la force réside dans le fait que ce rapprochement économique prépare la possibilité d’un lien politique et donc également militaire.” (Carr, Ibidem)
En même temps l’Etat russe, avec le soutien de l'IC, déclare par la voix de Boukharine : “J'affirme que nous sommes déjà largement prêts de conclure une alliance avec une bourgeoisie étrangère pour, au moyen de cet Etat bourgeois, être capables de renverser une autre bourgeoisie... Dans le cas où une alliance militaire a été conclue avec un Etat bourgeois, le devoir des camarades dans chaque pays consiste à contribuer à la victoire des deux alliés.” (Carr, Ibidem) “Nous disons à ces Messieurs de la bourgeoisie allemande ... si vous voulez réellement lutter contre l'occupation, si vous voulez lutter contre les insultes de l'Entente, il ne vous reste rien d'autre que de chercher un rapprochement avec le premier pays prolétarien, ...” (Zinoviev, 12e congrès du parti, avril 1923)
La propagande nationaliste parle d'humiliation et de soumission de l'Allemagne par le capital étranger, en particulier par la France. Les dirigeants militaires allemands tout comme les représentants importants de la bourgeoisie allemande ne cessent de faire des déclarations publiques disant que le seul salut possible pour la nation allemande pour se libérer du joug du traité de Versailles est de faire une alliance militaire avec la Russie soviétique et d'engager une “guerre du peuple révolutionnaire” contre l'impérialisme français.
Dans la nouvelle couche de bureaucrates, capitalistes d'Etat, qui se développe au sein de l'Etat russe, cette politique est accueillie avec un grand intérêt.
Au sein de l'IC et du PC russe, les internationalistes prolétariens qui restent fidèles à l'objectif de l'extension de la révolution mondiale sont eux-mêmes, à ce moment-là, aveuglés par ces discours séduisants. Bien qu'il ne soit pas pensable pour le capital allemand d'établir une alliance véritable avec la Russie contre ses rivaux impérialistes de l'Ouest, les dirigeants de l'Etat russe et la direction de l’IC se laissent abuser et tombent dans le piège. Ils contribuent activement, ainsi, à pousser la classe ouvrière dans ce même piège.
Avec la complicité de toute la classe capitaliste, la bourgeoisie allemande est en train d'ourdir un complot contre la classe ouvrière en Allemagne. D'un côté elle cherche à échapper à la pression du traité de Versailles en retardant le paiement des réparations à la France et en menaçant d'y mettre fin, de l'autre côté elle pousse la classe ouvrière en Allemagne dans le piège nationaliste. Cependant, la "coopération" de l'Etat russe et de l’IC lui est indispensable pour cela.
La bourgeoisie allemande prend la décision consciente de provoquer le capital français en refusant de payer les réparations de guerre. Celui-ci réagit en occupant militairement la région de la Ruhr le 11 janvier 1923.
Le capital allemand complète sa tactique par la décision délibérée de laisser courir la tendance inflationniste qui existe du fait de la crise. Il utilise l'inflation comme une arme pour diminuer le coût des réparations et pour alléger le poids des crédits de guerre. En même temps elle cherche à moderniser ses usines de production.
La bourgeoisie sait aussi que le développement de l'inflation va pousser la classe ouvrière à la lutte. Et elle espère détourner ces luttes défensives attendues sur le terrain nationaliste. L'occupation de la Ruhr par l'armée française est ce qui sert à appater la classe ouvrière et c'est le prix que la bourgeoisie allemande est prête à payer pour cela. La question clé va être la capacité de la classe ouvrière et de ses révolutionnaires à déjouer ce piège de la défense du capital national. Sinon la bourgeoisie allemande infligera une défaite décisive à la classe ouvrière. La classe dominante est ainsi prête à défier une nouvelle fois le prolétariat parce qu'elle sent que le rapport de forces au niveau international lui est favorable, que des parties de l'appareil d'Etat russe peuvent être séduites par cette politique et même que l’IC peut être entraînée dans le piège.
La provocation de l'occupation de la Ruhr : quelles tâches pour la classe ouvrière?
En occupant la Ruhr, la bourgoisie française espère devenir le plus gros producteur d'Europe d’acier et de charbon. La Ruhr fournit en effet 72% de la production de charbon, 50% de la production d'acier, 25% de la production industrielle totale de l'Allemagne. Il est clair que dès que l'Allemagne va être privée de ses ressources, la chute brutale de la production entrainera une pénurie de marchandises et de profondes convulsions économiques. La bourgeoisie allemande est prête à faire un tel sacrifice parce que les enjeux, pour elle, sont élevés. Le capital allemand fait le pari de pousser les ouvriers à des grèves pour les amener sur le terrain nationaliste. Les patrons et le gouvernement décident le lock out et tout ouvrier qui veut travailler sous la domination des forces françaises d'occupation est menacé de licenciement. Le président SPD Ebert annonce, le 4 mars, de lourdes amendes pour les ouvriers qui continueraient à travailler dans les mines ou dans les chemins de fer. Le 24 janvier l’association des patrons et l’ADGB (fédération des syndicats allemands) lancent un appel afin de “lever des fonds” pour combattre la France. La conséquence est que de plus en plus d'entreprises jettent leur personnel à la rue. Tout ceci sur fond d'inflation galopante : alors que le dollar vaut encore 1000 marks en avril 1922, en novembre 1922 il est déjà à 6000 marks; après l'occupation de la Ruhr il atteint 20.000 marks en février 1923. En juin 1923 il atteint 100.000 marks, fin juillet il monte à 1 million, fin août il est à 10 millions, mi-septembre 100 millions, fin novembre il atteint son point culminant à 4.200.000.000.000 marks.
Cela ne pénalise pas trop les patrons de la Rhur dans la mesure où ils pratiquent le paiement en or ou le troc. Par contre pour la classe ouvrière cela signifie la famine. Très souvent les chômeurs et ceux qui ont encore un travail manifestent ensemble pour faire valoir leurs revendications. Il y a de façon répétée des confrontations avec les forces françaises d’occupation.
L’IC pousse les ouvriers
dans le piège du nationalisme
En tombant dans le piège des capitalistes allemands qui appellent à une lutte commune entre la “nation allemande opprimée” et la Russie, l’IC commence a répandre l’idée que l’Allemagne a besoin d’un gouvernement fort qui doit pouvoir affronter les forces françaises d’occupation sans que les luttes de la classe ouvrière ne viennent le poignarder dans le dos. L’IC sacrifie ainsi l’internationalisme prolétarien au profit des intérêts de l’Etat russe[2] [3882].
Cette politique est inaugurée sous la bannière du “national-bolchevisme”. Alors qu’à l’automne 1920 l’IC a agi avec un grande détermination contre les “tendances national-bolcheviks” et, dans ses discussions avec les délégués du KAPD, insisté pour que les nationaux-bolcheviks de Laufenberg et Wolfheim soient exclus du parti, elle en est maintenant à préconiser cette même ligne politique.
Ce tournant de l’IC ne peut pas simplement s’expliquer par les confusions et l’opportunisme de son Comité exécutif. Mais nous devons y voir la “main invisible” de ces forces qui ne sont pas intéressées par la révolution mais par le renforcement de l’Etat russe. Le national-bolchevisme ne peut prendre qu’à partir du moment où l’IC a déjà commencé à dégénérer, qu'elle se trouve déjà prise dans les griffes de l’Etat russe et même absorbée par celui-ci. Radek argumente ainsi : “L’Union soviétique est en danger. Toutes les tâches doivent être soumises à la défense de l’Union soviétique, parce qu’avec cette analyse un mouvement révolutionnaire en Allemagne serait dangereux et saperait les intérêts de l’Union soviétique...
Le mouvement communiste allemand n’est pas capable de renverser le capitalisme allemand, il doit servir comme un pilier de la politique étrangère russe. Les pays d’Europe organisés sous la direction du Parti bolchevik, qui utilise les capacités militaires de l’armée allemande contre l’Ouest, telle est la perspective, telle est la seule issue...”
En janvier 1923, Die Rote Fahne écrit : “La nation allemande est poussée dans l’abîme si elle n’est pas sauvée par le prolétariat allemand. La nation est vendue et détruite par les capitalistes allemands si la classe ouvrière ne les empêche pas de le faire. Ou la nation allemande meurt de faim et se disloque à cause de la dictature des baïonnettes françaises, ou elle sera sauvée par la dictature du prolétariat.” “Cependant, aujourd’hui le national-bolchevisme signifie que tout est imprégné du sentiment que nous ne pouvons être sauvés que par les communistes. Aujourd’hui, nous sommes la seule issue. La forte insistance sur la nation en Allemagne est un acte révolutionnaire, de même que l’insistance sur la nation dans les colonies.” (Die Rote Fahne, 1er avril 1923). Rakosi, un délégué de l’IC, fait l’éloge de cette orientation du KPD : “...un parti communiste doit s’attaquer à la question nationale. Le parti allemand a traité cette question de façon très habile et adéquate. Il est dans le processus d’arracher l’arme nationaliste hors des mains des fascistes.” (Schüddelkopf, p.177)
Dans un manifeste à la Russie soviétique, le KPD écrit : “La conférence du parti exprime sa gratitude à la Russie soviétique pour la grande leçon, qui a été écrite dans l’histoire avec les flots de sang et les sacrifices incroyables, que la préoccupation de la nation reste encore la préoccupation du prolétariat.”
Talheimer déclare même le 18 avril : “Cela reste la tâche privilégiée de la révolution prolétarienne, non seulement de libérer l’Allemagne, mais d’accomplir l’oeuvre de Bismarck d’intégrer l’Autriche dans le Reich. Le prolétariat doit accomplir cette tâche dans une alliance avec la petite-bourgeoisie.” (Die Internationale, V 8, 18 avril 1923, p.242-247)
Quelle perversion de la position communiste fondamentale sur la nation ! Quel rejet de la position internationaliste développée par les révolutionnaires pendant la 1re guerre mondiale, qui avaient à leur tête Lénine et Rosa Luxemburg et qui ont combattu pour la destruction de toutes les nations !
Après la guerre, les forces séparatistes de Rhénanie et de Bavière sentent leurs chances augmenter et espèrent, avec le soutien de la France, qu’ils pourront séparer la Rhénanie de la Ruhr. C'est avec fierté que la presse du KPD rapporte comment le parti a aidé le gouvernement Cuno dans son combat contre les séparatistes : “De petits détachements armés furent mobilisés dans la Ruhr pour marcher sur Düsseldorf. Ils avaient la tâche d’empêcher la proclamation de la ‘République de Rhénanie’. Quand à 14 heures les séparatistes se rassemblèrent sur les berges du Rhin et s'apprêtaient à commencer leur meeting, quelques groupes de combat, armés de grenades, les ont attaqués. Il a suffi seulement de quelques grenades et toute cette bande fut prise de panique, pris la fuite et abandonna les rives du Rhin. Nous les avions empêchés de se rassembler et de proclamer une ‘République de Rhénanie’.” (W.Ulbricht, Mémoires, p.132, Vol.1)
“Nous ne dévoilons pas un secret si nous disons ouvertement que les détachements de combat communistes, qui dispersèrent les séparatistes dans le Palatinat, dans l’Eifel et à Düsseldorf avec des fusils et des grenades, étaient sous commandement d'officiers prussiens à mentalité nationaliste.” (Vorwärts)
Cette orientation nationaliste n'est pas l'oeuvre du seul KPD; elle est aussi le produit de la politique de l'Etat russe et de certaines parties du l’IC.
Après s'être coordonnée avec le Comité exécutif de l’IC, la direction du KPD pousse à ce que le combat soit dirigé, en premièr lieu, contre la France et seulement après contre la bourgeoisie allemande. Voila pourquoi la direction du KPD proclame : “La défaite de l'impérialisme français dans la guerre mondiale n'était pas un objectif communiste, la défaite de l'impérialisme français dans la Ruhr, par contre, est un objectif communiste.”
Le KPD et l'espoir d'une “alliance nationaliste”
La direction du KPD s’élève contre les grèves. Déjà à la conférence du parti de Leipzig, fin janvier, peu de temps après l'occupation de la Ruhr, la direction, avec le soutien de l’IC, bloque le débat sur cette orientation "nationale-bolchévik" de peur que cela ne mène à son rejet dans la mesure où la majorité du parti s'y oppose.
En mars 1923, lorsque les sections du KPD dans la Ruhr tiennent une conférence régionale, la direction du parti se prononce contre les orientations qu'elles dégagent. La Centrale proclame : “Seul un gouvernement fort peut sauver l'Allemagne, un gouvernement qui est porté par les forces vives de la nation.” (Die Rote Fahne, 1er avril 1923)
Dans la Ruhr la majorité de la conférence du KPD met en avant l'orientation suivante :
- débrayages dans toutes les zones occupées par les forces militaires,
- occupation des usines par les ouvriers en utilisant le conflit franco allemand et si possible prise du pouvoir local.
Au sein du KPD, deux orientations antagoniques s’opposent. L'une est prolétarienne, internationaliste et prend parti pour une confrontation avec le gouvernement Cuno, pour une radicalisation du mouvement dans la Ruhr[3] [3883].
Ceci contredit la position de la Centrale du KPD qui, avec l'aide de l’IC, s’oppose énergiquement aux grèves et essaye d’entraîner la classe ouvrière sur le terrain nationaliste.
Le capital peut même être si sûr de la politique de sabotage des luttes ouvrières, que le secrétaire d'Etat, Malzahn, après une discussion avec Radek le 26 mai rapporte dans un mémorandum strictement secret à Ebert et aux ministres les plus importants : “Il (Radek) a pu m’assurer que les sympathies russes découlaient de leurs propres intérêts à se mettre aux côtés du gouvernement allemand (...) Il a défendu énergiquement et a demandé expressément aux dirigeants du parti communiste au cours de la semaine dernière de montrer la stupidité et l'approche erronée de leur attitude précédente vis-à-vis du gouvernement allemand. Nous pouvons être certains de voir que, dans quelques jours, les tentatives de coup d’Etat des communistes dans la Ruhr vont reculer.” (Archives du Foreign Office, Bonn, Deutschland 637.442ff, in Dupeux, p.181)
Après la proposition de front unique avec le SPD contre révolutionnaire et avec les partis de la 2e Internationale, c'est maintenant la politique du silence vis-à-vis du gouvernement capitaliste allemand.
Dans une prise de position de Die Rote Fahne du 27 mai 1923, on peut voir à quel point la direction du KPD est décidée sur le fait qu'il ne faut pas “poignarder dans le dos” le gouvernement : “Le gouvernement sait que le KPD est resté silencieux sur beaucoup de questions à cause du danger provenant du capitalisme français; autrement cela aurait fait perdre la face au gouvernement dans toute négociation internationale. Aussi longtemps que les ouvriers social-démocrates ne luttent pas ensemble avec nous pour un gouvernement ouvrier, le parti communiste n'a pas intérêt à remplacer ce gouvernement sans tête par un autre gouvernement bourgeois... Ou le gouvernement abandonne ses appels au meurtre contre le PC ou nous rompons le silence.” (Rote Fahne, 27 mai 1923, Dupeux, p.1818)
Les appels nationalistes visant à séduire la petite bourgeoisie patriote
Dans la mesure où l'inflation touche aussi la petite bourgeoisie et les classes moyennes, le KPD pense qu'il peut proposer une alliance à ces couches. Au lieu d'insister sur la lutte autonome de la classe ouvrière qui est seule capable d'attirer les autres couches non exploiteuses dans son sillage, dans la mesure où elle développe sa force et son impact, il envoie un message de flatterie et de séduction à ces couches leur disant qu'elles peuvent faire alliance avec la classe ouvrière. “Nous devons nous adresser nous-mêmes aux masses souffrantes, confuses et outragées de la petite bourgeoisie prolétarienne et leur dire qu’elles ne peuvent se défendre elles-mêmes et défendre le futur de l’Allemagne que si elles s’unissent avec le prolétariat dans leur combat contre la bourgeoisie.” (Carr, L’inter-règne, p.176)
“C’est la tâche du KPD d’ouvrir les yeux de l’importante petite bourgeoisie et des masses intellectuelles nationalistes sur le fait que seule la classe ouvrière –une fois victorieuse– sera capable de défendre le sol allemand, les trésors de la culture allemande et le futur de la nation allemande.” (Die Rote Fahne, 13 mai 1923)
Cette politique de l’unité sur une base nationaliste n’est pas le seul fait du KPD, mais elle est aussi soutenue par l’IC. Le discours que K.Radek prononce au Comité exécutif de l’IC le 20 juin 1923 en est un témoignage. Dans ce discours il fait l’éloge d'un membre de l’aile droite séparatiste, Schlageter, qui a été arrêté et tué par l’armée française le 26 mai pendant le sabotage des ponts de chemin de fer près de Düsseldorf. C'est le même Radek qui, dans les rangs de l’IC en 1919 et 1920, a demandé instamment au KPD et au KAPD d’expulser les national-bolcheviks de Hambourg.
“Cependant, nous croyons que la grande majorité des masses qui sont agitées de sentiments nationalistes appartient non au camp du capital mais au camp du travail. Nous voulons chercher et trouver la route pour atteindre ces masses, et nous y arriverons. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour que des hommes qui étaient prêts, comme Schlageter, à donner leur vie pour une cause commune, ne deviennent pas des pélerins du néant, mais les pélerins d'un avenir meilleur pour l’humanité toute entière, ...” (Radek, 20 juin 1923, dans Broué, p.693) “Il est évident que la classe ouvrière allemande ne conquerra jamais le pouvoir si elle n’est pas capable d’inspirer confiance aux larges masses du peuple allemand, qu'il s'agit là du combat mené par ses meilleures forces pour se débarrasser du joug du capital étranger." (Dupeux, p.190)
Cette idée, que “le prolétariat peut agir comme une avant-garde et la petite bourgeoisie nationaliste comme un arrière-garde”, en bref que tout le peuple peut être pour la révolution, que les nationalistes peuvent suivre la classe ouvrière, sera défendue sans la moindre réserve par le 5e congrès de l’IC en 1924. Même si l’opposition se prononce contre la politique du “silence” qui est pratiquée par la direction du KPD depuis septembre 1923, cela ne l'empêche pas d’amener la classe ouvrière dans des impasses et sur un terrain nationaliste. Ainsi R.Fisher propage des mots d’ordre antisémites : “Qui parle contre le capital juif... est déjà un combattant de la classe, même s’il ne le sait pas... Combattre contre les capitalistes juifs, les pendre aux réverbères, les écraser... L’impérialisme français est maintenant le plus grand danger dans le monde, la France est le pays de la réaction... Seule l’établissement d’une alliance avec la Russie... peut faire que le peuple allemand chasse le capitalisme français de la Ruhr.” (Flechtheim, p.178)
La classe ouvrière se défend sur son terrain de classe
Alors que la bourgeoisie vise à attirer la classe ouvrière en Allemagne sur un terrain nationaliste et à l’empêcher de défendre ses intérêts de classe, alors que le Comité exécutif de l’IC et la direction du KPD poussent la classe ouvrière sur ce terrain nationaliste, la majorité des ouvriers dans la Ruhr et dans les autres villes ne se laissent pas entraîner sur ce terrain. Seules quelques usines ne sont pas touchées par les grèves.
De petites vagues de grèves et de protestations se multiplient. Ainsi le 9 mars en Haute Silésie, 40 000 mineurs débrayent, le 17 mars à Dortmund, les mineurs arrêtent le travail. De plus, les chômeurs manifestent avec les actifs, comme le 2 avril à Mulheim dans la Ruhr.
Alors que des parties de la direction du KPD sont séduites et trompées par les flatteries nationalistes, il devient clair pour la bourgeoisie allemande, dès que les grèves surgissent dans la Ruhr, qu’il lui faut l’aide des autres Etats capitalistes contre la classe ouvrière. A Mulheim les travailleurs occupent plusieurs usines. Presque toute la ville est touchée par la vague de grèves, l’Hôtel de ville est occupé. Les troupes allemandes de la Reichswehr ne peuvent pas intervenir à cause de l’occupation de la Ruhr par les forces françaises ; on appelle alors la police, mais leurs effectifs sont insuffisants pour exercer la répression contre les ouvriers. Le maire de Düsseldorf demande par courrier le soutien du Général en Chef des forces d’occupation françaises : “Je dois vous rappeler que le commandement suprême allemand aida les troupes françaises à l’époque de la Commune de Paris, à tout moment, pour écraser ensemble le soulèvement. Je vous demande de nous offrir le même soutien, si vous voulez éviter qu’une situation similaire ne se produise.” (Dr Lutherbeck, lettre au général De Goutte, dans Broué, p.674)
En plusieurs occasions la Reichswehr est envoyée pour écraser des luttes ouvrières dans différentes villes, comme Gelsenkirchen et Bochum. En même temps que la bourgeoisie allemande affiche son animosité dans les relations avec la France, elle n’hésite jamais à envoyer l'armée contre les travailleurs qui résistent au nationalisme.
L’accélération rapide de la crise économique, surtout de l’inflation, impulse la combativité ouvrière. Les salaires perdent de leur valeur heure par heure. En comparaison avec la période d’avant-guerre, le pouvoir d’achat est divisé par quatre. De plus en plus d’ouvriers perdent leur travail. Au cours de l’été 60% de la force de travail se retrouve sans emploi. Même les fonctionnaires reçoivent des salaires ridicules. Les entreprises veulent imprimer leur propre “monnaie”, les autorités locales introduisent une “monnaie de secours” pour le paiement des fonctionnaires. Puisque la vente de leur récolte ne rapporte plus aucun profit, les fermiers gardent leurs produits et les stockent. L’approvisionnement en nourriture est presque au point mort. Les travailleurs et les chômeurs manifestent ensemble de plus en plus souvent. De partout on rapporte des révoltes de la faim et des pillages de magasins. Fréquemment la police ne peut qu’assister passivement aux révoltes de la faim.
Fin mai, près de 400.000 ouvriers partent en grève dans la Ruhr, en juin 100 000 mineurs et métallurgistes en Silésie, tout comme 150.000 ouvriers à Berlin. En juillet, un autre vague de grèves surgit qui mène à une série de confrontations violentes.
Ces luttes comportent toujours une de ces caractéristiques qui seront typiques de toutes les luttes ouvrières dans la période de décadence du capitalisme : un nombre important d’ouvriers quittent les syndicats. Dans les usines les ouvriers s'organisent en assemblées générales, de plus en plus de rassemblements se font dans la rue. Les ouvriers passent plus de temps dans la rue, dans des discussions et des manifestations, qu’au travail. Les syndicats s’opposent autant qu’ils peuvent au mouvement. Les travailleurs essayent spontanément de s’unir dans des assemblées générales et des comités d’usines à la base. La tendance est à l’unification. Le mouvement gagne en puissance. Sa force ne réside pas dans un regroupement autour des mots d’ordre nationalistes, mais dans la recherche d’une orientation de classe.
Où sont les forces révolutionnaires ? Le KAPD, affaibli par le fiasco de la scission entre les tendances d’Essen et de Berlin, à nouveau réduit en nombre et organisationnellement affaibli depuis la fondation de la KAI (Internationale communiste ouvrière), n’est pas capable d’avoir une intervention organisée dans cette situation même s'il exprime assez bruyamment son rejet du piège national-bolchevik.
Le KPD, qui a attiré de plus en plus d’éléments (les 4/5e), s’est cependant lui même passé la corde du pendu autour du cou. Le KPD est incapable d’offrir un orientation claire pour la classe. Que propose le KPD ?[4] [3884] Il refuse d'agir pour renverser le gouvernement. En fait le KPD et l’IC accroissent la confusion et contribuent à l’affaiblissement de la classe ouvrière.
D’un côté le KPD fait concurrence aux fascistes sur le terrain nationaliste. Le 10 août par exemple (le jour même où surgit une vague de grèves à Berlin), les dirigeants du KPD, comme Talheimer à Stuttgart, tiennent encore des rassemblements nationalistes ensemble avec les national-socialistes. En même temps le KPD appelle à la lutte contre le danger fasciste. Alors qu’à Berlin le gouvernement interdit toute manifestation et que la direction du KPD est prête à se soumettre à cette interdiction, l’aile gauche du parti quant à elle veut à tout prix organiser le 29 juin une mobilisation du front uni contre les fascistes !
Le KPD est incapable de prendre une décision claire ; le jour de la manifestation quelques 250.000 ouvriers sont dans la rue face aux bureaux du parti, attendant en vain des instructions.
En août 1923, le KPD contre l'intensification des luttes
En août une nouvelle vague de grèves commence. Presque tous les jours les ouvriers manifestent, actifs et chômeurs ensemble. Dans les usines c'est l’effervescence, des comités d’usines se forment. L’influence du KPD est à son apogée.
Le 10 août les ouvriers de l’imprimerie de la monnaie nationale partent en grève. Dans une économie heure par heure l’Etat doit imprimer davantage de monnaie, la grève des imprimeurs des billets de banque a un effet paralysant particulièrement fort sur l’économie. En quelques heures les réserves de papier-monnaie sont épuisées. Les salaires ne peuvent plus être payés. La grève de l’imprimerie qui a commencé à Berlin, s’étend comme une traînée de poudre aux autres secteurs de la classe. De Berlin elle s’étend à l’Allemagne du nord, àla Rhénanie, au Wurtemberg, à la Haute Silésie, à la Thuringe et jusqu’à la Prusse orientale. De plus en plus de secteurs de la classe ouvrière rejoignent le mouvement. Les 11 et 12 août se produisent de violentes confrontations dans plusieurs villes ; plus de 35 ouvriers sont tués par la police. Comme tous les mouvements qui ont surgi depuis 1914, ils sont caractérisés par le fait qu’ils se mènent en dehors et contre la volonté des syndicats. Les syndicats comprennent que la situation est sérieuse. Quelques uns simulent un soutien à la grève au début, pour être capables de la saboter de l’intérieur. D’autres syndicats s’opposent directement à la grève. Le KPD lui-même prend position, une fois que les grèves ont commencé à s’étendre : “pour une intensification des grèves économiques, pas de revendications politiques. ” Et dès que la direction syndicale annonce qu’elle ne soutient pas la grève, la direction du KPD appelle les ouvriers à cesser la grève. La direction du KPD ne veut soutenir aucune grève en dehors du cadre syndical.
Alors que Brandler insiste pour arrêter la grève, puisque l’ADGB s’y oppose, les section locales du parti par contre veulent étendre le nombre de grèves locales et les unifier dans un grand mouvement contre le gouvernement Cuno. Le reste de la classe ouvrière est “appelé à s’unir au puissant mouvement du prolétariat de Berlin et à étendre la grève générale à travers l’Allemagne.”
Le parti en arrive à une impasse. La direction du parti se prononce contre la continuation et l’extension des grèves, car ceci impliquerait le rejet du terrain nationaliste sur lequel le capital veut entraîner les ouvriers en même temps qu'une remise en cause du front unique avec le SPD et les syndicats.. Le 18 août, le Rote Fahne écrit encore : “S’ils le veulent, nous combinerons même nos forces avec le peuple qui a assassiné Liebknecht et Rosa Luxemburg.”
L’orientation pour un front unique, l’obligation de travailler dans les syndicats sous le prétexte de vouloir conquérir plus d’ouvriers de l’intérieur, signifie en réalité se soumettre à la structure syndicale, contribuer à empêcher les ouvriers de prendre leurs luttes en mains. Tout ceci signifie un conflit terrible pour le KPD : ou reconnaître la dynamique de la lutte de classe, rejeter l’orientation nationaliste et le sabotage syndical, ou se retourner contre les grèves, être absorbé par l’appareil syndical, en dernière analyse devenir le mur protecteur de l'Etat et agir comme un obstacle pour la classe ouvrière. Pour la première fois dans son histoire, le KPD en arrive à un conflit ouvert avec la classe ouvrière en lutte, à cause de son orientation syndicale et parce que la dynamique des luttes ouvrières pousse les ouvriers à rompre avec le cadre syndical. La confrontation avec les syndicats est inévitable. Au lieu de l'assumer, la direction du KPD discute des moyens de prendre la direction des syndicats pour soutenir la grève !
Sous la pression de cette vague de grèves le gouvernement Cuno démissionne le 12 août. Le 13 août la direction du KPD lance un appel à cesser la grève. Cet appel rencontre la résistance des délégués de base, qui se sont radicalisés, dans les usines à Berlin. De plus, des sections locales du parti s’y opposent aussi et veulent que le mouvement continue. Elles attendent les instructions de la Centrale. Elles veulent éviter les confrontations isolées avec l’armée en attendant que les armes, que la Centrale prétend posséder, soient distribuées.
Le KPD est devenu la victime de sa propre politique national-bolchevik et de sa tactique de front unique ; la classe ouvrière est plongée dans une grande confusion et perplexité, ne sachant pas vraiment quoi faire ; la bourgeoisie par contre est prête à prendre l’initiative.
Comme dans les situations précédentes de développement de la combativité ouvrière, le SPD va jouer un rôle décisif pour briser la tête du mouvement. Le gouvernement Cuno, proche du parti du Centre, est remplacé par une “grande coalition” à la tête de laquelle se trouve le dirigeant du Centre Gustav Streseman, qui est soutenu par 4 ministres du SPD (Hilferding devient ministre des Finances). Le fait que le SPD rejoigne le gouvernement n’est pas l’expression d’une impuissance ou d'une paralysie, ni d’une incapacité du capital d’agir, comme le KPD le croit à tort. C'est une tactique consciente de la bourgeoisie pour contenir le mouvement. Le SPD n’est en aucun manière sur le point de céder, comme la direction du KPD le proclamera plus tard, pas plus que la bourgeoisie n'est divisée ou dans l'incapacité de nommer un nouveau gouvernement.
Le 14 août, Streseman annonce l’introduction d’une nouvelle monnaie et la stabilisation des salaires. La bourgeoisie parvient à prendre le contrôle de la situation et décide de manière consciente d’en terminer avec la spirale de l’inflation – de la même manière qu’un an auparavant elle a consciemment décidé de laisser se développer l’inflation.
En même temps, le gouvernement appelle les ouvriers dans la Ruhr à terminer la “résistance passive” contre la France et, après avoir “flirté” avec la Russie, il déclare la “guerre au bolchevisme” un des principaux objectifs de la politique allemande.
En promettant de maîtriser l’inflation la bourgeoisie parvient à inverser le rapport de forces ; même si après la fin du mouvement à Berlin une série de grèves continuent en Rhénanie et dans la Ruhr, le 20 août, le mouvement dans son ensemble est terminé.
La classe ouvrière n’a pas pu être entraînée sur le terrain nationaliste, mais elle est incapable de pousser en avant son mouvement – une des raisons en étant que le KPD lui-même est une victime de sa propre politique national-bolchevik, permettant ainbsi à la bourgeoisie de faire un pas vers son objectif qui est d’infliger une défaite décisive à la classe ouvrière. La classe ouvrière sort désorientée de ces luttes, avec un sentiment d’impuissance face à la crise.
Les fractions de gauche de l’IC, qui se sentent encore plus isolées après l’abandon du projet d’alliance entre l’“Allemagne opprimée” et la Russie, après le fiasco du national-bolchevisme, se trouvent entraînées à essayer de se tourner à nouveau dans une tentative désespérée d’insurrection. C'est ce que nous aborderons dans la deuxième partie de cet article.
DV.[1] [3885] Dans un correspondance privée, le président du Parti en 1922, E.Meyer insulte la Centrale et des dirigeants du parti. Meyer envoie par exemple des notes personnelles, donnant des descriptions de la personnalité des dirigeants du parti dans leur comportement avec leur femme. Il demande à sa femme qu’elle lui rapporte des informations sur l’atmosphère dans le parti, pendant son séjour à Moscou. Il y a un beaucoup de correspondance privée entre les membres de la Centrale et l’IC. Différentes tendances dans l’IC ont des liens particuliers avec différentes tendances dans le KPD. Le réseau de “canaux de communication informels et parallèles” est étendu. Qui plus est, l’atmosphère dans le KPD est pour fortement empoisonnée : au 5e congrès de l’IC, Ruth Fischer, qui elle-même a considérablement contribué à cela, rapporte : “à la conférence du parti de Leipzig (en janvier 1923) il est arrivé quelque fois que des travailleurs de différents quartiers soient assis à la même table. A la fin il demandaient : d’où êtes-vous ? Et quelque pauvre ouvrier disait : je suis de Berlin. Les autres se levaient alors, quittant la table et évitant le délégué de Berlin. Voilà sur l’atmosphère dans le parti.”
[2] [3886] Des voix dans le parti tchèque s’opposent à cette orientation. Ainsi Neurath attaque les positions de Talheimer comme une expression de la corruption par les sentiments patriotiques. Sommer, un autre communiste tchèque, écrit dans le Rote Fahne pour demander le rejet de cette orientation : “il ne peut y avoir aucune compréhension avec l’ennemi de l’intérieur.” (Carr, L’inter-règne, p.168)
[3] [3887] En même temps ils veulent mettre en place des unités économiques autonomes, une orientation qui exprime le fort poids syndicaliste. L’opposition du KPD veut une république ouvrière qui serait mise en place en Rhénanie-Ruhr, pour envoyer une armée en Allemagne centrale pour y contribuer à la prise du pouvoir. Cette motion, proposée par R.Fischer, est rejetée par 68 contre 55 voix.
[4] [3888] Beaucoup d’ouvriers, qui n’ont pas une grande formation théorique et politique, sont attirés par le parti. Le parti ouvre ses portes à l’adhésion de masse. Tout le monde est le bienvenu. En avril 1922, le KPD annonce : “dans la situation politique actuelle, le KPD a le devoir d’intégrer tout ouvrier dans nos rangs, qui veut nous rejoindre.” A l’été 1923, beaucoup de sections de province tombent entre les mains d’éléments jeunes, radicaux. Ainsi, de plus en plus impatients, les éléments inexpérimentés rejoignent le parti. En 6 mois les effectifs du parti passent de 225 000 à 295 000 membres, de septembre 1922 à septembre 1923, le nombre de groupes locaux du parti passe de 2481 à 3321. A cette époque, le KPD a sa propre presse et publie 34 quotidiens et un grand nombre de revues. En même temps beaucoup d’éléments infiltrés ont rejoint le parti, pour essayer de le saboter de l'intérieur.
Géographique:
- Allemagne [98]
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Allemande [1955]
Conscience et organisation:
Approfondir:
- Révolution Allemande [1957]
Heritage de la Gauche Communiste:
- La Révolution prolétarienne [1149]
A propos de l'appel lancé par le CCI sur la guerre en Serbie
- 3254 reads
L'offensive guerrière de la bourgeoisie exige une réponse unide la part des révolutionnaires
- La guerre en Serbie a démasqué les faux révolutionnaires et mis en évidence l'unité de fond des groupes véritablement internationalistes
Les guerres, comme les révolutions, constituent des événements historiques d'une grande portée pour délimiter le camp de la bourgeoisie de celui des révolutionnaires et viennent donner la preuve de la nature de classe des forces politiques. Il en fut ainsi pour la première guerre mondiale qui a provoqué la trahison de la social-démocratie au niveau international, la mort la 2e Internationale et l'émergence d'une minorité qui va constituer les nouveaux partis communistes et la 3e Internationale. Il en fut ainsi avec la seconde guerre mondiale qui confirma l'intégration des différents partis staliniens dans la défense de l'État bourgeois à travers leur soutien au front impérialiste "démocratique" contre le "fascisme", mais aussi des différentes formations trotskistes qui appelèrent la classe ouvrière à défendre “l'État ouvrier” russe contre l'agression de la dictature nazi-fasciste, et qui vit aussi la résistance courageuse d'une infime minorité de révolutionnaires qui surent maintenir le cap au cours de cette terrible épreuve historique. Aujourd'hui nous ne sommes pas encore face à une troisième guerre mondiale, les conditions ne sont pas encore mûres et nous ne pensons pas qu'elles vont l’être dans un futur proche ; toutefois, l’opération guerrière en Serbie est certainement l’événement le plus grave depuis la fin de la seconde guerre mondiale et elle a provoqué une polarisation des forces politiques autour des deux principales classes de la société : le prolétariat et la bourgeoisie.
Alors que les diverses formations gauchistes ont confirmé leur fonction bourgeoise par leur soutien soit à l’attaque de l'OTAN soit à la défense de la Serbie[1] [3889], nous pouvons au contraire constater avec une profonde satisfaction comment les principaux groupes politiques révolutionnaires ont tous assumé une position internationaliste cohérente en soutenant les points fondamentaux suivants :
1. La guerre en cours est une guerre impérialiste (comme toutes les guerres aujourd’hui) et la classe ouvrière n’a rien à gagner dans le soutien à l’un ou l’autre front :
“Armer tel ou tel camp –américain ou serbe, italien ou français, russe ou anglais– ce sont toujours des conflits inter-impérialistes suscités par les contradictions de l'économie bourgeoise (...). Pas un homme, pas un soldat pour la guerre impérialiste : lutte ouverte contre sa propre bourgeoisie nationale, serbe ou kosovar, italienne ou américaine, allemande ou française.” (Il Programma comunista, n°4, 30 avril 1999)
“Pour les communistes authentiques, le soutien à tel ou tel impérialisme, en distinguant le plus faible du plus fort parce qu’entre deux maux il faudrait choisir le moindre est erroné, opportuniste et malhonnête. Tout appui à un front impérialiste ou l’autre est un appui au capitalisme. C’est une trahison de toutes les espérances d’émancipation du prolétariat et de la cause du socialisme.
Le seul chemin pour sortir de la logique de la guerre passe seulement par la reprise de la lutte de classe au Kosovo comme dans le reste de l’Europe, aux États-Unis comme en Russie.” (Tract du BIPR, “Capitalisme veut dire impérialisme, impérialisme veut dire guerre”, 25 mars 1999)
2. La guerre en Serbie, loin de poursuivre des objectifs humanitaires en faveur de telle ou telle population, est la conséquence logique de l'affrontement inter-impérialiste au niveau mondial :
“Les avertissements et les pressions sur la Turquie, et même la guerre contre l'Irak, n'ont pas arrêté la répression et le massacre des kurdes ; comme les avertissements et les pressions sur Israël n'ont pas arrêté la répression et le massacre des palestiniens. Les missions de l’ONU, les soi-disant forces d'interposition, les embargos, n'ont ni évité ni arrêté la guerre hier en ex-Yougoslavie, entre Serbie et Croatie, entre Croatie, Serbie et Bosnie, de tous contre tous. Et l’intervention militaire des bourgeoisies occidentales organisée par l'OTAN contre la Serbie n'évitera pas la ‘purification ethnique’ contre les kosovars, comme elle n'a pas évité non plus le bombardement de Belgrade et de Pristina.
Les missions humanitaires de l'ONU (...) ont tout au plus ‘préparé’ le terrain à des répressions et des massacres encore plus horribles. C’est la démonstration que la vision et l'action humanitaires et pacifistes sont en réalité simplement illusoires et donc impuissantes.” (“La véritable opposition aux interventions militaires et à la guerre est la lutte de classe du prolétariat, sa réorganisation classiste et internationaliste contre toutes les formes d'oppression bourgeoise et de nationalisme”, supplément à Il comunista, n°64-65, avril 1999).
3. Cette guerre, au-delà de l'unité de façade, exprime un affrontement entre les puissances impérialistes engagées dans l'alliance atlantique et principalement entre les États-Unis d'une part et l'Allemagne et la France d'autre part :
“la ferme volonté des États-Unis de créer un ‘casus belli’ par l’intervention directe contre la Serbie est apparue pendant les pourparlers de Rambouillet : ces colloques, loin de chercher une solution pacifique à la question inextricable du Kosovo, devait servir au contraire à rejeter la responsabilité de la guerre sur le gouvernement yougoslave. (...) Le vrai problème pour les États-Unis était en fait celui de leur propres alliés et Rambouillet a servi à les presser et leur imposer l’approbation à l'intervention de l'OTAN (...).” (Il Partito comunista, n°266, avril 1999)
“Pour empêcher que se consolide un nouveau bloc impérialiste capable de s’opposer au premier, les États-Unis poussent à l'extension de l’OTAN à l’aire entière des Balkans ainsi qu’à l’Europe de l’Est (...) Ils prétendent (...), peut-être le point le plus important, infliger un coup dur aux aspirations européennes à jouer un rôle impérialiste autonome.
Les européens, à leur tour, font bonne figure dans ce maudit jeu en soutenant l’action militaire de l'OTAN seulement pour ne pas risquer d'être complètement exclus d'une région d’une telle importance.” (Tract du BIPR, “Capitalisme veut dire impérialisme, impérialisme veut dire guerre”, 25 mars 1999)
4. Le pacifisme, comme toujours, démontre encore une fois qu’il est l’instrument non pas de la lutte de la classe ouvrière et des masses populaires contre la guerre, mais le moyen destiné à les endormir, utilisé par les partis de gauche, ce qui confirme le rôle de ces derniers de sergent-recruteur de tout futur carnage :
“Ceci veut dire abandonner toute les illusions pacifistes et réformistes qui désarment et se tourner vers des objectifs et des méthodes de luttes classistes qui ont toujours appartenu à la tradition prolétarienne (...)” (Il Programma comunista, n°4, 30 avril 1999)
“Le front bigarré (...) adresse le même appel pacifiste à tous ceux dont le capital se sert pour faire la guerre : la Constitution, les Nations Unies, les gouvernements (...). Enfin, et ce qui en devient ridicule, on demande à ce même gouvernement qui est en train de faire la guerre... d’être gentil et d’oeuvrer pour la paix.” (Battaglia Comunista, n°5, mai 1999)
Notre appel au milieu politique prolétarien
Comme on peut le constater, il s’agit d’une pleine convergence sur toutes les questions de fond sur le conflit des Balkans entre les différentes organisations qui font partie du milieu politique révolutionnaire. Toutefois, il existe naturellement aussi des divergences qui concernent une approche différente de l'analyse de l'impérialisme dans la phase actuelle et du rapport de forces entre les classes. Mais, sans sous-estimer ces divergences, nous considérons que les aspects qui les unissent sont de très loin plus importants et significatifs que ceux qui les distinguent par rapport aux enjeux du moment et c’est sur cette base que, le 29 mars 1999, nous avons lancé un appel à l'ensemble de ces groupes[2] [3890] pour prendre une initiative commune contre la guerre :
“Camarades, ...
Aujourd'hui, les groupes de la gauche communiste sont les seuls à défendre ces positions classiques du mouvement ouvrier. Seuls les groupes qui se rattachent à ce courant, le seul qui n'ait pas trahi au cours de la seconde guerre mondiale, peuvent apporter une réponse de classe aux interrogations qui ne manqueront pas de se faire jour au sein de la classe ouvrière. Leur devoir est d'intervenir le plus largement possible au sein de la classe pour y dénoncer les flots de mensonge que déversent tous les secteurs de la bourgeoisie et y défendre les principes internationalistes que nous ont légués l'Internationale communiste et ses Fractions de gauche. Pour sa part, le CCI a déjà publié un tract dont nous vous envoyons ici une copie. Mais nous pensons que la gravité des enjeux mérite que l'ensemble des groupes qui défendent une position internationaliste publie et diffuse une prise de position commune affirmant les principes de classe prolétarien contre la barbarie guerrière du capitalisme. C'est la première fois depuis plus d'un demi-siècle que les principaux brigands impérialistes mènent la guerre en Europe même, c'est-à-dire le théâtre principal des deux guerres mondiales en même temps que la principale concentration prolétarienne du monde. C'est dire la gravité de la situation présente. Elle donne la responsabilité aux communistes d'unir leurs forces afin de faire entendre le plus fort possible la voix des principes internationalistes, afin de donner à l'affirmation de ces principes l'impact le plus grand possible que le permettent nos faibles forces.
Il est clair pour le CCI qu'une telle prise de position serait différente par certains aspects de celle contenue dans le tract que nous avons publié puisque nous savons bien qu'il existe au sein de la Gauche communiste des désaccords sur certains aspects de l'analyse que nous pouvons faire de tel ou tel aspect de la situation mondiale. Cependant nous sommes fermement convaincus que l'ensemble du groupe de la Gauche communiste peuvent parvenir à un document réaffirmant les principes fondamentaux de l'internationalisme sans édulcorer ces principes. C'est pour cela que nous vous proposons que nos organisations se rencontrent le plus rapidement possible afin d'élaborer un appel commun contre la guerre impérialiste, contre tous les mensonges de la bourgeoisie, contre toutes les campagnes du pacifisme et pour la perspective prolétarienne de renversement du capitalisme.
En faisant cette proposition, nous nous estimons fidèles à la politique menée par les internationalistes, et particulièrement par Lénine, lors des conférences de Zimmerwald et de Kienthal en 1915 et 1916. Une politique qui fut capable de surmonter ou laisser de côté les divergences pouvant subsister entre différents secteurs du mouvement ouvrier européen pour affirmer clairement la perspective prolétarienne face à la guerre impérialiste. Evidemment, nous sommes ouverts à toute autre initiative que pourrait prendre votre organisation, à toute proposition permettant de faire entendre le point de vue prolétarien face à la barbarie et aux mensonges de la bourgeoisie. (...)
Nous vous adressons nos salutations communiste.
Le CCI.”
______________________________
Les réponses à notre appel
Malheureusement les réponses à cet appel n'ont pas été à la hauteur de la situation et de notre attente. Deux des formations bordiguistes, Il Comunista-Le Prolétaire et Il Partito Comunista, n'ont pas encore répondu à l'appel, malgré une seconde lettre de proposition envoyée le 14 avril 1999 pour solliciter une réponse. Le troisième groupe bordiguiste, Programma comunista, avait promis une réponse écrite (négative), mais nous n'avons rien reçu. Enfin le BIPR nous a fait l'honneur de répondre à notre invitation par un refus fraternel. Il est évident que nous ne pouvons que regretter l’échec de cet appel, outre qu’il confirme une fois de plus, s’il en était encore besoin, les difficultés dans lesquelles se trouve aujourd'hui le milieu politique prolétarien, encore fortement imprégné de l’engourdissement sectaire du climat contre-révolutionnaire dans lequel ce milieu s'est reconstitué. Mais en ce moment, par rapport au problème de la guerre, notre préoccupation principale n'est pas d'alimenter encore plus les frictions dans le milieu politique prolétarien en développant une polémique sur l'irresponsabilité que constitue une réponse négative ou une absence de réponse à notre appel, mais de développer jusqu’au bout les arguments qui militent en faveur de la nécessité et de l'intérêt pour la classe ouvrière qu'une initiative commune soit prise par l'ensemble des groupes internationalistes. Pour faire cela nous analyserons les arguments opposés par le BIPR (le seul qui nous ait répondu !) soit par lettre soit dans les rencontres directes que nous avons eues avec ce groupe, en considérant que beaucoup des arguments du BIPR pourraient être avec une forte probabilité ceux que nous auraient donnés les groupes bordiguistes, si seulement ils avaient daigné nous répondre. De cette façon nous espérons réussir à faire avancer notre proposition d'initiative commune face à tous les camarades et toutes les formations politiques de la classe ouvrière et obtenir un meilleur résultat dans le futur.
Est-il vrai qu'une réponse unie du milieu politique ait nécessairement un “profil bas”?
Le premier argument utilisé par le BIPR est que les positions des divers groupes sont trop différentes, motif pour lequel une prise de position commune serait “de profil politique très bas” et donc peu efficace pour “faire sentir le point de vue prolétarien face à la barbarie et aux mensonges de la bourgeoisie” (de la lettre de réponse du BIPR à notre appel).
Et, en appui à ces affirmations, il ajoute :
“Il est vrai que ‘aujourd'hui les groupes de la gauche communiste sont les seuls à défendre les positions classiques du mouvement ouvrier’, mais il est vrai que chaque courant le fait d’une manière qui aujourd'hui apparaît radicalement différente. Nous n'indiquerons pas les différences spécifiques que tout observateur attentif peut facilement relever ; nous nous limitons à souligner que ces différences marquent une décantation très importante entre les forces qui se réclament d’une Gauche communiste générique. ...” (Ibidem)
Ceci est exactement le contraire de ce que nous venons juste de démontrer. Les citations rapportées au début de l’article pourraient facilement être changées entre les différents groupes sans produire aucune déformation politique et, prises tout ensemble, fournir les éléments politiques de base d'une possible prise de position commune dont a tant besoin la classe ouvrière en ce moment.
Pourquoi alors le BIPR parle de “divergences radicales” qui rendraient inefficaces les efforts pour une initiative en commun ? Parce que le BIPR met sur le même plan les positions de fond (l’attitude défaitiste face à la guerre) et les analyses politiques de la phase actuelle (les causes de la guerre en Serbie, le rapport de forces entre bourgeoisie et prolétariat...). Nous ne cherchons certainement pas à sous-estimer l'importance des divergences actuelles dans le milieu politique prolétarien sur ces analyses. Nous reviendrons sur ces arguments dans un prochain article et notre critique à ce que nous considérons être une position économiste développée en particulier par Battaglia Comunista et par Il Partito comunista. Actuellement nous estimons que le problème le plus important est la sous-estimation que le BIPR, et avec lui tous les autres groupes cités, exprime en ce qui concerne l'écho que pourrait avoir une telle initiative.
Ce n'est pas pour rien si, pour réfuter cette possibilité, le BIPR est contraint de s'attaquer à la signification des conférences de Zimmerwald et de Kienthal et qu'il arrive à les sous-estimer énormément.
La signification des conférences de Zimmerwald et Kienthal
“Pour cette raison la référence à Zimmerwald et Kienthal présente dans votre lettre-appel n’est d'aucune référence avec la situation historique actuelle.
Zimmerwald et Kienthal n'ont pas été des initiatives bolcheviks ou de Lénine, mais plutôt des socialistes italiens et suisses qui s’y sont réunis et majoritairement les tendances ‘radicales’ internes aux partis de la Seconde internationale. Lénine et les bolcheviks vont y participer pour pousser à la rupture avec la 2e Internationale mais :
- a) la rupture n’était pas certaine à ce moment-là, au contraire Lénine est resté en minorité absolue dans les deux conférences ;
- b) il n'est pas sûr que le manifeste de Zimmerwald ‘affirme clairement la perspective prolétarienne face à la guerre impérialiste’, mais c’est plutôt les motions de Lénine, rejetées par les conférences.
Donc présenter la participation des bolcheviks aux conférences de Zimmerwald et Kienthal comme modèle auquel se référer dans la situation actuelle n'a pas de sens.” (Lettre de réponse du BIPR à notre appel)
Dans ce passage, après avoir rappelé des choses évidentes comme le fait que les conférences ont été à l’initiative des socialistes italiens et suisses et non des bolcheviks (mais c’est peut-être déshonorant ?), que Lénine y a participé avec l'intention de pousser à la rupture avec la 2e internationale et que, par conséquent ajoutons-nous, Lénine est resté en minorité absolue dans les deux conférences, on finit par lancer l’anathème à ceux qui présentent “les conférences de Zimmerwald et Kienthal comme modèle auquel se référer dans la situation actuelle.”
Or, le BIPR ne comprend pas –évidemment par inattention à la lecture de notre appel– ce que nous-mêmes affirmons : c'est “la politique menée par les internationalistes, et particulièrement par Lénine, lors des conférences de Zimmerwald et de Kienthal en 1915 et 1916 (qui a été capable) d'affirmer clairement la perspective prolétarienne face à la guerre impérialiste”. Le problème est que le BIPR semble ignorer l'histoire même de notre classe. S'il est vrai en fait que les bolcheviks, à la “gauche du mouvement ouvrier” de l’époque, ont toujours cherché à pousser le plus loin possible les résultats de ces conférences, ils n’ont jamais imaginé rester en dehors parce qu’ils comprenaient la nécessité de se rassembler dans un moment de décantation politique particulièrement forte et cruciale comme celui du début du siècle. Lénine lui-même y a mené un travail très important animant ce qui s’est appelé “la gauche de Zimmerwald”, le creuset à partir duquel ont été forgées les forces politiques qui permettront la construction de la 3e Internationale. Et, encore à propos du fait que “Zimmerwald et Kienthal n'ont pas été des initiatives bolcheviks”, voilà ce que pensait la gauche révolutionnaire de Zimmerwald :
“Le manifeste accepté par la conférence ne nous satisfait pas complètement. Dans celui-ci il n’y a rien de particulier sur l'opportunisme déclaré ou sur ce qui se cache derrière les phrases radicales –de cet opportunisme qui non seulement porte la principale responsabilité de l’effondrement de l’Internationale, mais qui de plus veut se perpétuer. Le manifeste ne spécifie pas clairement les moyens pour s’opposer à la guerre. (...)
Nous acceptons le Manifeste parce que nous le concevons comme un appel à la lutte et parce que, dans cette lutte, nous voulons marcher, côte à côte, avec les autres groupes de l’Internationale. (...)”
(Déclaration de la Gauche zimmerwaldienne à la conférence de Zimmerwald, signée par N.Lénine, G.Zinoviev, Radek, Nerman, Höglung et Winter et rapportée dans Les origines de l'Internationale communiste, de Zimmerwald à Kienthal, J.Humbert-Droz, éditions Guanda)
Et voilà ce que disait Zinoviev le lendemain de la conférence de Kienthal :
“Nous, zimmerwaldiens, avons l'avantage de nous être déjà retrouvés au niveau international, alors que les sociaux patriotes ne l'ont pas encore pu. Nous devons donc mettre à profit cet avantage pour organiser la lutte contre le social patriotisme (...).
Au fond, la résolution représente un pas en avant. Ceux qui confrontent cette résolution avec le projet de la gauche zimmerwaldienne, en septembre 1915, et avec les écrits de la gauche allemande, hollandaise, polonaise et russe, devront admettre que nos idées ont été alors dans le sens des principes acceptées par la Conférence (...).
Lorsqu’on fait le point, la seconde Conférence de Zimmerwald représente un pas en avant. La vie travaille pour nous (...).
La Seconde Conférence de Zimmerwald sera politiquement et historiquement un nouveau pas en avant sur la voie de la 3e internationale.” (G. Zinoviev, Ibidem)
En conclusion, Zimmerwald et Kienthal ont constitué deux étapes cruciales dans la bataille que les révolutionnaires ont conduit pour le rapprochement des révolutionnaires et leur séparation d’avec les social-patriotes traîtres en vue de la constitution de la 3e Internationale.
Les bolcheviks et Lénine ont été capables de comprendre ce que représentait pour les ouvriers isolés et désespérés sur les fronts, le Manifeste de Zimmerwald : un immense espoir et une sortie de l’enfer. C’est ce que ne comprend malheureusement pas le BIPR. Il y a des moments dans l’histoire où une avancée des révolutionnaires est plus importante que mille programmes les plus clairs politiquement, pour paraphraser ce que disait Marx.
Que reste-t-il ?
La dernière chose qui reste à comprendre, en ce qui concerne spécifiquement le BIPR, est comment cette organisation, qui il y a encore quelques mois et depuis quelques années, a pris avec nous toute une série d'initiatives communes dont les plus significatives sont :
- la participation coordonnée et l'intervention parfois au nom des deux organisations, dans la deuxième conférence sur l’héritage politique de Trotsky organisée à Moscou en 1997 par la mouvance trotskiste ;
- la tenue d'une réunion publique commune à Londres sur la révolution russe avec une introduction unique pour les deux groupes, un seul présidium et la publication d'un même article de bilan rédigé ensemble par les deux groupes et publié dans les organes de presse respectifs en langue anglaise Workers Voice et World Revolution ;
- une intervention coordonnée entre les deux organisations dans la confrontation à des groupes parasites en Grande-Bretagne ;
refuse maintenant toute initiative de ce type. Quand nous avons posé la question aux camarades de Battaglia comunista, ceux-ci nous ont répondu que sur la révolution russe on pouvait travailler ensemble parce que “les leçons étaient acquises depuis beaucoup de temps”, il s'agit là d’analyses consolidées, de choses du passé, alors que la guerre est un problème différent, actuel, qui a des implications sur les perspectives. Or, à part le fait que, outre les réunions publiques sur la révolution d'octobre, c’est aussi l'intervention faite aux conférences en Russie qui ne concernait absolument pas le passé, mais par définition le présent et le futur du mouvement ouvrier, et ce qui est curieux c’est que la même discussion sur Octobre 1917 est présentée comme un élément d'archéologie politique plutôt que comme un instrument pour affiner les armes d'intervention dans la classe ouvrière aujourd'hui. En somme, encore une fois, les arguments du BIPR sont non seulement pas valables, mais en plus ils sont faux.
En réalité, à y regarder de près, ce retournement du BIPR n’est pas tellement mystérieux parce qu'il a été annoncé et correspond à ce que les camarades ont écrit dans leurs conclusions de la “Résolution sous le travail international” du 6e congrès de Battaglia comunista, adoptées par l'ensemble du Bureau et rapportées dans la réponse du BIPR à notre appel :
“C’est maintenant un principe acquis de notre ligne de conduite politique que, sauf dans des circonstances très exceptionnelles, toutes les nouvelles conférences et réunions internationales entreprises par le Bureau et ses organisations doivent se situer complètement dans le sens qui mène à la consolidation, au renforcement et à l’extension des tendances révolutionnaires du prolétariat mondial. Le Bureau International pour le Parti révolutionnaire et les organisations qui lui appartiennent adhèrent à ce principe. (...) Et il est clair à partir du contexte et de l’ensemble des autres documents du Bureau que par ‘tendances révolutionnaires du prolétariat’ nous entendons toutes les forces qui vont former le Parti International du prolétariat. Et, –étant donné la méthode politique actuelle de votre organisation et des autres– nous ne pensons pas que vous puissiez en faire partie.”
Dans ce passage, au delà de l’évidence de la première partie, avec laquelle nous pouvons nous aussi être d'accord, “toutes les nouvelles conférences et réunions internationales (...) doivent se situer complètement dans le sens qui mène à la consolidation, au renforcement et à l’extension des tendances révolutionnaires du prolétariat mondial”, se cache l’idée selon laquelle le BIPR est, aujourd’hui la seule organisation crédible à l’intérieur de la gauche communiste (d’où vient cette auto-proclamation d’un type nouveau au sin du mouvement ouvrier ; mais le BIPR a peut-être comme le pape un “arrangement avec le ciel”), étant donné la nature “idéaliste” du CCI et la “sclérose” des bordiguistes : “étant donné la méthode politique actuelle de votre organisation et des autres, nous ne pensons pas que vous puissiez faire partie” du “Parti International du prolétariat”. Pour cela, autant vaut suivre directement sa propre voie par rapport aux organisations soeurs, mais sans perdre du temps à faire des conférences ou initiatives communes qui auraient des résultats stériles et sans perspective.
C’est la seule position claire du BIPR, mais complètement incohérente ou pour le moins avec des raisons tout à fait spécieuses.
Nous reviendrons sur ces aspects. En ce qui nous concerne nous savons que le parti naîtra de la confrontation et de la décantation politiques qui se fera inévitablement au sein des organisations révolutionnaires existantes.
31 mai 1999, Ezechiele
[1] [3891] Voir dans nos différents organes de presse territoriale des mois d'avril, mai, juin 1999 la dénonciation des formations faussement révolutionnaire présentes dans chaque pays.
[2] [3892] Bureau International pour le Parti Révolutionnaire (Partito Comunista Internazionalista qui publie Battaglia Comunista en Italie et Communist Workers Organisation qui publie Revolutionary Perspectives en Grande-Bretagne) ; Partito Comunista Internazionale (qui publie Il Comunista en Italie et Le Prolétaire en France) ; Partito Comunista Internazionale (qui publie Il Partito Comunista) ; Partito Comunista Internazionale (qui publie Il Programma Comunista en Italie, Cahiers Internationalistes en France, Internationalist Papers en Grande-Bretagne)
Vie du CCI:
- Interventions [3893]
Géographique:
- Europe [95]
Conscience et organisation:
Courants politiques:
- Gauche Communiste [49]
Approfondir:
Questions théoriques:
- Internationalisme [1058]
- Guerre [129]
Heritage de la Gauche Communiste:
Revue Internationale no.99 - 4e trimestre 1999
- 3001 reads
Editorial : Timor, Tchétchénie…
- 2923 reads
Le capitalisme, synonyme de chaos et de barbarie
Après le Kosovo, le Timor
oriental ; après le Timor, la Tchétchénie. Le sang d'un massacre n'est pas
encore séché qu'il coule de nouveau à flots en un autre lieu de la planète. En
même temps, le continent africain n'en finit pas d'agoniser : aux guerres
endémiques qui saignent jour après jour l'Erythrée, le Soudan, la Somalie, le
Sierra Leone, le Congo, et bien d'autres pays encore, sont venus s'ajouter
récemment de nouveaux massacres au Burundi et un affrontement entre les deux
“amis” Rwandais et Ougandais, alors que la guerre reprend de plus belle en
Angola. Nous sommes vraiment loin des prophéties du président américain Bush,
il y a exactement dix ans, lors de l'effondrement du bloc de l'Est, annonçant
“un nouvel ordre mondial fait de paix et de prospérité”. La seule paix qui a
fait des progrès, au cours de la dernière décennie, c'est la paix des
cimetières.
En fait, jour après jour, se confirme la réalité de l'enfoncement de la société capitaliste dans le chaos et la décomposition.
Timor et Tchétchénie, deux manifestations de la décomposition du capitalisme
Les massacres (des milliers de morts) et les destructions (dans certaines agglomérations, il y a entre 80 et 90% de maisons brûlées) qui viennent de ravager le Timor oriental ne sont pas chose nouvelle dans ce pays. Une semaine après que le Portugal lui ait donné son indépendance en mai 1975, les troupes indonésiennes l'avaient envahi pour en faire, un an plus tard, la 27ème province de l'Indonésie. Les massacres et les famines avaient fait à cette occasion entre 200 000 et 300 000 morts dans une population qui comprenait moins d'un million de personnes. Cependant, il ne faudrait pas considérer ce qui vient de se passer au Timor oriental comme un pâle “remake” des événements de 1975. A cette époque, il y avait déjà de nombreux conflits qui étaient souvent meurtriers (la guerre du Vietnam ne prend fin qu'en 1975). Mais l'extermination systématique de populations civiles sur la base de leur appartenance ethnique faisait encore figure d'exception alors qu'elle est devenue aujourd'hui la règle. Les massacres de Tutsis en 1994 au Rwanda ne sont pas une particularité “africaine” liée au sous-développement de ce continent. La même tragédie s'est produite il y a quelques mois au cœur de l'Europe, au Kosovo. Et si, aujourd'hui, on assiste au Timor à une répétition de tels actes barbares, c'est bien comme une manifestation de la barbarie présente du capitalisme, du chaos dans lequel s'enfonce ce système, qu'il faut les considérer et non comme un problème spécifique de ce pays lié à une décolonisation ratée il y a 25 ans.
Le fait que la période actuelle se distingue nettement de celle d'avant l'effondrement du bloc de l'Est s'illustre parfaitement dans la nouvelle guerre qui ravage aujourd'hui la Tchétchénie. Il y a dix ans, l'URSS avait perdu en quelques semaines son bloc impérialiste qu'elle avait dominé d'une poigne de fer pendant quatre décennies. Mais comme cet effondrement du bloc découlait en premier lieu d'une crise économique et politique catastrophique de sa puissance dominante, crise qui avait conduit celle-ci à une totale paralysie, il portait en lui l'explosion de l'URSS elle-même : les républiques baltes, caucasiennes, d'Asie centrale et même d'Europe de l'Est (Ukraine, Biélorussie) ont voulu imiter l'exemple de la Pologne, de la Hongrie, de l'Allemagne de l'Est, de la Tchécoslovaquie, etc. En 1992, la messe était dite et la Fédération de Russie se retrouvait seule. Mais cette dernière, elle-même comportant de multiple nationalités, commençait à être victime du même processus de désagrégation concrétisé par la guerre de Tchétchénie entre 1994 et 1996. Cette guerre, après avoir fait plus de 100 000 morts des deux côtés et avoir détruit les principales villes du pays, s'était soldée par une défaite russe et l'indépendance de fait de la Tchétchénie.
L'entrée au Daghestan, au mois d'août, des troupes islamistes du tchétchène Chamil Bassaïev et de son compère, le jordanien Khattab, ont constitué le point de départ d'une nouvelle guerre en Tchétchénie. Cette nouvelle guerre est un concentré des manifestations de la décomposition qui affecte l'ensemble du capitalisme[1] [3895].
D'une part, elle est une retombée de l'effondrement de l'URSS qui a constitué, jusqu'à présent, la manifestation la plus importante de la phase de décomposition dans laquelle s'enfonce la société bourgeoise. D'autre part, elle met en jeu la montée de l'intégrisme islamique qui révèle elle aussi, dans toute une série de pays (Iran, Afghanistan, Algérie, etc.), la décomposition du système et dont la contrepartie, dans les pays avancés, peut être trouvée dans la montée de la violence urbaine, de la drogue et des sectes.
Par ailleurs, s'il est vrai, comme l'affirment de nombreuses sources (et c'est tout à fait vraisemblable), que Bassaïev et sa clique sont financés par le milliardaire mafieux Berezovski, l'éminence grise de Eltsine, ou bien que les explosions de Moscou du mois de septembre sont le fait des services secrets russes, nous aurions là d'autres manifestations de la décomposition du capitalisme qui sont loin de s'arrêter à la seule Russie : l'utilisation de plus en plus fréquente du terrorisme par les Etats bourgeois eux-mêmes (et pas seulement par des petits groupes incontrôlés), la montée de la corruption en leur sein. En tout état de cause, même si les “services” russes ne sont pas derrière les attentats, ces derniers ont été utilisés par les autorités pour créer un puissant sentiment xénophobe en Russie justifiant cette nouvelle guerre contre la Tchétchénie. Cette guerre est voulue par l'ensemble des secteurs politiques russes (à l'exception de Lebed, signataire des accords de Kassaviourt en août 1996 avec la Tchétchénie), depuis les staliniens de Ziouganov jusqu'aux “démocrates” du maire de Moscou, Loujkov. Et justement, que l'ensemble de l'appareil politique de Russie, malgré le fait que sa majorité dénonce la corruption et l'impéritie de la clique d'Eltsine, soutienne sa fuite en avant dans une aventure qui ne pourra qu'aggraver la catastrophe économique et politique dans laquelle s'enfonce ce pays en dit long sur le chaos croissant qui le gagne.
Le cynisme et l'hypocrisie des puissances “démocratiques”
Il y a quelques mois, l'offensive militaire des armées de l'OTAN en Yougoslavie avait été couverte de la feuille de vigne de “l'ingérence humanitaire”. Il avait fallu un mitraillage intensif d'images de la détresse des réfugiés kosovars et des charniers découverts après le retrait des troupes serbes du Kosovo pour faire oublier aux populations des pays de l'OTAN le fait que cette intervention militaire avait eu comme première conséquence de déchaîner “l'épuration ethnique” des milices de Milosevic contre les albanais de cette province.
Aujourd'hui, avec le Timor oriental, l'hypocrisie bat de nouveaux records. Lorsque, en 1975-76, cette région avait été annexée par l'Indonésie de Suharto, une annexion qui avait provoqué la mort de près d'un tiers de sa population, les médias, et encore moins les gouvernements occidentaux, ne s'étaient guère préoccupés de cette tragédie. Même si l'assemblée générale de l'ONU n'avait pas reconnu l'annexion, les grands pays occidentaux avaient apporté un soutien sans faille à Suharto en qui ils voyaient le garant de l'ordre occidental dans cette partie du monde[2] [3896]. Les Etats-Unis, notamment avec leurs livraisons d'armes et l'entraînement des troupes de choc indonésiennes (les mêmes qui ont organisé les milices anti-indépendantistes recrutées parmi les voyous timorais), s'étaient évidemment distingués dans ce soutien au bourreau du Timor. Mais ils n'avaient pas été les seuls puisque la France et la Grande-Bretagne avaient poursuivi leurs livraisons d'armes à Suharto (le “Secret Action Service” de ce dernier pays ayant par ailleurs entraîné aussi les troupes d'élite indonésiennes). Quant au pays qui est présenté aujourd'hui comme le “sauveur” des populations est-timoraises, l'Australie, il fut le seul à reconnaître l'annexion du Timor oriental (dont il fut récompensé en 1981 par une participation à l'exploitation des gisements de pétrole au large du Timor). Récemment encore, en 1995, ce pays a signé avec l'Indonésie un traité de coopération militaire visant notamment le “terrorisme” -parmi lequel il fallait évidemment compter la guérilla indépendantiste du Timor oriental.
Aujourd'hui, tous les médias sont mobilisés pour montrer la barbarie dont ont été victimes les populations de ce pays après qu'elles aient voté massivement pour l'indépendance. Et cette mobilisation médiatique est évidemment venue soutenir l'intervention des forces sous commandement australien mandatées par l'ONU. Comme au Kosovo, les campagnes sur les “droits de l'homme” ont précédé une intervention armée. Une nouvelle fois, les organisations humanitaires (les multitudes d'ONG) sont arrivées dans les valises des militaires, permettant d'avaliser le mensonge que l'ingérence armée n'a pas d'autre objectif que celui de défendre des vies humaines (et sûrement pas de défendre des intérêts impérialistes).
Cependant, si le massacre des Albanais du Kosovo était parfaitement prévisible (et en fait il a été voulu par les dirigeants de l'OTAN pour justifier à posteriori l'intervention), celui des habitants du Timor oriental était non seulement prévisible mais ouvertement annoncé par ses protagonistes, les milices anti-indépendantistes. Malgré toutes les mises en garde, l'ONU a patronné sans sourciller la préparation du référendum du 30 août, livrant les est-timorais au massacre annoncé.
Quand on a demandé aux responsables de l'ONU pourquoi ils avaient été d'une telle imprévoyance, un de ses diplomates a répondu calmement que : “l'ONU n'est que la somme de ses membres”[3] [3897]. Et effectivement, pour le principal pays de l'ONU, les Etats-Unis, le discrédit qui a frappé cette organisation n'était pas une mauvaise chose. C'était un moyen de remettre les pendules à l'heure après la conclusion de la guerre du Kosovo où une opération débutée sous l'égide américaine, avec les bombardements de l'OTAN, s'est achevée par un retour en force de l'ONU dont le contrôle échappe de plus en plus aux Etats-Unis du fait du poids qu'y exercent nombre de pays qui s'opposent à la tutelle US, notamment de la France.
La position des Etats-Unis avait d'ailleurs été clairement affichée à plusieurs reprises par ses principaux responsables :
“Il n'est pas question d'envoyer des troupes de l'ONU à court terme, les indonésiens doivent eux-mêmes reprendre le contrôle des différentes factions qui existent au sein de la population.” (Peter Burleigh, ambassadeur adjoint américain aux Nations Unies)[4] [3898]. Voilà qui était bien dit lorsqu'il était plus qu'évident que la “faction” anti-indépendantiste était à la botte de l'armée indonésienne. “Ce n'est pas parce que nous avons bombardé Belgrade que nous allons bombarder Dili” (Samuel Berger, chef du Conseil national de sécurité à la Maison Blanche). “Le Timor oriental n'est pas le Kosovo” (James Rubin, porte parole du Département d'Etat )[5] [3899].
Ce sont des propos qui ont au moins le mérite de mettre en évidence l'hypocrisie et le double langage de Clinton quelques mois auparavant, juste à la fin de la guerre du Kosovo, quand il claironnait : “Que vous viviez en Afrique, en Europe centrale ou n'importe où ailleurs, si quelqu'un veut commettre des crimes de masse contre une population civile innocente, il doit savoir que, dans la mesure de nos possibilités, nous l'en empêcherons.”[6] [3900]
En fait, la position de “non intervention” des Etats-Unis ne s'explique pas seulement par la volonté de rabattre le caquet de l'ONU. Plus fondamentalement, outre le fait que la première puissance mondiale ne tenait pas à “heurter la sensibilité” de son fidèle allié de Djakarta (avec qui elle avait encore fait le 25 août des manœuvres conjointes autour du thème “les activités de secours et humanitaires en situation de désastre” !), il s'agissait de lui apporter son plein soutien dans l'opération de police que représentaient pour l'Etat indonésien les massacres perpétrés par les milices. En fait, pour l'armée indonésienne (qui détient l'essentiel du pouvoir), même si elle savait qu'elle ne pourrait pas garder indéfiniment le contrôle du Timor oriental (et c'est pour cela qu'elle a consenti à l'intervention des troupes mandatées par l'ONU), les massacres qu'elle a orchestrés au lendemain du référendum avaient pour objectif de donner un avertissement à tous ceux qui, dans l'immense archipel indonésien, auraient d'autres velléités indépendantistes. Les populations de Sumatra du Nord, des Célèbes ou des Moluques qui se laissent tenter par les sirènes de divers mouvements nationalistes devaient être averties. Et cet objectif de la bourgeoisie indonésienne est parfaitement partagé par les bourgeoisies des autres Etats de la région (Thaïlande, Birmanie, Malaisie) eux mêmes confrontés à des problèmes de minorités ethniques. Il est également pleinement partagé par la bourgeoisie américaine qui s'inquiète de la déstabilisation de cette région du monde qui viendrait s'ajouter à celle de toute une série d'autres régions.
Dans l'opération de “retour à l'ordre” du Timor oriental, opération qui ne pouvait pas ne pas avoir lieu, sous peine de discréditer l'idéologie “humanitaire” déversée à flots au cours des dernières années, les Etats-Unis ont délégué le travail à l'Australie, ce qui présentait pour eux l'avantage de ne pas se compromettre directement auprès de Djakarta tout en poussant en avant leur plus fidèle et solide allié dans cette région. C'est réciproquement une bonne occasion pour l'Australie de concrétiser ses projets de renforcement de ses positions impérialistes dans la région (même au prix d'une brouille temporaire avec l'Indonésie). Pour la première puissance mondiale, il est en effet fondamental de maintenir une forte présence, par alliés interposés, dans cette partie du monde car elle sait que le développement général des tensions impérialistes contenues dans la situation historique actuelle porte avec lui la menace d'une avancée de l'influence des autres deux grandes puissances qui peuvent prétendre jouer un rôle dans la région, le Japon et la Chine.
C'est le même type de préoccupations géostratégiques qui permet d'expliquer l'attitude présente des Etats-Unis et des autres puissances face à la guerre en Tchétchénie. Dans cette région, les civils sont écrasés jour après jour par les bombardements de l'aviation russe. C'est par centaines de milliers qu'on compte les réfugiés et, à l'approche de l'hiver, ce sont des dizaines de milliers de familles qui ont perdu leur maison. Face à ce nouveau “désastre humanitaire” qui dure depuis des semaines, les dirigeants occidentaux font entendre leur voix. Clinton se déclare “inquiet” de la situation en Tchétchénie et Laurent Fabius, président de l'Assemblée nationale française, affirme tout net qu'il faut s'opposer à toutes les velléités de sécession au sein de la Fédération de Russie.
Bien que les médias continuent de faire vibrer la fibre humanitaire, il existe un consensus, y compris entre des pays qui s'affrontent souvent par ailleurs (tels la France et les Etats-Unis), pour ne pas créer la moindre difficulté à la Russie et la laisser poursuivre les massacres. En fait, tous les secteurs de la bourgeoisie occidentale sont intéressés à éviter une nouvelle aggravation du chaos dans lequel s'enfonce le pays le plus étendu du monde, à cheval sur deux continents, par ailleurs encore détenteur de milliers d'armes atomiques.
Aux deux extrêmes de l'immense continent asiatique, le plus peuplé de la planète, la bourgeoisie mondiale est confrontée aux menaces croissantes de chaos. Ce continent avait déjà subi, durant l'été 1997, les attaques brutales de la crise contribuant à déstabiliser la situation politique de certains pays, comme on l'a vu particulièrement en Indonésie (qui sans faire partie de l'Asie proprement dite, est toute proche de ce continent). En même temps, les facteurs de chaos se sont accumulés, notamment avec la radicalisation de conflits traditionnels comme celui entre l'Inde et le Pakistan, au début de l'été 1999. Le risque qui pèse à terme sur l'ensemble du continent asiatique, c'est celui d'une explosion des antagonismes comme ceux qui affectent aujourd'hui le Caucase, le développement d'une situation similaire à celle du continent africain, mais avec des conséquences évidemment bien plus catastrophiques encore pour l'ensemble de la planète.
oOo
Le chaos qui s'étend de plus en plus dans le monde constitue évidemment une réelle préoccupation pour tous les secteurs de la bourgeoisie mondiale, notamment pour les dirigeants des grandes puissances. Mais cette préoccupation est impuissante. La volonté de garantir un minimum de stabilité se heurte en permanence aux intérêts contradictoires des différents secteurs nationaux de la classe dominante. Il en résulte que les pays avancés, les “grandes démocraties”, se comportent la plupart du temps en pompiers pyromanes, intervenant pour “stabiliser” une situation qu'ils ont grandement contribué à rendre chaotique (comme on l'a vu notamment dans l'ex Yougoslavie, et aujourd'hui au Timor).
Mais ce chaos qui se généralise dans l'arène impérialiste n'est lui-même qu'une expression de la décomposition générale de la société bourgeoise. Une décomposition qui résulte de l'incapacité de la part de la classe dominante de donner la moindre réponse, y compris celle qu'elle avait donnée en 1914 et en 1939, la guerre mondiale, à la crise insoluble de son économie. Une décomposition qui se manifeste par un véritable pourrissement sur pied de l'ensemble de la société. Un décomposition qui n'est pas réservée aux pays arriérés mais qui affecte aussi les grandes métropoles bourgeoises et dont le terrible accident ferroviaire du 5 octobre à Londres, capitale de la plus ancienne puissance capitaliste du monde (et non d'un quelconque pays du tiers monde), tout comme l'accident nucléaire du 30 septembre à Tokaimura au Japon, le pays de la “Qualité” et du “Zéro défaut”, constituent des manifestations au quotidien. Une décomposition qui ne pourra prendre fin qu'avec le capitalisme lui-même, lorsque le prolétariat renversera ce système qui est devenu aujourd'hui synonyme de chaos et de barbarie.
Fabienne (10/10/1999)
[1] [3901] Pour une analyse de la décomposition du capitalisme, voir notamment “La décomposition du capitalisme” (Revue internationale n° 57) et “La décomposition, phase ultime de la décadence du capitalisme” (Revue internationale n° 62)
[2] [3902] Le coup d'Etat de Suharto, en 1965, contre Soekarno jugé trop proche des pays “socialistes”, avait été réalisé grâce au soutien américain. Les autorités américaines avaient d'ailleurs particulièrement apprécié que leur aide à l'armée indonésienne l'ait “encouragé à agir contre le Parti communiste quand l'occasion s'était présentée” (suivant les termes de Mac Namara, chef du Pentagone à l'époque).
[3] [3903] Le Monde du 16 septembre.
[4] [3904] Libération du 5 septembre.
[5] [3905] Le Monde du 14 septembre.
[6] [3906] Le Monde du 16 septembre.
Géographique:
- Tchéchénie [3907]
- Asie [2836]
Crise économique : Le gouffre qui se cache derrière la "croissance ininterrompue"
- 2996 reads
Il règne en cette fin d'année 1999 une sorte d'euphorie sur la “croissance économique”. En 1998, l'effondrement des “tigres” et des“dragons” du sud-est asiatique, celui du Brésil, du Venezuela et de la Russie avaient provoqué la crainte d'une récession et même d'une “dépression”, une peur qui semblerait aujourd'hui “injustifiée” selon les dires des grands medias bourgeois. Le millénaire semble se terminer sur une note optimiste qui vient alimenter la propagande à destination des grandes masses ouvrières : l'éloge du capitalisme, “le seul système économique viable”, toujours capable de faire face à ses crises. Bref le message est en substance : “le capitalisme se porte bien”.
Alors qu'au début 1999, certaines prévisions montraient la perspective d'une “récession” dans les pays développés, les résultats d'aujourd'hui affichent des “taux de croissance” non négligeables accompagnés d'un “recul du chômage”, selon les chiffres officiels bien sûr. Nous avions nous-mêmes écrit : “La plongée dans une récession ouverte qui sera encore plus profonde que les précédentes -certains parlent même de «dépression»- est en train de faire taire les discours sur une croissance économique durable promise par les «experts».” (Revue internationale n°96), ou encore : “Bien que les pays centraux du capitalisme aient échappé à ce sort jusqu'à présent [la banqueroute en Asie du sud est], ils sont en train de faire face à leur pire récession depuis la guerre -au Japon c’est déjà commencé.” (“Résolution sur la situation internationale”, Revue internationale n°97)
- Nous étions-nous avancé de façon hasardeuse dans une prévision non vérifiée ? Qu'en est-il vraiment de la situation économique actuelle ?
C'est un nouveau tour de passe-passe, un gros mensonge qu'on nous ressert sur l'état de l'économie mondiale. Au niveau de certains chiffres officiels, on assiste effectivement à un ralentissement moins fort que prévu de l'économie mondiale, notamment aux Etats-Unis, phénomène faussement qualifié de “boom” par les plumitifs de service. Mais en effet la durée de la croissance sans récession, même très faible, depuis 7 ou 8 ans, comme cela ne s'était pas vu depuis la 2e guerre mondiale, est le signe d'une certaine “prospérité”. Cependant ces chiffres sont trompeurs.
D'abord la bourgeoisie dispose d'artifices, par ses manipulations financières et monétaires, qui permettent de masquer le ralentissement de la croissance de la production réelle. Et s'il est de bon ton de proclamer la “poursuite de la croissance ininterrompue” et de vanter la bonne santé de l'économie dans les messages qui s'adressent à la population et en particulier à la classe ouvrière, dans les cercles plus restreints de la bourgeoisie qui a besoin d'une connaissance concrète et non mystifiée de l'état de l'économie, les discours sont déjà beaucoup plus nuancés. Quelques exemples valent la peine d'être cités. “Dans les scénarios de référence plus optimistes, la croissance prévue dans le monde est réduite de 50 % par rapport à la projection d'il y a un an, mais elle se maintient à 2 % environ en 1999 comme en 1998. Dans les variantes basses, elle disparaît pratiquement. La menace d'une récession globale nous paraît donc réelle en 2000. (...) Le boom américain face à la dépression des anciens dragons : incroyable renversement ! Mais il faut être lucide : c'est le regonflement de la bulle à Wall Street qui a permis de sauver l'expansion aux Etats-Unis, et donc ailleurs dans le monde. La "bulle Greenspan", diront les historiens. Pour les uns, le président de la Réserve fédérale est un magicien. Pour d'autres -c'est notre cas (le lecteur le sait bien)-, c'est un apprenti sorcier, car la correction sera à la mesure des excès commis. Elle est en bonne place dans les scénarios «pessimistes» des experts : 13 % de baisse à Wall Street pour le FMI, -30 % selon l'OCDE... Pourquoi ? Mais parce que l'ascension de la Bourse n'est en rien justifiée par la tendance de l'économie réelle, qui est déclinante.” (L'Expansion, octobre 1999) Ou encore : “Les mesures de stimulation de la Réserve Fédérale l'automne dernier ont semblé avoir écarté une catastrophe immédiate. Certains économistes et politiciens craignent que l'allègement de la politique monétaire ait accru significativement l'énorme déséquilibre qui domine maintenant l'économie américaine. (...) Le tableau pessimiste est qu'il est trop tard pour empêcher que le déséquilibre n'aboutisse à une débâcle complète. (...) L'inflation va reprendre de façon accélérée et la Bourse va s'effondrer. Cela va provoquer un nouvelle phase d'instabilité financière globale, endommager de façon significative la demande intérieure américaine, et peut-être même précipiter la récession mondiale contre laquelle le G7 a si durement travaillé pour l'éviter il y a un an.” (Financiel Times, FT, octobre 1999)
Peut-être avons-nous suivi à tort, il y a un an, le pronostic de la “récession” de l'économie, cela n'empêche que, concernant l'aggravation considérable de la crise, nous persistons et signons. Les experts de la bourgeoisie eux-mêmes sont bien obligés de le constater à leur manière : il n'existe aucune perspective d'amélioration durable de la situation économique. Au contraire, tout concourt à d'autres secousses dont, comme toujours, le prolétariat fera les frais.
Ensuite la récession n'est qu'une manifestation particulière de la crise capitaliste, elle est loin d'être la seule. Nous avions déjà mis en évidence l'erreur de ne prendre en compte que les indicateurs de “croissance” fournis par la bourgeoisie, qui se basent sur “l'accroissement des chiffres bruts de la production sans se préoccuper de quoi est faite cette production ni qui va la payer.” (Revue internationale n°59, 4e trim. 1989) Nous signalions à l'époque tous les autres éléments significatifs qui permettent de mesurer la réelle gravité de la crise : “l'accroissement vertigineux de l'endettement des pays sous-développés (...), la progression continue des dépenses d'armement (...), l'accélération du processus de désertification industrielle (...), l'énorme aggravation du chômage (...), une nouvelle aggravation des calamités qui frappent les pays sous-développés (...)” (Ibid.) Aujourd'hui ces éléments sont non seulement toujours présents, mais ils se sont aggravés. Et les facteurs comme l'endettement (de même d'ailleurs que les “calamités” en matière de sécurité ou de santé !) touchent désormais non seulement les pays de la périphérie mais aussi ceux du coeur du capitalisme industrialisé.
Le déficit commercial des Etats-Unis estimé officiellement à 40 milliards de dollars bat tous les records. Le “déficit budgétaire atteint plus de 300 milliards de dollars cette année, 3 % du Produit Intérieur Brut” (FT, Ibid.) La consommation interne qui se développe et constitue le facteur le plus “spectaculaire” de la “croissance” n'est pas basée sur une augmentation des salaires car, malgré les beaux discours, la tendance de ces dernières années a été à une baisse des salaires[1] [3908]. Elle est surtout liée à des revenus d'actions boursières, dont la distribution s'est “démocratisée” (même si c'est surtout pour les cadres des entreprises auxquels sont distribuées des “Stock Options”). Et ces revenus ont été conséquents puisque liés aux “records” permanents de la Bourse de Wall Street. Cet accroissement de la consommation est donc particulièrement volatile car, au moindre retournement de tendance de la Bourse, ce sera une catastrophe pour nombre de travailleurs dont une bonne part des revenus ou retraites est placée sous forme d'actions. Le “taux de croissance” cache cette fragilité, tout comme il masque une nouvelle aberration historique du point de vue économique, le fait qu'aujourd'hui l'épargne est devenue négative aux Etats-Unis, c'est-à-dire que les ménages américains ont globalement plus de dettes que d'économies ! Ce que constatent les “spécialistes” : “(...) L'industrie américaine est en fait au bord de la récession. Cela est incompatible avec la hauteur des cours des actions à Wall Street, dont la valorisation est à un pic depuis 1926 ; les profits anticipés sont les plus élevés depuis la guerre. Tout cela est intenable, bien qu'essentiel au maintien de la confiance des ménages et à la diffusion de l'effet de richesse qui les incite à consommer toujours plus à crédit. Leur taux d'épargne est devenu négatif, phénomène jamais vu depuis la Grande Dépression. Comment l'atterrissage (inévitable) pourrait-il s'effectuer en douceur ?” (L'Expansion, Ibid.)
L'indicateur officiel de la manifestation ouverte de la crise, le ralentissement de la production, a une nouvelle fois été caché, la récession a été repoussée avec les mêmes palliatifs : l'endettement, la fuite en avant dans le crédit et la spéculation (les achats d'actions en l'occurrence). Pour la première fois le volume d'endettement aux Etats-Unis est supérieur à celui de l'épargne. Et un autre symbole de cette fuite en avant qui n'a plus aucun lien avec une production réelle de richesses, c'est que les plus fortes valeurs en bourse, ces derniers mois, ont été celles des sociétés qui fournissent des accès à Internet, en gros des vendeurs de vent ! La situation de l'économie mondiale est donc toujours plus fragile et porteuse de prochaines “purges” qui laisseront à nouveau sur le carreau des masses de prolétaires.
Enfin, dans la mesure où la “récession”, c'est-à-dire un “taux de croissance” négatif, constitue pour la bourgeoisie le symbole de la crise de son système, elle est un facteur de destabilisation et même parfois de panique dans les sphères capitalistes, ce qui contribue à amplifier encore le phénomène. C'est une des raisons qui explique que la bourgeoisie fait tout son possible pour éviter une telle situation.
Une autre raison, peut-être plus importante encore, est la nécessité de masquer la faillite de son système aux yeux de la classe ouvrière ; comme le disent les spécialistes, c'est “essentiel au maintien de la confiance des ménages et à la diffusion de l'effet de richesse qui les incite à consommer toujours plus à crédit.” Le “taux de croissance” qui s'effondre et c'est toute la propagande sur la validité du système capitaliste qui en est affectée; c'est aussi un encouragement à la lutte de classe et surtout à la réflexion, donc à la remise en question du système. C'est ce que la bourgeoisie craint par dessus tout.
D'ailleurs, pour les prolétaires jetés définitivement sur le pavé par millions, dans les pays dits “émergents” (comme ceux d'Asie du sud-est qui ne se remettront jamais de l'accélération de la crise de 1997-98) ou pour les immenses masses paupérisées des pays dits “en développement” de la périphérie du capitalisme (sur le continent africain, en Asie, en Amérique latine) mais également pour les laissés pour compte de la “croissance” de plus en plus nombreux dans les pays industrialisés, il n'est pas besoin de grandes démonstrations théoriques. Ils subissent déjà dans leurs conditions de vie au jour le jour la faillite d'un système de plus en plus incapable de leur fournir les moyens élémentaires de subsistance.
Certains y voient une sorte de fatalité “naturelle”, une loi selon laquelle seuls les forts sont appelés à survivre et à s'en sortir, la misère et en fin de compte la mort pour les “faibles” n'étant que la conséquence “normale” de cette “loi”. Evidemment, il n'en est rien. Aujourd'hui, et depuis les débuts du 20e siècle, le système capitaliste étouffe d'une crise de surproduction. La société dispose aujourd'hui potentiellement, et ce depuis le début du 20e siècle, de tous les moyens industriels et techniques pour faire vivre largement toute l'humanité. Ce qui plonge dans le chômage et la dégradation de leurs conditions de vie des millions de travailleurs des pays industrialisés, dans la misère et la barbarie par la multiplication de guerres “locales” des dizaines de millions d'êtres humains dans les pays de la périphérie du capitalisme, c'est la survivance de ce système capitaliste fondé sur la loi de l'accumulation du capital et du profit.
Le développement du capitalisme, même s'il se faisait déjà “dans la boue et le sang”, correspondait encore jusqu'au 19e siècle, en termes globaux, à une accroissement de la satisfaction des besoins humains. Entré, avec la 1re guerre mondiale, dans sa phase de décadence et de déclin historique, il a depuis entraîné le monde dans une spirale de crise-guerre-reconstruction, nouvelle crise plus profonde-nouvelle guerre plus meurtière, à nouveau crise économique ; cette dernière manifestation de la crise dure maintenant depuis plus de 30 ans[2] [3909] et la menace de la destruction généralisée de la planète est bien réelle, même si elle ne revêt plus la forme du risque d'une 3e conflagration mondiale depuis la disparition des deux grands blocs impérialistes il y a près d'une décennie.
Ce déclin irréversible du système capitaliste ne signifie pas pour autant que la classe dominante aux commandes va se déclarer en faillite et mettre la clé sous la porte comme cela peut se passer au niveau d'une simple entreprise capitaliste. Toute l'histoire du 20e siècle l'a montré, en particulier à travers l'“issue” donnée par le capitalisme mondial à la grande crise de 1929 il y a 70 ans : la guerre mondiale. Les capitalistes sont prêts à s'entretuer et à entraîner toute l'humanité dans la destruction à travers leur lutte sans merci pour le partage du “gâteau” du marché mondial. Et depuis trente ans de crise économique ouverte, s'ils n'ont pas pu entraîner les grandes masses du prolétariat dans la guerre, ils n'ont pas cessé de tricher avec les lois mêmes du développement capitaliste pour le maintenir en survie et n'ont pas cessé de faire payer aux travailleurs, actifs et chômeurs le prix de l'agonie de leur système économique moribond.
Contre les attaques toujours plus fortes contre les conditions d'existence, comprendre la crise économique, son caractère irréversible, sa dynamique dans le sens d'une aggravation constante, est un facteur essentiel de la prise de conscience de l'impérieuse nécessité de la lutte de classe, non seulement pour se défendre contre le capitalisme mais aussi pour ouvrir la seule véritable perspective qui reste à l'humanité : celle de la révolution communiste, la vraie ! Pas le visage hideux du capitalisme d'Etat stalinien que la bourgeoisie a travesti en communisme.
MG.
Récent et en cours:
- Crise économique [28]
13e Congrès du CCI : RAPPORT SUR LA LUTTE DE CLASSE
- 2509 reads
Introduction
Ce rapport a avant tout pour but de combattre les campagnes idéologiques de la bourgeoisie sur “la fin de la lutte des classes” et “la disparition de la classe ouvrière”, et de défendre que, malgré ses difficultés actuelles, le prolétariat n'a pas perdu son potentiel révolutionnaire. Dans les premières parties de ce rapport, non publiées ici pour des raisons de place, nous avons montré que le rejet par la bourgeoisie de ce potentiel se fonde sur une conception purement immédiatiste qui prend l'état de la lutte de classe à n'importe quel moment pour la vérité essentielle du prolétariat à tout moment. A cette démarche superficielle et empirique, nous opposons la méthode marxiste qui défend que “le prolétariat ne peut exister qu'en tant que force historique et mondiale, de même que le communisme, action du prolétariat, n'est concevable qu'en tant que réalité historique et mondiale.” (Marx, L'idéologie allemande) Ce rapport sur la lutte de classe se situe donc dans le contexte du mouvement historique de la classe, depuis sa première tentative (épique) pour renverser le capitalisme en 1917-23, puis durant les décennies de contre-révolution qui ont suivi. Nous ne publions ici que la partie du rapport qui se centre plus particulièrement sur l'évolution du mouvement depuis la reprise des combats de classe à la fin des années 1960. Certains passages traitant de situations récentes et à court terme ont aussi été coupés ou résumés.
1968-89 : Le réveil du prolétariat
(...) Et c’est là que réside toute la signification des événements de mai-juin 1968 en France : l’émergence d’une nouvelle génération d’ouvriers qui n'avait pas été écrasée ni démoralisée par les misères et les défaites des décennies précédentes, qui avait été habituée à un niveau de vie relativement élevé pendant les années du “boom” d’après la guerre et qui n’était pas prête à se soumettre aux exigences d’une économie nationale une nouvelle fois entraînée dans la crise. La grande grève générale de 10 millions d’ouvriers en France -allant de pair avec une énorme fermentation politique au sein de laquelle la notion de révolution, de transformation du monde, devenait à nouveau un sujet de discussion sérieux- a marqué la nouvelle entrée de la classe ouvrière sur la scène de l’histoire, la fin du cauchemar de la contre-révolution qui lui avait coupé le souffle depuis si longtemps. L’importance du “mai rampant” en Italie et de “l’automne chaud” l’année suivante réside dans le fait que ces événements ont apporté une preuve formelle de cette interprétation, principalement contre tous ceux qui tentaient de ne voir en mai-68 rien de plus qu’une révolte étudiante. L’explosion de la lutte au sein du prolétariat italien, qui est le plus avancé politiquement au monde, avec sa puissante dynamique antisyndicale, a clairement montré que mai 1968 n’était pas un éclair dans un ciel d'azur mais constituait bien l’ouverture de toute une période de luttes de classe se développant à une échelle internationale. Les mouvements massifs ultérieurs (Argentine 1969, Pologne 1970, Espagne et Angleterre 1972, etc.) en apportèrent une confirmation supplémentaire.
Les organisations révolutionnaires existantes n'ont pas toutes été capables de le voir : les plus anciennes, particulièrement dans le courant bordiguiste, atteintes d'une myopie croissante au cours des années, ont été incapables de voir le profond changement qui s’opérait dans le rapport de force global entre les classes ; mais celles qui sont parvenues à la fois à saisir la dynamique de ce nouveau mouvement et à réassimiler la “vieille” méthode de la gauche italienne qui constitua un pôle essentiel de clarté dans la pénombre de la contre-révolution, ont déclaré l’ouverture d’un nouveau cours historique, fondamentalement différent de celui qui avait prévalu à l'apogée de la contre-révolution, dominé par le cours vers la guerre. La réouverture de la crise économique mondiale allait certainement amener à une exacerbation des antagonismes impérialistes qui, s'ils suivaient leur dynamique propre, entraîneraient l’humanité vers une troisième et très probablement dernière guerre mondiale. Mais, parce que le prolétariat avait commencé à répondre à la crise sur son propre terrain de classe il agissait comme un obstacle fondamental à cette dynamique. Plus encore, en développant ses luttes de résistance, il se montrait capable de mettre en oeuvre sa propre dynamique vers un deuxième assaut révolutionnaire et mondial contre le système capitaliste.
La nature ouverte et massive de cette première vague de luttes, et le fait qu’elle avait à nouveau permis de faire parler de la révolution, a entraîné que beaucoup des éléments les plus impatients surgis avec ce mouvement ont fini par “prendre leurs désirs pour des réalités” et par penser que le monde était au bord d’une crise révolutionnaire dès le début des années 1970. Cette forme d’immédiatisme était fondée sur une incapacité à comprendre :
- que la crise économique qui avait donné l'impulsion à la lutte n'en était qu'à sa phase initiale et que, contrairement aux années 30, cette crise s'imposait à une bourgeoisie armée des leçons de l'expérience et détenant des instruments qui la rendaient capable de “gérer” la descente dans l'abîme, c'est-à-dire le capitalisme d'Etat, l'utilisation d'organes constitués au niveau du bloc, la capacité à contenir les effets les plus néfastes de cette crise par le recours au crédit et à repousser son impact vers la périphérie du système ;
- que les effets politiques de la contre-révolution avaient toujours un poids considérable sur la classe ouvrière, à travers la rupture quasi totale de la continuité avec les organisations politiques du passé, le faible niveau de culture politique dans le prolétariat dans son ensemble et sa méfiance invétérée pour “la politique” résultant de son expérience traumatisante du stalinisme et de la social-démocratie.
Ces facteurs apportaient la certitude que la période de lutte prolétarienne ouverte en 1968 ne peut être que longue. Contrastant avec la première vague révolutionnaire, qui était née en réponse à une guerre et s'était donc rapidement portée sur le plan politique -trop rapidement en quelque sorte, comme Luxemburg le nota par rapport à la révolution de novembre en Allemagne 1918-, les batailles révolutionnaires du futur ne peuvent être préparées que par toute une série de combats de défense économique qui -et c’est de toutes façons une caractéristique fondamentale de la lutte de classe en général- sont forcés de suivre un processus, difficile et inégal, fait d’avancées et de reculs.
La réponse de la bourgeoisie française à Mai 68 a donné le ton à la contre-offensive de la bourgeoisie mondiale : le piège électoral a été utilisé pour disperser la lutte de classe (après que les syndicats aient réussi à l'enfermer) ; on a agité au nez des ouvriers la promesse d’un gouvernement de gauche et l'aveuglante illusion que celui-ci résoudra tous les problèmes ayant motivé la vague de lutte et qu'il instituera un nouveau règne de prospérité et de justice, voire un petit peu de “contrôle ouvrier”. Les années 1970 pouvaient donc être caractérisées comme “années d'illusion” dans le sens où la bourgeoisie, confrontée à un développement relativement limité de la crise économique, était bien mieux placée pour vendre ces illusions à la classe ouvrière. Cette contre-offensive de la bourgeoisie a brisé l’élan de la première vague internationale de luttes.
L’incapacité de la bourgeoisie à tenir dans les faits la moindre de ses promesses signifiait que le resurgissement des luttes n’était qu’une question de temps. Les années 1978-80 ont connu une explosion d’importants mouvements de classe : Longwy-Denain en France, avec des efforts d’extension au delà du secteur de la sidérurgie et la confrontation à l’autorité syndicale ; la grève des dockers de Rotterdam, où a surgi un comité de grève autonome ; en Grande-Bretagne, “l’hiver du mécontentement” qui a vu une explosion simultanée de luttes dans de nombreux secteurs et la grève dans la sidérurgie en 1980 ; enfin, la Pologne 1980, point culminant de cette vague et en quelque sorte de toute la période de reprise.
A la fin de cette turbulente décennie, le CCI avait déjà annoncé que les années 1980 seraient des “années de vérité”. Par là nous n’entendions pas, comme c’est souvent mal interprété, que ce serait la décennie de la révolution mais une décennie au cours de laquelle les illusions des années 1970 seraient balayées par l’accélération brutale de la crise et par les attaques drastiques contre les conditions de vie de la classe ouvrière qui en résulteraient ; une décennie au cours de laquelle la bourgeoisie elle-même parlerait le langage de la vérité, celui qui promet “du sang, de la sueur et des larmes” ou comme celui de Thatcher affirmant avec arrogance : “Il n’y a pas d’alternative”. Ce changement de langage correspondait aussi à un changement dans la ligne politique de la classe dominante, avec la mise en place d'une droite dure au pouvoir menant les attaques nécessaires et une gauche faussement radicalisée dans l’opposition, chargée de saboter de l’intérieur et dévoyer la riposte des ouvriers. Enfin, les années 1980 seraient les années de vérité parce que l’alternative historique qui se posait à l’humanité -guerre mondiale ou révolution mondiale- non seulement deviendrait plus claire mais serait en un sens décidée par les événements de la décennie qui s'ouvrait. Et, effectivement, les événements inaugurant la décennie l'ont montré concrètement : d’un côté l’invasion russe en Afghanistan mettait cruellement en lumière la “réponse” de la bourgeoisie à la crise et ouvrait une période de tensions particulièrement aiguës entre les blocs (illustrée par les avertissements de Reagan contre l’Empire du Mal et par les budgets militaires gigantesques alloués à des programmes tel que le projet “Guerre des étoiles”), d'un autre côté la grève de masse en Pologne faisait clairement entrevoir la réponse prolétarienne.
Le CCI a toujours reconnu l’importance cruciale de ce mouvement : “En effet, cette lutte a donné une réponse à toute une série de questions que les luttes précédentes avaient posée sans pouvoir y répondre ou le faire clairement :
- La nécessité de l'extension de la lutte (grève des dockers de Rotterdam) ;
- La nécessité de son auto-organisation (sidérurgie en Grande-Bretagne) ;
- L’attitude face à la répression (lutte des sidérurgistes de Longwy/Denain).
Sur tous ces points, les combats de Pologne représentent un grand pas en avant de la lutte mondiale du prolétariat et c’est pour cela que ces combats sont les plus importants depuis plus d'un demi-siècle.” (Résolution sur la lutte de classe, 4e Congrès du CCI, 1981, publiée dans le Revue internationale n°26)
En somme, le mouvement polonais a montré comment le prolétariat pouvait se poser en force sociale unifiée capable non seulement de résister aux attaques du capital mais aussi de dresser la perspective du pouvoir ouvrier, un danger bien identifié par la bourgeoisie qui mit de côté ses rivalités impérialistes pour étouffer le mouvement, en particulier par la mise en place du syndicat Solidarnosc.
Ayant répondu à la question comment étendre et organiser la lutte dans le but de l’unifier, la grève de masse polonaise a posé une autre question : celle de la généralisation de la grève de masse au delà des frontières nationales comme condition préalable au développement d’une situation révolutionnaire. Mais comme notre résolution l’a dit à l'époque, cela ne pouvait être une perspective immédiate. La question de la généralisation avait été posée en Pologne mais c’était au prolétariat mondial, et particulièrement au prolétariat de l’Europe de l’ouest, qu'il revenait d’y répondre. En essayant de garder l’esprit clair sur la signification des événements en Pologne, nous devions combattre deux types de déviation : d’un côté, une sous-estimation sérieuse de l’importance de la lutte (par exemple, au sein de la section du CCI en Grande Bretagne, chez les partisans des comités de lutte syndicaux dans la grève de la sidérurgie britannique, qui considéraient le mouvement en Pologne comme moins important que ce qui s’était passé en Angleterre) et d’un autre côté, un dangereux immédiatisme qui exagérait le potentiel révolutionnaire à court terme de ce mouvement. Afin de combattre ces erreurs symétriques, nous avons été amenés à développer la critique de “la théorie du maillon faible” (mise en avant par Lénine, entre autres, reprise notamment par les groupes bordiguistes, et exploitée au profit de la bourgeoisie par les tiers-mondistes de tous bords).
L’élément central de cette critique est une reconnaissance du fait que la percée révolutionnaire requiert un prolétariat concentré et surtout politiquement expérimenté ou “cultivé”. Le prolétariat des pays de l’Est a un passé révolutionnaire glorieux mais qui a été complètement effacé par les horreurs du stalinisme, ce qui explique l’énorme fossé entre le niveau d’auto-organisation et d’extension du mouvement en Pologne et sa conscience politique (la prédominance de la religion et surtout de l’idéologie démocratique et syndicale). Le niveau politique du prolétariat en Europe de l’Ouest, qui a fait pendant des décennies l'expérience des “délices” de la démocratie, est considérablement plus élevé (un fait illustré entre autre, par la présence en Europe de la majorité des organisations révolutionnaires internationales). C’est en Europe de l’Ouest, d’abord et avant tout, que nous devons chercher la maturation des conditions pour le prochain mouvement révolutionnaire de la classe ouvrière.
De même, la profonde contre-révolution qui a déferlé sur la classe ouvrière dans les années 1920 a désarmé le prolétariat dans son ensemble. On pourrait dire que le prolétariat d’aujourd’hui a un avantage sur la génération révolutionnaire de 1917 : aujourd’hui il n’y a pas de grandes organisations prolétariennes qui viennent juste de passer dans le camp de la classe dominante et qui soient de ce fait capables de continuer à susciter une forte loyauté de la part d'une classe qui n'a pas eu le temps d’assimiler les conséquences historiques de leur trahison. Cela avait constitué, avec la social-démocratie, une raison majeure de l’échec de la révolution allemande en 1918-19. Mais cette situation comporte une autre facette. La destruction systématique des traditions révolutionnaires du prolétariat, la méfiance qu'en a tiré le prolétariat envers toute organisation politique, son amnésie croissante envers sa propre histoire (un facteur qui s’est accéléré considérablement au cours de la dernière décennie en gros) constituent une grave faiblesse pour la classe ouvrière de toute la planète.
A tous points de vue, le prolétariat d’Europe de l’Ouest n’était pas prêt à relever le défi posé par la grève de masse en Pologne. La seconde vague de luttes avait été émoussée par la nouvelle stratégie de la bourgeoisie consistant à placer la gauche dans l’opposition; quant aux ouvriers polonais, ils se sont retrouvés isolés au moment même où ils avaient le plus besoin que la lutte éclate ailleurs. Cet isolement (imposé sciemment par la bourgeoisie mondiale) a ouvert les portes aux chars de Jaruzelski. La répression de 1981 en Pologne marqua la fin de la seconde vague de luttes.
Les événements historiques de cette ampleur ont des conséquences à long terme. La grève de masse en Pologne a apporté la preuve définitive que la lutte de classe est la seule force qui peut contraindre la bourgeoisie à mettre de côté ses rivalités impérialistes. En particulier, elle a montré que le bloc russe -historiquement condamné, par sa position de faiblesse, à être “l’agresseur” dans toute guerre- était incapable de répondre à la crise économique croissante par une politique d’expansion militaire. Il était clair que les ouvriers du bloc de l’Est (et, très probablement, de la Russie elle-même) ne pouvaient absolument pas être enrôlés comme chair à canon dans une quelconque guerre future pour la gloire du “socialisme”. Ainsi la grève de masse en Pologne a été un facteur important dans l’implosion ultérieure du bloc impérialiste russe.
Bien qu’incapable de poser la question de la généralisation, la classe ouvrière occidentale n'a pas battu en retraite longtemps. Avec une première série de grèves dans le secteur public en Belgique en 1983, elle s'est lancée dans une “troisième vague” de lutte très longue qui, bien que ne démarrant pas au niveau de la grève de masse, contenait une dynamique globale vers celle-ci.
Dans notre résolution de 1980 citée plus haut, nous comparions la situation actuelle de la classe à celle de 1917. Les conditions de la guerre mondiale faisaient que toute résistance de la classe était immédiatement amenée à se confronter directement et pleinement à l’Etat et de ce fait à poser la question de la révolution. En même temps, les conditions de la guerre contenaient de nombreux inconvénients (la capacité de la bourgeoisie à semer des divisions entre les ouvriers des pays “vainqueurs” et des pays “vaincus” ; à couper l’herbe sous les pieds de la révolution en arrêtant la guerre, etc.). Par contre, une crise économique longue et mondiale non seulement tend à uniformiser les conditions de l'ensemble de la classe mais donne aussi au prolétariat plus de temps pour développer ses forces, pour développer sa conscience de classe à travers toute une série de luttes partielles contre les attaques du capitalisme. La vague internationale des années 1980 avait clairement cette caractéristique ; si aucune des luttes n’a eu le caractère spectaculaire de 1968 en France ou 1980 en Pologne, elles ont néanmoins combiné leurs efforts pour apporter d’importantes clarifications sur le pourquoi et le comment lutter. Par exemple, l’appel très répandu à la solidarité au delà des limites sectorielles en Belgique en 1983 et en 1986, ou au Danemark en 1985, a montré concrètement comment le problème de l’extension pouvait être résolu ; les efforts des ouvriers pour prendre le contrôle de la lutte (les assemblées des cheminots en France en 1986, les assemblées des travailleurs de l’enseignement en Italie en 1987) ont montré comment s’organiser en dehors des syndicats. Il y a eu aussi des tentatives maladroites pour tirer des leçons des défaites comme en Grande-Bretagne par exemple, à la suite de la défaite des longues luttes combatives mais épuisantes et isolées qu'ont menées les mineurs et les imprimeurs au milieu des années 1980 ; des luttes de la fin de la décennie ont montré que les ouvriers ne voulaient pas être entraînés dans les mêmes pièges (les ouvriers de British Telecom qui se sont mis en grève et sont ensuite rapidement retournés au travail avant d'avoir été paralysés ; les luttes simultanées dans de nombreux secteurs pendant l’été 1988). En même temps l’apparition de comités de lutte ouvriers dans divers pays a apporté des réponses à la question de savoir comment les ouvriers les plus combatifs peuvent agir vis-à-vis de la lutte dans son ensemble. Tous ces ruisseaux, apparemment sans liens les uns avec les autres, avaient un point de convergence qui, s'il avait été atteint, aurait représenté un approfondissement qualitatif de la lutte de classe internationale.
Cependant, à un certain niveau, le facteur temps a commencé à moins jouer en faveur du prolétariat. Confrontée à l’approfondissement de la crise de tout un mode de production, d’une forme historique de civilisation, la lutte de classe, bien que continuant à avancer, n'a pas réussi à tenir le rythme de l’accélération générale de la situation, ne parvenant pas au niveau requis pour que le prolétariat s'affirme en tant que force révolutionnaire positive. Cependant cette lutte de la classe n'en continuait pas moins à bloquer la marche vers la guerre mondiale. Ainsi, pour la grande majorité de l’humanité et pour celle du prolétariat lui-même, la réalité de la troisième vague est restée plus ou moins dissimulée, certes du fait du black-out de la bourgeoisie, mais aussi par sa progression lente et non spectaculaire. La troisième vague était même “cachée” pour la majorité des organisations politiques du prolétariat qui tendaient à ne voir que ses expressions les plus ouvertes; et de plus, à ne les voir que comme des phénomènes séparés, sans connexions
Cette situation, dans laquelle, malgré une crise sans cesse plus profonde, la classe dominante n’était pas non plus capable d’imposer sa “solution”, a donné naissance au phénomène de décomposition, qui est devenu de plus en plus identifiable, au cours des années 1980, à plusieurs niveaux en lien les uns avec les autres : au niveau social (atomisation croissante, gangstérisme, consommation de drogues, etc.), idéologique (développement d’idéologies irrationnelles et fondamentalistes), écologique, etc. Etant le produit d'un blocage de la situation, un blocage qui est dû au fait qu'aucune des deux classes fondamentales de la société n'est arrivée à imposer sa “solution”, la décomposition agit à son tour pour miner la capacité du prolétariat à se forger lui-même en une force unifiée ; à la fin de la décennie, la décomposition a de plus en plus pris le devant de la scène, culminant dans les gigantesques événements de 1989 qui ont marqué l’ouverture définitive d’une nouvelle phase dans la longue chute du capitalisme en faillite, une phase durant laquelle tout l’édifice social a commencé à craquer, trembler et s’écrouler.
1989-99 : la lutte de classe face à la décomposition de la société bourgeoise
L’effondrement du bloc de l’Est s'est donc imposé à un prolétariat qui, quoique toujours combatif et développant lentement sa conscience de classe, n’avait pas encore atteint le niveau pour être capable de réagir sur son propre terrain de classe à un événement historique d'une telle importance.
L'effondrement du stalinisme et l'énorme campagne idéologique mensongère sur la “mort du communisme” que la bourgeoisie a développé à cette occasion ont donné un coup d'arrêt à la troisième vague et (sauf pour une très faible minorité politisée de la classe ouvrière) a eu un impact profondément négatif sur l’élément clé que représente la conscience de classe, en particulier au niveau de sa capacité à développer une perspective, à mettre en avant un but global à la lutte ce qui est plus vital que jamais à une époque où il peut de moins en moins y avoir de séparation entre les luttes défensives et le combat offensif et révolutionnaire du prolétariat.
L’effondrement du bloc de l’Est a porté un coup à la classe de deux façons :
- il a permis à la bourgeoisie de développer toute une série de campagnes autour du thème de la “mort du communisme” et de la “fin de la lutte de classe” qui a profondément affecté la capacité de la classe à placer ses luttes dans la perspective de la construction d'une nouvelle société, à se présenter en force autonome et antagonique au capital, ayant ses propres intérêts à défendre. La classe ouvrière, qui n'a absolument joué aucun rôle spécifique dans les événements de 1989-91, était atteinte profondément au niveau de la confiance en soi. Sa combativité et sa conscience ont toutes les deux subi un recul considérable, certainement le plus profond recul depuis la reprise de 68. Les syndicats ont tiré le plus grand profit de cette perte de confiance en faisant un retour triomphal comme “seul et véritable moyen qu'ont les ouvriers” pour se défendre ;
- Dans le même temps, l’effondrement du bloc de l’Est a ouvert les vannes à toutes les forces de la décomposition qui étaient déjà à son origine, soumettant de plus en plus la classe à l’atmosphère putride du “chacun pour soi”, aux influences néfastes du gangstérisme, du fondamentalisme, etc. En outre, la bourgeoisie, tout en étant autant sinon plus affectée par la décomposition de son système, se montrait capable de retourner les manifestations de celle-ci contre la classe. Un exemple typique de cette façon d'agir de la classe dominante a été l’affaire Dutroux en Belgique où les pratiques sordides de cliques bourgeoises furent utilisées comme prétexte pour entraîner la classe ouvrière dans une vaste campagne démocratique pour un “gouvernement propre”. En fait, l’utilisation de la mystification démocratique est devenue de plus en plus systématique parce qu'elle est à la fois la “conclusionlogique à tirer de l’échec du communisme” (selon la bourgeoisie) et qu'elle constitue l’instrument idéal aujourd'hui pour accroître l'atomisation de la classe et l’enchaîner pieds et poings liés à l’Etat capitaliste. Les guerres provoquées par la décomposition - le massacre du Golfe en 1991, l'ex-Yougoslavie, etc. - ont certes permis à une minorité de voir plus clairement la nature militariste et barbare du capitalisme mais ont eu aussi pour effet plus général d’augmenter le sentiment d’impuissance dans le prolétariat, le sentiment de vivre dans un monde cruel et irrationnel dans lequel il n’y a d’autre solution que de se cacher la tête dans le sable.
La situation des chômeurs a mis clairement en lumière les problèmes qui se posaient maintenant à la classe. A la fin des années 1970 et au début des années 1980, le CCI avait considéré les chômeurs comme une source potentielle de radicalisation pour l’ensemble du mouvement, ayant un rôle comparable à celui joué par les soldats durant la première vague révolutionnaire. Mais sous le poids de la décomposition, il s'est avéré qu'il était de plus en plus difficile pour les chômeurs de développer leurs propres formes collectives de lutte et d’organisation, étant eux-mêmes particulièrement vulnérables aux effets les plus destructeurs de celle-ci (atomisation, délinquance, etc.). Cela est vrai surtout pour les chômeurs de la jeune génération qui n’ont jamais fait l’expérience de la discipline collective et de la solidarité du travail. En même temps, ce poids négatif n’a pas été allégé par la tendance du capital à “désindustrialiser” ses secteurs “traditionnels” - les mines, les chantiers navals, la sidérurgie, etc. - où les ouvriers ont une longue expérience de la solidarité de classe. Au lieu d’être en mesure d’apporter leur force collective à leur classe, ces prolétaires ont eu tendance à se noyer dans une masse inerte. Les dégâts dans ce secteur ont eu bien sûr des effets sur la lutte des ouvriers ayant un emploi, dans le sens où cela a participé à la perte de sources importantes d'identité et d'expérience de classe.
Les dangers contenus dans la nouvelle période pour la classe ouvrière et l'avenir des ses luttes ne peuvent être sous-estimés. Si le combat de la classe ouvrière a clairement barré la voie à la guerre mondiale dans les années 1970 et 1980, il ne peut stopper ni ralentir le processus de décomposition. Pour engager une guerre mondiale, la bourgeoisie aurait dû infliger une série de défaites majeures aux bataillons centraux de la classe ouvrière. Aujourd’hui, le prolétariat est confronté à une menace à plus long terme mais non moins dangereuse d’une “mort à petit feu” où la classe ouvrière est toujours plus écrasée par ce processus de décomposition jusqu’à perdre sa capacité à s’affirmer en tant que classe, tandis que le capitalisme s’enfonce de catastrophe en catastrophe (guerres locales, catastrophes écologiques, famine, maladie, etc.). Cela peut aller jusqu’à ce que les prémisses même d’une société communiste aient été détruites pour des générations, sans parler de possibilité même de la destruction totale de l’humanité.
Pour nous, cependant, malgré les problèmes posés par la décomposition, malgré le reflux de la lutte de classe que nous avons vécu ces dernières années, la capacité du prolétariat à lutter, à réagir au déclin du système capitaliste, n’a pas disparu et le cours vers des affrontements massifs de classe reste ouvert. Pour montrer cela, il est nécessaire d’examiner à nouveau la dynamique générale de la lutte de classe depuis le début de la phase de décomposition.
L’évolution de la lutte depuis 1989
Comme le CCI l’avait prévu à l'époque, au cours des deux ou trois années qui ont suivi l’effondrement du bloc de l’Est, le recul de la classe ouvrière a été très marqué, à la fois au niveau de sa conscience et de sa combativité. La classe ouvrière subissait pleinement la campagne sur la mort du “communisme”.
Au cours de l’année 1992, les effets de cette campagne ont commencé sinon à s’effacer tout au moins à diminuer et on a pu discerner les premiers signes d’un renouveau de la combativité, en particulier à travers les mobilisations des ouvriers italiens contre les mesures d’austérité du gouvernement D'Amato en septembre 1992. Ces mobilisations ont été suivies en octobre par les manifestations des mineurs contre la fermeture de mines en Angleterre. La fin de 1993 a vu de nouveaux mouvements en Italie, en Belgique, en Espagne et surtout en Allemagne avec des grèves et des manifestations dans de nombreux secteurs, notamment dans le bâtiment et l’automobile. Le CCI, dans un éditorial opportunément intitulé “La difficile reprise de la lutte de classe” (Revue internationale n°76), déclarait que “le calme social qui régnait depuis près de quatre ans est définitivement rompu”. Tout en saluant cette reprise de la combativité dans la classe, le CCI soulignait les difficultés et obstacles importants auxquels elle devait faire face : la force retrouvée des syndicats ; la capacité de la bourgeoisie à manoeuvrer contre elle, en particulier sa capacité à choisir le moment et les thèmes sur lesquels les mouvements les plus importants éclateraient ; la capacité de la classe dominante à utiliser pleinement le phénomène de décomposition pour renforcer l’atomisation de la classe (à ce moment là, il y avait une grande utilisation des scandales dont un exemple fut la campagne “mains propres” en Italie).
En décembre 1995, le CCI (et le milieu révolutionnaire en général) a subi une épreuve importante. Dans le sillage d'un conflit dans les chemins de fer et suite à une attaque très provocatrice contre la protection sociale de tous les ouvriers, tout se passait comme si la France était au bord d'un mouvement de classe majeur, avec des grèves et des assemblées générales dans de nombreux secteurs, avec des mots-d'ordre avancés par les syndicats et scandés par les ouvriers qui soulignaient que la seule façon d’avoir gain de cause sur ses revendications était de “lutter tous ensemble”. Un certain nombre de groupes révolutionnaires, d'habitude sceptiques sur la lutte de classe en général, se sont particulièrement enthousiasmés pour ce mouvement. Par contre, le CCI a mis en garde les ouvriers sur le fait que ce “mouvement” était avant tout le produit d’une gigantesque manoeuvre de la classe dominante, consciente du mécontentement grandissant au sein de la classe qui cherchait à déclencher préventivement l’explosion avant que la colère latente puisse s’exprimer dans une vraie lutte, avant qu'elle ne se transforme en une vraie volonté d’en découdre. En particulier, en présentant les syndicats comme les champions de la lutte, comme les meilleurs défenseurs des méthodes ouvrières de lutte (assemblées, délégations massives vers les autres secteurs, etc.), la bourgeoisie cherchait à renforcer la crédibilité de son appareil syndical, en préparation de confrontations futures plus importantes. Bien que le CCI ait été beaucoup critiqué pour sa vision “conspiratrice” de la lutte de classe, cette analyse a été confirmée dans la période qui suivit. Les bourgeoisies allemande et belge, par leurs syndicats, ont en effet déclenché des sortes de copies conformes du “mouvement français”, tandis qu’en Grande-Bretagne (la campagne sur les dockers de Liverpool) et aux Etats-Unis (la grève à UPS), plusieurs tentatives de renforcement de l’image des syndicats avaient lieu.
L’ampleur de ces manoeuvres n'a pas remis en question la réalité sous-jacente de la reprise de la lutte de classe. En fait, on pourrait dire que ces manoeuvres, du fait que la bourgeoisie a habituellement un temps d'avance sur les ouvriers, provoquant des mouvements dans des conditions défavorables et souvent sur des revendications fausses, constituent une mesure du danger que la classe ouvrière représente.
La grande grève au Danemark au début de l'été 1998 a apporté la confirmation la plus importante de nos analyses. A première vue, ce mouvement comportait beaucoup de ressemblances avec les événements de décembre 1995 en France. Mais, comme nous l’avons écrit dans l’éditorial de notre Revue Internationale n°94, ce n’était pas le cas : “Malgré l’échec de la grève et les manoeuvres de la bourgeoisie, ce mouvement n’a pas exactement la même signification que celui de décembre 1995 en France. En particulier, alors que la reprise du travail s’était faite en France dans une certaine euphorie, avec un sentiment de victoire qui ne laissait pas de place à une remise en cause du syndicalisme, la fin de la grève danoise s’est faite avec un sentiment d’échec et peu d’illusion sur les syndicats. Cette fois, l’objectif de la bourgeoisie n’était pas de lancer une vaste opération de crédibilisation des syndicats au niveau international comme en 1995, mais de "mouiller la poudre", d’anticiper sur un mécontentement et une combativité croissante qui s’affirment petit à petit tant au Danemark que dans les autres pays d’Europe et ailleurs.”
L’éditorial montre aussi d’autres aspects importants de la grève : sa massivité (un quart du prolétariat en grève pendant deux semaines) qui témoignait véritablement du niveau grandissant de colère et de combativité dans la classe, et l’utilisation intensive du syndicalisme de base pour absorber la combativité et le mécontentement ouvriers envers les syndicats officiels.
Par dessus tout, c’est le contexte international qui avait changé : une atmosphère de combativité montante qui s’exprimait dans de nombreux pays et qui s'est poursuivie :
- aux Etats-Unis, pendant l’été 1998, avec la grèves de presque 10 000 ouvriers à la General Motors, celle de 70 000 ouvriers de la compagnie de téléphone Bell Atlantic, celle des ouvriers du secteur de la santé à New York, sans parler des violents affrontements avec la police pendant une manifestation massive de 40 000 ouvriers du bâtiment à New York ;
- en Grande-Bretagne, avec les grèves non officielles des ouvriers de la santé en Ecosse, des postiers à Londres, ainsi que les deux grèves des électriciens dans la capitale qui ont montré une claire volonté de se battre malgré l’opposition de la direction syndicale ;
- en Grèce, pendant l’été, où des grèves dans le secteur de l'enseignement sont allées jusqu’à l’affrontement avec la police ;
- en Norvège où une grève comparable en ampleur à celle du Danemark a eu lieu durant automne ;
- en France où toute une série de luttes dans différents secteurs se sont déroulées, dans l'enseignement, dans la santé, à la Poste et dans les transports, notamment la grève des chauffeurs de bus de Paris à l'automne où les ouvriers ont répondu sur leur terrain de classe à une des conséquence de la décomposition - le nombre croissant d’agressions qu'ils subissent - en revendiquant des emplois supplémentaires plutôt que la présence dans les bus de policiers ;
- en Belgique où une lente mais claire montée de la combativité, illustrée par les grèves dans l’industrie automobile, les transports, les communications, a été contrée par une gigantesque campagne autour du thème du “syndicalisme de combat”. Cela a pris une forme résolument explicite avec la promotion d’un “mouvement pour le renouveau syndical” qui utilise un langage très radical et “unitaire” et dont le leader, D'Orazio, s'est vu paré d’une auréole de radicalisme en étant poursuivi en justice pour “violence” ;
- dans le tiers-monde, avec des grèves en Corée, des rumeurs sur un mécontentement social massif et grandissant en Chine et, plus récemment, au Zimbabwe où une grève générale a été lancée pour canaliser la colère des ouvriers non seulement contre les mesures d’austérité du gouvernement mais aussi contre les sacrifices exigés par la guerre en République Démocratique du Congo ; cette grève a coïncidé avec des désertions et des protestations au sein des troupes.
D’autres exemples pourraient être donnés, bien qu’il soit difficile d’obtenir des informations en raison du fait que -contrairement aux grandes manoeuvres syndicales largement répercutées par les médias en 1995 et 1996- la bourgeoisie a répondu à la plupart de ces mouvements par la politique du black-out, ce qui est une preuve supplémentaire du fait que ces mouvements sont l’expression d’une véritable et croissante combativité que la bourgeoisie ne veut certainement pas encourager.
Les réponses de la bourgeoisie et les perspectives de la lutte de classe
Face à la montée de la combativité, la bourgeoisie ne peut pas rester inactive. Elle a déjà lancé ou intensifié toute une série de campagnes sur le terrain même de la lutte tout comme sur un plan politique plus général, et cela pour saper la combativité de la classe et empêcher le développement de sa conscience. On connaît aujourd'hui un regain des syndicats “de combat” (comme en Belgique, Grèce ou dans la grève des électriciens britanniques), en même temps que se développent la propagande sur la “démocratie” (la victoire des gouvernements de gauche, l'affaire Pinochet, etc.), les mystifications sur la crise (la “critique” de la mondialisation, les appels à une soi-disant “troisième voie” qui utiliserait l'Etat pour tenir les rênes d'une “économie de marché” débridée) et que se poursuivent les calomnies contre la révolution d'Octobre, le bolchevisme et la Gauche communiste, etc.
En plus de ces campagnes, nous allons voir certainement la classe dominante utiliser au maximum toutes les manifestations de la décomposition sociale pour aggraver les difficultés auxquelles la classe ouvrière doit faire face. Il reste encore un très long chemin à parcourir entre le genre de mouvement que nous avons vu au Danemark et le développement d’affrontements massifs de classe dans les pays du coeur du capital, affrontements qui offriront à nouveau la perspective de la révolution à tous les exploités et opprimés de la terre.
Néanmoins, le développement de la lutte durant la période récente a montré que, malgré toutes les difficultés auxquelles elle a été confrontée durant la dernière décennie, la classe ouvrière n’en sort pas défaite et conserve même un énorme potentiel pour combattre ce système moribond. En effet, il existe plusieurs facteurs importants qui peuvent permettre la radicalisation des mouvements actuels de la classe et les porter à un niveau supérieur :
- Le développement de plus en plus ouvert de la crise économique mondiale. En dépit de toutes les tentatives de la bourgeoisie pour minimiser sa signification et déformer ses causes, la crise reste “l’alliée du prolétariat” en ce sens qu’elle tend à mettre à nu les limites réelles du mode de production capitaliste. L’an dernier; nous avons déjà assisté à un approfondissement majeur de la crise économique et nous savons cependant que le pire est encore devant nous ; avant tout, les grands centres capitalistes commencent seulement à ressentir les effets de ce dernier plongeon ;
- L’accélération de la crise signifie l’accélération des attaques capitalistes contre la classe ouvrière. Mais elle signifie aussi que la bourgeoisie est de moins en moins en mesure d’étaler dans le temps ces attaques, de les reporter ou de les concentrer sur certains secteurs. De plus en plus, c'est toute la classe ouvrière qui sera visée et tous les aspects de ses conditions de vie qui seront menacés. Ainsi la nécessité d’attaques massives de la bourgeoisie mettra de plus en plus en lumière la nécessité d’une réponse massive de la classe ouvrière.
- En même temps, la bourgeoisie des principaux centres du capitalisme sera aussi contrainte de s’engager de plus en plus dans des aventures militaires ; la société sera de plus en plus imprégnée d’une atmosphère de guerre. Nous avons noté qu’en certaines circonstances (cela a été le cas immédiatement après l’effondrement du bloc de l’Est), le développement du militarisme peut augmenter le sentiment d’impuissance du prolétariat. En même temps nous avons noté, même au moment de la guerre du Golfe, que de tels événements peuvent aussi avoir un effet positif sur la conscience de classe, particulièrement au sein d’une minorité plus politisée ou plus combative. Il reste que la bourgeoisie est incapable de mobiliser massivement le prolétariat pour ses aventures militaires. Un des facteurs qui explique la large “opposition” au sein de la classe dominante aux récents raids sur l’Irak était la difficulté à “vendre” cette politique guerrière à la population en général et à la classe ouvrière en particulier. Ces difficultés vont croître pour la classe dominante, parce qu'au niveau militaire elle sera de plus en plus obligée de montrer les dents.
***
Le Manifeste Communiste décrit la lutte de classe comme une “guerre civile plus ou moins voilée”. La bourgeoisie, tout en essayant de créer l’illusion d’un ordre social au sein duquel les conflits de classe appartiendraient au passé, est néanmoins obligée d’accélérer les conditions mêmes qui polarisent la société autour de deux camps opposés par des antagonismes irréconciliables. Plus la société bourgeoisie sombre dans son agonie mortelle, plus le voile qui cache cette “guerre civile” s’écartera. Confrontée à des contradictions économiques, sociales et militaires toujours plus fortes, la bourgeoisie est obligée de resserrer son étau politique totalitaire sur la société, de proscrire toute atteinte à son ordre, de demander toujours plus de sacrifices et de donner toujours moins en retour. Comme au siècle dernier, quand le Manifeste fut écrit, la lutte des ouvriers tend à redevenir la lutte d’une classe “hors-la-loi”, une classe qui n’a pas d’intérêt à défendre dans le système actuel, dont toutes les rebellions et les protestations sont effectivement interdites par la loi. En cela réside l’importance de trois aspects essentiels de la lutte de classe aujourd’hui :
- la lutte pour construire un rapport de forces en faveur des ouvriers, c'est la clé pour que la classe ouvrière soit capable de réaffirmer son identité de classe contre toutes les divisions imposées par l'idéologie bourgeoise en général et les syndicats en particulier et contre l'atomisation aggravée par la décomposition du capitalisme. C'est surtout une clé dans la pratique parce qu'elle surgit comme nécessité immédiate dans chaque lutte: les ouvriers ne peuvent se défendre qu'en élargissant le front de leur lutte le plus largement possible ;
- la lutte pour sortir de la prison syndicale ; ce sont en effet les syndicats qui mettent en avant partout la “légalité” capitaliste et les divisions corporatistes dans la lutte, qui cherchent à empêcher les ouvriers de constituer un rapport de force en leur faveur. La capacité des ouvriers à se confronter aux syndicats et à développer leurs propres formes d’organisation sera donc un critère d’évaluation crucial de la maturation véritable de la lutte dans la période future, quelles que soient la difficulté de ce processus ;
- l’affrontement aux syndicats est en même temps l’affrontement à l’Etat capitaliste ; et l’affrontement à l’Etat capitaliste -qui est assumé en permanence par les minorités les plus avancées- est la clé de la politisation de la lutte de classe. Dans bien des cas, c’est la bourgeoisie qui prend l’initiative de faire de “toute lutte de classe une lutte politique” (Le Manifeste) parce qu’elle ne peut pas, en fin de compte, intégrer la lutte de classe dans son système. La démarche de la “confrontation” a été et sera de plus en plus engagée par la classe dominante. Mais la classe ouvrière devra répondre, pas simplement sur le terrain de défense immédiate, mais avant tout en développant une perspective générale pour ses luttes, en replaçant chaque lutte partielle dans le contexte plus large du combat contre tout le système. Cette conscience sera nécessairement limitée pendant encore longtemps à une minorité. Mais cette minorité grandira et cette croissance se manifestera dans l'augmentation de l’influence des organisations politiques révolutionnaires sur un nombre de plus en plus important d’ouvriers radicalisés. De là découle la nécessité vitale pour ces organisations de suivre de très près le développement du mouvement de la classe et d’être capables d’intervenir en son sein dans la mesure de leurs moyens.
La bourgeoisie peut chercher à nous vendre le mensonge selon lequel la lutte de classe est morte. Mais elle est déjà en train de se préparer à la “guerre civile dévoilée” qui est sûrement contenue dans le futur d’un ordre social qui est dos au mur. La classe ouvrière et ses minorités révolutionnaires doivent, elles aussi, s'y préparer.
28/12/98
Vie du CCI:
- Résolutions de Congrès [131]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [143]
Le communisme n'est pas un bel idéal, il est à l'ordre du jour de l'histoire [8° partie] I
- 3045 reads
Comprendre la défaite de la
révolution russe (1re partie)
1918 : la révolution critique ses erreurs
Aujourd'hui, la classe ouvrière vit toujours avec les lourdes conséquences de la défaite de la révolution russe :
- d'abord parce cette défaite a véritablement été celle de la révolution mondiale, de la première tentative du prolétariat international de renverser le capitalisme ; et le résultat de cet échec, c'est que, depuis, l'humanité a été soumise au siècle le plus tragique de toute l'histoire ;
- mais aussi à cause de la forme qu'a prise cette défaite : la contre-révolution stalinienne qui a étouffé la révolution, a revêtu son costume, celui de Lénine et du bolchevisme. Cela a permis à la bourgeoisie internationale de la stériliser grâce au mensonge colossal selon lequel le stalinisme serait le communisme. Pendant des décennies, au sein de la classe ouvrière, cela a été source de confusion et de démoralisation profondes. Mais jamais celles-ci n'ont eu les proportions qu'elles ont prises après l'effondrement final des régimes staliniens à la fin des années 1980.
Pour les organisations communistes d'aujourd'hui, la lutte contre ce mensonge reste donc une tâche primordiale. C'est un combat où nous sommes tout à fait sûrs de notre terrain : “Les régimes étatisés qui, sous le nom de “socialistes” ou “communistes”, ont vu le jour en URSS, dans les pays de l'Est de l'Europe, en Chine, à Cuba, etc. n'ont été qu'une des formes particulièrement brutales d'une tendance universelle au capitalisme d'Etat, propre à la période de décadence.” (“Nos positions”, imprimé sur chacune des publications du CCI). Mais il n'a pas du tout été facile d'atteindre cette lumineuse clarté. Au contraire, il a fallu au moins deux décennies de réflexion, d'analyse et de débat avant qu'on puisse considérer “l'énigme russe” comme définitivement résolue. Et auparavant, lorsque la révolution russe encore vivante commençait à montrer des signes de déraillement, le défi que les révolutionnaires avaient à relever -critiquer leurs erreurs et avertir des dangers auxquels ils s'affrontaient, tout en défendant en même temps la révolution contre ses ennemis- était d'une certaine façon une tâche encore plus difficile.
Dans la suite des articles de cette série, nous allons examiner certains moments-clé de cette lutte, longue et ardue, pour la clarté. Bien que nous n'ayons pas l'ambition d'écrire l'histoire complète de cette lutte, il est impossible de l'omettre dans une série dont le but déclaré est de montrer comment le mouvement prolétarien a développé de façon progressive sa compréhension des buts et des méthodes de la révolution communiste ; et il est tout à fait évident que comprendre pourquoi et comment la révolution russe a abouti à une défaite constitue un guide indispensable pour le chemin que devra suivre la révolution du futur.
Rosa Luxemburg et la révolution russe
Le marxisme est d'abord et avant tout une méthode critique puisqu'il est le produit d'une classe qui ne pourra s'émanciper que par la critique la plus impitoyable de toutes les conditions existantes. Une organisation révolutionnaire qui ne parvient pas à critiquer ses fautes, à apprendre de ses erreurs, s'expose inévitablement aux influences conservatrices et réactionnaires de l'idéologie dominante. Et c'est encore plus vrai à une époque de révolution qui, par sa nature même, doit ouvrir de nouvelles voies, s'engager en territoire inconnu, avec pas grand chose d'autre que la boussole des principes généraux pour tracer son chemin. Le parti révolutionnaire est d'autant plus nécessaire après l'insurrection victorieuse qu'il est celui qui maîtrise le mieux cet instrument, qui se base sur l'expérience historique de la classe et la démarche scientifique du marxisme. Mais s'il renonce à la nature critique de cette démarche, il perdra de vue ces leçons historiques et sera incapable de tirer les nouvelles leçons qui découlent des événements du processus révolutionnaire qui se déroule sous ses yeux. Comme nous le verrons, l'une des conséquences du fait que le parti bolchevik se soit identifié de façon croissante à l 'Etat soviétique, a été la perte progressive de sa capacité à se critiquer lui-même ainsi que le cours général de la révolution. Mais tant qu'il est resté un parti prolétarien, il a en permanence sécrété des minorités qui ont accompli cette tâche. Le combat héroïque de ces minorités bolcheviques est le principal objet des prochains articles. Mais nous allons commencer par examiner la contribution d'une révolutionnaire qui n'appartenait pas au parti bolchevik, Rosa Luxemburg qui, en 1918, dans les conditions les plus pénibles, a écrit son article La révolution russe qui nous fournit la meilleure méthode possible pour aborder les erreurs de la révolution : la critique la plus aiguë fondée sur une solidarité sans faille face aux assauts de la classe dominante.
La révolution russe a été écrit en prison, juste avant l'éclatement de la révolution en Allemagne. A ce moment-là, avec la guerre impérialiste qui faisait toujours rage, il était extraordinairement difficile d'obtenir une information précise sur ce qui se passait en Russie -pas seulement du fait des difficultés de communication résultant de la guerre (pour ne pas mentionner l'emprisonnement de Luxemburg) mais surtout parce que, dès le début, la bourgeoisie a tout fait pour cacher la réalité de la révolution russe derrière un écran de fumée de calomnies et d'affabulations sanguinaires. L'article ne fut pas publié du vivant de Luxemburg ; Paul Levi, au nom de la Ligue Spartacus, avait même rendu visite à Rosa en prison pour la persuader que, étant donné les campagnes haineuses contre la révolution russe, publier un article critiquant les bolcheviks ne ferait que leur apporter du grain à moudre. Elle fut d'accord avec lui, et lui envoya donc l'article avec une note qui disait “J'écris ceci rien que pour vous, et si je peux vous convaincre, alors mon effort n'est pas perdu.” Le texte n'a été publié qu'en 1922 et les raisons qu'avait Levi de le publier à ce moment-là étaient loin d'être révolutionnaires (sur l'éloignement grandissant de Levi du communisme, lire l'article sur l'Action de mars dans la Revue internationale n°93).
Néanmoins, la méthode critique contenue dans La révolution russe est employée dans un esprit totalement juste. Dès le début, Luxemburg défend loyalement la révolution d'octobre contre la théorie menchevik/kautskyste selon laquelle la révolution aurait dû s'arrêter juste après l'étape “démocratique” car la Russie était un pays arriéré, et elle montre que seuls les bolcheviks ont été capables de poser l'alternative réelle : la contre-révolution bourgeoise ou la dictature du prolétariat. Simultanément, elle réfute l'argument social-démocrate selon lequel il aurait fallu obtenir une majorité formelle avant de pouvoir appliquer une politique révolutionnaire. Contre l'impasse de cette logique parlementaire, elle défend l'audace révolutionnaire de l'avant-garde bolchevique : “Nourrissons incorrigibles du crétinisme parlementaire, ils (les social démocrates allemands) se contentent de transposer sur la révolution, la vérité terre à terre du jardin d'enfants parlementaire : pour faire quelque chose, il faut d'abord avoir la majorité. Donc, pour la révolution également, il nous faut d'abord devenir une "majorité". Mais la véritable dialectique de la révolution inverse ce précepte de taupe parlementaire : on ne passe pas de la majorité à la tactique révolutionnaire mais de la tactique révolutionnaire à la majorité. Seul un parti qui sait diriger, c'est-à-dire faire avancer, gagne ses adhérents dans la tempête. La fermeté de Lénine et de ses amis à lancer au moment décisif le seul mot d'ordre mobilisateur -tout le pouvoir aux mains du prolétariat et des paysans- a fait presque en une nuit de cette minorité persécutée, calomniée, illégale, dont les chefs étaient, comme Marat, contraints de se cacher dans les caves, la maîtresse absolue de la situation.” (Ed. Petite collection Maspero, 1978)
Et, à l'instar des bolcheviks, Luxemburg était tout à fait consciente que cette politique audacieuse de l'insurrection en Russie ne pouvait avoir de sens qu'en tant que première étape vers la révolution prolétarienne mondiale. C'est toute la signification de la conclusion fameuse de son texte : “En ce sens (les bolcheviks) conservent le mérite impérissable d'avoir ouvert la voie au prolétariat international en prenant le pouvoir politique et en posant le problème pratique de la réalisation du socialisme, d'avoir fait progresser considérablement le conflit entre capital et travail dans le monde entier. En Russie, le problème ne pouvait être que posé. Il ne pouvait être résolu en Russie. Et en ce sens, l'avenir appartient partout au "bolchevisme".” (Ibid.)
Cette solution, dans l'esprit de Luxemburg, était entièrement concrète : elle demandait avant tout au prolétariat allemand de prendre ses responsabilités et de soutenir le bastion prolétarien en Russie en faisant la révolution lui-même. Ce processus était en train de se préparer au moment où elle écrivait cet article. Cependant, dans ce même article, elle affirme l'immaturité politique relative de la classe ouvrière allemande, ce qui montre une grande perspicacité et une vision du destin tragique de cette tentative.
Luxemburg était donc bien placée pour porter les critiques indispensables à ce qu'elle considérait être les principales erreurs des bolcheviks : elle les jugeait non de haut avec le détachement d'un “observateur” mais en tant que camarade révolutionnaire qui reconnaissait que ces erreurs étaient, d'abord et avant tout, le résultat des difficultés immenses que l'isolement imposait au pouvoir des soviets en Russie. En fait, ce sont précisément ces difficultés qui exigeaient des véritables amis de la révolution russe d'en faire non “une apologie aveugle” ou de la couvrir d'acclamations révolutionnaires, mais d'y porter “une critique approfondie et réfléchie” : “Il serait insensé d'imaginer que la première tentative d'importance mondiale d'instaurer une dictature de la classe ouvrière serait pleinement fructueuse et surtout dans les circonstances les plus difficiles qui soient : au milieu de la conflagration mondiale et du chaos d'un génocide impérialiste, dans l'étau d'acier de la plus réactionnaire des puissances militaires européennes, devant l'abandon complet du prolétariat international, ce que la Russie fait ou ne fait pas lors d'une expérience de dictature ouvrière, dans des conditions aussi parfaitement anormales ne saurait atteindre le sommet de la perfection.” (Ibid.)
Les critiques que portait Rosa Luxemburg aux bolcheviks étaient centrées sur trois aspects principaux :
- 1. la question de la terre
- 2. la question nationale
- 3. démocratie et dictature.
1. Les bolcheviks avaient gagné le soutien des paysans à la révolution d'octobre en les invitant à prendre la terre aux grands propriétaires terriens. Luxemburg reconnaissait que c'était “une excellente tactique”. Mais poursuivait-elle : “elle avait, hélas deux faces, la prise immédiate des terres par les paysans n'a, la plupart du temps, rien à voir avec l'économie socialiste, c'était là son revers. (...) Non seulement ce n'est pas une mesure socialiste, mais elle coupe le chemin qui y mène, elle crée une montagne de difficultés insurmontables à la restructuration des conditions agraires dans le sens du socialisme.” (Ibid.)
Luxemburg souligne qu'une politique économique socialiste ne peut que partir de la collectivisation de la grande propriété foncière. Elle ne critique pas les bolcheviks pour ne pas avoir collectivisé tout de suite, étant tout à fait instruite des difficultés auxquelles ils étaient confrontés. Mais ce qu'elle dit, c'est qu'en encourageant activement les paysans à diviser la terre en un nombre incommensurable de petites parcelles, les bolcheviks se préparaient des problèmes pour l'avenir, créant une nouvelle couche de petits propriétaires qui serait naturellement hostile à toute tentative de socialiser l'économie. L'expérience l'a confirmé : bien que prêts à soutenir les bolcheviks contre le vieux régime tsariste, les paysans indépendants sont plus tard devenus de façon croissante un boulet conservateur pour le pouvoir prolétarien. Luxemburg avait aussi tout à fait raison d'avertir que la division de la terre favoriserait les paysans riches aux dépens des plus pauvres. Mais il faut dire aussi que même la collectivisation de la terre n'aurait pas garanti la marche vers le socialisme, pas plus que celle de l'industrie. Seul le succès de la révolution à l'échelle mondiale aurait pu l'assurer -tout comme il aurait permis de surmonter les difficultés posées par la parcellisation de la terre en Russie.
2. La critique la plus tranchante portée par Luxemburg concerne la question de l'“auto détermination nationale”. Tout en reconnaissant que la défense par les bolcheviks du slogan du “droit des peuples à disposer d'eux-mêmes”' était basée sur la préoccupation légitime de s'opposer à toutes les formes d'oppression nationale et de gagner à la cause révolutionnaire les masses des parties de l'empire tsariste qui se trouvaient sous le joug du chauvinisme grand-russe, Luxemburg montre ce que ce “droit” entraînait dans la pratique ; les “nouvelles” unités nationales qui avaient opté pour la séparation d'avec la république soviétique russe se sont systématiquement alliées avec l'impérialisme contre le pouvoir prolétarien : “Défenseurs de l'indépendance nationale, même jusqu'au "séparatisme", Lénine et ses amis pensaient manifestement faire ainsi de la Finlande, de l'Ukraine, de la Pologne, de la Lithuanie, des pays de la Baltique, du Caucase, etc., autant de fidèles alliés de la révolution russe. Mais nous avons assisté au spectacle inverse : l'une après l'autre, ces "nations" ont utilisé la liberté qu'on venait de leur offrir pour s'allier en ennemies mortelles de la révolution russe à l'impérialisme allemand et pour transporter sous sa protection en Russie même le drapeau de la contre-révolution.” (Ibid.) Et elle poursuit en expliquant pourquoi il ne pouvait en être autrement puisque, dans la société de classe capitaliste, il ne peut exister de “nation” qui serait distincte des intérêts de la bourgeoisie et qui refuserait de se soumettre à la domination de l'impérialisme pour faire cause commune avec la classe ouvrière révolutionnaire : “Certes, dans tous les cas cités, ce ne sont pas les "nations" qui pratiquent cette politique réactionnaire, mais les classes bourgeoisies et petites bourgeoises qui, en opposition violente avec leurs masses prolétariennes, ont transformé le "droit à l'autodétermination nationale" en instrument de leur politique de classe contre-révolutionnaire. Mais -et nous touchons là le coeur du problème- cette formule nationaliste révèle son caractère utopique et petit bourgeois, car, dans la rude réalité de la société de classes, et surtout à une époque d'antagonismes exacerbés, elle se transforme en un moyen de domination des classes bourgeoises. Les bolcheviks ont dû apprendre à leurs dépens et à ceux de la révolution que sous l'hégémonie du capitalisme, il n'y a pas d'autodétermination de la nation, que dans une société de classes, chaque classe tend à "s'autodéterminer" différemment et que pour les classes bourgeoises, les considérations sur la liberté nationale viennent bien après celles qui touchent à la domination de classe. La bourgeoisie finlandaise et la petite bourgeoisie ukrainienne sont tombées tout-à-fait d'accord pour préférer le régime autoritaire de l'Allemagne à la liberté nationale, si celle-ci devait être liée aux dangers du "bolchevisme".” (ibid.)
De plus, la confusion des bolcheviks sur cette question (il faut rappeler qu'une minorité du parti bolchevique -en particulier Piatakov- était totalement d'accord avec Rosa Luxemburg sur ce point) devait avoir un effet négatif à l'échelle internationale puisque l'“auto-détermination nationale” était également le cri de ralliement du président américain Woodrow Wilson et de tous les grands requins impérialistes qui cherchaient à l'utiliser pour déloger leurs rivaux impérialistes des régions qu'ils convoitaient eux-mêmes. Toute l'histoire du 20e siècle a confirmé à quel point “le droit des nations” n'est devenu rien d'autre qu'un paravent dissimulant les désirs impérialistes des grandes puissances et de leurs émules plus faibles. Luxemburg ne niait pas le problème des sensibilités nationales, elle insistait sur le fait qu'il ne pouvait être question d'un régime prolétarien “intégrant” les pays en lice seulement par la force militaire. Mais il est également vrai que toute concession aux illusions nationalistes des masses dans ces régions ne pouvait que les lier plus étroitement à leurs exploiteurs. Le prolétariat, une fois qu'il se trouvait au pouvoir dans une région, ne pouvait gagner ces masses à sa cause que par “l'union la plus compacte des forces révolutionnaires”, par “une politique de classe internationale authentique” ayant pour but de séparer les ouvriers de leur propre bourgeoisie.
3. Sur la “démocratie et la dictature”, il y a des éléments profondément contradictoires dans la position de Luxemburg. D'un côté, elle fait une véritable confusion entre la démocratie en général et la démocratie ouvrière en particulier -les formes démocratiques utilisées dans le cadre et l'intérêt de la dictature du prolétariat. On le voit dans sa défense résolue de l'Assemblée constituante que le pouvoir soviétique a dissous en 1918, ce qui était en totale cohérence avec le fait que l'apparition même de ce dernier avait rendu les vieilles formes démocratiques bourgeoises complètement obsolètes. Et cependant, Luxemburg en quelque sorte y voit une menace pour la vie de la révolution prolétarienne. Dans le même sens, elle est réticente à accepter le fait qu'afin d'exclure la classe dominante de la vie politique, le “suffrage” dans le régime soviétique doive être basé sur la collectivité du lieu de travail plutôt que sur le domicile du citoyen individuel. Sa préoccupation était de s'assurer que les chômeurs ne soient pas exclus, ce qui n'a rien à voir avec le but recherché par la bourgeoisie quand elle met en avant ce dernier critère. Ces préjugés démocratiques inter-classistes contrastent de façon frappante avec ses arguments sur “l'auto-détermination nationale” qui ne peut jamais exprimer autre chose que “l'auto-détermination de la bourgeoisie”. L'argument est identique en ce qui concerne les institutions parlementaires qui n'expriment pas, quelles que soient leurs apparences, les intérêts du “peuple” mais ceux de la classe dominante capitaliste. Le point de vue de Rosa Luxemburg dans cet article est aussi en totale contradiction avec le programme de la Ligue Spartacus formulé peu après, puisque ce dernier document réclame la dissolution de tous types de corps parlementaire, national et municipal, et leur remplacement par les conseils des délégués ouvriers et soldats. Nous ne pouvons que supposer que la position de Luxemburg en faveur de l'Assemblée constituante -qui sera le cri de ralliement de la contre-révolution en Allemagne- s'est modifiée très rapidement dans le feu du processus révolutionnaire.
Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a rien de valable dans les critiques portées par Luxemburg à la position des bolcheviks sur la démocratie ouvrière. Elle était tout à fait consciente que dans la situation extrêmement difficile à laquelle faisait face le pouvoir soviétique assiégé, il existait un réel danger que la vie politique de la classe ouvrière soit subordonnée à la nécessité de barrer la route à la contre-révolution. Vu la situation, Luxemburg avait raison d'être sensible à tout signe indiquant que les règles de la démocratie ouvrière étaient violées. Sa défense de la nécessité du débat le plus large possible au sein du camp prolétarien, contre la suppression autoritaire de toutes les tendances politiques prolétariennes, était justifiée à la lumière du fait que les bolcheviks exerçant le pouvoir d'Etat dérivaient vers un monopole du parti qui était néfaste tant à eux-mêmes qu'à la vie du prolétariat en général, en particulier avec l'introduction de la Terreur rouge. Luxemburg ne s'opposait pas du tout à la notion de dictature du prolétariat. Mais elle insistait sur le fait que “cette dictature réside dans le mode d'application de la démocratie et non dans sa suppression, en empiétant avec énergie et résolution sur les droits acquis et les rapports économiques de la société bourgeoise ; sans cela on ne peut réaliser la transformation socialiste. Mais cette dictature doit être l'oeuvre de la classe, et non pas d'une petite minorité qui dirige au nom de la classe, c'est-à-dire qu'elle doit être l'émanation fidèle et progressive de la participation active des masses, elle doit subir constamment leur influence directe, être soumise au contrôle de l'opinion publique dans son ensemble, émaner de l'éducation politique croissante des masses populaires.” (Ibid.)
Luxemburg pressentait particulièrement le danger lorsqu'elle avertissait contre le fait de vider de plus en plus les soviets de leur vie politique au fur et à mesure que le pouvoir se concentrait entre les mains du parti : dans les trois années qui suivirent, cela devait devenir l'un des drames principaux de la révolution. Mais que Luxemburg ait eu raison ou tort dans ses critiques spécifiques, ce qui nous inspire par-dessus tout c'est la démarche qu'elle a adoptée envers le problème, une démarche qui devait servir de guide à toutes les analyses ultérieures de la révolution russe et de sa mort : la défense intransigeante de son caractère prolétarien, et, en conséquence la critique de ses faiblesses et de son échec en tant que problème du prolétariat et pour le prolétariat. Malheureusement, bien trop souvent, le nom de Luxemburg a été utilisé pour salir la mémoire même d'Octobre -non seulement par les courants conseillistes qui se sont prétendus héritiers de la Gauche allemande, alors qu'en réalité, ils ont perdu de vue les véritables traditions de la classe ouvrière, mais aussi, et peut-être de façon plus importante, par les forces bourgeoises qui, au nom du “socialisme démocratique”, ont utilisé Luxemburg pour chercher à détruire Lénine et le bolchevisme. Cela a été la spécialité de ceux qui viennent politiquement des forces mêmes qui , pour sauver la peau de la bourgeoisie, ont assassiné Luxemburg en 1919, les sociaux-démocrates, en particulier leur aile gauche. Pour notre part, nous avons absolument l'intention, en analysant les erreurs des bolcheviks et la dégénérescence de la révolution russe, de rester fidèles au contenu réel de sa méthode.
Les premiers débats sur le capitalisme d'Etat
Presque simultanément aux critiques de Luxemburg, les premiers désaccords importants sur la conduite de la révolution ont surgi dans le parti bolchevik. Ce débat -provoqué au départ par la signature du Traité de Brest-Litovsk, mais qui a par la suite évolué sur les formes et les méthodes du pouvoir prolétarien- a eu lieu de façon tout à fait ouverte dans le parti. Il est certain qu'il a donné lieu à des polémiques féroces entre ses protagonistes mais il n'était pas question de faire taire les positions minoritaires. En fait, pendant un moment, la position “minoritaire” sur la signature du Traité semblait devoir devenir majoritaire. A ce stade, les groupes qui défendaient des positions différentes prenaient plus la forme de tendances que de fractions clairement définies résistant au cours de la dégénérescence. En d'autres termes, ils se regroupaient sur une base temporaire pour exprimer des orientations particulières au sein du parti qui, malgré les tendances à l'étranglement par l'Etat, était encore très vivant, une saine avant-garde de la classe.
Néanmoins, il y a ceux qui ont défendu que la signature du traité de Brest-Litovsk constituait déjà le début de la fin sinon la fin des bolcheviks comme parti prolétarien, marquant l'abandon effectif de la révolution mondiale (voir la brochure de Guy Sabatier, Brest-Litovsk coup d'arrêt à la révolution, éditions Spartacus). Et dans une certaine mesure, la tendance au sein du parti qui s'est opposée le plus vigoureusement au traité -le groupe de la Gauche communiste autour de Boukharine, Piatakov, Ossinski et d'autres- redoutait que soit foulé au pied un principe prolétarien fondamental avec la signature par les représentants du pouvoir soviétique d'un accord de “paix” extrêmement désavantageux avec le cupide impérialisme allemand. Elle préconisait l'engagement dans une “guerre révolutionnaire” contre ce dernier. Son point de vue n'était pas différent de celui de Rosa Luxemburg, bien que la préoccupation principale de cette dernière était que la signature du traité risquait de retarder l'éclatement de la révolution en Allemagne et à l'Ouest.
Mais de toutes façons, une simple comparaison entre le traité de Brest-Litovsk en 1918 et celui de Rapallo quatre ans plus tard permet de mettre en lumière la différence essentielle entre un retrait de principe face à des impératifs absolus et le véritable marchandage des principes qui a pavé la route de l'intégration de la Russie soviétique au concert mondial des nations capitalistes. Dans le premier cas, le traité a été ouvertement discuté dans le parti et dans les soviets ; il n'y a eu aucune tentative de cacher les conditions draconiennes imposées par l'Allemagne ; tout le cadre du débat était déterminé par les intérêts de la révolution mondiale et non par les intérêts “nationaux” de la Russie. Rapallo, au contraire, a été signé en secret, et comportait la fourniture à l'armée allemande par l'Etat soviétique des armes mêmes qui allaient être utilisées pour défendre l'ordre capitaliste contre les ouvriers allemands en 1923.
L'essentiel du débat autour de Brest-Litovsk portait sur une question stratégique : le pouvoir soviétique qui dirigeait un pays déjà exsangue après quatre années de carnage impérialiste mondial, avait-il à sa disposition les moyens économiques et militaires pour lancer immédiatement une “guerre révolutionnaire” contre l'Allemagne, voire même la guerre partisane que Boukharine et d'autres communistes de gauche semblaient promouvoir ? Et par ailleurs, la signature du traité allait-elle sérieusement retarder l'éclatement de la révolution en Allemagne, soit par le message “capitulationniste” qu'il envoyait au prolétariat mondial ou, plus concrètement, parce qu'il permettait à l'impérialisme allemand de souffler, sur le front oriental ? Sur les deux points, il nous semble, en accord avec Bilan dans les années 1930, que Lénine a eu raison de défendre la nécessité pour le pouvoir soviétique d'avoir un espace vital pour regrouper ses forces, non pour se développer comme pouvoir “national” mais pour être plus en mesure de contribuer à la révolution mondiale, par exemple avec sa contribution à la fondation de la Troisième internationale en 1919, plutôt que de sombrer dans une défaite héroïque. Et on peut même dire que ce recul, loin d'avoir repoussé dans le temps l'éclatement de la révolution en Allemagne, a permis au contraire de le hâter : libéré de la guerre sur le front est, l'impérialisme allemand a tenté de lancer une nouvelle offensive à l'ouest ce qui a provoqué des mutineries dans la marine et dans l'armée qui ont déclenché la révolution allemande en novembre 1918.
S'il y a une leçon principielle à tirer de la signature du Traité, c'est celle de Bilan : “Les positions de la fraction dirigée par Boukharine et suivant laquelle la fonction de l'Etat prolétarien était de délivrer par la "guerre révolutionnaire" le prolétariat des autres pays se heurte brutalement à la nature même de la révolution prolétarienne et de la fonction historique du prolétariat.” Contrairement à la révolution bourgeoise qui peut véritablement être exportée par des moyens militaires, la révolution prolétarienne dépend de la lutte consciente du prolétariat de chaque pays contre sa propre bourgeoisie : “Une victoire de l'Etat prolétarien contre un Etat capitaliste (en donnant à ces termes une signification territoriale) n'est nullement une victoire de la révolution.” (“Parti-Etat-Internationale : l'Etat prolétarien”, Bilan n°18, avril-mai 1935). Cette position avait déjà été confirmée en 1920 avec la débâcle de la tentative d'exporter la révolution à la force des baïonnettes de l'Armée rouge.
La position des communistes de gauche sur Brest-Litovsk - en particulier sous sa forme “la mort ou le déshonneur” que Boukharine a défendue - n'était donc pas leur point fort même si c'est cette position qui les rappelle le mieux à notre souvenir. Une fois la “paix” conclue avec l'Allemagne et maîtrisée la première vague de résistance et de sabotage bourgeois qui a fait suite à l'insurrection d'octobre, le centre du débat s'est déplacé. Le temps de répit ayant été obtenu, il était prioritaire de déterminer comment le pouvoir soviétique devait se consolider en attendant que la révolution mondiale ait atteint une nouvelle étape.
En avril 1918, Lénine fit un discours au comité central du parti bolchevik qui a été publié par la suite sous le titre “Les tâches immédiates du pouvoir des soviets”. Dans ce texte, il défend que la première tâche à laquelle la révolution devait faire face -supposant, comme lui et beaucoup d'autres le faisaient alors, que les pires moments de la guerre civile étaient derrière et non devant le nouveau pouvoir- c'était celle de l'“administration”, de reconstruire une économie ruinée, d'imposer une discipline du travail et de développer la productivité, d'assurer un rapport et un contrôle strict du processus de production et de distribution, d'éliminer la corruption et le gaspillage et, peut-être plus que tout, de lutter contre la mentalité petite-bourgeoise double qu'il voyait comme un tribut à payer au poids énorme de la paysannerie et des survivances semi-médiévales.
Les parties de son texte les plus sujettes à controverse concernent les méthodes qu'il défend pour atteindre ces buts. Il n'hésite pas à utiliser ce qu'il traitait lui-même de méthodes bourgeoises, y compris l'utilisation de spécialistes techniques bourgeois (qu'il décrivait comme un “pas en arrière” par rapport aux principes de la Commune puisque, “pour les gagner” au pouvoir soviétique, ils devaient être achetés par un salaire bien supérieur au salaire moyen d'un ouvrier), le recours au travail aux pièces ; l'adoption du “système de Taylor” que Lénine disait “(allier) la cruauté raffinée de l'exploitation bourgeoise aux conquêtes scientifiques les plus précieuses concernant l'analyse des mouvements mécaniques dans le travail, la suppression des mouvements superflus et malhabiles, l'élaboration des méthodes de travail les plus rationnelles, l'introduction des meilleurs systèmes de recensement et de contrôle, etc.” ( “Les tâches immédiates du pouvoir des soviets”, Oeuvres choisies, Tome 2) Plus sujette à caution que tout, la réaction de Lénine contre un certain degré d'“anarchie” sur le lieu de travail, en particulier là où le mouvement des comités d'usine était fort et disputait le contrôle des usines à l'ancienne ou à la nouvelle direction. Il a donc appelé à la “direction d'un seul homme”, en affirmant que “la soumission sans réserve à une volonté unique est absolument indispensable pour le succès d'un travail organisé sur le modèle de la grande industrie mécanique.” (Ibid.) Ce passage est souvent cité par les anarchistes et les conseillistes qui sont zélés à montrer que Lénine était le précurseur de Staline. Mais il faut le lire dans son contexte : la défense par Lénine de la “dictature individuelle” dans la direction n'excluait pas du tout le large développement de discussions et de prises de décision démocratiques sur la politique globale dans les meetings de masse ; et plus forte serait la conscience de classe du prolétariat, plus cette subordination au “directeur” durant le processus réel rappellerait “plutôt la direction délicate d'un chef d'orchestre” (Ibid.)
Néanmoins, toute l'orientation de ce discours alarma les communistes de gauche, d'autant plus qu'il était accompagné d'une tendance à réfréner le pouvoir des comités d'usine à la base et à les incorporer dans l'appareil syndical plus flexible.
Le groupe communiste de gauche qui était extrêmement influent dans les régions de Petrograd et de Moscou, avait créé son propre journal, Kommounist (Le communiste). Il y a publié deux importantes polémiques envers la démarche contenue dans le discours de Lénine : les “Thèses sur la situation actuelle” du groupe (publiées dans Critique, Glasgow, 1977, comme brochure) et l'article d'Ossinski “Sur la construction du socialisme”.
Le premier document montre que ce groupe n'était absolument pas animé par un esprit d'“infantilisme petit-bourgeois” comme devait le proclamer Lénine. La démarche est tout à fait sérieuse et commence par chercher à analyser le rapport de forces entre les classes au lendemain du traité de Brest-Litovsk. Il est certain que ceci révèle le côté faible de l'analyse du groupe : il se raccroche à l'idée à la fois que le traité a porté un coup sérieux aux perspectives de la révolution, tout en prédisant en même temps que “pendant le printemps et l'été, l'effondrement du système impérialiste doit commencer”, un morceau de diseuse de bonne aventure auquel Lénine sonne les cloches avec raison dans sa réponse. Cette position contradictoire est un produit direct des fausses suppositions que les gauches avaient faites dans le débat sur le traité.
Le côté fort du document est la critique de l'utilisation de méthodes bourgeoises par le nouveau pouvoir soviétique. Ici il faut dire que le texte n'est pas rigidement doctrinaire : il accepte l'utilisation de spécialistes techniciens bourgeois par la dictature du prolétariat et n'exclut pas la possibilité d'établir des relations commerciales avec les puissances capitalistes, tout en alertant contre le danger de “manoeuvres diplomatiques de la part de l'Etat russe parmi les puissances impérialistes”, y compris d'alliances politiques et militaires. Et il met aussi en garde contre de telles politiques qui, à l'échelle internationale, s'accompagneraient inévitablement de concessions à la fois au capital international et au capital originaire de Russie même. Ces dangers devaient devenir particulièrement concrets avec le reflux de la vague révolutionnaire après 1921. Mais l'aspect le plus valable des critiques portées par la Gauche concernait le danger d'abandonner les principes de l'Etat-commune dans les soviets, dans l'armée et dans les usines :
“Une politique de direction des entreprises sur le principe d'une large participation des capitalistes et d'une centralisation semi-bureaucratique va naturellement de pair avec une politique du travail visant l'établissement d'une discipline parmi les ouvriers déguisée en "autodiscipline" ; l'introduction de la responsabilité du travail pour les ouvriers (un projet de cette nature a été promu par les bolcheviks de droite - travail à la pièce, allongement de la journée de travail, etc.)
La forme du contrôle de l'Etat sur les entreprises doit se développer dans la direction de la centralisation bureaucratique, de la domination de différents commissaires, de la privation d'indépendance des soviets locaux et du rejet dans la pratique du type d'"Etat-Commune" dirigé par en bas...
Dans le domaine de la politique militaire, il doit apparaître, et on peut en fait déjà le noter, une déviation vers le rétablissement du service militaire à l'échelle nationale (incluant la bourgeoisie)... Avec l'établissement de cadres de l'armée pour lesquels sont nécessaires l'entraînement et le commandement par des officiers, la tâche de créer un corps prolétarien d'officiers à travers une organisation large et planifiée d'écoles et de cours appropriés est perdue de vue. De cette façon, sont reconstitués dans la pratique le vieux corps des officiers et les structures de commandement des généraux tsaristes.” (traduit de l'anglais par nous)
Ici, la gauche communiste discernait les tendances préoccupantes qui commençaient à apparaître au sein du nouveau régime soviétique et qui devaient s'accélérer rapidement dans la période suivante de “Communisme de guerre”. Ils étaient particulièrement préoccupés du fait que si le parti s'identifiait à ces tendances, il risquait d'être contraint de s'affronter aux ouvriers comme force hostile : “L'introduction de la discipline du travail en lien avec la restauration de la direction capitaliste dans la production ne peut pas accroître fondamentalement la productivité du travail, mais elle affaiblira l'autonomie de classe, l'activité et le degré d'organisation du prolétariat. Pour mettre en place ce système dans le contexte de la haine de classe qui prévaut dans la classe ouvrière contre les "capitalistes et les saboteurs", le parti devra chercher le soutien de la petite-bourgeoisie contre les ouvriers, et donc en finir avec lui-même comme parti du prolétariat.” (Ibid.)
L'issue finale d'une telle involution était, pour les Gauches, la dégénérescence du pouvoir prolétarien en un système de capitalisme d'Etat : “A la place d'une transition d'une nationalisation partielle vers une socialisation générale de la grande industrie, les accords avec les "capitaines de l'industrie" vont mener à la formation de grands trusts dirigés par eux et regroupant les branches fondamentales de l'industrie ce qui peut prendre, avec une aide extérieure, la forme d'entreprises d'Etat. Un tel système d'organisation de la production jette les bases d'une évolution vers le capitalisme d'Etat et constitue une étape transitoire vers celui-ci.” (Ibid.)
A la fin des Thèses, les communistes de gauche développent leurs propres propositions pour maintenir la révolution sur le droit chemin : poursuite de l'offensive contre la contre-révolution bourgeoise et la propriété capitaliste ; contrôle strict sur les spécialistes industriels et militaires bourgeois ; soutien à la lutte des paysans pauvres à la campagne ; et plus important, pour les ouvriers “pas d'introduction du travail à la pièce ni allongement de la journée de travail ce qui, dans les circonstances d'un développement du chômage n'a pas de sens, mais introduction par les conseils économiques locaux et les syndicats d'horaires standards et d'une diminution de la journée de travail avec augmentation du nombre d'équipes et organisation large du travail social productif.
L'octroi d'une grande indépendance aux soviets locaux et non le contrôle de leur activité par les commissaires envoyés par le pouvoir central. Le pouvoir soviétique et le parti du prolétariat doivent chercher un soutien dans l'autonomie de classe des grandes masses vers le développement de laquelle tous les efforts doivent être dirigés.” Et les gauches définissent pour finir leur propre rôle : “Elles définissent leur attitude envers le pouvoir soviétique comme une position de soutien universel à ce pouvoir en cas de nécessité -par le moyen de la participation à celui-ci... Cette participation n'est possible que sur la base d'un programme politique défini qui empêche la déviation du pouvoir soviétique et de la majorité du parti vers le chemin fatal de la politique petite-bourgeoise. En cas d'une telle déviation, l'aile gauche du parti devra prendre la position d'une opposition prolétarienne active et responsable.”
On peut trouver dans ces lignes un certain nombre de faiblesses théoriques importantes. L'une d'elles est la tendance à confondre la nationalisation totale de l'économie par l'Etat soviétique avec un processus réel de socialisation - c'est-à-dire comme faisant déjà partie de la construction d'une société socialiste. Dans sa réponse aux thèses, “Sur l'infantilisme "de gauche" et les idées petites-bourgeoises” (mai 1918), Lénine attaque cette confusion. A la position des Thèses selon laquelle “l'utilisation systématique des moyens existants de production n'est concevable que si une politique de socialisation la plus déterminée se poursuit”, Lénine répond : “On peut être résolu ou irrésolu en matière de nationalisation et de confiscation. Mais aucune "résolution", fût-elle la plus grande qui soit, ne suffit pour assurer le passage de la nationalisation et des confiscations à la socialisation. Toute la question est là précisément. Le malheur de nos "communistes de gauche", c'est que par ce naïf et puéril assemblage de mots : "La socialisation... la plus résolue", ils révèlent leur incompréhension totale du noeud de la question et de la situation "actuelle"(...) Hier, il fallait essentiellement nationaliser, confisquer, battre et achever la bourgeoisie et briser le sabotage avec le maximum de résolution. Aujourd'hui, il n'est que des aveugles pour ne pas voir que nous avons nationalisé, confisqué, brisé et démoli plus que nous n'avons réussi à compter. Or la socialisation diffère de la simple confiscation précisément en ceci qu'on peut confisquer avec la seule "résolution", sans être compétent en matière de recensement et de répartition rationnelles de ce qui a été confisqué, tandis qu'on ne peut socialiser à défaut de cette compétence.” (Oeuvres choisies, Tome 2)
Ici, Lénine est capable de montrer qu'il existe une différence de qualité entre la simple expropriation de la bourgeoisie (en particulier quand cela prend la forme de l'étatisation) et la construction réelle de nouveaux rapports socialistes. La faiblesse des Gauches sur ce point devait conduire beaucoup d'entre eux à confondre l'étatisation quasi complète de la propriété et même de la distribution qui a eu lieu pendant la période du “Communisme de guerre” avec le communisme authentique ; comme nous l'avons montré, Boukharine en particulier a développé cette confusion en une théorie élaborée dans son livre Economique de la période de transition (voir la Revue internationale n°96). Lénine au contraire est bien plus réaliste sur la possibilité que le pouvoir soviétique russe, épuisé, puisse accomplir des pas véritables vers le socialisme en l'absence d'une révolution mondiale.
Cette faiblesse empêche aussi les gauches de voir avec une pleine clarté d'où vient le principal danger de la contre-révolution. Pour elles, le “capitalisme d'Etat” est considéré comme le danger central, c'est vrai. Mais il est plutôt vu comme l'expression d'un danger encore plus grand : que le parti finisse dans une déviation vers la “politique petite-bourgeoise”, qu'il s'aligne sur les intérêts de la petite-bourgeoisie contre le prolétariat. C'était un reflet partiel de la réalité : le statu quo post-insurrectionnel était une situation dans laquelle le prolétariat victorieux ne s'affrontait pas seulement à la furie des vieilles classes dominantes, mais aussi au poids mort des vastes masses paysannes qui avaient leurs propres raisons de résister à une avancée ultérieure du processus révolutionnaire. Mais le poids de ces couches sociales se faisait sentir sur le prolétariat avant tout à travers l'organe étatique qui, dans sa tendance naturelle à préserver le statu quo social, tendait à devenir un pouvoir autonome pour lui-même. Comme la plupart des révolutionnaires de l'époque, les gauches identifiaient le “capitalisme d'Etat” à un système de contrôle étatique dirigeant l'économie soit dans l'intérêt de la grande bourgeoisie, soit dans celui de la petite-bourgeoisie ; elles ne pouvaient pas encore envisager la montée d'un capitalisme d'Etat ayant effectivement écrasé ces classes et opérant toujours sur une base entièrement capitaliste.
Comme nous l'avons vu, la réponse de Lénine aux gauches, “L'infantilisme de l'aile gauche”, tape sur leurs points faibles : les confusions sur les implications de Brest-Litovsk, la tendance à confondre la nationalisation et la socialisation. Mais Lénine à son tour tombe dans une erreur très grave quand il commence à faire les louanges du capitalisme d'Etat comme étape nécessaire pour la Russie arriérée, en fait comme fondement du socialisme. Lénine avait déjà mis en avant ce point de vue dans son discours au comité exécutif des soviets à la fin avril. Là il traite la question à partir de la meilleure intuition des communistes de gauche -le danger d'une évolution vers le capitalisme d'Etat- et part dans une direction totalement fausse :
"Eh bien, quand je vois désigner de pareils ennemis dans le journal des communistes de gauche, je demande : qu'est-il arrivé à ces hommes, comment des bribes de livres peuvent-elles leur faire oublier la réalité ? La réalité dit que le capitalisme d'Etat serait pour nous un pas en avant. Si nous pouvions en Russie réaliser sous peu un capitalisme d'Etat, ce serait une victoire. Comment peuvent-ils ne pas voir que le petit propriétaire, le petit capital est notre ennemi ? Comment peuvent-ils coir dans le capitalisme d'Etat notre principal ennemi ? Dans la passage du capitalisme au socialisme, ils ne doivent pas oublier que notre ennemi principal, c'est la petite-bourgeoisie avec ses habitudes, ses coutumes, sa situation économique (...)
Qu'est-ce que le capitalisme d'Etat sous le pouvoir des soviets ? Etablie à présent le capitalisme d'Etat, c'est établir le recensement et le contrôle qu'appliquaient les classes capitalistes. L'Allemagne nous offre un modèle de capitalisme d'Etat. Nous savons qu'elle s'est révéjée supérieure à nous. Mais si vous réfléchissez tant soit peu à ce que signifierait en Russie, dans la Russie des Soviets, la réalisation des bases de ce capitalisme d'Etat, quiconque a gardé son bon sens et ne s'est pas bourré le crâne de fragments de vérités livresques, devra dire que le capitalisme d'Etat serait pour nous le salut.
J'ai dit que le capitalisme d'Etat serait pour nous le salut ; si nous l'avions en Russie, la transition au socialisme intégral serait aisée, elle serait entre nos mains, parce que le capitalisme d'Etat est quelque chose de centralisé, de calculé, de contrôlé et de socialisé, et c'est précisément ce dont nous manquons. Nous sommes menacés par les éléments aveugles du laisser-aller petite-bourgeois, engendré le plus directement par toute l'histoire et l'économie de la Russie (...)” (Lénine, Séance du CEC, 29 avril 1918, Oeuvres complètes, Tome 27)
Il y a dans ce discours un fort élément d'honnêteté révolutionnaire, d'avertissement contre tout schéma utopique sur une construction rapide du socialisme dans une Russie qui sortait à peine du Moyen Age et qui ne recevait pas encore d'assistance directe du prolétariat mondial. Mais il y a aussi une sérieuse erreur que toute l'histoire du 20e siècle a vérifiée. Le capitalisme d'Etat ne constitue pas une étape organique vers le socialisme. En fait, il représente la dernière forme de défense du capitalisme contre l'effondrement de son système et l'émergence du communisme. La révolution communiste est la négation dialectique du capitalisme d'Etat. Les arguments de Lénine d'un autre côté trahissent les vestiges de la vieille idée social-démocrate selon laquelle le capitalisme évoluerait pacifiquement vers le socialisme. Il est certain que Lénine a rejeté l'idée que la transition vers le socialisme puisse commencer sans destruction politique de l'Etat capitaliste, mais ce qu'il oublie c'est que la nouvelle société ne peut émerger qu'à travers une lutte consciente et constante du prolétariat pour supplanter les lois aveugles du capital et créer de nouveaux rapports sociaux fondés sur la production pour l'usage. La “centralisation” de la structure économique capitaliste par l'Etat - même un Etat soviétique -ne fait pas disparaître les lois du capital, la domination du travail mort sur le travail vivant. C'est pourquoi les gauches avaient raison de dire comme dans les remarques souvent citées d'Ossinski, que : “Si le prolétariat lui-même ne sait pas créer les pré-requis de l'organisation socialiste du travail, personne ne peut le faire à sa place et personne ne peut le contraindre à le faire. Le bâton dressé sur la tête des ouvriers se retrouvera dans les mains d'une force sociale qui sera soit sous l'influence d'une autre classe sociale ou bien dans les mains du pouvoir des soviets ; mais le pouvoir des soviets sera alors forcé de rechercher le soutien d'une autre classe (comme la paysannerie) contre le prolétariat, et ce faisant, il se détruira lui-même en tant que dictature du prolétariat. Le socialisme ou l'organisation socialiste sera établi par le prolétariat lui-même ou ne le sera pas ; quelque chose d'autre sera mis en place -le capitalisme d'Etat.” (“Sur la construction du socialisme”, Kommounist n°2, avril 1918, traduit de l'anglais par nous)
Bref, le travail vivant ne peut imposer ses intérêts sur ceux du travail mort que par ses propres efforts, par sa lutte même pour prendre le contrôle direct et de l'Etat et des moyens de production et de distribution. Lénine avait tort de considérer ça comme une preuve de la démarche petite-bourgeoise et anarchiste des gauches. Les gauches, contrairement aux anarchistes, n'étaient pas opposées à la centralisation. Bien qu'elles aient été en faveur d'initiatives des comités d'usine et des soviets locaux, elles étaient pour la centralisation de ces organes dans des conseils économiques et politiques supérieurs. Ce qu'elles voyaient cependant, c'était qu'il n'y avait pas de choix entre deux voies pour construire la nouvelle société -celle de la centralisation prolétarienne et celle de la centralisation bureaucratique. Cette dernière ne pouvait mener que dans une direction totalement différente et culminerait inévitablement dans une confrontation entre la classe ouvrière et un pouvoir qui, même né de la révolution, se serait de façon croissante éloigné de celle-ci.
C'était une vérité générale, applicable à toutes les phases du processus révolutionnaire. Mais les critiques des communistes de gauche avaient aussi une validité plus immédiate. Comme nous l'avons écrit dans l'étude sur la Gauche communiste russe dans la Revue internationale n°8 : “La défense par Kommounist des comités d'usine, des conseils et de l'activité autonome de la classe ouvrière était importante non parce qu'elle aurait fourni une solution aux problèmes économiques rencontrés par la Russie, et encore moins comme recette pour la construction immédiate du "communisme" en Russie ; la Gauche déclarait explicitement que "le socialisme ne peut pas être réalisé dans un seul pays et surtout pas dans un pays arriéré" (cité par L.Schapiro, The origins of the communist autocracy, 1955). Le fait que ce soit l'Etat qui impose une discipline du travail, l'incorporation des organes autonomes du prolétariat dans l'appareil d'Etat, constituait surtout des coups portés à la domination politique de la classe ouvrière russe. Comme le CCI l'a souvent souligné, le pouvoir politique de la classe est la seule garantie véritable de l'issue victorieuse de la révolution ; et le pouvoir politique ne peut être exercé que par les organes de masse de la classe, par ses comités, ses assemblées d'usine, ses conseils, ses milices. En affaiblissant l'autorité de ces organes, la politique de la direction bolchevik faisait peser une grave menace sur la révolution elle-même. Les signes de ce danger que les communistes de gauche avaient si clairement vus dans les premiers mois de la révolution, devaient devenir encore plus sérieux pendant la période de guerre civile.”
***
Au lendemain de l'insurrection d'octobre, quand le personnel du gouvernement soviétique s'est formé, Lénine a eu une hésitation avant d'accepter le poste de président du soviet des commissaires du peuple. Son intuition politique lui disait que cela freinerait sa capacité à agir comme avant-garde de l'avant-garde, à être à la gauche du parti révolutionnaire comme il l'avait si clairement été entre avril et octobre 1917. La position adoptée par Lénine en 1918 contre les gauches, tout en se situant fermement dans les paramètres d'un parti prolétarien vivant, reflète déjà les pressions du pouvoir étatique sur les bolcheviks ; les intérêts de l'Etat, de l'économie nationale, de la défense du statu quo avaient déjà commencé à entrer en conflit avec les intérêts des ouvriers. En ce sens, il y a une certaine continuité entre les faux arguments de Lénine contre les gauches en 1918 et sa polémique contre la Gauche communiste internationale après 1920 qu'il a également accusée d'infantilisme et d'anarchisme. Mais en 1918, la révolution mondiale était encore dans sa phase ascendante et si elle s'était étendue au-delà de la Russie, il aurait été bien plus facile de corriger ses premières erreurs. Dans de prochains articles, nous examinerons comme la Gauche communiste a répondu au véritable processus de dégénérescence qui a pris le parti bolchevik et le pouvoir soviétique quand la révolution internationale est entrée dans sa phase de reflux.
CDW.
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Russe [2920]
Approfondir:
Questions théoriques:
- Communisme [492]
Heritage de la Gauche Communiste:
REVOLUTION ALLEMANDE (XIII) - 1923 - II
- 5551 reads
1923 (II).
Une défaite qui signe la fin de la vague révolutionnaire mondiale
Avec l’occupation de la Ruhr
par les troupes françaises, la bourgeoisie allemande cherche les moyens de se
débarrasser du poids “des réparations de guerre” qui lui sont imposées par le
traité de Versailles en le faisant porter par la classe ouvrière; mais elle
essaie surtout d’attirer celle-ci sur le terrain nationaliste dans une lutte
pour la défense de la nation contre le capital français.
Bien que le KPD, soutenu par l’IC, succombe aux appels nationalistes du capital et essaie d’entrainer derrière lui, sous couvert du “national-bolchevisme”, les ouvriers, ceux-ci ne semblent pas prêts de tomber dans le piège. Pour se défendre contre une paupérisation de plus en plus grande, la classe ouvrière développe son combat contre la volonté de la direction du KPD. En proposant une solution nationaliste, en appelant à la “sauvegarde de la république” et à la formation d'un front uni avec la Social-démocratie contre-révolutionnaire, le KPD développe une politique qui affaiblit la classe ouvrière.
Après une phase de lutte de classe montante le mouvement atteint son apogée en août 1923. Fortement alerté par la détermination des ouvriers, le capital allemand décide d'en finir avec sa politique provocatrice (cf. article dans Revue Internationale n°98) d'appel à “la résistance passive” contre les forces françaises d'occupation, tout en stoppant la spirale de l'inflation qui avait contraint la classe ouvrière à se battre pour sa simple survie. Le principal maitre d'oeuvre de cette stratégie du capital est le SPD qui, en août 1923, rejoint le gouvernement pour briser le mouvement.
Ainsi la bourgeoisie réussit à empêcher une reprise du mouvement. Le capital allemand qui avait mis en place l'appât du national-bolchevisme, le retire du jour au lendemain, en annonçant une nouvelle orientation politique pro-occidentale, enterrant ainsi les espoirs d'une alliance entre une “Allemagne opprimée” et la Russie. De plus, du fait de la confusion semée par le KPD, la classe ouvrière est soumise à une complète absence d'orientation politique.
Dans un article précédent, nous avons montré comment l'isolement international de la révolution en Russie a entraîné la dégénérescence de l'IC et la montée du capitalisme d'Etat russe.
Après la signature du traité secret de Rapallo la classe capitaliste internationale se rend compte que l'Etat russe est en train de faire de l'IC son instrument. En Russie se développe d'ailleurs une forte opposition contre cette tendance, ce qui amène à une série de grèves au cours de l'été 1923 dans la région de Moscou et ce qui s'exprime surtout par une opposition bruyante de plus en plus importante dans le parti bolchevik. A l'automne 1923, Trotsky, après beaucoup d'hésitations, décide finalement d'engager une lutte plus déterminée contre l'orientation capitaliste d'Etat. Bien que l'IC, avec sa politique de front unique et son soutien au national-bolchevisme, devienne de plus en plus opportuniste et tende à dégénérer d'autant plus rapidement qu'elle est étranglée par l'Etat russe, il reste en son sein une minorité de camarades internationalistes qui continuent à défendre l'orientation de la révolution mondiale. Après l'abandon par le capital allemand de sa promesse d'une lutte commune entre la “nation opprimée” et la Russie, cette minorité internationaliste est désorientée parce qu'elle est persuadée que, de ce fait, la perspective d'un “sauvetage” de la révolution d'octobre de l'extérieur ainsi que celle d'une relance de la vague révolutionnaire mondiale s'éloignent de plus en plus. Par crainte d'un développement du capitalisme d'Etat en Russie et dans l'espoir d'un resurgissement révolutionnaire, elle recherche désespérément une dernière étincelle, la dernière possibilité d'un assaut révolutionnaire.
“Vous pouvez voir camarades, c'est finalement le grand assaut que nous avons attendu depuis tant d'années, et qui changera l'image du monde. Ces évènements vont avoir une importance considérable. La révolution allemande signifie l'effondrement du monde capitaliste.” (Trotsky) Convaincu qu'il subsiste encore un potentiel révolutionnaire et que le moment de l'insurrection n'est pas encore passé, Trotsky presse l'IC de faire tout ce qu'elle peut pour soutenir une montée révolutionnaire.
En même temps la situation en Pologne et en Bulgarie s'accélère. Le 23 septembre, les communistes en Bulgarie, soutenus par l'IC, lancent un soulèvement qui échoue. En octobre et novembre, une nouvelle vague de grèves, suivie par près des deux tiers du prolétariat industriel du pays, éclate en Pologne. Le Parti communiste polonais est lui-même surpris par la combativité de la classe. Ces soulèvements insurrectionnels sont écrasés en novembre 1923.
Dans le cadre du combat politique qui se mène au sein du Parti russe, Staline s'élève contre le soutien du mouvement en Allemagne dans la mesure où le succès de celui-ci pourrait constituer une menace directe contre l'appareil d'Etat russe actuel au sein duquel il contrôle quelques unes des positions les plus importantes : “Mon point de vue est que les camarades allemands doivent se retirer et que nous ne devons pas les encourager.” (Lettre de Staline à Zinoviev, 5/8/1923)
L'IC se fourvoie dans l'aventure de l'insurrection
Accroché au dernier espoir d'une reprise de la vague révolutionnaire, le Comité exécutif de l'IC (CEIC) décide par lui-même, sans consulter préalablement le KPD, de presser le mouvement en Allemagne et de se préparer à l'insurrection.
Lorsque les nouvelles de la fin de la politique de “résistance passive” de l'Allemagne contre la France et du début des négociations franco-allemandes arrivent à Moscou le 11 septembre, le CEIC appelle à l'insurrection en Bulgarie pour la fin septembre, qui doit être suivie peu après en Allemagne. Les représentants du KPD sont sommés par Moscou de préparer l'insurrection avec le CEIC. Ces discussions auxquelles prennent aussi part les représentants des pays voisins de l'Allemagne durent plus d'un mois, de début septembre à début octobre.
L'IC prend un nouveau tournant désastreux. Après la politique catastrophique de front unique avec les forces social-démocrates contre-révolutionnaires dont les conséquences destructrices se font encore sentir, après le flirt avec le national-bolchevisme, c'est maintenant la fuite en avant désespérée, l'aventure dans une tentative de soulèvement sans que soient réunies les conditions pour un succès possible.
Des conditions défavorables
Même si la classe ouvrière en Allemagne reste la partie la plus forte et la plus concentrée du prolétariat international, celle qui, avec le prolétariat russe, a été à la pointe du combat révolutionnaire, elle est en 1923 -la vague internationale de luttes étant, à ce moment-là, déjà dans une phase de reflux- relativement isolée. Par rapport à cette situation, le CEIC a un fausse estimation du rapport de forces et il ne voit pas comment la réorientation tactique du gouvernement dirigé par le SPD en août 1923 est parvenu à faire pencher celui-ci en faveur de la bourgeoisie. Pour avoir une analyse correcte, pour comprendre la stratégie de l'ennemi, un parti internationalement organisé et centralisé doit pouvoir s'appuyer sur une évaluation exacte de la situation “sur place” faite par sa section locale. Mais le KPD lui-même est aveuglé par sa politique national-bolchevik et ne comprend pas la dynamique réelle du mouvement. Le mouvement en Allemagne même met à nu de nombreuses faiblesses :
- Jusqu'à août il se limite surtout à des revendications économiques. La classe ouvrière ne met pas en avant ses propres revendications politiques. Même si le mouvement développe plus de force à partir des usines, même s'il occupe la rue, même si des ouvriers de plus en plus nombreux s'unissent dans des assemblées générales et que des conseils ouvriers sont formés, on ne peut pourtant pas parler de période de double pouvoir. Plusieurs membres du CEIC estiment que la formation de conseils ouvriers ne peut que détourner le mouvement de ce qu'ils considèrent être la tâche prioritaire, la préparation militaire de l'insurrection, et même que les conseils vont servir de pretexte à la répression du gouvernement. Le nouveau gouvernement a en effet interdit les conseils d'usines. Une majorité du CEIC propose de ce fait que les soviets ne soient formés qu'après la prise du pouvoir.
- Au lieu de tirer les leçons de la politique désastreuse qui s'est essentiellement appuyée sur une “alliance nationale”, une politique dans laquelle la stratégie de Front unique n'était que le premier pas, le KPD base toute la préparation de l'insurrection sur la formation d'un “gouvernement ouvrier” avec le SPD.
- Enfin, ce qui n'est pas la moindre des faiblesses, la condition indispensable pour envisager une insurrection victorieuse n'est pas remplie : le KPD divisé, miné et affaibli par son évolution opportuniste ne joue pas un rôle politique véritablement décisif dans la classe.
Les préparatifs de l'insurrection
Plusieurs questions sont débattues dans le CEIC.
Trotsky insiste fortement sur la nécessité de fixer la date de l'insurrection. Il propose le 7 novembre, le jour du soulèvement victorieux d'octobre en Russie six ans auparavant. En fixant une date, il veut écarter toute attitude attentiste. Le président du KPD, Brandler, quant à lui, refuse de fixer une date précise. La décision est enfin prise à la fin septembre pour que l'insurrection ait lieu au cours des 4 à 6 semaines à venir, c'est-à-dire dans les premiers jours de novembre.
La direction du parti allemand se considèrant comme trop inexpérimentée, Brandler suggère que Trotsky lui-même, qui a joué un rôle si important dans l'organisation de l'insurrection d'octobre 1917 en Russie, vienne en Allemagne pour aider à organiser l'insurrection.
La proposition rencontre la résistance des autres membres du CEIC. Zinoviev exige, en tant que président de l'IC, de tenir ce rôle dirigeant. On ne peut comprendre cette querelle qu'en la replaçant dans le contexte de la lutte croissante pour le pouvoir en Russie même. Finalement il est décidé qu'un organe collectif, composé de Radek, Gouralsky, Skoblevsky et Tomsky, sera envoyé en Allemagne. Le CEIC décide également que l'aide doit être apportée à trois niveaux :
- l'aide militaire en est l'aspect principal. Des officiers de l'Armée rouge, qui ont acquis de l'expérience pendant la guerre civile en Russie, sont envoyés secrètement en Allemagne pour aider les Cents rouges et afin de construire une Armée rouge. Ils offrent aussi leur soutien en mettant en place un service de renseignement en Allemagne qui a pour tâche de garder des relations avec les officiers oppositionnels de l'armée allemande. De plus, il est prévu que des membres très expérimentés du parti doivent attendre à la frontière pour se rendre en Allemagne aussi vite que possible.
- l'aide matérielle (alimentaire), notamment un million de tonnes de blé doit être transporté à la frontière occidentale russe pour être immédiatement acheminer en Allemagne en cas de victoire de la révolution.
- au niveau de la propagande, un peu partout des réunions publiques sont organisées avec pour thèmes “L'octobre allemand est devant nous”, “Comment pouvons-nous aider la révolution allemande ?”, des réunions au cours desquelles sont communiquées des nouvelles de ce qui se passe en Allemagne. Des fonds sont levés et de l'argent et autres subsides collectés. On appelle ainsi les femmes à donner leurs bijoux pour la “cause allemande”.
Tandis que les discussions se poursuivent à Moscou, des émissaires de l'IC en Allemagne commencent déjà les préparatifs de l'insurrection. Au début d'octobre, de nombreux dirigeants du KPD commencent à rentrer dans l'illégalité. Mais alors qu'à Moscou la direction du KPD et le CEIC sont encore en train de discuter des plans de l'insurrection, en Allemagne même il ne semble pas y avoir de discussion plus approfondie sur cette question et sur les perspectives immédiates.
Depuis le début 1923 et particulièrement depuis la conférence du parti à Leipzig, le KPD a commencé à mettre en place des unités de combat de Cents rouges. Initialement ces troupes armées devaient servir comme forces de protection des manifestations et des assemblées ouvrières. Tout ouvrier expérimenté au combat, quelles que soient ses convictions politiques, peut les rejoindre. Maintenant, les Cents rouges sont occupés à parfaire l'entraînement militaire, s'entraînant aux alertes et suivant des cours spéciaux de maniement des armes.
En comparaison avec mars 1921, beaucoup plus d'attention est consacrée à cet aspect et des moyens considérables sont investis dans ces préparations militaires. En plus, le KPD a mis sur pied un service de renseignement militaire. Il y a le “M-Apparat”, le “Z-Gruppe” pour infiltrer l'armée du Reich et le “T-Terrorgruppe” dans la police. Des arsenaux secrets sont installés, des cartes militaires de toutes sortes sont collectées.
Les conseillers militaires russes disposent d'un demi-million de fusils. Ils espèrent être capables de mobiliser très rapidement 50 000 à 60 000 hommes de troupe. Cependant l'armée du Reich et les troupes de droite qui la soutiennent représentent avec la police une force 50 fois supérieure aux formations militaires dirigées par le KPD.
En toile de fond de ces préparatifs, l'IC élabore un plan basé sur une frappe militaire stratégique.
Si, dans certaines régions, le KPD se joint au SPD pour former un “gouvernement ouvrier”, en application de la tactique de Front unique, cela ne peut que mettre le feu aux poudres. La Saxe et la Thuringe sont choisies parce que le SPD y est déjà à des postes gouvernementaux et parce que l'armée y dispose de moins d'unités comparé à Berlin et au reste du pays.
L'idée de base est que la formation d'un gouvernement ouvrier SPD-KPD va être perçue comme une provocation par les “forces fascistes” et l'armée. On suppose que les fascistes vont quitter la Bavière et l'Allemagne du sud pour se rendre en Saxe et en Allemagne centrale. En même temps on attend une réaction de l'armée qui devrait mobiliser ses troupes stationnées en Prusse. Cette offensive de la bourgeoisie peut être contrée par la mobilisation d'énormes unités ouvrières armées. Il est même prévu que l'armée et les unités fascistes soient défaites en étant attirées dans un piège près de Kassel. Les Cents Rouges doivent être à la base de la constitution d'une Armée rouge dont les unités de Saxe marcheront sur Berlin et celles de Thuringe sur Munich. Enfin, il est prévu que le gouvernement qui sera mis en place à l'échelle nationale comprendra des communistes, des sociaux-démocrates de gauche, des syndicalistes et des officiers nationaux-bolcheviks.
Une situation cruciale doit donc se mettre en place dès que le KPD aura rejoint le gouvernement de Saxe.
L'insurrection pouvait-elle s'appuyer sur une alliance gouvernementale avec le SPD ?
En août le SPD rejoint le gouvernement national pour calmer la situation et pour barrer la route à un mouvement insurrectionnel en faisant tout un tas de promesses.
Mais alors que, le 26 septembre, le gouvernement annonce officiellement la fin de la “résistance passive” vis à vis de l'occupant français et promet le paiement des arriérés de salaires, le 27 septembre une grève éclate dans la Ruhr. Le 28 septembre le KPD appelle à une grève générale dans tous le pays et à l'armement des ouvriers afin de mettre en place “un gouvernement ouvrier et paysan”. Le 29 septembre l'état d'urgence est déclaré, tandis que le KPD appelle les ouvriers à cesser leur mouvement dès le 1er octobre. Comme dans le passé, son objectif n'est pas tant de chercher à renforcer progressivement la classe ouvrière par la lutte dans les usines que de tout centrer sur un moment décisif qu'il prévoit pour plus tard. Ainsi, au lieu de faire monter la pression à partir des usines, comme l'IC le soulignera plus tard de façon critique, afin de dévoiler le véritable visage du nouveau gouvernement SPD, il tend au contraire à bloquer l'initiative des ouvriers dans les usines. Ainsi la combativité des ouvriers, leur détermination à repousser les attaques du nouveau gouvernement, ne sont pas seulement sapées par les promesses de compromis faites par le SPD, elles le sont également par la politique même du KPD. A son 5e congrès, l'IC conclura : “Après la grève Cuno, l'erreur a été faite de vouloir retarder les mouvements élémentaires jusqu'aux luttes décisives. Une des plus grandes erreurs a été que la rébellion instinctive des masses n'a pas été transformée en une volonté révolutionnaire consciente de combat en s'axant systématiquement sur des buts politiques... Le parti a échoué à poursuivre une agitation énergique, vivante pour la tâche de constituer des conseils politiques. Les revendications transitoires et les luttes partielles devaient être reliées du mieux possible au but final de la dictature du prolétariat. La négligence du mouvement des conseils d'usines a rendu impossible pour les conseils d'usines de prendre temporairement le rôle des conseils ouvriers, ainsi pendant les jours décisifs il n'y a pas eu de centre d'autorité, autour duquel les masses hésitantes d'ouvriers puissent se rassembler, et qui puisse s'opposer à l'influence du SPD.
Puisque les autres organes unitaires (comités d'action, comités de contrôle, comités de lutte) n'étaient pas utilisés de façon systématique, pour préparer la lutte politiquement, la lutte a été vue principalement comme une question de parti et non comme une lutte unitaire du prolétariat.”
En empéchant la classe ouvrière de développer ses luttes défensives sous prétexte qu'elle doit “attendre jusqu'au jour de l'insurrection”, le KPD l'empèche en fait de développer sa propre force face au capital et de gagner à elle les ouvriers encore hésitants du fait de la propagande du SPD. Ainsi l'IC fera plus tard la critique suivante :
“Surestimer les préparatifs techniques pendant les semaines décisives, se polariser sur les actions comme une lutte de parti et attendre le "coup décisif" sans un mouvement de luttes partielles et des mouvements de masse qui les préparent, a empêché l'estimation du véritable rapport de forces et rendu impossible de fixer une date réelle... En réalité il était seulement possible de constater que le parti était dans un processus de gagner la majorité, sans, cependant, avoir véritablement la direction dans la classe.” (Les leçons des évènements d'Allemagne et les tactiques de front unique)
A l'époque, des membres d'une “division noire de l'armée du Reich” (une unité sympathisante des fascistes) organisent une révolte le 1er octobre à Küstrin. Mais leur révolte est écrasée par la police prussienne. L'Etat démocratique n'a manifestement pas encore besoin des fascistes.
Le 9 octobre, Brandler rentre donc de Moscou avec la nouvelle orientation d'une insurrection initiée par l'entrée du KPD dans le gouvernement. Le 10 octobre la formation d'un gouvernement avec le SPD est décidée pour la Saxe et la Thuringe. Trois communistes entrent dans celui de Saxe (Brandler, Heckert, Böttcher), deux dans celui de Thuringe (K.Korsch et A.Tenner).
Alors qu'en janvier 1923 la conférence du parti affirmait : “La participation du KPD dans un gouvernement d'un land, sans poser des conditions au SPD, sans un fort mouvement de masse et sans un soutien extraparlementaire suffisant, ne peut avoir qu'un effet négatif sur l'idée d'un gouvernement ouvrier et avoir un effet destructeur au sein du parti lui-même” (p.255, Document), quelques mois plus tard la direction du KPD est prête à suivre les instructions de l'IC et à entrer dans un gouvernement SPD pratiquement sans poser de condition. Le KPD pense ainsi trouver un levier pour l'insurrection, parce qu'il espère réussir à armer la classe ouvrière quand il sera au gouvernement.
Mais, alors que le parti s'attend à une réaction très violente des fascistes et de l'armée, c'est en fait Ebert, le président du SPD, qui destitue les gouvernements de Saxe et de Thuringe le 14 octobre. Le même jour, il donne l'ordre à l'armée d'occuper la Saxe et la Thuringe.
C'est le “démocratique” président social-démocrate Ebert qui envoie les forces armées contre les gouvernements de Saxe et de Thuringe pourtant “élus démocratiquement”. Une fois encore, c'est le SPD qui, par une politique habile et manoeuvrière, a préparé et assumé la répression des ouvriers pour le compte du capital.
Dans le même temps, les troupes fascistes quittent la Bavière pour la Thuringe. Le KPD riposte en appelant les ouvriers à prendre les armes. Dans la nuit du 19 au 20 octobre, il distribue 150 000 exemplaires d'un tract dans lequel il demande aux membres du parti de se procurer le plus possible d'armes. Il proclame en même temps la grève générale qui doit déclencher l'insurrection.
Chronique d'une défaite annoncée
Pour éviter que ce soit le parti qui prenne la décision d'insurrection et être sûr que ce sera une assemblée générale ouvrière qui le fera, Brandler cherche à convaincre la conférence des ouvriers de Chemnitz de voter la grève. Y sont présents quelques 450 délégués, parmi lesquels 60 sont des délégués officiels du KPD, 7 du SPD et 102 sont des représentants des syndicats.
Afin “d'évaluer l'ambiance”, Brandler suggère à l'assemblée de voter la grève générale. En entendant cette proposition, les représentants des syndicats surtout ainsi que les délégués SPD protestent énergiquement et menacent de quitter la réunion. La question de l'insurrection n'est même pas évoquée. Le ministre SPD qui est présent dans l'assemblée se prononce avec force contre la grève générale. La réunion se soumet ainsi au SPD et aux représentants syndicaux. Même les délégués du KPD se soumettent sans dire un mot. Ainsi la conférence -qui aurait dû, selon le KPD, être l'étincelle du mouvement insurrectionnel en décidant la grève générale- décide de repousser celle-ci.
Cependant Brandler et la direction du KPD restent pleinement convaincus que les délégués dans l'assemblée vont retrouver de l'ardeur en apprenant que l'armée se dirige vers la Saxe et qu'ils vont surement appeler à la lutte du fait du renversement “prévisible” du gouvernement de Berlin. Après avoir fait une analyse erronée du rapport de forces en août, une fois encore le KPD estime mal celui-ci ainsi que l'état d'esprit des ouvriers.
A l'assemblée de Chemnitz qui est voulue par la direction du KPD comme un moment-clé de l'insurrection, la majorité des délégués sont sous l'influence du SPD. Même dans les comités d'usines et dans les assemblées générales le KPD n'a pas la majorité. Au contraire des bolcheviks en 1917, il n'a ni correctement estimé la situation, ni été capable d'influencer le cours des évènements de façon décisive. Pour les bolcheviks la question de l'insurrection ne pouvait être mise à l'ordre du jour que s'ils avaient conquis la majorité des délégués dans les conseils et donc quand le parti pouvait jouer un rôle dirigeant et déterminant.
L'assemblée de Chemnitz se disperse ainsi sans avoir décidé d'une grève et encore moins du déclenchement d'un mouvement insurrectionnel. Après l'issue désastreuse de cette réunion, la direction du parti -pas seulement Brandler mais également les membres de “l'aile gauche” de la Centrale ainsi que tous les camarades étrangers qui étaient présents en Allemagne à l'époque- vote unanimement pour le retrait.
Quand les sections du parti, qui se tiennent prêtes “fusil à la main”, à travers tout le pays, sont informées de cette décision, la déception est énorme.
Bien qu'il existe différentes versions sur ce qui s'est passé à Hambourg, il semble que le message de l'annulation de l'insurrection n'y soit pas arrivé à termps. Convaincus que le plan de l'insurrection se déroulerait suivant les prévisions, les membres du parti se mettent en route sans avoir reçu la confirmation de la direction. Dans la nuit du 22 au 23 octobre, les communistes et les Cents Rouges commencent à mettre en place le plan de l'insurrection à Hambourg et se battent contre la police suivant les instructions préalablement élaborées. Ces combats durent plusieurs jours. Mais la majorité des ouvriers reste passive, alors qu'un grand nombre de membres du SPD se portent volontaires, dans les postes de police, pour combattre contre les insurgés.
Lorsque le 24 octobre le message d'arrêter les combats arrive à Hambourg, une retraite en bon ordre n'est plus possible. La défaite est inévitable.
Le 23 octobre les troupes de l'armée marchent sur la Saxe. Une fois encore, la répression s'abat sur le KPD. Un peu plus tard, le 13 novembre, la Thuringe est occupée également par l'armée. Dans les autres parties du pays, il n'y a pas de réactions significatives des ouvriers. Même à Berlin, où “l'aile gauche” du KPD est majoritaire, quelques centaines d'ouvriers se sont mobilisés pour des manifestations de solidarité. Le parti est déserté par de nombreux éléments déçus.
Les leçons de la défaite
La tentative de l'IC d'organiser une insurrection aventureuse en Allemagne afin de relancer la vague révolutionnaire mondiale et donner une autre tournure à la situation en Russie, a échoué. En 1923 la classe ouvrière en Allemagne se trouve plus isolée qu'au début de la vague révolutionnaire en 1918 et 1919. Qui plus est, la bourgeoisie est beaucoup plus avertie et a déjà resserré les rangs au niveau international contre la classe ouvrière. Il est évident que les conditions pour un soulèvement victorieux en Allemagne même ne sont pas présentes. La combativité qui existe pourtant dans la classe ouvrière est contrée par la bourgeoisie en août 1923. La pression venant des usines, les efforts pour s'unir dans des assemblées générales, tout cela a connu un recul important. “De notre point de vue, le critère de notre influence révolutionnaire était les Soviets... Les soviets offraient le cadre politique de nos activités conspiratrices ; ils étaient aussi des organes de gouvernement après la véritable prise du pouvoir.” (Trotsky, Une contre-révolution ou une révolution peuvent-elles être déterminées à une date fixe ?, 1924) En 1923 en Allemagne, la classe ouvrière n'a pas réussi à constituer des conseils ouvriers qui sont une des conditions premières de la prise du pouvoir.
Les conditions politiques dans la classe comme un tout ne sont pas mûres, mais surtout le KPD se montre incapable de jouer son rôle politique dirigeant. Son orientation politique -l'orientation du national-bolchevisme jusqu'en août, sa politique de front unique et de défense de la démocratie bourgeoise- contribue à développer une grande confusion dans la classe et participe à son désarmement politique. Une insurrection victorieuse ne peut être possible que si la classe ouvrière a une vision claire de ses buts politiques et que si elle a, en son sein, un parti capable de lui montrer clairement la direction à prendre et capable de déterminer le juste moment de l'action. Sans un parti fort et solide, aucune insurrection ne peut être victorieuse, puisque c'est seulement lui qui peut avoir une véritable vision d'ensemble, qui peut correctement estimer le rapport des forces et en tirer les justes implications. Comprendre la stratégie de la classe ennemie, mesurer la température dans la classe, en particulier dans les principaux bataillons, jeter tout son poids dans la bataille dans les moments décisifs, ce sont ces capacités, quand elles sont mises en oeuvre, qui font que le parti est indispensable.
L'IC a surtout insisté sur les préparatifs militaires. Le camarade en charge de ces questions dans le KPD, K.Retzlaw, rapporte dans sa biographie que les conseillers militaires russes discutaient principalement de stratégie militaire pure, sans jamais prendre en compte les larges masses de la classe ouvrière.
Même si l'insurrection a besoin d'un plan militaire précis, il ne s'agit pas d'une simple opération militaire. Les préparatifs militaires ne peuvent être abordés qu'une fois le processus de maturation et de mobilisation politiques de la classe largement entamé. On ne peut pas faire l'économie d'un tel processus.
Cela veut dire que la classe ouvrière ne peut pas négliger de réduire sa pression à partir des usines, comme le KPD le propose en 1923. Alors que les bolcheviks savaient comment appliquer “l'art de l'insurrection” en octobre 1917, le plan de l'insurrection d'octobre 1923 n'est qu'une pure farce qui a débouché sur une tragédie. Les internationalistes, au sein de l'IC non seulement font une estimation erronée de la situation mais s'accrochent à un faux espoir. En septembre, Trotsky lui-même, manifestement mal informé sur la situation, est le plus convaincu que le mouvement est encore montant et il est parmi ceux qui poussent le plus fortement à l'insurrection.
La critique qu'il formulera après les évènements est en grande partie inexacte. Il reproche au KPD d'avoir, en 1921, fait un putsch de façon aventuriste et impatiente, alors qu'en 1923 il serait tombé dans l'autre extrême, celui d'attendre, de négliger son propre rôle. “La maturation de la situation révolutionnaire en Allemagne a été comprise trop tard...; aussi (que) les mesures les plus importantes du combat ont été abordées trop tard. Le Parti communiste ne peut pas, par rapport au mouvement révolutionnaire montant, prendre un position d'attente. C'est l'attitude des mencheviks : agir comme une entrave à la révolution tout au long de son développement, utiliser ses succès, quand c'est une petite victoire, faire tout ce qu'on peut pour s'y opposer.” (Trotsky, Ibid.)
D'un côté il insiste correctement sur le facteur subjectif et sur le fait que l'insurrection a besoin d'une intervention claire, décidée et énergique du parti, malgré toutes les hésitations et les irrésolutions de la classe. De plus, il comprend parfaitement le rôle destructeur des staliniens : “La direction stalinienne... a entravé et freiné les ouvriers, alors que la situation dictait un assaut révolutionnaire courageux, a proclamé des situations révolutionnaires, alors que leur moment était déjà passé, a formé des alliances avec les faiseurs de phrases et les beaux parleurs de la petite-bourgeoisie, a marché sans relâche derrière la social-démocratie sous couvert de la politique de front unique.” (La tragédie du prolétariat allemand, mai 1933)
Mais, d'un autre côté Trotsky lui-même est plus dominé par ses vaines espérances dans la reprise de la vague révolutionnaire que guidé par une analyse correcte du rapport des forces.
La défaite d'octobre 1923 n'est pas seulement une défaite physique des ouvriers allemands. Elle va surtout occasionner une profonde désorientation politique pour la classe ouvrière dans son ensemble.
La vague de luttes révolutionnaires dont le point culminant a été 1918-1919, s'achève en effet en 1923. La bourgeoisie a réussi à infliger, en Allemagne, une défaite décisive à la classe ouvrière.
Les défaites des luttes en Allemagne, en Bulgarie et en Pologne laissent la classe en Russie encore plus isolée. Même s'il y aura encore quelques luttes importantes, parmi lesquelles celles de 1927 en Chine, la classe ouvrière va poursuivre son recul pour enfin connaître une longue et terrible période de contre-révolution qui ne s'achèvera qu'avec la reprise de la lutte de classe en 1968.
L'IC se montre elle-même incapable de tirer les véritables leçons des évènements en Allemagne.
L'incapacité de l'IC et du KPD de tirer les véritables leçons
A son 5e congrès mondial en 1924, l'IC (avec le KPD en son sein) concentre ses critiques principalement sur le fait que le KPD aurait, en 1923, mal appliqué la tactique de front unique et de gouvernement ouvrier.
Cette dernière n'est en aucune manière remise en question. Le KPD affirme même, dédouanant ainsi le SPD de ses responsabilités dans la défaite ouvrière : “On peut dire sans aucune exagération : la social-démocratie allemande actuelle est en réalité seulement un réseau lâche d'organisations aux liens faibles avec des attitudes politiques très différentes.” Il persiste et signe dans sa politique opportuniste et néfaste vis à vis de la social-démocratie traitre : “la pression communiste permanente sur le gouvernement Zeigner (en Saxe) et la fraction de gauche qui s'est formée au sein du SPD va amener le SPD à la dislocation. Le point (principal) est que sous la direction du KPD la pression des masses sur le gouvernement social-démocrate doit être accrue, aiguisée et que le groupe dirigeant social démocrate de gauche qui émerge sous la pression d'un grand mouvement doit être confronté à l'alternative, soit entrer en lutte contre la bourgeoisie avec les communistes, soit se démasquer lui-même et ainsi détruire les dernières illusions des masses social-démocrates d'ouvriers.” (9e congrès du Parti, avril 1924)
Depuis la première guerre mondiale, le SPD est totalement intégré à l'Etat bourgeois. Ce parti, dont les mains sont tâchées du sang des ouvriers dans la 1ère guerre mondiale et de l'écrasement des luttes ouvrières dans la vague révolutionnaires, n'est en aucune manière en train de se disloquer. Au contraire, tout en faisant partie de l'appareil d'Etat, il continue d'exercer une grande influence sur les ouvriers. Même Zinoviev doit le concéder au nom de l'IC : “Un grand nombre d'ouvriers ont encore confiance dans les sociaux-démocrates de 'gauche',... qui en réalité servent de couverture pour la sale politique contre-révolutionnaire de l'aile droite de la social-démocratie.”
L'histoire a montré de façon répétée qu'il n'est pas possible, pour la classe ouvrière, de reconquérir un parti qui a trahi et changé de nature de classe. La politique consistant à vouloir diriger la classe ouvrière avec l'aide du SPD est déjà une expression de la dégénérescence opportuniste de l'IC. Alors que Lénine dans ses fameuses Thèses d'avril de 1917 rejette le soutien au gouvernement Kerensky et revendique la plus claire démarcation vis-à-vis de celui-ci, le KPD, en octobre 1923, rejette toute idée de démarcation avec le gouvernement SPD et finit par y entrer sans aucune condition. Au lieu de permettre une radicalisation du combat, la participation du KPD au gouvernement tend à démobiliser les ouvriers. La frontière de classe qui sépare le KPD du SPD, est gommée. La classe ouvrière est de plus en plus désarmée politiquement et la répression par l'armée est facilitée. Un mouvement insurrectionnel ne peut se développer que si la classe ouvrière parvient à se débarrasser des illusions vis à vis de la démocratie bourgeoise. Et une révolution ne peut vaincre qu'en écrasant les forces politiques qui défendent cette démocratie, c'est à dire le principal barrage.
En 1923, le KPD, non seulement n'a pas combattu la démocratie bourgeoise, il est même allé jusqu'à appeler les ouvriers à se mobiliser pour sa défense.
Concernant le SPD en particulier, le KPD s'est mis en contradiction flagrante avec la position défendue par l'IC, lors de son congrès de fondation, qui avait dénoncé avec la plus grande clarté ce parti comme le boucher de la révolution allemande de 1919.
Par la suite, le KPD ne se contente pas de persister dans l'erreur, il s'affirme comme un champion de l'opportunisme. Parmi tous les partis de l'IC, il devient le plus fidèle laquais du stalinisme. Non seulement il est la force motrice de la tactique de front unique et de “gouvernement ouvrier”, mais il est aussi le premier parti à appliquer la politique des cellules d'usines et de “bolchevisation” prônée par Staline. La défaite de la classe ouvrière en Allemagne a aussi renforcé la position du stalinisme. A la fois en Russie et internationalement la bourgeoisie peut désormais intensifier son offensive et ainsi imposer à la classe ouvrière la pire contre-révolution qu'elle ait eu à subir. Après 1923, l'Etat russe est d'ailleurs reconnu par les autres pays capitalistes et par la Société des Nations.
En 1917, la prise du pouvoir en Russie a constitué le début de la première vague révolutionnaire mondiale. Mais le capital est parvenu à empêcher la victoire de la révolution surtout dans les pays-clés comme l'Allemagne. Les leçons de la conquête victorieuse du pouvoir en Russie en 1917 par le prolétariat, tout comme celles de l'échec de la révolution en Allemagne, en particulier la compréhension de la manière dont la bourgeoisie est parvenue à empêcher une révolution victorieuse en Allemagne et des conséquences que cela a eu sur la dynamique internationale des luttes et sur la dégénérescence de la révolution en Russie, tous ces éléments font partie d'une seule et même expérience historique de la classe ouvrière.
Pour que la prochaine vague révolutionnaire soit possible et pour que la prochaine révolution puisse être un succès, la classe ouvrière doit absolument se réapproprier cette expérience inestimable.
DV.
Géographique:
- Allemagne [98]
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Allemande [1955]
Conscience et organisation:
Approfondir:
- Révolution Allemande [1957]
Heritage de la Gauche Communiste:
- La Révolution prolétarienne [1149]
Polémique avec le BIPR
- 3593 reads
La méthode marxiste et l'appel du CCI sur la guerre en ex-Yougoslavie
Après quelques signes de reconnaissance mutuelle et de débat entre les groupes de la Gauche Communiste au cours de ces dernières années, y compris la tenue d'une réunion publique en commun sur la révolution russe entre le Bureau International pour le Parti Révolutionnaire (BIPR) et le CCI en Grande-Bretagne, la guerre récente engagée par l'OTAN dans les Balkans représentait un test pour juger de la capacité de ces groupes à assumer une défense commune de l'internationalisme prolétarien qui soit la plus large et la plus forte possible. Malheureusement les groupes ont refusé un appel du CCI pour une déclaration commune contre le carnage impérialiste en ex-Yougoslavie. Nous avons déjà dressé un premier bilan des réactions à cet appel dans notre Revue Internationale n°97.
Dans cet article-ci, nous répondrons brièvement à l'idée mise en avant par le BIPR, selon laquelle la méthode politique du CCI supposée “idéaliste” justifiait un tel refus.
“Quand vous écrivez dans votre tract que "c'est parce que, depuis la grève massive de Mai 68 en France, la classe ouvrière mondiale a développé ses luttes en refusant de se soumettre à la logique du capitalisme en crise qu'elle a pu empêcher le déchaînement d'une troisième guerre mondiale", vous montrez que vous restez prisonniers de vos schémas que nous avons déjà caractérisés comme idéalistes et qui sont aujourd'hui particulièrement inaptes aux besoins de clarté et de solidarité théorico-politique nécessaires pour l'intervention dans la classe.” (lettre du BIPR, 8/4/99, traduit par nous de l'anglais)
Il est vrai que l'idéalisme serait une tare profonde pour une organisation révolutionnaire. L'idéalisme est un important, sinon le seul rempart philosophique de l'idéologie bourgeoise. Cherchant la force motrice ultime de l'histoire dans les idées, les morales et les vérités qui sont produites par la conscience humaine, l'idéalisme est une des bases fondamentales des différentes idéologies de la classe dominante qui cherche à cacher son exploitation de la classe ouvrière et à lui dénier toute réelle capacité pour sa libération. La division du monde en classes ainsi que la possibilité et la nécessité de la révolution communiste pour renverser ce monde ne peuvent être comprises que par la conception matérialiste de l'histoire. L'histoire de la pensée s'explique par l'histoire de l'être, et non l'inverse.
L'idéalisme et le cours historique
Mais pourquoi la conception du “cours historique” qui prend position sur le rapport de force entre les classes dans une période historique donnée et qui tire la conclusion que la perspective n'est pas ouverte aujourd'hui à une guerre impérialiste généralisée, mais est toujours ouverte à d'immenses confrontations de classe... est-elle “idéaliste” ? La lettre de la Communist Workers' Organisation (le BIPR en Grande-Bretagne) au CCI, qui refuse la tenue d'une réunion publique commune en Grande-Bretagne sur la guerre, essaie de nous l'expliquer :
“Pour vous, cela peut vous sembler un petit point, mais pour nous cela souligne à quel point vous êtes éloignés de la réalité. Nous sommes absolument atterrés par aussi peu de réponse prolétarienne au tour pris par les événements. 'Socialisme ou barbarie' est un mot d'ordre qui a une signification absolue dans cette crise. Mais comment pouvez-vous maintenir que la classe ouvrière empêche la guerre quand l'évidence de tout ce qui est arrivé en Yougoslavie, montre à quel point les impérialistes (gros et petits) ont les mains libres ? (...) La guerre se déroule maintenant à 800 miles de Londres (à vol d'oiseau). Doit-elle arriver jusqu'à Brighton pour que vous corrigiez vos perspectives ? La guerre est un pas sérieux vers la barbarie générale. Nous ne pouvons lutter ensemble pour une alternative communiste si vous suggérez que la classe ouvrière est une force sur laquelle il faut compter dans la période présente.” (lettre de la CWO, 26/4/99, traduit par nous de l'anglais)
L'idéalisme, notre idéalisme, ne serait donc pas “rattaché à la réalité”, à “l'évidence”; à la réalité telle que la comprend le BIPR. D'abord, l'accusation d'idéalisme, qui est une accusation grave, est difficilement recevable telle que le BIPR la formule puisqu'elle réduit une question historique à un problème de “bon sens commun”.
Pourtant, cette rapide exposition de la version du BIPR de la réalité manque sérieusement de matérialité historique et dépend trop d'un raisonnement de “bon sens” submergé par des faits récents et locaux. Il nous assure que “Socialisme ou barbarie” s'applique absolument à la situation : que les perspectives historiques alternatives des deux principales classes ennemies dans la société sont fondamentalement en jeu dans les Balkans. Et ensuite, il se contredit quelques lignes plus loin quand il défend que le prolétariat, et sa perspective historique, le socialisme, ne comptent plus dans la situation.
Il ne reste que le BIPR, seul dans le monde, pour brandir la bannière de l'alternative communiste. Cette analyse contradictoire de la réalité, de la réalité “immédiate”, “évidente”, n'est pas “dialectique”, comme aime à le penser le BIPR, car elle échoue précisément à voir comment les tendances historiques fondamentales se manifestent dans une situation donnée.
Alors que le CCI a essayé au moins de comprendre le poids historique du prolétariat dans la guerre des Balkans sans minimiser le moins du monde le sérieux de la situation, le BIPR s'exprimant justement sur le terrain de l'empirisme à la Bacon et Locke[1] [3912], estimerait plutôt les événements à partir de leur proximité géographique de Londres ou Brighton. Le prolétariat n'est apparemment pas une “force sur laquelle il faut compter dans la situation présente” car il n'y a pas de faits tangibles pour prouver le contraire, car ce n'est pas confirmé empiriquement, dans la réalité immédiate. Le BIPR n'arrive pas à voir le prolétariat dans la situation historique présente, il ne le sent pas, ne le goûte pas, ni ne l'entend. Donc le prolétariat n'est pas présent. Et quiconque affirme qu'il est une force, aussi limitée soit-elle, qu'il est toujours présent, aussi faible soit cette présence, est un idéaliste.
Les contre-tendances à l'absence apparente du prolétariat –particulièrement le manque d'adhésion à la guerre des classes ouvrières d'Europe Occidentale et d'Amérique du Nord– sont par conséquent ignorées comme facteurs. Les tendances latentes dans les événements qui peuvent être seulement prises comme une marque négative dans la situation, comme des empreintes dans le sable, doivent cependant être prises en compte afin d'être consistant avec la réalité historique la plus large.
La méthode qui ne voit les événements que comme de simples faits sans toutes leurs interrelations historiques n'est matérialiste que dans le sens métaphysique :
“Et quand, grâce à Bacon et à Locke, cette manière de voir passa de la science de la nature à la philosophie, elle produisit l'étroitesse d'esprit spécifique des derniers siècles, le mode de pensée métaphysique.
Pour le métaphysicien, les choses et leurs reflets dans la pensée, les concepts, sont des objets d'étude isolés, à considérer l'un après l'autre et l'un sans l'autre, fixes, rigides, donnés une fois pour toutes. Il ne pense que par antithèses sans moyen terme : il dit oui, oui, non, non ; ce qui va au-delà ne vaut rien. Pour lui, ou bien une chose existe, ou bien elle n'existe pas ; une chose ne peut pas non plus être à la fois elle-même et une autre. Le positif et le négatif s'excluent absolument ; la cause et l'effet s'opposent de façon tout aussi rigide. Si ce mode de pensée nous paraît au premier abord tout à fait plausible, c'est qu'il est celui de ce qu'on appelle le bon sens. Mais si respectable que soit ce compagnon tant qu'il reste cantonné dans le domaine prosaïque de ses quatre murs, le bon sens connaît des aventures tout à fait étonnantes dès qu'il se risque dans le vaste monde de la recherche, et la manière de voir métaphysique, si justifiée et si nécessaire soit-elle dans de vastes domaines dont l'étendue varie selon la nature de l'objet, se heurte toujours, tôt ou tard, à une barrière au-delà de laquelle elle devient étroite, bornée, abstraite, et se perd en contradictions insolubles : la raison en est que, devant les objets singuliers, elle oublie leur enchaînement ; devant leur être, elle oublie leur devenir et leur périr ; devant leur repos, elle oublie leur mouvement ; les arbres l'empêchent de voir la forêt.” (F. Engels, Socialisme utopique et socialisme scientifique, Editions sociales)
L'empirisme –le bon sens commun– assimile le matérialisme historique et sa méthode dialectique à l'idéalisme car le marxisme refuse de considérer les faits sur leur simple apparence.
Le BIPR s'oppose à l'histoire du mouvement révolutionnaire quand il taxe d'idéaliste le “schéma” du cours historique. Le groupe de la fraction de gauche du PC d'Italie qui publiait la revue Bilan dans les années 1930, était-il coupable d'idéalisme quand il développait ce concept pour déterminer si l'histoire allait vers la guerre ou vers la révolution[2] [3913] ? C'est une question à laquelle le BIPR devrait répondre puisque Bilan fait partie intrinsèque de l'histoire de la Gauche Italienne dont il se réclame.
Mais si le BIPR se croit capable d'utiliser le matérialisme historique de manière unilatérale en mettant en avant une supposée vérité évidente des faits, il est aussi coupable d'utiliser des schémas mécaniques pour inventer des faits inexistant. Selon son tract internationaliste contre la guerre en ex-Yougoslavie, il défend que l'objectif principal de l'intervention de l'OTAN était de “s'assurer le contrôle du pétrole du Caucase”. Comment le BIPR a-t-il pu arriver à une telle fantaisie ? En appliquant le schéma selon lequel la principale force motrice derrière l'impérialisme aujourd'hui est la recherche du profit économique “pour s'assurer le contrôle et la gestion du pétrole, de la rente pétrolifère et des marchés financiers ou commerciaux.”
Peut-être est-ce là un schéma matérialiste, mais c'est du matérialisme mécanique. En effet, même si le facteur principal de l'impérialisme moderne reste les contradictions économiques fondamentales du capitalisme, ce schéma ignore les facteurs politiques et stratégiques qui sont devenus prédominant dans le conflit entre les Etats nations.
La méthode marxiste et l'intervention révolutionnaire sur la guerre
Si le BIPR adopte une approche empiriste quand il est confronté à la question du rôle de la classe ouvrière dans tout événement à l'échelle de l'histoire, il montre que sur les questions les plus générales et les plus décisives il est parfaitement capable de voir de façon marxiste ce que le bon sens commun est incapable de faire. Son tract sur la guerre –comme les tracts des autres groupes de la gauche communiste– a révélé que derrière les buts prétendument humanitaires des grandes puissances unies au Kosovo, une confrontation plus large et inévitable avait lieu. Il a montré que les pacifistes et les gauchistes, malgré leurs grandes déclarations contre la violence, entretenaient en réalité les feux de la guerre. Finalement, même s'il ne pouvait voir le prolétariat comme une force dans la situation présente, il affirmait cependant que la lutte de la classe ouvrière menant à la révolution communiste était le seul moyen d'échapper à la barbarie capitaliste croissante.
La position prolétarienne internationaliste sur la guerre impérialiste, commune aux différents groupes de la gauche communiste, partagée par le CCI et le BIPR, est parfaitement marxiste et donc fidèle à la méthode du matérialisme historique.
Donc, au moins sur ce point, l'accusation d'idéalisme contre le CCI s'écroule complètement.
Le problème de l'unité dans l'histoire du mouvement révolutionnaire
Dans sa lettre à Wilhem Bracke en 1875 qui introduit sa Critique au Programme de Gotha du Parti ouvrier social-démocrate d'Allemagne, K.Marx dit que “tout pas fait en avant, toute progression réelle importe plus qu'une douzaine de programmes” (Marx-Engels, éditions sociales). Et cette phrase célèbre constitue un point de référence pour l'action unie des révolutionnaires. C'est une parfaite mise en application de ce que mettaient en évidence les tout aussi célèbres Thèses sur Feuerbach de 1845 qui démontraient que le matérialisme historique n'est pas une nouvelle philosophie contemplative mais une arme de l'action prolétarienne.
“La coïncidence de la modification des circonstances et de l'activité humaine ou autotransformation ne peut être saisie et comprise rationnellement qu'en tant que pratique révolutionnaire” et “les philosophes n'ont fait qu'interpréter diversement le monde, ce qui importe, c'est de le transformer.” (Marx, Thèses sur Feuerbach, éditions sociales)
Dans sa lettre introductive et dans son texte, Marx critique sévèrement le programme d'unité du parti social-démocrate allemand pour les concessions faites aux Lassaliens[3] [3914]. Il estime qu'un “accord pour l'action contre l'ennemi commun” est de la plus haute importance et il suggère qu'il aurait mieux valu repousser la rédaction du programme jusqu'à “une époque où pareils programmes eussent été préparés par une longue activité commune” (Lettre à W. Bracke, éditions sociales). Des divergences extrêmes n'étaient donc pas des obstacles à l'action unie, mais au contraire allaient être confrontées dans ce contexte.
Comme nous l'avons déjà mis en avant dans notre appel, Lénine et les autres représentants de la gauche marxiste appliquèrent la même méthode à la conférence de Zimmerwald, en septembre 1915, au cours de laquelle ils signèrent son retentissant manifeste contre la première guerre impérialiste mondiale. Pourtant ils avaient exprimé des critiques et des désaccords marqués du fait de ses lacunes graves et ils soumirent même au vote leur propre position[4] [3915] qui fut repoussée par la majorité de la conférence.
Le BIPR s'est déjà essayé au travail savant de démonstration qu'un tel exemple historique d'unité des révolutionnaires dans le passé eut lieu dans des circonstances différentes et donc ne peut s'appliquer dans la période présente. En d'autres termes, le BIPR ne veut pas voir les fils qui relient le passé de Zimmerwald au présent. Il n'y voit qu'un épisode fini du passé qui n'est utile qu'à la réflexion des historiens.
Les différentes circonstances dans lesquelles l'unité révolutionnaire a eu lieu dans le passé, au lieu de prouver qu'elle n'est pas applicable au mouvement révolutionnaire actuel, soulignent en fait toute sa validité aujourd'hui.
La chose la plus frappante à propos de la défense par Marx et Lénine du travail commun entre révolutionnaires dans les deux exemples donnés, c'est que les différences entre les Eisenachiens et les Lassaliens dans un cas, et entre la gauche marxiste (en premier lieu les bolcheviks) et les socialistes à Zimmerwald dans l'autre cas, étaient beaucoup plus importantes que les différences entre les groupes de la gauche communiste d'aujourd'hui.
Marx préconisait le travail en commun, dans un même parti, avec une tendance qui défendait “l'Etat libre”, les “droits égaux”, “la juste distribution du produit du travail” et qui parlait de la “loi d'airain des salaires”, et autres préjugés bourgeois. Le Manifeste de Zimmerwald était une opposition commune à la 1re guerre impérialiste mondiale entre les internationalistes intransigeant qui appelaient à la guerre civile contre la guerre impérialiste et à la constitution d'un nouvelle Internationale d'une part, et de l'autre, les pacifistes, les centristes et autres hésitants qui visaient à la réconciliation avec les social-patriotes et contestaient les mots d'ordre révolutionnaires de la gauche. Au contraire, dans le milieu communiste d'aujourd'hui, il n'y a pas de concessions aux illusions démocratiques et humanistes. Il y a une dénonciation commune de la guerre comme guerre impérialiste, une dénonciation commune du pacifisme et du chauvinisme de la gauche et un engagement commun pour la “guerre civile”, c'est à dire pour opposer à la guerre impérialiste la perspective et la nécessité de la révolution prolétarienne.
Lénine signa le Manifeste de Zimmerwald, avec toutes ses insuffisances et inconsistances, afin de faire avancer le mouvement réel. Dans un article écrit directement après la première conférence de Zimmerwald, il dit :
“C'est un fait que ce dernier [le manifeste de la conférence de Zimmerwald] constitue un pas en avant vers la lutte effective contre l'opportunisme, vers la rupture et la scission avec lui. Ce serait du sectarisme que de renoncer à ce pas en avant avec la minorité des Allemands, des Français, des Suédois, des Norvégiens et des Suisses, quand nous conservons l'entière liberté et l'entière possibilité de critiquer l'inconséquence et de chercher à obtenir davantage. Ce serait une mauvaise tactique de guerre que de refuser de marcher avec le mouvement international grandissant de protestation contre le social-chauvinisme, sous prétexte que ce mouvement est trop lent, qu'il fait "seulement" un pas en avant, qu'il est prêt et disposé demain à faire un pas en arrière et à rechercher une conciliation avec l'ancien Bureau socialiste international." (Lénine, "Un premier pas", octobre 1915, Oeuvres complètes)
Karl Radek arriva à la même conclusion dans un autre article sur cette conférence :
“...la gauche a décidé de voter le manifeste pour les raisons suivantes. Il serait doctrinaire et sectaire de nous séparer des forces qui ont commencé, dans une certaine mesure, à lutter contre le social-patriotisme dans leur propre pays alors qu'ils font face à de furieuses attaques de la part des social-patriotes” (La gauche de Zimmerwald, traduit par nous de l'anglais).
Il ne fait aucun doute que les révolutionnaires d'aujourd'hui doivent agir contre le développement de la guerre impérialiste avec la même méthode que Lénine et la gauche à Zimmerwald contre la 1re guerre mondiale. L'avancée du mouvement révolutionnaire comme un tout est la priorité centrale. La différence principale entre les circonstances d'alors et celles d'aujourd'hui souligne la beaucoup plus grande convergence politique entre les groupes internationalistes actuels qu'entre la gauche et le centre de Zimmerwald[5] [3916], et par conséquent la beaucoup plus grande nécessité et justification pour une action commune.
Une déclaration internationaliste commune et d'autres expressions d'activité unie contre la guerre de l'OTAN auraient, bien sûr, augmenté énormément la présence politique de la gauche communiste en comparaison avec l'impact des différents groupes pris séparément. Cela aurait été un antidote matériel, réel contre les divisions nationalistes imposées par la bourgeoisie. L'intention commune de faire avancer le mouvement réel aurait créé un pôle d'attraction plus fort pour les éléments en recherche des positions communistes qui sont actuellement déboussolés par la dispersion déconcertante des différents groupes. Et la réunion des forces aurait eu un impact plus large sur la classe ouvrière comme un tout. Par dessus tout, cela aurait marqué un point de référence historique pour les révolutionnaires dans le futur, comme le fit tout aussi sûrement le Manifeste de Zimmerwald qui lança un signal d'espoir pour les futurs révolutionnaires jusque dans les tranchées. Comment peut-on caractériser la méthode politique qui consiste à refuser une telle action commune ? La réponse nous est donnée par Lénine et Radek : elle est doctrinaire et sectaire[6] [3917].
Si nous nous sommes limités à deux exemples historiques, c'est pour des raisons d'espace, non par manque d'exemples d'action commune entre les révolutionnaires du passé. Les 1re, 2e et 3e Internationales ont toutes été formées avec la participation d'éléments qui n'acceptaient même pas les prémisses principaux du marxisme, tels que les anarchistes dans la 1re, ou les anarcho-syndicalistes français et espagnols qui défendaient l'internationalisme et la révolution Russe et qui furent donc les bienvenus dans l'IC.
Nous ne devons pas non plus oublier que le spartakiste Karl Liebknecht, reconnu par toute la gauche marxiste comme le défenseur le plus héroïque du prolétariat dans la première guerre mondiale, était lui un idéaliste dans le vrai sens du terme puisqu'il rejetait la méthode matérialiste dialectique en faveur du Kantisme.
La méthode de confrontation des positions dans le mouvement révolutionnaire
La plupart des groupes d'aujourd'hui imaginent qu'en s'unissant même pour une activité minime, ils vont embrouiller ou diluer les divergences importantes qu'ils ont avec les autres groupes. Rien n'est plus faux. Après la formation du parti social-démocrate allemand et après Zimmerwald, il n'y eut aucune dilution opportuniste des différences qui existaient entre les différents participants mais, à l'inverse, un aiguisement de celles-ci et en fin de compte une confirmation dans la pratique des positions les plus claires. Les marxistes finirent par dominer complètement dans le parti allemand et, après 1875, sur les Lassaliens dans la seconde Internationale. Après Zimmerwald, les positions intransigeantes de la gauche, qui était en minorité, ont pris complètement le dessus notamment quand la vague révolutionnaire, ayant commencé en Russie en 1917, confirma leur politique dans le cours même des événements, alors que par ailleurs les centristes retombèrent dans les bras des social-patriotes.
S'ils n'avaient pas mis leurs positions à l'épreuve dans le cadre d'une action commune même limitée, leur succès futur n'aurait pas été possible. L'Internationale Communiste est en effet redevable à la gauche de Zimmerwald.[7] [3918]
Ces exemples de l'histoire du mouvement révolutionnaire confirme aussi une autre thèse bien connue sur Feuerbach :
“La question de l'attribution à la pensée humaine d'une vérité objective n'est pas une question de théorie, mais une question pratique. C'est dans la pratique que l'homme a à faire la preuve de la vérité, c'est à dire de la réalité et de la puissance de sa pensée, la preuve qu'elle est de ce monde. Le débat sur la réalité ou l'irréalité de la pensée isolée de la pratique est une question purement scolastique.” (Editions sociales, souligné par Marx lui-même)
Les groupes de la gauche communiste qui rejettent un cadre pratique pour leur mouvement commun au sein duquel leurs divergences pourraient être confrontées, tendent à réduire leur différents sur la théorie marxiste à un niveau scolastique. Même si ces groupes ont la volonté de prouver la validité de leurs positions dans la pratique au sein de la lutte de classe la plus large, cet objectif restera un espoir vain s'ils ne peuvent mettre leur propre maison en ordre et vérifier leurs positions en lien pratique avec les autres tendances internationalistes.
La reconnaissance d'un minimum d'activité commune est la base sur laquelle les divergences peuvent être posées clairement, être confrontées, testées et clarifiées pour ces éléments qui émergent des rangs du prolétariat, particulièrement dans les pays où la gauche communiste n'a pas encore de présence organisée. Malheureusement c'est ce que les groupes communistes d'aujourd'hui se refusent à comprendre. Les groupes du courant bordiguistes défendent le sectarisme comme un principe. Sans aller jusque là, le BIPR tend à rejeter toutes confrontations sérieuses des positions politiques. : “Nous critiquons le CCI (...) parce qu'il attend que ce qu'il appelle le milieu politique prolétarien reprenne et débatte de ses préoccupations politiques de plus en plus bizarres”[8] [3919] (traduit par nous de l'anglais), dit-il dans Internationalist Communist n°17, la revue du BIPR, qui est en partie consacrée à la mise en avant de ses divergences avec le CCI, en réponse à des éléments en recherche en Russie et ailleurs; éléments qui s'interrogent sur cette question de la responsabilité des internationalistes et de leur action commune face à la guerre impérialiste. Il est particulièrement désolant de constater que le milieu internationaliste repousse tout débat sérieux par peur de la confrontation de positions divergentes. Le mouvement révolutionnaire d'aujourd'hui a besoin de retrouver la confiance que les marxistes du passé avaient dans leurs idées et positions politiques
L'accusation selon laquelle le CCI est idéaliste ne tient pas debout. Nous attendons, pour le moins, des critiques plus solides et plus développées pour soutenir cette affirmation.
Face à la situation internationale qui empire et face aux exigences croissantes devant lesquelles se trouve la classe ouvrière, il devrait être clair que la méthode matérialiste du mouvement révolutionnaire marxiste exige une réponse commune. La gauche communiste n'a pas été au niveau de toutes ses responsabilités lors de la guerre du Kosovo. Mais les événements à venir la forceront à les mettre au centre de ses préoccupations.
Como
[1] [3920] Francis Bacon (1561-1626) et John Locke (1632-1704) sont deux philosophes matérialistes anglais.
[2] [3921] Dans un article au titre explicite, la course vers la guerre, voilà comme Bilan dans son n° 29 de mars 1936 pose le problème du cours historique : “Les tenants des gouvernements actuels (...) ont droit à la reconnaissance éternelle du régime capitaliste pour avoir conduit à son terme extrême l'oeuvre d'écrasement du prolétariat mondial. Seulement en arrivant à égorger la seule force capable de créer une nouvelle société, ils ont aussi ouvert la porte à l'inévitabilité de la guerre, terme extrême des contradictions internes du régime capitaliste. (...) Pour quand la guerre ? Personne ne saurait le prédire. Ce qui est certain, c'est que tout est prêt.” Et un autre article du même numéro revient sur la question en précisant les conditions du cours à la guerre impérialiste qui s'affirme alors : “Nous sommes tout à fait convaincus qu'avec la politique de trahison socialo-centriste qui a conduit le prolétariat à son impuissance de classe dans les pays “démocratiques”; qu'avec le fascisme qui est arrivé par la terreur aux mêmes résultats, on a jeté les prémisses indispensables pour le déclenchement du nouveau carnage mondial. La trajectoire de dégénérescence de l'URSS et de l'IC représente un des symptômes les plus alarmants de la course vers le précipice de la guerre.”.
En passant, il est intéressant de rappeler, ou d'informer, au BIPR et aux groupes bordiguistes quelle est la perspective d'action que propose Bilan aux différentes forces qui sont restées communistes : “La seule réponse que ces communistes pourraient opposer aux événements que nous venons de vivre, la seule manifestation politique qui pourra être un jalon dans la voie de la victoire de demain, ce serait une Conférence Internationale qui relie les pauvres membranes qui restent aujourd'hui du cerveau de la classe ouvrière mondiale”. Notre souci de déterminer quel est le cours historique, et notre appel à une défense commune de l'internationalisme, sont dans le droit fil de la tradition de la gauche italienne, n'en déplaise à nos ignorants.
[3] [3922] Le Parti Social Démocrate d'Allemagne s'est constitué à partir de l'unification de deux grands courants, l'un petit-bourgeois, les Lassaliens du nom de leur dirigeant, Lassalle, l'autre marxiste, les Eisenachiens du nom de la ville où se constitua cette tendance en Parti Ouvrier Social Démocrate d'Allemagne en 1869.
[4] [3923] Nous avons souligné la validité de la politique unitaire de la Gauche de Zimmerwald pour le camp internationaliste aujourd'hui dans la Revue Internationale n° 44 en 1986.
[5] [3924] En fait, on peut même affirmer que les différences au sein même de la gauche de Zimmerwald étaient plus grandes que celles au sein du camp internationaliste actuel. En particulier, il y avait alors d'importantes divisions pour savoir si la libération nationale était encore possible et, donc, si le mot d'ordre “le droit des nations à l'auto-détermination” faisait toujours partie de la politique marxiste. Les positions tranchées et opposées entre Lénine d'un côté, et Trotsky et Radek de l'autre, sur le soulévement de Pâques 1916 à Dublin, révèla au grand jour et de manière aigue les divisions au sein de la gauche de Zimmerwald. Au sein du Parti Bolchévik lui-même, des différences significatives existaient dans cette période sur l'auto-détermination nationale avec Boukharine et Piatakov qui défendaient son obsolescence, et sur la validité des mots d'ordre de “défaitisme révolutionnaire” et “d'Etat-Unis d'Europe”.
[6] [3925] La politique de Lénine d'unité internationaliste n'était pas limitée au mouvement de Zimmerwald. Il l'appliqua aussi au sein de la social-démocratie russe en encourageant le travail en commun avec un groupe non-bolchévik comme celui de Trotsky, Naché Slovo. Si ces efforts ne furent pas couronnés de succès – jusqu'à la révolution russe – ce fut du fait des hésitations et du sectarisme de Trotsky à l'époque.
[7] [3926] “Les conférences de Zimmerwald et de Kienthal eurent leur importance à une époque où il était nécessaire d'unir tous les éléments prolétariens disposés sous une forme ou une autre à protester contre la boucherie impérialiste (...). Le groupement de Zimmerwald a fait son temps. Tout ce qu'il y avait dans le groupement de Zimmerwald de véritablement révolutionnaire passe et adhère à l'Internationale Communiste” (Déclaration faite par les participants de la conférence de Zimmerwald au Congrès de l'IC, textes complets des 4 premiers congrès mondiaux de l'IC). Cette déclaration est signée par Rakovsky, Lénine, Zinoviev, Trotsky, Platten.
[8] [3927] “We criticise the ICC (...) for expecting what they call the "proletarian political milieu" to take up and debate their increasingly outlandish political concerns”.
Courants politiques:
- TCI / BIPR [137]
Approfondir:
Questions théoriques:
- Guerre [129]